Évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
Formats substituts

Évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants [PDF - 2.9 Mo]
Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.
Liste des tableaux
- Tableau 1. Renseignements sur les dépenses annuelles réelles et prévues du volet 1 du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
- Tableau 2. Renseignements sur les dépenses annuelles réelles et prévues du volet 2 du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
- Tableau 3. Nombre et proportion de participants uniques par province, de 2012 à 2021
- Tableau 4. Proportion de participants au programme Passeport pour ma réussite par sous-population et par région, de 2012 à 2021
- Tableau 5. Nombre de projets et de recherches réalisés dans le cadre du Fonds d’innovation en 2020 2021
Liste des graphiques
- Graphique 1 : Structure du Programme-cadre de soutien à l’apprentissage des étudiants
- Graphique 2 : Répercussions possibles de l’absence de diplôme d’études secondaires
- Graphique 3 : Principaux obstacles auxquels les jeunes sont confrontés entravant la poursuite de leurs objectifs scolaires
- Graphique 4 : Les principaux défis auxquels sont confrontés les étudiants issus de ménages à faible revenu dans le cadre de votre projet visant à les aider à atteindre leurs objectifs scolaires
- Graphique 5 : Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans titulaire d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon le statut autochtone
- Graphique 6 : Proportion de personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans titulaires d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon gravité (en 2017)
- Graphique 7 : Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire, selon le statut d’immigration, en 2021
- Graphique 8 : Proportion de personnes âgées de 25 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire, selon l’origine ethnique, en 2021
- Graphique 9 : Proportion de membres de minorités visibles et de personnes n’appartenant pas à une minorité visible, âgés de 25 à 64 ans, titulaires d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon le statut d’immigrant, en 2021
- Graphique 10 : Proportion d’étudiants âgés de 25 à 64 ans ayant obtenu un certificat ou un diplôme postsecondaire entre 2015 et 2018, selon leur identité de genre
- Graphique 11 : Mesure dans laquelle le(s) projet(s) du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants aide(nt) les étudiants à surmonter diverses difficultés
- Graphique 12 : Avantages des partenariats avec les organisations financées par le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
- Graphique 13 : Pays dans lesquels les établissements postsecondaires canadiens ont établi des partenariats dans le cadre du programme Expérience compétences mondiales
Liste des acronymes
- EDSC
- Emploi et Développement social Canada
- PSAE ou “Le Programme”
- Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
- OCDE
- Organisation de coopération et de développement économiques
Sommaire
Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (ci-après dénommé « le Programme ») finance un large éventail d’organisations au service des jeunes. Ces organisations offrent des mesures de soutien à l’apprentissage adaptées, financières et non financières. Deux grands volets de financement soutiennent les apprenants à risque d’abandonner les études :
Le volet 1 - Financement de mesures de soutien parascolaires et intégrées – soutient les organisations au service des jeunes. Ces organisations aident les étudiants mal desservis à réussir à l’école, à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et le marché du travail. Elles offrent des mesures de soutien parascolaires, intégrées et adaptées, notamment le tutorat, le mentorat ou l’encadrement, le soutien en matière de santé mentale, de toxicomanie et de bien-être, l’accès aux technologies de littératie numérique et d’apprentissage, le perfectionnement professionnel et perfectionnement de compétences de base et d’autres mesures intégrées pour aider la famille de l’étudiant à accéder plus facilement aux services visant à satisfaire les besoins fondamentaux.
Le volet 1 est composé de 3 composantes principales :
- Passeport pour ma réussite;
- Indspire;
- les accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.
Le volet 2 – Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger - soutient 2 associations nationales d’établissements d’enseignement postsecondaire. Ces associations collaborent avec les établissements d’enseignement postsecondaire pour offrir aux étudiants la possibilité d’étudier et de travailler à l’étranger.
Bien que la Direction d’évaluation évalue ce programme-cadre pour la première fois, elle s’appuie sur l’« évaluation de Passeport pour ma réussite » (EDSC, 2019). Les conclusions de cette évaluation portent sur la période allant de l’exercices 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022. Au cours de cette période, le Programme a accordé des subventions et contributions s’élevant à 150,1 millions de dollars pour le volet 1 et 18,2 millions de dollars pour le volet 2.
Principales constatations concernant le volet 1 – Mesures de soutien parascolaires et intégrées
Le Canada a un taux élevé de réussite au niveau postsecondaire par rapport à d’autres pays développés. Cependant, certaines communautés au Canada se heurtent à des obstacles supplémentaires, sont mal desservies ou sont sous-représentées dans l’enseignement postsecondaire. Cette situation a de nombreuses conséquences pour les étudiants de ces communautés et pour le Canada.
Passeport pour ma réussite : Entre avril 2019 et mars 2022, le programme Passeport pour ma réussite a aidé entre 6 209 et 6 512 étudiants par an.
Passeport pour ma réussite a eu un effet positif sur l’obtention du diplôme d’études secondaires et sur l’inscription dans un programme d’enseignement postsecondaire. Il a également eu un effet positif sur la préparation à l’emploi et les résultats sur le marché du travail. En fait, le taux d’obtention de diplôme d’études secondaires est en moyenne 22,2 % plus élevé pour les participants des sites de l’Ontario et 37,6 % plus élevé pour les participants du Québec comparativement aux non-participants. De plus, de 2019 à 2021, entre 68 % et 74 % des participants au programme Passeport pour ma réussite sont passés aux études ou à la formation postsecondaires, selon les sites.
Indspire a octroyé 12 839 bourses d’études au cours des exercices 2020 à 2021 et 2021 à 2022. Cela représente un total d’environ 43 millions de dollars versés aux jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Les participants à Indspire ont un taux d’obtention du diplôme postsecondaire plus élevé que les autres étudiants autochtones.
Les trois-quarts (75 %) des bénéficiaires de bourses octroyées par Indspire ont terminé leurs études postsecondaires dans le temps prévu et 88,4 % ont obtenu leur diplôme dans les 4 ans suivant la date prévue.
Accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants :
De l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022, environ 34 648 étudiants ont bénéficié d’un soutien parascolaire et intégré dans le cadre des accords du programme Droit au but. Au cours de la même période, 16 505 étudiants ont bénéficié d’un soutien similaire dans le cadre des mesures d’urgence relatives à la COVID‑19.
Compte tenu du caractère récent des projets évalués, les données disponibles sont limitées sur le profil démographique des participants aux projets (contrairement au programme Passeport pour ma réussite et Indspire). En effet, au cours de la période d’évaluation, les données sur les résultats des projets étaient limitées parce que la plupart des projets étaient encore en cours (notamment les accords du programme Droit au but et les mesures d’urgence relatives à la COVID 19). Étant donné que la plupart des projets menés dans le cadre des accords du Programme sont relativement récents, il est trop tôt pour examiner les résultats obtenus chez les jeunes, compte tenu des preuves disponibles.
Les organisations financées déterminent et diffusent des pratiques innovantes pour soutenir les étudiants mal desservis. Elles développent aussi des partenariats et des réseaux avec d’autres organisations au service des jeunes. Ces petites organisations ont accès à des mesures de soutien financières et non financières pour aider plus efficacement les étudiants mal desservis.
Les nouveaux accords, financés dans le cadre de l’appel de propositions de 2021, fournissent moins de prévisibilité pour les prestataires de services en raison du financement à court terme. Les accords de 1 an, combinés à des retards quant aux décisions de financement et à l’attribution des fonds, ont rendu difficile la mise en œuvre de mesures de soutien adaptées pour lutter contre les obstacles systémiques.
Principales constatations concernant le volet 2 – Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger
Les étudiants qui souhaitent participer à des possibilités à l’étranger en retirent des avantages. Cela profite également au Canada. Pourtant, les étudiants se heurtent à des obstacles financiers et non financiers qui les empêchent d’étudier et de travailler à l’étranger. Certains étudiants sont confrontés à davantage d’obstacles, en particulier ceux-ci :
- les étudiants qui souhaitent étudier ou travailler dans des pays non traditionnels (par exemple des pays autres que les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie et la France);
- les étudiants sous-représentés (par exemple les étudiants issus de familles à faible revenu, les étudiants autochtones et les étudiants handicapés).
Les établissements d’enseignement postsecondaire financés ont contribué à l’élaboration de leçons apprises et de pratiques prometteuses. Il s’agit notamment de recherches sur l’atténuation des obstacles et sur les mesures de soutien intégrées permettant aux étudiants de participer à des possibilités à l’étranger.
En 2020‑2021, environ 13 600 étudiants canadiens ont directement tiré profit de ces activités. En outre, les projets financés ont permis de développer des partenariats avec des établissements d’enseignement postsecondaire dans près de 50 pays.
Recommandations
- Continuer à recueillir des données pour comprendre les caractéristiques, les défis et les pratiques prometteuses et tenir compte des besoins émergents et de mieux soutenir les étudiants mal desservis ou sous-représentés dans l’enseignement postsecondaire.
- Examiner des possibilités d’améliorer la durabilité des projets au-delà du financement du Programme en favorisant le développement de partenariats et en renforçant le rôle du Programme dans l’élaboration et la diffusion de leçons apprises et de pratiques prometteuses auprès de toutes les organisations au service de la jeunesse.
- Continuer à améliorer et à renforcer la stratégie de collecte de données afin d’optimiser les résultats et de soutenir la prise de décision, y compris en explorant les moyens d’optimiser l’impact du Programme.
Réponse et plan d’action de la direction
Réponse globale de la direction
La direction accepte les recommandations formulées dans l’évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants et utilisera les constatations pour orienter le travail en cours et la recommandation stratégique sur l’avenir du Programme après 2025. Le Programme est relativement nouveau, il est donc important de noter que, au moment de l’évaluation, certains travaux étaient en cours pour traiter bon nombre d’aspects qui ont été relevés dans le rapport d’évaluation. Par exemple, renforcer et uniformiser la collecte de données auprès des bénéficiaires du financement, aider les responsables du Programme à mieux comprendre les obstacles auxquels les étudiants se heurtent et élaborer un cadre de mesure de l’incidence du Programme.
Les objectifs de l’évaluation formative étaient d’examiner la pertinence et la conception du Programme ainsi que l’efficacité de ce dernier au chapitre de l’atteinte des objectifs et résultats escomptés entre avril 2019 et mars 2022. L’évaluation du Programme au cours de cette période s’est avérée difficile, car, comme indiqué précédemment, le Programme était nouveau et les diverses initiatives financées se trouvaient à différents stades de mise en œuvre. En outre, bien qu’il y ait eu une injection importante de nouveaux fonds sur une courte période pour un projet pilote du Programme, d’importants problèmes de mise en œuvre ont entraîné la signature d’accords au-delà de la période visée par l’évaluation. La prolongation de 2 ans du projet pilote annoncé dans l’énoncé économique de l’automne 2022 a permis au Ministère de se concentrer sur un grand nombre d’éléments essentiels répertoriés dans l’évaluation, à savoir la diffusion des connaissances et la collecte de données. On a accordé moins d’importance à ces activités, car il fallait se pencher en priorité sur le renouvellement du Programme en raison de la brièveté des cycles de financement.
Cette évaluation s’appuie sur l’évaluation du programme Passeport pour ma réussite de 2019, mais il s’agit de la première évaluation du Programme-cadre. Dans l’ensemble, s’assurer que les étudiants disposent des mesures de soutien dont ils ont besoin dans le cadre de leurs études afin de favoriser leur réussite future est une priorité pour le Programme. Comme on le mentionne dans l’évaluation, même si le Canada a un taux de réussite élevé en matière d’études postsecondaires par rapport à d’autres pays similaires, certains étudiants ont encore besoin d’un soutien supplémentaire dans le système scolaire ou en dehors de celui-ci pour réussir. Compte tenu des conséquences négatives pour les personnes et pour la société dans son ensemble associées à l’abandon scolaire, le Programme est essentiel, car il offre un soutien adapté en dehors du système scolaire et tout au long du parcours d’apprentissage de l’étudiant. Grâce au financement du Programme, diverses organisations nationales ou régionales ou locales ont été bien placées pour offrir un soutien aux étudiants ou aux organisations éducatives et continuent de l’être.
Recommandation numéro 1
Continuer à recueillir des données pour comprendre les caractéristiques, les défis et les pratiques prometteuses et tenir compte des besoins émergents et de mieux soutenir les étudiants mal desservis ou sous-représentés dans l’enseignement postsecondaire.
Réponse
La direction accepte cette recommandation. Des efforts considérables étaient déjà en cours pendant la période d’évaluation et à la suite de celle-ci, afin de garantir que les interventions du Programme aident le plus efficacement possible les jeunes qui ont les besoins les plus importants.
Plan d’action de la direction
Discuter avec des experts de premier plan des obstacles à la réussite scolaire des groupes ciblés et utiliser les constatations des sources de données existantes pour orienter la conception et la mise en œuvre des programmes. À compléter par l’été 2023 et en continu.
Mettre en œuvre un plan d’action de la stratégie d’impact pour la mise en place de mesures à court, moyen et long terme, sur la base des recommandations d’un cabinet d’experts. À compléter par l’automne 2023.
Évaluer l’impact d’Expérience compétences mondiales sur l’acquisition de compétences de base au moyen d’une évaluation externe du programme et de recherches. Poursuivre la collecte de données et d’éléments probants pour soutenir la mise en œuvre d’Expérience compétences mondiales. À compléter par l’automne 2023 et en continu.
Réviser le profil d’information sur le rendement pour tenir compte des changements récents apportés au programme-cadre (c’est-à-dire 2 volets) et délimiter les résultats associés et la mesure de l’impact. À compléter par l’automne 2023.
Recommandation numéro 2
Examiner des possibilités d’améliorer la durabilité des projets au-delà du financement du Programme en favorisant le développement de partenariats et en renforçant le rôle du Programme dans l’élaboration et la diffusion de leçons apprises et de pratiques prometteuses auprès de toutes les organisations au service de la jeunesse.
Réponse
La direction accepte cette recommandation. Le Programme examine de nouvelles stratégies afin de prendre appui sur les pratiques prometteuses mises en œuvre à ce jour et d’accroître la capacité des organisations au service des jeunes à mieux cibler les étudiants en quête d’équité en leur apportant un soutien global et efficace.
Plan d’action de la direction
Le Programme préparera une stratégie de mobilisation renforcée pour établir des partenariats plus solides avec les organisations financées et améliorera les processus du Programme pour ce qui est de la collecte et de la diffusion des éléments probants, y compris les leçons apprises découlant des projets financés. À compléter par l’automne 2023.
Accroître la visibilité du Programme en augmentant la participation de la direction à la mise en œuvre des projets financés, par des visites sur le terrain et la participation à des événements clés organisés par les bénéficiaires du financement. En continu.
Recommandation numéro 3
Continuer à améliorer et à renforcer la stratégie de collecte de données afin d’optimiser les résultats et de soutenir une meilleure prise de décision, y compris en explorant les moyens d’optimiser l’impact du Programme.
Réponse
La direction accepte cette recommandation. Au cours de la période d’évaluation, le Programme menait déjà des efforts pour renforcer la capacité du programme à produire des résultats et un impact et continue de le faire depuis. Le Programme continuera à explorer de nouvelles méthodes de collecte de données dans le respect des objectifs stratégiques, des principes de protection des renseignements personnels et des limites juridictionnelles.
Plan d’action de la direction
Normaliser la collecte de données auprès des organisations financées et mettre en place une structure de rapport modernisée, en se concentrant sur l’examen des résultats propres à chaque projet. À compléter par l’été 2023 et en continu.
Lancer un projet pilote d’enquête auprès des étudiants bénéficiant d’un soutien dans le cadre de projets financés par le Programme, afin de mieux comprendre l’impact du Programme. En continu.
Poursuivre avec les secteurs d’activité compris dans le Plan d’action de la stratégie d’impact (sensibilisation internationale des pays pairs, exploitation des données administratives d’EDSC). En continu.
1. Introduction
Ce rapport présente les constatations de l’évaluation formative du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (ci-après « le Programme »), qui est un programme-cadre de subventions et de contributions. Il vise à aider les étudiants mal desservis à terminer leurs études secondaires, à faire la transition vers les études postsecondaires et à les réussir. Il s’appuie sur les mesures de soutien de base offertes par Passeport pour ma réussite Canada. EDSC a déjà évaluée cette entente en 2019.
Les objectifs de cette évaluation sont d’examiner la pertinence et la conception du Programme ainsi que l’efficacité de ce dernier au chapitre de l’atteinte des objectifs et résultats escomptés. L’évaluation couvre la période allant de l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022. La Direction de l’évaluation a effectué l’évaluation conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Politique sur les résultats. La Direction de l’évaluation a défini la portée de l’évaluation, les questions et les sources de données en consultation avec la Direction générale de l’apprentissage et la Direction générale des opérations de programmes d’EDSC.
2. Contexte
2.1 Objectifs du programme
Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants finance un large éventail d’organisations au service des jeunes pour fournir une gamme de mesures ciblées en matière d’apprentissage, non financières et financières. Deux volets de financement principaux appuient les étudiants qui risquent d’abandonner les étudesNotes de bas de page 1.
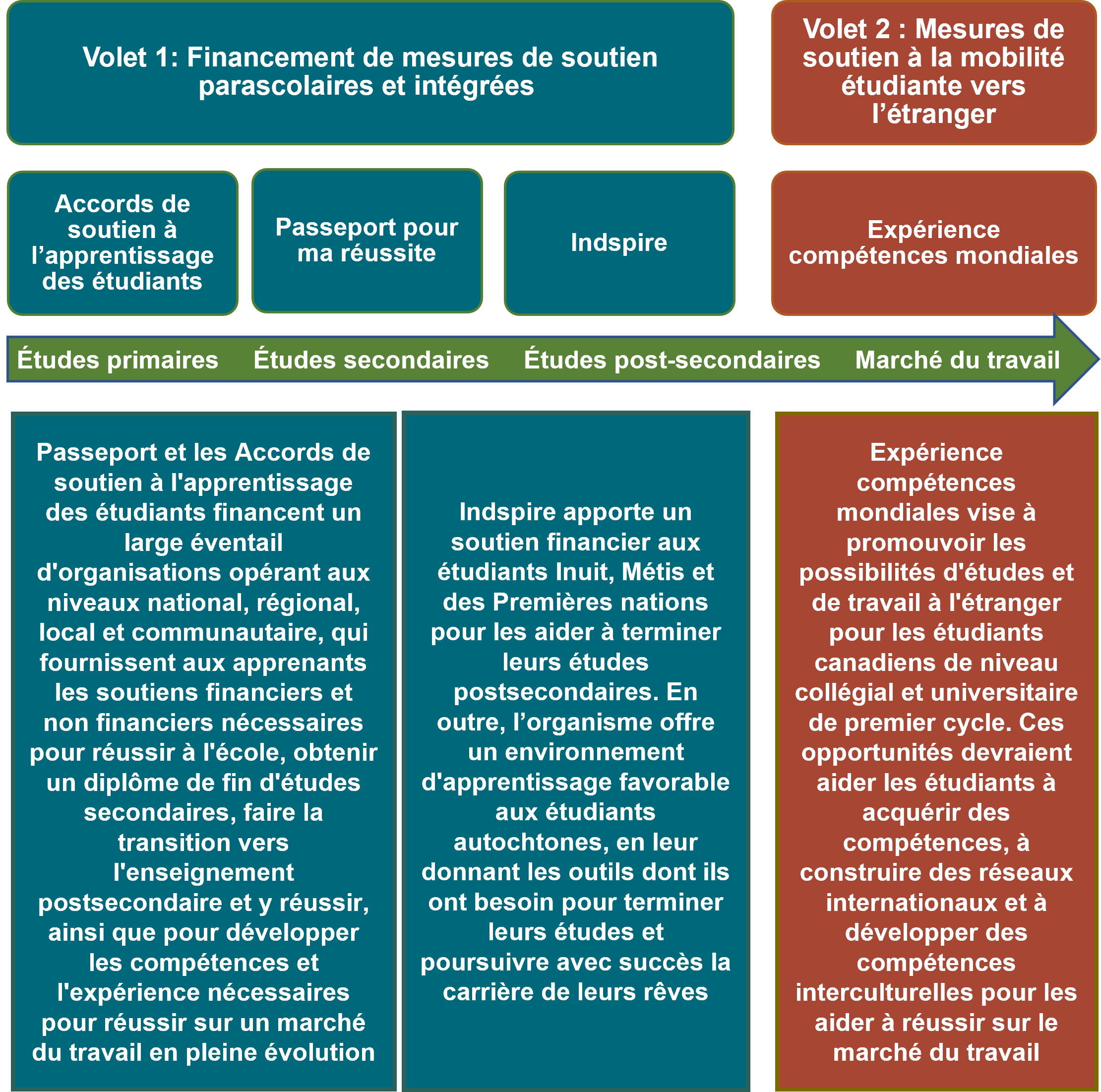
Description textuelle – Graphique 1
Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants est composé de 2 volets. Il comprend tout d’abord le volet 1 : Financement de mesures de soutien parascolaires et intégrées. Ce volet comprend les accords suivants :
- accord dans le cadre de Passeport pour ma réussite Canada (ou « Passeport »);
- accord dans le cadre d’Indspire;
- accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (y compris les accords établis pour le programme Droit au but).
Les accords de Passeport et Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants financent un large éventail d’organisations opérant aux niveaux national, régional, local et local et fournissant aux apprenants les soutiens financiers et non financiers nécessaires pour réussir à l’école, obtenir un diplôme d’études secondaires, faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et y réussir, ainsi que pour acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour réussir sur un marché du travail en pleine évolution.
Indspire apporte un soutien financier aux étudiants Inuit, Métis et des Premières nations de tout le Canada pour les aider à terminer leurs études postsecondaires. En outre, il offre un environnement d’apprentissage favorable aux étudiants autochtones, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour terminer leurs études et poursuivre avec succès la carrière de leurs rêves.
Le volet 2 - Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger (que l’on appelle également Expérience compétences mondiales) – vise à promouvoir les possibilités d’études et de travail à l’étranger pour les étudiants canadiens de niveau collégial et universitaire de premier cycle. Ces opportunités devraient aider les étudiants à acquérir des compétences, à construire des réseaux internationaux et à développer des compétences interculturelles pour les aider à réussir sur le marché du travail.
Le volet 1 – Mesures de soutien parascolaires et intégrées – fournit un financement aux organisations au service des jeunes. Ces organisations proposent diverses mesures parascolaires et intégrées pour aider les étudiants mal desservisNotes de bas de page 2 à réussir à l’école et à obtenir leur diplôme d’études secondaires. L’objectif du Programme est d’aider les étudiants à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et le marché du travail. Ce volet est composé de 3 éléments principaux, à savoir :
- accord dans le cadre de Passeport pour ma réussite Canada (ou « Passeport »);
- accord dans le cadre d’Indspire;
- accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (y compris les accords établis pour le programme Droit au but).
Le volet 2 - Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger (que l’on appelle également Expérience compétences mondiales) – octroie des fonds à Universités Canada et à Collèges et instituts Canada. Ces 2 organisations collaborent avec les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens pour offrir aux étudiants la possibilité d’étudier et de travailler à l’étranger. Ce volet est destiné aux étudiants sous-représentésNotes de bas de page 3 et à ceux qui cherchent à étudier ou à travailler dans des pays non traditionnelsNotes de bas de page 4.
En outre, le Programme favorise la collaboration avec des partenaires et des intervenants, y compris des organisations spécialisées, pour rechercher, tester et mettre en œuvre des solutions innovantes. L’objectif est de mesurer les effets directs des diverses initiatives financées. Par conséquent, le Programme cherche à générer des leçons apprises et des pratiques prometteuses à utiliser pour améliorer ses programmes.
2.2 Ressources du programme
À partir d’avril 2019 jusqu’à mars 2024, le budget total réel et prévu du Programme s’élève à 341,1 millions de dollars (se référer aux tableaux 1 et 2 pour les dépenses propres au Programme).
| Composantes du Programme | 2019 à 2020 (réelles) | 2020 à 2021 (réelles) | 2021 à 2022 (réelles) | 2022 à 2023 (prévues) | 2023 à 2024 (prévues) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeport pour ma réussite Canada | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $4,5 |
| Indspire | $3 | $11,8 | $11,8 | $16,8 | $11,8 | $55,2 |
| Droit au but | $7 | $11 | $12 | $10 | $10 | $50 |
| Fonds d’urgence relatif à la COVID 19 | $0 | $15 | $0 | $0 | $0 | $15 |
| Autres annonces du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants | $0 | $0 | $50 | $48 | $10 | $98 |
| Accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (total de Droit au but, du fonds d’urgence relatif à la COVID 19 et des autres annonces du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants) | $7 | $26 | $62 | $58 | $20 | 173$ |
- Source : Données administratives du programme.
- Notes: Indspire a également reçu 8 817 000 dollars de la part de Services aux Autochtones Canada au cours de l’exercice 2019 2020) avant que tous les financements du gouvernement du Canada accordés à Indspire ne soient consolidés sous l’égide d’EDSC. Dans le cadre de Droit au but, le programme a reporté 3 millions de dollars de l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2020 à 2021, et 2 millions de dollars de l’exercice 2020 à 2021 à l’exercice 2021 à 2022. Dans le cadre d’autres annonces concernant le Programme, le budget 2021 a prévu des fonds pour mener une expansion pilote du programme sur 2 ans. Ces fonds soutiendront les organisations parascolaires nationales et locales qui œuvrent pour que les enfants et les jeunes vulnérables puissent obtenir leur diplôme d’études secondaires et ne soient pas encore plus marginalisés à cause de la pandémie. En outre, en septembre 2022, la déclaration économique d’automne a annoncé le financement d’une prolongation de 2 ans du programme à des niveaux réduits. Cela représentait un financement de 10 millions de dollars en 2023 et 2024 et de 20 millions de dollars en 2024 et 2025. L’énoncé économique d’automne prévoyait le renouvellement du financement de Passeport et d’Indspire pendant 1 an, aux niveaux existants (9,5 millions de dollars et 8 millions de dollars en 2023 et 2024, respectivement).
| Composantes du Programme | 2019 à 2020 (réelles) | 2020 à 2021 (réelles) | 2021 à 2022 (réelles) | 2022 à 2023 (prévues) | 2023 à 2024 (prévues) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expérience compétences mondiales | 3 $ | 6,2 $ | 9 $ | 16,2 $ | 31 $ | 65,4 $ |
- Source: Données administratives du programme
2.3 Volets du programme
Volet 1 : Mesures de soutien parascolaires et intégrées
Passeport pour ma réussite Canada
Depuis 2010, le Ministère fournit un financement, principalement au moyen d’une subvention publique à Passeport pour ma réussite Canada ou « Passeport ». Cette organisation caritative à but non lucratif aide les étudiants à terminer leurs études secondaires et à faire la transition vers à l’enseignement postsecondaire, la formation ou le marché du travail.
Passeport pour ma réussite s’associe à des organisations d’accueil locales (comme des organismes de santé, des centres de ressources communautaires, des organisations au service des jeunes et des organisations autochtones) dans les communautés. Les organisations partenaires mettent ensuite en œuvre le programme Passeport pour ma réussite. Ce dernier s’adresse aux jeunes issus de populations historiquement mal desservies en matière d’enseignement postsecondaire, par exemple :
- jeunes autochtones;
- jeunes nouveaux arrivants;
- jeunes issus de familles à faible revenu;
- jeunes issus de familles dont les membres n’ont pas fait d’études postsecondaires.
Passeport pour ma réussite se pose en complément du système scolaire public en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires communautaires et des bénévoles. Ce partenariat offre aux jeunes qui risquent d’abandonner leurs études une variété de mesures de soutien pour des activités parascolaires. Ces mesures d’aide visent à réduire les taux d’abandon scolaire et à lever les obstacles systémiques à l’éducation. En voici quelques-uns :
- mentorat individuel;
- soutien scolaire;
- soutien social;
- soutien financier.
Une fois qu’il a établi un site de projet, le programme Passeport pour ma réussite travaille avec l’organisation hôte pour recueillir des données sur les participants et rendre compte des mesures assurant le progrès. Il organise également des activités d’échange de connaissances et d’apprentissages entre communautés afin de transmettre des pratiques et des idées prometteuses et de soutenir les activités de financement locales.
Indspire
Depuis le début des années 1990, le gouvernement du Canada finance Indspire, une organisation caritative enregistrée nationale dirigée par des Autochtones. Au cours de l’exercice 2019 2020, le financement a passé de Services aux Autochtones Canada à EDSC. Ce financement vise à soutenir les étudiants autochtones qui ne reçoivent pas d’aide financière pour l’enseignement postsecondaire par l’entremise d’autres programmes gouvernementaux. Indspire aide les étudiants autochtones principalement en leur octroyant un soutien financier pour leur permettre de faire des études postsecondaires. Indspire consacre la majeure partie de son financement au programme Bâtir un avenir meilleur. Ce programme offre des bourses d’études aux étudiants autochtones. Le financement obtenu dans le cadre de ce volet appuie également d’autres initiatives d’Indspire, comme le mentorat et le perfectionnement professionnel.
Autres accords liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
Dans le cadre du volet 1, le Programme a regroupé d’autres accords sous les accords de contribution du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants, notamment :
- les accords liés au programme Droit au but;
- les accords liés au Fonds d’urgence relatif à la COVID 19;
- de nouveaux accords de projet dans le cadre de la dernière (accords de contribution du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants).
Accords liés au programme Droit au but : Droit au but s’appuie sur des résultats positifs et sur la relation qu’EDSC a développée avec Passeport pour ma réussite Canada. EDSC a mis en œuvre les accords liés au programme Droit au but en 2019 dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Cependant, le Ministère l’a transféré au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. Ce volet fournit un financement sous forme de contributions aux organisations au service des jeunes pour qu’elles puissent offrir des mesures de soutien parascolaires complètes. Le programme Droit au but s’adresse aux jeunes confrontés à des obstacles à l’apprentissage, à la réussite scolaire et à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et aide ces jeunes à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire ou le marché du travail.
Le financement du programme Droit au but sert essentiellement à mener à bien 3 grands objectifs :
- collaborer avec des organisations dont les résultats et le potentiel de croissance sont avérés, afin d’améliorer et éventuellement d’élargir les programmes existants;
- introduire un modèle d’impact collectif. Ce modèle s’appuiera sur l’expertise et les points forts des organisations du secteur. Encourager la collaboration sur des initiatives communes dans plusieurs communautés;
- soutenir l’innovation et tester des solutions proposées par les jeunes qui peuvent être rapidement prototypées et évaluées et, en cas de succès, servir de base à des projets potentiels qui pourront ensuite être développés à plus grande échelle.
Fonds d’urgence relatif à la COVID 19 : En avril 2020, le plan d’intervention d’urgence relatif à la COVID 19 du gouvernement canadien comprenait des mesures spécifiques. Ce plan visait à atténuer les répercussions disproportionnées de la pandémie de COVID 19 sur les jeunes et les étudiants à risque. Il comprend notamment un financement annuel de 15 millions de dollars dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. L’objectif était de permettre aux organisations au service des jeunes :
- d’offrir leurs mesures d’aide en ligne;
- combler le fossé numérique;
- d’augmenter les ressources essentielles pour les étudiants qui ont besoin de soutien (par exemple, distribution de diverses technologies, accès à l’Internet à large bande).
S’inspirant du plan d’intervention d’urgence relatif à la COVID 19 du gouvernement du Canada, le budget 2021 a élargi le Programme pour une période de 2 ans. Il visait à financer un large éventail d’organisations au service des jeunes. Il s’agissait notamment d’assurer la continuité des initiatives en réponse à la COVID 19 et de permettre de nouveaux investissements pour joindre les jeunes au sein des populations et des communautés mal desservies.
Accords liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants : Le budget 2021 prévoit également un financement de 118,4 millions de dollars sur 2 ans (de l’exercice 2021 à 2022 à l’exercice 2022 2023). Ce financement permettra de procéder à une expansion pilote des investissements fédéraux dans les programmes parascolaires. Il permettra aussi d’élargir les mesures de soutien à l’apprentissage et les mesures de soutien intégrées pour les jeunes dans le cadre du programme-cadre du Programme.
L’expansion pilote du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants était assortie d’un profil de financement de 2 ans seulement. Ainsi, EDSC a adopté une stratégie à 2 volets pour mettre en œuvre le projet pilote en temps opportun :
- le renouvellement ou la modification de certains accords en vigueur avec les bénéficiaires du programme Droit au but et du fonds d’urgence relatifs à la COVID 19;
- le lancement d’un appel de propositions par processus concurrentiel (EDSC a approuvé 34 nouveaux projets).
En août 2021, le Programme a lancé un appel de propositions. L’objectif était de financer des organisations avec de nouveaux projets pour un montant pouvant atteindre 8,5 millions de dollars par an. La durée maximale d’un projet était de 59 semaines. à l’instar de Passeport pour ma réussite Canada et des accords liés au programme Droit au but, cet appel de propositions visait à financer des mesures de soutien souples et inclusives qu’offrent les organisations financées. Le but est d’aider les étudiants mal desservis à rester à l’école, à obtenir leur diplôme dans le temps prévu ou à poursuivre des études postsecondaires. Les mesures de soutien directes aux étudiants se rapportent à au moins un des 4 thèmes clés suivants :
- persévérance et préparation aux études;
- mentorat complet et bien-être mental;
- développement des aspirations scolaires et de la résilience;
- accroissement de la connectivité.
Volet 2 : Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger
Expérience compétences mondiales
Le gouvernement du Canada a lancé une nouvelle stratégie en matière d’éducation internationale en août 2019, une initiative horizontale dirigée par Affaires mondiales Canada. Cette stratégie prévoyait d’investir dans un nouveau projet pilote de mobilité étudiante vers l’étranger (maintenant appelé Expérience compétences mondiales). Ce projet pilote vise à donner les moyens aux étudiants du premier cycle d’universités et de collèges canadiens d’acquérir les compétences recherchées grâce à des programmes d’étude et de travail à l’étranger. En particulier, le programme Expérience compétences mondiales vise à atteindre les objectifs suivants :
- accroître la participation des étudiants mal desservisNotes de bas de page 3 aux possibilités d’études ou de travail à l’étranger (50 % du financement);
- diversifier les pays de destination où les étudiants canadiens vont étudier ou travailler à l’étrangerNotes de bas de page 4 (40 % du financement);
- mettre à l’essai des approches innovantes pour réduire les obstacles aux études ou au travail à l’étranger (jusqu’à 10 % du financement).
Fonds d’innovation – Expérience compétences mondiales
En raison des restrictions de voyage imposées en raison de la COVID 19, la mise en œuvre du Programme s’est faite par étapes. On a commencé par la mise en œuvre du Fonds d’innovation. Ce Fonds a soutenu les établissements d’enseignement postsecondaire dans les activités suivantes :
- tester des approches innovantes, y compris des possibilités de mobilité virtuelle;
- mener des recherches sur la réduction des obstacles, la gestion des risques;
- mettre à l’essai de mesures de soutien intégrées.
Ces activités ont permis aux établissements postsecondaires de mettre à l’essai de nouveaux outils et de nouvelles approches. Elles ont également permis d’adapter les programmes de mobilité à la situation liée à la COVID 19 et de jeter les bases du lancement du programme completNotes de bas de page 5.
3. Contexte de l’évaluation
3.1 évaluation de programme précédente
Bien que ce programme-cadre soit évalué pour la première fois, cette étude s’appuie sur l’« évaluation du programme Passeport pour ma réussite Canada » (EDSC, 2019). L’objectif de cette évaluation était d’examiner le degré de pertinence du programme et la réalisation de ses résultats. L’évaluation a également mesuré l’impact différentiel que le programme a eu sur ses étudiants admissibles. L’évaluation a révélé ce qui suit :
- les programmes de Passeport pour ma réussite Canada répondent à un besoin manifeste en aidant les jeunes défavorisés à:
- terminer leurs études;
- faire la transition vers un avenir prospère;
- atteindre leur potentiel.
- les programmes offerts dans le cadre de Passeport pour ma réussite ont contribué à une hausse du nombre d’inscriptions dans les établissements d’enseignement postsecondaire parmi les participants. Par exemple, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires est de 10 à 19 % plus élevé pour les participants au programme Passeport pour ma réussite que pour les groupes de comparaison composés de non-participants;
- l’adaptation des programmes offerts par le site de Winnipeg, dont 72 % des étudiants du programme Passeport pour ma réussite sont autochtones, a eu un effet positif sur les jeunes Autochtones;
- la participation au programme Passeport pour ma réussite a été positivement liée aux taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, à l’inscription à un programme d’études postsecondaires et au rendement scolaire;
- le Programme a eu une incidence positive sur les résultats sur le marché du travail des participants admissibles. Par exemple, une étude de Lavecchia et coll. (2018) a mis en correspondance les dossiers scolaires et les données relatives à l’impôt sur le revenu. L’étude a ainsi pu évaluer les résultats en matière d’emploi des jeunes dans l’aire de recrutement du programme Passeport pour ma réussite pour le site de Regent Park. L’étude a révélé que la participation au programme Passeport pour ma réussite a augmenté le revenu des adultes de 19 % et l’emploi de 14 %. Elle a également permis de réduire de plus de 30 % le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à un groupe contrôleNotes de bas de page 6 (Lavecchia et coll., 2018).
En outre, une analyse coûts-avantages a conclu que le bénéfice net individuel pour les étudiants participants s’élevait à près de 5 500 dollars sur 25 ans. Le bénéfice social net total pour la société d’un étudiant admissible participant au programme Passeport pour ma réussite sur 25 ans était de 7 490 dollars par rapport à un étudiant non admissible. Cela représente un taux de rendement social total de 50,1 % sur 25 ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,6 %.
3.2 évaluation du programme de 2022
Cette évaluation s’appuie sur l’évaluation de 2019 du programme Passeport pour ma réussite et sur l’augmentation du financement depuis sa publication. Elle comprend des constatations tirées de plusieurs sources de données afin d’évaluer l’impact du programme entre l’exercice 2019 à 2020 et l’exercice 2021 à 2022Notes de bas de page 7. En outre, elle examine les récentes modifications apportées au processus de demande (dans l’appel de propositions de 2021).
Cette évaluation s’appuie sur 5 sources principales de données :
- analyse documentaire et revue de la littératureNotes de bas de page 8;
- entrevues avec des informateurs clés internes et des fonctionnaires du gouvernement du Canada;
- entrevues avec des informateurs clés externes au sein d’organisations bénéficiaires établies (dans le cadre des accords liés à Passeport pour ma réussite Canada, à Indspire, à Droit au but et à Expérience compétences mondiales);
- entrevues avec des informateurs clés externes au sein d’organisations sollicitées par le Programme dans le cadre de l’appel de propositions de 2021;
- sondage auprès :
- de représentants d’organisations au service des jeunes (volet 1);
- d’établissements d’enseignement postsecondaire (volet 2) qui ont conclu un partenariat avec un signataire de l’accord relatif au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.
Le sondage porte sur les fonctionnaires impliqués dans la fourniture d’un soutien direct aux étudiants, la gestion et la coordination du projet, la publicité du projet ou l’évaluation ou la conduite des activités de recherche.
Un rapport méthodologique détaillé est accessible à l’annexe C.
Les principales limites de cette évaluation sont l’absence de participation directe des étudiants (utilisateurs finaux) qui ont pris part aux projets. En outre, le Programme dispose de peu de données sur les résultats des participants pour les projets moins avancés et pour les projets affectés par la pandémie de COVID 19.
En outre, l’évaluation actuelle n’a pas pu inclure une analyse des répercussions. Toutefois, le Programme collabore avec Passeport pour ma réussite Canada, des chercheurs et Statistique Canada afin d’étudier l’impact de Passeport pour ma réussite sur la santé et la criminalité. Lors de la réalisation de la présente évaluation, ces recherches étaient toujours en cours.
De plus, pour le volet 2, cette évaluation ne comprend pas de renseignements sur le rendement permettant d’évaluer l’impact des possibilités de travail et d’études à l’étranger. Cette évaluation ne présente que les résultats des projets financés dans le cadre du Fonds d’innovation.
4. Volet 1 – Pertinence du Programme
Il est nécessaire d’apporter un soutien personnalisé et au cas par cas à chacun des groupes d’étudiants sous-représentés et mal desservis. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où chaque groupe d’étudiants est confronté à des défis uniques. Les organisations au service des jeunes financées par le Programme fournissent des mesures de soutien intégrées, souples et au cas par cas pour atténuer ces difficultés (consulter la section 5).
4.1 Besoin continu du programme
Selon Statistique Canada, en 2019, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires (84,3 %) était supérieur à la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (80,3 %) (Statistique Canada, 2022d).
Bien que le Canada soit en avance sur de nombreux autres pays en termes de niveau d’éducation postsecondaire, des sous-populations d’étudiants sont confrontées à des obstacles particuliers en matière d’éducation.
Selon une récente fiche d’information de Statistique Canada (2022e), les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires varient en fonction du genre, des provinces et des territoires. Une plus grande proportion de jeunes femmes (87 %) que de jeunes hommes (81 %) ont terminé leurs études secondaires dans le temps prévu. Statistique Canada a observé cette tendance dans toutes les provinces et tous les territoires. Statistique Canada note que les comparaisons des taux d’obtention de diplômes d’études secondaires entre les provinces et les territoires nécessitent une interprétation nuancée. Les parcours académiques, les notes de passage, les matières requises et les groupes d’étudiants pris en compte peuvent différer d’une province ou d’un territoire à l’autre. Pourtant, les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires au cours de l’exercice 2019 2020 varient entre 94 % à Terre Neuve et Labrador et 79 % au Québec. Les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires sont plus faibles dans les territoires (par exemple, 46 % au cours de l’exercice de 2019 à 2020 dans les Territoires du Nord-Ouest).
La littérature attire aussi l’attention sur d’autres facteurs d’intersectionnalité affectant la capacité des étudiants à obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires (sans toutefois s’y limiter) :
- étudiants issus de ménages à faible revenu;
- étudiants autochtones;
- étudiants en situation de handicap;
- étudiants racisés;
- immigrants (y compris les nouveaux arrivants et les immigrants établis);
- étudiants qui s’identifient comme 2SLGBTQI+;
- étudiants qui ont déjà été en situation d’itinérance ou qui le sont ou qui sont à risque de l’être;
- étudiants pris en charge ou qui ne le sont plus en raison de leur âge.
Comme l’indique l’évaluation 2019 du programme Passeport pour ma réussite, l’abandon des études secondaires a de nombreuses conséquences pour les personnes et pour le Canada (consulter le graphique 2).
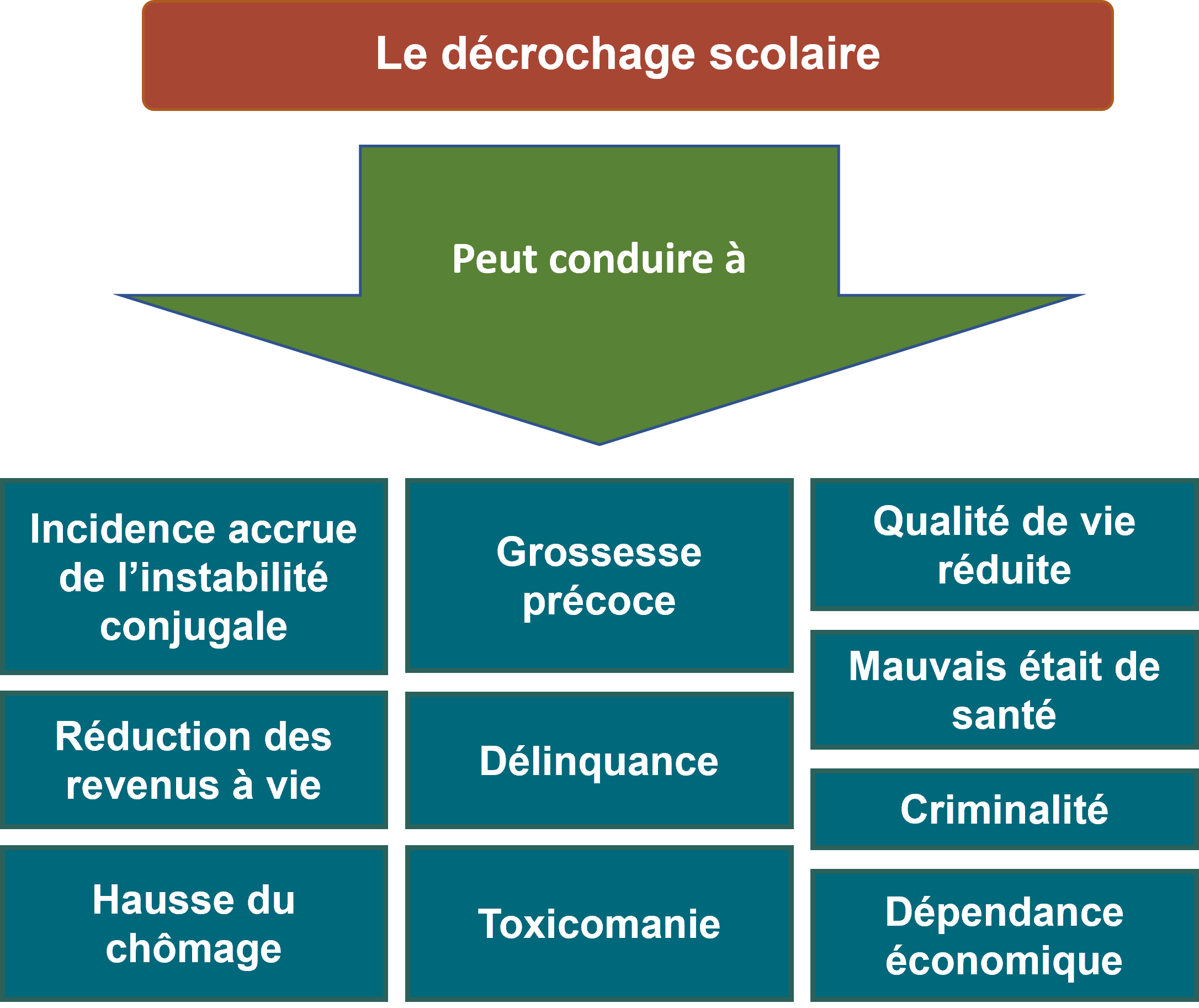
- Source: Emploi et Développement social Canada (2019), évaluation de Passeport pour ma réussite.
Description textuelle – Graphique 2
L’abandon des études secondaires peut entraîner une augmentation de l’instabilité matrimoniale, une diminution des revenus de toute une vie et une augmentation du chômage. Il peut également conduire à des grossesses précoces, à la délinquance et à la toxicomanie. En outre, l’abandon des études secondaires peut entraîner une diminution de la qualité de vie, une mauvaise santé, la criminalité et la dépendance économique.
Selon les représentants des organisations au service des jeunes financées, plus des trois quarts des répondants (81 %) ont mentionné le manque de motivation personnelle comme l’un des principaux obstacles empêchant les jeunes d’atteindre leurs objectifs en matière de résultats scolaires.
Les deuxièmes et troisièmes obstacles les plus fréquemment cités sont les suivants :
- le manque d’argent pour les besoins de base;
- les problèmes de santé mentale et de toxicomanie (consulter le graphique 3).
Ces résultats reflètent les principaux obstacles relevés par Statistique Canada (2002) dans le cadre de l’Enquête auprès des jeunes en transition.
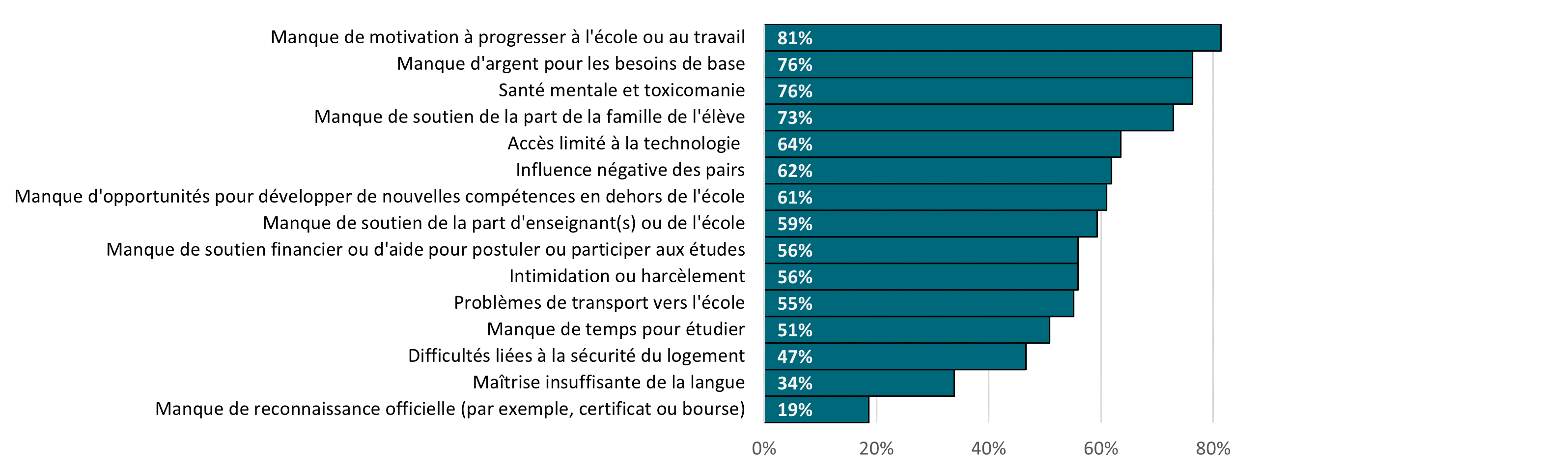
- Source: Sondage auprès des représentants d’organisations au service des jeunes (118 répondants).
Description textuelle – Graphique 3
| Défis | Pourcentage |
|---|---|
| Manque de motivation à progresser à l’école ou au travail | 81% |
| Manque d’argent pour les besoins de base | 76% |
| Santé mentale et toxicomanie | 76% |
| Manque de soutien de la part de la famille de l’élève | 73% |
| Accès limité à la technologie | 64% |
| Influence négative des pairs | 62% |
| Manque d’opportunités pour développer de nouvelles compétences en dehors de l’école | 61% |
| Manque de soutien de la part d’enseignant(s) ou de l’école | 59% |
| Manque de soutien financier ou d’aide pour postuler ou participer aux études | 56% |
| Intimidation ou harcèlement | 56% |
| Problèmes de transport vers l’école | 55% |
| Manque de temps pour étudier | 51% |
| Difficultés liées à la sécurité du logement | 47% |
| Maîtrise insuffisante de la langue | 34% |
| Manque de reconnaissance officielle (par exemple, certificat ou bourse) | 19% |
| Autre(s) | 8% |
| Ne sais pas | 1% |
| Total | 100% |
Pour les étudiants à faible revenu, le manque d’argent pour les besoins de base comme la nourriture, le logement et le linge est l’obstacle le plus fréquemment mentionné. En fait, 85 % des fournisseurs de services interrogés ont indiqué qu’il s’agissait de l’un des principaux obstacles à surmonter. Le manque de reconnaissance officielle, le manque de motivation personnelle et le manque de soutien de la part de la famille de l’étudiant étaient les éléments cités ensuite (consulter le graphique 4).
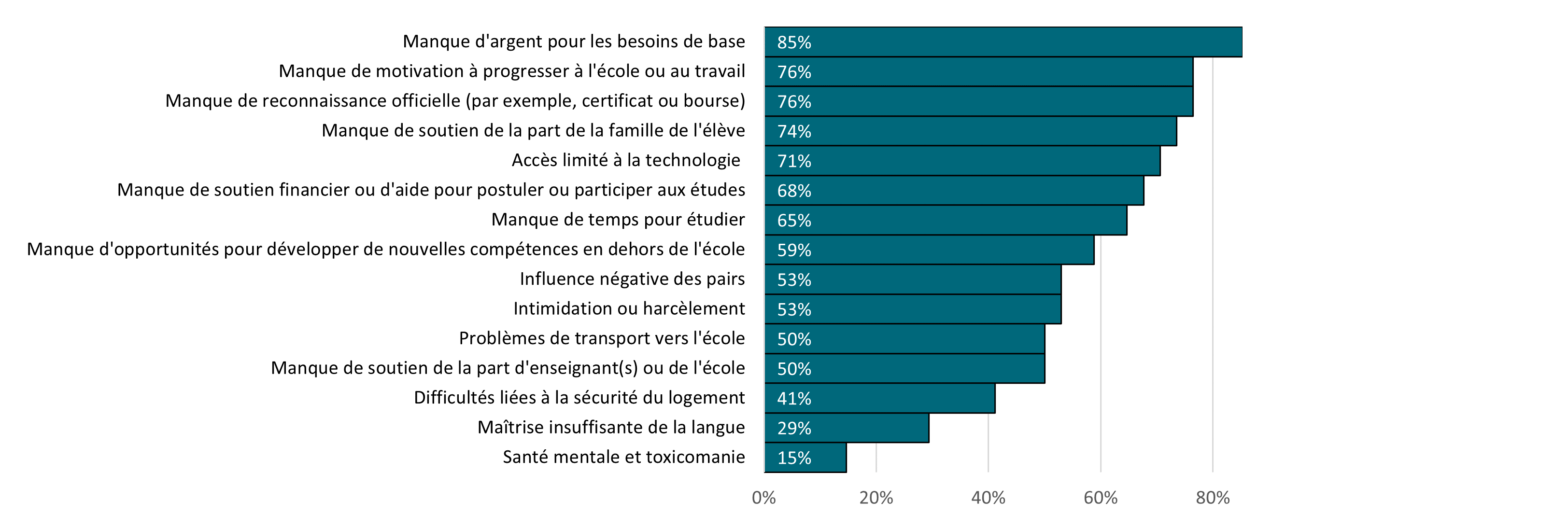
- Source: Sondage auprès des représentants d’organisations au service de la jeunesse (34 répondants).
Description textuelle – Graphique 4
| Défis | Pourcentage |
|---|---|
| Manque d'argent pour les besoins de base | 85% |
| Manque de motivation à progresser à l'école ou au travail | 76% |
| Manque de reconnaissance officielle (par exemple, certificat ou bourse) | 76% |
| Manque de soutien de la part de la famille de l'élève | 74% |
| Accès limité à la technologie | 71% |
| Manque de soutien financier ou d'aide pour postuler ou participer aux études | 68% |
| Manque de temps pour étudier | 65% |
| Manque d'opportunités pour développer de nouvelles compétences en dehors de l'école | 59% |
| Influence négative des pairs | 53% |
| Intimidation ou harcèlement | 53% |
| Problèmes de transport vers l'école | 50% |
| Manque de soutien de la part d'enseignant(s) ou de l'école | 50% |
| Difficultés liées à la sécurité du logement | 41% |
| Maîtrise insuffisante de la langue | 29% |
| Santé mentale et toxicomanie | 15% |
| Total | 100% |
4.2. Participation des étudiants autochtones aux études postsecondaires au Canada
Selon les données du recensement canadien (consulter le graphique 5), le taux de réussite au niveau postsecondaire est toujours plus faible chez les populations autochtones que chez les populations non-autochtones. L’écart est toujours resté supérieur à 16 points de pourcentage et s’est creusé pour atteindre plus de 18 points de pourcentage en 2021.
En outre, le taux d’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires varie également selon les divers groupes autochtones. Selon le recensement de 2021, plus de la moitié (56,3 %) des Métis âgés de 25 à 64 ans détenaient un diplôme d’études postsecondaires. Pour les populations des Premières Nations, moins de la moitié en détenait un, (45,3 %), et pour les populations inuites environ un tiers (33,6 %) en détenait un (Statistique Canada, 2022).
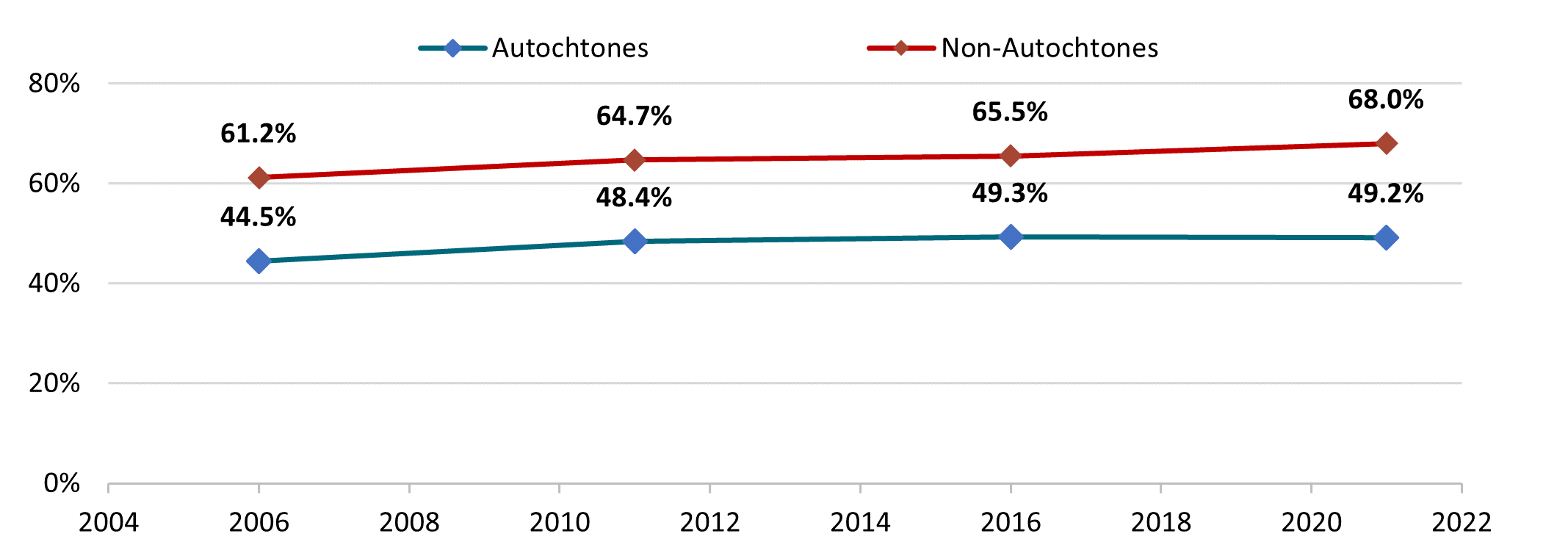
- Sources: Statistique Canada (2006, 2011, 2016, 2022b).
Description textuelle – Graphique 5
| Année de recensement | Pourcentage d'autochtones | Pourcentage de non-autochtones |
|---|---|---|
| 2006 | 44,5% | 61,2% |
| 2011 | 48,4% | 64,7% |
| 2016 | 49,3% | 65,5% |
| 2021 | 49,2% | 68,0% |
Par conséquent, même si le taux de réussite au niveau postsecondaire s’est considérablement amélioré, l’écart entre les populations autochtones et non-autochtones demeure. En outre, selon le recensement de 2021, les Autochtones âgés de 15 à 19 ans avaient un taux de fréquentation scolaire de 78,4 % en moyenne. Cette proportion est inférieure à celle des étudiants non-autochtones (87 %). Statistique Canada (2022b) note que le fait de fréquenter l’école peut laisser présager un taux de réussite au niveau postsecondaire moins élevé à l’avenir.
D’après l’analyse documentaire Notes de bas de page 8, le sondage mené auprès des représentants des organisations au service des jeunes et les entrevues avec des représentants des organisations financées, les étudiants autochtones sont confrontés à des obstacles uniques, notamment ceux mentionnés ci-après.
Discrimination institutionnelle et systémique et traumatisme intergénérationnel
Les politiques coloniales d’assimilation (p. ex. les pensionnats) ont suscité la méfiance des peuples autochtones à l’égard des établissements d’enseignement (Indspire 2021b). Les résultats de ces politiques ont une incidence négative sur les résultats scolaires des jeunes Autochtones. En outre, les informateurs clés reconnaissent que les étudiants autochtones ont souvent fait l’objet de discriminations dans le système éducatif et sur le marché du travail. Cela a un impact négatif sur la qualité de vie et la réussite, ainsi que sur la confiance en soi, la santé mentale et le bien-être (Goss Gilroy, 2021).
Manque de représentation de la culture autochtone dans les programmes d’études et les établissements
Au Canada, les systèmes scolaires privilégient les approches éducatives euro centriques et occidentales, tandis que le contenu autochtone est souvent facultatif (Indspire, 2021a). Cette discrimination systématique se traduit par un manque de représentation du contenu autochtone dans les programmes d’études. Par conséquent, le système éducatif renforce les idéaux et les faux récits de la suprématie des modes d’apprentissage coloniaux (Indspire, 2021b).
Manque de représentation au sein du personnel de l’école
De nombreux employeurs et conseils scolaires n’ont pas encore mis en place de politiques et de pratiques d’embauche tenant compte de la culture autochtone (Indspire, 2021b). Les informateurs clés ont également noté un manque de représentation autochtone dans le système éducatif ainsi que de modèles autochtones.
Obstacles financiers
Les jeunes Autochtones sont confrontés à des obstacles financiers considérables qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs en matière d’éducation. Les contraintes financières ont des répercussions directes et indirectes sur les éléments suivants :
- la satisfaction des besoins fondamentaux, par exemple une alimentation suffisante et l’accès à un logement;
- l’accès à un espace de travail, à l’Internet ou à un ordinateur;
- la conciliation entre le travail, l’école et les obligations liées à la famille ou aux amis.
Accès aux services et à la technologie
Selon l’endroit où se trouve leur communauté, les jeunes peuvent éprouver des difficultés à accéder aux services parascolaires. En effet, en raison de l’éloignement et de l’accès limité à l’Internet dans leur communauté, certains apprenants autochtones n’ont qu’un accès limité aux mesures de soutien à l’apprentissage en personne ou en ligne. Cela peut obliger les jeunes Autochtones à quitter leur communauté avant ou après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Le fait de s’éloigner de leur communauté peut entraîner la perte du soutien de la famille et de la communauté (Indspire 2021a).
Étudiants de première génération
Les étudiants autochtones sont plus susceptibles d’être les premiers de leur famille à terminer un programme d’enseignement postsecondaire. Les étudiants de la première génération sont désavantagés par rapport aux étudiants qui ne sont pas de la première génération en raison du caractère limité de divers éléments, notamment les suivants :
- connaissances parentales;
- accès aux ressources financières;
- implication des parents.
Pratiques prometteuses pour soutenir les étudiants autochtones
- Promotion de la culture autochtone dans les activités liées à l’éducation, tant pour les étudiants autochtones que pour les étudiants non-autochtones. Il peut s’agir, par exemple, de la langue, de l’histoire, des connaissances traditionnelles, de l’intégration des connaissances des aînés.
- Aide financière pour payer les frais supplémentaires liés aux études en dehors de la communauté (par exemple, le transport, le logement, la nourriture).
- Renforcement de la représentation autochtone au sein des organisations au service des jeunes afin de mieux faire connaître les obstacles propres aux Autochtones et de fournir des modèles aux étudiants autochtones.
- Offre de programmes de mentorat avec un membre de la communauté qui peut faire part de son témoignage positif et de sa réussite en tant qu’Autochtone et qui peut promouvoir la culture autochtone.
- Développement de partenariats entre les organisations au service des jeunes, les communautés et les familles afin de mieux aider les jeunes Autochtones à surmonter les obstacles propres à leur communauté et à promouvoir la participation à l’enseignement postsecondaire.
4.3. Participation des étudiants handicapés à l’enseignement postsecondaire au Canada
Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, 56 % des personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans avaient suivi une forme d’enseignement postsecondaire. à titre de comparaison, cette proportion est de 67 % pour les personnes non handicapées. Plus de 540 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans (13 %) avaient 1 ou plusieurs handicaps, selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. Chez les jeunes, le type de handicap le plus courant est celui lié à la santé mentale (8 %), suivi par les troubles d’apprentissage (6 %) et les troubles liés à la douleur (4 %) (Statistique Canada, 2017).
En outre, la gravité de l’invalidité a un effet négatif sur le taux d’achèvement d’études postsecondaires. Comme le montre le graphique 6, 45 % des personnes âgées de 25 à 64 ans ayant une invalidité très grave ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires. à titre de comparaison, cette proportion est de 63 % pour les personnes souffrant d’une invalidité légèreNotes de bas de page 9.
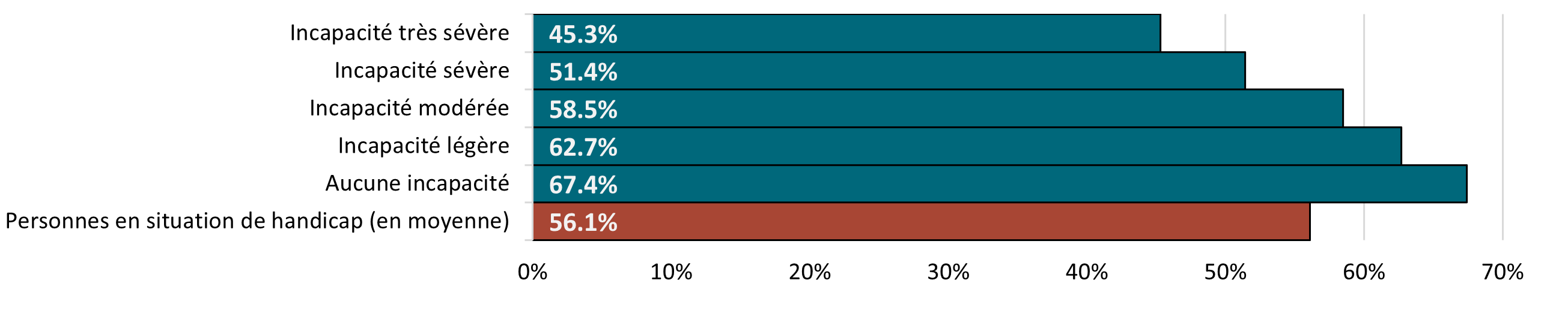
- Source: Statistique Canada (2017) Enquête canadienne sur le handicap.
Description textuelle – Graphique 6
| Sévérité du handicap | Taux de diplomation |
|---|---|
| Aucune incapacité | 67,4% |
| Incapacité légère | 62,7% |
| Incapacité modérée | 58,5% |
| Incapacité sévère | 51,4% |
| Incapacité très sévère | 45,3% |
| Personnes en situation de handicap (en moyenne) (Important) | 56,1% |
L’analyse documentaire Notes de bas de page 8, les sondages menés auprès d’organisations au service des jeunes et les entrevues avec des représentants d’organisations financées ont révélé que les étudiants handicapés se heurtent à des obstacles particuliers, énumérés ci-après.
Obstacles financiers
Les étudiants handicapés doivent assumer des dépenses supplémentaires comparativement aux autres étudiants, notamment en ce qui concerne les évaluations psychopédagogiques, les aménagements accessibles, l’équipement médical, les dépenses et les technologies d’assistance. Toutefois, l’aide financière accordée aux étudiants handicapés de niveau postsecondaire n’est pas la même d’une province ou d’un territoire à l’autre.
En outre, l’accès à l’aide financière est souvent conditionnel, lié aux critères du programme et propre aux coûts qu’il couvre. En conséquence, les étudiants handicapés doivent passer par les étapes suivantes :
- déterminer les aménagements nécessaires;
- communiquer la décision aux enseignants;
- veiller à ce que leurs droits soient respectés.
Certains étudiants se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer les mesures d’adaptation dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études. Ils signalent également qu’ils se heurtent à de la résistance ou à des désaccords concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont cernées. Cette situation conduit certains étudiants à ne pas divulguer leurs besoins en matière de mesures d’adaptation et à plutôt essayer de naviguer dans un environnement éducatif beaucoup plus difficile sans aide.
Accessibilité des infrastructures
L’existence de barrières physiques constitue un autre obstacle pour les étudiants à l’obtention de résultats en matière d’éducation. Il s’agit, par exemple, de toilettes accessibles, d’escaliers sans rampe, d’évacuations d’urgence, d’emplacements d’aires de stationnement). L’accessibilité aux technologies de l’information et des communications peut également poser problème.
Manque de soutien de la part des organisations au service des jeunes et manque de sensibilisation de la part de certains membres du personnel
Les étudiants handicapés doivent s’engager dans un processus visant à :
- cerner les mesures d’adaptation potentielles;
- communiquer la décision aux enseignants;
- s’assurer que le personnel au service des jeunes respecte leurs droits.
Certains étudiants disent se sentir mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer leurs besoins en matière de mesures d’adaptation à leurs professeurs. Ils signalent se heurter à de la résistance ou à des désaccords concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont déterminées et craignent d’être victimes de discrimination.
Discrimination et stigmatisation systémiques
En moyenne, les étudiants handicapés qui terminent leurs études postsecondaires ont des salaires moins élevés. Par conséquent, il est peu probable qu’ils atteignent la parité de revenus avec leurs pairs non handicapés. Cette discrimination systémique à l’encontre des personnes handicapées a un effet négatif sur leur motivation à obtenir un diplôme d’études postsecondaires.
Certains étudiants se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer les mesures d’adaptation dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études. Ils signalent également se heurter à une résistance à la mise en œuvre des mesures d’adaptation ou à un désaccord concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont déterminées. De ce fait, certains étudiants ne divulguent pas leurs besoins en matière de mesure d’adaptation et essayent plutôt de naviguer dans un environnement éducatif beaucoup plus difficile sans aide.
Pratiques prometteuses pour aider les étudiants handicapés
- Fournir un soutien en fonction du type d’invalidité et mieux équiper le personnel pour qu’il puisse prendre en charge une grande variété d’invalidités.
- Améliorer l’accès à l’aide financière.
- Offrir un tutorat.
- Offrir des interventions communautaires précoces et des programmes de transition entre l’école secondaire et les secteurs postsecondaires et entre l’enseignement postsecondaire et le marché du travail.
4.4. Participation des étudiants immigrés, racisés ou nouveaux arrivants à l’enseignement postsecondaire
Selon le recensement de 2021 (consulter le graphique 7), un pourcentage plus élevé d’immigrants et de résidents non permanents âgés de 25 à 64 ans sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires comparativement aux non-immigrants. L’une des principales raisons est que le Canada exploite les talents des immigrants très instruits pour répondre aux besoins du marché du travail. Il s’agit d’un critère de sélection important pour l’immigration. Comme le note Statistique Canada (2022a), ce critère a un effet positif sur la proportion globale de Canadiens ayant suivi une forme quelconque d’enseignement postsecondaire.
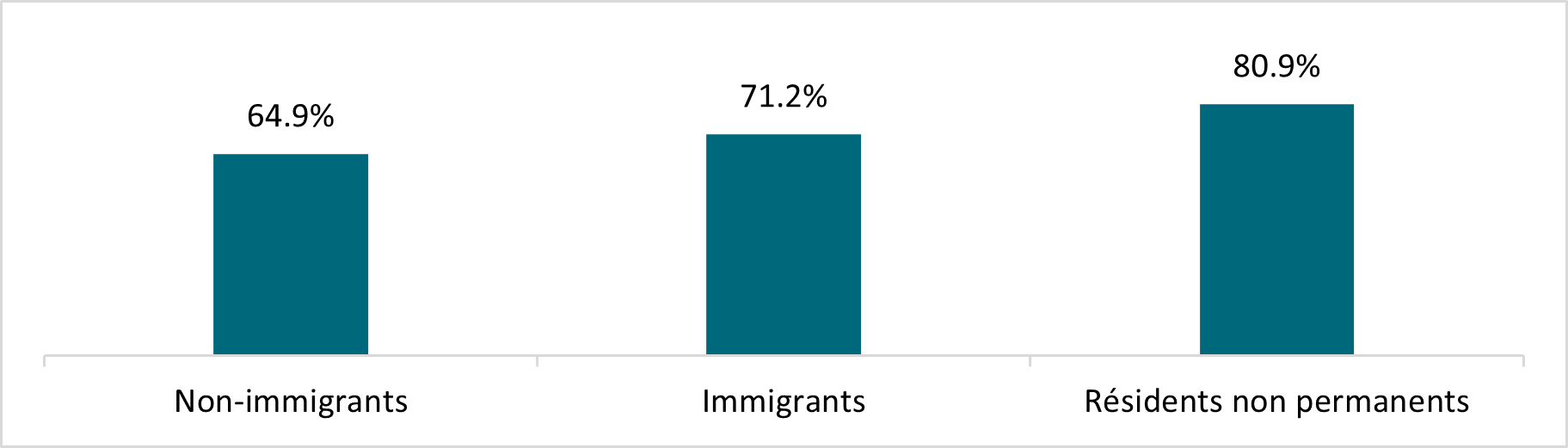
- Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 2022b.
Description textuelle – Graphique 7
| Statutd'immigration | Pourcentage d'individus ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |
|---|---|
| Non-immigrant | 64,9% |
| Immigrant | 71,2% |
| Résidents non permanents | 80,9% |
De plus, selon le recensement de 2021, plus de la moitié (72,2 %) des membres de minorités visibles âgés de 25 à 64 ans avaient un diplôme d’études postsecondaires. En comparaison, 65,2 % de la population n’appartenant pas à une minorité visible en avait un (consulter le graphique 8). Toutefois, cette situation s’explique par l’origine ethnique et le statut de la génération d’immigration. Comme le montre le graphique ci-dessous, le taux de réussite au niveau postsecondaire du groupe des Asiatiques du Sud-Est s’élève à 54,9 %. Ce taux est inférieur au taux de réussite des personnes n’appartenant pas à une minorité visible (consulter le graphique 8).
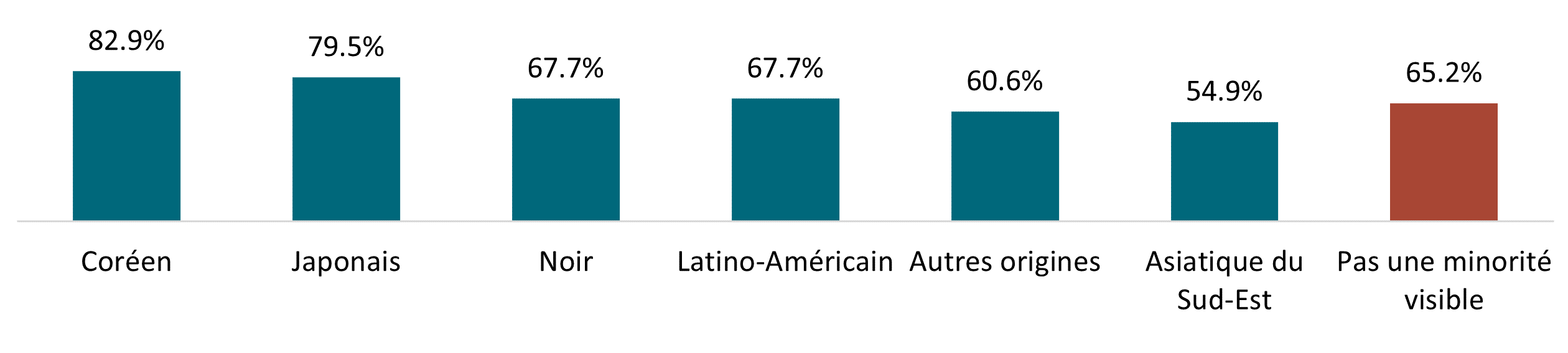
- Source: Statistique Canada (2022b), Recensement de la population de 2021.
Description textuelle – Graphique 8
| Origine ethnique | Pourcentage d’individus ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |
|---|---|
| Coréen | 82,9% |
| Japonais | 79,5% |
| Noir | 67,7% |
| Latino-Américain | 67,7% |
| Autres origines | 60,6% |
| Asiatique du Sud-Est | 54,9% |
| Pas une minorité visible (Important) | 65,2% |
En outre, le statut de la génération d’immigration influe considérablement sur l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire au sein de diverses populations de minorités visibles. Parmi les minorités visibles, environ 71,6 % des immigrants de première génération et 77,3 % des immigrants de deuxième génération ont suivi une formation postsecondaire. En comparaison, ce taux s’élève à 60,2 % pour les autres, y compris la troisième génération ou plus (consulter le graphique 9).
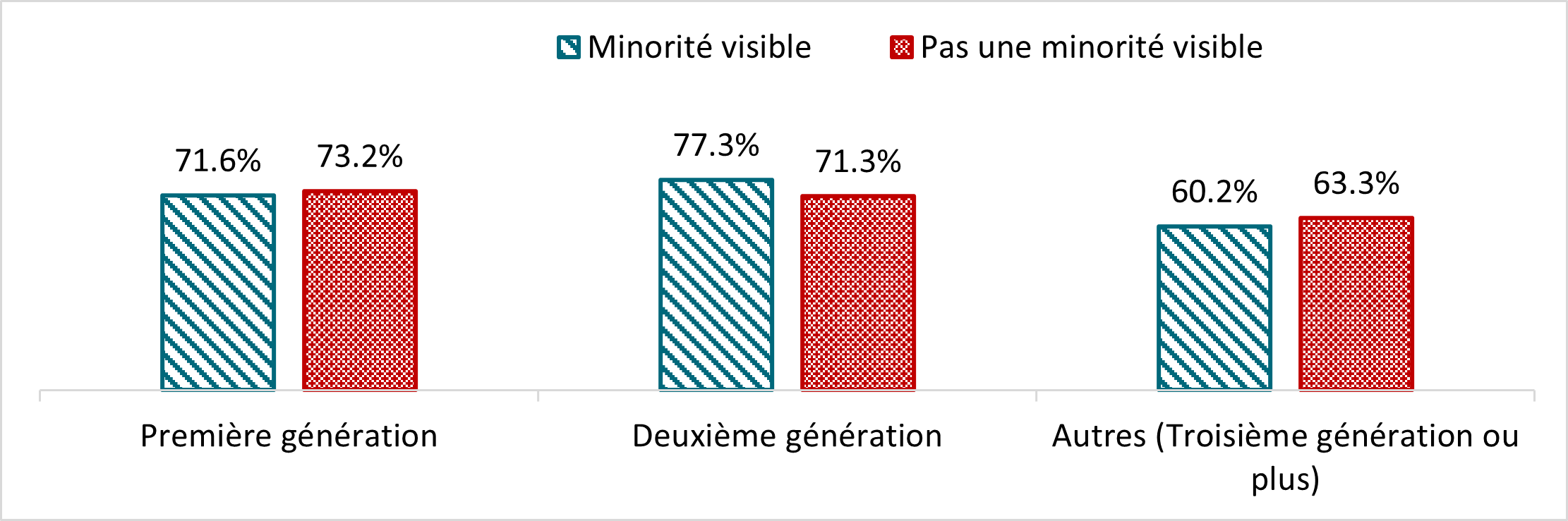
- Source: Statistique Canada (2022b) Recensement de la population 2021.
Description textuelle – Graphique 9
| Statut d’immigrant | Pourcentage de membres de minorité visible ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire | Pourcentage de personne n’appartenant pas à une minorité visible ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |
|---|---|---|
| Première génération | 71,6% | 73,2% |
| Deuxième génération | 77,3% | 71,3% |
| Autres (Troisième génération ou plus) | 60,2% | 63,3% |
Par rapport à d’autres populations, il y a une plus grande différence dans le taux de réussite au niveau postsecondaire entre les immigrants et les immigrants de troisième génération ou plus. Dans la population noire, plus des deux tiers (68,6 %) des immigrants de première génération sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires. En comparaison, moins de la moitié (49,8 %) des immigrants de troisième génération (ou plus) ont un diplôme d’études postsecondaires. De même, les Latino-Américains de première génération sont plus nombreux à avoir un diplôme d’études postsecondaires (67,7 %) que ceux de troisième génération (ou plus) (45,6 %).
L’analyse documentaire Notes de bas de page 8, le sondage et les informateurs clés ont révélé que les étudiants issus des minorités visibles, les nouveaux arrivants et les immigrants de deuxième génération sont confrontés à des obstacles particuliers qui les empêchent de réaliser leurs aspirations académiques.
Absence de reconnaissance des diplômes
Les immigrants qui ont obtenu un diplôme postsecondaire à l’étranger sont surqualifiés pour leur emploi. Selon certains informateurs clés, cette situation accroît le sentiment d’inégalité et diminue la motivation des étudiants à poursuivre leurs études. Parmi les immigrants ayant étudié à l’étranger, le taux de surqualification est globalement de 25,8 %. Cette proportion est de 28,3 % pour la catégorie « Femmes+ » et de 23,1 % pour la catégorie « Hommes+ ». Ce taux est nettement plus élevé que le taux de surqualification des personnes nées au Canada, qui est de 10,6 % dans l’ensemble. Ce taux s’élève à 9,8 % pour la catégorie « Femmes+ » et à 11,7 % pour la catégorie « Hommes+ » (2022a).
Soutien limité des parents en raison de la méconnaissance des programmes d’enseignement
Les parents nouvellement arrivés et les parents immigrés de deuxième génération sont plus susceptibles d’avoir une connaissance limitée du programme d’enseignement et des services offerts à leurs enfants.
Obstacles culturels
Les étudiants nouvellement arrivés, qui ont quitté leur communauté, peuvent subir un choc culturel à leur arrivée au Canada. Cette situation entraîne de l’anxiété ou se traduit par un manque de compétences sociales dans un environnement nouveau ou inconnu.
Discrimination systémique
Les inégalités raciales en matière d’éducation et les inégalités sociales croissantes ont un effet négatif sur la réussite scolaire. Par inégalités raciales, on entend, entre autres, les préjugés raciaux, les stéréotypes et la discrimination, les obstacles linguistiques, les questions d’appartenance et de liens culturels et l’aliénation.
Pratiques prometteuses pour aider les étudiants racisés et les étudiants immigrés
- Sensibiliser davantage les fonctionnaires gouvernementaux et les organisations au service des jeunes aux questions raciales et les doter d’outils d’analyse pour lutter contre le racisme.
- Consigner les leçons apprises et les pratiques prometteuses afin de mieux comprendre les obstacles à la réussite scolaire des étudiants noirs.
- Soutenir les organisations qui : s’emploient à casser le continuum « de l’école à la prison », se concentrent sur les domaines des science, technologie, ingénierie et mathématiques, fournissent des services d’immigration, se penchent sur la sécurité alimentaire, aident les étudiants et familles à accéder aux ressources communautaires et offrent de l’aide à la transition vers l’enseignement postsecondaire et de l’aide au maintien dans le système scolaire et offrent un soutien juridique pour les jeunes dans le système de justice pénale.
4.5. Participation des personnes 2SLGBTQI+ à l’enseignement postsecondaire au Canada
Selon Statistique Canada (2021b), 76,2 % des lesbiennes canadiennes âgées de 25 à 64 ans ont fait des études postsecondaires, un pourcentage similaire à celui des femmes hétérosexuelles, soit 74,1 %. Ce taux est plus élevé que celui de la :
- population gaie (67,0 %);
- population masculine hétérosexuelle (69,8 %);
- population masculine bisexuelle (68,9 %);
- population féminine bisexuelle (67,7 %).
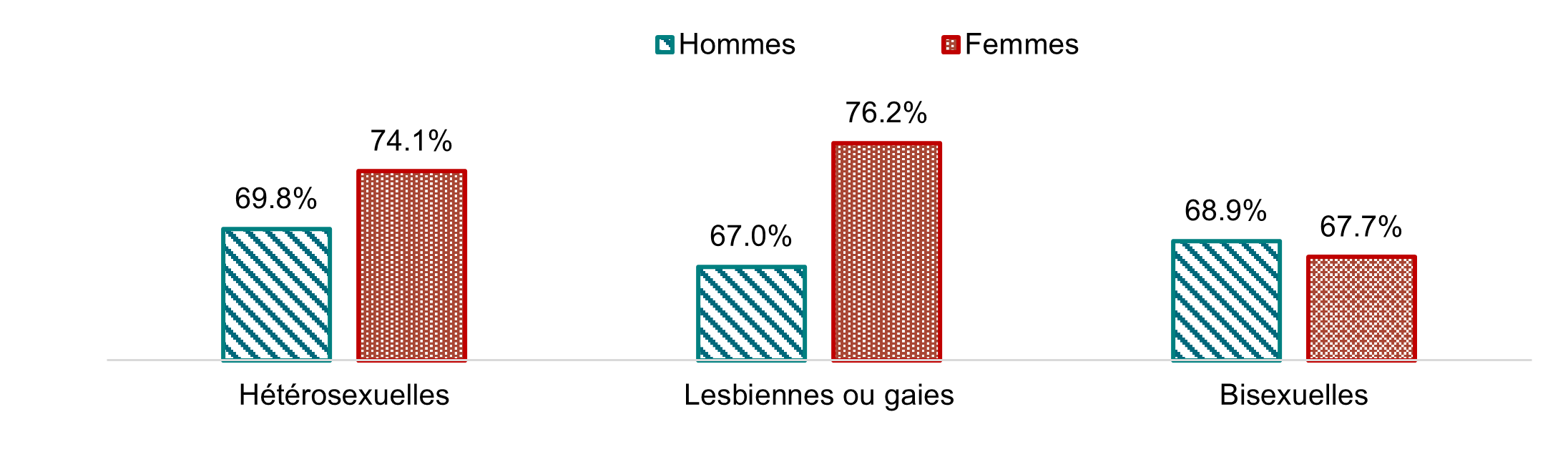
- Source: Statistique Canada (2022c) Participation aux études et niveau de scolarité des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles au Canada.
Description textuelle – Graphique 10
| Orientation sexuelle | Hommes+ | Femmes+ |
|---|---|---|
| Hétérosexuelles | 69,8% | 74,1% |
| Lesbiennes ou gaies | 67,0% | 76,2% |
| Bisexuelles | 68,9% | 67,7% |
En 2018, selon Statistique Canada (2021b), le Canada comptait environ 1 million de personnes 2SLGBTQI+. Cette population représentait 4 % de la population totale âgée de 15 ans et plus. La population 2SLGBTQI+ est relativement jeune. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient 30 % de la population 2SLGBTQI+, contre 14 % de la population non 2SLGBTQI+.
D’après l’analyse documentaireNotes de bas de page 8, les étudiants 2SLGBTQI+ sont confrontés à des obstacles particuliers entravant la poursuite de leurs objectifs académiques.
Discrimination, harcèlement et intimidation
Les étudiants s’identifiant comme étant 2SLGBTQI+ sont plus susceptibles d’être confrontés à la discrimination en milieu scolaire que les jeunes hétérosexuels cisgenres. En effet, 10,8 % des étudiants de niveau postsecondaire 2SLGBTQI+ ont déclaré avoir été victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au cours des 12 derniers mois, selon Statistique Canada (2021b).
Pratiques prometteuses pour soutenir les étudiants 2SLGBTQI+
- Fournir des espaces et des services positifs (y compris dans le cadre des mesures de soutien périscolaires).
- Fournir des services de santé mentale.
- Aider le personnel des organisations au service des jeunes à élaborer un programme d’études incluant toutes les orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre (OSIGEG).
- élaborer une campagne pour sensibiliser le personnel scolaire et les administrateurs.
- Proposer des initiatives en matière de logement destinées aux étudiants 2SLGBTQI+.
4.6. Répercussions de la COVID 19 sur les étudiants mal desservis
Les représentants des organisations au service des jeunes interrogés dans le cadre de la présente évaluationNotes de bas de page 10 ont indiqué que la pandémie avait eu des répercussions importantes et durables sur les étudiants. Par exemple, plus des trois quarts (83 %) sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que la pandémie a aggravé les problèmes auxquels étaient déjà confrontées les populations mal desservies. Selon le sondage, 88 % des personnes ayant reconnu que la COVID 19 avait exacerbé les difficultés des étudiants marginalisés estiment que ces problèmes pourraient persister et affecter les étudiants à l’avenir. Les défis liés à la COVID 19 mentionnés par les informateurs clés et les représentants interrogés des organisations au service des jeunes, mais également relevés dans le cadre de l’analyse documentaire Notes de bas de page 8 sont les suivants.
Perturbation des services d’apprentissage à l’école et après l’école
En raison de la fermeture des écoles, de nombreux étudiants n’ont pas eu accès aux services d’apprentissage qui leur étaient normalement proposés.
Accès limité aux technologies d’apprentissage à distance
L’utilisation accrue de diverses technologies dans l’éducation a nui à la capacité de certains étudiants à participer à l’apprentissage à distance et à diverses mesures de soutien aux activités périscolaires.
Soutien limité des parents
Certains enfants ont reçu moins de soutien de la part de leurs parents pour plusieurs raisons :
- la situation professionnelle des parents;
- le niveau d’éducation des parents.
Le niveau de soutien reçu par les jeunes peut également dépendre des besoins ou d’une invalidité des frères et sœurs. Par exemple, les parents qui ont un enfant handicapé ont déclaré avoir moins de temps pour fournir de l’aide à leurs autres enfants.
Perturbation de l’assiduité scolaire et abandon scolaire des jeunes
En raison du passage soudain à l’apprentissage à distance, certains étudiants se sont sentis dépassés par l’enseignement en ligne. Par conséquent, les jalons et les résultats scolaires ont été perturbés (par exemple, l’accumulation de crédits, les notes avant l’obtention du diplôme et la demande d’inscription dans un établissement d’enseignement postsecondaire). En outre, de nombreux jeunes âgés de 15 à 29 ans se sont désintéressés de leurs études et de leur travail au cours des premiers mois de la pandémie. (Statistique Canada, 2021a, 2022f).
Santé mentale
La COVID 19 a eu des répercussions négatives sur la santé mentale des jeunes, notamment pour les raisons suivantes :
- isolement;
- absence d’interactions en personne;
- annulation d’activités parascolaires.
En outre, des informateurs clés ont signalé que des événements survenus pendant la pandémie ont eu des répercussions sur certaines sous-populations d’étudiants, par exemple :
- le mouvement Black Lives Matter;
- la découverte de sépultures d’enfants autochtones;
- d’autres événements stressants propres à certaines populations.
Ces événements stressants, combinés à la COVID 19, ont créé des besoins supplémentaires en matière de soutien émotionnel et psychologique.
Obstacles financiers
La situation financière des familles de certains étudiants s’est détériorée en raison de la perte d’emploi et de l’augmentation des prix des produits de première nécessité, comme l’ont indiqué des informateurs clés et les fonctionnaires interrogés. Certains étudiants ont dû chercher un emploi au lieu de poursuivre leurs études. Cette situation s’explique par le fait qu’ils étaient confrontés à des problèmes d’accès à la nourriture, de stabilité du logement et de sécurité du revenu (Goss Gilroy, 2021).
5. Volet 1 – Conception et exécution du programme
5.1. La souplesse des accords de financement et des programmes permet d’obtenir des résultats ciblés pour les étudiants confrontés à divers obstacles
Les paramètres du Programme pour le volet 1 permettent aux organisations financées de cerner les besoins de la population qu’elles desservent. En outre, elles peuvent apporter un soutien au cas par cas à chaque groupe d’étudiants. Les accords de financement sont souples et permettent aux organisations financées de fournir un soutien adapté à tous les types d’étudiants mal desservis.
Les informateurs clés, tant internes qu’externes, ont signalé que la conception du programme était souple. Ils ont également dit que cela permettait aux organisations financées de fournir divers types de soutien adaptés aux besoins individuels des étudiants. Par conséquent, les paramètres du Programme permettent de soutenir divers types d’étudiants considérés comme étant mal desservis ou sous-représentés.
Parmi les 14 organisations financées par le programmeNotes de bas de page 11, les organisations ont ciblé les étudiants suivants :
- étudiants autochtones (12 organisations);
- étudiants issus de ménages à faible revenu (9 organisations);
- étudiants Noirs et racialisés (8 organisations);
- étudiants vivant dans des régions rurales, éloignées ou nordiques (7 organisations);
- étudiants qui se déclarent handicapés (7 organisations);
- étudiants s’identifiant comme étant bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et en questionnement (2SLGBTQI+) (5 organisations);
- étudiants des communautés de langue officielle en situation minoritaire (3 organisations);
- étudiants nouvellement arrivés au Canada depuis moins de 5 ans (3 organisations);
- étudiants en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance (2 organisations);
- étudiants qui sont ou qui seraient les premiers d’une famille à étudier dans un établissement d’enseignement postsecondaire (2 organisations).
De l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022, aucun projet n’a ciblé les étudiants pris en charge ou qui ne le sont plus en raison de leur âgeNotes de bas de page 12. En outre, le Programme n’a pas recueilli de données sur le nombre de projets ciblant spécifiquement les réfugiés ou les immigrants (depuis plus de 5 ans).
La souplesse des accords permet également aux organisations financées d’offrir aux étudiants diverses mesures de soutien parascolaires et intégrées. D’après l’analyse documentaire, les organisations financées par le Programme s’inspirent de l’ensemble des pratiques prometteuses mentionnées à la section 4.
Parmi les 14 organisations financées (à l’exclusion d’Expérience compétences mondiales et des organisations financées dans le cadre de l’appel de propositions de 2021) :
- 11 fournissent des mesures de soutien à la persévérance et à la préparation aux études. Il s’agit notamment de tutorat et d’encadrement, d’aide à la planification et à la transition vers l’enseignement postsecondaire, de programmes de compétences éducatives, de formation (par exemple, en sciences, technologie, ingénierie, arts ou mathématiques) et de mentorat (tel que le soutien par les pairs). En outre, les organisations financées offrent une variété de mesures de soutien intégrées aux étudiants pour les aider à surmonter les obstacles (décrits dans la section 4) qui peuvent compromettre leurs efforts visant à atteindre leurs objectifs académiques;
- 10 offrent un soutien diversifié en matière de santé mentale, de toxicomanie, de bien-être et de résilience. Il s’agit notamment d’activités parascolaires (par exemple activités traditionnelles ou culturelles, sportives, artistiques, nutritionnelles ou en lien avec la nature), de mesures de soutien générales (comme le soutien par les pairs), de programmes de santé mentale fondés sur des données probantes, de thérapies et de services de prévention et d’intervention axés sur la toxicomanie;
- 10 fournissent un soutien en ligne ou améliorent la connectivité des étudiants, y compris sur le plan de la littératie numérique et de la formation spécialisée, en fournissant ou en finançant l’accès à la technologie (par exemple, l’accès aux logiciels et au matériel informatique), en développant des partenariats et en soutenant la capacité locale d’accès aux services Internet et à des espaces d’étude;
- 9 proposent des activités liées au perfectionnement professionnel, notamment le mentorat, les stages, la préparation aux compétences professionnelles (par exemple la communication, l’autorégulation, les entrevues, les ateliers sur les carrières et les CV et l’aide à l’obtention d’un emploi);
- 8 travaillent avec les employés pour améliorer leur capacité à mieux soutenir les étudiants;
- 6 aident les étudiants à développer des compétences non techniques;
- 5 offrent un soutien financier direct aux étudiants pour les aider à payer les divers coûts liés à la participation aux études secondaires et postsecondaires (par exemple, les frais de scolarité, les frais de demande auprès d’établissements postsecondaires, les frais de transport vers l’école, le coût du diner de l’étudiant, les frais liés aux mesures d’adaptation);
- 4 soutiennent les familles des étudiants, le développement des compétences des parents (éducation des enfants, éducation financière, cours sur la grossesse et la période prénatale), et l’aiguillage vers les services de défense des droits (par exemple pour obtenir un logement, accéder aux ressources, réduire les obstacles à la participation, réunir les jeunes avec leurs enfants, établir des liens avec les prestations de garde d’enfants et les mesures de soutien au revenu).
Des exemples concrets de projets du volet 1 sont présentés à l’annexe D.
5.2. L’appel de propositions par processus concurrentiel pour les accords du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
Les accords de financement signés en 2022 et 2023Notes de bas de page 13 s’inscrivent dans les objectifs du Programme. Toutefois, nombre de ces organisations ont exprimé des inquiétudes quant à la stabilité des projets. En effet, comme cela a été mentionné au cours des entrevues, elles tentent d’atténuer des difficultés systémiques et à long terme avec des financements à court terme et imprévisibles.
L’évaluation révèle que les signataires des accords en 2022 à 2023 s’appuient sur des pratiques efficaces pour soutenir les divers sous-groupes d’étudiants. En outre, ils offrent des programmes qui cadrent bien avec les objectifs du volet 1 du Programme. Les projets financés soutiennent également des étudiants issus de groupes mal desservis que le Programme a repérés. Ils ont également le potentiel de générer et de diffuser des pratiques innovantes pour soutenir les étudiants.
Cependant, la plupart des représentants de ces organisations interrogés s’inquiètent de la stabilité des projets pour 2 raisons essentiellement. En effet, les accords d’une durée d’1 an ont rendu la planification et l’atténuation des obstacles systémiques complexes difficiles pour les organisations. Ces obstacles comprennent la pauvreté, l’itinérance, le manque de soutien de la part des parents, la discrimination, l’accessibilité pour les étudiants handicapés, le manque d’accès à l’Internet et aux technologies. En outre, dans le cadre du processus d’appel de propositions, les informateurs clés ont constaté des retards dans l’annonce des propositions retenues. Ainsi, l’allocation des fonds aux organisations et le soutien aux étudiants ont également été retardés.
La courte période de l’accord, combinée aux retards dans la réception des fonds, a entraîné des défis supplémentaires pour les organisations. Les voici, du plus important au moins important :
- difficultés de recrutement et de maintien en poste du personnel. Ce problème est dû à la courte période entre la décision de financement et le début des activités. Il est également attribuable à la courte durée de l’emploi;
- retard des projets et annulation des activités;
- décalage entre le versement des fonds et l’année scolaire.
Bien que le Programme ait approuvé ces accords de financement en mars 2022, certaines organisations ont confirmé qu’elles n’avaient reçu le financement qu’en août ou septembre 2022. Par conséquent, elles ont dû développer des partenariats avec des organisations au service des jeunes et d’autres partenaires en peu de temps. En outre, ces organisations ont dû prendre davantage de risques financiers en planifiant ou en menant des activités sans savoir si elles recevraient des fonds.
Les activités d’une cohorte d’étudiants (s’étendant généralement de septembre à juin) chevauchent 2 exercices. L’incertitude liée à l’obtention d’un financement sur 2 exercices consécutifs a empêché les organisations de soutenir pleinement une cohorte.
Les fonctionnaires d’EDSC et les représentants des organisations financées ont fait remarquer que des accords pluriannuels pourraient aider les organisations à atténuer l’impact des obstacles mentionnés précédemment. Les accords pluriannuels permettent aux organisations financées de faire ce qui suit :
- établir des partenariats à plus long terme;
- soutenir une cohorte d’étudiants pendant plus d’une année;
- avoir un impact à plus long terme;
- embaucher du personnel sur une base plus permanente;
- promouvoir les programmes plus efficacement.
En outre, les accords pluriannuels peuvent atténuer les problèmes suivants :
- les retards liés à l’approbation du budget et à l’allocation des fonds;
- le décalage entre l’exercice financier et l’année scolaire.
Le représentant d’une organisation a mentionné que la première année de l’accord de contribution a permis de développer une réputation au sein de la communauté ciblée et des pratiques exemplaires. La plupart des représentants des organisations ont fait part de leurs préoccupations concernant la structure de financement à court terme du Programme et le risque de ne pas renouveler le financement ou de ne pas trouver d’autres partenaires financiers.
Selon les représentants des organisations non-demanderesses interrogéesNotes de bas de page 14, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas présenté de demande comprennent :
- le décalage entre les objectifs du Programme et les activités de l’organisation;
- le manque d’expérience ou de compréhension de la procédure de demande du gouvernement fédéral;
- les ressources ou le personnel disponibles limités pour remplir la demande et élargir les activités de l’organisation;
- elles ne savent pas si les ressources que les organisations consacrées à la demande aboutiront à un financement.
6. Volet 1 – Résultats du programme
6.1. Passeport pour ma réussite Canada
Passeport pour ma réussite Canada a eu un effet positif sur le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires des participants et a contribué à l’augmentation du nombre d’inscriptions aux études postsecondaires. Il a également eu un effet positif sur la préparation à l’emploi et les résultats des participants sur le marché du travail.
Selon l’analyse documentaire, le programme Passeport pour ma réussite a soutenu 6 386 étudiants en 2019, 6 512 en 2020 et 6 209 en 2021. Le programme Passeport pour ma réussite comptait au total 31 sites en 2021 (contre 27 en 2020 et 20 en 2019). Au cours de l’année scolaire 2020 à 2021, il y a eu :
- 15 sites au Québec;
- 9 en Ontario;
- 2 en Colombie‑Britannique;
- 1 en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick et en Nouvelle‑écosse.
Les tableaux 3 et 4 fournissent des renseignements supplémentaires sur le profil des participants pour la période 2012 à 2021, sur la base de la déclaration volontaire des participants.
Les sites de Passeport pour ma réussite en Colombie‑Britannique comptaient plus d’hommes que de femmes. Cette situation contraste avec d’autres provinces qui comptaient plus de femmes que d’hommes parmi leurs participants. C’est dans les sites de l’Ontario que l’on trouve la plus grande proportion de participants nés hors du Canada (28 %). Vient ensuite le site du Nouveau‑Brunswick avec 22 % des participants. Par ailleurs, c’est le site du Manitoba qui comptait la plus grande proportion de participants autochtones (52 %). Viennent ensuite les sites de Colombie‑Britannique avec 16 % de participants autochtones. C’est au Québec que l’on trouve la plus grande proportion de participants souffrant d’un handicap physique (4 %).
| Provinces où il y a des sites Passeport | Nombre unique de participant | Proportion de participants d'une province par rapport à l'ensemble des participants de Passeport |
|---|---|---|
| Nouvelle-écosse | 791 | 6,1% |
| Nouveau-Brunswick | 148 | 1,2% |
| Québec | 1 599 | 12,4% |
| Manitoba | 896 | 7,0% |
| Colombie-Britannique | 604 | 4,7% |
| Ontario | 8 829 | 68,6% |
- Source: Goss Gilroy (2021) évaluation du programme Passeport pour ma réussite.
| Provinces | Femmes | Participant nés à l'extérieur du Canada | Participants autochtones | Participants avec un handicap physique |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-écosse | 54% | 14% | <1% | <1% |
| Nouveau-Brunswick | 56% | 22% | 4% | <1% |
| Québec | 55% | 3% | <1% | 4% |
| Ontario | 51% | 28% | 1% | <1% |
| Manitoba | 59% | <1% | 52% | <1% |
| Colombie-Britannique | 44% | 13% | 16% | <1% |
- Source: Goss Gilroy (2021) évaluation du programme Passeport pour ma réussite.
Passeport pour ma réussite a eu une incidence positive sur le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires des participants
Selon les rapports d’activité du programme Passeport pour ma réussiteNotes de bas de page 15, au cours de la période d’évaluation, le taux de diplomation se situait entre 69 % et 77 % en moyenne. Dans l’ensemble des sites du programme Passeport pour ma réussite observés, le taux de diplomation s’est amélioré de manière significative par rapport aux étudiants non admissiblesNotes de bas de page 16. Selon l’évaluation par un tiers de Goss Gilroy, par rapport aux étudiants présentant des caractéristiques similaires, le taux de diplomation était en moyenne 22,2 % plus élevé pour les participants des sites de l’Ontario. Le taux de diplomation était 37,6 % plus élevé pour les participants du QuébecNotes de bas de page 17. Cependant, le taux moyen de diplomation des participants du site d’Halifax s’élevait à 17,9 %, soit un taux inférieur à celui des non participantsNotes de bas de page 18.
Passeport pour ma réussite a contribué à l’augmentation du nombre d’inscriptions aux études postsecondaires
Passeport pour ma réussite Canada a aidé les étudiants à prendre part à l’enseignement postsecondaire. Le Programme a aidé les étudiants à s’inscrire dans des établissements d’enseignement postsecondaire. De 2019 à 2021, entre 68 % et 74 % des étudiants participants ont effectué une transition vers l’enseignement postsecondaire ou la formation, en fonction de la cohorte. Selon l’évaluation par les tiers réalisée par Goss Gilroy Inc., il existe des preuves qualitatives que le Programme a aidé les participants à présenter une demande dans un établissement d’enseignement postsecondaire, à y être acceptés et à s’y inscrire. Cela est attribuable principalement aux mesures d’aide financières et non financières souples et adaptées.
Passeport pour ma réussite Canada a eu un effet positif sur la préparation à l’emploi et les résultats sur le marché du travail
D’après l’analyse documentaire, le programme Passeport pour ma réussite a aidé les étudiants participants à se préparer à l’emploi. Selon l’évaluation du programme Passeport pour ma réussite réalisée par EDSC en 2019, le Programme a obtenu un rendement social positif net des investissements. L’avantage social net pour un seul étudiant du programme Passeport pour ma réussite s’est traduit par un rendement du capital investi de 50 % sur 25 ans, tant pour le participant que pour les gouvernements. Ce résultat a été obtenu en comparant les résultats des participants à ceux d’une population comparableNotes de bas de page 19.
D’après cette analyse, un investissement dans le programme atteint « le seuil de rentabilité » (seuil où les profits sont équivalents aux coûts) après 22,5 ans du point de vue du gouvernement. L’investissement atteint le seuil de rentabilité au bout de 20,8 ans si l’on tient compte des avantages pour les étudiants et pour le Canada.
6.2. Indspire
De 2019 à 2022, le taux de diplomation postsecondaire et les résultats sur le marché du travail des participants à Indspire sont supérieurs à ceux des autres étudiants autochtones. Selon les rapports d’activité d’Indspire, l’organisation a octroyé près de 20 millions de dollars au moyen de 6 240 bourses d’études au cours de l’exercice 2020 à 2021. Au cours de l’exercice 2021 à 2022, l’organisation a accordé plus de 23 millions de dollars sous la forme de 6 599 bourses d’études à des jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis. D’après les données administratives d’Indspire, entre 2013 et 2020, 62,6 % des bénéficiaires se sont identifiés comme étant membres des Premières Nations. En outre, 31,4 % se sont identifiés comme étant Métis, 3 % comme Inuits et 2,9 % comme membres des Premières Nations non inscrites.
Indspire a eu un effet positif sur le taux de diplomation postsecondaire des étudiants autochtones
Selon les données administratives d’Indspire, 90 % des bénéficiaires de bourses Indspire ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires. Plus de 75 % des bénéficiaires de bourses Indspire ont obtenu leur diplôme d’études postsecondaires dans le temps prévu. En outre, 88,4 % ont obtenu leur diplôme dans les 4 ans suivant la date prévue. Selon les données administratives d’Indspire, près de 60 % des bénéficiaires étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur.
Indspire a eu un effet positif sur les résultats obtenus sur le marché du travail
La plupart des bénéficiaires de bourses Indspire interrogés (89,4 %) avaient un emploi en 2020, selon l’enquête nationale sur l’éducation d’Indspire. Il s’agit des bénéficiaires de bourses d’études entre 2013 et 2020. En comparaison, cette proportion est de 75,9 % pour l’ensemble de la population autochtone du Canada. Au cours de l’exercice 2020 à 2021, plus de 76 % des bénéficiaires de bourses sont entrés sur le marché du travail ou ont poursuivi leurs études ou leur formation.
6.3. Autres accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants
De 2019 à 2022, les organisations financées par les autres accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants ont aidé les étudiants à atteindre leurs objectifs éducatifs. Toutefois, comme la plupart des projets sont relativement récents (2 à 3 ans d’existence), les données disponibles sur les résultats des projets pour les utilisateurs finaux sont limitées.
Dans l’ensemble, 34 648 étudiants ont bénéficié de projets financés dans le cadre des accords du programme Droit au but et 16 505 étudiants ont bénéficié de projets financés dans le cadre des mesures d’urgence relatives à la COVID‑19Notes de bas de page 20. Cependant, il n’est pas possible de fournir des données agrégées sur les participants en fonction de facteurs sociodémographiques, et ce pour de nombreuses raisons, par exemple :
- variété des groupes desservis;
- divers niveaux de maturité du projet;
- différences des niveaux de maturité des organisations financées.
En outre, en raison de la maturité limitée du projet, le Programme recueille peu de données pour expliquer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats intermédiaires et finaux, notamment les suivants :
- obtention du diplôme de fin d’études secondaires;
- l’accès aux études postsecondaires;
- transition vers le marché du travail.
L’annexe D contient des renseignements détaillés sur les réalisations et les résultats par projet, ainsi que d’autre renseignements sur le rendement.
Parmi les représentants des organisations au service des jeunes interrogésNotes de bas de page 21 :
- plus des trois quarts (84,4 %) étaient d’avis que leur projet offrait aux étudiants la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences;
- plus des trois quarts (78,9 %) ont indiqué que les projets ont aidé les étudiants à gagner en motivation personnelle, en confiance ou en estime de soi;
- plus de deux tiers (71,6 %) des représentants estiment que leurs projets ont aidé les étudiants à surmonter l’influence négative de leurs pairs.
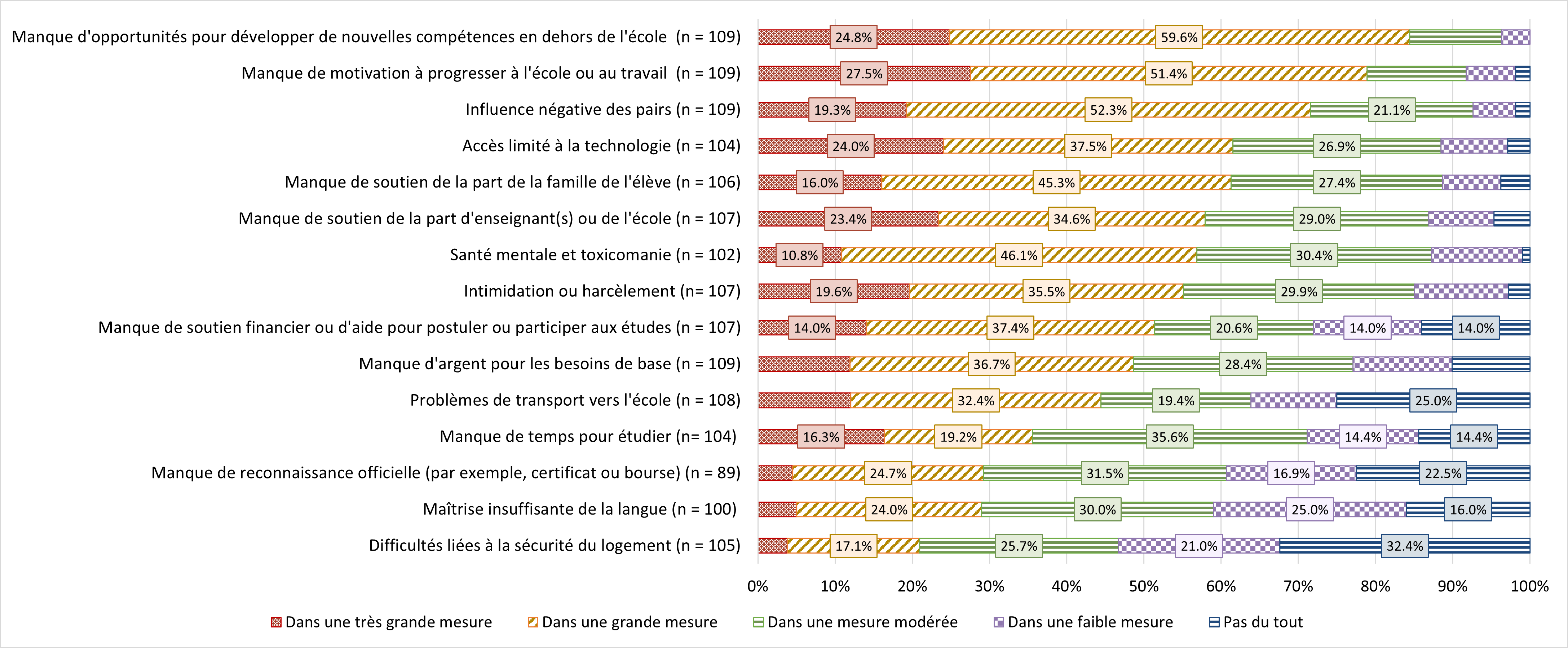
- Source: Sondage sur le soutien à l’apprentissage des étudiants auprès de représentants d’organisations au service des jeunes (entre 89 et 109 répondants).
Description textuelle – Graphique 11
| Difficultés | Dans une très grande mesure | Dans une grande mesure | Dans une mesure modérée | Dans une faible mesure | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|---|
| Manque d’opportunités pour développer de nouvelles compétences en dehors de l’école (n = 109) | 25% | 60% | 12% | 4% | 0% |
| Manque de motivation à progresser à l’école ou au travail (n = 109) | 28% | 51% | 13% | 6% | 2% |
| Influence négative des pairs (n = 109) | 19% | 52% | 21% | 6% | 2% |
| Accès limité à la technologie (n = 104) | 24% | 38% | 27% | 9% | 3% |
| Manque de soutien de la part de la famille de l’élève (n = 106) | 16% | 45% | 27% | 8% | 4% |
| Manque de soutien de la part d’enseignant(s) ou de l’école (n = 107) | 23% | 35% | 29% | 8% | 5% |
| Santé mentale et toxicomanie (n = 102) | 11% | 46% | 30% | 12% | 1% |
| Intimidation ou harcèlement (n= 107) | 20% | 36% | 30% | 12% | 3% |
| Manque de soutien financier ou d’aide pour postuler ou participer aux études (n = 107) | 14% | 37% | 21% | 14% | 14% |
| Manque d’argent pour les besoins de base (n = 109) | 12% | 37% | 28% | 13% | 10% |
| Problèmes de transport vers l’école (n = 108) | 12% | 32% | 19% | 11% | 25% |
| Manque de temps pour étudier (n= 104) | 16% | 19% | 36% | 14% | 14% |
| Manque de reconnaissance officielle (par exemple, certificat ou bourse) (n = 89) | 4% | 25% | 31% | 17% | 22% |
| Maîtrise insuffisante de la langue (n = 100) | 5% | 24% | 30% | 25% | 16% |
| Difficultés liées à la sécurité du logement (n = 105) | 4% | 17% | 26% | 21% | 32% |
6.4. Innovation, leçons apprises et pratiques prometteuses
Dans une certaine mesure, les organisations financées dans le cadre du volet 1 du Programme et leurs partenaires définissent des pratiques innovantes pour soutenir les étudiants mal desservis. Ils déterminent également des pratiques prometteuses et des leçons apprises et communiquent leurs constatations au moyen de divers outils de diffusion ou d’événements.
Selon l’analyse documentaire et les informateurs clés, de nombreux projets génèrent des pratiques prometteuses et des leçons apprises dans le cadre de diverses approches, y compris la recherche et l’évaluation. Toutefois, la capacité à définir les leçons apprises et les pratiques prometteuses dépend des éléments suivants :
- la maturité des projets;
- les objectifs des organisations financées;
- L’impact de la COVID sur le projet et sur la communauté desservie.
D’après les entrevues avec les informateurs clés, 2 groupes sont plus susceptibles d’élaborer et de diffuser les leçons apprises et les pratiques prometteuses :
- des projets plus matures ou des organisations financées;
- des projets ou des organisations dont l’objectif est de définir et de diffuser les leçons apprises et les pratiques prometteuses.
Les organisations financées font également part des pratiques prometteuses et des leçons apprises :
- sur leurs sites Web (avec des rapports d’études quantitatives et qualitatives);
- dans le bulletin d’information aux partenaires et aux experts dans le domaine;
- en organisant des présentations et des conférences;
- en transmettant les connaissances aux partenaires et comités d’experts.
Toutefois, du point de vue de la durabilité, il sera difficile de conserver et de mettre à jour les plateformes d’échange des connaissances en ligne si le financement devait prendre fin.
Les organisations partenaires financées explorent ou testent également des approches innovantes qui permettent de surmonter les obstacles persistants auxquels les étudiants sont confrontés ou d’améliorer les résultats de ces derniers. Les trois quarts des représentants d’organisations au service des jeunes interrogés (75 %) ont indiqué que leur organisation élaborait des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La plupart de ces organisations (60,9 %) effectuent des recherches et études. La majorité des organisations dans ce groupe mène des projets pilotes (82 %) ou des enquêtes (64 %). D’autres se sont appuyés sur d’autres techniques de recherche, notamment les entrevues semi-structurées, l’analyse d’impact, l’analyse coûts-avantages ou la collecte de données anecdotiques.
Environ un tiers des organisations interrogées (37,9 %) travaillent en partenariat avec des chercheurs et d’experts en évaluation (par exemple des universités ou des instituts de recherche).
La majorité des représentants des organisations au service des jeunes interrogés (52,9 %) ont indiqué que leur organisation communiquait les leçons apprises et pratiques prometteuses. Elles le font de diverses manières :
- publications et rapports de recherche;
- présentations lors de conférences;
- présentations aux organismes partenaires;
- présentations au personnel;
- bulletins;
- webinaire ou publication d’information en ligne;
- publications dans les médias sociaux.
Les informateurs clés externes ont indiqué que le Programme devrait organiser davantage d’événements virtuels ou en personne pour communiquer les pratiques prometteuses et les leçons apprises. Ces événements pourraient se faire au niveau local, régional et national. Selon les informateurs clés, le Programme pourrait servir de point central pour générer et communiquer les pratiques exemplaires.
Il en découlerait de multiples avantages, notamment celui de développer des partenariats avec d’autres organisations similaires ou avec des organisations qui fournissent des services complémentaires. De nombreuses organisations financées par le Programme collaborent déjà pour mieux soutenir les étudiants.
En outre, les leçons apprises et les pratiques prometteuses pourraient servir aux organisations qui ne reçoivent pas actuellement de financement du Programme. Selon les représentants des organisations de jeunesse interrogées, les sujets sur lesquels leur organisation pourrait acquérir des connaissances sont les suivants, du plus cité au moins cité :
- obstacles pour les élèves sous-représentés à l’atteinte des résultats en matière d’études et pratiques efficaces pour y parvenir (63,2 %);
- obstacles à l’atteinte des résultats en matière d’études et pratiques efficaces pour y parvenir (53,8 %);
- développement de partenariats (50,4 %);
- pratiques prometteuses pour faire face aux nouveaux défis et obstacles (50,4 %);
- faire connaître le projet aux étudiants sous-représentés (48,7 %);
- recherche de participants potentiels (39,3 %);
- gestion des risques (39,3 %);
- pratiques prometteuses pour la communication des résultats (32,4 %);
- faire de la recherche et élaborer des pratiques prometteuses (25,6 %).
6.5. Partenariats
Le volet 1 du Programme profite également aux organisations au service des jeunes en partenariat avec les organisations financées par le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. Grâce à leur partenariat, elles ont accès à des mesures de soutien financières et non financières supplémentaires. En outre, les partenariats renforcent la crédibilité et la stabilité de leurs programmes et leur permettent d’atteindre de nouveaux étudiants. En outre, les avantages comprennent l’accès à un réseau pancanadien d’organisations au service des jeunes. Elles ont également accès à des pratiques innovantes pour les aider à soutenir les étudiants de manière plus efficace.
Selon les fonctionnaires interrogés, les partenariats créés dans le cadre du Programme ont été bénéfiques à la fois pour leur organisation et pour les organisations financées par le volet 1.
Plus des trois quarts des représentants des fournisseurs de services interrogés (85,6 %) estiment que les organisations financées les aident à fixer des objectifs communs; par exemple : définir une stratégie commune pour le fournisseur de services et l’organisation financée afin de soutenir les étudiants. Une proportion similaire (80,5 %) estime que le partenariat a contribué à accroître la capacité de l’organisation à soutenir les étudiants. Le partenariat a également renforcé la crédibilité de l’organisation au sein de la communauté (82,2 %). Les participants au sondage ont également noté que les partenariats augmentaient la portée de leur organisation (73,7 %).
Enfin, la plupart des représentants des organisations au service des jeunes interrogés pensent que les partenariats sont bénéfiques pour faire ce qui suit :
- définir une stratégie commune de mesure du rendement ou d’établissement de rapports (72,0 %);
- accroître la portée de l’organisation financée (70,5 %);
- développer des partenariats avec d’autres organisations (61,7 %);
- trouver ou obtenir un financement supplémentaire (54,2 %) (consulter le graphique 12).
Certaines organisations ont indiqué que les organisations financées fournissaient de l’équipement et du soutien qu’elles pouvaient utiliser en dehors du Programme. C’est particulièrement le cas pour les organisations qui ont servi les étudiants qui n’ont pas accès à la technologie.
En outre, les représentants des organisations au service des jeunes interrogés ont indiqué qu’ils bénéficiaient du réseau fourni par leur organisation financée dans le cadre du volet 1. Les organisations partenaires développent désormais des partenariats dans tout le pays. Les organisations financées dans le cadre du volet 1 partagent divers matériels d’apprentissage et organisent des conférences, au cours desquelles les organisations partenaires peuvent mettre en commun les pratiques exemplaires et leçons apprises.
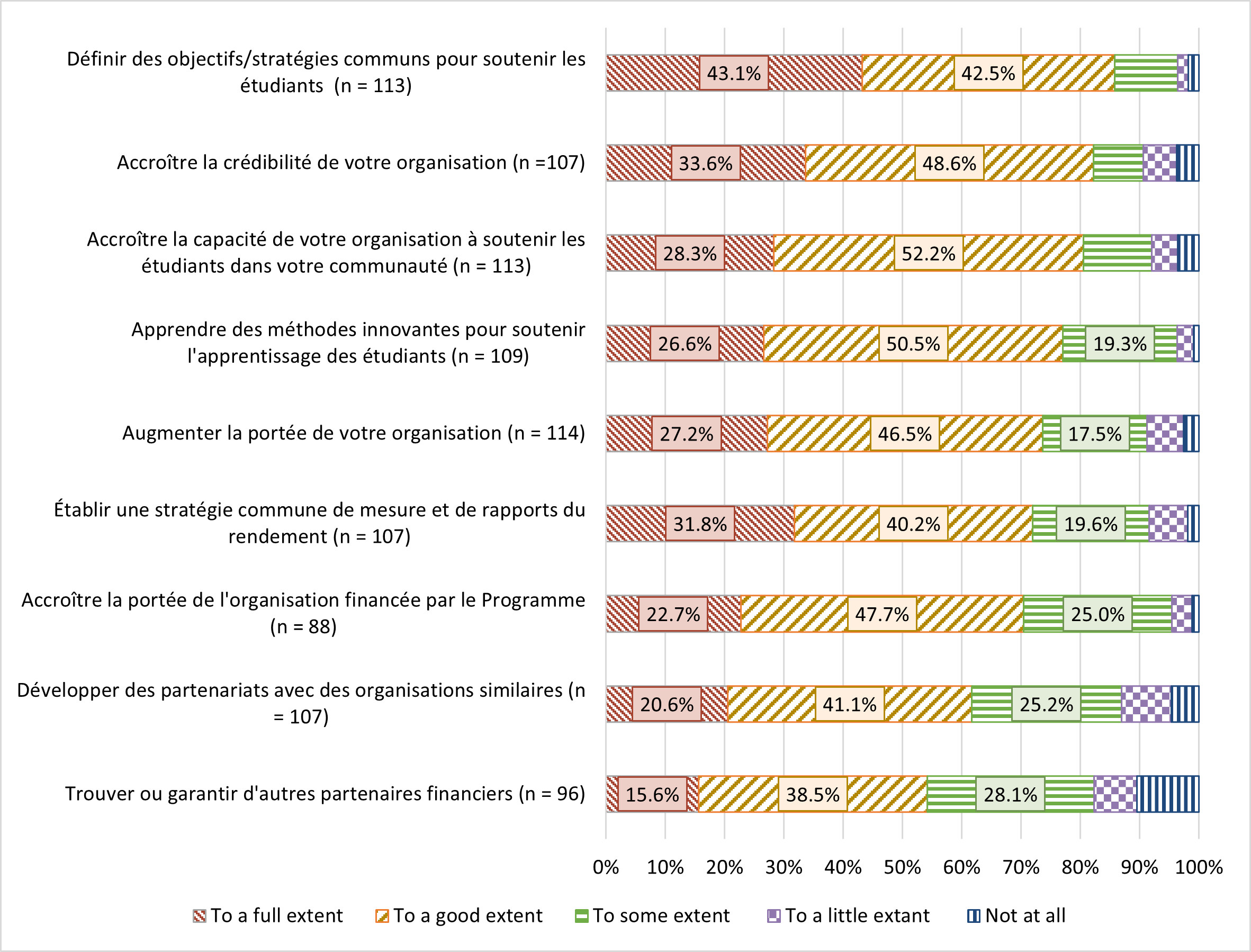
- Source: Sondage sur le soutien à l’apprentissage des étudiants auprès de représentants d’organisations au service des jeunes (entre 88 et 114 répondants).
Description textuelle – Graphique 12
| Avantages | Dans une très grande mesure | Dans une grande mesure | Dans une mesure modérée | Dans une faible mesure | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|---|
| Définir des objectifs/stratégies communs pour soutenir les étudiants (n = 113) | 43,1% | 42,5% | 10,6% | 1,8% | 1,8% |
| Accroître la crédibilité de votre organisation (n =107) | 33,6% | 48,6% | 8,4% | 5,6% | 3,7% |
| Accroître la capacité de votre organisation à soutenir les étudiants dans votre communauté (n = 113) | 28,3% | 52,2% | 11,5% | 4,4% | 3,5% |
| Apprendre des méthodes innovantes pour soutenir l'apprentissage des étudiants (n = 109) | 26,6% | 50,5% | 19,3% | 2,8% | 0,9% |
| Augmenter la portée de votre organisation (n = 114) | 27,2% | 46,5% | 17,5% | 6,1% | 2,6% |
| établir une stratégie commune de mesure et de rapports du rendement (n = 107) | 31,8% | 40,2% | 19,6% | 6,5% | 1,9% |
| Accroître la portée de l'organisation financée par le Programme (n = 88) | 22,7% | 47,7% | 25,0% | 3,4% | 1,1% |
| Développer des partenariats avec des organisations similaires (n = 107) | 20,6% | 41,1% | 25,2% | 8,4% | 4,7% |
| Trouver ou garantir d'autres partenaires financiers (n = 96) | 15,6% | 38,5% | 28,1% | 7,3% | 10,4% |
7. Volet 2 – Expérience compétences mondiales
Malgré ses avantages pour les étudiants et le pays dans son ensemble, les étudiants canadiens sont moins nombreux à étudier ou à travailler à l’étranger que ceux des autres pays de l’OCDE. Les premières données laissent entrevoir que les étudiants handicapés, les étudiants autochtones et les étudiants issus de familles à faible revenu participent encore moins en raison d’obstacles particuliers. Les ressources limitées des établissements d’enseignement postsecondaire restreignent leur capacité à offrir un soutien sur mesure aux étudiants qui étudient dans des pays non traditionnels.
Lors des restrictions de voyage liées à la pandémie, le Fonds d’innovation pour le programme Expérience compétences mondiales a contribué à l’élaboration de leçons apprises et de pratiques prometteuses. De 2020 à 2021, environ 13 600 étudiants canadiens ont bénéficié directement des activités financées par ce Fonds d’innovation. En outre, les projets financés ont permis de développer des partenariats avec des établissements d’enseignement postsecondaires dans près de 50 pays.
7.1. Avantages liés aux possibilités d’études et de travail à l’étranger pour les étudiants
Selon la documentation, 11 % des étudiants canadiens décident d’étudier ou de travailler à l’étranger. Ce taux est inférieur à celui des étudiants français (33 %), allemands (29 %), australiens (19 %) et américains (16 %). (Affaires mondiales Canada, 2019)
L’analyse documentaire et les entrevues avec les informateurs clés révèlent que le financement de possibilités d’études et de travail à l’étranger profite aux étudiants et au Canada.
Ceci inclus les avantages suivant pour les étudiants :
- développer des compétences non techniques (comme la résolution de problèmes, la communication et le travail d’équipe);
- développer des aptitudes et des compétences concordant avec les aptitudes requises dans le milieu de travail;
- préciser l’orientation académique et professionnelle;
- augmenter le taux de diplomation et les résultats en matière d’emploi;
- développer un réseau international, y compris avec des employeurs potentiels;
- mieux comprendre les régions économiques importantes pour le Canada.
Ça inclus aussi les avantages suivant pour le Canada :
- s’adapter aux réalités mondiales en évolution. Les Canadiens doivent acquérir des connaissances au sujet des pays émergents, de plus en plus importants, et créer un réseau international;
- s’adapter à l’évolution de la nature du travail;
- renforcer les valeurs d’ouverture. L’apprentissage dans une optique mondiale renforce la compréhension interculturelle et l’appréciation de sociétés diversifiées;
- rester compétitif parmi les partenaires de l’OCDE. D’autres pays de l’OCDE ont mis en place des programmes de soutien aux étudiants voyageant dans des pays non traditionnels.
7.2. Obstacles à l’étude ou au travail à l’étranger pour les étudiants sous-représentés
Peu de données sont disponibles sur le nombre d’étudiants sous-représentés qui participent à des possibilités d’études et de travail à l’étranger. D’après les données recueillies dans le cadre de la présente évaluation, les étudiants sous-représentés sont confrontés à des obstacles particuliers lorsqu’il s’agit de travailler ou d’étudier à l’étranger. Il s’agit notamment des étudiants handicapés, des étudiants autochtones et des étudiants issus de familles à faible revenu.
Coûts supplémentaires pour les populations mal desservies
Selon les représentants d’établissements postsecondaires interrogés, les principaux obstacles qui empêchent les étudiants sous-représentés d’étudier ou de travailler à l’étranger sont liés à leur situation financière. Parmi les représentants interrogés, 91 % estiment que les obligations financières des étudiants constituent l’un de ces obstacles. Il peut s’agir, par exemple, de payer les frais liés à l’éducation, les dépenses personnelles et l’aide aux personnes à charge.
En outre, 83 % des représentants interrogés ont indiqué que le manque de soutien financier ou les contraintes financières constituent un obstacle majeur aux études ou au travail à l’étranger pour les étudiants sous-représentés. Par exemple, voyager lorsque l’on a une invalidité peut être associé à des coûts supplémentaires (par exemple, le transport de l’équipement, l’équipement supplémentaire et les aides nécessaires). Pour les étudiants autochtones vivant dans des régions isolées, les coûts liés aux déplacements sont généralement plus élevés. En outre, les étudiants autochtones sont plus susceptibles de vivre dans des ménages à faible revenu.
Par ailleurs, 80 % des représentants interrogés ont indiqué qu’en raison principalement du manque de ressources financières des établissements postsecondaires canadiens, il était difficile d’offrir des possibilités d’études et de travail à l’étranger.
Méconnaissance de l’aide disponible et mesures de soutien et de renseignements non adaptés aux étudiants sous-représentés
Parmi les représentants d’établissements d’enseignement postsecondaire interrogés, 66 % estiment que les étudiants ne connaissent pas les mesures de soutien financières disponibles. Un examen de la recherche sur la réduction des obstacles pour les étudiants a confirmé cette constatation. Les ressources et les renseignements sur le travail et les études à l’étranger ne sont pas adaptés aux besoins des étudiants sous-représentés. Cette situation concerne les étudiants handicapés, les étudiants autochtones et les étudiants vivant dans des foyers à faible revenu.
Selon certains représentants interrogés, les établissements ne savent pas comment adapter leurs mesures de soutien aux besoins des étudiants sous-représentés. En outre, les étudiants sous-représentés et leur famille sont moins susceptibles d’avoir déjà voyagé. Il en résulte un besoin de soutien supplémentaire pour les éléments fondamentaux du voyage. Il s’agit notamment d’une aide à l’obtention d’un passeport et à la réservation d’un voyage.
L’insuffisance des ressources constitue un défi pour les établissements d’enseignement postsecondaire qui proposent des programmes d’études et de travail à l’étranger adaptés aux étudiants sous-représentés, comme l’ont fait remarquer 57 % des représentants interrogés. Les établissements d’enseignement postsecondaire d’autres pays ne disposent pas nécessairement des ressources requises pour former le personnel à mieux soutenir les étudiants sous-représentés à leur arrivée.
Autres obstacles
Selon les représentants interrogés, d’autres raisons expliquent pourquoi les étudiants sous-représentés n’étudient pas ou ne travaillent pas à l’étranger :
- préoccupations concernant la disponibilité des mesures de soutien et des ressources à l’étranger qui sont disponibles au pays (51 %);
- obligations familiales (49 %);
- opportunités compétitives au Canada (43%);
- préoccupations concernant la sécurité pendant les études ou le travail à l’étranger (43 %);
- manque de soutien de la famille (37 %).
En outre, les étudiants handicapés se heurtent à de nombreux problèmes en lien avec l’accessibilité dans les autres pays. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- options de transport accessibles;
- possibilité d’adaptation à plusieurs types de handicaps;
- accessibilité physique des établissements d’enseignement postsecondaire;
- mesures d’adaptation prises par les partenaires à bord.
Toutes ces considérations nécessitent une préparation et un soutien accrus pour les étudiants handicapés. Bien que certains établissements d’enseignement postsecondaire puissent accueillir des étudiants handicapés, de nombreux étudiants préfèrent ne pas faire part de leur handicap afin d’éviter les répercussions négatives. Beaucoup craignent d’être victimes de discrimination de la part du personnel ou d’autres étudiants.
Selon les représentants des établissements d’enseignement postsecondaires interrogés et les recherches sur la réduction des obstacles, les étudiants autochtones sont également confrontés à des obstacles uniques. Pour certains étudiants, il est difficile de quitter leur communauté. L’histoire et les traumatismes associés aux pensionnats peuvent diminuer le soutien de la famille et de la communauté à l’égard de l’éducation en dehors de leur communauté. C’est pourquoi le programme Expérience compétences mondiales doit inclure une approche complète qui englobe la famille et la communauté de l’étudiant.
7.3. Obstacles à l’étude ou au travail dans des pays non traditionnels
D’après un examen de la documentation, les étudiants canadiens qui étudient à l’étranger choisissent des destinations d’enseignement traditionnelles, à savoir les États‑Unis (56,3 %), le Royaume‑Uni (11,8 %), l’Australie (5,39 %) et la France (5,73 %)Notes de bas de page 22.
Peu d’étudiants décident d’aller étudier dans d’autres pays, en particulier dans des pays émergents comme en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Toutefois, comme indiqué au point 7.1, étudier à l’étranger, en particulier dans des pays non traditionnels, profite à la fois aux étudiants et au pays dans son ensemble. Cela inclut, entre autres, le développement de partenariats et de réseaux solides dans les pays émergentsNotes de bas de page 4.
Il y a de nombreux défis qui font obstacle au travail et aux études dans un pays non traditionnel, comme l’ont indiqué les représentants des établissements d’enseignement postsecondaire interrogés. Les informateurs clés interrogés ont également confirmé l’existence d’obstacles multiples. Bien que le Programme se concentre sur les pays non traditionnels, la plupart des réponses se rapportent aux obstacles liés aux études ou au travail dans les pays émergents.
Coût du travail et des études dans les pays non traditionnels
Selon 84 % des représentants interrogés, les contraintes financières et le manque de soutien financier constituent un obstacle majeur. étudier dans certains pays non traditionnels peut coûter plus cher en matière de transport, de visa et de vaccination. En outre, la majorité des représentants interrogés pensent que les étudiants ne sont pas au courant des mesures de soutien financières disponibles.
Sécurité
Une majorité (55 %) des représentants interrogés estiment que la sécurité est l’un des principaux obstacles qui empêchent les étudiants de travailler ou d’étudier dans des pays non traditionnels. Ils ont indiqué que certains étudiants sous-représentés pouvaient craindre de voyager vers des destinations non traditionnelles. Dans nombre de ces destinations, principalement dans les pays émergents, leur identité peut les mettre en danger en raison de la protection limitée liée aux droits de la personne. Ces populations comprennent les étudiants autochtones, les étudiants 2SLGBTQI+, les étudiants handicapés et les étudiantes. En outre, certaines destinations non traditionnelles sont moins stables sur le plan politique. Cela peut empêcher les étudiants de terminer leur expérience à l’étranger ou augmenter les risques pour leur sécurité une fois sur place.
Obstacles linguistiques et culturels
La plupart des représentants interrogés (52 %) ont indiqué que l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les étudiants est le manque de compétences linguistiques pour étudier dans des pays non traditionnels. De nombreuses personnes interrogées ont indiqué que les étudiants souhaitaient étudier dans leur langue maternelle. Or, la plupart des établissements postsecondaires des pays non traditionnels d’Amérique latine ou d’Asie ne proposent pas de programmes en français ou en anglais. En outre, certains représentants interrogés ont indiqué que les étudiants doivent apprendre quelques notions de base sur la culture et les exigences politiques et administratives de la destination. Cela peut représenter une charge supplémentaire pour certains étudiants.
Voici des exemples d’autres obstacles mentionnés :
- préoccupations concernant la possibilité de retard dans l’obtention du diplôme en raison des études ou du travail à l’étranger (42 %);
- préoccupations concernant la disponibilité des mesures de soutien et des ressources à l’étranger qui sont disponibles au pays (42 %);
- manque de soutien de la famille (42 %);
- manque d’information à la disposition des étudiants (39 %);
- manque de possibilités ou de programmes à l’étranger (36 %);
- difficultés liées à la réglementation (par exemple, visa, lois) (33 %);
- manque d’intérêt des étudiants (24 %);
- difficultés liées à la reconnaissance des crédits (18 %).
7.4. Fonds d’innovation
En raison des restrictions de voyage liées à la COVID 19, les programmes d’étude et les expériences de travail en personne dans le cadre du programme Expérience compétences mondiales ont été retardés. En conséquence, les organisations financées ont alloué une partie du Fonds d’innovation du programme Expérience compétences mondiales pour soutenir des projets innovants dans les établissements d’enseignement postsecondaire. Le plan initial prévoyait de distribuer le financement pour l’innovation aux établissements d’enseignement postsecondaire en même temps que le financement destiné aux études en présentiel et aux expériences professionnelles. Cependant, en raison de la COVID 19, le Programme a distribué 50 % du financement (soit 4,4 millions de dollars) alors que des restrictions de voyage étaient en vigueur.
En 2020 et 2021, les organisations financées ont contribué à la réalisation d’un total de 130 projets innovants visant à déterminer les leçons apprises et les pratiques prometteuses. Il s’agit de 117 projets individuels et de 13 projets de consortiums. Parmi les 171 projets :
- 51 portaient sur la recherche sur la réduction des obstacles;
- 49 portaient sur les mesures de soutien intégrées;
- 36 portaient sur la mobilité virtuelle;
- 17 étaient axés sur le marketing et le recrutement;
- 11 portaient sur la gestion des risques;
- 7 portaient sur la création de partenariats.
| Catégorie de projets | Collèges du Canada | Universités du Canada | Total |
|---|---|---|---|
| Marketing et recrutement | 9 | 8 | 17 |
| Créations de partenariats | 7 | 0 | 7 |
| Recherche sur la réduction des obstacles | 13 | 38 | 51 |
| Gestion des risques | 3 | 8 | 11 |
| Mobilité virtuelle | 17 | 19 | 36 |
| Mesures de soutien intégrées | 20 | 29 | 49 |
| Total | 69 | 102 | 171 |
- Sources: Collèges du Canada (2021) Rapport sur le fonds d’innovation – 2020 à 2021 et Universités du Canada (2021) Rapport sur le fonds d’innovation – 2020 à 2021.
De 2020 à 2021, 13 691 étudiants ont directement participé à des activités financées par le Fonds d’innovation. Ces projets comprenaient un grand nombre d’étudiants issus des populations ciblées, notamment :
- 1 348 étudiants autochtones (environ 10 %);
- 2 403 étudiants handicapés (environ 18 %);
- 2 438 étudiants issus de familles à faible revenu (environ 18 %).
Il est à noter que ces étudiants n’ont pas participé à des possibilités à l’étranger en raison de restrictions de voyage. Cependant, ils ont participé à d’autres possibilités au Canada (par exemple des expériences de mobilité virtuelle). En outre, dans le cadre du Fonds d’innovation, les établissements postsecondaires financés par les programmes ont développé des partenariats avec des établissements postsecondaires de 49 pays. Parmi eux, 45 pays non traditionnels (consulter le graphique 13). Ces partenariats seront bénéfiques pour les futures possibilités offertes à l’étranger.
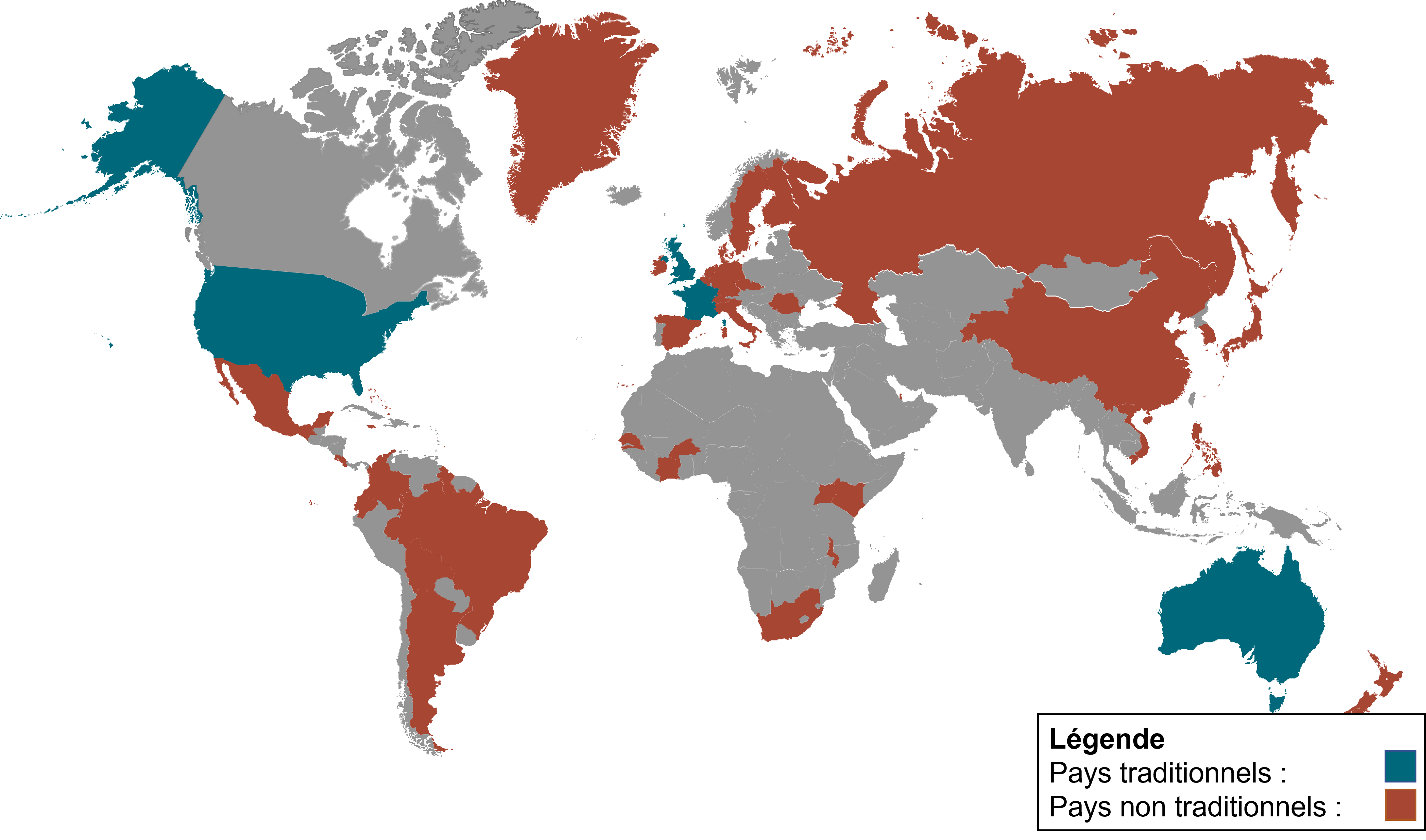
- Source: Collèges du Canada (2021) Rapport sur le Fonds d’innovation, 2020 à 2021 et Universités du Canada (2021) Rapport sur le Fonds d’innovation, 2020 à 2021.
Description textuelle – Graphique 13
Dans l’ensemble, dans le cadre des projets d’innovations, Collèges du Canada et Universités du Canada ont aidé des établissements postsecondaires à développer des partenariats dans 50 pays, y compris des pays traditionnels (par exemple l’Australie, le Canada, la France, le Royaume-Uni et les états-Unis) et dans 45 pays non traditionnels comprenant :
- Afrique du Sud;
- Allemagne;
- Argentine;
- Autriche;
- Bahamas;
- Barbade;
- Belgique;
- Bolivie;
- Brésil;
- Burkina Faso;
- Chine;
- Colombie;
- Corée du Sud;
- Costa Rica;
- Côte d’Ivoire;
- Danemark;
- Dominique;
- Danemark;
- Espagne;
- Fédération de Russie;
- Finlande;
- Groenland;
- Guadeloupe;
- Guyane;
- Irlande;
- Italie;
- Jamaïque;
- Jamaïque;
- Kenya;
- Malawi;
- Martinique;
- Mexique;
- Nouvelle-Zélande;
- Ouganda;
- Palau;
- Philippines;
- Polynésie française;
- République Tchèque;
- Roumanie;
- Sénégal;
- Suède;
- Suisse;
- Vietnam.
8. Mesure du rendement
Assurer la disponibilité, la qualité, la validité et la fiabilité des indicateurs de rendement et des renseignements, y compris leur utilité pour l’évaluation, représente une tâche assortie d’obstacles. En effet, le Programme recueille des données sur les résultats à long terme pour les accords liés à Passeport pour ma réussite Canada et à Indspire, mais ces données sont actuellement limitées pour les autres accords du volet 1.
8.1. Accords Indspire et à Passeport pour ma réussite Canada (volet 1)
Passeport pour ma réussite Canada et Indspire disposent de renseignements solides sur le rendement afin d’éclairer la politique et l’évaluation. Il s’agit notamment de l’achèvement des études secondaires, de la participation à l’enseignement postsecondaire, de l’achèvement des études postsecondaires et des résultats en matière d’emploi.
L’impact différentiel et l’analyse coûts-avantages réalisés lors du dernier cycle d’évaluation se sont limités à 1 seul site au Canada. La recherche a été réalisée en collaboration avec Lavecchia et coll. (2018). Les chercheurs mènent actuellement une analyse supplémentaire pour évaluer l’impact du programme Passeport pour ma réussite sur la santé et la criminalité. Les données actuellement collectées par le programme ne permettent pas à EDSC de réaliser une analyse d’impact supplémentaire sans collaborer avec des partenaires externes. De plus, en raison de la complexité d’une telle analyse, aucune analyse coûts-avantages n’a été réalisée dans le cadre du présent rapport d’évaluation.
En outre, le Programme dispose de peu de données sur les autres accords, y compris les accords du programme Droit au but, car ils ont été mis en œuvre récemment. En particulier, il n’y a pas de données sur les éléments suivants :
- les résultats intermédiaires (obtention d’un diplôme d’études secondaires);
- les résultats finaux (participation à l’enseignement postsecondaire ou transition vers le marché du travail).
Les responsables du Programme ont indiqué que la pandémie de COVID‑19 avait exacerbé les difficultés liées à la collecte de données. Cependant, certaines données sur les résultats immédiats (certains étudiants reçoivent un soutien pour rester à l’école) sont disponibles.
8.2. Accords liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (volet 1)
Pour tous les projets du programme Droit au but, on collecte des données sur le nombre total de participants de l’exercice 2019‑2020 à l’exercice 2021‑2022. Toutefois, EDSC dispose de données limitées sur le nombre de participants par type d’activités, par population ciblée et par exercice.
En outre, EDSC dispose de données limitées pour évaluer l’efficacité des projets dans les domaines suivants :
- la fréquentation de l’école secondaire;
- l’achèvement des études secondaires;
- la participation à l’enseignement postsecondaire;
- l’achèvement des études postsecondaires;
- résultats relatifs à l’emploi.
Selon les informateurs clés internes et externes, cette situation est en partie due à plusieurs facteurs, notamment les suivants :
- la maturité des projets (temps nécessaire pour avoir de données sur les résultats à long terme);
- un accès limité ou inexistant aux données sur les résultats des participants en matière d’éducation et leurs résultats sur le marché du travail;
- l’éventail des modèles de réalisation des projets (y compris la tranche d’âge et le niveau d’études des participants);
- les types et la nature des activités du projet;
- les montants du financement des projets.
L’un des principaux défis pour de nombreux projets est l’accès limité aux données des conseils scolaires et des organisations au service des jeunes. De nombreuses organisations financées n’ont pas ou peu accès aux données relatives aux éléments suivants :
- le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires;
- la participation à l’enseignement postsecondaire;
- l’achèvement des études postsecondaires;
- les résultats sur le marché du travail.
Beaucoup n’ont pas de partenariat avec le secteur de l’éducation leur permettant de collecter ces données.
Des représentants d’EDSC ont déclaré que l’incohérence des données sur les réalisations et les résultats des projets constituait un problème. Cette situation est attribuable à la souplesse du Programme et à l’absence d’une stratégie systématique de collecte de données. Cependant, de nombreux représentants d’organisations financées ont mentionné qu’ils disposaient d’une stratégie de collecte de données pour rendre compte des résultats à plus long terme.
8.3. Expérience compétences mondiales (volet 2)
Les signataires d’accords liés au programme Expérience compétences mondiales, Universités Canada et Collèges et instituts Canada coordonnent leur stratégie de mesure du rendement et de collecte de données. Ces dispositions permettent d’obtenir des résultats agrégés pour ce volet.
Toutefois, en raison des restrictions de voyage imposées en raison de la COVID 19, seules les données relatives au Fonds d’innovation étaient accessibles au cours de la période d’évaluation. Cette évaluation n’a pas permis de déterminer la mesure dans laquelle les renseignements sur le rendement collectés dans le cadre du volet 2 du Programme répondent aux normes de disponibilité, de qualité, de validité et de fiabilité. Cette situation est attribuable à des circonstances sur lesquelles le secteur de programme n’a aucune emprise.
L’analyse documentaire a révélé qu’il n’existe pas de données sur le taux de participation des étudiants canadiens mal desservis aux études à l’étranger. Ce manque de données ne permet pas de déterminer si les étudiants ciblés par Expérience compétences mondiales sont sous-représentés en ce qui a trait aux études à l’étranger. Ainsi, il est également difficile de répertorier d’autres groupes pouvant être confrontés à des obstacles les empêchant de travailler ou d’étudier dans d’autres pays. En outre, en raison de ce manque de données, il est difficile d’évaluer l’impact net des projets d’Expérience compétences mondiales sur la participation de ces populations d’étudiants.
9. Conclusions
Le Canada obtient de bons résultats au chapitre de l’éducation postsecondaire par rapport à d’autres pays similaires. Cependant, certains étudiants ont encore besoin de soutien supplémentaire dans le système scolaire ou en dehors de celui-ci :
- réussir à l’école;
- terminer les études secondaires;
- réussir la transition vers l’enseignement postsecondaire et le marché du travail.
Compte tenu des conséquences négatives associées à l’abandon scolaire pour les personnes et la société dans son ensemble, le Programme est nécessaire. Il offre un soutien personnalisé en dehors du système scolaire, mais tout au long du parcours d’apprentissage des étudiants. Diverses organisations nationales ou régionales et locales sont bien placées pour offrir un soutien aux étudiants ou aux organisations éducatives.
Il est prouvé que les organisations financées dans le cadre du volet 1 du Programme aident les étudiants à surmonter des défis existants et émergents. Les accords de financement liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants sont suffisamment souples pour soutenir divers groupes d’étudiants mal desservis. Aussi, le Programme leur offre le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière d’éducation. En fait, il est prouvé que les accords liés à Passeport pour ma réussite Canada et à Indspire contribuent à améliorer la participation à l’enseignement postsecondaire et les taux de diplomation parmi les populations mal desservies. Il est ainsi possible d’améliorer les résultats des étudiants en matière d’éducation et de marché du travail.
D’autres accords de financement au titre du volet 1 s’appuient sur le modèle et les expériences éprouvées observées dans le cadre du programme Passeport pour ma réussite. Cependant, il n’existe pas de suffisamment de données pour déterminer si ces accords entraînent également des effets positifs similaires sur l’éducation et les résultats des participants sur le marché du travail. En outre, les représentants des projets les plus récemment signés ont fait part de certaines préoccupations concernant la durabilité des projets. Pour ces organisations, la courte période de financement et le décalage entre le calendrier scolaire et les exercices financiers du programme ont entraîné divers problèmes. Il s’agit notamment des difficultés liées à l’embauche de personnel, à la promotion des activités de soutien aux étudiants et à la planification des programmes.
Le volet 1 du Programme a eu des retombées positives sur les organisations au service des jeunes ayant conclu un partenariat avec les organisations financées par le Programme. Il a également eu un effet positif sur la diffusion des connaissances. Le Programme a contribué à l’élaboration de pratiques exemplaires et à la diffusion des leçons apprises dans tout le pays. Malgré cela, de nombreux représentants d’organisations ont indiqué que le Programme pourrait jouer un rôle plus important, notamment en faisant ce qui suit :
- favoriser l’innovation;
- diffuser plus fréquemment les leçons apprises et les pratiques exemplaires dans l’ensemble du Canada;
- organiser des activités de réseautage et de diffusion des connaissances entre les titulaires d’un accord au titre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.
Pour le volet 2, par rapport aux autres pays de l’OCDE, les étudiants canadiens sont moins nombreux à étudier ou à travailler à l’étranger. Malgré des données limitées, des éléments préliminaires indiquent que certaines populations d’étudiants ciblées par le Programme participent encore moins à ces possibilités en raison d’obstacles uniques. Pour les établissements d’enseignement postsecondaire, il est difficile d’offrir un soutien personnalisé aux étudiants sous-représentés en raison des ressources limitées dont ils disposent. Grâce au Fonds d’innovation, les organisations financées ont tiré des leçons apprises et mis au point des pratiques prometteuses pour mieux soutenir les établissements d’enseignement postsecondaire. Il s’agit de leçons apprises et pratiques prometteuses dans les domaines du marketing et du recrutement, du développement de partenariats, de la recherche sur la réduction des obstacles, de la gestion des risques, de la mobilité virtuelle et de l’offre de mesures de soutien intégrées.
10. Recommandations
Recommandation numéro 1 : Continuer à recueillir des données pour comprendre les caractéristiques, les défis et les pratiques prometteuses et tenir compte des besoins émergents et de mieux soutenir les étudiants mal desservis ou sous-représentés dans l’enseignement postsecondaire.
La Direction de l’évaluation sait que l’équipe Conception, impact et sensibilisation de la Direction générale de l’apprentissage a élaboré une série d’analyses documentaires afin de mieux comprendre les obstacles à la réussite et les facteurs facilitant la réussite. Cependant, d’autres groupes d’étudiants sous-représentés peuvent également être confrontés à des défis uniques (par exemple, les réfugiés, les sous-populations « Hommes+ » et « Femmes+ »).
Pour certains étudiants, la pandémie de COVID‑19 a exacerbé ces obstacles. Même si certaines difficultés étaient ponctuelles et se sont fait sentir pendant les fermetures d’écoles, certaines pourraient demeurer ou s’intensifier dans les années à venir. Les organisations financées par le Programme et leurs partenaires étaient bien placées pour soutenir les sous-populations d’étudiants confrontés à des difficultés liées à la pandémie de COVID‑19. Ils sont également bien placés pour aider les étudiants mal desservis à surmonter à d’autres défis émergents.
Par conséquent, les activités visant à se tenir au courant des difficultés actuelles et émergentes pour une sous-population d’étudiants permettraient d’aider plus efficacement les organisations au service des jeunes dans le cadre des activités parascolaires. Elles permettraient également de cerner les priorités de financement potentielles et de répertorier les organisations susceptibles d’être financées.
Recommandation numéro 2 : Examiner les moyens d’améliorer la durabilité des projets au-delà du financement du Programme en soutenant le développement de partenariats et en renforçant le rôle du Programme dans l’élaboration et la diffusion des leçons apprises et des pratiques prometteuses auprès de toutes les organisations au service des jeunes.
Les organisations financées dans le cadre du volet 1 du Programme et leurs partenaires :
- définissent des pratiques innovantes pour soutenir les étudiants mal desservis;
- génèrent des pratiques prometteuses et des leçons apprises;
- font part de leurs résultats au moyen de divers outils de diffusion ou d’activités.
Toutefois, le Programme pourrait déployer des efforts supplémentaires pour diffuser les pratiques exemplaires visant à soutenir les étudiants mal desservis auprès des organisations au service des jeunes. Par ailleurs, le Programme pourrait organiser davantage d’activités virtuelles ou en personne pour diffuser les pratiques prometteuses et les leçons apprises au niveau local et national. Il en découlerait de multiples avantages, notamment celui de développer des partenariats avec d’autres organisations similaires ou avec des organisations qui fournissent des services complémentaires. Pour avoir un effet plus important sur les populations mal desservies, le Programme devrait transmettre les leçons apprises et les pratiques exemplaires à toutes les organisations au service des jeunes, y compris les organisations non participantes.
Dans la mesure du possible, dans le cadre du volet 1, le Programme devrait envisager de recourir à des accords pluriannuels. De cette façon, il pourrait aider plus efficacement les organisations au service des jeunes et améliorer la prévisibilité des accords. La présente évaluation a révélé de nombreux problèmes liés aux accords d’1 an. C’est particulièrement vrai pour les organisations au service des jeunes qui soutiennent les étudiants mal desservis et qui tentent de s’attaquer aux obstacles systémiques.
Recommandation numéro 3 : Continuer à améliorer et à renforcer la stratégie de collecte de données afin d’optimiser les résultats et de soutenir une meilleure prise de décision, y compris en explorant les moyens d’optimiser l’impact du Programme.
Au cours de la période d’évaluation, il n’y avait pas de stratégie systématique de collecte des données. En conséquence, l’évaluation ne pouvait pas réellement présenter des données agrégées pour l’ensemble du Programme ou pour certains de ses volets. La Direction de l’évaluation sait que le secteur de programme élabore présentement une structure de reddition de comptes modernisée. Pour ce faire, elle utilise le système interactif de recherche des faits et envisage d’autres options pour collecter des données systématiquement en vue d’améliorer la disponibilité des données.
Annexes
Annexe A – Résultats, extrants et activités du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (en cours de révision)
Résultat final 1 : Interventions précoces : Un plus grand nombre de participants au Programme accèdent à l’enseignement postsecondaire ou font la transition vers le marché du travail.
Résultat intermédiaire lié : Un plus grand nombre de participants au programme obtiennent leur diplôme d’études secondaires.
Résultat immédiat lié : Un plus grand nombre d’étudiants qui risquent d’abandonner les études reçoivent du soutien pour rester à l’école.
Extrants liés :
- des services conçus pour améliorer les résultats scolaires sont en place;
- un plus grand nombre de jeunes sont joints;
- rapports annuels, ponctuels et d’évaluation.
Activités liées :
- fournir un soutien direct aux étudiants;
- élargissement de la portée du programme;
- collecte de données et établissement de rapports.
Résultat final 2 : Soutien à l’enseignement post-secondaire des Autochtones : Un plus grand nombre de boursiers font la transition vers le marché du travail, suivent une formation ou poursuivent des études supplémentaires.
Résultat intermédiaire lié : Un plus grand nombre de boursiers obtiennent un diplôme d’études postsecondaire.
Résultat immédiat lié : Un plus grand nombre d’étudiants autochtones ont les moyens financiers d’accéder aux études postsecondaires.
Extrants liés :
- des bourses d’études et des mesures de soutien non financières sont accordées aux étudiants;
- rapports annuels.
Activités liées :
- évaluer et approuver les demandes d’inscription des étudiants;
- collecte de données et établissement de rapports.
Résultat final 3 : Projet de mobilité étudiante vers l’étranger: Les participants au projet pilote font la transition vers le marché du travail.
Résultat intermédiaire lié : Les participants au projet pilote, y compris les étudiants sous-représentés, acquièrent des compétences transférables et des compétences interculturelles qui leur permettent de participer au marché du travail.
Résultat immédiat lié : Un plus grand nombre d’étudiants au niveau postsecondaire, y compris des étudiants sous-représentés, participent au projet pilote pour étudier ou travailler à l’étranger dans le cadre de leurs études dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien.
Extrants liés :
- les fonds sont versés aux établissements d’enseignement postsecondaire. et des mesures de soutien financières et non financières sont fournies aux étudiants;
- rapports semestriels d’avancement et d’évaluation.
Activités liées :
- évaluer et approuver les propositions de projets des établissements d’enseignement postsecondaire;
- collecte de données, supervision, suivi et établissement de rapports.
Les activités d’EDSC comprennent la négociation des accords, des conditions générales et l’examen des projets. Les résultats connexes comprennent la signature d’accords de financement et le versement de paiements aux détenteurs d’accords. En outre, le EDSC est chargé du suivi et de la supervision, ainsi que de la recherche et de l’analyse des données. Les produits connexes comprennent les rapports de programme, les données sur les performances, les audits et les évaluations.
Annexe B –Matrice d’évaluation
Question d’évaluation 1 : Quelle est la pertinence du Programme dans le cadre du continuum d’apprentissage?
Sous-questions :
- nécessité d’un soutien aux activités parascolaires pour les étudiants issus de familles à faible revenu, y compris ceux qui sont sous-représentés au chapitre de l’enseignement postsecondaire, pour leur permettre d’accéder et de participer à l’enseignement postsecondaire (Passeport pour ma réussite Canada et Droit au but);
- besoin continu de soutien financier pour que les jeunes Autochtones puissent réussir dans l’enseignement postsecondaire et sur le marché du travail (Indspire);
- besoin d’un soutien financier pour les jeunes qui souhaitent étudier ou travailler dans des pays autres que les États Unis, le Royaume Uni, la France et l’Australie (Mobilité des étudiants vers l’étranger);
- besoin d’un soutien financier pour les jeunes issus de familles à faible revenu, les étudiants handicapés et les étudiants autochtones afin qu’ils puissent étudier ou travailler à l’étranger (Mobilité des étudiants vers l’étranger);
- bécessité des mesures relatives à la Covid 19 dans le cadre du Programme (Passeport pour ma réussite Canada, Droit au but et Indspire).
Les sources information pour la question 1 incluent :
- une revue de la littérature;
- une analyse documentaire;
- des entrevues auprès d’informateurs clés (internes et externes);
- des sondages.
Question d’évaluation 2 : Dans quelle mesure le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants atteint-il ses objectifs et ses résultats escomptés (immédiats et intermédiaires)?
Sous-questions :
- détermination des connaissances nécessaires pour soutenir plus efficacement l’élaboration de projets de soutien aux étudiants;
- mesure dans laquelle des approches innovantes, leçons apprises ou pratiques prometteuses sont générées par les organisations de financement;
- diffusion des pratiques prometteuses eft des leçons apprises;
- facteurs ayant une incidence sur la mise en œuvre du Programme (Passeport pour ma réussite Canada, Droit au but et Indspire);
- les étudiants qui risquent d’abandonner l’école restent à l’école, par groupes ciblés, étudiants issus de familles à faible revenu, Autochtones. (Passeport pour ma réussite Canada, Droit au but et Indspire);
- mesure dans laquelle les mesures d’urgence du Programme relatives à la Covid 19 ont répondu aux besoins des organisations et des étudiants.
Les sources information pour la question 2 incluent :
- une revue de la littérature;
- une analyse documentaire;
- des entrevues auprès d’informateurs clés (internes et externes);
- des sondages.
Question d’évaluation 3 : La stratégie de mesure du rendement génère-t-elle des données valides et fiables qui évaluent les résultats obtenus et soutiennent les évaluations futures et l’élaboration des politiques?
Sous-question : Des systèmes de collecte de données et de rapports sont en place pour soutenir le prochain cycle d’évaluation.
Les sources information pour la question 3 incluent :
- une analyse documentaire;
- des entrevues auprès d’informateurs clés (internes).
Question d’évaluation 4 : Les organisations de mise en œuvre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants ont-elles été en mesure de s’adapter efficacement aux difficultés de mise en œuvre auxquelles elles ont été confrontées en raison de la COVID 19?
Sous-question : Mise en œuvre du Programme pendant la pandémie de Covid 19.
Les sources information pour la question 4 incluent :
- une analyse documentaire;
- des entrevues auprès d’informateurs clés (internes).
Annexe C – Méthode
Analyse documentaire et revue de la littérature
L’objectif de l’analyse documentaire est de fournir des renseignements contextuels sur la pertinence du Programme. Il s’agit en particulier des obstacles auxquels se heurtent les étudiants vulnérables lorsqu’il s’agit :
- d’obtenir un diplôme d’études secondaires;
- d’étudier ou de travailler à l’étranger;
- d’accéder aux mesures de soutien à l’apprentissage en raison des mesures sanitaires relatives à la COVID‑19.
Les renseignements tirés de cet examen serviront de de fondement aux autres sources de données.
En outre, l’analyse documentaire contribue à la conception, à l’exécution et à la mise en œuvre du Programme ainsi qu’à l’efficacité de ses divers volets.
Dans le cadre de cet examen, on étudie les données administratives et la littérature pertinente, notamment :
- documents administratifs comprenant des rapports d’activité, des accords de financement, des documents internes et des présentations;
- évaluation indépendante et produits de la recherche;
- publications sur les leçons apprises et les pratiques prometteuses accessibles sur les sites Web des organisations financées;
- rapports gouvernementaux;
- analyse de la littérature pour mieux comprendre les obstacles à la réussite et les facteurs facilitant la réussite scolaire au Canada. Ce document a été produit par l’équipe Conception, impact et sensibilisation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.
Puisque les données pour les 4 composantes du Programme étaient disponibles à divers moments, les indicateurs de rendement peuvent être présentés pour chaque volet séparément seulement. Cette situation est attribuable aux différents niveaux de maturité de chaque accord et à la souplesse des conditions générales du Programme.
Entrevues auprès d’informateurs clés
Les entrevues auprès des informateurs clés ont permis de recueillir des éléments de preuve approfondis, notamment des opinions, des explications, des exemples et des renseignements qui contribueront à répondre à toutes les questions de l’évaluation. Les entrevues avec les informateurs clés permettent à la Direction de l’évaluation d’obtenir des renseignements précieux sur le rendement du Programme qui ne sont pas accessibles dans les dossiers et les documents. Les évaluateurs ont eu l’occasion de poser des questions particulières sur la manière dont les volets du Programme ont été conceptualisés, mis en œuvre et exécutés. Les entrevues ont également permis d’étayer et de compléter les conclusions tirées d’autres sources de données.
Cette source de données était assortie d’entrevues auprès d’informateurs clés internes et externes. La Direction de l’évaluation a réalisé toutes les entrevues à interne.
L’objectif des entrevues auprès d’informateurs clés est de fournir des renseignements sur la mise en œuvre du Programme, y compris les succès, les défis et les problèmes. Elles fourniront également des renseignements sur la pertinence du Programme en déterminant les obstacles potentiels pour les étudiants, une pratique prometteuse.
Pour la première fois, le Programme a distribué des fonds dans le cadre d’un appel de propositions concurrentiel. Outre les entrevues avec les organisations établies, la Direction de l’évaluation a également mené des entrevues avec des organisations qui ont été sollicitées ou qui ont présenté une demande dans le cadre de l’appel de propositions de 2021 à 2022 (y compris des organisations financées et non financées). Les entrevues avec ces organisations permettront de collecter des renseignements sur les facteurs favorables et sur les défis potentiels liés à l’appel de propositions de 2021 à 2022.
Entrevues avec des intervenants clés internes
Cette sous-source de données est la seule méthode par laquelle des fonctionnaires ont été consultés. En outre, les entrevues avec les informateurs clés offrent une perspective importante de la part de ceux qui ne sont pas les bénéficiaires directs du financement du Programme. Les personnes interrogées ont été sélectionnées en fonction de leur niveau d’expérience, de leur type de travail, de l’étendue de leurs connaissances et de leur expérience antérieure liée au Programme. Elles ont fait part des réussites, des défis et des problèmes du Programme du point de vue de la politique, des opérations et de l’intégrité.
La sélection des informateurs clés s’est faite en concertation avec le groupe de travail sur l’évaluation. Pour les besoins de l’échantillonnage, 7 entrevues avec les informateurs clés avec des fonctionnaires intervenant dans la conception, la mise en œuvre et les aspects stratégiques du Programme ont été invités à participer à des entrevues. L’échantillon comprenait des fonctionnaires de la Direction générale des opérations de programmes (n=3) et de la Direction générale de l’apprentissage (n=4).
Entrevues avec des intervenants clés externes
Les entrevues avec les informateurs clés externes ont fourni des informations contextuelles et observations supplémentaires sur les résultats des sources de données secondaires (l’analyse documentaire) et ont contribué à valider les renseignements fournis par les entrevues avec les informateurs clés internes. En outre, cette sous-source de données a offert une perspective importante du point de vue des organisations financées pour cerner les réussites, les défis et les problèmes potentiels concernant la structure actuelle du Programme.
La Direction de l’évaluation a invité au moins 1 représentant de toutes les organisations financées dans le cadre des volets Passeport pour ma réussite Canada, Indspire, Droit au but et Expérience compétences mondiales entre 2019 et 2021 à participer à une entrevue avec les informateurs clés. Parmi les 21 représentants invités, 17 ont participé à une entrevue.
En outre, la Direction de l’évaluation a invité au moins 1 représentant de toutes les organisations (n=57) qui ont été invitées à présenter une demande ou qui ont présenté une demande dans le cadre de l’appel de propositions 2021 à 2022 pour le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. Dans l’ensemble, parmi ce groupe, 12 représentants ont participé à une entrevue :
- 7 représentants des 34 organisations ayant reçu un financement dans le cadre de l’appel de propositions 2021 à 2022;
- 3 représentants d’organisations non financées;
- 2 représentants d’organisations n’ayant pas présenté de demande ont participé à une entrevue avec les informateurs clés.
Sondage auprès des représentants des organisations au service des jeunes
Le sondage s’adressait aux représentants chargés d’apporter un soutien direct aux étudiants, de gérer ou de coordonner le projet, de faire connaître le projet ou d’évaluer le projet et de faire de la recherche sur ce dernier.
L’objectif de ce sondage était de mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les étudiants sous-représentés et qui compromettent l’atteinte de leurs objectifs en matière d’éducation au Canada. Il tente également de comprendre l’impact du Programme et la manière dont il pourrait être amélioré.
La Direction de l’évaluation a mené le sondage en ligne et l’analyse des données en interne. Le sondage a été mené sur la plateforme de sondage en ligne, le système interactif de recherche des faits d’EDSC. Cette plateforme est entièrement personnalisable et répond aux exigences du ministère en matière d’accessibilité des sites Web.
Le sondage a été distribué en collaboration avec les organisations financées dans le cadre des volets 1 et 2. Deux options leur étaient proposées pour distribuer le questionnaire :
- option A) EDSC transmettait à l’organisation financée un modèle de lettre d’invitation comprenant un lien vers le sondage. Le Ministère envoyait ensuite le sondage aux représentants des organisations partenaires du projet et rendait compte du nombre de questionnaires envoyés;
- option B) L’organisation financée fournissait à EDSC les coordonnées des représentants d’organisations partenaires, y compris leur nom et leur adresse électronique, ainsi que le nom de leur organisation respective. EDSC envoyait une invitation aux organisations partenaires du projet pour qu’elles participent au sondage.
Parmi les 14 organisations qui ont reçu un financement dans le cadre du volet 1 :
- 8 ont choisi l’option A;
- 1 a choisi l’option B;
- 5 n’ont pas répondu à la demande de la Direction de l’évaluation.
Certaines organisations n’ont pas indiqué le nombre de questionnaires envoyés. De plus, certains répondants ont envoyé le questionnaire à d’autres représentants de leur organisation sans en informer la Direction de l’évaluation. Pour ces raisons, il est impossible de connaître le nombre exact de personnes qui ont été invitées à répondre au sondage. Au total, 116 représentants d’organisations au service des jeunes y ont répondu.
Pour le volet 2, les 2 organisations financées ont choisi l’option A, y compris les employés de l’organisation partenaire du volet 1. Dans l’ensemble, 35 représentants d’établissements postsecondaires ayant reçu un financement dans le cadre du volet 2 ont répondu au sondage.
Annexe D – Accords relatifs au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (volet 1)
Accords relatifs à Droit au but
BGC Canada (anciennement Boys and Girls Club of Canada): L’Initiative pour l’engagement des jeunes de BGC Canada représente un engagement national visant à créer des espaces et des possibilités qui réduisent les obstacles et permettent aux jeunes de réaliser leur potentiel. L’initiative dessert plus de 50 000 jeunes dans divers clubs partout au pays et aide les jeunes confrontés à des obstacles à l’éducation à : comprendre leurs intérêts personnels et à les concrétiser; à éveiller un sens de la découverte et de l’enthousiasme à l’égard des possibilités que présente le savoir; à réaliser leurs aspirations professionnelles qui correspondent à leurs intérêts personnels, à leurs objectifs et à leurs capacités; à obtenir un diplôme d’études secondaires ou collégiales; à obtenir les crédits et des notes nécessaires pour s’inscrire dans le programme d’études postsecondaires de leur choix. L’initiative soutient également les jeunes à faire la transition de la pandémie vers la reprise des activités, et veille à ce que les jeunes Canadiens ne soient pas davantage marginalisés en raison de la pandémie en améliorant l’accessibilité des mesures de soutien essentielles pour les populations mal desservies. Au troisième trimestre de l’année fiscale 2021 à 2022, le projet a servi 3514 participants. Parmi eux, 12% des participants sont nés à l’étranger et 4,2% sont de nouveaux arrivants (au Canada depuis moins de 5 ans) ; 49% s’identifient comme des femmes, 44% comme des hommes et 5% comme des personnes non binaires ou d’autres genres ; 37% s’identifient comme des minorités visibles ; 22% déclarent vivre avec un handicap. Le projet est proposé dans 44 sites. Au 15 janvier 2021, 28 clubs avaient déposé une demande de subvention pour la santé mentale d’un montant total de 275 000 dollars. Selon une enquête distribuée à 307 jeunes participants, 90 % des jeunes déclarent avoir appris la sécurité en ligne grâce aux clubs.
Choices for Youth Inc. : Dans le cadre de ce projet, Choices for Youth vise à réduire les facteurs de risque menant à des résultats scolaires médiocres, à des environnements familiaux instables, à l’itinérance et à une faible participation au marché du travail d’enfants et de jeunes à risque qui sont issus de familles vulnérables. Les objectifs du projet sont les suivants :
- la prévention et l’intervention précoce;
- le renforcement de l’indépendance et la réussite sur le marché du travail;
- l’évolution des systèmes et la durabilité des projets.
Le projet vise à prévenir et à éliminer l’itinérance chez les jeunes grâce aux efforts coordonnés des écoles et des communautés, en repérant les jeunes qui risquent de devenir sans-abri et en leur fournissant, ainsi qu’à leur famille, un ensemble de mesures de soutien. 259 participants ont bénéficié de ce projet dans 2 sites. Du premier trimestre de l’année fiscale 2020-2021 au quatrième trimestre de l’année fiscale 2021-2022, il y a eu 28 clients en développement éducatif général, par le biais du programme de préparation à l’emploi, 47 clients ont fait la transition vers des programmes éducatifs et 63 nouveaux renvois vers le programme de préparation à l’emploi de Choices for Youth.
Digital Moment (anciennement connu sous le nom de Kids Code Jeunesse) : Ce projet élargit les programmes pour servir les jeunes souvent marginalisés dans les communautés partout Canada qui sont touchés par la pandémie de COVID 19, au moyen d’ateliers de formation en anglais et en français visant à acquérir des compétences numériques. Les objectifs du projet sont les suivants : mettre en place des clubs de codage hebdomadaires en ligne qui enseignent des compétences numériques aux jeunes, faire participer les groupes mal desservis et sous-représentés à des activités de codage stimulantes, établir une communauté de pratique pour les groupes communautaires et dispenser une formation par le biais d’ateliers de codage pour les jeunes. En réponse à la pandémie de COVID-19, le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants a d’abord servi les jeunes sous-représentés par l’intermédiaire de son projet Code Clubs, en leur fournissant du soutien comme des ateliers en ligne, du mentorat et un meilleur accès à la technologie. 1560 participants ont bénéficié de ce projet. Parmi eux, 49 % étaient des jeunes qui s’identifient comme « noirs », « autochtones » ou « de couleur ». 70 % des participants ont complété le projet. Parmi les 205 communautés et organisations engagées dans 125 sites, il y avait 60 clubs francophones, 12 groupes autochtones, 64 groupes de jeunes, 50 bibliothèques, 28 écoles, 62 groupes communautaires et familiaux et 7 groupes de nouveaux arrivants. De plus, 53 ordinateurs portables ont été donnés à 7 partenaires afin d’améliorer l’accès à la technologie dans les zones rurales et isolées.
Fondation Rideau Hall : La Fondation Rideau Hall a lancé le Fonds pour l’innovation et l’accès à l’apprentissage, un volet de son initiative Catapulte Canada. Le Fonds vise à soutenir les organisations au service de la jeunesse au Canada dans la conception, la mise en place, l’extension et l’évaluation de l’impact des initiatives. Les objectifs du projet sont les suivants :
- soutenir l’égalité des occasions d’apprentissage au Canada finançant directement des projets novateurs visant à remédier aux lacunes systémiques qui freinent l’augmentation des taux d’achèvement des études secondaires et l’accès à l’enseignement postsecondaire;
- soutenir et développer un écosystème d’organisations qui fournissent des services efficaces aux jeunes à risque afin de les aider à atteindre le niveau d’éducation requis.
Au premier trimestre de l’exercice 2020-2021, 6 000 participants ont bénéficié du programme dans 77 sites. Au quatrième trimestre de l’exercice 2021 à 2022, la Fondation Rideau Hall a financé 28 projets. De plus, 3 projets d’innovation sont en phase exploratoire de développement.
Shad Canada : Une organisation qui contribue au développement des jeunes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et/ou des mathématiques par l’intermédiaire de programmes d’été interactifs et d’une mise en commun localisées des connaissances autochtones. 459 étudiants sous-représentés ont participé dans 19 sites dans la période évaluée.
Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires : L’objectif du projet Ensemble pour nos jeunes est de favoriser l’intégration sociale et économique de jeunes adultes décrocheurs provenant de communautés noires par leur réintégration au système scolaire et par un soutien continu afin d’assurer leur motivation dans ce processus. Un accompagnement à distance sera mis en place via des outils numériques pour soutenir le raccrochage scolaire de ces jeunes qui les mènera vers l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et l’accès aux études postsecondaires. Au total, 55 participants ont participé au projet dans 1 site dans la période évaluée.
Institut Tamarack pour l’engagement communautaire : L’Institut Tamarack a mis en œuvre le programme Communautés bâtissant l’avenir des jeunes dans 19 communautés au Canada afin d’exercer une influence collective et d’élaborer des solutions à l’échelle du système pour aider les jeunes se heurtant à des obstacles à faire la transition de l’enseignement secondaire vers l’enseignement postsecondaire, la formation et l’emploi. Le projet comprend des initiatives communautaires pour les jeunes, une collaboration nationale, une réunion annuelle des partenaires, un fonds d’innovation, ainsi que des mesures de soutien à l’évaluation et à l’apprentissage.
Au total, 6515 participants ont pris part au projet dans 19 sites au cours de la période d'évaluation. En outre, 15 approches innovantes ont été développées au niveau national et 518 au niveau local. L'institut Tamarack a développé 5 études de cas/panels, 7 webinaires et 2 guides/outils.
Ulnooweg Development Group Inc. : Le projet aide les jeunes traditionnellement sous-représentés au niveau postsecondaire à terminer leurs études secondaires et à faciliter leur transition vers l’enseignement postsecondaire pour leur permettre d’accéder à des emplois de bonne qualité. L’objectif du projet est de surmonter les multiples obstacles afin d’augmenter le nombre d’étudiants qui poursuivent activement des études postsecondaires et des carrières professionnelles. Le projet proposera une série d’activités cohérentes, continues et intégrées grâce auxquelles les jeunes acquerront les compétences et la confiance et bénéficieront des contacts et des possibilités dont ils ont besoin pour s’épanouir au niveau postsecondaire. Au total, 1 550 participants ont pris part au projet dans 350 sites au cours de la période d'évaluation. Parmi les étudiants interrogés, 62 % des participants ont déclaré être intéressés par les STEM au niveau post-secondaire. En outre, l'organisation a établi 15 nouveaux partenariats et s'est engagée avec 165 partenaires dans des communautés ciblées.
Accords relatifs aux ententes d’urgence liés la COVID 19
BGC Canada (anciennement Boys and Girls Club of Canada) : Les programmes virtuels pancanadiens de BGC Canada relatifs à la COVID, qui comprennent des mesures de soutien destinées aux jeunes Canadiens à faible revenu pour aider ces derniers à accéder aux programmes virtuels et aux services de Clubs et au soutien à la connectivité. La création conjointe et le lancement du centre jeunesse de BGC Canada, une plateforme polyvalente pour le personnel des clubs et les jeunes, qui améliorera l’accès aux programmes et la qualité de ces derniers ainsi que l’expérience des jeunes membres. 3 515 enfants et jeunes ont bénéficié du projet, dont 2 003 femmes, 1 580 hommes, 27 personnes non-binaires, 191 parents et tuteurs. 6 % d’entre eux étaient des autochtones, 6 % avaient un handicap, 12 % étaient de nouveaux arrivants au Canada et 38 % étaient issus de foyers à faibles revenus. Le projet est proposé dans 60 sites liés à BGC Canada. 1 444 bourses ont été attribuées à des élèves et à des familles pour améliorer la connectivité, l’accès à l’internet et aux appareils informatiques. La plupart des membres du personnel du Club (57 %) ont déclaré que leur expérience de la programmation virtuelle était soit bien meilleure, soit légèrement meilleure, soit à peu près la même que celle de la programmation en personne. Le projet a aidé les élèves à développer des amitiés avec d’autres membres, à améliorer les relations avec d’autres membres de la famille et à améliorer les relations entre les participants et le personnel du club.
Indigenous Disability Canada : Le projet aide les étudiants à accéder à des mesures de soutien à l’enseignement postsecondaire, à la formation et à l’apprentissage continu afin de leur permettre d’acquérir les compétences et l’expérience professionnelle dont ils ont besoin pour participer à un marché du travail en pleine évolution. Les objectifs du projet sont les suivants : contribuer à répondre aux besoins en technologies et en ressources des étudiants autochtones du Canada ayant des ressources financières limitées, en priorisant les étudiants autochtones handicapés, afin d’aider les étudiants à étudier à distance et dans des cadres éducatifs formels et à obtenir l’équipement et le matériel nécessaires chez eux, en dehors des heures de cours normales, pour mener à bien leurs travaux scolaires, collecter des renseignements et des données relatives aux obstacles rencontrés par les élèves autochtones et proposer des mécanismes pour y remédier, y compris pour les personnes handicapées et les familles des étudiants, le cas échéant. 64 participants ont bénéficié de ce projet dans 13 sites. Tous s’identifiaient comme autochtones (50 comme Premières nations, 2 comme Inuit et 12 comme Métis), tous étaient issus de foyers à faibles revenus, 55 étudiants avaient un handicap, 25 s’identifiaient comme des hommes et 38 comme des femmes. Finalement, 3 étudiants vivaient dans des zones rurales, éloignées ou nordiques.
Association nationale des centres d’amitié : Le projet servira les jeunes Autochtones et les membres vulnérables des communautés à travers le Canada par l’intermédiaire du réseau des centres d’amitié qui sont touchés par la pandémie de COVID 19 et continuera à financer l’accès équitable à la technologie et aux mesures de soutien à l’apprentissage. Les objectifs du projet sont les suivants :
- aider les jeunes Autochtones à poursuivre leurs études, tant sur le plan académique que traditionnel;
- aider les jeunes Autochtones et les membres vulnérables de la communauté à avoir accès à la technologie et aux mesures de soutien à l’apprentissage;
- faciliter l’établissement de relations entre les jeunes Autochtones, les membres de la communauté, les mentors, les tuteurs et les aînés.
7141 participants ont bénéficié de ce projet dans 85 sites. 138 activités ont soutenu l’éducation, notamment la promotion de l’éducation et la planification des carrières. 97 activités ont aidé les étudiants indigènes à surmonter les problèmes de santé mentale et de bien-être. 93 activités se sont concentrées sur les pratiques d’apprentissage traditionnelles, impliquant des aînés ou des gardiens du savoir.
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) : Le projet « Accès virtuel pour tous » vise à sensibiliser les étudiants handicapés et à réduire les obstacles auxquels ils se heurtent. Le projet comprend la création d’un portail virtuel comprenant des ressources, des webinaires mensuels et des activités en personne ainsi qu’un programme de mentorat par les pairs pour faciliter les étudiants handicapés lors de leur transition de l’enseignement secondaire à l’enseignement postsecondaire. Ce projet apporte un soutien aux étudiants confrontés à des coûts imprévus liés à la COVID 19, tels que la transition vers l’apprentissage virtuel, les technologies adaptées, les frais de scolarité et d’autres services globaux. L’organisation collabore également avec les différents acteurs de la communauté, des associations étudiantes et des prestataires de services sur les campus pour organiser des événements et élargir la portée du projet aux étudiants de l’enseignement postsecondaire. Au troisième trimestre de l’exercice 2021 à 2022, 200 participants ont bénéficié du projet par le biais d’activités virtuelles disponibles au niveau national (telles que des webinaires). De plus, 40 participants ont reçu des subventions.
Taking IT Global Youth Association : Ce projet renforcera le soutien à la participation continue des étudiants à l’apprentissage au sein des communautés isolées en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID 19. Les objectifs du projet sont les suivants : renforcer la réussite des étudiants autochtones dans leur parcours vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et vers l’enseignement postsecondaire, et soutenir les efforts visant à accroître le recrutement et la réussite des étudiants autochtones au niveau postsecondaire. Au total, 4 100 participants ont pris part au projet dans 41 sites au cours de la période d'évaluation.
Annexe E – Bibliographie
- Collèges du Canada (2021), Rapport sur le Fonds d’innovation – 2020 à 2021
- Emploi et Développement social Canada (2019), Évaluation du programme Passeport pour ma réussite
- Affaires mondiales Canada (2019), Miser sur le succès : la Stratégie d’éducation internationale (2019 à 2024)
- Goss Gilroy (2021), Évaluation du programme Passeport pour ma réussite.
- Indspire (2021a), Rapport d’activité annuel de 2020 à 2021
- Indspire (2021b), Naviguer entre deux mondes : Voies menant à la réussite professionnelle des Autochtones
- Lavecchia, Adam M., Philip Oreopoulos et Robert Brown (2019), Effets à long terme du programme Passeport pour ma réussite.
- Statistique Canada (2002), Les premiers indicateurs du risque de décrochage au secondaire
- Statistique Canada (2006), Recensement de la population de 2006
- Statistique Canada (2011), Recensement de la population de 2011
- Statistique Canada (2016), Recensement de la population de 2016
- Statistique Canada (2017), Enquête canadienne sur l’incapacité
- Statistique Canada (2021a), Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la proportion de jeunes ni en emploi ni aux études au début de l’année scolaire selon le genre
- Statistique Canada (2021b), Les communautés LGBTQ2I+ au Canada : un aperçu démographique
- Statistique Canada (2022a). Le Canada est en tête des pays du G7 pour ce qui est de la main-d’œuvre la plus scolarisée, grâce aux immigrants, aux jeunes adultes et à un solide secteur collégial, mais il subit des pertes importantes de titulaires de certificats d’apprenti dans les principaux domaines de métiers
- Statistique Canada (2022b), Recensement de la population de 2021
- Statistique Canada (2022c), Participation aux études et niveau de scolarité des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles au Canada
- Statistique Canada (2022d), Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires chez les étudiants de moins de 25 ans, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et pays partenaires, 2019
- Statistique Canada (2022e), Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires au Canada, années scolaires 2016 à 2017 à 2019 à 2020
- Statistique Canada (2022f), Pourcentage de la population âgée de 15 à 29 ans aux études et pas aux études selon la situation dans la population active, le niveau de formation le plus élevé atteint, le groupe d’âge et le sexe
- Universités du Canada (2021), Rapport sur le Fonds d’innovation - 2020 à 2021