Comparution de la Ministre des Femmes et l’Égalité des genres devant le SOCI ACS Plus - Le 27 octobre 2022
La Sous-ministre était aussi présente et a reçu le cartable de la comparution à ce comité parlementaire.
Mot d’ouverture
Merci, madame la présidente, de me donner l’occasion de participer à la discussion opportune du Comité sur le rôle de l’analyse comparative entre les sexes Plus dans le processus d’élaboration des politiques.
Comme vous le savez, l’analyse comparative entre les sexes Plus – ou l’ACS Plus – est le principal outil utilisé par le gouvernement pour éclairer les initiatives gouvernementales pour qu’elles soient inclusives et qu’elles répondent aux besoins de personnes diversifiées.
Lorsque nous procédons à l’ACS Plus, nous tenons compte des personnes touchées par un problème que nous essayons de régler, de la façon dont elles sont touchées et de la façon dont nos initiatives peuvent être adaptées pour répondre à leurs besoins diversifiés et éliminer les obstacles et les inégalités. Cela contribue à faire en sorte que l’égalité, la diversité et l’égalité des chances soient au cœur de toutes les activités gouvernementales.
L’ACS Plus est intersectionnelle dans sa conception, ce qui signifie qu’elle prend en compte un éventail de facteurs comme l’origine ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, le revenu et le sexe. De la même façon que les facteurs identitaires interagissent entre eux, ils recoupent également les normes et les attitudes sociales, ainsi que les systèmes de discrimination pour réaliser des expériences uniques de pouvoir, de privilège et de marginalisation.
Lorsque nous considérons la pandémie de COVID‑19, nous pouvons comprendre pourquoi l’ACS Plus est un outil important pour éclairer l’élaboration de programmes et de politiques. Les femmes, les filles, les jeunes et les personnes racisées et 2ELGBTQI+ autochtones ont été touchés.
Par exemple, les femmes et d’autres personnes en quête d’équité ont été confronté à des problèmes de santé mentale pendant la pandémie. Cinquante‑sept pour cent des femmes, 71 % des personnes de diverses identités de genre et 64 % des jeunes ont déclaré que leur santé mentale s’était détériorée.
De plus, les femmes, en particulier les jeunes femmes, les femmes autochtones, les immigrantes, les femmes en situation de handicap et les femmes des minorités visibles, ont été touchées de façon disproportionnée par les pertes d’emploi liées à la COVID‑19. En mars 2020, les pertes d’emploi chez les femmes étaient près du double de celles des hommes. Lorsque l’économie a commencé à rouvrir en mai 2020, l’emploi a repris deux fois plus rapidement chez les hommes que chez les femmes.
Cependant, il est également important de noter qu’il y avait des différences au sein des groupes. Par exemple, prenons le cas d’une mère célibataire qui travaille dans un secteur essentiel et qui doit trouver le moyen de prendre soin de ses enfants lors des fermetures de l’école. Le fait que cette personne soit une mère célibataire, principal soutien de famille et seule personne qui s’occupe de ses enfants amplifie les répercussions de la pandémie.
La pandémie a mis en évidence la nécessité d’établir une perspective intersectionnelle en réalisant l’ACS Plus des programmes, des services et des politiques que nous élaborons et mettons en œuvre. Cette analyse doit être éclairée par divers intervenants pour que les décisions du gouvernement reflètent les besoins et les aspirations des gens que nous servons. Cette méthode d’examen des situations permet à tous les gouvernements d’élaborer des politiques et des programmes pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.
C’est pourquoi l’ACS Plus est si importante.
L’ACS Plus est le résultat d’un engagement soutenu à l’égard de sa conduite et constitue une partie essentielle de notre travail depuis 1995.
Pour constamment refléter les enjeux de l’heure, l’ACS Plus a évolué grâce à un processus d’amélioration continue. Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (FEGC) continue de travailler avec des partenaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du Conseil privé pour améliorer la mise en œuvre de l’ACS Plus à l’échelle du gouvernement et assurer sa conduite rigoureuse dans les activités du gouvernement.
Depuis 2015, nous avons réalisé d’importants progrès pour appuyer les ministères fédéraux et accroître la capacité de l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement en créant des terrains de collaboration, en élaborant des outils et des ressources et en prodiguant des conseils. Par exemple, FEGC a élaboré plusieurs microvidéos d’apprentissage et des outils de travail pour aider les fonctionnaires à mieux comprendre comment procéder à l’ACS Plus. En juin 2021, FEGC a publié un nouvel ensemble d’outils pour aider les fonctionnaires à réaliser une ACS Plus intersectionnelle rigoureuse. Cela comprenait un guide étape par étape, un outil de référence rapide et un compendium contenant des statistiques et des questions clés à prendre en considération lors de la conduite de l’ACS Plus. FEGC collabore également avec l’École de la fonction publique du Canada pour offrir de la formation afin d’aider les fonctionnaires fédéraux à mener l’ACS Plus.
En octobre 2022, près de 225 000 fonctionnaires, parlementaires et membres du personnel du Parlement avaient suivi le cours d’introduction à l’ACS Plus.
Bien que ces réalisations soient bonnes, nous pouvons faire mieux. FEGC surveille et décèle les lacunes au cours de la réalisation de l’ACS Plus, avec le soutien essentiel du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du Conseil privé, dans le but de bien adapter la formation et les ressources. Il est important de noter que c’est au ministère ou à l’organisation qui présente une proposition ou une initiative particulière qu’il incombe de faire une ACS Plus approfondie et rigoureuse.
Depuis 2016, et en réponse à un audit de 2015 du vérificateur général du Canada, nous surveillons la réalisation de l’ACS Plus au moyen d’un sondage annuel effectué auprès des ministères et des organismes fédéraux.
Nos constatations découlant du sondage annuel ont été confirmées dans le rapport du vérificateur général de mai 2022 en ce qui concerne la nécessité constante d’apporter des améliorations à l’échelle du gouvernement dans les domaines suivants :
- accès et utilisation des données désagrégées;
- compréhension et conduite de l’ACS Plus comme outil intersectionnel;
- capacité des ministères fédéraux de procéder à l’ACS Plus dès le début de l’élaboration des initiatives.
Nous n’avons pas encore réalisé le plein potentiel de l’ACS Plus, qui vise à faire en sorte que les décisions du gouvernement tiennent compte de l’expérience et de la situation de divers groupes de la population canadienne.
Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens s’attendent à ce qu’on tienne compte d’eux dans les politiques et les programmes qui touchent leur vie quotidienne. Femmes et Égalité des genres Canada est toujours déterminé à travailler avec des partenaires du gouvernement et d’autres secteurs pour que nous disposions des outils et des méthodes nécessaires pour :
- refléter les différences entre les groupes et au sein des groupes;
- comprendre comment les conditions structurelles renforcent les inégalités;
- veiller à ce que les réponses du gouvernement tiennent compte des multiples formes de désavantages et répondent aux divers besoins.
À l’avenir, FEGC continuera de travailler avec les organismes centraux pour renforcer son rôle de centre d’expertise pour l’ACS Plus – accroître la sensibilisation et la compréhension et améliorer la capacité et l’expertise à l’échelle du gouvernement fédéral et encourager la consultation et la mobilisation des groupes clés de la population canadienne pour tirer parti de leurs connaissances.
Je suis fière de vivre dans un pays qui maintient son engagement envers l’ACS Plus depuis plus de 25 ans. Il reste beaucoup à faire, mais le Canada est l’un des rares pays à avoir systématiquement examiné la façon dont les questions de genre et d’égalité sont intégrées dans toutes les activités gouvernementales.
Je félicite le Comité d’avoir entrepris cet important travail, qui aidera à réaliser le potentiel de l’ACS Plus et à ouvrir de nouvelles perspectives sur les questions de politique publique et les populations touchées.
En travaillant ensemble, nous ferons progresser de façon significative la justice, l’équité, la diversité et l’inclusion pour toutes et tous. Cette étude fournira des renseignements importants qui contribueront à l’amélioration continue de la façon dont le gouvernement conduit l’analyse des politiques pour concevoir des solutions stratégiques transformatrices qui ne peuvent être trouvées à partir d’autres cadres ou optiques axés sur l’équité.
Merci. Maintenant, je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions.
Réponse au rapport du Bureau du vérificateur général du Canada
Enjeu/question:
Que fait le gouvernement pour répondre à la vérification du rendement de l’analyse comparative entre les sexes plus du Bureau du vérificateur général?
Réponse proposée
- Femmes et Égalité des genres Canada salue le rapport de 2022 de la vérificatrice générale sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus). Même si nous avons fait des progrès, nous devons en faire plus.
- Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer continuellement l’utilisation de l’ACS Plus en tant qu’outil clé de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes, de politiques et de services pour veiller à ne laisser personne pour compte.
- Les constatations du rapport de la vérificatrice générale sont axées sur la mise en œuvre de l’ACS Plus en réponse à certaines recommandations du rapport du vérificateur général sur l’ACS Plus de 2015. Le rapport s’est également penché sur l’utilisation et la disponibilité des données à l’appui de l’ACS Plus.
- Un plan d’action est en cours d’élaboration pour répondre aux recommandations de la vérificatrice générale et renforcer l’application de l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement, et il sera soumis en novembre au Comité permanent des comptes publics.
Information clé
Investissement
Aucune information sur le financement.
Résultats
S.O.
Exemples de projets
S.O.
Contexte
- Le Bureau du vérificateur général du Canada a effectué des audits de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) en 2009 et 2015. Ceux‑ci ont révélé que malgré les efforts d’amélioration déployés, bon nombre de ministères n’avaient pas respecté l’engagement de 1995 du gouvernement d’analyser les répercussions sexospécifiques (2009) et qu’il y avait des obstacles à la réalisation de l’analyse comparative entre les sexes et à l’intégration des considérations de genre au processus décisionnel (2015).
- Le Bureau du Conseil privé (BCP), le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) ont répondu à l’audit de 2015 en élaborant un plan d’action (2016-2020) pour donner suite aux recommandations formulées. Ce plan comprenait des activités, comme des outils visant à préciser comment effectuer des analyses intersectionnelles, de la formation et d’autres ressources pour renforcer la capacité des ministères, ainsi que des activités en vue d’accroître la collaboration entre les ministères.
- En mai 2021, la vérificatrice générale du Canada a lancé son troisième audit de l’ACS Plus pour fournir l’assurance que le gouvernement fédéral a agi pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2015 et mettre en œuvre le plan d’action. Le rapport d’audit a été publié en mai 2022 et couvre la période du 1eravril 2016 au 31 janvier 2022.
- Ce dernier audit a plus particulièrement mis l’accent sur deux recommandations de l’audit de 2015 concernant le recensement et la suppression des obstacles qui empêchent la réalisation d’une ACS Plus rigoureuse (recommandation 1.61), et la tenue d’examens et la production de rapports sur la mise en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes au sein des ministères et organismes fédéraux, ainsi que sur les répercussions de ces analyses sur les projets de politiques, de mesures législatives et de programmes (recommandation 1.62). Le rapport examine également l’utilisation et la disponibilité des données à l’appui de l’ACS Plus.
- Dans l’ensemble, l’audit a révélé que même si FEGC, le BCP et le SCT avaient en partie donné suite aux recommandations de l’audit de 2015, notamment au moyen d’initiatives dirigées par FEGC pour fournir de la formation, des outils et des conseils, et grâce à la collaboration et à l’apprentissage par l’entremise de comités interministériels, peu de progrès ont été réalisés dans l’ensemble quant à la mise en œuvre de l’ACS Plus au sein du gouvernement fédéral, et des obstacles de longue date à la mise en œuvre de l’ACS Plus subsistent.
- Dans les six mois suivant le dépôt du rapport, FEGC, le SCT et le BCP sont tenus de présenter une réponse et un plan d’action de la direction (RPAD) au Comité des comptes publics pour donner suite aux recommandations. Le RPAD sera finalisé et présenté en novembre.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus)
Enjeu/question :
Que fait le gouvernement pour améliorer la mise en œuvre de l’ACS Plus?
Réponse proposée
- Il est essentiel que les Canadiennes et les Canadiens de toutes les régions du pays se reconnaissent dans les priorités du gouvernement et notre travail.
- À ce titre, le gouvernement demeure déterminé à veiller à ce que les politiques publiques tiennent compte de divers besoins et soient élaborées dans une optique intersectionnelle, en appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus au processus décisionnel.
- Femmes et Égalité des genres Canada continuera d’aider les ministères et les organismes fédéraux à renforcer l’ACS Plus pour promouvoir l’égalité entre les genres et une plus grande inclusion pour les Canadiennes et les Canadiens dans toute leur diversité. Cela comprend :
- peaufiner et améliorer l’approche à l’égard de l’ACS Plus, en collaboration avec les organismes centraux, pour que les expériences vécues par l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens soient mieux comprises et traitées.
- appuyer l’application de l’ACS Plus en tant que volet obligatoire des décisions clés du gouvernement et de leur mise en œuvre.
- fournir son expertise en tant qu’autorité fédérale en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact du Canada et aider à faire en sorte que les exigences de l’ACS Plus sont prises en compte dans tous les aspects du processus.
- collaborer avec des partenaires fédéraux pour renforcer leur capacité à appliquer l’ACS Plus en élaborant des outils et des formations pour la fonction publique.
Information clé
Investissement
Aucune information sur le financement.
Résultats
S.O.
Exemples de projets
S.O.
Contexte
- L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) est un outil d’analyse utilisé pour appuyer l’élaboration de politiques, de programmes et d’autres initiatives adaptés et inclusifs. L’ACS Plus est un processus permettant de comprendre qui est touché par la question ou la possibilité visée par l’initiative et de quelle manière, de déterminer comment l’initiative pourrait être adaptée pour répondre aux divers besoins des personnes les plus touchées, et d’anticiper et d’atténuer tous les obstacles qui empêchent les gens d’accéder à l’initiative ou d’en bénéficier. L’ACS Plus est une analyse intersectionnelle qui va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour prendre en compte d’autres facteurs, comme l’âge, le handicap, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie, la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle.
- En tant que centre d’expertise, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) fait son possible pour :
- mieux faire connaître et comprendre l’ACS Plus
- améliorer la capacité et l’expertise concernant l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement fédéral
- favoriser la collaboration entre un large éventail d’actrices et d’acteurs afin de saisir les nouvelles connaissances et de partager des pratiques exemplaires
- servir de « carrefour » de connaissances et d’expertise en ACS Plus
Renforcement de l’ACS Plus
- L’ACS Plus est le résultat d’un engagement soutenu de plus de 25 ans. Elle a évolué au fil du temps et est guidée par un processus d’amélioration continue. Les changements ont été éclairés par un large éventail de données probantes et d’apports.
- Les engagements formulés dans la lettre de mandat de 2021 vous enjoignent à mener le processus d’évaluation de l’ACS Plus dans le but d’améliorer le cadre et les paramètres de cet outil d’analyse, en accordant une attention particulière à l’analyse intersectionnelle, afin qu’il reflète mieux les expériences vécues par la population canadienne.
- Les ministres du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, des Relations Couronne-Autochtones, du Développement économique rural, de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et la présidente du Conseil du Trésor ont reçu le mandat d’appuyer ce travail et seront des partenaires essentiels pour faire avancer le plan.
- Afin de faire progresser les travaux relatifs à cet engagement de la lettre de mandat, FEGC a commencé à collaborer avec les partenaires fédéraux pertinents pour prévoir un processus de mobilisation d’un éventail de parties prenantes internes et externes, qui débutera à l’automne 2022. L’objectif de ce processus est d’offrir à diverses personnes, y compris à des organismes de la société civile et des spécialistes en équité, des occasions de participer de manière significative au renforcement du cadre et des paramètres de l’ACS Plus de sorte qu’elle tienne mieux compte des expériences vécues par toutes les personnes au Canada.
- Parmi les autres apports récents visant à renforcer l’ACS Plus, mentionnons la présentation par la sénatrice Mary Jane McCallum (GSI) du projet de loi S-218 en novembre 2021. Le projet de loi propose d’inclure une disposition dans la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour exiger que la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres examine chaque projet de loi du gouvernement présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement et dépose un énoncé énumérant les effets potentiels du projet de loi sur les femmes, en particulier les femmes autochtones. En date d’octobre 2022, le projet de loi S-218 est en deuxième lecture.
Budgétisation sensible aux sexes
- La Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes est entrée en vigueur en décembre 2018, inscrivant la budgétisation sensible aux sexes dans le processus de gestion financière et budgétaire du gouvernement fédéral. La Loi comporte trois exigences clés :
- Rapports sur les nouvelles mesures budgétaires : Dans les trente premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, la ou le ministre des Finances fait déposer devant elle un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le plan budgétaire; la ou le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public.
- Analyse des dépenses fiscales : Une fois par année, la ou le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales – notamment des exonérations, des déductions ou des crédits fiscaux – qu’il estime indiquées.
- Analyse – programmes : Une fois par année, le président du Conseil du Trésor rend publiques des analyses de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec la ou le ministre des Finances, estime indiqués.
- À l’instar des récents budgets et mises à jour relatives à la situation financière, le budget de 2022 comprend un énoncé budgétaire sensible aux genres et la publication de plus de 200 résumés d’ACS Plus des mesures budgétaires. Étant donné que l’énoncé et l’analyse sont rendus publics, ils favorisent la responsabilisation axée sur le genre et l’égalité dans l’ensemble des ministères et organismes. La publication de l’ACS Plus est en place depuis 2019 et depuis, l’application de l’ACS Plus aux propositions budgétaires s’est nettement améliorée.
- La plupart (78 %) des ACS Plus ont été amorcées au début ou au milieu de l’initiative, ce qui témoigne des efforts continus déployés pour mieux intégrer l’ACS Plus plus tôt et tout au long du processus budgétaire.
- L’ACS Plus du budget de 2022 comprend des rapports faisant état de 12 % des mesures budgétaires où un obstacle potentiel à l’accès ou à la participation d’un groupe particulier a été identifié. De ce nombre, la grande majorité (85 %) comprenait des mesures visant à réduire les obstacles ou à faciliter l’accès et la participation.
L’ACS Plus dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact
- FEGC appuie l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et les ministères partenaires dans la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact de 2019. Cette loi exige que les promotrices et promoteurs d’initiatives majeures, y compris les projets liés aux ressources naturelles, appliquent l’ACS Plus à la planification et à la mise en œuvre des projets afin d’évaluer leurs répercussions potentielles sur différents groupes de personnes.
- Grâce à cette loi, FEGC veille à atténuer les incidences négatives des projets, y compris les effets sur la violence fondée sur le sexe, et de faire en sorte que les avantages de ces projets se fassent sentir de manière égale parmi différents groupes de personnes.
- Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones Canada sont d’importants partenaires dans la mise en œuvre de cette loi et dans l’application de l’ACS Plus d’un point de vue autochtone.
Aperçu des progrès des audits précédents du BVG et des recommandations du comité parlementaire sur l’ACS Plus
Enjeu/question
Que fait le gouvernement pour donner suite aux recommandations visant à améliorer l’ACS Plus?
Messages clés
- L’ACS Plus est le résultat d’un engagement soutenu et d’une amélioration continue. Le gouvernement du Canada a fait des progrès importants, augmentant progressivement la portée, l’échelle et la qualité de l’application de l’ACS Plus tout au long du processus décisionnel.
- Ces progrès s’appuient sur un certain nombre d’examens et d’études. Le Canada est également l’un des rares pays à avoir vérifier régulièrement la mise en œuvre de l’ACS Plus.
- Grâce à ces études, le gouvernement a également tiré profit d’observations sur les possibilités d’amélioration, y compris la réalisation de l’ACS Plus plus tôt dans le processus d’élaboration des politiques et l’augmentation de la disponibilité de données désagrégées.
- Le gouvernement du Canada continuera à améliorer l’application de l’ACS Plus pour s’assurer de combler les divers besoins et de ne laisser personne pour compte.
Contexte
Recommandations des rapports précédents :
- L’audit de 2009 effectué par la vérificatrice générale du Canada examinait les pratiques d’ACS au sein de neuf ministères et a constaté une mise en œuvre inégale de l’ACS et peu d’éléments prouvant son influence sur le processus décisionnel. La vérificatrice générale a formulé plusieurs recommandations pour améliorer l’application de l’ACS Plus, notamment :
- l’exigence de résumés écrits dans les mémoires au Cabinet et les présentations au Conseil du Trésor sur la façon dont l’ACS Plus a été intégrée
- des évaluations plus formelles de la qualité de l’ACS Plus dans les documents décisionnels de la part des organismes centraux
- l’élaboration de directives pour communiquer aux ministères les attentes quant à l’application de l’ACS Plus au processus décisionnel
- la fourniture de ressources suffisantes à Condition féminine Canada (aujourd’hui FEGC) pour lui permettre de surveiller et d’évaluer l’application de l’ACS Plus par les ministères
- Le rapport de 2015 du vérificateur général du Canada, intitulé « La mise en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes », souligne la nécessité d’en faire davantage pour mettre pleinement en œuvre l’ACS comme pratique rigoureuse dans l’ensemble du gouvernement. En particulier, le vérificateur général a formulé plusieurs recommandations, notamment :
- la prise de mesures concrètes pour cerner et éliminer les obstacles à l’application de l’ACS Plus
- des évaluations de l’application de l’ACS Plus et de ses répercussions, et des rapports connexes
- des évaluations des ressources et l’affectation de ressources suffisantes au sein de Condition féminine Canada (aujourd’hui FEGC) pour qu’il remplisse son mandat en matière d’ACS Plus
- À la suite de l’audit de 2015, le Comité permanent des comptes publics (PACP) et le Comité permanent de la condition féminine (FEWO) ont publié des rapports distincts sur l’état de l’ACS Plus au sein du gouvernement du Canada. Les recommandations du FEWO comprenaient des appels à améliorer la gouvernance, les exigences législatives relatives à l’ACS Plus, la promotion de l’ACS Plus intersectionnelle, la formation obligatoire sur l’ACS Plus et l’obligation d’intégrer l’ACS Plus dans les documents du Cabinet ainsi que dans les plans et rapports ministériels. Les recommandations du PACP soulignaient la nécessité de rendre obligatoire l’ACS Plus dans les mémoires au Cabinet et les présentations au Conseil du Trésor, ainsi que la reddition de comptes sur les progrès réalisés au Comité. Des rapports d’étape provisoires et finaux ont été remis aux deux comités en mars 2017 et 2018 respectivement. En réponse aux rapports sur la mise en œuvre de l’ACS Plus par le PACP et le FEWO, le gouvernement s’est engagé à informer les deux comités des progrès réalisés. Pour ce faire, le ministère a fait un point sur les engagements du plan d’action dans un rapport provisoire publié en 2017 et un rapport final publié en 2018.
- Le gouvernement du Canada a demandé à l’OCDE d’entreprendre un examen de l’écosystème de l’égalité des genres, y compris l’application de l’ACS Plus, la gouvernance et les pratiques budgétaires. L’examen, publié en juin 2018, a fourni un certain nombre de recommandations en matière d’ACS Plus, notamment :
- l’élargissement du mandat de FEGC afin d’étendre la portée, qui visait uniquement les femmes, à des enjeux plus vastes pour être en harmonie avec la nature générale de l’ACS Plus, ainsi que des ressources afin de permettre à FEGC de devenir le carrefour des politiques du gouvernement sur les questions de l’égalité des genres, de l’ACS Plus et de l’intersectionnalité
- la clarification des pouvoirs et des responsabilités afin de mieux tenir compte de l’égalité des genres et de l’intersectionnalité dans le processus décisionnel du Cabinet
- l’élaboration d’une stratégie de collecte de données pour éliminer les obstacles à l’ACS Plus liés aux données et appuyer les progrès réalisés à l’égard du Cadre des résultats relatifs aux sexes
- l’établissement de critères d’évaluation de la qualité de l’ACS Plus;
- un soutien des ministères dans l’application de l’ACS Plus en début de processus d’élaboration des politiques et le suivi de l’application de l’ACS Plus tout au long du cycle des politiques;
- la communication publique des rapports sur l’ACS Plus dans le respect des politiques de confidentialité du Cabinet
- la prise en compte de l’ACS Plus par le BVG dans toutes les vérifications du rendement et l’intégration par les comités parlementaires de l’ACS Plus dans leurs travaux
- Le rapport de 2022 de la vérificatrice générale du Canada sur l’ACS Plus souligne les lacunes persistantes et la nécessité d’en faire davantage pour mettre pleinement en œuvre l’ACS comme pratique rigoureuse dans l’ensemble du gouvernement. En particulier, la vérificatrice générale a formulé plusieurs recommandations, notamment :
- le SCT et le BCP doivent fournir une rétroaction opportune et éclairée aux ministères et aux organismes sur l’application de l’ACS Plus dans leurs mémoires au Cabinet et leurs présentations au Conseil du Trésor et transmettre cette rétroaction à FEGC; les ministères et les organismes devraient ensuite apporter des améliorations lors des cycles futurs pour renforcer l’application de l’ACS Plus
- Femmes et Égalité des genres Canada devrait veiller à ce que ses efforts à titre de chef de file et de centre d’expertise contribuent à faire progresser l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement fédéral
- le BCP et le SCT devraient veiller à ce que tous les ministères et organismes mettent en œuvre comme il se doit le cadre d’ACS Plus et rendent compte publiquement de leurs progrès
- le BCP, le SCT et FEGC devraient collaborer avec les ministères et organismes pour veiller à ce que des données désagrégées soient demandées, compilées et utilisées pour la conception, l’exécution et la mesure du rendement de l’ensemble des politiques, programmes et initiatives
- FEGC, avec l’appui du BCP et du SCT, devrait surveiller de près l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement fédéral, y compris des plans pour faire progresser la mise en œuvre de l’ACS Plus, et en rendre compte publiquement
- le SCT devrait fournir des directives aux ministères et organismes sur la façon de rendre compte de l’ACS Plus dans leur rapport ministériel sur les résultats afin d’obtenir des résultats complets, exacts et uniformes qui peuvent contribuer de façon significative à l’analyse des progrès de la mise en œuvre de l’ACS Plus et de ses répercussions
- FEGC, en collaboration avec d’autres ministères et organismes responsables et les organismes centraux, devrait :
- établir des cibles précises et mesurables pour les cadres de résultats dont il est responsable et auxquels il contribue
- élaborer et mettre en œuvre un plan et surveiller les résultats pour améliorer la disponibilité des données sur les facteurs identitaires intersectionnels pertinents pour tous les indicateurs utilisés dans les cadres connexes
Progrès réalisés au sujet des recommandations des rapports précédents :
- FEGC, en collaboration avec les organismes centraux, les ministères responsables et d’autres partenaires de la mise en œuvre de l’ACS Plus, a réalisé d’importants progrès pour toutes les recommandations relatives à l’ACS Plus mentionnées ci‑dessus, notamment :
- les modèles pour les mémoires au Cabinet, les présentations au Conseil du Trésor, les présentations budgétaires fédérales et les plans ministériels et rapports sur les résultats ministériels annuels exigent que tous les ministères et organismes fournissent des documents sur les constatations de l’ACS Plus et sur la façon dont elle a été prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes, services et autres initiatives fédérales (audit de 2009). De plus, l’ACS Plus pour les présentations budgétaires fédérales ainsi que les plans ministériels et rapports sur les résultats ministériels annuels ont été rendus publics (rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2015 du PACP; rapport de 2018 de l’OCDE).
- l’application de l’ACS Plus a également été inscrite dans divers textes législatifs, qui servent également à préciser les rôles et responsabilités liés à l’application de l’ACS Plus (rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2018 de l’OCDE). Plus particulièrement, l’application de l’ACS Plus a été inscrite dans la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes, la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- De plus, au cours des dernières années, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre d’exigences non législatives pour l’application de l’ACS Plus (rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2015 du PACP), notamment :
- la Directive sur les résultats, qui exige que les responsables des programmes intègrent l’ACS Plus (le cas échéant) lors de l’établissement, de la mise en œuvre et de la tenue à jour des profils de l’information sur le rendement des programmes.
- la Directive du Cabinet sur la réglementation, qui exige que les ministères et organismes fédéraux entreprennent une évaluation des répercussions sociales et économiques sur divers groupes de Canadiennes et de Canadiens de chaque projet de règlement.
- la Politique sur les paiements de transfert, qui exige que les ministères et organismes veillent à ce que les programmes de paiements de transfert soient conçus et exécutés de manière à être inclusifs et sensibles au genre et à la diversité, et répondent aux priorités et aux objectifs stratégiques du gouvernement.
- depuis 2019, les lettres de mandat ministériel obligent l’ensemble des ministres à appliquer l’ACS Plus au processus décisionnel.
- En 2019, le SCT a fourni des directives aux ministères responsables pour communiquer les attentes relatives à l’application de l’ACS Plus aux évaluations des programmes (rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2015 du PACP; rapport de 2018 de l’OCDE).
- En 2019, FEGC a collaboré avec le BCP et le SCT pour élaborer des critères d’évaluation de la qualité de l’ACS Plus (rapport de 2018 de l’OCDE). Ces critères ont permis à FEGC et aux organismes centraux de faire des évaluations formelles de la qualité de l’ACS Plus dans les documents décisionnels (audit de 2009). Ces critères ont également permis aux organismes centraux d’élaborer des directives sur les attentes relatives à l’application de l’ACS Plus dans les documents décisionnels (audit de 2009).
- En 2016, FEGC a mis en place des structures de gouvernance pangouvernementales et d’autres mécanismes visant à cerner les obstacles à l’application de l’ACS Plus, ainsi qu’à surveiller sa mise en œuvre et ses répercussions et à produire des rapports en la matière. Par exemple, FEGC a créé un réseau interministériel de championnes et de champions de l’ACS Plus au niveau de la haute direction, ainsi qu’un comité de personnes-ressources de l’ACS Plus qui se réunissent chaque trimestre pour discuter des pratiques prometteuses, des obstacles à la mise en œuvre de l’ACS Plus et des stratégies pour éliminer ces obstacles. De plus, FEGC et l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) ont mis sur pied un groupe de travail consultatif interministériel sur l’apprentissage ainsi qu’un groupe de travail sur le renforcement des capacités afin de conseiller FEGC, l’EFPC et les organismes centraux sur l’élimination des obstacles et le renforcement des capacités ministérielles (audit de 2015; rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2018 de l’OCDE).
- Chaque année, FEGC évalue l’application de l’ACS Plus et produit des rapports connexes en s’appuyant sur les renseignements recueillis auprès de ces comités de gouvernance ainsi que dans le cadre de l’enquête annuelle sur la mise en œuvre de l’ACS Plus, lancée en 2016.
- Les résultats sont communiqués chaque année à l’ensemble des sous‑ministres par l’entremise du Comité de responsabilisation de gestion de la fonction publique. En outre, FEGC a communiqué les résultats des enquêtes préliminaires sur la mise en œuvre de l’ACS Plus sur son site Web ministériel. Enfin, le BCP et le SCT procèdent chacun à un examen annuel d’un échantillon de mémoires au Cabinet et de présentations au Conseil du Trésor pour évaluer la qualité de l’application de l’ACS Plus. Les rapports sont produits et communiqués à FEGC (audit de 2015).
- Afin d’aider les ministères à appliquer l’ACS Plus en début de cycle des politiques, d’éliminer les obstacles persistants à l’application de l’ACS Plus et de renforcer l’ACS Plus et les considérations relatives à l’intersectionnalité dans les documents du Cabinet et autres documents décisionnels, FEGC a élaboré une série d’outils, de ressources et de cours depuis 2012, notamment :
- en 2021, FEGC, les organismes centraux et d’autres partenaires de la mise en œuvre de l’ACS Plus ont diffusé un guide étape par étape et un recueil d’outils sur les facteurs intersectionnels à prendre en compte dans le cadre de l’ACS Plus. Le guide étape par étape met l’accent sur la nécessité d’effectuer l’ACS Plus afin d’éclairer les options en matière de politiques et de programmes, dès les premières étapes du cycle d’élaboration des politiques et des programmes, et d’appliquer l’ACS Plus jusqu’aux étapes de la surveillance et de l’évaluation (rapport de 2018 de l’OCDE; audit de 2015; rapport de 2015 du FEWO).
- FEGC a élaboré un outil de travail sur l’intersectionnalité pour renforcer l’application de l’ACS Plus et les considérations relatives à l’intersectionnalité (rapport de 2018 de l’OCDE).
- depuis 2017, FEGC a publié huit microleçons vidéo sur l’application de l’ACS Plus à des enjeux précis afin d’éliminer les obstacles qui empêchent de comprendre comment effectuer l’ACS Plus (audit de 2015). Ces vidéos, publiées sur le site Web de FEGC, portent sur des sujets comme la réalisation de l’ACS Plus, l’ACS Plus des changements climatiques, l’ACS Plus de la prévention et du traitement des commotions cérébrales, et l’intersectionnalité (audit de 2015; rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2018 de l’OCDE).
- FEGC, l’École de la fonction publique du Canada et d’autres partenaires de la mise en œuvre de l’ACS Plus ont conçu et dispensé trois cours sur l’ACS Plus pour renforcer la capacité de la fonction publique à appliquer l’ACS Plus. Ces cours comprennent une introduction à l’ACS Plus, un cours intermédiaire sur l’ACS Plus et un cours appliqué sur l’ACS Plus (audit de 2015; rapport de 2015 du FEWO; rapport de 2018 de l’OCDE).
- FEGC fournit des conseils techniques ponctuels et de la formation aux organismes centraux et aux ministères responsables sur l’application de l’ACS Plus (audit de 2015; rapport de 2018 de l’OCDE).
- En décembre 2018, par l’entremise de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, le gouvernement du Canada a élargi le mandat de l’ancien ministère de la Condition féminine au-delà de l’égalité pour les femmes afin d’inclure des considérations plus larges relatives à l’égalité des genres et des considérations intersectionnelles (rapport de 2018 de l’OCDE). De plus, la Loi a clarifié le pouvoir de FEGC de renforcer l’application de l’ACS Plus et de promouvoir une meilleure compréhension de l’intersectionnalité (rapport de 2018 de l’OCDE).
- Dans les budgets fédéraux successifs depuis 2016, FEGC a obtenu des ressources financières et humaines supplémentaires pour l’aider à remplir son mandat d’ACS Plus (audit de 2009, audit de 2015). En date d’octobre 2022, l’équipe de FEGC responsable de l’ACS Plus compte 17 postes équivalents temps plein pour exécuter le mandat d’ACS Plus.
- Ayant déterminé que l’ACS Plus constituait un obstacle persistant à son application optimale (audit de 2015, audit de 2022), le gouvernement du Canada a fait d’importants investissements pour améliorer la disponibilité des données désagrégées et l’accès à celles-ci (rapport de 2018 de l’OCDE). Par exemple, dans le cadre des budgets successifs du gouvernement fédéral depuis 2016, FEGC investit chaque année près de 10 millions de dollars dans les données désagrégées et la recherche pour éclairer l’ACS Plus. De plus, en 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements dans un nouveau centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada. En 2019, le Centre a mis sur pied un carrefour de statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion, où toutes les données désagrégées sont hébergées, classées et rendues accessibles dans divers formats analytiques.
- Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de 170 millions de dollars à Statistique Canada pour appuyer un plan d’action sur les données désagrégées (rapport de 2018 de l’OCDE; audit de 2022).
Recommandations en suspens
- Malgré les progrès importants précisés ci-dessus, les rapports mentionnés comportent plusieurs recommandations en suspens sur lesquelles FEGC, les organismes centraux et d’autres partenaires de la mise en œuvre de l’ACS Plus travaillent actuellement, notamment :
- la formation sur l’ACS Plus doit être rendue obligatoire (rapport de 2015 du FEWO); selon l’enquête sur la mise en œuvre de l’ACS Plus de 2020, un peu plus de 50 % des ministères et organismes fédéraux ont rendu obligatoire la formation sur l’ACS Plus pour des collectivités fonctionnelles spécifiques.
- l’achèvement du plan d’action sur les données désagrégées et l’élimination des obstacles à la mise en œuvre de l’ACS Plus liés aux données (rapport de 2018 de l’OCDE; audit de 2022).
- la réalisation de l’ACS Plus au début du cycle d’élaboration des politiques et des programmes (rapport de 2018 de l’OCDE). Selon l’enquête sur la mise en œuvre de l’ACS Plus de 2020, un peu plus de 40 % des initiatives fédérales sont menées tôt dans le processus d’élaboration. Cela est conforme au rapport sur l’ACS Plus des budgets fédéraux récents.
- l’évaluation de la qualité et des répercussions de l’ACS Plus et la production de rapports connexes (audits de 2009, 2015 et 2022).
- FEGC collabore avec les organismes centraux à l’élaboration d’un plan d’action comprenant des mesures novatrices et concrètes pour régler ces problèmes en suspens ou persistants. Ce plan d’action sera communiqué au Comité des comptes publics d’ici la fin novembre 2022.
Analyse comparative entre les sexes plus : Rôles, responsabilités et outils
Enjeu/question :
Qui est responsable de l’application de l’ACS Plus dans le processus décisionnel au sein du gouvernement fédéral et quelles ressources sont en place pour appuyer son application?
Réponse proposée
- Les ministres sont toutes et tous responsables de la mise en œuvre de l’ACS Plus dans l’ensemble de leurs portefeuilles et il incombe à chaque fonctionnaire de veiller à ce que l’ACS Plus éclaire la prise de décisions.
- Divers ministères et organismes fédéraux sont responsables du suivi et de la surveillance de l’application de l’ACS Plus, notamment Femmes et Égalité des genres Canada et les trois organismes centraux. En outre, des partenaires clés de la mise en œuvre appuient la capacité des ministères à appliquer l’ACS Plus, dont l’École de la fonction publique du Canada pour la formation et Statistique Canada pour les données.
- Il existe un certain nombre d’outils et de formations pour s’assurer que les fonctionnaires comprennent comment appliquer l’ACS Plus au processus décisionnel, nous savons toutefois que des améliorations sont toujours possibles. À la suite du rapport d’audit de la vérificatrice générale de mai 2022, FEGC collabore avec les organismes centraux et d’autres partenaires de la mise en œuvre de l’ACS Plus pour cerner les obstacles persistants et les mesures de soutien supplémentaires nécessaires pour améliorer l’application de l’ACS Plus.
Information clé
Investissement
Aucune information sur le financement
Résultats
S.O.
Exemples de projets
S.O.
Contexte
Rôles dans l’ACS Plus
- Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) appuie la mise en œuvre pangouvernementale de l’ACS Plus en élaborant de la formation et des outils pour aider les ministères et organismes fédéraux à appliquer l’ACS Plus. Le Ministère est également chargé de surveiller la mise en œuvre de l’ACS Plus par le gouvernement et de fournir des conseils et une orientation technique aux organismes centraux et aux ministères responsables sur l’application de l’ACS Plus. Le Bureau du Conseil privé, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et les autres ministères peuvent consulter directement FEGC à titre de centre d’expertise lors de l’application de l’ACS Plus ou de l’élaboration de politiques, de directives et de plans internes connexes.
- Le Bureau du Conseil privé (BCP) est chargé d’examiner les présentations des ministères et organismes, comme les mémoires au Cabinet, qui sont soumises à l’approbation du Cabinet. Ces présentations sont des étapes importantes du cycle de vie des politiques du gouvernement. Les analystes du BCP guident les membres du personnel des ministères et organismes afin d’ajouter du contenu et d’y apporter des ajustements lorsqu’ils présentent des demandes de financement ou d’autres propositions. Ce rôle des organismes centraux consiste à s’assurer que les ministères et organismes appliquent l’ACS Plus à leurs propositions d’initiatives législatives, de politiques et de programmes.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a la responsabilité d’examiner les présentations au Conseil du Trésor des ministères et organismes, qui sont soumises à l’approbation du Cabinet. Ces présentations sont des étapes importantes du cycle de vie des politiques du gouvernement, car elles fournissent des détails sur la conception, la mise en œuvre et la surveillance des initiatives fédérales.
- En vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes, une fois par année, le président du Conseil du Trésor, en collaboration avec la ou le ministre des Finances, doit rendre publiques les analyses des répercussions des programmes gouvernementaux en matière de genre et de diversité qu’il juge appropriées. À titre d’organe administratif du Conseil du Trésor, le Secrétariat aide le président à répondre à cette demande.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est également responsable de la mise en œuvre de la Politique sur les résultats et, par cette politique, de l’intégration de l’ACS Plus à la planification ministérielle et à la production de rapports, aux évaluations des programmes et à la mesure du rendement.
- Le ministère des Finances Canada dirige la budgétisation sensible aux sexes en vertu de la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes. En vertu de la Loi, la ou le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures; la ou le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public. De plus, une fois par année, la ou le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales. À titre de centre d’expertise du gouvernement du Canada en matière d’égalité des genres, FEGC collabore avec le ministère des Finances Canada à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes et à la rédaction de l’Énoncé sur l’égalité des genres et la diversité.
- Les ministères et organismes fédéraux sont tenus d’intégrer l’ACS Plus à tous leurs processus décisionnels, y compris les mémoires au Cabinet, les présentations au Conseil du Trésor, les propositions budgétaires fédérales et les règlements.
Ressources mises à la disposition des ministères et organismes fédéraux
Formation :
- La formation de base sur l’ACS Plus est accessible à tous les ministères et organismes fédéraux ainsi qu’au grand public dans le cadre du cours Introduction à l’ACS Plus, sur le site Web de FEGC. Ce cours est également ouvert aux fonctionnaires fédéraux par l’entremise de la plateforme d’apprentissage de l’École de la fonction publique du Canada.
- Depuis qu’il a été lancé en 2012, près de 225 000 fonctionnaires, parlementaires et membres de leur personnel ont suivi le cours en ligne Introduction à l’ACS Plus.
- En outre, un cours plus avancé sur la façon d’appliquer une ACS Plus exhaustive et intersectionnelle est accessible aux fonctionnaires fédéraux par l’entremise de l’École de la fonction publique du Canada.
- Depuis le lancement de ce cours en février 2021, plus de 500 fonctionnaires fédéraux ont suivi le cours virtuel animé par une formatrice ou un formateur.
Ressources :
- Depuis 2017, les ressources et les outils suivants ont été mis à la disposition des fonctionnaires fédéraux et du grand public sur le site Web de FEGC :
- Outil de travail sur l’intersectionnalité
- Outil de travail pour la planification d’événements inclusifs
- Microleçon vidéo – Les 10 principales choses à ne pas faire en ACS Plus
- Microleçon vidéo – La sécurité des Canadiennes et Canadiens : une priorité ici et partout dans le monde
- Microleçon vidéo – Le changement climatique touche-t-il tout le monde de la même façon?
- Microleçon vidéo – L’ACS Plus appliquée à la prévention et au traitement des commotions cérébrales
- Microleçon vidéo – L’ACS Plus en action à la Garde côtière canadienne
- Microleçon vidéo – L’ACS Plus : étape par étape
- Microleçon vidéo – ACS Plus : Au-delà du sexe et du genre
- Microleçon vidéo – L’ACS Plus : Égalité ou équité?
- Directives sur l’élaboration d’un cadre d’ACS Plus au sein des ministères responsables
- De plus, en juin 2021, FEGC a publié une nouvelle série d’outils pour aider les fonctionnaires à appliquer une ACS Plus intersectionnelle rigoureuse. Cette série se composait d’un guide étape par étape et d’un outil de référence rapide comportant des questions clés à prendre en compte dans le cadre de l’ACS Plus, ainsi que d’un recueil d’outils sur chacun des facteurs identitaires individuels à prendre en compte dans le cadre de l’ACS Plus. Ces outils comprenaient des statistiques clés et des considérations pour chaque facteur. Ces outils visaient à aider les fonctionnaires fédéraux à mieux comprendre comment appliquer l’ACS Plus d’un point de vue intersectionnel.
L’ACS Plus et la COVID-19
- Tout au long de la réponse à la pandémie de COVID-19, FEGC a collaboré avec des partenaires à l’échelle du gouvernement pour veiller à ce que l’ACS Plus soit appliquée aux mesures d’intervention, notamment :
- créer une équipe de travail sur la COVID-19 au sein de FEGC pour aider les ministères à appliquer l’ACS Plus. L’équipe de travail a compilé des recherches et des données pour éclairer l’ACS Plus, a mis au point des outils pour appuyer la capacité des ministères à appliquer l’ACS Plus et a fourni des conseils et une orientation techniques sur l’ACS Plus.
- communiquer aux ministères et aux organismes fédéraux une synthèse des connaissances et une analyse exhaustive des répercussions sexospécifiques et intersectionnelles de la COVID-19 afin d’éclairer l’ACS Plus des mesures d’intervention. FEGC a également élaboré des exposés de politique, les dix questions principales pour faire une ACS Plus des mesures d’intervention liées à la COVID-19 et d’autres ressources « Les faits en bref » sur l’ACS Plus.
- coprésider (avec Patrimoine canadien) le Groupe de travail sur les collectivités en quête d’équité et la COVID‑19 au sein du gouvernement fédéral. Cela a permis aux ministères fédéraux de discuter de l’application de l’ACS Plus à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes dans le contexte de la COVID-19. Le Groupe de travail a également permis d’entendre directement des personnes de diverses collectivités en quête d’équité au sujet de leur expérience vécue durant la pandémie. Les responsables de l’ensemble du gouvernement du Canada ont ainsi pu obtenir de précieux renseignements sur la façon dont différentes personnes vivaient la pandémie et les mesures de santé publique et autres mises en œuvre par divers gouvernements.
- collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour appuyer l’application de l’ACS Plus à leur réponse à la COVID-19, notamment par le partage d’outils – comme « les dix questions principales pour faire une ACS Plus dans le contexte de la COVID-19 » – et une synthèse des connaissances sur les répercussions de la pandémie sur différentes populations.
- convoquer les personnes-ressources de l’ACS Plus de l’ensemble du gouvernement du Canada à une séance spéciale pour discuter de l’application de l’ACS Plus aux mesures liées à la COVID-19. Il était notamment question d’animer un échange sur les pratiques exemplaires, les lacunes et sur les difficultés rencontrées par les personnes‑ressources en aidant leurs ministères à appliquer rigoureusement l’ACS Plus à leurs mesures d’intervention.
- tenir une table ronde, en collaboration avec l’École de la fonction publique du Canada, intitulée « Intervention inclusive contre la pandémie grâce à l’analyse comparative entre les sexes plus », à laquelle 1 500 fonctionnaires ont participé.
Exemples d’application de l’ACS Plus aux initiatives
ACS Plus et sécurité aéroportuaire :
- L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a appliqué l’ACS Plus aux bornes d’inspection primaire, qui ont été créées pour améliorer les services frontaliers pour les voyageuses et voyageurs internationaux dans les aéroports les plus achalandés du Canada. Tout au long de la phase de planification, l’ACS Plus a été utilisée pour éclairer la conception et le fonctionnement des bornes afin de s’assurer qu’aucun groupe ne serait injustement désavantagé par la technologie. Bien que l’ACS Plus ait montré que la plupart des éléments des bornes avaient des répercussions minimales sur différents groupes, elle a permis de constater que l’authentification faciale pouvait avoir des répercussions différentes selon le genre, l’âge, la mobilité et l’ethnicité des personnes. Par exemple, la technologie de reconnaissance faciale ne fonctionne pas bien sur les enfants, mais son rendement s’améliore rapidement à mesure qu’une personne vieillit. L’ACS Plus a été utilisée pour élaborer une stratégie d’atténuation dans le cadre de laquelle les voyageuses et voyageurs dont les notes de correspondance sont inférieures à un seuil préétabli sont soumis à une inspection visuelle.
ACS Plus et recherche en santé :
- La recherche a démontré que le genre et l’âge sont des variables clés pour expliquer l’incidence, les symptômes et le rétablissement des traumatismes crâniens. Par exemple, après une commotion cérébrale, les femmes disent ressentir plus de symptômes, un déclin cognitif plus important et un temps de réaction plus lent. L’incidence la plus élevée de commotions cérébrales est observée chez les enfants et les adolescents, et les adolescentes subissent davantage de commotions cérébrales, présentent des symptômes différents et plus graves, et se rétablissent plus lentement. Les Instituts de recherche en santé du Canada demandent aux chercheuses et chercheurs qui présentent une demande de financement – y compris pour la recherche sur les commotions cérébrales – d’indiquer si, et de quelle façon, le sexe et le genre sont intégrés à leur projet de recherche.
ACS Plus et changements climatiques :
- L’ACS Plus a été appliquée à des initiatives clés de l’approche du Canada en matière de changements climatiques, car la recherche montre que les changements climatiques ont des répercussions différentes sur les gens en fonction de multiples facteurs intersectionnels. Par exemple, dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, le gouvernement collabore avec les collectivités autochtones et côtières pour mettre au point un système de sécurité maritime de classe mondiale qui répond aux besoins uniques du Canada. L’ACS Plus aide à faire en sorte que les groupes sous‑représentés dans l’Arctique canadien, y compris divers groupes d’Autochtones et de femmes, jouent un rôle actif dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions d’urgence et la gestion des voies navigables. De plus, l’ACS Plus a été appliquée à la Politique d’aide internationale féministe du Canada, reconnaissant que les femmes vivant en situation de pauvreté subissent de façon disproportionnée les effets des changements climatiques.
Application de l’analyse comparative entre les sexes plus
Enjeu/question :
Comment le gouvernement du Canada appuie-t-il la capacité des fonctionnaires à appliquer l’ACS Plus aux processus décisionnels?
Réponse proposée
- Le gouvernement du Canada maintient son engagement envers l’ACS Plus et continue de promouvoir activement son application dans l’ensemble des processus décisionnels du gouvernement.
- C’est parce que l’ACS Plus est reconnue comme étant un volet efficace de la stratégie du gouvernement visant à faire avancer l’égalité et comme répondant aux besoins de diverses personnes par ses programmes et initiatives.
- L’ACS Plus est le résultat de plus de 25 ans d’amélioration continue, qui a engendré une augmentation progressive de sa portée grâce à une série d’actions délibérées.
- Des exigences législatives et non législatives ont notamment été établies pour intégrer l’ACS Plus aux processus décisionnels du gouvernement.
- En plus de rendre l’ACS Plus obligatoire pour les documents du Cabinet et d’autres documents décisionnels, le gouvernement a également investi dans le renforcement de la capacité pour s’assurer que l’ACS Plus est robuste, intersectionnelle et étayée par des données et des études de qualité.
- Il reste du travail à faire en matière d’ACS Plus, pour peaufiner les outils et leur application à mesure que nous apprenons, notamment en discutant avec les collectivités et les parties prenantes des connaissances et des facteurs culturels à prendre en compte dans ces analyses.
Information clé
Investissement
Aucune information sur le financement
Résultats
S.O.
Exemples de projets
S.O.
Contexte
- L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) est un outil d’analyse utilisé pour appuyer l’élaboration de politiques, de programmes et d’autres initiatives adaptés et inclusifs. C’est un processus qui permet de comprendre qui est touché par les problèmes que nous cherchons à traiter, de déterminer comment adapter les initiatives pour répondre aux divers besoins, et d’anticiper et atténuer les obstacles qui empêchent d’accéder aux initiatives ou d’en bénéficier.
- L’ACS Plus est intersectionnelle de par sa conception, ce qui signifie qu’elle va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour prendre en compte d’autres facteurs, comme l’âge, le handicap, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie, la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle, ainsi que le contexte social, y compris les normes sociales, les attitudes et la discrimination systémique.
Efforts pour améliorer la capacité d’appliquer une ACS Plus rigoureuse à l’échelle du gouvernement
- Le gouvernement du Canada maintient son engagement envers l’analyse comparative entre les sexes (ACS) depuis près de trente ans. Elle découle d’un engagement fédéral de 1995 de la mettre en œuvre dans tous les ministères et organismes fédéraux en réponse à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing de l’ONU présentés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
- En 2007, la version révisée du Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor exige que des renseignements sur l’ACS Plus soient inclus dans toute présentation au Conseil du Trésor.
- En 2011, le gouvernement fédéral a renommé l’ACS en ACS Plus. Le « plus » a été ajouté pour encourager la prise en compte des multiples facteurs qui façonnent les expériences et les résultats, au-delà du sexe et du genre. Avec ce changement de marque, la roue de l’ACS Plus a été également introduite.
- En 2015, le vérificateur général du Canada a effectué un audit du rendement de l’ACS Plus, qui recommandait que Condition féminine Canada (aujourd’hui FEGC), le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor collaborent avec tous les ministères fédéraux pour repérer les obstacles à la mise en œuvre de l’ACS Plus et évaluent périodiquement les progrès pour en faire rapport.
- En 2016, le gouvernement du Canada a élaboré le Plan d’action sur l’ACS Plus de 2016‑2020 pour mettre en œuvre la gouvernance interministérielle afin d’appuyer la mise en œuvre de l’ACS, une exigence relative à l’ACS Plus dans les mémoires au Cabinet et le renouvellement de l’engagement d’intégrer l’ACS Plus dans les présentations au Conseil du Trésor.
- En 2018, la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes a été adoptée. L’ACS Plus a été inscrite dans la loi pour l’ensemble des nouvelles mesures budgétaires annuelles, les dépenses fiscales et les dépenses existantes du gouvernement fédéral.
- Les engagements pris à l’égard de l’ACS Plus ont été inclus dans toutes les lettres de mandat ministériel. La même année, la Loi sur l’évaluation d’impact est entrée en vigueur. L’ACS Plus est prévue par la loi pour toutes les grandes initiatives dans le cadre des évaluations d’impact.
- De plus, au cours des dernières années, le gouvernement a instauré un certain nombre d’exigences non législatives relatives à l’application de l’ACS Plus, notamment :
- la Directive sur les résultats, qui exige que les responsables des programmes intègrent l’ACS Plus (le cas échéant) lors de l’établissement, de la mise en œuvre et de la tenue à jour des profils de l’information sur le rendement des programmes.
- la Directive du Cabinet sur la réglementation, qui exige que les ministères et organismes fédéraux entreprennent une évaluation des répercussions sociales et économiques sur divers groupes de Canadiennes et de Canadiens de chaque projet de règlement.
- la Politique sur les paiements de transfert, qui exige que les ministères et organismes veillent à ce que les programmes de paiements de transfert soient conçus et exécutés de manière à être inclusifs et sensibles au genre et à la diversité, et répondent aux priorités et aux objectifs stratégiques du gouvernement.
- En septembre 2018, le gouvernement a lancé le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada en réponse à la demande croissante de meilleures données intersectionnelles. Le Centre renferme des faits en bref, des statistiques et des analyses récentes sur l’égalité des genres et la diversité. En 2021, des investissements ont été prévus dans le budget de 2021 pour renforcer la collecte de données désagrégées afin de permettre une application plus rigoureuse de l’ACS Plus. Des modifications ont été apportées à la Politique sur les paiements de transfert pour inclure les exigences en matière d’ACS dans les programmes de subventions et de contributions. Des engagements ont également été pris dans les lettres de mandat ministériel pour améliorer le cadre et les paramètres de l’ACS Plus.
- Afin de surveiller l’application de l’ACS Plus dans l’ensemble du gouvernement fédéral et de cerner les obstacles à l’ACS Plus et les possibilités de renforcer sa mise en œuvre, FEGC a instauré en 2016 une enquête annuelle sur la mise en œuvre de l’ACS Plus. L’enquête recueille des données auprès de tous les ministères et organismes fédéraux sur leur gouvernance, capacité, application et surveillance de l’ACS Plus, la formation en la matière et les obstacles à l’ACS Plus. Les résultats de cette enquête ont été communiqués aux sous‑ministres dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. De plus, FEGC a utilisé ces renseignements pour déterminer les nouveaux outils, la formation et les autres ressources nécessaires pour améliorer l’application de l’ACS Plus par les ministères et organismes.
- En novembre 2018, FEGC a organisé un forum sur l’ACS Plus, auquel plus de 1 000 personnes ont participé pour partager leurs points de vue sur le renforcement de l’ACS Plus. Le forum a généré des indications importantes, dont la nécessité d’un engagement inclusif et de possibilités de participation au processus décisionnel, d’une plus grande compétence culturelle, d’une plus grande sensibilisation aux divers facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’ACS Plus, d’une meilleure responsabilisation, d’une capacité accrue de mener une analyse rigoureuse et intersectionnelle, et d’une personne‑ressource centrale pour faciliter les progrès continus de la mise en œuvre de l’ACS Plus.
- En 2017-2018, le gouvernement du Canada a demandé à l’OCDE d’entreprendre un examen de l’écosystème de l’égalité des genres, y compris l’application de l’ACS Plus, la gouvernance et les pratiques budgétaires. L’examen, publié en juin 2018, a fourni un certain nombre de recommandations en matière d’ACS Plus, notamment :
- l’élargissement du mandat de FEGC afin d’étendre la portée, qui visait uniquement les femmes, à des enjeux plus vastes pour être en harmonie avec la nature générale de l’ACS Plus, ainsi que des ressources afin de permettre à FEGC de devenir le carrefour des politiques du gouvernement sur les questions de l’égalité des genres, de l’ACS Plus et de
- la clarification des pouvoirs et des responsabilités afin de mieux tenir compte de l’égalité des genres et de l’intersectionnalité dans le processus décisionnel du Cabinet
- l’élaboration d’une stratégie de collecte de données pour éliminer les obstacles à l’ACS Plus liés aux données et appuyer les progrès réalisés à l’égard du Cadre des résultats relatifs aux sexes
- l’établissement de critères d’évaluation de la qualité de l’ACS Plus
- un soutien des ministères dans l’application de l’ACS Plus en début de processus d’élaboration des politiques et le suivi de l’application de l’ACS Plus tout au long du cycle des politiques
- la communication publique des rapports sur l’ACS Plus dans le respect des politiques de confidentialité du Cabinet
- Outre ces recommandations, l’OCDE a également demandé au BVG de tenir compte de l’ACS Plus dans toutes les vérifications du rendement et que les comités parlementaires intègrent l’ACS Plus dans leurs travaux
- Les indications tirées de l’enquête annuelle sur la mise en œuvre, du forum sur l’ACS Plus et de l’étude de l’OCDE ont éclairé les initiatives du Plan d’action sur l’ACS Plus 2016-2020 du gouvernement du Canada, qui donnait également suite aux recommandations de la vérification du rendement de l’ACS Plus de 2015 du vérificateur général du Canada.
L’évolution de l’ACS Plus au gouvernement du Canada
1995 : Engagement du gouvernement envers l’ACS
- À la suite de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Beijing, en Chine, et avec l’approbation de la Déclaration et Programme d’action de Beijing, le gouvernement du Canada s’est engagé à effectuer une ACS pour l’ensemble des programmes et des politiques.
2007 : ACS obligatoire dans les présentations au SCT
- La version révisée du Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor de 2007 exige que des renseignements sur l’ACS soient inclus dans toute présentation au Conseil du Trésor.
2011 : Nouveau nom : ACS Plus
- En 2011, le gouvernement du Canada a renommé l’ACS en ACS Plus. Le « plus » a été ajouté pour encourager la prise en compte des multiples facteurs qui façonnent les expériences et les résultats, au-delà du sexe et du genre. Avec ce changement de marque, la roue de l’ACS Plus a été introduite.
2015 : Vérification de l’ACS par le vérificateur général
- Ce rapport recommandait que Condition féminine Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor collaborent avec tous les organismes fédéraux pour repérer les obstacles à la mise en œuvre de l’ACS Plus et évaluent périodiquement les progrès pour en faire rapport.
2016 : Plan d’action sur l’ACS Plus
- Le Plan d’action sur l’ACS Plus de 2016-2020 comprend une exigence d’inclure l’ACS Plus dans les mémoires au Cabinet et un engagement à l’intégrer dans les processus stratégiques.
- Le Plan réaffirme l’obligation d’appliquer l’ACS Plus dans les présentations au Conseil du Trésor.
- Le processus de gouvernance à l’appui de l’ACS Plus a été mis en œuvre. La formation a été élargie avec l’École de la fonction publique du Canada (EFPC).
2018 : Budget de 2018
- La Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes a été adoptée en décembre 2018. L’ACS Plus est prévue par la loi pour l’ensemble des nouvelles mesures budgétaires annuelles, les dépenses fiscales et les dépenses existantes.
2019 : Intégration de l’ACS Plus
- Les engagements pris à l’égard de l’ACS Plus sont compris dans toutes les lettres de mandat ministériel.
- La Loi sur l’évaluation d’impact est entrée en vigueur. L’ACS Plus est prévue par la loi pour toutes les grandes initiatives dans le cadre des évaluations d’impact.
2021‑2022 : Renforcement de l’ACS Plus
- Des engagements sont pris dans les lettres de mandat ministériel pour renforcer l’application de l’ACS Plus et élaborer un processus d’évaluation de ses répercussions.
- Des investissements sont prévus dans le budget de 2021 pour renforcer les données désagrégées afin d’éclairer l’ACS Plus.
- Des modifications sont apportées à la politique sur les paiements de transfert pour inclure les exigences en matière d’ACS Plus dans les programmes de S et C.
- FEGC, les organismes centraux et les ministères partenaires publient de nouvelles directives et méthodes pour l’ACS Plus.
Aperçu du Comité
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI)
Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a pour mandat d’examiner les projets de loi ainsi que les questions liées aux affaires culturelles et aux arts, aux affaires sociales et au travail, à la santé et au bien-être, aux pensions et au logement. Il est aussi responsable de l’étude des questions concernant la condition physique et les sports amateurs, l’emploi et l’immigration, les affaires des consommateurs et les affaires de la jeunesse.
Durant la dernière décennie, le Comité a réalisé une variété d’études spéciales et produit plusieurs rapports marquants. Dans le domaine de la santé, il a entrepris, en 2002, une étude en plusieurs phases du système de soins de santé du Canada, qui mettait l’accent sur la viabilité du système à long terme et sur le rôle du gouvernement fédéral dans sa réforme et son renouvellement. Comme le rapport de la Commission royale Romanow, qui a rendu public son dernier rapport un mois plus tard, le rapport final du Comité a contribué de façon significative au débat sur la politique. Suite à son étude en six volumes sur les soins de santé, le Comité fut reconnu comme un lieu privilégié pour une discussion publique sur la politique en matière de santé.
Le Comité a produit des rapports de fond suite à des études approfondies sur la santé mentale, sur les médicaments sur ordonnance, sur les adoptions forcées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur la démence dans la société et sur l’incidence de l’obésité au Canada. Parmi les autres questions sociales ayant fait l’objet d’un rapport de fond, mentionnons l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées et du régime enregistré d’épargne-invalidité, le rôle du gouvernement fédéral dans un fonds de financement social et l’intégration des technologies de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’impression en 3D dans le système de soins de santé. Il a aussi mené une étude sur la réponse du gouvernement à la pandémie COVID-19.
Le Comité a examiné des projets de portaient sur un large éventail de sujets reflétant l’étendue du mandat du Comité et comprenant notamment : la santé, les aliments et drogues, la citoyenneté et l’immigration, la sûreté publique et la sécurité des produits, les pensions et l’assurance-emploi, la sensibilisation à diverses questions par la tenue de jours ou de semaines désignés, les modifications proposées au Code criminel et d’autres sujets divers. Au cours des dernières années, le Comité a examiné la nouvelle Loi canadienne sur l’accessibilité, laquelle accroît la participation pleine et égale de toutes les personnes, notamment les personnes handicapées, la Loi sur le cannabis, qui légalise l’accès au cannabis, ainsi que les changements à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que le gouvernement avait apportés pour donner suite à deux décisions de justice sur l’isolement préventif. Des projets de loi d’intérêt public du Sénat concernant des changements au Règlement sur le sang et des modifications à la Loi sur l’hymne national, ont aussi été renvoyés au Comité.
En plus d’examiner divers projets de loi, lors de la 43e législature, le Comité a étudié :
- la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19
- l’avenir des travailleurs au Canada
- la mise en œuvre et la réussite d’un cadre fédéral relatif à l’état de stress post‑traumatique (TSPT) par le gouvernement du Canada
En plus d’examiner de divers projets de loi, lors de la 44e législature, le Comité a convenu d’étudier :
- le rôle de l’analyse comparative entre les sexes plus dans le processus d’élaboration des politiques
- le Cadre fédéral de prévention du suicide (en cours)
- le cadre législatif et réglementaire de la procréation assistée au Canada ainsi que toute autre question connexe jugée pertinente par le Comité
Le format des réunions des comités sénatoriaux est sensiblement moins structuré que celui des comités de la Chambre des communes. Par exemple, il n’y a pas d’ordre préapprouvé ni de temps alloué pour les périodes de questions. La présidente peut établir un plan au début de la réunion si elle estime que ce sera nécessaire, mais autrement, elle gère le temps afin de permettre à l’ensemble des membres de poser des questions. La présidente est plus susceptible de prendre le temps de poser des questions que le président d’un comité de la Chambre, et les membres ont plus souvent tendance à poursuivre dans la lignée de la question de la sénatrice ou du sénateur précédent qu’en comités de la Chambre.
Membres du SOCI
Groupe des sénateurs indépendants (GSI):
Ratna Omidvar, présidente du GSI - (Ontario)
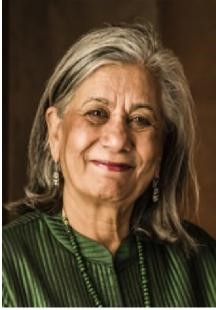
En avril 2016, le premier ministre Trudeau a nommé la sénatrice Omidvar au Sénat du Canada en tant que sénatrice indépendante représentant l’Ontario. Membre du Groupe des sénateurs indépendants, elle est responsable du plumitif. Ratna Omidvar est une experte de renommée mondiale en matière de migration, de diversité et d’inclusion. Depuis son arrivée au Canada d’Iran, en 1981, sa propre expérience du déplacement, de l’intégration et de la participation citoyenne a constitué le fondement de ses travaux.
La sénatrice Omidvar est la directrice générale fondatrice du Global Diversity Exchange (GDX) et une éminente professeure invitée à l’École de gestion Ted Rogers de l’Université Ryerson. Le GDX est un groupe de réflexion et d’action sur la diversité, la migration et l’inclusion qui fait le lien entre l’expérience et les idées locales et les réseaux mondiaux. Il se consacre à la création d’une communauté de leaders internationaux qui perçoivent la migration comme une source de prospérité.
La sénatrice Omidvar copréside actuellement le Conseil mondial pour la migration organisée par le Forum économique mondial et elle est conseillère au Conseil mondial pour les réfugiés. Elle est également directrice à l'Environics Institute et au Centre Samara pour la démocratie de même que présidente émérite du Conseil sur l'emploi des immigrants de la région de Toronto. Elle était auparavant présidente de l'organisme Lifeline Syria.
La sénatrice Omidvar est coauteure de Flight and Freedom: Stories of Escape to Canada (2015), un ouvrage primé d’Open Book Toronto en 2015, qui figure parmi les cinq recommandations de lecture du festival Word on the Street du Toronto Star. Elle est aussi une collaboratrice de l’ouvrage The Harper Factor (2016) et codirectrice de Five Good Ideas: Practical Strategies for Non-Profit Success (2011). La sénatrice Omidvar a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université York en 2012.
Par ailleurs, en 2010, la sénatrice Omidvar a été reconnue par The Globe and Mail au nombre des bâtisseurs de la décennie au Canada pour ce qui est de la citoyenneté. Elle figurait parmi les dix principaux champions mondiaux de la diversité de la première liste de la diversité mondiale dressée par le magazine The Economist en 2015. En 2016, elle a reçu des prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations de la part de CivicAction et de l’Institut urbain du Canada, récompenses qui lui ont été remises pour rendre hommage à son profond dévouement pour le leadership civique et l’édification des villes.
Domaines d’intérêt :
- Immigration et intégration, et réfugiés
- Secteur de la bienfaisance
- Réduction de la pauvreté
- Modernisation du Sénat
Stan Kutcher, GSI - (Nouvelle-Écosse)

Nommé au Sénat en décembre 2018 par le premier ministre Justin Trudeau, le sénateur Kutcher est un psychiatre et professeur de renom qui a aidé des jeunes à gérer avec succès de graves maladies mentales. Le Dr Kutcher a étudié l’histoire et les sciences politiques avant de décrocher un diplôme en médecine de l’Université McMaster. Il a poursuivi ses études à Toronto, puis à Édimbourg, en Écosse, après quoi il est revenu au Canada pour travailler à l’Université de Toronto.
C’est là qu’il a fait la première de ses nombreuses contributions au système de soins de santé du Canada, notamment en transformant la division de psychiatrie de l’adolescent de l’Hôpital Sunnybrook en un centre novateur de soins cliniques et de recherche. Il a aussi été à l’avant‑garde de la recherche sur les causes des problèmes de santé mentale graves chez les jeunes, comme le trouble bipolaire, la schizophrénie et la dépression, et les traitements connexes.
Le Dr Kutcher a ensuite été nommé directeur du département de psychologie de l’Université Dalhousie, puis doyen adjoint, Santé internationale, et titulaire de la Chaire Financière Sun Life sur la santé mentale des adolescents.
En plus d’exercer sa profession, le Dr Kutcher a siégé au conseil d’administration de la Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse ainsi qu’au conseil d’administration du Spryfield Boys and Girls Club. Il a aussi dirigé l’élaboration d’un cadre national sur la santé mentale des jeunes du Canada à titre de membre du Comité consultatif sur les jeunes et les enfants de la Commission de la santé mentale du Canada.
Le Dr Kutcher a également reçu de nombreux prix et distinctions d’excellence pour son travail, dont l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, le prix Naomi Rae-Grant et le prix Paul D. Steinhauer de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le McMaster University Distinguished Alumni Award et le prix John Ruedy pour l’innovation en enseignement médical de l’Association des facultés de médecine du Canada.
Domaines d’intérêt :
- Santé mentale
- Trouble bipolaire et trouble dépressif majeur
Rosemary Moodie, GSI - (Ontario)

Nommée au Sénat en décembre 2018 par le premier ministre Justin Trudeau, la sénatrice Moodie, qui est née en Jamaïque, est pédiatre et néonatologiste. Après avoir obtenu un diplôme de l’University of the West Indies, elle a suivi une formation postdoctorale en pédiatrie et en médecine néonatale et périnatale au Hospital for Sick Children à Toronto.
La sénatrice Moodie est néonatologiste principale, enseignante clinique et professeure agrégée au département de pédiatrie de l’Université de Toronto. Elle est aussi membre du Collège royal des médecins du Canada et de l’American Academy of Pediatrics. Ses travaux de recherche ont porté sur les déterminants sociaux de l’allaitement et elle est l’auteure de nombreuses publications sur les services de santé régionaux et la planification des effectifs médicaux.
La sénatrice Moodie est une figure réputée à l’échelle nationale et internationale dans le domaine médical. Elle a appuyé des organismes et des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration de politiques et de la défense des intérêts afin d’améliorer l’équité en santé et d’élargir l’accès à des soins de santé de qualité pour les populations les plus vulnérables, les plus mal desservies et les plus marginalisées. Durant sa carrière, elle a été tour à tour directrice générale de la pédiatrie et directrice médicale du programme régional de santé maternelle et infantile du réseau de la santé de la vallée de la Rouge, responsable de la santé maternelle, infantile et de la jeunesse et de la gynécologie du réseau local d’intégration des services de santé du Centre‑Est, et membre de comités régionaux et provinciaux, dont le Child Health Network et le Provincial Council of Children’s Health. Elle possède également une expertise en planification des soins de santé à l’échelle locale et internationale.
La sénatrice Moodie est également évaluatrice d’hôpitaux pour Agrément Canada et possède une vaste expérience de l’amélioration de la qualité des soins offerts au Canada et à l’étranger.
La sénatrice Moodie est une ardente défenseure des femmes et des jeunes filles. Elle a grandement contribué à réduire les inégalités sociales et les écarts en matière de santé touchant les enfants et les milieux. Elle siège au conseil d’administration inaugural de Providence Healthcare, du St. Joseph’s Health Centre et de l’hôpital St. Michael’s (Unity Health Toronto) et de la ScotiaBank Jamaica Foundation.
Domaines d’intérêt :
- Réduction des inégalités sociales et des écarts en matière de santé chez les enfants
- Logement abordable
- Enfants et jeunes
- Collecte de données fondées sur la race
Chantal Petitclerc, GSI - (Québec - Grandville)

La sénatrice Chantal Petitclerc a été nommée au Sénat le 18 mars 2016 par le premier ministre Justin Trudeau. L’honorable Chantal Petitclerc est à la fois une athlète de renommée internationale et une femme de cœur. À l’âge de 13 ans, un accident l’a privée de l’usage de ses jambes. Pendant qu'elle perfectionnait ses habiletés à titre d'athlète en fauteuil roulant, la sénatrice Petitclerc s'est consacrée à ses études, d'abord en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy et, par la suite, en histoire à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Elle a surmonté l’adversité et de nombreux obstacles pour devenir une cheffe de file incontestée dans le monde du sport. Les médailles d'or qu'elle a remportées aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth, les nombreux prix et marques de reconnaissance dont elle a fait l'objet, ainsi que sa nomination à titre de chef de mission de l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Rio, témoignent de son triomphe.
Ses nombreuses réalisations et son parcours personnel ont fait d’elle une conférencière de marque, reconnue à travers le Canada. La sénatrice Petitclerc est porte-parole du Défi sportif AlterGo depuis 17 ans et ambassadrice de l’organisme international Right to Play. Messagère inlassable de la contribution des personnes handicapées à notre société, elle joue assurément un rôle dans la création d’une société plus inclusive. Par son exemple, elle encourage les autres à surmonter les obstacles pour réaliser leur potentiel.
En raison des expériences qu’elle a vécues, la sénatrice Petitclerc a aussi été amenée à bien connaître les caractéristiques particulières des diverses collectivités, ainsi que les procédures décisionnelles à l’échelle nationale. Ayant elle-même des limites fonctionnelles, elle est en mesure de bien comprendre les besoins de diverses minorités et souhaite contribuer à faire entendre leurs préoccupations. La sénatrice est Compagnon de l’Ordre du Canada et Chevalière de l’Ordre du Québec. Elle a reçu le trophée Lou Marsh de l’Athlète de l’année au Canada et elle a été intronisée au Temple de la renommée paralympique du Canada. Elle a aussi reçu quatre doctorats honorifiques. De plus, la sénatrice Petitclerc offre une contribution dynamique et un savoir‑faire unique en siégeant à plusieurs comités et conseils d’administration.
Domaines d’intérêt :
- Personnes handicapées
- Accessibilité
- Agriculture et foresterie
- Cadre fédéral relatif au trouble stress post-traumatique
Donna Dasko, GSI - (Ontario)

Donna Dasko a été nommée au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau le 6 juin 2018.
Spécialiste réputée des sondages, commentatrice dans les médias et chef d’entreprise, elle possède une vaste expérience dans le milieu des politiques publiques. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université du Manitoba ainsi que d’une maîtrise ès arts et d’un doctorat de l’Université de Toronto.
Madame Dasko a été vice-présidente principale d’Environics Research Group. Sous sa gouverne, la petite société d’experts-conseils est devenue l’un des plus importants cabinets de recherche au pays. Au cours de sa carrière, elle a dirigé d’importants projets de recherche pour des ministères et des organismes fédéraux et provinciaux, une clientèle du secteur privé et des organisations non gouvernementales, dans de nombreux domaines, y compris l’économie, les priorités budgétaires, la lutte contre le tabagisme, la promotion de la santé et l’unité nationale. Elle figure parmi les chefs de file de la conception de sondages menés pour le compte de médias, dont le Globe and Mail, ainsi que de sondages dans le cadre d’élections et de dossiers spéciaux réalisés pour la Société Radio-Canada.
À titre de bénévole communautaire, elle a occupé de nombreuses fonctions, notamment de présidente de l’organisme St. Stephen’s Community House, directrice de Centraide du Grand Toronto, gouverneure du Conseil de l’unité canadienne (consacré à l’unité canadienne et au fédéralisme), présidente de la table ronde nationale des dirigeants d’entreprise de la Société Alzheimer Canada et conseillère du Comité politique pour l’environnement (qui favorise le leadership en matière d’environnement).
La détermination de Mme Dasko à accroître la présence des femmes en politique a guidé la majeure partie de son action sociale. Elle a cofondé À voix égales, un organisme non partisan qui vise à faire élire un plus grand nombre de femmes au Canada, et elle en a été la présidente nationale. Elle siège actuellement au conseil d’administration du Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, organisation qui fait la promotion de l’égalité des droits pour les femmes. En 2015, elle a cofondé la Campagne pour un Sénat à représentation égale, une initiative qui vise à favoriser la parité au sein du Sénat. Elle aide également le National Democratic Institute à faire avancer la cause des femmes en politique sur la scène internationale.
Madame Dasko est agrégée supérieure de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto. Elle enseignait au programme de maîtrise de ce même établissement avant d’être nommée au Sénat. Elle fait partie du Comité consultatif des conditions sociales de Statistique Canada.
Madame Dasko est née à Winnipeg, où elle a également grandi. De plus, elle a une fille et un fils.
Domaines d’intérêt :
- Égalité des genres et unité nationale
- Lutte contre le tabagisme et promotion de la santé
Groupe progressiste du Sénat (GPS):
Patricia Bovey, vice-présidente du GPS - (Manitoba)

La sénatrice Patricia Bovey a été nommée au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau le 10 novembre 2016. Avant d’être nommée au Sénat, la sénatrice Bovey a été, à Winnipeg, directrice et conservatrice de galerie d’art, historienne de l’art, auteure, professeure et, pendant de longues années, consultante en gestion dans le domaine des arts et le secteur à but non lucratif.
Ancienne présidente du conseil des gouverneurs de l’Université du Manitoba, elle a siégé aux conseils d’administration du Musée des beaux-arts du Canada (2005-2009) et du Conseil des arts du Canada (1990-1993). Elle a participé au Groupe de travail Withrow-Richard sur les musées nationaux et régionaux en 1986 et a fait partie du conseil national du Canadian Center for Cultural Management à l’Université de Waterloo (2002-2010). Elle a été présidente du conseil des gouverneurs de l’Université Emily Carr et du conseil d’administration de l’Organisation des directeurs des musées d’art canadiens. Elle a fait partie du Comité d’art public de la ville de Winnipeg (2003-2007) et du Groupe de travail du maire sur l’art public afin d’élaborer la politique sur l’art public de la ville de Winnipeg (2002-2003). Ancienne membre du conseil d’administration des Presses de l’Université du Manitoba, elle siège actuellement à la Fondation Eckhardt-Gramatté. Elle a été présidente du conseil d’administration du Centre de l’art contemporain canadien et membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, des comités de sélection de la bourse Rhodes du Manitoba et de la bourse Loran, du conseil d’administration de Manitoba Artists in Healthcare et du Manitoba Chamber Orchestra.
Lauréate en 2015 du prix Investors Making a Difference du Conseil des arts de Winnipeg, la sénatrice Bovey a aussi été nommée membre de la Société royale pour les arts au Royaume‑Uni et membre de l’Association des musées canadiens. Elle a reçu la Médaille du 125e anniversaire du Canada, la Médaille du jubilé de la Reine, le titre de Femme de distinction dans les arts de Winnipeg en 2002, le prix pour services exceptionnels de l’Association des musées canadiens, la Médaille de l’Académie royale des arts du Canada et le premier prix d’excellence de l’Association des musées du Manitoba décerné en 2013.
Depuis 2005, les conseils de Mme Bovey portent sur la gouvernance, l’élaboration de politiques ainsi que la planification stratégique et d’affaires pour les galeries d’art, les musées et les organismes artistiques multidisciplinaires.
Domaines d’intérêt :
- Réduction de la pauvreté
- Accès aux programmes sociaux et éducatifs
- Préservation de l’environnement
- Instauration d’un revenu de base universel
Jane Cordy, GPS - (Nouvelle-Écosse)

La sénatrice Cordy a été nommée au Sénat par le très honorable Jean Chrétien le 9 juin 2000. Elle est née à Sydney, en Nouvelle-Écosse. La sénatrice Cordy est diplômée du Collège des enseignants de la Nouvelle-Écosse et de l’Université Mount Saint Vincent. Elle a enseigné pendant trente ans à l’école primaire à Sydney, à New Glasgow et dans la municipalité régionale d’Halifax, en Nouvelle-Écosse.
La sénatrice Cordy a agi à titre de vice-présidente de la commission de développement du port de Halifax-Dartmouth. Elle a également occupé le poste de présidente du Conseil arbitral de l’assurance-emploi. En outre, elle a siégé au conseil de la Phoenix House et de l’Université Mount Saint Vincent.
La sénatrice Cordy est l’ancienne présidente de la Commission des femmes libérales de la Nouvelle-Écosse. Elle a également siégé au sein du groupe de travail du premier ministre Chrétien sur les aînés.
La sénatrice Cordy est l’ancienne présidente de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN et l’ancienne vice-présidente internationale de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, où elle représentait l’Amérique du Nord au sein de l’exécutif. Elle a également agi à titre de vice-présidente de la Commission sur la dimension civile de la sécurité de cette même Assemblée. La sénatrice Cordy continue de participer aux activités de l’Association parlementaire de l’OTAN et de l’Association parlementaire Canada–États-Unis.
La sénatrice Cordy s’intéresse particulièrement aux dossiers qui portent sur la santé mentale, la sclérose en plaques, les aînés et le vieillissement, l’OTAN, les femmes et la sécurité, l’éducation et les enfants. Elle était membre du comité sénatorial qui a publié un rapport intitulé De l’ombre à la lumière, une étude sur les enjeux liés à la santé mentale, à la maladie mentale et à la toxicomanie au Canada. Elle a également été membre du comité sénatorial spécial qui a examiné les incidences du vieillissement de la société canadienne.
La sénatrice Cordy vit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, avec son mari Bob. Ils ont deux enfants d’âge adulte, Alison et Michelle, et quatre petits-enfants.
Domaines d’intérêt :
- Santé mentale
- Harcèlement sexuel et inconduite sexuelle au sein des Forces canadiennes
- Personnes âgées
- Autisme
Groupe des sénateurs canadiens (GSC):
Dennis Glen Patterson, GSC - (Nunavut)

Dennis Patterson (Nunavut) est un ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest qui s’est efforcé d’améliorer la vie des populations de l’ensemble du Nord canadien. Il a été nommé au Sénat en 2009 par le très honorable Stephen Harper.
Pendant ses 16 années de carrière comme membre de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, M. Patterson a occupé diverses fonctions, dont celles de ministre de l’Éducation, de ministre de la Santé et des Services sociaux et de ministre de la Justice, puis de premier ministre de 1987 à 1991.
Lors de son passage dans la fonction publique, M. Patterson joue un rôle clé dans le règlement de l’accord final d’Inuvialuit et de la revendication territoriale du Nunavut. M. Patterson dirige également la campagne qui a duré plus de 20 ans et qui a mené à l’établissement du Nunavut en tant que nouveau territoire du Canada en 1999. Avant d’entrer en politique, M. Patterson pratiquait le droit et a été nommé directeur administratif fondateur du Centre des services juridiques (la société Maliiganik Tukisiiniakvik) à Iqaluit.
Après avoir quitté ses fonctions de premier ministre, M. Patterson fonde un cabinet d’experts‑conseils privé, est admis au Barreau du Nunavut en 2001, et siège depuis 2003 à titre d’administrateur du Northern Property Real Estate Investment Trust, en plus d’agir en qualité de président de la gouvernance du comité de rémunération et de nomination de cette organisation jusqu’en septembre 2015.
Domaines d’intérêt :
- Nutrition Nord
- Ressources naturelles
- Taxe sur le carbone
- Politique de défense
- Réforme électorale
Josée Verner, GSC - (Québec - Montarville)

Josée Verner a été élue à la Chambre des communes pour la première fois en 2006, et réélue en 2008. En février 2006, elle a été nommée ministre de la Coopération internationale, ministre de la Francophonie et des Langues officielles. En août 2007, elle est devenue ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles. En mai 2008, elle s’est vu confier à nouveau la responsabilité de ministre de la Francophonie.
En octobre 2008, elle a été nommée ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre de la Francophonie et ministre responsable de la région de Québec.
En juin 2011, elle a été nommée au Sénat du Canada par le très honorable Stephen Harper.
Mme Verner a fait carrière pendant près de vingt ans dans le domaine des communications et dans le secteur public.
Domaines d’intérêt :
- Langues officielles
- Condition féminine
- Environnement et ressources naturelles
Parti conservateur du Canada (C):
Rose-May Poirier, C - (Nouveau-Brunswick - Saint-Louis-de-Kent)

Avant de se lancer en politique provinciale, Rose-May Poirier était une femme d’affaires qui réussissait bien, exerçant comme représentante en assurance pour Assomption Vie et comme cadre dirigeante de marque pour Tupperware Canada. Au cours de sa carrière, elle a reçu plusieurs distinctions en tant que responsable des ventes, gérante et recruteuse, y compris pour avoir mené l’une des meilleures équipes de vente au Canada et avoir été l’une des meilleures vendeuses en Amérique du Nord.
Sa carrière politique a débuté au niveau municipal, où elle a exercé deux mandats au sein du conseil municipal de Saint-Louis de Kent. En 1999, Rose-May Poirier a fait le saut en politique provinciale, représentant les gens de Rogersville-Kouchibouguac pendant trois mandats. Comme députée du Parti progressiste-conservateur, elle a été la première femme à siéger en tant que présidente du caucus. Lors de sa réélection le 9 juin 2003, elle a été nommée ministre du Bureau des ressources humaines et, deux ans plus tard, ministre des Gouvernements locaux et ministre responsable des Affaires autochtones.
Nommée au Sénat en 2010 par le très honorable Stephen Harper, la sénatrice Poirier était auparavant présidente du caucus du Parti conservateur au Sénat et vice-présidente du caucus national du Parti conservateur de 2011 à 2015. Elle a repris la fonction de présidente du caucus du Parti conservateur au Sénat en décembre 2019.
La sénatrice Poirier siège actuellement au Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, et comme vice-présidente du Comité permanent des langues officielles.
Dans sa collectivité, la sénatrice Poirier a consacré beaucoup de son temps à diverses causes : Enfant-Retour, la Fondation Rêves d’enfants, la Fondation des maladies du cœur, la campagne de l’Arbre de l’espoir de l’Hôpital Docteur Georges L. Dumont, la Friends of the Moncton Hospital ainsi que le développement économique de la région de Kent.
Domaines d’intérêt :
- Langues officielles
- Ressources humaines
- Soutien aux enfants
- Secteur de la bienfaisance
Non affiliés:
Marilou McPhedran, non affiliée - (Manitoba)

Marilou McPhedran est née et a grandi dans une région rurale du Manitoba, au Canada. Elle a été admise au Barreau de l’Ontario (1978-2007), et a été nommée Membre de l’Ordre du Canada en 1985 pour avoir mené conjointement la campagne visant à mieux protéger l’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution canadienne. Le gouverneur général David Johnston, sur la recommandation du premier ministre Justin Trudeau, l’a nommée au Sénat du Canada en 2016. Marilou McPhedran est une avocate et éducatrice de formation juridique qui s’est spécialisée dans l’enseignement et la mise en œuvre de mécanismes de changement systémiques et durables visant à promouvoir l’égalité et la diversité. Elle a fondé conjointement plusieurs organismes canadiens sans but lucratif de réputation internationale, comme le Fonds d’action et d’éducation pour les femmes, qui, depuis plus de 30 ans, intervient dans des causes afin d’en évaluer le degré d’égalité en regard de la Constitution, METRAC, le Metropolitan Action Committee on Violence against Women and Children, et le Gerstein Crisis Centre, ouvert aux patients sans-abri qui sortent des hôpitaux psychiatriques.
Elle a fondé l’International Women’s Rights Project en 1998 et l’Institut pour les droits internationaux des femmes au Global College en 2009, reposant sur ses modèles intergénérationnels, « l’activité de défense fondée sur des éléments de preuve » et « les droits vécus ». En sa qualité de directrice générale d’un centre d’excellence fédéral relevant de l’Université York, au Canada, elle a dirigé du personnel et des programmes, dont un réseau de cyberrecherche sur la santé et les droits des femmes.
Elle a mis sur pied des cours sur les droits de la personne qui se donnent en ligne et en classe, a présidé trois enquêtes indépendantes concernant les agressions sexuelles contre des patients (1991-2015), a mené des recherches appliquées et corédigé des rapports, y compris la première étude internationale visant à évaluer les répercussions sur dix pays de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (1998-2000); « What about accountability to the patient? » (2001) et « National Study on Rural, Remote and Northern Women’s Health in Canada » (2001‑2003); le manuel « Preventing Sexual Abuse: a Legal Guide for Health Care Professionals » (2004); un document de stratégie à l’intention de l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, « Engendering the ‘Responsibility to Protect’ Doctrine » (2005); « Women’s Constitutional Activism in South Africa and Canada » (2009, International Review of Constitutionalism) et « 28-Helluva Lot to Lose in 27 Days: The Ad Hoc Committee and Women’s Constitutional Activism in the Era of Patriation » (2015).
Elle a aussi publié, à titre d’auteure, en 2006, dans la Revue nationale de droit constitutionnel, l’article « Impact of S.15 equality rights on Canadian society: beacon or laser? », en 2007, dans la Supreme Court Law Review, l’article « A Truer Story: Constitutional Trialogue » et, en 2014, dans la Michigan State Law Review, l’article « Complements of CEDAW - U.S. foreign policy coherence on women’s human rights and human security ».
Pionnière en matière de recherche et d’activités de défense pour la promotion des droits de la personne grâce au changement systémique en droit, en médecine, en éducation et en gouvernance, elle a présidé en 2006 le Forum international sur l’activisme des femmes dans la réforme constitutionnelle, a été titulaire de la chaire des droits de la personne Ariel F. Sallows de la Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan, elle a été nommée commissaire en chef de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan en 2007, et elle a été directrice (doyenne) du Global College de l’Université de Winnipeg, au Manitoba, de juin 2008 à juillet 2012, pour ensuite devenir Fellow (chercheuse) en matière de droits de la personne au Bureau de liaison du FNUAP, à Genève, et professeure associée à l’Université pour la paix au Costa Rica, mandatée par les Nations Unies, en 2012-2013.
De 2008 à 2019, elle a été professeure titulaire permanente à l’Université de Winnipeg. En 2009, elle a fondé, au Global College, l’Institut pour les droits internationaux des femmes, dont elle a été la directrice jusqu’en 2016. Elle a également fondé l’Institut d’été annuel « Human Rights UniverCITY », dont elle a été la directrice de 2011 à 2018, et qui est établi au Musée canadien pour les droits de la personne.
Domaines d’intérêt :
- Égalité entre les genres
- Condition féminine
- Droits des femmes et sécurité humaine
- Réforme judiciaire
Patrick Brazeau, non affilié - (Québec - Repentigny)

Né à Maniwaki, au Québec, Patrick Brazeau est membre de la communauté algonquienne de Kitigan Zibi. Patrick a été le Chef national du Congrès des peuples autochtones (CPA) de février 2006 à janvier 2009.
À titre de Chef national du CPA, M. Brazeau est un ardent défenseur de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L’abrogation de l’article 67 a conféré les mêmes mesures de protection des droits de la personne aux citoyennes et citoyens assujettis à la Loi sur les Indiens que ceux accordés à tous les autres depuis 1978.
Il a été nommé au Sénat en décembre 2008 par le premier ministre Stephen Harper et siège actuellement en tant que sénateur algonquin indépendant. Il est le troisième plus jeune sénateur jamais nommé et est actuellement le plus jeune sénateur en fonction.
Brazeau est convaincu que toutes et tous doivent travailler ensemble pour trouver des moyens de soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il parle ouvertement de ses expériences personnelles dans l’espoir d’inciter autrui à chercher de l’aide en cas de besoin. Il est membre fondateur du conseil d’administration de la Fondation Aquarium de Montréal, un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la promotion du bien-être des enfants, des adolescents et des jeunes adultes d’aujourd’hui.
Brazeau a soutenu les efforts visant à organiser une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. M. Brazeau est un partisan convaincu de la reddition de comptes, de la responsabilité et de la transparence dans les Affaires autochtones. Il milite pour que la Loi sur les Indiens soit remplacée par une législation plus progressiste qui permette la reconstitution des véritables Nations indiennes, y compris la compétence sur leurs propres affaires. M. Brazeau est toujours à la recherche de moyens pour réformer le système des réserves indiennes et il croit fermement que le gouvernement fédéral doit faire passer la réparation avant la réconciliation pour les survivantes et survivants générationnels autochtones et leurs familles.
Brazeau a servi au sein de la Réserve navale des Forces canadiennes du NCSM Carleton. Il détient un diplôme en sciences humaines du Cégep Heritage College et a étudié le droit civil à l’Université d’Ottawa.
Domaines d’intérêt :
- Santé mentale
- Affaires autochtones
- Jeunesse