Lignes directrices sur la gestion des vulnérabilités du gouvernement du Canada
1. Introduction
1.1 Contexte
La Politique sur la sécurité du gouvernement et l’Annexe B : Procédures obligatoires relatives aux mesures de sécurité de la technologie de l’information de la Directive sur la gestion de la sécurité exigent que les ministères mettent « en œuvre des mesures pour protéger les systèmes d’information, leurs composants et l’information qu’ils traitent et transmettent contre les attaques qui exploitent les vulnérabilités dans les systèmes d’information pour toucher leur intégrité et qui pourraient avoir une incidence sur leur disponibilité ou leur confidentialité (par exemple un code malveillant)Note de bas de page 1 ». Cette exigence comprend la mise en œuvre de mesures correctives, comme l’application de correctifs, pour remédier aux vulnérabilités. De plus, le Centre canadien pour la cybersécurité classe l’application de correctifs aux applications et aux systèmes d’exploitation en deuxième place dans sa liste des plus importantes mesures de sécurité des technologies de l’information (TI) que les organisations peuvent prendre pour réduire au minimum les intrusions et les répercussions connexesNote de bas de page 2.
Ce document présente les éléments fondamentaux du modèle de maturé de la gestion des vulnérabilités (en anglais) du SANS Institute ainsi que du guide de planification de la gestion des correctifs d’entreprise : maintenance préventive des technologies (NIST SP 800‑40 Rev. 4) (en anglais) pour les technologies de gestion des correctifs d’entreprise. Il fournit des conseils précis sur la mise en place, la tenue à jour et la gestion d’un programme de gestion des correctifs et des vulnérabilités.
La gestion des vulnérabilités (GV) est à la base une fonction de gestion des risques conçue pour cerner, évaluer et atténuer les risques liés à la sécurité de l’information découlant des faiblesses des TI. En mettant l’accent sur la correction ou la réduction des risques à des niveaux acceptables, la GV permet à une organisation d’assurer la continuité de sa mission de façon efficace et sécuritaire. La GV sert à réduire le risque d’exploitation d’une manière exigeant beaucoup moins de temps et de ressources financières que le fait de réagir à un incident après l’exploitation. Ainsi, un programme de GV bien mis en œuvre vise à optimiser la gestion des risques et l’affectation des ressources.
1.2 Objectif et portée
Le présent document vise à fournir des conseils sur la mise en place, la tenue à jour et la gestion d’un programme de GV au sein d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Canada (GC).
Les présentes lignes directrices cadrent avec les documents et instruments du GC suivants :
- Politique sur la sécurité du gouvernement;
- Politique sur les services et le numérique;
- Directive sur la gestion de la sécurité;
- Stratégie intégrée de cybersécurité du gouvernement du Canada;
- Plan de gestion des événements de cybersécurité du gouvernement du Canada (PGEC GC);
- Orientation sur la gestion des rustines;
- Correction des systèmes d’exploitation et des applications – Bulletin de sécurité des TI à l’intention du gouvernement du Canada (ITSM‑96)
1.3 Public cible
Les présentes lignes directrices s’adressent aux personnes responsables de la gestion, de l’analyse et de la correction des vulnérabilités qui touchent les systèmes de TI du GC. Ces responsables comprennent les gestionnaires des risques liés à la cybersécurité, les équipes de GV, les responsables des services de TI, les administrateurs des services de TI et les agents de sécurité des TI.
2. Survol de la gestion des vulnérabilités
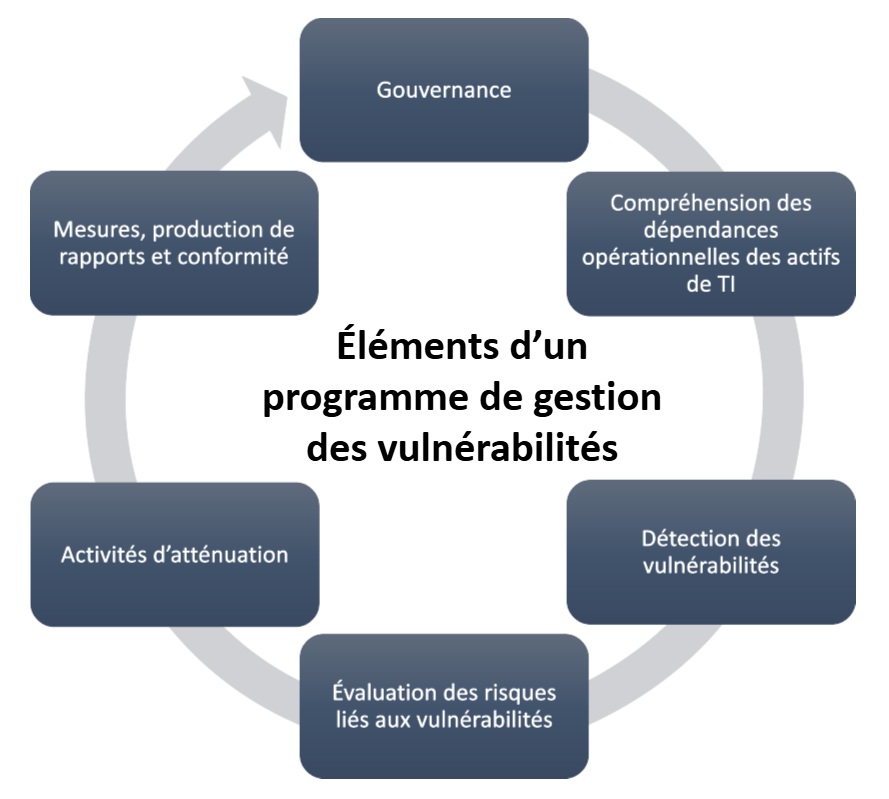
Les éléments essentiels d’un programme efficace de GV comprennent ce qui suit.
- Gouvernance : des processus de gouvernance et des instruments de politique bien définis servent de fondement à toutes les activités de GV. Une communication et une coordination efficaces entre les diverses équipes, y compris celles des TI, de la sécurité et du développement, sont essentielles. La tenue de réunions régulières et la mise en place de cadres de collaboration aident à combler les écarts entre les équipes afin de favoriser une approche unifiée des questions de sécurité.
- Compréhension des dépendances opérationnelles des actifs de TI : une GV efficace exige une connaissance exhaustive et à jour de l’état des actifs de TI (c’est-à-dire les stocks et les configurations) et de la façon précise dont ils assurent la tenue d’activités opérationnelles et peuvent donc mettre celles-ci en péril.
- Détection des vulnérabilités : diverses méthodes comme les analyses de réseau, les agents, les essais de pénétration, la gestion de la surface d’attaque, l’analyse des composants logiciels ainsi que l’information fondée sur les fournisseurs et le renseignement sont essentielles pour cerner les vulnérabilités dans les systèmes d’une organisation. Un mécanisme officiel et coordonné de divulgation des vulnérabilités permet une meilleure compréhension.
- Évaluation des risques liés aux vulnérabilités : les vulnérabilités doivent être classées par ordre de priorité en fonction du niveau de risque qu’elles présentent pour les activités opérationnelles. Une approche fondée sur le risque devrait être utilisée pour évaluer la gravité et l’incidence possible des vulnérabilités, pour que la priorité soit ainsi accordée aux menaces les plus graves. Un cadre de gestion des risques doit fournir une méthode transparente, raisonnable et reproductible pour établir la priorité des vulnérabilités et présenter les délais d’atténuation connexes.
- Activités d’atténuation : le processus d’évaluation des risques devrait présenter les exigences de travail sous forme de correctifs et d’autres mesures d’atténuation. Des échéanciers clairs pour la correction des vulnérabilités devraient être définis en fonction des niveaux de risque afin d’assurer une atténuation rapide des vulnérabilités à risque élevé et le respect continu des exigences réglementaires. Ce travail devrait s’accomplir par l’intermédiaire de la création de billets, de la gestion du changement, de la gestion de la configuration et des outils de gestion des correctifs.
- Mesures, rapports et conformité : des mesures et une production de rapports solides sur les activités de GV sont essentielles à l’amélioration continue et à la responsabilisation.
2.1 Gouvernance
Une GV efficace repose sur des instruments de politique et des processus de gouvernance bien définis. Ils établissent les exigences, les attentes, les responsabilités, les cadres et les processus de travail, tous approuvés par la haute direction pour assurer les ressources et le soutien institutionnels. Les documents sur la gouvernance doivent comprendre des politiques générales et des procédures tactiques intégrant les pratiques exemplaires de l’industrie. En cas de différend ou d’audit, ces documents fournissent un registre de l’engagement de l’organisation à l’égard d’une gouvernance structurée et transparente.
Voici les principaux éléments de la gouvernance en matière de GV.
- Engagement de la direction : un solide leadership par les cadres supérieurs (par exemple, dirigeant principal des données du ministère, dirigeant principal de la sécurité de l’information) est essentiel au succès d’un programme de GV. Les dirigeants doivent faire la promotion du programme, affecter des ressources et veiller à ce que la sécurité soit une priorité dans l’ensemble de l’organisation. L’engagement des dirigeants envoie un message clair aux employés, comme quoi la sécurité est importante, et les encourage à s’approprier le programme et à y participer.
- Organes décisionnels et protocoles de prise de décisions : préciser qui a le pouvoir et la responsabilité de prendre des décisions, en veillant au respect des objectifs de gestion du risque de l’organisation.
- Évaluation des risques et atténuation : définir des processus et des cadres pour évaluer les vulnérabilités et établir des activités d’atténuation et des échéanciers en fonction des niveaux de risque.
- Mesures du rendement : utiliser des mesures pour mesurer divers aspects du programme de GV qui serviront d’indicateurs de rendement clés en matière d’amélioration continue.
- Conformité et documents : veiller au respect des règlements externes et des politiques internes en limitant au minimum les risques juridiques et opérationnels. Les documents aident à communiquer les processus nécessaires et à veiller à ce que tous les intervenants comprennent leurs rôles et responsabilités.
- Éléments obligatoires et éléments recommandés : faire une distinction claire entre les éléments obligatoires et les éléments recommandés dans les documents sur la gouvernance.
- Ententes de niveau de service : préciser les attentes et les ententes de niveau de service pour les services de GV, en particulier lorsqu’on fait appel à des tiers.
2.2 Compréhension des dépendances opérationnelles des actifs de TI
Il est essentiel pour la GV de comprendre les dépendances des activités opérationnelles essentielles à certains actifs de TI. Les organisations doivent avoir une connaissance approfondie des activités opérationnelles qui génèrent de la valeur et orientent leur mission. Il s’agit notamment de relever les défis uniques liés à la gestion des vulnérabilités dans les environnements infonuagiques. Des techniques d’analyse spécialisées et des contrôles de sécurité adaptés aux ressources en nuage dynamiques et partagées devraient être mis en œuvre. Pour gérer efficacement les vulnérabilités, les organisations devraient procéder au mappage entre leurs actifs de TI et leurs activités opérationnelles, et déterminer le risque opérationnel associé à chaque actif de TI. Les contrôles CM‑8 et PM‑5 des Contrôles de sécurité et améliorations de contrôle suggérés (ITSG‑33) du Centre canadien pour la cybersécurité mettent l’accent sur la nécessité de procéder à un mappage méthodique des activités opérationnelles par rapport aux actifs de TI sous-jacents, afin qu’ainsi l’ordre de priorité des vulnérabilités tienne compte de l’urgence technique et du risque pour les activités opérationnelles essentielles.
Le mappage des actifs de TI avec les activités opérationnelles nécessite une visibilité à jour et précise de l’écosystème technologique grâce à la découverte complète des actifs, au mappage des dépendances, au suivi des stocks en temps réel et à l’intégration aux processus et outils de gestion du changement et de la configuration de l’organisation. Les organisations doivent tenir à jour leur répertoire et les bases de données de gestion des configurations de leurs biens informatiques physiques et virtuels, y compris les actifs liés à la technologie opérationnelle et à l’Internet des objets.
La gestion des actifs de TI et la gestion des configurations permettent aux organisations de faire le suivi des logiciels non conformes déployés dans les environnements de TI. Étant donné la complexité et les multiples facettes des systèmes de TI, il est essentiel d’inclure tous les environnements informatiques dans un programme de GV, qu’il s’agisse de technologies mobiles, sur place, infonuagiques ou opérationnelles. Ces technologies comprennent notamment les points terminaux, les applications, les intergiciels, les bibliothèques, les systèmes d’exploitation, les hyperviseurs, les machines virtuelles, les moteurs de conteneurs, les conteneurs, les micrologiciels, le matériel, les systèmes de contrôle industriel, les systèmes d’acquisition et de contrôle de données, les systèmes de commande répartis, les automates programmables, les terminaux à distance, les interfaces personne-machine, les capteurs et les actionneurs.
La Politique sur les services et le numérique rend la gestion des actifs obligatoire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des actifs de TI, consultez la publication Utilisation de la gestion des biens de technologies de l’information (GBTI) pour renforcer la cybersécurité (ITSM.10.004) (2023) du Centre canadien pour la cybersécurité.
2.3 Détection des vulnérabilités
La détection des vulnérabilités est un élément crucial de la GV et comprend la recherche de vulnérabilités au sein des réseaux sous la responsabilité du ministère. Les organisations acquièrent des connaissances sur les vulnérabilités en synthétisant des données provenant de multiples sources, comme l’analyse des vulnérabilités, les renseignements sur les menaces, les avis des fournisseurs, les essais de pénétration et le mécanisme coordonné de divulgation des vulnérabilités. L’intégration des flux de renseignements sur les menaces aide à demeurer au fait des nouvelles vulnérabilités et menaces, ce qui permet d’établir les priorités et de corriger les vulnérabilités de manière plus pratique. Les sources offrent des renseignements uniques qui fournissent collectivement une vue d’ensemble pour cerner les vulnérabilités.
Les organisations doivent effectuer des analyses des vulnérabilités régulières et automatisées afin de toujours cerner les vulnérabilités potentielles et les autres risques de sécurité dans leurs réseaux, conformément à la Directive sur la gestion de la sécurité. Les outils automatisés doivent être configurés pour exécuter des analyses à intervalles réguliers et lorsque d’importants changements sont apportés à l’infrastructure du réseau. Des données à jour sur la GV sont essentielles pour appuyer la gestion des cyberincidents, car elles permettent une évaluation précise des répercussions potentielles ou réelles d’un incident.
Réduction des vulnérabilités au moyen d’un cycle de vie du développement logiciel
« Un cycle de vie du développement logiciel est une méthodologie officielle ou officieuse pour la conception, la création et la tenue à jour des logiciels (y compris le code intégré au matériel). Il existe de nombreux modèles de cycles de vie du développement logiciel, y compris les modèles en cascade, en spirale, agiles et (plus particulièrement) agiles combinés aux pratiques de développement de logiciels et d’opérations de TI (DevOps)… Quel que soit le modèle de cycle de vie du développement logiciel utilisé, des pratiques sûres de développement logiciel devraient y être intégrées pour trois raisons : réduire le nombre de vulnérabilités dans les logiciels publiés, réduire l’incidence potentielle de l’exploitation de vulnérabilités non détectées ou non corrigées, et s’attaquer aux causes profondes des vulnérabilités afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent. Les vulnérabilités comprennent non seulement des bogues causés par des défauts de codage, mais aussi des faiblesses causées par des paramètres de configuration de sécurité, des hypothèses de confiance erronées et une analyse des risques désuète. » (Source [traduction libre] : cadre de développement de logiciels sécurisés V1.1 : recommandations pour atténuer le risque de vulnérabilités logicielles (NIST SP 800‑218) (en anglais).
Les plateformes de GV commerciales ne peuvent généralement pas détecter les défauts des applications opérationnelles personnalisées ou des applications gouvernementales standard. Le cycle de vie de la gestion des risques pour ces applications devrait comprendre des évaluations régulières ciblées des vulnérabilités, des essais de pénétration et un processus coordonné de divulgation des vulnérabilités pour relever les lacunes logicielles et de configuration.
Les applications personnalisées reposent souvent sur des composants commerciaux standard ou de code source libre, des interfaces de programmation d’application, des progiciels ou des cadres. Les responsables d’applications doivent être au courant de ces dépendances, y compris l’utilisation d’une nomenclature logicielle et de documents sur l’architecture de la solution. Une nomenclature logicielle est un répertoire complet de tous les composants logiciels, y compris les bibliothèques, les outils et les processus utilisés dans le développement d’un produit logiciel. La nomenclature logicielle joue un rôle essentiel dans la GV en assurant la transparence de la chaîne d’approvisionnement des logiciels. Ainsi, les organisations peuvent repérer et évaluer rapidement les vulnérabilités potentielles. Lorsqu’elles sont jumelées à des outils d’analyse de la composition logicielle, les nomenclatures logicielles peuvent améliorer considérablement la sécurité en analysant les dépendances de code source libre pour repérer les vulnérabilités connues, les licences risquées et les logiciels malveillants.
2.3.1 Méthodes pour cerner les vulnérabilités
Il existe de multiples méthodes pour cerner les vulnérabilités au sein des systèmes, y compris des méthodes d’évaluation automatisées et manuelles. Voici quelques-unes des approches les plus couramment utilisées en GV.
2.3.1.1 Évaluations internes
Les organisations évaluent régulièrement les vulnérabilités au moyen d’outils ou de processus spécialisés. Les outils d’analyse automatisés analysent les plages Internet Protocol (IP) prédéfinies ou utilisent des agents installés dans les systèmes pour cerner les vulnérabilités connues. Bien que les agents permettent une analyse continue, ce ne sont pas tous les actifs (par exemple, routeurs, informatique sans serveur, appareils multifonction) qui prennent en charge l’installation d’agents. De plus, dans certains environnements, l’installation d’agents peut ne pas être possible ou permise. Les analyses peuvent être effectuées sur des actifs de production ou dans un laboratoire, et les résultats peuvent être extrapolés à l’environnement de production. Il importe de veiller à ce que les fichiers de signature des vulnérabilités soient automatiquement et régulièrement mis à jour.
Les méthodes d’évaluation internes comprennent ce qui suit.
- Analyse des vulnérabilités : outils automatisés qui analysent les systèmes pour détecter les vulnérabilités connues en fonction de plages IP prédéfinies ou d’agents installés.
- Vérification de la configuration : outils qui évaluent les configurations des systèmes et des réseaux pour assurer la conformité aux pratiques exemplaires en matière de sécurité et aux politiques organisationnelles.
- Analyse de l’infrastructure en tant que code : analyse du code définissant l’infrastructure (par exemple, Terraform, CloudFormation) afin de cerner les problèmes de sécurité avant le déploiement.
- Outils de gestion des correctifs : systèmes permettant de faire le suivi et de gérer l’application de correctifs aux logiciels et au matériel pour corriger les vulnérabilités.
- Détection et intervention aux points terminaux : solutions qui permettent de surveiller les menaces aux points terminaux et d’y réagir en assurant de manière continue l’évaluation et la mise en œuvre de mesures correctives.
- Audits de conformité : vérifications régulières pour veiller à ce que les systèmes et les processus soient conformes aux politiques internes et aux règlements externes.
- Analyse des journaux : examiner les journaux des systèmes et des applications pour repérer les activités inhabituelles pouvant indiquer des vulnérabilités ou des atteintes à la sécurité.
- Analyse du trafic réseau : surveillance du trafic réseau pour détecter les anomalies pouvant indiquer des vulnérabilités ou des activités malveillantes.
- Essais de pénétration : simulation d’attaques réelles pour découvrir des vulnérabilités que les outils automatisés pourraient manquer.
2.3.1.2 Évaluations externes
Les évaluations externes comprennent la détection des vulnérabilités provenant de l’extérieur du périmètre de réseau de l’organisation. Cette approche aide à comprendre la façon dont les attaquants peuvent exploiter les faiblesses d’un point de vue externe. Les outils et services de gestion de la surface d’attaque entrent dans cette catégorie puisqu’ils aident les organisations à effectuer le mappage des actifs externes et à les surveiller. Les outils d’évaluation externes simulent le point de vue d’un attaquant en évaluant les vulnérabilités des adresses IP et des domaines externes de l’organisation. Des évaluations externes devraient être effectuées régulièrement, surtout après des changements importants à l’infrastructure du réseau.
Les méthodes d’évaluation externe comprennent ce qui suit.
- Gestion de la surface d’attaque : outils et services qui aident les organisations à effectuer le mappage de leurs actifs externes et à les surveiller afin de cerner les vulnérabilités.
- Analyse des vulnérabilités externes : outils qui simulent le point de vue d’un attaquant en analysant les vulnérabilités des adresses IP et des domaines externes de l’organisation.
- Évaluations par des tiers : emploi d’entreprises de sécurité externes pour effectuer des évaluations indépendantes de la situation de sécurité externe de l’organisation.
- Processus coordonné de divulgation des vulnérabilités : mettre en œuvre un processus coordonné de divulgation des vulnérabilités afin de veiller à ce que les intervenants et les partenaires connaissent les vulnérabilités qui pourraient les toucher. Cette approche tire parti de l’expertise de la collectivité pour relever et gérer les enjeux de sécurité. Les programmes coordonnés de divulgation des vulnérabilités exigent des lignes directrices et des processus clairs quant à la production de rapports externes et à la communication en temps opportun avec les chercheurs.
2.3.1.3 Intervention en cas d’incident
L’intervention en cas d’incident joue un rôle dans l’amélioration des programmes de GV. Les renseignements recueillis après l’incident dans le cadre de l’examen et de l’analyse aident à comprendre comment une atteinte à la sécurité s’est produite et quelles vulnérabilités ont été exploitées. Cette analyse fournit des renseignements précieux sur les faiblesses du système, ce qui aide à établir l’ordre de priorité pour la correction des vulnérabilités qui ont été activement exploitées. Des procédures définies de divulgation des vulnérabilités améliorent la capacité à réagir aux vulnérabilités et à les corriger. Le PGEC GC inclut les vulnérabilités dans la définition d’un événement de cybersécurité, c’est-à-dire un événement, un acte, une omission ou une situation pouvant nuire à la sécurité du gouvernement. On s’attend à ce que les ministères établissent un plan ministériel de gestion des événements de cybersécurité qui cadre avec le PGEC GC.
2.3.2 Délais d’évaluation suggérés
Pour assurer la détection rapide et efficace des vulnérabilités, les organisations devraient adopter un calendrier structuré pour chaque méthode d’évaluation. Le tableau 2.1 présente les fréquences recommandées de diverses techniques de détection des vulnérabilités, selon les directives du GC et les pratiques exemplaires de l’industrie. Ces échéanciers appuient la gestion proactive des risques et l’harmonisation avec l’évolution des menaces et des besoins opérationnels.
| Méthode de détection | Fréquence recommandée | Justification ou source |
|---|---|---|
| Analyse des vulnérabilités (interne) | Au moins une fois par semaine ou après des changements importants; agents pour l’évaluation continue | Centre canadien pour la cybersécurité – Contrôle RA‑5 de La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG‑33); cadre avec la détection proactive et les cycles de correctifs |
| Analyse des vulnérabilités (externe) | Une fois par mois et après des changements importants à l’infrastructure | Appuyé par la page Facteurs relatifs à la sécurité à considérer pour les dispositifs d’accès (ITSM.80.101) du Centre canadien pour la cybersécurité et les pratiques exemplaires de l’industrie |
| Vérification de la configuration | Une fois par mois et après des changements de configuration | Concorde avec les contrôles CM‑6 et CM‑8 de La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG‑33) |
| Analyse de l’infrastructure en tant que code | À chaque engagement de code ou demande de retrait | Pratiques exemplaires de développement, de sécurité et d’exploitation; garantit que des vulnérabilités ne sont pas introduites avant le déploiement |
| Outils de gestion des correctifs | Surveillance continue; examen hebdomadaire | Garantit la mise en œuvre de correctifs en temps opportun et le respect de l’orientation du GC concernant les correctifs |
| Suivi de la détection et de l’intervention aux points terminaux | En continu | Détection et intervention en temps réel; Les 10 mesures de sécurité des TI du Centre canadien pour la cybersécurité |
| Audits de conformité | Deux fois par année | Selon les cycles d’audit du GC et le contrôle PM‑5 de La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG‑33) |
| Analyse des journaux | Une fois par jour ou en temps quasi réel | Selon le contrôle AU‑6 de La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG‑33) |
| Analyse du trafic réseau | En continu | Détection des anomalies et des vulnérabilités potentielles en temps réel |
| Essais de pénétration | Une fois par année ou après des changements importants au système; plus fréquemment pour les systèmes à risque élevé | Selon le contrôle CA‑8 de La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie (ITSG‑33) |
| Gestion de la surface d’attaque | En continu au moyen d’examens mensuels | Surveillance continue de l’exposition externe assurant une visibilité à jour des expositions et des actifs accessibles par Internet |
| Évaluations par des tiers | Une fois par année ou au besoin en fonction du risque | Garantit une validation indépendante de la situation de sécurité |
| Processus coordonné de divulgation des vulnérabilités | En continu; examen des rapports dans les cinq jours ouvrables suivant leur réception | PGEC GC et pratiques exemplaires de l’industrie pour une réponse rapide aux rapports externes |
2.4 Évaluation des risques liés aux vulnérabilités
Les organisations du GC doivent « analyser les incidences des vulnérabilités cernées, et mettre en œuvre des mesures correctives (par exemple appliquer des correctifs et des mises à jour, conformément aux échéances définies et, au besoin, en cas d’urgence). » (Source : Directive sur la gestion de la sécurité, annexe B, sous-section B.2.3.7.3.)
L’évaluation efficace des risques est la pierre angulaire de tout programme de GV puisqu’elle permet aux organisations d’établir l’ordre de priorité des activités d’atténuation visant à protéger la prestation continue des activités opérationnelles. Pour ce faire, la méthode clé à cet effet est un outil de calcul de l’évaluation des risques liés aux vulnérabilités qui devrait être conçu en fonction des principes qui suivent.
- Facteurs de risque clairement définis : les facteurs de risque doivent être clairement définis et être distincts les uns des autres. Parmi les exemples, on compte la facilité d’exploitation, l’exploitation active sur des réseaux, la présence sur les systèmes de TI appuyant les activités opérationnelles essentielles et si les vulnérabilités se trouvent dans des actifs de TI connectés à Internet. Il faut également indiquer si des mesures d’atténuation ou des contrôles compensatoires ont déjà été mis en œuvre pour chaque facteur.
- Grande valeur ajoutée à la détermination des risques : les facteurs de risque devraient ajouter une grande valeur à la détermination des risques.
- Guide d’évaluation non ambigu : un guide d’évaluation devrait expliquer dans un langage non ambigu la façon dont les différentes cotes sont évaluées pour chaque facteur de risque.
- Mécanisme d’évaluation transparent : le guide d’évaluation devrait également expliquer comment les cotes de chaque facteur de risque sont combinées pour en arriver à une cote de risque globale. Ce processus devrait être transparent, simple et facile à comprendre.
Une méthode d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités devrait produire deux éléments d’analyse essentiels.
- Cote de risque globale : indique le niveau de risque associé à un actif vulnérable.
- Échéances d’atténuation : échéances précises d’atténuation liées aux cotes de risque, qui diminuent à mesure que le risque augmente. Ces échéances devraient correspondre à celles d’organisations semblables et être efficaces contre les vitesses d’exploitation connues des auteurs de menace, comme rapportées par les fournisseurs et les sources de renseignements.
Il existe de nombreuses façons d’effectuer une évaluation des risques. Par exemple, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a publié la catégorisation des vulnérabilités propres aux intervenants (en anglais), qui constitue un exemple d’utilisation d’arbres décisionnels. Le calcul du risque moyen pondéré est une autre méthode d’évaluation. L’annexe C présente une approche d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités fondée sur une cote de risque moyenne pondérée tenant compte des facteurs de risque suivants :
- cote de risque du fournisseur;
- cote technique liée aux vulnérabilités;
- maturité de l’exploitation;
- importance des actifs pour les auteurs de menace;
- importance des actifs pour les activités opérationnelles;
- exposition externe de l’actif.
Bien qu’il soit essentiel de respecter les échéances d’atténuation, des exceptions et des exemptions peuvent s’appliquer à la mise en œuvre de correctifs. Par rapport aux vulnérabilités pour lesquelles il n’existe aucun correctif, d’autres mesures d’atténuation (par exemple, la segmentation du réseau) ou des solutions de rechange temporaires (par exemple, désactiver la fonction vulnérable) peuvent servir de mesures provisoires. Quand il ne s’agit pas d’une vulnérabilité du jour zéro, d’autres mesures d’atténuation peuvent également être acceptables, mais elles ne doivent pas exposer l’organisation à des risques supplémentaires. Toute exception aux échéances d’atténuation établies doit être appuyée par une évaluation des risques confirmant que les mesures de rechange atténuent adéquatement le risque.
Dans certains cas, les responsables du risque peuvent décider d’accepter certains risques associés aux vulnérabilités. Un processus officiel d’acceptation des risques et un registre d’acceptation des risques sont cruciaux pour gérer les vulnérabilités qui ne peuvent être immédiatement atténuées. Ce processus consiste à documenter les cas où une organisation décide d’accepter les risques associés à une vulnérabilité donnée plutôt que d’immédiatement mettre en œuvre des mesures correctives. Le registre d’acceptation des risques doit contenir :
- la justification pour chaque décision d’acceptation, y compris une analyse de l’incidence par rapport au coût des mesures d’atténuation et s’il existe des mesures de contrôle en place qui atténuent partiellement le risque;
- les conditions dans lesquelles l’acceptation du risque sera examinée et potentiellement revue, comme les changements dans le contexte des menaces ou l’existence de stratégies d’atténuation plus efficaces.
Ce registre constitue un outil essentiel pour faire le suivi des risques acceptés au fil du temps, en veillant à ce qu’ils soient connus, justifiés et continuellement évalués par rapport à la situation de sécurité et à la tolérance au risque de l’organisation. Toute acceptation de risque doit inclure une date d’expiration de moins de 12 mois à compter de la date d’acceptation. Ce délai permet de nouvelles acceptations et des examens réguliers.
2.5 Activités d’atténuation
L’atténuation des vulnérabilités peut prendre plusieurs formes, selon la nature et la gravité des vulnérabilités, la complexité et le caractère essentiel du système vulnérable, et même l’existence d’un correctif. Bien que cela ne soit pas toujours possible, la méthode privilégiée consiste à mettre en œuvre le correctif fourni par le fournisseur ou à ajuster les paramètres de configuration pour corriger entièrement le problème.
2.5.1 Correctifs
Les correctifs sont des mises à jour apportées aux micrologiciels et aux logiciels pour corriger des lacunes fonctionnelles et de sécurité. Il est essentiel d’appliquer des correctifs aux systèmes d’exploitation, aux applications et aux dispositifs pour assurer leur sécurité. En tirant parti de l’automatisation pour faciliter la mise en œuvre des correctifs, on peut améliorer considérablement l’efficacité et la précision, réduire le risque d’erreur humaine et veiller à l’installation rapide des mises à jour essentielles. Les correctifs d’urgence, souvent mis en œuvre en réponse à des vulnérabilités du jour zéro, devraient suivre un calendrier de changements d’urgence bien défini.
Les correctifs et les mises à jour doivent faire l’objet d’un suivi au moyen du système ministériel de gestion des changements (Directive sur la gestion de la sécurité, sous-section B.2.3.3). Les plans de mise en œuvre des correctifs doivent inclure des mesures d’urgence et de retour en arrière. Le document Correction des systèmes d’exploitation et des applications – Bulletin de sécurité des TI à l’intention du gouvernement du Canada (ITSM‑96) contient des renseignements plus détaillés sur la gestion des correctifs.
2.5.2 Changements de configuration
Les changements de configuration constituent une mesure commune et essentielle d’atténuation des vulnérabilités et devraient être inclus dans les processus de gestion de la configuration et du changement. Les changements de configuration comprennent la modification des paramètres du système pour accroître la sécurité et atténuer les vulnérabilités. On parle alors communément d’une configuration renforcée, selon Les 10 mesures de sécurité des TI visant à protéger les réseaux Internet et l’information (ITSM.10.089) du Centre canadien pour la cybersécurité. Les fonctions généralement activées par défaut doivent être désactivées pour limiter le plus possible l’exposition et éviter de mettre en œuvre des correctifs d’urgence s’ils ne sont pas nécessaires. Le renforcement peut également comprendre la désactivation ou la suppression de comptes et de services non requis, la modification des mots de passe par défaut du fabricant, et la modification des contrôles d’accès. Les changements de configuration devraient être consignés et gérés au moyen du processus de gestion de la configuration afin qu’ils soient mis en œuvre de façon correcte et uniforme. Des examens et des audits réguliers des configurations peuvent aider à maintenir la sécurité et la conformité.
2.5.3 Contrôles compensatoires
L’atténuation complète est l’option privilégiée pour corriger les vulnérabilités. Lorsque les correctifs ou les changements de configuration ne peuvent pas être immédiatement mis en œuvre, les contrôles compensatoires offrent d’autres moyens de maintenir la sécurité et de réduire les risques. L’objectif des contrôles compensatoires est de permettre la continuité des activités tout en s’attaquant aux enjeux de sécurité. Souvent, de multiples contrôles compensatoires sont combinés pour ramener le risque à un niveau acceptable jusqu’à ce qu’il soit possible de mettre en œuvre une solution permanente.
Voici des exemples de contrôles compensatoires (liste non exhaustive).
- Zonage de sécurité du réseau : segmenter le réseau pour isoler les systèmes vulnérables et limiter les vecteurs d’attaque potentiels.
- Pare-feu d’applications Web : protéger les applications Web par le filtrage et la surveillance du trafic HTTP entre les applications Web et Internet.
- Systèmes de détection et de prévention des intrusions : surveiller les activités des réseaux ou des systèmes pour déceler des activités malveillantes ou des violations des politiques et prendre des mesures préventives
- Désactivation ou suppression de services ou de logiciels vulnérables : désactiver ou désinstaller temporairement des services ou des logiciels dont la vulnérabilité est connue.
- Contrôles d’accès : mettre en œuvre des contrôles d’accès stricts pour limiter les personnes pouvant accéder aux systèmes et aux données sensibles.
- Liste d’applications autorisées : ne permettre que l’exécution d’applications autorisées sur le réseau afin de réduire le risque d’exécution de logiciels malveillants.
- Formation sur la sensibilisation à la sécurité : sensibiliser les employés aux pratiques exemplaires en matière de sécurité et à la façon de reconnaître les menaces potentielles.
- Surveillance accrue : renforcer les activités de surveillance pour détecter les activités inhabituelles ou les tentatives d’exploitation et y réagir rapidement.
Les contrôles compensatoires doivent être revus et réapprouvés au moins une fois par année pour assurer leur efficacité et conformité continues face à l’évolution des menaces.
2.5.4 Soutien culturel pour l’atténuation
Les activités d’atténuation efficaces reposent sur une culture organisationnelle de soutien. Un engagement ferme de la part des dirigeants permet d’accorder la priorité à la sécurité et de veiller à ce que les ressources soient affectées de façon appropriée. Les dirigeants doivent participer activement aux discussions sur la sécurité et tenir les équipes responsables du rendement en matière de sécurité.
La collaboration entre les équipes des TI, de la sécurité, du développement et des autres ministères est essentielle. La tenue de réunions régulières pour discuter des exigences en matière de sécurité et coordonner les mesures de correction favorise une approche unifiée. Une culture axée sur la sécurité encourage les employés à suivre les pratiques exemplaires et à assumer leurs responsabilités en matière de sécurité. La formation sur la sensibilisation à la sécurité et la promotion du signalement des incidents constituent des éléments clés.
La communication ouverte et la transparence par rapport aux questions de sécurité favorisent la confiance et la coopération au sein des équipes. Des mises à jour régulières sur les activités d’atténuation et des processus consignés avec clarté sont essentiels. Grâce à l’amélioration continue, les stratégies d’atténuation évoluent de manière à pouvoir s’attaquer aux nouvelles menaces. Il est essentiel d’examiner et de mettre à jour les processus, de tenir compte de la rétroaction et d’investir dans la formation de manière régulière.
2.6 Mesures, production de rapports et conformité
Un programme de GV devrait comprendre une surveillance et une amélioration continues pour maintenir la sécurité face aux menaces en constante évolution. Cette approche comprend l’utilisation d’outils et de techniques pour surveiller les systèmes, effectuer des évaluations régulières et mettre en œuvre des mises à jour et des correctifs en temps opportun. Les mesures doivent évaluer la couverture, l’efficacité, l’efficience et la conformité des activités de GV. La production de rapports réguliers sur les mesures permettra à l’organisation d’établir un point de référence en matière de rendement. Les mesures devraient être fondées sur des outils de gestion des services de TI afin que les vulnérabilités soient signalées et fassent l’objet d’un suivi aux fins d’atténuation. De plus, les mesures devraient être liées à un modèle de maturité de la GV afin de permettre une approche rationnelle et transparente de mesure la maturité du programme de GV. Les gestionnaires de programme peuvent utiliser les modèles de maturité pour cerner les domaines où le rendement souhaité est obtenu et ceux qui nécessitent des réformes et des investissements supplémentaires.
Les rapports et les tableaux de bord permettent d’assurer de manière continue la surveillance et l’évaluation de la conformité. Ces outils donnent à tout moment un aperçu de la situation de sécurité de l’organisation, ce qui permet de réagir rapidement aux nouvelles vulnérabilités et de respecter les exigences réglementaires.
Le tableau 2.2 présente des exemples de mesures.
| Catégorie | Mesure |
|---|---|
| Couverture |
|
| Efficience et efficacité |
|
| Conformité |
|
2.7 Processus habilitants
La GV ne fonctionne pas en vase clos; elle repose sur un ensemble de processus de base qui fournissent une infrastructure et un soutien essentiels. Ces processus habilitants sont essentiels pour veiller à ce que les vulnérabilités soient détectées, évaluées et atténuées de façon systématique et efficace. Ils créent un cadre rigoureux qui améliore la situation de sécurité globale de l’organisation en intégrant divers aspects de la gestion des TI et de la sécurité.
La Stratégie intégrée de cybersécurité du GC – Annexe A MOSC décrit certains processus habilitants clés appuyant un programme de GV réussi. Elle souligne leurs objectifs et la façon dont ils contribuent à la détection, à l’ordre de priorité et à la correction des vulnérabilités. En comprenant et en mettant en œuvre ces processus, les organisations peuvent élaborer une approche complète et durable pour gérer les vulnérabilités et protéger leurs actifs.
- Gestion du changement : la gestion du changement permet la gestion systématique de tous les changements apportés aux systèmes de TI grâce à la mise en œuvre de politiques et d’outils permettant de faire le suivi des changements et de les consigner.
- Gestion des correctifs : la gestion des correctifs permet de corriger les vulnérabilités logicielles et matérielles au moyen de correctifs opportuns qui sont régulièrement revus et mis en œuvre au moyen d’outils automatisés.
- Gestion de la configuration : la gestion de la configuration permet d’assurer la sécurité des configurations des systèmes de TI au moyen d’outils permettant d’appliquer les paramètres sécurisés et de mettre régulièrement à jour les configurations.
- Gestion des accès : la gestion des accès permet de contrôler l’accès aux systèmes de TI. Elle empêche tout accès non autorisé au moyen de l’authentification multifacteur et de contrôles d’accès fondés sur les rôles.
- Renseignements sur les menaces : les renseignements sur les menaces permettent de rester au courant des nouvelles menaces et vulnérabilités grâce à l’intégration des sources de renseignements sur les menaces et à l’examen régulier des rapports.
- Gestion des fournisseurs : la gestion des fournisseurs garantit la conformité des fournisseurs tiers aux normes de sécurité grâce aux évaluations régulières de sécurité et à l’ajout d’exigences en matière de sécurité dans les contrats.
- Audits et conformité : les audits et la conformité permettent d’assurer la conformité de l’organisation aux règlements et aux normes en matière de sécurité grâce à la réalisation d’audits réguliers et à la correction des lacunes en matière de conformité.
- Activités de sensibilisation et de formation : les activités de sensibilisation et de formation permettent de sensibiliser les employés à la GV et aux pratiques exemplaires en matière de sécurité grâce à l’élaboration d’un programme de formation, à la tenue de séances régulières et à l’offre de formation propre aux postes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Stratégie intégrée de cybersécurité du GC – Annexe A MOSC.
2.8 Considérations technologiques
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les options technologiques et les capacités des plateformes d’identification des vulnérabilités, consultez le document sur l’amélioration des correctifs d’entreprise pour les systèmes de TI généraux : mieux utiliser les processus et les outils existants (NIST SP 1800‑31) (en anglais), 1800‑31B ().
3. Conclusion
Un programme de GV réussi est essentiel pour protéger les actifs de TI d’une organisation et assurer la continuité des activités opérationnelles. Le présent document d’orientation vise à aider les organisations à mettre en œuvre un programme de gestion des vulnérabilités rigoureux et complet. Il décrit les éléments clés de la gouvernance en matière de GV, y compris les protocoles de prise de décisions, les stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques, les mesures du rendement, les exigences en matière de conformité et les ententes de niveau de service. Il souligne également l’importance que l’engagement des dirigeants, la collaboration interfonctionnelle et une culture axée sur la sécurité ont à titre d’éléments essentiels à l’efficacité du programme de GV.
Annexe A. Définitions
- gestion de la surface d’attaque
- La gestion de la surface d’attaque est le processus qui consiste à cerner, à répertorier et à sécuriser de manière continue tous les éléments numériques, les services et les points terminaux d’une organisation qui pourraient être exposés à des attaquants. L’objectif est de dresser systématiquement un répertoire et de réduire la vulnérabilité des points susceptibles d’être attaqués au sein de l’infrastructure numérique d’une organisation afin d’atténuer le risque de cybermenaces.
- processus coordonné de divulgation des vulnérabilités
- Le processus coordonné de divulgation des vulnérabilités comprend la gestion systématique des signalements, de l’analyse et de l’atténuation des vulnérabilités en matière de cybersécurité. L’objectif est de veiller à ce que les vulnérabilités relevées par les chercheurs, les utilisateurs ou d’autres intervenants soient directement signalées à l’organisation afin de permettre l’élaboration et le déploiement des correctifs ou des mesures d’atténuation nécessaires avant la divulgation publique. Ce processus aide à établir un équilibre entre la nécessité de divulguer rapidement les vulnérabilités et l’impératif de protéger les utilisateurs en réglant les problèmes avant qu’ils ne soient largement connus.
- systèmes et services essentiels
- Les systèmes et services essentiels sont définis par le Secrétariat du Conseil du Trésor comme ceux dont la compromission sur le plan de l’accessibilité ou de l’intégrité « porterait un préjudice élevé ou très élevé à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens et des Canadiennes, ou encore au fonctionnement efficace du gouvernement du Canada ». (Source : Politique sur la sécurité du gouvernement.)
- gestion des correctifs
- Il s’agit d’un processus de gestion d’un réseau d’ordinateurs dans le cadre duquel des mises à jour et des correctifs sont régulièrement mis en œuvre pour assurer la protection des systèmes contre les vulnérabilités et les menaces à la sécuritéNote de bas de page 3.
- essais de pénétration
- Les essais de pénétration, ou tests d’intrusion, sont une cyberattaque simulée contre un système pour vérifier s’il existe des vulnérabilités exploitables. Il s’agit d’une tentative proactive et autorisée d’évaluer la sécurité d’un système en tentant d’exploiter ses vulnérabilités de façon sécuritaire.
- nomenclature logicielle
- Une nomenclature logicielle est un document officiel décrivant en détail les composantes et les relations de la chaîne d’approvisionnement des divers éléments utilisés pour créer un progiciel. Elle fonctionne comme un répertoire intégré qui dresse la liste de tous les éléments dont la solution logicielle complète se compose. Une nomenclature logicielle assure la transparence de la composition du logiciel et aide les organisations à détecter et à gérer les vulnérabilités, à assurer la conformité et à accroître la sécurité tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
- analyses de réseau
- Les analyses de réseau comprennent l’utilisation d’outils logiciels pour repérer les dispositifs, serveurs et autres entités sur un réseau ainsi que leurs services, configurations et vulnérabilités. Il s’agit d’une étape essentielle dans l’évaluation de la situation de sécurité des réseaux.
- renseignements sur les menaces
- Il s’agit des renseignements sur les menaces et les auteurs de menace qui aident à atténuer les événements néfastes dans le cyberespace. Ils comprennent les renseignements sur les mécanismes, les indicateurs, et les répercussions ainsi que les conseils pratiques au sujet des menaces existantes ou nouvelles.
- vulnérabilité
- Une vulnérabilité est une faiblesse ou une faille d’un système d’information, de procédures de sécurité des systèmes, de contrôles internes ou de mise en œuvre qui pourrait être exploitée par un auteur de menace pour obtenir un accès non autorisé à l’information ou perturber les services essentiels. Les vulnérabilités peuvent provenir de diverses sources, y compris de bogues logiciels, d’erreurs de configuration ou de pratiques de sécurité inadéquates.
Annexe B. Liste de contrôle pour la gestion des vulnérabilités
Voici une liste de contrôle qui résume les principaux éléments abordés dans le présent document. Cette structure aide à établir un programme clair et efficace de gestion des vulnérabilités qui cadre avec les objectifs organisationnels et assure la protection des actifs essentiels.
Liste de contrôle pour la gestion des vulnérabilités
1. Gouvernance
Objectif : établir une structure officielle pour gérer les vulnérabilités et assurer la responsabilisation.
Étapes
- Définir la portée et les objectifs du programme.
- Attribuer les rôles et les responsabilités (par exemple, équipe de la sécurité, propriétaires d’actif, cadres responsables).
- Élaborer des politiques et des procédures pour orienter les activités de gestion des vulnérabilités.
- Veiller au respect des politiques, des normes et des exigences réglementaires du GC.
2. Compréhension des dépendances opérationnelles des actifs de TI
Objectif : cerner les actifs essentiels et leurs dépendances.
Étapes
- Faire l’inventaire de tous les actifs de TI, y compris le matériel, les logiciels et les composants de réseau.
- Procéder au mappage entre les processus opérationnels et les actifs de TI dont ils dépendent.
- Établir l’ordre de priorité des actifs en fonction de leur importance pour les activités opérationnelles et de la sensibilité des données.
3. Détection des vulnérabilités
Objectif : détecter les vulnérabilités des actifs de TI afin de gérer les risques de façon proactive.
Étapes
- Effectuer régulièrement des évaluations internes et externes à l’aide d’outils automatisés.
- Compléter les évaluations automatisées par de la validation et des tests manuels.
- Tirer parti des résultats des interventions en cas d’incident pour cerner les lacunes.
- Surveiller les sources de renseignements sur les menaces pour trouver les vulnérabilités nouvellement divulguées.
4. Évaluation des risques liés aux vulnérabilités
Objectif : évaluer les vulnérabilités et établir leur ordre de priorité en fonction de leur incidence potentielle et de leur probabilité.
Étapes
- Évaluer la gravité des vulnérabilités détectées.
- Tenir compte de l’importance de l’actif et de son exposition aux menaces.
- Créer une matrice de risques pour catégoriser les vulnérabilités en fonction de leur priorité (par exemple, risque élevé, moyen ou faible).
5. Activités d’atténuation
- Mettre en œuvre un correctif ou une mise à jour dans les systèmes et applications concernés.
- Apporter des changements à la configuration pour atténuer temporairement les risques.
- Mettre en œuvre des contrôles compensatoires pour réduire les risques à un niveau acceptable lorsqu’une correction complète n’est pas possible ou prendrait trop de temps.
6. Mesures, production de rapports et conformité
Objectif : mesurer l’efficacité du programme et démontrer la conformité.
Étapes
- Élaborer des indicateurs de rendement clés (par exemple, temps de correction, nombre de vulnérabilités à risque élevé corrigées).
- Produire des rapports réguliers pour les intervenants qui présentent les tendances et les réalisations.
- Assurer l’harmonisation avec les exigences réglementaires et d’audit au moyen de preuves écrites.
Annexe C. Outil d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités
L’objectif de cet outil d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités est :
- de disposer d’une approche rationnelle, justifiable et facile à utiliser pour établir l’ordre de priorité des vulnérabilités en fonction du risque qu’elles représentent pour la prestation de services essentiels et la situation de l’organisation en matière de cybersécurité;
- de définir des attentes en matière de correction des vulnérabilités qui concordent avec celles d’organisations semblables et tiennent compte de la vitesse de développement d’exploitations des auteurs de menace;
- d’adopter une approche uniforme à l’échelle du GC.
L’outil d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités adopte les pratiques exemplaires de l’industrie. En règle générale, les organisations du GC devraient accorder la priorité aux systèmes et services essentiels dans tout scénario d’atténuation. Le risque potentiel plus élevé pour ces systèmes devrait être pris en compte dans l’outil d’évaluation des risques liés aux vulnérabilités. Une bonne compréhension et un répertoire complet des systèmes essentiels sont également importants pour la continuité des activités et la reprise après un sinistre de TI.
C‑1 : processus
Les étapes suivantes doivent être suivies lors de l’utilisation de l’outil.
- Évaluer chaque facteur de risque.
- Additionner les notes (total de 50 points).
- Déterminer où la note se situe dans la matrice de risques pour les délais de mise à l’essai et de correction.
Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l’utilisation de l’outil.
- Une expertise spécialisée est requise pour évaluer les facteurs.
- Si un facteur ne peut pas être évalué, il faut calculer la somme des autres notes en tant que pourcentage de points disponibles et catégoriser comme suit :
- rouge = 80 % à 100 %;
- orange = 60 % à 79 %;
- jaune = 40 % à 59 %;
- vert = 1 % à 39 %.
C‑2 : facteurs de risque
Le tableau C.1 présente les facteurs de risque.
| Facteur | Description | Note maximale |
|---|---|---|
| Cote de risque du fournisseur | Fournie par le fournisseur | 5 |
| Exploitabilité technique et incidence technique (cote de base du Système commun de notation des vulnérabilités) | Fourni dans la National Vulnerability Database | 10 |
| Maturité de l’exploitation | Mesure dans laquelle l’exploitation est accessible et utilisée sur des réseaux | 10 |
| Importance des actifs pour les activités de menace | Importance de l’actif vulnérable pour les auteurs de menace en raison de ce que l’actif permettrait d’accomplir | 5 |
| Importance des actifs pour les activités opérationnelles | Importance de l’actif vulnérable pour les activités selon les activités, l’application ou le registre des risques du système | 10 |
| Exposition externe de l’actif | Mesure dans laquelle l’actif vulnérable est accessible par Internet | 10 |
C‑3 : guides d’évaluation des facteurs de risque
La section suivante présente des guides d’évaluation pour plusieurs facteurs de risque. Comme indiqué dans le tableau C.1, la cote de risque du fournisseur et la cote de base du Système commun de notation des vulnérabilités sont fournies par le fournisseur et la National Vulnerability Database.
| Points | Description |
|---|---|
| De 8 à 10 | Un code autonome fonctionnel existe ou aucune exploitation n’est requise (déclenchement manuel) et l’information est largement accessible. Le code d’exploitation fonctionne dans toutes les situations ou est activement livré par l’intermédiaire d’un agent autonome (comme un ver ou un virus). Les systèmes connectés au réseau pourraient subir des tentatives d’analyse ou d’exploitation. Le développement de l’exploitation a atteint le niveau d’outils automatisés fiables, largement accessibles et faciles à utiliser. |
| De 5 à 7 | Le code d’exploitation fonctionnel est accessible. Le code fonctionne dans la plupart des situations où il existe une vulnérabilité. |
| De 3 à 4 | Un code d’exploitation de validation de principe est accessible, ou une démonstration d’attaque n’est pas pratique pour la plupart des systèmes. La technique ou le code n’est pas fonctionnel dans toutes les situations et pourrait nécessiter des modifications importantes de la part d’un attaquant compétent. |
| De 1 à 2 | Aucun code d’exploitation n’est accessible, ou l’exploitation est théorique. |
| Points | Description |
|---|---|
| De 4 à 5 |
|
| 3 |
|
| De 1 à 2 |
|
| Points | Description |
|---|---|
| De 8 à 10 | L’actif est essentiel aux principales activités opérationnelles. La compromission de cet actif a une incidence directe sur la continuité des activités et pourrait avoir de graves répercussions financières, opérationnelles ou sur la réputation. Un nombre plus élevé d’actifs touchés correspond généralement à une cote plus élevée. Peut comprendre les actifs prenant en charge les systèmes Protégé B. Comprend les actifs prenant en charge l’information catégorisée comme Secret et Protégé C. |
| De 5 à 7 | L’actif appuie les activités opérationnelles essentielles, mais n’en est pas le moteur principal. La compromission de l’actif n’interrompra pas les activités opérationnelles, mais pourrait causer des perturbations ou inconvénients importants. |
| De 3 à 4 | L’actif prend en charge des fonctions opérationnelles secondaires qui ne sont pas étroitement liées aux activités principales. Sa compromission, bien que nuisible, peut être gérée sans perturbation importante aux principales fonctions. |
| De 1 à 2 | L’actif appuie des tâches ou des opérations non essentielles, et la compromission aurait une incidence minime. Sa compromission a une incidence immédiate minime sur les principales fonctions opérationnelles. L’actif peut servir à des rôles périphériques et non essentiels et peut être facilement remplacé ou omis. |
| Points | Description |
|---|---|
| De 8 à 10 | L’actif vulnérable est routable de l’extérieur. Un auteur de menace pourrait exploiter l’actif à partir d’Internet. |
| De 5 à 7 | L’actif vulnérable est exploitable à distance. Un auteur de menace doit accéder au même réseau étendu (RE) que l’actif vulnérable pour l’exploiter. |
| De 3 à 4 | L’actif vulnérable est exploitable à partir du réseau local. Un auteur de menace doit accéder au même segment de réseau que l’actif vulnérable pour l’exploiter. |
| 2 | L’actif vulnérable est exploitable localement. Un auteur de menace doit avoir un accès direct à l’actif vulnérable. |
| 1 | L’actif vulnérable est physiquement exploitable. Un auteur de menace doit avoir un accès physique à l’actif vulnérable. |
C‑4 : matrice de risques
Le tableau C.6 présente les délais recommandés pour la mise à l’essai et la correction des vulnérabilités détectées.
| Points | Pourcentage | Niveau de risque global | Délai de correction | Processus |
|---|---|---|---|---|
| De 40 à 50 | De 80 % à 100 % | Critique | 48 heures | Renvoi au PGEC GC; correction de la vulnérabilité ministérielle |
| De 30 à 39 | De 60 % à 79 % | Élevé | 21 jours | Correction de la vulnérabilité ministérielle |
| De 20 à 29 | De 40 % à 59 % | Moyen | 30 jours | Correction de la vulnérabilité ministérielle |
| De 1 à 19 | De 1 % à 39 % | Faible | 90 jours | Correction de la vulnérabilité ministérielle |