ARCHIVÉ : Chapitre 6 : Les jeunes au Canada : leur santé et leur bien-être – Les comportements à risque chez les jeunes sur le plan de la santé

L'usage du tabac et la consommation d'alcool et de drogues durant l'adolescence sont des activités parfois considérées comme non normatives et antisociales. Pourtant, c'est le désir d'indépendance des jeunes et leur curiosité à l'égard du monde dans lequel ils vivent qui les amènent à expérimenter le tabac, l'alcool et la marijuana. Bon nombre d'entre eux ne vont pas plus loin que la phase de l'expérimentation, mais d'autres continuent d'avoir des habitudes de vie qui les exposent à divers risques du point de vue de la santé. L'adoption de comportements qui présentent des risques sur le plan sanitaire est la principale cause de morbidité et de mortalité chez les adolescents. Ces comportements ont tendance à coexister chez les jeunes, ce qui crée un style de vie nuisible à la santé ayant des répercussions sur le plan physique (Pickett, Boyce, Garner et King, 2002). Dans le présent chapitre, nous examinons les habitudes comportementales des adolescents canadiens présentant un risque pour la santé qui sont liés au tabagisme, à la consommation d'alcool et de drogues et aux rapports sexuels, de même que l'évolution de celles-ci au cours des 12 dernières années.
Le tabagisme
Chez les jeunes, le tabagisme est associé à une augmentation de la fréquence et de la gravité des maladies respiratoires, à une diminution du taux de croissance et de capacité pulmonaires et à une élévation de la fréquence cardiaque au repos qui influe sur la performance et l'endurance physiques. Le tabagisme est également un déterminant de la consommation d'alcool et de drogues et il est associé à l'activité sexuelle précoce et à des rapports sexuels non protégés (Centers for Disease Control and Prevention, 1993). Selon l'enquête HBSC de 2002, c'est en 10e année qu'on trouve le plus grand nombre de jeunes qui fument tous les jours (figure 6.1). Depuis l'enquête de 1998, les taux de tabagisme chez les jeunes Canadiens sont demeurés stables, à l'exception de ceux des garçons et des filles de 8e année qui ont quelque peu diminué et de celui des filles de 10e année qui a considérablement fléchi (figures 6.2 et 6.3). Selon les données de Statistique Canada, la prévalence du tabagisme était autrefois plus élevée pour les jeunes filles de 15 à 19 ans que pour les jeunes garçons du même âge (Rapports sur la santé, 1999). Ces constatations concordent avec celles des enquêtes HBSC de 1990, 1994 et 1998. Toutefois, parmi les répondants à l'enquête HBSC de 2002, qui étaient un peu plus jeunes que ceux faisant par-tie de l'échantillon de Statistique Canada étant donné qu'ils appartenaient au groupe d'âge des 12 à 16 ans, 15 p. 100 des garçons de 10e année fumaient tous les jours, comparativement à seulement 11 p. 100 des filles de la même année (figures 6.2 et 6.3). La diminution du nombre de filles qui fumaient tous les jours, qui est passé de 21 p. 100 en 1998 à 11 p. 100 en 2002 pour les élèves de la 10e année, représente une variation importante s'accompagnant d'une baisse de l'usage occasionnel du tabac (au moins une fois par semaine, mais pas à tous les jours, et moins d'une fois par semaine) observable également parmi les filles du même âge.

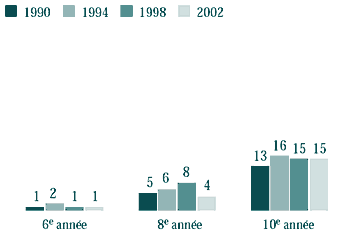
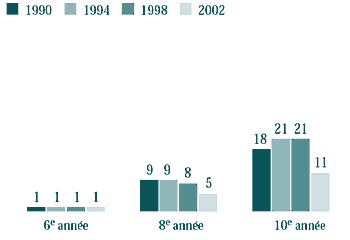
Des réductions similaires des taux de tabagisme chez les filles ont été documentées aux États-Unis (Johnston, O'Malley et Bachman, 2002), où l'on a enregistré des diminutions du pourcentage de jeunes filles de 10e année qui fumaient la cigarette, qui est passé de 16,8 p. 100 en 1998 à 11,9 p. 100 en 2001. Ont contribué à ce déclin la majoration du prix des cigarettes, la restriction de la publicité sur les produits du tabac, le plus grand nombre de campagnes médiatiques de sensibilisation aux effets nuisibles du tabagisme ainsi que l'évolution des attitudes sociales à l'égard du tabagisme et envers les fumeurs (Johnston et coll., 2002). Ces mêmes facteurs n'ont toutefois pas eu d'incidence sur les taux de tabagisme chez les garçons de 10e année.
Le fait d'avoir un parent qui fume renforce les chances qu'un adolescent fume. La probabilité que les élèves de 6e, 8e et 10e année, tant les garçons que les filles, fument est beaucoup plus grande si l'un des parents fume (figures 6.4 à 6.7). Selon d'autres études, le fait que la mère fume a une incidence plus déterminante sur le tabagisme des adolescents que l'exemple du père à cet égard (Kandel et Wu, 1995; Griffin et coll., 1999; Key et Marsh, 2002). Cette constatation n'est vraie que pour les filles de 8e et de 10e année faisant partie de l'échantillon de l'enquête HBSC. Qui plus est, les élèves dont le meilleur ami ou la meilleure amie fume risquent fort de fumer eux-mêmes, cette observation étant valable pour l'ensemble des répondants aux enquêtes HBSC (figures 6.8 et 6.9).
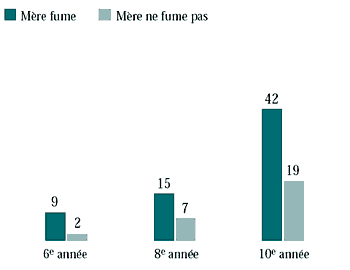
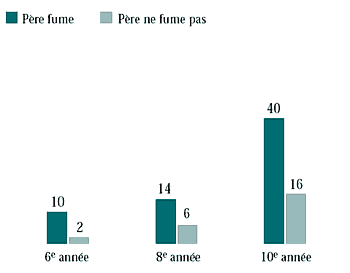
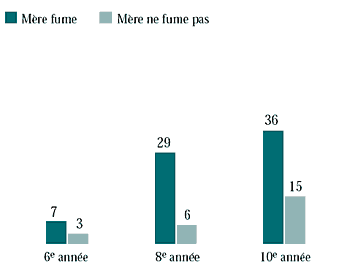

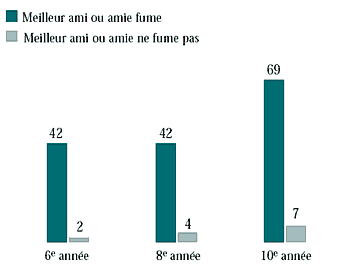
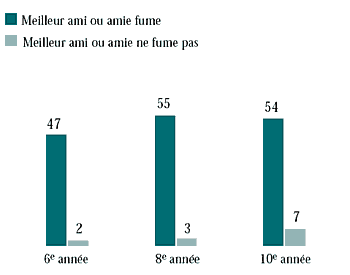
Les élèves qui fument ont plus de chances que leurs camarades d'éprouver des problèmes émotionnels ou psychologiques sous-jacents (Centers for Disease Control and Prevention, 1993) et d'être moins satisfaits de leur vie (Zullig, Valois, Huebner, Oeltmann et Drane, 2001). Les figures 6.10 et 6.11 indiquent que, pour ce qui est des jeunes faisant partie de l'échantillon de l'enquête HBSC, les non-fumeurs, tant les garçons que les filles, semblaient être plus satisfaits de leur vie à la maison que ceux qui fumaient tous les jours.
Figure 6.10 Garçons qui fument tous les jours et ceux qui ne fument pas qui sont satisfaits de leur vie (%)
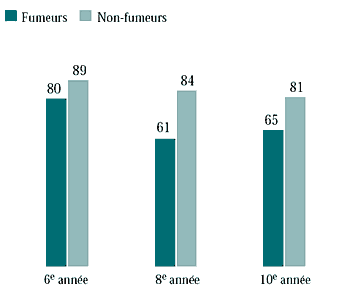
Figure 6.11 Filles qui fument tous les jours et celles qui ne fument pas qui sont satisfaites de leur vie (%)
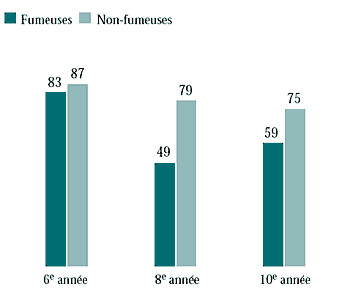
Le fait de fumer avec des amis peut être une activité sociale qui symbolise l'appartenance au groupe (Connop et King, 1999). Dans l'échan-tillon de l'enquête HBSC, la majorité des jeunes qui fumaient tous les jours, en particulier les filles, fumaient souvent avec leurs amis ou amies (figure 6.12), ce qui indique peut-être que le tabagisme répond à un besoin de soutien mutuel.
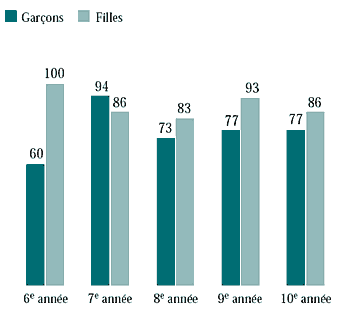
L'alcool
Tous les élèves interrogés dans le cadre de l'enquête HBSC de 2002 n'avaient pas l'âge requis par la loi pour acheter et consommer des boissons alcoolisées dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada.
La consommation d'alcool est l'un des nombreux comportements à risque des adolescents qui tendent à coexister. Elle peut nuire au rendement scolaire, provoquer des troubles psychologiques, amener les adolescents à prendre le risque de conduire un véhicule avec facultés affaiblies et réduire leur capacité de former des idées claires et de faire preuve de discernement (Johnston et coll., 1998). Voici les cinq raisons de boire de l'alcool mentionnées par les adolescents : prendre du bon temps avec des amis; expérimenter la consommation d'alcool et voir ce qu'il en est; éprouver une sensation de bienêtre ou se défoncer; faire l'expérience du goût de l'alcool; se détendre et chasser la tension (Johnston et coll., 1998).
La préférence des adolescents va d'ordinaire à l'alcool qui est souvent ce qu'ils essaient en premier (Andrews, Hops, Ary, Lichtenstein et Tildesley, 1991; Johnston et coll., 1994). La consommation excessive d'alcool est associée à l'usage accru de tabac et de drogues illicites au fil du temps.
Selon l'enquête HBSC de 2002, les taux de consommation hebdomadaire d'alcool ont constamment progressé pour les jeunes de la 6e à la 10e année, passant de 3 p. 100 à 23 p. 100 dans le cas des filles et de 6 p. 100 à 34 p. 100 dans celui des garçons (figure 6.13).
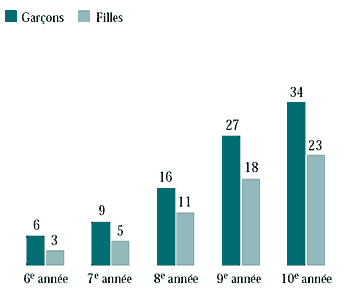
Comme on peut s'y attendre, les taux de consommation d'alcool, en particulier de bière et de spiritueux, étaient beaucoup plus élevés pour les élèves de 10e année. En 2002, la consommation de spiritueux semblait devenir plus populaire que celle de bière ou de vin, en particulier chez les plus jeunes adolescents (figures 6.14 à 6.16). Cette hausse peut s'expliquer en partie par la publicité entourant les boissons alcoolisées à saveur sucrée comme les panachés ou les « alcopops », qui plaisent aux filles en particulier; l'industrie de la publicité misant sur les images attrayantes des contenants design de ces boissons alcoolisées (The National Center on Addiction and Substance Abuse, 2003).
Figure 6.14 Élèves qui boivent de la bière au moins une fois par semaine, selon l'année de l'enquête (%)
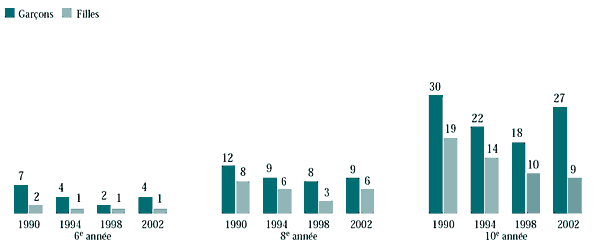
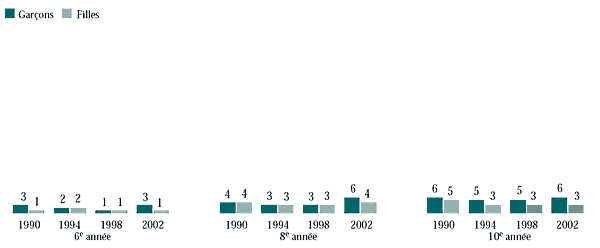
Figure 6.16 Élèves qui boivent des spiritueux au moins une fois par semaine, selon l'année de l'enquête (%)
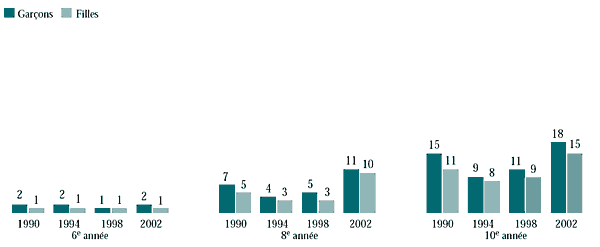
À la mi-adolescence (9e et 10e année), on constate une hausse marquée de la consommation d'alcool en quantité suffisante pour s'enivrer. Un pourcentage important (16 p. 100) d'élèves de 8e année ont déclaré s'être vraiment enivrés au moins deux fois. Pour ce qui est des élèves de 9e année, cette proportion s'établissait à presque un tiers (figure 6.17). Dans le même ordre d'idées, 44 p. 100 des élèves de 10e année ont indiqué qu'ils s'étaient enivrés au moins deux fois. Par contre, 23 p. 100 des filles et 34 p. 100 des garçons de 10e année ont affirmé avoir pris de l'alcool au moins une fois par semaine (figure 6.13). Cette tendance est conforme aux conclusions d'autres recherches effectuées au Canada selon lesquelles les jeunes Canadiens boivent rarement mais, quand cela se produit, ont tendance à consommer une quantité excessive d'alcool (Hewitt, Vinje et MacNeil, 1995). Fait intéressant, aucune différence notable n'a été relevée entre les sexes eu égard à l'ivresse.
Figure 6.17 Élèves qui ont déjà pris assez d'alcool pour être « vraiment ivres » au moins deux fois (%)
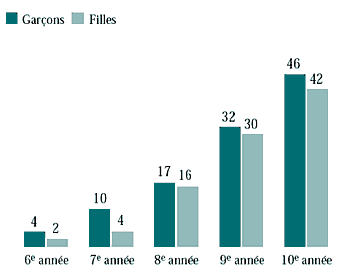
La consommation de drogues
La consommation de drogues durant l'adolescence peut avoir des répercussions à long terme du point de vue du bien-être des jeunes et de leur participation et leur contribution à la société. On admet généralement que, chez les adolescents, le fait de fumer des cigarettes et de boire de l'alcool est un signe précurseur de la consommation de marijuana; dans le même ordre d'idées, la consommation régulière de marijuana précède presque toujours celle d'autres drogues comme la cocaïne, l'héroïne ou le LSD (Tashkin, 1993; Zapert, Snow et Tebes, 2002). Précisons que seuls les élèves de 9e et de 10e année ont répondu aux questions ayant trait à la consommation de drogues de l'enquête HBSC de 2002.
Les données de l'enquête HBSC recueillies au cours des douze dernières années semblent indiquer que, chez les jeunes de la 10e année, le taux d'expérimentation de la marijuana a continué d'augmenter dans le cas des garçons (50 p. 100) mais s'est stabilisé dans celui des filles (40 p. 100) (figure 6.18). Des études régionales antérieures réalisées au Canada révèlent qu'environ 40 p. 100 des adolescents avaient fait l'essai de la marijuana avant l'âge de 15 ans (The McCreary Centre Society, 1999). Certains auteurs sont d'avis que la popularité de la marijuana en tant que drogue à caractère social chez les adultes incite les adolescents à s'en procurer et à considérer sa consommation comme une activité de loisirs sécuritaire (Tonkin, 2002). Cependant, des données sur les conséquences à long terme de la consommation de marijuana sur la santé des adolescents ne sont pas encore disponibles. Celles découlant de rapports cliniques ont démontré l'existence d'un lien entre la consommation de marijuana et le fléchissement du rendement scolaire et de la motivation et la progression de l'absentéisme (Tonkin, 2002). Les figures 6.19 et 6.20 indiquent que la consommation de marijuana augmente en fonction de l'année d'é-tudes. En 10e année, un tiers des garçons et un quart des filles avaient consommé de la marijuana trois fois ou plus au cours des 12 derniers mois.
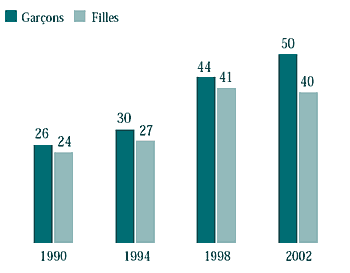
Figure 6.19 Fréquence de consommation de marijuana chez les élèves de 9e année au cours des 12 derniers mois (%)
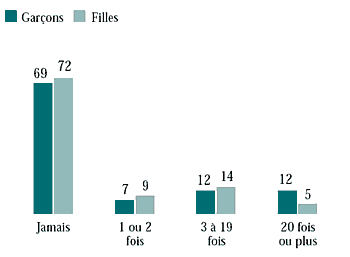
Figure 6.20 Fréquence de consommation de marijuana chez les élèves de 10e année au cours des 12 derniers mois (%)
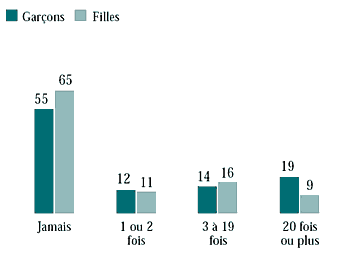
Le tableau 6.1 illustre le lien indiscutable entre la consommation de marijuana et des activités comme s'enivrer, boire de la bière ou des spiritueux, fumer des cigarettes et d'autres facteurs psychosociaux. La consommation de marijuana a été associée avec le fait d'avoir des amis qui ont des comportements à risque et également de ne pas avoir utilisé de condom au moment des dernières relations sexuelles, ce qui accroît le risque de grossesse et de maladies transmissibles sexuellement (MTS), entre autres l'infection par le VIH et le sida. De surcroît, la consommation de marijuana a été plus ou moins associée avec le fait d'avoir des relations difficiles avec ses parents, de ne pas aimer l'école et d'être insatisfait de sa vie. Selon d'autres recherches, les élèves qui ont commencé à consommer de la marijuana ont deux fois plus de chances d'abandonner leurs études secondaires que ceux qui n'ont pas pris cette habitude (Bray, Zarkin, Ringwalt et Junfeng, 2000).
Les figures 6.21 à 6.30 montrent la consommation de drogue chez les adolescents pour la période visée par les deux dernières enquêtes HBSC (1998 et 2002). Le nombre de garçons qui consomment de la drogue est un peu plus élevé que celui des filles qui font de même. La consommation de marijuana est beaucoup plus répandue que celle d'autres drogues, comme le LSD, la cocaïne et l'héroïne, l'opium ou la morphine. Toutefois, la consommation de marijuana a peu varié pour la période visée par les deux enquêtes, sauf chez les garçons de 10e année.
Figure 6.21 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris de la marijuana, selon l'année de l'enquête (%)
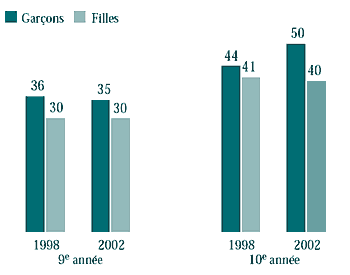
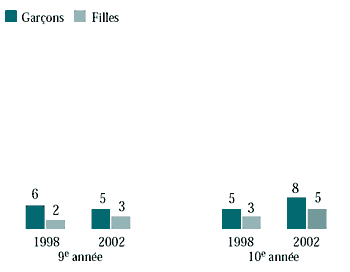
Figure 6.23 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris des amphétamines, selon l'année de l'enquête (%)
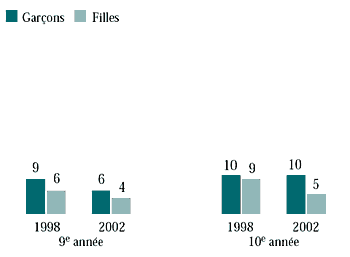
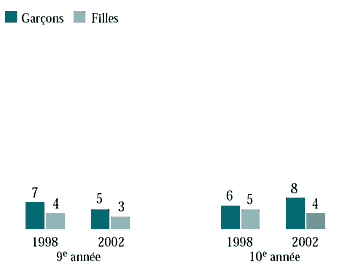
Figure 6.25 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris de l'héroïne, de l'opium ou de la morphine, selon l'année de l'enquête (%)
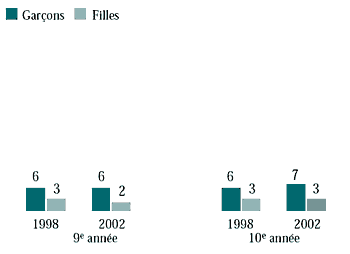
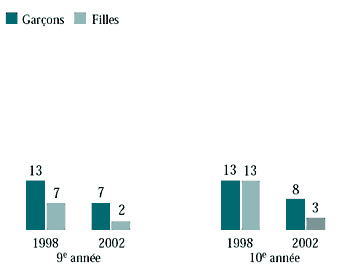
Figure 6.27 Élèves de 9e et de 10e année qui ont inhalé de la colle ou des solvants, selon l'année de l'enquête (%)
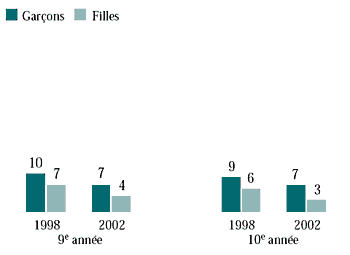
Figure 6.28 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris des médicaments d'ordonnance pour se droguer, selon l'année de l'enquête (%)
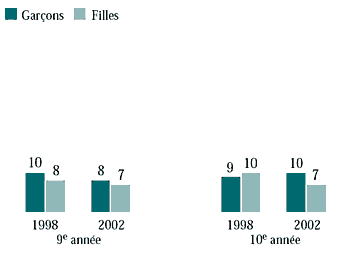
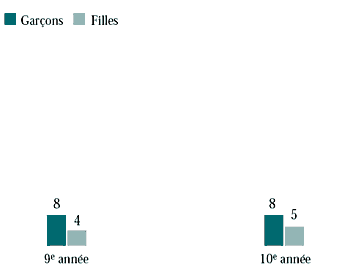
Figure 6.30 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris des stéroïdes anabolisants, selon l'année de l'enquête (%)
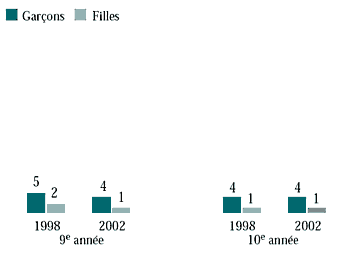
L'Ecstasy est une drogue synthétique ayant des propriétés stimulantes et hallucinogènes qu'on consomme surtout comme une drogue à usage récréatif et qu'on trouve dans les bars, en particulier à l'occasion de soirées « raves ». Chez les élèves de 10e année, la consommation d'Ecstasy n'a que très peu augmenté depuis 1998, de 3 p. 100 pour ce qui est des garçons et de 2 p. 100 dans le cas des filles. La consommation d'Ecstasy semble être en hausse aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne (Community Epidemiology Work Group, 2001).
Les amphétamines et la cocaïne font partie de la catégorie des stimulants qui donnent rapidement, quoique temporairement, un regain d'éner-gie. Pour la période allant de 1998 à 2002, la consommation d'amphétamines a diminué de moitié chez les jeunes filles de 10e année. La consommation d'amphétamines et celle de cocaïne ont toutes deux quelque peu reculé parmi les garçons et les filles de 9e année. Une importante divergence entre les sexes a été relevée quant à la consommation d'amphétamines et de cocaïne chez les élèves de 10e année, le nombre de garçons qui consommaient ces drogues étant deux fois plus élevé que celui des filles.
La proportion des élèves qui consommaient de l'héroïne, de l'opium ou de la morphine est demeurée inchangée par rapport à celle enregistrée en 1998, le nombre de filles qui prenaient ces drogues étant inférieur à celui des garçons.
Pour ce qui est de la consommation du LSD, qui est un hallucinogène, on a observé une tendance à la baisse pour la période allant de 1998 à 2002; les pourcentages de garçons et de filles ayant déclaré en 2002 qu'ils prenaient du LSD n'atteignant respectivement que la moitié et le quart de ceux enregistrés en 1998. Une tendance similaire quant à la consommation du LSD a été relevée chez les adolescents américains (National Institute on Drug Abuse, 2002).
Les solvants sont des produits qu'on trouve dans bien des bureaux et des foyers. Font partie de cette catégorie, par exemple, le dissolvant pour vernis à ongles, le diluant à peinture, la colle, l'essence et les peintures destinées à être pulvérisées. Ces produits sont licites, relativement peu coûteux et faciles à cacher, et les plus jeunes adolescents peuvent s'en procurer facilement pour obtenir rapidement un effet planant (Johnston, O'Malley et Bachman, 2001). Les produits à inhaler ont un effet anesthésique sur le corps et peuvent provoquer une perte de conscience. Outre des dommages au cœur, aux reins, au cerveau, au foie, à la moelle épinière et à d'autres organes, l'exposition chronique à ces produits entraîne des dommages persistants au cerveau et à d'autres parties du système nerveux. On signale également qu'ils sont à l'origine du syndrome de mort subite après inhalation volontaire (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2001). Selon l'enquête HBSC de 2002, l'inhalation de colle ou de solvants a légèrement diminué par rapport à 1998.
Les données recueillies aux États-Unis donnent à penser que la consommation de médicaments d'ordonnance à des fins non médicales a augmenté chez les adolescents, en particulier chez les jeunes filles (National Institute on Drug Abuse, 2001). Au nombre de ces médicaments, mentionnons le dextrométhorphane (remède contre la toux), les analgésiques, les stimulants comme l'éphédrine ou le Ritalin, les barbituriques, les tranquillisants et les narcotiques licites (National Institute on Drug Abuse, 2001). Toutefois, selon les enquêtes HBSC, la consommation de médicaments d'ordonnance par des élèves qui veulent se défoncer a peu varié au cours de la période comprise entre 1998 et 2002.
Le Ritalin est un stimulant du système nerveux central prescrit aux enfants hyperactifs pour son effet calmant. Cependant, certains adolescents prennent du Ritalin comme s'il s'agissait d'une drogue récréative pour rester éveillé, être plus attentifs, avoir moins d'appétit et se sentir euphoriques. Une question sur la consommation de Ritalin a été ajoutée à l'enquête HBSC de 2002. La proportion d'élèves qui prenaient ce médicament pour en tirer un effet planant était un peu plus forte chez les garçons de 9e et de 10e année (8 p. 100) que chez les filles (5 p. 100), comme le montre la figure 6.29. Suivant les résultats d'autres recherches effectuées dans les provinces de l'Atlantique, 8,5 p. 100 des enfants de la 7e à la 12e année ont pris du Ritalin à des fins non médicales, comparativement à 5,3 p. 100 des jeunes à qui ce médicament a été prescrit pour des raisons médicales. Sept pour cent des enfants qui prennent du Ritalin pour des raisons médicales ont déclaré qu'ils avaient donné à quelqu'un d'autre une partie de leurs médicaments. (Poulin, 2001).
Les athlètes de sexe masculin consomment depuis longtemps des stéroïdes pour améliorer leur performance sportive. Par contre, d'autres études ont également démontré une hausse du nombre de jeunes garçons qui prenaient des stéroïdes pour améliorer leur apparence physique (Boston University School of Public Health, 2002). Parmi les répondants à l'enquête HBSC, les stéroïdes anabolisants étaient plus populaires auprès des garçons que des filles, mais leur consommation est demeurée faible et inchangée pour la période allant de 1998 à 2002.
Les jeunes qui expérimentent des substances enivrantes, quelles qu'elles soient, au début de l'adolescence risquent davantage de devenir de gros fumeurs plus tard (Griffin et coll., 1999). Selon l'étude HBSC, c'est chez les jeunes de la 8e à la 10e année qu'on observe les hausses les plus marquées de l'usage quotidien de tabac et de la consommation régulière d'alcool (figures 6.1 et 6.13), ce qui correspond à la transition de l'école intermédiaire à l'école secondaire dans bien des provinces. Le tableau 6.2 illustre le lien existant entre les épisodes d'ivresse et le tabagisme pour ce qui est des jeunes faisant partie de l'échantillon. Par exemple, 40 p. 100 des élèves de 9e et de 10e année qui s'étaient vraiment enivrés plus de dix fois ont déclaré qu'ils fumaient tous les jours, comparativement à seulement 1,4 p. 100 de ceux qui ne s'étaient jamais vraiment enivrés.
Le comportement sexuel

C'est à l'adolescence que s'affirment les attitudes et les comportements sexuels. Il est donc important qu'on comprenne et qu'on cerne les comportements à risque qui prédisposent les adolescentes à tomber enceintes et qui favorisent la transmission de maladies transmissibles sexuellement, entre autres l'infection par le VIH et le sida.
La chlamydiose et la gonorrhée sont des infections bactériennes transmissibles sexuellement, qu'on peut soigner avec des antibiotiques. Ces infections sont toutefois souvent asymptomatiques chez les jeunes femmes. Non soignées, elles sont une importante cause d'infections pelviennes et d'infertilité ultérieure. La présence d'une infection bactérienne transmissible sexuellement accroît en outre le risque qu'une personne contracte et transmette le VIH (Santé Canada, 2002). Des 32 869 cas de chlamydiose déclarés chez les filles au Canada en 2000, 40 p. 100 visaient des jeunes femmes de 15 à 19 ans. Dans ce groupe d'âge, les taux de chlamydiose déclarés chez les filles ont augmenté, passant de 1 063 cas par tranches de 100 000 en 1998 à 1 236 cas par tranches de 100 000 en 2000. Des 2 368 cas de gonorrhée déclarés pendant la même période, 41 p. 100 visaient des femmes de 15 à 19 ans.
Parmi les participants à l'enquête HBSC de 2002, seuls les élèves de 9e et de 10e année ont été invités à répondre à des questions de santé liées à la sexualité. Un peu moins d'un cinquième des élèves de 9e année ont indiqué qu'ils avaient eu des relations sexuelles. En 10e année, environ le quart des élèves ont déclaré avoir eu des relations sexuelles (figure 6.31). Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux déclarés aux États-Unis. Selon les données provenant de la National Youth Risk Behavior Study, 36,9 p. 100 des élèves américains de 9e année et 66,4 p. 100 de ceux de 12e année ont déclaré qu'ils avaient eu des relations sexuelles (American Academy of Pediatrics, 1999). Une étude canadienne récente, réalisée sur une grande échelle, a révélé que parmi les élèves de 9e année, 23 p. 100 des garçons et 19 p. 100 des filles avaient eu des relations sexuelles; cette proportion s'établissant, dans le cas des élèves de 11e année, à 40 p. 100 des garçons et à 46 p. 100 des filles (Boyce, Doherty, MacKinnon et Fortin, 2003).
Figure 6.30 Élèves de 9e et de 10e année qui ont pris des stéroïdes anabolisants, selon l'année de l'enquête (%)
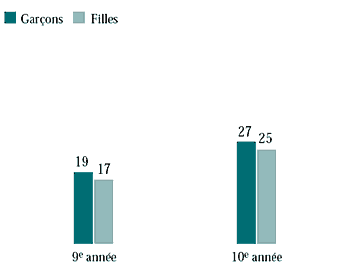
Pour devenir des adultes en santé, les adolescents doivent acquérir la capacité de faire des choix responsables en matière de sexualité. Pour obtenir des estimations des pratiques sexuelles à risque des adolescents, nous avons demandé aux élèves d'indiquer quel genre de protection ou de contraception ils avaient utilisé au moment de leurs dernières relations sexuelles (figures 6.32 et 6.33).
Figure 6.32 Moyens de contraception utilisés par les élèves de 9e année sexuellement actifs la dernière fois où ils ont eu des relations sexuelles (%)
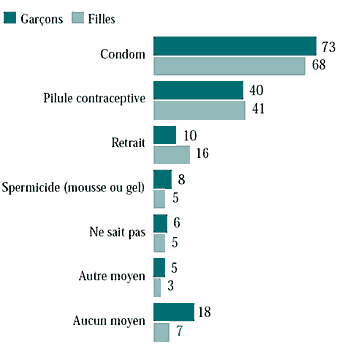
Figure 6.33 Moyens de contraception utilisés par les élèves de 10e année sexuellement actifs la dernière fois où ils ont eu des relations sexuelles (%)
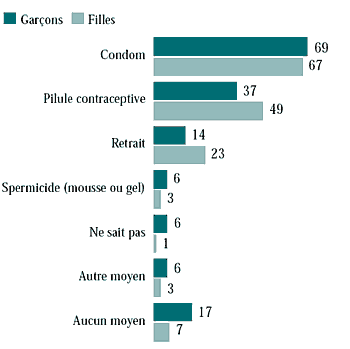
Des jeunes femmes ont déclaré que les méthodes de protection et de contraception qu'elles utilisaient le plus souvent étaient le condom et la pilule contraceptive (Polaneczky, 1998). Suivant l'enquête HBSC, les condoms semblent être le mode de contraception que préfèrent à la fois les garçons et les filles. Presque 70 p. 100 des élèves de 9e et de 10e année, tant les garçons que les filles, ont déclaré qu'ils avaient utilisé des condoms la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Cependant, la proportion des élèves qui utilisaient constamment des condoms n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de cette étude.
Pris régulièrement, les contraceptifs oraux ont un taux d'échec de 1 p. 100 pour ce qui est de la prévention des grossesses. Néanmoins, le taux d'échec de ces contraceptifs pourrait atteindre, dans le cas des adolescentes, jusqu'à 15 p. 100 en raison du fait qu'ils sont pris irrégulièrement puisque les jeunes filles qui utilisent ce moyen de contraception omettent en moyenne de prendre trois de ces pilules chaque mois (American Academy of Pediatrics, 1999). Qui plus est, les contraceptifs oraux n'offrent aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement et le VIH. Parmi les jeunes faisant partie de l'échantillon HBSC, l'utilisation de la pilule contraceptive était plus répandue chez les jeunes filles de 10e année (49 p. 100) que chez celles de 9e année (41 p. 100). Fait remarquable, la même proportion de garçons et de filles de 9e année ont déclaré qu'ils avaient recours à la pilule contraceptive. Cette constatation est encourageante car elle laisse supposer que certains garçons assument peut-être la responsabilité de se renseigner sur le moyen de contraception qu'utilisent leurs partenaires.
Toutefois, les garçons de 10e année ayant déclaré qu'ils avaient opté pour la pilule contraceptive étaient proportionnellement moins nombreux que les filles de la même année qui ont mentionné ce moyen de contraception.
Chose étonnante, le retrait semble être une pratique commune chez les élèves de ces deux années d'enquêtes. Le nombre de filles ayant signalé qu'elles avaient opté pour ce mode de contraception la dernière fois qu'elles avaient eu des relations sexuelles était supérieur à celui des garçons pour ces deux années d'études (figures 6.32 et 6.33). Cette constatation est inquiétante compte tenu du taux d'échec élevé de cette méthode en matière de prévention des grossesses et du fait qu'elle n'offre aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement (American Academy of Pediatrics, 1999).
Une faible proportion d'élèves (variant entre 1 et 6 p. 100) de 9e et de 10e année ont indiqué qu'ils ne pouvaient préciser quelle méthode de contraception ils avaient utilisée la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Par contre, une importante proportion de garçons de ces deux années d'études (18 p. 100), et une proportion moins grande de filles (7 p. 100), ont indiqué qu'ils n'avaient utilisé aucun moyen de protection ou de contraception au moment de leurs dernières relations sexuelles.
En ce qui a trait aux comportements à risque des adolescents, une distinction peut être établie entre les élèves sexuellement actifs (qui avaient eu des relations sexuelles au moins une fois) et sexuellement non actifs (qui n'avaient jamais eu de relations sexuelles). Le pourcentage des élèves de 9e et 10e année sexuellement actifs qui fumaient tous les jours était compris entre le quart et la moitié de ces jeunes, comparativement à celui des élèves non encore sexuellement actifs qui était inférieur à 6 p. 100 (figure 6.34).
Figure 6.34 Élèves de 9e et de 10e année actifs et non actifs sexuellement qui fument tous les jours (%)
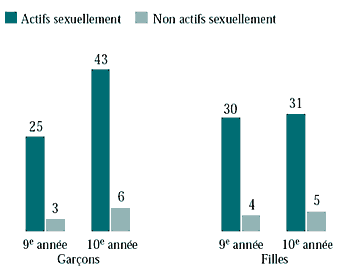
Des tendances comparables ont été observées quant à la consommation de marijuana chez les élèves de 9e et de 10e année faisant partie de l'échantillon (figure 6.35). Parmi les élèves de 9e et de 10e année ayant déclaré une consommation modérée de marijuana (plus de trois fois), le nombre de ceux sexuellement actifs était supérieur à celui des jeunes non actifs sur le plan sexuel.
Figure 6.35 Élèves de 9e et de 10e année actifs et non actifs sexuellement qui ont consommé de la marijuana plus de trois fois (%)
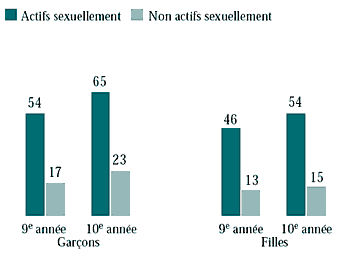
Dans le même ordre d'idées, les garçons sexuellement actifs étaient plus nombreux que ceux sexuellement non actifs à s'être enivrés fréquemment (figure 6.36). Les relations sexuelles non planifiées sous l'influence de l'alcool ont été associées à l'utilisation irrégulière du condom et à la multiplicité des partenaires sexuels (Poulin et Graham, 2001; Boyce et coll., 2003). Parmi les jeunes faisant partie de l'échantillon de l'enquête HBSC, une importante proportion des adolescents sexuellement actifs couraient manifestement le risque d'une grossesse chez les adolescentes et d'infections transmissibles sexuellement en raison de leur consommation excessive d'alcool.
Figure 6.36 Élèves de 9e et de 10e année actifs et non actifs sexuellement qui se sont enivrés plus de quatre fois (%)
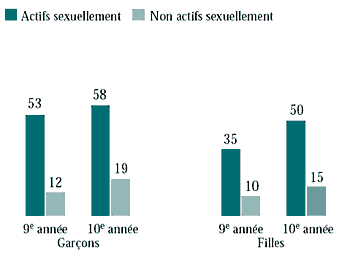
L'initiation au risque
L'initiation à des comportements présentant des risques sur le plan sanitaire est d'ordinaire déterminée d'après les déclarations rétrospectives des élèves. L'âge de l'initiation varie en fonction de celui des membres de l'échantillon visé par l'enquête, la fourchette étant plus large dans le cas des élèves plus vieux. Il semble que les répondants à l'enquête HBSC aient été particulièrement jeunes lorsqu'ils ont bu de l'alcool pour la première fois. L'initiation à l'alcool semble atteindre un sommet à 13 et 14 ans, en particulier pour les filles (figure 6.37). Cette constatation confirme les résultats de recherches sur la santé des adolescents qui révèlent que ceux-ci se tournent d'abord vers l'alcool (Duncan, Duncan et Hops, 1998). La consommation d'alcool est d'ordinaire considérée comme socialement acceptable parmi les adultes, comparativement au tabagisme et à la consommation de drogues. Qui plus est, l'alcool est couramment servi aux repas à la maison et bon nombre de parents tolèrent que leurs enfants d'âge mineur boivent de l'alcool à l'occasion de certaines activités sociales, religieuses ou culturelles. L'âge auquel les jeunes s'enivrent pour la première fois atteint un point culminant entre 13 et 14 ans, le nombre de jeunes filles qui s'enivrent pour la première fois à cet âge dépassant celui des garçons. Une plus forte proportion de garçons s'étaient enivrés avant l'âge de 13 ans (figure 6.38).
Figure 6.37 Âge qu'avaient les élèves de 9e et de 10e année la première fois qu'ils ont bu de l'alcool (%)
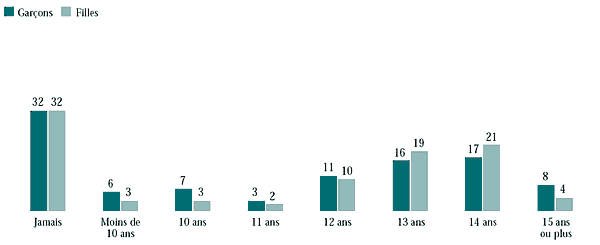
Figure 6.38 Âge qu'avaient les élèves de 9e et de 10e année la première fois qu'ils se sont enivrés (%)
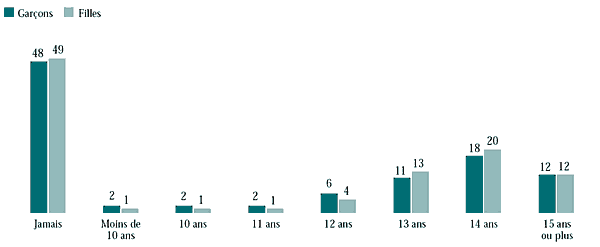
La figure 6.39 illustre la répartition de l'âge de l'initiation au tabagisme. Environ un élève sur dix a essayé de fumer des cigarettes avant d'avoir 12 ans. De faibles pourcentages de garçons et de filles ont eu leurs premières relations sexuelles avant l'âge de 14 ans. La très grande majorité des élèves de 9e et 10e année qui avaient eu des relations sexuelles ont toutefois déclaré avoir eu à l'époque 14 ans ou plus (figure 6.40).
Figure 6.39 Âge qu'avaient les élèves de 9e et de 10e année la première fois qu'ils ont fumé une cigarette (%)
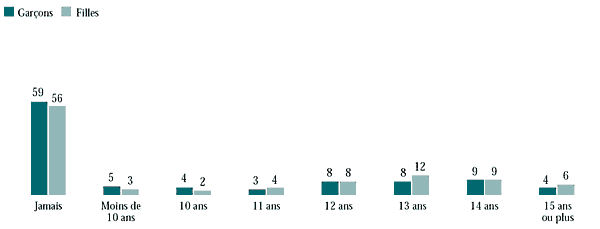
Figure 6.40 Âge qu'avaient les élèves de 9e et de 10e année la première fois qu'ils ont eu des relations sexuelles (%)
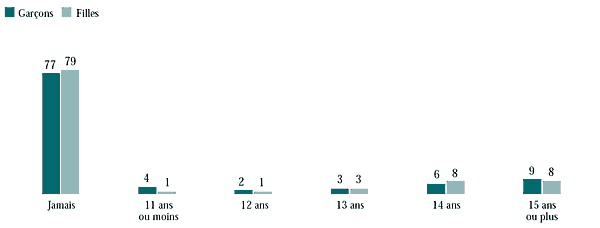
Principales constatations

- On remarque une diminution du tabagisme chez les filles plus âgées et également chez les élèves de 8e année, selon l'année de l'enquête.
- Manifestement, le nombre d'adolescents plus jeunes qui consomment des boissons riches en alcool était légèrement supérieur, selon l'année de l'enquête.
- Deux élèves de 10e année sur cinq ont déclaré s'être enivrés au moins deux fois.
- La consommation de drogues a été assez stable, sauf celle de la marijuana qui a augmenté chez les garçons de 10e année et celle du LSD qui a diminué tant chez les garçons que chez les filles depuis 1998.
- La consommation de marijuana a été associée au tabagisme, à la consommation d'alcool, à des pratiques sexuelles risquées, à des relations difficiles avec les parents et à des sentiments négatifs à l'égard de l'école.
- Le fait de s'enivrer souvent était étroitement lié à l'usage quotidien de tabac.
- Presque 25 p. 100 des élèves de 9e et de 10e année ont déclaré avoir eu des relations sexuelles.
- Ces mêmes élèves ont signalé qu'ils avaient souvent, mais non pas systématiquement, eu recours au condom.
- Ils ont indiqué qu'ils utilisaient fréquemment la pilule contraceptive mais non pas de façon soutenue.
- Le fait d'avoir des relations sexuelles était associé à l'usage quotidien du tabac, à la consommation de marijuana et à l'enivrement fréquent.