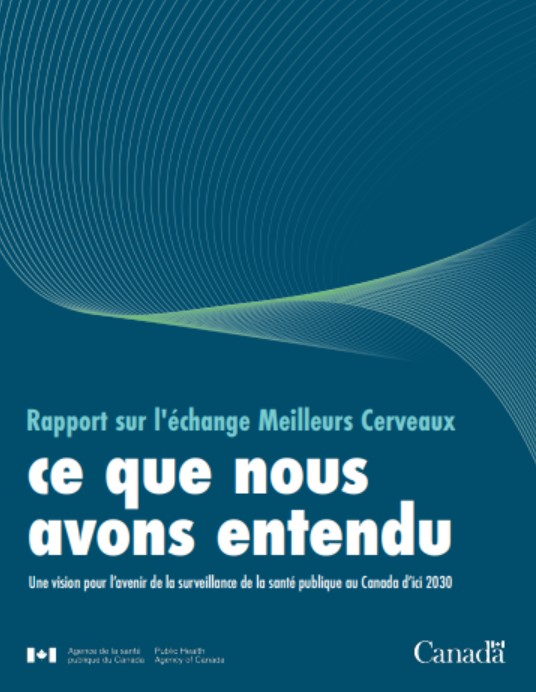Rapport « Ce que nous avons entendu » sur l’échange Meilleurs Cerveaux : Une vision pour l’avenir de la surveillance de la santé publique au Canada d’ici 2030
Télécharger en format PDF
(18,019 Ko, 26 pages)
Organisation: Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : 2024-07-25
Table des matières
- Dre Sarah Viehbeck, conseillère scientifique en chef et vice-présidente, Direction générale des données, de la surveillance et de la prospective, ASPC
- Sommaire
- Acronymes
- Contexte et objectifs
- Conclusions principales
- Conclusion
- Annexe A : Liste des présentateurs et animateurs de l'échange Meilleurs Cerveaux
- Annexe B : Ordre du jour de l'échange Meilleurs Cerveaux
- Références
- Notes de fin de page
Dre Sarah Viehbeck, conseillère scientifique en chef et vice-présidente, Direction générale des données, de la surveillance et de la prospective, ASPC
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport Ce que nous avons entendu : échange Meilleurs Cerveaux sur une vision de la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030, qui reprend les discussions de l'échange Meilleurs Cerveaux qui s'est tenu le 21 novembre 2023, organisé conjointement par l'Agence de la santé publique du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada. Cet événement a rassemblé des experts canadiens et internationaux pour un dialogue ouvert et constructif sur les occasions prometteuses pour l'avenir de la surveillance de la santé publique au Canada. Leurs discussions ont mis en évidence l'importance cruciale de l'amélioration des flux de travail de surveillance grâce aux nouvelles technologies, de l'amélioration de la qualité des données pour soutenir les populations cibles, de l'amélioration du partage et du couplage des données, de l'utilisation d'approches communautaires et de partenariat, de l'établissement de la confiance par l'engagement et la communication avec le public, de l'alignement des activités de surveillance sur les priorités de santé de la population et du passage de la vision à la mise en œuvre d'un changement concret et durable.
L'Agence de la santé publique du Canada s'est engagée à promouvoir une culture de l'excellence scientifique. En tant que rassembleur national et connecteur international, nous tirons parti des technologies modernes et des nouvelles sources de données pour stimuler l'innovation dans les pratiques de surveillance, tout en intégrant l'équité en matière de santé afin de fournir des informations opportunes et des prévisions pour la prise de décision. Ce rapport Ce que nous avons entendu contribuera à la planification et aux actions de surveillance de la santé publique au Canada, ainsi qu'à l'élaboration d'une vision pour l'avenir de la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030.
Nous remercions tous les participants à l'échange Meilleurs Cerveaux pour la diversité de leurs points de vue et leur expertise qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport.
Sommaire
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est à la tête de Vision 2030, une initiative visant à imaginer ce que devrait être la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030. Pour élaborer cette vision, l'Agence consulte divers acteurs et partenaires de la santé publique au Canada et à l'étranger. Dans le cadre de ce processus, l'ASPC a organisé, en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), une réunion virtuelle échange Meilleurs Cerveaux (EMC) le 21 novembre 2023 afin de réunir des décideurs principaux, des chercheurs et d'autres intervenants en santé publique, au pays et à l'étranger, pour discuter des principaux défis auxquels est confrontée la surveillance de la santé publique et pour recueillir des idées en vue d'apporter des changements concrets et durables. Ce rapport Ce que nous avons entendu fournit un résumé des thèmes clés de ces discussions, qui seront utilisés pour l'élaboration du rapport final sur la Vision 2030.
Thèmes clés de ce que nous avons entendu
- Nouvelles technologies pour améliorer les flux de travail de surveillance. Les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, ont un rôle à jouer pour soutenir le personnel de santé publique et faciliter l'intégration d'ensembles de données nouveaux et divers dans les flux de travail de surveillance. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour automatiser les tâches de routine et libérer les praticiens de la santé publique pour les travaux plus complexes d'analyse, d'interprétation et d'établissement de relations. La clé pour obtenir l'adhésion est de travailler avec les praticiens pour identifier et éliminer les points douloureux dans leur flux de travail. Un participant a donné une étude de cas sur l'utilisation de l'IA pour faciliter les notes de sortie et le travail administratif dans le cadre des soins de santé. Une autre application de ces technologies émergentes consiste à élargir notre palette d'outils d'analyse des données, de l'utilisation de l'IA pour trier les mégadonnées afin d'obtenir des informations exploitables à l'utilisation de grands modèles de langage (comme ChatGPT) pour effectuer des requêtes en langage clair sur des ensembles de données complexes. Les participants ont mis en garde contre le fait que les outils d'IA soulèvent une série de préoccupations juridiques et éthiques, centrées sur leur potentiel à faciliter la désinformation et à créer des résultats biaisés ou faussement confiants. Le personnel de santé publique aurait besoin d'une formation pour utiliser efficacement ces nouveaux outils tout en appréciant leurs pièges potentiels.
- Des données de haute qualité pour soutenir les populations cibles. L'afflux d'informations lors d'une crise de santé publique a créé une « infodémie » où des données dont la qualité et la pertinence sont inconnues sont utilisées pour éclairer la prise de décision. Les sources de données pratiques et accessibles, telles que les mégadonnées, peuvent potentiellement produire des estimations inexactes et biaisées pour les paramètres nécessaires à l'élaboration d'interventions en matière de santé de la population. Un participant a vu dans ces circonstances une occasion de se recentrer sur une approche classique de la collecte de données de surveillance de la santé publique, privilégiant la qualité à la quantité. Cette approche commence par l'identification des besoins d'information spécifiques d'une population cible, suivie d'une collecte de données sur mesure et de la diffusion de l'analyse qui en résulte auprès de ceux qui l'utiliseront pour éclairer la prise de décision en matière de santé publique. Un autre participant s'est inquiété du fait que les enquêtes de population, un outil important pour la collecte de données de haute qualité, étaient menacées par de faibles taux de réponse.
- Amélioration du partage et le couplage des données. Le partage et la mise en relation des données au sein des différents ordres de gouvernement et entre eux sont entravés par l'existence de silos de données, de normes incohérentes et d'obstacles juridiques et culturels à l'échange d'informations. Souvent, les données nécessaires à la prise de décision en matière de santé publique ont été saisies quelque part, mais ne peuvent être obtenues en temps voulu ou avec la granularité nécessaire. Les participants ont relevé plusieurs moyens de faire tomber ces barrières au sein des institutions gouvernementales, notamment la législation, l'élaboration conjointe de normes et le passage d'un paradigme de rapports hiérarchiques à un échange réciproque. Pour la Vision 2030, les participants ont conclu qu'il fallait donner la priorité à quelques couplages de données clés à court terme afin de démontrer les avantages du partage des données et de jeter les bases des efforts futurs. Les participants ont suggéré que le Canada fasse avancer ces mêmes initiatives au niveau international afin d'améliorer le partage des données avec les partenaires mondiaux de la santé.
- Approches communautaires et partenariales pour la surveillance de la santé publique. Les données désagrégées relatives aux déterminants sociaux de la santé sont importantes pour lutter contre les inégalités sociales dans le cadre de la surveillance de la santé publique. Des données plus détaillées sont souvent détenues par des groupes cliniques et communautaires, et la formation de partenariats avec ces organisations serait bénéfique pour approfondir les connaissances sur la santé individuelle et communautaire. Les participants ont souligné l'importance de veiller à ce que les communautés aient leur mot à dire sur la manière dont leurs données sont gérées, rapportées et utilisées pour informer les actions de santé publique, en mentionnant la gouvernance des données autochtones comme modèle pour ce processus.
- La mobilisation du public et la communication pour instaurer la confiance. La confiance dans la santé publique et les institutions gouvernementales en général a souffert ces dernières années. Même le terme « surveillance » dans le domaine de la santé publique peut poser problème, car il peut avoir des connotations différentes pour les professionnels de la santé publique et le public, notamment les communautés autochtones. Rétablir la confiance dans la santé publique reste un défi de taille, exacerbé par l'omniprésence de la désinformation. Certains participants ont estimé que la communication en matière de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 avait parfois été trop catégorique, et le fait de ne pas communiquer correctement l'incertitude et les limites de nos connaissances peut alimenter la méfiance. L'affectation des ressources à la communication devrait être revue, compte tenu de sa fonction essentielle dans la construction de la crédibilité et de la cohésion autour des objectifs de santé publique. En outre, l'utilisation par l'ASPC de données sur la mobilité pendant la pandémie de COVID-19, qui a donné lieu à une enquête parlementaire et à une investigation du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, a été citée comme un exemple des raisons pour lesquelles il est essentiel de renforcer l'engagement du public dès les premières étapes et de mettre l'accent sur des approches participatives pour concevoir des systèmes de surveillance.
- Harmoniser les activités de surveillance avec les priorités en matière de santé de la population. Le Canada est confronté à des crises croissantes liées à la consommation d'opioïdes et à la santé mentale, ainsi qu'à des problèmes de longue date concernant l'accès aux déterminants sociaux les plus fondamentaux de la santé : l'alimentation, l'eau potable et le logement. S'il est essentiel que les leçons apprises de la pandémie de COVID-19 soient utilisées pour se préparer à la prochaine pandémie, certains participants ont estimé qu'il était important de réévaluer l'orientation des activités de surveillance de l'ASPC afin de mettre davantage l'accent sur les maladies chroniques et d'autres problèmes de santé publique qui ne sont pas directement liés aux maladies infectieuses. Les priorités en matière de renforcement des capacités de surveillance de la santé publique devraient s'aligner sur notre compréhension des risques que les maladies non transmissibles et la répartition inégale des déterminants sociaux de la santé font peser sur la santé de la population.
- Passer de la vision à la mise en œuvre. La séance a mis en évidence une frustration généralisée face au fossé persistant entre la vision et la mise en œuvre de l'amélioration de la surveillance de la santé publique au Canada. Les participants ont noté l'excellence des rapports précédents dans le diagnostic des problèmes de surveillance de la santé publique et l'insuffisance des progrès réalisés dans la conversion de ces plans et stratégies en changements concrets et durables. Un participant a suggéré un « échange des meilleurs réalisateurs ». Il a également été suggéré que les juristes et les législateurs soient davantage impliqués dans le processus, en particulier dans les discussions relatives à la gouvernance des données de santé. Pour progresser, il faut non seulement des solutions techniques, mais aussi des stratégies politiques visant à établir des relations entre les différentes parties prenantes dans le domaine de la santé publique.
Acronymes
- IA : Intelligence artificielle
- EMC : échange Meilleurs Cerveaux
- IRSC : Instituts de recherche en santé du Canada
- COVID-19 : Maladie à coronavirus 2019
- CSTE : Council of State and Territorial Epidemiologists
- GML : Grand modèle de langage
- ASPC : Agence de la santé publique du Canada
Contexte et objectifs
La surveillance de la santé publique est le fondement de la pratique de la santé publique, car elle fournit aux décideurs les données et les informations dont ils ont besoin pour fixer des priorités et mettre en œuvre des interventions. Les évolutions survenues au cours des deux dernières décennies, depuis les nouvelles menaces de maladies infectieuses jusqu'aux technologies émergentes et aux modèles de gouvernance des données, ont continuellement mis les systèmes de surveillance de la santé publique du Canada au défi de s'adapter. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance cruciale de rassembler des données dans de nombreux domaines, notamment des données épidémiologiques, de laboratoire, génomiques et de sécurité des vaccins, ainsi que de nombreux autres types d'informations.
Vision 2030 est une initiative menée par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour imaginer ce à quoi devrait ressembler la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030, au-delà des défis quotidiens auxquels sont confrontés les praticiens de la santé publique aujourd'hui. C'est l'occasion de réimaginer la surveillance de la santé publique afin qu'elle réponde aux besoins évolutifs des personnes résidant au Canada et de guider l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles façons de penser et de nouveaux modes de gouvernance dans cette activité fondamentale de la santé publique.
Pour soutenir le développement de cette vision, l'ASPC a entamé un processus visant à impliquer les parties prenantes clés et les experts d'un océan à l'autre du pays et au niveau international afin de recueillir des informations sur les besoins en matière de surveillance de la santé publique et de rassembler des idées concrètes pour produire des améliorations durables. Ce rapport fournit un résumé de haut niveau d'une réunion de l'échange Meilleurs Cerveaux (EMC) qui s'est tenue le 21 novembre 2023 dans le cadre d'un partenariat entre l'ASPC et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cette rencontre a rassemblé des décideurs politiques nationaux et internationaux, des chercheurs, des experts en mise en œuvre et d'autres acteurs clés pour une discussion virtuelle d'une journée, sur invitation uniquement, concernant l'avenir de la surveillance de la santé publique au Canada. Neuf présentateurs et animateurs (dont la liste figure à l'annexe A) et une cinquantaine de participants nationaux et internationaux y ont participé. Les objectifs de l'EMC étaient les suivants :
- Déterminer les questions nouvelles et actuelles hautement prioritaires qui nécessiteront une surveillance de la santé publique;
- Caractériser le type et la quantité d'informations de santé publique nécessaires à la surveillance de la santé publique pour orienter la politique et l'action en matière de santé publique;
- Discuter des modèles internationaux de gouvernance, des structures organisationnelles et des politiques qui permettent la surveillance de la santé publique, y compris le partage d'informations avec les parties prenantes en vue d'une action de santé publique;
- Déterminer les aptitudes et compétences clés en matière de surveillance de la santé publique pour le futur personnel de santé publique.
Ce rapport présente un résumé des discussions qui ont eu lieu lors de l'EMC (voir l'ordre du jour à l'annexe B), en fournissant une synthèse des connaissances tirées des présentateurs et des participants. Cinq personnes ont pris des notes détaillées sur ce qui a été dit au cours de chaque séance et un document de notes consolidées a été créé. À partir de ces notes, le rédacteur technique a élaboré un résumé thématique, en notant les principaux domaines de besoins, les solutions innovantes et les sujets suscitant des divergences d'opinions. Les thèmes ne sont pas nécessairement incompatibles. Les évaluations anonymes réalisées après l'atelier par environ la moitié des participants ont été utilisées pour contextualiser les discussions. Les thèmes, les idées et les points de discussion ne sont pas attribués à des personnes spécifiques afin de protéger l'identité des participants. Des citations sont utilisées occasionnellement pour souligner des points clés.
Le contenu de ce rapport ne reflète pas nécessairement les opinions de l'ASPC ou des IRSC. Les thèmes et les discussions de cette réunion contribueront à l'élaboration d'une vision de la surveillance de la santé publique au Canada à l'horizon 2030, parallèlement aux consultations des parties prenantes, à la mobilisation des populations autochtones, à la mobilisation du public et à la validation par des experts. Un rapport final sur cette vision sera publié sur Canada.ca à la fin de l'année 2024.
Conclusions principales
L'objectif de la surveillance de la santé publique est d'éclairer la prise de décision en matière de santé, en fournissant les informations nécessaires pour fixer les priorités, déterminer les possibilités d'intervention et contrôler les résultats de ces interventions Note de bas de page 1. Un thème récurrent tout au long de la réunion a été la myriade de contraintes auxquelles sont confrontés les praticiens de la santé publique qui cherchent à améliorer les systèmes de surveillance, notamment des obstacles législatifs, humains, culturels, technologiques et financiers. Un participant a suggéré une question pour guider les efforts visant à apporter des améliorations concrètes et durables à la surveillance de la santé publique d'ici à 2030 :
« Cela aide-t-il à la prise de décision? »
En d'autres termes, comment les informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance de la santé publique permettront-elles de prendre des mesures pour améliorer la vie des résidents du Canada? Les participants ont fait part de leur expérience des défis auxquels est confrontée la surveillance de la santé publique et de leurs suggestions quant aux mesures qui pourraient être prises pour l'améliorer. Ces idées sont résumées ci-dessous en sept thèmes.
De nouvelles technologies pour améliorer les flux de travail de surveillance
Défis
Les flux de travail de la surveillance de la santé publique contiennent de nombreux éléments fastidieux et répétitifs. Comment pouvons-nous utiliser les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA) pour aider à rationaliser et automatiser ces flux de travail, libérant ainsi le personnel de santé publique pour le travail d'analyse et d'interprétation nécessaire à la production d'informations exploitables? En outre, les sources de « mégadonnées »Note de bas de page i, telles que l'« échappement numérique »Note de bas de page ii de nos vies de plus en plus informatisées, offrent des pistes potentiellement intéressantes pour la compréhension de la santé publique. Cependant, la croissance exponentielle de ces sources de données les rend impossibles à trier à la main et nécessite des outils avancés pour en extraire des informations utiles.
Mesures possibles
« Automatiser autant que possible pour préserver les ressources humaines précieuses pour l'interprétation »
Les participants ont noté que la clé d'un déploiement réussi de l'IA était de travailler avec les praticiens de la santé publique pour identifier les cas d'utilisation de ces outils afin d'éliminer les problèmes dans leurs flux de travail. L'ASPC doit consulter ses partenaires des services de santé publique locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux afin d'identifier les meilleures propositions de valeur pour l'automatisation de leurs processus de surveillance. Un participant a donné des exemples d'utilisation de l'IA pour l'automatisation dans le cadre clinique, y compris les notes de congé et le travail administratif. La marge de manœuvre des outils d'IA clinique est restreinte : ils sont supervisés et leurs résultats sont contrôlés. Il a également été suggéré de concentrer l'automatisation sur les systèmes clés existants qui soutiennent plusieurs domaines, tels que le système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.
Les progrès de l'apprentissage automatique et de l'IA permettent également aux praticiens de la santé publique d'extraire des pépites d'informations exploitables à partir de sources de « mégadonnées » bruyantes. Plusieurs exemples ont été proposés. Cette technologie est utilisée depuis longtemps pour la détection précoce des maladies grâce à l'analyse automatisée de grands volumes de données textuelles libres, telles que les médias sociaux et les rapports d'actualité Note de bas de page 2. Par exemple, HealthMap analyse les flux d'informations publiés sur Internet pour identifier et géolocaliser les épidémies correspondant à un dictionnaire d'agents pathogènes et de syndromes connus. Les grands modèles de langage (GML), tels que ChatGPT, ont également été utilisés pour accélérer le processus d'interrogation et d'extraction d'informations à partir de grands ensembles de données. Un exemple a été présenté de l'utilisation d'un GML pour interroger, en langage clair, un ensemble de données sur les épidémies de maladies infectieuses géré par la plateforme Global.health Note de bas de page 3. Parmi les exemples de requêtes, citons « afficher un graphique des éclosions de grippe par année » et « afficher une carte des éclosions de choléra ». En ce qui concerne le déploiement de modèles d'IA pour des ensembles de données sensibles liées à la santé, la gouvernance locale des données peut être maintenue en demandant à chaque organisation de déployer sa propre instance de ces outils dans un environnement de serveur sécurisé conforme aux lois locales sur la confidentialité des données de santé. Un autre cas d'utilisation de l'IA est la prise en charge d'une analyse avancée impliquant de nombreux flux de données. Une étude de cas a été présentée sur l'utilisation de l'IA dans la modélisation des capacités à l'Hôpital pour enfants de Boston. Ce système a été utilisé pour prévoir les hospitalisations et la demande de lits pour la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial en incorporant plusieurs types de données, y compris des facteurs environnementaux tels que le pollen et les incendies de forêt.
Outre les applications potentiellement utiles de l'IA pour la surveillance de la santé publique, plusieurs participants ont mis en garde contre le fait que ces nouvelles technologies pourraient être utilisées pour stimuler la création et l'amplification de la désinformation. L'IA est une arme à double tranchant : elle peut présenter des informations incorrectes avec une fausse confiance, elle est susceptible d'être biaisée, elle peut ingérer des données peu fiables et elle soulève des questions difficiles en matière de protection des renseignements personnels, y compris des considérations d'ordre juridique. Pour tirer pleinement parti de ces technologies émergentes, le personnel de santé publique doit comprendre des personnes ayant la formation et l'expérience nécessaires pour en apprécier la complexité et les pièges potentiels. Les possibilités de formation, ainsi qu'un plan d'embauche et de maintien en poste de personnel possédant des compétences spécialisées, seront essentiels pour faciliter cette transition technologique.
Des données de haute qualité pour soutenir les populations cibles
Défis
Un autre participant a proposé une autre perspective sur le déluge de données collectées à l'ère numérique, en citant le « paradoxe des mégadonnées », qui stipule que plus les données sont importantes, plus nous sommes sûrs de nous tromper nous-mêmes Note de bas de page 4. Ce participant a fait remarquer que si les mégadonnées peuvent être utiles pour la surveillance fondée sur les événementsNote de bas de page iii, il est beaucoup plus difficile de les utiliser pour des problèmes basés sur la population, comme la conception d'un programme de prévention du tabagisme. Un exemple a été donné de la plateforme d'enquête Delphi-Facebook qui a largement surestimé la couverture de la première dose du vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis au cours du premier semestre 2021 par rapport aux références ultérieures des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis Note de bas de page 5. La plateforme d'enquête a permis d'accéder facilement à des estimations opportunes avec des échantillons de grande taille et des marges d'erreur minimes. En d'autres termes, les estimations « mégadonnées » étaient précises, mais inexactes. Le problème vient du fait que les personnes qui ont répondu aux enquêtes étaient très différentes de la population en général, et que ces biais n'ont pas été suffisamment pris en compte par des ajustements statistiques a posteriori.
Mesures possibles
Un participant a présenté le paradigme de la « santé publique à données lentes » pour remettre en question l'idée selon laquelle les problèmes de santé publique pourraient être résolus en acquérant simplement davantage de données Note de bas de page 6. Le terme « infodémie » Note de bas de page iv a été utilisé pour décrire les innombrables flux de données qui sont filtrés par de nombreux acteurs, créant un flot d'informations de qualité inconnue utilisées pour éclairer la prise de décision lors d'une crise de santé publique Note de bas de page 7, Note de bas de page 8.
En revanche, le processus classique de surveillance de la santé publique consiste à identifier un problème au sein d'une population cible, à sélectionner un outil permettant de collecter une quantité limitée de données auprès de cette population et, enfin, à utiliser cet ensemble de données sur mesure pour résoudre le problème. Le problème des « mégadonnées », a expliqué un participant, est qu'elles sont généralement collectées pour un objectif sans rapport avec la question posée, que la population cible est souvent fluide et vaguement définie, et que les données collectées sont de mauvaise qualité et manquent de standardisation. La solution proposée consistait à adopter une approche commençant par l'identification des informations nécessaires pour évaluer et améliorer la santé d'une population cible au sein du système de systèmes pour la prise de décision en matière de santé. Ensuite, des données de haute qualité doivent être collectées auprès d'une population cible bien définie et être utilisées pour créer une analyse reproductible. Enfin, les informations obtenues doivent être diffusées efficacement, conformément aux exigences prédéfinies en matière d'information, à ceux qui peuvent les utiliser pour éclairer la prise de décision. Le but de cette « santé publique à données lentes » n'est pas de rendre l'acquisition de données de surveillance moins opportune, mais plutôt de se concentrer, de délibérer et d'être efficace dans la collecte de données qui peuvent réellement être utilisées pour informer l'action de santé publique dans une population cible spécifique.
Les participants ont convenu que les mégadonnées et l'IA avaient des limites importantes et que leur application correcte dépendait de la question précise à traiter. Plus tard, au cours de la discussion générale, un participant a évoqué une menace importante pour la collecte active de données dans le domaine de la santé publique :
« La nécessité d'intégrer d'autres solutions aux enquêtes de population dont les taux de réponse deviennent alarmants n'est pas abordée. »
Les solutions potentielles à ce problème constitueraient un sujet de discussion fructueux pour les experts en matière de conception et de mise en œuvre d'enquêtes.
Amélioration du partage et du couplage des données
Défis
Un autre point de vue dominant concernant l'acquisition de données pour la surveillance de la santé publique est que, dans de nombreux cas, les données requises existent déjà. Le problème est de faire parvenir les données pertinentes aux personnes qui en ont besoin pour prendre des décisions. Ce problème fondamental découle du fait que la surveillance de la santé publique n'est pas un système, mais un ensemble de systèmes. Si les participants ont mentionné des obstacles liés à la technologie et aux ressources, les barrières culturelles, humaines et juridiques ont également fait l'objet de discussions approfondies. L'existence de « silos de données » – entre les différents ordres de gouvernement ainsi qu'au sein des différentes équipes d'un même ordre – a été une critique souvent répétée. Le fait que de nombreuses organisations se soient appuyées sur des ensembles de données non officiels pendant la pandémie, tels que ceux fournis par le Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins et le Groupe de travail sur les données ouvertes de la COVID-19 au Canada, est symptomatique des problèmes liés à la gouvernance des données dans le cadre de la surveillance de la santé publique. Ensemble, ces obstacles font qu'il est difficile pour les décideurs en matière de santé publique d'accéder aux informations dont ils ont besoin et d'améliorer les données dont ils disposent déjà en les reliant à d'autres ensembles de données connexes.
Mesures possibles
Un participant a fourni un point de départ utile pour ce thème : recadrer la surveillance de la santé publique non pas comme une hiérarchie de rapports avec des informations remontant de l'ordre local à l'ordre provincial et enfin à l'ordre fédéral, mais plutôt comme un réseau. Le partage des données doit être bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il doit se faire aussi bien vers le bas que vers le haut.
« Les gens pensent à une hiérarchie de rapports; réfléchissez plutôt à la personne la mieux placée pour collecter, partager et rapporter les données. »
Les participants ont suggéré que des organismes fédéraux comme Statistique Canada et l'ASPC se coordonnent pour mener des enquêtes nationales auprès de la population dont les résultats seraient utiles aux organismes de santé publique locaux et provinciaux. Un exemple a été donné de l'étude « Real-time Assessment of Community Transmission » (REACT) au Royaume-Uni. Cette étude, réalisée pour le compte du gouvernement du Royaume-Uni, a produit des estimations rigoureuses et longitudinales de la prévalence de la COVID-19 au Royaume-Uni pendant toute la durée de la pandémie Note de bas de page 9.
Un autre participant a fait remarquer que les acteurs locaux n'apprécient guère les systèmes de surveillance imposés d'en haut si ces systèmes ne les aident pas à obtenir les informations dont ils ont besoin. Une autre considération concernant la surveillance de la santé publique est la viabilité des méthodes et des sources de données dans des contextes géographiques différents, tels que les zones rurales ou les territoires nordiques (« au nord du 60e parallèle »). Les tests au point d'intervention et l'analyse des eaux usées ont été cités comme deux méthodologies ayant permis de renforcer la surveillance de la COVID-19 dans le Nord au cours de la pandémie. La surveillance des eaux usées, en plus d'être facile à mettre en place par les territoires et les municipalités de manière indépendante pour obtenir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions au niveau local, a été présentée comme une réussite en matière de partage de données et de collaboration au niveau national et international pendant la pandémie.
Le manque de normalisation est un problème technique omniprésent dans le partage et la mise en relation des données, ce qui rend l'interopérabilité des données difficile, même si l'objectif du partage est convenu. Les normes communes sont un élément clé de la Charte pancanadienne des données sur la santé Note de bas de page 10. Cela permettrait d'utiliser des méthodes analytiques communes pour produire des résultats comparables à partir de sources de données fédérées au niveau provincial et d'améliorer la collaboration entre les autorités de santé publique dans l'ensemble du pays. Un participant a mentionné le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP) comme exemple d'effort de normalisation des données des dossiers médicaux électroniques (DME) selon un schéma commun pour soutenir la recherche, la surveillance et l'amélioration de la qualité Note de bas de page 11. L'accès à un plus grand nombre de données facilite à la fois la surveillance de la population et la recherche médicale, mais un participant a averti que les déductions peuvent être trompeuses si les données sous-jacentes ne sont pas réellement comparables, citant l'exemple de certaines bases de données de surveillance européennes. Le Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE) aux États-Unis a été cité comme un exemple de groupe utile pour permettre l'interopérabilité, comme l'élaboration de définitions de cas communes. Il a été noté que le CSTE n'avait pas d'équivalent au Canada, et certains participants ont suggéré de rétablir le rôle des épidémiologistes provinciaux/territoriaux aux côtés des comités de coordination nationaux.
« Au niveau national, des barrières législatives sont mises en place. Nous ne pouvons pas partager les données parce que les lois n'autorisent pas le partage des données à travers le Canada. Les discussions pluriannuelles sur les Ententes multilatérales sur l'échange de renseignements (EMER) ne nous ont pas permis d'obtenir les données dont nous avons besoin au niveau provincial. »
La législation peut être un catalyseur essentiel du partage et de l'interconnexion des données, car les questions relatives à la protection des renseignements personnels et à la sécurité des données ne peuvent souvent pas être résolues uniquement par des changements de culture organisationnelle en matière de partage des données. La biosurveillance intégrée au cours de la pandémie de COVID-19 en Corée du Sud a été utilisée comme étude de cas, ce qui a permis de faire plusieurs observations Note de bas de page 12. Tout d'abord, la législation a été considérée comme le fondement de l'autorité, de la responsabilité et de l'obligation de rendre compte des efforts de partage des données. Deuxièmement, la législation doit être spécifique et définir non seulement la disponibilité des données, mais aussi les délais de partage. Enfin, des objectifs clairs et concrets doivent être fixés quant à l'utilisation des données obtenues. Cela inclut une répartition convenue des tâches pour le traitement et l'analyse de la fusion de données qui en résulte, afin de produire des informations utiles et des indicateurs bien définis.
« L'intégration, des données quelles qu'elles soient n'est d'aucune utilité; elle conduit à un système géant et lourd qui est souvent lent, s'il fonctionne. »
Tout effort visant à établir des liens à grande échelle prendra du temps et pourrait porter ses fruits après l'horizon 2030. Un participant a suggéré qu'à court terme, il faudrait donner la priorité à quelques liens clés, afin d'obtenir juste assez de données détaillées et comparables pour éclairer les décisions clés en matière de santé publique. Cette stratégie permettrait également de mettre en place un échafaudage pour les futurs travaux de couplage de données et, espérons-le, de susciter l'intérêt en démontrant les avantages du partage des données. Les participants ont également estimé que le renforcement de la position de l'ASPC sur le partage d'informations entre les différents ordres de gouvernement aiderait le Canada à devenir un meilleur partenaire sur la scène internationale. Le Canada peut et doit être un leader international dans l'échange d'informations transfrontalières afin d'éclairer les priorités sanitaires mondiales telles que la préparation aux pandémies et le développement d'approches fondées sur des données probantes pour les interventions de santé publique telles que les restrictions aux frontières.
Approches communautaires et partenariales pour la surveillance de la santé publique
Défis
Les inégalités sociales en matière de mortalité et de santé sont un problème omniprésent et bien ancré au Canada. Ces dernières années, des données ont montré le poids inégal de la mortalité due à COVID-19 sur les différentes communautés pendant la pandémie Note de bas de page 13. Un participant a fait valoir que la surveillance de la santé publique au Canada pourrait mieux soutenir la tâche consistant à quantifier et à traiter les causes profondes de ces résultats sanitaires disparates. Toutefois, de nombreux ensembles de données détaillées susceptibles d'éclairer ces questions ne sont pas détenus directement par des organisations gouvernementales, mais plutôt par des groupes cliniques et communautaires.
« Les gens sont à la recherche de données plus désagrégées concernant les déterminants sociaux de la santé. Nous ne faisons pas un bon travail de collecte d'informations au niveau individuel. »
Mesures possibles
Dans de nombreux cas, les organisations cliniques, non gouvernementales et autres organisations locales sont celles qui ont les liens les plus étroits avec les individus au sein de la communauté et qui les connaissent le mieux. La qualité et la granularité de la surveillance de la santé publique pourraient être améliorées si les autorités de santé publique formaient des partenariats pour relier les données sur les individus et les ménages dans les systèmes cliniques et communautaires. Un exemple a été donné au cours de la discussion : l'initiative sur les données cliniques et communautaires, mise en œuvre au Colorado et en Caroline du Sud pour soutenir la recherche et les interventions en matière d'obésité et de maladies chroniques Note de bas de page 14. Dans ce modèle, les données de santé longitudinales provenant de diverses sources cliniques et communautaires sont codées de manière sécurisée et partagées avec un tiers de confiance afin de permettre le couplage et l'analyse anonymes des ensembles de données améliorés qui en résultent.
Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les individus et les communautés représentés dans les données désagrégées et individuelles partagées dans le cadre de ces partenariats auront leur mot à dire sur la manière dont elles seront gérées, rapportées et utilisées pour informer l'action de santé publique. Cela doit être fait pour garantir que les informations provenant des systèmes de surveillance profiteront aux populations observées tout en évitant la stigmatisation ou d'autres préjudices potentiels. La gouvernance des données autochtones a été citée comme modèle pour ce processus Note de bas de page 15.
La mobilisation du public et la communication pour instaurer la confiance
Défis
La confiance dans la santé publique et les institutions gouvernementales en général a souffert ces dernières années. La communication sur les questions de santé publique est devenue de plus en plus difficile face à l'assaut de la désinformation. En ce qui concerne la surveillance de la santé publique en particulier, le terme même de « surveillance » peut être problématique, car il peut avoir une signification très différente pour un professionnel de la santé publique et pour un membre du public. D'autres termes tels que « évaluation et réponse de santé publique » sont utilisés dans certaines discussions Note de bas de page 15, Note de bas de page 16. De même, les praticiens de la santé publique ne veulent pas que les activités de surveillance de la santé publique soient perçues comme une ingérence gouvernementale. L'adoption de nouvelles techniques de surveillance de la santé publique ne s'est pas toujours faite sans heurts : L'utilisation par l'ASPC de données relatives à la mobilité pendant la pandémie de COVID-19 a donné lieu à une enquête parlementaire et à une enquête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada Note de bas de page 17.
Mesures possibles
L'adhésion du public est essentielle au bon fonctionnement de la surveillance de la santé publique. Les participants ont déclaré qu'il fallait davantage impliquer le public dans les premières phases, au moins pour qu'il ne soit pas surpris par l'utilisation de l'information pour traiter une question de santé publique donnée. L'engagement du public devrait également être à la base du processus d'identification des questions prioritaires et de la définition des types de questions auxquelles les systèmes de surveillance sont conçus pour répondre. Dans le cas contraire, les autorités de santé publique risquent de gaspiller leurs efforts dans des enquêtes et des interventions peu pertinentes pour les populations qu'elles sont censées servir.
« Je pense que les approches participatives de la surveillance (et en général, les approches écosystémiques de la santé) sont très prometteuses pour améliorer la pertinence et l'utilité des systèmes de surveillance. Cela impliquerait par définition l'engagement de la communauté et des approches transdisciplinaires. »
Un participant a admis que la communication pendant la pandémie de COVID-19 avait parfois été trop confiante, ce qui a suscité la méfiance lorsque l'information a été rétractée. Ne pas communiquer l'incertitude et les limites de nos connaissances peut également conduire à la méfiance. Un autre participant a cité la maîtrise des données par les décideurs comme un obstacle à une bonne communication de la part de la santé publique.
Un participant s'est demandé si nos systèmes de surveillance de la santé publique étaient réellement conçus pour communiquer avec les individus de la manière attendue des médias sociaux (par exemple la rapidité, l'accessibilité, la concision et l'attrait visuel). Le participant s'est demandé si la santé publique devait entrer dans cet espace, et si oui, comment? Il a notamment été suggéré d'examiner attentivement les ressources allouées à la communication dans les budgets de surveillance de la santé publique, étant donné l'importance de la communication pour renforcer la crédibilité et la cohésion autour des objectifs de la santé publique. Un autre a déclaré que la santé publique devrait privilégier le partage des données avec le public et les décideurs, afin d'instaurer la confiance, tout en étant aussi transparente que possible quant à la fiabilité et à la certitude associées aux ensembles de données.
Une autre étape importante consiste à élaborer un plan de communication pour partager des informations sur les problèmes potentiels de santé publique identifiés par la surveillance. Ce plan doit définir les critères de déclenchement d'une communication publique, en tenant compte à la fois du niveau de danger pour le public et du degré de certitude de l'information. Les faux positifs comme les faux négatifs peuvent saper la confiance du public, et donc ces critères doivent être soigneusement étudiés et élaborés avec l'apport de la communauté.
Aligner les activités de surveillance sur les priorités en matière de santé de la population
Une grande partie des discussions de cet EMC a porté sur la surveillance des maladies infectieuses, en particulier la pandémie de COVID-19. Cela est compréhensible, étant donné l'intensité avec laquelle la pandémie a amplifié de nombreux problèmes de longue date dans le domaine de la santé publique. La possibilité d'une pandémie future de l'ampleur de celle de COVID-19 est également une préoccupation importante. Vers la fin de la séance, un participant a partagé un rapport du Center for Global Development qui prévoyait que la probabilité d'un tel événement au cours des 25 prochaines années était « à peu près équivalente à un tirage à pile ou face » Note de bas de page 18.
Toutefois, certains participants ont également souligné la nécessité de réévaluer l'orientation de nos activités de surveillance afin de mettre davantage l'accent sur les maladies chroniques et d'autres problèmes de santé publique qui ne sont pas directement liés aux maladies infectieuses. Le Canada est confronté à des crises croissantes liées à la consommation d'opioïdes et à la santé mentale, ainsi qu'à des problèmes de longue date concernant l'accès aux déterminants sociaux les plus fondamentaux de la santé : l'alimentation, l'eau potable et le logement. Notre connaissance croissante de l'importance des maladies non transmissibles pour la santé de la population et de la répartition inégale des déterminants sociaux de la santé devrait s'accompagner d'une attention et de ressources accrues pour le renforcement des capacités de surveillance de la santé publique dans ces domaines.
Passer de la vision à la mise en œuvre
Tout au long de la séance, plusieurs participants ont fait part de leur frustration quant au processus d'amélioration de la surveillance de la santé publique au Canada.
« Si vous aviez cent dollars et que vous pouviez les dépenser pour la mise en œuvre ou l'innovation, où les dépenseriez-vous? […] Nous avons des centaines de rapports, mais nous ne pouvons pas les mettre en œuvre leurs recommandations. Nous disposons des meilleurs cerveaux, mais nous avons besoin des meilleurs réalisateurs. Dans quelle mesure devrions-nous réparer nos systèmes actuels? »
Un exemple précis a été donné concernant le recensement canadien, « la base de données la plus importante ». Les modèles de santé publique pourraient être rendus représentatifs si les données de recensement étaient mieux intégrées et s'il était possible de rassembler les données nécessaires pour effectuer les ajustements, mais cela n'est souvent pas possible. Une possibilité de mesure découlant de cette observation pourrait être la création d'un portail rendant les données existantes détenues par le gouvernement fédéral plus accessibles afin de soutenir les efforts de surveillance à travers le pays.
Bien que la rencontre de l'EMC ait rassemblé de nombreux participants disposant d'une expertise technique, un participant a suggéré qu'un « échange des meilleurs réalisateurs » serait également utile. Un autre participant a noté l'absence de législateurs à la réunion, compte tenu notamment de l'importance accordée à la législation en tant que facilitateur du partage des données au cours de la discussion. Les considérations juridiques et de protection des renseignements personnels ont été évoquées comme un obstacle au partage des données avec les collègues fédéraux et à une collaboration plus étroite avec les partenaires communautaires tels que les groupes autochtones. Les avocats et les experts juridiques doivent également être associés à ces partenariats pour qu'ils soient couronnés de succès et que les accords de partage de données soient satisfaisants pour toutes les parties concernées. Les participants ont souligné que nous devons nous concentrer non seulement sur les solutions techniques proposées par les personnes concernées par les exigences en matière de données, mais aussi sur les stratégies politiques visant à établir des relations entre les intervenants.
Conclusion
Le système de santé publique au Canada a été mis à l'épreuve par une série de défis critiques, notamment la pandémie de COVID-19 et la crise continue des opioïdes. Un renouvellement du système de surveillance de la santé publique du pays est nécessaire pour détecter et diagnostiquer les problèmes, concevoir et évaluer les interventions destinées à les résoudre et progresser dans la lutte contre les inégalités en matière de santé.
Cette discussion avec les intervenants clés a permis d'identifier un grand nombre de défis importants et d'idées de mesures. L'ASPC remercie les participants à cette rencontre de l'EMC pour le temps qu'ils ont consacré à partager leurs réflexions et leurs expériences sur l'amélioration du système de surveillance de la santé publique au Canada. Les principaux thèmes et exemples soulevés au cours de la discussion et synthétisés dans ce rapport seront analysés et pris en compte parallèlement aux résultats des consultations de l'ASPC avec les parties prenantes internes et externes de la santé publique, les peuples et communautés autochtones et les membres du public. Collectivement, ces résultats guideront la création d'une vision fondée et ciblée pour la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030. Le rapport final sur la Vision 2030 sera publié à la fin 2024.
Annexe A : Liste des présentateurs et animateurs de l'échange Meilleurs Cerveaux
Oratrice principale
Theresa Tam
Administratrice en chef de la santé publique du Canada, Agence de la santé publique du Canada
Présentateurs
Steven Hoffman
Vice-président, Direction des données, de la surveillance et de la prospective, Agence de la santé publique du Canada et titulaire de la chaire distinguée Dahdaleh en gouvernance mondiale et épidémiologie juridique/professeur de santé mondiale, de droit et de science politique, Université York
David Buckeridge
Directeur scientifique exécutif, Direction générale des données, de la surveillance et de la prospective, Agence de la santé publique du Canada, Université McGill
Sangwoo Tak
Directeur de l'évaluation des risques, Bureau de la réponse et de la préparation aux situations urgentes de santé publique de l'agence de contrôle et de prévention des maladies de la Corée.
Arnaud Chiolero
Médecin de santé publique et épidémiologiste, responsable du Laboratoire de santé des populations, Université de Fribourg
John Brownstein
Dirigeant principal de l'innovation, Hôpital pour enfants de Boston et professeur, école de médecine de l'Université Harvard
Samuel Groseclose
Expert-conseil en santé publique, Decatur (Georgia), États-Unis
Kelley Lee
Professeur et chaire de recherche du Canada de niveau 1 en gouvernance de la santé dans le monde, Faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser
Animateur
Cory Neudorf
Expert en médecine principal, Agence de la santé publique du Canada et professeur au département de santé communautaire et d'épidémiologie, Collège de médecine, Université de la Saskatchewan
Annexe B : Ordre du jour de l'échange Meilleurs Cerveaux
Échange Meilleurs Cerveaux : Une vision pour l'avenir de la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030
Mardi 21 novembre 2023 / 10 h à 14 h 30 HNE
But et objectifs de la réunion
Cet échange Meilleurs Cerveaux (EMC) vise à réunir des experts nationaux et internationaux de la surveillance appliquée de la santé publique et des décideurs politiques principaux afin de contribuer à une vision renouvelée de la surveillance de la santé publique au Canada fondée sur des données probantes et orientée vers le public. Pour ce faire, les objectifs suivants seront poursuivis :
- Déterminer les questions nouvelles et actuelles hautement prioritaires qui nécessiteront une surveillance de la santé publique;
- Caractériser le type et la quantité d'informations de santé publique nécessaires à la surveillance de la santé publique pour orienter la politique et l'action en matière de santé publique;
- Discuter des modèles internationaux de gouvernance, des structures organisationnelles et des politiques qui permettent la surveillance de la santé publique, y compris le partage d'informations avec les parties prenantes en vue d'une action de santé publique;
- Déterminer les aptitudes et compétences clés en matière de surveillance de la santé publique pour le futur personnel de santé publique.
Programmation
- Inscription (9 h 45 à 10 h)
- Remarques préliminaires (10 h à 10 h 20)
- Bienvenue de la part de l'animateur de l'EMC et des hôtes
- Reconnaissance des terres
- Format/orientation technique (gestion interne)
- Tour de table d'introduction
- Aperçu des objectifs de l'EMC
- Intervenant(e) : Cory Neudorf
- Mot d'ordre : Le contexte politique (10 h 20 à 10 h 30)
- Intervenant(e) : Theresa Tam
- Présentation de mise en scène : Pourquoi sommes-nous ici? (10 h 30 à 10 h 40)
- Intervenants : Steven Hoffman, David Buckeridge
- Panel : Modèles internationaux et mobilisation des intervenants pour la surveillance de la santé publique (10 h 40 à 11 h 40)
- Intervenants : Sangwoo Tak, Arnaud Chiolero, John Brownstein
- Pause dîner (11 h 40 à 12 h 30)
- Panel : Approches et partenariats innovants pour faire progresser la surveillance de la santé publique (12 h 30 à 13 h 30)
- Intervenants : Samuel Groseclose, Kelley Lee
- Période de discussion : Questions prioritaires et mesures à court et à long terme pour la surveillance de la santé publique au Canada d'ici 2030 (13 h 30 à 14 h 15)
- Évaluation de l'EMC (14 h 15 à 14 h 20)
- Remarques finales et fin de la séance (14 h 20 à 14 h 30)
- Intervenant(e) : Cory Neudorf
Références
- Note de bas de page 1
-
Chiolero, A. and D. Buckeridge, Glossary for public health surveillance in the age of data science. J Epidemiol Community Health, 2020. 74(7): p. 612-616 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 2
-
Brownstein, J.S., et al., Advances in Artificial Intelligence for Infectious-Disease Surveillance. N Engl J Med, 2023. 388(17): p. 1597-1607 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 3
-
Benjamin, A., et al., Global.health: a scalable plaform for pandemic data integration, analytics, and preparedness. Research Square, 2022 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 4
-
Meng, X.-L., Statistical paradises and paradoxes in big data (I): Law of large populations, big data paradox, and the 2016 US presidential election. The Annals of Applied Statistics, 2018. 12(2) (en anglais seulement).
- Note de bas de page 5
-
Bradley, V.C., et al., Unrepresentative big surveys significantly overestimated US vaccine uptake. Nature, 2021. 600(7890): p. 695-700 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 6
-
Chiolero, A., S. Tancredi, and J.P.A. Ioannidis, Slow data public health. Eur J Epidemiol, 2023. 38(12): p. 1219-1225 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 7
-
Briand, S.C., et al., Infodemics: A new challenge for public health. Cell, 2021. 184(25): p. 6010-6014 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 8
-
Chiolero, A., How infodemic intoxicates public health surveillance: from a big to a slow data culture. J Epidemiol Community Health, 2022. 76(6): p. 623-625 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 9
-
Imperial College London. Real-time Assessment of Community Transmission (REACT) Study: Frequently asked questions. 2024; Disponible sur : https://www.imperial.ac.uk/medicine/research-and-impact/groups/react-study/faqs/ (en anglais seulement).
- Note de bas de page 10
-
Santé Canada. Charte pancanadienne des données sur la santé. 2023; Disponible sur : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/transparence/ententes-en-matiere-de-sante/priorites-partagees-matiere-sante/accords-bilateraux-travailler-ensemble/charte-pancanadienne-donnees.html.
- Note de bas de page 11
-
Morkem, R., et al., CPCSSN Data Quality: An Opportunity for Enhancing Canadian Primary Care Data. 2023, Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network: Kingston, ON (en anglais seulement).
- Note de bas de page 12
-
Kang, H., S. Tak, and S.J. Kang, Required Elements for an Integrated Biosurveillance Platform: A Capacity and Needs Assessment of the Central Government in the Republic of Korea. Health Secur, 2023. 21(2): p. 95-104 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 13
-
Agence de la santé publique du Canada. Inégalités sociales dans les décès attribuables à la COVID-19 au Canada. 2022; Disponible sur : https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/inegalites-deces/rapport-technique.html.
- Note de bas de page 14
-
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (U.S.) Division of Nutrition, P.A., and Obesity. Clinical & Community Data Initiative. 2021; Disponible sur : https://stacks.cdc.gov/view/cdc/112844 (en anglais seulement).
- Note de bas de page 15
-
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 2021; Disponible sur : https://www.ccnsa.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/10351/RPT-Visioning-the-Future_FR_2021-12-07-web.pdf.
- Note de bas de page 16
-
Agence de la santé publique du Canada. Vision 2030 : L'avenir de l'évaluation de la santé publique au Canada. 2023; Disponible sur : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/pratique-sante-publique/surveillance/vision-2030-avenir-surveillance-sante-publique-canada.html.
- Note de bas de page 17
-
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Enquête sur la collecte et l'utilisation de données dépersonnalisées sur la mobilité dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 2023; Disponible sur : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-institutions-federales/2022-23/pa_20230529_aspc/.
- Note de bas de page 18
-
Madhav, N.K., et al. Estimated Future Mortality from Pathogens of Epidemic and Pandemic Potential. 2023; Disponible sur : https://www.cgdev.org/sites/default/files/estimated-future-mortality-pathogens-epidemic-and-pandemic-potential.pdf (en anglais seulement).
Notes de fin de page
- Note de bas de page 19
-
Mégadonnées : Très grands ensembles de données caractérisés par leur volume (taille), leur vélocité (vitesse à laquelle les données sont créées et collectées) et leur variété (grande variété de sources et de formats, souvent non-structurés ou semi-structurés, par exemple des messages sur les médias sociaux, des notes cliniques et des images satellites)
- Note de bas de page 20
-
Échappement numérique : La grande quantité et la variété des données créées par les interactions avec les systèmes en ligne ou informatisés
- Note de bas de page 21
-
Surveillance fondée sur les événements : Détection d'événements susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, généralement par l'analyse de sources d'information non structurées et ad hoc, telles que les médias d'information et les médias sociaux
- Note de bas de page 22
-
Infodémie : Une « épidémie d'information », en particulier lors d'une crise sanitaire, définie par une surabondance d'informations, y compris d'informations erronées, disponibles en temps réel à partir de nombreuses sources