Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs
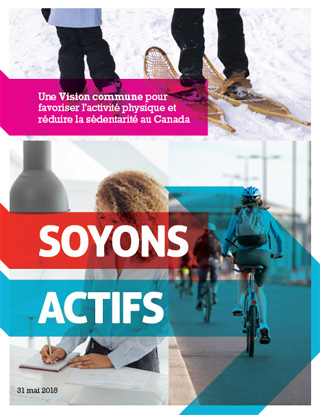
Télécharger le format de rechange
(Format PDF, 29.2Mo, 54 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
ISBN : 978-0-660-08861-7
Publiée : 2018-05-31
Afin d'appuyer les efforts multisectoriels en cours dans le but d'aider les Canadiens et les Canadiennes à s'asseoir moins et bouger plus, le Comité fédéral, provincial et territorial de l'activité physique et des loisirs a identifié ces champions :
- Normes culturelles – Bruce (Spider) Jones, Sport North Federation
- Environnements physiques – Christa Costas-Bradstreet et CJ Noble, Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)
- Mobilisation du public – Diana Dampier et Ken Zolotar, ParticipACTION
- Partenariats – Margo Greenwood, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA)
- Leadership et formation – À déterminer
- Progression – Christine Cameron et John C. Spence, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie (ICRCP)
Table des matières
- Résumé
- Introduction
- Méthodologie
- Première partie : Le contexte – Activité physique et sédentarité au Canada
- Deuxième partie : Le fondement – Activité physique pour tous
- Troisième partie : Les possibilités – Domaines prioritaires
- Quatrième partie : La voie de l’avenir – Progresser ensemble
- Références
Résumé
La Vision commune : un Canada où toute la population s’assoit moins et bouge plus.
Être physiquement actif est essentiel pour bénéficier d’une bonne santé globale et prévenir les maladies chroniques. Or, le niveau d’inactivité physique et de sédentarité observé chez les Canadiens et les Canadiennes représente un problème crucial au Canada.
Le Canada n’a encore jamais accordé une attention stratégique particulière à l’activité physique et à sa relation avec le sport, le loisir, la santé et d’autres domaines d’intérêt public. La Vision commune représente une nouvelle voie collective qui guidera le pays vers des stratégies permettant d’accroître l’activité physique et de réduire la sédentarité. Il s’agit d’un document de politique nationale qui vise à faire bouger le paysNote de bas de page *.
Éclairée et inspirée par les points de vue autochtones et les commentaires de nombreux organismes et dirigeants, la Vision commune s’adresse à tous ceux et celles qui ont à cœur de promouvoir l’activité physique et de réduire la sédentarité au Canada. Pour réaliser des progrès, nous devons tous ensemble adopter des mesures audacieuses.
La Vision commune complète d’autres politiques, stratégies et cadres pertinents, tout en s’harmonisant avec ceux-ci.
Fondement : l’activité physique pour tous
La Vision commune se fonde sur cinq principes interdépendants essentiels à l’augmentation du niveau d’activité physique et à la réduction de la sédentarité : la littératie physique, le parcours de vie, une démarche populationnelle, la prise de décisions fondées sur des données probantes et émergentes, et les motivations.
Possibilités : les domaines prioritaires
La Vision commune englobe un ensemble complet de six domaines prioritaires d’action concertée : les normes culturelles, les environnements physiques, la mobilisation du public, les partenariats, le leadership et la formation, et la progression. Ces domaines prioritaires ont été identifiés dans le cadre d’un processus national global de consultation et de mobilisation. Chaque domaine prioritaire implique des impératifs stratégiques permettant d’en orienter la planification et la mise en œuvre. Ces impératifs stratégiques nécessitent un travail de collaboration et sont définis de façon à aider à façonner une perspective collective en matière de planification, de priorités et de programmes dans l’ensemble du Canada.
En avant tous ensemble
Ce n’est que grâce à la coordination et à la collaboration entre les secteurs concernés et les paliers de gouvernement que le niveau d’activité physique pourra augmenter et la sédentarité diminuer dans l’ensemble de la population. En travaillant à la mise en œuvre d’une Vision commune et en partageant ses résultats, on pourra réaliser ensemble des percées importantes et faire des progrès substantiels.
Le leadership joue un rôle crucial pour faire en sorte que la population canadienne s’assoie moins et bouge plus. Tous les gouvernements peuvent contribuer à développer, coordonner et rassembler des partenariats. Les ministères et les organismes gouvernementaux responsables des politiques dans les domaines concernés, notamment ceux du sport, du loisir, de la santé, des infrastructures, de la culture, du patrimoine, du transport et de l’éducation, peuvent jouer un rôle essentiel dans les conditions de succès. En outre, la Vision commune peut servir à répondre aux appels à l’action pertinents du rapport Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). À cette fin, la Vision commune définit ce que les organismes, les collectivités, les dirigeants et les gouvernements peuvent accomplir ensemble, y compris les responsabilités du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre d’activités bien précises.
Ce que les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent
Promouvoir, partager et utiliser la Vision commune, soit seuls, soit en partenariat.
Ce que les gouvernements peuvent faire
Développer, coordonner et rassembler des organismes, des collectivités et des dirigeants dans tous les domaines stratégiques pertinents.
Ce que les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent faire ensemble
AGIR de manière responsable, coordonnée, collaborative et transparente afin de favoriser une action concertée inspirée par la Vision commune.
Soyons actifs!
Introduction
Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs est le premier appel à l’action de ce genre jamais lancé au Canada.
Le Canada n’a encore jamais accordé une attention stratégique particulière à l’activité physique et à sa relation avec le sport, le loisir, la santé et d’autres domaines d’intérêt public. Qui plus est, le présent document aborde la question cruciale de la sédentarité. La Vision commune représente une nouvelle voie collective qui guidera notre pays vers des stratégies permettant d’accroître l’activité physique et de réduire la sédentarité au Canada. Il s’agit d’un document de politique nationale qui vise à faire bouger le pays.
La Vision commune : un Canada où toute la population s’assoit moins et bouge plus
La Vision commune reconnaît que les conditions de santé et de mobilité affectent une grande variété de gestes physiques. Or, tout geste peut contribuer au bien-être physique, émotionnel et culturel.
La présente Vision commune répond à un appel du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux à élaborer un cadre pancanadien sur l’activité physique. Elle a bénéficié des connaissances et des idées stimulantes de nombreux organismes et dirigeants ayant à cœur d’améliorer l’ensemble des conditions et d’examiner les nombreux facteurs interreliés qui influent sur l’activité physique et la sédentarité au Canada.
La Vision commune affirme l’impossibilité pour un seul groupe, organisme ou palier de gouvernement de réaliser des progrès à lui seul, ainsi que la nécessité d’adopter collectivement de nouvelles mesures audacieuses. L’incitation et le soutien à l’activité physique, tout comme la réduction de la sédentarité sont des questions complexes qui exigent des responsabilités partagées et des actions concertées. Le système de facteurs interreliés qui contribuent à la hausse des taux d’inactivité physique et de sédentarité est en effet complexe : des facteurs biologiques, comportementaux, sociaux, psychologiques, technologiques, environnementaux, économiques et culturels interviennent à tous les niveaux, de l’individu à la famille, et à la société dans son ensembleNote de bas de page 1.
À l’instar des maladies chroniques qui découlent de comportements malsains, ce système complexe l’est encore plus en raison d’une grande diversité de décisions politiques dans plusieurs secteurs qui influent sur les comportements en question. Par exemple, le rapport Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la commission de vérité et réconciliation du Canada (2015)Note de bas de page 2 décrit les obstacles systémiques pour les peuples autochtones au Canada. Les effets persistants de la période des pensionnats obligatoires et d’autres politiques du gouvernementNote de bas de page 3 ont empêché des personnes, des familles et des collectivités autochtones de participer à des activités physiques saines. Il faudra du temps et des efforts concertés pour que la population canadienne s’assoie moins et bouge plus.
Cela signifie que tous les organismes, toutes les collectivités et tous les leaders qui ont à cœur de promouvoir et soutenir l’activité physique sous toutes ses formes au Canada ont un rôle à jouer, au niveau tant local que national. La mise en œuvre de la Vision commune exige des plans d’action interdépendants élaborés par les gouvernements de manière collective et individuelle, bilatérale et multilatérale, ainsi que par des organismes non gouvernementaux et des leaders.
La Vision commune englobe un ensemble complet de six domaines prioritaires d’action concertée : les normes culturelles, les environnements, la mobilisation du public, les partenariats, le leadership et la formation, et la progression. Ces domaines prioritaires ont été identifiés dans le cadre d’un processus national global de consultation et de mobilisation. Chaque domaine prioritaire implique des impératifs stratégiques permettant d’en orienter la planification et la mise en œuvre. Ces impératifs stratégiques, décrits dans la Troisième Partie : Les possibilités, nécessitent une attention concertée afin de façonner une perspective collective en matière de planification, de priorités et de programmes dans l’ensemble du Canada.
Plus précisément, les impératifs stratégiques concernent tous les organismes, toutes les collectivités et tous les dirigeants. Par exemple, les professionnels en loisir municipal peuvent collaborer avec les urbanistes pour créer des environnements favorables, les dirigeants d’organismes sans but lucratif peuvent mettre à profit la technologie pour stimuler la mobilisation du public, les responsables des politiques du gouvernement peuvent travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour susciter conjointement des possibilités d’activité physique pertinentes sur le plan culturel, les dirigeants d’entreprises peuvent contribuer à l’établissement de nouvelles normes culturelles en réduisant les comportements sédentaires sur les lieux de travail, les établissements d’enseignement postsecondaires peuvent contribuer à développer le leadership et la formation, et les bénévoles locaux qui partagent efforts et résultats peuvent contribuer à mesurer les progrès.
Ce n’est que grâce à la coordination et à la collaboration entre les secteurs et les paliers de gouvernement que le niveau d’activité physique pourra augmenter et la sédentarité diminuer dans l’ensemble de la population. En travaillant à la mise en œuvre d’une Vision commune et en partageant des résultats, on pourra réaliser ensemble des percées importantes et faire des progrès substantiels.
Le leadership joue un rôle crucial pour faire en sorte que la population canadienne s’assoie moins et bouge plus. Tous les gouvernements peuvent contribuer à développer, coordonner et rassembler des partenariats. Les ministères et les organismes gouvernementaux responsables des politiques dans les domaines concernés, notamment ceux du sport, du loisir, de la santé, des infrastructures, de la culture, du patrimoine, du transport et de l’éducation, peuvent jouer un rôle essentiel dans les conditions de succès. À cette fin, la Vision commune définit ce que les organismes, les collectivités, les dirigeants et les gouvernements peuvent accomplir ensemble. La Quatrième partie : La voie de l’avenir décrit également les responsabilités que devront assumer le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre d’activités bien précises.
La Vision commune peut aussi contribuer à la réalisation des objectifs des politiques, stratégies et cadres nationaux, fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de sport, d’activité physique, de loisir et de santé, notamment la Politique canadienne du sport 2012Note de bas de page 4 , le Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada : Sur la voie du bien-êtreNote de bas de page 5 , Canada actif 20/20 : une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada (2012)Note de bas de page 6, Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé (2010)Note de bas de page 7, la Politique de Sport Canada sur la participation des Autochtones au sport (2005)Note de bas de page 8, la Politique sur le sport pour les personnes ayant un handicap (2006)Note de bas de page 9 et Mobilisation active : Politique concernant le sport pour les femmes et les filles (2009)Note de bas de page 10. De plus, la Vision commune est alimentée par les appels à l’action pertinents du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015).
La Vision commune n’est pas destinée à remplacer ou à dédoubler ces efforts. Elle a plutôt pour objectif de les harmoniser, de les amplifier et de les promouvoir davantage. Elle s’appuie sur les éléments de convergence déjà relevés dans plusieurs de ces initiatives : l’adoption d’une démarche fondée sur le parcours de vie, l’amélioration de l’accès, de l’équité et de la diversité, le soutien à la littératie physique, l’incitation au jeu, l’aménagement d’équipements communautaires, le développement du bénévolat et la progression.
La Vision commune est divisée en quatre parties :
- Première partie : Le contexte – Activité physique et sédentarité au Canada
- Deuxième partie : Le fondement – Activité physique pour tous
- Troisième partie : Les possibilités – Domaines prioritaires
- Quatrième partie : La voie de l’avenir – Progresser ensemble
Les gouvernements, les collectivités, les organismes et les dirigeants peuvent unir leurs efforts pour favoriser un leadership partagé en vue de promouvoir une nouvelle ère de vie active et de vitalité qui favorisera l’activité physique sous toutes ses formes et réduira le temps d’inactivité. La seule façon de contribuer à faire avancer le pays vers un avenir plus sain, plus heureux et plus actif est d’aider la population canadienne à s’asseoir moins et à bouger plus.
Soyons actifs!
Miser sur nos points forts
Le Canada peut s’appuyer sur ses vastes connaissances et son savoir-faire, ainsi que sur les expériences et l’expertise d’autres pays et organismes internationaux afin de faire progresser le pays. La Vision commune s’inspire des principes, des méthodes éprouvées et des acquis tirés d’autres cadres, stratégies et rapports pertinents sur le sport, l’activité physique, le loisir et la santé.
Activité physique, sport et loisir
- Directives canadiennes en matière d’activité physique (2011), Directives canadiennes en matière d’activité physique et en matière de comportement sédentaire à l’intention des enfants et des jeunes (2011), Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures à l’intention des enfants et des jeunes (2016) et Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants (2017)
- Canada actif 20/20 : Une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada (2012)
- Politique canadienne du sport (2012)
- Déclaration de consensus sur le jeu actif à l’extérieur (2015)
- Déclaration de consensus canadien sur la littératie physique (2016)
- Cadre stratégique pour les loisirs au Canada de 2015 : Sur la voie du bien-être
- Au Canada, le sport c’est pour la vie – Développement à long terme de l’athlète 2.1 (2016)
- Éclairer l’avenir : Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes (2016)
- Plan d’action mondial sur l’activité physique 2018-2030 de l’Organisation mondiale de la Santé (2018)
- Stratégie sur l’activité physique pour la Région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé (2016–2025)
Modes de vie sains et promotion de la santé
- Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé (2010)
- Pour un Canada plus sain : faire de la prévention une priorité, Déclaration sur la prévention et la promotion (2010)
- Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020) de l’Organisation mondiale de la Santé
- Charte de Bangkok pour la promotion de la santé (2016)
Autres documents de référence
- Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant – Traité relatif aux droits de l’homme (1989)
- Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2008)
- Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015)
Figure 1. Une Vision commune qui s’articule avec d’autres politiques, stratégies et cadres pertinents, et les enrichit

Figure 1 - Équivalent du texte
Domaines prioritaires de la Vision commune :
- Normes culturelles
- Environnements physiques
- Mobilisation du public
- Partenariats
- Leadership et formation
- Progression
Points de convergence+ :
- Adoption d’une démarche fondée sur le parcours de vie
- Amélioration de l’accès
- Équité et diversité
- Soutien à la littératie physique
- Incitation au jeu
- Aménagement d’équipements communautaires
- Développement du bénévolat
- Progression
Les points de convergence conduisent aux initiatives suivantes :
- Politique canadienne du sport
- Cadre stratégique pour le loisir au Canada :
- Sur la voie du bien-être – Vie active, intégration et accessibilité; liens entre les gens et la nature; environnements positifs; capacité récréative
- Canada actif 20/20
- Une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada – Démarches complémentaires
- Freiner l’obésité juvénile
- Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé – Environnements propices à un poids santé
Amplification et harmonisation :
- Activité physique par le sport Environnements propices à un poids santé
- Vie active, intégration et accessibilité; liens entre les gens et la nature; environnements positifs; capacité récréative
- Démarches complémentaires
- Environnements propices à un poids santé
+ Ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs. Vers l’harmonisation : Programme concerté sur les loisirs, le sport et l’activité physique au Canada, 2015.
Méthodologie
Mode d’élaboration de la Vision commune
La Vision commune est destinée à tous les organismes, collectivités et dirigeants, actuels et éventuels, qui ont à cœur de promouvoir l’activité physique et de réduire la sédentarité. De ce fait, elle reflète les idées, les points de vue et les suggestions de diverses personnes qui jouent un rôle clé dans la promotion de l’activité physique et la réduction de la sédentarité auprès de l’ensemble de la population canadienne.
L’élaboration du document Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs a tenu compte des idées d’un vaste éventail d’intervenants provenant de divers secteurs de la société canadienne, notamment des particuliers, des professionnels, des organismes sans but lucratif et des entreprises du secteur privé, des universitaires et des chercheurs, ainsi que tous les paliers de gouvernement dans l’ensemble des provinces, des territoires et des régions du Canada.
Les gouvernements ont sollicité les points de vue et les idées d’experts dans les domaines de la santé, de l’activité physique et du comportement sédentaire, du sport, du loisir, des infrastructures, du transport, du patrimoine, de la culture, de l’éducation, de l’environnement, des parcs et dans d’autres secteurs, notamment le secteur privé, et des membres de collectivités qui pourraient se heurter à des obstacles à la participation (par exemple, les nouveaux Canadiens et Canadiennes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes et les filles, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles (LGBTQI2-S), ainsi que les personnes vivant dans les régions rurales, éloignées et isolées).
Des activités de consultation et de mobilisation ont été effectuées au moyen d’enquêtes publiques, de webinaires interactifs, d’un atelier de consultation national et d’entrevues avec des intervenants d’importance.
Une quête d’information ciblée a été effectuée, portant sur les problèmes auxquels font face les municipalités, les collectivités autochtones dans les réserves et hors des réserves, ainsi que les collectivités nordiques, rurales et éloignées.
Un groupe d’étude non gouvernemental a contribué à l’analyse de l’orientation proposée et du contenu de la version préliminaire. Ce travail a impliqué la collaboration de ParticipACTION, de l’Association canadienne des parcs et loisirs, du Groupe Le sport est important, du Centre de documentation pour le sport et de représentants de Canada actif 20/20 : une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada.
Une série de six ateliers spécialisés a porté sur le contenu. Ces ateliers ont permis à des experts provenant d’un grand éventail de secteurs de se prononcer afin d’orienter les discussions sur le contenu en matière de collaboration, d’environnements physiques, d’environnements sociaux, de formation et de leadership, d’inclusion et de diversité sociale, ainsi que de mobilisation du public.
Les informations provenant des consultations, de la mobilisation et des ateliers ont été synthétisées et regroupées en six domaines prioritaires. Ces informations ont également aidé à formuler des impératifs stratégiques précis menant à des pistes d’action dans chacun de ces domaines.
Remerciements
Le document Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs a été élaboré par le Comité directeur fédéral-provincial-territorial d’élaboration du Cadre sur l’activité physique au nom des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et du loisir. Le Comité directeur est composé de représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux dans les domaines du sport, de l’activité physique et du loisir.
Nous remercions tout particulièrement le Conference Board du Canada d’avoir assuré la gestion du processus national de consultation et de mobilisation ainsi que la préparation des rapports Developing a Pan-Canadian Physical Activity Framework: Consultation and Engagement Summary ReportNote de bas de page 11 et Consultation and Engagement Addendum Report – Northern, Rural, Remote and/or Indigenous Perspectives, March 2017Note de bas de page 12, qui ont contribué à orienter la Vision commune.
Nous exprimons également notre gratitude à tous ceux et celles qui ont fait part de leurs idées et de leurs points de vue au cours du processus de consultation et de mobilisation, ainsi qu’aux dirigeants et aux réseaux de ParticipACTION, de l’Association canadienne des parcs et loisirs, du Groupe Le sport est important, du Centre de documentation pour le sport, du Cercle sportif autochtone, et aux représentants de Canada actif 20/20 : une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada pour leur implication et leur expertise.
Un merci bien particulier au Réseau Accès Participation, ainsi qu’à Pierre Morin, et Denis Poulet pour le partage de leurs connaissances et de leurs expertises dans la révision de la version française de la Vision commune. Leur soutien à ce projet s’est avéré très important.
Première partie : Le contexte – Activité physique et sédentarité au canada
Aujourd’hui plus que jamais, il faut mobiliser l’ensemble de la population canadienne et lui donner les moyens de s’asseoir moins et de bouger plus sur une base régulière.
L’activité physique figure parmi les fonctions humaines fondamentales. On peut être actif physiquement à la maison, à l’école, au travail, pendant le temps libre ou en déplacement. Dans le passé, l’activité physique était intégrée à la vie quotidienne, car le travail était plus exigeant sur le plan physique. Nous comptions moins sur l’automatisation et dépendions moins de l’automobile. Il était plus facile d’être actif, car le travail, les tâches ménagères et la vie quotidienne en général exigeaient davantage d’efforts physiques. En outre, ici, au Canada, la vie de nombreux peuples autochtones reposait traditionnellement sur une relation holistique avec la terre, les activités physiques faisaient partie de la vie quotidienne et étaient intégrées à la culture. Des politiques gouvernementales ont eu pour effet d’affecter cette relation, comme celles qui ont conduit à l’éloignement des populations de leurs territoires traditionnels et à leur établissement dans des réserves, et aux pensionnats indiens.
Aujourd’hui, l’activité physique a pratiquement été éliminée de nos vies. De plus, nombreux sont ceux qui pensent qu’ils doivent sortir de leur routine pour être physiquement actifs, qu’il s’agit d’activités à ne faire que pendant son temps libre, dans un centre de conditionnement physique ou sur un terrain de sport. Il est important de reconnaître que l’éloignement de la société de l’activité physique a pris des décennies; il faudra du temps pour inverser cette tendance et revenir à une société plus active.
Résultat? Près de la moitié des adultes canadiens ne sont pas suffisamment actifs pour en retirer des avantages pour leur santé et leur bien-êtreNote de bas de page 13 . Nous menons des vies de plus en plus sédentaires. Nous passons trop de temps à ne rien faire, à regarder des écrans, à surfer en ligne ou à jouer à des jeux vidéo. En outre, même ceux qui parviennent à respecter les directives en matière d’activité physique sont trop sédentaires le reste de la journée. L’inactivité physique est désormais le quatrième facteur de risque de décès prématuré, après l’hypertension, le tabagisme et le diabèteNote de bas de page 14. Les premières recherches en ce sens ont établi que la sédentarité contribue à une mauvaise santé et même au décès prématuréNote de bas de page 15. On a estimé que l’inactivité physique chez les adultes a coûté environ 6,8 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2009Note de bas de page 16.
Tout comme l’activité physique, le comportement sédentaire peut se manifester dans les contextes du temps libre, du travail, du domicile et du transportNote de bas de page 17. Un comportement sédentaire excessif peut nuire à la santé, quel que soit le niveau d’activité général. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures étayent la relation entre l’activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil, ce dernier étant un facteur de maintien de la santéNote de bas de page 18. Pour les besoins de la Vision commune, la sédentarité fait référence à l’accumulation des comportements sédentaires qui se produisent au cours d’une période de 24 heures donnée.
Encadré 1
Définition de l’activité physique : Tout mouvement du corps produit par les muscles squelettiques, qui nécessite une dépense d’énergie. Cela peut comprendre un éventail de mouvements tout au long de la journée, dont l’intensité peut être légère (1,5 à 4,0 équivalents métaboliques de la tâche [MET – mesure physiologique exprimant le coût énergétique des activités physiques] pour les enfants et les jeunes, et de 1,5 à 3,0 MET pour les adultes; modérée (de 4,0 à 6,9 MET pour les enfants et les jeunes et de 3,0 à 5,9 MET pour les adultes); ou élevée (7,0 MET ou plus pour les enfants et les jeunes, et 6,0 MET ou plus pour les adultes)Note de bas de page 19. Mentionnons, par exemple, les activités sportives et récréatives, l’utilisation des escaliers au travail, le jeu à l’extérieur, aller à l’école à pied, les travaux ménagers, les déplacements actifs domicile-travail ainsi que les activités territoriales traditionnelles pratiquées par certains peuples autochtones, comme la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette et toute autre activité en lien avec l’environnement naturel.
Définition du sport : La participation au sport se définit par les quatre contextes relevés dans la Politique canadienne du sport (2012)Note de bas de page 4.
- Introduction au sport – Acquisition des compétences, des connaissances et des attitudes fondamentales nécessaires à la participation au sport organisé et non organisé
- Sport récréatif – Participation au sport pour le plaisir, la santé, les rapports sociaux et la détente
- Sport de compétition – Possibilité de s’améliorer systématiquement et de mesurer sa performance à celle des autres en compétition
- Sport de haut niveau – Participation aux plus hauts niveaux de la compétition internationale
Définition du loisir : Expérience qui découle de la participation librement choisie à des activités physiques, sociales, intellectuelles, créatives ou spirituelles qui renforcent le bien-être individuel et collectifNote de bas de page 5
Définition du comportement sédentaire : Tout comportement en état de veille caractérisé par une dépense d’énergie égale ou inférieure à 1,5 MET. Le comportement sédentaire a trait à la posture du corps, comme la position assise ou allongée, en sus d’une faible dépense d’énergie et de l’inactivité physique. Les comportements courants auxquels s’adonnent généralement les personnes en période d’inactivité comprennent regarder la télévision, être assis à un bureau ou dans un sofa, aller au travail en voiture, parler au téléphone ou lire un livreNote de bas de page 19.
Définition de l’activité physique utilitaire : Activité physique exercée principalement pour accomplir un travail ou des tâches ménagères, faire des courses ou se déplacer, conformément à ses propres valeurs et pratiques culturellesNote de bas de page 20.
Considérations sociales et démographiques
Certains facteurs sociaux et démographiques entravent la capacité d’être physiquement actif. Les lieux de résidence, d’études, de travail et de détente influent considérablement sur la santé. Les choix personnels et les comportements, y compris l’activité physique, sont façonnés par toute une gamme de facteurs sociaux et économiques, notamment le revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l’éducation, l’emploi et les conditions de travail, les environnements sociaux, les environnements physiques, l’hygiène de vie, le développement de la santé de l’enfant, le patrimoine biologique et génétique, les services de santé, le sexe, la culture et bien d’autres facteurs. Tous ceux qui participent à la promotion de l’activité physique doivent tenir compte de ces facteurs importants.
Personnes âgées
Les résultats du Recensement de 2016 affichent une augmentation importante du nombre de personnes âgées au Canada (65 ans et plus). Au moment du Recensement de 2016, le Canada comptait plus de personnes âgées (5,9 millions) que d’enfants de moins de 14 ans (5,8 millions)Note de bas de page 21. La population des personnes âgées devrait atteindre au moins 10 millions d’ici 2036Note de bas de page 22.
Immigrants
L’immigration joue un rôle important dans la composition démographique canadienne, car les immigrants représentent environ 22 % de la population canadienne, selon le Recensement de 2016Note de bas de page 23.
De 2011 à 2016, plus de 1,2 million de nouveaux immigrants se sont établis au Canada de façon permanenteNote de bas de page 24.
Autochtones
Au Canada, les peuples autochtones font face à des difficultés particulières. La Commission de vérité et réconciliation (2015) l’atteste, les collectivités autochtones doivent composer avec les séquelles durables du traumatisme intergénérationnel découlant de la colonisation, ainsi qu’avec la perte de la culture, de la langue, de l’identité et des infrastructures autochtones.
La disparition de la culture, l’insalubrité et la promiscuité, auxquelles s’ajoute souvent l’insécurité alimentaire, ont fait en sorte que les enfants et les jeunes autochtones déclarent être en moins bonne santé que les enfants et les jeunes non autochtonesNote de bas de page 25. Par ailleurs, de nombreuses collectivités autochtones éloignées font face à une épidémie de suicides chez les jeunes, une situation également dévastatrice.
La population autochtone croît à un rythme bien supérieur à celui de la population canadienne générale. De 2006 à 2016, la population autochtone a connu une croissance de plus de 42,5 %, soit près de quatre fois plus que la population non autochtoneNote de bas de page 23.
Déficiences physiques
Les adultes canadiens qui déclarent rencontrer des limitations de participation ou d’activité sont 26 % moins susceptibles d’être modérément actifs que ceux qui n’en rencontrent pas. Ceux qui signalent des déficiences fonctionnelles modérées à graves sont de 23 à 33 % moins susceptibles d’être modérément actifs que ceux qui n’ont aucune déficienceNote de bas de page 26.
Pauvreté ou faible revenu
La pauvreté et l’inégalité économique sont en croissance dans tout le pays. Les taux d’activité physique se sont révélés décliner d’une catégorie de revenu à une autre. Ceux qui disposent des revenus les plus modestes sont 33 % moins susceptibles d’être modérément actifs que ceux qui gagnent les revenus les plus élevés26 .
L’occupation peut également avoir une incidence sur l’activité physique. Les travailleurs non qualifiés sont 30 % moins susceptibles d’être modérément actifs, ceux qui exercent un métier semi-spécialisé sont 22 % moins susceptibles, ceux qui occupent des postes techniques ou des postes de supervision sont 15 % moins susceptibles et ceux qui occupent des postes de direction sont 8 % moins susceptibles d’être modérément actifs que ceux qui appartiennent à la catégorie des professionnelsNote de bas de page 26.
Évolution des environnements bâtis
Au cours des 50 dernières années, le pourcentage de la population qui vit en milieu urbain a changé considérablement. Cela présente à la fois des difficultés et des possibilités : l’augmentation de la population urbaine peut se traduire par un accroissement des embouteillages, du bruit et de la pollution de l’air.
De nombreuses collectivités autochtones rurales, éloignées et nordiques vivent des inégalités quant au développement des infrastructures.
Diverses initiatives populationnelles peuvent vraiment augmenter le niveau d’activité physique et réduire la sédentarité à tout âge et à tout stade de développement. Même de légers gains dans les différents groupes de population, comme les peuples autochtones, pourraient avoir un effet considérable.
Petite enfance (0 à 4 ans)
Activité physique
Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures précisent le nombre d’heures que doivent passer les enfants âgés de 4 ans ou moins à être actifs, à être assis et à dormir afin de leur assurer une croissance et un développement sains.
- 13 % des enfants d’âge préscolaire (3 à 4 ans) se conforment aux Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heuresNote de bas de page 27.
- 62 % des enfants d’âge préscolaire (3 à 4 ans) se conforment aux recommandations relatives à l’activité physique figurant dans les Directives en matière de mouvement sur 24 heuresNote de bas de page 27.
Enfants et jeunes (5 à 17 ans)
Niveaux d’activité physique
Les enfants et les jeunes qui respectent les directives en matière d’activité physique ne sont pas assez nombreux.
- 9,5 % des enfants et des jeunes (5 à 17 ans) se conforment aux Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heuresNote de bas de page 28.
- 38 % des enfants et des jeunes font en moyenne 60 minutes d’activité physique modérée à intense par jourNote de bas de page 28.
- 49 % des enfants s’adonnent à des jeux actifs à l’extérieur de l’école 3 heures par semaine ou moinsNote de bas de page 28.
- 74 % des parents canadiens ont déclaré que leurs enfants ont participé à des sports au cours des 12 derniers moisNote de bas de page 29.
Comparaison selon le sexe
Les écarts sont encore considérables entre les garçons et les filles.
- 26 % des filles âgées de 5 à 17 ans font en moyenne 60 minutes d’activité physique modérée à intense par jour, par rapport à 48 % des garçons âgés de 5 à 17 ansNote de bas de page 28.
Changements à l’adolescence
Le nombre de jeunes qui suivent les directives en matière d’activité physique diminue avec le début de l’adolescence.
- 48 % des enfants âgés de 5 à 11 ans font en moyenne 60 minutes d’activité physique modérée à intense par jour, par rapport à 27 % des jeunes âgés de 12 à 17 ansNote de bas de page 28.
Transport actif
Le nombre d’enfants qui se rendent à l’école à pied, à vélo, en patins à roulettes ou en planche à roulettes a diminué.
- En 2013-2014, seulement 26 % des enfants et des jeunes utilisaient principalement un moyen de transport actif pour se rendre à l’école. Les taux de transport actif étaient plus élevés en 2009-2010 : 32,5 % des enfants marchaient ou prenaient un vélo pour se rendre à l’écoleNote de bas de page 30.
- La distance semble jouer un rôle dans le transport actif. Alors que 42 % des enfants dont le trajet jusqu’à l’école dure 5 minutes s’y rendent à pied, le pourcentage chute à 28 % lorsque le trajet dure entre 5 et 15 minutes Note de bas de page 30.
- Même pour les courts trajets de 5 minutes ou moins, seuls 3 % des enfants et des jeunes se rendent à l’école à véloNote de bas de page 30.
Comportement sédentaire
Les enfants et les jeunes ne respectent pas les Directives canadiennes en matière de comportement sédentaire.
- 72 % des enfants et des jeunes excèdent le temps maximal recommandé pour les activités récréatives devant un écran, à savoir pas plus de deux heures par jourNote de bas de page 28.
- En outre, les enfants et les jeunes sont sédentaires environ 8,4 heures en période d’éveil dans une journée, la plupart du temps à l’école pendant la semaineNote de bas de page 28.
Adultes (18 ans et plus)
Niveaux d’activité physique
Les adultes canadiens sont un peu plus actifs aujourd’hui, mais ils ne se conforment pas encore aux directives en matière d’activité physique.
- 18 % des adultes se conforment aux directives canadiennes en matière d’activité physique, lesquelles conseillent 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée par semaine en séances de 10 minutes ou plusNote de bas de page 28.
- 53 % des adultes ont déclaré être modérément actifs; il s’agit d’une augmentation par rapport aux niveaux observés 10 ans plus tôtNote de bas de page 13.
Comparaison selon le sexe
Les hommes et les femmes affichent des augmentations du niveau d’activité modérée. Lorsque les Canadiens et les Canadiennes atteignent l’âge adulte, l’écart de l’activité physique entre les hommes et les femmes commence à déclinerNote de bas de page 13.
- 55 % des hommes en 2013 (par rapport à 51 % en 2003)Note de bas de page 13
- 51 % des femmes en 2013 (par rapport à 46 % en 2003)Note de bas de page 13
Transport actif
On peut faire mieux en matière de transport actif.
- Les adultes déclarent consacrer 1,9 heure par semaine au transport actifNote de bas de page 31 .
Comportement sédentaire
Les adultes sont sédentaires pendant la grande majorité de leur journée.
- En moyenne, les adultes sont sédentaires 9,6 heures par jourNote de bas de page 28.
Personnes âgées
Niveaux d’activité physique
Les personnes âgées sont bien en deçà des directives quotidiennes.
- 14 % des personnes âgées de 65 à 79 ans se conforment aux directives canadiennes en matière d’activité physique, lesquelles conseillent 150 minutes d’activité physique modérée à intense par semaine en séances de 10 minutes ou plusNote de bas de page 28.
Transport actif
L’utilisation d’un moyen de transport actif diminue avec l’âge.
- Les personnes âgées de 65 à 79 ans consacrent 1,5 heure par semaine au transport actif, ce qui est bien inférieur au nombre relevé dans la population adulte en généralNote de bas de page 31.
- Les adultes de 80 ans et plus y consacrent encore moins de temps, soit moins d’une heure par semaineNote de bas de page 31.
Comportement sédentaire
Le comportement sédentaire augmente avec l’âge.
- Les personnes âgées sont sédentaires pendant 10,1 heures de leur journée. Cette proportion est plus élevée que dans la population adulte en généralNote de bas de page 28.
On relève des signes de progrès
Au cours des dernières années, on a observé à l’échelle nationale et internationale une reconnaissance des répercussions sociales, économiques et liées à la santé de l’inactivité physique et de la sédentarité, ainsi que relevé des efforts visant à les résoudre. Les efforts déployés pour augmenter le niveau d’activité physique et réduire la sédentarité ont donné certains résultats prometteurs. En voici quelques exemples :
- Le concept des villes habitables transforme la manière dont les quartiers sont aménagés. Ce concept porte notamment sur la façon de concevoir les rues, de promouvoir les activités à l’extérieur et de situer les aménagements plus près des résidents pour créer, au bout du compte, des collectivités dynamiques.
- Les partenaires municipaux et communautaires participent depuis quelques décennies à l’amélioration du bien-être à long terme de la population par une offre de service en loisir qui répond aux besoins. Cette offre contribue à réduire les obstacles à la participation et à augmenter le niveau d’activité physique. Elle touche également la saine alimentation et la nutrition, la santé et le bien-être personnel, la santé mentale, l’inclusion sociale et d’autres besoins locaux.
- L’approche globale de la santé en milieu scolaire est reconnue pour aider à améliorer le rendement scolaire des élèves tout en gérant la santé dans ce milieu d’une façon planifiée, intégrée et holistique. Les mesures incluent quatre composantes distinctes, mais étroitement liées : environnements social et physique; enseignement et apprentissage; politique; partenariats et servicesNote de bas de page 32. Dans ce modèle intégré, l’activité physique est encouragée tout au long de la journée d’école, pas seulement pendant le cours d’éducation physique. Cette approche comprend de nombreux aspects, qui vont du mode de transport des enfants entre la maison et l’école à la façon dont ils apprennent en classe, en passant par leurs activités pendant la récréation. Il est essentiel d’intégrer à cette approche la littératie physique pour que les enfants et les jeunes puissent développer les aptitudes requises pour faire de l’activité physique l’engagement de toute une vie.
- L’activité physique est intégrée au système de soins de santé, car les professionnels de la santé prescrivent l’activité physique et offrent des conseils pratiques et proactifs. Ils proposent des séances d’activité physique et un soutien utile qui contribuent à prévenir les maladies.
- Le « sport pour tous » de qualité ajoute une dimension ludique et du plaisir à l’activité physique. Il s’agit également d’une excellente occasion de donner l’exemple aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées, quel que soit leur niveau d’aptitude ou de capacité.
- Les programmes de bien-être au travail commencent à élaborer des stratégies visant à l’établissement de lieux de travail plus propices à l’activité physique afin d’améliorer la santé, le bien-être et la productivité des employés.
La réussite de ces stratégies et d’autres méthodes montre que le fait d’être physiquement plus actif et moins sédentaire peut être une expérience agréable qui génère toute une série de bienfaits.
Encadré 2 : Plus les Canadiens et les Canadiennes sont actifs, plus le Canada en retire des bienfaits
L’activité physique est associée à de nombreux bienfaits découlant de l’activité sous toutes ses formes, qui profitent à la population canadienne à l’échelle individuelle, familiale, communautaire et sociétale dans de nombreux secteurs, comme l’éducation, la santé, le transport et l’environnement.
Bienfaits en matière de santé
- L’activité physique prévient les maladies chroniques non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, l’obésité, le diabète et certaines formes de cancer.
- Elle améliore la motricité, la force musculaire, la forme cardiorespiratoire et la santé des os.
- Elle maintient l’agilité et l’indépendance fonctionnelle.
- Elle améliore la santé mentale et le bien-être.
- Elle contribue à régulariser les habitudes de sommeil.
- Elle stimule la créativité et l’apprentissage.
- Elle réduit le stress, l’anxiété et la dépression.
- Elle améliore la prise de décision.
- Elle apporte des bienfaits précis tout au long du parcours de vie, aussi bien aux tout-petits, qui dorment mieux, qu’aux personnes âgées, chez les lesquelles l’apparition de la démence est retardée.
- Elle renforce le sentiment d’appartenance.
- Elle calme l’anxiété et rend heureux.
- Elle contribue à renforcer l’assurance et l’estime de soi.
Bienfaits sociaux
- Elle renforce la cohésion sociale, aide à la formation d’une identité positive et réduit l’isolement.
- Elle socialise les enfants en leur inculquant un mode de vie actif.
- Un accès élargi aux installations et aux espaces publics peut favoriser la diminution des crimes en incitant les jeunes à adopter des comportements positifs.
- Santé et capacité communautaires.
Bienfaits environnementaux
- Elle améliore la qualité de l’air et a une incidence directe sur l’environnement.
- Le transport actif réduit les polluants produits par les véhicules automobiles.
- Lien avec la nature.
Bienfaits en matière d’éducation
- Elle renforce les compétences en résolution de problèmes.
- Elle améliore la concentration, la mémoire, l’apprentissage et l’attention.
- Elle a une incidence sur les notes d’examens et sur la réussite globale des élèves.
Bienfaits économiques
- Elle réduit les coûts globaux des soins de santé.
- Elle augmente la productivité et fait baisser le taux d’absentéisme.
- Elle crée d
- Elle réduit les frais communautaires et les coûts de stationnement; les collectivités qui offrent des espaces et des lieux actifs voient leurs activités touristiques croître et attirent les entreprises.
Deuxième partie : Le fondement – Activité physique
La Vision commune se fonde sur cinq principes interdépendants qui orientent chacun des domaines prioritaires et des impératifs stratégiques connexes décrits dans la Troisième partie : Les possibilités.
Avoir énoncé ces principes dès le début du présent document montre à quel point ils sont fondamentaux pour chaque impératif stratégique figurant dans la Troisième partie, ainsi que l’importance d’un leadership partagé et de démarches coordonnées décrits dans la Quatrième partie : La voie de l’avenir. Plus précisément, il faut que toutes les mesures dans chaque territoire et que tous les organismes et collectivités intègrent ces principes afin d’assurer le succès de la Vision commune.
Littératie physique : La littératie physique est la base d’un mode de vie actif durant toute la vie. Elle se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’activité physique pour toute sa vieNote de bas de page 33. Améliorer la littératie physique ouvre davantage de possibilités d’activité physique. Comme c’est le cas pour la littératie et la numératie, l’acquisition des capacités de mouvement dès le jeune âge est plus facile et plus durable. Le renforcement de la littératie physique aux premiers stades du développement, notamment au moyen d’activités physiques quotidiennes à l’école, est essentiel pour atteindre l’objectif de la Vision commune.
Tous les gouvernements, organismes, collectivités et dirigeants devraient aborder les domaines prioritaires dans une perspective qui :
- Procure aux Canadiens et aux Canadiennes la formation, les expériences et les occasions leur permettant de développer leur littératie physique. Les concepts de base du mouvement, comme l’agilité, l’équilibre, la coordination et la vitesse, sont les pierres d’assise qui aideront à rendre les Canadiens et les Canadiennes plus actifs.
- Reconnaît et encourage la littératie physique comme élément essentiel du développement de l’enfant, au même titre que la numératie et la littératie.
- Promeut, au sein des différents secteurs et à tous les niveaux, une vision unifiée pour comprendre et développer la littératie physique.
- Promeut l’enseignement de la littératie physique et du développement des connaissances.
- Favorise le développement des connaissances et des programmes de formation en littératie physique.
- Reconnaît que le développement de la littératie physique, peu importe le niveau, est un élément de tout programme d’éducation physique de qualité, et qu’un minimum de 30 minutes par jour d’éducation physique de qualité est nécessaire pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances, les aptitudes, les compétences et la confiance qui feront d’eux des personnes actives à vie.
Parcours de vie : Une démarche axée sur le parcours de vie reconnaît qu’il y a des périodes critiques en bas âge pendant lesquelles les aptitudes sociales et cognitives, les habitudes, les stratégies d’adaptation, les attitudes et les valeurs s’acquièrent plus facilement. Ces capacités et compétences précoces façonneront la santé plus tard dans la vie. Cette démarche identifie également quelques périodes charnières importantes, notamment entre la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte, où l’instabilité peut modifier la trajectoire du parcours de vie et la santé à long termeNote de bas de page 34.
Tous les gouvernements, organismes, collectivités et dirigeants devraient envisager les domaines prioritaires dans une perspective qui :
- Reconnaît que les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de soutiens différents à différents âges et stades de développement pour rester actifs.
- Encourage les Canadiens et les Canadiennes de tous âges dans leurs efforts pour être plus actifs physiquement dans tous les aspects de leur vie quotidienne et à toutes les étapes de leur vie en leur facilitant la tâche.
Démarche populationnelle : Pour que les Canadiens et les Canadiennes s’assoient moins et bougent plus, il faut tenir compte des conditions et des facteurs interreliés qui influent sur les populations tout au long de la vie. Il s’agit de l’ensemble des déterminants de la santé — revenu et statut social, réseaux de soutien social, éducation, discrimination, conditions d’emploi et de travail, environnements sociaux, environnements physiques, pratiques de santé personnelle, développement sain de l’enfant, dotation biologique et génétique, services de santé, sexe, culture – dont on a pu démontrer la corrélation à l’état de santéNote de bas de page 35. Augmenter le niveau d’activité physique et réduire la sédentarité exige des mesures qui visent l’ensemble de la population ou les groupes de population, et pas seulement les individus.
Tous les gouvernements, organismes, collectivités et dirigeants devraient aborder les domaines prioritaires dans une perspective qui :
- Reconnaît la diversité de la population canadienne, y compris les peuples autochtones, et met l’accent sur la réduction des inégalités entre les groupes de population en matière de possibilités d’être physiquement actifs. Cela nécessite plus particulièrement que les activités soient inclusives, équitables, abordables, pertinentes sur le plan culturel et accessibles à tous les groupes, notamment les nouveaux Canadiens et Canadiennes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes et les filles, ainsi que les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles (LGBTQI2-S).
- Donne la priorité à l’accessibilité pour tous. Cela comprend l’élimination des obstacles et l’amélioration de l’accès aux activités physiques et aux autres possibilités de bouger.
- Tient compte des changements démographiques liés à l’âge, l’immigration, l’expansion urbaine, la dépopulation, la pauvreté et l’inégalité des revenus.
- Tient compte de la diversité géographique du Canada, caractérisée par de grands centres urbains, de petites collectivités locales et les collectivités du Nord, rurales, éloignées et autochtones (y compris des réserves), lesquelles sont nombreuses à ne pas disposer d’installations favorisant l’activité physique.
- Dans un souci de compréhension commune, établit des relations avec les groupes sous-représentés et leur donne la possibilité de se faire entendre et de jouer un rôle actif dans la prise de décisions.
Prise de décisions fondées sur des données probantes et émergentes : Il faut prendre des décisions reposant sur des données probantes pour définir les priorités et les stratégies qui encourageront et habiliteront les Canadiens et les Canadiennes à s’asseoir moins et à bouger plus. Même si les données quantitatives en sont un élément clé, il est tout aussi important de tenir compte des données qualitatives, lesquelles peuvent aider à révéler les points de vue sous-jacents, les idées et les relations humaines qui permettent d’établir un climat de confiance et de compréhension. Les démarches éprouvées peuvent orienter la planification ultérieure, mais l’un des aspects importants de l’innovation est le développement de nouvelles sources d’exploration et de données probantes qui pourront aider à atteindre l’objectif de la Vision commune.
Tous les gouvernements, organismes, collectivités et dirigeants devraient aborder les domaines prioritaires dans une perspective qui :
- Repose fondamentalement sur des données probantes.
- Appuie l’exploration de nouvelles approches en misant sur des innovations qui montrent des signes avant-coureurs de succès et pourraient déboucher sur de nouvelles données probantes.
- Crée des possibilités d’intégrer les principes de la Vision commune dans les discussions et la planification préliminaires.
Motivations : Même si la Vision commune indique clairement la nécessité de changements systémiques dans les environnements sociaux et physiques pour favoriser l’augmentation du niveau d’activité physique et la réduction de la sédentarité, la motivation individuelle reste un facteur clé de l’activité physique. Les motivations peuvent fluctuer : elles changent tout au long de la vie et peuvent différer en fonction de l’activité. La motivation d’être actif peut résider dans l’amélioration de la santé, la réduction de l’isolement, l’amélioration de la santé mentale, le renforcement du sentiment d’appartenance ou d’autres facteurs. Qui plus est, pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, l’activité physique est agréable et plaisante, elle fait partie intégrante de leur bonheur et de leur santé. Toutes ces motivations sont importantes dans la conception de la Vision commune.
Tous les gouvernements, organismes, collectivités et dirigeants devraient aborder les domaines prioritaires dans une perspective qui :
- Tient compte des aspirations individuelles et des motivations particulières pour être physiquement actif au-delà de l’aspect purement lié à la santé physique.
- Enracine les programmes, les promotions et les efforts de mobilisation du public dans les points de vue des consommateurs concernant ce que veulent les Canadiens et les Canadiennes, plutôt que dans le discours des organismes.
- Tient compte de la culture, des valeurs, des croyances et des pratiques des individus, ainsi que de la manière dont celles-ci influencent la motivation de chacun.
- Prend en considération la vaste gamme d’expériences que tous les Canadiens et les Canadiennes, y compris les peuples autochtones, ont vécues dans le domaine de l’activité physique, qu’il s’agisse de recherche de la santé ou du plaisir, de revitalisation culturelle ou de participation sportive à un haut niveau.
Troisième partie : Les possibilités – Domaines prioritaires
La Vision commune : un Canada où toute la population s’assoit moins et bouge plus.
Pour que les Canadiens et les Canadiennes s’assoient moins et bougent plus, il faut adopter une démarche multidimensionnelle et interdépendante visant à augmenter le niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité qui puisse contribuer à surmonter les obstacles. Cette démarche, qui constitue une première étape, ne doit pas se limiter au sport, à l’activité physique, au loisir et à la santé. La recherche a établi clairement que l’activité physique est influencée par un ensemble complexe de facteurs et de conditions interreliés à l’échelle individuelle et sociétale, dont la plupart ne relèvent pas des politiques et des programmes en matière de sport et de loisir.
Pour mettre le pays sur la voie de nouvelles mesures audacieuses visant à augmenter le niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité, les intervenants ont défini six domaines prioritaires dans le cadre d’un vaste processus de consultation et de mobilisation. Tous les organismes et les dirigeants qui ont à cœur de promouvoir l’activité physique et de réduire la sédentarité au Canada, sur le plan autant local que national, doivent s’engager. Une action concertée entre tous les secteurs est nécessaire pour augmenter le niveau d’activité physique et réduire la sédentarité dans tout le pays. À travailler dans le cadre d’une vision commune, on pourra réaliser des percées considérables.
Encadré 3 : Obstacles à l’activité physique
Obstacles individuels (perçus et vécus) :
- Contraintes de temps
- Contraintes financières
- Manque de plaisir à faire de l’activité physique
- Énergie consommée par des activités concurrentes
- Faible niveau de confiance en soi
- Capacités et compétences déficientes
- Fatigue et stress découlant d’autres responsabilités
- Maladies ou blessures
- Sentiment de malaise ou de gêne
- Absence de modèles positifs
- Traumatismes antérieurs
- Valeurs et pratiques culturelles
- Préoccupations de sécurité
Obstacles sociétaux :
- Difficulté d’accès à une offre de service en loisir permettant d’être actif dans les collectivités dont la population est dispersée, par exemple dans les situations d’étalement urbain, de régions rurales ou éloignées, ou dans les collectivités autochtones (y compris les réserves)
- Manque d’infrastructures de transport et de soutien (p. ex., pistes cyclables et locaux à vélos)
- Potentiel piétonnier limité
- Services de garde insuffisants
- Discrimination engendrant l’exclusion et la démobilisation
- Longues durées de déplacement
- Nature de la profession ou du métier, configuration du lieu ou du poste de travail
- Coût de participation et de l’équipement
- Climat ou environnement peu propice
- Accès réduit à des programmes ou établissements en nombre insuffisant
- Diversité des normes culturelles
- Politiques et règlements défavorables
- Activité physique insuffisante à l’école
- Manque d’entraîneurs qualifiés, de responsables de programme, d’enseignants en éducation physique, d’éducateurs en matière de santé et d’intervenants auprès de la petite enfance
- Manque de compréhension des répercussions du comportement sédentaire
Figure 2. Les opportunités : Domaines d'action

Figure 2 - Équivalent du texte
Au centre :
- Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes s’assoient moins et bougent plus
Deuxième cercle :
- Motivations
- Démarche populationnelle
- Décisions fondées sur des données probantes et émergentes
- Littératie physique
- Parcours de vie
Troisième cercle :
- Environnements : Il faut que les environnements physiques soient favorables à toutes les formes d’activité physique
- Normes culturelles : Il est important que bouger devienne une norme sociale
- Mobilisation du public : Il est urgent de stimuler la mobilisation du public
Quatrième cercle :
- Partenariats : Il est essentiel de travailler ensemble
- Leadership et formation : Il est crucial d’établir un solide réseau de leadership et de formation pour renforcer les capacités
- Progression : Il est indispensable de savoir ce qui fonctionne
Ces domaines prioritaires sont fondés sur le modèle socioécologique de la promotion de la santé. Ce cadre permet de comprendre les facteurs qui produisent et entretiennent les problèmes de santé ou liés à la santé, et décrit les systèmes interreliés à l’échelle intrapersonnelle, interpersonnelle, organisationnelle, communautaire et politiqueNote de bas de page 36.
Ensemble, ces domaines prioritaires joueront un rôle interdépendant dans l’approche holistique de l’activité physique au Canada visant à augmenter le niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité. À titre de rappel, il est important de considérer chacun des domaines prioritaires sous l’angle des principes clés décrits dans la Deuxième partie : Le fondement. Voici les domaines prioritaires :
Normes culturelles et environnements physiques : Ces deux facteurs sont interreliés et contribueront à aménager des environnements sociaux et physiques plus propices à l’augmentation du niveau d’activité physique et à la réduction de la sédentarité. Les normes culturelles doivent permettre d’instaurer des valeurs sociales et des convictions qui contribueront à faire de l’activité physique la priorité. En outre, les environnements physiques contribuent à offrir des espaces plus propices et accessibles pour que l’activité physique devienne une habitude ancrée dans la vie quotidienne. Par exemple, dans certaines collectivités autochtones, l’importance culturelle des lieux repose sur une perception de l’environnement en tant qu’espace destiné à des activités physiques territoriales traditionnelles.
Mobilisation du public : L’un des aspects essentiels de l’augmentation du niveau d’activité physique et de la réduction de la sédentarité consiste à permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de savoir comment et où être actifs de façon plus systématique et plus durable.
Partenariats, leadership et formation, progression : Le travail en collaboration et le développement de partenariats joueront un rôle essentiel pour faire progresser le niveau d’activité physique et réduire le comportement sédentaire chez tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, ainsi que pour établir un solide réseau de leadership et de formation qui guidera le processus. Parallèlement, le mouvement visant à rendre les gens plus actifs doit évaluer les progrès avec exactitude pour pouvoir comprendre ce qui fonctionne.
On a défini pour chaque domaine prioritaire des impératifs stratégiques qui orienteront la mise en œuvre de chacun. Ces impératifs stratégiques constituent un appel à l’action et visent à contribuer à une démarche concertée et coordonnée en matière de politiques, de planification, de priorités et de programmation à l’échelle du pays.
Les impératifs stratégiques ne sont pas des suggestions de programmes. Il s’agit plutôt de recommandations d’orientation à l’intention de tous ceux et celles qui ont à cœur de soutenir l’activité physique et de réduire la sédentarité au Canada. Ces impératifs stratégiques peuvent les inspirer pour définir le rôle qu’ils joueront selon leurs points forts, leurs capacités et atouts particuliers, soit de manière autonome, soit en partenariat.
Encadré 4
Les impératifs stratégiques peuvent aider à formuler des recommandations dans les programmes en incitant :
- les intervenants à échanger des pratiques exemplaires avec leurs homologues afin de soutenir les progrès
- les professionnels en loisir municipal à collaborer avec les planificateurs communautaires pour créer des environnements accessibles et inclusifs
- les entreprises à contribuer à l’établissement de normes culturelles au moyen de réunions qui se déroulent debout afin de modifier l’environnement social sur le lieu de travail
- les dirigeants, les éducateurs et les spécialistes du sport autochtones à renforcer les normes culturelles autochtones qui traduisent la valeur culturelle des pratiques d’activité physique au sein des collectivités autochtones
- les établissements d’enseignement secondaire, les ministères de l’Éducation, les commissions scolaires, les administrateurs et les enseignants à repenser les parcours et les programmes scolaires en fonction du leadership et de la formation
- les professionnels qui conçoivent les politiques des organismes sans but lucratif à mettre à profit la technologie pour stimuler la mobilisation du public
- les gouvernements à travailler en partenariat avec des dirigeants autochtones pour mettre en œuvre les appels à l’action tirés du Rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (2015)
- les dirigeants politiques à mobiliser tous les paliers de gouvernement pour qu’ils agissent de concert dans tous les domaines prioritaires
1. Normes culturelles : Il est important que bouger devienne une norme sociale
Le contexte
Il est essentiel de développer des normes culturelles où l’activité physique fait partie des habitudes quotidiennes. Pour ce faire, les normes sociales doivent préconiser l’activité physique non structurée pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Pour mettre les choses en contexte, les normes sociales servent à évaluer l’acceptabilité sociale et la convenance des comportements de chacun et chacune. Par exemple, il n’est pas nécessaire de prendre l’ascenseur, mais il est devenu un moyen socialement acceptable de passer d’un étage à un autre. Rechercher la place de stationnement la plus proche de l’entrée est un autre exemple de norme reconnue. Mais peut-on changer des normes? Les normes sociales peuvent renforcer les comportements positifs en matière d’activité physique. De façon réaliste, il peut s’agit de normes visant à introduire des pauses intégrées au travail ou à l’horaire scolaire pour faire de l’activité physique, à utiliser les escaliers ou à se stationner au fond du terrain.
Il ne s’agit pas de décrier les comportements inactifs ou sédentaires, mais plutôt d’utiliser les normes sociales pour créer de nouvelles valeurs et croyances relatives à toutes les formes d’activité physique pour que les gens cessent d’être inactifs et sédentaires.
Même s’il est possible de favoriser de nouvelles normes sociales au moyen de promotions et de communications, de nombreuses autres stratégies peuvent être appliquées de manière interdépendante, allant de politiques publiques de santé au recours à la technologie pour instaurer des programmes de qualité en passant par un meilleur aménagement des espaces et bien d’autres stratégies. Il faut également reconnaître que les lieux jouent un rôle important dans le renforcement des normes sociales; la « piétonnisation » des quartiers et des places publiques en est un exemple frappant. Il faut adopter une approche holistique pour faire naître et encourager les comportements normatifs.
Si des choix actifs comme marcher ou rester debout plus longtemps sont davantage à la portée de la majorité des Canadiens et des Canadiennes, ces choix deviendront des choix « populaires » ou qui vont de soi, et ils pourront susciter un mouvement social.
- Impératifs stratégiques
- 1.1 Modeler les attitudes du public afin de faire de l’activité physique un choix agréable et populaire pour tous les Canadiens et les Canadiennes : inspirer, faciliter et reconnaître une mutation culturelle qui créera chez les Canadiens et les Canadiennes un mouvement général favorable à l’activité physique structurée et non structurée tout au long de la journée.
- 1.2 Agir sur les attitudes pour lutter contre la sédentarité en indiquant quoi faire (p. ex., il n’est pas nécessaire de s’inscrire à un programme animé par un instructeur), où le faire (p. ex., se tenir debout pendant une réunion de travail, en classe ou dans les gradins pendant les matchs ou les jeux des enfants) et quand le faire (p. ex., les milieux de travail où les employés sont incités à marcher pendant les pauses-repas et les autres pauses).
- 1.3 Amorcer un changement majeur qui ouvre la voie au jeu (p. ex., surmonter les obstacles légaux, techniques et sociaux liés à la sécurité qui limitent le jeu libre) de façon à donner aux gens la liberté et la confiance dont ils ont besoin pour aller dehors et à multiplier les possibilités de jeu libre sécuritaire dans tous les milieux de plein air : à la maison, à l’école, dans les garderies, au travail, dans les lieux publics et dans la nature.
- 1.4 Combattre la stigmatisation et les stéréotypes qui affectent le jeu libre et spontané des enfants dehors (qui font que les parents peuvent se sentir jugés ou catalogués parce qu’ils laissent leurs enfants jouer sans surveillance) en martelant que le jeu libre actif peut être« risqué », mais pas toujours dangereux (p. ex., les enfants reconnaissent et peuvent évaluer le risque en fonction de leurs propres capacités).
- 1.5 Modifier les attitudes dominantes de plusieurs Canadiens et Canadiennes pour lesquels l’activité physique n’est qu’un passe-temps auquel s’adonner lorsqu’il fait beau : pratiquer des sports et des loisirs et faire de l’activité physique en toute saison est un trait bien canadien.
- 1.6 Encourager le jeu actif plutôt que le temps d’écran (p. ex., « se débrancher et jouer ») à titre de norme sociale, et pas seulement de programme ou d’initiative politique.
- 1.7 Soutenir les expériences d’activité physique de qualité qui sont formatrices tôt dans la vie, comme l’éducation physique quotidienne pour tous les élèves et bouger dans la salle de classe même, ainsi que les modes de transport actif entre l’école et la maison.
- 1.8 Travailler de concert avec les partenaires autochtones pour intégrer les points de vue autochtones afin de faire ressortir les valeurs culturelles de l’activité physique et du mouvement dans leurs communautés.
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- Les parents, les enseignants et les éducatrices en service de garde peuvent encourager les enfants à jouer dehors dans la nature, même s’il y a des imprévus et des risques. Ils peuvent les inciter à choisir régulièrement le plein air comme lieu où développer leurs capacités motrices fondamentales et leur sociabilité, et être physiquement actifs. Ils peuvent se joindre aux responsables de l’éducation et des services de garde pour travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et dans tous les secteurs afin d’examiner les politiques, les règlements administratifs et les normes d’assurance qui font obstacle au jeu sain à l’extérieur, qui peut être risqué mais est généralement sans danger.
- Les employeurs, les professionnels des ressources humaines, les syndicats et les fournisseurs de services de santé et de sécurité peuvent proposer des choix inédits aux employés dont la nature du travail exige de rester assis trop longtemps. Ils peuvent leur procurer un équipement modifié, comme des bureaux assis-debout, ou proposer des formules de réunion modifiées, comme des réunions en marchant au lieu de réunions assises. Ils peuvent susciter d’autres changements souhaitables pour les personnes sédentaires pendant leur travail, par exemple installer des supports et des locaux à vélo à l’intérieur qui permettent de se rendre au travail de manière plus active, ou prévoir un budget santé permettant de payer l’abonnement à un centre d’activité physique, des vêtements de sport ou la cotisation à une ligue sportive.
- Les enseignants et les écoles autochtones peuvent accroître le niveau de sensibilisation culturelle grâce à des programmes axés sur les activités territoriales traditionnelles.
- Les municipalités, les clubs sociaux, les groupes confessionnels et les associations de bénévoles peuvent tenir compte des expériences des nouveaux arrivants et faire valoir leurs points de vue sur ce que signifie être actif. Ils peuvent encourager les nouveaux citoyens à transmettre leurs idées et soutenir leurs propositions pour être plus actifs. Ils peuvent inviter les communautés culturelles ou les associations d’immigrants à organiser une journée où elles pourront présenter des activités physiques populaires dans leur communauté, comme le cricket, le « bocce », la pétanque, le tai-chi et le boulingrin.
2. Environnements physiques : Il faut que les environnements physiques soient favorables à toutes les formes d’activité physique
Le contexte
Autrefois, il était plus facile de faire suffisamment d’exercice physique pendant la journée. La plupart des gens exécutaient dans le cadre de leur métier et de leurs responsabilités quotidiennes des tâches pénibles sur le plan physique, comme les travaux agricoles, industriels ou ménagers. Or, pour beaucoup trop de Canadiens et de Canadiennes, l’activité physique quotidienne a été complètement évacuée. L’activité physique est trop souvent reléguée au rôle de passe-temps purement récréatif.
L’aménagement physique des espaces joue un rôle important pour inciter et habiliter les Canadiens et les Canadiennes à être actifs dans leur vie quotidienne. L’espace bâti à l’échelle locale influe sur les activités physiques sportives et récréatives, ainsi que sur l’activité physique utilitaire. Des politiques gouvernementales concernant les peuples autochtones ont eu jadis une incidence sur les liens étroits et profonds qu’ils entretenaient avec les lieux propices à l’activité physique régulière.
En matière d’activités physiques et récréatives, l’accès à des sentiers, à des parcs et à des espaces verts offre aux gens des choix sécuritaires peu coûteux ou gratuits pour être actifs. Ces possibilités vont au-delà des terrains et des centres de sports et de loisirs. La bonne nouvelle, c’est qu’on dispose déjà de solides infrastructures sur lesquelles s’appuyer. Par exemple, au Canada, depuis plus d’une centaine d’années, les parcs, les jardins et les terrains de jeu non seulement jouent un rôle essentiel pour relier et protéger les écosystèmes, mais créent également des possibilités extraordinaires d’être actif. En ce qui concerne l’activité physique utilitaire, il est possible d’intégrer des possibilités aux activités quotidiennes en aménageant des voies cyclables qui permettent de se rendre à l’école et au travail de manière active, en dotant les immeubles d’escaliers sécuritaires, accessibles et accueillants, et en construisant des écoles à des endroits facilement accessibles par des moyens de transport actifs (p. ex., à proximité d’un réseau de sentiers interreliés ou dans des espaces verts).
Des environnements physiques favorables et durables qui permettent de faire des activités physiques sportives et récréatives et de s’adonner à une activité physique utilitaire à d’autres moments sont essentiels pour permettre de bouger plus et de réduire la sédentarité. Il s’agit notamment d’éliminer les obstacles pour que l’activité physique devienne une véritable habitude quotidienne.
- Impératifs stratégiques
- 2.1 Donner priorité à l’aménagement des environnements physiques de façon à augmenter les possibilités d’activité physique récréative et utilitaire dans tous les milieux (p. ex., les communautés, les écoles, les espaces publics et les espaces verts) tout en accroissant l’accessibilité des installations, salles et infrastructures existantes.
- 2.2 Encourager les urbanistes et les développeurs à introduire dans leurs projets des éléments visant à augmenter le niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité. Ces éléments auront trait notamment à la sécurité, à la qualité des installations, à l’accessibilité physique et financière, aux capacités des individus, à la localisation, aux pratiques saisonnières, à l’inclusion et à la proximité avec la maison, l’école ou le bureau.
- 2.3 Inclure des modes de soutien généraux indispensables pour appuyer et encourager la participation (p. ex., une nouvelle patinoire accessible à vélo ou en autobus, ou une nouvelle piscine bénéficiant d’un financement suffisant et d’un personnel formé adéquatement).
- 2.4 Aménager des endroits culturellement pertinents où les peuples autochtones pourront pratiquer des activités physiques, comme des endroits sécuritaires propices à la marche (à l’intérieur et à l’extérieur des réserves et dans les environnements urbains).
- 2.5 Mettre à profit les pratiques exemplaires en matière d’évolution des collectivités aux niveaux local, régional, national et international.
- 2.6 206 Analyser et soutenir des projets de transport actif et de transport en commun (p. ex., intégration des systèmes de transport en commun, amélioration des itinéraires cyclables, nouveaux incitatifs à moins utiliser la voiture), et encourager les employeurs et les établissements scolaires à faire de même (p. ex., local à vélos, incitatifs au transport en commun, zones de déchargement des passagers plus éloignées et horaires flexibles, y compris pendant les périodes où la circulation est moins dense).
- 2.7 Inventorier les programmes de soutien (p. ex., en matière d’équipements et de procédures) qui favorisent l’activité physique et la position debout pendant les périodes d’activités sédentaires (p. ex., pendant les heures de travail et de classe).
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- Les professionnels en loisir, les enseignants et les bénévoles peuvent aider les parents ou les tuteurs à jouer un rôle plus actif, ou à rester debout et à se montrer plus actifs physiquement pendant qu’ils assistent aux activités de loisir des enfants. Ils peuvent, par exemple, installer des tapis en caoutchouc où se tenir debout est plus confortable, offrir des vélos stationnaires ou des couloirs de marche aux spectateurs dans les centres de loisirs, ou encore aménager une piste de marche ou des voies de circulation interreliées et éclairées autour des terrains pour encourager les gens à marcher pendant qu’ils assistent aux activités.
- Les municipalités peuvent réviser les règlements administratifs et les directives qui interdisent le jeu à l’extérieur sans danger dans les rues des quartiers. Cela peut inclure, par exemple, la levée des interdictions de jouer au hockey dans la rue, de pratiquer la planche à roulettes ou la glissade l’hiver.
- Les dirigeants des collectivités rurales et éloignées doivent disposer des moyens nécessaires et déployer des efforts partagés pour redonner accès à la population aux territoires et aux établissements publics afin de favoriser l’activité physique. Dans les collectivités autochtones, cela peut comprendre l’inclusion d’activités conformes aux traditions et à la culture qui établissent des liens avec le territoire, renforcent l’identité culturelle, enseignent des techniques de survie, favorisent le développement complet de la personne et équilibrent les dimensions physique, mentale, émotionnelle, culturelle et spirituelle de la vie autochtone.
- Les établissements scolaires peuvent nouer des partenariats avec les organisateurs communautaires en vue d’augmenter l’accès de la communauté aux installations scolaires récréatives et sportives en dehors des heures de classe. Cela peut comprendre, par exemple, l’accès à des professionnels en sport ou en loisir qui inculqueront les divers éléments de la littératie physique non seulement aux enfants qui en sont à leurs premiers stades de développement, mais également aux adultes et aux personnes âgées qui peuvent bénéficier de l’accès à une formation en littératie physique ou à des programmes de loisirs actifs.
- Les entreprises locales, les chambres de commerce et les organismes communautaires peuvent déployer de plus grands efforts pour soutenir les programmes qui ouvrent les rues aux gens et les ferment aux voitures, afin d’encourager la marche, le vélo et les autres types d’activité physique. Les rues piétonnes peuvent faciliter la participation des groupes sous-représentés qui se heurtent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’accéder aux centres ou aux programmes de sports et de loisirs locaux. Les rues ouvertes encouragent toutes les formes d’activité physique et rassemblent les membres de la communauté.
- Les municipalités et les professionnels en loisir peuvent offrir dans les quartiers des programmes d’activité physique multisports qui favorisent le développement des capacités motrices de base et augmentent le niveau d’activité physique à l’aide des aménagements existants, comme les sentiers, les terrains de jeu et les parcs. Pour favoriser la participation, le personnel chargé d’appliquer ce genre de programme devrait être présent à des fins de supervision, l’endroit devrait être accessible à tous afin d’éliminer les obstacles, et le programme devrait mettre à profit les infrastructures existantes (p. ex., les installations communautaires ou les équipements des terrains de jeu).
3. Mobilisation du public : Il est urgent de stimuler la mobilisation du public
Le contexte
En règle générale, les Canadiens et les Canadiennes comprennent que l’activité physique est importante pour la santé et le bien-être tout au long de la vie. Au cours des dernières décennies, on a beaucoup insisté sur les bienfaits de l’activité physique et, plus récemment, on a multiplié les appels à la réduction de la sédentarité. Il faut maintenant aller au-delà de la sensibilisation et passer à des mesures incitatives en offrant des possibilités de mobilisation du public systémiques et soutenues qui permettront à tous de devenir actifs. Cela signifie que les efforts de mobilisation du public peuvent aider un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes à mieux comprendre comment et où être actifs.
L’un des principaux aspects de cette démarche consiste à inclure les Canadiens et les Canadiennes dans l’élaboration de campagnes de sensibilisation où ils pourront jouer un rôle important dans la mise sur pied de programmes qui leur conviendront. Comme les nouvelles technologies jouent également un rôle déterminant pour accroître la participation du public, il faut miser sur celles-ci pour explorer des idées ou concevoir des outils qui pourront aider les gens à trouver des façons d’être actifs.
- Impératifs stratégiques
- 3.1 Mettre à jour les pratiques exemplaires canadiennes en matière de promotion de l’activité physique et tirer les leçons des programmes de mobilisation des collectivités qui ont connu du succès.
- 3.2 Concevoir des campagnes, des messages et des programmes de mobilisation du public nationaux, mais qui peuvent être adaptés et exécutés à l’échelle régionale ou locale (p. ex., en vue de maximiser la coordination, réduire au minimum les messages confus et respecter les particularités de chaque région ou collectivité) afin de créer un mouvement national d’engagement des Canadiens et des Canadiennes à s’asseoir moins et à bouger plus.
- 3.3 Donner la possibilité aux organismes autochtones de s’exprimer publiquement au nom des collectivités autochtones.
- 3.4 Rejoindre les individus là où ils passent beaucoup de temps (p. ex., à la maison pour les familles et à l’école pour les enfants, au travail pour les employés et dans les résidences pour personnes âgées) et là où ils se situent sur le continuum de l’activité physique (p. ex., aider les Canadiens et les Canadiennes inactifs à devenir actifs et aider ceux et celles qui sont actifs à le rester); le faire de façon appropriée, dans un langage accessible et inclusif.
- 3.5 Tenir compte des obstacles sociaux et financiers qui entravent la participation à l’activité physique, ainsi que des conditions qui contribuent à la sédentarité. Cela comprend les préjugés, les stéréotypes, les inégalités et la peur du rejet auxquels les groupes sous-représentés sont fréquemment confrontés dans leurs efforts pour être physiquement actifs.
- 3.6 Promouvoir et diffuser les recommandations canadiennes en matière d’activité physique quotidienne. Cela comprend la diffusion des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24heures, qui informent clairement les Canadiens et les Canadiennes qu’il convient de limiter le nombre d’heures passées assis et devant un écran, et qui leur présentent des recommandations sur le nombre d’heures de sommeil quotidien.
- 3.7 Encourager et mettre à profit de nouvelles approches (p. ex., sociofinancement, économie comportementale, innovation sociale, innovations technologiques, mesures incitatives) qui présentent des caractères évidents d’innovation.
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- Les parents, les enseignants et les éducatrices en service de garde, y compris les éducateurs en matière de santé, peuvent aider les enfants à trouver le bon équilibre entre activité physique, comportement sédentaire et sommeil suffisant. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures à l’intention des enfants et des jeunes (5 à 17 ans) et de la petite enfance (0 à 4 ans) sont une première mondiale. Elles permettent aux enfants et aux jeunes de connaître le nombre d’heures d’activité physique, de comportement sédentaire et de sommeil dans une journée de 24 heures qui leur convient.
- Les organismes, les fournisseurs de soins de santé et les dirigeants communautaires qui font de la prévention par la promotion de l’activité physique peuvent souligner que la gamme de ses bienfaits ne se limite pas à la santé physique. Il y a aussi des bienfaits sociaux, une amélioration de la santé mentale et une capacité accrue de résilience.
- Les municipalités, les organismes communautaires et les dirigeants peuvent mobiliser les groupes sous-représentés qui se heurtent à des obstacles particuliers à l’activité physique en adaptant à leur intention les messages et les possibilités. Cela peut comprendre des programmes de loisirs gratuits ou peu coûteux, ou des laissez-passer de transport en commun pour aider ceux qui font face à des obstacles financiers à l’activité physique à y avoir accès.
- Les organismes et les dirigeants peuvent consulter les usagers et les citoyens pour connaître leurs désirs et leurs besoins en matière d’accès ou pour améliorer leur expérience de l’activité physique. Les sondages, les enquêtes en ligne et les groupes de discussion ne sont que quelques moyens pour y parvenir. Les citoyens peuvent signaler à leurs dirigeants les obstacles qu’ils rencontrent et leur proposer des moyens qui leur permettraient de les surmonter. Cela pourrait comprendre des moyens de transport pour les personnes isolées dans les collectivités aussi bien urbaines que rurales.
- Les dirigeants dans les domaines de l’environnement et de l’éducation ou autres peuvent faire des infrastructures des parcs locaux des carrefours de vie et d’activité physique communautaires. Les réseaux de parcs provinciaux et nationaux peuvent offrir un accès gratuit ou peu coûteux au plein air, le plus grand terrain de jeu au Canada. Les parcs et les terres autochtones de grande importance culturelle et spirituelle sont des lieux où les gens entrent en contact avec la nature. Les parcs, les espaces verts, les jardins communautaires et les réseaux de sentiers facilitent l’activité physique, y compris le jeu libre non structuré. Ils favorisent également le contact social et le bien-être mental, et ont de nombreux autres bienfaits.
- Les organismes et les experts en promotion de la santé peuvent mettre à profit les médias sociaux et les autres technologies en ligne pour attirer l’attention des gens et les mobiliser. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et d’autres plateformes peuvent offrir un espace de rencontre virtuel pour rejoindre le public, mais on doit garder à l’esprit que les formes de sensibilisation plus traditionnelles peuvent être préférables pour communiquer avec les gens peu familiers avec ces technologies ou qui n’y ont pas accès. Les appareils portables, les applis de vie saine et les applis de suivi de la condition physique permettent aux consommateurs d’accéder en un seul endroit à leurs données de saines habitudes et à les surveiller. Même si le recours à des activités en ligne pour faire pratiquer des activités physiques peut sembler paradoxal, il peut s’agir du moyen le plus efficace de les rejoindre là où ils passent déjà la majeure partie de leur temps : en ligne.
4. Partenariats : Il est essentiel de travailler ensemble
Le contexte
L’augmentation du niveau d’activité physique et la réduction de la sédentarité au Canada sont des questions complexes. De nombreux facteurs peuvent influer sur la capacité d’être actif, aussi bien la condition économique que la santé, aussi bien le milieu de travail que l’environnement scolaire, aussi bien les lieux publics que les équipements privés, aussi bien les aptitudes que la sécurité, et bien d’autres facteurs.
Pour atteindre des objectifs communs, les approches doivent être multisectorielles, faisant intervenir toutes les composantes de la société. Par exemple, la promotion de l’activité physique dans une collectivité repose sur la mobilisation de nombreux secteurs et organismes, que ce soit dans le domaine du transport (p. ex., introduction de mesures d’apaisement de la circulation), dans celui des infrastructures (p. ex., ajout d’un meilleur éclairage), dans celui des soins de santé (p. ex., accent mis sur la prévention), dans celui des parcs (p. ex., maximisation de leur utilisation), dans celui de l’urbanisme (p. ex., amélioration de la piétonnisation) ou dans bien d’autres domaines. Un excellent travail se fait déjà dans ces domaines à tous les échelons, mais davantage de partenaires, d’horizons plus variés, doivent se rassembler. Les progrès seront plus importants si le secteur privé s’engage davantage, tout comme les organismes sans but lucratif, les services de garde, les établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire, les organismes qui œuvrent dans les secteurs du sport, du loisir et de la santé, et dans d’autres secteurs, ainsi que tous les paliers de gouvernement.
Le soutien et l’encouragement de l’activité physique sous toutes ses formes, du jardinage à la marche et au jeu en plein air, en passant par le transport actif et le sport de haut niveau, sont une responsabilité partagée. Tous les organismes, toutes les collectivités et tous les dirigeants qui ont à cœur de promouvoir l’activité physique et de réduire la sédentarité ont un rôle à jouer. Et c’est seulement en travaillant ensemble que des percées innovantes pourront être réalisées et que les objectifs communs pourront être atteints.
- Impératifs stratégiques
- 4.1 Faire valoir l’importance de la collaboration et de la coordination : susciter des attentes en matière de concertation et valoriser davantage la coopération pour faire progresser l’activité physique et réduire la sédentarité.
- 4.2 Élaborer un message commun pour que les gens s’unissent en vue d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire la sédentarité; inciter les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux à utiliser ce message lorsqu’ils prônent la collaboration et la coordination locales.
- 4.3 Établir des priorités et des objectifs communs clairs pour tous les secteurs (p. ex., santé, éducation, planification communautaire, infrastructures, transport, culture, plein air et autres domaines du secteur privé) dans une perspective d’actions concrètes (p. ex., déterminer les extrants et les résultats, agir sur ceux-ci, s’entendre sur les échéances, insister sur la responsabilité).
- 4.4 Soutenir les organismes et les dirigeants dans l’établissement de partenariats et de collaborations efficaces. Cela comprend l’examen des pratiques exemplaires en matière de collaboration avec le secteur privé et de mobilisation de ce dernier.
- 4.5 Adopter une approche de collaboration fondée sur les points forts particuliers de tous les partenaires dans tous les secteurs, accompagnée de rôles, objectifs et produits livrables clairs pour mesurer les progrès à court et à long terme.
- 4.6 Faire preuve d’inclusion à l’égard de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes signifie également de donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (2015). Il y a là la possibilité unique de reconnaître les injustices historiques et les actes de discrimination dont ont été victimes les peuples autochtones et de répondre à leurs besoins. De nombreux appels à l’action ont trait explicitement au sport, à la santé et à l’activité physique. Les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones peuvent aider à élaborer une stratégie visant à favoriser l’activité physique et la santé chez les Autochtones.
- 4.7 Faciliter la communication et la coordination au sein des ministères gouvernementaux et entre ceux-ci afin de tirer parti des approches « pangouvernementales ». Cela comprend l’établissement de politiques interministérielles (p. ex., en sport, loisir, santé, éducation et dans des domaines « non traditionnels » comme les infrastructures, le transport, le patrimoine et l’environnement) dans une perspective populationnelle plutôt que ministérielle. Par exemple, les politiques déjà en cours en matière d’éducation et de santé dans les provinces et les territoires afin de faire progresser l’approche globale de la santé en milieu scolaire.
- 4.8 Se pencher sur les facteurs de l’inactivité physique en renforçant les partenariats entre les gouvernements et les administrateurs des soins de santé, les médecins et les autres intervenants en santé qui travaillent en prévention.
- 4.9 Coordonner et harmoniser les politiques, stratégies et cadres pertinents dans les domaines du sport, de l’activité physique, du loisir et des saines habitudes de vie.
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- En vertu d’une approche globale de la santé en milieu scolaire, les commissions scolaires et les écoles peuvent collaborer avec les autorités sanitaires et les professionnels en loisir pour offrir diverses possibilités d’activité physique, notamment des initiatives qui favorisent le développement de la littératie physique chez les enfants et les jeunes avant et après les heures de classe. Les partenariats permettent plus facilement de donner aux enfants les bases solides de compétences, de connaissances et d’attitudes dont ils ont besoin pour participer avec confiance à une vaste gamme d’activités physiques dès les premiers stades de développement.
- Les programmes parascolaires pour enfants et jeunes des nouvelles familles canadiennes pourraient aussi être axés sur des connaissances et des méthodes pédagogiques enracinées dans leur culture mais intégrées aux programmes d’activité physique.
- Les professionnels et les bénévoles en loisir et en activité physique peuvent collaborer avec la communauté pour offrir des possibilités d’activité physique appropriées sur le plan culturel. Ils pourraient, par exemple, favoriser la réalisation d’activités territoriales traditionnelles. La chasse, la pêche, la trappe et la cueillette étaient autrefois des activités vitales chez les peuples autochtones du Canada et demeurent importantes dans certaines régions. Les avantages de ces activités en matière de développement physique peuvent être majeurs.
- Les professionnels de la santé, les organismes et les aînés dans les collectivités autochtones qui travaillent avec des personnes âgées (dans les centres pour personnes âgées, les groupes communautaires, les centres d’amitié, etc.) peuvent enseigner et promouvoir l’importance de l’activité physique quotidienne, source d’avantages sociaux, cognitifs, culturels et émotionnels, qui réduit et prévient les chutes, et prévient les maladies en général. Ils peuvent également collaborer avec les prestataires de services d’activité physique et les municipalités pour orienter les personnes âgées vers des programmes d’activité physique accessibles et de haute qualité dans leur collectivité, qui les aideront à développer leurs capacités motrices.
- Le secteur privé peut collaborer avec les organismes sans but lucratif et les gouvernements pour nouer des partenariats multisectoriels qui mettent à profit et apportent de nouvelles ressources, compétences et pratiques en matière d’activité physique.
- Les collectivités et les gens peuvent travailler avec les personnes ayant des handicaps physiques, intellectuels, sensoriels, comportementaux, développementaux ou autres, ainsi qu’avec celles qui font face à d’autres défis, y compris des problèmes de santé mentale et des maladies mentales, pour surmonter les obstacles à l’activité physique.
5. Leadership et formation : Il est crucial d’établir un solide réseau de leadership et de formation pour renforcer les capacités
Le contexte
L’expression « secteur de l’activité physique » fait souvent référence aux nombreux organismes et dirigeants qui œuvrent dans les domaines du sport, du loisir et de la santé au Canada, et qui jouent un rôle direct ou indirect dans la promotion de l’activité physique. Il est essentiel que les dirigeants et les bénévoles, l’échelle tant nationale que locale, aient les aptitudes, les qualifications et la sensibilité culturelle nécessaires, de même qu’une certaine connaissance de l’histoire des Autochtones, pour effectuer ce travail important. La qualité des programmes de sport, de loisir, de santé et autres programmes d’activité physique peut avoir une influence sur les gens, et les expériences marquantes peuvent avoir des effets positifs qui durent toute la vie. En dehors des programmes organisés, d’autres dirigeants ont besoin de soutiens semblables.
Parallèlement, il est essentiel de renforcer les capacités des acteurs au-delà du secteur traditionnel de l’activité physique. Il faut élargir le cercle d’influence pour y inclure tous les organismes et les dirigeants intéressés dans l’ensemble des secteurs. Même si le leadership en matière de promotion de l’activité physique se concentre chez les nombreux partenaires actuels du secteur de l’activité physique proprement dit, il est nécessaire de renforcer les capacités des intervenants en dehors des secteurs du sport, du loisir, de la santé et de l’éducation. Ces leaders peuvent travailler dans des secteurs aussi variés que l’urbanisme, les transports, les infrastructures, l’environnement, l’immigration, la culture, le patrimoine ou autres.
Il faut soutenir et renforcer tout particulièrement les capacités de ceux qui se trouvent « en première ligne ». Dans bien des cas, les bénévoles forment l’épine dorsale de l’intervention en matière d’activités physiques organisées et non organisées. Il est essentiel d’améliorer les soutiens à leur endroit pour parvenir à mettre les Canadiens et les Canadiennes sur la voie de la réussite.
- Impératifs stratégiques
- 5.1 Encourager les établissements d’enseignement postsecondaire à veiller à ce que tous les programmes de formation des enseignants incluent des cours obligatoires d’éducation en santé et en activité physique aux fins de l’obtention du diplôme.
- 5.2 Encourager le système d’éducation à exercer un leadership dans l’amélioration des possibilités d’activité physique tout au long de la journée scolaire, notamment en augmentant le temps consacré à une éducation physique de qualité, et en incitant les enfants et les jeunes à réduire leurs activités sédentaires.
- 5.3 Préconiser des jalons plus officiels dans les programmes d’études et le perfectionnement professionnel (p. ex., certificat de praticien en activité physique, formation continue). Il faut notamment élargir le cercle de mobilisation du secteur à des professionnels provenant d’autres disciplines (p. ex., la santé mentale, la nutrition), établir des normes de certification qui tiennent compte des programmes et titres de compétence existants, mais qui vont au-delà (p. ex., pratiques exemplaires en matière d’inclusion), et élaborer des normes éthiques à l’intention des professionnels en activité physique.
- 5.4 Inclure dans les programmes des éléments de contenu et des méthodes pédagogiques pertinentes sur le plan culturel qui sensibilisent les gens à l’histoire et au vécu des peuples autochtones et d’autres communautés au Canada.
- 5.5 Diriger les professionnels de terrain vers les pratiques exemplaires en formation et en perfectionnement professionnel, ce qui comprend des outils, des programmes et des ressources (p. ex., programmes d’activités parascolaires, programmes de jeu en sport, programmes d’activité physique liés à la culture). Il faut augmenter les possibilités d’enrichir les connaissances sur les moyens de surmonter les obstacles à l’activité physique et les façons de réduire au minimum les comportements sédentaires chez les gens de tous âges et de toutes capacités.
- 5.6 Aider les collectivités qui comptent sur les bénévoles (ainsi que celles qui font face à des pénuries de bénévoles ou à un roulement élevé des bénévoles, des entraîneurs ou des gestionnaires) à trouver de bonnes idées pratiques pour recruter des bénévoles et les soutenir afin qu’elles puissent offrir des programmes de qualité solides et crédibles.
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- Les établissements d’enseignement postsecondaire peuvent améliorer les programmes d’études et la formation des ingénieurs et des urbanistes en incluant l’activité physique comme principe dans la conception des immeubles et des quartiers. Par exemple, la planification peut prévoir des escaliers bien visibles, attrayants et sécuritaires. Les programmes d’études et la formation peuvent également être conçus de façon à favoriser une meilleure accessibilité des espaces à une variété d’utilisateurs (p. ex., rendre les bords de trottoir et les entrées universellement accessibles aux fauteuils roulants, poussettes et marchettes, prévoir des ascenseurs dans les logements à plusieurs étages, installer des plinthes contrastées et créer des espaces d’activité physique où tous les utilisateurs pourront se déplacer en toute aisance et en toute sécurité).
- Les commissions scolaires, les administrateurs et les associations d’enseignants peuvent trouver des moyens d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire les comportements sédentaires chez les élèves et le personnel au cours de la journée d’école, et offrir aux enseignants des possibilités de perfectionnement professionnel en matière de littératie physique.
- Le Grand Sentier (anciennement le Sentier transcanadien) est le plus long sentier récréatif au monde. Il invite à pratiquer une vaste gamme d’activités physiques dans divers environnements urbains, ruraux et sauvages. Le Grand Sentier a été aménagé grâce à l’initiative d’organismes sans but lucratif, d’entreprises privées et des divers paliers de gouvernement, municipal, provincial, territorial et fédéral, de tout le pays.
- Les groupes communautaires peuvent accroître les occasions de devenir physiquement actifs en mobilisant leurs membres. Par exemple, les « groupes de rencontre » qui utilisent les médias sociaux peuvent convoquer leurs membres à se retrouver dans un lieu public pour y faire une activité physique en groupe.
- Les aînés et les chefs de communautés peuvent transmettre des savoirs traditionnels pour concevoir et mettre en œuvre des programmes territoriaux efficaces enracinés dans la culture à l’intention des jeunes autochtones et non autochtones.
- Les professionnels de la santé peuvent aider leurs patients à accéder à des activités physiques gratuites ou peu coûteuses dans leur collectivité. Ils sont souvent les intervenants de première ligne lorsque les gens sont malades ou viennent les consulter pour leur examen annuel. Ils peuvent notamment les inciter à faire de l’activité physique comme mode de prévention des maladies, de réduction du stress ou de contribution à la réadaptation physique.
- Les établissements scolaires, les centres de la petite enfance, les centres d’amitié autochtones, les bénévoles et bien d’autres intervenants peuvent s’inspirer des nombreuses approches de leadership et de formation. Ces modèles peuvent être adaptés et intégrés, le cas échéant. Dans le monde du sport, de nombreux modèles favorisent l’apprentissage tout au long de la vie, comme Actif pour la vie ou le Développement à long terme des athlètes et participants. Les modèles devraient également intégrer l’égalité des sexes, l’accessibilité, l’inclusion socioéconomique, ainsi que l’inclusion sociale et culturelle. Il convient par ailleurs d’examiner d’autres modèles axés sur les enjeux importants du leadership.
6. Progression : Il est indispensable de savoir ce qui fonctionne
Le contexte
Dans les domaines qui doivent faire l’objet d’un suivi et de rapports, le Canada a déjà fait du bon travail dans tout le pays. Il peut être un leader mondial en matière de veille, d’évaluation, d’information et de présentation de nouvelles données probantes sur l’incidence de l’activité physique et de la sédentarité dans nos vies. Les initiatives et outils existants sont nombreux. Mentionnons, entre autres, les efforts du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux pour évaluer le niveau d’activité physique de la population et faire rapport à ce sujet; ces efforts orientent déjà les politiques visant à freiner l’excès de poids et l’obésité. On relève également des outils tels que les Directives canadiennes en matière d’activité physique, les Directives canadiennes en matière de comportement sédentaire, le modèle Le sport c’est pour la vie, les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures à l’intention des jeunes et des enfants en bas âge, ainsi que le Bulletin de l’activité physique chez les enfants et les jeunes de ParticipACTION. Et cet inventaire est loin d’être exhaustif.
Le défi consiste à partager et à utiliser efficacement ces ressources afin de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On peut mettre à profit les réussites, développer davantage les domaines féconds en possibilités, et continuer à améliorer le suivi et la qualité de l’information sur les nouvelles stratégies et solutions. Les démarches doivent permettre d’en arriver à une évaluation exhaustive de la complexité des facteurs systémiques qui favorisent ou entravent l’activité physique et la sédentarité chez tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Le renforcement et l’amélioration de la qualité de l’information, du suivi et de l’évaluation joueront un rôle clé.
- Impératifs stratégiques
- 6.1 Diffuser, à l’échelle nationale, provinciale, régionale et communautaire, des données de base qui englobent le continuum complet de l’activité physique sous toutes ses formes, et les classer en ordre de priorité. Il est tout aussi important de s’appuyer sur les données de base pour orienter les mesures de lutte contre la sédentarité.
- 6.2 Améliorer les outils et les systèmes de collecte de données et de veille à l’échelle nationale, provinciale, régionale et communautaire de manière à faire écho aux données probantes émergentes.
- 6.3 Collaborer avec des partenaires autochtones pour accroître le niveau de sensibilisation et de compréhension des protocoles nécessaires pour entreprendre des recherches avec les collectivités et les organismes autochtones, et mettre au point des méthodes pertinentes pour mener ces recherches.
- 6.4 Mettre l’accent sur la mesure du rendement et sa relation entre divers milieux (p. ex., établissements scolaires, parcs, lieux de travail) et les domaines d’intervention.
- 6.5 Favoriser une meilleure harmonisation des ressources et des résultats de recherche.
- 6.6 Coordonner et faciliter l’échange de connaissances et de pratiques exemplaires entre les professionnels, les responsables des politiques et les chercheurs, ainsi que des processus et des outils sous-jacents utilisés pour définir ces pratiques.
- 6.7 Élaborer un processus conjoint de suivi des progrès dans le but d’atteindre des objectifs communs, incluant les indicateurs communautaires.
- 6.8 Prioriser les investissements stratégiques et coordonnés, le partage des connaissances, ainsi que la qualité de l’information, le suivi et l’évaluation.
- 6.9 Améliorer les processus d’évaluation des professionnels de l’activité physique.
Soyons actifs – Quelques idées préliminaires sur la manière dont les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent commencer à mettre en œuvre ces impératifs stratégiques :
- Les municipalités, les ingénieurs et les urbanistes peuvent utiliser les outils du système d’information géographique (SIG) pour déceler les tendances et les points faibles en matière d’accessibilité piétonnière, d’accès aux infrastructures de loisir et d’utilisation des espaces verts dans les collectivités.
- Les commissions scolaires et les administrateurs des divers programmes peuvent évaluer la qualité de la programmation de l’activité physique et le temps d’activité sédentaire afin d’offrir des expériences appropriées sur le plan culturel et développemental, qui comprennent une activité physique modérée à intense suffisante, conformément aux Directives nationales sur le mouvement.
- Les municipalités et les chercheurs peuvent collaborer avec les collectivités et les professionnels en loisir pour évaluer l’état des parcs, des terrains de jeu et d’autres lieux publics afin de trouver la meilleure manière de rendre ces espaces plus actifs.
- Les groupes communautaires peuvent utiliser des listes de vérification et des outils d’autoévaluation (p. ex., Photovoice) fondés sur des données probantes pour évaluer les possibilités et les obstacles en matière d’activité physique dans les quartiers.
- Les gouvernements, les universitaires et les chercheurs peuvent travailler ensemble et en collaboration avec les partenaires pertinents, comme les organisations autochtones, pour inventorier et mettre à profit les activités de collecte de données afin de mieux orienter la planification et d’effectuer un meilleur suivi des résultats à l’échelle de multiples secteurs tels que l’éducation, l’environnement, l’urbanisme, l’aménagement paysager, le transport et la santé. Les peuples et les organisations autochtones doivent participer au processus de recherche.
- Les gestionnaires d’infrastructures de loisir peuvent en évaluer l’accessibilité et améliorer l’accès aux installations, s’il y a lieu. Ils peuvent, par exemple, vérifier si elles sont accessibles aux personnes handicapées. En outre, il est possible d’offrir aux groupes sous-représentés la possibilité de se mobiliser pour jouer un rôle actif dans la prise de décisions qui répondront mieux aux besoins de tous les membres de la collectivité. On appelle parfois cette démarche « Rien pour moi sans moi », ce qui signifie que tous les groupes qui seront touchés par le processus de prise de décision devraient être consultés.
Quatrième partie : La voie de l’avenir – Progresser ensemble
Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs n’est rien de moins qu’un cri de ralliement pour faire en sorte que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes soient moins assis et bougent plus. Cette approche a été conçue pour inciter tous les secteurs et les divers paliers de gouvernement à adopter ensemble de nouvelles mesures audacieuses afin d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire la sédentarité au Canada.
La Vision commune est également une invitation à tous les organismes, à toutes les collectivités et à tous les dirigeants qui ont à cœur d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire la sédentarité à unir leurs efforts dans un esprit de collaboration et à s’engager à la concertation et à la coordination, tout en respectant les responsabilités, les ressources et les rôles de chacun dans son propre domaine.
Ce que les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent faire
Tous les organismes, toutes les collectivités et tous les dirigeants qui ont à cœur d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire la sédentarité peuvent envisager des occasions immédiates de promouvoir, de partager et d’utiliser la Vision commune, soit seuls, soit en partenariat.
Promouvoir. Partager. Utiliser.
- Réfléchissez à la manière dont votre organisme ou votre collectivité pourrait mettre à profit la Vision commune.
- Comparez les domaines prioritaires et les impératifs stratégiques avec le mandat, la mission, le plan stratégique ou les priorités de votre organisme ou de votre collectivité qui favorisent l’activité physique et la réduction de la sédentarité chez vos membres, les utilisateurs de vos services, les autres intervenants dans votre milieu et vos partenaires.
- Faites référence à la Vision commune pour prendre des décisions éclairées et pour orienter la planification, l’allocation des ressources et l’élaboration ou la révision de vos stratégies, politiques ou programmes.
- Demandez-vous comment la Vision commune peut vous permettre de mieux mesurer et partager vos succès.
- Discutez avec des collègues de votre secteur ou d’autres secteurs pour trouver comment une nouvelle Vision commune de l’activité physique et de la réduction de la sédentarité pourrait les aider dans leur travail ou dans les rôles qu’ils jouent dans leur collectivité.
- Parlez de la Vision commune avec vos collègues, vos employés, les bénévoles et les dirigeants dans votre milieu; apportez le document aux réunions, aux congrès, aux ateliers et aux autres rassemblements locaux, régionaux ou nationaux; envoyez-le par courriel ou via les médias sociaux pour lancer la conversation.
- Collaborez avec d’autres organismes et collectivités autour de priorités communes afin d’optimiser l’utilisation des ressources, d’obtenir des résultats communs et de réaliser des changements dans tous les secteurs.
- Intégrez les principes de base de la Vision commune dans vos propres politiques et programmes, tout en ayant le souci de consulter les groupes clés qui seront touchés.
- Faites connaître les appels à l’action pertinents du Rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation et signalez les occasions de répondre aux besoins particuliers des peuples autochtones.
- Utilisez la Vision commune en tant que cadre d’un plan d’action en vue d’augmenter le niveau d’activité physique et de réduire les comportements sédentaires au sein de votre organisme ou de votre collectivité.
- Proposez des façons de l’utiliser pour renforcer ou réviser les politiques et les programmes existants en matière d’activité physique structurée ou non structurée, ou pour réduire la sédentarité dans votre organisme ou votre collectivité.
- Faites part de l’influence que la Vision commune peut avoir sur les environnements afin de favoriser une vie quotidienne plus active, y compris les activités territoriales traditionnelles.
- Mettez-vous au défi, vous et votre entourage de pousser plus loin la réflexion sur la manière dont la Vision commune peut aider à faire de l’activité physique la priorité.
- Prenez fait et cause pour la Vision commune.
Ce que les gouvernements peuvent faire
Le leadership est également essentiel pour rendre la population canadienne plus active. Les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique, du loisir, de la santé et de l’éducation jouent notamment un rôle clé dans la préparation du terrain visant à permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d’être moins assis et de bouger plus, et à les encourager en ce sens. C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux s’engagent à développer, coordonner et rassembler des organismes, des collectivités et des dirigeants dans tous les domaines pertinents.
Développer. Coordonner. Rassembler.
- Développer en s’appuyant sur les efforts existants : D’importants travaux collaboratifs s’effectuent déjà à l’échelle municipale, provinciale, territoriale et nationale pour augmenter le niveau d’activité physique et réduire la sédentarité chez les Canadiens et les Canadiennes; il faut les reconnaître et il faut qu’ils se poursuivent. Que ce soit dans le domaine du sport, du loisir, de la santé ou dans d’autres domaines publics, tous les paliers de gouvernement peuvent s’appuyer sur ces travaux. À l’aide de la Vision commune, tous peuvent chercher à établir des liens en vue d’efforts concertés visant à progresser vers les objectifs communs des politiques, des stratégies et des cadres de référence en matière de sport, d’activité physique, d’éducation, de loisir et de santé.
- Coordonner la planification et la prise de décisions : Tous les paliers de gouvernement doivent se réunir pour convenir de nouvelles manières emballantes de mettre en œuvre la Vision commune dans tous les domaines publics pertinents et pour trouver conjointement des pistes de succès rapide qui permettront de maintenir l’élan.
- Rassembler les organismes, les collectivités et les dirigeants : Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux poursuivent leur collaboration avec les organismes, les collectivités et les dirigeants pour promouvoir l’activité physique et réduire la sédentarité. Les gouvernements peuvent rassembler tous les partenaires et les Canadiens et les Canadiennes pour leur faire prendre conscience des avantages et des effets positifs de la Vision commune.
Ce que les gouvernements, les organismes, les collectivités et les dirigeants peuvent faire ensemble
En collaboration avec les autres intervenants, les gouvernements peuvent soutenir les politiques publiques favorables à la santé et en susciter de nouvelles; mettre à profit des outils communs pour obtenir des données comparables à l’échelle de tout le pays en vue d’orienter l’élaboration des politiques; s’associer à des recherches et à des expériences de pointe susceptibles d’améliorer le corpus des données probantes, y compris l’essai et la mise à l’échelle d’interventions éprouvées dans le domaine de l’activité physique et de la sédentarité; établir et coordonner de nouvelles relations et de nouveaux partenariats, y compris entre les ministères, les domaines politiques, les secteurs et tous les paliers de gouvernement; et renforcer la capacité des organismes d’offrir des programmes plus nombreux et plus efficaces.
Les données probantes montrent que les approches multisectorielles qui font intervenir tous les segments de la société sont nécessaires pour aborder les enjeux complexes qui touchent la population tout entière. C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux s’engagent à aller de l’avant en collaboration avec les autres intervenants.
En travaillant ensemble et avec les autres organismes, collectivités et dirigeants intéressés, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent AGIR de manière responsable, coordonnée, collective et transparente afin de favoriser une action concertée inspirée par la Vision commune.
Reddition de comptes
Aucun établissement ni secteur ne peut à lui seul obtenir les résultats et l’effet souhaités. Grâce au leadership du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, il est possible de prendre les mesures suivantes pour favoriser la reddition de comptes :
- Élaborer un cadre conjoint de reddition de comptes avec tous les organismes, toutes les collectivités, tous les dirigeants et tous les groupes clés concernés par la Vision commune et s’engager à le respecter.
- Préparer et mettre en œuvre un plan d’action de suivi et de production de rapports qui relève les progrès accomplis au moyen de la Vision commune et en faire état. Ce plan permettra de tirer profit des travaux en cours réalisés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres partenaires des domaines du sport, du loisir, et de la promotion des saines habitudes de vie et du poids santé.
Coordination et collaboration
Une nouvelle initiative concertée peut prendre en compte l’éventail des partenaires pancanadiens dans les secteurs dont l’intérêt et la contribution seront nécessaires pour obtenir les résultats et les effets partagés de la Vision commune. Grâce au leadership du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, il est possible de prendre les mesures suivantes pour favoriser le leadership, la responsabilité et les résultats partagés :
- Consigner la contribution et les rôles des organismes en fonction de leur mandat, de leurs ressources, de leurs priorités et de leurs pouvoirs respectifs.
- Animer des discussions visant à élaborer un mécanisme de coordination national permettant de faire progresser la Vision commune.
- Négocier et dégager un consensus sur les intrants, les activités, les extrants, les résultats et les effets souhaités des activités entreprises dans le cadre de l’initiative concertée.
- Aborder les appels à l’action pertinents du Rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (2015). Travailler à l’élaboration conjointe de politiques et de possibilités qui répondent aux besoins particuliers des peuples autochtones.
- S’appuyer sur les efforts en cours pour harmoniser et coordonner les politiques, stratégies et cadres de référence nationaux dans les secteurs du sport, de l’activité physique, du loisir et de la santé, entre autres domaines stratégiques.
- Désigner des champions ou des ambassadeurs motivés provenant de tous les horizons, qui seront responsables de la promotion et de la mise en œuvre de la Vision commune.
Transparence
Tous les gouvernements au pays manifestent de plus en plus un engagement à la transparence en préconisant des données ouvertes, une information ouverte et un dialogue ouvert. Le but est de promouvoir la transparence, de rendre les citoyens plus autonomes et responsables, et de tirer parti des nouvelles technologies. Le milieu des affaires, l’industrie, le secteur des organismes sans but lucratif, le milieu universitaire et les autres membres de la société civile partagent cet engagement. Grâce au leadership du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, il est possible de prendre les mesures suivantes pour assurer la transparence dans la mise en œuvre de la Vision commune :
- S’entendre sur un processus et un échéancier de production de rapports publics périodiques sur les mesures, les réalisations et les résultats découlant de la Vision commune.
- Étudier, en compagnie des autres organismes, collectivités et dirigeants concernés, de nouvelles manières de recueillir et de diffuser des données, relever les nouvelles possibilités d’échanger des données et d’y accéder, ainsi que de nouvelles façons de relier les données et les résultats communs et d’en faire état.
- Mettre au point une démarche de transfert des connaissances efficace.
Les gouvernements, les collectivités, les organismes et les dirigeants peuvent unir leurs efforts pour favoriser un leadership partagé en vue de promouvoir une nouvelle ère de vie active et de vitalité pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Nous pouvons tous aider la population canadienne à s’asseoir moins et à bouger plus, et contribuer à faire avancer le pays vers un avenir plus sain, plus heureux et plus actif.
Soyons actifs!
Références
- Note de bas de page 1
-
Ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs. Activité physique de la population au Canada, rapport infographique. 2015.
- Note de bas de page 2
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Winnipeg : Commission de vérité et réconciliation du Canada. 2015.
- Note de bas de page 3
-
Erasmus, Georges, et René Dussault. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. [Ottawa : Ont.]. 1996. Impression.
- Note de bas de page 4
-
Ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs. Politique canadienne du sport. [Inuvik : T.N.-O.]. 2012. Web.
- Note de bas de page 5
-
Conseil interprovincial du sport et des loisirs et Association canadienne des parcs et loisirs. Sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada. [Ottawa : Ont.]. 2015. Web.
- Note de bas de page 6
-
Canada actif 20/20 – Une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au Canada : créer une culture d’une nation active. Mai 2012.
- Note de bas de page 7
-
Agence de la santé publique du Canada. Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé. [Ottawa : Ont.]. 2011. Web.
- Note de bas de page 8
-
Patrimoine canadien. Politique de Sport Canada sur la participation des Autochtones au sport. [Ottawa : Ont.]. Mai 2005. Web.
- Note de bas de page 9
-
Patrimoine canadien. Politique sur le sport pour les personnes ayant un handicap. [Ottawa : Ont.]. 2006. Web.
- Note de bas de page 10
-
Patrimoine canadien. Mobilisation active : Politique concernant le sport pour les femmes et les filles. [Ottawa : Ont.]. Janvier 2009. Web.
- Note de bas de page 11
-
Conference Board du Canada. Developing a Pan-Canadian Physical Activity Framework: Consultation and Engagement Summary Report. Mars 2017. Web.
- Note de bas de page 12
-
Conference Board du Canada. Developing a Pan-Canadian Physical Activity Framework: Consultation and Engagement Addendum Report – Northern, rural, remote and/or Indigenous Perspectives. Mars 2017. Web.
- Note de bas de page 13
-
Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013. Ottawa : Statistique Canada. 2013. Web.
- Note de bas de page 14
-
Organisation mondiale de la Santé. Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. [Genève : Suisse]. 2010. Web.
- Note de bas de page 15
-
Organisation mondiale de la Santé. La sédentarité, une cause majeure de maladies et d’incapacités. Avril 2002. Web.
- Note de bas de page 16
-
Conference Board du Canada. Moving Ahead: The Economic Impact of Reducing Physical Inactivity and Sedentary Behaviour. Octobre 2014. Web.
- Note de bas de page 17
-
Cohen, Sarah S., et al. « Sedentary and Physically Active Behavior Patterns Among Low-Income African-American and White Adults Living in the Southeastern United States », in Robert L. Newton (éd.), PLoS ONE, vol. 8, no 4, e59975. Juin 2013. Web.
- Note de bas de page 18
-
Société canadienne de physiologie de l’exercice. Directives canadiennes en matière de mouvements sur 24 heures pour les enfants et les jeunes : une approche intégrée regroupant l’activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil. [Ottawa : Ont.]. 2016. Web.
- Note de bas de page 19
-
Tremblay, Mark. « Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project Process and Outcome », International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vol. 14, no 75. Juin 2017. Web.
- Note de bas de page 20
-
Hekler, Eric, et al. « The CHOICE Study: A “Taste-Test” of Utilitarian vs. Leisure Walking among Older Adults », Health Psychology. Stanford. 2011. Web.
- Note de bas de page 21
-
Statistique Canada. « The Daily », 3 mai 2017.
- Note de bas de page 22
-
Dion, Patrice, et al. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires 2009 à 2036. [Ottawa : Ont.]. Statistique Canada. 2010. Web.
- Note de bas de page 23
-
Statistique Canada. « The Daily », 25 octobre 2017.
- Note de bas de page 24
-
Statistique Canada. « The Daily », 25 octobre 2017.
- Note de bas de page 25
-
Statistique Canada. Les peuples autochtones : Feuillet d’information du Canada, 89-656-X. Ottawa : Statistique Canada. 2016. Web.
- Note de bas de page 26
-
Outil de données sur les inégalités en santé à l’échelle du Canada, édition 2017. Une initiative conjointe de l’Agence de la santé publique du Canada, du Réseau pancanadien de santé publique, de Statistique Canada et de l’Institut canadien d’information sur la santé. Impression.
- Note de bas de page 27
-
Chaput, Jean-Philippe, et al. « Proportion of Preschool-Aged Children Meeting the Canadian 24-Hour Movement Guidelines and Associations with Adiposity: Results from the Canadian Health Measures Survey », BioMed Central Public Health, vol. 17, no 829. Novembre 2017. Web.
- Note de bas de page 28
-
Statistique Canada. Enquête canadienne sur les mesures de la santé. Ottawa : Statistique Canada. 2014-2015. Web.
- Note de bas de page 29
-
Indicateurs de l’activité physique et sportive. Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie.
- Note de bas de page 30
-
Organisation mondiale de la Santé. Les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire. Kingston : Université Queen’s. 2013-2014.
- Note de bas de page 31
-
Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2016. Ottawa : Statistique Canada. 2016. Web.
- Note de bas de page 32
-
Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé. Approche globale de la santé en milieu scolaire. [Summerside : Î.-P.-É.]. 2017. Web.
- Note de bas de page 33
-
Déclaration de consensus canadien sur la littératie physique. Juin 2015. Web.
- Note de bas de page 34
-
Organisation mondiale de la Santé. A Life Course Approach to Health. [Genève : Suisse]. 2000. Web.
- Note de bas de page 35
-
Gouvernement du Canada, Agence de la santé publique du Canada. Qu’est-ce que l’approche axée sur la santé de la population? Janvier 2013. Web.
- Note de bas de page 36
-
White, Franklin, et al. Global Public Health : Ecological Foundations. [New York]. Oxford University Press. 2013.