Examen de l’importance de la recherche sur l’Antarctique au Canada
Par : Ann Balasubramaniam
La portée de la science antarctique pour le Canada
L’Antarctique, protégé par traité international et consacré à « la paix et à la science », occupe un territoire équivalant à un sixième de la planète, soit près de 14 millions de kilomètres carrés au sud du 60e parallèle1,2. Ce continent froid et couvert essentiellement de glace a permis d’acquérir des connaissances scientifiques importantes au fil du temps. Par exemple, les données recueillies par les premiers scientifiques canadiens, comme le physicien et glaciologue Charles Seymour Wright (expédition britannique Terra Nova, 1910-1913) et le géologue Fred Roots (expédition norvégienne-britannique-suédoise, 1949 1952), ont joué un rôle clé dans la compréhension de la tectonique des plaques à l’échelle mondiale et des migrations passées des continents3. De plus, au milieu des années 1980, des mesures de concentrations d’ozone dans l’Antarctique ont permis de mieux comprendre l’ampleur des pertes globales d’ozone. Ce constat a d’ailleurs accéléré l’adoption du Protocole de Montréal, accord qui a inspiré les pays à travailler ensemble pour réduire la production des substances appauvrissant la couche d’ozone4. Bien que la valeur extraordinaire de la région de l’Antarctique pour les programmes scientifiques nationaux et internationaux soit indéniable, le Canada n’a toujours pas de programme national de recherche sur l’Antarctique.
De nos jours, l’Antarctique continue d’être un important enjeu pour les chercheurs canadiens et internationaux. Plus de 150 spécialistes de partout au Canada ont effectué des recherches dans l’Antarctique sur un large éventail de sujets comme l’observation de la Terre, la biologie marine et des eaux douces, la géologie, la dynamique des glaces et la psychologie humaine5,6. Ces chercheurs proviennent de quatorze universités, de quatre organismes gouvernementaux et d’organisations de recherche indépendantes. Les travaux sur les changements touchant les glaciers, les courants océaniques, les carottes de sédiments, les carottes de glace et les communautés biologiques dans la région de l’Antarctique se sont révélés inestimables pour expliquer les systèmes mondiaux et les effets des changements climatiques6,7. La connaissance des facteurs influant sur les gaz à effet de serre, des liens bipolaires concernant la circulation océanique et atmosphérique, ainsi que du rôle de la région de l’Antarctique dans l’élévation du niveau des mers est essentielle pour mieux appréhender scientifiquement les changements climatiques1,11. En 2014, l’importance planétaire de ces questions a été soulignée dans les résultats de la « veille de l’horizon » du Comité scientifique pour les recherches antarctiques, qui indiquaient les questions de recherche les plus urgentes dans l’Antarctique et l’océan Austral telles que définies par la communauté internationale de recherche polaire12. Il va sans dire que pour le Canada, un pays qui constate un réchauffement rapide de ses régions arctiques et qui est vulnérable à la hausse du niveau des mers en raison des investissements publics et économiques importants réalisés le long de sa côte, participer à la recherche dans l’Antarctique lui permettra d’accroître sa capacité nationale d’anticiper les effets des processus qui se déroulent dans le Sud sur nos écosystèmes nordiques. En outre, l’expertise acquise par les chercheurs canadiens en étudiant l’Arctique canadien peut mener à des perspectives uniques et faciliter les comparaisons bipolaires1.
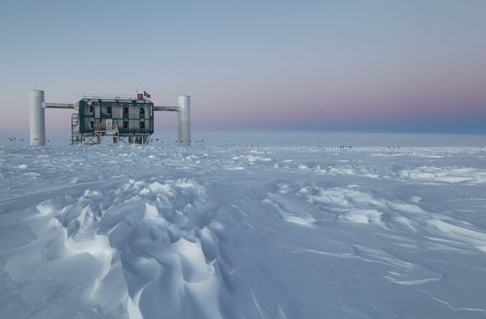
Le rôle national du Canada à l’égard de la science et de la gouvernance dans l’Antarctique
Dans l’Antarctique, la science est très étroitement liée à la gouvernance et constitue une sorte de monnaie influant sur la façon dont les pays interagissent et expriment leurs intérêts dans le continent11. Le Système du traité sur l’Antarctique (STA), créé dans la foulée de l’Année géophysique internationale (AGI) 1957-1958, forme la structure de gouvernance axée sur la collaboration pour la région de l’Antarctique1. En 1988, le Canada est devenu le 38e pays à signer le Traité sur l’Antarctique à titre de partie non consultative, donc non votante2. Depuis, le gouvernement du Canada a signé la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) à titre de partie coopérante11, a ratifié le Protocole de Madrid en 2003 et a promulgué la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique11. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) réglemente les activités des Canadiens dans l’Antarctique en vertu de cette loi. De plus, par le truchement du prédécesseur de Savoir polaire Canada, la Commission canadienne des affaires polaires, le Canada s’est joint au Comité scientifique pour les recherches antarctiques (CSRA), qui facilite la collaboration internationale dans les programmes de recherche sur l’Antarctique. Il a aussi créé le Comité canadien de recherches antarctiques (CCRA) pour donner des avis sur les questions antarctiques1,11. Les représentants de Savoir polaire Canada (POLAIRE) et d’ECCC participent à la réunion consultative annuelle du Traité de l’Antarctique afin de contribuer aux discussions sur la gouvernance dans l’Antarctique, dont bon nombre d’entre elles sont liées à la gestion scientifique et environnementale.
Questions et orientations futures
Malgré la participation active des scientifiques canadiens à la recherche sur l’Antarctique dans le cadre des programmes nationaux d’autres pays, le gouvernement du Canada, en raison de son statut de partie non consultative, ne peut voter sur d’importantes décisions de gouvernance dans l’Antarctique. Pour obtenir le statut de partie consultative, le Canada devrait déployer sur place des activités de recherche scientifique de taille, telles qu’établir une station de recherche scientifique ou mener une expédition scientifique11. De plus, en n’ayant pas de programme national sur l’Antarctique, il rate une occasion de soutenir et de favoriser l’expertise scientifique nationale existante dans la région2. Un programme national de recherche sur l’Antarctique améliorerait la coordination des chercheurs canadiens et permettrait à ceux¬ ci d’appliquer leurs connaissances dans l’Antarctique, tout en mettant l’accent sur les domaines prioritaires du Canada.
En réponse à ces questions, Savoir polaire vise à élaborer un programme canadien de recherche sur l’Antarctique en s’appuyant sur les conseils et l’orientation du CCRA1,11. POLAIRE consulte depuis un certain temps les chercheurs canadiens afin de déterminer les priorités nationales de recherche sur l’Antarctique. De plus, en raison d’un grand intérêt de la part de la communauté internationale de recherche polaire à effectuer des études dans l’Arctique canadien, POLAIRE travaille aussi activement avec les partenaires internationaux pour renforcer les ententes actuelles et accroître la coopération scientifique dans les régions polaires. En fait, il s’agit d’une occasion inégalée d’attirer des investissements de la part des instituts internationaux de recherche polaire, en particulier grâce à la Station canadienne de recherche dans l’Extrême Arctique, qui sera opérationnelle en 2017; ces fonds soutiendraient l’établissement d’un programme canadien de recherche sur l’Antarctique. Indéniablement, la création d’un tel programme rehausserait la capacité et la réputation du Canada en recherche bipolaire; elle lui permettrait aussi de demander un statut consultatif afin de participer à titre de partie votante aux réunions consultatives du Traité de l’Antarctique, ce qui assurerait au Canada de prendre part au processus décisionnel concernant les dossiers antarctiques d’importance mondiale11.
Références :
- (1) Comité canadien de la recherche Antarctique. La science Antarctique et les liens bipolaires : une stratégie pour le Canada, 2002. Consulté en ligne : http://www.polarcom.gc.ca/uploads/Antarctic%20Publications/Antarctic%20Science.pdf.
- (2) Loken, O. Toward a Canadian Antarctic Research Program. Centre canadien pour le développement de la politique étrangère, 1996. Consulté en ligne : http://dfait-aeci.canadiana.ca/view/ooe.b3765052/1?r=0&s=1 (document non traduit en français).
- (3) Scott Polar Research Institute. Site Web : Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition, 1949-1952. Consulté en ligne : http://www.spri.cam.ac.uk/resources/expeditions/nbsx/ (en anglais seulement).
- (4) Statistique Canada. Étude de cas : L’appauvrissement de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal. Consulté en ligne : http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch5/casestudy-edudedecas/5214797-fra.htm.
- (5) Ommanney, S. Annual Report on National Antarctic Scientific Activities Contributing to SCAR Programme Activities. Documents de la Commission canadienne des affaires polaires, 2005. Consulté en ligne : http://www.polarcom.gc.ca/uploads/Antarctic%20Publications/SCAR.pdf (document non traduit en français).
- (6) Simon, C., et L. Ommanney. Scientifiques affiliés à des institutions canadiennes dotés d’une expertise antarctique ou intéressés par ce continent, rapport pour le Comité canadien de la recherche antarctique, 2010.
- (7) Committee on Future Science Opportunities in Antarctic and Southern Ocean. « Future Science Opportunities in Antarctica and the Southern Ocean », National Academy of Sciences Report in Brief, 2011. Consulté en ligne : http://www.nsf.gov/geo/plr/usap_special_review/usap_brp/mtg_docs/nov2011/presentations/nrc_ant_rpt_smmry.pdf (en anglais seulement).
- (8) Indermuhle A., T.F. Stocker, F. Joos, H. Fischer, H.J. Smith, M. Wahlen, B. Deck, D. Mastroianni, J. Tschumi, T. Blunier, R. Meyer et B. Stauffer. « Holocene carbon-cycle dynamics based on CO2 trapped in ice at Taylor Dome, Antarctica », Nature, vol. 398, 1999, p. 121-126.
- (9) Rohling E.J., K. Grant, M. Bolshaw, A.P. Roberts, M. Siddall, Ch. Hemleben et M. Kucera. « Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles », Nature Geoscience, no 2, 2009, p. 500-504.
- (10) EPICA Community Members. « One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland and Antarctica », Nature, vol. 444 (7116), 2006, p. 195-198. Consulté en ligne : http://epic.awi.de/33179/1/2006epica_n.pdf (en anglais seulement).
- (11) Connexions polaires : Planification de la recherche antarctique canadienne, compte rendu d’un colloque international, Université de l’Alberta, Alberta, Canada, rév. par O.H. Loken, N.J. Couture et W.H. Pollard, 2004. Consulté en ligne : http://www.polarcom.gc.ca/uploads/Antarctic%20Publications/Polar%20Connections.pdf.
- (12) Kennicutt M.C., S.L. Chown, J.J. Cassano, D. Liggett, R. Massom, L.S. Peck, S.R. Rintoul, J.W.V. Storey, D.G. Vaughn, T.J. Wilson et W.J. Sutherland. « Polar research: Six priorities for Antarctic science « , Nature, vol. 512, 2014, p. 23-25. Doi : 10.1038/512023a. Consulté en ligne : http://www.nature.com/news/polar-research-six-priorities-for-antarctic-science-1.15658 (en anglais seulement).
- (13) Pêches et Océans Canada. Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAN-INN), 2005. Consulté en ligne : http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-iuu-fra.htm.
- (14) Ressources naturelles Canada. Demandes de soutien logistique dans l’Arctique, 2015. Consulté en ligne : http://www.rncan.gc.ca/le-nord/program-du-plateau-continental-polaire/demandes-logistique-arctiques/9992.