Critique de livre - Urban Warfare in the Twenty-First Century - Anthony King
Critique préparée par Amos C. Fox, candidat au doctorat à l’Université de Reading
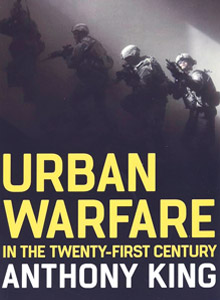
Campbridge, Polity, 2021
288 pp.
ISBN: 978-1-509-54365-6
Introduction
Dans la lignée d’autres sommités britanniques des études sur la guerre, notamment J.F.C. Fuller, B.H. Liddell Hart et Michael Howard, Anthony King offre un classique moderne en publiant Urban Warfare in the Twenty-First Century. Paru en 2021, l’ouvrage de King se démarque habilement de la plupart des écrits contemporains sur la guerre urbaine. L’auteur livre avec éloquence un récit sur la conduite de la guerre moderne, les raisons pour lesquelles les conflits modernes ont si souvent lieu dans des environnements urbains et la manière dont le caractère de la guerre urbaine peut être défini. Le travail de King s’appuie sur des exemples pertinents pour illustrer l’histoire de la guerre urbaine et la façon dont les changements dans les structures des forces militaires ont été parmi les principaux facteurs qui ont défini les combats urbains dans l’après-Guerre froide.
L’équilibre entre l’information qualitative et quantitative contenue dans ce livre forme une riche étude empirique de la guerre urbaine, sans submerger le lectorat avec une multitude de statistiques. De surcroît, la variété d’information que présente l’auteur, son style d’écriture vif, et son excellente sélection d’études de cas maintiennent l’attention du lectorat qui peine à lâcher l’ouvrage.
Résumé
King jette un regard empirique sur la montée de la guerre urbaine dans les conflits armés. Selon ses recherches, depuis la fin de la Guerre froide, le combat urbain représente une part disproportionnée des conflits armés comparativement aux autres époques de la guerre. En bref, King affirme avec justesse que la guerre et les combats urbains – quasi constants depuis les années 2000 – sont à la fois prédominants et déterminants dans les conflits armés modernes.
King soutient que les relations entre les armes, les villes et les forces sont essentielles à la compréhension de la guerre urbaine. De plus, il affirme que pour comprendre ce phénomène, il faut dépasser les limites de la pensée disciplinaire. Un état d’esprit interdisciplinaire est nécessaire pour bien saisir la guerre urbaine.
Conduite de la guerre
King présente plusieurs changements dans la guerre moderne qui permettent d’expliquer pourquoi les combats urbains sont devenus plus courants après la Guerre froide. Les trois changements les plus importants seraient l’augmentation de la portée et de la létalité dans les échelons inférieurs de l’organisation, le combat en fourrageurs, et les sièges. Ainsi, l’augmentation de la létalité et de la précision des armes à feu aux niveaux inférieurs de l’organisation, c’est-à-dire au niveau du peloton, de la section et de l’escouade, a poussé les combattants à rechercher la parité, non pas avec des armes comparables, mais en compensant les avantages de ces armes. La ville – formidable atout pour compenser des systèmes d’armes asymétriques – est devenue l’un des principaux éléments dont se servent les combattants pour accroître leurs chances face à un adversaire numériquement et technologiquement supérieur.
Le combat en fourrageurs est une autre adaptation de la guerre qui connaît une résurgence. Dans le contexte des combats urbains, il est le résultat d’acteurs plus faibles misant sur les zones urbaines pour contrebalancer les forces ennemies supérieures. L’auteur note qu’à Grozny, en 1994, des petits groupes de combattants tchétchènes ont mis en déroute des forces russes supérieures. Les Tchétchènes, qui connaissaient bien mieux la géographie urbaine tridimensionnelle de Grozny que le soldat russe moyen, se déplaçaient habilement d’un endroit à l’autre, éliminant les chars et les véhicules d’infanterie mécanisés russes, avant de disparaître comme des fantômes et de se regrouper dans un autre lieu central de la bataille.
Les sièges et les microsièges sont la dernière adaptation de la guerre que King explore. L’auteur note que les sièges connaissent un regain de popularité en raison de la parité qu’offrent les champs de bataille urbains. Ainsi, les acteurs qui ne souhaitent pas s’engager dans des combats de rue ont tendance à mener des sièges. Toutefois, comme les forces modernes sont de moins en moins nombreuses et que les villes sont de plus en plus grandes, il est souvent impensable d’encercler complètement une ville. Par conséquent, les microsièges remplacent les sièges à grande échelle. Les microsièges, comme l’encerclement par l’armée américaine de Sadr City à Bagdad dans le cadre de l’Opération IRAQI FREEDOM, deviennent plus courants. L’auteur affirme qu’à mesure que les villes continuent de s’étendre et que les forces terrestres continuent de décroître, les microsièges deviennent de plus en plus une composante de la guerre urbaine.
Villes
King soutient que l’une des principales raisons de l’augmentation de la fréquence des guerres urbaines est la croissance effrénée des villes dans le monde. Ainsi, des villes déjà grandes continuent de croître. Cette croissance urbaine a également transformé progressivement les petites villes et les villages en grandes villes. Alors qu’autrefois il était possible de se déplacer sur des terrains ouverts beaucoup plus passifs, l’espace physique d’aujourd’hui est moins restrictif puisque les villes sont beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient dans un passé récent. La croissance urbaine exerce donc un effet déterministe sur les combattants d’aujourd’hui, en les attirant dans les zones urbaines en raison de leur géographie et de la nécessité de survie.
Forces
King soutient de manière convaincante que les forces terrestres, nettement moins nombreuses que celles des générations précédentes, sont à l’origine de la généralisation des combats urbains. Dans le passé, notamment pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, les armées étaient extrêmement nombreuses et opéraient le long de fronts, ou sur une vaste bande de terre occupée par des soldats et des formations, tant en largeur qu’en profondeur. Les fronts militaires éliminaient tout ce qui se trouvait à l’intérieur de leurs limites. La taille des fronts rendait les combats urbains moins importants et moins visibles en raison de l’échelle de ces fronts, de l’importance des forces et de la moindre taille des zones urbaines comparativement à celles d’aujourd’hui. Cependant, avec la diminution du nombre de soldats dans les armées ainsi que la croissance des villes, il est pratiquement impossible pour les armées de dominer les zones urbaines et leurs quartiers, et les combattants les plus faibles ont recours au combat urbain pour contrebalancer la force de l’adversaire.
Recommandation
Le livre de King constitue un véritable monument en matière d’études sur la guerre urbaine. La diversité de l’ouvrage est sans doute sa plus grande qualité. De nombreux ouvrages sur les conflits armés ont tendance à se concentrer entièrement sur les répercussions en matière de politiques ou bien sur l’information concrète pour les intervenants. Urban Warfare se distingue des autres livres en intégrant des conclusions à la fois utiles pour les décideurs politiques et les intervenants. Pour les décideurs qui envisageraient un conflit armé comme solution à un problème politique, l’ouvrage remet en perspective les prédictions ambitieuses de la guerre éclair : les guerres sont remportées au prix de durs combats d’usure, qui sont aujourd’hui indissociables du champ de bataille urbain. En outre, le livre sert de mise en garde pour les décideurs politiques, car il laisse entrevoir un avenir de longues guerres d’usure en raison de la décroissance des armées modernes et de la parité que les zones urbaines offrent aux partisans et aux acteurs non étatiques hostiles.
De même, Urban Warfare présente aux intervenants des considérations réalistes à prendre en compte dans le cadre du combat urbain. Fondées sur les réalités du champ de bataille urbain, les considérations sont liées à l’emploi des forces, au développement des forces ainsi qu’à l’élaboration de doctrines et de concepts pour tous les niveaux de la guerre. En effet, les intervenants seront probablement confrontés à des sièges et à des microsièges lors de futurs combats urbains. En outre, les environnements urbains ne permettent pas d’optimiser la puissance aérienne ni d’autres capacités de précision, ce qui contrecarre les projets de guerre de courte durée. Plus à propos, l’auteur indique que la guerre urbaine écarte rapidement la perspective de batailles sanitaires, mais qu’elle augmente fortement la probabilité d’une impasse, de victimes civiles, et de dommages collatéraux, et qu’elle transforme les conflits armés en guerres d’usure.
Urban Warfare d’Anthony King est une contribution exceptionnelle aux études sur la guerre. L’ouvrage devrait figurer au sommet de la liste de lecture de toute personne étudiant les conflits armés modernes. Il s’agit d’une excellente introduction au caractère de la guerre moderne et fournit une trajectoire possible pour l’avenir de la guerre. Comme l’affirme King, la guerre urbaine n’est pas une simple tendance ni le résultat d’une mauvaise tactique. Au contraire, la guerre urbaine est une condition permanente des conflits armés modernes et futurs. Les personnes s’intéressant de près ou de loin à la compréhension des conflits armés modernes, les défenseurs du droit international humanitaire en temps de guerre, et les experts en matière de défense souhaitant acquérir les connaissances les plus utiles sur les conflits de l’après-Guerre froide devraient commencer par Urban Warfare in the Twenty-First Century. Il s’agit, sans conteste, d’un classique dans l’étude sur la guerre moderne.
Cet article a été publié pour la première fois dans l’édition d’octobre 2024 du Journal de l’Armée Canadienne (21-1).
