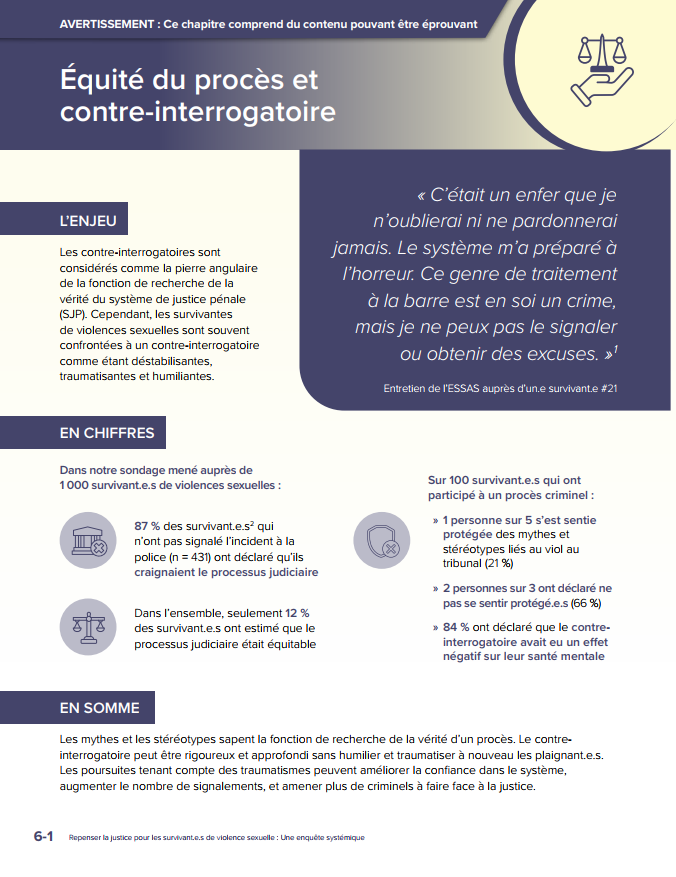Équité du procès et contre-interrogatoire
AVERTISSEMENT : Ce chapitre comprend du contenu qui peut être traumatisant
« C'était un enfer que je n'oublierai ni ne pardonnerai jamais. Le système m'a préparé à l'horreur. Ce genre de traitement à la barre est en soi un crime, mais je ne peux pas le signaler ou obtenir des excuses. »[1]
L’ENJEU
Les contre-interrogatoires sont considérés comme la pierre angulaire de la fonction de recherche de la vérité du système de justice pénale (SJP). Cependant, les survivantes de violences sexuelles sont souvent confrontées à un contre-interrogatoire comme étant déstabilisantes, traumatisantes et humiliantes.
EN CHIFFRES
Dans notre sondage mené auprès de 1 000 survivant.e.s de violences sexuelles :
- 87 % des survivant.e.s[2] qui n'ont pas signalé l'incident à la police (n = 431) ont déclaré qu’ils craignaient le processus judiciaire
- Dans l'ensemble, seulement 12 % des survivant.e.s ont estimé que le processus judiciaire était équitable
Sur 100 survivant.e.s qui ont participé à un procès criminel :
- 1 personne sur 5 s'est sentie protégée des mythes et stéréotypes liés au viol au tribunal (21 %).
- 2 personnes sur 3 ont déclaré ne pas se sentir protégé.e.s (66 %)
- 84 % ont déclaré que le contre-interrogatoire avait eu un effet négatif sur leur santé mentale
IDÉES CLÉS
- Malgré d'importants changements apportés au Code criminel, certains contre-interrogatoires reposent encore sur des mythes et des stéréotypes
- Certaines méthodes de contre-interrogatoire peuvent être déshumanisantes
- Les survivant.e.s ayant une déficience intellectuelle ou neurodivergents font face à un risque d’injustice disproportionnée
- Le contre-interrogatoire est traumatisant pour les enfants survivants, surtout lorsque deux témoignages sont requis
EN SOMME
Les mythes et les stéréotypes sapent la fonction de recherche de la vérité d'un procès. Le contre-interrogatoire peut être rigoureux et approfondi sans humilier et traumatiser à nouveau les plaignant.e.s. Les poursuites tenant compte des traumatismes peuvent améliorer la confiance dans le système, augmenter le nombre de signalements, et amener plus de criminels à faire face à la justice.
RECOMMANDATIONS
Enquêtes préliminaires
4.1 Éliminer les enquêtes préliminaires : Le gouvernement fédéral devrait modifier le Code criminel afin de supprimer les enquêtes préliminaires pour toutes les infractions sexuelles, protégeant ainsi les enfants et les plaignants vulnérables contre les préjudices causés par de multiples contre-interrogatoires.
Contre-interrogatoires
4.2 Revoir les procédures judiciaires pour améliorer les pratiques tenant compte des traumatismes et culturellement sûres : Le gouvernement fédéral devrait examiner le Code criminel afin d'accroître les pratiques tenant compte des traumatismes pour tous les essais. Les pratiques tenant compte des traumatismes devraient inclure accessibilité pour les personnes handicapées et des soutiens adaptés à la culture et aux Autochtones, comme des défenseurs des survivant.e.s autochtones dévoués.
4.3 Élaborer une stratégie nationale de justice pour protéger les enfants et les jeunes : Le gouvernement fédéral devrait envisager une stratégie nationale coordonnée pour défendre la dignité et la sécurité de tous les enfants et de tous les jeunes qui ont été victimes de violence sexuelle. Cette stratégie pourrait comprendre la normalisation nationale des protocoles d'entrevues judiciaires, la formation obligatoire des intervieweurs, des normes de formation nationales et l'accès universel aux centres d'appui aux enfants et aux jeunes.
Notre enquête
Contexte
Dans le jugement révolutionnaire de 1993 dans l'affaire R c. Osolin,[3] le juge Cory de la Cour suprême du Canada (CSC) a écrit : « Le plaignant ne devrait pas être indûment tourmenté et mis au pilori au point de le transformer en victime d'un système judiciaire insensible. »[4]
- Trente ans plus tard, les plaignants ont déclaré toujours être harcelés, intimidés et traumatisés à nouveau lors du témoignage à la barre.
Comme l'a écrit le juge Sopinka dans l'arrêt R c. Stinchcombe, « Le droit de présenter une défense pleine et entière constitue un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient pas déclarés coupables.[5] Cependant, si un procès criminel doit être équitable pour l'accusé, un procès qui n'est équitable que pour l'accusé n'est pas un procès équitable.[6]
« Si quelqu'un entreprend intentionnellement de concevoir un système pour provoquer des symptômes de stress traumatique, cela pourrait ressembler beaucoup à un tribunal. »[7]
Ce que nous avons entendu
Les survivant.e.s nous ont dit que :
- Le contre-interrogatoire a été très traumatisant. Cela a été catastrophique pour leur santé mentale et leur bien-être général,[8] provoquant des crises de panique pendant les mois qui ont suivi[9]
- Le contre-interrogatoire a été humiliant ; Les avocats de la défense s'amusent à détruire la survivante[10]
- Le contre-interrogatoire les a rendus très furieux[11]
- Le contre-interrogatoire les a amenés à ne plus jamais signaler de violences sexuelles[12]
- Le contre-interrogatoire a amené la survivante à croire que le SJP est fondamentalement défectueux en tant que moyen de justice pour les survivantes d'agression sexuelle[13]
Confiance du public dans le système de justice :
« J'étais trop terrifiée à l'idée de faire un signalement parce que je ne voulais pas avoir à aller au tribunal et à être contre-interrogée. »[14]
L'un des indicateurs les plus préoccupants de la façon dont les survivant.e.s sont traité.e.s dans le SJP provient des personnes qui travaillent dans le système. Les intervenants nous ont dit que la police avertit souvent les survivant.e.s que le signalement ne vaut pas la peine et la souffrance que cela causera. Un juge nous a dit que si son enfant était victime de violence sexuelle, il ne lui suggérerait pas d'avoir affaire au SJP.[15] Dans notre sondage auprès des survivant.e.s (n = 499), 28 % des survivant.e.s qui se sont rendus à la police pour signaler des violences sexuelles ont été découragés de faire un rapport officiel.
- La peur du processus judiciaire ne cesse de croître. Sur les 431 survivantes qui ont choisi de ne pas signaler les violences sexuelles à la police, 87 % ont déclaré que l'une des raisons pour lesquelles elles ne l'avaient pas fait était qu'elles craignaient le processus judiciaire.
- 96 % des survivantes qui ont subi des violences sexuelles en 2020 ou plus tard et qui ne l'ont pas signalée à la police ont déclaré que la peur du processus judiciaire était l'une des raisons de leur décision
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
« Le contre-interrogatoire est une expérience très traumatisante. L'agression sexuelle elle-même est déjà un événement horrible à endurer, mais le fait qu'un avocat de la défense agressif et froid vous pousse à douter publiquement de votre expérience devant le tribunal, auprès du juge, de vos amis et ceux qui vous soutiennent, de la presse, ça a été catastrophique pour ma santé mentale et mon bien-être général. Le système judiciaire n'a pas fait grand-chose, voire rien, pour nous soutenir en tant que victimes. Le juge et l'avocat de la défense se sentaient comme des robot médico-légaux disséquant chaque parcelle de preuve, ne montrant aucun soin ou empathie, aucune indication qu'il y avait devant eux un être humain vivant qui a été gravement blessé. L'accusé a agressé plusieurs femmes et pourtant le processus judiciaire semblait être conçu pour protéger l'accusé plus que les victimes. »[16]
« On ne m'a jamais dit que l'avocat de la défense ... pouvait se moquer de moi sur le stand et me crier après de nombreuses fois. On ne m'a jamais dit qu'il serait acceptable que l'accusé non seulement se lève et mente, qu'il me traite de grosse et de tous les noms et que ce serait permis. On ne m'a jamais dit qu'après avoir vu le procès retardé tant de fois, la défense serait en mesure de me garder à la barre pendant trois jours et de me contre-interroger. »[17]
Le contre-interrogatoire est parfois fondé sur des mythes et des stéréotypes
« Le contre-interrogatoire a été horrible. J'ai été surpris parce qu'ils ne sont pas censés poser de questions sur la base de mythes et de stéréotypes. Le juge n'a pas arrêté cette série d'interrogatoires. »[18]
« Mon agression a eu lieu quand j'avais 6 ou 7 ans, et on m'a demandé au tribunal : « Que portiez-vous au moment de l'agression? » Des questions comme celle-ci ont une insinuation négative. Ils sont hors de propos et font honte à la victime. »[19]
La CSC a statué à maintes reprises que « les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans un système juridique rationnel et juste, du fait qu’ils compromettent la fonction judiciaire de recherche de la vérité. ».[20] Dans l'affaire R c. Kruk,[21] la Cour suprême donne un aperçu des mythes et des stéréotypes sur le viol qui étaient utilisés pour discréditer les plaignantes. Ces mythes et stéréotypes perpétuent l'idée que les femmes sont moins dignes de foi et ne méritent pas une protection juridique contre la violence sexuelle. S'y fier est maintenant une erreur de droit.
Certains de ces mythes incluent :[22]
- Les véritables agressions sexuelles sont perpétrées par des individus qui ne connaissent pas la victime
- Les fausses allégations d’agression sexuelle fondées sur des motifs inavoués sont plus fréquentes que les fausses allégations relatives aux autres infractions
- Les véritables victimes d’agression sexuelle devraient avoir des lésions corporelles visibles
- Une plaignante qui a dit « non » ne voulait pas nécessairement dire « non » et peut avoir voulu dire « oui »
- Si la plaignante est restée passive ou n’a pas résisté aux avances de l’accusé, que ce soit physiquement ou verbalement en disant « non », elle était forcément consentante
- Une femme active sexuellement est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle qui fait l’objet de l’accusation et est moins crédible — aussi appelés les « deux mythes »
Ces mythes et stéréotypes détourne l'enquête de la conduite présumée de l'accusé pour s'intéresser à la valeur morale perçue du plaignant.
Les deux mythes sont énoncés au paragraphe 276(1) du Code criminel et s'appliquent à toute partie d'une procédure dans le cadre d'une poursuite relative à un crime de nature sexuelle.
- Les attitudes sociales négatives à l'égard des femmes ont souvent été utilisées pour différencier les « vraies » victimes de viol des femmes soupçonnées d'avoir inventé de fausses allégations par intérêt personnel ou par vengeance.
- Les préjugés à l'égard des femmes autochtones, noires, racisées, handicapées ou de la communauté 2ELGBTQI+ influencent également les attentes et les règles de la société à l'égard des victimes d'agression sexuelle.[23]
« Les mythes et les stéréotypes sont profondément enracinés dans nos croyances sociétales sur ce qu'est l'agression sexuelle et sur la façon dont une véritable victime d'agression sexuelle devrait se comporter. Le système de justice n'est pas à l'abri de ces mythes et stéréotypes. En fait, il existe plusieurs exemples bien médiatisés où des mythes et des stéréotypes ont été utilisés sciemment ou involontairement tout au long du processus pénal. »[24] [Traduction]
Même si le fait de s'appuyer sur des mythes et des stéréotypes est maintenant une erreur de droit, la capacité de les distinguer des raisonnements légitimes continue d'être un défi dans les procès pour agression sexuelle.[25]
- Une juriste a remarqué une tendance selon laquelle même si plus de juges sont formés en matière d'agression sexuelle, plus de procès devant jury sont choisis par l'accusé. Elle pense que c'est parce que la défense croit qu'il est peut-être plus facile d'invoquer des mythes et des stéréotypes avec un jury composé de profanes sans formation en matière d'agression sexuelle.[26]
- Une survivante que nous avons interviewée a expliqué à quel point elle était reconnaissante que le juge intervienne chaque fois que la défense s'appuyait sur des mythes et des stéréotypes dans ses questions.[27] D'autres survivantes ont demandé pourquoi le juge du procès ou le ministère public n'avaient pas mis fin à cette série de questions.[28]
- Une personne impliquée dans la formation des juges nous a dit que certains juges n'interviennent pas pour éviter un appel basé sur une allégation de partialité envers la victime.[29]
Comme on l’a fréquemment souligné, les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d’agression sexuelle et des catégories de dossiers ont trop souvent, dans le passé, entravé la recherche de la vérité et imposé un fardeau lourd et inutile aux plaignants dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel.»[30]
Au cours du procès criminel de cinq joueurs de hockey accusés d'agression sexuelle, les avocats de la défense ont contre-interrogé la plaignante au sujet de sa communication textuelle avec sa meilleure amie qui a eu lieu le lendemain de l'agression.
L'avocat de la défense a suggéré lors du contre-interrogatoire que si elle avait été agressée sexuellement, elle l'aurait dit à sa meilleure amie. Cette « suggestion » invoque explicitement le mythe selon lequel il est logique pour une victime d'agression sexuelle d'en informer les gens tout de suite. Le ministère public s'y est opposé, affirmant que cette série de questions reposait entièrement sur un raisonnement fondé sur le mythe.
Cependant, la défense a justifié ses questions à la Cour en affirmant qu'elles faisaient partie du contexte permettant de comprendre ses actions le lendemain. Le juge l'a autorisé.
Observation par le BOFVAC du procès R v. McLeod 2025 ONSC 4319
Bien qu'un juge puisse être en mesure d'analyser le raisonnement fondé sur un mythe à partir de son analyse, un jury peut être plus facilement influencé par l'insinuation sous-jacente du mythe et ne pas comprendre qu'il s'agit en fait d'une réaction traumatique normale de ne pas parler et de ne pas parler aux gens d'une agression sexuelle.
- Nous savons que les survivant.e.s d'agression sexuelle peuvent éprouver de la confusion, des traumatismes, de la honte, des doutes et ne dire à personne ce qui s'est passé, parfois pendant des années[31]
- Même si un jury a pour instruction de ne pas s'appuyer sur un raisonnement fondé sur un mythe, l'insinuation peut facilement conduire à un point d'interrogation dans l'esprit des juges et des jurés et soulever un doute sur la façon dont un « vrai » survivant se serait comporté
« Les jurys sont des profanes qui n'ont pas de formation dans l'interprétation de la loi et qui sont susceptibles de se livrer à la représentation théâtrale d'un avocat de la défense. La Couronne, quant à elle, pratique une forme de droit plus respectable, où elle n'utilise pas de mythes erronés, de stéréotypes ou n'attaque pas le caractère; elle ne fait qu'appliquer la loi à la situation. Dans la théâtralité dramatisée d'une salle d'audience, la vérité réelle est confuse, et les jurys prennent une décision basée sur une caricature de drame télévisé, et non sur des faits réels tels qu'ils ont été documentés mot pour mot dans la déclaration écrite de la police et l'entretien. »[32] [Traduction]
Étude de cas : Surveillance des tribunaux pour les agressions sexuelles
Dans le cadre d'un projet de trois ans visant à évaluer les réponses juridiques pénales à la violence sexuelle au Canada, WomenatthecentrE a assisté à 13 procès d'agression sexuelle à Toronto afin d'analyser l'administration de la justice dans les poursuites pour infractions sexuelles.
Les observateurs des tribunaux ont noté l'utilisation de mythes sur le viol et de stéréotypes à l'égard des plaignantes, qu'ils attribuent le plus souvent aux juges et aux avocats de la défense. Ils ont appliqué une perspective anti-oppression critique, y compris la race critique, le féminisme critique et les approches queer critiques pour mieux comprendre les déséquilibres de pouvoir dans la salle d'audience basés sur le genre, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, la capacité, la classe et la citoyenneté.
Elles ont souligné que l'administration des audiences fait des ravages chez les survivant.e.s, qui n'ont souvent pas été informés des changements et ont peut-être parcouru de longues distances pour se rendre au tribunal, pour se faire dire que l'affaire n'irait pas de l'avant et que les déplacements et la préparation seraient requises à nouveau un autre jour. Lorsque le personnel de la justice, l'accusé ou les plaignants ne se présentaient pas ou n'étaient pas préparés pour le procès, de nouvelles audiences étaient prévues des mois plus tard.
« Nous voulons également saluer les quelques acteurs exemplaires de la justice qui ont inlassablement dénoncé les mythes et les stéréotypes sur le viol, refusant de rester les bras croisés pendant que les plaignants étaient réprimandés et harcelés à la barre et en dehors. De même, nous dénonçons complètement la manière scandaleuse et décevante dont le système judiciaire lui-même et de nombreuses personnes en son sein continuent de traiter les survivantes de violences sexuelles. » [Traduction]
WomenatthecentrE a constaté que les preuves externes (preuves de tiers, d'experts, d'universitaires) présentées par la Couronne ont fait une différence significative sur l'issue de l'affaire, bien que les preuves continuent de faire l'objet d'un contre-interrogatoire et puissent encore être utilisées contre la plaignante. Les affaires qui ne présentaient pas d'éléments de preuve autres que le témoignage du plaignant ont souvent été qualifiées par la défense de « c’est la parole de la victime contre celle de l’accusé ».[33] WomenatthecentrE a également noté que les plaignantes de violence sexuelle sont réduites au statut de « témoins » dans le système judiciaire, sauf que leur témoignage est traité avec un degré plus élevé de doute et d'incrédulité que d’autres témoins ou victimes d'actes criminels.[34]
Sondage auprès des survivant.e.s :
Malgré les efforts pour réduire la prévalence des mythes et des stéréotypes sur le viol devant les tribunaux, les survivantes nous ont dit qu'elles ne se sentaient pas protégées. Sur 100 survivant.e.s qui ont participé à un procès criminel :
- 1 survivante sur 5 a déclaré qu'elle se sentait protégée contre les mythes et les stéréotypes sur le viol devant les tribunaux (21 %)
- 2 survivant.e.s sur 3 ont déclaré ne pas se sentir protégé.e.s (66 %)
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
La protection fait partie d'un processus équitable. Sur les 66 survivantes qui ne se sont pas senties protégées contre les mythes et les stéréotypes sur le viol lors du contre-interrogatoire, seulement 4 ont estimé que le processus judiciaire était équitable (6 %). Dans l'ensemble, seulement 12 % des survivant.e.s estimaient que le processus judiciaire était équitable. 84 % ont déclaré que le contre-interrogatoire avait eu un effet négatif sur leur santé mentale et seulement 12 % estimaient que le contre-interrogatoire avait soulevé des faits pertinents à l’affaire.
Certaines méthodes de contre-interrogatoire sont déshumanisantes
« Les victimes ne devraient pas être obligées de garer leur dignité à la porte de la salle d'audience. »[35] [Traduction]
« L'aspect le plus préjudiciable du processus a été d'être contre-interrogé... C'était humiliant et rabaissant. »[36] [Traduction]
« Le contre-interrogatoire a été gravement traumatisant et humiliant. Il a inventé des choses et a essayé de convaincre le jury de mensonges éhontés. Il a essayé de prendre tous les détails qu'il pouvait et de me faire paraître aussi horrible que possible. C'était au-delà de la violence psychologique. Je n'ai pas été en mesure de parler en public par la suite jusqu'à ce que je me sois remise du traumatisme. L'avocat était pire que le criminel. Je suis certaine que le criminel a aimé me voir être humiliée; il a lui-même créé la moitié des insultes. C'était une extension des horreurs que j'ai vécues et ça ne devrait pas être permis. »[37] [Traduction]
Le contre-interrogatoire est un élément clé du droit à une défense pleine et entière,[38] cependant, « le droit de contre‑interroger n’est pas sans limites. »[39] [Traduction]
- L'avocat de la défense doit être de bonne foi pour poser ses questions.[40]
- L'équité du procès ne garantit pas à l'accusé le meilleur processus sans tenir compte d'autres facteurs. Un procès équitable doit également tenir compte des préoccupations sociétales plus larges.[41]
- « Le droit à un procès équitable ne garantit pas “le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé”. »[42]
Le processus judiciaire a pour but la recherche de la vérité et, à cette fin, le témoignage de tous les participants à des poursuites judiciaires doit être donné de la façon la plus propre à faire éclater la vérité.
Madame la juge L'Heureux-Dubé
dans l'arrêt R c. Levogiannis, 1993 CanLII 47 (CSC).
La violence sexuelle est intrinsèquement et intentionnellement traumatisante. C'est un crime de pouvoir et de domination. Si les survivant.e.s doivent répondre à des questions difficiles et revivre leurs expériences pour que les auteurs de crimes répondent de leurs actes, il faut qu'on leur donne une chance équitable de le faire. Une chance équitable signifie que la Couronne, la défense et les juges doivent comprendre l'impact du traumatisme et la façon dont il peut affecter le témoignage d'un plaignant.
- Les personnes qui ont subi un traumatisme ont plus de difficulté à se souvenir de certains types de détails, tels que les dates et les heures.[43]
- Les survivant.e.s de traumatismes sont encore plus désavantagés devant les tribunaux car il est plus difficile de raconter leur histoire de manière cohérente, surtout durant un interrogatoire hostile.[44]
- Des recherches ont montré qu'il existe des types de questions qui sont mieux adaptées pour déclencher un souvenir[45]
La peur du contre-interrogatoire
L'une des principales raisons invoquées par les femmes pour ne pas signaler les violences sexuelles est la peur du processus de justice pénale.[46] Nous avons appris :
- Certaines survivantes nous ont dit que le contre-interrogatoire avait été ressenti comme une infliction intentionnelle d'angoisse mentale
- Certaines l'ont décrit comme un harcèlement sexuel facilité par l'État[47] ou un deuxième viol[48]
- Le contre-interrogatoire est perçu comme abusif pour de nombreuses survivantes parce qu'elles n'ont pas le droit de refuser d'être contre-interrogées[49]
- Les défenseurs croient que le contre-interrogatoire est souvent utilisé pour déséquilibrer les plaignants, les humilier et les pousser à abandonner
« Nous savons maintenant pourquoi les victimes d'agression sexuelle hésitent à porter des accusations criminelles. Protégés par la présomption d'innocence, les accusés n'ont pas à témoigner pendant que le plaignant est impitoyablement grillé par les avocats de la défense lors des contre-interrogatoires. »[50][Traduction]
Certains exemples de contre-interrogatoire étaient si flagrants qu'ils semblaient s'apparenter à un traitement cruel et inhabituel.[51] Dans ces cas, la défense semble essayer de faire honte et d'intimider la victime, devant l'accusé et tout le monde devant le tribunal.[52]
- Plusieurs survivant.e.s ont l'impression que la défense semble prendre plaisir à les humilier et à les confondre sans pitié pendant qu'on leur fait revivre publiquement leur traumatisme. Les avocats de la défense semblent croire qu'un contre-interrogatoire tortueux avantagera leur client en discréditant le plaignant ou en l'obligeant à laisser tomber.[53]
L'humiliation comme tactique délibérée
Une survivante de violence sexuelle entre partenaires intimes et de contrôle coercitif a fait l'objet d'un contre-interrogatoire prolongé et invasif au cours duquel la Cour a autorisé la diffusion de plusieurs heures de séquences vidéo choquantes, enregistrées à son insu, sur un grand écran pendant plusieurs jours. Ces images faisaient partie des accusations d'agression sexuelle et de voyeurisme.
La Cour a permis à la défense de mettre la vidéo en pause à plusieurs reprises pendant qu'elle l'interrogeait – de sorte que des images choquantes d'elle étaient projetées pendant qu'elle témoignait. La Cour a également autorisé la création et la distribution de plusieurs brochures imprimées contenant des photos image par image de l'agression. Ces brochures étaient visiblement empilées sur des bureaux dans la salle d'audience et utilisées pour l'interroger dans les moindres détails. Elle était très troublée à l'idée de savoir qui avait vu ces images, car l'avocat ne les a sûrement pas imprimées, découpées et reliées professionnellement lui-même.
Plutôt que de reconnaître le traumatisme d'avoir été confrontée à des enregistrements non consensuels de sa propre agression sexuelle, la Cour a traité ces documents comme des outils de preuve pour la discréditer. Cette approche l'a non seulement traumatisée à nouveau, mais a également créé une expérience publique et humiliante qui a aggravé le mal initial. Notamment, le jugement n'a pas reconnu la nature voyeuriste des enregistrements, ni l'impact invasif de leur présentation de cette manière au tribunal.
- Entretien avec une survivante #198
L'examen minutieux de ce que la victime a fait ou n'a pas fait, plutôt que des actions de l'accusé, peut déterminer l'issue d'une affaire.[54]
- Un style combatif d'avocats en matière d'agression sexuelle était autrefois promu par les membres seniors du barreau et enseigné dans les facultés de droit.[55]
- Les avocats de la défense qui ont utilisé des techniques agressives de contre-interrogatoire au point de dévaster complètement le témoin ont été considérés comme brillants.[56]
- Si l'objectif d'un procès criminel est la recherche de la vérité, nous devrions poser des questions qui facilitent cet objectif plutôt que d'interférer avec celui-ci.[57]
« La défense a été capable de lancer des déclarations farfelues ou des mensonges. ‘Je vais suggérer que vous vouliez que cela vous arrive...’ Essayant de vous ébranler. Destiné à vous déséquilibrer. »[58] [Traduction]
« Mettre un bouledogue là pour mettre [le témoin] en pièces est barbare. »[59] [Traduction]
Dans l'affaire R c. Khaery, la victime était une femme racialisée de 19 ans. Elle n'a pas voulu témoigner. Une colocataire et quatre secouristes ont été témoins oculaires du viol, mais elle a tout de même été soumise à cinq jours de contre-interrogatoire :
« Je n'étais pas préparée aux questions... Je pensais que je pouvais gérer, et à la fin de la semaine, j'étais épuisée et juste... Je ne pouvais plus le supporter mentalement. J'ai cru que j'allais craquer. » [Traduction]
Après le troisième jour du contre-interrogatoire, elle s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle se sentait suicidaire.[60]
Les approches tenant compte des traumatismes et de la violence tiennent compte de l'impact de traumatismes sur le cerveau. Ces approches sont fondées sur des données probantes et tiennent également compte de l'impact de la violence. Elles visent à transformer les politiques et les pratiques en fonction d'une compréhension de l'impact des traumatismes et de la violence sur la vie et les comportements des victimes. Ces approches sont compatibles avec les efforts visant à rendre les politiques et les pratiques plus sûres sur le plan culturel, et appuyées par ceux-ci.[61]
Les poursuites tenant compte des traumatismes peuvent aider les tribunaux à rechercher la vérité et à améliorer la confiance dans le processus de justice pénale. Comprendre l'éventail des réponses normales au traumatisme peut empêcher les survivant.e.s d'être injustement traité.e.s comme n'étant pas crédibles ou fiables. Par exemple:
- L'auto-culpabilité et la honte sont des réactions courantes à l'agression sexuelle. Les poursuites tenant compte des traumatismes utilisent ces connaissances pour reconnaître que l'auto-culpabilité et la honte ne signifient pas que la survivante était consentante.
- Le contact sexuel est un sujet très privé et personnel dans toutes les cultures. Les poursuites tenant compte des traumatismes appliquent ces connaissances pour comprendre que la difficulté à répondre aux questions ne signifie pas un effort pour cacher la vérité.
- Une terminologie trompeuse peut brouiller la vérité pour le plaignant, le public et la Cour. Les poursuites tenant compte des traumatismes font attention aux mots utilisés pour décrire les actes en question.
- Des termes tels que « embrassé » pour décrire une expérience de violence sexuelle confondent une agression avec une relation sexuelle consensuelle. Les poursuites tenant compte des traumatismes utilisent un langage descriptif et factuel tel que « mettre sa bouche sur ta bouche. »[62]
Les poursuites tenant compte des traumatismes tiennent également compte du fait que les actes impliqués dans une agression sexuelle sont socialement normatifs dans différentes circonstances. Ce n'est pas le cas pour les autres formes de voies de fait.
- Un coup de poing au visage est toujours une agression. Un homme qui met son pénis dans le vagin d'une femme peut être soit un acte sexuel consensuel, soit un acte de violence.[63]
« S'ils arrêtaient de permettre aux avocats de la défense de harceler et de détruire les témoins à la barre. Vous pouvez discréditer un témoin sans dévaster complètement quelqu'un. »[64] [Traduction]
D'autres pays s'efforcent également d'améliorer la justice tenant compte des traumatismes.
Le gouvernement de l'Écosse a créé un programme national comprenant un large éventail de secteurs et de services pour prévenir et répondre plus efficacement aux expériences négatives de l'enfance.
- Le programme fournit des modules éducatifs, des guides de formation et d'autres références à toute personne travaillant avec des personnes ayant subi un traumatisme.
- L'un des principes clés est d'éviter une nouvelle victimisation. Le programme reconnaît que les services et les systèmes peuvent créer d'autres traumatismes et que les politiques, et pas seulement les fournisseurs de services, doivent tenir compte des traumatismes.[65]
Étude de cas : Comment l'identité façonne l'expérience des survivant.e.s dans le SJP
Contexte
Dans l'arrêt R c. N.S.,[66] une musulmane qui porte le niqab a déclaré avoir été agressée sexuellement dans son enfance par son oncle et son cousin. Adolescente, elle a révélé les abus à un enseignant, mais la police n'a pas porté d'accusations. À l'âge adulte, elle s'est de nouveau manifestée.
À l'enquête préliminaire, l'accusé a demandé à N.S. d'enlever son niqab pour témoigner, faisant valoir que leur droit à un contre-interrogatoire exigeait de voir son visage. Sans représentation juridique, N.S. a expliqué au juge que le port du niqab faisait partie de son identité religieuse.
Malgré cela, la Cour a mis en doute la sincérité de sa foi, pointant du doigt la photo de son permis de conduire, sur laquelle son visage était visible, ce qui impliquait une incohérence.[67] La Cour d'appel de l'Ontario a par la suite rejeté ce raisonnement et a conclu qu'il s'agissait d'une forme d'« altérité ».[68]
Droits constitutionnels en conflit
En appel devant la CSC, l'accent a été mis sur un débat constitutionnel sur la liberté de religion et l'équité du procès. La Cour a créé un critère de pondération en quatre parties que les juges du procès peuvent appliquer lorsque le fait que le fait de dissimuler la religion d'un témoin est soulevé comme une préoccupation.[69]
Dans une dissidence, la juge Abella a mis en garde contre l'effet dissuasif :
« La conclusion de la majorité selon laquelle l'impossibilité de voir le visage du témoin est acceptable du point de vue d'un procès équitable si la preuve n'est « pas contestée » signifie essentiellement que les plaignantes d'agression sexuelle, dont le témoignage sera inévitablement contesté, seront forcées de choisir entre porter plainte et porter le niqab, ce qui, comme je l'ai déjà mentionné, pourrait ne pas être un choix significatif du tout. »[70]
Lors d'un deuxième procès, N.S. n'a jamais eu l'occasion de témoigner. Les accusations ont finalement été abandonnées.[71]
En somme : Les témoignages des survivant.e.s issus de milieux marginalisés peuvent être examinés ou contestés d'une manière qui les discrédite et détourne l'attention de la violence qu'ils ont subie. En insistant pour que N.S. retire son niqab afin de continuer, l'accusé et le système judiciaire ont reflété certains aspects du préjudice qu'elle avait signalé, l'obligeant à être exposée à la honte et la vulnérabilité.
Certaines méthodes de contre-interrogatoire sont injustes pour les survivant.e.s ayant une déficience intellectuelle ou neurodivergents
« Le droit au contre-interrogatoire ne s'étend certainement pas au droit de tirer parti des difficultés des témoins vulnérables. »[72] [Traduction]
« Nous faisons en sorte qu'il soit si facile pour les hommes d'agresser sexuellement des personnes ayant une déficience intellectuelle. »[73] [Traduction]
« Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont de quatre à dix fois plus susceptibles d'être victimes d'agression sexuelle que la population générale. »[74] [Traduction]
Nous avons entendu ce qui suit :
- Lorsque des survivant.e.s ayant une déficience intellectuelle ont la chance de témoigner, certains avocats de la défense tentent intentionnellement de faire taire leur témoignage en posant des questions destinées à les semer la confusion.[75]
- Les juges n'intervenaient pas assez souvent pour aider les témoins ayant une déficience intellectuelle à s'assurer qu'ils comprenaient la question.[76]
- Lors des requêtes en admissibilité et de production de documents, les victimes ayant une déficience intellectuelle peuvent être touchées de manière disproportionnée parce que
- ils peuvent ne pas comprendre le raisonnement pour retenir les services d'un avocat ;
- Ils peuvent divulguer eux-mêmes des renseignements personnels qui pourraient être utilisés contre eux
- ils peuvent consentir à ce que leurs documents soient consultés sans en connaître les répercussions.
- Certains défenseurs croient que les méthodes traditionnelles de contre-interrogatoire sont discriminatoires à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle.[77] Ils insistent que l'utilisation d'un langage et de questions complexes peut être particulièrement déroutante lors du contre-interrogatoire pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces personnes peuvent être particulièrement vulnérables aux questions suggestives très suggestives souvent utilisées en contre-interrogatoire.[78]
La juge en chef McLachlin a écrit : « En fixant des critères trop exigeants relativement à l’habilité à témoigner des adultes ayant une déficience intellectuelle, on permet à des contrevenants d’agresser sexuellement ces personnes presque impunément, »
R c. D.A.I., 2012 CSC 5 (CanLII).
La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées stipule que « Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres» et que « Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique »
Article 12 Version française
« Nous devons, bien sûr, veiller à ce que les personnes ayant des handicaps mentaux et physiques bénéficient d'une protection égale de la loi garantie à tous par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. »[79] [Traduction]
Le paragraphe 1 de l'article 15 garantit que « la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »[80]
- La CSC a souligné que « l’égalité ne signifie pas nécessairement traitement identique et que le modèle formel du "traitement analogue" peut en fait engendrer des inégalités.»[81]
- Pour que les témoins handicapés soient traités de manière égale, il faut qu'ils aient une chance équitable de s'exprimer. Ils ne doivent pas être considérés comme moins crédibles parce que leur cerveau traite l'information de différentes manières.[82]
D'importants progrès ont été réalisés pour améliorer l'accessibilité.
- Deux dispositifs d'aide au témoignage (personne de soutien, témoignage à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran) sont présumés pour les personnes handicapées.[83]
- Nous avons appris que, selon l'endroit où vit la victime, la télévision en circuit fermé pour les témoignages en dehors de la salle d'audience peut ne pas être disponible.
Les intermédiaires en communication sont une autre option pour accroître l'accès au processus de justice pénale pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles de la communication.
- Les intermédiaires en communication peuvent aider la Cour avec des témoins qui communiquent d'une manière qu'un tribunal traditionnel n'est pas en mesure de comprendre.[84]
- L'article 6 de la Loi sur la preuve au Canada[85] peut être interprété de manière à permettre et à faciliter le recours à des intermédiaires en communication et à assurer le respect des droits à l'égalité.[86]
Un exemple de l'incapacité à protéger les personnes handicapées a été mis en lumière dans une horrible situation d'abus sexuel où des résidents handicapés ont été agressés sexuellement pendant des années par un travailleur de leur foyer de groupe.
La personne qui les a agressés a déclaré qu’« il a attendu d'être seul avec les victimes pour donner suite à ses pulsions et les a ciblées parce qu'elles ne parlaient pas et ne pouvaient pas le dénoncer ».[87] [Traduction]
- « Une infirmière aux urgences m'a dit que personne ne me croirait et que cela ne valait pas la peine d'être signalé. Elle a dit que je serais déchirée à la barre parce qu'on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. »[88] [Traduction]
Neuro-divergence et crédibilité
Une survivante neurodivergente, diagnostiquée avec un TDAH [trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité] et une douance, a été à plusieurs reprises qualifiée à tort de manque de crédibilité en raison de la communication et des traits cognitifs correspondant à son profil. Par exemple, le juge a noté que ses réponses étaient parfois si longues qu'elle « oubliait la question », ce qui impliquait qu'elle était évasive. En réalité, ce modèle reflète des défis bien documentés du TDAH avec la mémoire de travail et une tendance à fournir des explications détaillées et contextuelles, une stratégie courante utilisée par les personnes neurodivergentes et surdouées pour assurer l'exactitude.
Par exemple, elle a corrigé l'avocat de la défense, qui a affirmé qu'elle avait témoigné que l'accusé l'avait « giflée au vagin ». Elle a réfuté cette affirmation, expliquant qu'elle n'avait pas utilisé et qu'elle n'utiliserait pas ce terme parce que le vagin est un organe interne et que l'accusé lui avait frappé la vulve et le clitoris. Son utilisation précise du langage, motivée par un besoin d'exactitude factuelle et une crainte d'être perçue comme malhonnête, a plutôt été interprétée comme argumentative et a finalement contribué à la conclusion du juge qu'elle n'était pas crédible.
Ces exemples reflètent les résultats des recherches actuelles, qui démontrent comment les témoins neurodivergents sont souvent mal compris et discrédités lorsque leurs styles de communication authentiques ne sont pas reconnus ou pris en compte par les tribunaux.
Le juge a conclu qu'un tel comportement est caractéristique des témoins peu fiables, malgré des recherches importantes montrant qu'il s'agit de traits communs chez les personnes neurodivergentes. Le juge a décrit son témoignage comme manquant de « spontanéité », un terme souvent utilisé dans les évaluations de crédibilité pour favoriser les styles de communication neurotypiques.
Ces évaluations n'ont pas tenu compte de son profil cognitif neurodivergent et ont plutôt pathologisé les comportements mêmes qui sont compatibles avec le TDAH et le traitement des surdoués. Son témoignage n'a pas été jugé en fonction de son contenu ou de sa véracité, mais en fonction de la manière dont il a été rendu.
Entretien d’ESSAS auprès d’un survivant #198
Le contre-interrogatoire peut être profondément traumatisant pour les enfants survivants, surtout lorsqu'ils doivent témoigner deux fois
« Il a été condamné à quatre ans de prison. Mais j'ai été condamné à perpétuité. »[89] [Traduction]
Le contre-interrogatoire est l'une des parties les plus pénibles du processus de justice pénale pour les enfants victimes.
- Certains avocats de la défense tentent de trouver un équilibre éthique entre plaider pour leur client et tenir compte de l'impact de leur approche sur l'enfant.
- Lorsque le système auquel les enfants font confiance pour les protéger les expose aux procédures judiciaires, ils peuvent se sentir manipulés et perdre confiance dans les institutions publiques.
Enquêtes préliminaires
« C'est incroyablement frustrant de voir des enfants témoigner deux fois. Cela n'a pas de sens. C'est une très mauvaise idée. »[90] [Traduction]
Témoigner est une expérience difficile, parfois traumatisante pour n'importe qui. Bien que les réformes procédurales aient éliminé la nécessité de témoigner deux fois pour la plupart des survivant.e.s adultes de violence sexuelle,[91] les enfants sont souvent encore tenus de témoigner lors d'une enquête préliminaire et d'un procès.
- Les procureurs de la Couronne nous ont dit qu'il n'y avait pas aucun besoin d'enquêtes préliminaires.
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
En 2019,[92] le législateur a restreint le recours aux enquêtes préliminaires, reconnaissant que la fonction d'enquête préalable était devenue inutile depuis l’arrêt R c. Stinchcombe.[93]
- Le législateur a reconnu que les enquêtes préliminaires ajoutaient aux délais et à la détresse des victimes. Toutefois, les modifications ont maintenu les enquêtes préliminaires pour les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement de 14 ans ou plus, comme les infractions sexuelles contre les enfants.
Retards dans les témoignages
Le processus de justice pénale ne reconnaît souvent pas l'urgence de l'expérience d'un enfant. Nous avons entendu :
- Deux jeunes filles ont attendu plus de deux heures dans un palais de justice pour témoigner dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des accusations de contacts sexuels envers des enfants. La salle d'audience avait plusieurs affaires ce jour-là. Malgré la demande de la Couronne, le juge n'a pas accordé la priorité au témoignage des enfants.
- Pour un adulte, deux heures d'attente peuvent ne pas sembler longues. Pour un enfant, attendre dans un palais de justice, sans savoir quand ni comment il sera appelé à témoigner, peut déclencher une détresse physique et émotionnelle.
- Cela peut avoir une incidence sur leur capacité à s'autoréguler et à témoigner de manière cohérente. Pourtant, c'est un phénomène régulier. Cet impact n'est pas reflété dans les transcriptions ou les enregistrements.[94]
Même avec une condamnation, les enfants survivants sortent souvent du processus sans aucun sens de la justice.
La réflexion d'un enquêteur
Au cours d'un entretien en personne, une survivante adulte d'abus sexuels pendant son enfance a sangloté en décrivant le contre-interrogatoire et la façon dont elle a été traitée par l'avocat de la défense. Elle a dit : « Il m'a complètement détruite. »[95] [Traduction]
C'était douloureux de témoigner de ce désespoir, de constater avec peine qu'une salle d'audience pleine de professionnels a permis à cette personne d'être autant humiliée.
Pratiques exemplaires en matière de justice tenant compte des traumatismes pour les enfants et les jeunes
De nombreux services de police au Canada ont mis en place des protocoles pour s'assurer que les enfants et les jeunes survivant.e.s de violence sexuelle reçoivent une justice tenant compte des traumatismes.
- Ils travaillent en collaboration avec les Centres d'appui aux enfants et aux jeunes qui sont équipés pour mener des entrevues médico-légales avec des enfants.
Les entretiens médico-légaux avec les enfants sont un élément essentiel des enquêtes et des réponses judiciaires à la violence sexuelle envers les enfants. Ces entrevues visent à recueillir des renseignements exacts et fiables auprès des enfants et des jeunes, d'une manière qui tient compte des traumatismes et qui convient au développement. Ces entrevues enregistrées pourraient être utilisées pendant le procès afin que l'enfant ne soit pas tenu de témoigner devant le tribunal.
- L'accès à de telles entrevues à l'échelle du Canada demeure inégal, en raison de disparités dans la formation, les protocoles et la disponibilité des services.
- Un accès équitable à des entretiens médico-légaux de haute qualité est essentiel pour protéger les droits des enfants, soutenir leur rétablissement et garantir la justice.
- Une stratégie nationale coordonnée comprenant la normalisation des protocoles d'entrevue médico-légale est nécessaire pour combler les lacunes actuelles et défendre la dignité et la sécurité de tous les enfants et de tous les jeunes qui ont été victimes de violence sexuelle.[96]
Contre-interrogatoire des témoins experts
Au cours de cette enquête, l'une des enquêtrices du BOFVAC s’est entretenue avec une experte juridique dans le domaines des agressions sexuelles.
L'experte m’a demandé : « Avez-vous déjà été contre-interrogé? » J'ai répondu que non, je ne l'avais jamais été. Elle a ajouté : « Je l'ai été. Deux fois. J'ai été témoin expert lors d'une enquête et d'une audience sur les droits de la personne. Ces expériences ont été horribles. J'ai refusé de servir à nouveau en tant que témoin expert. »
J'avoue avoir été décontenancé. Elle est une avocate, une universitaire et une professeure admirée, bien connue et respectée. Elle est confiante, bien informée, une leader dans le domaine et a publié sur ce sujet à plusieurs reprises.
Son expérience d'être contre-interrogée a été si horrible qu'elle ne se remettrait plus jamais dans cette situation. Elle n'était même pas la plaignante.
Comment pourrait-on s'attendre à ce qu'un plaignant, peut-être déjà traumatisé, aille jusqu'au bout alors qu'une experte très respectée et chevronnée, invité à fournir une expertise aux tribunaux, trouve l’expérience insupportable?[97]
À RETENIR
Un système juste empêche les tactiques qui traumatisent à nouveau
plutôt que de tester la crédibilité
L'interrogatoire juridique ne doit jamais devenir un préjudice sanctionné
[1] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #21
[2] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s
[3] R c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC).
[4] R c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), aux paragraphes 669 et 670.
[5] R c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC).
[6] Cunningham, M. (2018). What Does #MeToo Mean for Crowns? Why Trauma-Informed Prosecutions are Necessary à la p. 15. (Disponible en anglais seulement).
[7] Herman, J. L. (2005). Justice from the victim’s perspective. Violence Against Women, 11(5), 571–602. (Disponible en anglais seulement).
[8] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #07
[9] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse#175
[10] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #21
[11] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #004
[12] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #386
[13] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #439 ; Mattoo, D., & Hrick, P. (2025). The criminal justice system keeps failing sexual-assault survivors. There has to be a better way. The Globe and Mail. (Disponible en anglais seulement).
[14] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #341
[15] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #196
[16] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #007
[17] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #590
[18] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #121
[19] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #82
[20] R v. A.G., 2000 SCC 17 (CanLII), au para 2.
[21] R c. Kruk, 2024 CSC 7 (CanLII).
[22] R c. Kruk, 2024 CSC 7 (CanLII), au para 36.
[23] R c. Kruk, 2024 CSC 7 (CanLII), au para 35.
[24] Cunningham, M. (2018). What Does #MeToo Mean for Crowns? Why Trauma-Informed Prosecutions are Necessary at p 15(Disponible en anglais seulement).
[25] Dufraimont, L. (2019) Myth, Inference and Evidence in Sexual Assault Trials. Queen's Law Journal, 44(2), 316. (Disponible en anglais seulement).
[26] Groupe de travail 02 de l’ESSAS
[27] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #015
[28] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #030, #121
[29] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #199
[30] R c. Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), au para 119.
[31] Haskell, L. et Randall, M. (2019). L'impact du traumatisme sur les victimes d'agression sexuelle d’âge adulte. Ministère de la Justice du Canada.
[32] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #151
[33] WomenatthecentrE. (2020). Declarations of truth: Documenting insights from survivors of sexual abuse. (Disponible en anglais seulement).
[34] WomenatthecentrE. (2020). Declarations of truth: Documenting insights from survivors of sexual abuse. (Disponible en anglais seulement).
[35] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #17
[36] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #494
[37]Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #21
[38] R c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), au paragraphe 43 ; R c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), aux paragraphes 663 à 665.
[39] R c. J.J., 2022 CSC 28 (CanLII), au paragraphe 183.
[40] R c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), au paragraphe 47.
[41] R c. Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), [2006] 2 RCS 787, au paragraphe 48.
[42] R c. J.J., 2022 CSC 28 (CanLII), [2022] 2 RCS 3, au paragraphe 184.
[43] Haskell, L. et Randall, M. (2019). L'impact du traumatisme sur les victimes d'agression sexuelle à l'âge adulte. Ministère de la Justice du Canada.
[44] Jurist, E., & Ekhtman, J. (2024). Truth and repair: How trauma survivors envision justice. Psychoanalysis Culture & Society. (Disponible en anglais seulement).
[45] Cunningham, M. et ministère du Procureur général de l'Ontario. (2023, 26 juillet). Présentation au BOFVAC sur les poursuites tenant compte des traumatismes [présentation].
[46] Craig, E. (2018). Procès sur procès : l'agression sexuelle et l'échec de la profession d'avocat. Presses de l'Université McGill-Queen's, p. 220.
[47] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #113
[48] Craig, E. (2018). Putting trials on trial: Sexual assault and the failure of the legal profession. McGill-Queen’s University Press, 220. (Disponible en anglais seulement).
[49] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #094
[50] Horsburgh, M. (2025, 28 May). Opinion: In junior hockey players’ trial, what could go wrong, did. Winnipeg Free Press. (Disponible en anglais seulement).
[51] Traitement ou peine cruels et inusités. Cette expression figure à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 12 a pour objet d'empêcher l'État d'infliger des douleurs et des souffrances physiques ou mentales au moyen de peines ou de traitements dégradants et déshumanisants. Il vise à protéger la dignité humaine et à respecter la valeur inhérente des individus. Chartepédia, Justice Canada.
[52] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #106, Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #019
[53] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #019
[54] Cunningham, M. et ministère du Procureur général de l'Ontario. (2023, 26 juillet). Présentation au BOFVAC sur les poursuites tenant compte des traumatismes [présentation].
[55] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #113
[56] Craig, E. (2018). Putting trials on trial: Sexual assault and the failure of the legal profession. McGill-Queen’s University Press, 220. (Disponible en anglais seulement).
[57] Benedet, J., et Grant, I. (2012). Taking the stand: Access to justice for witnesses with mental disabilities in sexual assault cases. Osgoode Hall Law Journal, 50(1), 1–45. (Disponible en anglais seulement).
[58] Entretien de l’ESSAS auprès d'un.e survivant.e #004
[59] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #21
[60] Craig, E. (2018). Putting trials on trial: Sexual assault and the failure of the legal profession. McGill-Queen’s University Press, 220. (Disponible en anglais seulement). R c. Khaery 2014 ABQB 676 (CanLII)
[61] Ponic, P., Varcoe, C. et Smutylo, T. (2016). Approches tenant compte des traumatismes (et de la violence) pour soutenir les victimes de violence : dimensions stratégiques et pratiques. Dans Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels (no 9). Ministère de la Justice du Canada.
[62] Cunningham, M. et ministère du Procureur général de l'Ontario. (2023, 26 juillet). Présentation au BOFVAC sur les poursuites tenant compte des traumatismes [présentation].
[63] Cunningham, M. (2018). What Does #MeToo Mean for Crowns? Why Trauma-Informed Prosecutions are Necessary. (Disponible en anglais seulement).
[64] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #52
[65]Roadmap for Creating Trauma-Informed and Responsive Change | NHS E. (22 novembre, 2023). NHS Education for Scotland. (Disponible en anglais seulement).
[66] R c. N.S., 2012 CSC 72 (CanLII), [2012] 3 RCS 726.
[67] Hassan, M. (2024). Gendered racialization and the Muslim identity: the difference that ‘difference’ makes for Muslim women complainants in Canadian sexual assault cases (T). University of British Columbia. (Disponible en anglais seulement).
[68] Hassan, M. (2024). Gendered racialization and the Muslim identity: the difference that ‘difference’ makes for Muslim women complainants in Canadian sexual assault cases (T). University of British Columbia. (Disponible en anglais seulement).
[69] R c. N.S., 2012 CSC 72 (CanLII), au paragraphe 9.
[70] R c. N.S., 2012 CSC 72 (CanLII), [2012] 3 RCS 726, au paragraphe 96.
[71] Bureau, A. H. C. H. (2014, 17 juillet). Sex-assault case that led to Supreme Court niqab ruling ends abruptly. Toronto Star. (Disponible en anglais seulement).
[72] Benedet, J., et Grant, I. (2012). Taking the stand: Access to justice for witnesses with mental disabilities in sexual assault cases. Osgoode Hall Law Journal, 50(1), 1–45. (Disponible en anglais seulement).
[73] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #131
[74] Énoncé concernant une étude sur la communauté du Réseau des femmes handicapées (DAWN Canada). (mai 2022). Déclaration au nom d'une collectivité - Les femmes et les filles handicapées et les répercussions des agressions sexuelles - Dawn Canada ; Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont de quatre à dix fois plus susceptibles d'être victimes d'agression sexuelle que la population générale, selon Inclusion Canada. (2024, 26 janvier). Communiqué de presse : Inclusion Canada réclame justice à la lumière de la condamnation inadéquate dans l'affaire Brent Gabona.
[75] Entretien de l’ESSAS avec les intervenant.e.s #113
[76] Benedet, J., et Grant, I. (2012). Taking the stand: Access to justice for witnesses with mental disabilities in sexual assault cases. Osgoode Hall Law Journal, 50(1), 1–45. (Disponible en anglais seulement).
[77] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #131
[78] Benedet, J., et Grant, I. (2012). Taking the stand: Access to justice for witnesses with mental disabilities in sexual assault cases. Osgoode Hall Law Journal, 50(1), 1–45. (Disponible en anglais seulement).
[79] R c. Pearson, 1994 CanLII 8751 (BC CA), au paragraphe 36.
[80] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
[81] Gouvernement du Canada, ministère de la Justice, (2025a, 14 juillet). Chartepédia - Article 15 – Droit à l'égalité.
[82] Lim, A., Young, R. et Brewer, N. (2022). Autistic Adults May Be Erroneously Perceived as Deceptive and Lacking Credibility. National Library of Medicine. (Disponible en anglais seulement).
[83] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486.1 et 486.2. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-175.html
[84] Accès troubles de la communication Canada. Intermédiaires de communication. (s.d.).
[85] L'article 6 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, se lit comme suit : 6 (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre. (2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.
[86] Birenbaum, J., Collier, B., & Communication Disabilities Access Canada (CDAC). (2017). Communication intermediaries in justice services. In Access to Justice for Ontarians Who Have Communication Disabilities. CDAC. (Disponible en anglais seulement).
[87] McAdam, B. (2024). Former Sask. care aide gets 6.5 years for sexually abusing people with disabilities. Saskatoon StarPhoenix. (Disponible en anglais seulement).
[88] Sondage de l’ESSAS auprès des survivant.e.s, réponse #697
[89] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e survivant.e #012
[90] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #173
[91] Gouvernement du Canada, ministère de la Justice. (2022). Contexte législatif : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, telles qu'édictées (projet de loi C-75 de la 42e législature).
[92] Gouvernement du Canada, ministère de la Justice. (2022). Contexte législatif : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, telles qu'édictées (projet de loi C-75 de la 42e législature).
[93] R c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326
[94] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #17
[95] Entretien de l’ESSAS auprès d'un.e survivant.e #090
[96] Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #195 et Soumission écrite à l’ESSAS par le Luna Child and Youth Advocacy Centre
[97]Entretien de l’ESSAS auprès d’un.e intervenant.e #200