Cahier d’information pour le comité HUMA : Comparution de la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap (DIPH) - Le 12 décembre 2024
Titre officiel : Comparution de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap (DIPH), Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA). Étude : Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040 et Objet du Budget supplémentaire des dépenses (B), 2024 à 2025, et priorités. Date: le 12 décembre 2024, de 11h00 à 13h00.
Sur cette page
- Allocution d'ouverture
- Environnement parlementaire
- Sujets d'actualité : Inclusion des personnes en situation de handicap
- La Prestation Canadienne pour les personnes handicapées
- Questions et réponses : Prestation Canadienne pour les personnes handicapées
- Loi canadienne sur l'accessibilité
- Questions et réponses : Loi canadienne sur l'accessibilité
- Programme de partenariats pour le développement social : Personnes en situation de handicap
- Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap
- Financement
- Tableau de financement : Fonds d'intégration pour les personnes handicapées
- Tableau de financement : Fonds pour l'accessibilité
- Tableau de financement : Initiative Appuyer les communautés noires du Canada
- Tableau de financement : Programme de partenariats pour le développement social, composante Personnes en situation de handicap
- Budget
1. Allocution d'ouverture
1.a. Allocution d'ouverture de la ministre : Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040
Mot d'ouverture pour la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, pour sa comparution devant le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) dans le cadre de l'étude intitulée « Canada, un pays exempt d'obstacles d'ici 2040 ». Chambre des communes, 12 décembre 2024
La version prononcée fait foi.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité,
Je tiens à souligner que je me joins à vous à partir du territoire ancestral, traditionnel et non cédé de la nation algonquine.
Je remercie le Comité et ses membres de leur intérêt pour la Loi canadienne sur l'accessibilité et du travail qu'ils ont réalisé dans le cadre de cette étude.
Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est essentiel d'accorder la priorité à l'accessibilité pour créer des collectivités et des milieux de travail sans obstacles où tout le monde peut participer et s'épanouir.
Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'entendre différents points de vue sur la façon de faire progresser l'accessibilité en mettant en œuvre cette loi historique.
Comme certains d'entre vous le savent peut-être, la Loi canadienne sur l'accessibilité a été reconnue comme étant l'une des lois sur l'accessibilité les plus complètes au monde, et elle a influencé l'élaboration d'autres lois sur l'accessibilité au Canada.
Si vous me le permettez, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter certains des progrès que nous avons réalisés en mettant en œuvre cette loi cruciale. Tout a commencé par l'établissement des structures et des rôles fondamentaux nécessaires pour réaliser le changement, comme la création de Normes d'accessibilité Canada en 2019 et la nomination de la première dirigeante principale de l'accessibilité et du premier commissaire à l'accessibilité du Canada, en mai 2022.
Depuis sa création, Normes d'accessibilité Canada a publié plusieurs normes pour que le public les commente, notamment une norme essentielle sur l'emploi accessible, et cette organisation travaille à la publication de normes sur l'utilisation équitable de l'intelligence artificielle, le tourisme accessible et les sorties de secours, pour n'en citer que quelques-unes.
En 2021, nous avons publié le Règlement canadien sur l'accessibilité, ainsi que des règlements sur la planification et la production de rapports pour les secteurs des transports, des télécommunications et de la radiodiffusion. Ces règlements, les premiers du genre, obligent maintenant les organisations réglementées à rendre compte au public de manière transparente de leurs plans d'amélioration de l'accessibilité et de leurs progrès. Nous avons également mis en place un processus sans redirection : ainsi, peu importe où une plainte concernant le respect de ces règlements est déposée, elle sera envoyée au bon ministère pour qu'il y donne suite.
Depuis l'année dernière, nous travaillons également à l'élaboration d'un règlement sur l'accessibilité numérique. Une fois sa version définitive établie, ce règlement positionnerait le Canada parmi les chefs de file internationaux en matière d'accessibilité numérique. En effet, alors que les approches traditionnelles de promotion de l'accessibilité numérique adoptées dans d'autres pays, comme les États‑Unis, sont axées sur les organisations gouvernementales, le règlement canadien sur l'accessibilité numérique s'appliquerait également au secteur privé fédéral, comme les banques. Le projet de règlement sera publié prochainement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à le consulter et à formuler leurs commentaires et leurs suggestions.
D'autres travaux essentiels ont été réalisés, notamment la publication d'une Stratégie fédérale de mesure et de données sur l'accessibilité, afin de recueillir des renseignements indispensables sur les lacunes en matière d'accessibilité et de mesurer les progrès.
Bien entendu, rien de tout cela n'aurait pu être réalisé sans les contributions et les perspectives importantes de la communauté des personnes en situation de handicap. Conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et au principe « Rien sans nous » inscrit dans la Loi canadienne sur l'accessibilité, nous avons saisi et continuerons de saisir toutes les occasions de consulter les personnes en situation de handicap sur les politiques et les programmes qui les concernent.
Financement
Dans le cadre de plusieurs programmes, nous avons soutenu des projets communautaires pour contribuer à renforcer les capacités de la communauté des personnes en situation de handicap afin de montrer la voie à suivre d'ici 2040. Par exemple, le Fonds pour un Canada accessible soutient des projets communautaires qui célèbrent la Semaine nationale de l'accessibilité dans tout le pays et contribue à la création de partenariats nécessaires entre la communauté des personnes en situation de handicap et d'autres secteurs.
Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées fournit quant à lui un financement à des organismes au sein de collectivités de partout au Canada. Ces organismes offrent une formation axée sur des compétences et d'autres formes de soutien à l'emploi aux personnes en situation de handicap et aident les employeurs à créer des lieux de travail plus inclusifs et accessibles augmentant la participation au marché du travail des personnes en situation de handicap en âge de travailler.
Pouvoir de mobilisation
J'espère que vous conviendrez que la création d'un Canada sans obstacles nécessite une vision et une participation nationales. C'est pourquoi nous avons lancé récemment des consultations sur la Feuille de route pour un Canada accessible provisoire, qui a pour but d'ancrer et de guider les actions de tous les ordres de gouvernement et de la société.
Comme vous le savez, la Semaine nationale de l'accessibilité est un jalon établi par la loi, et elle commence le dernier dimanche de mai. En 2022, nous avons créé le Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap pour lancer les célébrations de la Semaine nationale de l'accessibilité partout au Canada. Depuis sa création en 2022, le Congrès canadien a atteint plus de 11 000 participants inscrits de partout au Canada et d'ailleurs. Il a remporté un tel succès qu'il est maintenant l'événement de lancement annuel de la Semaine nationale de l'accessibilité. Comme l'a fait remarquer à juste titre l'un des participants, que je cite : « Nous devons poursuivre ce type d'échange. Les discussions aboutiront éventuellement à la réduction des obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de s'épanouir ».
J'espère que mes observations commencent à vous donner une idée des progrès accomplis, mais aussi du chemin qui reste à parcourir.
L'élimination des obstacles au Canada est une tâche de grande envergure et la réaliser correctement prendra du temps. Il s'agit d'une responsabilité collective : le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, les entreprises, la société civile et les Canadiennes et Canadiens en tant qu'individus auront tous un rôle à jouer dans l'atteinte de cet objectif. Il faudra consulter les intervenants appropriés et veiller à ce que la communauté des personnes en situation de handicap participe au processus dès le début et tout au long de celui-ci.
C'est avec plaisir que je répondrai maintenant à toutes vos questions.
Je vous remercie de m'avoir écoutée.
-30-
1.b. Allocution d'ouverture de la ministre : Objet du Budget supplémentaire des dépenses (B), 2024 à 2025, et priorités
Notes d'allocution pour la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, pour sa comparution devant le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) au sujet de son mandat et du Budget supplémentaire des dépenses (B), Chambre des communes, 12 décembre 2024.
La version prononcée fait foi.
Permettez-moi de commencer par reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine anishinaabe. Veuillez prendre un moment pour honorer ces terres ancestrales et célébrer la résilience et la force dont les peuples autochtones ont fait preuve dans le monde entier.
Je vous remercie de m'avoir invitée à me joindre à vous aujourd'hui. C'est une autre occasion pour moi de discuter des progrès que nous réalisons en vue d'assurer l'accessibilité et l'inclusion pour toutes les personnes en situation de handicap du Canada.
Aujourd'hui, je parlerai surtout de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la Stratégie d'emploi.
De nombreuses personnes en situation de handicap du Canada ont désespérément besoin du soutien supplémentaire offert par la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Leurs taux de pauvreté sont disproportionnellement élevés et elles sont souvent confrontées à d'importants obstacles à l'emploi.
Selon l'Enquête canadienne sur le revenu de 2022, 12,3 % des personnes en situation de handicap âgées de 15 ans ou plus vivaient sous le seuil de la pauvreté.
Nous travaillons donc d'arrache-pied pour que la prestation soit versée aux personnes qui en ont besoin. Permettez-moi de faire le point sur les progrès que nous réalisons à cet égard.
Nous nous sommes engagés à commencer à verser la prestation en juillet 2025, après avoir terminé le processus réglementaire ainsi que les consultations avec les personnes en situation de handicap.
Nous avons publié ce règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 29 juin de cette année. Et les Canadiennes et Canadiens avaient jusqu'au 23 septembre pour formuler leurs commentaires. Au total, nous avons reçu plus de 2 700 commentaires de plus de 900 personnes.
Nous passons actuellement en revue ces commentaires et révisons le règlement. Nous prévoyons de publier le texte final du règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada au début de l'année prochaine.
La prestation a pour but de compléter les prestations fédérales, provinciales et territoriales existantes. Le montant maximal sera de 2 400 $ par année pour les personnes en situation de handicap à faible revenu âgées de 18 à 64 ans.
Dans le budget de 2024, nous avons affecté 6,1 milliards de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 à 2025, et 1,4 milliard de dollars par année par la suite, ce qui comprend les coûts associés au versement de la prestation.
Nous payons également le coût des formulaires médicaux requis pour demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Comme nous le savons, les provinces et les territoires jouent un rôle essentiel en offrant un soutien financier et des services aux personnes en situation de handicap.
Nous travaillons avec eux pour déterminer comment cette nouvelle prestation fédérale peut interagir avec leurs programmes fondés sur le revenu.
C'est un travail complexe, mais nécessaire.
Nous voulons offrir la prestation rapidement, mais nous avons également besoin d'assurer l'uniformité à l'échelle du pays.
Malgré la complexité de la tâche et la nécessité de franchir avec soin toutes les étapes du processus réglementaire, nous avons réalisé des progrès remarquables. Je suis convaincue que nous respecterons la date de mise en œuvre prévue.
Chers collègues, depuis 2015, le gouvernement a réalisé des progrès sans précédent pour améliorer l'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap.
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est un engagement essentiel du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Le Plan s'articule autour de 4 piliers :
- sécurité financière;
- emploi;
- communautés accessibles et inclusives;
- une approche moderne à l'égard des personnes en situation de handicap.
Chers collègues, toute personne désireuse et capable de travailler préférerait assurément avoir un emploi plutôt qu'une prestation.
Mais voici la réalité : le taux de chômage des personnes en situation de handicap, qui s'élève à 7,6 % , est presque le double de celui des personnes sans incapacité, qui est de 4,6 %.
En juillet dernier, j'ai eu le privilège d'annoncer la nouvelle Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap.
La Stratégie a pour but d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontées, comme nous le savons, de nombreuses personnes en situation de handicap lorsqu'elles cherchent à obtenir un emploi, à lancer une entreprise ou à obtenir une promotion. Le gouvernement est également déterminé à soutenir les organismes qui travaillent à éliminer ces obstacles.
Lorsque je suis retournée travailler comme infirmière autorisée au début de la pandémie, j'ai pu constater de mes propres yeux les obstacles supplémentaires auxquels les personnes en situation de handicap ont été confrontées lors du confinement. De nombreuses personnes en situation de handicap qui travaillaient dans des restaurants ou qui occupaient d'autres emplois où elles fournissaient des services au public ont perdu leur emploi. Bon nombre d'entre elles ont été coupées de la société beaucoup plus que d'autres personnes, car elles ne pouvaient plus accéder à des services de soutien essentiels comme la physiothérapie ou le transport accessible.
Notre objectif en tant que gouvernement est donc de combler l'écart en matière d'emploi et de répondre aux besoins et aux attentes en évolution des personnes en situation de handicap.
Nous y parvenons en déterminant et en éliminant les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de trouver et de conserver de bons emplois, de progresser dans leur carrière ou de devenir entrepreneurs.
Nous travaillons avec d'autres ministères fédéraux, nos partenaires provinciaux et territoriaux, la communauté des personnes en situation de handicap, les employeurs et les peuples autochtones pour y parvenir.
Il ne faut pas oublier non plus que, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, au Canada, 27 % des personnes âgées de 15 ans ou plus ont une ou plusieurs incapacités qui limitent leurs activités quotidiennes.
Cela représente 8 millions de personnes.
Ce sont nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins et nos collègues.
Lorsque 8 millions de personnes dont nous nous soucions réalisent pleinement leur potentiel en obtenant un emploi, en devenant indépendantes et en gagnant en dignité, cela crée un sentiment d'équité dans notre pays et donne un puissant coup de pouce à notre économie.
C'est mon mandat et c'est notre objectif.
Merci, Monsieur le président et Mesdames et Messieurs les membres du comité.
C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
-30-
2. Environnement parlementaire
2.a. Note de scénario
Aperçu
Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) vous a invité à comparaître, accompagné de fonctionnaires, pour discuter de 2 sujets, dans le cadre de 2 différents panels, à la même réunion. Le premier sujet concerne l'étude sur les progrès réalisés vers l'objectif de créer un Canada sans obstacle d'ici 2040. Le deuxième a trait à la motion suivante adoptée le 17 septembre 2024 : Que le Comité invite les ministres de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de la Diversité et de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, du Travail et des Aînés, de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que des Services aux citoyens à comparaître séparément devant lui pendant au moins 2 heures chacun, dans les 28 jours suivant l'adoption de la présente motion, au sujet du Budget supplémentaire des dépenses (B) et leurs priorités pour la rentrée parlementaire et de leurs mandats.
Délibérations du Comité
La comparution est prévue le jeudi 12 décembre 2024, de 11 h à 13 h. Le président du Comité, Robert J. Morrissey (Egmont, PLC), préside la réunion. Vous disposez de 5 minutes pour présenter vos observations préliminaires dans le cadre de chaque panel.
Les fonctionnaires d'EDSC suivants font aussi partie du panel :
- Tina Namiesniowski, sous-ministre déléguée principale;
- Elisha Ram, sous-ministre adjointe principal, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social;
- Saajida Deen, directrice générale, Élaboration et conception de politiques de programmes d'emploi;
- Karen Hall, sous-ministre adjointe associée, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social (deuxième panel seulement).
Vous n'avez pas de réponse de suivi écrite en suspens auprès du Comité.
Vous avez la correspondance suivante en cours à adresser à l'intention des membres du Comité HUMA et des porte-paroles :
- Bonita Zarrillo - 10 juillet 2024 : Lettre adressée à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap concernant le soutien aux personnes en situation de handicap;
- Bonita Zarrillo - 16 octobre 2024 : Lettre adressée à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap concernant le soutien financier aux entrepreneurs en situation de handicap (Fonds d'intégration pour les personnes handicapées).
Le Comité a convenu de répartir le temps alloué pour interroger les témoins de la manière suivante :
- au premier tour, chaque parti dispose de 6 minutes, et l'ordre des interventions est le suivant :
- Parti conservateur;
- Parti libéral;
- Bloc québécois;
- Nouveau Parti démocratique.
- lors du deuxième tour et des tours subséquents, l'ordre des interventions et le temps alloué sont les suivants :
- Parti conservateur, 5 minutes;
- Parti libéral, 5 minutes;
- Bloc québécois, 2 minutes et demie;
- Nouveau Parti démocratique, 2 minutes et demie;
- Parti conservateur, 5 minutes;
- Parti libéral, 5 minutes.
Contexte parlementaire
Le Canada sans obstacle d'ici 2040
Votre panel est le dernier en ce qui concerne cette étude. Le 8 février 2024, le Comité HUMA a adopté la motion suivante pour entreprendre une étude sur la question de « Canada sans obstacle » : Que, conformément à l'article 108(2) du Règlement, le Comité s'inquiète des progrès réalisés à l'égard de l'atteinte de l'objectif « un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040 » et mène une étude d'au moins 2 réunions pour étudier l'atteinte de cet objectif d'un Canada sans barrières d'ici 2040; que le Comité invite la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, la vérificatrice générale du Canada, la dirigeante principale de l'accessibilité du Canada; le commissaire à l'accessibilité du Canada, des défenseurs des droits des personnes handicapées ainsi que des représentants des industries sous réglementation fédérale; que le Comité fasse rapport de ses conclusions et de ses recommandations à la Chambre et que, conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au rapport.
Lors d'une réunion antérieure, le Comité HUMA a tenu une séance d'information avec le chef de la direction d'Air Canada sur les services offerts aux voyageurs en situation de handicap. Il convient de souligner que le Comité des transports (TRAN) a terminé son étude sur les transports accessibles aux personnes en situation de handicap, découlant de la motion suivante : Que, étant donné que de nombreux rapports récents font état de personnes en situation de handicap qui sont victimes de discrimination et de traitements inacceptables lorsqu'elles voyagent avec des compagnies aériennes canadiennes, et qu'Air Canada a admis avoir violé la réglementation canadienne sur les personnes en situation de handicap; que, conformément à l'article 108(2) du Règlement, le Comité entreprenne une étude sur l'état du transport accessible aux personnes en situation de handicap par les compagnies aériennes canadiennes et sur le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées; que le Comité invite le ministre des Transports, les présidents-directeurs généraux d'Air Canada et de WestJet, la vérificatrice générale du Canada, des aéroports et l'Office des transports du Canada, des spécialistes et d'autres intervenants; que le Comité tienne au moins 3 réunions et fasse part de ses conclusions et recommandations à la Chambre; et que le gouvernement apporte une réponse globale au rapport.
3. Sujets d'actualité : Inclusion des personnes en situation de handicap
3.a. La Prestation Canadienne pour les personnes handicapées
Enjeu
Progrès réalisés à l'égard de la mise en œuvre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Contexte
- La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.
- La Loi établit le cadre de la prestation, et les principaux détails de la prestation doivent être abordés dans un règlement. La conception de la prestation a été ratifiée par le Cabinet en mai 2023, et dans le budget de 2024, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement de 6,1 milliards de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 à 2025, et de 1,4 milliard de dollars par année par la suite. Le gouvernement s'est également engagé à commencer les versements de la prestation en juillet 2025, à la suite d'une mobilisation réussie auprès de la communauté des personnes en situation de handicap et de l'achèvement du processus réglementaire.
- Le 29 juin 2024, le gouvernement a publié le projet de règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada aux fins de commentaires du public; la période de commentaires s'est terminée le 23 septembre 2024. Au total, le gouvernement a reçu 9 632 commentaires concernant le projet de règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées de la part de 7 814 intervenants, dont 82 organisations.
Faits saillants
- Le budget de 2024 propose un financement de 6,1 milliards de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 à 2025, et de 1,4 milliard de dollars par année par la suite pour la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, y compris les coûts liés à son versement. Le budget a également annoncé que le gouvernement prévoit commencer à verser la prestation aux Canadiens admissibles en juillet 2025.
- La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées est entrée en vigueur le 22 juin 2024. La Loi exige également que, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur, le gouverneur en conseil prenne les règlements nécessaires pour permettre le versement de la prestation. De plus, la Loi exige que le gouvernement fasse rapport au Parlement 6 mois après l'entrée en vigueur, de la façon dont la communauté des personnes en situation de handicap a participé au processus réglementaire et 12 mois après l'entrée en vigueur, des progrès réalisés dans le cadre du processus réglementaire .
- En s'appuyant sur les activités de mobilisation qui ont eu lieu en 2021 et 2022, le gouvernement a lancé, à l'été 2023, un processus de mobilisation en 2 phases pour éclairer l'élaboration du règlement et la mise en œuvre de la prestation. La première phase, qui s'est déroulée de novembre 2023 à février 2024, comprenait des tables rondes ministérielles et techniques, des réunions bilatérales ainsi qu'un sondage en ligne. Au cours de la première phase, plus de 5 000 commentaires ont été reçus. La deuxième phase a commencé par la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 29 juin 2024, afin que le public puisse formuler des commentaires. Lorsque la consultation s'est terminée le 23 septembre 2024, le gouvernement avait reçu 9 632 commentaires de 7 814 intervenants. Le gouvernement tiendra compte des commentaires reçus avant de publier la version finale du règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada; on prévoit que cela aura lieu au début de 2025, avant le lancement de la prestation.
Messages clés
- La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, une mesure législative historique prise par le gouvernement, a créé le cadre juridique d'une prestation directe pour les personnes en situation de handicap à faible revenu en âge de travailler. Le gouvernement est très conscient du fait que de nombreux Canadiens en situation de handicap ont besoin du soutien financier supplémentaire que la prestation leur offrira.
- Le budget de 2024 fait de cette prestation une réalité en y accordant un financement de 6,1 milliards de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 à 2025, et de 1,4 milliard de dollars par année par la suite.
- La prestation sera offerte aux personnes en situation de handicap à faible revenu admissibles âgées de 18 à 64 ans, qui ont un certificat valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le montant maximal de la prestation à son lancement sera de 2 400 $ par année. Le gouvernement a l'intention de commencer à verser la prestation en juillet 2025.
- Peu après la sanction royale, le gouvernement a lancé un processus de mobilisation en 2 phases visant à éclairer l'élaboration du règlement sur la prestation. La première phase, qui comprenait des tables rondes, un outil de mobilisation en ligne et des réunions bilatérales avec les intervenants, s'est achevée au début de 2024. La deuxième phase a commencé par la publication préalable du projet de règlement sur la prestation dans la Gazette du Canada le 29 juin 2024. Lorsque la consultation a pris fin le 23 ;septembre 2024, le gouvernement avait reçu 9 632 commentaires de 7 814 intervenants.
- Le gouvernement tient maintenant compte des commentaires reçus avant de mettre la dernière main au règlement. On prévoit que la version finale du règlement sera publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada au début de 2025, avant le lancement de la prestation.
3.b. Questions et réponses : Prestation Canadienne pour les personnes handicapées
Le montant annoncé est-il suffisant pour sortir une personne de la pauvreté, comme on l'avait promis?
L'objectif de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) vise à réduire la pauvreté et appuyer la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler. Elle a été conçue pour combler l'écart entre l'Allocation canadienne pour enfants, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti.
Annoncé dans le cadre du budget de 2024, le montant de la prestation représente une étape importante qui, selon les estimations, touchera plus de 600 000 personnes en situation de handicap lorsque la prestation sera entièrement mise en œuvre.
De plus, comme indiqué dans le budget de la même année, le gouvernement du Canada se donne comme objectif que le montant combiné des mesures de soutien du revenu fédérales, provinciales ou territoriales devienne comparable au soutien offert par l'entremise de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti. Cet objectif vise à s'attaquer aux taux de pauvreté vécus par les personnes en situation de handicap. La prestation sert à compléter d'autres sources de revenu et de soutien offerts.
Pourquoi le gouvernement exige-t-il que les demandeurs aient un certificat du Crédit d'impôt pour les personnes handicapées valide pour être admissibles à la PCPH? Cette exigence ne rend-elle pas la prestation plus complexe et moins accessible?
Fonder l'admissibilité à l'invalidité pour la PCPH sur le Crédit d'impôt pour les personnes handicapées (CIPH) va contribuer à garantir que le gouvernement puisse maintenir une approche cohérente et égalitaire à travers le pays. De plus, l'utilisation du CIPH simplifiera grandement le processus de demande de la PCPH pour les quelque 500 000 personnes en situation de handicap en âge de travailler qui ont déjà un certificat valide du CIPH (dont plusieurs seraient admissibles à la prestation). Le CIPH couvre également un large éventail de fonctions physiques et mentales et évalue leurs incidences sur la vie quotidienne, tout en mettant l'accent sur les personnes ayant les plus grands besoins liés à une incapacité. L'utilisation du certificat du CIPH simplifiera également les processus de demande et de paiement.
De plus, le CIPH fait partie des critères d'admissibilité pour d'autres programmes fédéraux (comme le Régime enregistré d'épargne-invalidité, le Supplément pour personnes en situation de handicap de l'Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapés) et certains programmes provinciaux et territoriaux (comme le Montant de supplément de revenu pour les personnes handicapées de Terre-Neuve-et-Labrador et le Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire de la Colombie-Britannique).
Quel accueil la réglementation a-t-elle reçu?
Le 28 juin 2024, le règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 86 jours. Entre le 28 juin et le 23 septembre 2024, un total de 2 733 commentaires provenant de 915 répondants a été soumis par l'entremise de la page en ligne de la Gazette. Au total, 84 répondants ont déclaré représenter une organisation. Il y a également eu 2 campagnes de lettres qui ont donné lieu à plus de 6 900 courriels contenant un message semblable.
Dans l'ensemble, ce sont les principaux aspects liés au montant des prestations et à l'admissibilité qui ont reçu le plus d'attention de la part des répondants. Les principales préoccupations soulevées par les commentateurs sont les suivantes :
- l'augmentation du montant et des seuils proposés pour réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap;
- les obstacles liés au CIPH, y compris ses critères, l'accès aux soins de santé et son processus de demande;
- l'incidence du revenu du conjoint sur l'autonomie, la dignité et l'indépendance financière des personnes en situation de handicap;
- le traitement de la Prestation à des fins fiscales, et ses interactions avec d'autres programmes d'aide sociale fédéraux, provinciaux ou territoriaux;
- la garantie que tous les aspects du programme de prestations soient simples, inclusifs et accessibles dans la mesure du possible, surtout en ce qui concerne les demandes (par exemple, pour l'inscription automatique des personnes admissibles), et la réponse aux décisions concernant le droit à la prestation;
- la mise en œuvre de la Prestation plus rapidement afin que les personnes en situation de handicap puissent commencer à recevoir plus tôt des paiements de la Prestation.
Les répondants ont également formulé des commentaires sur les aspects liés au processus administratif, comme la prise de décisions appuyées, la portée des décisions qui peuvent être réexaminées et faire l'objet d'un appel, les délais dans lesquels les personnes doivent répondre aux décisions et le recouvrement des paiements en trop. Le ministère examine actuellement tous les commentaires reçus pendant la période de consultation et pourrait apporter des modifications au règlement avant qu'il ne soit finalisé et publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Quand la prestation sera-t-elle mise en œuvre?
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu'il commencerait à verser des paiements aux Canadiens admissibles à compter de juillet 2025, une fois l'achèvement réussi du processus réglementaire et des consultations menées auprès des personnes en situation de handicap.
Est-ce que l'admissibilité au CIPH est la meilleure façon pour accéder à la prestation et la plus facile?
Le gouvernement est conscient que l'exigence selon laquelle les personnes doivent posséder un certificat valide du CIPH pour avoir accès à la prestation suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne la complexité et les coûts associés à l'obtention d'un certificat. Ultimement, il a été conclu qu'il est nécessaire de s'appuyer sur le CIPH afin d'offrir la prestation le plus rapidement possible et d'assurer l'uniformité de l'admissibilité à l'échelle nationale. Pour aider à relever les défis auxquels les personnes en situation de handicap peuvent faire face dans la recherche et l'accès aux programmes et services, un fonds est prévu dans le budget de 2024 afin de couvrir les coûts des formulaires médicaux requis pour présenter une demande pour le CIPH et des services communautaires de navigation. Cette mesure vise à améliorer la sensibilisation et la prise en charge des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux offerts aux Canadiens en situation de handicap en âge de travailler. Le gouvernement est conscient que de nombreux Canadiens en situation de handicap ont besoin du soutien financier supplémentaire qu'offrira la nouvelle PCPH. L'intention est donc de procéder le plus rapidement possible au processus d'élaboration des règlements, tout en veillant à ce que cette communauté soit mobilisée, comme l'exige la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le règlement doit être finalisé avant que les paiements puissent commencer en juillet 2025.
Avez-vous rencontré vos homologues des provinces et des territoires?
- Les provinces et les territoires représentent des partenaires essentiels à la mise en œuvre de la Prestation canadienne pour personnes handicapées. J'ai rencontré mes homologues, tant au niveau bilatéral que multilatéral.
- J'ai tenu des rencontres bilatérales avec tous mes homologues des provinces et territoires pour discuter de la PCPH. En septembre 2024, j'ai co-présidé une réunion des ministres responsables des services sociaux (MRSS) avec ma collègue des Territoires du Nord-Ouest. L'objectif de cette réunion était de discuter de la PCPH et d'offrir un endroit pour les provinces et territoires afin qu'ils puissent fournir leurs commentaires sur le projet de règlement de la Prestation canadienne pour personnes handicapées lors de la période de consultation officielle.
- À la suite de la réunion des MRSS, les ministres ont publié un communiqué commun dans lequel nous avons, entre autres, accueilli favorablement l'occasion de discuter de la PCPH, convenu que l'inclusion sociale et financière des personnes en situation de handicap sont nos principales priorités, et souligné l'importance de respecter les programmes provinciaux et territoriaux afin d'assurer un accès équitable et simple pour ceux qui en ont le plus besoin.
- J'ai hâte de rencontrer à nouveau les représentants des provinces et des territoires au sujet de la PCPH.
- Dans l'ensemble, mes discussions avec les provinces et les territoires ont été très positives. De leur côté, ils ont exprimé leur appui à l'objectif et au but de la PCPH. Plusieurs d'entre eux ont déjà indiqué qu'ils ne récupéreront pas la prestation.
- Aussi, les fonctionnaires du ministère ont discuté de façon bilatérale et multilatérale avec leurs homologues des provinces et territoires, notamment en tenant des discussions techniques pour les appuyer dans leur analyse visant à déterminer comment la PCPH sera traitée dans leur administration respective. Ils s'efforcent également d'éviter les interactions négatives possibles entre la PCPH et leurs programmes et prestations.
3.c. Loi canadienne sur l'accessibilité
Enjeu
Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA).
Contexte
La LCA est entrée en vigueur en 2019 et a pour principal objectif de faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040.
Grâce à une approche proactive et systémique, la LCA aide à cerner, à éliminer et à prévenir les obstacles à l'accessibilité dans 7 domaines prioritaires de compétence fédérale, notamment :
- l'emploi;
- l'environnement bâti;
- les technologies de l'information et des communications (TIC);
- la communication autre que les TIC;
- l'acquisition de biens, de services et d'installations;
- la conception et la prestation de programmes et de services;
- le transport.
Les pouvoirs de prendre des règlements en vertu de la LCA sont partagés entre plusieurs entités gouvernementales, notamment :
- le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui est responsable de la surveillance réglementaire du secteur des télécommunications et de la radiodiffusion;
- l'Office des transports du Canada (OTC) qui est responsable de la surveillance réglementaire du réseau national de transport;
- Emploi et Développement social Canada, agissant au nom du gouverneur en conseil, qui a le pouvoir de prendre des règlements dans tous les autres domaines qui ne sont pas couverts par le CRTC ou l'OTC.
Faits saillants
La mise en œuvre de la LCA est en bonne voie.
2 nouveaux rôles et une nouvelle organisation ont été créés dans le cadre de la LCA :
- Normes d'accessibilité Canada (NAC) a été établie en 2019 avec le mandat d'élaborer des normes nationales d'accessibilité. Le président-directeur général et le premier Conseil d'administration de NAC ont été nommés en 2019 et, en 2024, de nouvelles nominations ont été faites au Conseil, y compris un nouveau président et un nouveau vice-président;
- en mai 2022, le gouvernement a nommé la première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada et le premier commissaire à l'accessibilité du Canada;
- la dirigeante principale de l'accessibilité et le commissaire à l'accessibilité ont tous 2 publié leur premier rapport annuel.
Le Règlement canadien sur l'accessibilité (RAC), qui rend opérationnelles les exigences de planification et de production de rapports de la LCA, est entré en vigueur en décembre 2021.
Le Ministère élabore de nouveaux règlements sur les technologies de l'information et des communications accessibles. Une vaste mobilisation de la communauté des personnes en situation de handicap, des entités sous réglementation fédérale et d'autres intervenants a été menée à l'automne 2022 pour éclairer l'élaboration de règlements, et un rapport « Ce que nous avons entendu » résumant les points de vue des intervenants a été publié à l'été 2023.
À ce jour, NAC a mis sur pied 11 comités techniques qui élaborent activement des normes pour éliminer les obstacles dans plusieurs domaines prioritaires différents. La conformité aux normes élaborées par NAC est volontaire, à moins qu'elles ne soient adoptées dans le Règlement.
La mesure des progrès réalisés dans l'élimination des obstacles est un aspect important de la mise en œuvre de la LCA. En 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie fédérale de mesure et de données fédérales sur l'accessibilité. La Stratégie énonce les principaux domaines de travail qui visent à fournir aux Canadiens des renseignements et des données à long terme sur les progrès réalisés pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. En août 2023, le Ministère a publié la première série d'indicateurs qui seront utilisés pour orienter la collecte de données sur l'accessibilité à l'avenir. Un deuxième ensemble d'indicateurs est en cours d'élaboration.
En juin 2021, le Ministère a lancé le Carrefour de données sur l'accessibilité, une initiative collaborative hébergée sur le site Web de Statistique Canada pour partager des données sur l'accessibilité avec le public canadien. Le Carrefour a été mis à jour en mai 2024 afin de mieux harmoniser les données disponibles avec les sept domaines prioritaires établis dans la LCA. De nouvelles données sur les obstacles rencontrés dans les domaines de l'emploi, des technologies de l'information et des communications et du transport ont également été ajoutées, ainsi qu'un outil de visualisation des données qui présente l'incidence de certains obstacles par province ou territoire, le type d'incapacité et la gravité de l'incapacité.
Le gouvernement continue d'investir dans la sensibilisation à l'accessibilité et à l'objectif de créer un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040. En mai 2022, il a établi le Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap afin de lancer la Semaine nationale de l'accessibilité (SNA) et d'appuyer l'échange d'idées et de points de vue pour aider à façonner et à faire progresser des collectivités et des milieux de travail accessibles et inclusifs partout au Canada.
Depuis 2019, le Fonds Canada accessible a fourni 2,7 millions de dollars en financement annuel pour soutenir la communauté des personnes en situation de handicap. Cela comprend le financement de projets visant à accroître la capacité et à améliorer le leadership au sein de la communauté des intervenants auprès des personnes en situation de handicap, à faire mieux connaître la LCA, à changer les attitudes et les comportements, et à mobiliser les connaissances pour favoriser l'accessibilité et l'inclusion. En mai 2024, le Ministère a lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre du volet de la SNA du Fonds, qui fournira jusqu'à 2 millions de dollars sur 2 ans pour appuyer des projets visant à améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles à l'accessibilité. Plus de 300 demandes ont été reçues.
Le budget de 2022 prévoyait 5,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées afin de financer des projets visant à améliorer la capacité en interprétation en langue des signes professionnelle. Le deuxième appel de propositions en 2 étapes a pris fin en février 2024. Les ententes de financement pour les demandeurs retenus devraient être finalisées à l'automne 2024.
Dans le Plan d'action de 2023 concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que la mise en œuvre de la LCA pour les conseils de bande des Premières Nations soit appropriée sur le plan culturel et à ce que les Premières Nations soient appuyées dans l'amélioration de l'accessibilité au niveau communautaire.
Le Ministère a lancé une consultation nationale sur l'ébauche de la Feuille de route pour un Canada accessible. L'objectif de la mobilisation est d'amorcer une conversation nationale sur l'effort collectif requis par les agents de changement en matière d'accessibilité pour atteindre l'objectif d'un Canada exempt d'obstacles énoncé dans la LCA.
Messages clés
Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Pour réaliser un Canada exempt d'obstacles, il faut que tous les ordres de gouvernement et tous les Canadiens prennent des mesures, car la réalité, c'est que l'amélioration de l'accessibilité profite à tous.
Pour renforcer cet engagement, en 2019, le gouvernement a présenté la Loi canadienne sur l'accessibilité, une mesure historique, dans le but de créer un Canada exempt d'obstacles d'ici le 1er janvier 2040. Il s'agit de l'une des réalisations les plus importantes en matière de droits des personnes en situation de handicap au Canada.
En mettant l'accent sur l'identification, l'élimination et la prévention des obstacles, la Loi ouvre la voie à l'adoption généralisée d'une culture inclusive partout au Canada. Il s'agit d'une approche qui met l'accent sur la prise en compte de l'accessibilité dès le départ plutôt qu'après coup.
Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de la Loi en vase clos. Pour cette raison, nous lançons un engagement national à l'égard d'une ébauche de Feuille de route pour un Canada accessible. L'objectif de la Feuille de route consiste à susciter une discussion nationale sur la vision d'un Canada libre d'obstacles, ce qui aidera à orienter les efforts cohérents et complémentaires des intervenants en matière d'accessibilité et des agents de changement pour faire progresser l'accessibilité partout au Canada.
3.d. Questions et réponses : Loi canadienne sur l'accessibilité
État d'avancement concernant la réglementation sur l'accessibilité
1. Pourquoi le gouvernement n'a‑t‑il pas progressé plus rapidement dans l'élaboration de règlements en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité?
Depuis l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité, nous avons réalisé de grands progrès sur le plan réglementaire en mettant en place 3 ensembles de règlements qui rendent opérationnelles les exigences en matière de planification et d'établissement de rapports énoncées dans la Loi canadienne sur l'accessibilité.
Publiés en 2021, les règlements en matière de planification et d'établissement de rapports ont été élaborés par l'Office des transports du Canada (OTC), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC).
Toutefois, dans le but d'atteindre l'objectif d'un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040, nous voulons être certains que les organismes réglementés ne répondent pas simplement aux exigences réglementaires, mais qu'ils les dépassent. Après la publication des 3 ensembles de règlements concernant la production et l'établissement de rapports en matière d'accessibilité, nous avons publié une série de directives réglementaires pour aider ces organismes à utiliser leurs pratiques exemplaires dans le but d'aller au-delà des exigences.
En parallèle, EDSC travaille sur un nouveau projet de règlement sur l'accessibilité numérique qui sera disponible prochainement pour consultation.
Il ne faut pas oublier que l'élaboration de nouveaux règlements, surtout ceux qui touchent les entreprises, est un processus rigoureux qui doit tenir compte de nombreuses considérations.
D'abord et avant tout, conformément au principe « Rien sans nous », nous avons l'obligation de consulter les personnes en situation de handicap sur toute nouvelle politique ou initiative, ou tout nouveau programme qui pourrait les toucher, y compris l'élaboration de règlements.
De plus, tout nouveau règlement doit établir un équilibre entre les résultats et le fardeau pour les entreprises et les organismes réglementés, afin que les entités touchées aient la capacité de se conformer aux nouvelles exigences.
Il faut du temps pour élaborer des exigences réglementaires qui sont à la fois significatives et réalisables. Pour que ce travail réussisse, il ne peut pas être précipité.
Les répercussions de la Loi canadienne sur l'accessibilité vont s'accentuer avec le temps, à mesure que de plus en plus de règlements seront mis en place.
2. Pourquoi y a-t-il 3 ensembles de règlements concernant la planification et l'établissement de rapports sur l'accessibilité?
La Loi canadienne sur l'accessibilité utilise une approche sectorielle qui s'appuie sur les mandats actuels en matière d'accessibilité et sur l'expertise de l'Office des transports du Canada (OTC) et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
En vertu de cette approche, l'OTC et le CRTC continuent de surveiller et de réglementer l'accessibilité dans leur administration actuelle. De son côté, EDSC est responsable de la réglementation de l'accessibilité dans tous les domaines de compétence fédérale qui ne sont pas la responsabilité de l'OTC et du CRTC.
C'est pour cette raison qu'EDSC, l'OTC et le CRTC ont chacun leurs règlements sur la planification et l'établissement de rapports en vertu de la LCA.
Cela dit, ces règlements ont été conçus pour s'harmoniser les uns avec les autres afin que les entités réglementées, si elles le souhaitent, n'aient à produire qu'un seul ensemble de documents de planification et d'établissement de rapports pour les 3 organismes de réglementation.
3. Qu'est-ce qu'un règlement fondé sur des normes?
Les règlements fondés sur des normes sont ceux qui exigent que les organismes réglementés veillent à ce qu'un ou plusieurs aspects de leurs activités soient conformes à une norme reconnue.
Par exemple, un règlement fondé sur des normes axé sur l'accessibilité numérique pourrait exiger qu'une organisation s'assure que son site Web et ses applications mobiles sont conformes à une norme sur l'accessibilité numérique particulière, comme les Règles pour l'accessibilité des contenus Web.
Nouvelle réglementation sur les technologies numériques (technologies de l'information et des communications - TIC)
1. Pourquoi les TIC ont-elles été choisies comme prochaine matière à réglementation en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité?
Les TIC ou les technologies numériques sont un domaine prioritaire en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité.
Les technologies numériques prennent une place importante dans la vie quotidienne des gens. Par exemple, les gens les utilisent régulièrement pour gérer leurs finances et pour avoir accès aux prestations et aux programmes gouvernementaux.
Les TIC sont aussi un passeport pour l'emploi. C'est pourquoi garantir leur accessibilité est crucial pour éliminer les obstacles pour les chercheurs d'emploi et les employés, afin de soutenir leur avancement professionnel, et de permettre un travail sans obstacle, en particulier dans les environnements hybrides ou à distance.
De plus, le domaine de la technologie numérique est fortement soutenu par des normes internationales bien établies comme les Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) et les normes européennes (EN 301 549). Finalement, Normes d'accessibilité Canada a récemment adopté la norme européenne pour le Canada.
La progression de l'accessibilité des technologies numériques dans les secteurs fédéraux complète les efforts existants dans les autres compétences comme l'Ontario, le Québec et le Manitoba.
Cette progression s'harmonise également avec les approches adoptées par les partenaires stratégiques du Canada aux États-Unis et en Europe.
Compte tenu de la portée des règlements, en vertu du Règlement sur l'accessibilité au Canada touchant à la fois les organisations du secteur fédéral et celles du secteur privé, l'élaboration d'une réglementation sur l'accessibilité numérique positionnera le Canada parmi les chefs de file internationaux en la matière. Puisque, contrairement au Canada, la réglementation sur les technologies numériques accessibles dans certains pays partenaires, comme les États-Unis, ne touche que les organisations fédérales.
2. Quand la nouvelle réglementation sur les technologies numériques accessibles sera-t-elle publiée aux fins de commentaires?
Au cours des dernières années, Emploi et Développement social Canada a travaillé sans relâche sur la réglementation relative aux technologies numériques accessibles.
Ce travail comprend des consultations approfondies sur une période de plus de 18 mois auprès de personnes en situation de handicap, d'organismes fédéraux, d'entreprises et d'organisations du secteur privé, et de fournisseurs de TI. Ces consultations visent à s'assurer que la nouvelle réglementation reflète les besoins des personnes en situation de handicap, et que les entreprises concernées possèdent les connaissances et la capacité pour se conformer aux exigences réglementaires.
Nous travaillons à faire progresser ces règlements le plus rapidement possible.
Dès que les projets de réglementation sont publiés, EDSC organisera une série de séances d'information technique. Lors de ces séances, EDSC expliquera la réglementation proposée dans un langage général pour encourager la communauté des personnes en situation de handicap, les organismes réglementés et les Autochtones à participer au processus de consultation.
3. Est-ce que la réglementation des technologies de l'information et des communications utilisera la norme pour l'accessibilité numérique qui a été récemment adoptée par Normes d'accessibilité Canada?
Le contenu du projet de règlement relève des renseignements confidentiels du Cabinet.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de faire progresser l'accessibilité et de mettre en œuvre la Loi canadienne sur l'accessibilité, que ce soit à l'aide de réglementation ou d'autres mécanismes, EDSC fait tous les efforts possibles pour veiller à avoir une approche cohérente. Cette approche vise à réduire au minimum les répercussions sur les personnes en situation de handicap et les autres intervenants.
Promotion de la conformité et application de la Loi canadienne sur l'accessibilité et de ses règlements
1. Quelles sont les responsabilités du commissaire à l'accessibilité?
Le commissaire à l'accessibilité est responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'accessibilité et du Règlement canadien sur l'accessibilité.
Il traite également certaines plaintes relatives à l'accessibilité. Une personne peut déposer une plainte au commissaire à l'accessibilité si elle a subi des dommages physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une contravention au Règlement par une entité réglementée.
2. De qui le commissaire à l'accessibilité relève-t-il?
Le commissaire à l'accessibilité est nommé par le ministre de la Justice, et est un membre de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) qui est indépendante du gouvernement.
En vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, le commissaire à l'accessibilité doit soumettre un rapport annuel à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap qui résume les activités en lien avec l'administration et l'application de la LCA.
Une copie de ce rapport doit aussi être envoyée au ministre de la Justice.
La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap doit déposer ce rapport dans les 2 Chambres du Parlement.
3. Quels efforts ont été déployés pour s'assurer que les entités réglementées comprennent leurs obligations en vertu du Règlement canadien sur l'accessibilité?
Parallèlement à la publication du Règlement canadien sur l'accessibilité en 2021, EDSC a élaboré une gamme de documents d'orientation destinés à aider ces entités à répondre aux exigences réglementaires.
Au total, il y a 8 documents d'orientation distincts pour les entités réglementées. Ces documents couvrent tout : préparation de plans et rapports dans un langage simple, clair et concis; procédures de consultation avec les personnes en situation de handicap; contenu qui devrait être inclus dans un plan sur l'accessibilité; etc.
Le bureau du commissaire à l'accessibilité a aussi publié des documents d'orientation et des modèles complémentaires pour les plans d'accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d'état d'avancement.
En plus de la création de matériel d'orientation, le commissaire à l'accessibilité a émis des lettres à tous les organismes réglementés du secteur privé pour les informer de leurs obligations et pour leur transmettre l'information sur les documents d'orientation et les outils existants.
Finalement, le commissaire à l'accessibilité et son bureau ont participé à environ 150 réunions avec des organismes sous réglementation fédérale, des représentants et des organismes des communautés de personnes en situation de handicap, et d'autres agences gouvernementales. Ces intervenants sont responsables de mener des activités de sensibilisation, d'accroître celle-ci, d'établir des relations et de recueillir de l'information en vertu de la LCA.
4. Quel est le taux de conformité aux rapports de conformité d'accessibilité?
Organismes gouvernementaux
Comme l'indique le rapport annuel 2023 du commissaire à l'accessibilité, il y avait un taux de conformité très élevé pour les exigences liées à la notification, à la publication et à l'accessibilité du contenu Web.
Grandes entreprises du secteur privé (100 employés ou plus)
Initialement, à la suite de l'échéancier du 1er juin 2023, le taux de conformité des grandes entreprises du secteur privé était bas. Seulement 22 % de ces entreprises avaient avisé le commissaire à l'accessibilité de la publication de leur plan initial et de la description de leur processus de rétroaction avant l'échéancier.
Pour aider à résoudre le faible taux de conformité pour ces entreprises, des lettres de mise en garde ont été envoyées pour les informer de leurs obligations.
Il y a eu une augmentation stable dans le nombre de notifications; d'environ 20 % (depuis le 1er juin 2023) à 40 % (depuis le 31 mars 2024).
La CCDP a continué son travail pour s'assurer que les entités sont au courant des exigences réglementaires, et pour accroître le taux de conformité.
5. [SI L'ON INSISTE] Quels sont les plus récents taux de conformité pour le gouvernement fédéral ou le secteur privé?
La CCDP continue son travail pour s'assurer que les entités sont au courant des exigences réglementaires, et que les taux de conformité augmentent.
Les questions en lien avec le taux de conformité devraient être envoyées au bureau du commissaire à l'accessibilité, étant donné qu'ils seraient les mieux placés pour fournir l'information à jour.
6. [SI L'ON INSISTE] La conformité et l'application de la réglementation sont-elles toujours en cours, étant donné que le commissaire à l'accessibilité est actuellement absent?
Les employés du bureau du commissionnaire à l'accessibilité possèdent des pouvoirs délégués en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, ce qui leur permet de continuer leur travail.
Ce travail comprend la vérification auprès des organismes réglementés pour voir s'ils respectent leurs obligations en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité.
Plaintes
1. Qui peut déposer une plainte en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité?
Toute personne peut déposer une plainte si elle a subi un préjudice physique ou psychologique, des dommages matériels ou une perte financière, ou si elle a été autrement lésée par le non-respect d'un règlement en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité.
2. Comment les plaintes relatives à l'accessibilité sont-elles traitées?
La Loi canadienne sur l'accessibilité prévoit une approche « sans fausse route » pour le traitement des plaintes. Cette expression signifie que, peu importe l'endroit où une plainte en matière d'accessibilité est déposée, elle sera envoyée au bon ministère aux fins de traitement.
Une fois que le ministère adéquat a reçu la plainte, celui-ci fera une enquête selon ses propres processus.
Plus précisément, l'Office des transports du Canada traite les plaintes liées à l'accessibilité dans le réseau de transport fédéral, y compris les compagnies aériennes ainsi que les fournisseurs de service de transports ferroviaire, routier et maritime qui traversent les frontières provinciales ou internationales.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes traite les plaintes dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications.
La Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique fédérale traite les plaintes au sein de la fonction publique fédérale.
Le bureau du commissaire à l'accessibilité traite les plaintes dans tous les autres secteurs relevant du gouvernement fédéral. Par exemple, les banques et les élévateurs à grains, ainsi que toutes les plaintes qui proviennent de la non-conformité d'un organisme réglementé avec le Règlement canadien sur l'accessibilité.
De plus, la Direction générale des services d'examen des plaintes de la Commission canadienne des droits de la personne traite les plaintes relatives à la discrimination et au harcèlement en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Toutefois, parce que nous avons établi une approche « sans fausse route », les plaintes en matière d'accessibilité seront envoyées à l'organisme approprié.
3. [SI L'ON INSISTE] Y a-t-il eu des plaintes à ce jour et, le cas échéant, quels ont été les résultats?
À ma connaissance, aucune plainte de cette nature n'a été déposée et corroborée à ce jour.
La raison pour laquelle aucune plainte n'a été déposée pourrait s'expliquer par le fait que les seuls règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité actuellement en vigueur ont trait à la planification et aux rapports. Les plaintes devraient porter sur des organisations qui ne respectent pas les exigences réglementaires relatives à la publication des plans d'accessibilité, des rapports d'étape ou à l'élaboration de processus de rétroaction.
Le bureau du commissaire à l'accessibilité est responsable de l'information en lien avec les plaintes.
Élaboration des normes d'accessibilité
1. Comment Normes d'accessibilité Canada (NAC) élabore-t-elle ses normes?
Chaque norme est élaborée par un comité technique que NAC crée et soutient.
Les comités techniques sont composés de bénévoles.
Au moins 30 % des membres sont des personnes en situation de handicap. Les comités techniques comprennent également des experts et des représentants de l'industrie.
2. Qui détermine les normes que NAC devrait élaborer?
NAC a un conseil d'administration responsable de la supervision de ses activités, ce qui comprend l'orientation sur les normes à élaborer.
La plupart des directeurs sont des personnes en situation de handicap, et le conseil reflète la diversité de la société canadienne.
3. Quels progrès NAC a-t-elle réalisés à ce jour dans l'élaboration de normes en matière d'accessibilité?
NAC a récemment adopté la norme harmonisée européenne pour les technologies de l'information et des communications (TIC) pour son utilisation au Canada.
NAC a publié plusieurs ébauches de normes pour recueillir les commentaires du public, y compris une norme clé en matière d'emploi accessible, dont une partie devrait être finalisée au cours des prochains mois.
D'autres projets de normes sur les mesures d'urgence, les espaces extérieurs, l'environnement bâti et le langage simple ont été publiés aux fins de commentaires.
Plus d'une douzaine d'autres comités techniques se penchent sur divers nouveaux sujets importants, y compris la conception et la prestation de programmes et services accessibles, l'utilisation équitable de l'intelligence artificielle, le tourisme accessible et les évacuations d'urgence.
NAC finance également divers projets de recherche pour éclairer l'élaboration de normes d'accessibilité.
NAC transmet régulièrement de l'information sur son travail avec ses partenaires provinciaux et territoriaux et a signé des ententes avec les 6 provinces suivantes pour favoriser l'échange d'information et l'harmonisation éventuelle des normes : le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario.
Normes et règlements
1. La conformité aux normes de Normes d'accessibilité Canada (NAC) est-elle obligatoire?
La conformité aux normes, y compris celles élaborées par NAC, est volontaire à moins qu'une norme ne soit intégrée dans un règlement.
2. Toutes les normes élaborées par NAC sont-elles transformées en règlements?
Non, les normes de NAC ne deviennent pas automatiquement des règlements.
NAC peut soumettre ses nouvelles normes à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap pour qu'elles soient prises en considération dans un règlement, mais ce n'est pas automatique.
Emploi et Développement social Canada fournit des conseils à la ministre quant à la nécessité d'adopter une norme dans un règlement, en tenant compte d'un éventail de considérations fondées sur des données probantes, y compris l'ampleur des répercussions pour les personnes en situation de handicap ainsi que les organismes réglementés.
3. Que se passe-t-il si la ministre décide qu'une norme devrait être adoptée dans un règlement?
Si le ministre décide d'adopter une norme dans un règlement, EDSC doit suivre le processus normalisé d'élaboration de la réglementation.
Cela comprend la mobilisation réglementaire auprès de tous les intervenants concernés, y compris les personnes en situation de handicap et les organismes réglementés des secteurs fédéral et privé, la rédaction des exigences proposées, la publication des exigences proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada aux fins de consultation avec les Canadiens, l'intégration des commentaires dans les exigences proposées et la publication du règlement définitif dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
4. Que se passe-t-il lorsqu'une norme est adoptée dans un règlement?
La principale répercussion est que la conformité à la norme devient obligatoire pour tous les organismes sous réglementation fédérale.
Cela signifie que non seulement l'ensemble de la fonction publique doit s'y conformer, mais aussi les sociétés d'État et le secteur privé sous réglementation fédérale, comme les banques, certains musées et certains fournisseurs de services de transport.
Étant donné que les répercussions peuvent être très vastes, EDSC évalue attentivement toutes les normes afin de déterminer lesquelles sont appropriées pour devenir obligatoires.
5. Si les normes de NAC demeurent volontaires, comment permettent-elles de progresser vers un Canada exempt d'obstacles?
Les normes de NAC sont offertes gratuitement, dans les 2 langues officielles, et peuvent être adoptées par n'importe quel organisme au Canada.
Les normes peuvent offrir de la souplesse et des outils supplémentaires qui sont utiles à ceux qui peuvent et veulent aller au-delà de ce qui peut être requis dans leur administration.
Elles fournissent des conseils et des renseignements clairs à tous les citoyens du Canada, et même de l'étranger, sur les pratiques exemplaires.
Elles peuvent servir de catalyseur pour le changement et sensibiliser la population aux problèmes d'accessibilité. Par conséquent, les normes volontaires jouent un rôle important dans l'élimination des obstacles.
L'adoption volontaire de normes par les organismes aide également à élaborer la base de données probantes sur l'efficacité et les coûts et avantages qui sont nécessaires à l'élaboration de règlements.
6. Comment NAC travaille-t-elle avec les provinces et les territoires pour répondre à des exigences communes?
NAC partage régulièrement de l'information sur son travail avec ses partenaires provinciaux et territoriaux. Cela ouvre la porte à des possibilités de collaboration.
À ce jour, NAC a signé des ententes avec 6 provinces pour favoriser l'échange d'information et l'harmonisation éventuelle des normes, y compris des ententes avec le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario.
Tous les Canadiens gagnent à ce que les exigences soient les mêmes partout au pays.
Dirigeante principale de l'accessibilité (DPA) du Canada
1. La ministre dirige‑t‑elle le travail de la DPA?
Le mandat de la DPA est décrit dans la Loi canadienne sur l'accessibilité, et vise à fournir à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap des conseils indépendants sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité et sur les problèmes d'accessibilité émergents ou systémiques.
Dans le cadre de son travail, la DPA peut consulter ou collaborer avec un large éventail de partenaires et d'intervenants, y compris la communauté des personnes en situation de handicap.
2. La fonction de DPA est-elle obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité?
Non, en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, le ministre responsable de la LCA peut nommer un DPA.
3. À quelle fréquence la DPA publie‑elle un rapport?
La DPA doit présenter un rapport annuel à la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.
Le rapport doit résumer les résultats obtenus dans le cadre de la LCA et peut traiter de tout problème systémique ou émergent en matière d'accessibilité.
La ministre est tenue de déposer le rapport devant les 2 chambres du Parlement.
La ministre peut aussi demander à la DPA de préparer un rapport spécial sur les problèmes d'accessibilité systémiques ou émergents.
4. La ministre doit‑elle donner suite aux recommandations de la DPA?
La DPA agit à titre de conseillère auprès de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap. Les rapports du DPA visent à informer la ministre.
Formation obligatoire sur l'accessibilité
1. La formation sur l'accessibilité pour les entités sous réglementation fédérale devrait-elle être obligatoire?
La formation est particulièrement importante, car il s'agit d'un outil clé pour sensibiliser les gens aux obstacles comportementaux auxquels font face les personnes en situation de handicap en milieu de travail et dans les collectivités, et pour y remédier.
Elle joue également un rôle clé dans le développement de l'expertise et des connaissances, ainsi que dans le renforcement des capacités au sein des organismes réglementés afin que leurs employés soient mieux outillés pour fournir des services, des produits et des programmes à leurs clients et aux clients en situation de handicap.
La formation n'est qu'un exemple de la façon dont l'harmonisation de nos efforts peut nous aider à atteindre plus efficacement l'objectif d'un Canada exempt d'obstacles.
United States Access Board / Centre d'excellence sur l'accessibilité
1. Le Canada devrait-il établir un centre d'excellence comme l'a proposé la DPA, Stephanie Cadieux? (inspiré du United States Access Board)
Le gouvernement a déjà créé plusieurs nouveaux rôles et organismes voués à la promotion de l'accessibilité et à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité :
- par exemple, la Direction du Canada accessible d'EDSC est le point central pour la mise en œuvre de la LCA;
- l'organisme est chargé d'élaborer des règlements conformément à la LCA, d'élaborer de nouveaux programmes qui appuient la mise en œuvre de la LCA et d'aider la communauté des personnes en situation de handicap à renforcer les capacités et les partenariats qui mobilisent le savoir pour faire progresser l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap;
- de plus, le Bureau de l'accessibilité de la fonction publique du Secrétariat du Conseil du Trésor aide les ministères et organismes à se conformer à la LCA et sert de point central pour faire du gouvernement du Canada la fonction publique la plus accessible au monde;
- Normes d'accessibilité Canada a créé un programme de recherche qui offre du financement à des organismes partout au Canada pour générer des recherches qui éclairent l'élaboration de normes.
Au-delà de ces nouvelles structures et dans le cadre de son approche sectorielle, la Loi canadienne sur l'accessibilité a maintenu les organismes déjà existants responsables de l'accessibilité, dont ceux au sein de l'Office des transports du Canada.
Ensemble, ces organismes et ces rôles créent un solide système de promotion de l'accessibilité qui va bien au-delà des objectifs du U.S. Access Board.
2. Le U.S. Access Board joue un rôle clé en fournissant au public des renseignements fiables sur l'accessibilité. De quelle façon le gouvernement du Canada partage-t-il actuellement l'information sur l'accessibilité avec les Canadiens?
Des renseignements exacts sur l'accessibilité sont essentiels pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles.
C'est pourquoi EDSC a publié la Stratégie fédérale de mesure et de données sur l'accessibilité en 2022. Depuis la publication de la Stratégie, EDSC a travaillé à l'établissement d'indicateurs de rendement qui permettent de mesurer les progrès réalisés dans la reconnaissance et l'élimination des obstacles à l'accessibilité au fil du temps.
EDSC collabore également avec Statistique Canada et d'autres partenaires fédéraux pour recueillir, analyser et partager des données sur l'accessibilité afin d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes.
L'un de nos principaux outils de collecte de données est l'Enquête canadienne sur l'incapacité, qui est menée tous les 5 ans depuis 2017. En 2022, le questionnaire du sondage comprenait un nouveau module comportant des questions sur certains obstacles à l'accessibilité. Les données extraites des réponses à ces questions sont en cours d'analyse et seront diffusées sous forme de 4 rapports qui seront publiés au cours de la prochaine année.
De concert avec Statistique Canada, EDSC a également créé le Carrefour de statistiques sur l'accessibilité, une page Web où tout membre du public peut accéder à des données sur l'accessibilité.
EDSC tient également une page Web sur le site www.canada.ca qui fournit de l'information et des liens vers des pages connexes expliquant ce que fait le gouvernement fédéral pour favoriser l'accessibilité.
Accroître la sensibilisation à l'accessibilité et éliminer les obstacles comportementaux
1. Qu'a fait le gouvernement du Canada pour accroître la sensibilisation à l'accessibilité?
La Semaine nationale de l'accessibilité (SNA) est un jalon législatif de la Loi canadienne sur l'accessibilité qui a lieu chaque année à compter du dernier dimanche de mai.
L'objectif de la SNA est de célébrer les précieuses contributions des Canadiens en situation de handicap et les efforts des personnes, des collectivités et des milieux de travail qui travaillent activement à éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Ce jalon annuel est essentiel pour éliminer les obstacles comportementaux qui persistent dans les milieux de travail et les collectivités.
En 2022, EDSC a mis sur pied le Congrès canadien annuel sur l'inclusion des personnes en situation de handicap afin de sensibiliser la population et de créer une dynamique entourant les célébrations de la SNA et les mesures d'accessibilité et d'inclusion.
L'objectif est de réunir des leaders d'opinion et des innovateurs de la communauté des personnes en situation de handicap, du milieu des affaires, du milieu universitaire et d'autres secteurs afin qu'ils échangent de l'information, des idées et des pratiques exemplaires pour aider à façonner des collectivités et des milieux de travail accessibles et inclusifs partout au Canada.
Le volet SNA du Fonds Canada accessible finance également des projets qui appuient les célébrations de la SNA et les activités de sensibilisation dans les collectivités et les milieux de travail partout au Canada.
2. Quelle est la portée des activités de la SNA?
Le Congrès canadien annuel sur l'inclusion des personnes en situation de handicap (CCIH) est un événement virtuel, accessible et inclusif qui est gratuit et ouvert au public.
Depuis sa création en 2022, le CCIH a rejoint plus de 11 000 participants inscrits de partout au Canada et d'ailleurs.
En 2024, EDSC a créé une page réservée au CCIH sur le site Canada.ca pour permettre à quiconque d'accéder aux transcriptions et aux enregistrements afin de poursuivre son apprentissage.
Cela s'ajoute au travail important que les organismes communautaires mènent, en partie grâce au soutien qu'ils reçoivent du Fonds Canada accessible, afin de sensibiliser la population à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
3. De quelle façon la SNA contribue-t-elle aux objectifs de changement de culture de la Loi canadienne sur l'accessibilité?
Les célébrations de la SNA et le Congrès canadien annuel sur l'inclusion des personnes en situation de handicap contribuent aux objectifs de changement de culture de la LCA en amplifiant les voix, les expériences et les progrès réalisés par les personnes en situation de handicap pour éliminer les obstacles.
Plus précisément, les programmes de la SNA et du CCIH visent à faire passer la culture de « l'accessibilité après coup » à « l'inclusion dès le départ ».
Financement pour soutenir l'accessibilité
1. Quels sont les financements existants qui appuient l'accessibilité?
Dans le cadre de plusieurs programmes, le Ministère a appuyé des projets communautaires visant à renforcer les capacités au sein de la communauté des personnes en situation de handicap afin que ces dernières soient au cœur de nos efforts pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040.
Dans le cadre de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, le Ministère verse 11 millions de dollars par année à l'appui d'ententes visant à améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
Dans le cadre de ce programme, le Fonds Canada accessible offre un financement annuel de 2,7 millions de dollars à des organismes sans but lucratif et à d'autres secteurs afin de soutenir des projets axés sur l'accessibilité selon 2 volets.
Le volet de la Semaine nationale de l'accessibilité finance des projets plus modestes qui appuient les célébrations et les activités de la SNA dans les collectivités et les milieux de travail partout au Canada.
Le volet Partenariats de l'initiative Canada accessible finance des projets de plus grande envergure qui renforcent les capacités et favorisent des partenariats clés entre la communauté des personnes en situation de handicap, les secteurs sous réglementation fédérale et d'autres secteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la LCA.
Le Fonds pour l'accessibilité (FA) offre du financement pour appuyer des projets communautaires et en milieu de travail partout au Canada visant à améliorer l'accessibilité dans des domaines comme l'environnement bâti ou les technologies de l'information et des communications.
Le Fonds pour l'accessibilité est doté d'un financement de base permanent de 13,65 millions de dollars par année; d'un financement supplémentaire pour les infrastructures sociales de 7 millions de dollars par année (jusqu'en 2027 à 2028 sous forme de subventions et contributions) et de 10 millions de dollars sur 2 ans, à partir du budget 2023 pour la période allant de 2024 à 2025 à 2025 à 2026.
Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées aide les personnes en situation de handicap à se préparer au marché du travail, à obtenir un emploi et à le maintenir. Il offre du financement aux employeurs et aux fournisseurs de services d'emploi pour appuyer la formation professionnelle, mettre en place des mesures d'adaptation en milieu de travail et créer des milieux de travail accessibles.
Dans le cadre du Fonds d'intégration, le gouvernement du Canada versera 5,5 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer l'accès à l'interprétation gestuelle professionnelle. Les projets financés dans le cadre de cet appel visent à accroître le nombre d'interprètes gestuels formés en sensibilisant davantage la population au cheminement de carrière et en aidant les interprètes existants à améliorer leurs compétences et à demeurer sur le marché du travail.
2. De quelle façon le gouvernement du Canada appuie-t-il l'accès à l'interprétation gestuelle professionnelle?
Il y a moins de 1 000 interprètes gestuels professionnels au Canada, ce qui est loin d'être suffisant pour servir la population canadienne de personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent la langue des signes comme principale langue de communication.
En plus de la mobilisation des intervenants, y compris les établissements d'enseignement de l'interprétation gestuelle, les fournisseurs de services d'interprétation, les associations professionnelles et les organisations représentant les utilisateurs de la langue des signes, le gouvernement du Canada a lancé le tout premier appel de propositions visant à améliorer l'accès à l'interprétation gestuelle professionnelle. Dans le cadre du Fonds d'intégration, un investissement de 5,5 millions de dollars sur 3 ans vise à accroître la sensibilisation aux programmes reconnus d'interprétation gestuelle, à augmenter le nombre d'interprètes gestuels qualifiés et à améliorer les compétences des interprètes gestuels existants.
Les négociations avec les bénéficiaires du financement sont en cours.
Feuille de route pour un Canada accessible
1. En quoi consiste la Feuille de route pour un Canada accessible et comment appuie-t-elle la réalisation d'un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040?
Nous savons que la réalisation d'un Canada exempt d'obstacles exige que tout le monde travaille ensemble.
Les provinces, les territoires, les municipalités, la société civile, les organisations de personnes en situation de handicap et le secteur privé agissent chaque jour pour améliorer l'accessibilité.
La Feuille de route pour un Canada accessible vise à faire en sorte que le résultat de nos efforts combinés soit supérieur à la somme de chaque contribution individuelle. Elle présente une vision nationale servant à orienter les efforts vers un Canada exempt d'obstacles.
Nous espérons que tous ceux qui participent à la promotion de l'accessibilité, tous les Canadiens, utiliseront la Feuille de route définitive pour déterminer les mesures à prendre afin de contribuer à notre objectif collectif d'un Canada exempt d'obstacles.
2. Combien de temps dure le processus de consultation sur l'ébauche de la Feuille de route pour un Canada accessible?
L'engagement en ligne sur l'ébauche de la Feuille de route est ouvert jusqu'au 8 janvier 2025.
L'objectif de la consultation est de veiller à ce que la Feuille de route reflète les besoins et les points de vue des personnes en situation de handicap et d'autres collectivités à l'image de la diversité du Canada.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur l'ébauche de la Feuille de route et la vision d'un Canada exempt d'obstacles.
Les Canadiens peuvent consulter le site Canada.ca pour en savoir plus sur la façon de participer.
Inaccessibilité des audiences du comité HUMA
1. À la lumière des témoins du comité HUMA qui n'ont pas pu participer en raison de problèmes d'accessibilité, que fait le gouvernement pour s'assurer que le Parlement est exempt d'obstacles?
Il s'agissait d'un événement malheureux et regrettable.
Les Canadiens qui sont appelés à témoigner aux audiences du comité devraient pouvoir participer sans obstacle.
Mon ministère s'est engagé à travailler avec le Parlement et le Bureau de la traduction pour éviter que cette situation ne se reproduise.
Transport accessible
1. Que fait le gouvernement pour se conformer aux recommandations du vérificateur général en matière de transport?
Il ne serait pas approprié que je commente ici puisque les organismes visés par les recommandations, comme VIA Rail, l'Office des transports du Canada (OTC) et l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, relèvent de la ministre des Transports.
2. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas de renseignements sur les plaintes déposées auprès des fournisseurs de services de transport?
À l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas le pouvoir d'exiger que les fournisseurs de services de transport fournissent régulièrement des données sur les plaintes relatives à l'accessibilité.
Les personnes en situation de handicap qui vivent une expérience de voyage négative peuvent déposer des plaintes auprès du fournisseur de services de transport ou de l'OTC. Toutefois, lorsque les plaintes sont présentées uniquement au fournisseur de services de transport, l'OTC n'en est pas avisé.
Le gouvernement veut changer la donne en apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada dans le projet de loi C-52 qui a été présenté à la Chambre des communes au printemps 2023. Les modifications donneraient au gouvernement le pouvoir de prendre des règlements concernant la fourniture de données sur l'accessibilité par les fournisseurs de services de transport.
3. Quels progrès ont été réalisés en ce qui concerne les engagements découlant du Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien?
Lors du sommet, tous les partenaires ont convenu de trouver des moyens d'assurer un transport fluide pour les personnes en situation de handicap et de rendre le transport aérien plus inclusif et agréable pour tous.
En particulier, les compagnies aériennes ont convenu de travailler ensemble pour rationaliser les processus et adopter un formulaire médical commun pour les passagers en situation de handicap qui simplifierait la préparation de leur voyage. Elles ont également convenu d'explorer des façons de recueillir et de partager les données plus efficacement avec les ministères.
Transports Canada supervise ce travail, alors toute autre question au sujet de ces efforts devrait être adressée à la ministre des Transports.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
1. Quel est le rôle du CRTC conformément à la LCA pour améliorer l'accessibilité?
Selon l'approche sectorielle de la Loi canadienne sur l'accessibilité, le CRTC maintient ses pouvoirs de réglementation en matière d'accessibilité, qui existaient avant la LCA.
Cela signifie que le CRTC continue d'être responsable de réglementer la plupart des aspects de l'accessibilité pour les entités de radiodiffusion et de télécommunications.
Cela comprend le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l'accessibilité du CRTC de 2021, pris en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui énonce les exigences relatives aux plans d'accessibilité, aux rapports d'étape et aux processus de rétroaction des entités de radiodiffusion et de télécommunications.
EDSC, en tant que ministère fédéral responsable de la réglementation de l'emploi dans les secteurs fédéraux, est chargé de réglementer les aspects liés à l'emploi de l'accessibilité pour les radiodiffuseurs, les fournisseurs de services de télécommunications et les entreprises canadiennes.
3.e. Programme de partenariats pour le développement social : Personnes en situation de handicap
Enjeu
Quels progrès le gouvernement a-t-il réalisés pour respecter l'engagement pris dans son mandat de renforcer la capacité des organisations nationales œuvrant auprès des personnes en situation de handicap?
Contexte
- La composante Personnes en situation de handicap du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS-PH) appuie et renforce les principales activités des organisations nationales de personnes en situation de handicap afin d'améliorer le rendement et les activités; de créer des partenariats durables et efficaces; d'assurer la durabilité des services; et, en bout du compte, de démontrer l'impact sur l'amélioration de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap au Canada.
- Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé un financement de 10 millions de dollars sur 2 ans (de 2023 à 2024 à 2024 à 205) pour le PPDS-PH. Ce financement est consacré au renforcement de la capacité des organismes œuvrant auprès des personnes en situation de handicap au moyen de partenariats visant à répondre aux besoins en matière de capacité et à permettre aux personnes en situation de handicap d'apporter une contribution précieuse à leurs collectivités
- En novembre 2023, le programme a lancé un appel de propositions (AP) qui a donné lieu à des investissements dans des projets tombant dans 2 volets d'activités : des projets en matière de renforcement de la capacité organisationnelle des organismes œuvrant pour les personnes en situation de handicap dans des domaines tels que la mesure des résultats et la gouvernance, ainsi que des projets en matière de développement des capacités intersectionnelles où les organismes et leurs partenaires sont soutenus afin d'éliminer les obstacles pour les divers groupes formant la population de personnes en situation de handicap. Les projets financés feront également la promotion d'un plus vaste partage d'information entre les organisations au Canada pour appuyer l'acquisition de connaissances, partager les outils et les pratiques exemplaires et élaborer des perspectives intersectionnelles et transversales en matière d'incapacité.
- Le programme a également appuyé le renforcement des capacités des organisations nationales œuvrant auprès des personnes en situation de handicap en investissant dans un projet de LIFT Impact Partners. Par l'entremise d'un modèle de cohorte de pairs, ce projet permet aux organismes sans but lucratif œuvrant auprès de personnes en situation de handicap d'améliorer et d'accroître leur capacité organisationnelle, améliorant ainsi leur efficacité et leur responsabilisation dans la communauté des personnes en situation de handicap
- Ces investissements appuieront la réalisation de l'engagement pris dans la lettre de mandat de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et les engagements pris dans le cadre du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap afin d'aider les organisations nationales de personnes en situation de handicap à renforcer leurs capacités et à collaborer aux efforts visant à éliminer les obstacles systémiques
Faits saillants
- Il existe 6,2 millions de personnes en situation de handicap au Canada. Elles constituent environ 22 % de la population canadienne. Les personnes en situation de handicap reflètent la diversité et la composition de la population canadienne, selon les groupes d'âge, l'ethnicité, la race et le sexe. Elles font face à de nombreuses inégalités sociales et économiques de longue date.
- La communauté des personnes en situation de handicap et les organisations les représentant n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre adéquatement aux demandes qui pèsent sur leur capacité de fournir leur expertise et leur point de vue au gouvernement. Le rôle et les membres des groupes représentant les personnes en situation de handicap continuent d'évoluer. On est de plus en plus conscient de la nécessité de tenir compte de l'intersectionnalité des groupes de personnes en situation de handicap avec d'autres groupes marginalisés.
- Pour remplir cet engagement, le programme a attribué environ 8,8 millions de dollars en subventions et contributions sur 2 ans, à compter de 2023 à 2024, du financement prévu dans le budget de 2023 dans le cadre de 2 initiatives :
- 2 millions de dollars (1,4 million de dollars en 2024 à 2025) pour appuyer un projet de LIFT Impact Partners qui permettra aux organismes sans but lucratif œuvrant auprès des personnes en situation de handicap d'améliorer leur capacité organisationnelle au moyen d'un modèle de cohorte de pairs;
- 6,8 millions de dollars (3,6 millions de dollars en 2024 à 2025) pour appuyer les organismes nationaux sans but lucratif œuvrant auprès des personnes en situation de handicap au moyen de l'AP en matière de renforcement de la capacité, plus particulièrement sous le volet de renforcement de la capacité organisationnelle.
Principaux messages
- Le renforcement des capacités internes des organisations œuvrant auprès des personnes en situation de handicap leur permet de participer et de contribuer aux efforts du gouvernement visant à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap, conformément au principe « Rien sans nous ». Cela comprend la capacité des organisations œuvrant auprès des personnes en situation de handicap de répondre à la demande qui leur est faite de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'initiatives visant à favoriser leur inclusion.
- Le fait de permettre à la communauté des personnes en situation de handicap d'avoir les compétences et les ressources nécessaires pour travailler aux côtés du gouvernement amplifiera l'impact positif des dépenses fédérales et des nouvelles initiatives.
3.f. Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (PAIPSH)
Enjeu
Comment le gouvernement fait-il progresser la mise en œuvre du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (PAIPSH).
Contexte
La lettre de mandat de décembre 2021 de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap prévoyait la finalisation et la diffusion d'un PAIPSH.
- Le gouvernement a publié le tout premier PAIPSH du Canada en octobre 2022. Le Plan d'action comporte 4 piliers : la sécurité financière; l'emploi; les communautés accessibles et inclusives et l'adoption d'une approche moderne à l'égard des personnes en situation de handicap.
- Les principales mesures dans le cadre du PAIPSH comprennent la nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées et la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap.
- Le budget de 2024 prévoyait:
- 6,1 milliards de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 et 2025, et 1,4 milliard de dollars par année par la suite, pour le versement de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Les paiements devraient commencer en juillet 2025;
- les détails sur l'admissibilité à la prestation comprennent : un montant maximal de 2 400 $ par année pour les personnes en situation de handicap à faible revenu âgées de 18 à 64 ans ayant un certificat valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- 243 millions de dollars sur 6 ans, à compter de 2024 et 2025, et 41 millions de dollars par année par la suite, pour couvrir le coût des formulaires médicaux requis pour présenter une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées.
- Le budget de 2022 et de 2023 ont fait un investissement initial important pour faire progresser la mise en œuvre du PAIPSH, notamment :
- une somme de 10 millions de dollars sur 2 ans à compter de 2023 et 2024 pour aider à répondre aux besoins uniques et aux obstacles continus auxquels font face les personnes en situation de handicap en investissant dans le renforcement des capacités et le travail communautaire des organisations de personnes en situation de handicap au Canada (compris dans le Budget supplémentaire des dépenses B de 2023 à 2024);
- un financement de 21,5 millions de dollars en 2023 à 2024 pour la poursuite des travaux en vue du versement futur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, ce qui comprend la mobilisation de la communauté des personnes en situation de handicap et des provinces et territoires au processus réglementaire (compris dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2023 à 2024);
- une somme de 10 millions de dollars sur 2 ans à compter de 2024 et 2025 à l'intention du Fonds pour l'accessibilité.
- Autres engagements en matière du PAIPSH annoncés précédemment dans le budget de 2022 :
- le financement de 276,5 millions de dollars sur 5 ans, ainsi qu'un financement de 185 millions de dollars en permanence, pour appuyer la mise en œuvre d'une stratégie d'emploi pour les personnes en situation de handicap par l'entremise du Fonds d'intégration. (Cela figurait dans le Budget supplémentaire des dépenses B de l'an dernier en 2022 à 2023.) Il permettra de pallier les pénuries de main-d'œuvre en augmentant la participation des personnes en situation de handicap et en rendant les milieux de travail plus inclusifs et accessibles. De ce financement, 20 millions de dollars seront affectés au programme Prêts, disponibles et capables pour aider les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ou de déficiences intellectuelles à trouver un emploi;
- la somme de 25 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer la production de documents en médias substituts par le Centre d'accès équitable aux bibliothèques et le Réseau national de services équitables de bibliothèque; mener des recherches pour mieux comprendre les lacunes dans la disponibilité de documents de lecture accessibles; et lancer un nouveau Programme d'accès équitable à la lecture pour dynamiser la production de documents de lecture en format accessible grâce à des partenariats novateurs.
Faits saillants
La première mise à jour annuelle du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap a été publiée la semaine suivant la Journée internationale des personnes en situation de handicap, le 8 décembre 2023. La mise à jour annuelle souligne les progrès réalisés à l'égard des mesures de suivi dans les 4 piliers du PAIPSH depuis l'été 2022. La deuxième mise à jour annuelle est à venir.
Messages clés
- Le gouvernement a réalisé des progrès importants dans la mise en œuvre du PAIPSH, notamment :
- l'entrée en vigueur de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées en juin 2024, qui représente une étape importante vers l'amélioration de la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler;
- le lancement du nouveau Programme d'accès équitable à la lecture (PAEL);
- le lancement de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. La Stratégie appuie les personnes en situation de handicap en cernant et en éliminant les obstacles qui les empêchent de trouver et de conserver un bon emploi, d'avancer dans leur carrière ou de devenir entrepreneurs;
- des investissements importants dans le Fonds d'intégration pour soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap;
- des investissements importants dans le Fonds pour l'accessibilité afin d'améliorer l'accessibilité des refuges, des places en garderie, des collectivités et des milieux de travail;
- la publication de nouvelles normes en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité;
- le lancement du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap afin de promouvoir et de faire progresser l'accessibilité et l'inclusion en milieu de travail.
- Le gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap pour mettre en œuvre le PAIPSH, en veillant à ce qu'il réponde aux besoins des personnes en situation de handicap.
- Les expériences vécues par les personnes en situation de handicap ont éclairé chaque partie du Plan d'action. Grâce à des efforts de mobilisation, nous avons entendu parler des précieuses contributions que les personnes en situation de handicap apportent à nos collectivités et à notre économie. Nous savons que les personnes en situation de handicap font face à des obstacles à la participation sociale et économique en raison de la discrimination, des stéréotypes et de l'exclusion systémique. Bien que nous ayons fait des progrès importants, il reste du travail à faire.
4. Financement
4.a. Tableau de financement : Fonds d'intégration pour les personnes handicapées
Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées permet d'aider les personnes handicapées à se préparer à occuper un emploi, à obtenir un emploi et à le conserver. Il soutient les 3 objectifs de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. Des objectifs sont les suivants :
- individus : les aider à trouver et à conserver de bons emplois, à faire progresser leur carrière ou à devenir des entrepreneurs;
- employeurs : les aider à diversifier leur main-d'œuvre en créant des milieux de travail inclusifs et accessibles;
- facilitateurs : accroître l'offre, la capacité et la portée des individus et des organismes qui soutiennent l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'accessibilité à l'emploi.
Le programme finance des organismes communautaires dans l'ensemble du pays qui offrent un large éventail de programmes et de servies, notamment des mesures de soutien pour la recherche d'emploi, des services préalables à l'emploi, des subventions salariales, des placements professionnels et des initiatives de sensibilisation des employeurs, qui incitent ces derniers à embaucher des personnes en situation de handicap.
| Financement par année | Budget total* | Clients desservis **/*** |
|---|---|---|
| 2004 à 2005 | 30,000,000 | 4 507 |
| 2005 à 2006 | 30,000,000 | 5 539 |
| 2006 à 2007 | 30,000,000 | 4 923 |
| 2007 à 2008 | 30,000,000 | 4 300 |
| 2008 à 2009 | 30,000,000 | 4 840 |
| 2009 à 2010 | 30,000,000 | 5 574 |
| 2010 à 2011 | 30,000,000 | 5 370 |
| 2011 à 2012 | 30,000,000 | 5 449 |
| 2012 à 2013 | 35,000,000 | 4 222 |
| 2013 à 2014 | 42,500,000 | 5 012 |
| 2014 à 2015 | 47,000,000 | 3 473 |
| 2015 à 2016 | 47,825,000 | 4 509 |
| 2016 à 2017 | 48,275,000 | 4 630 |
| 2017 à 2018 | 43,075,000 | 5 464 |
| 2018 à 2019 | 40,233,283 | 4 452 |
| 2019 à 2020 | 45,749,727 | 4 242 |
| 2020 à 2021 | 62,354,965 | 5 768 |
| 2021 à 2022 | 87,878,170 | 4 375 |
| 2022 à 2023 | 83,046,213 | 4 047 |
| 2023 à 2024 | 109,234,101 | Aucune donnée disponible |
- * Financement du programme de subventions et de contributions + administration ministérielle.
- ** Les résultats du programme pour 2023 à 2024 ne sont pas disponibles en raison des changements apportés aux exigences en matière de production de rapports.
- ***Les résultats des données clients pour les exercices financiers 2020 à 2021, 2021 à 2022 et 2022 à 2023 n'incluent pas les données du Québec, car les résultats dans le cadre de l'entente de contribution Canada-Québec n'avaient pas été reçus avant la publication du Rapport sur les résultats ministériels.
4.b. Tableau de financement : Fonds pour l'accessibilité
Nom de programme: Fonds pour l'accessibilité
Description de programme
Le Fonds pour l'accessibilité (FA) finance des projets visant à rendre les collectivités et les milieux de travail du Canada plus accessibles. Le FA contribue aussi au Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada, en particulier au Pilier 3 : Communautés accessibles et inclusives. Les données commencent en 2008, car c'est l'année où le programme a été lancé.
Ainsi, le FA appuie les personnes en situation de handicap en créant plus de possibilités pour ces dernières. Par conséquent, elles pourront participer aux activités et aux programmes, ou obtenir des services ou un emploi.
Le FA comprend 3 composantes de programme distinctes (petite envergure, moyenne envergure, et innovation jeunesse). Dans le cadre de chaque composante, on organise des appels de financement. Les critères d'admissibilités seront davantage définis lors de chaque appel de financement.
| Financement par année | Budget total | Projets financés |
|---|---|---|
| 2004 à 2005 | N/A | N/A |
| 2005 à 2006 | N/A | N/A |
| 2006 à 2007 | N/A | N/A |
| 2007 à 2008 | N/A | N/A |
| 2008 à 2009 | 35 897 246 $ | 168 |
| 2009 à 2010 | 5 835 862 $ | 169 |
| 2010 à 2011 | 24,479,067 $ | 305 |
| 2011 à 2012 | 6 396 951 $ | 192 |
| 2012 à 2013 | 16 793 484 $ | 562 |
| 2013 à 2014 | 753 386 $ | 28 |
| 2014 à 2015 | 12 024 918 $ | 438 |
| 2015 à 2016 | 13 629 335 $ | 459 |
| 2016 à 2017 | 15 622 070 $ | 575 |
| 2017 à 2018 | 15 590 672 $ | 609 |
| 2018 à 2019 | 32 379 796 $ | 487 |
| 2019 à 2020 | 12 436 981 $ | 362 |
| 2020 à 2021 | 21 111 084 $ | 480 |
| 2021 à 2022 | 92 868 887 $ | 1 413 |
| 2022 à 2023 | 71 622113 $ | 1 029 |
| 2023 à 2024 | 20 608 494 $ | 437 |
Remarque : Le budget total fait référence au financement des programmes de S et C - administration ministérielle.
4.c. Tableau de financement : Initiative Appuyer les communautés noires du Canada
Nom du programme
Initiative Appuyer les communautés noires du Canada
Description du programme
L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) est une initiative fédérale de subventions et de contributions établie en 2019 pour célébrer, partager les connaissances et renforcer la capacité des communautés noires dynamiques à travers le Canada.
L'IACNC repose sur 3 piliers :
- renforcement des capacités : renforce et améliore l'écosystème organisationnel dirigé et au service des personnes noires afin de favoriser un soutien plus durable au sein des communautés;
- changement de systèmes : soutien des projets et des initiatives qui réduisent les obstacles systémiques et les iniquités auxquels sont confrontées les personnes noires du Canada;
- priorités émergentes : répond aux lacunes et aux priorités émergentes identifiées par les communautés et organismes pour et par les personnes noires et par d'autres réseaux de communautés de pratique (internes et externes).
| Financement par année | Budget total1 (en millions de dollars) | Nombre de projets financés |
|---|---|---|
| 2004 à 2005 | N/A | N/A |
| 2005 à 2006 | N/A | N/A |
| 2006 à 2007 | N/A | N/A |
| 2007 à 2008 | N/A | N/A |
| 2008 à 2009 | N/A | N/A |
| 2009 à 2010 | N/A | N/A |
| 2010 à 2011 | N/A | N/A |
| 2011 à 2012 | N/A | N/A |
| 2012 à 2013 | N/A | N/A |
| 2013 à 2014 | N/A | N/A |
| 2014 à 2015 | N/A | N/A |
| 2015 à 2016 | N/A | N/A |
| 2016 à 2017 | N/A | N/A |
| 2017 à 2018 | N/A | N/A |
| 2018 à 2019 | N/A | N/A |
| 2019 à 2020 | 0,261 $ | 1 |
| 2020 à 2021 | 10,9 $ | 310 |
| 2021 à 2022 | 106,6 $ | 1,904 |
| 2022 à 2023 | 35,9 $ | 689 |
| 2023 à 2024 | 45,7 $ | 895 |
1 Budget total = Financement du programme de subventions et de contributions + financement de l'administration ministérielle
4.d. Tableau de financement : Programme de partenariats pour le développement social, composante Personnes en situation de handicap
Nom du programme
Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes en situation de handicap.
Description du programme
La composante Personnes en situation de handicap a été mise en place pour accroître la représentation des personnes en situation de handicap et leur capacité à :
- plaider en leur propre nom;
- éliminer les obstacles à l'inclusion sociale en s'attaquant aux obstacles liés aux comportements, aux institutions et à l'information;
- élaborer des solutions créatives pour renforcer la participation à la vie sociale et économique;
- favoriser les partenariats et les réseaux afin d'aborder les enjeux sociaux existants et émergents;
- reconnaître et soutenir la capacité des organisations sans but lucratif à identifier et à traiter les priorités de développement social; et reconnaître et promouvoir les initiatives de participation communautaire (par exemple, le bénévolat, la responsabilité sociale des entreprises, l'innovation par les organisations sans but lucratif, les partenariats, les coalitions).
Créé en 1998, le PPDS-PH se compose de 3 volets de financement :
- le fonds de fonctionnement annuel pour des organisations nationales;
- le fonds de fonctionnement annuel pour des organisations régionales qui sont des filiales d'Inclusion Canada;
- le financement des projets au moyen d'appels de propositions périodiques et/ou de propositions spontanées.
Dans le cadre du PPDS-PH, le financement annuel de l'initiative Canada accessible (2,7 millions de dollars) est destiné à soutenir des projets axés sur l'accessibilité. L'initiative Canada accessible comporte 2 volets de financement :
- Semaine nationale de l'accessibilité (SNA) : pour soutenir les célébrations et les activités de la SNA qui soulignent les contributions des personnes en situation de handicap et qui encouragent l'accessibilité et l'inclusion dans les communautés et les milieux de travail partout au Canada;
- Partenariats pour un Canada accessible (Partenariats) : pour financer des projets qui soutiennent des partenariats clés entre la communauté des personnes en situation de handicap et le secteur sous réglementation fédérale, et pour aider la communauté des personnes en situation de handicap à continuer de participer à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité et de ses règlements.
Chaque volet fait l'objet d'appels à financement distincts. Les critères d'admissibilité seront définis plus précisément au cours de chaque processus de financement.
| Année financière | Budget total* |
|---|---|
| 2004 à 2005 | 11 M$ |
| 2005 à 2006 | 11 M$ |
| 2006 à 2007 | 11 M$ |
| 2007 à 2008 | 11 M$ |
| 2008 à 2009 | 11 M$ |
| 2009 à 2010 | 10,4 M$ |
| 2010 à 2011 | 10,4 M$ |
| 2011 à 2012 | 10,4 M$ |
| 2012 à 2013 | 10,4 M$ |
| 2013 à 2014 | 10,4 M$ |
| 2014 à 2015 | 9 M$ |
| 2015 à 2016 | 11 M$ |
| 2016 à 2017 | 12 M$ |
| 2017 à 2018** | 15 M$ |
| 2018 à 2019** | 13,5 M$ |
| 2019 à 2020** ¶ | 15,2 M$ |
| 2020 à 2021** ¶ | 17,2 M$ |
| 2021 à 2022** ¶ | 17,7 M$ |
| 2022 à 2023** ¶ | 17,6 M$ |
| 2023 à 2024** §¶ | 22,7 M$ |
Remarque :
- * Financement du programme en S et C
- ** Augmentation de l'affectation en 2017 à 2018 afin d'inclure le financement pour les documents de lecture en formats substituts
- § Augmentation de l'affectation en 2023 à 2024 pour inclure l'AP thématique du B2023
- ¶ Comprend le financement pour la Direction du Canada accessible
5. Budget
5.a. Aperçu du Budget supplémentaire des dépenses B 2024 à 2025
Sujet: Vue d'ensemble - Dépôt du Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025
Objet
Pourquoi Emploi et Développement social Canada (EDSC) demande‑t‑il des autorisations additionnelles dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025?
Faits saillants
Le Budget supplémentaire des dépenses demande l'autorisation du Parlement d'ajuster les plans de dépenses ministériels pour l'exercice financier en cours.
EDSC demande un total de 158,8 millions de dollars en autorisations additionnelles dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B)*.
- Une augmentation de 45,5 millions de dollars au crédit 1 Dépenses de fonctionnement
- Une augmentation de 35,1 millions de dollars au crédit 5 Subventions et contributions
- Une augmentation de 75,2 millions de dollars en ajustement aux postes législatifs.
*La prévision législative de 70,1 millions de dollars pour le Programme national d'alimentation dans les écoles a été accordé dans le cadre de la Loi d'exécution du budget de 2024 et est incluse à titre d'information.
Réponse
EDSC demande l'approbation pour:
| A. Crédits votés | Fonctionnement Crédit 1 |
Subventions et contributions Crédit 5 |
Total |
|---|---|---|---|
| 1. Fonds destinés à la mise en place d'un programme national d'alimentation dans les écoles (Budget fédéral de 2024) (poste horizontal)1 | 5 368 685 | 2 019 934 | 7 388 619 |
| 2. Fonds destinés à stabiliser la technologie de l'information afin d'appuyer la prestation de programme | 31 057 189 | 0 | 31 057 189 |
| 3. Fonds destinés au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et ciblant les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé (Budget fédéral de 2024) | 910 319 | 23 846 804 | 24 757 123 |
| 4. Fonds destinés au Programme de soutien aux travailleurs migrants (Budget fédéral de 2024) | 2 045 970 | 17 944 026 | 19 989 996 |
| 5. Fonds destinés au Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants (Budget fédéral de 2024) | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| 6. Fonds destinés aux programmes de publicité du gouvernement (poste horizontal) | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 |
| 7. Fonds destinés aux services communautaires d'aide en matière financière du Programme de partenariats pour le développement social (Budget fédéral de 2024) | 0 | 1 430 000 | 1 430 000 |
| 8. Fonds destinés au Programme de Modernisation du versement des prestations - Livraison des prestations communes (LPC) | 1 163 353 | 0 | 1 163 353 |
| 9. Fonds destinés au Programme Compétences pour Réussir | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 10. Fonds destinés à renforcer l'épargne pour la retraite chez les préposés aux services de soutien à la personne (Budget fédéral de 2023) | 626 292 | 0 | 626 292 |
| 11. Fonds destinés à la création d'une stratégie nationale d'action bénévole dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social (Budget fédéral de 2024) | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Sous-total des crédits votés | 44 921 808 | 63 940 764 | 108 862 572 |
Note 1 : Les fonds destinés à la mise en place d'un programme national d'alimentation dans les écoles comprend également une composante législative de 70,1 millions de dollars accordée dans la Loi d'exécution du budget de 2024 (voir le tableau 3). Le total inclus dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour le Programme national d'alimentation dans les écoles est de 77,5 millions de dollars.
| B. Transferts | Fonctionnement Crédit 1 |
Subventions et contributions Crédit 5 |
Total |
|---|---|---|---|
| 12. Transfert de diverses organisations au ministère de l'Emploi et du Développement social pour appuyer Horizons de politiques Canada | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 13. Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à diverses organisations pour rajuster le financement versé antérieurement au personnel du ministère travaillant dans les missions à l'étranger | 54 455 | 0 | 54 455 |
| 14. Transfert du ministère de l'Emploi et du Développement social au ministère des Services aux Autochtones pour l'Initiative de transformation de l'Apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones | 0 | -28 787 261 | -28 787 261 |
| Sous-total des transferts | 554 455 | -28 787 261 | -28 232 806 |
| C. Postes législatifs budgétaires | Total |
|---|---|
| 1. Fonds destinés à la mise en place d'un programme national d'alimentation dans les écoles (Budget fédéral de 2024) (poste horizontal) | 70 100 000 |
| 15. Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 5 101 045 |
| Sous-total des postes législatifs budgétaires | 75 201 045 |
| Postes budgétaires | Transferts | Rajustements | Total |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 - Fonctionnement | 554 455 | 44 921 808 | 45 476 263 |
| Crédit 5 - Subventions et contributions | -28 787 261 | 63 940 764 | 35 153 503 |
| Total crédits votés | -28 232 806 | 108 862 572 | 80 629 766 |
| Postes législatifs* | 0 | 75 201 045 | 75 201 045 |
| Total des postes budgétaires | -28 232 806 | 184 063 617 | 155 830 811 |
* La prévision législative de 70,1 millions de dollars pour le Programme national d'alimentation dans les écoles a été accordé dans le cadre de la Loi d'exécution du budget de 2024 et est incluse à titre d'information.
Contexte
A. Crédits votés
1. Fonds destinés à la mise en place d'un programme national d'alimentation dans les écoles (budget fédéral de 2024) - 77,5 millions de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé le financement d'un programme national d'alimentation dans les écoles qui s'établira à 1,0 milliard de dollars sur 5 ans, à partir de l'exercice 2024 à 2025. Les ministères qui recevront des fonds au titre de ce programme sont EDSC, Services aux Autochtones Canada (SAC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). EDSC recevra 678,8 millions de dollars pour travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour aider à étendre et à améliorer les programmes existants à compter de cette année scolaire.
Le ministère demande 7,4 millions de dollars en crédits votés dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier 2024 à 2025. De plus, un crédit législatif dans la Loi d'exécution du budget a permis à EDSC d'accéder rapidement à une somme de 70,1 millions de dollars en financement pour l'année 1 avant les crédits votés du Budget supplémentaire des dépenses (B), afin d'avoir l'autorité de conclure des accords et de transférer des fonds aux provinces et territoires en temps opportun pour que le programme soit lancé au cours de l'année scolaire 2024 à 2025.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 5 368 685 de dollars au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement, excluant les Régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) de 536 848 $) et 2 019 934 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour mettre en place le programme national d'alimentation dans les écoles. Les prévisions législatives estimées à 70,1 millions de dollars sont incluses à titre d'information.
2. Fonds destinés à stabiliser la technologie de l'information afin d'appuyer la prestation de programmes - 31,1 millions de dollars
EDSC verse des milliards de dollars en prestations directes à des millions de Canadiens chaque année. Les systèmes de technologie de l'information (TI) d'EDSC qui permettent la prestation de services du ministère sont à risque de connaître une défaillance en raison d'années de sous-financement et de manque d'investissement soutenu.
Reconnaissant la nécessité de stabiliser et de corriger les systèmes de TI d'EDSC, le Gouvernement du Canada a approuvé, dans le cadre de décisions hors cycle en 2020 et en 2022, 761,2 millions de dollars à l'initiative de redressement de la dette technique d'EDSC pour stabiliser les systèmes de TI vieillissants.
Le total des autorisations de financement demandés pour cette initiative dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier 2024 à 2025 est de 133,9 millions de dollars (excluant les RASE), dont 31,1 millions proviennent du Trésor, 14,4 millions du compte du Régime de pensions du Canada (RPC) et 88,4 millions du Compte des opérations de l'assurance‑emploi. Ce financement est requis pour améliorer le rendement du réseau, la disponibilité et la capacité de récupération des applications informatiques essentielles, pour stabiliser les systèmes informatiques ministériels, et pour les applications vieillissantes.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 31 057 189 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement, excluant les RASE de 3 805 668 $) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour continuer à stabiliser les systèmes de TI et soutenir la mise en œuvre des programmes.
3. Fonds destinés au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et ciblant les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé (budget fédéral de 2024) - 24,8 millions de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé 50 millions de dollars sur 2 ans, pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, pour soutenir les professionnels formés à l'étranger dans les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé. Ce financement vise à développer et à renforcer la capacité d'évaluation et de reconnaissance des diplômes étrangers au Canada, à améliorer l'intégration du marché du travail et à soutenir la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre.
Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers investira dans des projets qui sont complémentaires aux activités des provinces et territoires, ainsi que dans des initiatives menées par des organismes de règlementation et d'autres organisations de portée nationale, qui répondent aux besoins du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers.
Depuis 2015, le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers a investi près de 270 millions de dollars dans 115 projets pour soutenir les professionnels formés à l'étranger. Ce financement supplémentaire s'ajoute aux investissements antérieurs du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers dans les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé, et d'autres secteurs.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 910 319 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement, excluant les RASE de 211 538 $) et 23 846 804 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers ciblant les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025.
4. Fonds destinés au Programme de soutien aux travailleurs migrants (budget fédéral de 2024) - 20,0 millions de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé 40,9 millions de dollars sur 2 ans, pour prolonger de 2 années le Programme de soutien aux travailleurs migrants (PSTM), à compter de l'exercice financier 2024 à 2025.
Le PSTM aide les travailleurs étrangers temporaires à connaître et à exercer leurs droits au Canada en finançant des organismes communautaires, notamment des organismes de soutien aux travailleurs migrants, qui fournissent des services essentiels. Cette mesure est conforme aux objectifs de protection des travailleurs du Programme des travailleurs étrangers temporaires et à l'objectif ministériel de favoriser un marché du travail inclusif et efficace.
Le ministère demande 20,0 millions de dollars dans le Budget supplémentaire des dépenses (B), pour l'exercice financier 2024 à 2025. Ce financement permettra au ministère de continuer à aider ces organisations à fournir des programmes et des services axés sur les travailleurs migrants, tels que l'orientation à l'arrivée, les services d'aiguillage dans les principaux aéroports et les mesures d'aide communautaires directes.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 2 045 970 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement, excluant les RASE de 420 955 $) et 17 944 026 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour renouveler le Programme de soutien aux travailleurs migrants.
5. Fonds destinés au Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants (budget fédéral de 2024) - 17,5 millions de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé 67,5 millions de dollars sur 3 ans pour le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants (PSAE), à compter de l'exercice 2024 à 2025.
Le ministère demande 17,5 millions de dollars dans le Budget supplémentaire des dépenses (B), pour l'exercice financier 2024 à 2025, afin de renouveler le soutien à Indspire et à Passeport pour ma réussite Canada, ce qui permettra aux jeunes de groupes sous-représentés à risque de quitter l'école de continuer à bénéficier d'une gamme complète d'activités parascolaires et d'aide aux étudiants fondées sur des données probantes.
L'année dernière, Indspire et Passeport pour ma réussite Canada ont soutenu près de 15 000 étudiants à faible revenus et étudiants autochtones. Ces mesures sont destinées aux jeunes qui sont confrontés aux plus grands obstacles socio-économiques et systémiques. Il est prouvé qu'investir dans des services sur mesure qui aident les jeunes à obtenir leur diplôme les aide à réussir sur le marché du travail et à contribuer à l'économie canadienne.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 17 500 000 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour renouveler les mesures d'aide aux étudiants et aux activités parascolaires dans le cadre du PSAE.
6. Fonds destinés aux programmes de publicité du gouvernement - 3,8 millions de dollars
Pour soutenir le plan de publicité 2024 à 2026 et l'Énoncé économique de l'automne de 2023, EDSC demande 3,8 millions de dollars pour l'exercice 2024 à 2025 et 4 millions de dollars pour l'exercice 2025 à 2026 pour 3 campagnes : Services pour les aînés, Milieux de travail inclusifs et Aider les jeunes à bâtir leur avenir. Ces campagnes s'alignent sur les objectifs des budgets fédéraux de 2023 et de 2024, notamment l'emploi des personnes en situation de handicap, l'aide à la retraite et l'emploi des jeunes.
Le financement de 3,8 millions de dollars demandé dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier 2024 à 2025 soutiendra la campagne de publicité Services pour les aînés. Cette campagne fera la promotion des programmes et des services offerts aux aînés.
Le gouvernement s'est engagé à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens en améliorant la Sécurité de la vieillesse (SV), le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Supplément de revenu garanti (SRG). Cela permettra à un plus grand nombre de personnes âgées de profiter de la retraite confortable et digne pour laquelle elles ont travaillé et qu'elles méritent. La campagne publicitaire contribuera à mieux faire connaître aux adultes âgés de 50 à 65 ans les programmes et services gouvernementaux liés à la retraite.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 3 750 000 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour des campagnes publicitaires visant à promouvoir les Services pour les aînés.
7. Fonds destinés aux services communautaires d'aide en matière financière dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social (budget fédéral de 2024) - 1,4 millions de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé 60 millions de dollars sur 5 ans pour Prospérité Canada, en commençant par 1,4 millions de dollars pour l'exercice 2024 à 2025, afin d'étendre les services communautaires d'aide financière. Cette initiative vise à aider un million de Canadiens à revenu faible ou modique à accéder à près de 2 milliards de dollars d'impôts et de prestations non réclamés par l'intermédiaire du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS).
Prospérité Canada travaillera avec des partenaires pour fournir des conseils, des outils et des renseignements afin de promouvoir la sécurité financière. Les principales activités comprennent la création de carrefours régionaux d'aide financière pour distribuer des fonds à des organisations locales dans l'ensemble du Canada, le développement des capacités et la formation par l'intermédiaire d'organisations dirigées par des experts, et la fourniture de sous-financements et d'efforts d'évaluation. Ce financement soutient les objectifs du gouvernement du Canada visant à améliorer la qualité de vie et à promouvoir la sécurité financière.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 1 430 000 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour les services d'aide financière fournis par les collectivités dans le contexte du PPDS.
8. Fonds destinés à la Modernisation du versement des prestations - 1,2 millions de dollars
Le Programme de Modernisation du versement des prestations (MVP) est une initiative interfonctionnelle pluriannuelle conçue pour améliorer le versement des prestations de base du gouvernement par EDSC en améliorant l'accès numérique et en centralisant l'administration des prestations.
Le Programme de modernisation du versement des prestations (MVP) demande le report de 22 millions de dollars en fonds inutilisés de l'exercice financier 2023 à 2024 à l'exercice financier 2024 à 2025. Ce montant comprend 19,8 millions de dollars pour l'assurance-emploi, 0,4 million de dollars pour le RPC et 1,2 million de dollars pour le Trésor.
Le financement demandé est requis pour assurer la poursuite des opérations et des développements pour les projets du réseau de prestation des services (RPS) et des Modes de service intégrés - Interface commune (MSI-IC), qui sont essentiels au traitement transparent des prestations entre l'assurance-emploi, la SV et le RPC. Cette initiative donne directement suite aux recommandations de l'évaluation stratégique de 2022 menées par le dirigeant principal de l'information (DPI) du Canada, harmonisant ainsi la MVP avec les efforts de modernisation à l'échelle du gouvernement. Il s'agit notamment d'intégrer des solutions infonuagiques, des outils d'accès numérique et des cadres de gestion des services afin d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à de multiples avantages.
EDSC demande l'autorisation d'inscrire 1 163 353 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour le programme de MVP, plateforme commune de versement des prestations.
9. Fonds destinés au programme Compétences pour réussir - $0,8 million de dollars
Le budget fédéral de 2021 a prévu 298 millions de dollars sur 3 ans pour le programme Compétences pour réussir lancé en 2021, qui remplace le Programme d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles d'EDSC, afin de fournir une formation professionnelle à un maximum de 90 000 Canadiens.
L'entente actuelle sur les compétences pour réussir conclu avec le gouvernement du Yukon a pris fin en juin 2024. Le ministère demande le report de fonds inutilisés de l'exercice 2023 à 2024 à l'exercice 2024 à 2025 pour soutenir la prolongation budgétaire de l'entente et donner au gouvernement du Yukon l'occasion d'achever diverses activités prévues en matière de compétences et d'emploi, telles que l'élaboration d'outils de formation et d'évaluation et leur déploiement dans le plan de formation du gouvernement du Yukon en matière d'emploi, et d'élaborer un plan de durabilité pour les résultats obtenus au cours de la phase initiale du projet.
EDSC demande l'autorisation d'inscrire 800 000 dollars au crédit 5 (Subventions et contributions) pour ces projets dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025.
10. Fonds destinés à renforcer l'épargne pour la retraite chez les préposés aux services de soutien à la personne (budget fédéral de 2023) - 0,6 million de dollars
Le budget fédéral de 2023 a annoncé jusqu'à 50 millions de dollars sur 5 ans pour élaborer et mettre à l'essai des solutions d'épargne-retraite innovantes pour les préposés aux services de soutien à la personne qui ne bénéficient pas de la couverture d'un régime de retraite de leur employeur.
Le programme appuiera des projets pilotes qui offrent des incitatifs à l'épargne-retraite aux préposés aux services de soutien à la personne qui ne bénéficient pas d'une couverture de sécurité de retraite en milieu de travail. Le programme permettra au gouvernement de tester différents paramètres pour encourager l'épargne-retraite et de déterminer quelle approche fonctionne le mieux. Les incitatifs devraient aider les préposés aux services de soutien à la personne participants à améliorer leur sécurité financière et pourraient contribuer à leur rétention dans le secteur des soins de longue durée.
L'autorisation de financement de 0,6 million de dollars demandée pour l'exercice financier 2024 à 2025 servira à soutenir les coûts opérationnels d'EDSC pour le lancement du programme.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 626 292 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour renforcer l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne.
11. Fonds destinés à la création d'une stratégie nationale d'action bénévole dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social (budget fédéral de 2024) - 0,4 million de dollars
Le budget fédéral de 2024 a annoncé un financement de contributions de 0,4 million de dollars pour l'exercice 2024 à 2025 afin de soutenir Bénévoles Canada (BC) et l'élaboration d'une Stratégie nationale d'action bénévole (SNAB), dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social (PPSD) - volet Enfants et Familles.
Ce financement permettra à Bénévoles Canada de mener des recherches supplémentaires, d'élargir l'engagement des parties prenantes et de coordonner le projet de SNAB, afin de s'assurer qu'il répond efficacement aux défis émergents, améliore les expériences bénévoles et renforce le bien-être communautaire grâce à cette stratégie.
EDSC demande l'autorisation d'inscrire 400 000 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour la création d'une SNAB dans le cadre du PPDS.
B. Transferts
12. De diverses organisations au ministère de l'Emploi et du Développement social pour appuyer Horizons de politiques Canada - Augmentation de 0,5 million de dollars
Horizons de politiques Canada (HPC), le centre d'excellence en prospective du gouvernement du Canada, joue un rôle stratégique en dotant le gouvernement du Canada d'un état d'esprit et d'une perspective tournée vers l'avenir afin de renforcer la prise de décision. Bien qu'il soit hébergé administrativement au sein d'EDSC, le mandat général de HPC est reflété par le Bureau du Conseil privé, qui copréside son comité directeur. Pour soutenir son mandat, 4 organisations (le Centre de la sécurité des télécommunications, Santé Canada, Ressources naturelles Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada) ont accepté de transférer des fonds à EDSC au cours de l'exercice financier 2024 à 2025.
EDSC demande l'autorisation d'inclure un transfert de 500 000 $ provenant de ces 4 organisations à EDSC au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour soutenir HPC.
13. Du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à diverses organisations pour rajuster le financement versé antérieurement au personnel du ministère travaillant dans des missions à l'étranger - Augmentation de 54,5 milliers de dollars
Le Programme du travail d'EDSC a officiellement entamé la suppression de 2 postes à l'ambassade du Canada au Mexique. Les coûts des services communs précédemment financés par EDSC pour les employés du Programme du travail en poste à Mexico dans le cadre de l'ACEUM ont été retransférés à EDSC. Cet ajustement est nécessaire pour tenir compte des fonds initialement prévus pour soutenir le personnel du Ministère dans les missions à l'étranger.
EDSC demande l'autorisation d'inclure 54 455 $ au crédit 1 (Dépenses de fonctionnement) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 pour ajuster le financement de ces postes.
14. Du ministère de l'Emploi et du Développement social au ministère des Services aux Autochtones pour l'Initiative de transformation de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones - Diminution de 28,8 millions de dollars
Dans le cadre de l'Initiative pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones (AGJEA), les partenaires autochtones peuvent demander des avances de financement par le biais d'accords existants avec des ministères fédéraux, comme EDSC, Services aux Autochtones (SAC), l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), afin de mettre en œuvre les programmes de l'Initiative.
Dans le cadre de cette initiative, les partenaires autochtones sont au premier plan de la prise de décisions en matière d'affectation des fonds, de plans et de priorités, et ont la possibilité de demander qu'une partie ou la totalité de leur financement pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants leur soit avancée par le biais d'accords avec n'importe lequel des 4 ministères fédéraux partenaires.
Les Premières Nations de la région de l'Atlantique, de l'Ontario et de l'Alberta ont demandé à recevoir une partie de leur financement pour l'AGJEA de 2024 à 2025 dans le cadre de leurs accords de financement avec Services aux Autochtones Canada. Par conséquent, le ministère demande l'autorisation de transférer 28,8 millions de dollars de EDSC à SAC.
EDSC demande l'autorisation d'inscrire 28 787 261 $ au crédit 5 (Subventions et contributions) dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2024 à 2025 qui sera affecté à SAC dans le cadre de l'Initiative pour l'AGJEA.
C. Postes budgétaires législatifs
15. Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés - Augmentation de 5.1 millions de dollars
Les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) comprennent le coût des contributions de contrepartie que le gouvernement verse comme employeur aux caisses de retraite de la fonction publique, au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec, au Régime de prestations de décès et au Compte des opérations de l'assurance-emploi.
L'augmentation de 5 101 045 $ est directement attribuable au financement demandé au titre du crédit 1 - Dépenses de fonctionnement dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour les postes de crédits votés présentés à la section A (postes 1, 2, 3, 4 et 10) ci-dessus. Les RASE totaux pour chaque poste sont les suivants:
- fonds destinés à stabiliser la technologie de l'information afin d'appuyer la prestation de programmes (3 805 668 $);
- fonds destinés à la mise en place d'un programme national d'alimentation dans les écoles (536 848 $);
- fonds destinés au Programme de soutien aux travailleurs migrants (420 955 $);
- fonds destinés au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et ciblant les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé (211 538 $);
- fonds destinés à renforcer l'épargne pour la retraite chez les préposés aux services de soutien à la personne (126 036 $).
Citations
S.O.
5.b. Vue d'ensemble : Dépôt du Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025, ministre de la Diversité, Inclusion et Personnes en situation de handicap
Aperçu du Budget supplémentaire des dépenses (B) 2024 à 2025 d'EDSC
EDSC demande un total de 155,8 millions de dollars en autorisations supplémentaires dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B), ce qui porterait le total des dépenses prévues à 194,4 milliards de dollars.
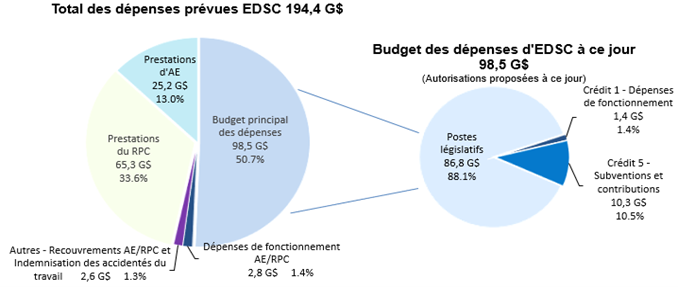
Texte descriptif:
Figure de gauche: Le total des dépenses prévues d'EDSC est de 194,4 milliards de dollars.
- Les dépenses prévues de prestations d'assurance-emploi sont de 25,2 milliards de dollars ou 13,0% du total des dépenses prévues
- Les dépenses prévues de prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) sont de 65,3 milliards de dollars ou 33,6% du total des dépenses prévues
- Les autres dépenses prévues de recouvrements de l'assurance-emploi et du RPC et de l'Indemnisation des accidentés du travail sont de 2,6 milliards de dollars ou 1,3% du total des dépenses prévues
- Les dépenses prévues de fonctionnement de l'assurance-emploi et du RPC sont de 2,8 milliards de dollars ou 1,4% du total des dépenses prévues
- Le Budget des dépenses est de 98,5 milliards de dollars ou 50,7% du total des dépenses prévues
Figure de droite: Le Budget des dépenses d'EDSC à ce jour, soit les autorisations proposées à ce jour, est de 98,5 milliards de dollars
- Le total des dépenses prévues des postes législatifs est de 86,8 milliards de dollars ou 88,1% du total du Budget des dépenses à ce jour
- Le total des dépenses prévues du Crédit 1 - Dépenses de fonctionnement est de 1,4 milliards de dollars ou 1,4% du total du Budget des dépenses à ce jour
- Le total des dépenses prévues du Crédit 5 - Subventions et contributions est de 10,3 milliards de dollars ou 10,5% du total du Budget des dépenses à ce jour
Des dépenses prévues de 194,4 milliards de dollars pour 2024 à 2025, 98,5 milliards de dollars sont rapportés dans le Budget des dépenses, desquels 97,0 milliards de dollars sont des paiements de transfert législatifs et votés. Voici quelques programmes inclus dans le Budget des dépenses d'EDSC à ce jour :
- programme de la Sécurité de la vieillesse = 80 556,0 millions de dollars;
- programme pour l'Apprentissage et la garde des jeunes enfants = 7 237,0 millions de dollars;
- programme canadien d'aide financière aux étudiants et Prêt canadien aux apprentis = 2 966,8 millions de dollars;
- programme canadien pour l'épargne-études = 1 260,0 millions de dollars;
- programme canadien pour l'épargne-invalidité = 729,1 millions de dollars;
- ententes sur le développement de la main-d'œuvre = 722,0 millions de dollars;
- stratégie emploi et compétences jeunesse = 418,0 millions de dollars;
- initiative de transformation de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones = 374,0 millions de dollars;
- programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones = 235,5 millions de dollars;
- stratégie canadienne de formation en apprentissage = 194,9 millions de dollars.
| Dépenses budgétaires | Autorisations à ce jour | Budget Supplémentaire des dépenses (B) | Autorisations proposées à ce jour (Budget des dépenses à ce jour) |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 - Fonctionnement | 1 405,1 | 45,4 | 1 450,5 |
| Crédit 5 - Subventions et contributions | 10 215,1 | 35,2 | 10 250,3 |
| Total des credits | 11 620,2 | 80,6 | 11 700,8 |
| Postes législatifs | 86 724,5 | 75,2 | 86 799,7 |
| Total des dépenses budgétaires | 98 344,7 | 155,8 | 98 500,5 |
Du montant de 155,8 millions de dollars demandé dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B), aucun item n'est sous la responsabilité de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.