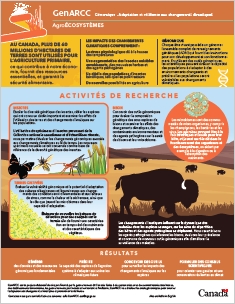Génomique pour l’adaptation et la résilience au changement climatique (GenARCC)
Aperçu
Les changements climatiques continuent d’entraîner de graves perturbations environnementales partout dans le monde, les dernières années ayant été les plus chaudes jamais enregistrées au cours de la période industrialisée. Au Canada, le climat continue de se réchauffer à un rythme plus de deux fois supérieur à celui du réchauffement planétaire, ses régions nordiques étant exposées aux changements les plus extrêmes. On a de plus en plus besoin d’avis scientifiques sur comment les espèces clés pourraient réagir aux changements climatiques, et sur les conséquences économiques et sociétales connexes. La génomique offre un ensemble d’outils très puissants qui peuvent y contribuer.
Transcription
Ian Bradbury
Chercheur scientifique
Pêches et Océans Canada
« Les changements climatiques ont de graves conséquences sur les écosystèmes dans le monde. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. On peut constater les effets tant sur la production agricole, la pêche, la foresterie, que sur la transmission de maladies et de pathogènes. »
Joey Angnatok
Pêcheur commercial
Putjotik Fisheries Ltd.
« Les gens ont remarqué une diminution du nombre d’ombles chevaliers. L’omble est très important pour l’alimentation en été comme en hiver. De plus, ça donne aux gens une raison d’aller sur le territoire et, je suppose, d’être qui ils sont. »
Carl Plante
Citoyen
« Je suis préoccupé par l'impact des changements climatiques sur les milieux forestiers. Ma perception, c'est qu’on va voir avec les décennies la dégradation des peuplements forestiers. »
Rick Bennett
Responsable de la sélection, Carinata
Nuseed Canada
« Nous croyons qu’il faut sélectionner des cultures résistantes aux changements climatiques. Nous voyons plus de phénomènes météorologiques extrêmes. »
Ian Bradbury
« La génomique est l’étude de l’ensemble de l’ADN d’un organisme, incluant tous ses gènes. En avril 2022, le gouvernement du Canada a lancé le projet Génomique pour l'adaptation et la résilience au changement climatique dans le cadre de son Initiative de recherche et de développement en génomique. Le projet GenARCC permet aux scientifiques de divers ministères de collaborer, de combiner leur expertise et d'aborder des questions qui dépassent le mandat d'un seul ministère.
Les chercheurs de GenARCC utilisent des outils génomiques pour répondre à ces questions. Comment les espèces et les populations du Canada sont-elles adaptées à leur environnement? À quelle vitesse les changements se produisent-ils? Et comment ces espèces et ces populations réagiront-elles aux changements climatiques? Les activités du projet GenARCC sont réparties en trois volets de travail axés sur des écosystèmes.
Dans le volet des écosystèmes de la forêt et de la toundra, les questions comprennent : comment investir des fonds pour conserver et protéger la faune, comme le caribou; où planter des arbres; et quels arbres planter en tenant compte de la sécheresse, de la tolérance à la chaleur et de la résistance aux ravageurs. »
Nathalie Isabel
Chercheuse scientifique
Ressources naturelles Canada
« La génomique forestière nous donne beaucoup d’agilité. Dans le projet GenARCC on étudie la diversité génétique dans les forêts, et puis on fait des expériences en conditions contrôlées. L'objectif serait d'avoir pour le Canada une idée si il y a des “hotspots” de diversité ou des “hotspots” de vulnérabilité.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu’on va être capable de superposer les informations pour différents niveaux trophiques. Donc, pas seulement les arbres, mais aussi le microbiome, donc tous les microorganismes du sol et ceux aussi associés avec les arbres. On parle de microorganismes symbiotiques ou de champignons symbiotiques. »
Ian Bradbury
« Dans le volet des agroécosystèmes, nous posons des questions comme : quelles sont les plantes qui soutiennent les pollinisateurs en déclin; quelles sont les cultures résistantes ou tolérantes aux sécheresses et à la chaleur; ou comment gérer les maladies dans les populations de bison. »
Christina Eynck
Chercheuse scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada
« Le canola est la principale plante oléagineuse des prairies canadiennes. Notre rôle dans le projet GenARCC est d'évaluer la capacité d’adaptation à la sécheresse des espèces de Brassica et de mettre au point des outils pour développer des cultivars tolérants à la sécheresse. »
Ian Bradbury
« Dans le volet des écosystèmes aquatiques et côtiers, nous cherchons à déterminer: quelles espèces peuvent être consommées sans danger ou nécessitent une nouvelle évaluation de la santé; où investir des fonds pour conserver et protéger les populations d’espèces sauvages, comme l’ours polaire, les oiseaux de mer et les salmonidés; et quelles pêches seraient sur le point de croitre ou sur le point de s’effondrer en raison des changements climatiques.
On sait très peu de choses au sujet des stocks d’omble chevalier dans la région côtière du Labrador, et une grande partie de ce projet consiste à établir une base de référence génomique ou une carte des variations génétiques de l’omble chevalier dans la région.
C’est important de comprendre et de conserver les variations génétiques entre les populations d’une espèce, car elles permettent de s’adapter aux changements environnementaux et aux autres stress. Le projet GenARCC repose en grande partie sur des liens étroits avec les utilisateurs, dont des groupes autochtones de partout au Canada. Ces liens nous permettent d'acquérir différentes connaissances, d'obtenir des renseignements de base essentiels et des échantillons.
L’intégration directe des utilisateurs dans le projet assure que les personnes les plus touchées par les changements climatiques bénéficient directement des résultats et des conseils scientifiques issus du projet. Il s’agit d’une nouvelle façon de faire de la recherche et d’aborder des enjeux importants pour la population canadienne. La capacité de prévoir les effets des changements climatiques sur les milieux naturels et agricoles du Canada est essentielle pour élaborer des mesures d’atténuation et d’adaptation efficaces. »
IRDG.CANADA.CA
GenARC
En avril 2022 a été lancé le projet Génomique pour l’adaptation et la résilience au changement climatique (GenARCC) dans le cadre de l’Initiative de recherche et développement en génomique du gouvernement du Canada. GenARCC vise à orienter l’adaptation aux changements climatiques à l’aide d’outils génomiques pour assurer la protection de la biodiversité, de la résilience des écosystèmes, de la sécurité alimentaire et de la santé au Canada. L’équipe de GenARCC se servira de son expertise pour répondre aux questions suivantes :
- Comment les populations et les espèces critiques se sont-elles adaptées à leur environnement?
- Cette relation change-t-elle en réponse aux changements climatiques?
- Quelle sera la réponse de ces populations et espèces critiques au cours des prochaines années?
Qu’est-ce que la génomique?
Chaque être vivant possède un génome, c’est-à-dire l’ensemble des informations génétiques (acide désoxyribonucléique, ou ADN*) qui comporte les instructions pour son développement et son fonctionnement. Au moyen d’outils génomiques, les scientifiques peuvent évaluer la capacité d’une population à s’adapter à l’évolution de son environnement et à prédire si elle sera vulnérable aux changements climatiques.
*Dans les virus, cette information génétique peut être gardée sous forme d’ADN ou d’ARN (acide ribonucléique).
Qu’est-ce que l’adaptation?

Face à un environnement en rapide évolution, les êtres vivants peuvent réagir par les moyens suivants :
- Déplacement : Se déplacer vers un habitat différent où ils sont mieux adaptés à l’environnement.
- Plasticité phénotypique : Changements physiques, comportementaux ou développementaux au niveau de l’individu.
- Adaptation : Changements génétiques héréditaires à long terme au niveau de la population ou de l’espèce.
- Disparition : La population pourrait ne pas être en mesure de survivre et disparaître.
Dans ce contexte, l’adaptation est un changement évolutif qui rend un organisme plus fonctionnel dans un certain environnement, améliorant sa capacité à survivre et à se reproduire avec succès. Cela diffère de l’adaptation aux changements climatiques, qui se produit lorsque nous ajustons nos décisions, nos comportements et nos activités pour tenir compte des changements climatiques existants ou prévus.
Ensembles de travaux de recherche
Forêt et toundra
Les forêts et la toundra sont des espaces essentiels pour les Canadiens qui leur fournissent des services écosystémiques, y compris des avantages sociaux et culturels et une valeur économique.
Voici certaines répercussions des changements climatiques :
- Risque plus élevé de sécheresse et d’incendies de forêt.
- Susceptibilité accrue aux ravageurs et aux agents pathogènes nouveaux et existants.
- Modification des services écosystémiques fournis par les forêts.
Activités de recherche
Forêt boréale
Évaluer la capacité des espèces d’arbres de la forêt boréale, de leurs microbiomes et de leurs ravageurs à s’adapter aux changements climatiques pour éclairer les activités de gestion menant à des forêts résilientes aux changements climatiques, y compris l’aide à la migration et le reboisement.
Agroécosystèmes
Étude du rôle des microbes dans le maintien des services écologiques des arbres et la façon dont ces derniers seront affectés par les changements climatiques et l’exploitation forestière.
Écosystèmes touchés par l’exploitation minière
Examen des effets de l’exploitation forestière et des changements climatiques sur les écosystèmes environnants pour améliorer l’efficacité et la viabilité de l’assainissement et de la restauration des sites touchés par les mines face aux changements climatiques.
Caribou
Évaluation de la vulnérabilité génomique des caribous, y compris l’identification de nouveaux agents pathogènes émergents, afin de prédire si les populations ont la capacité de s’adapter aux changements climatiques.
Microbiomes
Les microbiomes sont des communautés de micro-organismes, y compris les champignons, les bactéries et les virus. Les microbes peuvent être à la fois bénéfiques et nocifs pour leur hôte, et jouent un rôle clé dans le fonctionnement des organismes et des écosystèmes. Par exemple, les microbes associés aux racines des arbres jouent un rôle important dans l’absorption des nutriments.
Agroécosystèmes
Au Canada, plus de 60 millions d’hectares de terres sont utilisés pour l’agriculture primaire, ce qui contribue à notre économie, fournit des ressources essentielles et assure la sécurité alimentaire.
Voici certaines répercussions des changements climatiques :
- Le stress physiologique dû à la hausse des températures.
- Une augmentation des insectes nuisibles envahissants, des mauvaises herbes et des agents pathogènes.
- Un déclin des populations d’insectes bénéfiques, tels que les pollinisateurs.
- De nouvelles possibilités en agriculture.
Activités de recherche
Insectes
Étudier la diversité génétique des insectes, cibler les espèces qui ont connu un déclin important et examiner les effets de l’utilisation des terres et des changements climatiques sur les populations. L’utilisation de spécimens d’insectes provenant de la Collection nationale canadienne et d’échantillons récents nous permettra d’évaluer les changements génomiques associés aux changements climatiques au fil du temps. Les nouveaux spécimens recueillis seront conservés comme base de référence de la diversité génétique des insectes.
Terres cultivées
Évaluer la vulnérabilité génomique et le potentiel d’adaptation des cultures oléagineuses et légumineuses aux changements des conditions environnementales et aux facteurs de stress, comme la chaleur et les sécheresses, et le rôle que jouent les microbiomes dans leur capacité d’adaptation.
Élaborer de nouvelles techniques de détection pour des analyses sur le terrain visant à fournir une caractérisation en temps réel des nutriments et des caractéristiques des végétaux.
Bison
Développer des outils génomiques pour évaluer la composition génétique des sous‑espèces de bisons et examiner les effets des changements climatiques, des contaminants environnementaux et des agents pathogènes sur la génétique et la santé des bisons et leur microbiome. Les changements climatiques influent sur la dynamique des maladies chez les espèces sauvages à mesure que les aires de répartition des hôtes et des agents pathogènes se déplacent. Nous caractérisons les agents pathogènes qui infectent les bisons, évaluons leur prévalence et développons de nouveaux outils génomiques afin d’améliorer la surveillance des maladies.
Écosystèmes aquatiques et côtiers
Les écosystèmes aquatiques et côtiers sont au cœur de la biodiversité, de l’économie et de l’identité culturelle du Canada, qui compte plus de deux millions de lacs et de cours d’eau et dont le littoral est le plus long au monde.
Voici certaines répercussions des changements climatiques :
- Le stress physiologique dû à la hausse des températures.
- Les interactions compétitives et la propagation d’agents pathogènes.
- L’altération des réseaux trophiques en raison des changements dans la diversité et l’abondance des espèces.
Activités de recherche
Arctique et région subarctique
Évaluer la vulnérabilité génomique des espèces sauvages du Nord et qui se déplacent vers le Nord face aux changements climatiques, y compris les facteurs qui influent sur la dynamique des maladies causées par des agents pathogènes existants et émergents, en mettant l’accent sur les espèces récoltées par les communautés autochtones. Les pathogènes menacent les populations d’espèces sauvages, de même que la santé, la sécurité alimentaire et le bien-être culturel des collectivités autochtones nordiques.
Rivières d’eau douce de l’Est
Étude des interactions au sein d’une chaîne alimentaire de salmonidés, dans des rivières ayant des régimes thermiques différents, afin de prédire les effets des changements climatiques sur les écosystèmes d’eau douce. Toutes les espèces dans un écosystème sont interreliées par l’intermédiaire du réseau trophique. Un changement dans l’abondance ou la diversité d’une espèce peut avoir des effets en cascade, ce qui menace la stabilité et la productivité de l’écosystème dans son ensemble.
Résultats
- Générer des données et des ressources génomiques fondamentales
- Prévoir la capacité des espèces clés du Canada de s’adapter aux scénarios climatiques futurs
- Élaborer des outils pour surveiller les répercussions de l’utilisation des terres et des changements climatiques sur les écosystèmes environnants
- Cerner les risques pour la santé des espèces sauvages, la santé humaine et la sécurité alimentaire
- Fournir des conseils scientifiques pour orienter une gestion et une conservation résilientes au climat
Participants financés
- Conseil national de recherches Canada
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Environnement et Changement climatique Canada
- Pêches et Océans Canada
- Santé Canada
- Ressources naturelles Canada
- Agence de la santé publique du Canada
Partenaires du projet
GenARCC est un projet de collaboration de cinq ans financé par le gouvernement du Canada. Grâce à des partenariats avec les collectivités autochtones, les établissements universitaires, les gouvernements provinciaux et territoriaux et l’industrie, GenARCC vise à utiliser les outils génomiques pour éclairer l’adaptation aux changements climatiques et promouvoir la résilience.