Protocole canadien complémentaire à la norme ISO 10710 : Essai visant à mesurer l’inhibition de la croissance de la macroalgue, Ceramium tenuicorne
Unité de l’élaboration et de l’application des méthodes
Section de l’évaluation biologique et normalisation
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Rapport DGST 1/RM/63
mars 2025
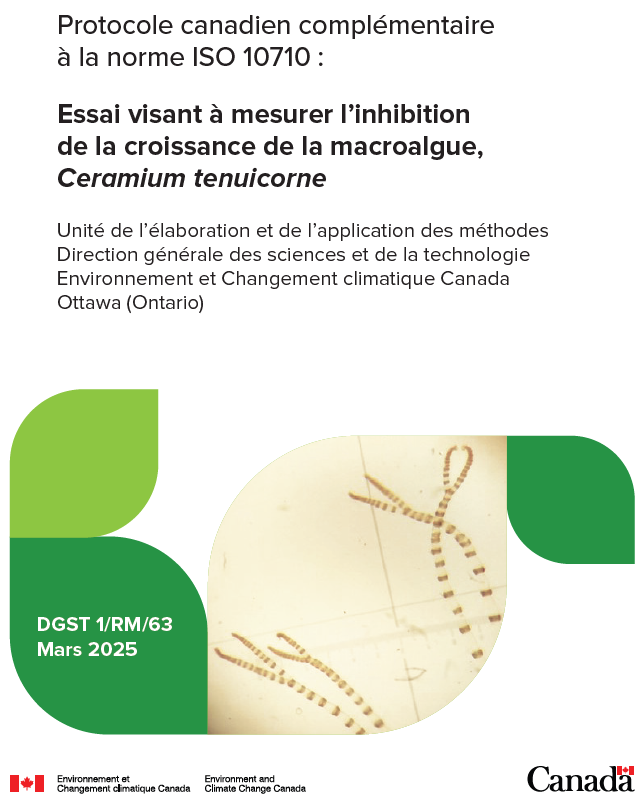
Téléchargez le format alternatif
(Format PDF, 1120 Ko, 39 pages)
Liste des figures
Figure 1 Des gamétophytes femelles sains de Ceramium tenuicorne (clone marin) au moment de la réception de l’Université d’Oslo (AquaTox, 2022)
Figure 2 Exemple de Ceramium tenuicorne utilisé pour préparer de nouveaux récipients de culture
Figure 3 Exemples de boutures de gamétophyte femelle de C. tenuicorne, mesurant 0,6 à 1,2 mm de longueur, qui se prêtent à l’essai d’inhibition de la croissance (AquaTox, 2022)
Figure 4 Gamétophyte femelle de C. tenuicorne muni d’une fourche au lieu de deux (AquaTox, 2022)
Figure 5 Exemples de Ceramium tenuicorne en santé ou non à la fin de l’essai (AquaTox, 2022)
Liste des tableaux
Tableau 1 Liste de contrôle des conditions et procédures exigées et recommandées pour la culture de Ceramium tenuicorne destinés aux essais de toxicité sublétale prescrits dans les règlements canadiens
Tableau 2 Liste de contrôle des conditions et procédures exigées et recommandées pour les essais de toxicité sublétale de Ceramium tenuicorne prescrits dans les règlements canadiens
Remerciements
Le présent protocole a été élaboré par Carolyn Martinko et Leana Van der Vliet (Unité de l’élaboration et de l’application des méthodes, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, Ontario), sous la direction de Rick Scroggins (retraité, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, Ontario). Nous tenons à remercier Sarah Costantini, Melanie Gallant, Lisa Taylor et le personnel technique de Nautilus Environmental (anciennement AquaTox Testing & Consulting Inc., Puslinch, Ontario), notamment : Paige Cochrane, Nadia Pajnic, Anna Sobaszek, Cintia Glasner Regis et Vanessa Chanes, pour leur contribution à l’adaptation de la norme ISO 10710 à la réalité des laboratoires canadiens. Nous remercions aussi Barb Buckland (retraitée, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau, Québec) qui a examiné les premières ébauches de ce protocole complémentaire. Nous sommes reconnaissants envers Lindsey Boyd, Hana Moidu et François Boisvert (Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau, Québec) pour leur soutien et leur financement tout au long de la validation de la méthode. Nous sommes aussi sensibles à l’aide apportée par feu Stein Fredriksen (département des biosciences, Université d’Oslo, Oslo, Norvège), qui a fourni des conseils techniques et la culture d’algues utilisée pour la validation de méthode. Nous remercions également Kerry Dykens et Mark Hurd (National Center for Marine Algae and Microbiota [NCMA], Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, East Boothbay, Maine), qui ont accepté que la culture d’algues soit déposée dans la collection publique de l’NCMA et fourni des conseils techniques.
1.0 Application
Ce protocole complémentaire canadien qui permet de mettre en culture Ceramium tenuicorne et de réaliser des essais avec ce dernier doit être suivi lorsque l’on effectue des essais de toxicité sublétale dans des installations conformes aux exigences des règlements canadiens, et s’applique aux effluents rejetés dans un milieu marin ou estuarien.
Ce protocole complémentaire doit être utilisé conjointement avec la norme 10710 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) (ISO, 2010), qui est un essai d’inhibition statique de la croissance de 7 jours réalisé avec la macroalgue rouge Ceramium tenuicorne. Les normes ISO peuvent être achetées de plusieurs organisations, notamment directement auprès de l’ISO www.iso.org. Veuillez noter que toutes les normes ISO sont protégées par un droit d’auteur. Les instructions et les conditions décrites dans le présent document différent parfois de celles de la norme ISO (2010). Les conditions de culture et d’essai du présent protocole complémentaire ont été validées dans un laboratoire canadien au moyen d’essais menés avec une substance chimique toxique de référence ainsi qu’avec de nombreux effluents d’usines de pâtes et papiers utilisant différents types de traitement, et de mines de métaux (AquaTox 2022, 2023; Nautilus Environmental, 2024). L’essai a toujours été jugé robuste, fiable et sensible avec les différents types d’effluents.
Dans le présent document, comme dans d’autres méthodes d’essai de toxicité normalisées d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), les degrés de rigueur suivants s’appliquent dans les instructions :
- L’auxiliaire doit (doivent) ou l’indicatif d’obligation (il faut) exprime l’obligation absolue.
- L’auxiliaire devrait (devraient) et le conditionnel d’obligation (il faudrait) expriment une recommandation ou la nécessité de respecter dans la mesure du possible la condition ou la marche à suivre.
- L’auxiliaire peut (peuvent) exprime l’autorisation ou la capacité d’accomplir une action.
- L’auxiliaire pourrait (pourraient) indique la possibilité ou l’éventualité.
Veuillez noter que l’utilisation de « doit » (« doivent ») et le présent « est » (« sont ») dans la norme ISO équivaut à une obligation ou à une « exigence » dans une méthode d’ECCC. L’utilisation de « il convient de » ou « il convient que » dans la norme ISO équivaut à « devrait » ou « devraient » dans une méthode d’ECCC; elle indique « qu’il est recommandé de ».
2.0 Justification
Plusieurs règlements sur les effluents pris en vertu de la Loi sur les pêches prévoient des méthodes faisant appel à une macroalgue marine pour réaliser les essais servant à la surveillance de la qualité des effluents. Ces méthodes d’essai sont celles qui ont été normalisées et publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA) et recourent à l’une ou l’autre de ces deux espèces : Macrocystis pyrifera ou Champia parvula. Dans le passé, des essais avec Champia parvula ont été réalisés avec succès pour des installations de la côte Est. Toutefois, au cours des dernières années, la reproductibilité de l’essai avec cette espèce a connu d’importantes ratées, d’où les préoccupations soulevées quant à la qualité des données. Le seul laboratoire en Amérique du Nord ayant effectué des essais avec Champia parvula a mis fin à au service qu’elle offrait, ce qui s’est soldé par une lacune dans les capacités d’analyse. En revanche, des essais ont été couronnés de succès avec Macrocystis pyrifera dans des installations de la côte Ouest et, plus récemment, dans la côte Est. Toutefois, il se peut que Macrocystis pyrifera ne soit pas représentatif des espèces de la côte Est, et, par ailleurs, l’obtention de l’espèce utilisée dans l’essai et le prélèvement de l’effluent dans les délais prescrits par la méthode d’essai présente de grands défis logistiques.
Afin de rétablir la souplesse qui existait antérieurement dans le choix des espèces d’essai, ECCC a examiné d’autres méthodes d’essai normalisées utilisant des espèces de macroalgues marines et s’est concentré sur la méthode normalisée ISO 10710 qui fait appel à Ceramium tenuicorne. Après avoir confirmé que Ceramium tenuicorne est pertinent sur le plan écologique dans l’environnement marin canadien (Garbary et McDonald, 1996; Sloan et Bartier, 2000; ECCC, 2020), l’Unité de l’élaboration et de l’application des méthodes (UEAM) d’ECCC a étudié la norme ISO (2010) et a élaboré des instructions et des conditions supplémentaires pour que cette norme soit compatible avec les autres essais de toxicité sublétale prescrits dans les règlements canadiens. Ce protocole complémentaire qui vise à mettre en application la méthode normalisée ISO 10710 dans le contexte canadien a été peaufiné grâce à des recherches effectuées dans un laboratoire commercial canadien (AquaTox, 2022, 2023; Nautilus Environmental, 2024). Comme il est indiqué à la section 1, ce protocole complémentaire doit être suivi conjointement avec la norme ISO 10710 (ISO, 2010).
3.0 Organismes d’essai
3.1 Espèces et source
La macroalgue rouge, Ceramium tenuicorne ([Kützing] Wærn, 1952; embranchement de Rhodophyta, ordre de Ceramiales), doit être utilisée comme espèce dans l’essai. Dixon (1960) et Cho et coll. (2001) décrivent la structure du genre Ceramium. En raison de sa structure, chaque cellule de Ceramium tenuicorne est en contact direct avec le milieu aquatique environnant et subit ainsi les effets des substances toxiques solubles (Eklund, 1998). À l’origine, deux clones isolés d’habitats différents étaient considérés comme des espèces distinctes. Toutefois, des études de séquençage de l’ADN et d’interfertilité ont permis de conclure que ces organismes appartenaient à la même espèce (Rueness, 1978; Gabrielsen et coll., 2003). Le clone marin (auparavant désigné Ceramium strictum) tire son origine du fjord d’Oslo (salinité de 20 à 25 parties par millier [‰]), tandis que le clone d’eau saumâtre provenait de la mer Baltique, au sud de Stockholm (7 ‰ de salinité) (Rueness, 1973; Eklund, 2005). La norme ISO (2010) a été utilisée avec succès avec les deux clones. En Canada, le clone marin de C. tenuicorne (C. strictum) a été trouvé dans le port de Monks Head, en Nouvelle-Écosse (Garbary et McDonald, 1996) et dans l’archipel Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte), en Columbie-Brittanique (Sloan et Bartier, 2000).
Le présent protocole complémentaire doit être appliquée en utilisant les gamétophytes femelles du clone marin de Ceramium tenuicorne, car ils croissent plus rapidement que les mâles et leur croissance en motif dichotomique est plus uniforme que celle des tétrasporophytes diploïdes (Bruno et Eklund, 2003; ISO, 2010), et ils peuvent s’acclimater et être cultivé à une salinité de 30 ‰ (Eklund, 2005; Macken et coll., 2012). On s’est servi des gamétophytes femelles du clone marin de Ceramium tenuicorne provenait de l’Université d’Oslo à toutes les étapes de la validation du présent protocole complémentaire (AquaTox 2022, 2023; Nautilus Environmental, 2024). Il faut identifier taxonomiquement et consigner l’espèce, le clone et le sexe de l’organisme utilisé dans l’essai. Cette exigence peut être satisfaite au moyen d’une certification provenant de la source. Voir l’annexe D pour plus de détails sur la structure et la façon de distinguer les gamétophytes femelles et mâles.
On peut acheter Ceramium tenuicorne auprès du fournisseur suivant :
National Center for Marine Algae and Microbiota (NCMA), Bigelow Laboratory for Ocean Sciences
60 Bigelow Drive, East Boothbay (Maine) 04544
Souche : Ceramium tenuicorne (Kützing) Waern
Téléphone : (207) 315-2567, poste 3
Courriel : ncma@bigelow.org
Les demandes de renseignements à jour sur les fournisseurs de C. tenuicorne peuvent être adressées à :
Unité de l’élaboration et de l’application des méthodes
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
335, chemin River
Ottawa (Ontario) K1V 1C7
Courriel : methods@ec.gc.ca
La figure 1 montre quelques gamétophytes femelles sains du clone marin de C. tenuicorne reçus en laboratoire et provenant d’une source établie. L’annexe D fournit des détails supplémentaires sur la santé de la culture.

Description longue
Quatre boutures de macroalgues rouge-brun dans des boîtes de Petri sur un fond clair. Les algues présentent une alternance de cellules corticales (bandes sombres) et de cellules axiales (bandes claires et translucides) le long des thalles. Les algues se sont développées selon un schéma de ramification dichotomique, avec trois ou quatre niveaux de ramification se terminant par des apex en forme de fourches incurvées.
3.2 Acclimatation
L’acclimatation de C. tenuicorne aux conditions de culture en laboratoire (p. ex., milieu, température, intensité lumineuse, photopériode) devrait être aussi graduelle que possible pour que les organismes subissent un minimum de stress (EC, 1999; AquaTox, 2022). Les cultures de C. tenuicorne doivent être acclimatées à une salinité de 30 ± 2 ‰, qui est celle des essais de toxicité sublétale réalisés avec les effluents rejetés dans un milieu marin ou estuarien, comme l’exigent les directives d’Environnement Canada (EC, 2001). L’acclimatation des cultures de C. tenuicorne à cette salinité devrait être graduelle, la salinité variant de ± 3 ‰ aux deux jours jusqu’à l’atteinte de la salinité désirée (section 5 de l’ISO, 2010). Les cultures de C. tenuicorne doivent être acclimatées à la salinité et à la température nécessaires aux essais au moins deux semaines avant le début de l’essai (ISO, 2010).
3.3 Conditions de culture
Le tableau 1 présente un résumé des conditions et procédures exigées et recommandées pour la culture de Ceramium tenuicorne dans le but de réaliser les essais de toxicité sublétale prescrits dans les règlements canadiens. Les conditions décrites dans la présente section complètent et, dans certains cas, remplacent celles précisées dans la norme ISO (2010).
La section 6 de la norme ISO (2010) décrit l’appareillage recommandé pour réaliser la culture et les essais. La culture de Ceramium tenuicorne devrait être conservée dans une installation où la température et l’éclairage peuvent être régulés. La zone de culture devrait être distincte des zones où les essais sont effectués et les échantillons sont préparés afin de réduire le risque de contamination des cultures par des substances ou des matières utilisées dans les essais. Le matériel qui entre en contact avec C. tenuicorne ou le milieu doit être fait d’une matière non toxique et chimiquement inerte; il ne faut pas utiliser de matériel ou d’équipement en cuivre (section 4.2.1 de la norme ISO, 2010).
Pour cultiver C. tenuicorne, on devrait recourir à des techniques d’asepsieNote de bas de page 1. Les cultures de C. tenuicorne doivent être exemptes d’autres algues et d’algues bleu-vert (c.-à-d. de cyanobactéries). Toutefois, il n’est pas nécessaire que les cultures soient complètement axéniques (S. Fredriksen, Université d’Oslo, communication personnelle, 2020; AquaTox, 2023).
AquaTox (2023) a constaté que l’utilisation d’une enceinte de sécurité biologique n’était pas nécessaire pour maintenir des cultures saines de C. tenuicorne. Le laboratoire a connu un incident isolé de contamination de la culture, mais celle-ci s’est rétablie en quelques semaines après avoir été complétée par des organismes provenant de la culture de masse; voir l’annexe D pour plus de détails sur la contamination (Nautilus Environmental, 2024).
Les algues C. tenuicorne utilisées dans des essais évaluant des eaux usées doivent être cultivées dans un milieu préparé conformément à la section 3.4 du présent protocole complémentaire. Les organismes doivent être transférés dans un milieu de culture frais toutes les semaines pour que les gamétophytes femelles puissent continuer de croître activement (Section 5 de la norme ISO, 2010)Note de bas de page 2. Les cultures ne sont pas aérées. Les récipients de culture devraient être des boîtes de Petri stériles en plastique ou en verre munies d’un couvercle; la taille recommandée est de 90 × 15 mm ou 100 × 15 mmNote de bas de page 3. La densité de chargement recommandée est d’environ 20 à 30 boutures d’algue par récipient, chacune mesurant entre 10 et 20 mm de longueur, dans 25 mL de milieu de culture stérile (ISO, 2010). Les boutures peuvent être coupées à la taille voulue au moyen du matériel et des techniques décrits à la section 4.3 du présent protocole complémentaire (c.-à-d. à l’aide d’un scalpel ou de petits ciseaux, de pinces, d’un microscope stéréoscopique ou d’une loupe, et de papier quadrillé). La figure 2 présente des exemples de boutures d’algues utilisées pour démarrer une nouvelle culture. Les boutures d’algues utilisées pour démarrer une nouvelle culture devraient avoir un point de ramification. Toutefois, les boutures sans point de ramification, mais qui semblent saines (c.-à-d. de couleur rouge et d’apparence normale) peuvent servir à démarrer une nouvelle culture si on dispose d’un nombre limité d’organismes (Nautilus Environmental, 2024).
Tableau 1 : Liste de contrôle des conditions et procédures exigées et recommandées pour la culture de Ceramium tenuicorne destinés aux essais de toxicité sublétale prescrits dans les règlements canadiens
Espèce
- - gamétophytes femelles du clone marin de Ceramium tenuicorne; espèce, clone et sexe confirmés
Milieu de culture
- - eau de mer naturelle non contaminée, filtrée à travers un filtre en papier (30 µm) et stérilisée par autoclave ou filtration stérile (0,2 µm) avant utilisation
- - solutions nutritives ajoutées conformément à la colonne A du tableau 3 de la norme ISO (2010)
- - la salinité doit être de 30 ± 5 ‰ et devrait être de 30 ± 2 ‰
Récipient de culture
- - boîte de Petri en verre ou en polystyrène stérile avec son couvercle
- - 90 × 15 mm ou 100 × 15 mm
Volume
- - environ 25 mL de milieu de culture stérile par récipient
Densité de chargement
- - environ 20 à 30 boutures d’algue, chacune ayant 10 à 20 mm de longueur, dans 25 mL de milieu
Entretien des cultures
- - repiquer la culture une fois par semaine dans un milieu de culture stérile frais
- - température, salinité, pH et oxygène dissous mesurés régulièrement (p. ex., au moment du renouvellement du milieu)
- - intensité lumineuse mesurée au moins une fois par semaine
Température
- - 22 ± 2 °C
pH
- - 8.0 ± 0.2, ajusté avant et après la stérilisation, au besoin, en utilisant du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/L
Oxygène dissous
- - saturation de 90 % à 100 %; milieu de culture aéré jusqu’à une valeur à l’intérieur de cette plage avant usage, au besoin
Aération
- - les récipients de culture ne sont pas aérés
Éclairage
- - tubes fluorescents de type « lumière du jour » ou lumière « blanc chaud » ou au moyen d’éclairage équivalente
- - intensité lumineuse de 35 ± 7 μmol m-2 s-1
- - photopériode de 14 h de lumière : 10 h d’obscurité
Critères de santé
- - la culture doit sembler saine et être associée à un degré de sensibilité acceptable, déterminé par un essai réalisé avec une substance toxique de référence et des cartes de contrôle
Les renseignements de ce tableau ne sont fournis qu’à titre de résumé. Les exigences et recommandations définitives du présent protocole complémentaire figurent dans le corps principal du document.
C. tenuicorne devrait être cultivé à une température de 22 ± 2 °C. Si la température dans les récipients de culture (ou dans une ou deux récipients supplémentaires utilisés pour vérifier la température de l’eau) est mesurée autrement que dans les récipients eux-mêmes (p. ex., dans l’incubateur ou l’enceinte à température contrôlée dans laquelle se trouvent les récipients), il faut établir la relation entre les lectures et la température à l’intérieur des récipients et faire une vérification périodique pour s’assurer que les algues sont cultivées dans la plage de températures souhaitée.
C. tenuicorne devrait être cultivé au moyen d’un éclairage fluorescent de type « lumière du jour » ou « blanc chaud » ou un éclairage équivalent. Le débit de fluence de la lumière (intensité lumineuse) devrait être de 35 ± 7 µmol m-2 s-1, mesuré à des points situés à environ la même distance de la source lumineuse que les organismes d’essai. Il faut recourir à des méthodes quantiques pour mesurer la lumière, car elles sont adaptées aux organismes photosynthétiquesNote de bas de page 4.
La photopériode devrait être de 14 h de lumière et 10 h d’obscurité. L’intensité lumineuse devrait être mesurée au moins une fois par semaine (AquaTox, 2022).
Les gamétophytes femelles de la culture de C. tenuicorne utilisés pour les essais doivent sembler sains et présenter un degré acceptable de sensibilité, paramètres mesurés au moyen d’essais réalisés avec une substance toxique de référence et des cartes de contrôle (voir la section 4.8 du présent protocole complémentaire). La figure 5 de la section 4.5 présente des exemples de caractéristiques de C. tenuicorne en santé ou non, observées à la fin d’un essai mené avec une substance toxique de référence. Voir également l’annexe D pour obtenir des détails sur la détermination du sexe, la coloration normale et la décoloration, ainsi que de la contamination de C. tenuicorne. Les cultures de C. tenuicorne contaminées (p. ex. par des microalgues, des protozoaires, des champignons ou des bactéries) devraient être éliminées.

Description longue
Une bouture de macroalgue rouge-brun sur un fond bleu clair. Un rectangle noir entoure un apex qui se termine par des « fourches » incurvées, et un ovale bleu entoure un apex qui est droit et ne se termine pas par des « fourches ».
3.4 Milieu de culture et qualité de l’eau
L’eau utilisée pour préparer les milieux de culture doit provenir d’un approvisionnement non contaminé d’eau de mer naturelle. La salinité doit être de 30 ± 5 ‰ et devrait être de 30 ± 2 ‰Note de bas de page 5. Pour l’heure, on ne dispose d’aucune donnée pour étayer le recours à de l’eau de mer artificielle dans la réalisation des culturesNote de bas de page 6. Voir la section 4.2.3 de la norme ISO (2010). L’eau de mer naturelle non contaminée doit être filtrée (p. ex., filtre en papier de 30 µm) pour éliminer les grosses particules. Le pH doit ensuite être vérifié. Au besoin, il faut ajuster le pH à 8,0 ± 0,2 avec du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/LNote de bas de page 7. Après un ajustement du pH, l’eau de mer naturelle doit être stérilisée par autoclave ou par filtration stérile (taille des pores = 0,2 µm) avant utilisation. Le pH de l’eau de mer naturelle doit être vérifié après la stérilisation et, au besoin, le pH doit être ajusté de nouveau à 8,0 ± 0,2 en utilisant du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/L avant utilisation. Les solutions mères de nutriments doivent être préparées selon les directives de la section 4.3 de la norme ISO (2010)Note de bas de page 8. Les solutions de nutriments (c.-à-d. ayant de l’azote, du phosphore, du fer, des oligoéléments et des vitamines) doivent être ajoutées à l’eau de mer naturelle stérilisée et dont le pH a été ajusté (au besoin), et respecter les concentrations indiquées dans la colonne A du tableau 3 de la norme ISO (2010). La teneur en oxygène dissous du milieu de culture préparé devrait être de 90 à 100 % de saturation avant utilisation. Si cela est nécessaire, une aération légère du milieu devrait être effectuée à l’aide d’air comprimé, filtré et exempt d’huile. Cette aération favorise également le mélange du milieu. On devrait éviter d’aérer de façon trop vigoureuse (EC, 2011).
Les conditions de culture, notamment la température, la salinité, le pH et l’oxygène dissous, doivent être surveillées et évaluées à intervalles réguliers (p. ex., au moment du renouvellement du milieu de culture). Les autres variables comme les gaz dissous totaux, l’ammoniac, l’azote, le nitrite, les métaux, les pesticides, les solides en suspension et le carbone organique total devraient être évalués aussi souvent que nécessaire pour que la qualité de l’eau puisse être consignée.
4.0 Système et instructions relatives à l’essaie
Le but du présent essai est de mesurer la toxicité sublétale des effluents d’eaux usées industrielles rejetés dans un milieu marin ou estuarien au Canada à l’aide d’une espèce de macroalgue. Au tableau 2, on décrit en résumé les instructions à suivre et les conditions d’essai avec Ceramium tenuicorne que l’on exige ou recommande pour réaliser des essais de toxicité sublétale avec les effluents ou les substances chimiques toxiques de référence prescrits dans les règlements canadiens. Ces directives complètent et, dans certains cas, remplacent celles précisées dans la norme ISO (2010).
4.1 Prélèvement, étiquetage, transport et conservation des échantillons
Les exigences en matière de volume d’échantillon dépendent du nombre de concentrations étudiées et du nombre de répétitions. En général, un échantillon d’effluent de 1 L est suffisant pour effectuer un essai d’inhibition de la croissance des algues. L’échantillon doit être prélevé et placé dans un contenant portant une étiquette ou un code et fait d’une matière inerte et non toxique. L’étiquette ou le code devrait comprendre au moins les renseignements suivants : type d’échantillon, source, date et heure du prélèvement, nom de la ou des personnes ayant fait le prélèvement. Le contenant doit être neuf ou nettoyé à fond et rincé avec de l’eau non contaminée. Il devrait également être rincé avec l’échantillon à prélever, puis rempli et scellé pour réduire au minimum l’espace libre. La chaîne de possession pendant le prélèvement, le transport et la conservation des échantillons devrait être consignée.
Au moment du prélèvement, les échantillons d’effluent tièdes (> 7 °C) doivent être refroidis à une température entre 1 et 7 °C avec de la glace régulière (et non de la glace sèche) ou des blocs réfrigérants froids. Au besoin, une grande quantité de glace ordinaire, des blocs réfrigérants ou d’autres moyens de réfrigération doivent être ajoutés au contenant de transport pour maintenir la température de l’échantillon entre 1 °C et 7 °C pendant le transport. Il ne faut pas que les échantillons gèlent pendant le transport ou la conservation. On peut surveiller la température pendant le transport à l’aide de thermomètres max/min.
L’essai mené avec les échantillons d’effluent devrait commencer dès que possible après le prélèvement de l’échantillon, et doit commencer au plus tard trois jours après le prélèvement de l’échantillon.
À l’arrivée au laboratoire, la température de l’échantillon doit être mesurée et consignée, et doit se situer entre 1 °C et 7 °C. La salinité de l’échantillon doit également être mesurée et consignée à ce moment-là. Celle-ci doit être mesurée par réfractométrie ou conductivité conformément au présent protocole complémentaire. On peut consulter les directives de mesure de la salinité par ces techniques à la Section 4.2 d’ECCC (2017, 2019)Note de bas de page 9. Les mesures du pH et de l’oxygène dissous devraient être consignées au moment de la réception de l’échantillon d’effluent, avant l’ajustement de la salinité à la valeur de 30 ± 2 ‰ (voir Section 4.2.2)Note de bas de page 10. Après tout ajustement nécessaire de la salinité, une portion aliquote de l’effluent requise à ce moment-là est équilibrée immédiatement ou pendant la nuit à la température de l’essai et sera utilisée dans le cadre de ce dernier (voir la section 4.2.2). Toute portion résiduelle de l’échantillon devant être conservée pour une utilisation ultérieure doit être placée à l’obscurité, dans un contenant scellé, sans espace libre, à 4 ± 2 °C.
Tableau 2 : Liste de contrôle des conditions et procédures exigées et recommandées pour les essais de toxicité sublétale de Ceramium tenuicorne prescrits dans les règlements canadiens
Type d’essai
- - statique; essai d’inhibition de la croissance de 7 jours
Récipient d’essai
- - boîte de Petri en verre ou en polystyrène stérile avec son couvercle
- - 50 × 10 mm, 50 × 9 mm ou 50 × 15 mm
Volume d’essai
- - 10 mL/répétition
Eau témoin/de dilution
- - eau de mer naturelle non contaminée (filtrée à travers un filtre en papier [30 µm]) ou eau de mer artificielle; stérilisée par autoclave ou par filtration stérile [0,2 µm] avant utilisation; pH ajusté à 8,0 ± 0,2 avec du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/L, avant et après la stérilisation, au besoin
- - solutions de nutriment ajoutées à l’eau de mer stérilisée naturelle ou artificielle conformément à la colonne B ou C, respectivement, du tableau 3 de la norme ISO (2010)
- - 30 ± 2 ‰ de salinité
Préparation du récipient de collecte d’algues en vue d’obtenir des organismes d’essai
- - boutures d’algue transférées dans les récipients de collecte d’algues remplies de milieu de culture frais 3 à 4 jours avant le début de l’essai
- - 20 à 30 boutures d’algues, chacune mesurant environ 10 à 15 mm de longueur, par récipient de collecte d’algues
- - récipients de collecte d’algues soumis à des conditions normales de culture
- - préparation de 3 à 4 (≥ 5 recommandé) récipients de collecte d’algues pour obtenir suffisamment de matière de départ pour un essai (au moins 64 à 72 boutures d’algue nécessaires)
Organisme d’essai
- - Clone marin constitué de gamétophytes femelles de Ceramium tenuicorne issus d’une culture qui a été acclimatée à la salinité et à la température de l’essai pendant ≥ 2 semaines
- - boutures d’algues prélevées sur les organismes des récipients de collecte d’algues
- - la longueur de chaque bouture d’algue doit être de 0,6 à 1,8 mm et devrait être de 0,6 à 1,2 mm, mesurée de la fourche la plus près de la base jusqu’à l’apex le plus éloigné de l’organisme; deux niveaux de fourche (c.-à-d. bouture avec deux ramifications) recommandés, mais un niveau de fourche est acceptable (c.-à-d. bouture sans ramification)
- - les boutures d’algue doivent sembler saines (c.-à-d. être brun rouge et non décolorées); les boutures endommagées sont éliminées; les boutures d’algue de longueur uniforme sont recommandées
- - 2 organismes d’essai/répétition
Nombre de concentrations
- - ≥ 7, plus le témoin de l’eau/de dilution
- - un autre traitement témoin (c.-à-d. le « témoin de sels » ou le « témoin de la saumure hautement concentrée ») doit être préparé si la salinité de l’échantillon d’effluent est ajustée (voir EC, 2001)
Nombre de répétitions
- - ≥ 4 répétitions/traitement, y compris le ou les témoins
Randomisation
- - les traitements sont répartis au hasard dans l’installation
- - il est recommandé de changer régulièrement l’endroit où on place les récipients d’essai dans l’installation durant l’essai (c.-à-d. une fois par jour, au hasard)
Exigence relative à l’échantillon
- - échantillon de 1 L d’effluent
Transport et conservation de l’échantillon
- - s’il fait chaud (> 7 °C), refroidir à 1 à 7 °C avec de la glace régulière (et non de la glace sèche) ou des blocs réfrigérants congelés au moment de la collecte; l’échantillon ne doit pas geler pendant le transport ou la conservation; la température à l’arrivée doit être de 1 à 7 °C; conserver dans le noir à 4 ± 2 °C; l’essai avec l’échantillon devrait commencer dès que possible après le prélèvement et doit commencer au plus tard trois jours après le prélèvement de l’échantillon
Salinité
- - au besoin, la salinité de l’échantillon d’effluent doit être ajustée à 30 ± 2 ‰ dès que possible après sa réception conformément aux directives d’Environnement Canada (2001); préparer le témoin de sels ou celui de saumure hautement concentrée si la salinité de l’échantillon d’effluent est ajustée
- - toutes les solutions de l’essai doivent avoir une salinité entre 28 et 32 ‰
Temperature
- - 22 ± 2 °C
Filtration
- - les échantillons d’effluents ne sont généralement pas filtrés
pH
- - dans la plage de 7,0 à 9,0; ajuster, si nécessaire, à l’intérieur de cette plage en utilisant du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/L
Ajout de nutriments dans l’effluent
- - nutriments (c.-à-d. azote, phosphore, fer et solutions de carbone) ajoutés à l’échantillon d’effluent non dilué conformément à la colonne C du tableau 3 de la norme ISO (2010)
Aération
- - les échantillons d’effluent enrichis en nutriments doivent être légèrement aérés au préalable pendant 20 minutes à une vitesse minimale (c.-à-d. ≤100 bulles/min) avant le début de l’essai
- - les solutions de l’essai ne sont pas aérées pendant l’essai
Éclairage
- - tubes fluorescents de type « lumière du jour » ou lumière « blanc chaud » ou lumière équivalente
- - intensité de 70 ± 7 μmol m-2 s-1
- - photopériode de 14 h de lumière : 10 h d’obscurité
Observations et mesures
- - la longueur initiale (mm) des boutures (≥ 20 boutures d’algue) d’un échantillon représentatif d’algues au début de l’essai (jour 0), mesurée du premier point de ramification jusqu’à l’apex le plus éloigné de chaque organisme
- - longueur finale (mm) de chaque bouture à la fin de l’essai (jour 7), mesurée du premier point de ramification jusqu’à l’apex le plus éloigné de chaque organisme
- - apparence des algues au début et à la fin de l’essai (jour 0 et jour 7)
- - température et salinité mesurées à la réception de l’échantillon d’effluent
- - température mesurée quotidiennement durant l’essai
- - pH, salinité et oxygène dissous mesuré au début et à la fin de l’essai dans les échantillons ayant une concentration représentative (au minimum : témoin(s) et concentrations faible, moyenne et élevée)
- - intensité mesurée à plusieurs endroits dans la zone d’essai au moins une fois pendant l’essai (recommandé quotidiennement)
Paramètres
- - augmentation moyenne de la longueur par jour (µ) (± ÉT) à la fin de l’essai pour chaque concentration examinée et chaque traitement témoin
- - CI25 (avec ses intervalles de confiance à 95 %) pour l’inhibition de la croissance par rapport au témoin de l’eau/de dilution, selon une augmentation moyenne de la longueur par jour (µ)
- - une stimulation statistiquement significative par rapport au témoin de l’eau/de dilution doit être consignée dans le rapport d’essai
Essais avec une substance toxique de référence
- - l’essai de 7 jours doit commencer dans les 14 jours de la période d’essai; effectué dans les mêmes conditions que l’essai définitif; sulfate de zinc recommandé (ZnSO4·7H2O)
Validité de l’essai
- - valide si : i) la longueur des témoins à la fin de l’essai a augmenté d’un facteur > 3 comparativement à la longueur de départ, et ii) le pH du témoin varie entre 6,5 et 9,5 (inclusivement) à la fin de l’essai.
- - si plus d’un traitement témoin est utilisé, chacun doit indépendamment satisfaire tous les critères de validité
Les renseignements de ce tableau ne sont fournis qu’à titre de résumé. Les exigences et recommandations définitives du présent protocole complémentaire figurent dans le corps principal du document.
4.2 Préparation des solutions de l’essai
Tous les récipients d’essai, les appareils de mesure, l’équipement d’agitation et le matériel utilisé pour transférer des organismes doivent être non toxiques et nettoyés à fond et rincés conformément aux modes opératoires normalisés. L’eau témoin/de dilution devrait servir comme dernière eau de rinçage des articles à utiliser immédiatement lors de la préparation de l’essai. L’eau distillée ou désionisée devrait servir comme dernière eau de rinçage des articles à ranger après le séchage (voir EC [2007a] pour obtenir les instructions recommandées pour nettoyer la verrerie).
4.2.1 Eau témoin/de dilution
L’eau témoin/de dilution doit être préparée avec de l’eau de mer naturelle ou de l’eau de mer artificielle non contaminées. La salinité de l’eau de mer naturelle ou artificielle utilisée comme eau témoin/de dilution doit être de 30 ± 2 ‰. L’eau de mer naturelle non contaminée doit être filtrée, son pH ajusté au besoin et être stérilisée avant utilisation (voir la section 3.4 du présent protocole complémentaire et la section 4.2.3 de la norme ISO, 2010). Les instructions pour préparer l’eau de mer artificielle se trouvent à la section 5.0 dans Environnement Canada (2001). Le pH de l’eau de mer artificielle doit être ajusté au besoin et cette eau doit être stérilisée avant utilisation (voir la section 3.4 du présent protocole complémentaire et la section 4.2.2 de la norme ISO, 2010, pour obtenir des directives). Les solutions de nutriment doivent être ajoutées à l’eau de mer stérilisée naturelle ou artificielle conformément à la colonne B ou C, respectivement, du tableau 3 de la norme ISO (2010). Un lot donné d’eau de dilution (naturelle ou artificielle) ne devrait pas être utilisé plus de 14 jours après sa préparation, période pendant laquelle son contenant devrait être gardé fermé et son contenu protégé de la lumière (EC, 2001). Pendant une conservation prolongée (plus d’une journée), l’eau de mer naturelle ou artificielle préparée comme eau de dilution doit être réfrigérée (4 ± 2 °C) afin que la prolifération microbienne soit réduite au minimum (EC, 2001). Il faut faire en sorte que la température de l’eau témoin/de dilution soit à 22 ± 2 °C avant son utilisation pour préparer des solutions de l’essai.
4.2.2 Échantillon d’effluent
La salinité de l’échantillon d’effluent doit être ajustée, au besoin, pour être dans la plage exigée pour les essais (c.-à-d. 30 ± 2 ‰) conformément aux directives fournies dans Environnement Canada (2001), dès que possible après la réception de l’échantillon en laboratoire et avant la préparation des différentes concentrations. Un ajustement de la salinité avec des sels de mer secs est recommandé, car on peut ainsi réaliser l’essai avec cet effluent à 100 % (non dilué). De plus, la plupart des travaux de validation du présent protocole complémentaire ont été effectués à l’aide de ce type d’ajustement de salinité (voir note de bas de page 14). L’échantillon ne doit pas être chauffé à la température de l’essai avant l’ajustement de la salinité (EC, 2001). Après tout ajustement de la salinité, la température de l’échantillon doit être vérifiée et ajustée, au besoin, à 22 ± 2 °C avant le début de l’essai. On peut ajuster la température de l’échantillon et des solutions de l’essai à la température d’essai en les chauffant ou en les refroidissant dans un bain-marie, mais ils ne doivent pas être chauffés au moyen d’un thermoplongeur ou au micro-ondes. En général, la filtration des échantillons d’effluent n’est pas nécessaire. Si elle est jugée nécessaire pour atténuer toute interférence potentielle avec l’essai, la filtration doit être justifiée et constitue un écart par rapport à l’essai. Si on filtre, on doit effectuer des essais en parallèle avec des échantillons filtrés et non filtrésNote de bas de page 11.
Après tout ajustement de la température, le pH de l’échantillon d’effluent doit être vérifié. Au besoin, il faut ajuster le pH pour qu’il se situe entre 7,0 et 9,0 avec du HCl à 1 mol/L ou du NaOH à 1 mol/L.
Après un ajustement du pH, les nutriments (c.-à-d. azote, phosphore, fer et solutions de carbone) doivent être ajoutés à l’échantillon d’effluent selon les quantités de la colonne C du tableau 3 de la norme ISO (2010). L’échantillon d’effluent enrichi de nutriments est considéré comme présentant la concentration de 100 % dans le présent essaiNote de bas de page 12. Avant de préparer les solutions de l’essai, l’échantillon d’effluent enrichi de nutriments est légèrement aéré au préalable pendant 20 minutes à un débit ne dépassant pas 100 bulles/minuteNote de bas de page 13. Il est préférable que l’air comprimé sans huile soit distribué par une conduite d’air et un tube jetable en plastique ou en verre (p. ex., un tube capillaire ou une pipette à embout Eppendorf) muni d’une petite ouverture (p. ex., diamètre intérieur de 0,5 mm).
4.2.3 Concentrations de l’essai
Un minimum de sept concentrations, en plus d’un témoin de l’eau/de dilution, doivent faire partie de l’essai. Une série de dilution géométrique pertinente devrait être utilisée. Consulter la section 7.3 de la norme ISO (2010) pour obtenir des conseils sur le choix d’une série de concentrations. Un autre traitement témoin doit être préparé si la salinité de l’effluent est ajustée (c.-à-d. « témoin de sels » ou « témoin de saumure hautement concentrée »Note de bas de page 14), conformément aux directives d’Environnement Canada (2001). Chaque traitement, y compris le ou les témoins, doit être répété au moins quatre fois (quatre répétitions).
Les solutions de l’essai doivent être préparées le jour de leur utilisationNote de bas de page 15; se reporter à la section 7.2.3.2 de la norme ISO (2010). Chaque solution doit être bien mélangée. Pour un essai donné, la même eau témoin/de dilution stérilisée et enrichie en nutriments (milieu d’essai) doit être utilisée pour préparer les dilutions et le témoin de l’eau/de dilution. Toutes les solutions de l’essai doivent avoir une salinité entre 28 et 32 ‰ pendant l’essai (EC, 2001), mesurée dans les échantillons ayant une concentration représentative (voir la section 4.5).
4.3 Préparation des organismes aux fins de l’essai
De trois à quatre jours avant le début d’un essai, les gamétophytes femelles de Ceramium tenuicorne sont préparés en transférant de 20 à 30 boutures d’environ 10 à 15 mm de longueur dans un récipient propre contenant 25 mL de milieu de culture frais et stérile (voir les sections 3.3 et 3.4 du présent protocole complémentaire). Il s’agit du récipient dit « de collecte d’algues ». La norme ISO (2010) recommande de préparer 3 à 4 récipients de collecte d’algues par essai afin qu’un nombre suffisant d’organismes de taille uniforme soit obtenu (section 7.1 de la norme ISO, 2010). Cependant, l’expérience de recherche au Canada semble indiquer qu’il convient de préparer ≥ 5 récipients de collecte d’algues par essai afin d’accroître la probabilité d’obtenir des boutures de taille uniforme (AquaTox, 2022, 2023). Les récipients de collecte d’algues sont soumis à des conditions normales de culture, et les algues doivent sembler saines avant d’être utilisées dans la préparation de l’essai (voir la section 3 et l’annexe D du présent protocole complémentaire).
Le jour où l’essai doit commencer (c.-à-d. au jour 0), un nombre suffisant de boutures d’algue des récipients de collecte d’algues doivent être préparés. Chaque bouture utilisée pour amorcer un essai doit mesurer entre 0,6 et 1,8 mm et devrait mesurer entre 0,6 à 1,2 mm de longueur, et la mesure se prend de la première fourche après la base jusqu’à l’apex le plus éloigné (figure 3)Note de bas de page 16. Il faut un minimum de 64 à 72 boutures d’algue pour l’essai à plusieurs concentrations décrit dans le présent protocole complémentaire (≥ 7 concentrations plus un ou des témoins). Toutefois, il est recommandé d’en préparer plus pour obtenir un nombre suffisant d’organismes de taille et d’apparence similaires. La section 7.1 de la norme ISO (2010) précise qu’il faut couper des boutures du clone marin de C. tenuicorne ayant deux niveaux de fourche, comme le montre la figure 1a de la norme. Cependant, dans un laboratoire canadien, on a observé que la plupart des boutures du clone marin de C. tenuicorne n’avaient pas de deuxième niveau de fourche au début de l’essai (figure 4; AquaTox, 2022)Note de bas de page 17. Selon des recherches réalisées au Canada, on peut obtenir une croissance saine suffisante (y compris le développement de fourches) qui répond aux critères de validité chez les organismes témoins au cours de l’essai de 7 jours, que la bouture d’algue de départ ait zéro, une ou deux fourches (AquaTox, 2022). Par conséquent, bien qu’il soit recommandé de commencer avec deux fourches par bouture, dans le présent protocole complémentaire, il n’est pas exigé que chaque bouture ait deux fourches au début de l’essai.
Les fragments d’algues peuvent être coupés à la taille désirée au moyen d’un scalpel (ISO, 2010) ou de ciseaux miniatures (p. ex., microciseaux ouverts d’ExeltaMD, no 63042-032 dans le catalogue de VWR) et de pinces (p. ex., pinces à pointes très fines incurvées d’ExeltaMD, no 63042-976 dans le catalogue de VWR) (AquaTox, 2022). Les fragments d’algues devraient être coupés au microscope stéréoscopique (ISO, 2010). Les boutures coupées sont déposées dans une boîte de Petri contenant du milieu de culture stérile ou de l’eau de dilution dont la salinité est de 30 ± 2 ‰. Les boutures qui s’écartent le plus des critères devraient être éliminées (ISO, 2010). Les boutures décolorées (c.-à-d. jaunies ou translucides; voir l’annexe D) ou endommagées ne doivent pas être utilisées pour amorcer un essaiNote de bas de page 18.
La longueur de départ des boutures (≥ 20) d’un échantillon représentatif doit être mesurée et consignée avant le début de l’essai (voir la section 7.1 de la norme ISO [2010] et la section 4.4 du présent protocole complémentaire). Cette longueur initiale devrait être mesurée au microscope stéréoscopique à l’aide d’une feuille de papier millimétré que l’on glisse sous la boîte de Petri (ISO, 2010). Le recours à un micromètre de microscope muni de divisions (p. ex., aux 0,1 mm) et accompagné d’un certificat traçable au National Institute of Standards and Technology (NIST) permet de mesurer les algues de façon plus précise. Sinon, un oculaire peut également être fixé au microscope pour mesurer la longueur en micromètres. Ces longueurs sont ensuite converties en millimètres (AquaTox, 2022). Les boutures d’algue non utilisées dans l’échantillon représentatif peuvent être coupées de la même manière à l’aide d’une loupe plutôt qu’au microscope stéréoscopique, afin d’améliorer l’efficience de la préparation de l’essai (AquaTox, 2022).

Description longue
Deux boutures de macroalgues rouge-brun sur un fond jaune clair. Chaque bouture d’algue est accompagné d’une barre de mesure indiquant que l’algue mesure entre 0,6 et 1,2 mm du premier point de ramification à l’extrémité la plus éloignée.

Description longue
Une bouture de macroalgue rouge-brun dans une boîte de Pétri posée sur une règle. L’un des apex présente un deuxième niveau de ramification, c’est-à-dire une « fourche », mais l’autre apex est droit et ne présente pas de fourche.
4.4 Conditions d’essai
La durée de l’essai d’inhibition de la croissance de Ceramium tenuicorne est de 7 jours. Il s’agit d’un essai statique. Le renouvellement des solutions de l’essai n’est pas autorisé. On recommande comme boîte d’essai, des boîtes de Petri stériles, non contaminées en plastique ou en verre munies d’un couvercle, de 50 mm × 10 mm (ISO, 2010), mais les boîtes de Petri de 50 × 9 mm ou 50 × 15 mm sont aussi acceptablesNote de bas de page 19. Un volume mesuré identique de 10 mL de solution doit être ajouté à chaque boîte servant aux répétitions. Un minimum de quatre répétitions par traitement, y compris le ou les témoins, est exigé. Un minimum de sept concentrations d’essai, en plus du ou des témoins, est nécessaire.
Les essais sont amorcés par le transfert de deux boutures de gamétophytes femelles de clone marin de Ceramium tenuicorne dans chaque récipient d’essai préparée. Chaque bouture doit mesurer de 0,6 à 1,8 mm et devrait avoir une longueur de 0,6 à 1,2 mm entre le premier point de ramification à la base et l’apex le plus éloigné, et toutes les boutures utilisées dans un essai devraient avoir une taille et une apparence similaires (voir la section 4.3). Le transfert des boutures doit se faire aléatoirement et de façon informelle (par exemple, voir la section 7.4 de la norme ISO, 2010) et il faut prendre soin de ne pas contaminer les algues destinées à un essai lorsqu’on les transfère dans leur récipient. Chaque récipient d’essai doit porter un code ou une étiquette qui identifie clairement la matière examinée ou la substance et la concentration à l’étude, ainsi que la date et l’heure du début de l’essai. Les boutures doivent être complètement immergées dans la solution au début de l’essai et doivent rester submergées tout au long de ce dernier. Les traitements doivent être placés au hasard dans l’installation, et ce lieu devrait être modifié régulièrement pendant l’essai (c.-à-d. une fois par jour, de façon aléatoire).
L’essai doit être effectué à la température de 22 ± 2 °C. Les conditions d’éclairage suivantes sont requises pendant l’essai : tube fluorescent « lumière du jour » ou lumière « blanc chaud » ou lumière équivalente; une intensité lumineuse de 70 ± 7 µmol m-2 s-1 (voir la note de bas de page 4) à des points situés environ à la même distance de la source lumineuse que les organismes d’essai; photopériode de 14 h de lumière et de 10 h d’obscuritéNote de bas de page 20. Il ne faut pas aérer les solutions de l’essai pendant l’essai. L’essai prend fin après sept jours.
4.5 Observations et mesures
La couleur, la turbidité, l’odeur et les matières solides flottantes ou déposées dans les échantillons d’effluent devraient faire l’objet d’une observation et d’une consignation au début de l’essai, ainsi qu’avant et après la filtration, s’il y a lieu. L’apparence générale des échantillons et tout changement qui survient pendant la préparation des solutions d’essai devraient être consignés (p. ex., précipitations, floculation, changement de couleur ou d’odeur, rejet de composés volatils), ainsi que tout changement dans l’apparence des solutions d’essai observé pendant l’essai.
Les longueurs initiales (mm) d’un échantillon représentatif d’algues (≥20 organismes) doivent être mesurée et consignée au début de l’essai, comme il est décrit à la section 4.2 de ce protocole complémentaire, et utilisée pour calculer la longueur initiale moyenne. La longueur finale (mm) de chaque organisme d’essai à la fin de l’essai (au jour 7) doit être mesurée et consignée pour chaque répétition de chaque concentration d’essai et de chaque traitement témoin. La longueur des algues doit être mesurée du premier point de ramification à l’apex le plus éloigné. Les longueurs finales peuvent être mesurée au microscope stéréoscopique, et de papier millimétré que l’on glisse sous la boîte de Petri (ISO, 2010). La mesure de la longueur à la fin de l’essai au moyen de l’imagerie numérique (p. ex., ImageJ) est une autre technique acceptable. Toutefois, avant de prendre des mesures, la technique substitutive doit être validée en effectuant des essais en parallèle qui comparent les longueurs obtenues par imagerie numérique avec celles mesurées au microscope stéréoscopique, et l’on doit démontrer que cette technique fournit une mesure fiable et constante de la longueur des algues.
Les algues de chaque récipient de l’essai doivent faire l’objet d’une observation au début et à la fin de l’essai (au jour 0 et au jour 7), au minimum. Il convient d’observer l’apparence des organismes d’essai, notamment s’il y a décoloration (voir l’annexe D), fragmentation, changement dans l’apparence des bandes corticales ou des cellules axiales, absence de développement des « fourches », retard de croissance ou désintégration des « fourches » (figure 5), et d’en faire la consignation pour chaque récipient d’essai.

Description longue
(A) Une bouture de macroalgue rouge-brun dans une boîte de Pétri posée sur une règle. La macroalgue présente plusieurs niveaux de ramification et certains apex se terminent par des « fourches » incurvées tandis que d’autres ont des extrémités droites. Les bandes corticales sont espacées de façon relativement régulière.
(B) Une bouture de macroalgue rouge-brun dans une boîte de Pétri posée sur une règle. La macroalgue n’a qu’un seul niveau de ramification et les apex ont une croissance rabougrie; ils se désagrègent et se terminent brusquement. Il y a quelques petites branches adventives.
(C) Une bouture de macroalgue rouge-brun dans une boîte de Pétri posée sur une règle. Certaines cellules axiales sont gonflées et de couleur plus foncée que les autres. Plusieurs branches adventives poussent à partir du thalle.
La température doit être surveillée tout au long de l’essai. Au minimum, la température doit être mesurée et consignée tous les jours de l’essai. Des récipients d’essai supplémentaires peuvent être préparés pour mesurer la température de l’eau pendant l’essai. Si les relevés de température sont fondés sur des mesures autres que celles des récipients d’essai (p. ex., dans un incubateur ou une enceinte à température contrôlée à proximité des récipients d’essai), il faut établir la relation entre ces lectures et la température à l’intérieur des récipients. Les enregistrements en continu ou les mesures quotidiennes des températures maximale et minimale sont des options acceptables.
La salinité, la température, le pH et l’oxygène dissous (en mg/L et en pourcentage de saturation) doivent être mesurés et consignés au début et à la fin de l’essai au minimum pour les concentrations faible, moyenne et élevée, ainsi que pour le ou les témoins. Une fois que les observations biologiques sont terminées, il convient d’évaluer à l’aide de mesures des solutions fraîchement préparées au début de l’essai et des échantillons des solutions d’essai utilisées que l’on a regroupées pour réaliser les répétitions de chaque traitement à la fin de l’essai.
Le débit de fluence de la lumière (intensité lumineuse) doit être mesuré au moins une fois pendant l’essai à des points situés environ à la même distance de la source lumineuse que les organismes d’essai et à plusieurs endroits de la zone de l’essai. Toutefois, il est recommandé de mesurer quotidiennement l’intensité lumineuse (AquaTox, 2022).
4.6 Calculs et résultats de l’essai
Le paramètre biologique mesuré de l’essai est l’inhibition de la croissance des algues exposées à l’effluent. On détermine l’augmentation de la longueur de l’algue par jour (µ), qui est le taux de croissance calculé conformément à l’équation 1Note de bas de page 21. Pour chaque concentration d’essai, y compris le ou les témoins, il faut calculer l’augmentation moyenne (± écart-type [ÉT]) de la longueur des algues par jour (μ) à la fin de l’essai (section 9 de la norme ISO, 2010). Le coefficient de variation (CV = 100 × écart-type/moyenne) de l’augmentation de la longueur des algues par jour (μ) pour chaque traitement témoin doit être calculé (voir l’annexe B), et devrait être ≤ 30 % (voir la note de bas de page 26). Les récipients dont des boutures d’algue ont été retirées accidentellement ou qui ont collées et séchées sur le côté du récipient durant l’essai devraient être éliminées de l’essai et la répétition correspondante devrait être exclue des calculs. Conformément aux pratiques exemplaires en matière d’évaluation des valeurs aberrantes (voir la section 4.6), tout récipient exclue du calcul doit être consigné dans le rapport de l’essai.
µ= (L7 – L0)/(t7 – t0) [Équation 1]
où :
µ = augmentation de la longueur par jour (c.-à-d. taux de croissance)
L0 = longueur initiale moyenne de l’organisme d’après l’échantillon représentatif au jour 0 (mm)
L7 = longueur finale de chaque organisme dans chaque répétition au jour 7 (mm)
t0 = jour 0
t7 = jour 7
Pour tout essai de toxicité qui comprend un témoin de sels ou un témoin de saumure hautement concentrée en plus d’un témoin de dilution (voir la section 4.2.3 de ce protocole complémentaire), et pour lequel les réponses des deux traitements témoins ont satisfait aux critères de validité (voir la section 4.7 du présent protocole complémentaire), les résultats des deux séries de solutions témoins doivent être regroupés avant le calcul de tout résultat statistique (c.-à-d. CI25) nécessitant une comparaison des observations de chaque ensemble de concentrations d’essai par rapport à celles des solutions témoins (EC, 2001). S’il n’y a pas de chevauchement entre la fourchette du taux de croissance des deux séries témoins, il faut le noter dans le rapport de l’essaiNote de bas de page 22.
Aux fins des essais de toxicité sublétale prescrits dans les règlements canadiens, l’Iµi ainsi que les calculs et les interprétations décrits aux sections 9.2 à 9.4 de la norme ISO (2010) ne sont pas exigés. Il faut plutôt harmoniser les calculs fondés sur des observations quantitatives de la croissance des algues avec ceux d’autres méthodes normalisées d’ECCC.
Le paramètre statistique exigé pour les données sur la croissance est la concentration inhibitrice provoquant 25 % d’effet (CI25)Note de bas de page 23 et les limites de l’intervalle de confiance à 95 % (c.-à-d. une réduction de 25 % de l’augmentation de la longueur par jour [µ]). Pour le calcul de la CI25 et de ses limites de l’intervalle de confiance, les mesures quantitatives sont utilisées directement. Dans le présent essai, les données d’entrée doivent être l’augmentation moyenne de la longueur par jour (µ) pour chaque répétition. ECCC (2005) fournit des directives et des conseils pour le calcul de la CIp, dont des organigrammes de décision pour orienter le choix des tests statistiques adaptés. Tous les tests statistiques utilisés pour obtenir les résultats exigent que les concentrations soient entrées sous forme de logarithmes.
Il est recommandé de tracer un premier graphique à l’aide des données brutes sur l’augmentation de la longueur en fonction du logarithme de la concentration, tant pour obtenir une représentation visuelle des données que pour vérifier la valeur des résultats par rapport à ceux obtenus avec calculs statistiques ultérieurs. Toute disparité majeure entre la CI25 approximative obtenue par graphique et la CI25 estimée numériquement ultérieurement doit être corrigée. Le graphique montre également si une relation logique existe entre la concentration logarithmique (ou, dans certains cas, la concentration) et l’effet, une caractéristique souhaitable d’un essai valide (EC, 2005).
L’analyse de régression est la principale technique statistique et doit être utilisée pour le calcul de la CI25, à condition que les hypothèses ci-dessous soient respectées. On dispose d’un certain nombre de modèles pour évaluer les données sur la croissance (à l’aide d’un test statistique quantitatif) par régression linéaire ou non linéaire. Le recours à des techniques de régression exige que les données respectent les hypothèses de normalité et d’homoscédasticité. Des techniques de pondération peuvent être appliquées pour obtenir l’hypothèse d’homoscédasticité. On recherche également les valeurs aberrantes dans les données au moyen de l’une des techniques recommandées (voir la section 10.2 dans EC, 2005). Toute analyse statistique réalisée sans valeurs aberrantes devrait également être effectuée avec celles-ci. Toutes les valeurs aberrantes et la justification de leur élimination doivent être consignées dans le rapport d’essai. Enfin, il faut choisir le modèle le mieux adaptéNote de bas de page 24 en considérant celui qui est le plus adapté pour obtenir la CI25 et les limites d’intervalle de confiance à 95 % correspondantes. Les résultats obtenus par analyse de régression doivent se situer dans l’intervalle des concentrations d’essai; L’extrapolation des résultats au-delà de la concentration d’essai maximale n’est pas une pratique acceptable.
La capacité de décrire mathématiquement l’hormèse (c.-à-d. une réponse stimulante ou « meilleure que le témoin » qui ne se produit qu’à de faibles concentrations d’exposition) dans la courbe dose-réponse a été intégrée aux modèles de régression pour les données quantitatives (voir la section 10.3 dans EC, 2005). Les données présentant une hormèse peuvent être saisies directement, car le modèle peut prendre en compte et intégrer tous les points de données; il n’y a aucune élimination de points de données qui indique un effet hormétique.
Dans le cas où les données ne se prêtent pas à une analyse de régression (parce que les hypothèses de normalité et d’homoscédasticité ne peuvent être satisfaites), on peut se servir de l’interpolation linéaire (p. ex. programme ICPIN; voir la section 6.4.3 dans EC, 2005) pour estimer une CI25.
Un effet stimulant (réponse accrue à toutes les concentrations ou à des concentrations élevées) doit être
consignée dans le rapport d’essai pour toutes les concentrations pour lesquelles une stimulation importante a été observée. Si un effet stimulant a été observé, il faut faire une comparaison statistique avec un ou des témoins par analyse ANOVA, suivie d’une comparaison binaire pertinente avec un ou des témoins (voir les sections 3.3 et 7.5 dans EC, 2005)Note de bas de page 25. Cette analyse permettra de déterminer les concentrations présentant un effet stimulant qui diffère considérablement de l’effet du ou des témoins. Le pourcentage de stimulation de ces concentrations doit être consignée dans le rapport d’essai comme un résultat de l’essai, et se calculer comme suit (EC, 2007a) :
S(%) = (T – C)/C × 100 [Équation 2]
où :
S (%) = pourcentage de stimulation
T = augmentation moyenne de la longueur par jour à la fin de l’essai (µ) à la concentration d’essai (mm)
C = augmentation moyenne de la longueur par jour à la fin de l’essai (µ) du ou des témoins(mm)
4.7 Critères de validité de l’essai
Aux fins des essais de toxicité sublétale exigés dans les règlements canadiens, les deux critères suivantsNote de bas de page 26 doivent être remplis pour chaque série de témoin ou témoins à la fin d’un essai afin que ce dernier soit valide :
i) l’augmentation moyenne de la longueur en 7 jours du témoin doit être plus de 3 fois la longueur de départ (équation 3; voir l’annexe A pour un exemple de calcul);
Facteur d'augmentation = (L7,C – L0,C)/L0,C [Équation 3]
où :
Facteur d’augmentation = augmentation moyenne de la longueur des organismes témoins après 7 jours
L0,C = longueur de départ moyenne des organismes témoins dans l’échantillon représentatif au jour 0 (mm)
L7,C = longueur moyenne à la fin de l’essai des organismes témoins au jour 7 (mm)
ii) le pH final de l’échantillon qui regroupe les répétitions du témoin doit être entre 6,5 et 9,5 (inclusivement).
4.8 Essais avec une substance toxique de référence
Une substance toxique de référence doit être utilisée pour évaluer la sensibilité relative de la culture de C. tenuicorne dans l’essai de toxicité, ainsi que la précision et la fiabilité des données produites par le laboratoire pour cette substance dans des conditions d’essai normalisées, ainsi que la compétence technique du personnel de laboratoire qui effectue l’essai (EC, 1990).
La ou les substances chimiques de référence choisies doivent être évaluées dans le cadre d’un essai à plusieurs concentrations qui doit commencer dans les 14 jours précédant ou suivant la date du début de l’essai de toxicité mené avec des cultures bien établies du laboratoire et après l’acclimatation d’un nouveau lot de C. tenuicorne. Les instructions et les conditions à suivre sont identiques à celles de la section 4 du présent document et sont décrites dans EC (1990), sauf que des aliquotes d’une substance chimique de référence sont ajoutées à de l’eau de dilution et analysées au lieu d’un effluent. L’eau témoin/de dilution (milieu d’essai) utilisée couramment dans les essais menés sur un effluent doit également servir à l’essai de toxicité réalisé avec la substance de référence (voir la section 4.2).
Il est recommandé d’utiliser le sulfate de zinc de qualité « réactif » (ZnSO4·7H2O) comme substance toxique de référence pour cet essai d’après l’expérience du laboratoire canadien (ISO, 2010; AquaTox, 2022, 2023; Nautilus Environmental, 2024; voir l’annexe C). Les solutions mères de sulfate de zinc devraient être préparées le jour même. Le 3,5-dichlorophénol de qualité « réactif » est également une substance toxique de référence qui convient (ISO, 2010). La CI25 au jour 7 devrait être calculée pour la substance toxique de référence utilisée. La concentration de zinc devrait être exprimée en µg Zn++/L. La concentration de 3,5-dichlorophénol devrait être exprimée en mg de 3,5-dichlorophénol/L. Les résultats de plusieurs essais de toxicité de référence effectués dans un laboratoire canadien avec du sulfate de zinc sont fournis à titre de référence à l’annexe C.
La concentration de la substance toxique de référence dans toutes les solutions mères devrait être mesurée chimiquement à l’aide de la méthode pertinente (APHA et coll., 2023). Lors de la préparation des solutions d’essai, on devrait prélever les aliquotes au minimum dans les témoins et les solutions à la concentration faible, moyenne et élevée, et les analyser directement ou les conserver aux fins d’analyse future si la CI25 est atypique (c.-à-d. au-delà des limites d’avertissement). Les solutions de zinc devraient être stabilisées (APHA et coll., 2023) avant leur conservation. Si elles sont stockées, les aliquotes des échantillons doivent être conservées à l’obscurité à 4 ± 2 °C. Les aliquotes stockées que l’on doit mesurer chimiquement devraient être analysées rapidement à la fin de l’essai de toxicité. Il est souhaitable, mais non obligatoire, de mesurer la concentration des mêmes solutions à la fin de l’essai. Les calculs de la CI25 devraient être fondés sur les concentrations mesurées si elles sont sensiblement (c.-à-d. ≥ 20 %) différentes des concentrations nominales et si l’exactitude de l’analyse chimique est satisfaisante.
Une fois que l’on a obtenu suffisamment de données (c.-à-d. au moins cinq points de données) (EC, 1990, 2005), une carte de contrôle qui représente graphiquement les valeurs de la CI25 doit être préparée et continuellement actualisée, avec chaque nouvel essai de toxicité avec la substance de référence. La carte de contrôle devrait représenter le logarithme de la concentration sur l’axe des Y en fonction de la date de l’essai ou du numéro de l’essai sur l’axe des X. On devrait comparer chaque nouvelle CI25 de la substance toxique de référence aux limites d’avertissement établies précédemment. La CI25 est acceptable si elle se situe à l’intérieur des limites d’avertissement (± 2 ÉT). Tous les calculs de la moyenne et de l’écart-type doivent être effectués avec le logarithme de CI25. Ainsi, on continue d’adhérer à l’hypothèse selon laquelle chaque CI25 a été estimée en fonction du logarithme des concentrations. La moyenne du logarithme de CI25, ainsi que ses limites supérieure et inférieure d’avertissement (± 2 ÉT), calculées à l’aide des valeurs disponibles du logarithme de CI25, sont recalculées avec chaque CI25 subséquent (EC, 1990, 2005). Si l’essai est effectué fréquemment, les 20 points de la substance toxique de référence les plus récents pourraient servir à calculer les moyennes et les limites d’avertissement.
La carte de contrôle peut être construite en traçant simplement le graphique de la moyenne ± 2 ÉT sous la forme d’un logarithme ou, si vous le souhaitez, en les convertissant en valeurs arithmétiques et en traçant CI25 ± 2 ÉT sur une échelle logarithmique de concentration. Différentes méthodes d’élaboration d’une carte de contrôle (p. ex., Levey-Jennings, moyenne mobile) sont acceptables. Les cartes de contrôle peuvent être utilisées pour détecter des tendances au fil du temps. Parmi les exemples de tendances qui pourraient être observées, citons une tendance à la hausse ou à la baisse, plusieurs points successifs d’un côté de la moyenne, des variations observées à différents moments de l’année et des valeurs de CI25 successives hors des limites d’avertissement ± 2 ÉT.
Si une CI25 particulière dépasse les limites d’avertissement, la sensibilité de la culture de C. tenuicorne ainsi que le rendement et la précision de l’essai sont à questionner. Comme cela peut se produire dans 5 % des cas en raison du hasard uniquement, une valeur aberrante ne signifie pas nécessairement que la sensibilité de la culture de C. tenuicorne ou la précision des données de toxicité produites par le laboratoire est remise en question. Il s’agit plutôt d’un avertissement que cela pourrait être le cas. Une vérification approfondie de toutes les cultures et des conditions d’essai, ainsi que des compétences techniques, est nécessaire à ce stade.
Les résultats d’essai qui se situent habituellement dans les limites d’avertissement n’indiquent pas nécessairement qu’un laboratoire produit des résultats cohérents. Un laboratoire qui a produit des données extrêmement variables pour une substance toxique de référence présente des limites d’avertissement très larges. Un nouveau point de référence pourrait se trouver à l’intérieur des limites d’avertissement, mais représenter tout de même une variation indésirable dans les résultats obtenus lors de l’essai. Pour obtenir des renseignements sur la variation raisonnable qu’il pourrait y avoir dans les données sur les substances toxiques de référence (c.-à-d. les limites d’avertissement d’une carte de contrôle), consultez la section 2.8.1 et l’annexe F d’EC (2005).
Si une CI25 dépassait les limites du témoin (moyenne ± 3 ÉT), il serait très probable qu’on ne peut accepter l’essai et qu’il devrait être répété, et tous les éléments de l’essai devraient être examinés attentivement. Si les résultats se situent entre les limites du témoin et les limites d’avertissement dans plus de 5 % des cas, il s’agirait d’une indication de la détérioration de la précision, et encore une fois, il conviendrait de répéter l’essai le plus récent et d’examiner minutieusement les instructions, les conditions et les calculs.
5.0 Exigences minimales pour le rapport d’essai
Les rapports d’essai doivent comprendre toutes les exigences suivantes, lesquelles remplacent les exigences de production de rapport énumérées dans la norme ISO (2010).
Dans chaque rapport d’essai, il faut indiquer s’il y a eu un écart par rapport à l’une ou l’autre des exigences décrites dans la protocole complémentaire d’ECCC et les sections citées de la norme ISO (2010) et, le cas échéant, fournir des détails sur cet écart. Le lecteur doit être en mesure d’établir, à partir du rapport de l’essai, si les instructions et les conditions précédant et pendant l’essai ont fait en sorte que les résultats soient valides et acceptables pour l’utilisation prévue.
Voici la liste des renseignements qui doivent figurer dans le rapport de l’essai.
5.1 Échantillon d’effluent
- description du type d’effluent (p. ex., effluent de procédé, effluent final, etc.), et s’il a été remis au personnel de laboratoire, le cas échéant;
- renseignements sur l’étiquette ou code de l’échantillon;
- date et heure du prélèvement de l’échantillon; date et heure de réception de l’échantillon à l’installation d’essai;
- température et salinité mesurées de l’échantillon à sa réception à l’installation d’essai; et
- température et salinité de l’échantillon, juste avant sa préparation et son utilisation dans l’essai de toxicité.
5.2 Organismes d’essai
- espèce, clone, sexe et source de la culture; origine et numéro de souche de la culture, s’il est connu;
- indication quant à savoir si la culture utilisée est axénique;
- taille et fragment des organismes utilisés pour amorcer l’essai;
- milieu de croissance utilisé pour la culture; et
- apparence ou traitement inhabituel de la culture avant son utilisation dans l’essai.
5.3 Installations et appareillage expérimentaux
- nom et adresse du laboratoire réalisant l’essai;
- nom de la ou des personnes qui réalisent l’essai; et
- brève description des récipients utilisés pour l’essai (taille, type de matériau, spécifications relatives à la stérilité).
5.4 Eau témoin/de dilution
- type(s) et source(s) de l’eau utilisée comme eau témoin et eau de dilution; et
- type et quantité de la ou des substances chimiques ajoutées à l’eau témoin ou à l’eau de dilution.
5.5 Méthode d’essai
- les noms des méthodes d’essai biologique utilisées (p. ex. conformément à la norme ISO 10710:2010 « Qualité de l’eau – Essai d’inhibition de croissance sur la macro algue d’eaux marine et saumâtre Ceramium tenuicorne » et le protocole complémentaire d’ECCC)
- brève description de la ou des marches à suivre si l’échantillon a été filtré ou le pH a été ajusté;
- brève description de la ou des marches à suivre, des produits utilisés et de la durée de la conservation pour tout ajustement de salinité de l’échantillon et de l’eau témoin/de dilution, le cas échéant; déclaration selon laquelle les directives d’Environnement Canada sur l’ajustement de la salinité ont été suivies;
- brève description de la fréquence et du type d’observations et de mesures effectuées pendant l’essai;
- nom et référence du ou des programmes et des méthodes utilisés pour l’analyse par imagerie numérique, s’il y a lieu; et
- nom et référence du ou des programmes et des méthodes utilisés pour calculer les résultats statistiques.
5.6 Conditions expérimentales et modes opératoires
- type d’essai (essai statique de 7 jours);
- plan et description de tout écart par rapport à l’une ou l’autre des marches à suivre ou aux conditions du présent protocole complémentaire d’ECCC et des sections citées de la norme ISO (2010) ou toute élimination de celles-ci;
- longueurs individuelles d’au moins 20 organismes représentatifs au début de l’essai (jour 0) et la longueur initiale moyenne calculée;
- nombre et concentration des solutions d’essai, y compris le ou les témoins;
- nombre de répétitions par traitement, y compris le ou les témoins;
- volume de solution dans chaque récipient d’essai;
- nombre d’organismes dans chaque récipient d’essai;
- bref énoncé (notamment sur les instructions, le débit et la durée) de toute aération préalable de l’échantillon ou des solutions de l’essai avant le début de ce dernier;
- type et quantité de substance chimique ajoutée à l’échantillon avant le début de l’essai (c.-à-d. ajout de nutriments);
- toutes les mesures requises (voir la section 4.3) de température, de salinité, de pH et d’oxygène dissous dans les solutions d’essai, y compris le ou les témoins, ainsi que celles du débit de fluence de la lumière effectuées pendant l’essai;
- date et heure du début et de la fin de l’essai; et
- brève déclaration indiquant si l’essai de toxicité avec la substance de référence a été effectué dans les mêmes conditions expérimentales que celles utilisées avec le ou les échantillons d’essai, et description de tout écart par rapport aux instructions et aux conditions précisées dans l’essai de toxicité de référence du présent protocole complémentaire ou toute exclusion de celles-ci.
5.7 Résultats de l’essai
- toute observation de l’apparence de l’organisme dans chaque récipient d’essai au début et à la fin de l’essai;
- longueur finale de chaque organisme dans chaque récipient d’essai à la fin de l’essai (jour 7);
- augmentation moyenne (± ÉT) de la longueur des algues par jour (taux de croissance, µ) pour chaque concentration, y compris le ou les témoins, à la fin de l’essai;
- toute CIp et ses limites de l’intervalle de confiance à 95 % pour le pourcentage d’inhibition de croissance et indication de la méthode quantitative utilisée; détails sur toute transformation des données qui était requise;
- valeurs aberrantes ou récipients exclues du calcul des résultats et justification de leur retrait;
- facteur d’augmentation moyen à la fin de l’essai pour chaque traitement témoin;
- toute constatation d’une stimulation importante de la croissance, exprimée en % de stimulation, à n’importe quelle concentration;
- CIp et limites de l’intervalle de confiance à 95 % pour tout essai de toxicité avec le ou les substances toxiques de référence qui a commencé dans les 14 jours suivant le début de l’essai, et valeur moyenne géométrique (± 2 ÉT) pour la ou les mêmes substances toxiques de référence estimées à l’installation lors des essais précédents; et
- toute anomalie dans le déroulement de l’essai, tout problème observé et toute mesure corrective.
Références
APHA, AWWA, et WEF (American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed., Lipps, W.C., Braun-Howland, E.B., Baxter, T.E. (eds.), Washington (DC).
Apogee Instruments Inc. 2016a. In-Depth Look at PAR/Quantum Meters. YouTube, téléchargé sur Apogee Instruments Inc., 27 janvier 2016,
Apogee Instruments Inc. 2016b. Why Do I Need a PAR/Quantum Meter? YouTube, téléchargé sur Apogee Instruments Inc., 27 janvier 2016.
AquaTox (AquaTox Testing and Consulting Inc.). 2022. Culturing and Reference Toxicant Testing with Ceramium tenuicorne at a Canadian Commercial Laboratory: Final Report, rapport préparé pour Environnement et Changement climatique Canada. 57 p.
AquaTox. 2023. Testing Effluent Samples from Canadian Pulp and Paper Mills with Ceramium tenuicorne at a Canadian Commercial Laboratory: Final Report, rapport préparé pour Environnement et Changement climatique Canada. 89 p.
ASTM (American Society of Testing and Materials). 2022. Standard Guide for Use of Lighting in Laboratory Testing, ASTM E1733-22, ASTM, Philadelphie (Pennsylvanie). 15 p.
Bruno, E., and Eklund, B. 2003. Two New Growth Inhibition Tests with the Filamentous Algae Ceramium strictum and C. tenuicorne (Rhodophyta), Environmental Pollution, 125:287–293.
Cho, T.O., Boo, S.M., et Hansen, G.I. 2001. Structure and reproduction of the genus Ceramium (Ceramiales, Rhodophyta) from Oregon, USA, Phycologia, 40(6):547-571.
Cotelle, S., Masfaraud, J.-F., Curie, T., et Lafay, L. 2025. A proposal for new genotoxic and cytotoxic endpoints to assess chemical effects on the red algae Ceramium tenuicorne, Environmental Science and Pollution Research, 32:3386-3392.
Dixon, P.S. 1960. Studies on Marine Algae of the British Isles: The Genus Ceramium, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 39:331–374.
EC (Environnement Canada). 1990. Document d’orientation sur le contrôle de la précision des essais de toxicité au moyen de produits toxiques de référence, Environnement Canada, Ottawa (Ontario), Rapport SPE 1/RM/12. 95 p.
EC (Environnement Canada). 1999. Procédure recommandée pour l’importation d’organismes destinés à des essais de toxicité sublétale, Environnement Canada, Ottawa (Ontario). 24 p.
EC (Environnement Canada). 2001. Procédure révisée pour l’ajustement de la salinité d’échantillons d’effluent soumis à un essai de toxicité sublétale en milieu marin conduit dans le cadre des programmes d’étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE), Environnement Canada, Ottawa (Ontario). 10 p.
EC (Environnement Canada). 2005. Document d’orientation sur les méthodes statistiques applicables aux essais d’écotoxicité, Rapport SPE 1/RM/46 (contient les modifications de juin 2007), Environnement Canada, Ottawa (Ontario). 263 p.
EC (Environnement Canada). 2007a. Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce, Rapport SPE 1/RM/25, 2e édition, Environnement Canada, Ottawa (Ontario). 80 p.
EC (Environnement Canada). 2007b. Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante macroscopique dulcicole Lemna minor, Rapport SPE 1/RM/37, 2e édition, Environnement Canada, Ottawa (Ontario), 140 p.
EC (Environnement Canada). 2011. Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins verts et oursins plats), 2e édition, Environnement Canada, Ottawa (Ontario), Rapport SPE 1/RM/27. 152 p.
ECCC (Environnement et Changement climatique Canada). 2017. Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l’aide de l’épinoche à trois épines, 2e édition, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa (Ontario), Rapport SPE 1/RM/10. 62 p.
ECCC (Environnement et Changement climatique Canada). 2019. Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa (Ontario), Rapport DGST 1/RM/60. 70 p.
ECCC (Environnement et Changement climatique Canada). 2020. Fact Sheet on Ceramium tenuicorne, préparé par l’Unité de l’élaboration et de l’application des méthodes, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa (Ontario). 6 p. (En anglais seulement)
Eklund, B. 1998. Reproductive Performance and Growth Response of the Red Alga Ceramium strictum Under the Impact of Phenol, Marine Ecology Progress Series, 167:119–126.
Eklund, B. 2005. Development of a Growth Inhibition Test with the Marine and Brackish Water Red Alga Ceramium tenuicorne, Marine Pollution Bulletin, 50:921–930.
Garbary, D.J., et McDonald, A.R. 1996. Fluorescent Labelling of the Cytoskeleton in Ceramium strictum (Rhodophyta), Journal of Phycology, 32:85-93.
Gabrielsen, T.M., Brochmann, C., and Rueness, J. 2003. Phylogeny and Interfertility of North Atlantic Populations of ‘Ceramium strictum’ (Ceramiales, Rhodophyta): How Many Species?, European Journal of Phycology, 38(1):1–13.
ISO (Organisation internationale de normalisation). 2010. Qualité de l’eau — Essai d’inhibition de croissance sur la macro algue d’eaux marine et saumâtre Ceramium tenuicorne, Genève (Suisse), ISO 10710. 24 p.
Johnsen, S. 2012. The Optics of Life: A Biologist’s Guide to Light in Nature, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. pp. 1–289.
Macken, A., Byrne, H.J., and Thomas, K.V. 2012. Effects of Salinity on the Toxicity of Ionic Silver and Ag-PVP Nanoparticles to Tisbe battagliai and Ceramium tenuicorne, Ecotoxicology and Environmental Safety, 86:101–110.
Martinko, C. 2024. Analysis of Control Growth Rates in Effluent Tests Using Ceramium tenuicorne, rapport préparé pour Environnement et Changement climatique Canada. 4 p.
Martinko, C., Van der Vliet, V., Gallant, M., Costantini, S., Glasner Regis, C., Sobaszek, A., Chanes, V., Pajnic, N., Cochrane, P., and Taylor, L.N. 2023, October 1-4. Canadian Adaptation of the Ceramium tenuicorne ISO 10710 Standard and Preliminary Evaluation Using Pulp and Paper Mill Effluent [présentation d’un colloque], Canadian Ecotoxicity Workshop – 49e rencontre annuelle, Ottawa (Ontario).
Nautilus Environmental. 2024. Testing Effluent Samples from Canadian Pulp and Paper Mills and Metal Mines with Ceramium tenuicorne at a Canadian Commercial Laboratory, rapport préparé pour Environnement et Changement climatique Canada. 107 p.
Rueness, J. 1973. Culture and Field Observations on Growth and Reproduction of Ceramium strictum Harv. from the Oslofjord, Norway, Norwegian Journal of Botany, 20:61–65.
Rueness, J. 1978. Hybridization in red algae. In: Modern Approaches to the Taxonomy of Red and Brown Algae, Irvine, D.E.G., and Price, J.H. (eds.), Academic Press, Londres, p. 247–262.
Sloan, N.A., et Bartier, P.M. 2000. Living Marine Legacy of Gwaii Haanas. I: Marine Plant Baseline to 1999 and Plant-Related Management Issues. Parcs Canada Rapports techniques en matière de sciences des écosystèmes, Rapport 027, Reine-Charlotte (Colombie-Britannique). 114 p. (En anglais seulement)
Ytreberg, E., Karlsson, J., Ndungu, K., Hasselöv, M., Breitbarth, E., and Eklund, B. 2011. Influence of Salinity and Organic Matter on the Toxicity of Cu to a Brackish Water and Marine Clone of the Red Macroalga Ceramium tenuicorne, Ecotoxicology and Environmental Safety, 74:636–642.
Annexe A : Exemple de calcul du facteur d’augmentation moyen du témoin
Le tableau A.1 présente un exemple de calcul du facteur d’augmentation du traitement par l’eau témoin/de dilution à la fin de l’essai, à l’aide des données d’un laboratoire canadien et du présent protocole complémentaire (AquaTox, 2023). L’équation 3 (section 4.7) est utilisée pour calculer le facteur d’augmentation moyen. Dans cet exemple, le facteur d’augmentation moyen de la longueur des algues dans le traitement par l’eau témoin/de dilution après 7 jours était de 24,76. Cette valeur est supérieure à 3 et répond donc à ce critère de validité (voir la section 4.7 du présent protocole complémentaire et la section 8 de la norme ISO [2010]).
| Répétition | Organisme | Longueur initiale moyenne (L0,C) (mm) | Longueur finale (mm) | Longueur finale moyenne (L7,C) (mm) | Facteur d’augmentation à la fin de l’essai du traitement témoin |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0,88 | 22,86 | 22,67 | Facteur d’augmentation = 24,76 |
| 2 | 23,73 | ||||
| B | 1 | 22,46 | |||
| 2 | 23,17 | ||||
| C | 1 | 20,71 | |||
| 2 | 21,50 | ||||
| D | 1 | 24,72 | |||
| 2 | 22,24 |
Annexe B : Exemple de calcul du taux de croissance et du coefficient de variation du témoin
Exemple de calcul de l’augmentation moyenne de la longueur par jour (µ; voir l’équation 1 à la section 4.6) et du coefficient de variation (CV = 100 × écart-type/moyenne) du traitement par l’eau témoin/de dilution, à l’aide des données d’un laboratoire canadien et le présent protocole complémentaire (AquaTox, 2023). Le CV du taux de croissance des témoins est ≤ 30 %, ce qui est conforme à la recommandation formulée à la section 4.6 du présent protocole complémentaire.
| Répétition | Organisme | Longueur initiale moyenne (L0) (mm) | Longueur finale (mm) |
Longueur finale moyenne de la répétition (L7) (mm) | Augmentation moyenne de la longueur par jour - répétition (µ) (mm/jour) |
Augmentation moyenne de la longueur par jour - traitement (µ) (mm/jour) |
Écart-type de µ (mm/jour) |
Coefficient de variation de µ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0,88 | 22,86 | 23,30 | 3,20 | 3,11 | 0,15 | 5,0 |
| 2 | 23,73 | |||||||
| B | 1 | 22,46 | 22,82 | 3,13 | ||||
| 2 | 23,17 | |||||||
| C | 1 | 20,71 | 21,10 | 2,89 | ||||
| 2 | 21,50 | |||||||
| D | 1 | 24,72 | 23,48 | 3,23 | ||||
| 2 | 22,24 |
Annexe C : Résultats des essais de toxicité menés avec la substance de référence qu’est le sulfate de zinc d’un laboratoire canadien
| Numéro de l’essai | IC25 μg Zn++/L |
IC25 mg ZnSO4·7H2O/L |
Coefficient de variation (%) des taux de croissance du témoin |
|---|---|---|---|
| 1 | 19,3 | 0,085 | 5,0 |
| 2 | 26,3 | 0,116 | 15,6 |
| 3 | 11,7 | 0,051 | 9,3 |
| 4 | 15,8 | 0,070 | 9,8 |
| 5 | 38,8 | 0,171 | 6,8 |
| 6 | 19,0 | 0,084 | 22,7 |
| 7 | 17,9 | 0,079 | 7,6 |
| 8 | 14,8 | 0,065 | 4,2 |
| 9 | 22,6 | 0,100 | 2,4 |
| 10 | 29,3 | 0,129 | 2,1 |
| 11 | 52,9 | 0,233 | 6,2 |
| Moyenne ± ÉT | 24,4 ± 12,1 | 0,108 ± 0,054 | 6,9 ± 4,0 |
* Le laboratoire a également calculé la CI50 pour les essais 1 à 5, et les résultats sont les suivants : 37,0, 85,3, 40,9, 65,5 et 83,6 μg Zn++/L, qui est équivalent à 0,163, 0,375, 0,180, 0,288 et 0,368 mg de ZnSO4·7H2O/L, dans les essais 1, 2, 3, 4, et 5, respectivement.
Annexe D : Santé, détermination du sexe et décoloration de la culture
Dixon (1960) et Cho et coll. (2001) décrivent la structure du genre Ceramium. La culture de gamétophytes femelles de Ceramium tenuicorne utilisée pour la validation de la méthode et déposée à la banque de culture du NCMA provenait de l’Université d’Oslo, où elle avait été maintenue en culture depuis les années 1970 (Rueness, 1973); l’espèce et le sexe de la culture ont été confirmés par feu Stein Fredriksen. Afin de déterminer le sexe de Ceramium pour des cultures provenait d’une source différente, il est nécessaire d’examiner les structures sexuelles. Chez les mâles, les spermaties sont libérées du spermatange, qui sont des structures rondes et incolores couvrant chaque bande corticale. Les mâles peuvent également avoir des poils unicellulaires, longs et fins (figure D.1). Les femelles développent des structures qui peuvent être plus difficiles à identifier : i) les procarpes qui sont un regroupement de quatre cellules et une structure allongée appelée trichogyne, qui est le récepteur d’une spermatie mâle. ii) après la fécondation, la femelle développera des cystocarpes (figure D.2). Les cystocarpes produisent des carpospores qui se transforment en tétrasporophytes (Dixon, 1960; Eklund, 1998, voir la figure 1; Cho et coll., 2001; S. Fredriksen, Université d’Oslo, communication personnelle, 2021). En l’absence de structures sexuelles, il est impossible de distinguer les sexes (gamétophytes haploïdes), et elles ressembleront à un tétrasporophyte diploïde sans tétrasporanges (S. Fredriksen, Université d’Oslo, communication personnelle, 2021).
La Norwegian Culture Collection of Algae (NORCCA) était à l’origine la source de cultures de Ceramium tenuicorne utilisées en recherche au Canada. Toutefois, la NORCCA n’était pas en mesure de confirmer le sexe des algues à cette époque-là. Peu importe le milieu de croissance, la salinité ou l’intensité lumineuse utilisée, les algues provenant de la NORCCA connaissaient une croissance lente et formaient des amas dans les récipients de l’essai (AquaTox, 2022). D’après une comparaison des photos des gamétophytes mâles (figure D.1) et femelles (figure D.2) cultivés à l’Université d’Oslo, on soupçonnait que des gamétophytes mâles avaient été obtenus par inadvertance de la NORCCA, car les algues cultivées présentaient au microscope de fines projections ressemblant à des poils, et aucune « fourche » n’était visible (figure D.3) (AquaTox, 2022). Par la suite, l’Université d’Oslo a fourni une culture confirmée de gamétophytes femelles (S. Fredriksen, Université d’Oslo, Norvège). La croissance de cette culture était plus rapide que celle des algues de la NORCCA, ne formait pas d’agrégats et ne développait pas de des poils (figure D.4). La figure D.5 illustre une croissance saine de la culture de C. tenuicorne de l’Université d’Oslo après deux semaines de culture (voir la figure 1 pour la taille et les structures d’origine).
Le laboratoire canadien a connu une contamination de sa culture C. tenuicorne tout au long de la validation de la méthode (Nautilus Environmental, 2024). La contamination était présente dans 93 % des récipients de culture. Visuellement, elle ressemblait à de petits amas denses de cellules non mobiles adhérées au fond du récipient (figure D.6), mais l’identité et la source du contaminant étaient inconnues. La contamination n’a été observée dans aucun des essais effectués pendant la validation de la méthode, et les autres essais n’ont pas été entrepris avant que la contamination ne soit éliminée par le recours à des organismes provenant de la culture de masse (Nautilus Environmental, 2024).
Un changement de coloration, notamment un jaunissement (chlorose) et une transparence, a été observé dans les cultures de C. tenuicorne et lors d’essais en laboratoire au Canada (M. Gallant, Nautilus Environmental, communication personnelle, 2023; Nautilus Environmental, 2024), et la banque de cultures de la NCMA (K. Dykens, NCMA, communication personnelle, 2023); voir la note de bas de page 18 pour plus de détails. À la figure D.7, on trouve un exemple d’algues translucides observées à Nautilus Environmental (2024). Il se peut que la bouture d’algue ait été endommagée au début de l’essai, car elle n’a pas poussé durant l’essai de 7 jours. La figure D.8 présente des exemples d’algues jaunies observées au NCMA, qui étaient saines et rouges aux extrémités, mais jaunes vers la base.

Description longue
(A) Thalle macroalgal rouge-brun avec 3 bandes sombres de cellules corticales, alternant avec 2 bandes claires de cellules axiales. Une branche adventice pousse près du premier cortex.
(B) Apex (bouture) d’une macroalgue rouge-brun. L’apex est recourbé sur lui-même comme une fourche, et de multiples poils fins, clairs et translucides en sortent.
(C) Thalle de macroalgue brun rouge avec des spermatangies de couleur claire entourant les bandes sombres de cellules corticales. Les bandes alternées de cellules axiales sont rouge pâle.

Description longue
(A) Thalle de macroalgue brun rouge, avec des apex (boutures) qui se recourbent sur eux-mêmes comme des fourches.
(B) Thalle de macroalgues brun rouge avec une forme bulbeuse foncée (cystocarpe) poussant à partir du point de ramification.

Description longue
(A) et (C) Des apex d’algues rouge-brun avec de multiples petites branches adventives poussant à partir du thalle.
(B) Thalle de macroalgue rouge-brun avec de multiples poils fins, clairs et translucides attachés.

Description longue
(A) Plusieurs boutures de macroalgues rouge-brun sur un fond quadrillé. Les algues sont agglutinées et de nombreuses branches adventives poussent à partir de chaque thalle. Il est difficile de dire si les algues poussent selon un schéma de ramification dichotomique.
(B) Plusieurs boutures de macroalgues rouge-brun se développant selon un schéma de ramification dichotomique. Quelques branches adventives poussent à partir de chaque thalle.

Description longue
Trois images, chacune montrant deux boutures de macroalgues rouge-brun poussant dans des boîtes de Petri posées sur du papier millimétré. Les algues présentent une alternance de cellules corticales (bandes foncées) et de cellules axiales (bandes claires et translucides). Les algues se sont développées selon un schéma de ramification dichotomique, avec trois ou quatre niveaux de ramification se terminant en forme de « fourches » incurvées.

Description longue
Amas rond de minuscules cellules vert-brun sur un fond vert clair.

Description longue
Image floue d’une bouture de macroalgue partiellement corticalisée sur un fond foncé. Le thalle est blanc et translucide et présente un seul point de ramification.

Description longue
Deux images de multiples morceaux de macroalgues rouge-brun poussant dans une boîte de Pétri posée sur un fond noir. Les apex des algues sont rouge vif et les régions inférieures du thalle sont jaunes.