Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien de 2022–2023
Bâtir un avenir meilleur ensemble
Cette publication est offerte sur demande en médias substituts.
Sur cette page
- Liste des figures
- Avant-propos de la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap
- Introduction
- Partie 1 : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme
- Partie 2 : Points saillants du Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme
- Partie 3 : Mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans l’ensemble des institutions fédérales
- Conclusion
- Annexe A : Liste des institutions fédérales participantes
Liste des figures
- Figure 1 : Infographie sur la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2022-23
- Figure 2 : Infographie sur le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme en 2022-23
- Figure 3 : Une photographie d’une fresque intitulée « Bienvenue »
- Figure 4 : Collecte de données statistiques
- Figure 5 : Utilisation des données à des fins d’amélioration
- Figure 6 : Domaines dans lesquels sont utilisées les données
- Figure 7 : Les divers aînés en résidence de Ressources naturelles Canada
- Figure 8 : Employés de Financement agricole Canada qui participent à un exercice démontrant ce qu’est une cérémonie des couvertures.
- Figure 9 : Affiche de l’exposition sur panneaux, Une communauté à la guerre
- Figure 10 : Taux de représentation au sein de comités, de groupes ou de forums
- Figure 11 : Mécanismes de collecte de commentaires
- Figure 12 : Motif des consultations avec le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme
- Figure 13 : Oeuvres sur oriflammes au pont Honoré-Mercier
- Figure 14 : Timbre de Postes Canada pour Diwali
- Figure 15 : Pièce de circulation commémorative mettant en vedette Oscar Peterson
- Figure 16 : Taux d’initiatives de célébration et de promotion internes et externes
- Figure 17 : Bannières soulignant la main-d’œuvre multiculturelle de Service Correctionnel Canada
- Figure 18 : Moyens utilisés pour appuyer les possibilités et le perfectionnement en matière de langues officielles
- Figure 19 : Dépliant en dari
- Figure 20 : Informations sur les droits des victimes en langue inuktitut
- Figure 21 : Communautés d’intérêt pour les discussions et les interventions
- Figure 22 : Domaines d’intérêt pour les programmes de paiements de transfert
- Figure 23 : Points saillants en lien avec la mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans les institutions fédérales
Avant-propos de la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap

L’honorable Kamal Khera,
Ministre de la Diversité,
de l’Inclusion et des
Personnes en situation de handicap
Le multiculturalisme, la diversité et l'inclusion sont des éléments fondamentaux de notre identité canadienne. En ma qualité de ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je suis chargé de diriger une approche pangouvernementale visant à construire une société plus inclusive, plus équitable et plus juste. Les efforts que notre gouvernement déploie à l’égard du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme sont des éléments indispensables à la création d’une telle société pour le Canada. J'ai le plaisir de partager le rapport suivant pour informer les Canadiens et Canadiennes des progrès réalisés par le gouvernement sur ces questions essentielles au cours de la dernière année. La toute première Stratégie canadienne de lutte contre le racisme est un gage de l’engagement de notre gouvernement à combattre le racisme et à éliminer les obstacles systémiques. Cette année, le rapport annuel présente les initiatives toujours en cours du gouvernement pour lutter contre le racisme et faire progresser le multiculturalisme au Canada, ainsi que ses démarches qui orienteront le renouvellement la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme en 2023-2024.
Les fonctions d'Envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme et de Représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie ont bénéficié d'un soutien continu lors du budget de 2022, avec un investissement de 11,2 millions de dollars sur cinq ans, dont 2,4 millions de dollars en continu.
En juin 2022, l'honorable Irwin Cotler, alors envoyé spécial, a participé à la première réunion plénière de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) sous la présidence suédoise. À cette occasion, le Canada s'est engagé à doubler son soutien annuel à l'AIMH et à mener des efforts pour lutter contre l'antisémitisme contemporain, l'antitsiganisme et la discrimination anti-Roms, ainsi qu'à adopter une position de principe face aux atrocités commises en Ukraine.
En janvier 2023, le gouvernement a fait une première enjambée importante dans la lutte contre la haine et l’islamophobie au Canada en nommant Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie. Grâce à ses connaissances et à son expérience approfondies, Amira Elghawaby fournit des orientations et des conseils pour soutenir les efforts du gouvernement du Canada en matière de lutte contre l'islamophobie et de sensibilisation aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans au Canada.
En outre, nous avons travaillé avec diligence pour veiller à ce que notre travail réponde aux préoccupations et aux priorités des diverses communautés du Canada. À cette fin, nous avons mené à bien des engagements communautaires de grande envergure, notamment deux sommets nationaux sur l’antisémitisme et l’islamophobie, un forum national sur le racisme envers les personnes noires, 21 tables rondes sur l’élimination de la haine, et trois tables rondes sur le Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, qui offre un soutien financier aux collectivités vulnérables aux incidents et aux crimes haineux afin d’améliorer les mesures de sécurité dans leurs lieux de rassemblement. Nous avons travaillé fort pour consulter nos intervenants en vue de rafraîchir la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et d’élaborer le Plan d’action de lutte contre la haine. La série de 21 tables rondes s’est déroulée de mars à mai 2022, et des consultations ont eu lieu avec d’autres ministères, les gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones nationales de juillet à décembre 2022. Les consultations au sujet du plan d’action comprenaient par ailleurs un questionnaire ouvert à l’ensemble de la population canadienne, qui a été lancé pendant l’été 2022 afin de recueillir des commentaires sur les formes que devrait prendre la lutte du gouvernement contre la haine et au racisme.
Notre approche à la promotion du multiculturalisme et à la lutte contre le racisme a toujours été, et sera toujours, centrée sur les besoins des communautés. Par ailleurs, en 2023, nous avons versé 1,5 million de dollars au fonds de dotation pour soutenir la chaire Jean Augustine en matière d’éducation, de communauté et de diaspora. Ce soutien financier aidera la chaire à participer à des projets de recherche et à des programmes d’éducation ainsi qu’à en entreprendre, en faciliter et en diriger afin de développer des partenariats communautaires adaptés à la culture, aux besoins éducatifs et sociaux, aux intérêts et aux aspirations des personnes noires et des membres d’autres communautés racisées. Cette initiative misera sur la mobilisation communautaire, les partenariats et la collaboration pour améliorer l’accès, l’équité et l’inclusion en matière d’éducation.
Lorsque nous examinons les réalisations de la dernière année, nous ne devons pas oublier les préjudices du racisme et les obstacles auxquels font encore face les communautés autochtones, noires, racisées et religieuses minoritaires. La haine, le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes n’ont pas leur place au Canada. Notre gouvernement continuera à travailler sans relâche pour combattre le racisme et la haine sous toutes ses formes.
Dans le Budget de 2022, le gouvernement a affecté 85 millions de dollars au renouvellement de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et à l’élaboration du Plan d’action de lutte contre la haine. De plus, d’autres investissements ont été annoncés dans le Budget de 2023, dont 25,4 millions de dollars sur cinq ans pour continuer de soutenir la Stratégie et pour combattre toutes les formes de racisme, notamment le racisme envers les personnes autochtones, noires et asiatiques, ainsi que l’antisémitisme et l’islamophobie.
Le multiculturalisme est une valeur canadienne centrale et un aspect fondamental de notre identité canadienne. Je vous invite à lire le rapport annuel 2022-2023 sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien pour découvrir les travaux accomplis dans la dernière année afin d’atteindre les objectifs de la Loi.

L’honorable Kamal Khera,
Ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap
Introduction
Le rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien est un véhicule important qu’utilise le gouvernement du Canada pour faire état du travail essentiel réalisé par la fonction publique fédérale pour endiguer le racisme, la haine et la discrimination, et pour présenter ses initiatives de promotion d’une société multiculturelle.
La diversité représente l’une des principales forces du Canada. C’est une caractéristique fondamentale de notre société, qui fera toujours partie intégrante de l’identité canadienne. D’ailleurs, Statistique Canada anticipe que, d’ici 2036, entre 31 et 36 % de la population fera partie d’un groupe raciséNote de bas de page 1. Or, malgré la diversification de la population canadienne, le racisme et la discrimination continuent de faire obstacle à la pleine participation des communautés autochtones, noires, racisées et religieuses minoritaires. Selon les données déclarées par la police, les crimes haineux ont augmenté de 27 % de 2020 à 2021, principalement en raison d’une hausse des crimes haineux ciblant des groupes religieux (+ 67 %), raciaux ou ethniques (+ 6 %)Note de bas de page 2. En outre, les recherches de Statistique Canada démontrent que les communautés racisées se heurtent à plus d’obstacles systémiques que les groupes non racisés, notamment des taux plus élevés de pauvretéNote de bas de page 3 et une représentation plus faible au sein des postes de directionNote de bas de page 4. Les institutions fédérales ont encore beaucoup de travail à faire pour créer une société réellement inclusive et exempte de racisme, de discrimination et de haine.
Les réalisations présentées dans le rapport de cette année démontrent manifestement l’attachement du gouvernement au multiculturalisme et son opposition au racisme, à la discrimination et à la haine. Qu’il s’agisse de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et des diverses mesures prises pour la renouveler, des consultations sur le Plan d’action de lutte contre la haine du Canada, du financement des projets communautaires ou des engagements nationaux et internationaux, le gouvernement du Canada n’a cessé d’administrer des politiques, des programmes et des services afin de cerner et d’éliminer les obstacles à la participation intégrale et équitable des personnes et des communautés de toutes origines.
Les parties 1 et 2 du présent rapport synthétisent les réalisations de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et du Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme, ainsi que leurs contributions au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Elles sont divisées ainsi :
- Partie 1 : Stratégie canadienne de lutte contre le racisme
- Partie 2 : Points saillants du Programme de multiculturalisme et de la lutte contre le racisme
La partie 3, quant à elle, décrit l’exécution des obligations des institutions fédérales en vertu de la Loi sur le multiculturalisme canadien en soulignant une série de pratiques prometteuses. Ces pratiques sont réparties dans les thèmes suivants :
- 3.1 Méthodologie et méthode d’analyse
- 3.2 Collecte de données
- 3.3 Éducation et sensibilisation
- 3.4 Prévention et solutions
- 3.5 Promotion et célébration
Partie 1 : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme
L’exercice 2022-2023 a marqué la conclusion de Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022 (SCLR 2019-2022), la première stratégie de lutte contre le racisme du Canada, ainsi que l’amorce de la transition vers une nouvelle stratégie, inspirée des réussites et des leçons apprises de la première stratégie.
Lancée en 2019, la SCLR 2019-2022 est venue jeter les bases des mesures fédérales visant à lutter contre le racisme et la discrimination au Canada à long terme. Elle avait pour but de favoriser une société inclusive et équitable où tous les Canadiens et Canadiennes peuvent participer pleinement et de manière significative aux sphères économique, culturelle, sociale et politique. De 2019 à 2023, le gouvernement a consacré 95 millions de dollars à la lutte contre le racisme systémique et la discrimination au Canada, dont 70 millions ont été versés à des organismes communautaires œuvrant à cette lutte et à la promotion du multiculturalisme.
Le Budget de 2022 a consacré à Patrimoine canadien 85 millions de dollars sur quatre ans à partir de l’exercice 2022-2023 pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, soit la SCLR 2023-2028. Cette dernière, qui sera édifiée sur les fondations posées de 2019 à 2022, prévoira un cadre communautaire doté d’une approche systémique en vue d’éliminer le racisme systémique au Canada. Un autre investissement a été consacré dans le Budget de 2023, cette fois de 25,4 millions sur cinq ans.
La présente section du rapport présente les grandes lignes des réalisations de la dernière année de la SCLR 2019-2022, y compris les mesures mises en place pour appuyer le renouvellement de la stratégie. Elle est divisée selon les piliers principaux de la SCLR 2019-2022 :
- Faire preuve de leadership fédéral par la mise sur pied d’un secrétariat fédéral pour la coordination horizontale, et le renforcement des capacités institutionnelles.
- Habiliter les communautés par le versement de subventions et de contributions aux communautés qui luttent contre le racisme systémique dans les domaines de la justice, de l’emploi et de la participation sociale, et par des activités de mobilisation des intervenants.
- Sensibiliser et changer les attitudes par l’amélioration de l’accès aux données désagrégées (renseignements ventilés en sous-catégories, comme des groupes démographiques précis) et par le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation du public.

Figure 1 : Infographie sur la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2022-23 – version texte
Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2022-23
- Faire preuve de leadership fédéral
- Donné du soutien à 50 initiatives fédérales visant à faire progresser la lutte contre le racisme.
- Co-animation d'une table ronde lors du Forum mondial de l'UNESCO contre le et la racisme et la discrimination.
- Soutenu la signature de la déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale le 10 janvier 2023.
- Habiliter les communautés
- Investissement de 10,8 millions de dollars dans le financement continu de projets qui contribuent à éliminer les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale parmi les peuples autochtones et les communautés racisées et religieuses minoritaires.
- Consultations avec les acteurs de la communauté en vue d'élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et un nouveau plan d'action contre la haine.
- Sensibiliser et changer les attitudes
- Financement octroyé à Statistique Canada, Justice Canada et Sécurité publique Canada pour la réalisation de recherches originales sur le racisme et la discrimination au Canada.
- Signé deux nouveaux accords de quatre ans avec Statistique Canada et Justice Canada afin de poursuivre la recherche à l'appui de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme.
1.1 Faire preuve de leadership fédéral
Le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme (le Secrétariat) est un centre d’expertise qui agit à titre de modérateur et de catalyseur entre le gouvernement et les communautés en prônant une approche pangouvernementale à la lutte contre le racisme systémique, la discrimination et la haine au Canada. En 2022-2023, le Secrétariat a continué à faire preuve de leadership fédéral en offrant de l’aide et des conseils aux partenaires fédéraux, provinciaux et internationaux sur la lutte contre le racisme à l’échelle nationale et internationale. Également, Patrimoine canadien a continué à guider la mise en œuvre de la SCLR et l’élaboration du Plan d’action de lutte contre la haine du Canada.
1.1.1 Soutien aux partenaires fédéraux
Au cours de l’année, le Secrétariat a appuyé environ 50 initiatives fédérales s’attaquant à divers domaines clés, comme la consultation sur l’examen de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la Stratégie nationale d’adaptation du Canada, l’examen stratégique de l’immigration et la stratégie canadienne de 2023 sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Le Secrétariat a notamment collaboré avec Justice Canada pour mettre en place un groupe de pilotage et un plan d'engagement communautaire en vue de l'élaboration de la stratégie canadienne en matière de justice pour les Noirs. En outre, une conférence nationale sur l'apprentissage collaboratif sur la justice réparatrice s'est tenue en octobre 2022. Cette conférence, qui a été financée par Justice Canada et à laquelle il a participé, comportait un volet spécifique visant à garantir la représentation du point de vue des communautés noires et racisées. Le Secrétariat a collaboré avec Justice Canada pour veiller à ce que ces perspectives soient représentées au sein de la délégation fédérale. La conférence comprenait un forum spécial intitulé : Transformative Journeys for Racial Justice: An Evening in Conversation with Angela Davis, Fania Davis and Margaret Burnham.
1.1.2 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine des Nations Unies (2015-2024)
En reconnaissance de la Décennie des Nations Unies des personnes d’ascendance africaine, le Secrétariat a continué de diriger le Groupe de travail sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine dans le cadre de l’Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, mise en œuvre par Emploi et Développement social Canada. Créé en juillet 2020, ce groupe de travail réunit environ 20 institutions fédérales qui se réunissent régulièrement pour veiller à ce que les politiques, les lois, les programmes et les services fédéraux appliquent une perspective axée sur la lutte contre le racisme envers les personnes noires et répondent aux besoins des personnes d’ascendance africaine au Canada.
1.1.3 Atelier du Forum mondial de l’UNESCO contre le racisme et la discrimination : Construire une alliance nord-américaine pour l’équité raciale et l’inclusion
La deuxième édition du Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) s'est tenue à Mexico les 28 et 29 novembre 2022. L'honorable Ahmed Hussen, alors ministre canadien du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du Forum et a présenté la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme aux participants. En outre, le Secrétariat a travaillé de concert avec des représentants de l’UNESCO, du Mexique et des États-Unis pour organiser une table ronde intitulée « Construire une alliance nord-américaine pour l’équité raciale et l’inclusion ». Quelque 13 000 personnes ont assisté aux discussions hybrides. Des représentants de gouvernements et de la société civile, des universitaires, des groupes d’affaires et des intervenants clés ont discuté de l’histoire commune de la suprématie blanche au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ils ont également abordé la colonisation, la réconciliation, le sort des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, l’esclavage et la solidarité dans la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Ce faisant, ils ont souligné les travaux, les programmes, les mesures, les expériences et les pratiques exemplaires des trois pays, tout en faisant part de leurs points de vue sur les difficultés et les possibilités qui surviennent dans la lutte contre le racisme et la discrimination. En outre, un résultat important du forum est que l'UNESCO sera une institution partenaire importante dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale. L'UNESCO sera l'une des institutions partenaires dans la mise en œuvre des activités, jouant le rôle de rassembleur des organisations de la société civile dans ce partenariat tripartite.
1.1.4 Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l’équité et la justice raciale
La Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l’équité et la justice raciale a été signée le 10 janvier 2023 à Mexico par l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Canada; l’honorable Anthony Blinken, secrétaire d’État du gouvernement des États-Unis; et l’honorable Marcelo Luis Ebrard Casaubon, ministre des Affaires étrangères du gouvernement des États-Unis mexicains. Elle découle de l’engagement de promouvoir des sociétés diversifiées, antiracistes, inclusives, équitables et démocratiques qu’ont pris le premier ministre Justin Trudeau, le président Joe Biden et le président Andrés Manuel Lopez Obrador à l’occasion du Sommet des leaders nord-américains de 2021. Elle est le fruit de deux ans de délibérations entre le Secrétariat (au nom du gouvernement du Canada) et les gouvernements des États-Unis et du Mexique. Il s’agit d’un effort commun pour lutter contre les formes systémiques de racisme et de discrimination et pour célébrer la riche mosaïque d’histoires, de coutumes, de cultures, de langues, d’identités, d’origines ethniques, de capacités et de croyances qui donnent toute sa force à l’Amérique du Nord. La Déclaration engage également les signataires à travailler ensemble pour faire avancer l’équité et la justice raciale en fonction de trois piliers : travailler à l’échelle nationale à faire progresser l’équité et la justice raciale; mettre sur pied un réseau trilatéral d’experts en équité raciale et en inclusion; et collaborer par l'intermédiaire d'organisations régionales et multilatérales. La coopération trilatérale qui résulte de la Déclaration sur le partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale se poursuit dans le cadre de la onzième édition du Sommet des leaders nord-américains, qui se tiendra au Canada en 2024.
1.2 Habiliter les communautés
Une des priorités de la stratégie est d’offrir du soutien aux collectivités sur le terrain qui ont l’expertise nécessaire pour lutter contre les diverses formes de racisme et de discrimination. Les travaux sont réalisés par l’entremise d’initiatives de financement et de mobilisation. En 2022-2023, Patrimoine canadien a continué à verser un soutien financier aux collectivités grâce à ses programmes de subventions et de contributions. De plus, le Ministère a tenu des consultations communautaires afin d’orienter le renouvellement de la Stratégie et l’élaboration du nouveau Plan d’action de lutte contre la haine.
1.2.1 Financement des communautés
Le Programme d’action et de lutte contre le racisme (PALR) et le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme (PSCMLR) sont deux mécanismes qu’utilise le gouvernement du Canada soutient le démantèlement du racisme et de la discrimination systémique dans le contexte de la SCLR.
Lancé en 2019 dans le cadre de la SCLR 2019-2022, le PALR a été conçu pour contribuer à éliminer les obstacles à l’emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des communautés racisées et religieuses minoritaires. Il finance également des projets qui se penchent sur la haine en ligne et la culture numérique. Le PALR a continué d’appuyer d’autres projets en 2022-2023 grâce à un investissement de 10,8 millions de dollars.
En vedette : Un projet financé par le PALR
Projet : Justice pour tous
Fonds approuvés : 400 000 $
Description : Du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023, grâce au financement du PALR, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal a pu mettre en œuvre le projet « Justice pour tous » à Montréal. Cette initiative est née du constat du problème de la surreprésentation des jeunes enfants pris en charge par les services de protection de l’enfance. L’objectif était de réduire les obstacles à la justice associés à la disproportion d’enfants issus de groupes noirs et racisés au sein du système de protection de l’enfance de Montréal. Le projet a abouti sur la création d’un plan d’action stratégique qui servira de référence pour les modifications systémiques à apporter aux services de protection de l’enfance. Ces modifications permettront de déconstruire les préjudices et les messages péjoratifs ciblant les communautés noires et diminueront la surreprésentation d’enfants noirs pris en charge.
Le PSCMLR existait avant la SCLR, mais a bénéficié d’un financement supplémentaire pour des initiatives s’attaquant au racisme. Consultez la section 2.1 pour obtenir des précisions sur les activités du PSCMLR de 2022-2023.
1.2.2 Consultations sur la SCLR 2023-2028 et le Plan d’action de lutte contre la haine du Canada
Du 29 mars au 4 mai 2022, 21 consultations en table ronde ont été organisées avec des partenaires et des intervenants des quatre coins du pays afin d’orienter l’élaboration du premier Plan d’action de lutte contre la haine du Canada ainsi que la modernisation de la SCLR. Dirigées par l’honorable Ahmed Hussen, alors ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, les tables rondes ont mis à contribution des figures d’autorité des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que celles des communautés noires, asiatiques, latino-américaines, arabes, musulmanes et juives, sans oublier celles d’autres groupes méritant l’équité, notamment les nouveaux arrivants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQQIA+. De surcroît, un questionnaire en ligne a été envoyé.
1.3 Sensibiliser et changer les attitudes
La SCLR reconnaît que les données et les éléments d’information raciaux et désagrégés sont d’importants outils permettant de cerner et de traiter les inégalités et d’étayer des mesures correctives pour éliminer le racisme et la discrimination. Dans le cadre de la SCLR 2019-2022, Patrimoine canadien a signé des ententes officielles avec Statistique Canada, Justice Canada et Sécurité publique Canada pour mener des recherches sur des sujets qui approfondissent notre compréhension du racisme et de la discrimination. Pendant l’exercice 2022-2023, d’autres produits livrables des ententes de la SCLR 2019-2022 ont été publiés, et de nouvelles ententes ont été établies avec Statistique Canada et Justice Canada pour produire des données supplémentaires et réaliser d’autres projets de recherche afin de faire avancer les connaissances à l’appui de la lutte contre le racisme.
1.3.1 Partenariat avec Statistique Canada
Patrimoine canadien et Statistique Canada ont établi une nouvelle entente de 1,1 million de dollars sur quatre ans à partir de 2022-2023 pour des projets de recherche et de développement des données afin de poursuivre les travaux entamés dans le cadre de la SCLR 2019-2022. Cette année, la priorité était accordée au cadre sur l’inclusion sociale, qui contient des indicateurs d’inclusion sociale pour les immigrants et les groupes ethnoculturels au Canada.
En 2022-2023, Statistique Canada a publié plus de 20 nouveaux indicateurs dans un ensemble de cinq tableaux de données, pour un total de plus de 120 indicateurs d’inclusion sociale. Il a également publié différents outils de visualisation des données, qui permettent aux utilisateurs d’organiser les indicateurs selon 11 thèmes, tels que la participation au marché du travail, représentation dans les postes décisionnels, engagement communautaire et participation politique, besoins fondamentaux et logement, santé et bien-être, etc. Les données peuvent par ailleurs être ventilées par caractéristique sociodémographique et par emplacement géographique.
La liste complète des indicateurs et une courte description de leur dérivation correspondante sont présentées dans le nouveau Guide de référence sur les indicateurs d’inclusion sociale pour les groupes ethnoculturels du Canada. Le cadre sur l’inclusion sociale, ses indicateurs et, maintenant, les outils de visualisation sont des produits diffusés par le Carrefour des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion.
De plus, le Comité consultatif sur la statistique ethnoculturelle et de l’immigration de Statistique Canada a tenu deux réunions en 2022-2023. Ce comité formule des conseils et des recommandations à l’intention de Statistique Canada sur les données, les concepts et les instruments utilisés pour recueillir des renseignements sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité ethnoculturelle, l’inclusion et la religion, ainsi que sur l’analyse et la dissémination des données sur les populations les plus susceptibles d’être victimes de discrimination et d’exclusion. Les activités du Comité aident Statistique Canada à maintenir la pertinence de ses programmes sur l’immigration et de ses programmes ethnoculturels et à continuer de fournir des statistiques, des produits et des services de grande qualité qui répondent aux besoins de la population et des institutions du Canada. Notamment, les membres ont été consultés au sujet de la mobilisation de Statistique Canada auprès de la population canadienne pour revoir le concept de minorité visible.
1.3.2 Partenariat avec le ministère de la Justice Canada
Patrimoine canadien et Justice Canada ont établi une nouvelle entente de 600 000 $ sur quatre ans à partir de 2022-2023 pour de nouveaux projets de recherche et de développement des données qui contribuent aux objectifs de la stratégie. Cette année, Justice Canada e a entrepris plusieurs projets de recherche visant à améliorer la compréhension des répercussions du racisme sur les personnes ayant des démêlés avec le système de justice et à trouver des solutions à ce problème, dont :
- un projet de couplage de données avec des organismes de traitement des plaintes relatives aux droits de la personne (en collaboration avec Statistique Canada);
- une étude qualitative supplémentaire sur les graves problèmes juridiques que rencontre un groupe minoritaire;
- une désagrégation supplémentaire des données de l’Enquête canadienne sur les problèmes juridiques.
En outre, Justice Canada a jeté les bases de la création de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, notamment en formant un groupe directeur de neuf membres chargé d’élaborer un cadre pour des consultations menées par les communautés noires partout au Canada. Il s’agit de la première étape d’une approche progressive à l’élaboration de la stratégie. Les prochaines étapes sont :
- la consultation des communautés noires;
- le rapport du groupe directeur sur les consultations;
- la rédaction d’un plan de mise en œuvre (qui devrait débuter en 2024); et
- la mise en œuvre de la stratégie (2024-2025).
1.3.3 Partenariat avec Sécurité publique Canada
En vertu de l’entente conclue dans le cadre de la SCLR 2019-2022, le Centre canadien d’engagement communautaire et de prévention de la violence de Sécurité publique Canada a réalisé deux examens systématiques en collaboration avec un réseau international de recherche en sciences sociales, la Campbell Collaboration. Le premier examen systématique portait sur la cartographie des connaissances scientifiques et des approches pour définir et mesurer les crimes, discours et incidents haineux (en anglais seulement). Le deuxième examen consistait en une revue systématique des preuves d’associations ou d’impacts de la haine en ligne et dans les médias traditionnels sur les individus, les auditoires et les communautés (en anglais seulement). Ces deux examens seront des outils précieux pour éclairer les politiques, les programmes et la recherche afin de comprendre la haine et l’extrémisme violent en ligne et en personne et de lutter contre celles-ci.
Partie 2 : Points saillants du Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme
Le Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme est un moyen qu’utilise le gouvernement du Canada pour appliquer la Loi sur le multiculturalisme canadien et pour faire progresser ses priorités en matière de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. En raison du rôle que joue le Programme dans la mise en œuvre de la SCLR, ses activités et objectifs ressemblent ou chevauchent ceux de la Stratégie. Par conséquent, la présente section met l’accent sur les initiatives du Programme qui complètent la SCLR, notamment :
- Les investissements communautaires par le biais du PSCMLR.
- Les événements commémoratifs qui promeuvent et célèbrent la diversité, en plus de mieux faire connaître les enjeux en matière de multiculturalisme, de racisme et de haine.
- Le soutien aux organisations qui contribuent aux objectifs de la Loi sur le multiculturalisme canadien.

Figure 2 : Infographie sur le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme en 2022-23 – version texte
Le programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme en 2022-23
- Les investissements communautaires comprennent :
- Soutenir des initiatives sous les volets Évènements, Projets et Renforcement des capacités communautaires pour un total d’environ 39 millions de dollars.
- Au total, 252 propositions de financement ont été approuvées sous les volets Projets et Renforcement des capacités communautaires.
- 312 propositions de financement ont été approuvées sous le volet Événements.
- Événements commémoratifs
- Patrimoine canadien a organisé des événements commémoratifs pour :
- le Mois de l'histoire des Noirs,
- la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale,
- le Mois du patrimoine asiatique et
- le Jour de l'émancipation.
- Les événements comprenaient :
- de grandes réceptions en personne,
- des activités de sensibilisation et d'éducation du public en personne et virtuelles, et
- un forum virtuel avec des orateurs de renom.
- Patrimoine canadien a organisé des événements commémoratifs pour :
- Soutien aux organisations qui préservent et renforcent le multiculturalisme dans le pays et à l'étranger
- Patrimoine canadien apporte un soutien opérationnel aux organisations internes et externes qui poursuivent les objectifs de la Loi sur le multiculturalisme, telles que la chaire Jean-Augustine en matière de communauté et de diaspora et l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste.
2.1 Investissements communautaires du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme
Le PSCMLR octroie des fonds aux projets et aux événements qui font la promotion de la diversité et de l’inclusion. Il comporte trois volets principaux de financement : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires.
Cette année, 252 initiatives ont été approuvées dans les volets Projets et Renforcement des capacités communautaires du PSCMLR, pour un montant total de 31,5 millions de dollars. Les fonds accordés dans le volet Projets ont soutenu des projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui promeuvent la diversité et l’inclusion en favorisant l’interaction entre les groupes communautaires. Les fonds accordés dans le volet Renforcement des capacités communautaires ont soutenu des activités visant à développer la capacité des organismes à promouvoir la diversité et l’inclusion, comme la formation à la gouvernance, l’établissement de partenariats et le recrutement de bénévoles.
De surcroît, 312 événements ont été approuvés, touchant plus de 3,8 millions de personnes au Canada, pour un investissement total de 7,5 millions de dollars. L’objectif de ces initiatives est de promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, d’encourager le dialogue sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, et de célébrer l’histoire et la culture des communautés.
En vedette : Un projet financé par le PSCMLR
Projet : Asian-Canadian Artists in Digital Age: School Workshops Enhanced by Artificial Intelligence
Fonds approuvés : 197 167 $
Description : De 2019-2020 à 2022-2023, le PSCMLR a octroyé des fonds à l’Université York pour un projet visant à permettre à deux conseils scolaires de Toronto ainsi qu’à des artistes canadiens d’origine asiatique, africaine et autochtone de transformer les mentalités et d’élargir les perspectives sur l’éducation contre le racisme et sur la participation communautaire. Pour ce faire, les artistes ont organisé une série d’ateliers sur l’art et l’intelligence artificielle dans le domaine de la mobilisation communautaire, du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme, tenus en personne ou de façon virtuelle avec les conseils scolaires. Des applications d’intelligence artificielle ont été conçues avec les conseils scolaires et IBM sur la reconnaissance visuelle des couleurs culturelles, la compréhension du langage naturel améliorée sur le plan culturel et l’assistant virtuel. Les artistes canadiens d’origine asiatique, africaine et autochtone ont échangé des pratiques exemplaires pour surmonter les obstacles sociaux et culturels. Le projet a été achevé en mars 2023 et a atteint un total de 80 000 participants directs.
2.2 Événements commémoratifs
Chaque année, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme au sein de la Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme organise des événements commémoratifs pour favoriser la reconnaissance des racines historiques et des contributions importantes des peuples autochtones, des communautés racisées et des communautés de minorités religieuses au Canada. Comme il l’a fait les années précédentes, il y a eu des événements organisés à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, du Mois du patrimoine asiatique et du Jour de l’émancipation.
2.2.1 Mois du patrimoine asiatique 2022
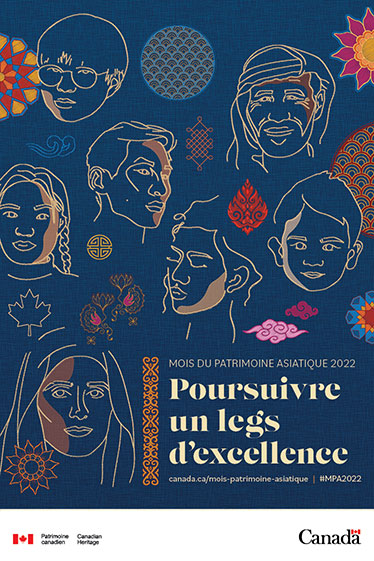
Mois du patrimoine asiatique 2022 :
Poursuivre un legs d’excellence
En 2022, l’honorable Ahmed Hussen, alors ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, a souligné le Mois du patrimoine asiatique en organisant une réception en personne le 9 mai au Centre national des Arts, à Ottawa, afin de célébrer le 20e anniversaire de la déclaration officielle du gouvernement faisant du mois de mai le Mois du patrimoine asiatique au Canada. Pour cette occasion, plusieurs ministres, leaders communautaires et Canadiens influents se sont joints au ministre Hussen. Le thème de l’année 2022, « Poursuivre un legs d’excellence », a été mis en vedette tout au long de la soirée dans des spectacles, des hommages et des entrevues honorant et célébrant les réalisations et les contributions des communautés asiatiques au Canada.
Cet événement était une occasion importante pour toute la population canadienne d’en apprendre davantage sur l’influence positive des communautés asiatiques, dans le passé, le présent et l’avenir.
2.2.2 Jour de l’émancipation
En 2022, afin de souligner le deuxième Jour de l’émancipation national, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a octroyé un contrat à sept organismes canadiens dirigés par des personnes noires pour la planification, l’animation et la prestation d’activités communautaires fondées sur l’art et l’éducation du public concernant l’importance historique du Jour de l’émancipation au Canada. Du 30 juillet au 14 août 2022, une série d’activités en personne et virtuelles ont été organisées par les partenaires communautaires régionaux suivants : la Black Advocacy Coalition (région du Nord), le Black Cultural Centre for Nova Scotia (région de l’Atlantique), la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs (région du Québec), le Blackhurst Cultural Centre (région de l’Ontario), African Communities of Manitoba Inc. (région du Centre/des Prairies), la Fondation pour les communautés noires (région de l’Alberta) et African Art & Cultural Community Contributor CCC Inc./Issamba Centre (région de la Colombie-Britannique).
2.2.3 Mois de l’histoire des Noirs 2023
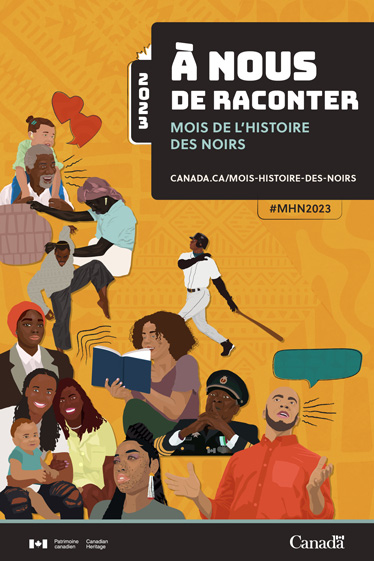
Mois de l’histoire des Noirs 2023 :
À nous de raconter
Le mercredi 8 février 2023, le ministre Hussen a organisé la célébration officielle du gouvernement du Canada pour le Mois de l’histoire des Noirs 2023 au Centre national des Arts. Le thème de l’année, « À nous de raconter », a été souligné tout au long de la soirée au moyen de spectacles, d’hommages et de discussions en groupe honorant et célébrant les réalisations et les contributions des communautés noires au Canada. Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, et plusieurs autres députés se sont joints au ministre Hussen lors de cet événement. Le nombre de participants s’est élevé à 750 personnes.
2.2.4 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Le 30 mars 2023, le Secrétariat a organisé un forum virtuel intitulé « La lutte contre le racisme en Amérique du Nord : Contrer les craintes » pour souligner la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Des conférenciers de renom d’organisations multilatérales, de gouvernements et de la société civile du Canada, des États-Unis et du Mexique étaient présents, notamment Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les Sciences sociales et humaines de l’UNESCO; Désirée Cormier-Smith, représentante spéciale pour l’équité raciale et la justice au Département d’État des États-Unis, Claudia Olivia Morales Reza, présidente du CONAPRED et María Celeste Sánchez Sugía, sénatrice mexicaine.
2.3 Soutien aux organisations contribuant au multiculturalisme, à la lutte contre le racisme et à la lutte contre la haine
L'une des principales activités du Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme de Patrimoine canadien est l'octroi d'autres subventions et contributions à des organismes qui contribuent à la réalisation du mandat de Patrimoine canadien d'offrir des politiques et des programmes qui préservent et améliorent le patrimoine multiculturel des Canadiens et des Canadiennes, tant au niveau national qu'international. De plus, Patrimoine canadien fournit un soutien opérationnel à l'Envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme et au Représentant spécial pour la lutte contre l'islamophobie dans l'exécution de leurs mandats respectifs.
2.3.1 Fonds de dotation Jean-Augustine
La chaire Jean-Augustine en matière d’éducation, de communauté et de diaspora est une chaire d’études fondée en 2008 par l’honorable Jean Augustine, C.P., C.M., C.B.E., la première femme noire élue au Parlement du Canada. Cette chaire, nichée au sein de la faculté d’éducation de l’Université York, à Toronto, est un pôle de recherche accessible aux membres et aux organismes des communautés racisées qui contribue aux politiques et aux programmes dans l’ensemble du Canada pour favoriser l’accès, l’équité et l’inclusion dans le monde de l’éducation pour les communautés noires et les autres communautés racisées.
Cette année, Patrimoine canadien et l’Université York ont signé une entente de financement d’un montant de 1,5 million de dollars pour le fonds de dotation de la chaire Jean Augustine en matière d’éducation, de communauté et de diaspora. Ce soutien financier appuie les activités régulières de la chaire et l’aide dans le lancement, la gestion et la direction de programmes de recherche et d’éducation pour la promotion des partenariats communautaires et la participation à de tels programmes.
2.3.2 Envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme
Le Bureau de l’envoyé spécial, en partenariat avec l’UNESCO et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, a offert une formation en anglais et en français sur la lutte contre l’antisémitisme au sein de Patrimoine canadien. Les documents préparés à cette fin servent de modèle à l’élaboration de formations à venir qui pourraient être offertes à l’ensemble de la fonction publique.
Le 26 mai 2022, Patrimoine canadien, en collaboration avec le Bureau de l’envoyé spécial, a tenu l’activité inaugurale du Mois du patrimoine juif canadien intitulée « Reconnaître et contrer la distorsion et le déni de l’Holocauste ».
2.3.3 Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste

L’honorable Irwin Cotler,
premier envoyé spécial du Canada
Le Canada, représenté par l’envoyé spécial Cotler, a pris part à la première réunion plénière de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) sous la présidence suédoise. Là-bas, il s’est engagé à doubler sa contribution annuelle à l’AIMH, à chapeauter des efforts pour combattre l’antisémitisme contemporain, l’antitsiganisme et la discrimination contre les Roms, et à adopter une position de principe à l’égard des horreurs perpétrées en Ukraine.
L’ancien envoyé spécial a aussi joué un rôle de leadership essentiel lors de la réunion plénière tenue en novembre 2022 à Göteborg, en Suède, où le Canada s’est engagé à déposer son second rapport national à l’AIMH au cours de l’année à venir. De plus, le Canada a soumis une mise à jour sur le respect et la mise en œuvre des promesses nationales formulées lors du Forum international de Malmö sur la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme – Remember-ReAct tenu en octobre 2021.
2.3.4 Représentante spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie

Amira Elghawaby,
première représentante spéciale du Canada
Le 26 janvier 2023, suivant les recommandations formulées au Sommet national sur l’islamophobie en 2021, le premier ministre Trudeau a annoncé la nomination d’Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.
La représente spéciale agit en tant que championne, conseillère, experte et représentante pour renforcer les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. Elle est experte en matière d'équité, d'inclusion et de droits de l'homme.
Elle a été membre fondatrice du conseil d'administration du Canadian Anti-Hate Network et membre du conseil d'administration du Silk Road Institute. Elle a rempli deux mandats de commissaire au sein de la Commission canadienne de l'expression démocratique du Forum des politiques publiques. Elle siège actuellement au Groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale, un comité indépendant qui conseille le sous-ministre de la sécurité publique. Auparavant, elle a été journaliste et défenseur des droits de l'homme.
Partie 3 : Mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans l’ensemble des institutions fédérales
La Loi sur le multiculturalisme canadien reconnaît le rôle crucial que jouent les institutions fédérales dans la préservation et l’amélioration du multiculturalisme au Canada. Elle ordonne aux organisations fédérales d’aborder la question de l’égalité des chances dans les institutions fédérales, de promouvoir le renforcement des capacités, d’améliorer la compréhension et le respect de la diversité, de recueillir des recherches et des données qui appuient l’élaboration de politiques, de pratiques et de programmes pertinents, de faire un usage approprié des compétences linguistiques et des connaissances culturelles des personnes de toutes origines et, de manière générale, de conduire leurs activités en tenant compte de la réalité multiculturelle du Canada.
Les institutions fédérales réalisent d’importants progrès relativement à la Loi et en réponse à des initiatives fédérales horizontales clés visant à promouvoir le multiculturalisme, à renforcer la diversité et à combattre le racisme et la discrimination. Cela est démontré par le vaste éventail d’activités mises en évidence dans les soumissions du rapport annuel de cette année. Des travaux importants ont été entrepris dans les domaines suivants : amélioration de la collecte de données désagrégées; offre d’une formation sur la lutte contre le racisme, la diversité et l’inclusion en milieu de travail; éducation et sensibilisation de la population à la diversité ethnoculturelle et raciale et aux difficultés rencontrées par les groupes issus de la diversité; encouragement des groupes d’employés à faire part de leurs idées et à exprimer leurs préoccupations en contribuant aux politiques, aux programmes et aux pratiques; récolte de commentaires directement auprès des communautés; collaboration avec des organes d’experts sur des questions importantes; et célébration de la riche histoire et des contributions des groupes issus de la diversité à la société canadienne.
Les institutions fédérales ont également fait des progrès importants pour s’assurer que les politiques, les pratiques et les programmes internes et externes sont inclusifs pour tous. Ils comprennent la détermination et l’élimination des obstacles à l’embauche et au maintien en poste des employés, ainsi que la promotion de l’avancement professionnel; la traduction, l’interprétation et l’optimisation des connaissances culturelles et multilingues du personnel afin de faciliter l’accès aux programmes; la tenue de discussions pour cerner et éliminer les obstacles systémiques; et la mise en œuvre de programmes de paiements de transfert qui s’attaquent directement au racisme et aux obstacles systémiques. Les points saillants de ces activités sont décrits ci-dessous.

Une fresque intitulée « Bienvenue » que les résidents du pavillon de ressourcement Okimaw Ohci ont créée. La fresque est une représentation multiculturelle promouvant divers groupes culturels/ethniques et langues, lesquels se souhaitant la bienvenue.
Source : Service correctionnel Canada
3.1 Méthodologie et méthode d’analyse
Afin de recueillir des données pour le rapport annuel auprès des institutions fédérales, Patrimoine canadien a encouragé les institutions fédérales de toutes tailles et de tous mandats à présenter leur soumission dûment remplie. Des 140 institutions qui ont reçu le questionnaire, 120 ont fourni une soumission (taux de réponse de 86 %), ce qui représente un résultat semblable à celui de l’année dernière (87 %). Le taux de réponse peut varier d'une année à l'autre, car la participation est fortement encouragée, mais pas obligatoire. La liste des institutions fédérales qui ont contribué au rapport de cette année figure à l'annexe A.
Tous les commentaires reçus ont été passés en revue, totalisés et analysés en fonction des quatre thèmes suivants :
- Collecte de données : Les efforts déployés pour recueillir et utiliser des données afin de concevoir des politiques, des pratiques et des programmes fondés sur des données probantes tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada.
- Éducation et sensibilisation : Les efforts déployés pour éduquer et sensibiliser les gens à la diversité culturelle et raciale et aux difficultés auxquelles les groupes issus de la diversité sont confrontés, et les efforts déployés pour promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales.
- Promotion et célébration : Les efforts visant à promouvoir et à célébrer la contribution et le patrimoine historiques des communautés de toutes origines à la société canadienne.
- Prévention et solutions : Les efforts visant à assurer l’accès complet et équitable des personnes et des communautés de toutes origines.
Les sections suivantes présentent la façon dont les institutions fédérales ont satisfait aux exigences de chaque thème.
3.2 Collecte de données
Les données fournissent une base solide pour l’amélioration des politiques, des programmes et des pratiques et, dans l’ensemble, renforcent le travail fondé sur des données probantes du gouvernement, puisque la classification des individus selon leurs attributs tels le genre, la langue et l’origine ethnique permet une compréhension plus complète de l’expérience et des réussites de groupes de population donnés. Dans le cadre de ce thème, les institutions fédérales devaient indiquer si :
- Elles recueillent des données statistiques désagrégées sur les communautés racisées, sur les communautés religieuses en situation minoritaire ou sur les peuples autochtones (autre que les données sur l’équité en matière d’emploi) pour élaborer ou améliorer les politiques, les programmes, les pratiques et les services.
- Dans l’affirmative, elles devaient préciser les groupes visés par la collecte de données désagrégées, les motifs de la collecte et les domaines pertinents auxquels elle a contribué.
Les institutions fédérales ont réalisé d’importants progrès dans la collecte de données sur la diversité ethnique, raciale et religieuse. La moitié (50 %) d’entre elles ont indiqué qu’elles recueillent des données statistiques désagrégées sur les communautés racisées, sur les minorités religieuses ou sur les peuples autochtones (autre que les données sur l’équité en matière d’emploi) pour élaborer ou améliorer les politiques, les programmes, les pratiques et les services. Ce résultat est légèrement inférieur à celui de l’année dernière (52 %).
Parmi les institutions ayant répondu « oui », la collecte visait les personnes s’identifiant aux communautés suivantes : Premières Nations (95 %), Inuit (95 %), Métis (93 %), personnes noires (92 %), personnes asiatiques (78 %), Latino-Américains (76 %), communautés du Moyen-Orient (75 %), autres groupes racisés (86 %), musulmans (24 %), juifs (25 %), hindous (24 %), sikhs (25 %) et membres d’autres groupes religieux minoritaires (24 %).

Figure 4 : Collecte de données statistiques – version texte
Collecte de données statistiques désagrégées
- Autres minorités religieuses : 24%
- Sikhs : 25%
- Hindous : 24%
- Juifs : 25%
- Musulmans : 24%
- Autres groupes racisés : 86%
- Groupes du Moyen-Orient : 75%
- Latino-Américains : 76%
- Asiatiques : 78%
- Noirs : 92%
- Métis : 93%
- Inuit : 95%
- Premières Nations : 95%
Les institutions fédérales utilisent leurs données pour l’amélioration ou la création de politiques (85 %), de programmes (78 %), de pratiques (66 %) et de services (64 %) dans les domaines du multiculturalisme (73 %), de la lutte contre le racisme (64 %), de la lutte contre la haine (36 %), de la lutte contre l’islamophobie (17 %) et de la lutte contre l’antisémitisme (15 %). Un faible pourcentage des institutions ont signalé que leurs données ne s’appliquent à aucun de ces domaines (10 %) ou qu’elles ne savaient pas (7 %). Les institutions, par exemple, utilisent les données pour orienter les stratégies de dotation, combler les écarts de représentation et mesurer les progrès et l’incidence des programmes sur les bénéficiaires et les clients; et améliorent les systèmes de données afin de faciliter l’analyse, de bonifier la prise de décision et de garantir la transparence et l’accessibilité pour les intervenants. Certaines institutions ont également soulevé des difficultés relatives à la collecte de données, la plus courante étant l’insuffisance de données désagrégées accessibles en temps opportun, à l’interne comme à l’externe. Cette difficulté a surtout été cernée par de petites institutions, qui ne disposent pas d’un système rigoureux pour recueillir systématiquement des données qui leur permettraient de prendre des décisions plus éclairées. Des institutions ont indiqué qu’elles prennent des mesures pour établir une stratégie plus solide de gestion et d’utilisation des données, comme la refonte de leur système de déclaration volontaire. Une des solutions utiles consiste à accroître l’échange de données entre les systèmes, d’abord au sein des institutions fédérales puis éventuellement ailleurs.

Figure 5 : Utilisation des données à des fins d’amélioration – version texte
Utilisation des données à des fins d’amélioration
- Services (p. ex. interactions avec le public) : 64 %
- Pratiques (p. ex. langue utilisée dans les communications internes) : 66 %
- Programmes (p. ex. subventions et contributions) : 78 %
- Politiques (p. ex. politiques d’embauche) : 85 %

Figure 6 : Domaines dans lesquels sont utilisées les données - version texte
Domaines dans lesquels sont utilisées les données
- Multiculturalisme : 73 %
- Lutte contre le racisme : 64 %
- Lutte contre la haine : 36 %
- Lutte contre l’islamophobie : 17 %
- Lutte contre l’antisémitisme : 15 %
- Sans objet : 10 %
- Ne sais pas : 7 %
3.3 Éducation et sensibilisation
L’éducation et la sensibilisation du public sont essentielles pour accroître la compréhension de la mosaïque de cultures et d’enjeux qui touchent les groupes méritant l’équité et pour fournir des outils et des ressources au public et aux institutions fédérales sur la façon d’agir. Dans le cadre de ce thème, les institutions fédérales devaient indiquer si :
- leurs employés participent à de la formation sur le racisme ou la discrimination envers les membres des communautés autochtones, noires et racisées et des communautés religieuses minoritaires;
- elles organisent des initiatives, à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu de travail, visant à éduquer les gens et à les sensibiliser à la diversité ethnoculturelle et raciale ainsi qu’aux défis avec lesquels pourraient devoir composer divers groupes;
- elles ont des comités, des groupes ou des forums pour représenter les préoccupations et les idées des employés qui peuvent appartenir aux communautés autochtones, noires et racisées et aux minorités religieuses;
- dans l’affirmative, elles devaient nommer les groupes représentés et indiquer si un soutien financier est offert;
- elles utilisent des mécanismes pour obtenir auprès des communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses des commentaires sur la conception, l’élaboration ou l’exécution de politiques, de pratiques, de programmes ou de services;
- elles mobilisent les membres des communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses pour obtenir de la rétroaction sur la conception, l’élaboration ou l’exécution des politiques, des programmes, des pratiques ou des services;
- elles consultent des organes d’experts au sujet de questions importantes, comme le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, l’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, et la représentante spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie.
3.3.1 Formation
Les institutions fédérales accordent une grande importance à l’offre de formations sur la diversité et l’inclusion aux employés. Cet engagement est démontré par le fait que 94 % des institutions sondées ont indiqué que leurs employés ont participé à une formation sur le racisme, la discrimination, la diversité ou l’inclusion, un taux légèrement plus élevé que celui de l’année dernière (92 %). À l’instar de celles des années précédentes, les formations ont porté sur une panoplie de sujets, comme la sensibilisation aux cultures, le racisme, les microagressions, les préjugés inconscients, et l’embauche équitable.

Les divers aînés en résidence de RNCan aident tout le monde à mieux comprendre l'histoire, les traditions et les cultures autochtones à travers des récits, des cérémonies autochtones spirituelles et sacrées, des cercles de guérison, des chants et des danses, et d'autres enseignements.
Source : Ressources naturelles Canada

Des employés de Financement agricole Canada participent à un exercice démontrant ce qu’est une cérémonie des couvertures. L’exercice a été organisé par le Groupe d’affinités avec les Autochtones et l’équipe Diversité, équité et inclusion de Financement agricole Canada. Les employés ont ensuite donné un compte-rendu.
Source : Financement agricole Canada.
3.3.2 Activités et produits de communication
Les activités et produits de communication sont d’importants compléments des autres formes d’apprentissage, y compris la formation. Ils sont axés sur la sensibilisation et offrent différentes ressources (webinaires, balados, recherches, articles, outils, etc.) pour aider les employés à se renseigner sur les questions importantes qui touchent les communautés méritant l’équité et leur histoire. Parmi les institutions fédérales, 92 % ont affirmé avoir mis au point des projets, comme des activités ou des produits de communication, au travail ou à l’extérieur pour éduquer et sensibiliser les gens à la diversité ethnoculturelle et aux défis que pourraient devoir surmonter les groupes issus de la diversité. De plus, 92 % des institutions planifient des initiatives internes pour les employés et 43 % le font pour les employés et le public (ces réponses n’étaient pas mutuellement exclusives). Comme c’était le cas l’année dernière, aucune institution fédérale n’a déclaré organiser des initiatives destinées uniquement au public. D’ailleurs, 8 % ont indiqué qu’elles n’ont pas ce type d’initiatives, et 1 % ont dit ne pas savoir. Le taux global d’initiatives est en hausse par rapport à l’année dernière (87 %), probablement en raison de l’adaptation accrue de la fonction publique et de la société aux nouvelles réalités de la pandémie de COVID-19. Dans plusieurs cas, les institutions fédérales ont fait appel à l’expertise de personnes ayant vécu des expériences de racisme et de discrimination afin de stimuler l’intérêt du personnel et d’encourager des discussions approfondies lors d’occasions comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le Jour de l’émancipation et la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie, parmi tant d’autres.

Affiche de l’exposition sur panneaux, Une communauté à la guerre – Le service militaire des Canadiennes et Canadiens noirs de Niagara. Photographie de groupe de William et Lavinia Chandler (assis, à gauche), ainsi que d’autres vétérans de la guerre civile américaine.
Source : Musée canadien de l’histoire et Niagara Military Museum.
3.3.3 Comités, groupes et forums
Un total de 76 % des institutions fédérales ont indiqué avoir des comités, des groupes ou des forums pour représenter les préoccupations et les idées des employés de communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses. Ce résultat est légèrement inférieur à celui de l’année dernière (77 %). Parmi les institutions ayant répondu « oui », leurs comités, groupes ou forums représentent des personnes s’identifiant aux communautés suivantes : Premières Nations (87 %), Inuit (82 %), Métis (85 %), personnes noires (88 %), personnes asiatiques (76 %), Latino-Américains (63 %), communautés du Moyen-Orient (69 %), autres groupes racisés (79 %), musulmans (33 %), juifs (34 %), hindous (24 %), sikhs (25 %) et autres membres de groupes religieux minoritaires (27 %). De plus, 60 % de ces institutions ont déclaré offrir une aide financière aux comités, groupes et forums pour la conduite de leurs activités, une augmentation considérable comparativement à l’année dernière (48 %). Le but des comités, groupes et forums varie d’une institution à l’autre. Entre autres fonctions, ils offrent des espaces sûrs où discuter de questions importantes, contribuent à l’organisation de célébrations, de commémorations et d’activités d’apprentissage pour le personnel ou formulent des conseils aux institutions pour améliorer les politiques, les programmes et les pratiques. Des institutions ont mentionné avoir de la difficulté à établir des comités, des groupes ou des forums pour les employés de minorités religieuses, mais ont dit qu’elles cherchent à le faire.

Figure 10 : Taux de représentation au sein de comités, de groupes ou de forums – version texte
Taux de représentation au sein de comités, de groupes ou de forums
- Autres minorités religieuses : 27 %
- Sikhs : 25 %
- Hindous : 24 %
- Juifs : 34 %
- Musulmans : 33 %
- Autres groupes racisés : 79 %
- Groupes du Moyen-Orient : 69 %
- Latino-Américains : 63 %
- Asiatiques : 76 %
- Noirs : 88 %
- Métis : 85 %
- Inuit : 82 %
- Premières Nations : 87 %
3.3.4 Mécanismes externes de collecte des commentaires
Si les comités, les groupes et les forums constituent des mécanismes internes de collecte de commentaires, 90 % des institutions fédérales sondées possèdent également différents mécanismes externes pour recueillir les commentaires des communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses, par exemple : des réseaux (72 %), des partenariats (64 %), des consultations (74 %), des conseils consultatifs (56 %) et d’autres outils (38 %) comme des courriels, des sondages, des groupes de travail et des entrevues. L’utilisation de la plupart de ces mécanismes a augmenté comparativement à l’année dernière, où elle était de 65 % pour les réseaux, de 60 % pour les partenariats, de 69 % pour les consultations, de 52 % pour les conseils consultatifs et de 44 % pour les autres outils. Un faible pourcentage des institutions ont dit ne pas avoir de tels mécanismes (10 %). Les institutions fédérales utilisent ces mécanismes pour améliorer les pratiques internes (70 %), améliorer la conception, l’élaboration ou l’exécution des programmes, des pratiques ou des services (77 %), et réduire les obstacles systémiques pour les communautés (64 %). Enfin, 18 % d’entre elles, qui possèdent ou non de tels mécanismes, ont dit ne pas avoir mobilisé les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses en 2022-2023.

Figure 11 : Mécanismes de collecte de commentaires – version texte
Mécanismes de collecte de commentaires
- Réseaux : 72 %
- Consultations : 74 %
- Autres mécanismes de mobilisation : 38 %
- Partenariats : 64 %
- Conseils consultatifs : 56 %
- Aucun mécanisme : 10 %
3.3.5 Mobilisation d’organes d’experts
Cette nouvelle section expose la nature des consultations des institutions fédérales auprès d’organes d’experts, qui peuvent les aider à traiter d’importantes questions, notamment les disparités, les difficultés, le racisme systémique ou les obstacles systémiques auxquels se heurtent les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses. Lorsqu’on a demandé aux institutions fédérales si elles consultaient le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, qui a été établi au lancement de la SCLR en 2019, 34 % ont répondu « oui », 63 % ont répondu « non » et 3 % ont dit ne pas savoir. Celles qui ont répondu « oui » ont également indiqué le motif de leurs consultations : réformer les systèmes de justice, d’application de la loi, de renseignement et de sécurité publique (32 %); faire avancer l’équité raciale dans les systèmes d’immigration, de santé et de logement (20 %); promouvoir l’autonomie économique, sociale et culturelle (59 %); faire avancer l’équité raciale et l’inclusion à l’échelle mondiale et multilatérale (46 %); et autres (37 %). Les autres motifs comprennent la diversité, la sensibilisation aux cultures et à l’inclusion, l’équité, l’établissement de partenariats, et la reddition de comptes.

Figure 12 : Motif des consultations avec le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme – version texte
Motif des consultations avec le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme
- Autres : 37 %
- Faire avancer l’équité raciale et l’inclusion à l’échelle mondiale et multilatérale : 20 %
- Promouvoir l’autonomie économique, sociale et culturelle : 59 %
- Faire avancer l’équité raciale dans les systèmes d’immigration, de santé et de logement : 46 %
- Réformer les systèmes de justice, d’application de la loi, de renseignement et de sécurité publique : 32 %
Lorsqu’on a demandé aux institutions fédérales si elles consultaient l’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, l’honorable Irwin Cotler, en poste de novembre 2020 à octobre 2023, 41 % d’entre elles ont indiqué connaître le rôle et le mandat de l’envoyé spécial et, parmi elles, 22 % ont dit avoir eu recours à ses services. Des institutions qui ont eu recours à ses services, 55 % ont répondu avoir consulté l’envoyé spécial ou utilisé ses recommandations pour l’élaboration de politiques et de programmes ou la prise de décision. D’autre part, 55 % de toutes les institutions fédérales ont déclaré qu’elles ne connaissent pas le rôle de l’envoyé spécial et 4 % ont dit ne pas savoir; ces deux groupes ne consultent ni l’envoyé spécial ni ses produits.
Enfin, une même question a été posée sur le rôle et le mandat de la première représentante spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, nommée le 20 février 2023. Un total de 41 % des institutions fédérales ont répondu qu’elles connaissent ce rôle. Parmi elles, 39 % ont déclaré avoir l’intention de consulter la représentante spéciale pour faire avancer leurs travaux. De toutes les institutions, 53 % ont répondu qu’elles ne connaissent pas ce rôle, et 5 % ne sont pas certaines de le connaître.
D’autres études doivent être menées afin de comprendre pourquoi les institutions fédérales choisissent ou non d’interagir avec les organes d’experts ayant d’importants mandats nationaux et internationaux, et afin de cerner les mécanismes de consultation utilisés. À la lumière des tendances initiales, ce sont les institutions fédérales dotées de budgets de fonctionnement importants et de politiques et de programmes qui ont une incidence sur la population canadienne et/ou internationale, notamment dans les domaines de l'économie, de la santé, de la sécurité, de l'immigration, de la justice et de la culture, qui s'alignent sur les mandats du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, de l'envoyé spécial et/ou de la représentante spéciale. Ces institutions fédérales ont une connaissance préalable de ces organismes et collaborent déjà avec eux dans le cadre de leur travail. Étant donné que la reconnaissance et la compréhension de questions telles que le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie augmentent, il est possible que les taux indiqués de sensibilisation, d'engagement et de consultation augmentent également.
3.4 Promotion et célébration
La promotion et la célébration de la contribution historique et du patrimoine des communautés de toutes origines à la société canadienne nous permettent de continuer à apprendre les uns des autres et à magnifier notre diversité. Dans le cadre de ce thème, les institutions fédérales devaient indiquer si :
- elles ont mis en œuvre des initiatives pour promouvoir et célébrer la contribution historique et le patrimoine des communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses à la société canadienne (p. ex. des événements ou des produits de communication);
- dans l’affirmative, elles devaient indiquer les groupes ciblés par les initiatives de promotion et de célébration internes et externes.
Parmi les institutions fédérales sondées, 92 % mettent en œuvre des initiatives pour promouvoir et célébrer la contribution historique à la société canadienne et le patrimoine des communautés de toutes origines, un taux plus élevé que celui de l’année dernière (86 %). De ce nombre, 90 % ont affirmé avoir des initiatives destinées aux employés et 44 % ont déclaré avoir des initiatives destinées au public (ces réponses n’étaient pas mutuellement exclusives). Un faible pourcentage des institutions (8 %) ont indiqué qu’elles n’ont pas ce type d’initiatives. Ces initiatives prennent toutes sortes de formes : messages par courriel et sur l’intranet; création et diffusion d’histoires, de vidéos et de calendriers multiculturels; spectacles et événements en direct lors d’occasions comme le Mois du patrimoine asiatique, le Mois de l’histoire des Noirs, le Mois du patrimoine juif canadien, le Mois du patrimoine latino-américain, la Journée canadienne du multiculturalisme et bien d’autres encore. Les institutions fédérales profitent également des journées, des semaines et des mois de célébration et de commémoration pour faire rayonner leurs efforts d’éducation et de sensibilisation.

Installation d’œuvres sur oriflammes au pont Honoré-Mercier. Cette initiative a été réalisée conjointement avec le Conseil mohawk de Kahnawà:ke. Elle vise à saluer l’apport des Premières Nations à l’histoire du pays et à célébrer la culture mohawk. Les œuvres représentées sur les oriflammes ont été créées par des membres de la communauté de Kahnwà:ke.
Source : Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.

Deux traditions au cœur de la célébration du triomphe du bien sur le mal se marient pour illuminer le nouveau timbre consacré à Diwali. Observée par les hindous, les bouddhistes, les jaïns, les sikhs et d’autres communautés dans le monde, l'annee derniere, cette fete importante a ete celebree le 24 octobre 2022.
Source : Société canadienne des postes

En 2022, la Monnaie royale canadienne a rendu hommage à l’un des plus grands musiciens au monde avec une nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $ qui célèbre la vie et le legs artistique du Canadien Oscar Peterson. Oscar Peterson (1925-2007) a ébloui le monde entier par sa virtuosité, ses improvisations musicales et ses quelque 200 compositions originales, y compris Hymn to Freedom, qui est devenu l’hymne du mouvement des droits civiques des années 1960.
Source : Monnaie royale canadienne
Les initiatives de promotion et de célébration mises en œuvre par les institutions fédérales sont vastes et touchent, à l’interne et à l’externe respectivement, les membres des communautés suivantes : Premières Nations (97 % et 98 %), Inuit (89 % et 85 %), Métis (90 % et 87 %), personnes noires (90 % et 77 %), personnes asiatiques (73 % et 57 %), Latino-Américains (43 % et 28 %), communautés du Moyen-Orient (45 % et 26 %), autres groupes racisés (57 % et 32 %), musulmans (58 % et 25 %), juifs (56 % et 23 %), hindous (28 % et 13 %), sikhs (28 % et 13 %) et autres groupes religieux minoritaires (23 % et 6 %).

Figure 16 : Taux d’initiatives de célébration et de promotion internes et externes – version texte
Taux d’initiatives internes et externes de célébration et de promotion
- Premières Nations : 97 % internes et 98 % externes
- Inuit : 89 % internes et 85 % externes
- Métis : 90 % internes et 87 % externes
- Noirs : 90 % internes et 77 % externes
- Asiatiques : 73 % internes et 57 % externes
- Latino-Américains : 43 % internes et 28 % externes
- Groupes du Moyen-Orient : 45 % internes et 26 % externes
- Autres groupes racisés : 57 % internes et 32 %externes
- Musulmans : 58 % internes et 25 % externes
- Juifs : 56 % internes et 23 % externes
- Hindous : 28 % internes et 13 % externes
- Sikhs : 28 % internes et 13 % externes
- Autres minorités religieuses : 23 % internes et 6 % externes
3.5 Prévention et solutions

Ces bannières soulignent la main-d’œuvre multiculturelle du SCC et sont utilisées aux événements tels que les salons de carrières, les présentations aux écoles et les séances d’informations.
Source : Service correctionnel Canada.
Les ministères et organismes fédéraux prennent des mesures concrètes afin que les personnes et les communautés de toutes origines puissent participer équitablement à la société canadienne. Pour cerner ces activités, les institutions ont dû indiquer si :
- elles disposent d’un processus pour cerner les éléments de racisme systémique ou les obstacles systémiques dans leurs politiques et pratiques en matière d’emploi auxquels font face les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses (p. ex. recrutement, maintien en poste et promotion);
- elles disposent de moyens pour veiller à ce que les membres des communautés autochtones, noires et racisées et des minorités religieuses aient la possibilité d’apprendre les langues officielles et de satisfaire aux exigences linguistiques de leur poste;
- elles tirent parti de la capacité multilingue, de la compétence culturelle ou de l’expertise culturelle de leurs employés pour éclairer ou améliorer leurs politiques, programmes, pratiques et services;
- dans l’affirmative, elles devaient indiquer si elles tirent parti de la maîtrise des langues autochtones, de la compétence culturelle autochtone ou de l’expertise culturelle autochtone de leurs employés pour éclairer ou améliorer leurs politiques, programmes, pratiques et services;
- elles prennent part à des discussions sur des sujets comme les disparités, les difficultés, le racisme systémique ou les obstacles rencontrés par les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses, et si elles s’emploient à renforcer leurs capacités à s’attaquer à ces problèmes;
- elles ont des programmes de paiements de transfert (p. ex. subventions et contributions) qui s’attaquent directement au racisme systémique ou aux obstacles systémiques auxquels font face les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses.
3.5.1 Recrutement et perfectionnement professionnel
La difficulté la plus fréquemment soulevée sous le thème « Prévention et solutions » est les écarts de représentation et, dans la même veine, les obstacles au recrutement et au maintien en poste de talents issus de la diversité. Parmi les institutions fédérales, 79 % ont indiqué avoir mis en place des processus pour cerner les éléments de racisme systémique ou les obstacles systémiques dans leurs politiques et pratiques en matière d’emploi auxquels font face les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses. Ce résultat est légèrement plus élevé que celui de l’année dernière (78 %). Les institutions utilisent un éventail de méthodes pour éliminer les obstacles à l’emploi, comme la modification des exigences de poste, des programmes de stages ciblés, des initiatives d’emploi pour les jeunes et la sensibilisation auprès des organismes d’aide aux immigrants, des collèges et des universités.
Aux fins de recrutement et de perfectionnement professionnel, la maîtrise des langues officielles du Canada est une compétence essentielle qui permet aux fonctionnaires de communiquer efficacement à l’interne et de mieux servir le public. Les institutions fédérales insistent beaucoup sur les possibilités pour les communautés autochtones, noires et racisées ou les communautés de langues officielles en situation minoritaire d’apprendre les langues officielles et de maintenir leur niveau de compétence, tout en ajustant régulièrement les exigences d’emploi et d’avancement. Au total, 84 % d’entre elles prennent au moins l’une des mesures suivantes : autoriser la dotation bilingue non impérative (81 %), offrir une formation linguistique aux employés de certaines communautés (77 %), examiner périodiquement le profil linguistique des postes (70 %), offrir des ressources d’autoapprentissage ou l’autoapprentissage en ligne (69 %), maintenir les postes unilingues anglais ou français (80 %), offrir l’accompagnement d’un encadreur en langues officielles aux employés de certaines communautés (30 %) et autres (21 %). Pour ce qui est des autres mesures, la plupart ont indiqué qu’elles offrent et appuient les occasions de formation linguistique pour les employés de tous les horizons.

Figure 18 : Moyens utilisés pour appuyer les possibilités et le perfectionnement en matière de langues officielles – version texte
Moyens utilisés pour appuyer les possibilités et le perfectionnement en matière de langues officielles
- Autres : 21 %
- Encadreur en langues officielles : 30 %
- Utilisation des postes unilingues anglais ou français : 80 %
- Ressources d’autoapprentissage/autoapprentissage en ligne : 69 %
- Examens périodiques des profils linguistiques des postes : 70 %
- Formation linguistique : 77 %
- Dotation bilingue non impérative : 81 %
3.5.2 Traduction et mobilisation des compétences linguistiques et de la compréhension culturelle

Dépliant en langue dari pour le projet pilote visant à prolonger la durée de la couverture des services de counseling en santé mentale pour les réfugiés afghans dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire. Des dépliants ont également été produits en pachtou.
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Informations sur les droits des victimes et sur la manière dont le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels peut les aider, en langue inuktitut. Brochure également disponible en algonquin, en cri et en ojibway.
Source : Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Lorsqu’on leur a demandé si elles traduisaient leur contenu dans des langues autres que l’anglais ou le français, 53 % des institutions fédérales ont répondu « oui » et 47 % ont répondu « non », soit le même résultat que l’année dernière. Les deux principaux facteurs utilisés pour trancher sont : le fait qu’un organisme dispose ou non de politiques, de programmes et de services destinés au public et, le cas échéant, le fait que la traduction ou l’interprétation augmenterait ou non de manière notable l’accessibilité pour les communautés méritant l’équité. Des exemples de langues dans lesquelles le contenu est traduit pour les communautés racisées et les minorités religieuses sont, notamment, le chinois, le japonais, le coréen, le tagalog, l’allemand, l’italien, le hollandais, l’espagnol, le portugais, l’arabe, l’hébreu, le pendjabi et l’hindi. Certaines institutions ont par ailleurs signalé qu’elles offrent du contenu dans la langue des signes américaine, dans la langue des signes québécoise et en braille. Des institutions fédérales ont également déclaré traduire leur contenu dans des langues autochtones afin d’accroître l’accessibilité de leurs programmes et de leurs services pour les peuples autochtones (p. ex. algonquin, cri, chipewyan, inuktitut, inuinnaqtun, mi’kmaq, mohawk, ojibwe).
Le sondage contenait en outre une question pour savoir si les institutions mobilisent la capacité multilingue, la compétence culturelle ou l’expertise culturelle de leurs employés pour éclairer ou améliorer leurs politiques, leurs programmes, leurs pratiques et leurs services. Le taux de réponses négatives était de 32 %, alors que celui des réponses affirmatives était de 68 %, une augmentation notable par rapport à l’année dernière (56 %). Parmi les institutions ayant répondu « oui », 80 % ont également affirmé qu’elles tirent parti de la maîtrise des langues autochtones, de la compétence culturelle autochtone ou de l’expertise culturelle autochtone (19 % ont répondu « non » et 1 % ont dit ne pas savoir). De ce fait, il est fort probable que celles ayant répondu « oui » à la première question sur la mobilisation tirent parti, entre autres, des capacités linguistiques autochtones, de la compétence culturelle autochtone ou de l’expertise culturelle autochtone.
3.5.3 Discussions pour cerner et éliminer les obstacles systémiques
Les obstacles systémiques sont la culture organisationnelle, les politiques, les directives, les pratiques ou les procédures qui excluent, supplantent ou marginalisent certains groupes, en particulier les peuples autochtones, les communautés noires, racisées et religieuses minoritaires par la création d’obstacles injustes qui les empêchent d’avoir accès à des avantages et à des possibilités de valeur. Parmi les institutions fédérales, 81 % ont indiqué qu’elles prennent part à des discussions sur des sujets comme les disparités, les difficultés, le racisme systémique ou les obstacles rencontrés par les communautés autochtones, noires et racisées et les minorités religieuses, et qu’elles s’emploient à renforcer leurs capacités à s’attaquer à ces problèmes. De nombreuses institutions ont signalé avoir pris des engagements en matière de diversité, d’inclusion, d’équité et d’accessibilité. Ces engagements sont indépendants ou font partie d’un plan d’action pluriannuel visant à créer des milieux de travail plus harmonieux qui représentent la diversité canadienne, à optimiser le travail des organismes auprès du public, notamment en se penchant sur différentes questions sectorielles, et à mieux servir les communautés marginalisées ou traditionnellement mal desservies.
Ces communautés comprennent les suivantes : Premières Nations (99 %), Inuit (91 %), Métis (92 %), communautés noires (91 %), communautés asiatiques (72 %), Latino-Américains (56 %), communautés du Moyen-Orient (57 %), autres groupes racisés (67 %), communautés musulmanes (48 %), juives (41 %), hindous (25 %), sikhs (27 %) et autres groupes religieux minoritaires (29 %).

Figure 21 Communautés d’intérêt pour les discussions et les interventions – version texte
Communautés d’intérêt pour les discussions et les interventions
- Premières Nations : 99 %
- Inuit : 91 %
- Métis : 92 %
- Noirs : 91 %
- Asiatiques : 72 %
- Latino-Américains : 56 %
- Groupes du Moyen-Orient : 57 %
- Autres groupes racisés : 67 %
- Musulmans : 48 %
- Juifs : 41 %
- Hindous : 25 %
- Sikhs : 27 %
- Autres minorités religieuses : 29 %
3.5.4 Programmes de paiements de transfert (subventions et contributions)
Les programmes de paiements de transfert comprennent ceux qui apportent un financement direct à des particuliers ou à des organismes à des fins précises, allant du soutien d’activités telles que l’agriculture, l’entrepreneuriat, la planification de la sécurité communautaire, le logement, les programmes culturels et artistiques, l’emploi, la recherche, l’élaboration d’outils et de ressources, et plus encore. De toutes les institutions fédérales, 36 % ont indiqué qu’elles ont des programmes de paiements de transfert qui visent directement le racisme systémique ou les obstacles systémiques, 63 % ont déclaré ne pas en avoir et 1 % ont répondu ne pas savoir. Ces résultats sont légèrement en hausse par rapport à l’année dernière, où 35 % avaient répondu « oui ». Les programmes de paiements de transfert touchent les domaines suivants : réformer les systèmes de justice, d’application de la loi, de renseignement et de sécurité publique (23 %); faire avancer l’équité raciale dans les systèmes d’immigration, de santé et de logement (28 %); promouvoir l’autonomie économique, sociale et culturelle (84 %); faire avancer l’équité raciale et l’inclusion à l’échelle mondiale et multilatérale (30 %); et autres (40 %). La catégorie « Autres » comprend, par exemple, les initiatives relatives aux changements climatiques et à l’écologisation pour certaines collectivités, l’autodétermination autochtone, la réconciliation avec les peuples autochtones, la recherche et la mobilisation des connaissances.

Figure 22 : Domaines d’intérêt pour les programmes de paiements de transfert – version texte
Domaines d’intérêt pour les programmes de paiements de transfert
- Autres : 40 %
- Faire avancer l’équité raciale et l’inclusion à l’échelle mondiale et multilatérale : 30 %
- Promouvoir l’autonomie économique, sociale et culturelle : 84 %
- Faire avancer l’équité raciale dans les systèmes d’immigration, de santé et de logement : 28 %
- Réformer les systèmes de justice, d’application de la loi, de renseignement et de sécurité publique : 23 %
Conclusion
Le présent rapport brosse le tableau de ce qu’ont fait les institutions fédérales pour démontrer leur détermination à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui reflètent l’essence du multiculturalisme, de la diversité et de l’inclusion. Les parties 1 et 2 étaient axées sur les mesures liées au Programme du multiculturalisme et de lutte contre le racisme, surtout sur ses activités rattachées aux trois piliers de la SCLR : faire preuve de leadership, habiliter les communautés, et sensibiliser et changer les attitudes. D’autres éléments ont été soulignés, comme des investissements communautaires, des événements commémoratifs et d’importantes organisations qui contribuent au mandat du programme.
La partie 3 du rapport a fait un survol des activités menées par les institutions fédérales afin de renforcer le mandat gouvernemental relatif au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme dans les quatre thèmes suivants : collecte de données, éducation et sensibilisation, promotion et célébration, prévention et solutions. Les institutions fédérales ont recueilli et utilisé des données pour parfaire les politiques, les pratiques et les programmes destinés aux communautés autochtones, noires et racisées et aux minorités religieuses. Elles ont aussi promu et exécuté des initiatives pour sensibiliser les gens aux défis que doivent surmonter les communautés diversifiées et pouvoir ainsi mieux servir les Canadiens; fourni des outils encourageant la mobilisation; et célébré les communautés dynamiques du Canada dans un esprit d’optimisme à l’égard de la création d’un avenir meilleur. De plus, elles ont renforcé leur équité à l’aide de pratiques d’embauche améliorées, du développement du potentiel de leur personnel et de l’utilisation efficace des connaissances et des compétences des employés. Simultanément, elles ont amélioré l’accès du public aux programmes et aux services et pris des mesures directes pour éliminer le racisme systémique, les obstacles et la haine envers les communautés méritant l’équité.

Figure 23 : Infographie sur les points saillants en lien avec la mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans les institutions fédérales – version texte
Points saillants en lien avec la mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans les institutions fédérales
- Taux de réponse
- 120 institutions fédérales ont fourni une soumission pour le Rapport annuel sur l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien 2022-2023, soit un taux de réponse de 86 %.
- Collecte de données
- 50 % des institutions fédérales ont collecté des données statistiques ventilées sur les communautés racisées, les communautés religieuses minoritaires et/ou les peuples autochtones afin d'élaborer et/ou d'améliorer les politiques, les programmes, les pratiques et/ou les services.
- Éducation et sensibilisation
- 94 % des institutions fédérales ont indiqué que leurs employés ont participé à des formations sur le racisme, la discrimination, la diversité et l'inclusion, et 92 % ont organisé des événements ou créé des produits pour aider les employés à s'informer sur les questions importantes qui touchent les communautés méritant l'équité.
- 76 % des institutions fédérales ont mis en place des comités, des groupes ou des forums pour représenter les préoccupations et les idées des employés autochtones, noirs ou issus de communautés racisées ou religieuses minoritaires, et 90 % des institutions fédérales ont mis en place des mécanismes pour recueillir les commentaires des communautés.
- Promotion et célébration
- 92 % des institutions fédérales ont mis en place des initiatives visant à promouvoir et à célébrer les contributions historiques et le patrimoine des communautés de toutes origines à la société canadienne.
- Prévention et solutions
- 79 % des institutions fédérales ont mis en place des processus pour identifier le racisme systémique ou les obstacles systémiques dans les politiques et pratiques d'emploi auxquels sont confrontés les peuples autochtones, les Noirs, les communautés racisées et les communautés religieuses minoritaires, et ont pris des mesures pour y remédier.
- 84 % des institutions fédérales ont encouragé les possibilités d'emploi dans les langues officielles pour favoriser les carrières et l'avancement dans la fonction publique.
- 68 % des institutions fédérales ont tiré parti de la capacité multilingue, de la compétence culturelle et/ou de l'expertise culturelle de leurs employés pour informer et/ou améliorer les politiques, les programmes, les pratiques et les services de leur institution.
Enfin, outre les défis susmentionnés, les institutions fédérales ont rencontré d’importantes difficultés globales dans chacun des thèmes. D’abord, compte tenu de la reconnaissance croissante de l’importance de la diversité, de l’inclusion, de l’équité et de l’accessibilité, et considérant la nécessité immuable des initiatives de lutte contre le racisme, la discrimination et la haine, ces efforts doivent être soutenus en veillant à ce que les institutions fédérales aient la capacité de s’adapter à l’évolution constante de la réalité et des besoins du Canada, notamment grâce à une meilleure coordination et au soutien des efforts mutuels entre les institutions. Une difficulté étroitement liée à celle-ci est le besoin d’offrir des formations, des événements et des produits mieux adaptés à la main-d’œuvre, qui prend de plus en plus conscience des questions d’intérêt (diversité, inclusion, racisme, discrimination, préjugés et haine) et qui se diversifie toujours plus du côté de ses origines, de ses connaissances et de ses compétences. Comme dernier point, de nombreuses institutions fédérales ont admis que les obstacles présents dans les sphères économique, culturelle, sociale et politique du Canada nuisent encore à la vie des communautés autochtones, noires et racisées, des minorités religieuses et d’autres communautés méritant l’équité, et qu’ils doivent être démantelés. Alors que les préoccupations s’éclaircissent et que l’importance et la compréhension de ces questions se solidifient, les institutions sont mieux outillées et ont de meilleures capacités, comme le démontrent les initiatives présentées dans ce rapport. Les institutions fédérales reconnaissent que le changement, dans les lieux de travail et dans la société, est un processus à long terme qui nécessite des efforts constants.
Le travail qu’effectuent Patrimoine canadien et de nombreuses autres institutions fédérales est complexe, mobilise différents intervenants et se répercute sur plusieurs secteurs, au pays comme à l’étranger. Bien qu’il soit essentiel de souligner les progrès importants réalisés dans l’ensemble des institutions fédérales pour renforcer le multiculturalisme, promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion et lutter contre le racisme systémique et la discrimination, il est aussi important de reconnaître les obstacles qui doivent être surmontés pour que nous obtenions des résultats déterminants et positifs à long terme. Le gouvernement du Canada poursuivra les travaux qui permettront la participation complète et équitable de tous et toutes à la société canadienne.
Annexe A : Liste des institutions fédérales participantes
- Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
- Administration de pilotage de l’Atlantique
- Administration de pilotage des Grands Lacs
- Administration de pilotage du Pacifique
- Administration du pipe-line du Nord
- Affaires mondiales Canada
- Agence canadienne d’évaluation d’impact
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Agence canadienne de développement économique du Nord
- Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Agence de la consommation en matière financière du Canada
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence du revenu du Canada
- Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario
- Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
- Agence spatiale canadienne
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Anciens combattants Canada
- Banque de développement du Canada
- Banque du Canada
- Bibliothèque et Archives Canada
- Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
- Bureau de la sécurité des transports du Canada
- Bureau du commissaire au renseignement
- Bureau du Conseil privé
- Bureau du surintendant des institutions financières
- Bureau du vérificateur général du Canada
- CBC/Radio-Canada
- Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
- Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
- Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Centre de la sécurité des télécommunications
- Centre de recherche pour le développement international
- Centre de recherche sur le développement international
- Centre national des Arts
- Comité externe d’examen de la GRC
- Commissaire à l’information du Canada
- Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
- Commissariat à la magistrature fédérale Canada
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Commissariat au lobbying du Canada
- Commission canadienne des droits de la personne
- Commission canadienne des grains
- Commission canadienne du lait
- Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC
- Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
- Commission de la capitale nationale
- Commission de la fonction publique du Canada
- Commission des champs de bataille nationaux
- Commission du droit d’auteur du Canada
- Conseil canadien des normes
- Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
- Conseil des arts du Canada
- Conseil des produits agricoles du Canada
- Conseil national de recherches du Canada
- Construction de défense (1951) Limitée (faisant des affaires sous le nom de Construction de défense Canada)
- Corporation de développement des investissements du Canada
- Cour suprême du Canada
- Développement économique Canada pour le Pacifique
- Développement économique Canada pour les Prairies
- École de la fonction publique du Canada
- Élections Canada
- Emploi et Développement social Canada
- Énergie atomique du Canada limitée
- Environnement et Changement climatique Canada
- Exportation et développement Canada
- Femmes et Égalité des genres Canada
- Financement agricole Canada
- Fondation canadienne des relations raciales
- Gendarmerie royale du Canada
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Infrastructure Canada
- Ingenium – musées des sciences et de l’innovation du Canada
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada
- Instituts de recherche en santé du Canada
- La Société des ponts fédéraux Limitée
- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
- Marine Atlantique
- Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes
- Ministère de la Justice Canada
- Ministère des Finances du Canada
- Monnaie royale canadienne
- Musée canadien de l’histoire
- Musée canadien de l’immigration du Quai 21
- Musée canadien de la nature
- Musée des beaux-arts du Canada
- Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP)
- Office d’investissement du régime de pensions du Canada
- Office des transports du Canada
- Office national du film du Canada
- Parcs Canada
- Patrimoine canadien
- Pêches et Océans Canada
- Régie de l’énergie du Canada
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
- Ressources naturelles Canada
- Santé Canada
- Savoir polaire Canada
- Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
- Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Sécurité publique Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Service correctionnel du Canada
- Service des poursuites pénales du Canada
- Services partagés Canada
- Services publics et Approvisionnement Canada
- Société canadienne d’hypothèques et de logement
- Société canadienne des postes
- Statistique Canada et Opérations des enquêtes statistiques
- Téléfilm Canada
- Transports Canada
- Via Rail Canada
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada (2024).
No de catalogue : CH31-1F-PDF
ISSN 1497-7435