ARCHIVÉ : Chapitre 10 : Les jeunes au Canada : leur santé et leur bien-être – La santé émotionnelle

La santé émotionnelle devrait préoccuper tous les Canadiens. Environ 20 p. 100 des habitants du Canada contracteront une maladie mentale quelconque dans leur vie (la dépression, la schizophrénie, la psychose, etc.). On estime que 2,5 millions de Canadiens de plus de 18 ans souffriront de troubles dépressifs (Association canadienne pour la santé mentale, 2002). De plus, une proportion élevée (66 p. 100) du phénomène des sans-abri (Association canadienne pour la santé mentale, 2002) et des suicides (Moscicki, 1999) au Canada est liée à une piètre santé émotionnelle. Malgré ces pourcentages élevés, l'importance réelle du problème peut être sous-estimée, puisque les gens peuvent ne pas toujours être disposés à admettre qu'ils souffrent de problèmes affectifs. Cette proportion relativement élevée de personnes souffrant de problèmes affectifs s'accompagne de coûts financiers et sociétaux. Un récent rapport soulignait qu'on consacre 14,4 milliards de dollars par année au traitement des maladies mentales au Canada (Joubert et Stephens, 2001). Ils prévoient même que ce montant augmentera au point où la maladie mentale représentera la principale dépense en santé au pays d'ici à 2020 (Association des psychiatres du Canada, 2001).
Les problèmes de santé émotionnelle qui surviennent à l'adolescence ne persistent pas nécessairement toute la vie (Elder et Crosnoe, 2002). La plupart des individus peuvent mener une vie saine et productive moyennant un traitement approprié, tel que le soutien psychologique individuel et/ou collectif ou des médicaments appropriés (Diverty et Beaudet, 1997). Il est donc essentiel de comprendre l'ampleur et l'origine des troubles émotifs chez les adolescents canadiens de façon qu'ils puis-sent être traités convenablement.
L'enquête HBSC de 2002 mesurait l'état de santé émotionnelle des jeunes de la 6e à la 10e année sur deux plans : sur le plan symptomatique et sur le plan global. Au niveau symptomatique, une liste de contrôle de huit points a été dressée. Quatre points mesuraient les indicateurs psychologiques de la santé émotionnelle (le fait d'être déprimé ou d'avoir le cafard, l'irritabilité ou la mauvaise humeur, la nervosité et les étourdissements) et quatre points mesuraient les facteurs somatiques (les maux de tête, les maux d'estomac, les maux de dos et la difficulté à s'endormir). L'échelle est flexible en ce sens que les scores sommaires (Haugland, Wold, Stevenson, AarØ et Woynarowska, 2001) et les scores individuels (Torsheim et Wold, 2001) sont significatifs. On a demandé aux adolescents à quelle fréquence ils avaient souffert de ces malaises, qui représentent des indicateurs de la santé émotionnelle, dans les six derniers mois (« presque chaque jour », « plus d'une fois par semaine », « presque chaque semaine », « presque chaque mois » et « rarement ou jamais »).
Les élèves ont dû répondre à deux questions globales sur la perception qu'ils ont de leur état de santé. Pour répondre à la première question sur la satisfaction au regard de leur vie, les élèves devaient évaluer leur vie au moyen d'une échelle de 11 niveaux, « 10 » correspondant à la meilleure vie possible et « 0 », à la pire vie possible. Cette échelle s'est montrée un instrument valable de l'évaluation du degré de satisfaction chez les adultes (Cantril, 1965), bien qu'il faille encore la valider comme mesure de la satisfaction chez les adolescents. Deuxièmement, les jeunes devaient décrire simplement leur état de santé en choisissant parmi « excellent », « bon », « moyen » ou « mauvais ». Cette question s'est révélée une mesure utile de la santé émotionnelle dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques d'envergure (Idler et Benyamini, 1997).
Les indicateurs psychosomatiques de la santé émotionnelle
Pour les besoins du présent rapport, notre examen a porté sur quatre symptômes individuels de la santé émotionnelle (deux symptômes somatiques et deux symptômes psychologiques) : les maux de tête, les maux de dos, le fait d'être déprimé ou d'avoir le cafard et l'irritabilité ou la mauvaise humeur. Ces symptômes ont été retenus parce qu'ils avaient été étudiés dans les rapports HBSC précédents au Canada (King, Boyce et King, 1999).
Les maux de tête
Les maux de tête ont de plus en plus fait l'objet de recherches ces dernières années, étant donné que leur corrélation avec le stress des adolescents a été très bien établie (Reynolds, O'Koon, Papademetriou et Szczygiel, 2001; Waldie, 2001). La figure 10.1 montre les pourcentages d'adolescents qui ont dit avoir souffert de maux de tête au moins une fois par semaine. À chaque niveau, un nombre considérablement plus élevé de filles que de garçons ont déclaré souffrir de maux de tête chaque semaine. Par exemple, tandis que 19 p. 100 des garçons de 6e année déclaraient avoir des maux de tête chaque semaine, 27 p. 100 des filles de ce niveau en faisaient autant. En outre, le nombre de répondants qui disaient souffrir de maux de tête augmentait à chaque niveau, tant chez les garçons que chez les filles. Cette augmentation était plus marquée chez les filles entre la 7e et la 8e année (33 p. 100 et 43 p. 100 respectivement).
Figure 10.1 Élèves qui ont souffert de maux de tête au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois (%)
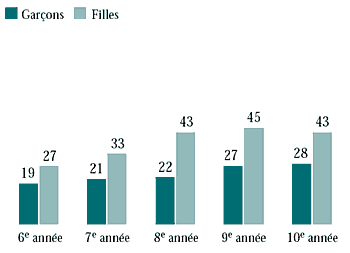
En ce qui concerne les maux de tête, la tendance à la baisse signalée dans le rapport précédent (King et coll., 1999) se poursuit en 2002, à l'exception des filles de 8e année et des garçons de 10e année (figure 10.2). Chez ces deux groupes en effet, le pourcentage d'élèves souffrant de maux de tête était plus élevé que dans les deux enquêtes HBSC précédentes. C'est chez les garçons de 8e année - le seul groupe où la proportion d'élèves souffrant de maux de tête a augmenté de 1994 à 1998 - que les maux de tête étaient à leur plus faible niveau dans les trois dernières enquêtes.
Figure 10.2 Éleves qui ont souffert de maux de tête au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois, selon l'année de l'enquête (%)
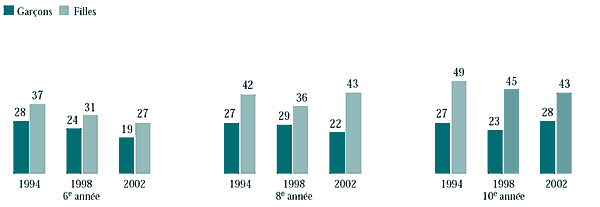
Les maux de dos
Contrairement à ce que l'on observait relativement à la plupart des autres indicateurs de la santé émotionnelle, le nombre de garçons et de filles déclarant souffrir de maux de dos était sem blable (figure 10.3). Le nombre d'élèves disant souffrir de maux de dos a régulièrement grandi par niveau, la hausse la plus marquée survenant après la 7e année (semblable en cela à la tendance relative aux maux de tête pour les filles).
Figure 10.3 Élèves qui ont souffert de maux de dos au moins une fois par mois au cours des six derniers mois (%)
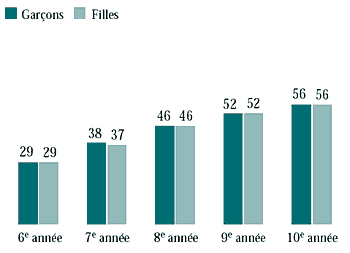
L'analyse des tendances relatives aux maux de dos (figure 10.4) ne met au jour aucun schéma systématique pour les trois dernières enquêtes. Cependant, le nombre d'élèves déclarant des maux de dos a diminué à chaque niveau 6e année 7e année 8e année 9e année 10e année chez les garçons et les filles depuis 1998. Les garçons de 8e année représentaient la seule exception; le nombre de maux de dos déclarés chez ce groupe est demeuré stable à 46 p. 100. La plus importante baisse entre les enquêtes a été enregistrée chez les élèves de 6e année : de 40 p. 100 à 29 p. 100 chez les garçons et de 38 p. 100 à 29 p. 100 chez les filles.
Figure 10.4 Élèves qui ont souffert de maux de dos au moins une fois par mois au cours des six derniers mois, selon l'année de l'enquête (%)

La dépression (avoir le cafard)
La figure 10.5 montre le pourcentage d'élèves qui ont déclaré avoir été déprimés (avoir eu le cafard) au moins une fois par semaine dans les six derniers mois. Pour ce qui est des garçons de la 6e à la 10e année, l'incidence des épisodes de déprime déclarés a légèrement augmenté de 21 p. 100 à 25 p. 100, tandis qu'elle a été nettement à la hausse chez les filles, passant de 23 p. 100 à 36 p. 100. Même s'ils sont légèrement plus élevés, ces pourcentages cadrent avec les constatations de l'Association canadienne pour la santé mentale (2002) selon lesquelles des troubles psychiatriques pouvant être diagnostiqués existent chez près de 20 p. 100 des enfants et des jeunes. Les différences entre les sexes étaient également semblables à celles relevées par des mesures cliniques de la dépression (Wade, Cairney et Pevalin, 2002). L'analyse des résultats des enquêtes précédentes révèle que le nombre d'élèves déclarant être déprimés ou avoir le cafard est demeuré essentiellement le même au fil des ans (figure 10.6).
Figure 10.5 Élèves qui ont été déprimés (qui ont eu le cafard) au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois (%)
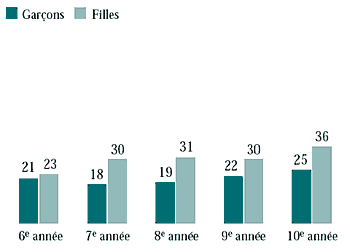
Figure 10.6 Élèves qui ont été déprimés (qui ont eu le cafard) au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois, selon l'année de l'enquête (%)

L'irritabilité ou la mauvaise humeur
Les écarts relevés entre les garçons et les filles concernant les maux de tête et le fait d'être déprimé étaient moins prononcés pour ce qui est de l'irritabilité ou de la mauvaise humeur (voir la figure 10.7). Chez les élèves de 8e année, un plus grand nombre de filles que de garçons ont déclaré être irritables ou de mauvaise humeur (23 p. 100 par rapport à 16 p. 100), tandis que les différences entre les sexes étaient négligeables chez les élèves des autres niveaux. La plus forte augmentation de l'incidence de la mauvaise humeur est observée chez les filles, entre la 7e et la 8e année (de 17 p. 100 à 23 p. 100). Cette tendance est semblable à celle constatée plus tôt concernant les maux de tête et les maux de dos.
Figure 10.7 Élèves qui ont été irritables ou de mauvaise humeur au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois (%)
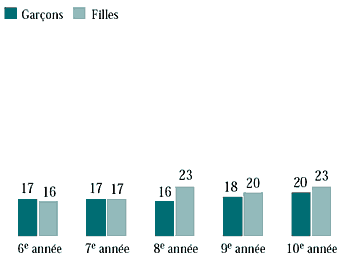
La figure 10.8 révèle une forte tendance à la baisse du nombre d'élèves déclarant avoir été irritables plus d'une fois par semaine chez les jeunes de la 6e année de 1994 à 2002. En effet, tant les garçons que les filles de 6e année ont déclaré avoir été moins souvent irritables au cours des périodes visées par les trois dernières enquêtes. Cette tendance s'observe aussi chez les garçons de 8e année et, dans une moindre mesure, chez les filles de 10e année. Les raisons de cet état de choses ne sont toutefois pas évidentes.
Figure 10.8 Élèves qui ont été irritables ou de mauvaise humeur au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois, selon l'année de l'enquête (%)
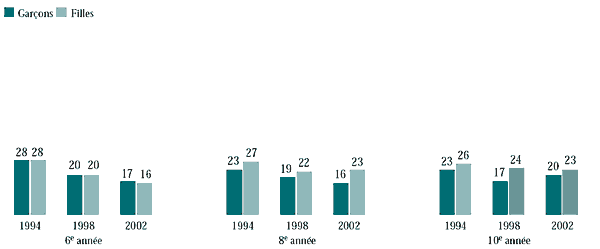
Un profil d'ensemble de la santé émotionnelle
La satisfaction au regard de la vie
Un nombre relativement peu élevé d'élèves, quel que soit le niveau, se sont dits satisfaits de leur vie au plus haut degré en s'attribuant la note « 10 » (figure 10.9). Les filles de 10e année étaient particulièrement peu susceptibles de s'accorder la note la plus élevée à cet égard (4 p. 100). Par contraste, 18 p. 100 des garçons de 6e année étaient entièrement satisfaits de leur vie (note de « 10 »).
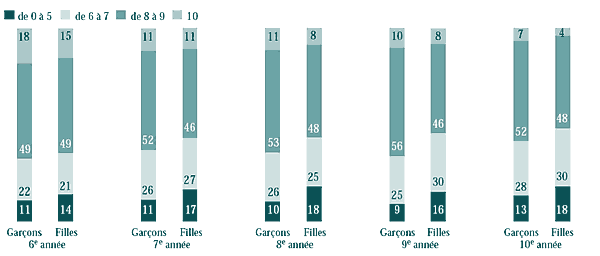
Même si relativement peu d'adolescents se sont dits entièrement satisfaits de leur vie (« 10 »), la majorité des élèves de chaque groupe se sont attribués une note d'au moins « 8 » sur l'échelle de satisfaction. Ici encore, les garçons de 6e année constituaient le groupe le plus satisfait (67 p. 100 d'entre eux se situaient entre « 8 » et « 10 »), et les filles de 10e année formaient le groupe le moins satisfait (52 p. 100 d'entre elles se situaient entre « 8 » et « 10 »). En fait, le degré de satisfaction au regard de la vie est constamment plus élevé chez les garçons que chez les filles, quelle que soit le niveau, tandis qu'il diminuait progressivement d'un niveau à l'autre.
Le tableau 10.1 établit un lien entre le degré de satisfaction des élèves au regard de leur vie et d'autres éléments d'évaluation de l'étude. Les coefficients de corrélation de Pearson qu'on y trouve indiquent la force de la corrélation entre les éléments d'évaluation et l'ensemble des échelles, les coefficients les plus élevés étant associés aux liens les plus forts. Le zéro indique l'absence de corrélation, tandis que le chiffre un dénote une corrélation parfaite. La direction du lien était établie suivant le libellé des questions.
Comme l'on pouvait s'y attendre, le degré de satisfaction était associé de façon positive à d'autres éléments d'évaluation de la santé émotionnelle, tels que la perception qu'avaient les élèves de leur état de santé et l'absence de symptômes psychosomatiques (tableau 10.1). En outre, les adolescents satisfaits de leur vie avaient tendance à avoir une meilleure estime de soi. La plus forte influence sur le niveau de satisfaction au regard de la vie était la relation qu'entretiennent les élèves avec leurs parents. La famille peut servir de base aux relations sociales en garantissant aux adolescents un sentiment de sécurité (Chubb et Fertman, 1992) et en les encourageant à développer un puissant sentiment d'identité (Noller et Callan, 1991). Le fonctionnement de la famille, sous l'angle de la résolution de problèmes par les parents (Vuchinich et de Baryshe, 1997), les responsabilités assumées par la famille (Taylor et coll., 1997) et le traitement parental positif (DeHaan et MacDermid, 1998) peuvent contribuer à une santé émotionnelle positive, telle que mesurée par le degré de satisfaction au regard de la vie.

Par contraste, le lien entre une bonne intégration sociale et une opinion positive de sa vie était moins solide chez les élèves qui ont répondu aux questions de l'enquête. Une bonne intégration sociale ne fait que refléter le degré d'intégration sociale et non la nature de l'influence des camarades utilisée dans la mesure connexe employée au chapitre 4 (Le Groupe de camarades). Certains auteurs ont soutenu que les besoins sociaux changent à l'adolescence et que le besoin d'intimité interpersonnelle augmente (Erdley, Nangle, Newman et Carpenter, 2001). Toutefois, la contribution apparente de l'intégration sociale à l'opinion positive qu'ont les élèves de leur vie dans l'échantillon de l'enquête HBSC était faible. Cette plus grande influence de la famille par rapport à celle des camarades peut être liée au fait que les parents fournissent un soutien continu aux enfants pendant de nombreuses années et aussi au fait que la santé émotionnelle se développe sur une période prolongée.
Afin d'établir si les adolescents qui avaient une opinion positive de leur vie étaient moins enclins à avoir des symptômes psychosomatiques, le nombre moyen de symptômes (de 0 à 8) ressentis par un élève une fois par semaine ou plus a été calculé. Comme prévu, plus les élèves avaient une opinion positive de leur vie, moins ils étaient susceptibles d'avoir des problèmes de santé émotionnelle (figure 10.10). Le contraste à ce chapitre était particulièrement spectaculaire entre ceux qui étaient le moins satisfait de leur vie et ceux qui l'étaient le plus. Par exemple, les filles qui s'étaient attribué la note « 10 » avaient en moyenne 1,3 symptôme psychosomatique. Par comparaison, celles qui s'étaient attribué la note « 0 » avaient en moyenne 5,8 symptômes. Chez les garçons, les moyennes comparables étaient de 1,1 et 4,2 symptômes. Les plus hauts niveaux de symptômes psychosomatiques chez les garçons allaient à ceux qui s'étaient attribué la note « 1 ». Chez les filles, cette note était « 2 ».
Figure 10.10 Nombre moyen de symptômes psychosomatiques, selon l'opinion que les élèves ont de leur vie sur une échelle de 0 à 10
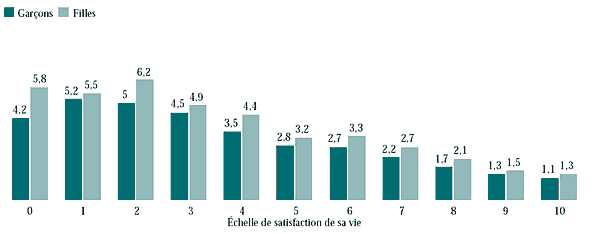
De plus, indépendamment du degré de satisfaction au regard de la vie, les filles connaissaient davantage de problèmes de santé émotionnelle. Compte tenu du nombre élevé de problèmes de santé signalés par les filles d'un bout à l'autre de l'échelle de satisfaction de sa vie, il serait peut-être préférable d'utiliser les symptômes psychosomatiques plutôt que cette échelle pour distinguer les filles qui risquent plus que d'autres d'avoir des problèmes de santé émotionnelle.
La perception de l'état de santé
La perception qu'ont les adolescents de leur état de santé constitue un second élément d'évaluation de la santé émotionnelle (figure 10.11). Toutes classes confondues, les garçons ont plus souvent dit être en « excellente » ou en « bonne » santé que les filles. Cependant, bien que l'écart entre les sexes soit minime en 6e et en 7e année (91 p. 100 contre 88 p. 100 en 6e année et 89 p. 100 contre 88 p. 100 en 7e année), la différence augmente de la 8e à la 10e année. Ce changement soudain entre la 7e et la 8e année chez les filles était également perceptible dans les symptômes psychosomatiques. Il est possible que les filles de 7e et de 8e année traversent une période particulièrement difficile de leur vie, comme en témoigne leur perception de leur état de santé. Cette situation est peut-être attribuable aux changements sur le plan du développement et de la puberté ainsi qu'aux symptômes physiques et émotionnels qui accompagnent l'apparition des premières règles, tels que les maux de tête, les maux d'estomac, les maux de dos, les épisodes de déprime et l'irritabilité.
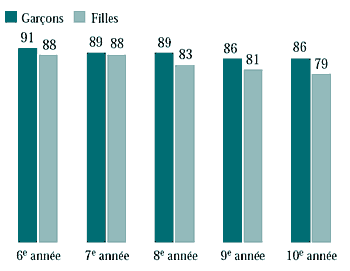
Les facteurs associés à la perception de l'état de santé vont de pair avec ceux associés à l'opinion qu'ont les élèves de leur vie (tableau 10.2). Ici encore, les rapports avec les parents jouent un rôle plus important au regard de la perception de l'état de santé que ne le fait l'intégration sociale.
Principales constatations
- Les filles étaient plus susceptibles de déclarer des symptômes somatiques (mal de tête) et psychologiques (épisodes de déprime), et cette tendance s'accentuait avec l'âge.
- Les élèves qui déclaraient peu de symptômes psychosomatiques étaient plus satisfaits de leur vie.
- La santé émotionnelle médiocre était associée au faible degré de satisfaction de sa vie et au mauvais état de santé subjectif chez les élèves des classes des niveaux les plus élevés.
- Les bonnes relations avec les parents et les camarades étaient liées aux mesures globales de satisfaction au regard de la vie et de la santé générale.
- La corrélation de la satisfaction au regard de la vie était plus forte avec les relations positives avec les parents qu'avec l'intégration sociale avec les camarades.