La santé des jeunes au Canada : portrait de la santé mentale
Télécharger en format PDF
(37,9 Mo, 242 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : 2025-06-23
Cat. : HP15-13/2025F-PDF
ISBN : 978-0-660-74692-0
Pub. : 240653
Conclusions de l’enquête de 2022 sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire
Avant-propos
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport national de l'enquête de 2022 sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (enquête HBSC) : La santé des jeunes au Canada : portrait de la santé mentale.
Le rapport national de 2022 met l'accent sur la santé mentale, reprenant le thème du rapport national de 2010, tout en se penchant sur d'autres déterminants sociaux importants de la santé des jeunes, notamment l'activité physique, la santé mentale, l'intimidation, la violence en contexte amoureux, la consommation de substances, l'utilisation des médias sociaux, l'alimentation saine et la COVID-19. En outre, pour la première fois, l'enquête explore les expériences des jeunes transgenres et de diverses identités de genre (jeunes TDIG), marquant ainsi une étape charnière dans la reconnaissance, la compréhension et la prise en compte des besoins diversifiés de tous les jeunes au Canada, peu importe leur identité de genre. Ces résultats sont particulièrement révélateurs, car les expériences des jeunes TDIG en matière de santé et de comportements de santé sont systématiquement moins bonnes que celles des autres jeunes, peu importe l'indicateur de l'état de santé examiné.
Sur une note plus positive, nous avons trouvé encourageant de voir que les relations solides continuent d'avoir de l'importance pour les jeunes. Les élèves qui déclarent avoir des relations solides avec leurs parents, leur famille, leurs amis et au sein de leur école sont beaucoup plus susceptibles de faire état d'une meilleure santé mentale et d'un niveau de bien-être plus élevé. Le rapport indique également que, quel que soit leur milieu socioéconomique, les jeunes qui se trouvent dans des conditions défavorables peuvent s'épanouir s'ils ont la chance de bénéficier d'un bon soutien et de bonnes relations. D'un autre côté, les résultats ont également révélé la présence de motifs de préoccupation importants. Nous continuons d'observer que les filles cisgenres au Canada font état de problèmes de santé importants dans de multiples domaines. Sur le plan du développement, lorsque les jeunes passent à la 9e et à la 10e année, de nombreux résultats de santé négatifs commencent à apparaître, en particulier ceux qui sont associés à la santé mentale. Le rapport donne également un aperçu des effets de la pandémie de COVID-19, de nombreux participants à l'enquête HBSC faisant état de conséquences négatives en ce qui concerne les relations avec les autres, l'expérience de l'école et la santé.
Le rapport national de l'enquête HBSC de 2022 s'inscrit dans la mission de l'Agence de la santé publique du Canada, qui consiste à promouvoir et protéger la santé des Canadiens au moyen du leadership, de partenariats, de l'innovation et de la prise de mesures dans le domaine de la santé publique. Les résultats du volet canadien de l'enquête HBSC améliorent notre compréhension de la santé des jeunes et constituent une source vitale d'informations et de données probantes pour les chercheurs, les parties prenantes et les personnes qui travaillent en milieu scolaire.
Nous tenons à exprimer notre gratitude aux plus de 26 000 élèves de plus de 300 écoles de partout au Canada qui ont fait part de leur vécu, ainsi qu'aux jeunes qui ont offert leurs réflexions et observations sur les résultats de l'enquête. Le point de vue des jeunes constitue toujours une contribution inestimable à notre travail. Nous remercions également les membres du personnel enseignant et administratif des écoles pour leur collaboration et leur soutien dans la réalisation de cette enquête. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus sain pour les jeunes au Canada.
Remerciements
Ce rapport a été préparé par: Wendy Craig (Université Queen's, Département de psychologie), Valerie F. Pagnotta (Université Brock, Département des sciences de la santé), Stephanie Wadge (Université Brock, Département des sciences de la santé), Matthew King (Université Queen's, Département de psychologie), et William Pickett (Université Brock, Département des sciences de la santé, Université Queen's, Département des sciences de la santé publique).
Le présent rapport fait état des conclusions qui émergent du neuvième cycle de l'enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (enquête HBSC) au Canada. Nous tenons à saluer la collaboration des 50 équipes de chercheurs d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que le soutien constant du Centre international de coordination (International Coordinating Centre), en Écosse, et du Centre international de coordination de la banque de données (International Databank Coordinating Centre), en Norvège.
La réalisation de l'enquête HBSC et la présentation des conclusions dans ce rapport sont rendues possibles grâce au soutien financier de l'Agence de la santé publique du Canada, par l'entremise de l'Unité de politique des jeunes, qui fait partie de la Division de l'enfance et de la jeunesse. Des remerciements spéciaux sont adressés à Suzy Wong, analyste principale des politiques, Deepika Sriram, analyste principale des politiques par intérim, Jennifer Anderson, gestionnaire, de même qu'aux réviseurs du gouvernement du Canada pour leurs précieux conseils et contributions tout au long de la planification et de la rédaction du rapport.
Le Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé (CCES) a collaboré avec l'équipe HBSC en offrant un soutien actif à l'étape de collecte des données de l'étude et en ce qui a trait à la détermination des thèmes prioritaires pour l'élaboration des outils d'enquête et l'établissement des rapports. La coordination de notre collaboration a été assurée par Susan Hornby, conseillère principale du Secrétariat du CCES, et le comité des coordonnateurs de la santé en milieu scolaire du CCES.
Nous tenons par ailleurs à remercier Larissa Lobo et Jayne Morrish pour leur travail de mise en place du groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC, ainsi que les jeunes qui en ont fait partie. Les membres du groupe consultatif ont offert des conseils et formulé des commentaires tout au long du processus, depuis la formulation des questions jusqu'à l'interprétation des données, et nous ont fait part de leurs expériences et réflexions après lecture des résultats, le tout avec une grande franchise. Salony Sharma a contribué au volet de l'engagement des jeunes de l'enquête nationale canadienne, notamment en concevant les rapports des écoles générés dans le cadre des efforts de diffusion de l'enquête HBSC au Canada.
L'équipe de l'enquête HBSC a été chargée de la collecte et de l'analyse des données sous la supervision et la direction de Matthew King. Zoe Saine, Christina Luzius-Vanin, Ella Blondin et Rebecca Stroud Stasel avaient la responsabilité de contacter les administrations scolaires et les écoles et de coordonner la tenue de l'enquête.
Mahma Ahmed, Reem Atallah, Dayna Bastien, Arielle Ventura Baguio, Riley Bonar, J Burns, Kadance Byron, Sophie Craig, Sophia Coppolino, Jade Deluca-Ahooja, Mackenzie Gribbon, Joshua Williams Haberer, Andrew Hall, Kareen Hewitt, Mazin Hussain, Yuhan Jiang, Jade Leonard, Nicole Li, John-Angus Maclean Davison, Lachlan Maclean Davison, Sofia Mancini, Logan McLellan, Olivia Merulla, Lucy Morrow, Julia Noble, Efkan Oguz, Sydney Orsak, Bridgette Paisley, Hope Rutledge, Kyran Sachdeva, Kerlas Samaan, Emily Sowa, Hailey Swain, Madison Taylor, Jacob Turnbull, Luning Wang, Haichaoyang Yan et Lilly Zepp se sont chargés de la saisie des données, du codage de l'information, du traitement des questionnaires ainsi que des activités de suivi et de documentation connexes.
Diane Yocum était responsable de l'exécution et de la supervision des nombreuses tâches administratives nécessaires au processus d'élaboration du questionnaire et à la collecte des données. Grace Moffat a joué un rôle similaire pour l'équipe de recherche dans la réalisation de ce rapport.
Cameron Hines a été chargée de préparer et d'éditer les fichiers de données, les figures et le texte du rapport. Brock Ostrom a assuré la conception graphique du rapport. Chantal Caron a traduit en français la version anglaise du rapport.
Nous tenons à remercier les cochercheurs et cochercheuses qui ont contribué à l'élaboration des mesures et de la méthodologie, ainsi qu'à l'orientation conceptuelle du rapport : Colleen Davison et Ian Janssen, Université Queen's; Gina Martin, Université d'Athabasca; Frank Elgar, Université McGill; Kathy Georgiades, Université McMaster; Scott Leatherdale, Université de Waterloo; Michael McIsaac, Université de l'Île-du-Prince-Édouard; Nour Hammami, Université Trent; Theodore Christou, Université Ontario Tech; et Elizabeth Saewyc, Université de la Colombie-Britannique.
Enfin, nous désirons remercier de façon toute particulière les élèves qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences, ainsi que les directions d'école, le personnel enseignant, les administrations scolaires et les parents, qui ont rendu cette enquête possible.
Contents
- Chapitre 1: Introduction
- Chapitre 2: La santé mentale
- Chapitre 3: Le foyer et la famille
- Chapitre 4: Les amis
- Chapitre 5: L'école
- Chapitre 6: La collectivité
- Chapitre 7: L'activité physique, le temps d'écran et le sommeil
- Chapitre 8: L'alimentation saine
- Chapitre 9: Le poids santé
- Chapitre 10: Les blessures et les commotions cérébrales
- Chapitre 11: L'intimidation et la violence en contexte amoureux
- Chapitre 12: La santé spirituelle
- Chapitre 13: La consommation de drogues et d'alcool
- Chapitre 14: La santé sexuelle
- Chapitre 15: L'utilisation des médias sociaux
- Chapitre 16: La pandémie de COVID-19
- Chapitre 17: Points de vue et priorités des jeunes
- Chapitre 18: Messages et thèmes principaux
Chapitre 1 : Introduction
But
Réalisée tous les quatre ans à l'aide d'un protocole de recherche commun, élaboré par l'International Assembly of Principal Investigators, l'enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire, ou enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), porte sur la santé et les comportements de santé des jeunes âgés de 11 à 15 ans dans plus de 50 pays. En tant qu'étude transnationale, cette enquête vise à comprendre la santé des jeunes à travers leurs contextes sociaux et environnementaux. La collecte de divers indicateurs de santé liés à la vie familiale, à la vie scolaire, au contexte communautaire, aux relations avec les camarades et aux comportements à risque ou favorisant la santé permet d'analyser et de comparer la santé de nos jeunes à l'échelle internationaleRéférence 1 et nationaleRéférence 2. En 1990, le Canada est devenu un pays membre et participe depuis à chaque cycle de l'enquête, ce qui permet d'établir des comparaisons dans le temps. L'enquête HBSC a permis d'élaborer un solide corpus de documents et de rapports qui servent à éclairer les politiques et les pratiques dans le pays.
Objectifs de l'enquête HBSC du Canada
Au Canada, l'enquête HBSC est financée par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et est effectuée par l'Université Queen's, avec le soutien d'autres chercheurs universitaires de tout le pays. Le questionnaire et la méthode d'échantillonnage utilisés pour les élèves canadiens sont régis par le protocole international de l'enquête HBSC, qui comprend l'obligation de poser toute une série de questions contenues dans le questionnaire international obligatoire de l'enquête HBSCRéférence 1Référence 2. Les questions supplémentaires utilisées au Canada sont élaborées dans le cadre d'un vaste modèle de consultation mettant en présence l'ASPC, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et de l'Éducation (par l'entremise du Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé [CCES]), un groupe diversifié de jeunes Canadiennes et Canadiens, ainsi que l'équipe de recherche canadienne de l'enquête HBSC.
Voici les principaux objectifsRéférence 3 de l'enquête HBSC :
- Entreprendre et soutenir à l'échelle nationale et internationale des travaux de recherche sur la santé et le bien-être, les comportements de santé, les déterminants sociaux de la santé, ainsi que le contexte social de la santé des adolescents.
- Diffuser les résultats aux publics intéressés, notamment les chercheurs, les décideurs, les intervenants en promotion de la santé, le personnel enseignant, les parents et les adolescents.
- Éclairer et soutenir l'élaboration d'interventions et de programmes liés à la promotion de la santé auprès des adolescents (appelés « jeunes d'âge scolaire » à l'échelle internationale).
- Participer à un réseau mondial qui génère de nouvelles données sur la santé et le bien-être des adolescents.
Méthodes
Sélection des écoles
- Neuf provinces et deux territoires ont participé au cycle 2022 de l'enquête HBSC. Le Nouveau-Brunswick et le Nunavut n'ont pas pu participer à ce cycle.
Sélection des élèves
- Le nombre de classes de chaque école a été estimé en fonction des années d'études enseignées à l'école, du nombre d'enseignant(e)s, du nombre total d'élèves inscrits et du nombre d'élèves inscrits par année d'études, tout en tenant compte des variations connues dans la structure des classes.
- Toutes les classes avaient à peu près la même chance d'être choisies.
- Toutes les classes de la 6e à la 10e année des écoles sélectionnées ont été invitées à participer.
- Les élèves des classes sélectionnées, après avoir donné leur accord, ont été invités à remplir le questionnaire d'enquête.
Réalisation de l'enquête
- Les données ont été recueillies en 2022 et 2023, durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.
- Les élèves participants ont rempli les questionnaires à l'école durant une période de 45 à 70 minutes.
- Les écoles pouvaient choisir de faire remplir le questionnaire par les élèves à l'aide d'une version en ligne sur le Web ou à l'aide d'un livret papier. Cinquante-quatre pour cent des questionnaires de l'ensemble des données ont été remplis à l'aide de la méthode en ligne.
- Au Yukon, la collecte des données a été effectuée sous la supervision du Bureau des statistiques du Yukon. La collecte des données sur place a été effectuée par le personnel de recherche qui s'est rendu dans les écoles.
Les membres du groupe consultatif de jeunes canadiennes et canadiens de l'enquête HBSC ont été consultés lors de l'élaboration du questionnaire, et leurs commentaires judicieux se reflètent dans le contenu du rapport. Leurs réflexions instructives sont également présentées dans chaque chapitre.
Les chercheurs ont obtenu les autorisations nécessaires auprès des comités d'éthique pour la recherche de l'Université Queen's, de l'Université Brock et de l'ASPC/Santé Canada.
Considérations relatives au sexe et au genre
Dans le cycle 2022 de l'enquête HBSC, on a demandé aux jeunes d'indiquer le sexe qui leur avait été assigné à la naissance selon les catégories suivantes : « Féminin » ou « Masculin ». En outre, les jeunes devaient indiquer leur identité de genre selon les catégories suivantes : « Garçon », « Fille », « Je ne m'identifie ni comme un garçon ni comme une fille » ou « Autre (précise) ». Les jeunes dont l'identité de genre correspondait au sexe qui leur avait été assigné à la naissance ont été classés comme des garçons cisgenres (sexe assigné à la naissance = masculin et identité de genre = garçon) ou des filles cisgenres (sexe assigné à la naissance = féminin et identité de genre = fille). Les jeunes dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à leur identité de genre et ceux qui ont coché « Je ne m'identifie ni comme un garçon ni comme une fille » ou « Autre (précise) » ont été classés dans la catégorie des jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG). Tous les jeunes TDIG ont été regroupés dans une catégorie distincte d'adolescents, afin de garantir une taille d'échantillon suffisante pour les analyses stratifiées en fonction de l'identité de genre.
| Genre | Mesure | Année d'études | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Garçons cisgenres | n | 2 931 | 2 663 | 2 704 | 2 395 | 1 812 | 12 505 |
| % | 48,0 | 48,4 | 49,4 | 47,2 | 47,8 | 48,2 % | |
| Filles cisgenres | n | 2 841 | 2 487 | 2 436 | 2 372 | 1 747 | 11 883 |
| % | 46,5 | 45,2 | 44,5 | 46,7 | 46,1 | 45,8 % | |
| Jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG) | n | 333 | 355 | 329 | 310 | 228 | 1 555 |
| % | 5,5 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 % | |
| Total | n | 6 105 | 5 505 | 5 469 | 5 077 | 3 787 | 25 943 |
| Province/territoire | Écoles | Élèves | ||
|---|---|---|---|---|
| % | n | % | nTableau 1.2 Note de bas de page * | |
| Colombie-Britannique | 2,5 | 8 | 3,8 | 1 007 |
| Alberta | 6,0 | 19 | 8,3 | 2 180 |
| Saskatchewan | 6,3 | 20 | 6,9 | 1 815 |
| Manitoba | 39,1 | 124 | 43,5 | 11 465 |
| Ontario | 9,1 | 29 | 8,3 | 2 201 |
| Québec | 7,3 | 23 | 2,9 | 772 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7,9 | 25 | 8,1 | 2 142 |
| Nouvelle-Écosse | 1,3 | 4 | 1,7 | 456 |
| Île-du-Prince-Édouard | 5,0 | 16 | 7,5 | 1 985 |
| Territoires du Nord-Ouest | 8,8 | 28 | 4,5 | 1 193 |
| Yukon | 6,6 | 21 | 4,3 | 1 144 |
| TOTAL | 100 % | 317 | 100 % | 26 360 |
|
||||
Thème du présent rapport
À la suite du rapport national 2010 de l'enquête HBSC, qui portait sur la santé mentale, il est apparu évident qu'il était essentiel de mieux comprendre la santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes. En consultation avec l'ASPC, le CCES et le groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC, il a été décidé que le rapport national 2022 porterait également sur la santé mentale. Ce sujet sera exploré à l'aide d'indicateurs (autant positifs que négatifs) de l'état de santé mentale, standardisés et reconnus à l'échelle internationale. Chacun de ces indicateurs a fait l'objet de démarches poussées menant à sa validation au Canada et sur le plan international. Quatre de ces indicateurs ont été choisis pour faire l'objet d'analyses plus approfondies tout au long du rapport, et portent sur les facteurs associés à un état de santé mentale positif (satisfaction à l'égard de la vie, indice de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé-5 [WHO-5]) et sur les facteurs associés à un état de santé mentale négatif (solitude, problèmes de santé).
Satisfaction à l'égard de la vie
La satisfaction à l'égard de la vie a été mesurée en demandant aux jeunes d'évaluer leur vie sur l'échelle de CantrilRéférence 4, de zéro à dix. Zéro, la position la plus basse sur l'échelle, correspondait à « la pire vie possible pour toi » et dix, la position la plus haute sur l'échelle, à « la meilleure vie possible pour toi ».
Indice de bien-être (WHO-5)
L'indice de bien-être (WHO-5Référence 5Référence 6) se compose de cinq questions présentées au tableau 1.3, avec des options de réponse allant de 0 (« à aucun moment ») à 5 (« tout le temps »). Les réponses à ces cinq questions ont ensuite été additionnées et multipliées par quatre (les scores pouvant aller de 0 à 100) pour déterminer le score global de l'indice de bien-être (WHO-5). Sur la base des précédents établisRéférence 5Référence 6, les scores qui se situent entre 0 et 50 sont classés dans la catégorie « faible niveau de bien-être ».
Indice de bien-être (WHO-5) :
- Je me suis senti(e) joyeux(se) et de bonne humeur.
- Tout le temps=5
- La plupart du temps=4
- Plus de la moitié du temps=3
- Moins de la moitié du temps=2
- De temps en temps=1
- À aucun moment=0
- Je me suis senti(e) calme et détendu(e).
- Tout le temps=5
- La plupart du temps=4
- Plus de la moitié du temps=3
- Moins de la moitié du temps=2
- De temps en temps=1
- À aucun moment=0
- Je me suis senti(e) actif(ve) et rempli(e) d'énergie.
- Tout le temps=5
- La plupart du temps=4
- Plus de la moitié du temps=3
- Moins de la moitié du temps=2
- De temps en temps=1
- À aucun moment=0
- Je me suis réveillé(e) frais(fraîche) et reposé(e).
- Tout le temps=5
- La plupart du temps=4
- Plus de la moitié du temps=3
- Moins de la moitié du temps=2
- De temps en temps=1
- À aucun moment=0
- Je sens que ma vie quotidienne est remplie de choses qui m'intéressent.
- Tout le temps=5
- La plupart du temps=4
- Plus de la moitié du temps=3
- Moins de la moitié du temps=2
- De temps en temps=1
- À aucun moment=0
Solitude
On a demandé aux élèves à quelle fréquence ils s'étaient sentis seuls au cours des 12 derniers mois. La fréquence de la solitude a été mesurée comme suit : « jamais », « rarement », « parfois », « la plupart du temps » et « toujours ».
Problèmes de santé
Les élèves ont été invités à indiquer à quelle fréquence, au cours des six derniers mois, ils avaient ressenti chacun des problèmes de santé subjectifs suivants : « maux de tête », « maux d'estomac », « maux de dos », « avoir les "blues" (être déprimé[e]) », « irritable ou de mauvaise humeur », « nervosité », « difficulté à s'endormir » et « étourdissements ». Les réponses relatives à la fréquence comprenaient « presque chaque jour », « plus d'une fois par semaine », « presque chaque semaine », « presque chaque mois » et « rarement ou jamais ».
Analyse statistique
Les estimations représentatives à l'échelle nationale (p. ex. les proportions) ont été calculées à l'aide de poids d'enquête, afin de refléter le nombre réel d'élèves inscrits dans chaque année d'études (de la 6e à la 10e année) et dans chaque province ou territoire. Dans le rapport, les données sont le plus souvent présentées selon deux catégories d'années d'études (de la 6e à la 8e année et la 9e et 10e année). L'ensemble des données est pondéré de manière à ce que dans chaque échantillon provincial/territorial, chacune des années d'études contribue aux catégories d'années d'études proportionnellement au nombre réel connu d'élèves inscrits dans ces années d'études. Toutes les estimations présentées et les intervalles de confiance à 95 % tiennent compte des mises en grappes à l'échelle de la classe.
Dans ce rapport, nous présentons les niveaux de fréquence des principaux indicateurs de santé, de manière globale et au sein de groupes définis (par exemple) selon l'année d'études et le genre. Ce faisant, nous présentons les différences entre les groupes sous forme de différences absolues de fréquence, exprimées en « points de pourcentage ». Par exemple, si la fréquence d'un comportement de santé est de 15 % chez les filles cisgenres et de 10 % chez les garçons cisgenres, la différence absolue est de 5 % du point de vue de la fréquence ou des points de pourcentage (15 % moins 10 %). Cela pourrait également être décrit comme une hausse de 5 points de pourcentage chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres, ou une baisse de 5 points de pourcentage chez les garçons cisgenres par rapport aux filles cisgenres. Ces différences pourraient également être exprimées sous forme de « différence relative ». Par exemple, la hausse de 15 % par rapport à 10 % décrite ci-dessus pourrait être décrite en termes relatifs comme une hausse de 150 % de la fréquence chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres, ou une hausse de 1,5 fois de la fréquence chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres. Toutefois, par souci d'harmonisation avec les rapports nationaux précédents et de cohérence dans l'ensemble du rapport, nous avons choisi de décrire les différences en termes absolus et non en termes relatifs.
Certaines analyses des estimations de fréquence sont également présentées au fil du temps. Dans ces analyses, les estimations sont stratifiées en fonction de jusqu'à neuf cycles d'enquête (1990 à 2022), des années d'études (de la 6e à la 8e année, 9e et 10e année) et du genre. Comme la question du sexe assigné à la naissance n'a été posée qu'à partir de l'enquête de 2022, ces analyses de tendances se limitent aux élèves qui s'identifient comme « garçons » (cisgenres et transgenres) et « filles » (cisgenres et transgenres) afin d'assurer la comparabilité entre les cycles.
En outre, dans certaines analyses, les estimations de fréquence sont présentées avec les intervalles de confiance (IC) à 95 % correspondants pour chaque groupe. Lors des comparaisons, la signification statistique des différences entre les groupes peut être déduite du fait que les IC se chevauchent ou non, l'absence de chevauchement impliquant une signification au niveau de signification statistique de 5 % (p<0,05). Tout au long du rapport, lorsque cette méthode permet d'obtenir une signification statistique, nous commentons l'importance des différences observées. Lorsque les IC se chevauchent de manière nette, nous interprétons cette tendance comme indiquant qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Il s'agit d'une méthode très prudente pour déduire la signification statistique des intervalles de confiance.
Le thème de ce rapport est la santé mentale des jeunes au Canada. Dans de nombreux chapitres, l'accent a donc été mis sur la corrélation entre les quatre indicateurs standards de l'état de santé mentale et d'autres indicateurs de l'enquête HBSC présentés dans le chapitre. Ces analyses ont pris en compte les déterminants potentiels de la santé mentale, ainsi que les conséquences de l'état de santé mentale. Cette analyse était également « intersectionnelleRéférence 7 » dans sa conception, ce qui signifie que les analyses ont été répétées dans des « situations sociales » sociodémographiques définies par des combinaisons des années d'études (de la 6e à la 8e année, 9e et 10e année), de l'identité de genre (garçons cisgenres, filles cisgenres, jeunes transgenres et de diverses identités de genre [TDIG]) et du statut socio-économique (degré d'aisance familiale, tel que mesuré par l'élément de l'enquête HBSC sur la richesse matérielle relative, qui demande aux élèves d'indiquer à quel point ils se perçoivent « à l'aise sur le plan financier » par rapport à leurs camarades). Le coefficient de corrélation de Pearson a été utilisé pour explorer les corrélations, les valeurs obtenues étant classées en quatre groupes : 0 à 0,19 (très faible), 0,2 à 0,39 (faible), 0,4 à 0,59 (modérée), et 0,6 et plus (forte). Les variables incluses dans ces analyses corrélationnelles ont été laissées dans leur forme originale (continue, ordinale à échelle) plutôt que reclassées et catégorisées. Les corrélations qui n'étaient pas statistiquement significatives (p<0,05) ont été notées « NS » dans les analyses.
Chapitre 2 : La santé mentale
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « [la] santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communautéRéférence 8. » « [Nos] capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons1 » reposent sur notre santé mentale, qui est « un droit fondamental de tout être humainRéférence 8 » et « un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socioéconomiqueRéférence 8 ».
Depuis quelques années, la santé mentale des jeunes au Canada est devenue une priorité de santé publique, en raison de la hausse des indicateurs d'une mauvaise santé mentaleRéférence 9. En 2020, près de 25 % des hospitalisations chez les enfants et les jeunes de 5 à 24 ans étaient liées à des problèmes de santé mentale (58 % de ces hospitalisations concernaient des filles et 42 % des garçonsRéférence 9). On a observé une hausse des consultations en santé mentaleRéférence 10, des diagnostics de troubles anxieux et de l'humeurRéférence 10, des taux de prescription de médicaments pour les troubles anxieux et de l'humeurRéférence 9 et de l'incidence de l'anorexie mentaleRéférence 11. Les raisons qui expliquent ces hausses sont complexes, mais selon des recherches, il s'agirait d'une interaction entre divers facteurs, notamment la pandémie de COVID-19Référence 12Référence 13Référence 14, la crise climatiqueRéférence 15Référence 16, la discriminationRéférence 17Référence 18 et une utilisation problématique des médias sociauxRéférence 19Référence 20.
La perception qu'ont les jeunes de leur santé mentale diffère souvent de la perception que leurs parents ont de celle-ci, de nombreux jeunes l'évaluant de manière moins positive que leurs parentsRéférence 21. Ces derniers ne sont pas toujours conscients des problèmes de santé mentale que vivent leurs enfantsRéférence 22 et il est important d'apprendre directement des jeunes comment ils perçoivent leurs expériences en matière de santé mentale.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, la santé mentale est mesurée au moyen de diverses questions et échelles. Certains des indicateurs négatifs révélateurs de troubles mentaux décrivent la fréquence et l'intensité des sentiments de tristesse ou de désespoir, de solitude et de nervosité. Les jeunes ont également été invités à indiquer la fréquence à laquelle, au cours des six derniers mois, ils avaient éprouvé des problèmes de santé subjectifs (p. ex. maux de tête, maux d'estomac, difficulté à s'endormir), ce qui constitue un autre indicateur de symptômes psychosomatiques pouvant laisser présager une mauvaise santé mentale. En ce qui a trait aux indicateurs d'une bonne santé mentale, les jeunes ont fait état de leur santé mentale au moyen de l'indice de bien-être de l'OMS (WHO-5)Référence 23Référence 24. Cet indice comporte une fourchette de valeurs allant de 0 à 100, un score se situant entre 60 et 100 quantifiant un bien-être relatif supérieur. D'autres indicateurs d'une bonne santé mentale incluent des mesures de la confiance en soi et de la satisfaction à l'égard de la vie.
Tristesse et désespoir
Figure 2.1. Élèves qui déclarent s'être sentis, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérés qu'ils ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 19 (17,3, 20,8) | 36 (33,8, 38,7) | 62 (56,2, 67,9) |
| 9e et 10e année | 23 (21,0, 25,6) | 50 (46,9, 52,5) | 68 (61,6, 75,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Dans toutes les catégories de genre, la proportion de jeunes se sentant tristes ou désespérés presque quotidiennement pendant deux semaines d'affilée ou plus est plus élevée chez les élèves de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année.
- L'écart le plus notable est enregistré chez les filles cisgenres : 50 % des filles cisgenres de 9e et 10e année déclarent se sentir tristes ou désespérées presque quotidiennement pendant deux semaines d'affilée ou plus, alors que ce pourcentage s'établit à 36 % chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, soit une différence de 14 points de pourcentage.
- C'est dans la catégorie des jeunes TDIG qu'on observe les plus hauts pourcentages de sentiments de tristesse et de désespoir presque quotidiens pendant deux semaines d'affilée ou plus, toutes années d'études confondues.
Tendances chez les garçons quant à la tristesse et au désespoir
Figure 2.2. Garçons qui déclarent s'être sentis, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérés qu'ils ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
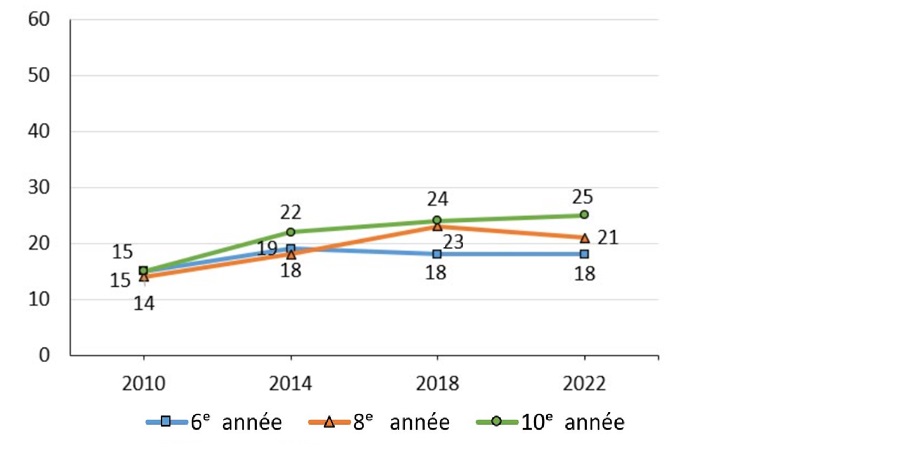
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
Figure 2.2 : Description textuelle
| L’année d’études | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6e année | 15 | 19 | 18 | 18 |
| 8e année | 14 | 18 | 23 | 21 |
| 10e année | 15 | 22 | 24 | 25 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||
- De façon générale, la proportion de garçons qui déclarent se sentir tristes ou désespérés a augmenté au fil du temps. Par exemple, 25 % des garçons de 10e année ont fait cette déclaration en 2022, par rapport à un pourcentage de 15 % en 2010.
- Une comparaison des trois années d'études révèle que les garçons de 10e année affichent constamment les niveaux les plus élevés de sentiments de tristesse ou de désespoir.
« Je pense que les garçons ont de meilleurs résultats en matière de santé mentale en raison des attentes sociétales; on s'attend à ce qu'ils surmontent les choses facilement. »
Tendances chez les filles quant à la tristesse et au désespoir
Figure 2.3. Filles qui déclarent s'être senties, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérées qu'elles ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.3 : Description textuelle
| L’année d’études | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6e année | 18 | 23 | 25 | 28 |
| 8e année | 24 | 34 | 38 | 46 |
| 10e année | 27 | 43 | 48 | 54 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- De façon générale, la proportion de filles qui déclarent se sentir tristes ou désespérées a augmenté au fil du temps. Par exemple, 54 % des filles de 10e année ont fait cette déclaration en 2022, contre 27 % en 2010.
- Les filles de 10e année affichent systématiquement des proportions plus élevées de sentiments de tristesse ou de désespoir que les filles de 6e et de 8e année.
- Les filles sont systématiquement plus nombreuses que les garçons à faire part de sentiments de tristesse ou de désespoir, et ce pour tous les cycles d'enquête, de 2010 à 2022.
Solitude
Figure 2.4. Élèves qui déclarent se sentir seuls la plupart du temps ou toujours, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 10 (9,0, 11,5) | 27 (24,5, 28,9) | 51 (44,9, 57,1) |
| 9e et 10e année | 17 (15,5, 19,0) | 34 (31,7, 36,4) | 52 (44,7, 58,6) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les garçons cisgenres et les filles cisgenres, la proportion de jeunes de 9e et 10e année qui se sentent seuls la plupart du temps ou toujours est plus élevée de 7 points de pourcentage par rapport aux jeunes de la 6e à la 8e année.
- Ce sont les jeunes TDIG qui sont les plus nombreux à déclarer se sentir seuls la plupart du temps ou toujours (51 % des élèves de la 6e à la 8e année et 52 % des élèves de 9e et 10e année). Il est inquiétant de constater que la majorité des jeunes TDIG ressentent ces sentiments négatifs, même dès le primaire.
Nervosité
Figure 2.5. Élèves qui déclarent avoir éprouvé de la nervosité au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 37 (34,5, 38,8) | 65 (62,2, 67,0) | 78 (72,7, 82,8) |
| 9e et 10e année | 46 (43,2, 49,2) | 78 (76,0, 79,9) | 84 (79,2, 88,9) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion de jeunes cisgenres qui affirment éprouver de la nervosité au moins une fois par semaine est plus élevée chez les jeunes de 9e et 10e année que chez les jeunes de la 6e à la 8e année.
- L'écart le plus important entre catégories s'observe chez les filles cisgenres (78 % pour la 9e et 10e année contre 65 % de la 6e à la 8e année, soit une différence de 13 points de pourcentage), suivi du résultat chez les garçons cisgenres (46 % contre 37 %, une différence de 9 points de pourcentage).
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, un plus grand nombre de jeunes TDIG que de jeunes cisgenres affirment éprouver de la nervosité (78 % des jeunes TDIG par rapport à 65 % des filles cisgenres et 37 % des garçons cisgenres).
Problèmes de santé
Figure 2.6. Élèves qui déclarent au moins deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et le genre (%).
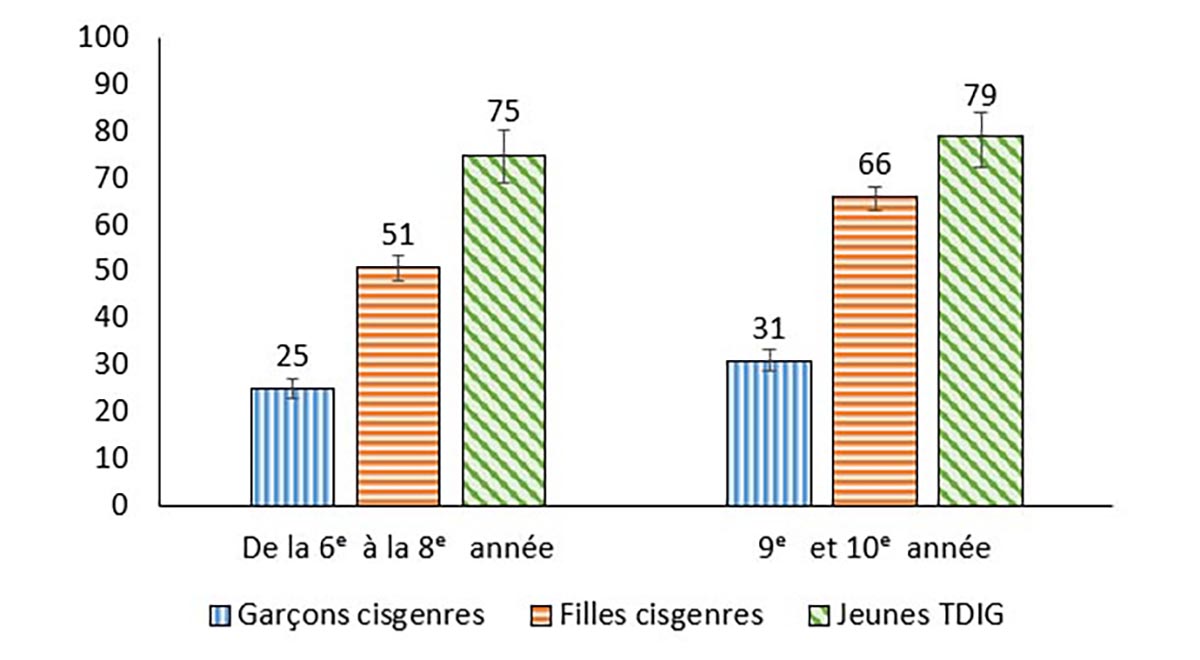
Figure 2.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 25 (22,8, 27,2) | 51 (48,0, 53,5) | 75 (69,0, 80,4) |
| 9e et 10e année | 31 (28,8, 33,4) | 66 (63,4, 68,2) | 79 (72,6, 84,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- De façon générale, la proportion de jeunes qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine (un indicateur standard d'une mauvaise santé mentale) est plus élevée chez les jeunes de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année.
- C'est chez les filles cisgenres que cet écart dans la manifestation des problèmes de santé est le plus important (66 % pour la 9e et 10e année contre 51 % pour la catégorie de la 6e à la 8e année), soit une différence de 13 points de pourcentage.
- Toutes années d'études confondues, un plus grand nombre des jeunes TDIG que de jeunes cisgenres déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs.
« Les gens commencent à se sentir plus à l'aise de parler de leur santé au secondaire, surtout qu'à mon école, on reçoit souvent des exposés sur la santé mentale qui nous rappellent que c'est correct d'en parler. »
Tendances chez les garçons quant aux problèmes de santé
Figure 2.7. Garçons qui déclarent au moins deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
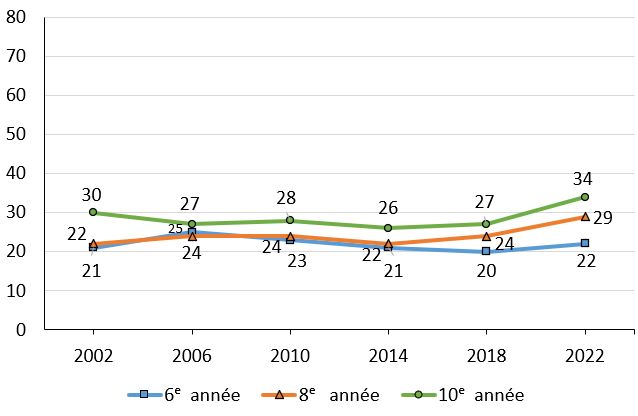
Figure 2.7 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 |
| 8e année | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 29 |
| 10e année | 30 | 27 | 28 | 26 | 27 | 34 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- La proportion de garçons qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine est relativement stable au fil des années. Par exemple, chez les garçons de 10e année, la proportion décline entre 2002 et 2014, passant de 30 à 26 %, puis augmente à 34 % en 2022.
- En 2022, 29 % des garçons de 8e année et 34 % des garçons de 10e année mentionnent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs; il s'agit là des pourcentages les plus élevés des cycles d'enquête pour ces groupes.
- Les tendances chez les garçons de 6e année sont moins marquées.
Tendances chez les filles quant aux problèmes de santé
Figure 2.8. Filles qui déclarent deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.8 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 26 | 25 | 30 | 27 | 30 | 42 |
| 8e année | 39 | 40 | 39 | 40 | 43 | 61 |
| 10e année | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 | 69 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- De 2002 à 2022, il y a eu augmentation de la proportion de filles qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine. Par exemple, chez les filles de 6e année, la proportion est passée de 26 % en 2002 à 42 % en 2022, soit une différence de 16 points de pourcentage. Une tendance similaire s'observe chez les filles de 8e année, où la proportion est passée de 39 % en 2002 à 61 % en 2022. Les filles de 10e année enregistrent l'augmentation la plus importante (29 %) entre 2002 et 2022, les résultats passant de 40 à 69 %.
- De façon générale, les filles affichent des proportions plus élevées de problèmes de santé subjectifs que les garçons, de 2002 à 2022.
Confiance en soi
Figure 2.9. Élèves qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux, selon l'année d'études et le genre (%)
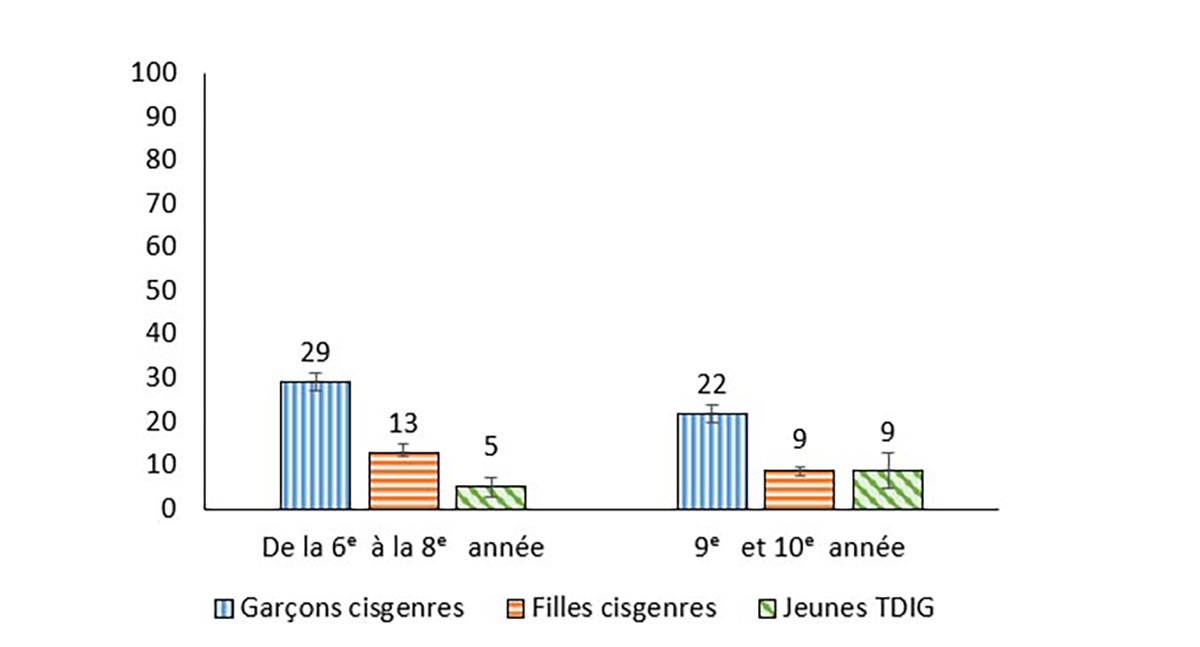
Figure 2.9 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 29 (27,3, 31,3) | 13 (11,9, 14,9) | 5 (2,7, 7,3) |
| 9e et 10e année | 22 (19,8, 24,0) | 9 (7,4, 9,8) | 9 (4,8, 13,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les garçons cisgenres affichent les plus hauts niveaux de confiance en eux-mêmes.
- Chez les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année, 5 % déclarent avoir confiance en eux, soit un pourcentage inférieur de 8 points par rapport aux filles cisgenres et de 24 points par rapport aux garçons cisgenres.
- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 9 % déclarent avoir confiance en eux, une proportion similaire à celle des filles cisgenres, et inférieure de 13 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
Tendance chez les garçons quant à la confiance en soi
Figure 2.10. Garçons qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.10 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 51 | 47 | 50 | 47 | 39 | 37 |
| 8e année | 32 | 31 | 34 | 35 | 26 | 24 |
| 10e année | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- Au fil des années, on constate une diminution de la proportion de garçons qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux. Par exemple, en 2002, 51 % des garçons de 6e année se montraient tout à fait d'accord avec cet énoncé, contre une proportion de 37 % en 2022.
- Les garçons de 10e année enregistrent systématiquement les plus faibles proportions de confiance en soi. Vingt-trois pour cent des garçons de 10e année disaient avoir confiance en eux en 2002, proportion qui a augmenté à 26 % en 2010, mais qui diminue constamment depuis, 19 % affirmant avoir confiance en eux en 2022.
Tendances chez les filles quant à la confiance en soi
Figure 2.11. Filles qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'elles ont confiance en elles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
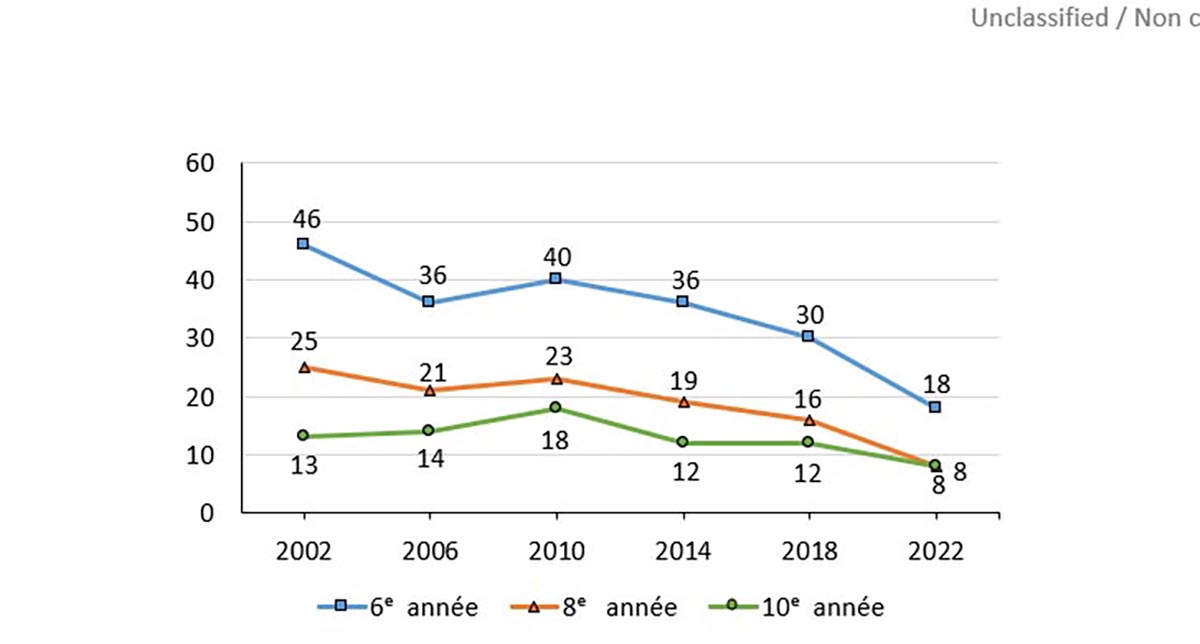
Figure 2.11 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 46 | 36 | 40 | 36 | 30 | 18 |
| 8e année | 25 | 21 | 23 | 19 | 16 | 8 |
| 10e année | 13 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- Au fil des années, il y a eu diminution de la proportion de filles qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'elles ont confiance en elles. Par exemple, en 2002, 46 % des filles de 6e année se montraient tout à fait d'accord avec cet énoncé, contre une proportion de 18 % en 2022.
- De façon générale, un plus grand nombre de filles de 8e année disent avoir confiance en elles que de filles de 10e année. Toutefois, en 2022, ces proportions sont égales (8 %) chez les filles de 8e année et de 10e année.
- Dans l'ensemble, de 2002 à 2022, les filles enregistrent de plus faibles proportions de confiance en elles que les garçons.
Satisfaction à l'égard de la vie
Figure 2.12. Élèves qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 10, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.12 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 30 (27,9, 32,5) | 24 (21,6, 25,7) | 9 (5,5, 11,5) |
| 9e et 10e année | 20 (17,6, 21,6) | 11 (9,1, 12,5) | 4 (1,4, 6,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- De façon générale, les jeunes TDIG affichent les plus faibles niveaux de satisfaction à l'égard de leur vie, et les garçons cisgenres les plus hauts niveaux.
- Chez les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année, 9 % déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie, une proportion inférieure de 15 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 21 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 4 % déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie, une proportion inférieure de 7 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 16 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
- Les élèves de 9e et 10e année déclarent moins souvent une grande satisfaction à l'égard de leur vie que leurs pairs de la 6e à la 8e année (garçons cisgenres : 30 % contre 20 %, soit 10 points de pourcentage de moins; filles cisgenres : 24 % contre 11 %, soit 13 points de pourcentage de moins).
« Si je me fie à mes expériences personnelles, les disparités entre les filles, les garçons et les jeunes TDIG ne sont pas surprenantes. Les jeunes TDIG ont plus de difficulté à trouver leur place parmi leurs pairs cisgenres, alors que pour les filles, de nombreuses attentes pèsent souvent sur elles, ce qui peut nuire à leur santé mentale. »
Tendances chez les garçons quant à la satisfaction à l'égard de la vie
Figure 2.13. Garçons qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 0 à 10, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
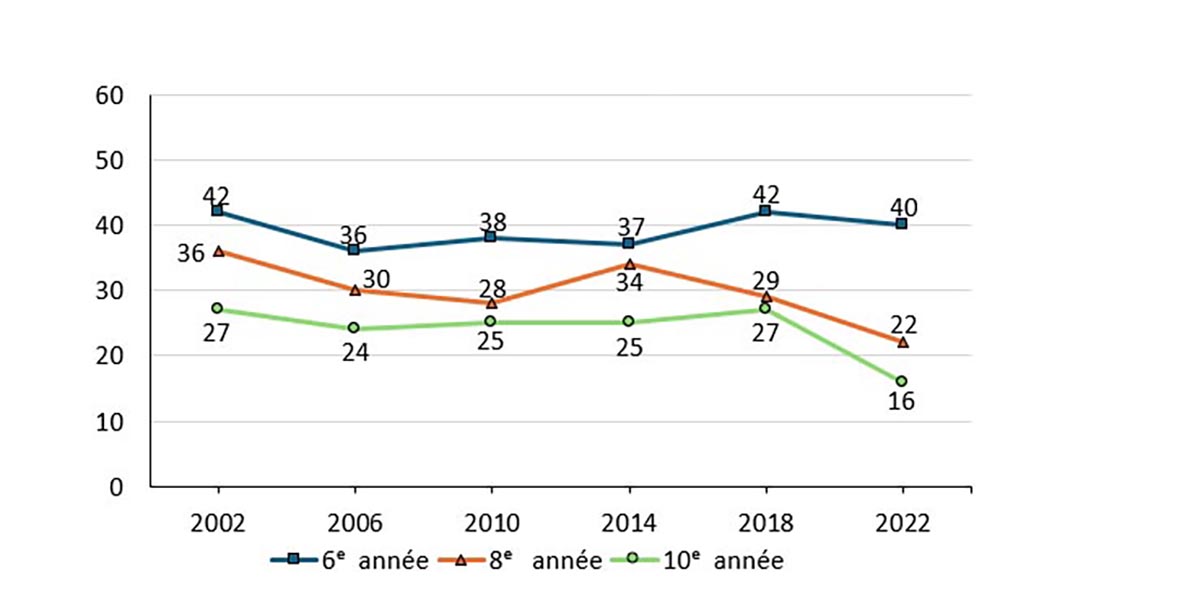
Figure 2.13 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 42 | 36 | 38 | 37 | 42 | 40 |
| 8e année | 36 | 30 | 28 | 34 | 29 | 22 |
| 10e année | 27 | 24 | 25 | 25 | 27 | 16 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- De 2002 à 2022, les garçons de 6e année affichent les niveaux les plus élevés de satisfaction à l'égard de leur vie, et les garçons de 10e année les niveaux les plus bas.
- Entre 2018 et 2022, on observe une diminution de la proportion de garçons de 8e année (29 % contre 22 %, une baisse de 7 points de pourcentage) et de garçons de 10e année (27 % contre 16 %, une baisse de 11 points de pourcentage) qui disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie.
Tendances chez les filles quant à la satisfaction à l'égard de la vie
Figure 2.14. Filles qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 0 à 10, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
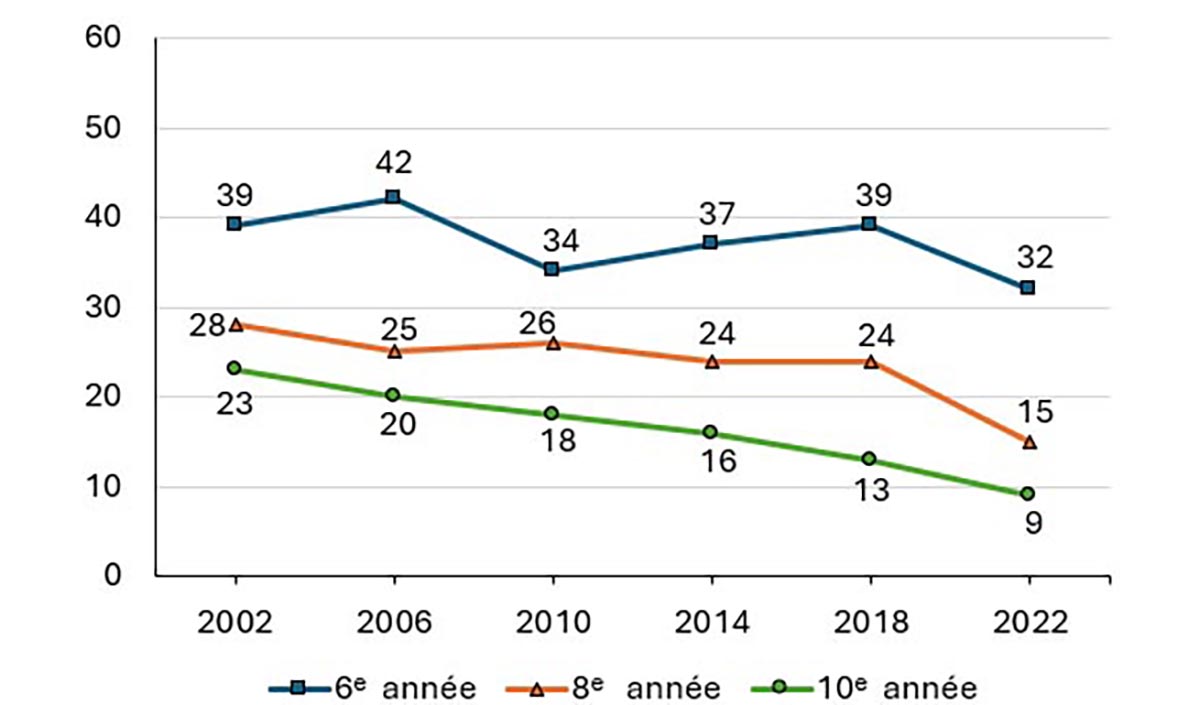
Figure 2.14 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 39 | 42 | 34 | 37 | 39 | 32 |
| 8e année | 28 | 25 | 26 | 24 | 24 | 14 |
| 10e année | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- On observe au fil du temps une diminution de la proportion de filles de 8e et de 10e année qui disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie. Par exemple, chez les filles de 10e année, la proportion a baissé de 14 points de pourcentage, passant de 23 % en 2002 à 9 % en 2022. Une tendance similaire se dessine chez les filles de 8e année, les proportions ayant passé de 28 % en 2002 à 15 % en 2022, soit une réduction de 13 points de pourcentage.
- Entre 2010 et 2018, on observe une hausse constante chez les filles de 6e année de la proportion de celles qui déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie. En 2022, 32 % des filles de 6e année disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie, ce qui représente le pourcentage le plus bas de tous les cycles d'enquête.
Indice de bien-être (who-5)
Figure 2.15. Élèves qui ont un faible niveau de bien-être selon l'indice de bien-être (WHO-5)

Figure 2.15 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 20 (18,5, 22,2) | 41 (38,4, 43,3) | 70 (65,0, 75,4) |
| 9e et 10e année | 30 (27,4, 32,6) | 54 (50,8, 56,3) | 72 (65,4, 78,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- C'est chez les jeunes TDIG qu'un faible niveau de bien-être est le plus souvent déclaré; suivent ensuite les filles cisgenres, puis les garçons cisgenres.
- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 72 % déclarent un faible niveau de bien-être, une proportion supérieure de 18 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 32 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
- Une tendance semblable associée au genre se dessine chez les élèves de la 6e à la 8e année, 70 % des jeunes TDIG affichant un faible niveau de bien-être, contre 41 % des filles cisgenres et 20 % des garçons cisgenres.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- En comparaison avec les filles cisgenres et les jeunes TDIG, les garçons cisgenres affichent des niveaux relativement élevés de résultats positifs en matière de santé mentale et des niveaux relativement faibles de résultats négatifs en matière de santé mentale.
Sujets de préoccupation
- Dans l'ensemble, on observe de moins bons résultats en matière de santé mentale chez les jeunes TDIG que chez leurs pairs cisgenres.
- Les filles cisgenres font état de moins bons résultats en matière de santé mentale que les garçons cisgenres.
- Les garçons cisgenres et les filles cisgenres de 9e et 10e année affichent une moins bonne santé mentale que leurs pairs plus jeunes.
- De façon générale, au fil des années, les filles et les garçons font état de moins bons résultats en matière de santé mentale.
Chapitre 3 : Le foyer et la famille
En règle générale, pendant l'enfance, la famille assume la responsabilité première de la santé de l'enfant en créant et en entretenant un cadre de soins en plus de fournir les ressources nécessaires à l'épanouissement de l'enfantRéférence 25. C'est souvent le contexte familial et les relations qui s'y nouent qui mettent les jeunes en contact avec les ressources et le stress, ce qui a une incidence sur leur santé dans l'immédiat et plus tard dans la vieRéférence 26. La famille a le potentiel d'influencer les voies psychologiques, physiologiques, comportementales et sociales qui ont une incidence sur la santé au cours d'une vieRéférence 27, ce qui en fait un aspect important pour comprendre la vie et les trajectoires de santé des jeunes. De plus, les comportements des parents qui favorisent une bonne santé (inciter les jeunes à pratiquer une activité physique et à manger sainement en plus de démontrer soi-même ces comportementsRéférence 28, discuter de santé sexuelleRéférence 29, surveiller le temps d'écran et agir à titre de modèle en ayant soi-même un temps d'écran raisonnable) ont une influence sur les comportements des jeunes. Enfin, l'implication et le soutien parental sont associés à des expériences positives en matière de santé mentaleRéférence 30Référence 31.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, les élèves doivent inscrire chez qui ils vivent tout le temps ou presque tout le temps. Les élèves devaient indiquer leur degré d'accord avec les énoncés « mes parents/tuteurs me comprennent », « j'ai une vie familiale heureuse » et « il y a des jours où je voudrais partir de la maison » sur une échelle de Likert en cinq points allant de 1 « je suis tout à fait d'accord » à 5 « je ne suis pas du tout d'accord ». Les élèves devaient également répondre à certaines questions sur leurs parents. Afin d'évaluer l'aisance de la communication avec leur mère et leur père, les jeunes devaient indiquer s'il était « très facile », « facile », « difficile » ou « très difficile » de parler avec eux de choses qui les préoccupent. Les élèves qui sont en contact avec seulement l'un de leurs parents ou qui ne sont en contact avec aucun de leurs parents pouvaient sélectionner « je n'ai personne de ce genre ou je ne la vois pas ». Enfin, l'échelle du soutien de la famille a été utilisée pour évaluer la santé de la famille et du foyer. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, les réponses à chaque élément sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de quatre (soutien faible) à 28 (soutien élevé).
Tableau 3.1. Échelle du soutien de la famille :
- Ma famille essaie vraiment de m'aider.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7= Je suis tout à fait d'accord
- J'obtiens l'aide et le soutien émotionnel dont j'ai besoin de la part de ma famille.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7= Je suis tout à fait d'accord
- Ma famille est prête à m'aider à prendre des décisions.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7= Je suis tout à fait d'accord
- Je peux parler de mes problèmes avec ma famille.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7= Je suis tout à fait d'accord
Structure familiale
Figure 3.1. Structure familiale (%)

Figure 3.1 : Description textuelle
| Structure familiale | Pourcentage |
|---|---|
| Deux parents | 75,1 |
| Mère et partenaire de la mère | 3,4 |
| Père et partenaire du père | 1,1 |
| Mère seulement | 14,1 |
| Père seulement | 3,2 |
| Autre | 3,1 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|
- Environ 75 % des élèves de la 6e à la 10e année déclarent vivre avec leurs deux parents.
- Un pourcentage de 14 % vivent avec leur mère uniquement, et 11 % vivent dans une structure familiale différente.
Vie familiale heureuse
Figure 3.2. Élèves qui déclarent avoir une vie familiale heureuse, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 85 (83,5, 86,7) | 74 (71,8, 76,0) | 50 (45,0, 55,3) |
| 9e et 10e année | 80 (77,7, 82,0) | 66 (64,0, 69,0) | 47 (40,8, 53,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les garçons cisgenres sont les plus nombreux à déclarer avoir une vie familiale heureuse (85 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année; 80 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année).
- Les jeunes TDIG sont les moins nombreux à avoir une vie familiale heureuse (50 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année; 47 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année).
- En général, la fréquence de déclaration d'une vie familiale heureuse est plus élevée chez les jeunes de la 6e à la 8e année que chez ceux de 9e et 10e année, la différence la plus marquée se trouvant chez les filles cisgenres (74 % de la 6e à la 8e année; 66 % pour la 9e et 10e année).
Souhait de partir de la maison
Figure 3.3. Élèves qui déclarent qu'il y a des jours où ils voudraient partir de la maison, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 20 (18,0, 21,6) | 28 (25,5, 29,7) | 47 (41,3, 53,1) |
| 9e et 10e année | 23 (34,3, 36,8) | 34 (20,9, 25,9) | 59 (52,2, 65,4) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les garçons cisgenres sont les moins nombreux à déclarer vouloir partir de la maison (20 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année; 23 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année).
- Les jeunes TDIG sont les plus nombreux à déclarer vouloir partir de la maison (47 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année; 59 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année).
- Les filles cisgenres de 9e et 10e année (34 %) déclarent vouloir partir de la maison dans une plus large mesure que les filles cisgenres de la 6e à la 8e année (28 %).
Communication avec la mère
Figure 3.4. Élèves qui trouvent facile ou très facile de parler avec leur mère, selon l'année d'études et le genre (%)
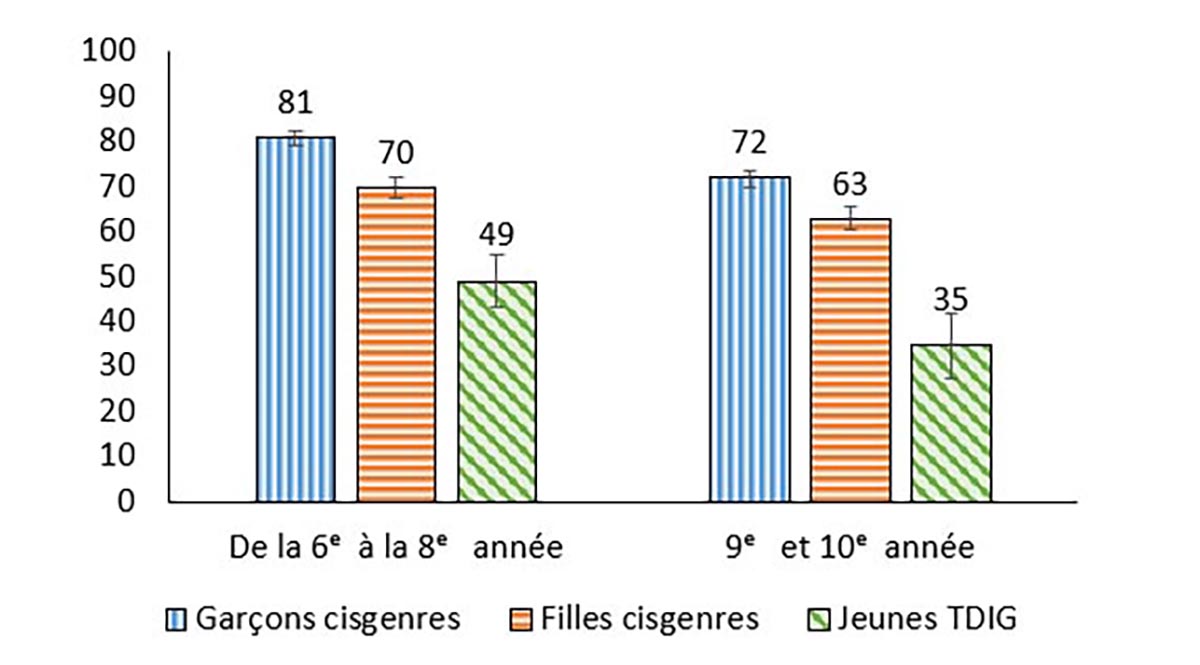
Figure 3.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 81 (79,1, 82,4) | 70 (67,7, 72,1) | 49 (43,2, 54,8) |
| 9e et 10e année | 72 (69,7, 73,5) | 63 (60,7, 65,5) | 35 (27,3, 41,9) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 35 et 81 % des jeunes qui ont une mère estiment qu'il est facile ou très facile de parler avec celle-ci; les pourcentages varient considérablement d'un groupe à l'autre.
- La facilité de communication avec la mère est plus faible chez les élèves de 9e et 10e année que chez les élèves de la 6e à la 8e année, peu importe l'identité de genre des jeunes : 9 points de pourcentage de moins pour les garçons cisgenres, 7 points de pourcentage de moins pour les filles cisgenres et 14 points de pourcentage de moins pour les jeunes TDIG.
- Quelle que soit l'année d'études, les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres et les jeunes TDIG à déclarer qu'il est facile de communiquer avec leur mère.
Communication avec le père
Figure 3.5. Élèves qui trouvent facile ou très facile de parler avec leur père, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 70 (67,9, 72,1) | 53 (50,6, 55,3) | 34 (28,1, 39,0) |
| 9e et 10e année | 60 (57,2, 61,7) | 42 (39,1, 43,9) | 23 (17,9, 28,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 23 et 70 % des jeunes qui ont un père estiment qu'il est facile ou très facile de parler avec leur père, ce qui représente une très grande variation des points de pourcentage.
- Le pourcentage de filles cisgenres et de garçons cisgenres qui déclarent qu'il est facile de parler avec leur père diminue avec le nombre d'années d'études.
- Soixante-dix pour cent des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année trouvent qu'il est facile de parler avec leur père, contre 60 % en 9e et 10e année. De façon similaire, 53 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année trouvent qu'il est facile de parler avec leur père, contre 42 % en 9e et 10e année.
- Peu importe l'année d'études, plus de garçons cisgenres que de filles cisgenres et de jeunes TDIG indiquent une facilité à communiquer avec leur père.
Tendances chez les garçons quant au sentiment d'être compris par leurs parents
Figure 3.6. Garçons qui déclarent se sentir compris par leurs parents, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 3.6 : Description textuelle
| L’année d’études | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 66 | 78 | 76 | 91 | 90 | 90 | 87 | 87 | 84 |
| 8e année | 56 | 62 | 64 | 83 | 78 | 80 | 80 | 79 | 73 |
| 10e année | 51 | 50 | 53 | 72 | 66 | 72 | 71 | 75 | 65 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles d'enquête.
- Entre 1990 et 2002, des proportions croissantes de garçons de 6e, 8e et 10e année ont déclaré se sentir compris par leurs parents. Après 2002, on observe un déclin graduel de ces déclarations pour chacune des trois années d'études.
- Dans l'ensemble, en 2022, moins de garçons de 6e, 8e et 10e année déclarent se sentir compris par leurs parents que lors des cinq cycles précédents de l'enquête HBSC (2002-2018).
- En général, la proportion de garçons qui déclarent se sentir compris par leurs parents diminue avec le nombre d'années d'études. Par exemple, en 2022, 84 % des garçons de 6e année déclarent se sentir compris par leurs parents, contre 73 % des garçons de 8e année et 65 % des garçons de 10e année.
Tendances chez les filles quant au sentiment d'être comprises par leurs parents
Figure 3.7. Filles qui déclarent se sentir comprises par leurs parents, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
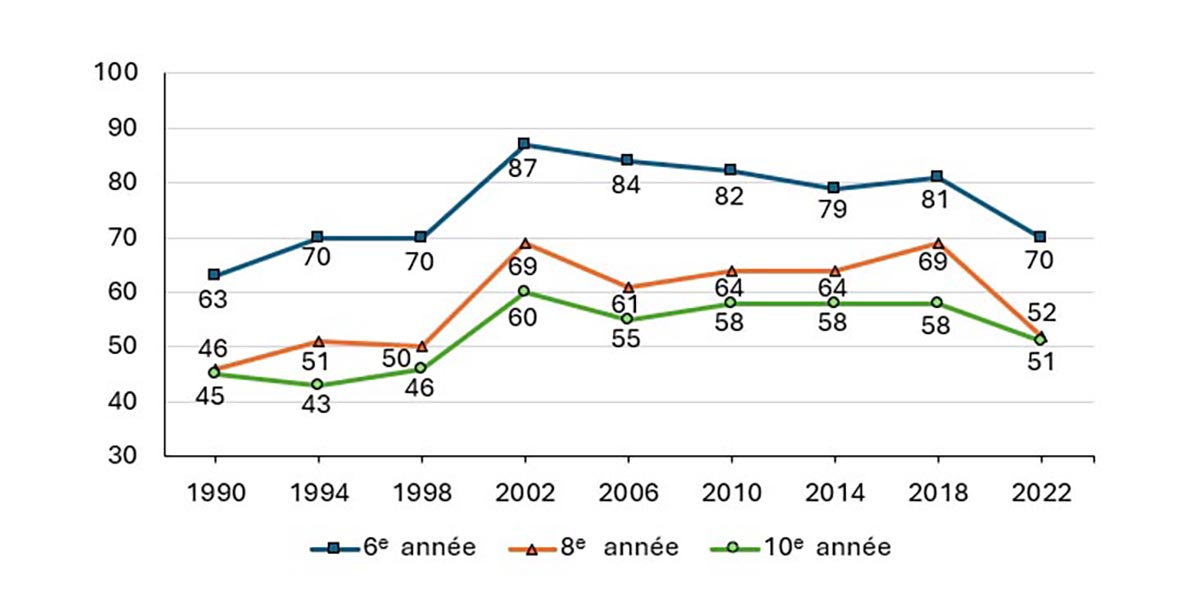
Figure 3.7 : Description textuelle
| L’année d’études | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 63 | 70 | 70 | 87 | 84 | 82 | 79 | 81 | 70 |
| 8e année | 46 | 51 | 50 | 69 | 61 | 64 | 64 | 69 | 52 |
| 10e année | 45 | 43 | 46 | 60 | 55 | 58 | 58 | 58 | 51 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- Entre 1990 et 2002, des proportions croissantes de filles de 6e, 8e et 10e année ont déclaré se sentir comprises par leurs parents. Après 2002, on observe un déclin graduel de ces déclarations pour chacune des trois années d'études.
- Dans l'ensemble, en 2022, moins de filles de 6e, 8e et 10e année déclarent se sentir comprises par leurs parents que lors des cinq cycles précédents de l'enquête HBSC (2002-2018).
- En 2022, la proportion de filles de 6e, 8e et 10e année qui déclarent se sentir comprises par leurs parents a diminué de façon significative par rapport à 2018. Chez les filles de 6e année, on observe une réduction de 11 points de pourcentage (de 81 % en 2018 à 70 % en 2022), chez les filles de 8e année, une réduction de 18 points de pourcentage (de 69 % en 2018 à 52 % en 2022), et chez les filles de 10e année, une réduction de 7 points de pourcentage (de 58 % en 2018 à 51 % en 2022).
- De façon générale, la proportion des filles qui se sentent comprises par leurs parents diminue avec le nombre d'années d'études. Toutefois, en 2022, environ la même proportion de filles de 8e et de 10e année déclarent se sentir comprises par leurs parents.
- De façon systématique, les filles sont moins nombreuses que les garçons à déclarer se sentir comprises par leurs parents.
« Cette augmentation du nombre de filles cisgenres déclarant ne pas se sentir comprises en 8e année était un thème commun chez mes camarades de classe. Au début de l’adolescence, la plupart des jeunes commencent à adopter des comportements tels que la consommation d’alcool, l’utilisation des médias sociaux et le maquillage. Ces comportements peuvent être considérés comme problématiques dans différentes structures familiales et par certains parents, causant plus de conflits, ce qui fait que les filles cisgenres se sentent moins comprises par leurs parents. »
Soutien familial
Figure 3.8. Élèves qui déclarent un niveau de soutien familial élevé, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.8 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 54 (52,0, 56,9) | 45 (42,2, 47,2) | 27 (21,1, 32,0) |
| 9e et 10e année | 45 (42,9, 47,7) | 38 (35,6, 39,7) | 21 (16,5, 26,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- De façon générale, les jeunes TDIG sont les moins nombreux à faire état d'un soutien familial élevé, et les garçons cisgenres sont les plus nombreux à faire état d'un tel soutien.
- De la 6e à la 8e année, 27 % des jeunes TDIG déclarent un soutien familial élevé, ce qui représente 18 points de pourcentage de moins que chez les filles cisgenres et 27 points de pourcentage de moins que chez les garçons cisgenres. Cette tendance à la baisse selon le genre s'observe également chez les élèves de 9e et 10e année.
- La proportion de jeunes qui déclarent un soutien familial élevé est plus faible en 9e et 10e année que de la 6e à la 8e année chez les garçons cisgenres (45 % contre 54 %) et chez les filles cisgenres (38 % contre 45 %).
Vie familiale heureuse et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,61 | 0,61 | -0,48 | -0,44 |
| Supérieure | 0,51 | 0,51 | -0,40 | -0,31 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,52 | 0,47 | -0,34 | -0,37 | |
| Supérieure | 0,46 | 0,46 | -0,33 | -0,28 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,72 | 0,67 | -0,60 | -0,53 |
| Supérieure | 0,56 | 0,51 | -0,38 | -0,36 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,54 | 0,52 | -0,50 | -0,51 | |
| Supérieure | 0,53 | 0,44 | -0,37 | -0,38 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,58 | 0,42 | -0,42 | -0,40 |
| 9e et 10e année | 0,48 | 0,50 | -0,27 | -0,35 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,64 | 0,40 | -0,38 | -0,38 | |
| Supérieure | 0,49 | 0,47 | -0,33 | -0,37 | ||
| Résultat global | 0,57 | 0,53 | -0,44 | -0,42 | ||
- Dans l'ensemble, une vie familiale heureuse est systématiquement associée aux indicateurs de santé mentale. Le fait d'avoir une vie familiale heureuse est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associé négativement à la solitude et aux problèmes de santé, peu importe l'année d'études, le genre ou le degré d'aisance familiale des élèves.
- Une vie familiale heureuse est plus fortement liée aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- De façon générale, pour les garçons cisgenres et les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, il existe une relation plus forte entre une vie familiale heureuse et les indicateurs de santé mentale positifs que chez leurs camarades plus âgés et dont la famille est plus aisée.
- Chez les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, une vie familiale heureuse affiche la plus forte corrélation avec la satisfaction à l'égard de la vie.
Soutien familial et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,38 | 0,35 | -0,36 | -0,41 |
| Supérieure | 0,28 | 0,25 | -0,24 | -0,22 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,45 | 0,41 | -0,24 | -0,38 | |
| Supérieure | 0,24 | 0,27 | -0,23 | -0,24 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,56 | 0,43 | -0,45 | -0,35 |
| Supérieure | 0,43 | 0,39 | -0,36 | -0,35 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,45 | 0,54 | -0,38 | -0,29 | |
| Supérieure | 0,41 | 0,31 | -0,32 | -0,31 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,46 | 0,42 | -0,24 | -0,37 |
| 9e et 10e année | 0,38 | 0,37 | -0,23 | -0,38 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,39 | 0,46 | -0,18 | -0,43 | |
| Supérieure | 0,43 | 0,40 | -0,25 | -0,37 | ||
| Résultat global | 0,39 | 0,36 | -0,33 | -0,34 | ||
- Dans l'ensemble, le soutien familial est systématiquement associé aux indicateurs de santé mentale. Le soutien familial est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associé négativement à la solitude et aux problèmes de santé, peu importe l'année d'études, le genre ou le degré d'aisance familiale des élèves.
- Le soutien familial est plus fortement lié aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Pour les filles cisgenres, le soutien familial est associé positivement de façon modérée à la satisfaction à l'égard de la vie. Pour les filles cisgenres dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, le soutien familial est associé positivement de façon modérée au bien-être.
- Pour les garçons cisgenres, à l'exception de ceux qui sont en 9e et 10e année et dont la famille est moins aisée, le soutien familial affiche une faible corrélation avec les indicateurs de santé mentale positifs.
- En ce qui concerne les jeunes TDIG, on observe chez ceux qui sont plus jeunes et dont la famille est plus aisée des associations plus fortes entre le soutien familial et les indicateurs de santé mentale positifs que par rapport aux indicateurs de santé mentale négatifs.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Les garçons cisgenres affichent des niveaux relativement élevés en ce qui concerne les indicateurs positifs liés au foyer et à la famille et des niveaux relativement faibles en ce qui concerne les indicateurs négatifs liés au foyer et à la famille.
- De 80 à 85 % des garçons cisgenres font état d'une vie familiale heureuse.
- La déclaration d'une vie familiale heureuse est fortement corrélée avec la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être chez certains élèves, en particulier les plus jeunes. Également, pour la plupart des élèves, le fait d'avoir une vie familiale heureuse est corrélé de façon modérée avec de nombreux indicateurs de santé mentale.
Sujets de préoccupation
- Les jeunes TDIG font état d'indicateurs liés au foyer et à la famille nettement moins bons que ceux observés chez leurs pairs cisgenres.
- De 47 à 59 % des jeunes TDIG mentionnent vouloir partir de la maison.
- Entre 2018 et 2022, il y a diminution du nombre de garçons et de filles à déclarer se sentir compris par leurs parents. Ce constat est particulièrement marqué chez les filles de 8e année.
- De manière générale, plus les jeunes vieillissent, moins ils font état d'indicateurs révélateurs de résultats positifs en matière de santé en ce qui concerne l'aspect du foyer et de la famille, notamment en ce qui a trait au soutien familial et à une vie familiale heureuse.
Chapitre 4 : Les amis
Les relations avec les amis sont importantes tout au long des années de scolarisation, mais acquièrent une signification encore plus grande à l'adolescence. Au fil du développement d'un enfant, ses amitiés, d'abord axées sur le jeu, évolueront et viendront à lui offrir davantage d'occasions de rapprochement et d'intimitéRéférence 32. Beaucoup de jeunes entretiennent des liens avec leurs amis à la fois dans leur environnement physique, comme l'école, et dans des espaces virtuels, comme les médias sociauxRéférence 32.
Les amis ont une influence directe sur les comportements des adolescentsRéférence 33Référence 34. Les jeunes qui adoptent un plus grand nombre de comportements à risque, comme la consommation excessive d'alcoolRéférence 35 et la consommation de droguesRéférence 36, sont plus susceptibles d'influencer négativement leurs pairs, alors que les jeunes qui font preuve de comportements plus protecteurs sont plus susceptibles d'influencer positivement leurs pairsRéférence 34. En ce qui a trait à la santé mentale, les relations caractérisées par un bon soutien entre pairs constituent un facteur de protection – les relations sociales positives préludant à des taux moindres de dépressionRéférence 37 et d'anxiétéRéférence 38 et à une atténuation des effets négatifs du stressRéférence 39.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, les relations avec les amis sont mesurées au moyen de diverses questions et échelles. D'abord, l'échelle du soutien des amis est utilisée pour évaluer la perception des élèves du soutien qu'ils reçoivent de leurs amis. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, les réponses à chaque élément sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de 4 (soutien faible) à 28 (soutien élevé). Les questions sur la communication avec les amis sont évaluées selon la facilité de la communication et la fréquence des communications en ligne au fil de la journée. En outre, nous avons demandé aux élèves de 9e et 10e année d'indiquer les activités positives et les activités à risque auxquelles leurs groupes d'amis s'adonnent. Les activités à risque présentées au tableau 4.4 (fumer la cigarette, se saouler au moins une fois par semaine, avoir recours aux drogues pour obtenir une sensation d'euphorie [un « high »] et vapoter) ont été combinées pour donner une échelle dont les valeurs vont de 4 (niveau le plus bas) à 20 (niveau le plus élevé).
Tableau 4.1. Échelle du soutien des amis
- Mes amis essaient vraiment de m'aider.
- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 = Je suis tout à fait d'accord
- Je peux compter sur mes amis lorsque les choses vont mal.
- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 = Je suis tout à fait d'accord
- Je peux exprimer mes sentiments de joie comme de tristesse devant mes amis.
- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 = Je suis tout à fait d'accord
- Je peux parler de mes problèmes avec mes amis.
- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 = Je suis tout à fait d'accord
Caractéristiques positives des groupes de pairs
| Élément d'enquête | Élèves de 9e et 10e année | ||
|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Bien réussir à l'école | 58 | 63 | 53 |
| Pratiquer des sports de groupe organisés | 43 | 41 | 23 |
| Participer à des activités culturelles autres que des activités sportives | 17 | 16 | 17 |
| Bien s'entendre avec ses parents | 64 | 53 | 29 |
- La caractéristique positive la plus fréquemment mentionnée par les garçons cisgenres est que leurs amis s'entendent bien avec leurs parents (64 %).
- Chez les filles cisgenres, 63 % indiquent que leurs amis réussissent bien à l'école; cette proportion s'établit à 53 % chez les jeunes TDIG.
- La caractéristique positive des groupes de pairs la moins souvent citée par l'ensemble des élèves est la participation à des activités culturelles autres que des activités sportives. Cette caractéristique est mentionnée par 16 % des filles cisgenres et 17 % des garçons cisgenres et des jeunes TDIG.
- Les jeunes TDIG, en comparaison avec les jeunes cisgenres, sont les moins nombreux à déclarer que leurs amis réussissent bien à l'école, pratiquent des sports et s'entendent bien avec leurs parents.
Activités à risque des groupes de pairs
| Élément d'enquête | Élèves de 9e et 10e année | ||
|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Fumer des cigarettes | 3 | 5 | 6 |
| Se saouler (consommation excessive d'alcool) au moins une fois par semaine | 5 | 6 | 4 |
| Avoir pris des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie (un « high ») | 10 | 13 | 14 |
| Vapoter | 12 | 19 | 14 |
- Chez les garçons cisgenres et les filles cisgenres, le vapotage est l'activité à risque la plus fréquemment citée; 19 % des filles cisgenres et 12 % des garçons cisgenres indiquent que leur groupe d'amis s'adonne au vapotage.
- Chez les jeunes TDIG, la consommation de drogues pour obtenir une sensation d'euphorie et le vapotage sont les activités à risque du groupe de pairs les plus fréquemment citées (soit un pourcentage de 14 % pour chaque catégorie).
- En comparaison avec les filles cisgenres et les jeunes TDIG, les garçons cisgenres enregistrent la plus faible proportion d'amis qui fument des cigarettes (3 %), qui consomment des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie (10 %) et qui vapotent (12 %).
Soutien des amis
Figure 4.1. Élèves qui déclarent avoir un soutien élevé de leurs amis, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 4.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 37 (35,0, 39,3) | 45 (42,5, 46,8) | 34 (27,5, 40,3) |
| 9e et 10e année | 36 (33,7, 38,1) | 42 (39,5, 44,0) | 48 (41,8, 54,6) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 45 % des filles cisgenres indiquent recevoir un soutien élevé de leurs amis, ce qui représente 8 points de pourcentage de plus que les garçons cisgenres et 11 points de pourcentage de plus que les jeunes TDIG.
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 36 % des garçons cisgenres indiquent recevoir un soutien élevé de leurs amis, ce qui représente 6 points de pourcentage de moins que les filles cisgenres et 12 points de pourcentage de moins que les jeunes TDIG.
« En tant que jeune queer, j'ai très peu de soutien. Je me tiens avec mes amis qui entrent aussi dans cette catégorie. On est un groupe tissé serré. Si tu as fait ton coming out, du point de vue vestimentaire, il y a une pression pour que tu t'habilles d'une certaine façon, sinon tu te fais questionner. C'est difficile de gérer ça et d'être normal. »
Communication en ligne avec les amis proches
Figure 4.2. Élèves qui déclarent communiquer en ligne avec leurs amis proches presque tout le temps, tout au long de la journée, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 4.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 42 (39,8, 44,3) | 54 (51,4, 56,2) | 45 (38,4, 50,9) |
| 9e et 10e année | 57 (54,5, 60,0) | 73 (70,4, 74,8) | 61 (54,7, 67,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion de garçons cisgenres et de filles cisgenres qui indiquent maintenir des contacts en ligne avec leurs amis proches presque tout le temps, tout au long de la journée, est plus forte chez les élèves de 9e et 10e année que chez les élèves de la 6e à la 8e année.
- C'est chez les filles cisgenres que l'on remarque la hausse la plus marquée entre les années d'études de la proportion de contacts en ligne avec les amis proches, la proportion passant de 54 % pour la catégorie de la 6e à la 8e année à 73 % pour la 9e et la 10e année, soit une augmentation de 19 points de pourcentage.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 42 % des garçons cisgenres indiquent avoir des contacts en ligne avec leurs amis proches presque tout le temps, tout au long de la journée, soit 12 points de pourcentage de plus que les filles cisgenres.
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 73 % des filles cisgenres mentionnent avoir des contacts en ligne avec leurs amis proches presque tout le temps, tout au long de la journée, soit 16 points de pourcentage de plus que les garçons cisgenres, et 12 points de pourcentage de plus que les jeunes TDIG.
« Souvent, mes amis sont avec moi à l’école, mais je leur parle quand même en ligne. La fin de semaine, je leur parle un peu plus en ligne parce que je ne peux pas les voir en personne. »
Facilité de la communication avec le meilleur ami ou la meilleure amie
Figure 4.3. Élèves qui déclarent trouver facile de parler avec leur meilleur ami ou meilleure amie à propos de choses qui les préoccupent, selon l'année d'études et le genre (%)
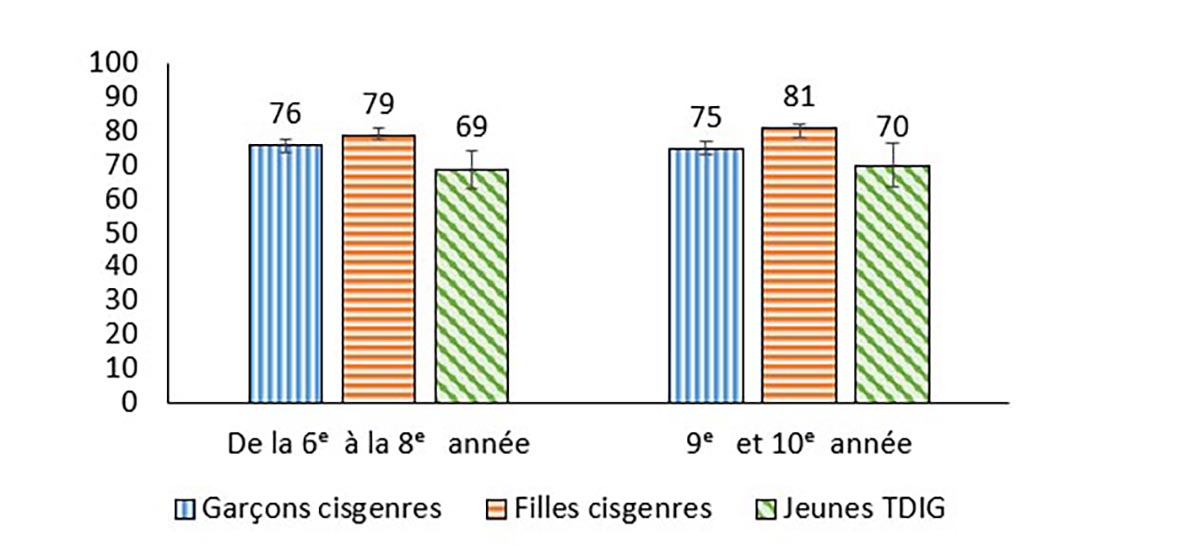
Figure 4.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 76 (73,8, 77,7) | 79 (77,5, 81,3) | 69 (63,1, 74,6) |
| 9e et 10e année | 75 (73,0, 77,2) | 81 (78,5, 82,5) | 70 (63,5, 76,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les filles cisgenres, peu importe le groupe d'années d'études, sont plus nombreuses que les garçons cisgenres et les jeunes TDIG à mentionner qu'il leur est facile de parler avec leur meilleur ami ou meilleure amie à propos de choses qui les préoccupent.
- Dans le groupe des élèves de la 6e à la 8e année, 79 % des filles cisgenres déclarent qu'il leur est facile de parler avec leur meilleur ami ou meilleure amie à propos de choses qui les préoccupent, soit 10 points de pourcentage de plus que les jeunes TDIG.
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 81 % des filles cisgenres révèlent qu'il leur est facile de parler avec leur meilleur ami ou meilleure amie à propos de choses qui les préoccupent, soit 6 points de pourcentage de plus que les garçons cisgenres, et 11 points de pourcentage de plus que les jeunes TDIG.
Comportements à risque des pairs et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | 9e et 10e année | Moindre | -0,30 | -0,26 | 0,39 | 0,47 |
| Supérieure | -0,13 | -0,07 | 0,13 | 0,12 | ||
| Filles cisgenres | 9e et 10e année | Moindre | -0,22 | -0,24 | 0,33 | 0,47 |
| Supérieure | -0,24 | -0,20 | 0,28 | 0,33 | ||
| Jeunes TDIG | 9e et 10e année | Les deux catégories d'aisance familiale | NS | -0,17 | NS | 0,19 |
| Moindre | NS | NS | NS | 0,25 | ||
| Supérieure | NS | -0,16 | NS | 0,13 | ||
| Résultat global | -0,21 | -0,18 | 0,24 | 0,28 | ||
- Dans l'ensemble, une corrélation négative a pu être établie entre les comportements à risque des pairs et la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être, et une corrélation positive a été observée entre les comportements à risque des pairs et la solitude et les problèmes de santé, et ce pour tous les groupes d'élèves.
- Chez les filles cisgenres et les garçons cisgenres dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, les comportements à risque des pairs sont fortement corrélés aux problèmes de santé.
- La plus forte corrélation entre les comportements à risque des pairs et les indicateurs de santé mentale s'établit chez les filles cisgenres, en comparaison avec les garçons cisgenres et les jeunes TDIG.
Soutien des amis et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,12 | 0,18 | -0,10 | -0,16 |
| Supérieure | 0,23 | 0,27 | -0,22 | -0,15 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | NS | NS | -0,16 | -0,19 | |
| Supérieure | 0,16 | 0,23 | -0,12 | -0,10 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,33 | 0,24 | -0,35 | -0,20 |
| Supérieure | 0,27 | 0,27 | -0,31 | -0,22 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,18 | 0,27 | -0,32 | -0,16 | |
| Supérieure | 0,18 | 0,20 | -0,24 | -0,13 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,12 | 0,21 | -0,10 | NS |
| 9e et 10e année | NS | 0,16 | -0,19 | NS | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | 0,16 | NS | 0,15 | |
| Supérieure | 0,12 | 0,19 | -0,13 | NS | ||
| Résultat global | 0,20 | 0,21 | -0,20 | -0,12 | ||
- Dans l'ensemble, le soutien des amis est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associé négativement à la solitude et aux problèmes de santé chez la majorité des jeunes. C'est chez les filles cisgenres que les corrélations sont les plus fortes.
« Si tu ne t'identifies pas comme un garçon ou une fille, les autres te rejettent automatiquement à l'école. »
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Les filles cisgenres démontrent des niveaux plutôt élevés d'indicateurs positifs concernant leurs amitiés. Ceci est particulièrement encourageant étant donné la relation entre le soutien élevé des amis et les indicateurs de santé mentale chez ce groupe de jeunes.
- De 16 à 64 % des élèves indiquent que leurs amis adoptent des comportements positifs (c.-à-d. bien réussir à l'école, pratiquer des sports de groupe organisés, participer à des activités culturelles autres que des activités sportives, bien s'entendre avec ses parents).
- Le soutien des amis est associé à une bonne santé mentale, surtout chez les filles cisgenres.
Sujets de préoccupation
- De 3 à 19 % des élèves mentionnent que leurs amis participent à des activités à risque (c.-à-d. fumer des cigarettes, se saouler au moins une fois par semaine, consommer des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie, vapoter), ce qui est particulièrement préoccupant pour les filles cisgenres et les garçons cisgenres dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, étant donné que les comportements à risque des pairs présentent une corrélation modérément positive avec les problèmes de santé chez cette catégorie de jeunes.
Chapitre 5 : L'école
Le climat scolaire englobe le cadre scolaire, la communauté, la sécurité et l'aspect institutionnel, qui contribuent tous à l'expérience des élèves à l'écoleRéférence 40. Le climat scolaire influence tous les aspects de la santé des élèves, y compris la santé mentale. Par exemple, les relations positives avec les camarades et le personnel enseignant sont associées à une augmentation du bien-être psychosocial, et des perceptions positives de la sécurité à l'école sont associées à une diminution des comportements à risqueRéférence 41.
À l'école, les élèves peuvent interagir avec leurs camarades et le personnel scolaire et enseignant tout en acquérant des habiletés fondamentales qui leur seront précieuses. Les élèves qui s'entendent bien avec leurs enseignant(e)s font état de moins de symptômes de dépressionRéférence 42, et lorsque les enseignant(e)s affichent eux-mêmes un bien-être supérieur, c'est également le cas pour leurs élèves, qui vivent aussi moins de détresse psychologiqueRéférence 43. Le personnel enseignant est également le défenseur des élèves de sa classeRéférence 44Référence 45, ce qui indique qu'il peut faciliter ou empêcher la satisfaction des besoins en matière de santé des élèves en contexte scolaireRéférence 46.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, on a posé aux élèves des questions touchant les indicateurs liés à leur milieu scolaire concernant, entre autres, leurs enseignant(e)s, leurs camarades de classe, les travaux scolaires et leur appréciation générale de l'école. L'échelle du climat scolaire regroupe quatre éléments liés à la perception du milieu scolaire par les élèves. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, les réponses à chaque élément sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de 4 (climat scolaire faible) à 20 (climat scolaire élevé). La perception d'avoir des enseignant(e)s bienveillant(e)s a été évaluée en demandant aux élèves dans quelle mesure ils étaient d'accord ou non avec l'affirmation : « J'ai le sentiment que mes enseignant(e)s se soucient de moi en tant que personne » sur une échelle de Likert en cinq points allant de 1 (« je suis tout à fait d'accord ») à 5 (« je ne suis pas du tout d'accord »).
Tableau 5.1. Échelle du climat scolaire
- Que penses-tu de l'école en ce moment?
- 1= Je n'aime pas du tout l'école
- 2= Je n'aime pas beaucoup l'école
- 3=J'aime un peu l'école
- 4= J'aime beaucoup l'école
- Notre école est un bon endroit où étudier.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2= Je ne suis pas d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je suis d'accord
- 5= Je suis tout à fait d'accord
- Je me sens à ma place dans cette école.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2= Je ne suis pas d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je suis d'accord
- 5= Je suis tout à fait d'accord
- Les règles à mon école sont justes.
- 1= Je ne suis pas du tout d'accord
- 2= Je ne suis pas d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je suis d'accord
- 5= Je suis tout à fait d'accord
Bienveillance des enseignant(e)s
Figure 5.1. Élèves qui déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux en tant que personnes, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 5.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 69 (66,9, 71,7) | 66 (62,8, 68,4) | 51 (45,3, 57,0) |
| 9e et 10e année | 62 (59,0, 64,3) | 53 (49,8, 55,4) | 52 (45,3, 57,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- En général, plus de la moitié des jeunes déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux.
- Le pourcentage de filles cisgenres et de garçons cisgenres qui déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux diminue avec le nombre d'années d'études.
- De la 6e à la 8e année, la proportion de jeunes TDIG qui déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux est plus faible que pour les garçons cisgenres et les filles cisgenres.
- Dans le groupe de 9e et 10e année, 62 % des garçons cisgenres déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux, une proportion supérieure de 9 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 10 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
« Aux personnes qui travaillent dans les écoles : c'est important de vous informer si vos élèves vont bien! L'école est pratiquement une deuxième maison, qu'on le veuille ou non, et c'est le rôle et la priorité du personnel de rendre cet endroit confortable et sûr pour les élèves. Si l'école causait moins de détresse aux élèves, que ce soit en adaptant les cours à leurs besoins ou en leur offrant une oreille attentive, on arriverait peut-être à réduire certaines des statistiques présentées dans le chapitre sur la santé mentale. Un environnement positif entraîne une santé mentale et un état d'esprit positifs. Aussi, les espaces sûrs pour les jeunes TDIG sont très bénéfiques pour eux! »
Soutien des enseignant(e)s
Figure 5.2. Élèves faisant état de différents niveaux de soutien perçu de la part des enseignant(e)s, selon l'année d'études et le genre (%)
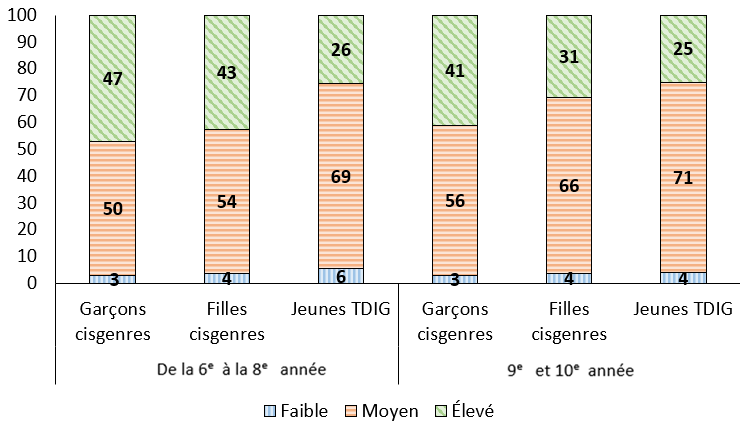
Figure 5.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Genre | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | Garçons cisgenres | 3 | 50 | 47 |
| Filles cisgenres | 4 | 54 | 43 | |
| Jeunes TDIG | 6 | 69 | 26 | |
| 9e et 10e année | Garçons cisgenres | 3 | 56 | 41 |
| Filles cisgenres | 4 | 66 | 31 | |
| Jeunes TDIG | 4 | 71 | 25 |
- Peu importe l'année d'études, les jeunes TDIG sont moins enclins que les garçons cisgenres et les filles cisgenres à faire état d'un niveau de soutien élevé de la part de leurs enseignant(e)s (26 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année; 25 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année).
- Les garçons cisgenres sont plus enclins que les filles cisgenres et que les jeunes TDIG à faire état d'un niveau de soutien élevé de la part de leurs enseignant(e)s (47 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année; 41 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année).
- La proportion de garçons cisgenres et de filles cisgenres qui font état d'un niveau de soutien élevé de la part de leurs enseignant(e)s diminue avec le nombre d'années d'études. Chez les garçons cisgenres de 9e et 10e année, le pourcentage s'élève à 41 %, contre 47 % pour la catégorie de la 6e à la 8e année. On observe une même tendance chez les filles cisgenres (31 % pour la 9e et 10e année; 43 % de la 6e à la 8e année).
- Dans l'ensemble, de 3 à 6 % des élèves font état d'un niveau de soutien faible de la part de leurs enseignant(e)s.
« Nos enseignants sont gentils et nous aident dans nos études, mais hésitent à parler de quoi que ce soit qui ne figure pas dans le test, même si cela nous intéresse. »
Sentiment d'être accepté par les autres élèves
Figure 5.3. Élèves qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les autres élèves les acceptent tels qu'ils sont, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 5.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 64 (61,3, 66,5) | 48 (45,6, 51,1) | 25 (19,4, 29,9) |
| 9e et 10e année | 64 (61,5, 66,3) | 50 (46,8, 52,6) | 26 (20,0, 32,4) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 64 % des garçons cisgenres sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les autres élèves les acceptent tels qu'ils sont, une proportion supérieure de 16 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 39 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
« Pour les filles cisgenres, du moins à mon école, si une personne fait quelque chose de mal, on la rejette instantanément de son groupe, et cela se propage à d’autres groupes. »
Les camarades sont gentils et serviables
Figure 5.4. Élèves qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les autres élèves sont gentils et serviables, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 5.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 54 (51,4, 57,4) | 43 (39,9, 46,3) | 26 (20,0, 31,3) |
| 9e et 10e année | 55 (52,1, 57,7) | 45 (41,9, 48,9) | 30 (23,3, 36,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres et que les jeunes TDIG à être d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les autres élèves sont gentils et serviables. Par exemple, ce pourcentage chez les garçons cisgenres de la 6e à la 8e année s'élève à 54 %, une proportion supérieure de 11 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 28 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
- Peu importe l'année d'études, les filles cisgenres sont plus nombreuses que les jeunes TDIG à déclarer que les autres élèves sont gentils et serviables.
Climat scolaire positif
Figure 5.5. Élèves qui font état d'un climat scolaire positif, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 5.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 41 (37,7, 43,5) | 34 (31,0, 36,9) | 20 (15,0, 24,6) |
| 9e et 10e année | 35 (32,1, 37,7) | 25 (22,5, 27,5) | 19 (13,1, 24,6) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 35 % des garçons cisgenres font état d'un climat scolaire positif, ce qui représente 10 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et 16 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG.
- Les filles cisgenres de 9e et 10e année sont moins nombreuses que les filles cisgenres de la 6e à la 8e année à faire état d'un climat scolaire positif (34 % contre 25 %).
- Dans la catégorie de la 6e à la 8e année, 20 % des jeunes TDIG font état d'un climat scolaire positif, ce qui représente 14 points de pourcentage de moins que chez les filles cisgenres et 21 points de pourcentage de moins que chez les garçons cisgenres.
« Créez un espace sûr (un coin tranquille) où les élèves peuvent se reposer à l’école. C’est vraiment important pour que les personnes qui se sentent seules et qui ne supportent pas les stimulations à long terme arrivent à mieux aimer l’école et à se sentir moins nerveuses. Installez des sofas, des fauteuils poires, des tentes et des étagères pour que l’on s’y sente comme chez soi. »
Appréciation de l'école
Figure 5.6. Élèves qui déclarent aimer l'école, un peu ou beaucoup, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 5.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 70 (67,5, 72,5) | 67 (63,8, 69,1) | 48 (42,1, 53,4) |
| 9e et 10e année | 64 (61,1, 66,9) | 60 (57,0, 62,6) | 52 (45,3, 59,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 48 % des jeunes TDIG déclarent qu'ils aiment l'école, une proportion inférieure de 19 % à celle des filles cisgenres et de 22 % à celle des garçons cisgenres.
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 64 % des garçons cisgenres déclarent qu'ils aiment l'école, une proportion supérieure de 12 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
Tendances chez les garçons quant à la pression liée aux travaux scolaires
Figure 5.7. Garçons qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
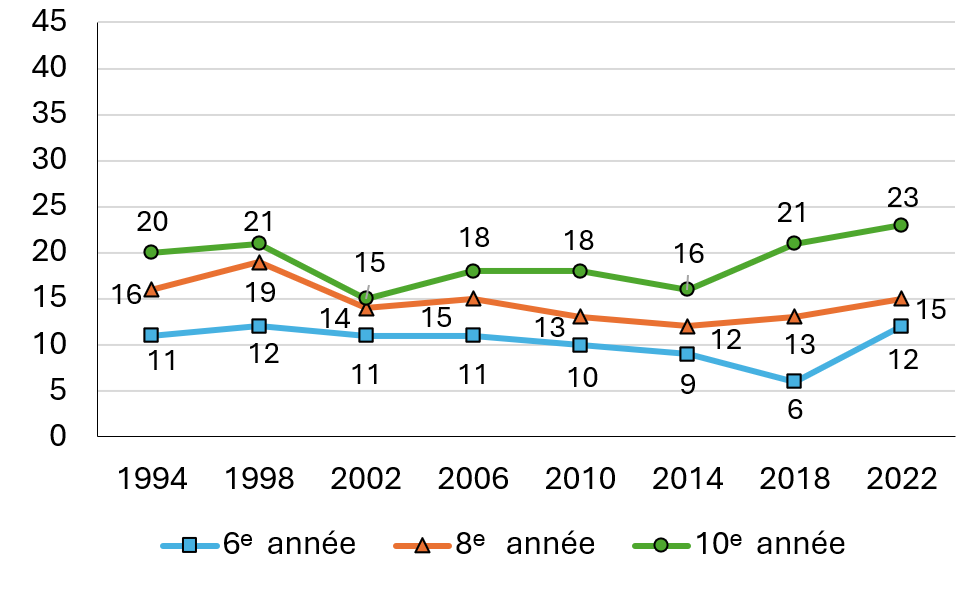
Figure 5.7 : Description textuelle
| L’année d’études | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 12 |
| 8e année | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| 10e année | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 16 | 21 | 23 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- De façon constante au cours des cycles d'enquête, le nombre de garçons qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires augmente avec le nombre d'années d'études. Par exemple, en 2022, 23 % des garçons de 10e année disent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires, par rapport à 15 % des garçons de 8e année et à 12 % des garçons de 6e année.
- En 2022, 23 % des garçons de 10e année déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires. Il s'agit de la proportion la plus élevée chez les garçons depuis l'amorce de l'enquête HBSC au Canada, en 1994.
- En 2022, la proportion de garçons de 6e année qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires est plus élevée qu'en 2018 (12 % en 2022 contre 6 % en 2018, soit une augmentation de 6 points de pourcentage).
Tendances chez les filles quant à la pression liée aux travaux scolaires
Figure 5.8. Filles qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 5.8 : Description textuelle
| L’année d’études | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 16 |
| 8e année | 13 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 26 |
| 10e année | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 41 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- Le nombre de filles qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires a considérablement augmenté au fil des cycles de l'enquête. Par exemple, chez les filles de 10e année, cette proportion est passée d'un minimum de 21 % en 2002 à un maximum de 41 % en 2022.
- De même, chez les filles de 8e année, cette proportion est passée d'un minimum de 13 % en 2002 à un maximum de 26 % en 2022 et, chez les filles de 6e année, cette proportion est passée d'un minimum de 6 % en 2014 à un maximum de 16 % en 2022.
- Le pourcentage de filles qui déclarent éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires est systématiquement plus élevé chez les filles de 10e année que chez les filles de 6e et de 8e année.
- Les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à déclarer éprouver une forte pression en raison des travaux scolaires.
Bienveillance des enseignant(e)s et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,24 | 0,19 | -0,26 | -0,22 |
| Supérieure | 0,18 | 0,27 | -0,15 | -0,11 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,40 | 0,36 | -0,35 | -0,37 | |
| Supérieure | 0,22 | 0,28 | -0,18 | -0,15 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,44 | 0,53 | -0,42 | -0,37 |
| Supérieure | 0,29 | 0,33 | -0,24 | -0,28 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,23 | 0,36 | -0,20 | -0,26 | |
| Supérieure | 0,31 | 0,33 | -0,20 | -0,24 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,22 | 0,26 | -0,15 | -0,17 |
| 9e et 10e année | 0,17 | 0,16 | -0,13 | -0,19 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | 0,19 | -0,21 | -0,36 | |
| Supérieure | 0,24 | 0,25 | -0,14 | -0,15 | ||
| Résultat global | 0,27 | 0,32 | -0,22 | -0,23 | ||
- Dans l'ensemble, la perception de la bienveillance des enseignant(e)s est systématiquement associée aux indicateurs de santé mentale. La bienveillance des enseignant(e)s est associée positivement à une plus grande satisfaction à l'égard de la vie et à un indice de bien-être plus élevé, et est associée négativement à la solitude et aux problèmes de santé, peu importe l'année d'études, le genre ou le degré d'aisance familiale des élèves.
- C'est chez les filles cisgenres que l'on dénote les corrélations les plus fortes entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale. Les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel affichent des corrélations positives modérées entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale positifs, de même que des corrélations négatives modérées avec la solitude.
- Les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel présentent l'association la plus forte entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale. Plus précisément, on remarque une corrélation positive modérée entre la bienveillance des enseignant(e)s et la satisfaction à l'égard de la vie pour ce groupe d'élèves.
- On dénote chez les élèves TDIG qui sont plus jeunes une association plus forte entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale positifs, comparativement à leurs camarades plus âgés. De plus, l'association entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale négatifs est moins forte pour les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée, alors que l'association entre la bienveillance des enseignant(e)s et les indicateurs de santé mentale positifs est plus forte pour leurs camarades dont la famille est plus aisée.
Climat scolaire positif et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,23 | 0,27 | -0,29 | -0,28 |
| Supérieure | 0,32 | 0,38 | -0,26 | -0,25 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,55 | 0,51 | -0,29 | -0,38 | |
| Supérieure | 0,31 | 0,33 | -0,21 | -0,23 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,52 | 0,53 | -0,45 | -0,48 |
| Supérieure | 0,45 | 0,50 | -0,42 | -0,46 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,44 | 0,55 | -0,43 | -0,41 | |
| Supérieure | 0,44 | 0,46 | -0,33 | -0,39 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,45 | 0,52 | -0,33 | -0,39 |
| 9e et 10e année | 0,26 | 0,34 | -0,28 | -0,39 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,24 | 0,35 | -0,37 | -0,42 | |
| Supérieure | 0,42 | 0,49 | -0,31 | -0,40 | ||
| Résultat global | 0,42 | 0,46 | -0,36 | -0,39 | ||
- Dans l'ensemble, un climat scolaire positif est systématiquement associé aux indicateurs de santé mentale positifs, et présente des corrélations moins prononcées avec les indicateurs de santé mentale négatifs. Pour tous les élèves, un climat scolaire positif est corrélé positivement avec les indicateurs de santé mentale positifs et corrélé négativement avec les indicateurs de santé mentale négatifs.
- Comparativement aux garçons cisgenres et aux jeunes TDIG, les filles cisgenres affichent les associations les plus prononcées entre un climat scolaire positif et les indicateurs de santé mentale.
- Les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel affichent les associations les plus marquées entre un climat scolaire positif et les indicateurs de santé mentale positifs.
- On constate chez les élèves TDIG qui sont plus jeunes et dont la famille est plus aisée des associations systématiques entre un climat scolaire positif et les indicateurs de santé mentale positifs.
Appréciation de l'école et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,20 | 0,26 | -0,13 | -0,24 |
| Supérieure | 0,23 | 0,28 | -0,16 | -0,19 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,40 | 0,44 | -0,20 | -0,25 | |
| Supérieure | 0,24 | 0,28 | -0,12 | -0,16 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,35 | 0,45 | -0,30 | -0,35 |
| Supérieure | 0,39 | 0,45 | -0,36 | -0,41 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,37 | 0,51 | -0,32 | -0,33 | |
| Supérieure | 0,38 | 0,44 | -0,26 | -0,34 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,39 | 0,47 | -0,28 | -0,31 |
| 9e et 10e année | 0,29 | 0,35 | -0,24 | -0,29 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | 0,19 | -0,17 | -0,20 | |
| Supérieure | 0,41 | 0,48 | -0,27 | -0,33 | ||
| Résultat global | 0,34 | 0,38 | -0,26 | -0,31 | ||
- Dans l'ensemble, la corrélation entre l'appréciation de l'école et les indicateurs de santé mentale est faible. Pour tous les élèves, l'appréciation de l'école est corrélée positivement avec une satisfaction à l'égard de la vie et avec le bien-être, et corrélée négativement avec la solitude et les problèmes de santé.
- La corrélation la plus marquée s'observe entre l'appréciation de l'école et le bien-être.
- Les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel affichent les corrélations les plus marquées entre un climat scolaire positif et les indicateurs de santé mentale positifs.
- Pour toutes les filles cisgenres, l'appréciation de l'école est associée positivement au bien-être. Plus particulièrement, les filles de la 6e à la 8e année dont la famille est plus aisée présentent une corrélation négative modérée entre l'appréciation de l'école et les problèmes de santé.
- Les jeunes TDIG dont la famille est plus aisée présentent des corrélations positives modérées entre l'appréciation de l'école et les indicateurs de santé mentale positifs.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Plus de la moitié des élèves canadiens déclarent avoir le sentiment que leurs enseignant(e)s se soucient d'eux.
- La majorité des garçons cisgenres déclarent se sentir acceptés par les autres et avoir des camarades de classe gentils et serviables.
- Jusqu'à 71 % des jeunes font état d'un soutien au moins « modéré » de la part de leurs enseignant(e)s, et 47 % font état d'un soutien élevé. Ces résultats sont encourageants puisque de nombreux indicateurs de santé mentale sont associés positivement au soutien des enseignant(e)s.
- Chez les jeunes TDIG, un climat scolaire positif s'avère un facteur de protection pour un état de santé mentale positif.
Sujets de préoccupation
- Ce sont les élèves cisgenres de 10e année qui sont les plus nombreux à mentionner des niveaux de pression élevés en raison des travaux scolaires, lorsqu'on les compare à leurs camarades plus jeunes. Au fil du temps, une plus grande proportion de garçons cisgenres et de filles cisgenres déclarent éprouver une forte pression à l'école.
- Les jeunes TDIG sont moins nombreux que leurs camarades cisgenres à faire état d'un soutien élevé de la part de leurs enseignant(e)s et d'une acceptation de la part de leurs camarades.
- Les jeunes TDIG sont moins susceptibles que leurs camarades cisgenres de faire état d'un climat scolaire positif. Ce résultat est préoccupant, étant donné que le climat scolaire est associé aux indicateurs de santé mentale.
Chapitre 6 : La collectivité
Les jeunes participent activement au développement de leur collectivité et à la promotion de la culture de celle-ciRéférence 47. À toutes les étapes de la vie, notamment à l'adolescence et au début de l'âge adulte, une participation active au sein de la collectivité contribue au bien-être socialRéférence 48. L'implication communautaire peut prendre plusieurs formes et comprend l'engagement civique, comme le bénévolatRéférence 49, les activités de loisirRéférence 50, ou des programmes mis sur pied par des organismes communautaires locaux ou nationaux visant directement les jeunes.
Les quartiers où évoluent les jeunes constituent une part importante de leur environnement social. Le sentiment d'appartenance à un quartier contribue à diminuer les comportements à risqueRéférence 52, et la perception qu'ont les adolescents de leur quartier est liée à leur santé mentaleRéférence 53. La cohésion communautaire, que l'on appelle aussi parfois « capital social », permet d'atténuer les effets d'événements stressants de la vie, comme la dépression et l'anxiété, les idées suicidaires et l'agressivitéRéférence 54. Les interactions des jeunes dans leur collectivité, ainsi que leur perception de celle-ci, jouent un rôle essentiel dans leur santé.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HSBC, on fait état de divers indicateurs de soutien de la collectivité. En premier lieu, on utilise l'échelle de soutien de la collectivité. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, le codage des réponses à chaque élément est inversé, puis les réponses sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de 5 (soutien faible) à 25 (soutien élevé). On demande aussi aux élèves de décrire comment ils perçoivent la sécurité de leur quartier en signifiant leur accord ou leur désaccord avec l'affirmation : « La plupart des gens des alentours essaieraient de profiter de toi s'ils en avaient l'occasion ». Enfin, on demande aux élèves d'indiquer s'ils ont fait du bénévolat dans leur collectivité.
Tableau 6.1. Échelle de soutien de la collectivité
- Les gens se saluent et arrêtent souvent pour se parler dans la rue.
- 1= Je suis tout à fait d'accord
- 2= Je suis d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je ne suis pas d'accord
- 5= Je ne suis pas du tout d'accord
- On peut faire confiance aux gens des alentours.
- 1= Je suis tout à fait d'accord
- 2= Je suis d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je ne suis pas d'accord
- 5= Je ne suis pas du tout d'accord
- Je peux demander de l'aide ou une faveur à mes voisins.
- 1= Je suis tout à fait d'accord
- 2= Je suis d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je ne suis pas d'accord
- 5= Je ne suis pas du tout d'accord
- Les jeunes enfants peuvent jouer dehors en toute sécurité durant la journée.
- 1= Je suis tout à fait d'accord
- 2= Je suis d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je ne suis pas d'accord
- 5= Je ne suis pas du tout d'accord
- Il y a de bons endroits où aller pendant nos temps libres.
- 1= Je suis tout à fait d'accord
- 2= Je suis d'accord
- 3= Je n'ai pas d'avis particulier
- 4= Je ne suis pas d'accord
- 5= Je ne suis pas du tout d'accord
Tendances touchant la perception du soutien de la collectivité chez les garçons
Figure 6.1. Score moyen pour l'échelle du soutien perçu de la collectivité chez les garçons, selon l'année d'études et l'année d'enquête
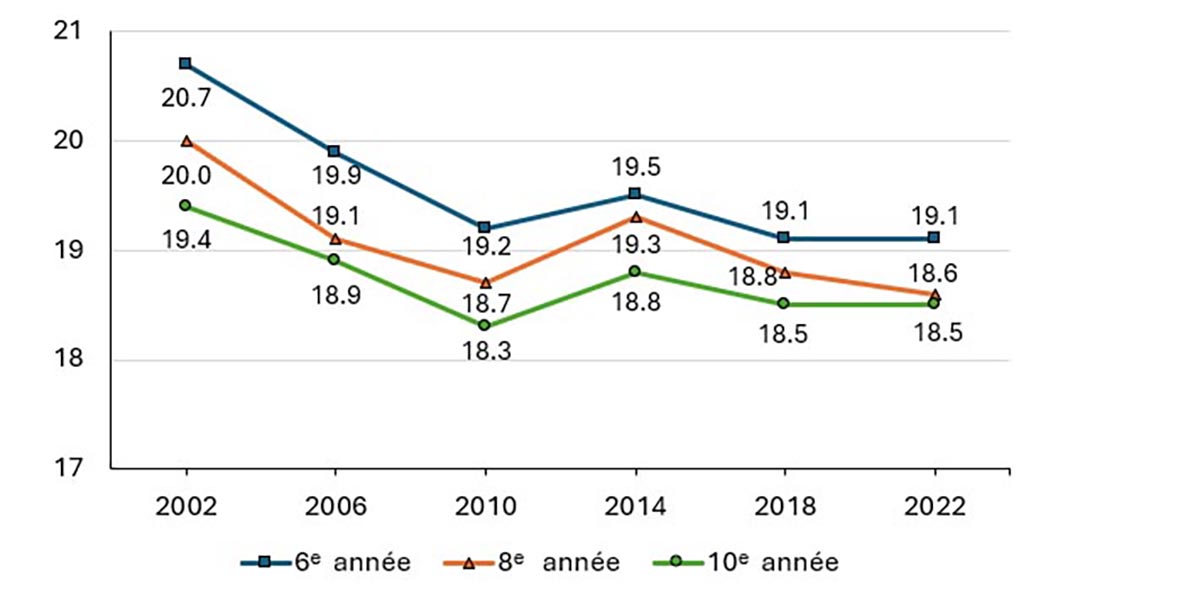
Figure 6.1 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 20,7 | 19,9 | 19,2 | 19,5 | 19,1 | 19,1 |
| 8e année | 20,0 | 19,1 | 18,7 | 19,3 | 18,8 | 18,6 |
| 10e année | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 18,8 | 18,5 | 18,5 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- En général, le niveau perçu de soutien de la collectivité chez les garçons a connuune baisse au fil du temps. Les scores moyens du soutien de la collectivitédiminuent de 2002 à 2010, puis semblent se stabiliser dans les plus récents cycles de l'enquête.
Tendances touchant la perception du soutien de la collectivité chez les filles
Figure 6.2. Score moyen pour l'échelle du soutien perçu de la collectivité chez les filles, selon l'année d'études et l'année d'enquête

Figure 6.2 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 20,8 | 19,5 | 19,2 | 19,7 | 19,2 | 19,0 |
| 8e année | 19,9 | 19,0 | 18,4 | 18,9 | 18,5 | 18,4 |
| 10e année | 19,8 | 18,9 | 18,2 | 18,4 | 18,1 | 18,1 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- En général, le niveau perçu de soutien de la collectivité chez les filles a connu une baisse au fil du temps. Les scores moyens diminuent de 2002 à 2010, puis semblent se stabiliser dans les trois plus récents cycles de l'enquête.
Confiance à l'égard du quartier
Figure 6.3. Élèves qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils peuvent faire confiance aux gens de leur quartier, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
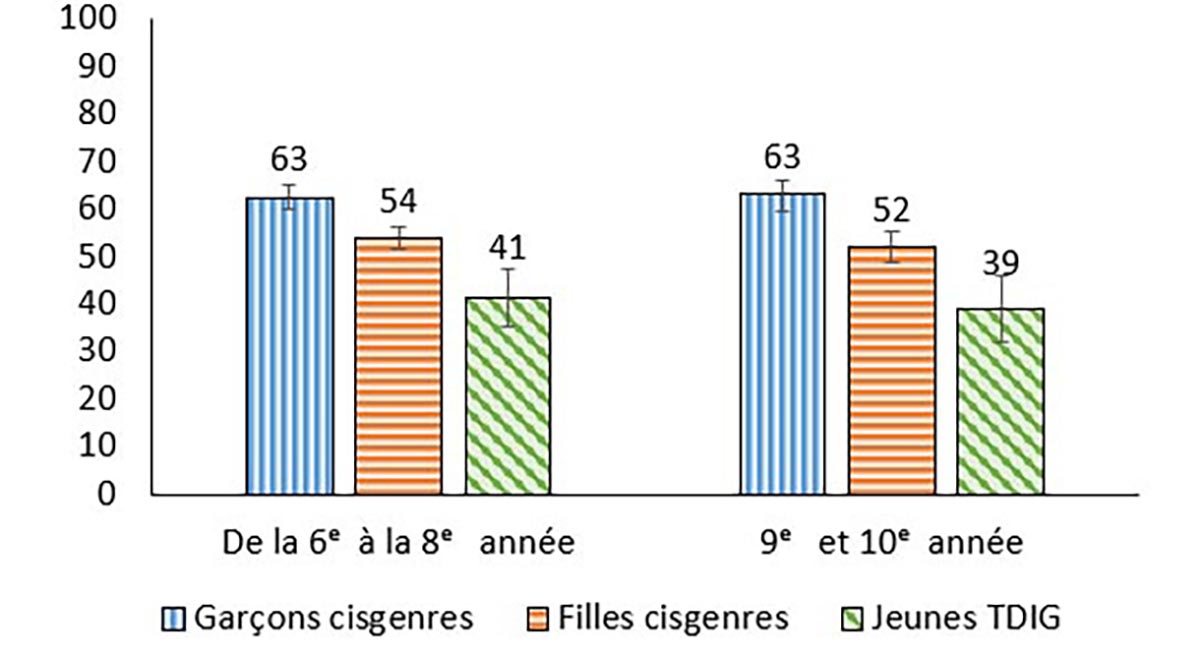
Figure 6.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 63 (60,1, 65,0) | 54 (51,6, 56,4) | 41 (35,5, 47,4) |
| 9e et 10e année | 63 (59,7, 66,3) | 52 (48,9, 55,2) | 39 (32,0, 46,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 39 et 63 % des jeunes sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils peuvent faire confiance aux gens de leur quartier.
- Indépendamment de l'année d'études, par rapport aux filles et aux garçons cisgenres, les jeunes TDIG sont les moins nombreux à affirmer qu'ils peuvent faire confiance aux gens de leur quartier.
- Dans le groupe des élèves de la 6e à la 8e année, 54 % des filles cisgenres affirment pouvoir faire confiance aux gens de leur quartier, soit 9 points de pourcentage de moins que les garçons cisgenres et 13 points de pourcentage de plus que les jeunes TDIG. Cette tendance sexospécifique s'observe également chez les élèves de 9e et 10e année.
« Moi et d’autres filles ne nous sentons pas en sécurité en présence d’inconnus. Les jeunes TDIG se demandent parfois s’ils peuvent se sentir en sécurité en présence de certaines personnes. »
Méfiance à l'égard du quartier
Figure 6.4. Élèves qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'eux s'ils en avaient l'occasion, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
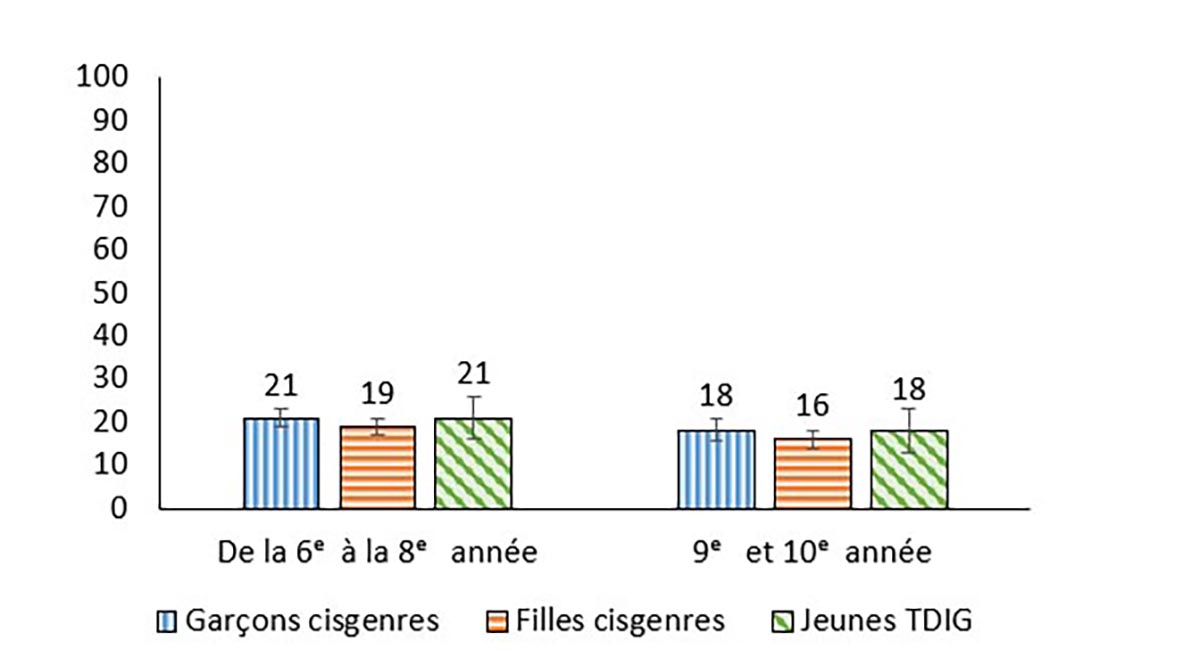
Figure 6.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 21 (18,8, 23,1) | 19 (17,2, 20,9) | 21 (16,3, 26,0) |
| 9e et 10e année | 18 (15,8, 20,8) | 16 (13,8, 18,0) | 18 (12,8, 23,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 16 et 21 % des jeunes sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'eux s'ils en avaient l'occasion. Les différences selon l'année d'études et le genre sont modestes.
Tendances en matière de méfiance à l'égard du quartier chez les garçons
Figure 6.5. Garçons qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'eux s'ils en avaient l'occasion, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
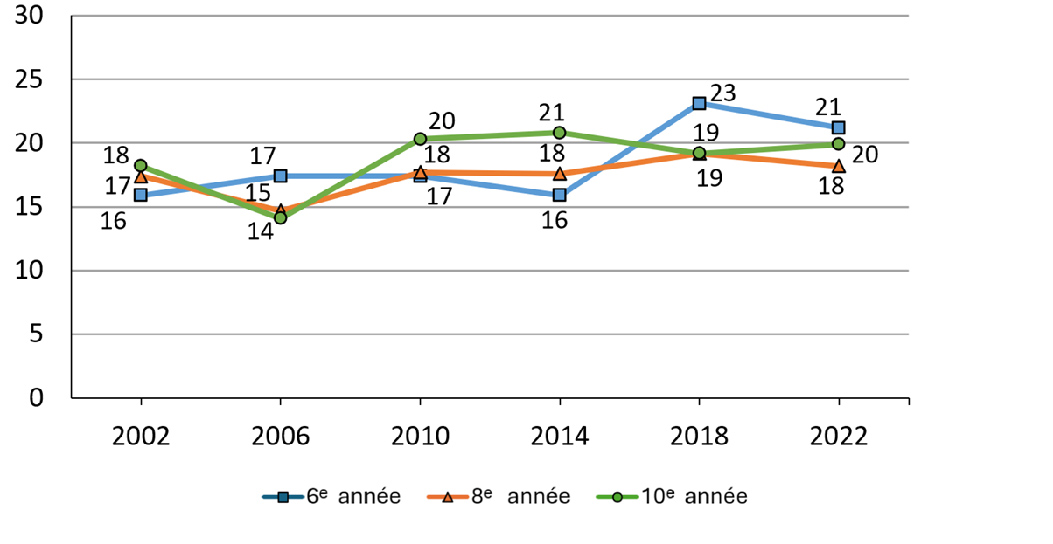
Figure 6.5 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 16 | 17 | 17 | 16 | 23 | 21 |
| 8e année | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 10e année | 18 | 14 | 20 | 21 | 19 | 20 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- Au fil du temps, il y a eu une augmentation de la proportion des garçons de 6e année qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'eux s'ils en avaient l'occasion.
- Les tendances au fil du temps chez les garçons de 8e et de 10e année sont moins évidentes.
Tendances en matière de méfiance à l'égard du quartier chez les filles
Figure 6.6. Filles qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'elles s'ils en avaient l'occasion, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 6.6 : Description textuelle
| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 |
| 8e année | 9 | 11 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| 10e année | 9 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- En général, au fil du temps, on constate une augmentation de la proportion de filles qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les gens de leur quartier essaieraient de profiter d'elles s'ils en avaient l'occasion. Cette tendance est particulièrement évidente chez les filles de 8e année, où l'on passe d'un minimum de 9 % en 2002 à un maximum de 18 % en 2022, soit une augmentation de 9 points de pourcentage. Une tendance similaire s'observe chez les filles de 6e année, où cette proportion a augmenté de 5 points de pourcentage, passant d'un minimum de 14 % en 2002 à un maximum de 19 % en 2022.
« Il y a souvent des moments où je ne me sens pas à l’aise lorsque je marche seule dans [mon] quartier, et je suis absolument certaine que d’autres filles se sentent comme moi. »
Bénévolat
Figure 6.7. Élèves qui déclarent faire du bénévolat, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 6.7 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 22 (20,1, 23,7) | 27 (25,3, 29,4) | 21 (15,9, 25,1) |
| 9e et 10e année | 33 (29,7, 35,9) | 45 (41,3, 48,8) | 35 (28,5, 41,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les filles cisgenres représentent le groupe le plus actif en matière de bénévolat (27 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année; 45 % des filles cisgenres de 9e et 10e année).
- Les jeunes de 9e et 10e année sont plus actifs en matière de bénévolat que les jeunes de la 6e à la 8e année.
- C'est chez les filles cisgenres que l'on remarque l'écart le plus important entre les années d'études : 27 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année déclarent faire du bénévolat, contre 45 % des filles cisgenres de 9e et 10e année, soit un écart de 18 points de pourcentage. Viennent ensuite les jeunes TDIG, dont 21 % déclarent faire du bénévolat de la 6e à la 8e année, contre 35 % en 9e et 10e année, soit une augmentation de 14 points de pourcentage. Enfin, 22 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année font du bénévolat, contre 33 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année, soit une augmentation de 11 points de pourcentage.
Soutien de la collectivité et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,33 | 0,37 | -0,37 | -0,19 |
| Supérieure | 0,25 | 0,30 | -0,22 | -0,18 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,28 | 0,32 | -0,17 | -0,24 | |
| Supérieure | 0,25 | 0,29 | -0,19 | -0,13 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,50 | 0,43 | -0,29 | -0,35 |
| Supérieure | 0,27 | 0,30 | -0,21 | -0,17 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,36 | 0,44 | -0,40 | -0,35 | |
| Supérieure | 0,29 | 0,30 | -0,21 | -0,16 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,44 | 0,34 | -0,24 | -0,20 |
| 9e et 10e année | 0,23 | 0,33 | -0,16 | -0,19 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,50 | 0,46 | -0,15 | -0,25 | |
| Supérieure | 0,31 | 0,31 | -0,20 | -0,18 | ||
| Résultat global | 0,30 | 0,32 | -0,24 | -0,20 | ||
- Dans l'ensemble, le soutien de la collectivité est systématiquement associé aux indicateurs de santé mentale. Pour tous les élèves, le soutien de la collectivité est positivement corrélé avec une satisfaction à l'égard de la vie et un bien-être supérieurs et négativement corrélé avec le sentiment de solitude et les problèmes de santé.
- Le soutien de la collectivité est plus fortement corrélé avec les indicateurs positifs de santé mentale qu'avec les indicateurs négatifs de santé mentale.
- Les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée sur le plan matériel affichent des corrélations positives modérées entre le soutien de la collectivité et les indicateurs positifs de santé mentale.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Comme on peut s'y attendre, la proportion de jeunes qui font du bénévolat augmente avec l'âge et le degré d'autonomie.
- Depuis 2010, le soutien de la collectivité est demeuré relativement stable pour les garçons et les filles. Ceci est particulièrement encourageant, puisqu'il existe une corrélation entre le soutien de la collectivité et les indicateurs positifs de santé mentale.
- Les niveaux de soutien de la collectivité sont systématiquement associés à des résultats positifs en matière de santé mentale.
Sujets de préoccupation
- Les jeunes TDIG sont nettement moins nombreux que les garçons et les filles cisgenres à être d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils font confiance aux gens de leur quartier.
- On remarque au fil du temps une diminution du niveau perçu de soutien de la collectivité, en particulier chez les filles.
Chapitre 7 : L'activité physique, le temps d'écran et le sommeil
L'activité physique s'entend de tous les mouvements que nous effectuons dans le cadre de nos loisirs, de notre travail ou de nos déplacementsRéférence 55. Selon les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, les enfants et les jeunes devraient accumuler en moyenne au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour et s'adonner à des activités qui permettent de renforcer les muscles et les os au moins trois jours par semaineRéférence 56. L'horaire quotidien des jeunes devrait aussi inclure plusieurs heures d'activités physiques d'intensité légère structurées et non structuréesRéférence 56. L'accumulation d'un nombre adéquat d'heures d'activité physique est associée à une meilleure santé mentaleRéférence 57, à un meilleur fonctionnement cognitifRéférence 57Référence 58, ainsi qu'à une réduction du risque de maladies chroniquesRéférence 59.
À l'opposé de l'activité physique, l'activité sédentaire désigne le temps que les jeunes passent dans un état inactif (p. ex. regarder la télévision, jouer sur un appareil électronique ou lire)Référence 60. Plus les jeunes avancent en âge, plus ils passent de temps en mode sédentaireRéférence 61. Les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés et ceux qui ont accès à de multiples écrans à la maison affichent des niveaux de sédentarité plus élevésRéférence 61. Les comportements sédentaires chez les jeunes sont associés à des risques plus élevés d'idées suicidairesRéférence 62, à une probabilité accrue de consommation de drogues et d'alcool, y compris une fréquence plus élevée de consommation de cannabisRéférence 63, et à des habitudes de sommeil perturbéesRéférence 64.
Au cours de l'adolescence, les comportements associés au sommeil et la physiologie du sommeil subissent de profonds changementsRéférence 65. Selon les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, les jeunes de 5 à 13 ans devraient dormir de 9 à 11 heures par nuit, et ceux de 14 à 17 ans, de 8 à 10 heures par nuitRéférence 56. Par ailleurs, ce sommeil devrait être ininterrompu et les enfants et les jeunes devraient se coucher et se lever à des heures régulièresRéférence 56. Un sommeil adéquat et de qualité est essentiel à la régulation émotionnelle, à l'apprentissage, à la mémoire et à la cognitionRéférence 65. À l'inverse, un sommeil inadéquat et perturbé est associé à des résultats négatifs sur divers plans, dont la réussite scolaire, les comportements à risque et la santé psychosocialeRéférence 66Référence 67.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, on demande aux élèves de faire état de la fréquence et de la durée de leurs activités physiques. Il s'agit notamment de l'exercice qu'ils font chaque semaine (les élèves devaient indiquer le nombre de jours où ils ont été actifs physiquement pendant au moins 60 minutes par jour, avec des possibilités de réponse allant de 0 à 7 jours), ainsi que de l'activité physique qu'ils pratiquent en dehors des heures de classe (les élèves devaient indiquer à quelle fréquence, en dehors des heures de classe, ils font habituellement de l'exercice dans leurs temps libres au point d'être essoufflés ou de transpirer) selon l'échelle suivante : « tous les jours », « 4 à 6 fois par semaine », « 3 fois par semaine », « 2 fois par semaine », « une fois par semaine », « une fois par mois », « moins d'une fois par mois » ou « jamais ». Les élèves ont également été interrogés sur les activités physiques auxquelles ils s'adonnent et sur leur mode de transport jusqu'à l'école, ainsi qu'à savoir s'il s'agit d'un mode de transport actif (marche, bicyclette, etc.).
En ce qui a trait aux comportements sédentaires, les élèves ont indiqué le temps moyen qu'ils passent devant les écrans. Enfin, des données sont recueillies sur différents aspects des habitudes de sommeil des élèves : durée du sommeil, respect des recommandations en matière de sommeil et fréquence des troubles du sommeil (les élèves devaient indiquer la fréquence à laquelle ils ont de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis selon l'échelle suivante : « jamais », « rarement », « parfois », « la plupart du temps » ou « tout le temps »).
Activité physique au cours de la dernière semaine
Figure 7.1. Élèves qui déclarent avoir été actifs physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours pendant au moins 60 minutes par jour, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 7.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 38 (35,5, 39,8) | 23 (21,0, 24,8) | 14 (10,2, 17,7) |
| 9e et 10e année | 30 (27,4, 31,9) | 16 (14,1, 17,3) | 12 (7,4, 15,6) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves cisgenres, le pourcentage de jeunes qui déclarent avoir été actifs physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours diminue avec le nombre d'années d'études.
- Un pourcentage de 38 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année déclarent avoir été actifs physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours, par rapport à 30 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année. De même, 23 % des filles cisgenres déclarent avoir été actives physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours, par rapport à 16 % des filles cisgenres de 9e et 10e année.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 38 % des garçons cisgenres déclarent avoir été actifs physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours, ce qui représente 15 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et 24 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG. Un plus grand nombre de filles cisgenres que de jeunes TDIG déclarent avoir fait de l'activité physique (23 % contre 14 %).
- Chez les élèves de 9e et 10e année, 30 % des garçons cisgenres déclarent avoir été actifs physiquement tous les jours au cours des sept derniers jours, ce qui représente 14 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et 18 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG.
Activité physique en dehors des heures de classe
Figure 7.2. Élèves qui déclarent avoir été actifs physiquement en dehors des heures de classe au moins trois fois par semaine, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 7.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 71 (68,4, 72,5) | 60 (58,2, 62,7) | 38 (32,5, 44,0) |
| 9e et 10e année | 69 (66,6, 71,3) | 54 (51,0, 56,9) | 38 (31,7, 43,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Peu importe l'année d'études, les jeunes TDIG sont les moins nombreux à être actifs physiquement en dehors des heures de classe, et les garçons cisgenres sont les plus nombreux à l'être.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 71 % des garçons cisgenres déclarent avoir été actifs physiquement en dehors des heures de classe, ce qui représente 11 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et 33 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG. De même, en 9e et 10e année, davantage de garçons cisgenres (69 %) que de filles cisgenres (54 %) et de jeunes TDIG (38 %) déclarent avoir été actifs physiquement en dehors des heures de classe.
- Chez les filles cisgenres, le pourcentage de celles qui déclarent avoir été actives physiquement en dehors des heures de classe diminue avec le nombre d'années d'études (60 % de la 6e à la 8e année contre 54 % en 9e et 10e année, soit 6 points de pourcentage de moins).
« La satisfaction qui vient avec le fait d'avoir fait de l'exercice et de savoir que tu as fait quelque chose de productif peut contribuer à ta santé. »
Participation à l'activité physique
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Activité physique qui t'essouffle | 46 | 35 | 27 | 50 | 38 | 31 |
| Sports organisés qui ne font pas partie d'un cours d'éducation physique | 44 | 40 | 16 | 41 | 38 | 18 |
| Exercice qui ne fait pas partie d'un cours d'éducation physique et qui n'est pas un sport organisé | 32 | 23 | 14 | 44 | 26 | 20 |
| Activités extérieures qui ne font pas partie d'un cours d'éducation physique et qui ne sont pas un sport organisé | 45 | 30 | 24 | 35 | 21 | 19 |
| Moyens actifs comme la marche ou le vélo pour se déplacer | 32 | 25 | 22 | 34 | 32 | 30 |
- La forme la plus courante d'activité physique chez les garçons cisgenres et les jeunes TDIG, toutes années d'études confondues, est une activité physique qui essouffle.
- Chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, ce sont les sports organisés qui ne font pas partie d'un cours d'éducation physique qui sont la forme la plus courante d'activité physique. Chez les filles cisgenres de 9e et 10e année, les catégories « activité physique qui t'essouffle » et « sports organisés qui ne font pas partie d'un cours d'éducation physique » ont la même popularité (38 %).
- Un plus petit nombre de jeunes TDIG que de jeunes cisgenres déclarent pratiquer chaque forme d'activité physique.
« La satisfaction qui vient avec le fait d’avoir fait de l’exercice et de savoir que tu as fait quelque chose de productif peut contribuer à ta santé. »
Transport actif pour se rendre à l'école
Figure 7.3. Élèves qui déclarent utiliser le transport actif pour se rendre à l'école, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 7.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 27 (24,6, 30,1) | 22 (19,3, 24,8) | 30 (24,0, 35,8) |
| 9e et 10e année | 19 (15,7, 21,8) | 13 (10,4, 15,5) | 23 (17,5, 29,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- L'utilisation du transport actif pour se rendre à l'école est moins fréquente chez les élèves cisgenres de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année. Ainsi, 27 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année déclarent utiliser le transport actif pour se rendre à l'école, contre 19 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année, et les proportions chez les filles cisgenres vont de 22 % de la 6e à la 8e année à 13 % en 9e et 10e année.
- En 9e et 10e année, 13 % des filles cisgenres déclarent utiliser le transport actif pour se rendre à l'école, ce qui correspond à 10 points de pourcentage de moins que chez les jeunes TDIG.
Temps d'écran
Figure 7.4. Élèves qui ne respectent pas la recommandation sur le temps d'écran quotidien (c.-à-d. deux heures ou moins par jour), selon l'année d'études et le genre (%)
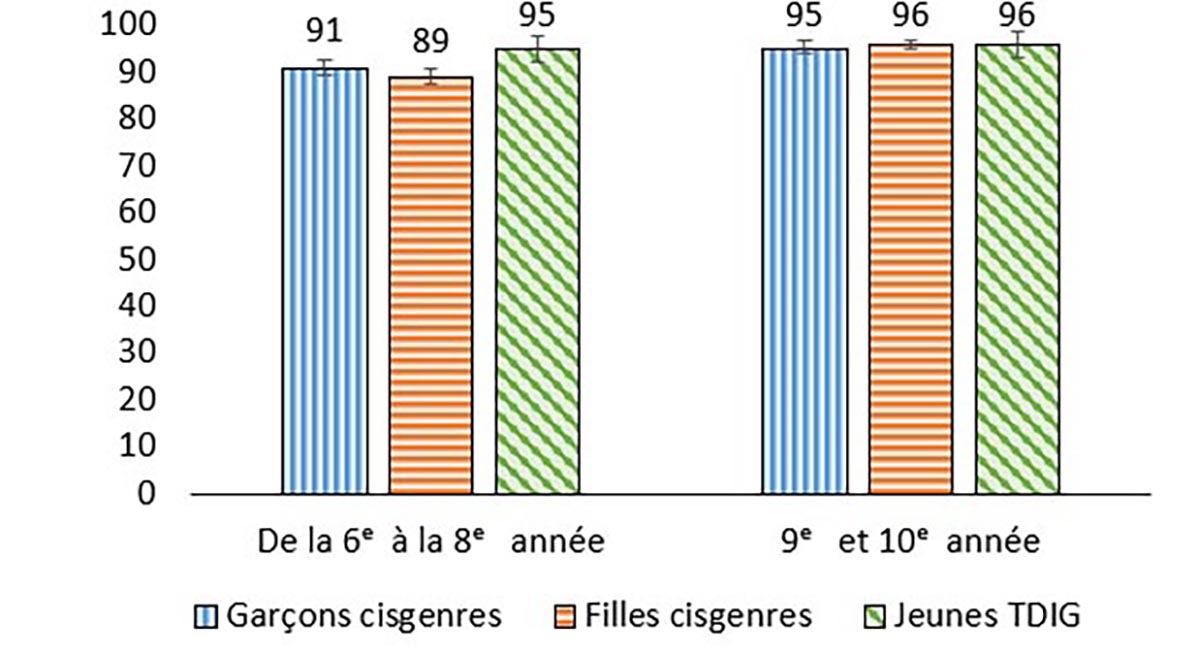
Figure 7.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 91 (89,6, 92,5) | 89 (87,7, 90,8) | 95 (92,0, 97,8) |
| 9e et 10e année | 95 (94,1, 96,7) | 96 (95,2, 97,0) | 96 (93,0, 98,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La grande majorité (de 89 à 96 %) des jeunes de tous les groupes ne respectent pas la recommandation sur le temps d'écran quotidien (d'un maximum de deux heures).
Recommandation sur les heures de sommeil
Figure 7.5. Élèves qui respectent la recommandation sur les heures de sommeil quotidiennes, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 7.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 64 (61,2, 66,7) | 56 (52,9, 58,4) | 38 (32,2, 43,1) |
| 9e et 10e année | 65 (62,9, 67,9) | 60 (57,2, 63,1) | 51 (44,7, 58,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, les jeunes TDIG sont les moins susceptibles de respecter la recommandation sur les heures de sommeil quotidiennes. Ainsi, 38 % des jeunes TDIG respectent cette recommandation, une proportion inférieure de 18 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 26 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
- En 9e et 10e année, 65 % des garçons cisgenres respectent la recommandation sur les heures de sommeil quotidiennes, une proportion supérieure de 14 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
Difficulté à s'endormir ou à rester endormi
Figure 7.6. Élèves qui déclarent avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis la plupart du temps ou tout le temps, selon l'année d'études et le genre (%)
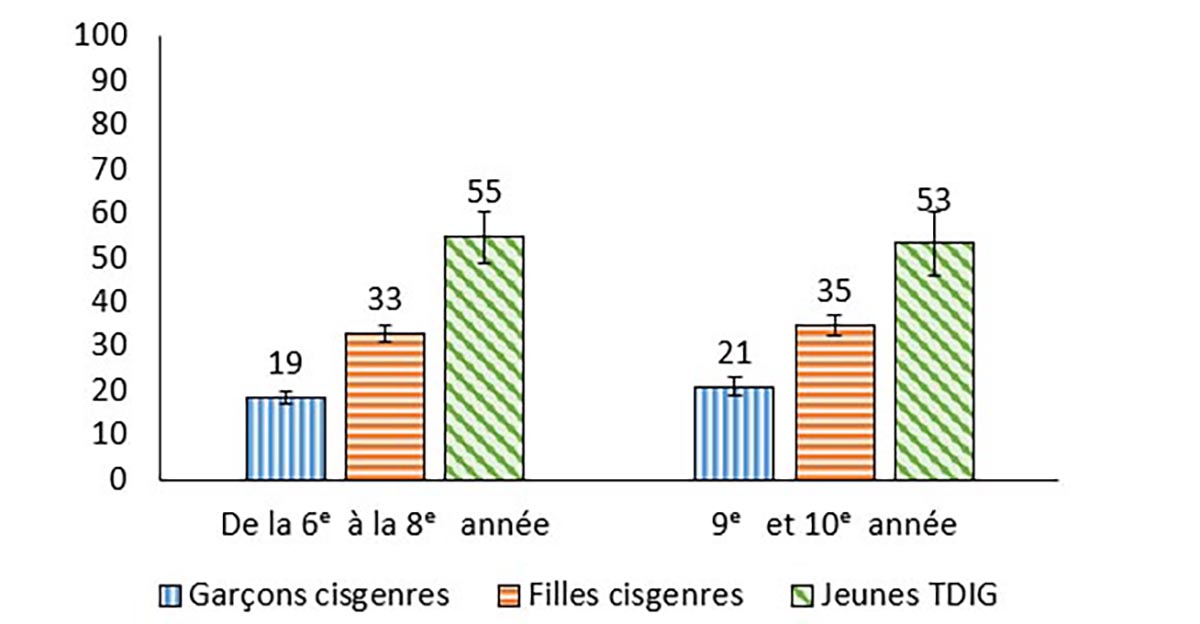
Figure 7.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 19 (17,1, 20,0) | 33 (31,0, 35,1) | 55 (48,7, 60,7) |
| 9e et 10e année | 21 (19,0, 23,2) | 35 (32,5, 37,4) | 53 (45,9, 60,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- De façon générale, les jeunes TDIG sont les plus nombreux à affirmer avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis (55 % la 6e à la 8e année et 53 % en 9e et 10e année).
- Les garçons cisgenres sont les moins nombreux à faire état de cette difficulté (19 % de la 6e à la 8e année et 21 % en 9e et 10e année).
« Je pense que d’avoir de la difficulté à s’endormir est un gros problème parce que la santé mentale est liée au sommeil. Beaucoup de gens qui vivent de l’anxiété et qui traversent des moments difficiles peuvent avoir du mal à dormir, même s’ils sont assez fatigués pour dormir toute la nuit. »
Somnolence diurne
Figure 7.7. Élèves qui déclarent avoir de la difficulté à rester éveillés pendant le jour lorsqu'ils veulent être éveillés, la plupart du temps ou tout le temps, selon l'année d'études et le genre (%)
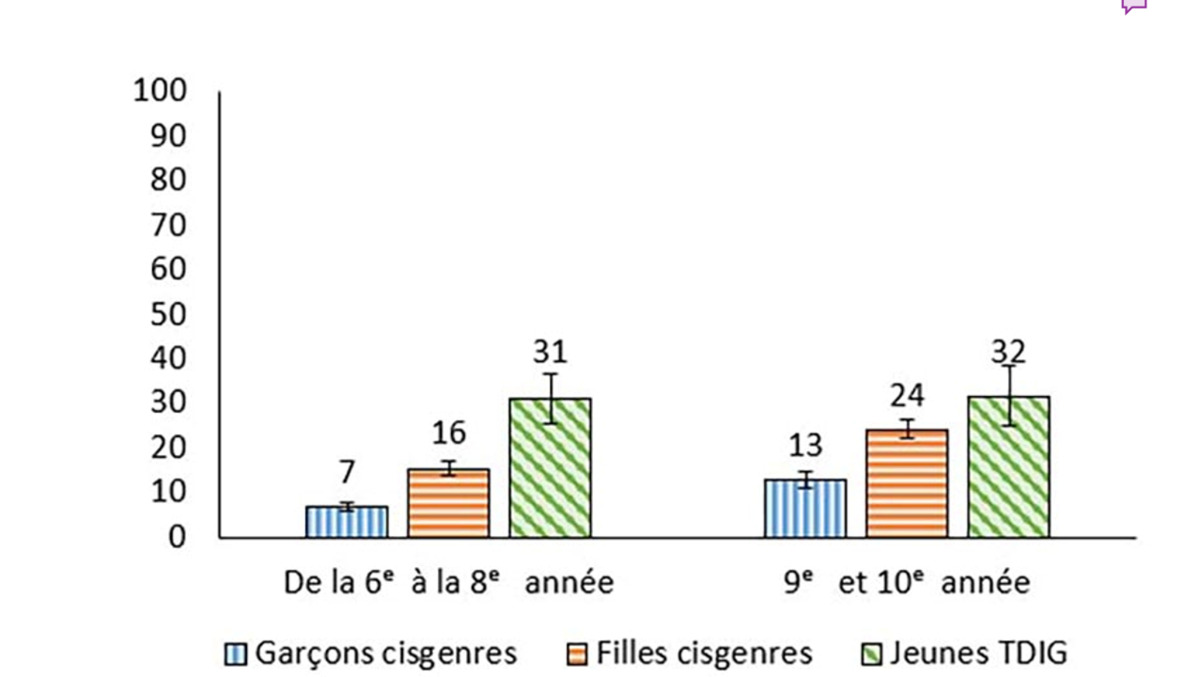
Figure 7.7 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 7 (5,9, 8,0) | 16 (13,8, 17,1) | 31 (25,4, 36,7) |
| 9e et 10e année | 13 (11,1, 14,8) | 24 (22,2, 26,5) | 32 (25,2, 38,4) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- De façon générale, les garçons cisgenres sont ceux qui font le moins état de somnolence diurne.
- La proportion de garçons cisgenres et de filles cisgenres qui affirment souffrir de somnolence diurne augmente avec le nombre d'années d'études.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 31 % des jeunes TDIG disent souffrir de somnolence diurne, une proportion supérieure de 15 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 24 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
Activités parascolaires
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Sport d'équipe organisé (p. ex. hockey, soccer, basketball) | 64 | 53 | 29 | 51 | 43 | 18 |
| Sport individuel organisé (p. ex. tennis, natation, patinage) | 32 | 39 | 26 | 28 | 29 | 18 |
| Groupe artistique (p. ex. musique, danse, théâtre) | 15 | 35 | 34 | 14 | 31 | 41 |
| Groupe communautaire (p. ex. scouts, Guides, 4-H, cadets) | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 |
| Église ou autre groupe religieux/spirituel | 20 | 20 | 14 | 21 | 20 | 11 |
| Autre activité ou groupe (p. ex. échecs, mathématiques, débat) | 23 | 16 | 20 | 18 | 16 | 24 |
- L'activité parascolaire la plus fréquente chez les garçons cisgenres (64 % de la 6e à la 8e année et 51 % en 9e et 10e année) et chez les filles cisgenres (53 % de la 6e à la 8e année et 43 % en 9e et 10e année) est le sport d'équipe organisé.
- L'activité parascolaire la plus fréquente chez les jeunes TDIG est le groupe artistique (34 % de la 6e à la 8e année et 41 % en 9e et 10e année).
- L'activité parascolaire la moins fréquente pour l'ensemble des élèves, sauf chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, est la participation à des groupes communautaires. Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, l'activité parascolaire la moins fréquente est l'église ou tout autre groupe religieux/spirituel.
- Les jeunes de 9e et 10e année sont moins nombreux que les jeunes de la 6e à la 8e année à participer à des activités parascolaires, surtout en raison de la diminution de la participation à des sports individuels et d'équipe.
Activité physique à l'école au cours de la dernière semaine et santé mentale
Tableau 7.3. Corrélations entre l'activité physique à l'école au cours de la dernière semaine et les indicateurs de santé mentale, selon le genre, l'année d'études et le degré d'aisance familiale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,28 | 0,29 | -0,19 | -0,13 |
| Supérieure | 0,20 | 0,27 | -0,11 | -0,08 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,17 | 0,30 | -0,15 | -0,20 | |
| Supérieure | 0,19 | 0,26 | -0,12 | -0,04 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,18 | 0,33 | -0,26 | NS |
| Supérieure | 0,22 | 0,29 | -0,14 | -0,09 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | NS | 0,23 | NS | NS | |
| Supérieure | 0,18 | 0,24 | -0,09 | -0,06 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,20 | 0,24 | -0,10 | -0,18 |
| 9e et 10e année | 0,15 | 0,12 | NS | NS | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,24 | 0,23 | -0,18 | NS | |
| Supérieure | 0,16 | 0,18 | NS | -0,10 | ||
| Résultat global | 0,25 | 0,32 | -0,19 | -0,16 | ||
- Dans l'ensemble, pour tous les élèves, l'activité physique à l'école est systématiquement associée à une plus grande satisfaction à l'égard de la vie et à un meilleur bien-être et est corrélée négativement avec la solitude et les problèmes de santé.
- Chez les garçons cisgenres, les filles cisgenres et les élèves TDIG plus jeunes dont la famille est moins aisée, il y a une faible corrélation positive entre l'activité physique et le bien-être.
- La corrélation entre l'activité physique et la satisfaction à l'égard de la vie diminue avec le nombre d'années d'études.
- On dénote une faible association négative entre l'activité physique et les problèmes de santé chez les garçons cisgenres plus âgés dont la famille est moins aisée.
- Il existe une faible association négative entre l'activité physique et la solitude chez les filles cisgenres plus jeunes dont la famille est moins aisée.
Activité physique en dehors de l'école et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,12 | 0,26 | -0,11 | NS |
| Supérieure | 0,14 | 0,23 | -0,11 | -0,04 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | NS | 0,15 | -0,13 | -0,25 | |
| Supérieure | 0,15 | 0,21 | -0,05 | NS | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | NS | 0,20 | -0,16 | NS |
| Supérieure | 0,13 | 0,21 | -0,08 | -0,04 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | NS | 0,17 | NS | NS | |
| Supérieure | 0,15 | 0,22 | -0,09 | NS | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,23 | 0,29 | -0,11 | -0,14 |
| 9e et 10e année | 0,22 | 0,18 | -0,10 | -0,09 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,27 | 0,29 | NS | NS | |
| Supérieure | 0,21 | 0,24 | -0,12 | -0,16 | ||
| Résultat global | 0,18 | 0,27 | -0,14 | -0,11 | ||
- Pour tous les jeunes, l'activité physique en dehors de l'école est corrélée positivement avec la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être, et corrélée négativement avec la solitude et les problèmes de santé.
- Les jeunes TDIG affichent les associations les plus marquées entre l'activité physique en dehors de l'école et les indicateurs de santé mentale positifs.
- En ce qui concerne les filles cisgenres, la relation entre l'activité physique en dehors de l'école et le bien-être est plus forte chez celles dont la famille est plus aisée que chez celles dont la famille est moins aisée.
- Les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée constituent le seul groupe d'élèves à présenter une corrélation négative faible entre l'activité physique en dehors de l'école et les problèmes de santé.
Troubles du sommeil et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,40 | -0,40 | 0,44 | 0,51 |
| Supérieure | -0,33 | -0,34 | 0,35 | 0,47 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,25 | -0,35 | 0,26 | 0,60 | |
| Supérieure | -0,27 | -0,32 | 0,35 | 0,47 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,42 | -0,45 | 0,39 | 0,56 |
| Supérieure | -0,36 | -0,40 | 0,35 | 0,51 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,29 | -0,37 | 0,36 | 0,43 | |
| Supérieure | -0,32 | -0,33 | 0,37 | 0,50 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,34 | -0,30 | 0,37 | 0,48 |
| 9e et 10e année | -0,39 | -0,34 | 0,33 | 0,56 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | -0,47 | -0,53 | 0,41 | 0,54 | |
| Supérieure | -0,32 | -0,29 | 0,35 | 0,49 | ||
| Résultat global | -0,38 | -0,41 | 0,41 | 0,53 | ||
- Dans l'ensemble, pour tous les jeunes, les troubles du sommeil sont corrélés négativement avec les indicateurs de santé mentale positifs et corrélés positivement avec les indicateurs de santé mentale négatifs.
- Chez les garçons cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée, les troubles du sommeil présentent une association positive modérée avec la solitude et une association négative modérée avec le bien-être.
- Chez les filles cisgenres, on observe des corrélations plus fortes entre les troubles du sommeil et les indicateurs de santé mentale chez celles de la 6e à la 8e année que chez celles de 9e et 10e année.
- Chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée, les troubles du sommeil présentent une corrélation négative modérée avec la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être.
- Chez les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée, les troubles du sommeil présentent des corrélations modérées avec tous les indicateurs de santé mentale.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Les garçons cisgenres affichent des niveaux d'activité physique relativement élevés. Ce résultat est encourageant, car l'activité physique est corrélée positivement avec les indicateurs de santé mentale positifs, en particulier le bien-être.
- Plus de la moitié des jeunes cisgenres respectent les recommandations sur les heures de sommeil.
- Les groupes artistiques (y compris les groupes de danse) sont une activité parascolaire populaire chez les jeunes TDIG, et pourraient être une source potentielle importante d'activité physique.
Sujets de préoccupation
- Par rapport aux garçons cisgenres, les filles cisgenres et les jeunes TDIG déclarent de faibles niveaux d'activité physique. Ce résultat est préoccupant compte tenu des nombreux bienfaits connus de l'activité physique pour la santé des jeunes.
- Par rapport aux jeunes cisgenres, les jeunes TDIG font état de niveaux élevés de troubles du sommeil. Ceci est particulièrement préoccupant étant donné les corrélations entre le sommeil et les indicateurs de santé mentale.
- La grande majorité (de 89 à 96 %) des jeunes ne respectent pas la recommandation sur le temps d'écran quotidien.
- La difficulté à s'endormir ou à rester endormi est corrélée avec des indicateurs de santé mentale positifs moins élevés et avec des indicateurs négatifs plus élevés.
Chapitre 8 : L'alimentation saine
Pour rester en bonne santé, il est important d'avoir une alimentation équilibrée composée de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéinesRéférence 68. Toutefois, selon le Guide alimentaire canadien, une alimentation saine ne se résume pas uniquement aux aliments que l'on consomme. Il faut également prendre conscience de ses habitudes alimentaires, cuisiner plus souvent, savourer ses aliments et prendre ses repas en bonne compagnieRéférence 68. Pour mieux intégrer l'alimentation saine à la routine quotidienne des jeunes, on peut les encourager à manger des légumes et des fruits, à limiter les aliments hautement transformés, à lire les étiquettes des aliments, à faire de l'eau leur boisson de choix et à prendre conscience de l'influence du marketing alimentaireRéférence 68.
Comme bien d'autres comportements liés à la santé, les comportements alimentaires peuvent se transformer au cours de l'adolescence et constituer un indice précoce des habitudes alimentaires à l'âge adulteRéférence 69. Le milieu physique, le contexte social, les croyances individuelles et les facteurs économiques sont tous des éléments qui influencent les comportements alimentairesRéférence 70.
Description des éléments
Dans ce chapitre, on mesure l'alimentation saine en examinant les habitudes de consommation de certains nutriments, la fréquence des petits déjeuners et des repas pris en famille (les élèves devaient indiquer à quelle fréquence ils prennent leurs repas en famille, selon les options suivantes : « chaque jour », « presque tous les jours », « environ une fois par semaine », « moins d'une fois par semaine » ou « jamais »), ainsi que la faim (on a demandé aux élèves d'indiquer à quelle fréquence ils se rendent à l'école ou se couchent le ventre vide parce qu'il n'y a pas assez de nourriture à la maison, selon les options suivantes : « toujours », « souvent », « parfois » ou « jamais ») et l'insécurité alimentaire. Enfin, les élèves devaient indiquer à quelle fréquence ils se brossent les dents.
Prise du déjeuner
Figure 8.1. Élèves qui déclarent prendre habituellement un déjeuner (plus qu'un verre de lait ou un jus de fruit) chaque jour de classe, selon l'année d'études et le genre (%)
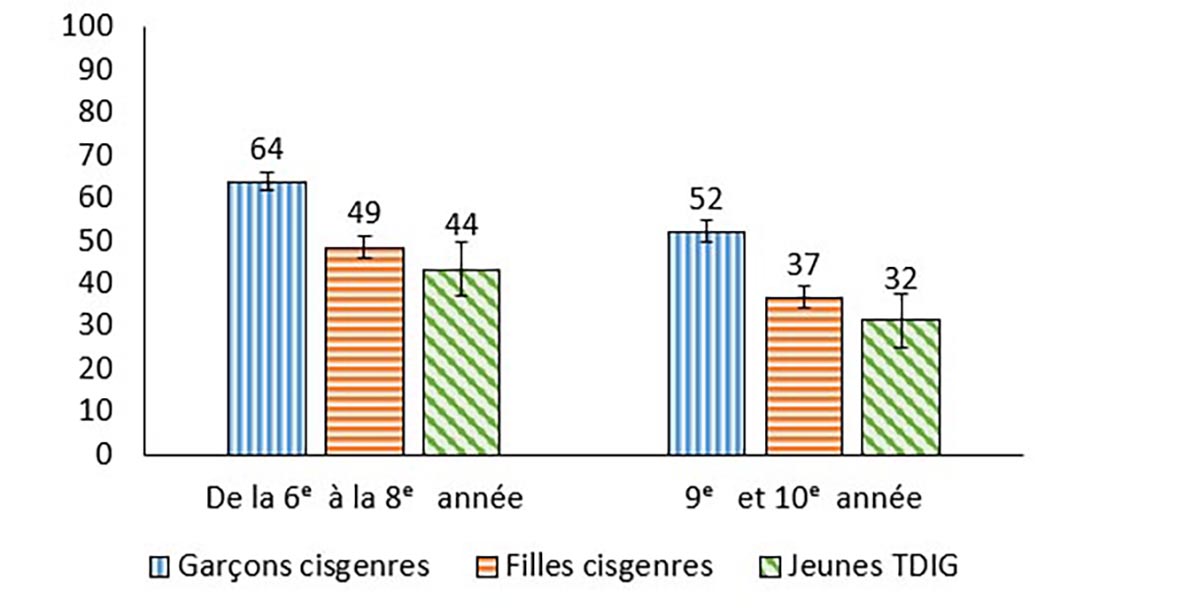
Figure 8.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 64 (61,7, 66,2) | 49 (46,1, 51,1) | 44 (37,4, 49,6) |
| 9e et 10e année | 52 (49,8, 54,7) | 37 (34,3, 39,3) | 32 (25,3, 37,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- En ce qui concerne la prise du déjeuner, les élèves cisgenres de 9e et 10e année affichent un écart à la baisse de 12 points de pourcentage par rapport aux élèves cisgenres de la 6e à la 8e année.
- Dans les deux groupes d'années d'études, les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres à déclarer prendre un déjeuner. Les jeunes TDIG sont les moins nombreux à déclarer prendre un déjeuner.
« Je connais plus de gens qui ne déjeunent pas avant d’aller à l’école que de gens qui déjeunent... »
Faim
Figure 8.2. Élèves qui déclarent qu'au moins parfois, ils ont faim lorsqu'ils vont à l'école ou lorsqu'ils se couchent parce qu'il n'y a pas assez de nourriture à la maison, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 8.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 15 (14,2, 17,3) | 16 (13,8, 17,1) | 27 (21,6, 32,8) |
| 9e et 10e année | 13 (11,3, 14,6) | 13 (11,1, 14,4) | 26 (20,0, 30,9) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les jeunes TDIG sont les plus nombreux à déclarer qu'au moins parfois, ils ont faim lorsqu'ils vont à l'école ou lorsqu'ils se couchent (27 % de la 6e à la 8e année; 26 % en 9e et 10e année).
- Un pourcentage à peu près égal de garçons cisgenres et de filles cisgenres déclarent qu'au moins parfois, ils ont faim lorsqu'ils vont à l'école ou lorsqu'ils se couchent.
Insécurité alimentaire
Figure 8.3. Élèves s'exprimant sur la disponibilité de la nourriture dans leur foyer (%)

Figure 8.3 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Jamais | Parfois | Souvent |
|---|---|---|---|
| Tu n’es pas parvenu(e) à manger un repas sain | 84 | 14 | 2 |
| La nourriture que ta famille a achetée a fini par s’épuiser | 76 | 21 | 3 |
| Tu t’es inquiété(e) de manquer de nourriture à la maison | 87 | 11 | 2 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Lorsque la sécurité alimentaire est décrite en fonction de trois indicateurs standards, plus des trois quarts des élèves déclarent vivre dans un foyer où la sécurité alimentaire est assurée.
- Une proportion de 16 % des élèves déclarent que, parfois ou souvent, ils ne parviennent pas à manger un repas sain.
- Une proportion de 24 % déclarent que, parfois ou souvent, la nourriture que leur famille a achetée a fini par s'épuiser.
- Une proportion de 13 % des élèves s'inquiètent, parfois ou souvent, de manquer de nourriture à la maison.
Sécurité alimentaire
Figure 8.4. Niveaux de sécurité alimentaire déclarés par les élèves (%)

Figure 8.4 : Description textuelle
| Niveaux de sécurité alimentaire | Pourcentage |
|---|---|
| Sécurité alimentaire élevée | 42 |
| Sécurité alimentaire marginale | 15 |
| Sécurité alimentaire faible | 34 |
| Sécurité alimentaire très faible | 9 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|
- Lorsqu'on utilise l'indice complet de la sécurité alimentaire, 34 % des élèves font état d'une sécurité alimentaire faible et 9 % font état d'une sécurité alimentaire très faible.
Repas en famille
Figure 8.5. Élèves qui déclarent prendre leurs repas en famille presque tous les jours ou tous les jours, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 8.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 85 (83,4, 86,4) | 82 (80,2, 83,6) | 68 (32,8, 72,9) |
| 9e et 10e année | 79 (76,3, 80,7) | 73 (70,6, 74,5) | 66 (60,7, 71,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 66 et 85 % des élèves déclarent prendre leurs repas en famille presque tous les jours ou tous les jours.
- Les élèves cisgenres de 9e et 10e année sont moins nombreux que les élèves cisgenres de la 6e à la 8e année à déclarer prendre leurs repas en famille presque tous les jours ou tous les jours.
- Dans les deux groupes d'années d'études, les jeunes TDIG sont moins nombreux que les élèves cisgenres à prendre leurs repas en famille.
Brossage des dents
Figure 8.6. Élèves qui déclarent brosser leurs dents plus d'une fois par jour, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 8.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 61 (58,9, 63,6) | 72 (70,0, 74,2) | 48 (41,5, 53,7) |
| 9e et 10e année | 62 (59,2, 64,5) | 74 (71,1, 76,1) | 44 (37,1, 50,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution significative entre les groupes d'années d'études en ce qui concerne les habitudes de brossage de dents des élèves.
- Les filles cisgenres sont les plus nombreuses à se brosser les dents plus d'une fois par jour, et les jeunes TDIG sont les moins nombreux à le faire.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 72 % des filles cisgenres déclarent brosser leurs dents plus d'une fois par jour, ce qui correspond à 11 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres et à 24 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG.
- De même, en 9e et 10e année, 74 % des filles cisgenres déclarent brosser leurs dents plus d'une fois par jour, ce qui correspond à 12 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres et à 30 points de pourcentage de plus que chez les jeunes TDIG.
Tendances dans la consommation d'aliments sains et d'aliments malsains
Figure 8.7. Élèves qui déclarent consommer des fruits, des légumes, des sucreries et des boissons gazeuses ordinaires (régulières) une fois par jour ou plus souvent, selon l'année d'enquête (%)

Figure 8.7 : Description textuelle
| Élément d'enquête | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruits | 38 | 38 | 44 | 49 | 52 | 48 |
| Légumes | 42 | 41 | 44 | 47 | 54 | 49 |
| Sucreries | 23 | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 |
| Boissons gazeuses | 22 | 15 | 12 | 9 | 6 | 9 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
- La consommation de fruits et de légumes augmente de manière générale au fil du temps. On note cependant en 2022 une diminution de la consommation, 49 % des jeunes déclarant consommer des légumes (contre 54 % en 2018) et 48 % des jeunes déclarant consommer des fruits (contre 52 % en 2018).
- Dans l'ensemble, au fil du temps, la consommation de boissons gazeuses ordinaires diminue. On remarque toutefois en 2022 de légères augmentations de ces indicateurs.
Faim et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,20 | -0,15 | 0,26 | 0,35 |
| Supérieure | -0,17 | -0,12 | 0,14 | 0,13 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,33 | -0,23 | 0,25 | 0,36 | |
| Supérieure | -0,19 | -0,12 | 0,12 | 0,15 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,42 | -0,29 | 0,20 | 0,25 |
| Supérieure | -0,20 | -0,12 | 0,15 | 0,17 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,36 | -0,21 | 0,24 | 0,23 | |
| Supérieure | -0,19 | -0,13 | 0,11 | 0,19 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,19 | -0,08 | 0,19 | 0,08 |
| 9e et 10e année | -0,26 | NS | NS | 0,14 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | -0,33 | -0,20 | 0,18 | 0,23 | |
| Supérieure | -0,17 | NS | 0,09 | 0,07 | ||
| Résultat global | -0,22 | -0,14 | 0,15 | 0,17 | ||
- Dans l'ensemble, le fait de souffrir de la faim est systématiquement associé aux indicateurs de santé mentale. Pour tous les élèves, la faim est associée négativement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associée positivement à la solitude et aux problèmes de santé.
- Les élèves dont la famille est moins aisée présentent les associations les plus fortes entre les indicateurs de santé mentale et la faim.
Prise de repas en famille et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,17 | 0,29 | -0,18 | -0,15 |
| Supérieure | 0,22 | 0,22 | -0,19 | -0,15 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,40 | 0,36 | -0,33 | -0,45 | |
| Supérieure | 0,16 | 0,20 | -0,16 | -0,14 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,46 | 0,45 | -0,33 | -0,42 |
| Supérieure | 0,30 | 0,29 | -0,20 | -0,21 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,21 | 0,16 | -0,24 | -0,23 | |
| Supérieure | 0,23 | 0,22 | -0,15 | -0,21 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,28 | 0,23 | -0,19 | -0,23 |
| 9e et 10e année | 0,20 | 0,23 | -0,19 | -0,22 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,22 | 0,24 | -0,22 | -0,20 | |
| Supérieure | 0,23 | 0,25 | -0,18 | -0,23 | ||
| Résultat global | 0,28 | 0,28 | -0,23 | -0,24 | ||
- Dans l'ensemble, la prise des repas en famille est corrélée positivement avec les indicateurs positifs de santé mentale et corrélée négativement avec les indicateurs négatifs de santé mentale pour tous les jeunes.
- Ces associations sont particulièrement marquées pour les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée, et pour les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- La majorité (de 76 à 87 %) des élèves ne font pas état d'indicateurs liés à une insécurité alimentaire à la maison. Ce résultat est particulièrement encourageant, la sécurité alimentaire étant associée à une bonne santé mentale.
- Plus de la moitié des jeunes Canadiennes et Canadiens déclarent prendre leurs repas en famille presque tous les jours ou tous les jours. Il s'agit là d'un facteur de protection de la santé mentale.
Sujets de préoccupation
- Dans l'ensemble, les élèves TDIG font état des niveaux les plus bas de comportements alimentaires favorables à la santé.
- Plus les élèves cisgenres avancent en âge, moins ils ont tendance à déjeuner.
- Par rapport à 2018, on observe en 2022 une baisse de la fréquence de consommation de fruits et de légumes, et une augmentation de la consommation de sucreries et de boissons gazeuses ordinaires.
Chapitre 9 : Le poids santé
Les fluctuations de poids se produisent lorsqu'il y a un déséquilibre entre le nombre de calories consommées et la quantité d'énergie dépensée tout au long de la journée. Lorsque l'apport calorique est supérieur à ce que l'organisme utilise, il y a prise de poids, ce qui conduit à des situations de surpoids et d'obésité. Cependant, les causes de l'obésité sont complexes et comprennent l'interaction de facteurs génétiques, environnementaux et comportementauxRéférence 71Référence 72. L'obésité est associée à de nombreux problèmes de santé chroniques, notamment le diabète de type 2, un taux de cholestérol élevé, la stéatose hépatique non alcoolique, l'hypertension artérielle, la dépression, l'apnée du sommeil et les problèmes articulairesRéférence 71Référence 73. Par ailleurs, le poids et la perception du poids sont associés à des résultats en lien avec des aspects sociaux de la vie des jeunes, tels que l'intimidation à l'écoleRéférence 74 et l'adoption de comportements à risqueRéférence 75.
Description des éléments
Pour les besoins du présent rapport, l'indice de masse corporelle (IMC) a été utilisé comme mesure pour rendre compte du poids santé. L'IMC est calculé en divisant le poids (kg) par la taille au carré (m2). Au Canada, les jeunes âgés de 12 à 17 ans dont l'IMC se situe en dehors de l'intervalle de poids normal (établi selon des classifications internationales qui reposent sur des seuils définis en fonction de l'âge et du genreRéférence 76) sont classés comme étant « minces » (ou ayant un « poids insuffisant »), « en surpoids », « obèses » ou « atteints d'obésité sévère »Référence 77. Dans le cadre de cette enquête, les personnes interrogées ont déclaré elles-mêmes leur taille et leur poids. Lors de cycles précédents de l'enquête HBSC menés à l'échelle internationale, il a été rapporté qu'environ la moitié des personnes interrogées estimaient incorrectement leur poidsRéférence 78. Au fil du temps, la sous-estimation du poids a augmenté tandis que la surestimation du poids a diminuéRéférence 79. En outre, il a été demandé aux élèves s'ils avaient fait l'objet de moqueries en raison de leur poids et comment ils perçoivent leur image corporelle.
Indice de masse corporelle
Figure 9.1. Répartition des élèves selon leur poids : poids insuffisant, poids normal, surpoids et obésité, selon l'année d'études et le genre (%)
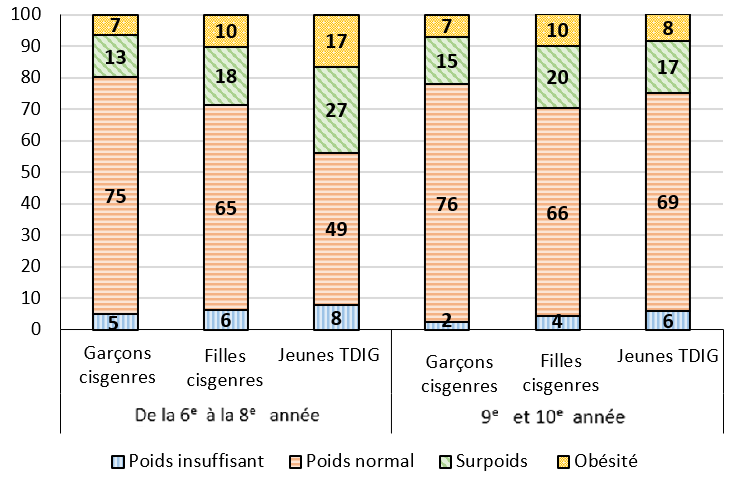
Figure 9.1 : Description textuelle
| Genre | L'année d'études | Poids infsuffisant | Poids normal | Surpoids | Obésité |
|---|---|---|---|---|---|
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | 5 | 75 | 13 | 7 |
| 9e et 10e année | 2 | 76 | 15 | 7 | |
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | 6 | 65 | 18 | 10 |
| 9e et 10e année | 4 | 66 | 20 | 10 | |
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | 8 | 49 | 27 | 17 |
| 9e et 10e année | 6 | 69 | 17 | 8 | |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||||
- La majorité des garçons cisgenres et des filles cisgenres font état d'un poids normal (entre 65 et 77 %).
- Quelle que soit l'année d'études, les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres à faire état d'un poids en dehors de l'intervalle de poids normal.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, les jeunes TDIG sont plus nombreux que les jeunes cisgenres à faire état d'un poids en dehors de l'intervalle de poids normal.
Tendances relatives à l'indice de masse corporelle
Figure 9.2. Élèves dont l'indice de masse corporelle correspond à la catégorie « en surpoids » ou « obésité », selon le genre et l'année d'enquête (%)

Figure 9.2 : Description textuelle
| Genre & Poids | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons en surpoids | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 |
| Garçons obèses | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| Filles en surpoids | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| Filles obèses | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » ou des « filles » dans tous les cycles.
- Au cours des six derniers cycles de l'enquête HBSC, les proportions d'élèves affichant un IMC correspondant à la catégorie « en surpoids » ou à la catégorie « obésité » sont restées relativement stables.
- Par rapport aux filles, les garçons font systématiquement état de proportions plus élevées d'IMC correspondant à la catégorie « en surpoids » ou à la catégorie « obèse ».
« Je pense qu’il y a un gros problème [par rapport au poids santé] chez les garçons cisgenres. Ils suivent le stéréotype selon lequel il faut avoir de gros muscles. Les filles, elles, sont toujours en train de comparer leur corps et veulent être plus minces, ce qui n’est pas une bonne chose. »
Moqueries en raison du poids
Figure 9.3. Élèves qui indiquent avoir fait l'objet de moqueries en raison de leur poids plus d'une ou deux fois au cours des 12 derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 9.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 9 (8,0, 10,8) | 11 (9,7, 12,5) | 19 (14,6, 23,7) |
| 9e et 10e année | 9 (7,6, 10,5) | 10 (8,0, 11,0) | 13 (8,0, 17,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 9 et 13 % des élèves de 9e et 10e année indiquent avoir fait l'objet de moqueries en raison de leur poids.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, 19 % des jeunes TDIG indiquent avoir fait l'objet de moqueries en raison de leur poids, une proportion supérieure de 8 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et supérieure de 10 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
« Définitivement, l’attente concernant ton poids vient beaucoup des médias sociaux... en tout cas, ça ajoute au problème, et tu te fais critiquer si tu ne réponds pas à ces attentes. »
Image corporelle
Figure 9.4. Élèves qui pensent que leur corps est trop mince, plus ou moins correct, ou trop gros, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 9.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Genres | Trop mince | Plus ou moins correct | Trop gros |
|---|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | Garçons cisgenres | 17 | 63 | 21 |
| Filles cisgenres | 10 | 61 | 29 | |
| Jeunes TDIG | 15 | 37 | 48 | |
| 9e et 10e année | Garçons cisgenres | 23 | 53 | 24 |
| Filles cisgenres | 11 | 54 | 35 | |
| Jeunes TDIG | 22 | 37 | 41 | |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||
- Peu importe l'année d'études, les jeunes TDIG sont plus susceptibles que les élèves cisgenres de penser que leur corps est trop gros.
- Peu importe l'année d'études, les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres et les jeunes TDIG à penser qu'ils sont trop minces.
- Les filles cisgenres de 9e et 10e année sont plus enclines que les filles cisgenres de la 6e à la 8e année à penser qu'elles sont trop grosses (35 % contre 29 %, une différence à la hausse de 6 points de pourcentage).
Indice de masse corporelle et problèmes de santé
Figure 9.5. Élèves qui déclarent au moins deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'indice de masse corporelle (poids insuffisant, poids normal, surpoids, obésité) et le genre (%)

Figure 9.5 : Description textuelle
| Genre | Poids infsuffisant | Poids normal | Surpoids | Obésité |
|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | 27 (19,1, 34,0) | 25 (22,7, 26,9) | 29 (25,5, 32,0) | 37 (31,9, 41,9) |
| Filles cisgenres | 55 (45,0, 64,0) | 55 (52,0, 57,0) | 71 (66,6, 75,0) | 68 (61,3, 74,2) |
| Jeunes TDIG | 75 (52,8, 96,0) | 79 (73,4, 85,4) | 80 (69,4, 89,6) | 90 (82,3, 97,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||
- Peu importe le genre, les jeunes en surpoids ou obèses se plaignent davantage de problèmes de santé que les jeunes ayant un poids insuffisant ou un poids normal.
- Les garçons cisgenres en surpoids se plaignent davantage de problèmes de santé que ceux qui sont de poids normal.
Indice de masse corporelle et indice de bien-être (WHO-5)
Figure 9.6. Élèves qui font état d'un bien-être supérieur selon l'indice de bien-être (WHO-5), selon l'indice de masse corporelle (poids insuffisant, poids normal, surpoids, obésité) et le genre (%)
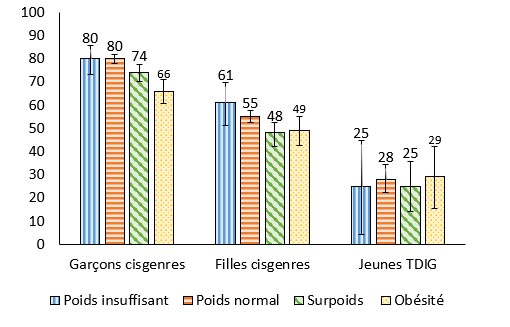
Figure 9.6 : Description textuelle
| Genre | Poids infsuffisant | Poids normal | Surpoids | Obésité |
|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | 80 (73,4, 85,7) | 80 (77,9, 81,8) | 74 (70,3, 77,4) | 66 (60,8, 71,2) |
| Filles cisgenres | 61 (51,3, 69,6) | 55 (52,7, 57,5) | 48 (42,3, 52,5) | 49 (42,4, 55,3) |
| Jeunes TDIG | 25 (4,4, 44,6) | 28 (22,1, 34,3) | 25 (14,3, 35,5) | 29 (15,6, 42,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||
- Les jeunes cisgenres qui sont de poids insuffisant ou de poids normal font état d'un meilleur bien-être que les jeunes cisgenres qui sont en surpoids ou qui sont obèses.
- En ce qui concerne les garçons cisgenres, ceux qui sont en surpoids font état d'un meilleur bien-être que ceux qui sont obèses.
Indice de masse corporelle et satisfaction à l'égard de la vie
Figure 9.7. Élèves qui font état d'une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 0 à 10, selon l'indice de masse corporelle (poids insuffisant, poids normal, surpoids, obésité) et le genre (%)

* Ces données sont supprimées en raison de la taille réduite des cellules.
Figure 9.7. : Description textuelle
| Genre | Poids infsuffisant | Poids normal | Surpoids | Obésité |
|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | 25 (18,8, 31,6) | 28 (26,3, 30,5) | 24 (20,3, 27,3) | 23 (18,2, 27,6) |
| Filles cisgenres | 28 (19,8, 36,2) | 20 (17,8, 21,8) | 10 (6,8, 12,5) | 11 (7,1, 15,3) |
| Jeunes TDIG | S.O.Figure 9.7 Note de bas de page * | 8 (3,5, 11,4) | 5 (0,0, 10,0) | 6 (0,0, 11,9) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022
|
||||
- Les filles cisgenres qui ont un poids insuffisant ou un poids normal sont plus nombreuses que celles qui sont en surpoids ou obèses à faire état d'une grande satisfaction à l'égard de leur vie. Également, les filles cisgenres qui ont un poids insuffisant sont plus enclines que celles qui ont un poids normal à afficher une grande satisfaction à l'égard de leur vie.
- Les garçons cisgenres qui ont un poids normal sont plus nombreux que ceux qui sont en surpoids ou obèses à afficher une grande satisfaction à l'égard de leur vie.
Indice de masse corporelle et solitude
Figure 9.8. Élèves qui déclarent se sentir seuls la plupart du temps ou toujours, selon l'indice de masse corporelle (poids insuffisant, poids normal, surpoids, obésité) et le genre (%)
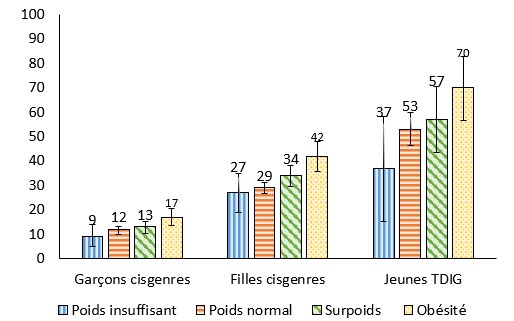
Figure 9.8 : Description textuelle
| Genre | Poids infsuffisant | Poids normal | Surpoids | Obésité |
|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | 9 (5.1, 13,8) | 12 (10,1, 13,0) | 13 (10,3, 15,1) | 17 (13,5, 30,4) |
| Filles cisgenres | 27 (18,8, 34,7) | 29 (26,5, 31,3) | 34 (29,4, 38,2) | 42 (35,8, 47,8) |
| Jeunes TDIG | 37 (15,2, 58,0) | 53 (46,3, 59,7) | 57 (43,5, 70,4) | 70 (56,4, 82,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||
- Les jeunes cisgenres qui sont obèses sont plus nombreux et nombreuses que les jeunes cisgenres dont le poids est insuffisant à déclarer souffrir de solitude.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- La proportion de garçons et de filles dont l'indice de masse corporelle est classé dans la catégorie du surpoids ou de l'obésité, bien qu'élevée, n'a pas augmenté au cours des derniers cycles de l'enquête HBSC.
- La majorité des garçons cisgenres et des filles cisgenres continuent de déclarer un indice de masse corporelle correspondant à un poids normal.
Sujets de préoccupation
- Par rapport aux jeunes cisgenres, les jeunes TDIG sont plus susceptibles de se considérer comme trop gros ou grosses et de faire l'objet de moqueries en raison de leur poids.
Chapitre 10 : Les blessures et les commotions cérébrales
Les blessures demeurent l'une des principales causes de décès et d'invalidité chez les jeunes dans le mondeRéférence 80. Les circonstances dans lesquelles les élèves se blessent le plus souvent sont les suivantes : sur le lieu de travail (en raison d'une formation inadéquate et d'une exposition aux dangers)Référence 81, lors de la pratique d'un sportRéférence 82, à bord d'un véhicule à moteur ou en lien avec la circulation routièreRéférence 83, et dans les espaces où se déroulent les activités de loisirRéférence 84.
Un type de blessure préoccupant à l'adolescence est la commotion cérébrale. Pour les jeunes qui ont subi une commotion cérébrale, diverses conséquences sont possibles, notamment l'absence de l'écoleRéférence 85, la détresse psychologiqueRéférence 86 et des difficultés à effectuer des tâches cognitivesRéférence 87. Pour beaucoup, les symptômes consécutifs à une commotion cérébrale tendent à disparaître rapidement, mais pour ceux et celles dont les symptômes persistent, un niveau important de détresse, une diminution de la qualité de vie et une perte de productivité peuvent être ressentis.
Description des éléments
Dans le cadre du présent rapport, les élèves ont indiqué s'ils avaient subi, au cours des 12 derniers mois, une blessure ayant exigé des soins médicaux de la part d'un médecin ou d'un(e) infirmier(ière) (options de réponse : « je n'ai pas subi de blessures au cours des 12 derniers mois », « une fois », « deux fois », « trois fois », « quatre fois ou plus »). Les blessures qui ont exigé un plâtre, une intervention chirurgicale, des points de suture ou un séjour d'au moins une nuit à l'hôpital ou dans un centre de santé ont été désignées comme étant graves. Des informations sur le lieu où l'élève se trouvait lorsque ces blessures ont eu lieu sont également présentées. Enfin, on a demandé aux élèves d'indiquer si un professionnel ou une professionnelle de la santé leur avait diagnostiqué une commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois (options de réponse : « non », « oui, une fois », « oui, plus d'une fois »).
Blessures ayant exigé des soins médicaux
Figure 10.1. Élèves qui déclarent avoir subi au cours des 12 derniers mois une blessure qui a exigé des soins médicaux, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 10.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 47 (44,3, 48,8) | 43 (40,8, 45,0) | 41 (35,3, 47,3) |
| 9e et 10e année | 47 (44,4, 49,5) | 44 (41,7, 46,2) | 42 (35,0, 48,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 41 et 47 % des jeunes ont subi au cours des 12 derniers mois une blessure qui a nécessité des soins médicaux. Ces proportions sont relativement stables d'un groupe à l'autre.
Tendances relatives aux blessures graves chez les garçons
Figure 10.2. Garçons qui déclarent avoir subi au cours des 12 derniers mois une blessure ayant exigé un plâtre, une intervention chirurgicale, des points de suture ou un séjour d'au moins une nuit à l'hôpital ou dans un centre de santé, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 10.2 : Description textuelle
| L’année d’études | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 |
| 8e année | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 10e année | 19 | 22 | 22 | 21 | 15 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- En général, on constate en 2022 qu'il y a moins de blessures graves (qui ont nécessité un plâtre, une intervention chirurgicale, des points de suture ou un séjour d'au moins une nuit dans un centre de santé) chez les garçons qu'en 2018.
- En 2022, les garçons de 10e année sont moins susceptibles que leurs camarades plus jeunes de faire état d'une blessure grave (15 % en 10e année contre 18 % en 6e et en 8e année).
Tendances relatives aux blessures graves chez les filles
Figure 10.3. Filles qui déclarent avoir subi au cours des 12 derniers mois une blessure ayant exigé un plâtre, une intervention chirurgicale, des points de suture ou un séjour d'au moins une nuit à l'hôpital ou dans un centre de santé, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
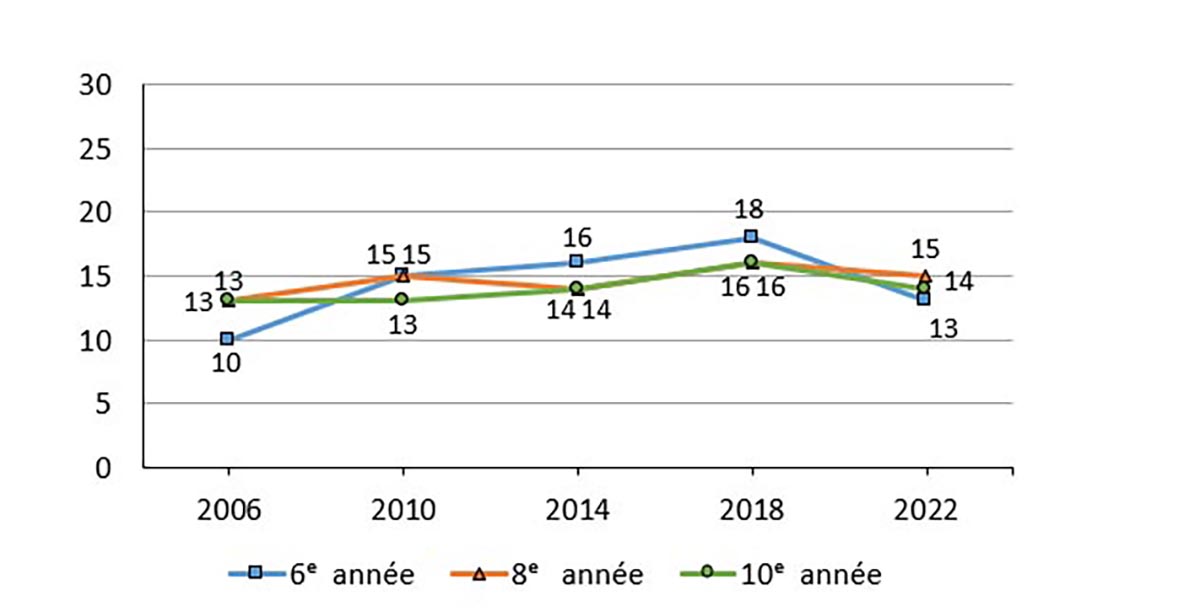
Figure 10.3 : Description textuelle
| L’année d’études | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6e année | 10 | 15 | 16 | 18 | 13 |
| 8e année | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| 10e année | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- En général, on constate en 2022 qu'il y a moins de blessures graves (qui ont nécessité un plâtre, une intervention chirurgicale, des points de suture ou un séjour d'au moins une nuit à l'hôpital ou dans un centre de santé) chez les filles qu'en 2018.
- Bien que les filles aient déclaré moins de blessures que les garçons en 2022, la différence entre les genres en 2022 est moins marquée que lors des cycles précédents de l'enquête HBSC.
« J’ai une amie qui a été blessée, et elle était très aimée, elle avait des gens qui l’aidaient à se déplacer d’une classe à l’autre, mais ça m’a fait réfléchir et penser que si tu n’as pas ce système de soutien et que tu es blessé, ça peut être difficile de devoir tout gérer seul. »
Endroits où les blessures se produisent pour les garçons cisgenres
Figure 10.4. Endroits où les garçons cisgenres indiquent avoir subi leur blessure la plus grave au cours des 12 derniers mois, selon l'année d'études (%)
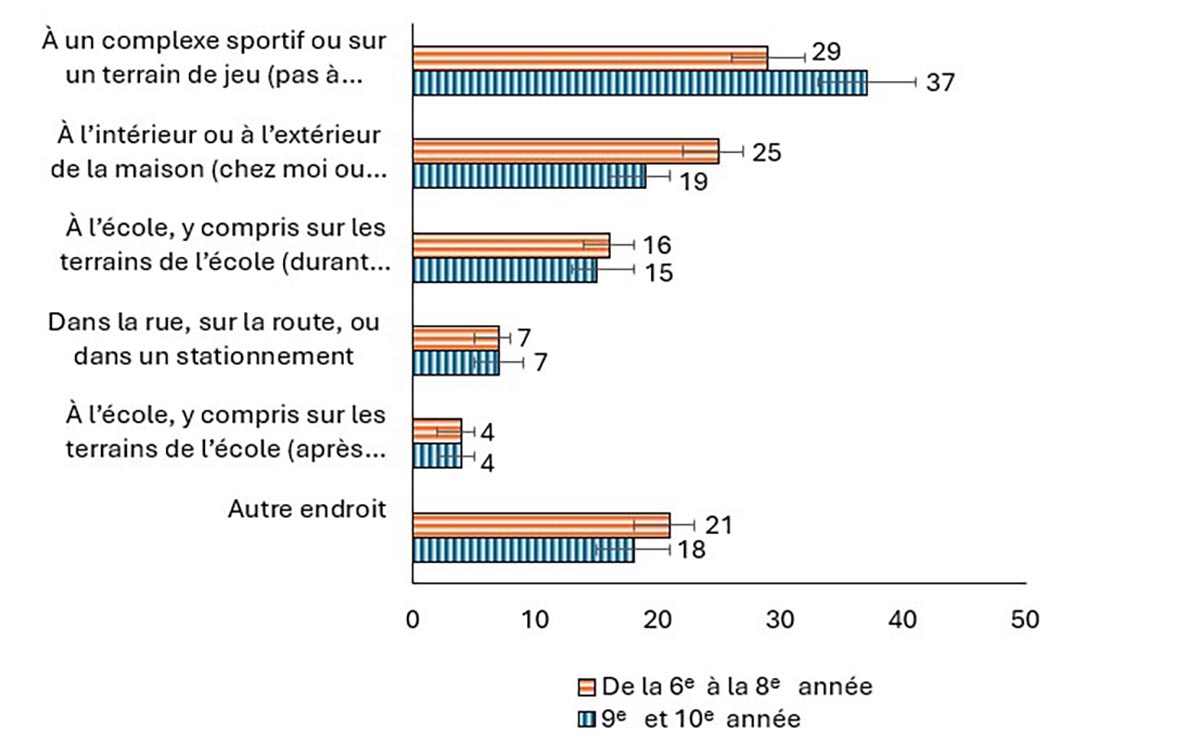
Figure 10.4 : Description textuelle
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année |
|---|---|---|
| À un complexe sportif ou sur un terrain de jeu (pas à l’école) | 29 | 37 |
| À l’intérieur ou à l’extérieur de la maison (chez moi ou chez quelqu’un d’autre) | 25 | 19 |
| À l’école, y compris sur les terrains de l’école (durant les heures de classe) | 16 | 15 |
| Dans la rue, sur la route, ou dans un stationnement | 7 | 7 |
| À l’école, y compris sur les terrains de l’école (après les heures de classe) | 4 | 4 |
| Autre endroit | 21 | 18 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||
- Les endroits les plus fréquents où s'est produite la blessure la plus grave pour les garçons cisgenres sont un complexe sportif/terrain de jeu (pas à l'école), et à l'intérieur/extérieur de la maison.
- L'endroit le moins fréquent où s'est produite la blessure la plus grave pour les garçons cisgenres de la 6e à la 8e année est l'école (après les heures de classe).
Endroits où les blessures se produisent pour les filles cisgenres
Figure 10.5. Endroits où les filles cisgenres indiquent avoir subi leur blessure la plus grave au cours des 12 derniers mois, selon l'année d'études (%)

Figure 10.5 : Description textuelle
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année |
|---|---|---|
| À un complexe sportif ou sur un terrain de jeu (pas à l’école) | 23 | 37 |
| À l’intérieur ou à l’extérieur de la maison (chez moi ou chez quelqu’un d’autre) | 31 | 25 |
| À l’école, y compris sur les terrains de l’école (durant les heures de classe) | 17 | 14 |
| Dans la rue, sur la route, ou dans un stationnement | 8 | 6 |
| À l’école, y compris sur les terrains de l’école (après les heures de classe) | 4 | 3 |
| Autre endroit | 18 | 14 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||
- Chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, l'endroit le plus fréquent où s'est produite la blessure la plus grave est à l'intérieur/extérieur de la maison.
- Chez les filles cisgenres de 9e et 10e année, l'endroit le plus fréquent où s'est produite la blessure la plus grave est un complexe sportif/terrain de jeu.
- Pour toutes les années d'études, l'endroit le moins fréquent où s'est produite la blessure la plus grave pour les filles cisgenres est l'école (après les heures de classe).
Commotions cérébrales
Figure 10.6. Élèves ayant indiqué avoir subi une commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 10.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 11 (10,0, 12,8) | 9 (7,7, 10,3) | 11 (7,1, 14,0) |
| 9e et 10e année | 11 (9,7, 12,8) | 10 (8,1, 10,9) | 8 (4,6, 11,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 8 et 11 % des jeunes indiquent avoir subi une commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois.
« J'ai eu une commotion cérébrale, et ça n'a pas été une expérience agréable, j'ai été absente pendant une semaine; ma sœur est tombée de son vélo et elle a dû s'absenter aussi, mais le plus important, ce sont les conséquences à long terme. J'ai encore une sensibilité à la lumière, et ça remonte à un an. »
Blessures ayant exigé des soins médicaux et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,30 |
| Supérieure | -0,06 | NS | 0,05 | 0,11 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,21 | -0,18 | NS | 0,25 | |
| Supérieure | NS | 0,07 | NS | 0,15 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,28 | -0,23 | 0,13 | 0,36 |
| Supérieure | -0,10 | -0,04 | 0,13 | 0,21 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,09 | NS | 0,17 | 0,20 | |
| Supérieure | -0,08 | NS | 0,09 | 0,24 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,14 | NS | NS | 0,08 |
| 9e et 10e année | -0,09 | -0,11 | NS | 0,22 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | -0,25 | -0,18 | NS | 0,37 | |
| Supérieure | NS | NS | NS | 0,08 | ||
| Résultat global | -0,08 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | ||
- Dans l'ensemble, le fait d'avoir subi une blessure ayant exigé des soins médicaux n'est pas fortement associé aux indicateurs de santé mentale. Les blessures ayant fait l'objet de soins médicaux sont corrélées négativement avec la satisfaction à l'égard de la vie et corrélées positivement avec les indicateurs négatifs de santé mentale, et ce pour tous les jeunes.
- Les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée affichent une corrélation négative faible entre les blessures ayant exigé des soins médicaux et la satisfaction à l'égard de la vie et une corrélation positive faible entre les blessures ayant exigé des soins médicaux et les problèmes de santé.
Commotions cérébrales et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,22 | NS | 0,12 | 0,26 |
| Supérieure | -0,11 | -0,04 | 0,07 | 0,09 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,27 | NS | 0,15 | 0,31 | |
| Supérieure | NS | NS | NS | 0,15 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,32 | -0,22 | 0,18 | 0,18 |
| Supérieure | -0,09 | 0,04 | 0,11 | 0,18 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | NS | NS | NS | 0,13 | |
| Supérieure | -0,05 | NS | 0,07 | 0,16 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | NS | NS | NS | 0,12 |
| 9e et 10e année | NS | 0,14 | -0,22 | NS | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | NS | NS | NS | |
| Supérieure | NS | NS | NS | NS | ||
| Résultat global | -0,09 | -0,02 | 0,06 | 0,12 | ||
- Dans l'ensemble, l'expérience d'une commotion cérébrale présente une association variable avec les indicateurs de santé mentale. Les commotions cérébrales sont associées négativement à la satisfaction à l'égard de la vie et positivement aux problèmes de santé, et ce pour tous les jeunes.
- Chez les garçons cisgenres dont la famille est moins aisée, on observe une corrélation négative faible entre les commotions cérébrales et la satisfaction à l'égard de la vie, et une corrélation positive faible entre les commotions cérébrales et les problèmes de santé.
- Les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée présentent des corrélations négatives faibles entre les commotions cérébrales et les indicateurs positifs de santé mentale.
- Les jeunes TDIG de 9e et 10e année présentent une corrélation négative faible entre la solitude et les commotions cérébrales.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Par rapport aux années précédentes, les proportions de blessures ont diminué dans le cycle d'enquête de 2022.
- Bien que toute blessure exigeant des soins médicaux et toute commotion cérébrale soit par nature préoccupante, il ne semble pas y avoir de différences de fréquence en fonction de l'année d'études ni du genre.
Sujets de préoccupation
- Le fait que 1 jeune sur 10 ait subi une commotion cérébrale est préoccupant, en raison des effets à court terme sur la santé et sur la capacité à participer à des activités, ainsi que des effets à long terme et de leur corrélation connue avec les résultats en matière de santé mentale.
Chapitre 11 : L'intimidation et la violence en contexte amoureux
L'intimidation est un problème relationnel qui résulte d'un déséquilibre de pouvoir et qui se manifeste par des gestes et des comportements répétitifs visant à faire du mal à une autre personneRéférence 88. L'intimidation peut notamment se faire sous forme verbale, relationnelle, physique ou par l'intermédiaire de plateformes en ligneRéférence 89. L'intimidation cible souvent les élèves sur la base de différences perçues, par exemple l'identité de genre déclarée ou perçue, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'origine ethniqueRéférence 90.
Être partie prenante d'une relation d'intimidation (que ce soit en tant que victime, auteur ou victime/auteur) est associé à de mauvais résultats en matière de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression, une faible satisfaction à l'égard de la vie et un sentiment de tristesse ou de désespoirRéférence 91Référence 92Référence 93. L'intimidation a aussi des répercussions négatives sur les enfants à l'école, car il a été constaté que les enfants victimes d'intimidation ont de moins bons résultats scolaires et sont moins bien intégrés à l'écoleRéférence 94.
La violence en contexte amoureux chez les adolescents est un préjudice causé intentionnellement à une partenaire amoureuse ou à un partenaire amoureux, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel ou par des moyens virtuels. Selon un rapport national récent, plus d'un jeune sur trois ayant eu des fréquentations amoureuses a subi ou exercé ce genre de violence au cours des 12 derniers moisRéférence 95. Être victime ou auteur de violence en contexte amoureux est plus courant chez les jeunes de diverses identités de genre et chez ceux et celles qui sont victimes de marginalisation socialeRéférence 95. Lorsqu'on étudie les liens entre cette violence et l'intimidation, on constate que les jeunes qui ont à la fois été auteurs et victimes de violence dans le cadre des relations entre camarades sont plus susceptibles de reproduire ces schémas dans leurs relations amoureusesRéférence 96. La violence en contexte amoureux chez les adolescents est d'autant plus préoccupante qu'elle est un facteur prédictif de la violence conjugale à l'âge adulteRéférence 97.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, on pose différentes questions aux élèves en ce qui concerne leurs expériences en matière d'intimidation. On leur demande d'abord à quelle fréquence ils ont été victimes d'intimidation (les réponses possibles sont les suivantes : « je n'ai pas été victime d'intimidation ou de taxage à l'école au cours des deux derniers mois », « cela est arrivé une ou deux fois », « deux ou trois fois par mois », « environ une fois par semaine » et « plusieurs fois par semaine »), les formes d'intimidation qu'ils ont subies et les raisons de l'intimidation. Ensuite, on demande aux élèves à quelle fréquence ils ont intimidé leurs camarades. Comme les adolescents et adolescentes passent de plus en plus de temps sur les médias sociaux et sur Internet, on a intégré à l'enquête des questions sur la cyberintimidation. On a demandé aux élèves à quelle fréquence ils avaient été victimes de cyberintimidation au cours des deux derniers mois selon le choix de réponses suivant : « je n'ai pas été victime de cyberintimidation au cours des deux derniers mois », « une ou deux fois », « deux ou trois fois par mois », « environ une fois par semaine » et « plusieurs fois par semaine ». Enfin, on a posé aux élèves de 9e et 10e année des questions sur leurs expériences de la violence en contexte amoureux.
Victimes d'intimidation
Figure 11.1. Élèves qui déclarent avoir été victimes d'intimidation à l'école au cours des deux derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 11.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Genre | Deux ou trois fois par mois | Une fois par semaine | Plusieurs fois par semaine |
|---|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | Garçons cisgenres | 10 (8,8, 11,2) | 8 (6,6, 8,7) | 14 (12,7, 16,2) |
| Filles cisgenres | 13 (11,4, 13,9) | 11 (9,4, 11,9) | 16 (14,2, 17,9) | |
| Jeunes TDIG | 16 (7,9, 15,6) | 12 (11,8, 20,5) | 28 (22,6. 33,6) | |
| 9e et 10e année | Garçons cisgenres | 8 (6,6, 9,7) | 7 (6,0, 8,6) | 13 (11,0, 14,6) |
| Filles cisgenres | 14 (12,1, 15,6) | 10 (8,1, 11,3) | 13 (11,1, 14,1) | |
| Jeunes TDIG | 15 (9,9, 19,7) | 16 (11,3, 20,4) | 20 (14,8, 24,2) | |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||||
- Dans la catégorie de la 6e à la 8e année, 28 % des jeunes TDIG déclarent avoir été victimes d'intimidation à l'école plusieurs fois par semaine, ce qui correspond à 12 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et à 14 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres.
Formes d'intimidation
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| J'ai reçu des insultes | 18 | 22 | 36 | 14 | 16 | 24 |
| J'ai été mis(e) à l'écart des autres | 13 | 18 | 30 | 9 | 14 | 25 |
| J'ai été frappé(e) ou botté(e) | 12 | 8 | 17 | 7 | 5 | 5 |
| On a dit des mensonges à mon sujet | 13 | 18 | 21 | 9 | 16 | 15 |
| On a raconté des blagues de nature sexuelle à mon sujet | 9 | 10 | 27 | 8 | 13 | 18 |
- L'insulte est la forme d'intimidation la plus courante subie par les élèves.
- De manière générale, on constate une diminution de la fréquence de tous les types d'intimidation en 9e et 10e année par rapport à la catégorie de la 6e à la 8e année, sauf pour les filles cisgenres, qui déclarent faire plus souvent l'objet de blagues de nature sexuelle.
- Les élèves TDIG sont plus nombreux que les garçons cisgenres à déclarer avoir été victimes de ces formes d'intimidation.
Raisons de l'intimidation
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Poids corporel | 9 | 11 | 19 | 9 | 9 | 13 |
| Origine ethnique ou couleur de la peau | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Religion | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Identité de genre | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | 28 |
| Orientation sexuelle | 3 | 5 | 27 | 4 | 4 | 23 |
- Les jeunes TDIG sont les plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, en particulier en ce qui concerne leur poids, leur identité de genre et leur orientation sexuelle.
- La raison la plus fréquente pour laquelle les garçons et les filles cisgenres sont victimes d'intimidation est le poids corporel.
Auteurs d'intimidation
Figure 11.2. Élèves qui déclarent avoir participé à des actes d'intimidation à l'égard d'autres élèves au moins deux ou trois fois par mois au cours des deux derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)
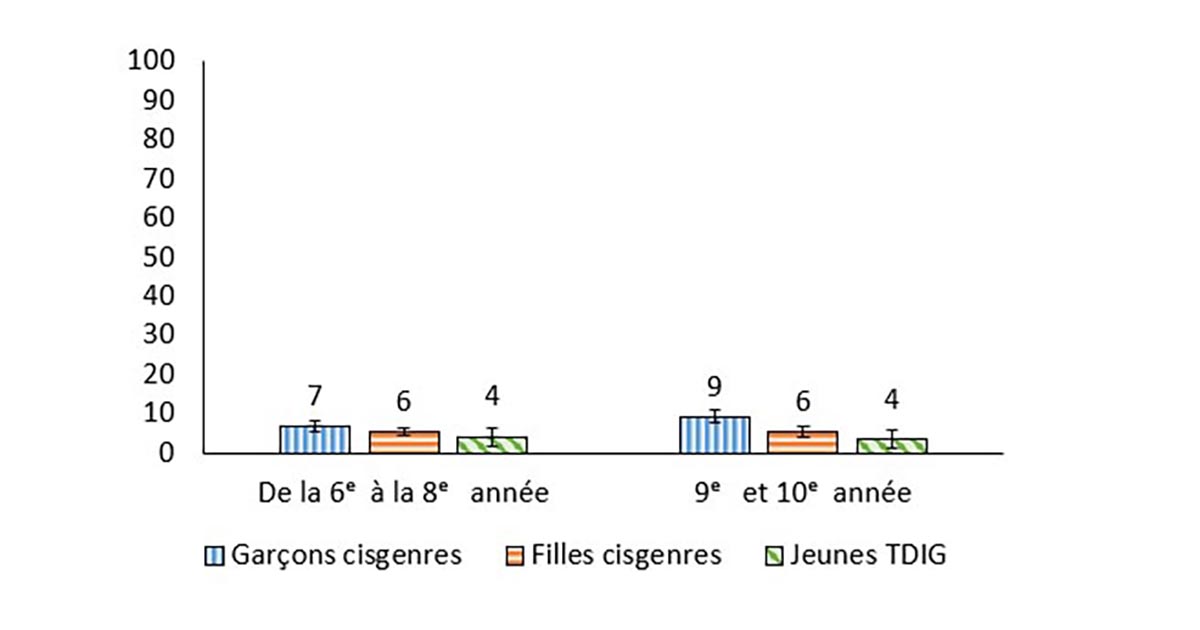
Figure 11.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 7 (5,7, 8,1) | 6 (4,5, 6,5) | 4 (1,8, 6,2) |
| 9e et 10e année | 9 (7,7, 11,0) | 6 (4,3, 6,7) | 4 (1,3, 6,2) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Dans les deux groupes d'années d'études, les garçons cisgenres sont ceux qui ont le plus souvent été auteurs d'actes d'intimidation, et les jeunes TDIG sont ceux qui ont le moins souvent été auteurs d'actes d'intimidation.
Tendances en matière d'intimidation
Figure 11.3. Élèves qui déclarent avoir été victimes d'intimidation, avoir été auteurs d'intimidation, ou les deux, selon l'année d'enquête (%)

Description textuelle
| Élément d'enquête | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auteur et victim d’intimidation | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Victime d’intimidation | 19 | 20 | 22 | 20 | 32 |
| Auteur d’intimidation | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||
- En 2022, 32 % des élèves déclarent avoir été victimes d'intimidation, ce qui représente une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à 2018. Il s'agit du taux le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la collecte de données sur l'intimidation pour l'enquête HBSC au Canada.
- En 2022, on note par rapport à 2018 une diminution de 4 points de pourcentage des élèves qui déclarent avoir été auteurs et victimes d'intimidation. Par ailleurs, 5 % des élèves déclarent avoir été victimes et auteurs d'intimidation, et 2 % déclarent avoir été auteurs d'actes d'intimidation.
Victimes de cyberintimidation
Figure 11.4. Élèves qui déclarent avoir été victimes de cyberintimidation au cours des deux derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 11.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 17 (15,2, 18,5) | 24 (21,5, 25,8) | 38 (32,2, 43,4) |
| 9e et 10e année | 17 (15,1, 19,2) | 23 (20,6, 25,0) | 27 (21,0, 33,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Dans le groupe de la 6e à la 8e année, 38 % des jeunes TDIG déclarent avoir été victimes de cyberintimidation, ce qui correspond à 14 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et à 21 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres.
- Cette tendance se maintient en 9e et 10e année, 27 % des jeunes TDIG déclarant avoir été victimes de cyberintimidation.
Auteurs de cyberintimidation
Figure 11.5. Élèves qui déclarent avoir participé à des actes de cyberintimidation au cours des deux derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 11.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 12 (10,4, 13,5) | 10 (8,0, 10,9) | 13 (8,7, 16,3) |
| 9e et 10e année | 16 (14,7, 18,1) | 10 (8,9, 11,9) | 12 (7,4, 16,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Entre 10 et 16 % des élèves déclarent avoir participé à des actes de cyberintimidation envers d'autres élèves.
- Les garçons cisgenres de 9e et 10e année sont plus nombreux que les garçons cisgenres de la 6e à la 8e année à déclarer avoir été auteurs de cyberintimidation (12 % contre 16 %).
Victimes de violence en contexte amoureux
Figure 11.6. Élèves de 9e et 10e année qui déclarent avoir été victimes de violence en contexte amoureux au cours des 12 derniers mois, selon le genre (%)

Figure 11.6 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| Violence physique | 5 (4,3, 6,5) | 6 (5,0, 7,5) | 13 (8,8, 16,9) |
| Contrôle ou blessures émotionnelles | 9 (7,1, 10,1) | 18 (15,8, 20,1) | 22 (16,6, 26,7) |
| Par l’entremise des medias sociaux | 6 (5,0, 7,3) | 11 (9,4, 12,4) | 19 (13,7, 2,.7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les jeunes TDIG sont plus nombreux que les jeunes cisgenres à déclarer avoir été victimes de violence physique en contexte amoureux (13 % des jeunes TDIG contre 6 % des filles cisgenres et 5 % des garçons cisgenres).
- Les garçons cisgenres sont moins nombreux que les filles cisgenres et que les jeunes TDIG à déclarer avoir été victimes d'un contrôle ou de blessures émotionnelles (9 % des garçons cisgenres contre 18 % des filles cisgenres et 22 % des jeunes TDIG).
- De même, les garçons cisgenres sont moins nombreux que les filles cisgenres et que les jeunes TDIG à déclarer avoir été victimes de violence en contexte amoureux par l'entremise des réseaux sociaux (6 % des garçons cisgenres contre 11 % des filles cisgenres et 19 % des jeunes TDIG).
- Le type de violence en contexte amoureux dont les filles cisgenres font le plus souvent l'objet est le contrôle/les blessures émotionnelles.
« Je dirais aux décideurs d'examiner de près la violence dans les relations amoureuses des ados. J'ai entendu parler de cas où la situation est devenue vraiment extrême. Je ne pense vraiment pas que les statistiques sur les élèves de 9e et 10e année qui ont déclaré avoir été victimes de violence dans leurs relations amoureuses soient exactes. Beaucoup de cas ne sont pas déclarés. »
Auteurs de violence en contexte amoureux
Figure 11.7. Élèves de 9e et 10e année qui déclarent avoir été auteurs de violence en contexte amoureux au cours des 12 derniers mois, selon le genre (%)
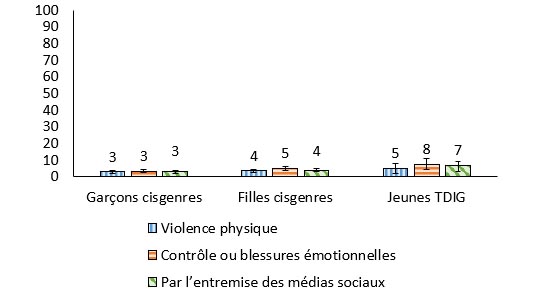
Figure 11.7 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| Violence physique | 3 (2,2, 4,1) | 4 (2,8, 4,6) | 5 (2,3, 8,3) |
| Contrôle ou blessures émotionnelles | 3 (2,4, 4,4) | 5 (3,9, 6,4) | 8 (4,3, 11,2) |
| Par l’entremise des médias sociaux | 3 (2,2, 4,0) | 4 (3,1, 5,0) | 7 (3,4, 9,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Les garçons et filles cisgenres déclarent dans des proportions similaires avoir été auteurs en contexte amoureux de violence physique, de contrôle/blessures émotionnelles ou de violence par l'entremise des réseaux sociaux.
- La proportion de ces trois formes de violence en contexte amoureux est légèrement plus élevée chez les jeunes TDIG.
Intimidation vécue et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,29 | 0,13 | 0,38 | 0,44 |
| Supérieure | -0,26 | -0,26 | 0,35 | 0,31 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,15 | -0,14 | 0,30 | 0,17 | |
| Supérieure | -0,20 | -0,16 | 0,26 | 0,27 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,45 | -0,31 | 0,43 | 0,44 |
| Supérieure | -0,31 | 0,28 | 0,42 | 0,38 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,32 | -0,28 | 0,39 | 0,47 | |
| Supérieure | -0,23 | -0,17 | 0,32 | 0,33 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,36 | -0,29 | 0,37 | 0,34 |
| 9e et 10e année | -0,22 | -0,21 | 0,29 | 0,28 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | -0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,26 | |
| Supérieure | -0,31 | -0,23 | 0,34 | 0,32 | ||
| Résultat global | -0,29 | -0,25 | 0,37 | 0,35 | ||
- Pour l'ensemble des jeunes, l'intimidation vécue est systématiquement associée à des niveaux plus élevés d'indicateurs négatifs de santé mentale et à des niveaux plus faibles d'indicateurs positifs de santé mentale.
- C'est chez les garçons cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel que l'on trouve les plus fortes corrélations entre l'intimidation vécue et les problèmes de santé.
- Chez les filles cisgenres, les corrélations entre l'intimidation vécue et les résultats en matière de santé mentale sont particulièrement marquées.
Cyberintimidation vécue et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,16 | NS | 0,23 | 0,42 |
| Supérieure | -0,17 | -0,14 | 0,20 | 0,19 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,19 | -0,18 | 0,18 | 0,17 | |
| Supérieure | -0,15 | -0,14 | 0,14 | 0,21 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,20 | -0,17 | 0,16 | 0,29 |
| Supérieure | -0,27 | -0,21 | 0,32 | 0,34 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,32 | -0,30 | 0,37 | 0,40 | |
| Supérieure | -0,24 | -0,13 | 0,23 | 0,29 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,25 | -0,20 | 0,28 | 0,25 |
| 9e et 10e année | -0,17 | -0,10 | 0,09 | 0,23 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | NS | 0,22 | 0,16 | |
| Supérieure | -0,23 | -0,15 | 0,21 | 0,24 | ||
| Résultat global | -0,24 | -0,18 | 0,25 | 0,28 | ||
- Pour tous les élèves, la cyberintimidation vécue est corrélée négativement avec les indicateurs positifs de santé mentale et corrélée positivement avec les indicateurs négatifs de santé mentale.
- Les corrélations entre la cyberintimidation vécue et les problèmes de santé sont particulièrement fortes.
« Les réseaux sociaux jouent un rôle dans ça, parce que maintenant, l'intimidation ne veut plus dire lamême chose, on n'a pas besoin de battre quelqu'un pour l'intimider. »
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Lorsqu'on compare les résultats avec ceux de 2018, moins d'élèves déclarent avoir intimidé d'autres élèves ou avoir été à la fois auteurs et victimes d'intimidation.
Sujets de préoccupation
- Le nombre d'élèves qui déclarent avoir été victimes d'intimidation a augmenté de manière significative.
- Les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année sont plus nombreux que leurs camarades cisgenres à déclarer avoir été victimes d'intimidation à l'école plusieurs fois par semaine.
- Le fait d'avoir été victime d'intimidation ou de cyberintimidation est associé à une hausse du sentiment de solitude et des problèmes de santé, ainsi qu'à une baisse du bien-être et de la satisfaction à l'égard de la vie.
- Entre 5 et 22 % des jeunes déclarent avoir été victimes de violence en contexte amoureux.
Chapitre 12 : La santé spirituelle
La spiritualité est reconnue comme un atout pour la santé des jeunesRéférence 98. À ne pas confondre avec la religion proprement dite, la spiritualité peut revêtir des significations différentes selon les personnes. Pour les jeunes du Canada, les aspects spirituels de la santé sont associés aux relations qui existent dans leur vie et qui sont généralement réparties en quatre domaines, soit les « relations avec soi-même », les « relations avec les autres », les « relations avec l'environnement naturel » et, pour certains, les « relations avec le transcendant », ou un mystère plus grand que soi ou pouvoir spirituelRéférence 99.
Pour évaluer les relations avec soi-même, on demande aux élèves dans quelle mesure il est important pour eux que leur vie ait « une signification ou un but » et d'éprouver de la joie dans la vie. Ce domaine de la spiritualité est d'une importance capitale pour les jeunes et leur santé mentaleRéférence 100Référence 101. Les relations avec les autres ont trait à l'importance d'être gentil et indulgent envers les autresRéférence 100. Les relations avec la nature portent sur l'importance de se sentir en lien avec la nature et de respecter l'environnement naturelRéférence 100. Enfin, les relations avec le transcendant décrivent l'importance qu'une jeune personne accorde au fait de se sentir connectée à une force supérieure, ou de prendre le temps de méditer ou de prierRéférence 100.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, on demande aux élèves d'évaluer l'importance de chacun des quatre domaines de la spiritualité (relations avec soi-même, les autres, la nature, le transcendant) dans leur vie, à l'aide d'une échelle simple comportant 10 questions. Les participants et participantes évaluent chaque élément sur une échelle de cinq points allant de 1 (« pas du tout important ») à 5 (« très important »), les scores de 4 ou 5 correspondant à « important » dans les analyses ultérieuresRéférence 99.
Relations avec soi-même
Figure 12.1. Élèves qui déclarent que les relations avec soi-même sont importantes, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 12.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 76 (74,1, 78,3) | 74 (72,1, 75,9) | 48 (41,4, 54,0) |
| 9e et 10e année | 75 (72,7, 77,6) | 78 (75,5, 79,8) | 52 (45,0, 58,9) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Peu importe l'année d'études, les jeunes TDIG sont les moins susceptibles d'évaluer comme importantes dans leur vie les relations avec soi-même (48 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année et 52 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année considèrent ce domaine important). Ces pourcentages sont assez faibles par rapport à ceux des garçons et filles cisgenres, qui varient de 74 à 78 %.
Relations avec les autres
Figure 12.2. Élèves qui déclarent que les relations avec les autres sont importantes, selon l'année d'études et le genre (%)
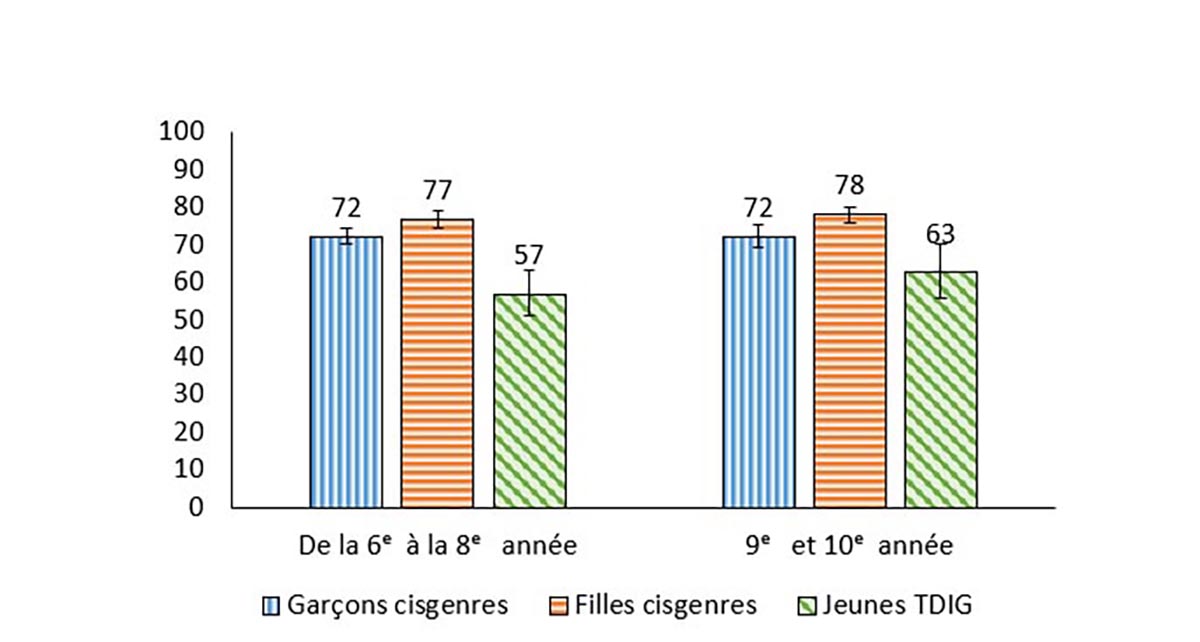
Figure 12.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 72 (70,2, 74,6) | 77 (74,5, 79,0) | 57 (51,4, 63,3) |
| 9e et 10e année | 72 (69,5, 75,2) | 78 (75,9, 79,9) | 63 (55,9, 70,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Pour toutes les années d'études, les jeunes cisgenres sont les plus susceptibles de déclarer que les relations avec les autres sont importantes dans leur vie (72 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année et de 9e et 10e année; 77 % et 78 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année et de 9e et 10e année, respectivement).
Relations avec la nature
Figure 12.3. Élèves qui déclarent que les relations avec la nature sont importantes, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 12.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 65 (62,8, 67,3) | 68 (66,1, 70.6) | 59 (52,5, 65,3) |
| 9e et 10e année | 56 (53,1, 58,5) | 64 (61,7, 66,5) | 58 (50,8, 64,4) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion de jeunes qui déclarent que les relations avec la nature sont importantes est plus faible en 9e et 10e année que de la 6e à la 8e année chez les garçons cisgenres (65 % contre 56 %, soit un écart à la baisse de 9 points de pourcentage) et chez les filles cisgenres (68 % contre 64 %, soit un écart à la baisse de 4 points de pourcentage).
« À mon école, la plupart des gens préfèrent rester chez eux et ne pas se rapprocher de la nature... donc la proportion rapportée ici est surprenante. »
Relations avec le transcendant
Figure 12.4. Élèves qui déclarent que les relations avec le transcendant sont importantes, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 12.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 31 (28,4, 33,1) | 30 (27,6, 32,3) | 13 (9,5, 17,2) |
| 9e et 10e année | 30 (27,0, 32,8) | 29 (25,9, 31,8) | 12 (8,2, 16,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- En général, les relations avec le transcendant sont considérées comme le domaine spirituel le moins important, et ce pour tous les groupes de jeunes.
- Les jeunes TDIG sont moins nombreux que les filles et les garçons cisgenres à déclarer que les relations avec le transcendant sont importantes (13 % de la 6e à la 8e année; 12 % en 9e et 10e année).
Relations avec soi-même et santé mentale
| Genre | Année d'études | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisance familiale | Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | ||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,45 | 0,40 | -0,32 | -0,50 |
| Supérieure | 0,37 | 0,40 | -0,27 | -0,24 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,31 | 0,31 | -0,21 | -0,50 | |
| Supérieure | 0,27 | 0,31 | -0,21 | -0,22 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,51 | 0,47 | -0,32 | -0,38 |
| Supérieure | 0,41 | 0,42 | -0,31 | -0,32 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,35 | 0,48 | -0,33 | -0,32 | |
| Supérieure | 0,35 | 0,34 | -0,24 | -0,21 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,39 | 0,46 | -0,28 | -0,36 |
| 9e et 10e année | 0,28 | 0,37 | NS | -0,22 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,40 | 0,41 | NS | -0,48 | |
| Supérieure | 0,34 | 0,43 | -0,20 | -0,27 | ||
| Résultat global | 0,38 | 0,39 | -0,28 | -0,28 | ||
- Pour toutes les catégories d'élèves, les relations avec soi-même sont systématiquement associées à une satisfaction à l'égard de la vie et à un bien-être plus positifs, et sont corrélées négativement avec la solitude et les problèmes de santé.
- Les relations avec soi-même sont plus fortement associées aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Pour les jeunes dont la famille est moins aisée, les relations avec soi-même sont modérément associées aux indicateurs de santé mentale positifs.
Relations avec les autres et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,31 | 0,32 | -0,09 | -0,36 |
| Supérieure | 0,24 | 0,28 | -0,14 | -0,12 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,30 | 0,29 | -0,19 | -0,47 | |
| Supérieure | 0,18 | 0,19 | -0,07 | -0,11 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,47 | 0,46 | -0,24 | -0,29 |
| Supérieure | 0,25 | 0,30 | -0,17 | -0,20 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,17 | 0,34 | -0,12 | -0,22 | |
| Supérieure | 0,23 | 0,26 | -0,14 | -0,13 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,27 | 0,26 | NS | -0,12 |
| 9e et 10e année | NS | 0,23 | NS | NS | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | 0,24 | NS | -0,19 | |
| Supérieure | 0,20 | 0,24 | NS | -0,08 | ||
| Résultat global | 0,24 | 0,26 | -0,12 | -0,14 | ||
- Pour toutes les catégories d'élèves, les relations avec les autres sont associées positivement aux indicateurs de santé mentale positifs et associées négativement aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Les relations avec les autres sont plus fortement associées aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée présentent des corrélations positives modérées entre les relations avec les autres et les indicateurs de santé mentale positifs.
- Pour les jeunes TDIG, les relations avec les autres sont plus fortement corrélées avec le bien-être qu'avec les autres indicateurs de santé mentale.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- De 55 à 60 % des jeunes cisgenres déclarent que les relations avec soi-même sont un aspect important pour eux. Ce résultat est encourageant compte tenu de l'importance de ces relations en tant que facteur prédictif d'indicateurs de santé mentale positifs.
- Les filles cisgenres font état de niveaux relativement élevés par rapport à l'importance des relations avec les autres. Ce résultat est encourageant étant donné que les relations avec les autres sont corrélées avec la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être.
Sujets de préoccupation
- Pour trois des quatre aspects de la spiritualité (relations avec soi-même, relations avec les autres, relations avec le transcendant), les jeunes TDIG sont moins enclins que leurs pairs cisgenres à déclarer que ces relations sont importantes pour eux.
- Les élèves cisgenres de 9e et 10e année sont moins susceptibles que les élèves cisgenres de la 6e à la 8e année de déclarer que les relations avec la nature sont importantes pour eux. Un résultat à ne pas négliger, en raison de la valeur thérapeutique des liens avec la nature et avec l'environnement.
Chapitre 13 : La consommation de drogues et d'alcool
Les occasions de prendre de nouveaux risques augmentent au cours de l'adolescence, lors du passage de l'enfance à l'âge adulteRéférence 102. Pensons notamment à la consommation de cigarettes, d'alcool ou d'autres substancesRéférence 103. De même, les vapoteuses (aussi appelées cigarettes électroniques) continuent de gagner en popularité auprès des jeunesRéférence 104Référence 105. En outre, au Canada, de nombreux jeunes consomment de multiples substances en même tempsRéférence 106Référence 107. Les attitudes relatives à la consommation de drogues et d'alcool sont façonnées par les comportements des camarades et des adultes, par les médias et par les politiques publiquesRéférence 103.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, la consommation de drogues et d'alcool s'entend de la consommation de cigarettes, de l'utilisation de vapoteuses (ou cigarettes électroniques) et de la consommation d'alcool, de cannabis, de médicaments sur ordonnance pour obtenir une sensation d'euphorie et d'autres substances contrôlées. Les élèves de la 6e à la 10e année ont été invités à indiquer combien de jours ils avaient fumé une cigarette au cours des 30 derniers jours. Le vapotage est mesuré par l'utilisation déclarée d'une vapoteuse à quelque moment de la vie (selon une échelle qui va comme suit : « jamais », « 1-2 jours », « 3-5 jours », « 6-9 jours », « 10-19 jours », « 20-29 jours » ou « 30 jours ou plus »), ainsi qu'au cours des 30 derniers jours. Il est également demandé aux élèves d'indiquer où ils se procurent leur matériel à vapoteuse. Dans ce rapport, la consommation d'alcool est mesurée par le pourcentage d'élèves qui ont déjà été « vraiment ivres » au moins deux fois dans leur vie. Les élèves de 9e et 10e année doivent aussi faire part de leur consommation de cannabis (selon une échelle qui va comme suit : « jamais », « 1-2 jours », « 3-5 jours », « 6-9 jours », « 10-19 jours », « 20-29 jours », « 30 jours ou plus »), de leur consommation de drogues « dures » et de leur consommation de médicaments dans le but d'obtenir une sensation d'euphorie au cours des 12 derniers mois.
Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours
Figure 13.1. Élèves qui déclarent avoir fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 13.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 2 (1,2, 2,5) | 2 (1,6, 3,3) | 6 (2,9, 8,4) |
| 9e et 10e année | 6 (4,4, 7,1) | 7 (5,2, 8,0) | 7 (3,5, 10,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Un très faible nombre d'élèves déclarent avoir fumé au cours des 30 derniers jours, les proportions allant de 2 % chez les garçons et les filles cisgenres de la 6e à la 8e année à 6 ou 7 % chez les jeunes de 9e et 10e année, tous genres confondus.
Vapotage au moins une fois dans la vie
Figure 13.2. Élèves qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse (aussi appelée cigarette électronique) au moins une fois dans leur vie, selon l'année d'études et le genre (%)
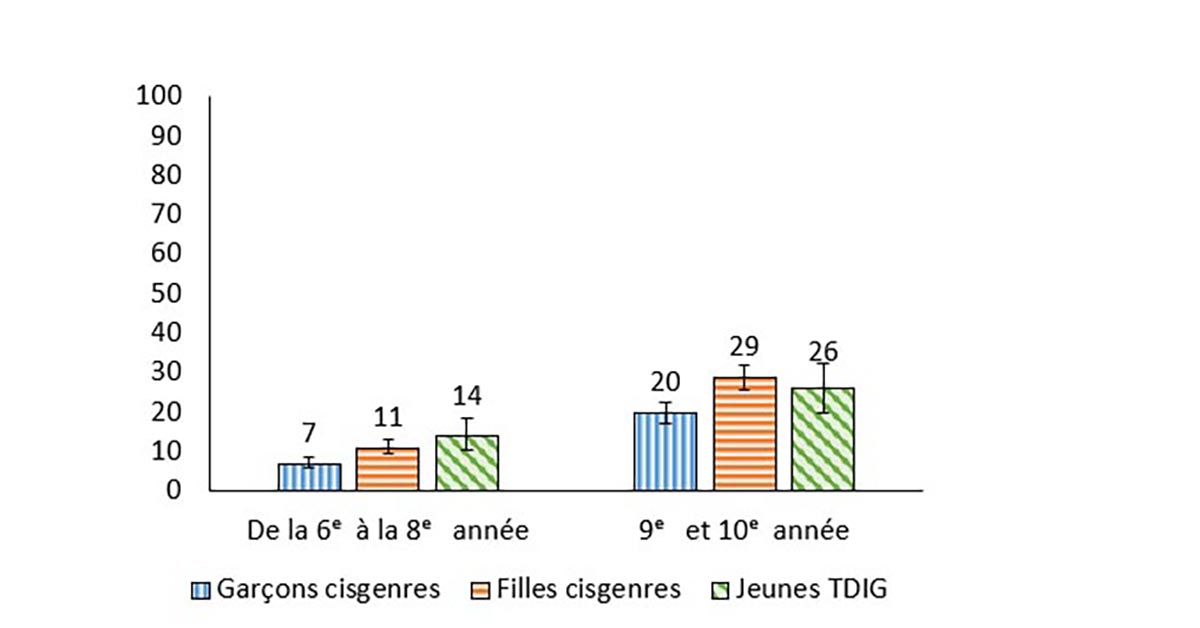
Figure 13.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 7 (5,7, 8,8) | 11 (9,3, 13,0) | 14 (10,4, 18,5) |
| 9e et 10e année | 20 (17,3, 22,3) | 29 (25,7, 32,1) | 26 (19,9, 32,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion d'élèves qui déclarent avoir vapoté au moins une fois dans leur vie augmente avec le nombre d'années d'études.
- Les filles cisgenres et les jeunes TDIG de 9e et 10e année enregistrent les plus grandes proportions d'élèves qui déclarent avoir vapoté au moins une fois dans leur vie.
Vapotage au cours des 30 derniers jours
Figure 13.3. Élèves qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse (aussi appelée cigarette électronique) au cours des 30 derniers jours, selon l'année d'études et le genre (%)
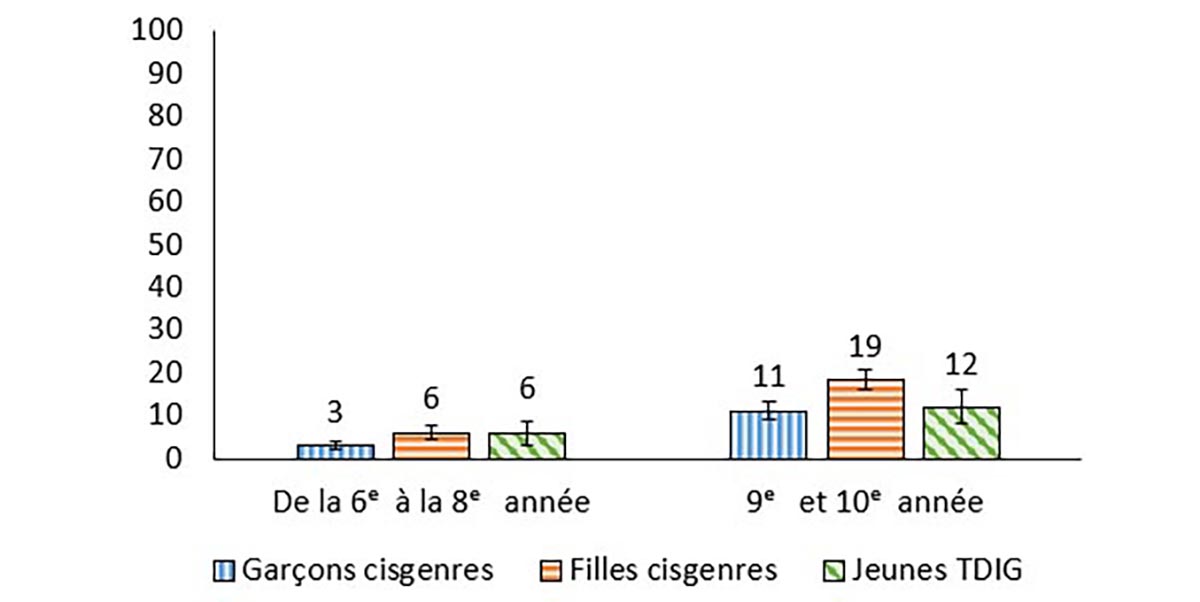
Figure 13.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 3 (2,3, 3,9) | 6 (4,6, 7,7) | 6 (3,2, 8,8) |
| 9e et 10e année | 11 (9,4, 13,2) | 19 (16,1, 21,1) | 12 (8,1, 16,4) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- C'est chez les élèves de 9e et 10e année, surtout les filles cisgenres, que le vapotage au cours des 30 derniers jours est le plus souvent déclaré.
« Je pense que (les tendances liées au vapotage) s'expliquent entre autres par le fait que les filles sont facilement influençables et qu'elles recherchent une validation... Ce peut dépendre de l'école où vous allez et des personnes qui s'y adonnent... mais il y a certainement une mode, comme l'était la cigarette à l'époque. »
Tendance chez les garçons quant au vapotage au moins une fois dans leur vie
Figure 13.4. Garçons qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse (aussi appelée cigarette électronique) au moins une fois dans leur vie, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 13.4 : Description textuelle
| L’année d’études | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 6e année | 3 | 7 | 5 |
| 7e année | 8 | 8 | 5 |
| 8e année | 10 | 16 | 13 |
| 9e année | 21 | 23 | 17 |
| 10e année | 26 | 28 | 24 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.
- En 2022, la proportion de garçons qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse au moins une fois dans leur vie a diminué par rapport au cycle 2018 de l'enquête HBSC.
- Chez les garçons, l'utilisation d'une vapoteuse au moins une fois dans leur vie augmente avec le nombre d'années d'études.
Tendance chez les filles quant au vapotage au moins une fois dans leur vie
Figure 13.5. Filles qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse (aussi appelée cigarette électronique) au moins une fois dans leur vie, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)
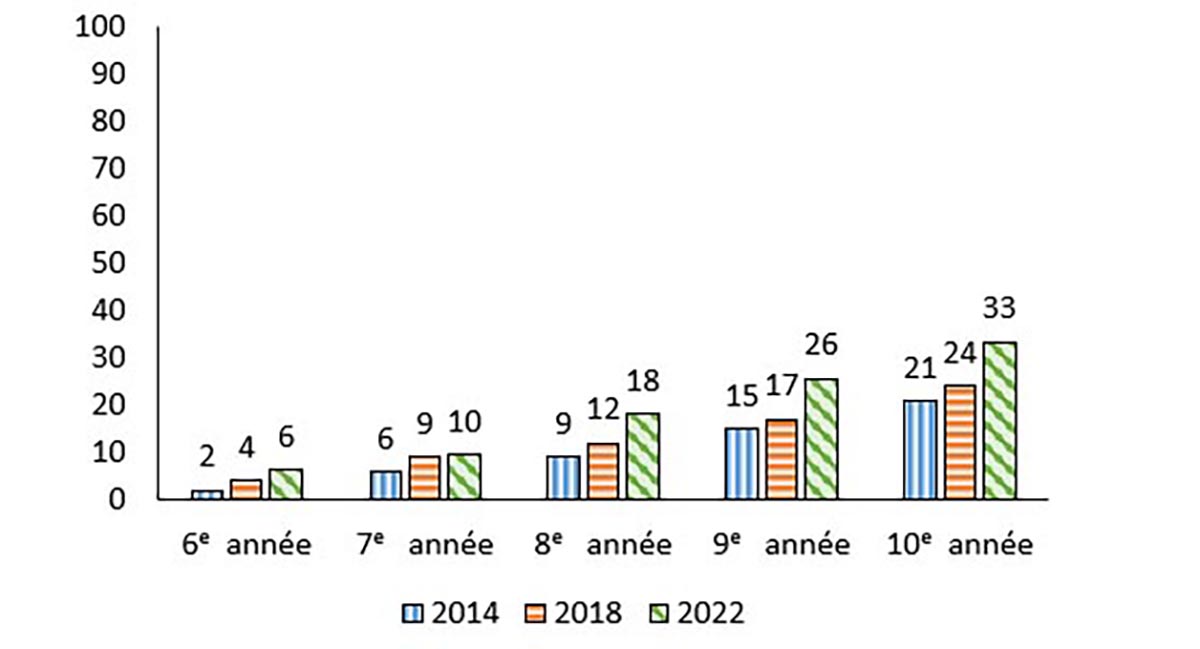
Figure 13.5 : Description textuelle
| L’année d’études | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 6e année | 2 | 4 | 6 |
| 7e année | 6 | 9 | 10 |
| 8e année | 9 | 12 | 18 |
| 9e année | 15 | 17 | 26 |
| 10e année | 21 | 24 | 33 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.
- La proportion de filles qui déclarent avoir utilisé une vapoteuse au moins une fois dans leur vie a augmenté de façon constante au cours des trois derniers cycles d'enquête.
- Cette proportion augmente également avec le nombre d'années d'études.
« Quand je vais aux toilettes, j’ai de la difficulté à me frayer un chemin parmi les filles qui vapotent. »
Approvisionnement en matériel à vapoteuse
| Élément d'enquête | 9e et 10e année | ||
|---|---|---|---|
| Filles cisgenres | Garçons cisgenres | Total | |
| Je l'achète moi-même dans une boutique de vapotage | 3 | 9 | 6 |
| Je l'achète moi-même dans un commerce (p. ex. un dépanneur) | 1 | 4 | 2 |
| Je l'achète sur Internet (y compris les applis) | 2 | 1 | 2 |
| Je demande à quelqu'un de l'acheter pour moi | 29 | 12 | 22 |
| Un membre de la famille me le donne | 6 | 7 | 6 |
| Un ami ou une amie me le donne | 27 | 24 | 26 |
| Quelqu'un d'autre me le donne | 12 | 14 | 13 |
| J'utilise la vapoteuse de quelqu'un sans sa permission | 2 | 2 | 2 |
| Autre | 18 | 27 | 21 |
Remarque : Les résultats pour les jeunes TDIG ne sont pas affichés dans le tableau 13.1 compte tenu de la taille des cellules.
- Une proportion de 54 % des élèves ont reçu une vapoteuse d'une autre personne, notamment d'un membre de leur famille, d'amis ou de quelqu'un d'autre. De même, 10 % des élèves se sont eux-mêmes procuré une vapoteuse, soit dans un commerce, soit en ligne.
- Chez les filles cisgenres, les méthodes les plus fréquentes pour obtenir une vapoteuse sont de demander à quelqu'un de leur en acheter une ou de la recevoir d'un ou d'une amie.
- Chez les garçons cisgenres, la méthode la plus fréquente pour obtenir une vapoteuse est de la recevoir d'un ou d'une amie.
Ivresse au moins deux fois dans la vie
Figure 13.6. Élèves qui déclarent avoir été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 13.6 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 3 (2,1, 3,6) | 4 (2,6, 4,6) | 5 (2,7, 7,8) |
| 9e et 10e année | 15 (12,6, 17,8) | 19 (16,3, 21,5) | 14 (8,9, 18,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Le pourcentage de jeunes qui déclarent avoir été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie augmente avec le nombre d'années d'études. Ainsi, 3 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année disent qu'ils ont déjà été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie, proportion qui atteint 15 % chez leurs pairs de 9e et 10e année. De même, 4 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année disent qu'elles ont déjà été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie, proportion qui atteint 19 % chez leurs pairs de 9e et 10e année. Enfin, 5 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année déclarent qu'ils ont déjà été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie, proportion qui atteint 14 % chez leurs pairs de 9e et 10e année.
Tendances quant à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois
Figure 13.7. Élèves de 9e et 10e année qui déclarent avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le genre et l'année d'enquête (%)

Figure 13.7 : Description textuelle
| Genre | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons | 37 | 28 | 28 | 20 | 17 | 16 |
| Filles | 31 | 28 | 26 | 21 | 17 | 20 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » ou comme des « garçons » dans tous les cycles.
- Au fil des six derniers cycles d'enquête, il y a eu diminution de la proportion d'élèves qui déclarent avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, sauf en 2022 chez les filles, qui affichent une hausse de 3 % par rapport à 2018.
- En 2022, 20 % des filles déclarent avoir consommé du cannabis, contre une proportion de 16 % chez les garçons, ce qui représente un écart de 4 points de pourcentage. Il s'agit du plus grand écart selon le genre depuis 2002, où 6 % plus de garçons que de filles avaient déclaré avoir consommé du cannabis.
Consommation de drogues ou de médicaments pour obtenir une sensation d'euphorie
| Élément d'enquête | 9e et 10e année | ||
|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Médicament sur ordonnance (p. ex. Vicodin, Ritalin, Ativan) | 5 | 6 | 4 |
| Médicament en vente libre (p. ex. médicaments contre la toux et le rhume) | 9 | 10 | 10 |
| Hallucinogènes (p. ex. LSD, champignons magiques, PCP) | 6 | 5 | 7 |
| Autre drogue (p. ex. speed, crystal meth) | 2 | 2 | 3 |
| Autre substance (p. ex. essence, colle) | 3 | 1 | 6 |
- Entre 1 et 10 % des élèves de 9e et 10e année déclarent avoir consommé une ou plusieurs drogues et/ou un ou plusieurs médicaments pour obtenir une sensation d'euphorie.
- Tous genres confondus, la substance la plus fréquemment utilisée pour obtenir une sensation d'euphorie est le médicament en vente libre (médicaments contre la toux et le rhume).
Vapotage au moins une fois dans la vie et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,20 | -0,22 | 0,17 | 0,26 |
| Supérieure | -0,18 | -0,14 | 0,13 | 0,15 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | 0,18 | -0,16 | 0,22 | 0,36 | |
| Supérieure | 0,13 | -0,05 | 0,09 | 0,16 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | -0,27 | -0,21 | 0,19 | 0,29 |
| Supérieure | -0,25 | -0,19 | 0,19 | 0,28 | ||
| 9e et 10e année | Moindre | -0,34 | -0,26 | 0,34 | 0,52 | |
| Supérieure | 0,27 | -0,19 | 0,25 | 0,34 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,15 | -0,11 | 0,16 | 0,09 |
| 9e et 10e année | -0,14 | -0,19 | 0,14 | 0,19 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | NS | NS | NS | NS | |
| Supérieure | 0,09 | -0,17 | 0,12 | 0,13 | ||
| Résultat global | -0,24 | -0,19 | 0,21 | 0,29 | ||
- Dans l'ensemble, le vapotage est associé à une réduction des niveaux positifs de santé mentale et à des niveaux plus élevés des indicateurs de santé mentale négatifs.
- Chez les garçons cisgenres, les plus fortes relations entre le vapotage et les indicateurs de santé mentale sont enregistrées chez les garçons dont la famille est moins aisée sur le plan matériel.
- Dans l'ensemble, c'est chez les filles cisgenres que s'observent les corrélations les plus fortes entre le vapotage et les indicateurs de santé mentale. Chez les filles de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée, il y a une corrélation positive modérée entre le vapotage et les problèmes de santé.
- Fait intéressant : dans certains groupes, il y a une corrélation positive entre le vapotage et la satisfaction à l'égard de la vie. Ce lien devra fait l'objet d'études plus approfondies.
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | ||||
| Garçons cisgenres | 9e et 10e année | Moindre | -0,32 | -0,24 | 0,32 | 0,43 | |
| Supérieure | -0,12 | -0,05 | 0,07 | 0,15 | |||
| Filles cisgenres | Moindre | -0,24 | -0,21 | 0,24 | 0,38 | ||
| Supérieure | 0,26 | -0,16 | 0,21 | 0,30 | |||
| Jeunes TDIG | 9e et 10e année | Les deux catégories d'aisance familiale | NS | -0,10 | NS | NS | |
| Moindre | 0,30 | 0,30 | NS | -0,28 | |||
| Supérieure | NS | 0,11 | NS | NS | |||
| Résultat global | -0,20 | -0,13 | 0,16 | 0,24 | |||
- Dans l'ensemble, la consommation de cannabis est associée de manière non constante aux indicateurs de santé mentale positifs ainsi qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Les plus fortes associations entre la consommation de cannabis et les indicateurs de santé mentale sont enregistrées chez les élèves dont la famille est moins aisée sur le plan matériel.
- Une corrélation positive modérée entre la consommation de cannabis et les problèmes de santé est enregistrée chez les garçons cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée.
- Une corrélation faible entre la consommation de cannabis et tous les indicateurs de santé mentale est enregistrée chez les filles cisgenres dont la famille est moins aisée. Chez les filles cisgenres dont la famille est plus aisée, il y a une association positive entre la consommation de cannabis et la satisfaction à l'égard de la vie.
- Chez les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée, on observe une corrélation positive faible entre la consommation de cannabis et les indicateurs de santé mentale positifs, et une corrélation négative faible entre la consommation de cannabis et les problèmes de santé.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- En comparaison avec les années précédentes, les garçons sont moins nombreux à déclarer avoir déjà utilisé une vapoteuse.
- Toute consommation de cigarettes est préoccupante. Tout de même, moins de 8 % des jeunes canadiens déclarent avoir fumé au cours des 30 derniers jours.
Sujets de préoccupation
- Il y a augmentation du nombre de filles qui déclarent avoir vapoté au cours des 30 derniers jours ou au cours de leur vie, ou avoir consommé du cannabis, une tendance qui diffère grandement de celle des garçons. La hausse du vapotage chez les filles est très inquiétante.
- Le vapotage et la consommation de cannabis sont tous deux plus fortement corrélés avec les indicateurs de santé mentale négatifs.
Chapitre 14 : La santé sexuelle
Durant l'adolescence, les jeunes peuvent commencer à adopter des comportements sexuels et à chercher à établir des relations avec des partenairesRéférence 108. Pour accompagner les jeunes dans ce nouvel aspect de leur santé, il est essentiel de leur apporter un soutien, de les éduquer et de leur fournir des ressources. Bien que les programmes d'éducation à la santé sexuelle varient d'un endroit à l'autre du Canada, une enquête nationale a révélé que la majorité des parents sont d'accord pour que l'éducation à la santé sexuelle soit offerte à l'école et qu'une grande variété de sujets y soient abordésRéférence 109. En outre, les jeunes eux-mêmes ont exprimé le souhait d'en savoir plus sur la santé sexuelle et sur les relationsRéférence 110Référence 111.
Les cycles précédents de l'enquête HBSC ont révélé que certains facteurs contextuels, tels qu'une structure familiale perturbée et un faible soutien familial, se reflètent par une activité sexuelle précoceRéférence 112. Bien que les activités sexuelles ne soient pas malsaines en soi, les personnes qui s'y adonnent à un plus jeune âge présentent des taux plus élevés d'infections sexuellement transmissibles, un plus grand nombre de partenaires sexuels au cours de leur vie et une plus grande probabilité de connaître une grossesse non planifiéeRéférence 113.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, les élèves de 9e et 10e année font état de leurs comportements en matière de santé sexuelle. Les élèves indiquent par quel(s) genre(s) ils se sentent attirés, s'ils ont eu des relations sexuelles, s'ils utilisent des moyens de contraception et s'ils pratiquent le sextage. Pour les besoins de l'enquête, les sextos se définissent comme étant « du contenu écrit, des photos ou des vidéos de soi sexuellement explicites qui sont transmis par des plateformes technologiques (p. ex. messages textes, iMessage, Snapchat, Instagram) ». L'une des mesures du sextage est le nombre de fois au cours des 12 derniers mois où les élèves ont ressenti une pression pour envoyer des sextos. Les réponses possibles sont : « jamais », « 1-3 fois », « 4-10 fois » et « plus de 10 fois ».
Tendances en matière de relations sexuelles
Figure 14.1. Élèves de 9e et 10e année qui déclarent avoir eu des relations sexuelles, selon le genre et l'année d'enquête (%)

Figure 14.1 : Description textuelle
| Genre | L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons | 9e année | 19 | 19 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 10e année | 27 | 25 | 31 | 28 | 25 | 22 | |
| Filles | 9e année | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 10e année | 25 | 27 | 31 | 29 | 27 | 23 | |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |
|||||||
Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » ou des « filles » dans tous les cycles.
- On observe au fil du temps une diminution dans les pourcentages de jeunes qui déclarent avoir eu des relations sexuelles. En 2022, 10 % des jeunes de 9e année, 22 % des filles de 10e année et 23 % des garçons de 10e année déclarent avoir eu des relations sexuelles, ce qui représente les pourcentages les plus bas jamais enregistrés depuis le début de la collecte de données sur les tendances en matière de relations sexuelles pour l'enquête HBSC.
- Dans l'ensemble, plus de jeunes de 10e année que de jeunes de 9e année indiquent avoir eu des relations sexuelles.
Utilisation de moyens de contraception
Figure 14.2. Élèves de 9e et 10e année sexuellement actifs qui déclarent avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur dernière relation sexuelle, selon le genre (%)

Figure 14.2 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres |
|---|---|---|
| Condoms | 62 (54,8, 68,6) | 57 (51,4, 63,5) |
| Pilule contraceptive | 38 (31,0, 45,2) | 40 (33,7, 46,2) |
| Autre moyen de contraception | 14 (9,0, 18,1) | 10 (6,5, 14,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
||
- Le type le plus fréquent de moyen de contraception indiqué par les jeunes cisgenres qui sont sexuellement actifs est le condom (62 % des garçons cisgenres et 57 % des filles cisgenres).
- En raison des chiffres trop faibles, il n'est pas possible d'indiquer les moyens de contraception utilisés par les jeunes TDIG.
Attirances des élèves
| Élément d'enquête | 9e et 10e année | ||
|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Attirance envers les garçons cisgenres | 6 | 86 | 65 |
| Attirance envers les filles cisgenres | 92 | 20 | 68 |
| Attirance envers les jeunes TDIG | 2 | 6 | 60 |
| Aucune attirance | 2 | 2 | 9 |
| Ne sait pas | 3 | 9 | 13 |
Remarque : Les catégories ne sont pas mutuellement exclusives, les jeunes ayant la possibilité de cocher plus d'une option.
- La majorité des garçons cisgenres sont attirés par les filles cisgenres (92 %) et la majorité des filles cisgenres sont attirées par les garçons cisgenres (86 %).
- Chez les filles cisgenres, 20 % sont attirées par les personnes qui ont la même identité de genre. Chez les garçons cisgenres, 6 % sont attirés par les personnes qui ont la même identité de genre.
- Chez les jeunes TDIG, 65 % sont attirés par les garçons cisgenres, 68 % sont attirés par les filles cisgenres et 60 % sont attirés par les jeunes TDIG. Les jeunes TDIG ont vraisemblablement coché plus d'une option pour indiquer leur attirance.
- Entre 2 et 9 % des jeunes indiquent n'éprouver aucune attirance.
Envoi non consensuel de sextos
Figure 14.3. Élèves de 9e et 10e année qui font état de l'envoi de sextos à une autre personne sans consentement de l'expéditeur initial (victimes ou auteurs), selon le genre (%)
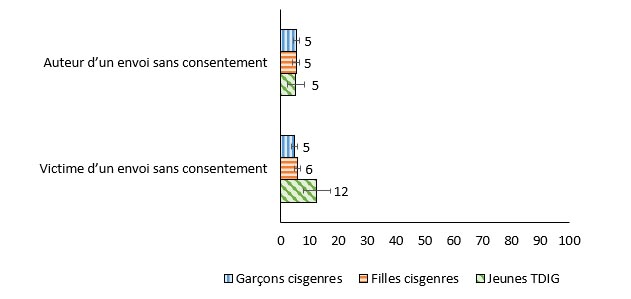
Figure 14.3 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| Auteur d’un envoi sans consentement | 5 (4,4, 6,5) | 5 (4,1, 6,4) | 5 (2,2, 8,2) |
| Victime d’un envoi sans consentement | 5 (3,7, 6,0) | 6 (4,6, 6,8) | 12 (7,7, 17,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Dans l'ensemble, 5 % des jeunes déclarent avoir envoyé à une autre personne un sexto sans consentement de l'auteur initial.
- Un pourcentage de 12 % des jeunes TDIG indiquent qu'un de leur sexto a été envoyé à une autre personne sans leur consentement, ce qui correspond à 7 points de pourcentage de plus que pour les garçons cisgenres et à 6 points de pourcentage de plus que pour les filles cisgenres.
Pratiques de sextage
Figure 14.4. Élèves de 9e et 10e année qui font état des pratiques de sextage
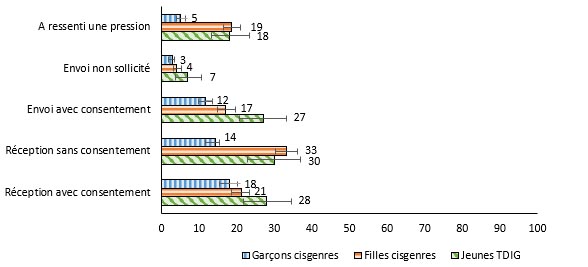
Figure 14.4 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| A ressenti une pression | 5 (4,0, 6,4) | 19 (16,5, 20,1) | 18 (13,4, 23,5) |
| Envoi non sollicité | 3 (1,8, 3,4) | 4 (3,2, 5,3) | 7 (3,8, 10,7) |
| Envoi avec consentement | 12 (9,8, 13,5) | 17 (15,0, 19,6) | 27 (20,8, 33,2) |
| Réception sans consentement | 14 (11,7, 15,4) | 33 (30,3, 36,1) | 30 (23,0, 37,0) |
| Réception avec consentement | 18 (15,5, 20,1) | 21 (18,7, 23,4) | 28 (21,9, 34,6) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- En général, les filles cisgenres et les jeunes TDIG affichent des pourcentages supérieurs d'envoi et de réception de sextos par rapport aux garçons cisgenres.
- Un pourcentage de 5 % des garçons cisgenres indiquent avoir ressenti une pression pour envoyer un sexto; ce pourcentage s'élève à 18 % chez les jeunes TDIG et à 19 % chez les filles cisgenres.
- Chez les jeunes TDIG, 7 % indiquent avoir envoyé un sexto non sollicité à une autre personne, ce qui correspond à 4 points de pourcentage de plus que pour les garçons cisgenres.
- Entre 12 et 27 % des jeunes affirment avoir envoyé un sexto avec consentement du ou de la destinataire. Le pourcentage chez les jeunes TDIG s'élève à 27 %, une proportion de 10 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et de 15 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres.
- Chez les filles cisgenres, 33 % indiquent avoir reçu un sexto sans consentement; ce pourcentage s'élève à 30 % chez les jeunes TDIG et à 14 % chez les garçons cisgenres.
- Chez les jeunes TDIG, 28 % indiquent avoir reçu un sexto avec leur consentement, contre 21 % des filles cisgenres et 18 % des garçons cisgenres.
« Ça ne m’a pas surpris de voir que les garçons affichent les résultats les plus bas [en ce qui concerne le sextage]. C’est logique compte tenu de la façon dont les genres sont perçus par la société… et les filles sont plus sexualisées. »
Pression pour envoyer des sextos et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | 9e et 10e année | Inférieure | -0,33 | -0,28 | 0,30 | 0,31 |
| Supérieure | -0,10 | -0,05 | 0,08 | 0,09 | ||
| Filles cisgenres | 9e et 10e année | Inférieure | NS | -0,13 | 0,18 | 0,38 |
| Supérieure | -0,21 | -0,14 | 0,25 | 0,28 | ||
| Jeunes TDIG | 9e et 10e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,10 | -0,11 | 0,20 | 0,21 |
| Inférieure | NS | NS | 0,39 | 0,36 | ||
| Supérieure | -0,17 | -0,11 | 0,16 | 0,17 | ||
| Résultat global | -0,20 | -0,16 | 0,23 | 0,28 | ||
- Dans l'ensemble, la pression pour envoyer des sextos est associée à une moins grande satisfaction à l'égard de la vie, à un bien-être inférieur, à la solitude et aux problèmes de santé.
- La pression pour envoyer des sextos est plus fortement associée aux indicateurs de santé mentale négatifs qu'aux indicateurs de santé mentale positifs.
- En ce qui concerne les garçons cisgenres, ceux dont la famille est moins aisée affichent les corrélations les plus fortes entre la pression pour envoyer des sextos et les indicateurs de santé mentale.
- C'est l'inverse chez les filles cisgenres : celles dont la famille est plus aisée affichent les corrélations les plus fortes entre la pression pour envoyer des sextos et les indicateurs de santé mentale.
- Pour les jeunes TDIG, la pression pour envoyer des sextos est plus fortement associée à la solitude et aux problèmes de santé qu'à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Les garçons cisgenres et les filles cisgenres affichent des taux sensiblement similaires d'utilisation de moyens contraceptifs.
Sujets de préoccupation
- Les filles cisgenres et les jeunes TDIG sont plus susceptibles d'envoyer et de recevoir des sextos que les garçons cisgenres.
- On constate que 5 % des jeunes ont envoyé à une autre personne un sexto sans consentement de l'auteur initial.
- Entre 5 et 19 % des jeunes ressentent une pression pour envoyer des sextos. Ce résultat est particulièrement préoccupant en raison des corrélations avec la santé mentale.
Chapitre 15 : L'utilisation des médias sociaux
L'accès à Internet et son utilisation fréquente sont devenus particulièrement courants dans la société canadienne, certains rapports indiquant que près de 100 % des adolescents et adolescentes ont utilisé Internet au cours des trois derniers mois et que 92 % utilisent régulièrement les médias sociauxRéférence 114. La technologie offre aux jeunes de nombreux avantages tels que l'accès à l'information sur la santéRéférence 119Référence 120Référence 121, un espace non traditionnel pour trouver du soutienRéférence 121, et des plateformes pour créer et entretenir des liens sociauxRéférence 120. La pandémie de COVID-19 a entraîné chez les jeunes une augmentation du temps consacré aux médias numériques, notamment les médias sociaux, les jeux vidéo, la télévision et l'apprentissage en mode virtuelRéférence 115. Des niveaux plus élevés d'utilisation ont été associés à des niveaux plus élevés de dépression, d'anxiété, de problèmes d'attention, d'irritabilité et d'hyperactivitéRéférence 115Référence 116. Outre les symptômes psychologiques, les personnes dont l'utilisation des médias sociaux devient de plus en plus problématique présentent davantage de symptômes somatiques, notamment des maux de tête, des vertiges, des maux de dos, des maux d'estomac et des douleurs au cou et aux épaules, ce qui correspond à des problèmes psychosomatiquesRéférence 117Référence 118. Un intérêt particulier est porté à l'étude des jeunes qui présentent des tendances problématiques en matière d'utilisation des médias sociaux, qui se traduisent par des symptômes correspondant à une dépendanceRéférence 122. En outre, il semble également exister une relation entre l'utilisation des médias sociaux et les comportements à risque tels que la consommation de substances et les activités sexuelles à risqueRéférence 123.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, l'utilisation problématique des médias sociaux est mesurée sur une échelle continue composée de 9 éléments, dont le score se situe entre 0 (faible) et 9 (élevé). Dans ce cycle de l'enquête, on a invité les jeunes à indiquer le nombre de fois où les médias sociaux ont facilité leur participation à des comportements à risque. Afin de déterminer les corrélations entre les comportements à risque contemporains et la santé mentale dans le tableau 15.2, on a utilisé l'échelle de la prise de risques contemporains, qui produit une gamme de valeurs allant de 0 (faible) à 10 (élevé).
Utilisation problématique des médias sociaux
Figure 15.1. Élèves qui font état d'une utilisation problématique des médias sociaux, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 15.1 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 7 (6,0, 8,2) | 12 (11,0, 13,8) | 21 (16,0, 25,1) |
| 9e et 10e année | 7 (5,2, 8,1) | 15 (13,7, 17,2) | 9 (4,9, 12,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- L'utilisation problématique des médias sociaux est plus élevée chez les filles cisgenres que chez les garçons cisgenres, peu importe l'année d'études.
- La proportion de jeunes TDIG qui font état d'une utilisation problématique des médias sociaux est moins grande chez les élèves de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année (21 % contre 9 %, un écart à la baisse de 12 points de pourcentage).
- Dans le groupe de la 6e à la 8e année, 21 % des jeunes TDIG font état d'une utilisation problématique des médias sociaux, ce qui correspond à 9 points de pourcentage de plus que chez les filles cisgenres et à 14 points de pourcentage de plus que chez les garçons cisgenres.
« Je crois que les jeunes TDIG recherchent une validation en ligne. »
Utilisation intensive des médias sociaux
Figure 15.2. Élèves qui font état d'une utilisation intensive des médias sociaux (contact en ligne « presque tout le temps, tout au long de la journée »), selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 15.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 29 (26,9, 30,9) | 40 (37,1, 42,1) | 32 (27,0, 37,3) |
| 9e et 10e année | 39 (35,9, 41,3) | 54 (51,1, 55,9) | 43 (36,3, 49,8) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion de jeunes qui font état d'une utilisation intensive des médias sociaux est plus grande chez les élèves de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année en ce qui concerne les garçons cisgenres (29 % contre 39 %, un écart à la hausse de 10 points de pourcentage) et en ce qui concerne les filles cisgenres (40 % contre 54 %, un écart à la hausse de 14 points de pourcentage).
- Dans le groupe de la 6e à la 8e année, 40 % des filles cisgenres font état d'une utilisation intensive des médias sociaux, ce qui correspond à 11 points de pourcentage de plus que pour les garçons cisgenres.
- Dans le groupe de 9e et 10e année, 54 % des filles cisgenres font état d'une utilisation intensive des médias sociaux, ce qui correspond à 15 points de pourcentage de plus que pour les garçons cisgenres et à 11 points de pourcentage de plus que pour les jeunes TDIG.
« Dans les médias sociaux, on voit que la plupart des choses ciblent les femmes. »
Comportements à risque contemporains
Figure 15.3. Adoption de comportements à risque contemporains facilités par les médias sociaux au moins 3 à 5 fois au cours des 12 derniers mois chez les jeunes de 9e et 10e année (%)

Figure 15.3 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| A adopté des comportements à risque découverts sur les médias sociaux | 13 (11,0, 15,0) | 30 (27,5, 32,7) | 21 (15,2, 25,8) |
| A rencontré en privé une personne inconnue après un contact sur un site de rencontre en ligne | 3 (2,2, 4,3) | 1 (0,7, 1,8) | 4 (1,2, 6,6) |
| A essayé d’atteindre une forme corporelle idéale en suivant un régime ou un programme d’exercices proposé dans les médias sociaux | 12 (10,2, 13,5) | 11 (9,0, 12,2) | 15 (10,6, 19,7) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- Une proportion de 30 % des filles cisgenres indiquent avoir essayé d'atteindre une forme corporelle idéale en suivant un régime ou un programme d'exercices proposé dans les médias sociaux; du côté des jeunes TDIG, cette proportion s'élève à 21 % et du côté des garçons cisgenres à 13 %.
- Entre 1 et 4 % des jeunes ont rencontré en privé une personne inconnue après un contact sur un site de rencontre en ligne.
- Entre 11 et 15 % des jeunes ont adopté des comportements à risque qu'ils ont découverts sur les médias sociaux.
Utilisation problématique des médias sociaux et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Inférieure | -0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,33 |
| Supérieure | -0,25 | -0,22 | 0,26 | 0,24 | ||
| 9e et 10e année | Inférieure | -0,17 | NS | 0,17 | NS | |
| Supérieure | -0,22 | -0,24 | 0,21 | 0,27 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Inférieure | -0,40 | -0,47 | 0,40 | 0,40 |
| Supérieure | -0,35 | -0,34 | 0,34 | 0,36 | ||
| 9e et 10e année | Inférieure | NS | -0,27 | 0,28 | 0,18 | |
| Supérieure | -0,21 | -0,21 | 0,27 | 0,21 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,25 | -0,27 | 0,29 | 0,24 |
| 9e et 10e année | -0,19 | -0,17 | 0,11 | 0,18 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Inférieure | -0,25 | -0,22 | 0,20 | 0,22 | |
| Supérieure | -0,21 | -0,25 | 0,22 | 0,21 | ||
| Résultat global | -0,31 | -0,32 | 0,33 | 0,34 | ||
- Une utilisation problématique des médias sociaux est associée à une plus faible satisfaction à l'égard de la vie et à des niveaux plus élevés d'indicateurs de santé mentale négatifs, pour tous les jeunes.
- Les garçons cisgenres dont la famille est plus aisée affichent des corrélations plus fortes entre l'utilisation problématique des médias sociaux et chacun des indicateurs de santé mentale par rapport aux garçons cisgenres dont la famille est moins aisée.
- Chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, celles dont la famille est moins aisée affichent des corrélations positives modérées entre l'utilisation problématique des médias sociaux et les indicateurs de santé mentale.
- Les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année affichent une corrélation plus forte entre l'utilisation problématique des médias sociaux et les indicateurs de santé mentale que les jeunes TDIG de 9e et 10e année.
Comportements à risque contemporains et santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | 9e et 10e année | Moindre | -0,23 | NS | 0,26 | 0,44 |
| Supérieure | -0,14 | -0,10 | 0,13 | 0,17 | ||
| Filles cisgenres | 9e et 10e année | Moindre | -0,21 | -0,23 | 0,36 | 0,41 |
| Supérieure | -0,24 | -0,18 | 0,29 | 0,31 | ||
| Jeunes TDIG | 9e et 10e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,18 | -0,10 | NS | 0,12 |
| Moindre | -0,32 | -0,36 | NS | NS | ||
| Supérieure | -0,12 | NS | NS | NS | ||
| Résultat global | -0,21 | -0,16 | 0,23 | 0,27 | ||
- Dans l'ensemble, les comportements à risque contemporains sont associés à des niveaux inférieurs d'indicateurs de santé mentale positifs, et à des niveaux supérieurs d'indicateurs de santé mentale négatifs.
- Pour les garçons cisgenres et les filles cisgenres de 9e et 10e année dont la famille est moins aisée, on observe une relation positive modérée entre les comportements à risque contemporains et les problèmes de santé.
- En général, lorsqu'on les compare aux filles cisgenres dont la famille est plus aisée, les filles cisgenres dont la famille est moins aisée affichent des corrélations plus fortes entre les comportements à risque contemporains et les indicateurs de santé mentale.
- De même, en ce qui concerne les jeunes TDIG, ceux dont la famille est moins aisée affichent des corrélations plus fortes entre les comportements à risque contemporains et les indicateurs de santé mentale positifs que ceux dont la famille est plus aisée.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Les garçons cisgenres font état des niveaux les plus bas d'utilisation problématique des médias sociaux, de la 6e à la 10e année.
Sujets de préoccupation
- Les filles cisgenres et les jeunes TDIG présentent les niveaux les plus élevés d'utilisation problématique des médias sociaux, sur la base de schémas d'utilisation qui reflètent une dépendance. Ce résultat est particulièrement préoccupant pour les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée, car elles présentent des corrélations modérées mais constantes entre une utilisation problématique des médias sociaux et les indicateurs de santé mentale.
- Les élèves cisgenres de 9e et 10e année sont plus susceptibles que leurs pairs plus jeunes de faire état d'une utilisation intensive des médias sociaux.
- De nombreux jeunes font état de comportements à risque contemporains. Le type de comportement à risque facilité par les médias sociaux le plus fréquent est la tentative d'atteindre une forme corporelle idéale en suivant un régime ou un programme d'exercices proposé dans les médias sociaux.
Chapitre 16 : La pandémie de Covid-19
Les effets de la pandémie de COVID-19 se sont fait sentir dans tous les groupes de populations au Canada, y compris chez les enfants et les jeunes. Si nombre d'entre eux étaient physiologiquement moins vulnérables au virus et à ses complications graves, ils ont tout de même vu leur routine interrompue, ont éprouvé une détresse psychologique importanteRéférence 124 et ont connu des changements dans la dynamique familiale qui, pour certains d'entre eux, se sont traduits par une augmentation des conflits ou de la violenceRéférence 125Référence 126. Les fermetures des établissements, les politiques de distanciation sociale et les mesures de quarantaine ont toutes entraîné une perte de liens sociauxNote de bas de page 4. Pour de nombreux jeunes, le fait de passer la majorité de leur temps à la maison a conduit à une diminution de l'activité physiqueRéférence 128Référence 129 et à une augmentation du temps d'écranRéférence 127Référence 129. La pandémie de COVID-19 a également eu une influence considérable sur de nombreux aspects de l'environnement scolaire des jeunes Canadiens et Canadiennes. L'apprentissage en ligne et les classes virtuelles ont été mis en place dans de nombreux endroits, posant des problèmes pour les jeunes, notamment un manque de soutien perçu de la part de l'écoleRéférence 130, un manque d'accès aux technologies numériquesRéférence 131 et des perturbations dans les habitudes scolairesRéférence 132.
En outre, la pandémie a exacerbé les inégalités en matière de santé. Par exemple, certains enfants vivant dans la pauvreté ont subi les effets délétères d'une pression financière accrue, telle que l'insécurité alimentaireRéférence 133. Les personnes vivant dans des logements insalubres ou en situation d'itinérance couraient un risque accru de contracter et de transmettre le virusRéférence 134. Des obstacles à l'accès au vaccin contre la COVID-19 existaient pour de nombreux groupes en quête d'équité, tels que ceux et celles qui s'identifient comme PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur, BIPOC en anglais) et/ou qui font partie de minorités sexuelles ou de genreRéférence 135Référence 136. Enfin, les différences sur le plan matériel ou structurel, telles que l'accès à un Internet stable et à un appareil fonctionnel, ont donné lieu à des expériences éducatives inéquitablesRéférence 137.
Description des éléments
Dans le cadre de l'enquête HBSC, on a interrogé les élèves sur la prévalence des résultats positifs à la COVID-19 dans leur famille, de même que sur leur statut vaccinal. Les élèves ont également indiqué les domaines de leur vie pour lesquels la pandémie avait entraîné des conséquences. Afin de rendre compte de l'association entre les conséquences de la pandémie de COVID-19 et la santé mentale, une échelle a été établie à partir des éléments du tableau 16.2 pour créer une plage de valeurs allant de 11 (faible) à 55 (élevé).
Prévalence de la Covid-19
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| L'élève a déjà été déclaré(e) positif(ve) à la COVID-19 | 54 | 53 | 48 | 53 | 56 | 46 |
| Quelqu'un de la famille proche a été déclaré positif à la COVID-19 | 79 | 82 | 83 | 80 | 83 | 79 |
| Si oui, l'une de ces personnes a été traitée à l'hôpital | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
- Entre 46 et 56 % des jeunes indiquent avoir été déclarés positifs à la COVID-19.
- Entre 79 et 83 % des jeunes indiquent qu'un membre de leur famille proche a été déclaré positif à la COVID-19.
- Parmi les jeunes qui répondent qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille proche ont été déclarés positifs à la COVID-19, entre 9 et 11 % indiquent qu'il y a eu traitement à l'hôpital.
Pourcentage d'élèves vaccinés
Figure 16.1. Statut vaccinal des élèves contre la COVID-19 (%)

Figure 16.1 : Description textuelle
| Élément d'enquête | Pourcentage |
|---|---|
| A reçu une dose | 8 |
| A reçu deux doses | 56 |
| A reçu trois doses | 15 |
| A reçu quatre doses ou plus | 5 |
| Pas de dose, mais aimerait se faire vacciner quand ce sera possible | 2 |
| Pas de dose, et ne veut pas se faire vacciner | 14 |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|
- Environ la moitié des jeunes (56 %) indiquent avoir reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.
- On constate que 2 % des jeunes n'ont pas été vaccinés contre la COVID-19, mais indiquent qu'ils aimeraient se faire vacciner quand ce sera possible.
- On observe que 14 % des jeunes n'ont pas été vaccinés contre la COVID-19 et ne veulent pas se faire vacciner.
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 : « ta vie dans son ensemble »
Figure 16.2. Élèves qui déclarent que la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences plutôt négatives ou très négatives relativement à l'aspect : « ta vie dans son ensemble », selon l'année d'études et le genre (%)
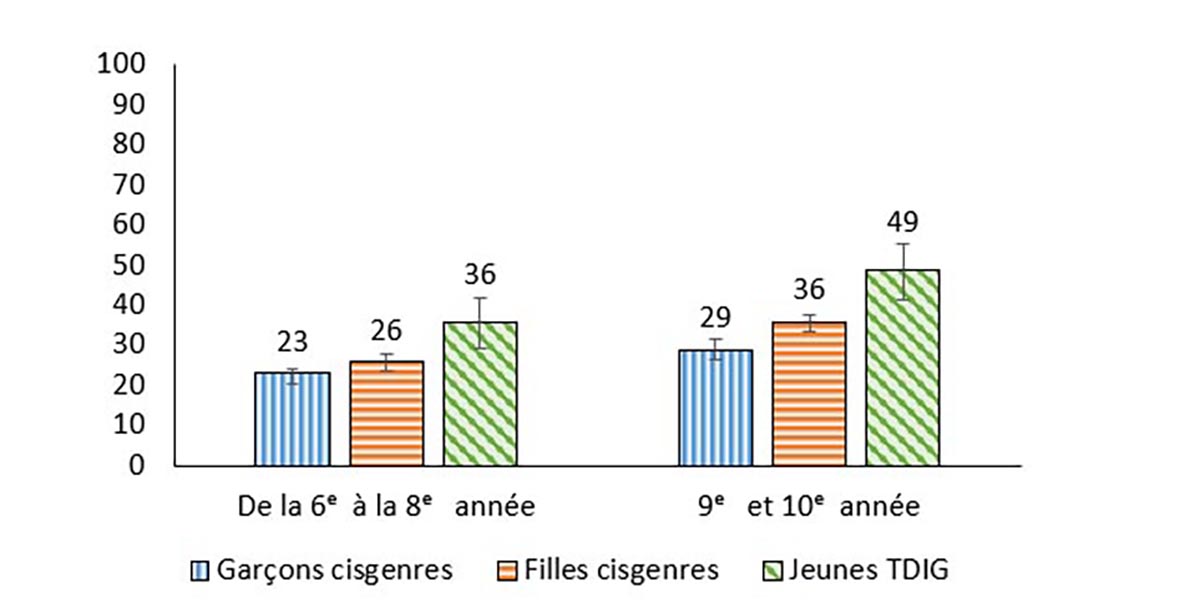
Figure 16.2 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 22.4 (20,6, 24,3) | 26 (23,8, 27,8) | 36 (29,3, 42,0) |
| 9e et 10e année | 28.9 (26,5, 31,4) | 35.5 (33,3, 37,7) | 48.6 (41,6, 55,3) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion d'élèves qui déclarent que leur vie dans son ensemble a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 est plus faible chez les élèves de la 6e à la 8e année que chez les élèves de 9e et 10e année pour les garçons cisgenres (23 % contre 29 %, une différence de 6 %) et pour les filles cisgenres (26 % contre 36 %, une différence de 10 %).
- Dans la catégorie de la 6e à la 8e année, 36 % des jeunes TDIG déclarent que leur vie dans son ensemble a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19, une proportion de 10 % supérieure à celle des filles cisgenres et de 13 % supérieure à celle des garçons cisgenres.
- En 9e et 10e année, les jeunes TDIG sont les plus nombreux à indiquer avoir eu le sentiment que leur vie dans son ensemble a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de la COVID-19 (49 %); ils sont suivis des filles cisgenres (36 %) et des garçons cisgenres (29 %).
« Beaucoup de gens ont été affectés négativement par la COVID-19. C'est ce que je pense parce que la plupart des personnes avec qui je parle de la COVID-19 disent qu'elles ont souffert de quelque chose ou qu'elles en souffrent encore (anxiété, solitude, difficulté à retrouver des compétences sociales) à cause de ça. »
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 : « ta santé mentale »
Figure 16.3. Élèves qui déclarent que la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences plutôt négatives ou très négatives relativement à l'aspect : « ta santé mentale (p. ex. gérer tes émotions, le stress, etc.) », selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 16.3 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 26 (24,5, 28,1) | 40 (37,7, 42,2) | 61 (55,0, 66,7) |
| 9e et 10e année | 34 (31,4, 36,2) | 59 (56,9, 61,4) | 67 (61,3, 73,5) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion d'élèves qui déclarent que leur santé mentale a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 est plus faible chez les élèves de la 6e à la 8e année que chez les élèves de 9e et 10e année pour les garçons cisgenres (26 % contre 34 %, une différence de 8 %) et pour les filles cisgenres (40 % contre 59 %, une différence de 19 %).
- En général, les garçons cisgenres sont les moins nombreux à déclarer que leur santé mentale a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19.
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, les jeunes TDIG sont les plus nombreux à déclarer que leur santé mentale a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 (61 %), suivis des filles cisgenres (40 %) et des garçons cisgenres (26 %).
- En 9e et 10e année, 34 % des garçons cisgenres indiquent que leur santé mentale a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19, une proportion inférieure de 25 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et inférieure de 33 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
« Je suis en 10e année. Ma santé mentale a écopé durant la pandémie de COVID-19. Et beaucoup de mes camarades ont des problèmes avec leur santé mentale. Je dirais que deux personnes sur cinq dans mes cercles sociaux ont des problèmes de santé mentale. Ça reflète mes expériences personnelles. »
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 : « activité physique »
Figure 16.4. Élèves qui déclarent que la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences plutôt négatives ou très négatives relativement à l'aspect : « ton activité physique (p. ex. sports, vélo, marche, etc.) », selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 16.4 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 28 (26,2, 30,3) | 30 (27,9, 31,7) | 45 (38,6, 51,5) |
| 9e et 10e année | 33 (30,0, 35,0) | 39 (36,0, 41,0) | 48 (41,7, 54,0) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- La proportion de filles cisgenres qui déclarent que leur activité physique a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 est plus faible chez celles de la 6e à la 8e année que chez celles de 9e et 10e année (30 % contre 39 %, une différence de 9 %).
- De la 6e à la 8e année, 45 % des jeunes TDIG déclarent que leur activité physique a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19, une proportion supérieure de 15 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et supérieure de 17 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.
- En 9e et 10e année, 48 % des jeunes TDIG déclarent que leur activité physique a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19, une proportion supérieure de 15 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres et supérieure de 9 points de pourcentage à celle des filles cisgenres.
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 : « ton sommeil »
Figure 16.5. Élèves qui déclarent que la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences plutôt négatives ou très négatives relativement à l'aspect : « ton sommeil », selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 16.5 : Description textuelle
| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 8e année | 23 (21,2, 24,9) | 34 (31,5, 35,9) | 55 (49,5, 60,7) |
| 9e et 10e année | 30 (27,4, 31,8) | 45 (42,7, 48,1) | 55 (48,0, 61,1) |
Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |
|||
- En général, les garçons cisgenres sont les moins nombreux à faire état de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur leur sommeil.
- La proportion d'élèves qui déclarent que leur sommeil a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 est plus faible chez les élèves de la 6e à la 8e année que chez les élèves de 9e et 10e année pour les garçons cisgenres (23 % contre 30 %, une différence de 7 %) et pour les filles cisgenres (34 % contre 45 %, une différence de 11 %).
- Dans la catégorie de la 6e à la 8e année, ce sont les jeunes TDIG qui sont les plus nombreux à déclarer que leur sommeil a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19 (55 %), suivis des filles cisgenres (34 %) et des garçons cisgenres (23 %).
- En 9e et 10e année, 30 % des garçons cisgenres déclarent que leur sommeil a subi des conséquences négatives en raison de la pandémie de COVID-19, une proportion inférieure de 15 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et inférieure de 25 points de pourcentage à celle des jeunes TDIG.
« Je pensais que le pourcentage réel de garçons cisgenres qui ont été touchés négativement par la COVID-19 serait d’environ 60 %, que ce soit du point de vue social (se faire des amis, sortir) ou mental (solitude, anxiété, isolement, etc.). »
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19
| Élément d'enquête | De la 6e à la 8e année | 9e et 10e année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |
| Ta santé | 20 | 23 | 31 | 24 | 32 | 44 |
| Tes relations avec ta famille | 14 | 19 | 29 | 14 | 21 | 33 |
| Tes relations avec tes amis | 21 | 22 | 30 | 22 | 29 | 29 |
| Tes résultats scolaires | 24 | 27 | 43 | 39 | 43 | 50 |
| Ce que tu as mangé ou bu | 17 | 23 | 33 | 23 | 36 | 43 |
| Tes attentes futures (p. ex. examens, emplois, etc.) | 16 | 19 | 28 | 19 | 27 | 35 |
| La situation financière de ta famille | 16 | 20 | 23 | 18 | 24 | 30 |
- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, l'élément « résultats scolaires » est l'aspect qui ressort le plus relativement aux conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 (24 % des garçons cisgenres; 27 % des filles cisgenres; 43 % des jeunes TDIG).
- De même, chez les élèves de 9e et 10e année, l'élément « résultats scolaires » est l'aspect qui ressort le plus (39 % des garçons cisgenres; 43 % des filles cisgenres; 50 % des jeunes TDIG).
- Dans l'ensemble, les jeunes TDIG sont plus nombreux que les jeunes cisgenres à indiquer que la pandémie a eu des conséquences négatives sur des aspects de leur vie.
Conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 sur « ta vie dans son ensemble » et la santé mentale
| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||
| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Inférieure | -0,10 | NS | NS | 0,19 |
| Supérieure | -0,16 | -0,18 | 0,14 | 0,11 | ||
| 9e et 10e année | Inférieure | -0,32 | -0,24 | 0,20 | 0,18 | |
| Supérieure | -0,31 | -0,31 | 0,21 | 0,20 | ||
| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Inférieure | -0,18 | -0,14 | 0,18 | 0,16 |
| Supérieure | -0,24 | -0,27 | 0,24 | 0,22 | ||
| 9e et 10e année | Inférieure | -0,16 | -0,28 | 0,36 | 0,27 | |
| Supérieure | -0,21 | -0,23 | 0,20 | 0,21 | ||
| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | -0,11 | -0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 9e et 10e année | -0,28 | -0,21 | 0,20 | 0,25 | ||
| Les deux catégories d'années d'études | Inférieure | -0,42 | -0,40 | 0,46 | 0,31 | |
| Supérieure | -0,15 | -0,18 | 0,15 | 0,21 | ||
| Résultat global | -0,24 | -0,25 | 0,23 | 0,22 | ||
Remarque : Certaines cellules ont été supprimées en raison de la faible taille des cellules et de la nécessité de respecter les règles éthiques. Par conséquent, les corrélations concernant les jeunes TDIG sont présentées séparément par catégories d'années d'études et catégories d'aisance familiale.
- Dans l'ensemble, les conséquences négatives de la COVID-19 sur la vie des élèves sont associées négativement aux indicateurs de santé mentale positifs et associés positivement aux indicateurs de santé mentale négatifs.
- Chez les garçons cisgenres, ce sont les plus âgés qui présentent les corrélations les plus fortes entre les conséquences négatives de la COVID-19 sur la vie des élèves dans son ensemble et les indicateurs de santé mentale.
- En ce qui concerne les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, lorsque comparées aux filles dont la famille est moins aisée, celles dont la famille est plus aisée présentent des corrélations plus fortes entre les conséquences négatives de la COVID-19 sur la vie des élèves dans son ensemble et les indicateurs de santé mentale.
- Dans l'ensemble, les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée présentent les corrélations les plus fortes entre les conséquences négatives de la COVID-19 sur la vie des élèves dans son ensemble et les indicateurs de santé mentale.
Résumé des conclusions
Constats encourageants
- Environ la moitié des jeunes (56 %) indiquent avoir reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 20 % des jeunes indiquent avoir reçu plus de deux doses de vaccin contre la COVID-19.
Sujets de préoccupation
- En général, les jeunes TDIG sont plus susceptibles que les élèves cisgenres de faire état de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur des aspects de leur vie.
- Les élèves cisgenres de 9e et 10e année sont plus susceptibles que leurs pairs de la 6e à la 8e année de faire état de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur leur vie dans son ensemble, leur santé mentale et leur sommeil.
Chapitre 17 : Points de vue et priorités des jeunes
Dans le cadre du présent rapport, les chercheurs et chercheuses de l'enquête HBSC ont sollicité l'avis des jeunes. Cette démarche est importante, car elle permet d'ancrer les résultats dans les expériences vécues par des jeunes issus de milieux et de contextes différents.
Le groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC est composé de 12 jeunes de tout le Canada. Ce groupe a été mis sur pied afin d'obtenir le point de vue des jeunes à des étapes clés de l'élaboration et de l'interprétation de l'enquête HBSC au Canada. Ses membres ont entre autres été appelés à donner leur avis sur l'importance de nouveaux éléments à inclure dans le questionnaire d'enquête, à participer à des groupes de discussion pour vérifier la clarté et la compréhension de certains éléments, à interpréter les résultats de l'étude et à donner des conseils pour les recherches en cours. Dans le cadre de cette démarche, il leur a été demandé de passer en revue chaque chapitre et de donner leur point de vue sur son contenu. Ils ont ainsi offert leurs réflexions (présentées sous forme de citations) afin que les lecteurs puissent « entendre leur voix » lors de la lecture des résultats de l'enquête.
Lors d'une rencontre récapitulative finale, il a été demandé aux jeunes conseillers et conseillères d'examiner les résultats de l'enquête dans leur ensemble, puis de classer les questions les plus importantes qui ont une incidence sur la santé et le bien-être des jeunes au Canada, mais de leur point de vue. Ce qui suit est un bref résumé de leurs observations, organisées de manière conceptuelle en fonction des idées et thèmes les plus importants qui ont émergé de nos discussions.
- La santé mentale reste une priorité majeure pour les jeunes, surtout après la pandémie de COVID-19. Cela s'applique particulièrement aux filles cisgenres et aux jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG) du Canada. Les jeunes expriment le besoin d'avoir plus de soutien et de services à l'école et dans la collectivité pour les aider à surmonter leurs problèmes de santé mentale.
« Je suis une fille cisgenre. J'ai l'impression que les résultats correspondent à mes expériences, mais qu'ils ne les représentent pas complètement. Je me sens plus seule, moins soutenue, moins acceptée, et je n'aime pas autant l'école parce que je ne peux pas explorer pleinement mes centres d'intérêt. Par contre, je suis aussi moins nerveuse et j'ai plus confiance en moi parce que je m'accepte davantage. »
- Les attentes liées au genre ont été l'une des principales questions soulevées par de nombreux membres du groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC. Ces attentes concernent les normes sociales associées au fait d'être un garçon cisgenre, une fille cisgenre ou un jeune TDIG dans la société canadienne. Beaucoup ressentent une pression d'avoir à se conformer à des rôles sexués stéréotypés qui déterminent leur façon de se comporter, et cette pression est ressentie comme ayant un effet négatif sur leur santé.
« Je m'attendais à ce que moins de garçons cisgenres déclarent se sentir seuls que de filles cisgenres. Je m'attendais à ça parce qu'en général, les garçons ne partagent pas autant leurs émotions et sont donc plus susceptibles de mentir à ce sujet. Je pense que les garçons cisgenres ressentent en fait autant de solitude que les filles cisgenres, mais qu'ils ne veulent pas l'admettre. »
- Les jeunes TDIG font état de moins bons résultats en matière de santé sur plusieurs plans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de relations positives solides à la maison, avec leurs amis et à l'école, et ils ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier. Pour la majorité des comportements liés à la santé, ce sont les jeunes TDIG qui éprouvent le plus de problèmes, qui sont probablement les moins reconnus et qui reçoivent le moins de soutien en tant que communauté.
« La question du genre est très déroutante, selon la façon dont tu as été élevé, et tu dois trouver où tu te situes dans tout ça. Et lorsque tu te rends compte des options limitées que tu as si tu ne t'identifies pas comme un garçon ou comme une fille, ça peut être vraiment déconcertant. Ça peut être éprouvant mentalement et émotionnellement. Essayer de trouver des gens qui te comprennent peut aussi être difficile. »
« N'ignorez pas les jeunes transgenres et de genre queer, et faites entendre leurs voix! Sincèrement, une jeune personne de genre queer de Québec. »
- Les médias sociaux influencent beaucoup les comportements et les expériences des jeunes en matière de santé. Certains jeunes ont indiqué que cette question est devenue encore plus importante durant la pandémie.
« Les médias sociaux ont une très grande influence sur tous ces thèmes. Par exemple, le régime alimentaire, la façon dont nous nous habillons, notre apparence… les médias sociaux peuvent influencer toutes ces choses. Les médias sociaux ont un impact sur presque tout ce qui est lié à la santé. »
- Les jeunes veulent plus de soutien et de liens à l'école, dans la collectivité et de la part des adultes qui les entourent. Les jeunes accordent une grande importance aux relations avec leurs pairs, leurs parents et leurs enseignants, et reconnaissent qu'elles jouent un rôle central dans leurs comportements. Les jeunes Canadiens et Canadiennes souhaitent que les adultes les soutiennent davantage et que leur école et leur collectivité soient des endroits sûrs pour eux. Ils estiment que le système scolaire et les autorités gouvernementales concernées pourraient faire davantage pour les soutenir.
« Je dirais aux directions d'école et aux dirigeants gouvernementaux qu'il faut s'occuper davantage des jeunes, qu'il s'agisse du vapotage dès la 6e année ou du fait de ne pas se sentir en sécurité dans son quartier, ce n'est pas acceptable. En tant que dirigeants, ils doivent agir, ne pas se contenter d'installer une affiche dans le couloir sur le sujet, mais vraiment travailler avec les élèves et établir un plan pour résoudre ces problèmes. »
- La prise de risque est en évolution, de nouvelles expressions de comportement remplaçant les anciennes (p. ex. le vapotage qui remplace le tabagisme, la cyberintimidation qui remplace l'intimidation en face à face) et de nouvelles expressions en ligne de comportements à risque apparaissant au fur et à mesure que les communications virtuelles deviennent la norme.
« Chaque fois que je vais aux toilettes, c'est difficile de circuler entre toutes les filles qui vapotent. »
Chapitre 18 : Messages et thèmes principaux
L'enquête HBSC permet de comprendre la santé et le bien-être des jeunes de la 6e à la 10e année au Canada et a pour objectif d'éclairer l'élaboration des politiques de santé et des programmes de promotion de la santé. Dans le présent rapport national, nous avons présenté les principaux résultats de l'enquête 2022-2023.
Le cycle 2022 de l'enquête HBSC était unique, car il a été mené après la pandémie de COVID-19 et nous a donc permis de fournir des données sur la situation des jeunes avant et après la pandémie. Deuxième caractéristique inédite de ce rapport : c'est la première fois que nous pouvons rendre compte des expériences de santé des jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG). Nous exposons dans le présent chapitre les principales conclusions de ce rapport et discutons des thèmes majeurs qui sont ressortis lors de l'examen des résultats dans leur ensemble.
Santé mentale
Par rapport aux filles cisgenres et aux jeunes TDIG, les garçons cisgenres présentent des niveaux relativement élevés d'indicateurs de santé mentale positifs (satisfaction à l'égard de la vie, confiance en soi) et des niveaux relativement faibles de mesures indiquant une mauvaise santé mentale (sentiment de nervosité, solitude, etc.). Un nombre inquiétant de filles cisgenres et de jeunes TDIG déclarent se sentir « tristes ou désespérés », « seuls », avoir des problèmes de santé associés à une mauvaise santé mentale et manquer de confiance en eux. Les jeunes TDIG sont les plus susceptibles de faire état de ces problèmes de santé mentale. En général, si l'on compare les résultats de l'enquête actuelle avec ceux des cycles précédents de l'enquête HBSC, on constate qu'au fil du temps, les filles et les garçons déclarent des résultats moins bons en matière de santé mentale.
Foyer et famille
La plupart des garçons cisgenres (p. ex. 85 % de la 6e à la 8e année) et des filles cisgenres (p. ex. 74 % de la 6e à la 8e année) font état d'une vie familiale heureuse. De leur côté, les jeunes TDIG font état d'une vie familiale plus difficile et qui leur offre moins de soutien, moins de la moitié d'entre eux et elles déclarant qu'il est facile de communiquer avec leurs parents et plus de la moitié de ceux et celles de 9e et 10e année indiquant vouloir partir de la maison. Une vie familiale heureuse et un bon soutien familial sont associés à une bonne santé mentale pour tous les jeunes, mais en particulier pour les jeunes dont la famille est moins aisée.
Amis
Moins de la moitié des jeunes indiquent avoir un soutien élevé de la part de leurs amis, mais sur une note plus positive, la majorité des jeunes disent qu'il leur est facile de parler avec leur meilleur(e) ami(e). La communication en ligne avec les amis est plus fréquente chez les filles cisgenres que chez les garçons cisgenres et les jeunes TDIG. Le soutien des amis est associé à une santé mentale positive, en particulier chez les filles cisgenres.
École
La plupart des jeunes déclarent aimer l'école et se sentir soutenus par leurs enseignants, bien que ces proportions soient moins élevées chez les jeunes TDIG. Seulement le quart des jeunes TDIG sont d'avis que les autres élèves de leur école les acceptent comme ils sont. Chez les garçons comme chez les filles, on constate au fil du temps une augmentation de la proportion d'élèves qui ressentent une pression en raison des travaux scolaires, la proportion la plus élevée se trouvant chez les filles. Un climat scolaire positif et la présence d'enseignants bienveillants sont associés à une santé mentale positive pour tous les jeunes.
Collectivité
On constate au fil du temps chez les filles une augmentation de la méfiance envers le quartier. Les jeunes TDIG sont moins susceptibles que les filles cisgenres d'affirmer qu'ils ont confiance dans les gens de leur quartier, et les filles cisgenres sont moins susceptibles que les garçons cisgenres d'afficher une telle confiance. Le soutien de la collectivité est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être pour tous les jeunes. Ces relations sont particulièrement marquées chez les jeunes TDIG et les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée.
Activité physique, temps d'écran et sommeil
La plupart des garçons cisgenres font état de niveaux d'activité physique élevés, et la majorité des jeunes cisgenres respectent les recommandations sur les heures de sommeil. Les filles cisgenres et les jeunes TDIG déclarent de faibles niveaux d'activité physique qui sont inquiétants, et les jeunes TDIG font état de niveaux élevés de troubles du sommeil (difficulté à s'endormir ou à rester endormi; somnolence diurne). La grande majorité des jeunes (entre 89 et 96 %) ne respectent pas la recommandation sur le temps d'écran quotidien.
Alimentation saine
On constate avec optimisme que la majorité des jeunes indiquent ne pas avoir été en situation d'insécurité alimentaire. L'utilisation d'un indice de la sécurité alimentaire révèle que 34 % des élèves font état d'une sécurité alimentaire faible et 9 % font état d'une sécurité alimentaire très faible. Plus les jeunes cisgenres avancent en âge, moins ils font état de pratiques alimentaires favorables à la santé, par exemple la prise du déjeuner et la prise de repas en famille. On observe une baisse de la fréquence de consommation de fruits et de légumes par rapport aux cycles d'enquête précédents, assortie d'une augmentation de la consommation de sucreries et de boissons gazeuses ordinaires. Dans l'ensemble, les jeunes TDIG font état des niveaux les plus bas de comportements alimentaires favorables à la santé.
Poids santé
La proportion de jeunes dont l'indice de masse corporelle correspond à la catégorie du surpoids ou de l'obésité est élevée (22 % pour les garçons cisgenres de 9e et 10e année et 30 % pour les filles cisgenres de 9e et 10e année). Au cours des six derniers cycles de l'enquête HBSC, la majorité des garçons et des filles ont affiché un poids normal et la proportion d'élèves dont l'indice de masse corporelle est classé dans la catégorie du surpoids ou de l'obésité est restée relativement stable. Les jeunes TDIG sont plus susceptibles que les jeunes cisgenres de se considérer comme trop gros ou trop grosses et de faire l'objet de moqueries en raison de leur poids.
Blessures et commotions cérébrales
On observe une diminution par rapport aux niveaux précédents de la proportion d'élèves déclarant avoir subi au cours des 12 derniers mois une blessure exigeant des soins médicaux, qui s'explique peut-être par la présence de la pandémie de COVID-19. Le fait que 1 jeune sur 10 ait subi une commotion cérébrale est préoccupant, en raison des effets à court et à long terme sur la santé et le bien-être.
Intimidation et violence en contexte amoureux
Moins d'élèves déclarent avoir été auteurs d'intimidation par rapport à 2018, mais la proportion de jeunes qui déclarent avoir été victimes d'intimidation a augmenté de 12 points de pourcentage. Les jeunes TDIG sont les plus susceptibles de déclarer avoir été victimes d'intimidation, peu importe la forme de celle-ci. Les cas d'intimidation sont préoccupants, car ils sont systématiquement associés à de moins bons résultats en matière de santé mentale.
Entre 5 et 22 % des jeunes déclarent avoir été victimes de violence en contexte amoureux. Les filles cisgenres et les jeunes TDIG sont plus susceptibles que les garçons cisgenres d'avoir fait l'objet de diverses formes de violence en contexte amoureux (contrôle/blessures émotionnelles; violence via les médias sociaux).
Santé spirituelle
Pour la plupart des jeunes cisgenres, les relations avec soi-même sont un aspect important. Ce résultat est encourageant, car le fait de considérer ces relations comme importantes est un facteur prédictif d'une santé mentale positive. Les filles cisgenres font état de niveaux relativement élevés quant à l'importance des relations avec les autres, ce qui est également fortement associé à une bonne santé mentale. Les jeunes TDIG sont moins enclins que leurs pairs cisgenres à considérer comme importantes les relations avec soi-même, avec les autres et avec le transcendant. Une plus grande proportion d'élèves de la 6e à la 8e année que d'élèves de 9e et 10e année déclarent que les relations avec la nature sont importantes pour eux.
Consommation de substances et d'alcool
Une très faible proportion de jeunes déclarent fumer des cigarettes. Cependant, le vapotage est courant chez tous les jeunes, jusqu'à un élève sur quatre indiquant avoir vapoté au moment où il atteint la 10e année. Les taux de vapotage sont particulièrement préoccupants chez les filles, des augmentations frappantes étant observées depuis 2018. De même, davantage de filles déclarent avoir déjà consommé du cannabis. Une plus grande pratique du vapotage et une plus grande consommation de cannabis sont associées à des indicateurs de santé mentale négatifs.
Santé sexuelle
Parmi les jeunes qui ont eu des rapports sexuels, des proportions similaires de garçons cisgenres et de filles cisgenres déclarent avoir utilisé un moyen de contraception (principalement des condoms). Les filles cisgenres et les jeunes TDIG de 9e et 10e année sont plus susceptibles que les garçons cisgenres de faire état de pratiques de sextage. La proportion de 5 % de jeunes qui déclarent avoir envoyé le sexto d'une autre personne sans consentement est préoccupante.
Utilisation des médias sociaux
Les filles cisgenres et les jeunes TDIG sont les plus nombreux à faire état d'une utilisation problématique des médias sociaux et à essayer d'atteindre une forme corporelle idéale par des moyens promus sur les médias sociaux. L'utilisation problématique des médias sociaux est associée à une hausse de la probabilité de faire état d'un sentiment de solitude et de problèmes de santé, ainsi qu'à une baisse de la satisfaction à l'égard de la vie et du bien-être. Ces relations sont particulièrement marquées chez les filles cisgenres dont la famille est moins aisée.
COVID-19 et santé
Dans l'ensemble, la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences négatives sur la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être des jeunes et est également associée à une augmentation de la solitude et des problèmes de santé. Bien que l'ampleur de ces conséquences soit limitée chez la plupart des participants à l'enquête, on a constaté une incidence négative marquée sur la vie de certains groupes de jeunes, en particulier les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée.
Thèmes qui ressortent des résultats de l'enquête
- Pour la première fois, l'enquête HBSC a permis de documenter les expériences des jeunes TDIG en matière de santé et de comportements de santé. Les résultats sont préoccupants, car les jeunes TDIG font état de moins bons résultats en matière de santé et d'une plus grande fréquence des comportements à risque pour la santé, et ce pour presque tous les indicateurs de l'enquête.
- Les schémas de développement demeurent une préoccupation importante. Les jeunes de 9e et 10e année, peu importe leur genre, rapportent des niveaux plus élevés pour presque tous les indicateurs de santé négatifs, en particulier ceux qui ont trait à leur santé mentale.
- La santé des filles cisgenres demeure un sujet de préoccupation, car celles-ci éprouvent des problèmes de santé importants dans de nombreux domaines.
- Les relations sont importantes. Les élèves qui font état de relations solides avec leurs parents, leur famille, leurs amis et au sein de leur école sont beaucoup plus susceptibles d'afficher une meilleure santé mentale et des niveaux de bien-être supérieurs.
- Les jeunes qui se trouvent dans des contextes défavorables peuvent s'en sortir mieux s'ils évoluent dans un environnement positif à l'école, au sein des groupes de camarades, dans la collectivité et, surtout, à la maison. Chez les élèves dont la famille est moins aisée, on observe des relations étroites entre le nombre de ressources liées à la santé présents dans leur vie et de nombreux résultats positifs en matière de santé, notamment sur les plans physique, social, émotionnel et spirituel.
- La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences négatives sur la vie de la plupart des jeunes, mais l'ampleur de ces conséquences est limitée chez la plupart des participants à l'enquête. Ces résultats donnent à penser que les jeunes sont peut-être plus résilients qu'on ne le croit.
Références
- Référence 1
-
S. d. Health behaviour in school-aged children. https://hbsc.org
- Référence 2
-
Gouvernement du Canada. (6 janvier 2022). L'Enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (Enquête HBSC) au Canada. La santé en milieu scolaire. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-enfant-nourissons/sante-scolaire/comportements-sante-jeunes-scolaire.html
- Référence 3
-
S. d. About. Health behaviour in school-aged children. https://hbsc.org/about/
- Référence 4
-
Glatzer, W. et Gulyas, J. (2014) Cantril self-anchoring striving scale. Dans A. C. Michalos (dir.),Encyclopedia of quality of life and well-being research. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_259
- Référence 5
-
Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S. et Bech, P. (2015). The Who-5 Well-Being Index: A systematic review of the literature. Psychotherapy and psychosomatics, 84(3), 167-176. https://doi.org/10.1159/000376585
- Référence 6
-
Organisation mondiale de la santé. (1998). Wellbeing measures in primary health care/The Depcare Project. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/349766/WHO-EURO-1998-4234-43993-62027-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Référence 7
-
Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Standford Law Review, 43(6), 1241-1299. https://doi.org/10.2307/1229039
- Référence 8
-
Organisation mondiale de la santé. (17 juin 2022). Santé mentale : renforcer notre action. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
- Référence 9
-
Institut canadien d'information sur la santé. (2022). La santé mentale des enfants et des jeunes au Canada — infographie. https://www.cihi.ca/fr/la-sante-mentale-des-enfants-et-des-jeunes-au-canada-infographie-0
- Référence 10
-
Weins, K., Bhattarai, A., Pedram, A., Williams, D. J., Bulloch, A. et Patten, S. (2020). A growing need for youth mental health services in Canada: Examining trends in youth mental health from 2011 to 2018. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e115. https://doi.org/10.1017/S2045796020000281
- Référence 11
-
Agostino, H., Burstein, B. et Moubayed, D. (2021). Trends in the incidence of new-onset anorexia nervosa and atypical anorexia nervosa among youth during the COVID-19 pandemic in Canada. JAMA Network Open, 4(12), e2137395. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.37395
- Référence 12
-
Cost, K. T., Crosbie, J., Anagnostou, E., Birken, C. S., Charach, A., Monga, S., Kelley, E., Nicolson, R., Maguire, J. L., Burton, C. L., Schachar, R. J., Arnold, P. D. et Korczak, D. J. (2022). Mostly worse, occasionally better: Impact of COVID-19 pandemic on the mental health of Canadian children and adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(4), 671-684. https://doi.org/10.1007/s00787-021-01744-3
- Référence 13
-
Craig, S. G., Ames, M. E., Bondi, B. C. et Pepler, D. J. (2023). Canadian adolescents' mental health and substance use during the COVID-19 pandemic: Associations with COVID-19 stressors. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 55(1), 46-55. https://doi.org/10.1037/cbs0000305
- Référence 14
-
Hawke, L. D., Hayes, E., Darnay, K. et Henderson, J. (2021). Mental health among transgender and gender diverse youth: An exploration of effects during the COVID-19 pandemic. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 8(2), 180-187. https://doi.org/10.1037/sgd0000467
- Référence 15
-
Gislason, M. K., Kennedy, A. M. et Witham, S. M. (2021). The interplay between social and ecological determinants of mental health and youth in the climate crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4573. https://doi.org/10.3390/ijerph18094573
- Référence 16
-
Hrabok, M., Delorme, A. et Agyapong, V. I. O. (2020). Threats to mental health and well-being associated with climate change. Journal of Anxiety Disorders, 76, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102295
- Référence 17
-
Fante-Coleman, T. et Jackson-Best, F. (2020). Barriers and facilitators to accessing mental healthcare in Canada for Black youth: A scoping review. Adolescent Research Review, 5,115-136. https://doi.org/10.1007/s40894-020-00133-2
- Référence 18
-
Richards, D., Gateri, H. et Massaquoi, N. (2018). The effects of intersectional stigma and discrimination on the mental well-being of Black, LBQ, female youth 18-25 years old. Dans S. Pashang, N. Khanlou et J. Clarke (dir.), Today's youth and mental health(p. 119-133).
- Référence 19
-
Abi-Jaoude, E., Naylor, K. T. et Pignatiello, A. (2020). Smartphones, social media use and youth mental health. CMAJ, 192(6), E136-E141. https://doi.org/10.1503/cmaj.190434
- Référence 20
-
Craig, W., Gariepy, G., Mayne, K., Atallah, R. et Georgiades, K. (2021). La santé mentale et l'utilisation problématique des médias sociaux chez les adolescents canadiens – Conclusions de l'Enquête de 2018 sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (Enquête HBSC). Agence de la santé publique du Canada. https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/science-research-data/mental-health-problematic-social-media-use-canadian-adolescents/sante-mentale-utilisation-medias-sociaux-canadiens-adolescents.pdf
- Référence 21
-
Statistique Canada. (2020). Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes, 2019. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/200723/dq200723a-fra.pdf?st=96xpuUb6
- Référence 22
-
Statistique Canada. (2022). La santé mentale des jeunes revient sous les feux de la rampe, alors que la pandémie s'éternise. https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/907-la-sante-mentale-des-jeunes-revient-sous-les-feux-de-la-rampe-alors-que-la-pandemie
- Référence 23
-
Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S. et Bech, P. (2015). The Who-5 Well-Being Index: A systematic review of the literature. Psychotherapy and psychosomatics, 84(3), 167-176. https://doi.org/10.1159/000376585
- Référence 24
-
Organisation mondiale de la santé. (1998). Wellbeing measures in primary health care/The Depcare Project. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/349766/WHO-EURO-1998-4234-43993-62027-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Référence 25
-
Berger, L. M. et Font, S. A. (2015). The role of the family and family-centered programs and policies. The Future of Children, 25(1), 155-176.
- Référence 26
-
Umberson, D., Williams, K., Thomas, P. A., Liu, H. et Thomeer, M. B. (2014). Race, gender, and chains of disadvantage: Childhood adversity, social relationships, and health. Journal of Health and Social Behavior, 55(1), 20-38. https://doi.org/10.1177/0022146514521426
- Référence 27
-
Umberson, D. et Thomeer, M. B. (2020). Family matters: Research on family ties and health, 2010-2020. Journal of Marriage and Family, 82(1), 404-419. https://doi.org/10.1111/jomf.12640
- Référence 28
-
Pyper, E., Harrington, D. et Manson, H. (2016). The impact of different types of parental support behaviors on child physical activity, healthy eating, and screen time: A cross-sectional study. BMC Public Health, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12889-016-3245-0
- Référence 29
-
Widman, L., Choukas-Bradley, S., Noar, S. M., Nesi, J. et Garrett, K. (2016). Parent-adolescent sexual communication and adolescent safer sex behavior: A meta-analysis. JAMA Pediatrics, 170(1), 52-61. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.2731
- Référence 30
-
Wang, C., La Salle, T. P., Do, K. A., Wu, C. et Sullivan, K. E. (2019). Does parental involvement matter for students' mental health in middle school? School Psychology, 34(2), 222-232. https://doi.org/10.1037/spq0000300
- Référence 31
-
Simons, L., Schrager, S. M., Clark, L. F., Belzer, M. et Olson, J. (2013). Parental support and mental health among transgender adolescents. Journal of Adolescent Health, 53(6), 791-793. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.07.019
- Référence 32
-
Bukowski, W. M., Simard, M., Dubois, M. E. et Lopez, L. A. (2011). Representations, process, and development: A new look at friendship in early adolescence. Dans E. Amsel et J. Smetana (dir.), Adolescent vulnerabilities and opportunities, (p. 159-181). Cambridge University Press.
- Référence 33
-
Glaser, B., Shelton, K. H. et van den Bree, M. B. M. (2010). The moderating role of close friends in the relationship between conduct problems and adolescent substance use. Journal of Adolescent Health, 47(1), 35-42. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.12.022
- Référence 34
-
Tomé, G., Gaspar de Matos, M., Simões, C., Camacho, I. et Alves Diniz, J. (2012). How can peer group influence behaviour of adolescents: Explanatory model. Global Journal of Health Science, 4(2), 26-35. https://doi.org/10.5539/gjhs.v4n2p26
- Référence 35
-
Eisenberg, D., Golberstein, E. et Whitlock, J. L. (2014). Peer effects on risky behaviors: New evidence from college roommate assignments. Journal of Health Economics, 33,126-138. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.11.006
- Référence 36
-
Branstetter, S. A., Low, S. et Furman, W. (2010). The influence of parents and friends on adolescent substance use: A multidimensional approach. Journal of Substance Use, 16(2), 150-160. https://doi.org/10.3109/14659891.2010.519421
- Référence 37
-
Delgado, M. Y., Nair, R. L., Updegraff, K. A. et Umaña-Taylor, A. J. (2019). Discrimination, parent-adolescent conflict, and peer intimacy: Examining risk and resilience in Mexican-origin youths' adjustment trajectories. Child Development, 90(3), 894-910. https://doi.org/10.1111/cdev.12969
- Référence 38
-
Erath, S. A., Flanagan, K. S., Bierman, K. L. et Tu, K. M. (2010). Friendships moderate psychosocial maladjustment in social anxious early adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1), 15-26. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2009.05.005
- Référence 39
-
Holt-Lunstad, J. (2017). Friendship and health. Dans M. Hojjat et A. Moyer (dir.), The psychology of friendship (p. 233-244). Oxford University Press.
- Référence 40
-
Wang, M.-T. et Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28, 315-352. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1
- Référence 41
-
Aldridge, J. M. et McChesney, K. (2018). The relationships between school climate and adolescent mental health and well-being: A systematic literature review. International Journal of Educational Research, 88, 121-145. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.01.012
- Référence 42
-
Joyce, H. D. et Early, T. J. (2014). The impact of school connectedness and teacher support on depressive symptoms in adolescents: A multilevel analysis. Children and Youth Services Review, 39, 101-107. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.02.005
- Référence 43
-
Harding, S., Morris, R., Gunnell, D., Ford, T., Hollingworth, W., Tilling, K., Evans, R., Bell, S., Grey, J., Brockman, R., Campbell, R., Araya, R., Murphy, S. et Kidger, J. (2019). Is teachers’ mental health and well-being associated with students’ mental health and well-being? Journal of Affective Disorders, 242, 180-187. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.08.080
- Référence 44
-
Athanases, S. Z. et De Oliveira, L. C. (2022). Advocacy for equity in classrooms and beyond: New teachers’ challenges and responses. Teachers College Record, 110(1), 64-104. https://doi.org/10.1177/016146810811000101
- Référence 45
-
Roberts, J. L. et Siegle, D. (2012). Teachers as advocates: If not you-who? Gifted Child Today, 35(1), 58-61. https://doi.org/10.1177/1076217511427432
- Référence 46
-
Pulimeno, M., Piscitelli, P., Miani, A., Colao, A. et Colazzo, S. (2020). Training teachers as health promoters. Journal of Interdisciplinary Research Applied to Medicine, 4(1), 37-46.
- Référence 47
-
Holland, J., Reynolds, T. et Weller, S. (2007). Transitions, networks, and communities: The significance of social capital in the lives of children and young people. Journal of Youth Studies, 10(1), 97-116. https://doi.org/10.1080/13676260600881474
- Référence 48
-
Cicognani, E., Mazzoni, D., Albanesi, C. et Zani, B. (2014). Sense of community and empowerment among young people: Understanding pathways from civic participation to social well-being. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26, 24-44. https://doi.org/10.1007/s11266-014-9481-y
- Référence 49
-
Ballard, P. J. (2014). What motivates youth civic involvement? Journal of Adolescent Research, 29(4), 439-463. https://doi.org/10.1177/0743558413520224
- Référence 50
-
Outley, C., Bocarro, J. N. et Boleman, C. T. (2011). Recreation as a component of the community youth development system. New Directions for Youth Development, 2011(130), 59-72. https://doi.org/10.1002/yd.397
- Référence 51
-
Perkins, D. F., Borden, L. M., Villarruel, F. A., Carlton-Hug, A., Stone, M. R. et Keith, J. G. (2007). Participation in structured youth programs: Why ethnic minority urban youth choose to participate—or not to participate. Youth and Society, 38(4), 420-442. https://doi.org/10.1177/0044118X06295051
- Référence 52
-
Brooks, F. M., Magnusson, J., Spencer, N. et Morgan, A. (2012). Adolescent multiple risk behavior: An asset approach to the role of family, school and community. Journal of Public Health, 34(1), i48-i56. https://doi.org/10.1093/pubmed/fds001
- Référence 53
-
Ivert, A.-K. et Levander, M. T. (2013). Adolescents’ perceptions of neighbourhood social characteristics—Is there a correlation with mental health? Child Indicators Research, 7, 177-192. https://doi.org/10.1007/s12187-013-9210-x
- Référence 54
-
Kingsbury, M., Clayborne, Z., Colman, I. et Kirkbride, J. B. (2020). The protective effect of neighbourhood social cohesion on adolescent mental health following stressful life events. Psychological Medicine, 50(8), 1292-1299. https://doi.org/10.1017/S0033291719001235
- Référence 55
-
Organisation mondiale de la santé. (2022). Activité physique. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
- Référence 56
-
Société canadienne de physiologie de l’exercice. (2021). Enfants et jeunes (5 à 17 ans). Directives en matière de mouvement sur 24 heures. https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/
- Référence 57
-
Biddle, S. J. H., Ciaccioni, S., Thomas, G. et Vergeer, I. (2019). Physical activity and mental health in children and adolescents: An updated review of reviews and an analysis of causality. Psychology of Sport and Exercise, 42, 146-155. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.011
- Référence 58
-
Valkenborghs, S. R., Noetel, M., Hillman, C. H., Nilsson, M., Smith, J. J., Ortega, F. B. et Lubans, D. R. (2019). The impact of physical activity on brain structure and function in youth: A systematic review. Pediatrics, 144(4), e20184032. https://doi.org/10.1542/peds.2018-4032
- Référence 59
-
Anderson, E. et Durstine, J. L. (2019). Physical activity, exercise, and chronic disease: A brief review. Sports Medicine and Health Science, 1(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.smhs.2019.08.006
- Référence 60
-
Gouvernement du Canada. (26 avril 2016). Le comportement sédentaire chez les enfants et les jeunes : un nouveau risque pour la santé. Gouvernement du Canada. https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/blogue-comportement-sedentaire.html
- Référence 61
-
Pate, R. R., Mitchell, J. A., Byun, W. et Dowda, M. (2011). Sedentary behaviour in youth. British Journal of Sports Medicine, 45(11), 906-913. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090192
- Référence 62
-
Uddin, R., Burton, N. W., Maple, M., Khan, S. R., Tremblay, M. S. et Khan, A. (2020). Low physical activity and high sedentary behaviours are associated with adolescents’ suicidal vulnerability: Evidence from 52 low- and middle-income countries. Acta Paediatrica, 109(6), 1252-1259. https://doi.org/10.1111/apa.15079
- Référence 63
-
Doggett, A., Qian, W., Godin, K., De Groh, M. et Leatherdale, S. T. (2019). Examining the association between exposure to various screen time sedentary behaviours and cannabis use among youth in the COMPASS study. SSM-Population Health, 9, 100487. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100487
- Référence 64
-
Štefan, L., Horvatin, M. et Baić, M. (2019). Are sedentary behaviours associated with sleep duration? A cross-sectional case from Croatia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(2), 200. https://doi.org/10.3390/ijerph16020200
- Référence 65
-
Tarokh, L., Saletin, J. M. et Carskadon, M. A. (2016). Sleep in adolescence: Physiology, cognition and mental health. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 70, 182-188. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.008
- Référence 66
-
Shochat, T., Cohen-Zion, M. et Tzischinsky, O. (2014). Functional consequences of inadequate sleep in adolescents: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, 18(1), 75-87. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2013.03.005
- Référence 67
-
Wang, C., Dopko, R. L., Clayborne, Z. M., Capaldi, C. A., Roberts, K. C. et Betancourt, M. T. (2022). Étude de l’association entre sommeil et composantes de la santé mentale des enfants : résultats de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, 42. https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.11/12.02f
- Référence 68
-
Santé Canada. (2019). Guide alimentaire canadien : Recommandations en matière d'alimentation saine. https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/
- Référence 69
-
Doggui, R., Ward, S., Johnson, C. et Bélanger, M. (2021). Trajectories of eating behavior changes during adolescence. Nutrients, 13(4), 1313. https://doi.org/10.3390/nu13041313
- Référence 70
-
Marcone, M. F., Madan, P. et Grodzinski, B. (2020). An overview of the sociological and environmental factors influencing eating food behavior in Canada. Frontiers in Nutrition, 7, 77. https://doi.org/10.3389/fnut.2020.00077
- Référence 71
-
Kansra, A. R., Lakkunarajah, S. et Jay, M. S. (2021). Childhood and adolescent obesity: A review. Frontiers in Pediatrics, 8, https://doi.org/10.3389/fped.2020.581461
- Référence 72
-
Haqq, A. M., Kebbe, M., Tan, Q., Manco, M. et Salas, X. R. (2021). Complexity and stigma of pediatric obesity. Childhood Obesity, 17(4), 229-240. https://doi.org/10.1089/chi.2021.0003
- Référence 73
-
Rao, D. P., Kropac, E., Do, M. T., Roberts, K. C. et Jayaraman, G. C. (2016). Tendances en matière d'embonpoint et d'obésité chez les enfants au Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, 36(9), 219-223. https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.9.03f
- Référence 74
-
Brooks, S. J., Feldman, I., Schiöth, H. B. et Titova, O. E. (2021). Important gender differences in psychosomatic and school-related complaints in relation to adolescent weight status. Scientific Reports, 11(14147). https://doi.org/10.1038/s41598-021-93761-0
- Référence 75
-
Bartlett, S., Bataineh, J., Thompson, W. et Pickett, W. (2023). Correlations between weight perception and overt risk-taking among Canadian adolescents. Revue canadienne de santé publique, 114(6), 1019-1028. https://doi.org/10.17269/s41997-023-00778-1
- Référence 76
-
Onis, M. D., Onyango, A. W., Borghi, E., Siyam, A., Nishida, C. et Siekmann, J. (2007). Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, 85(9), 660-667. https://doi.org/10.2471/blt.07.043497
- Référence 77
-
Statistique Canada. (2023). Indice de masse corporelle, embonpoint ou obèse, autodéclaré, jeune (18 ans et plus) [ensemble de données]. Tiré de https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009621&request_locale=fr
- Référence 78
-
Dzielska, A. et Woynarowska, M. (2022). Psychosocial predictors of body weight congruence in adolescents aged 15 and 17 years in Poland: Findings from the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2342. https://doi.org/10.3390/ijerph19042342
- Référence 79
-
Geraets, A. F. J., Cosma, A., Fismen, A.-S., Ojala, K., Pierannunzio, D., Kelly, C., Melkumova, M., Vassallo, C., Rakic, J. G. et Heinz, A. (2023). Cross-national time trends in adolescent body weight perception and the explanatory role of overweight/obesity prevalence. Child and Adolescent Obesity, 6(1). https://doi.org/10.1080/2574254X.2023.2218148
- Référence 80
-
Sleet, D. A. (2018). The global challenge of child injury prevention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1921. https://doi.org/10.3390/ijerph15091921
- Référence 81
-
Pratt, B., Cheesman, J., Breslin, C. et Do, M. T. (2016). Accidents de travail impliquant des jeunes Canadiens : analyse de 22 années de surveillance des données recueillies à partir du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, 36(5), 101-112. https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.5.01f
- Référence 82
-
Black, A. M., Meeuwisse, D. W., Eliason, P. H., Hagel, B. E. et Emery, C. A. (2021). Sport participation and injury rates in high school students: A Canadian survey of 2029 adolescents. Journal of Safety Research, 78,314-321. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.06.008
- Référence 83
-
Fridman, L., Fraser-Thomas, J. L., Pike, I. et Macpherson, A. K. (2018). Childhood road traffic injuries in Canada-a provincial comparison of transport injury rates over time. BMC Public Health, 18, https://doi.org/10.1186/s12889-018-6269-9
- Référence 84
-
Keays, G., Friedman, D. et Gagnon, I. (2020). Recherche quantitative originale – Les blessures pédiatriques au temps de la COVID-19. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, 40(11-12), 372-378. https://doi.org/10.24095/hpcdp.40.11/12.02f
- Référence 85
-
Russell, K., Selci, E., Black, B., Cochrane, K. et Ellis, M. (2019). Academic outcomes following adolescent sport-related concussion or fracture injury: A prospective cohort study. PLoS ONE, 14(4), e0215900. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215900
- Référence 86
-
Daley, M. M., Shoop, J. et Meehan III, W. P. (2023). Psychological consequences of concussion. Dans M. A. Christino, E. I. Pluhar et L. J. Micheli (dir.), Psychological considerations in the young athlete(p. 117-134).
- Référence 87
-
Choudhury, R., Kolstad, A., Prajapati, V., Samuel, G. et Yeates, K. O. (2020). Loss and recovery after concussion: Adolescent patients give voice to their concussion experience. Health Expectations, 23(6), 1533-1542. https://doi.org/10.1111/hex.13138
- Référence 88
-
Hellström, L., Thornberg, R. et Espelage, D. L. (2021). Definitions of Bullying. Dans P. K. Smith et J. O. Norman (dir.), The Wiley Blackwell handbook of bullying: A comprehensive and international review of research and intervention. John Wiley & Sons.
- Référence 89
-
Coyle, S., Cipra, A. et Rueger, S. Y. (2021). Bullying types and roles in early adolescence: Latent classes of perpetrators and victims. Journal of School Psychology, 89,51-71. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2021.09.003
- Référence 90
-
Mishna, F., Sanders, J. E., McNeil, S., Fearing, G. et Kalenteridis, K. (2020). "If somebody is different": A critical analysis of parent, teacher, and student perspectives on bullying and cyberbullying. Children and Youth Services Review, 118, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105366
- Référence 91
-
Romano, I., Butler, A., Patte, K. A., Ferro, M. A. et Leatherdale, S. T. (2019). High school bullying and mental disorder: An examination of the association with flourishing and emotional regulation. International Journal of Bullying Prevention, 2,241-252. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00035-5
- Référence 92
-
Yokoji, K., Hammami, N. et Elgar, F. J. (2023). Socioeconomic differences in the association between bullying behaviors and mental health in Canadian adolescents. Journal of School Health, 93(5), 420-427. https://doi.org/10.1111/josh.13300
- Référence 93
-
Stewart-Tufescu, A., Salmon, S., Taillieu, T., Fortier, J. et Afifi, T. O. (2019). Victimization experiences and mental health outcomes among grades 7 to 12 students in Manitoba, Canada. International Journal of Bullying Prevention, 3(1),1-12. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00056-0
- Référence 94
-
Halliday, S., Gregory, T., Taylor, A., Digenis, C. et Turnbull, D. (2021). The impact of bullying victimization in early adolescence on subsequent psychosocial and academic outcomes across the adolescent period: A systematic review. Journal of School Violence, 20(3), 351-373. https://doi.org/10.1080/15388220.2021.1913598
- Référence 95
-
Exner-Cortens, D., Baker, E. et Craig, W. (2021). The national prevalence of adolescent dating violence in Canada. Journal of Adolescent Health, 69(3), 495-502. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.032
- Référence 96
-
Exner-Cortens, D., Baker, E. et Craig, W. (2023). Canadian adolescents' experiences of dating violence: Associations with social power imbalances. Journal of Interpersonal Violence, 38(1-2). https://doi.org/10.1177/08862605221092072
- Référence 97
-
Taquette, S. R. et Monteiro, D. L. M. (2019). Causes and consequences of adolescent dating violence: A systematic review. Journal of Injury and Violence Research, 11(2), 137-147. https://doi.org/10.5249/jivr.v11i2.1061
- Référence 98
-
Scales, P. C., Syversten, A. K., Benson, P. L., Roehlkepartain, E. C. et Sesma, A. (2014). Relation of spiritual development to youth health and well-being: Evidence from a global study. Dans A. Ben-Arieh, F. Casas, I. Frønes et J. E. Korbin (dir.), Handbook of Child Well-being: Theories, methods & policies in global perspective (Vol. 2). https://doi.org/10.1007/978-90-481-9063-8_41
- Référence 99
-
Michaelson, V. (2020). Developing a definition of spiritual health for Canadian young people: A qualitative study. International Journal of Children's Spirituality, 26(1-2), 67-85. https://doi.org/10.1080/1364436X.2020.1856048
- Référence 100
-
Michaelson, V., Šmigelskas, K., King, N., Inchley, J., Malinowska-Cieślik, M. et Pickett, W. (2023). Domains of spirituality and their importance to the health of 75,533 adolescents in 12 countries. Health Promotion International, 38(3), daab185. https://doi.org/10.1093/heapro/daab185
- Référence 101
-
Michaelson, V., King, N., Inchley, J., Currie, D., Brooks, F. et Pickett, W. (2019). Domains of spirituality and their associations with positive mental health: A study of adolescents in Canada, England, and Scotland. Preventive Medicine, 125, 12-18. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.04.018
- Référence 102
-
Ciranka, S. et van den Bos, W. (2021). Adolescent risk-taking in the context of exploration and social influence. Developmental Review, 61. https://doi.org/10.1016/j.dr.2021.100979
- Référence 103
-
Gray, K. M. et Squeglia, L. M. (2018). Research review: What have we learned about adolescent substance use? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59(6), 618-627. https://doi.org/10.1111/jcpp.12783
- Référence 104
-
Wiley, E. R. et Seabrook, J. A. (2023). Nicotine and nicotine-free vaping behavior among a sample of Canadian high school students: A cross-sectional study. Children, 10(2), 368. https://doi.org/10.3390/children10020368
- Référence 105
-
East, K. A., Reid, J. L. et Hammond, D. (2023). Smoking and vaping among Canadian youth and adults in 2017 and 2019. Tobacco Control, 32(2), 259-262. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056605
- Référence 106
-
Leatherdale, S. T. et Burkhalter, R. (2012). The substance use profile of Canadian youth: Exploring the prevalence of alcohol, drug, and tobacco use by gender and grade. Addictive Behaviors, 37(3), 318-322. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.10.007
- Référence 107
-
Zuckermann, A. M. E., Williams, G. C., Battista, K., Jiang, Y., de Groh, M. et Leatherdale, S. T. (2020). Prevalence and correlates of youth poly-substance use in the COMPASS study. Addictive Behaviors, 107. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106400
- Référence 108
-
Olmstead, S. B. (2020). A decade review of sex and partnering in adolescence and young adulthood. Journal of Marriage and Family, 82(2), 769-795. https://doi.org/10.1111/jomf.12670
- Référence 109
-
Wood, J., McKay, A., Wentland, J. et Byers, S. E. (2021). Attitudes towards sexual health education in schools: A national survey of parents in Canada. The Canadian Journal of Human Sexuality, 30(1), 39-55. https://doi.org/10.3138/cjhs.2020-0049
- Référence 110
-
Laverty, E. K., Noble, S. M., Pucci, A. et MacLean, R. E. D. (2021). Let's talk about sexual health education: Youth perspectives on their learning experiences in Canada. The Canadian Journal of Human Sexuality, 30(1), 26-38. https://doi.org/10.3138/cjhs.2020-0051
- Référence 111
-
Ketting, E., Brockschmidt, L. et Ivanova, O. (2021). Investigating the 'C' in CSE: Implementation and effectiveness of comprehensive sexuality education in the WHO European region. Sex Education, 21(2), 133-147. https://doi.org/10.1080/14681811.2020.1766435
- Référence 112
-
Gazendam, N., Cleverley, K., King, N., Pickett, W. et Phillips, S. P. (2020). Individual and social determinants of early sexual activity: A study of gender-based differences using the 2018 Canadian Health Behaviour in School-aged Children Study (HBSC). PLoS ONE, 15(9), e0238515. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238515
- Référence 113
-
Kahn, N. F. et Halpern, C. T. (2018). Associations between patterns of sexual initiation, sexual partnering, and sexual health outcomes from adolescence to early adulthood. Archives of Sexual Behavior, 47(6), 1791-1810. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1176-9
- Référence 114
-
Schimmele, C., Fonberg, J. et Schellenberg, G. (2021). Canadians' assessments of social media in their lives. Economic and Social Reports, 1(3). https://doi.org/10.25318/36280001202100300004-eng
- Référence 115
-
Li, X., Vanderloo, L. M., Keown-Stoneman, C. D. G., Cost, K. T., Charach, A., Maguire, J. L., Monga, S., Crosbie, J., Burton, C., Anagnostou, E., Georgiades, S., Nicolson, R., Kelley, E., Ayub, M., Korczak, D. J. et Birken, C. S. (2021). Screen use and mental health symptoms in Canadian children and youth during the COVID-19 pandemic. JAMA Network Open, 4(12), e2140875. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.40875
- Référence 116
-
Kim, S., Belfry, K. D., Crawford, J., MacDougall, A. et Kolla, N. J. (2023). COVID-19 related anxiety and the role of social media among Canadian youth. Frontiers in Psychiatry, 14, 1029082. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1029082
- Référence 117
-
Marino, C., Lenzi, M., Canale, N., Pierannunzio, D., Dalmasso, P., Borraccino, A., Cappello, N., Lemma, P., Vieno, A. et le 2018 HBSC-Italia Group. (2020). Problematic social media use: Associations with health complaints among adolescents. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, 56(4), 514-521. https://doi.org/10.4415/ANN_20_04_16
- Référence 118
-
Paakkari, L., Tynjälä, J., Lahti, H., Ojala, K. et Lyyra, N. (2021). Problematic social media use and health among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1885. https://doi.org/10.3390/ijerph18041885
- Référence 119
-
Plaisime, M., Robertson-James, C., Mejia, L., Núñez, A., Wolf, J. et Reels, S. (2020). Social media and teens: A needs assessment exploring the potential role of social media in promoting health. Social Media + Society, 6(1). https://doi.org/10.1177/2056305119886025
- Référence 120
-
Rideout, V. et Fox, S. (2018). Digital health practices, social media use, and mental well-being among teens and young adults in the U.S. Providence St. Joseph Health Digital Commons Articles, Abstracts, and Reports, 1093.
- Référence 121
-
Pretorius, C., Chambers, D. et Coyle, D. (2019). Young people's online help-seeking and mental health difficulties: Systematic narrative review. Journal of Medical Internet Research, 21(11), e13873. https://doi.org/10.2196/13873
- Référence 122
-
Nagata, J. M. (2020). New findings from the health behaviour in school-aged children (HBSC) survey: Social media, social determinants, and mental health. Journal of Adolescent Health, 66(6S), S1-S2. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.024
- Référence 123
-
Vannucci, A., Simpson, E. G., Gagnon, S. et Ohannessian, C. M. (2020). Social media use and risky behaviours in adolescents: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 79,258-274. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.01.014
- Référence 124
-
Craig, S. G., Ames, M. E., Bondi, B. C. et Pepler, D. J. (2023). Canadian adolescents' mental health and substance use during the COVID-19 pandemic: Associations with COVID-19 stressors. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 55(1), 46-55. https://doi.org/10.1037/cbs0000305
- Référence 125
-
Cassinat, J. R., Whiteman, S. D., Serang, S., Dotterer, A. M., Mustillo, S. A., Maggs, J. L. et Kelly, B. C. (2021). Changes in family chaos and family relationships during the COVID-19 pandemic: Evidence from a longitudinal study. Developmental Psychology, 57(10), 1597-1610. https://doi.org/10.1037/dev0001217
- Référence 126
-
Sinko, L., He, Y., Kishton, R., Ortiz, R., Jacobs, L. et Fingerman, M. (2022). "The stay at home order is causing things to get heated up": Family conflict dynamics during COVID-19 from the perspectives of youth calling a national child abuse hotline. Journal of Family Violence, 37(5),837-846. https://doi.org/10.1007/s10896-021-00290-5
- Référence 127
-
Ashwin, A., Cherukuri, S. D. et Rammohan, A. (2022). Negative effects of COVID-19 pandemic on adolescent health: Insights, perspectives, and recommendations. Journal of Global Health, 12, https://doi.org/10.7189/jogh.12.03009
- Référence 128
-
Moore, S. A., Faulkner, G., Rhodes, R. E., Brussoni, M., Chulak-Bozzer, T., Ferguson, L. J., Mitra, R., O'Reilly, N., Spence, J. C., Vanderloo, L. M. et Tremblay, M. S. (2020). Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: A national survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17. https://doi.org/10.1186/s12966-020-00987-8
- Référence 129
-
Duncan, M. J., Riazi, N. A., Faulkner, G., Gilchrist, J. D., Leatherdale, S. T. et Patte, K. A. (2022). Changes in Canadian adolescent time use and movement guidelines during the early COVID-19 outbreak: A longitudinal prospective natural experiment design. Journal of Physical Activity and Health, 19(8),566-577. https://doi.org/10.1123/jpah.2021-0691
- Référence 130
-
Nandlall, N., Hawke, L. D., Hayes, E., Darnay, K., Daley, M., Relihan, J. et Henderson, J. (2022). Learning through a pandemic: Youth experiences with remote learning during the COVID-19 pandemic. SAGE Open, 12(3). https://doi.org/10.1177/21582440221124122
- Référence 131
-
Whitley, J., Beauchamp, M. H. et Brown, C. (2021). The impact of COVID-19 on the learning and achievement of vulnerable Canadian children and youth. FACETS, 6,1693-1713. https://doi.org/10.1139/facets-2021-0096
- Référence 132
-
Segre, G., Campi, R., Scarpellini, F., Clavenna, A., Zanetti, M., Cartabia, M. et Bonati, M. (2021). Interviewing children: The impact of the COVID-19 quarantine on children's perceived psychological distress and changes in routine. BMC Pediatrics, 21(231). https://doi.org/10.1186/s12887-021-02704-1
- Référence 133
-
Suleman, S., Ratnani, Y., Stockley, K., Jetty, R., Smart, K., Bennett, S., Gander, S. et Loock, C. (2020). Supporting children and youth during the COVID-19 pandemic and beyond: A rights-centred approach. Paediatrics & Child Health, 25(6), 333-336. https://doi.org/10.1093/pch/pxaa086
- Référence 134
-
Coughlin, C. G., Sandel, M. et Stewart, A. M. (2020). Homelessness, children, and COVID-19: A looming crisis. Pediatrics, 146(2). https://doi.org/10.1542/peds.2020-1408
- Référence 135
-
Aylsworth, L., Manca, T., Dubé, È., Labbé, F., Driedger, S. M., Benzies, K., Macdonald, N., Graham, J. et MacDonald, S. E. (2022). A qualitative investigation of the facilitators and barriers to accessing COVID-19 vaccines among Racialized and Indigenous Peoples in Canada. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(6), 1585-1592. https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2129827
- Référence 136
-
Garg, I., Hanif, H., Javed, N., Abbas, R., Mirza, S., Javaid, M. A., Pal, S., Shekhar, R. et Sheikh, A. B. (2021). COVID-19 vaccine hesitancy in the LGBTQ+ population: A systematic review. Infectious Disease Reports, 13(4),872-887. https://doi.org/10.3390/idr13040079
- Référence 137
-
Frohlich, K. L., Thomson, J. A., Fraser, S. L., Dupéré, V. et Beauregard, N. (2022). "It reflects the society in which we live, except now everything is accentuated": Youth, social inequities, and the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Public Health, 113(6), 795-805. https://doi.org/10.17269/s41997-022-00703-y
