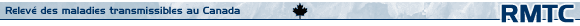ARCHIVÉ - Surveillance de l'infection invasive à Haemophilus influenzae au Manitoba à l'ère de la post-vaccination : mise en lumière d'un changement épidémiologique
le 15 mai 2006 Volume 32 Numéro 11
Introduction
La surveillance de l'infection invasive à Haemophilus influenzae (Hi) au Canada remonte à 1979(1), avant l'introduction du vaccin contre H. influenzae de sérotype b (Hib). Avant l'introduction de ce vaccin, la plupart des cas d'infection invasive à Hi étaient dus à Hib(2). Depuis l'adoption du vaccin conjugué à base de polyribophosphate au Canada, en 1992, l'incidence des infections à Hib a chuté radicalement pour atteindre un creux historique en 2000; en effet, cette année-là seulement quatre cas ont été relevés par un réseau pancanadien de 12 centres pédiatriques, chargés de surveiller les maladies évitables par la vaccination(3,4). Toutefois, les activités de surveillance de l'infection invasive à Hi, au Canada, ne portent que sur les cas dus à Hib, et l'on ne dispose que de très peu de données sur la prévalence ou l'incidence de l'infection invasive à Hi non liée au sérotype b. On n'a pas encore pu déterminer si le vaccin contre Hib modifie l'épidémiologie de l'infection invasive à Hi du fait qu'il induirait un changement de capsule. Ce phénomène de remplacement de la capsule dans l'infection à Hi a été signalé par au moins deux pays (le Brésil et le Portugal) après une utilisation à vaste échelle du vaccin contre Hib(5,6). Récemment, un éditorial faisait remarquer, non sans inquiétude, que les isolats de Hi de type non-b sont de plus en plus en cause dans les cas d'infection invasive à Hi(7). Il est donc légitime de se demander quelle devrait être la réponse des autorités de la santé publique face à l'infection invasive à Hi de type non-b.
Pour élucider une partie de ces questions, nous avons étudié des souches invasives de Hi (définies d'après le critère de l'isolement à partir de sites corporels normalement stériles comme le sang et le liquide céphalorachidien [LCR]) isolées au Centre des sciences de la santé (CSS) et à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg (Manitoba), entre 2002 et 2004, et sérotypées au moyen d'un antisérum spécifique au sérotype ainsi que de techniques moléculaires permettant de déceler la présence de gènes de synthèse du polysaccharide capsulaire spécifiques au sérotype.
Matériel et méthodes
Isolats bactériens
Les isolats provenant de cas d'infection invasive à Hi ont été obtenus auprès du Laboratoire de microbiologie clinique du CSS deWinnipeg. Les souches ont été cultivées sur des plaques d'agar chocolat et conservées à -80 0C dans un bouillon d'infusion cerveau-coeur glycérolé à 20 %. On a reconfirmé l'identité de tous les isolats par des analyses biochimiques standard(8).
Sérotypage par antisérum et analyse PCR des gènes de la synthèse du polysaccharide capsulaire
Le sérotypage a également été effectué par agglutination sur lame au moyen d'un antisérum provenant de deux sources commerciales (Difco, Oakville [Ont.]; Denka Seiken, Tokyo). L'amplification à la polymérase (PCR) du gène caractéristique du sérotype et du gène bexA responsable du transport capsulaire a été réalisée au moyen des amorces décrites par Falla et coll.(9).
Résultats
Le CSS et l'Hôpital pour enfants constituent le troisième centre de soins de santé tertiaires en importance au Manitoba, qui dessert les résidents du Manitoba, du Nord-Ouest de l'Ontario et du Nunavut. Selon le rapport annuel de 2004-2005 du CSS(10), environ 19 748 adultes et 5 452 enfants ont été admis au CSS et à l'Hôpital pour enfants, respectivement.
Le Laboratoire de microbiologie clinique du CSS a relevé 53 cas d'infection invasive à Hi. Nous avons été en mesure d'extraire les isolats correspondants de Hi pour 52 des 53 cas; un isolat n'a pu être cultivé à partir de l'échantillon congelé original du CSS. Le tableau 1 illustre la distribution par sérotype de ces 52 cas, selon l'année. Le sérotype des 52 isolats a été confirmé grâce à la détection par PCR de leur gène de synthèse du polysaccharide capsulaire spécifique au sérotype. Le gène bexA de transport capsulaire était également détectable dans toutes les souches se prêtant au sérotypage. Le sérotype le plus fréquemment identifié a été le sérotype a (26 cas), suivi des souches non sérotypables (NST) (20 cas); on n'a obtenu que trois isolats de sérotype a et un isolat chacun pour les sérotypes c, d et f. On n'a observé aucune tendance dans la fréquence du sérotype a ou des isolats NST entre 2000 et 2004. Bien que nous n'ayons pas eu en main les antécédents de vaccination des patients, il est intéressant de noter que les trois cas d'infection à Hib ont été observés chez des nourrissons de 5, 6 et 9 mois. Au Canada, pour le vaccin contre Hib, le calendrier d'immunisation systématique consiste en une dose primaire administrée à 2 mois, suivie de rappels à 4, 6 et 18 mois. Par conséquent, aucun des trois cas d'infection à Hib n'avait reçu les quatre doses de vaccin.
Tableau 1. Distribution par sérotype de 52 isolats d'Haemophilus influenzae provenant de patients souffrant de l'infection invasive
Sérotype |
Nbre d'isolats par année d'isolement |
Nbre total d'isolats |
||||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||
a |
3 |
7 |
6 |
6 |
4 |
26 |
b |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
c |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
d |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
f |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
NST |
4 |
7 |
4 |
1 |
4 |
20 |
Total |
8 |
16 |
10 |
8 |
10 |
52 |
La distribution par âge de l'ensemble des cas d'infection invasive à Hi est présentée à la figure 1. On a relevé 32 cas chez des patients de ≤ 2 ans, et neuf cas chez des patients de ≥ 50 ans. Chez les enfants (de ≤ 2 ans), on a identifié plus souvent des isolats de sérotype a que des isolats de Hi NST (test du chi carré, p < 0,01; rapport de cotes 5,0; intervalle de confiance à 95 % 1,2-22,4). Globalement, 41 isolats de Hi provenaient d'une culture sanguine et neuf, d'une culture de LCR; trois isolats ont été obtenus à partir des deux types de cultures.
Figure 1. Distribution par âge des 52 cas d'infection invasive à Haemophilus influenzae
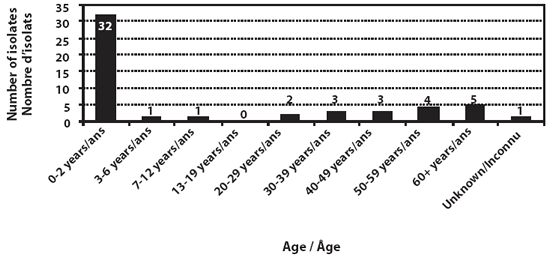
Analyse
Bien que, dans plusieurs études, on ait signalé des cas d'infection invasive à Hia, il s'agissait en général d'un nombre restreint de cas(6,11-13). La présente étude est l'une des rares, jusqu'à présent, où un grand nombre d'isolats d'Hia invasif ont été examinés. En effet, 26 (50 %) des 52 cas d'infection invasive à Hi dans cette étude étaient dus à Hia. Par contre, seulement trois cas (6 %) étaient associés à Hib. Une autre portion des 52 cas, soit 6 %, était causée par des sérotypes autres que Hia et Hib. Avant l'introduction des vaccins contre Hib, cette souche était responsable de la majorité des infections graves, comme la méningite, l'épiglottite, la pneumonie et la septicémie durant la petite enfance, ce qui donne à penser qu'il s'agissait d'un sérotype plus virulent que les autres. Avec la baisse de l'incidence de l'infection à Hib, il semble, à la lumière de cette étude ainsi que d'autres études, que le Hia pourrait être le deuxième type le plus virulent sur le plan clinique parmi les six sérotypes de Hi. Étant donné que la structure capsulaire est reliée à la virulence et au sérotype de Hi, il importe de noter que la structure capsulaire de Hia ressemble plus à celle de Hib qu'à celle des autres sérotypes de Hi. Les capsules tant de Hia que de Hib contiennent du ribitol, un sucre à cinq carbones. Dans le premier cas, le ribitol est lié au glucose pour former un polymère de glucose-ribitol-phosphate, tandis que dans le cas de Hib, la capsule est faite d'un polymère de ribose-ribitolphosphate (14,15).
Comme on l'a aussi noté dans d'autres études, la plupart des cas d'infection à Hia ont été observés chez des enfants(6,11-13). Vingt-et-un (81 %) de nos 26 cas d'infection à Hia concernaient des enfants de < 4 ans, et 14 de ceux-ci étaient âgés de < 12 mois. On a également relevé cinq cas chez des adultes : l'un avait 27 ans, deux avaient 37 ans et deux avaient entre 50 et 60 ans.
L'étude a par ailleurs permis de déceler un grand nombre de cas dus à des souches NST (20 des 52 cas, soit 38,5 %). Les caractéristiques liées à la virulence de Hi NST ne font pas l'unanimité(16); cependant, d'après nos constatations, il existe un lien clair entre Hi NST et l'infection invasive. À la différence de l'infection à Hia, Hi NST était plus souvent à l'origine des cas d'infection chez les adolescents ou les adultes (63 %, soit 12 cas sur 19; l'âge de l'un des cas d'infection à Hi NST n'était pas connu) que chez les nourrissons ou les enfants (37 %, soit sept cas sur 19, avaient < 13 mois).
L'importance de Hi NST parmi les cas d'infection invasive dans la population adulte pourrait être reliée au fait que Hi NST est un important pathogène respiratoire chez les patients souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)(17). Les souches de Hi isolées chez des patients présentant des signes d'exacerbation aigus de MPOC ont, d'après les rapports fournis, induit plus d'inflammation que les colonisateurs, ce qui pourrait expliquer la pathogénicité accrue chez ces patients(18). Cependant, il n'est pas possible, à partir de notre étude en laboratoire, de connaître la proportion de cas d'infection à Hi NST avec atteinte pulmonaire. Par conséquent, dans la deuxième phase de notre étude visant à caractériser l'évolution de l'épidémiologie de l'infection invasive à Hi, nous examinerons les dossiers médicaux pour déterminer les facteurs liés à l'hôte qui pourraient jouer un rôle dans l'infection invasive à Hi NST.
Bien que nos données ne se fondent sur les résultats que d'une seule province, les observations formulées ont de très grandes répercussions en ce qui concerne l'évolution de l'épidémiologie de l'infection invasive à Hi au Canada. Nous proposons donc d'intensifier la surveillance nationale de cette infection et, pour ce faire, de modifier la définition de cas d'infection invasive à Hi actuellement utilisée à l'échelle nationale de manière à inclure les cas où l'on a pu isoler l'un des six sérotypes de Hi aussi bien que Hi NST à partir de sites corporels normalement stériles. Une telle démarche pourrait avoir des répercussions sur la mise au point d'un vaccin contre l'infection invasive à Hi. En outre, nous recommandons que les sérotypes identifiés par agglutination bactérienne soient confirmés par PCR dans le but de réduire au minimum les possibilités d'erreurs et de faire en sorte que l'information sur le sérotype de tous les cas d'infection invasive à Hi soit exacte(19).
Pour donner suite à la présente étude, nous avons entrepris l'examen des dossiers des 52 patients atteints de l'infection invasive à Hi avec l'intention de décrire la gravité de la maladie et son issue et de déterminer s'il est possible de relever des facteurs de risque liés à l'hôte relativement à l'infection invasive à Hia ou à Hi NST. Nous prévoyons également d'autres analyses des isolats de Hi NST qui nous permettront de déterminer si ce groupe de bactéries présente des caractéristiques de virulence communes.
Remerciements
Nous remercions le Dr A. Kabani et son personnel du Laboratoire de microbiologie clinique, au CSS de l'Université du Manitoba, de nous avoir fourni les souches de H. influenzae décrites dans la présente étude, et de nous avoir permis de les utiliser. R.S.W. Tsang remercie John Robbins du National Institute of Health pour l'analyse des structures capsulaires de H. influenzae.
L'information présentée dans ce rapport est tirée d'un article publié antérieurement par les auteurs dans le Journal of Clinical Microbiology(20). Nous remercions le service des publications de l'American Society for Microbiology de nous avoir autorisés à reproduire cette information.
Références
-
Agence de la santé publique du Canada. Maladies à déclaration obligatoire en direct. URL: <http://dsol-smed.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed/ndis/list_f.html>.
-
Varughese P. Infections à Haemophilus influenzae au Canada, 1969-1985. RHMC 1986;12:37-43.
-
Scheifele D, Halperin S, VaudryWet coll. Le nombre de cas d'infection à Haemophilus influenzae de type B n'a jamais été aussi bas - Canada, 2000. RMTC 2001;27(18):149-50.
-
Scheifele D, Halperin S, Law B et coll. for the Canadian Paediatric Society/Health Canada Immunization Monitoring Program Active (IMPACT). Invasive Haemophilus influenzae type b infections in vaccinated and unvaccinated children in Canada, 2001-2003. Can Med Assoc J 2005;172:53-6.
-
Bajanca P, Canica M and the Multicenter Study Group. Emergence of nonencapsulated and encapsulated non-b-type invasive Haemophilus influenzae isolates in Portugal (1989-2001). J Clin Microbiol 2004;42:807-10.
-
Ribeiro GS, Reis JN, Cordeiro SM et coll. Prevention of Haemophilus influenzae type b (Hib) meningitis and emergence of serotype replacement with type a strains after introduction of Hib immunization in Brazil. J Infect Dis 2003;187:109-16.
-
Butler JC. Nature abhors a vacuum, but the public health is loving it: the sustained decrease in the rate of invasive Haemophilus influenzae disease. Clin Infect Dis 2005;40:831-33.
-
Kilian M. Haemophilus. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH et coll., éds. Manual of clinical microbiology, 8th éd. Washington, D.C.: ASM Press, 2003:623-35.
-
Falla TJ, Crook DWM, Brophy LN et coll. PCR for capsular typing of Haemophilus influenzae. J Clin Microbiol 1994;32:2382-86.
-
Health Sciences Centre,Winnipeg, Man. 2004-2005 annual report. URL: http://www.hsc.mb.ca/annual_report/HSC_04-05_Annual Report.pdf.
-
Adderson EE, Byington CL, Spencer L et coll. Invasive serotype a Haemophilus influenzae infections with a virulence genotype resembling Haemophilus influenzae type b: emerging pathogen in the vaccine era. Pediatrics 2001;108:E18.
-
Hammitt LL, Block S, Hennessy TW et coll. Outbreak of invasive Haemophilus influenzae serotype a disease. Pediatr Infect Dis J 2005;24:453-6.
-
Millar EV, O'Brien KL, Watt JP et coll. Epidemiology of invasive Haemophilus influenzae type a disease among Navajo and White Mountain Apache children. Clin Infect Dis 2005;40:823-30.
-
Branefors-Helander P. The structure of the capsular antigen from Haemophilus influenzae type a. Carbohydr Res 1977;56:117-22.
-
Crisel RM, Baker RS, Dorman DE. Capsular polymer of Haemophilus influenzae, type b. J Biol Chem 1975;250:4926-30.
-
Nizet V, Collina KF, Almquist JR et coll. A virulent nonencapsulated Haemophilus influenzae. J Infect Dis 1996;173:180-6.
-
Ko FWS, Lam RKY, Li TST et coll. Sputum bacteriology in patients hospitalized with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and concomitant pneumonia in Hong Kong. IntMed J 2005;35:661-67.
-
Chin CL, Manzel LJ, Lehman EE et coll. Haemophilus influenzae from patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation induce more inflammation than colonizers. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:85-91.
-
LaClaire LL, Tondella ML, Beall DS et coll. Serotyping discrepancies in Haemophilus influenzae type b disease - United States, 1998-1999. MMWR 2002;51:706-7.
-
Tsang RSW, Mubareka S, Sill ML et coll. Invasive Haemophilus influenzae in Manitoba, Canada, in the postvaccination era. J Clin Microbiol 2006;44:1530-35.
Source : RSW Tsang, MMedSc, PhD, Laboratoire des maladies bactériennes évitables par la vaccination, Laboratoire national de microbiologie (LNM), Agence de santé publique du Canada (ASPC); S Mubareka, MD, Département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses, Université du Manitoba (UM); ML Sill, BSc, LNM, ASPC; J Wylie, PhD, Laboratoire provincial de santé publique Cadham, Santé Manitoba, Winnipeg (Man.); S Skinner, MD, Département de microbiologie médicale, UM; DKS Law, BA, BSc, LNM, Agence de la santé publique du Canada, Winnipeg (Manitoba).
Détails de la page
- Date de modification :