Approche de gestion des risques proposée pour le Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (PTCE) Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 115-96-8
Environnement Canada
Santé Canada
Août 2009
- Contexte
- Historique
- Pourquoi devons-nous prendre des mesures?
- Utilisations actuelles et secteurs industriels
- Présence dans l'environnement au Canada et sources d'exposition
- Aperçu des mesures existantes
- Considérations
- Objectifs proposés
- Gestion des risques proposée
- Approche de consultation
- Prochaines étapes et échéancier proposé
- Références
1. Contexte
1.1 Catégorisation et Défi à l'industrie et à d'autres parties intéressées
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) doivent classer par catégories les substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS). Cette catégorisation consiste à identifier les substances de la LIS qui : a) sont jugées persistantes (P) et/ou bioaccumulables (B), selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Gouvernement du Canada, 2000), et qui présentent une toxicité intrinsèque pour les humains ou d'autres organismes, ou b) présentent, pour la population du Canada, le plus fort risque d'exposition. Les ministres doivent également effectuer une évaluation préalable de chaque substance satisfaisant aux critères de cette catégorisation. L'évaluation permet de déterminer plus précisément si la substance peut être qualifiée de « toxique » comme le définit l'article 64 de la Loi.
En décembre 2006, le Défi a permis d'identifier 193 substances chimiques au moyen de la catégorisation; ces substances sont devenues d'intérêt prioritaire aux fins d'évaluation en raison de leurs propriétés dangereuses et de leur potentiel de risque pour la santé humaine et l'environnement. En février 2007, les ministres ont commencé à publier des profils des lots comportant de 15 à 30 substances hautement prioritaires aux fins de commentaires par l'industrie et par les parties intéressées. De nouveaux lots sont publiés tous les trois mois aux fins de commentaires.
Par ailleurs, le pouvoir de collecte d'information prévu à l'article 71 de la LCPE (1999) est utilisé dans le cadre du Défi pour rassembler des renseignements particuliers là où il se doit. Ces renseignements qui sont recueillis au moyen du Défi seront utilisés pour prendre des décisions éclairées et gérer comme il se doit tout risque qui pourrait être associé à ces substances.
La substance Phosphate de tris(2-chloroéthyle), numéro 115-96-8 du registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS)1, ci-après appelée « PTCE », est incluse dans le cinquième lot du Défi, conformément au Plan de gestion des produits chimiques.
1.2 Conclusions du rapport final d'évaluation préalable visant le phosphate de tris(2-chloroéthyle)
Le 22 août 2009, Environnement Canada et Santé Canada ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada,un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d’évaluation préalable visant le phosphate de tris(2-chloroéthyle), conformément au paragraphe 77(6) de la LCPE (1999).
D’après les renseignements contenus dans le rapport d’évaluation préalable, il est conclu que le PTCE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constitue ou peut constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu de la cancérogénicité du PTCE pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, ainsi que du manque de fiabilité possible du seuil d’exposition pour d’autres effets sur la santé, il est conclu que le PTCE est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à pouvoir constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.
Par conséquent, il est conclu que le PTCE ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE (1999), mais qu’il satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). De plus, cette substance satisfait aux critères de persistance et ne satisfait pas aux critères du potentiel de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (1999).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conclusions du rapport final d’évaluation préalable visant le PTCE, veuillez consulter le texte intégral du rapport, à l’adresse http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot_5_f.html.
1.3 Gestion des risques proposée
À la suite d'une évaluation préalable d'une substance énoncée à l'article 74 de la LCPE (1999), il peut être conclu que la substance satisfait à un ou à plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Les ministres peuvent proposer de ne rien faire, de l'inscrire sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire en vue d'une évaluation plus approfondie, ou encore de recommander son inscription à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. Dans certaines circonstances, les ministres doivent faire une proposition spécifique, soit de recommander un ajout à la Liste des substances toxiques, soit de recommander la mise en œuvre d'une quasi-élimination (ou les deux). Dans le cas présent, les ministres proposent de recommander l'ajout du PTCE à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1. Par conséquent, ils devront élaborer un projet de texte – règlement ou autre – concernant les mesures de prévention ou de contrôle à prendre pour protéger la santé des Canadiens ainsi que l'environnement contre les effets possibles d'une exposition à cette substance.
Le rapport final d'évaluation préalable a conclu que le PTCE ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Par conséquent, le PTCE ne sera pas visé par les dispositions de quasi-élimination de la LCPE (1999) et sera géré à l'aide d'une approche du cycle de vie afin de prévenir ou de réduire au minimum son rejet dans l'environnement.
2. Historique
2.1 Renseignements sur la substance
Le PTCE fait partie du groupe chimique des produits chimiques organiques définis ainsi que du sous-groupe chimique des phosphates d’alkyles.
Le tableau 1 présente les autres noms, les noms commerciaux, les groupes chimiques, la formule chimique, la structure chimique et la masse moléculaire du PTCE.
| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) | 115-96-8 |
| Nom dans la LIS | Phosphate de tris(2-chloroéthyle) |
| Noms dans les inventaires2 | Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (PICCS) Phosphate de tris(2-chloroéthyle)(AICS, ASIA-PAC, ENCS, PICCS, SWISS, TSCA) Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (EINECS, PICCS) Tri(2-chloroethyl)phosphate (ECL) |
| Autres noms | 3CF; Amgard TCEP; CEF; Celluflex CEF; CLP; Disflamoll TCA; Fyrol CEF; Fyrol CF; Genomoll P; Niax 3CF; Niax Flame; NSC 3213; Retardant 3CF; TCEP; tri(β-chloroethyl) phosphate; tri(2-chloroethyl) phosphate; tri(chloroethyl) phosphate; tris(β-chloroethyl) phosphate; tris(2-chloroethyl) orthophosphate; tris(chloroethyl) phosphate |
| Groupe chimique | Produits chimiques organiques définis |
| Sous-groupe chimique | Phosphates d’alkyles |
| Formule chimique | C6H12Cl3O4P |
| Structure chimique | 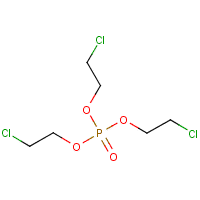 |
| SMILES | O=P(OCCCl)(OCCCl)OCCCl |
| Poids moléculaire | 285,49 g/mol |
3. Pourquoi devons-nous prendre des mesures
3.1 Caractérisation des risques
Essentiellement d’après l’évaluation fondée sur le poids de la preuve réalisée par la Commission européenne, la cancérogénicité est un des principaux effets du PTCE (Commission européenne, 1996, 1999). Cependant, en raison des résultats partagés des essais limités sur la génotoxicité in vivo et in vitro et l’éventail de tumeurs observées chez plusieurs espèces d’animaux de laboratoire pour lesquels le ou les modes d’induction n’ont pu être élucidés, on ne peut écarter la possibilité que le PTCE provoque la formation de tumeurs par un mécanisme d’action résultant d’une interaction directe avec le matériel génétique.
En ce qui concerne les effets non cancéreux, la dose minimale d’effet nocif observé (DME(N)O) pour l’exposition subchronique et à court terme était de 44 mg/kg de poids corporel (p.c.) par jour de PTCE, d’après l’augmentation de la masse relative du foie et des reins lors d’une étude de 16 semaines chez le rat par administration orale. On a également constaté une hyperplasie du tubule rénal et des tumeurs du tubule rénal et de la thyroïde à 44 mg/kg p.c. par jour de PTCE, la dose la plus faible examinée lors d’une étude de deux ans chez les rats.
Par ailleurs, plusieurs études par administration orale chez les rats et les souris ainsi que des études par inhalation chez les souris ont mis en évidence une toxicité pour la reproduction. La DMENO orale entraînant des effets sur la reproduction était de 700 mg/kg p.c. par jour chez les souris. Toutefois, cette valeur n’a pas pu être déterminée chez les rats en raison d’un manque d’information afin de caractériser la relation dose-effet dans des analyses critiques (les rats ayant reçu des doses de PTCE de 0, 22, 88 ou 175 mg/kg p.c. par jour). La seule étude examinant la toxicité de l’exposition répétée par inhalation a mis en évidence une toxicité testiculaire chez les souris à 0,5 mg/m3ou plus de PTCE pendant quatre mois.
La comparaison entre le niveau d’effet critique de l’administration répétée par voie orale (p. ex., 44 mg/kg p.c. par jour ayant entraîné des effets non-cancérogènes et une augmentation importante du nombre de tumeurs) et la limite supérieure estimée d’absorption quotidienne de PTCE dans les milieux environnementaux par l’ensemble de la population du Canada (soit 0,5 μg/kg p.c. par jour) donne une marge d’exposition d’environ 88 000. Si on tient compte de l’estimation des limites supérieures d’exposition cutanée à la poussière domestique, la marge d’exposition obtenue serait du même ordre de grandeur. Si l’on compare le seul niveau d’effet relevé concernant les effets sur la reproduction par inhalation (0,5 mg/m3) et l’estimation modérée de la limite supérieure d’exposition au PTCE par inhalation dans l’air intérieur (0,38 µg/m3), on obtient une marge d’exposition d’environ 1 300, alors que si on le compare avec la concentration moyenne dans l’air intérieur de ces maisons (0,02 µg/m3), on obtient une marge d’exposition de 25 000. Cependant, selon les données disponibles, les expositions de la population par inhalation dans l’air intérieur des écoles, des garderies, des bureaux, des véhicules de transport et d’autres endroits donneraient des marges d’exposition inférieures à celles présentées pour les résidences. L’exposition au PTCE peut également se produire lors de l’utilisation de produits de consommation. D’après une modélisation d’utilisation de ces produits, l’estimation d’exposition des consommateurs la plus élevée concernait des mousses ou tissus que les nourrissons (0 à 6 mois) et les enfants (6 mois à 4 ans) portent à la bouche contenant une concentration de PTCE égale à la solubilité dans l’eau de la substance, pour lesquels on a estimé une exposition quotidienne de 0,04 mg/kg p.c. pour les nourrissons et de 0,02 mg/kg p.c. pour les jeunes enfants. Si l’on compare cette estimation modérée avec le niveau d’effet critique d’exposition orale (44 mg/kg p.c. par jour), on obtient une marge d’exposition de 1 100 pour les nourrissons et de 2 200 pour les jeunes enfants (qui peuvent plus facilement accéder à ces produits que les nourrissons).
L’approche conservatrice a été utilisée dans la dérivation des conclusions de l’évaluation préalable incluant une mûre réflexion des incertitudes et des surestimations par rapport aux données toxicologiques et d’expositions.
3.2 Exposition des enfants
Les principales sources d’exposition au PTCE proviennent de l’air intérieur et de la poussière. Les enfants peuvent être exposés par contact avec les poussières contaminées des maisons, par inhalation du produit émis par les appareils électroniques (surtout les téléviseurs). Ces expositions sont secondaires au mâchonnement par les enfants des mousses de polyuréthane utilisées pour le rembourrage. Dans l’évaluation préliminaire sur le PTCE réalisée par l’Union européenne, les enfants qui mâchonnaient un jouet en mousse avaient les estimations d’exposition les plus élevées. Depuis, le jouet en question a été rappelé et retiré du marché de l’Union européenne. On ignore si des jouets vendus sur le marché canadien renferment du PTCE. Il est possible d’être exposé au PTCE par l’intermédiaire de sources alimentaires, mais ce type d’exposition est considéré comme une faible proportion de l’exposition totale.
4. Utilisations actuelles et secteurs industriels
D’après un sondage réalisé en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué une quantité de PTCE supérieure ou égale au seuil de déclaration de 100 kg en 2006. Cependant, les renseignements issus de cette même étude et des données fournies volontairement par l’industrie indiquent que la quantité totale de PTCE importée au Canada en 2006 se situe entre 100 000 et 1 000 000 kg (Environnement Canada, 2008a, 2008b).
Les renseignements obtenus en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), indiquent que le PTCE a été utilisé comme additif ignifuge dans les mousses de polyuréthane employées dans les coussins d’automobile. (Environnement Canada 2008a, 2008b). Le PTCE peut également avoir des applications comme composant de produits industriels de construction de toiture (Marklund et al., 2005). Il a des utilisations connues dans les adhésifs.
À l’échelle mondiale, le PTCE est principalement utilisé comme plastifiant et régulateur de viscosité en raison de ses propriétés ignifugeantes dans les polyuréthanes, les résines de polyester, les polyacrylates, le polychlorure de vinyle, les dérivés cellulosiques et d’autres polymères (CIRC, 1990, EURAR, 2006). Le PTCE a été utilisé dans les mousses de polyuréthane souples et rigides présentes dans les isolants des toitures et dans les meubles rembourrés. Les produits contenant du PTCE sont utilisés dans l’industrie du textile (p. ex., pour l’endos des tapis); dans la fabrication de voitures, de wagons et d’aéronefs; dans les composés en polychlorure de vinyle; dans les peintures et vernis ignifugés; dans les résines époxydes, phénoliques et aminiques; dans les agglomérés de bois, les adhésifs et les vernis-laques (CIRC 1990; PISSC, 1998; EURAR, 2006; OCDE, 2006). Les produits ignifuges sont également utilisés dans le domaine aéronautique pour la suppression des feux dans les aéronefs (American Fire Safety Council, 2005).
Dans les pays de l’Union européenne, le PTCE a historiquement été utilisé dans la production de mousses et de systèmes de polyuréthane rigides et souples, mais cette utilisation affiche une baisse depuis les années 1980 et le PTCE a été remplacé par d’autres ignifugeants (EURAR, 2006; PISSC 1998). L’emploi du PTCE comme ignifugeant dans les tissus pour usage vestimentaire n’est pas recommandé (CIRC, 1990; PISSC, 1998).
5. Présence dans l'environnement au Canada et sources d'exposition
5.1 Rejets dans l'environnement
Selon les renseignements fournis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), 7 kg de PTCE ont été rejetés dans les systèmes d’égouts sanitaires et d’aqueduc en 2006 (Environnement Canada, 2008a). Le PTCE a aussi été décelé dans certaines sources municipales d’eau potable au Canada (Canada, 2009).
Les rejets de PTCE ne sont pas déclarés actuellement à l’Inventaire national des polluants (INRP, 2006) ni au Toxic Release Inventory des États-Unis (TRI, 2006).
Le PTCE peut être rejeté lors de sa préparation et de son traitement, principalement dans les eaux usées et, dans une moindre mesure, dans les gaz d’échappement (OCDE, 2006). Il peut également être rejeté dans l’environnement lors de l’utilisation par les consommateurs de produits contenant cette substance et lors de leur élimination dans les sites d’enfouissement. En raison de la forte solubilité dans l’eau du PTCE, un important lessivage provenant des sites d’enfouissement pourrait se produire (OCDE, 2006) Le PTCE a été détecté dans divers systèmes hydrographiques et lixiviats de décharge (Ishikawa et al., 1985; Yasuhara, 1994; Scott et al., 1996; PISSC, 1998; Yasuhara et al., 1999 Fries et Püttmann, 2003; Andresen et al., 2004).
5.2 Sources d'exposition
Le PTCE n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Cette substance est obtenue en faisant réagir de l’oxychlorure de phosphore et de l’oxyde d’éthylène et doit ensuite être purifiée (CIRC, 1990; PISSC, 1998).
Les principales sources d’exposition au PTCE sont l’air intérieur et la poussière, ces expositions sont secondaires au PTCE libéré par les produits et les matériaux utilisés dans la maison, notamment : la mousse de polyuréthane des meubles; les produits électroniques (p. ex., les téléviseurs et les ordinateurs); les adhésifs; les textiles autres que pour vêtements; les tissus d’ameublement; l’endos des tapis; le caoutchouc et le plastique; les peintures et les vernis.
6. Aperçu des mesures existantes
6.1 Gestion des risques existante au Canada
Aucune mesure de gestion des risques associée spécifiquement au PTCE n’a été identifiée. À l’échelle provinciale, la Colombie-Britannique possède des normes limitant les concentrations dans les sols en zones rurales, urbaines et industrielles, ainsi qu’une norme pour l’eau potable.
6.2 Gestion des risques existante à l'étranger
Le PTCE est inscrit dans la proposition 65 de la Californie et figure également dans l’inventaire des produits chimiques prévu à l’article 8(b) de la Toxic Substances Control Act (TSCA).
Le PTCE se trouve sur la liste des substances dangereuses pour l’environnement par le Conseil des ministres des pays nordiques.
Le PTCE a été reconnu comme substance chimique produite en grande quantité (HPV) dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2003) et aux États-Unis (US EPA, 1990).
En Australie, l’État du Queensland possède un règlement pour la santé publique (« 2005 Schedule 3B Queensland Consolidated Regulations ») qui fixe une norme de 1 g/L de PTCE dans l’eau recyclée à des fins d’approvisionnement en eau potable.
L’Allemagne a proposé la directive I sur la qualité de l’air intérieur pour le PTCE de 0,005 mg/m3 ou 5 µg/m3 (Sagunski et Rosskamp, 2002).
L’Allemagne a proposé la directive II sur la qualité de l’air intérieur pour le PTCE de 0,05 mg/m3 ou 50 µg/m3 (Sagunski et Rosskamp, 2002).
7. Considérations
7.1 Substances chimiques de remplacement ou substituts
Tout le PTCE utilisé à des fins commerciales est produit en faisant réagir de l’oxychlorure de phosphore et de l’oxyde d’éthylène, suivi d’une purification.
La production de PTCE a diminuée depuis les vingt dernières années, car son utilisation pour la production de mousses polyuréthanes et de systèmes rigides et souples a été remplacée par d’autres substances ignifuges.
En Europe, le PTCE, NE CAS 115-96-8, n’est plus fabriqué pour être utilisé dans les mousses et a été remplacé par le tris (1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP), NE CAS 13674-84-5. Le TCPP est un mélange de quatre isomères. Au Canada, le TCPP n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer s’il correspond aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). TCPP est une substance de priorité moyenne pour l’évaluation sous le dans le Plan de gestion des produits chimiques.
L’ébauche de l’évaluation des risques de l’Union européenne mentionne que la production de PTCE en Europe a cessé (cela fait référence aux pays de l’Union européenne avant l’accueil de nouveaux pays le 1er mai 2004), et que son traitement a été réduit. Néanmoins, le PTCE et les produits connexes au PTCE sont toujours commercialisés dans l’Union européenne (EURAR, 2006).
Malgré l’absence de production de PTCE dans les pays de l’Union européenne pour l’année 2001-2002, trois entreprises ont déclaré avoir importé environ 1 150 tonnes de PTCE en Union européenne, en partie en provenance de Russie et de Pologne. Dans le contexte de l’évaluation des risques réalisée par l’Union européenne, la Russie et la Pologne sont considérés ne pas faire partie de l’Union européenne. Étant donné que 143 tonnes supplémentaires ont été exportées par la suite, on estime à 1 007 tonnes le tonnage total annuel pour l’Union européenne. Cette valeur est utilisée dans le calcul de l’exposition environnementale dans l’évaluation des risques réalisée par l’Union européenne (EURAR, 2006).
En 2005, l’Allemagne, le pays de l’Union européenne qui produits des rapports sur l’évaluation des risques avait reçu des données d’un nouvel état membre de l’Union européenne qui déclarait une production de 300 à 500 tonnes pour l’année 2004. En outre, les exportations étaient d’environ 300 à 400 tonnes en 2004. Malgré ces données transmises volontairement, l’évaluation des risques de l’Union européenne considère le tonnage annuel total de 1 007 tonnes pour l’Union européenne comme la valeur clé. (EURAR, 2006).
7.2. Considérations socioéconomiques
Les facteurs socioéconomiques ont été pris en considération dans le processus de sélection d'un règlement et/ou d'un instrument respectant les mesures de prévention ou de contrôle et dans la détermination des objectifs de gestion des risques. Les facteurs socioéconomiques seront également pris en considération dans l'élaboration d'un règlement, d'instruments et/ou d'outils, comme il est indiqué dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007) et dans les conseils fournis dans le document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale.
8. Objectifs proposés
8.1. Objectif concernant la santé humaine
L’objectif concernant la santé humaine proposé pour le PTCE est de réduire les expositions au PTCE dans la limite du possible, étant donné qu’on ne peut pas l’exclure en se basant sur les preuves disponibles actuellement, selon lesquelles le PTCE n’est pas une substance cancérogène sans seuil.
8.2. Objectif de gestion des risques
Un objectif de gestion des risques est une cible visée pour une substance donnée, et ce, en mettant en œuvre un règlement, un ou des instruments et/ou un ou des outils de gestion des risques. L’objectif de gestion des risques proposé pour le PTCE est de réduire l’exposition au PTCE en l’éliminant des produits présents dans les maisons.
9. Gestion des risques proposée
9.1. Approche de gestion des risques proposé(s)
Comme l'exigent la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation3 du gouvernement du Canada et les critères déterminés dans le document du Conseil du Trésorintitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale, il a fallu procéder de manière cohérente pour choisir les instruments de gestion des risques proposés, et il a fallu prendre en considération l'information recueillie dans le cadre du Défi ainsi que toute autre information alors disponible.
Les principales sources d’exposition au PTCE sont l’air intérieur et la poussière, ces expositions sont secondaires au PTCE libéré par les produits et les matériaux utilisés dans la maison, notamment : la mousse de polyuréthane des meubles; les produits électroniques (p. ex., les téléviseurs et les ordinateurs); les adhésifs; les textiles autres que pour vêtements; les tissus d’ameublement; l’endos des tapis; le caoutchouc et le plastique; les peintures et les vernis. La gestion des risques envisagée est d’interdire l’utilisation du PTCE dans ces produits et matériaux. L’étendue finale de cette interdiction sera déterminée après plus amples consultation et discussion avec les parties intéressées.
9.2. Plan de mise en œuvre
Le règlement ou instrument proposé concernant les mesures de prévention ou de contrôle, y compris l’interdiction, relatives au PTCE sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard au mois de septembre 2011, selon les délais indiqués dans la LCPE (1999).
10. Approche de consultation
Le cadre de gestion des risques pour le PTCE, qui résumait la gestion des risques proposée étudiée à ce moment-là, a été publié le 21 février 2009. L’industrie et les autres parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires sur ce cadre de gestion des risques au cours d’une période de commentaires de 60 jours. Les commentaires reçus relativement à ce cadre de gestion ont été pris en considération au moment de l’élaboration de la présente approche de gestion des risques proposée.
Les commentaires sur le cadre de gestion des risques seront examinés après le 21 octobre 2009, une fois la période de commentaire de 60 jours terminée.
Les principales parties intéressées comprennent :
- le secteur de fabrication de mousse de polyuréthane flexible et rigide;
- l’Association canadienne des constructeurs de véhicules;
- le secteur de fabrication d’aéronefs;
- les fabricants de meubles rembourrés;
- les fabricants d’équipement électronique;
- l’Association canadienne du jouet et la Children’s Safety Association of Canada;
- les organisations non gouvernementales;
- toutes les parties intéressées, notamment Santé Canada et Environnement Canada
11. Prochaines étapes et échéancier proposé
| Mesures | Date |
|---|---|
| Consultation électronique portant sur l'approche de gestion des risques proposée | Du 22 août 2009 au 21 octobre 2009 |
| Réponse aux commentaires portant sur l'approche de gestion des risques proposée | Au moment de la publication de l'instrument proposé |
| Consultation sur l’ébauche de règlement ou de l’instrument | Automne-hiver 2009 |
| Publication du règlement ou de l’instrument proposé | Au plus tard en août 2011 |
| Période de commentaires publics officielle concernant le règlement ou l’instrument proposé | Au plus tard à l’automne 2011 |
| Publication du règlement ou de l’instrument final | Au plus tard en fevrier 2013 |
Les représentants de l'industrie et les autres parties intéressées sont invités à présenter leurs commentaires sur le contenu de la présente approche de gestion des risques proposée et à transmettre tout autre renseignement qui pourrait contribuer à éclairer la prise de décisions. Veuillez faire parvenir ces commentaires ou renseignements au plus tard le 21 octobre 2009, car à compter de cette date, la gestion des risques pour le PTCE sera entreprise. Au cours de l'élaboration de règlement, de ou des instruments et/ou de ou des outils, il y aura des occasions de consultation. Veuillez transmettre tout commentaire ou autre renseignement ayant trait à la présente approche de gestion des risques proposée à l'adresse suivante :
Division de la gestion des produits chimiques
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Tél. : 1-888-228-0530/819-956-9313
Télécopieur : 819-953-7155
Adresse électronique : Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca
12. Références
American Fire Safety Council. 2005. Fire Retardants Helped Save Lives in Toronto Air Crash. Accès :
http://www.flameretardants.eu/Objects/2/Files/FlameRetardantsHelpedPrevent
FatalitiesinAirCanadaCrash.pdf
Andresen J, Grundmann A, Bester K. 2004. Organophosphorus flame retardants and plasticizers in surface waters. Total Environ. Sci. 332:155-166.
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999. L.C. 1999, chap. 33, Gazette du Canada. Partie III, Vol. 22, no 3. Ottawa : Imprimeur de la Reine. Accès : http://www.gazette.gc.ca/archives/p3/1999/g3-02203.pdf
Canada, ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2009. Ébauche d’évaluation préalable pour le Défi concernant le phosphate de tris(2-chloroéthyle) (PTCE). Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 115-96-8. Accès : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
[CIRC] Centre international de recherche sur le cancer. 1990. Centre international de recherche sur le cancer. Some flame retardants and textile chemicals, and exposures in the textile manufacturing industry. Monographie du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme, Vol. 48. Organisation mondiale de la Santé Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Lyon, France. p. 109. Accès : http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol48/volume48.pdf
Commission européenne. 1996. Summary Record Commission Working Group on the Classification and Labelling of Dangerous Substances. Rencontre au Bureau européen des substances chimiques à Ispra, du 25 au 27 septembre 1996. Direction générale du CCR de la Commission européenne. Centre commun de recherche. Bureau européen des substances chimiques. ECBI/34/96 – Rév. 2. Accès : http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Classification-Labelling/ADOPTED_SUMMARY_RECORDS/3496r2_cmr0996.pdf
Commission européenne. 1999. Phosphate de tris(2-chloroéthyle). Directive 98/98/EC de la Commission européenne datée du 15 décembre 1998. Annexe I. Journal officiel de l’Union européenne. 15 novembre1999. L 293/87. Commission européenne. Rectificatif, 25e ATP. Accès : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:293:0001:0079:FR:PDF
Environnement Canada. 2008a. Données sur les substances du groupe 5 recueillies en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, article 71 : Avis concernant les substances du groupe 5 du Défi. Données préparées par Environnement Canada, Programme sur les substances existantes.
Environnement Canada. 2008b. Soumission volontaire de données relatives aux substances contenues dans le lot 5 recueillies dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques en vertu du Défi. Données préparées par Environnement Canada, Division des substances existantes.
[EURAR] Union européenne. Rapport d’évaluation des risques. NE CAS no 115-96-8: Phosphate de tris (2-chloroéthyle) PTCE [Internet]. 2006. Luxembourg. Office des publications officielles des Communautés européennes. Ébauche de rapport du 2 mars 2006. [consulté le 15 mars 2007]. Accès : http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/DRAFT/R068_0603_env.pdf
Fries E, Püttmann W. 2003. Monitoring of the three organophosphate esters TBP, TCEP and TBEP in river water and ground water (Oder, Allemagne). J. Environ. Monit. 5:346-352.
[INRP] Inventaire national des rejets de polluants [base de données sur Internet]. 2006. Gatineau (Québec) : Environnement Canada. [consulté le 7 août 2008]. Accès : http://www.ec.gc.ca/pdb/querysite/query_e.cfm
Ishikawa S, Taketomi M, Shinohara R. 1985. Determination of trialkyl and triaryl phosphates in environmental samples. Water Research. 19(1):119-125.
Marklund A, Andersson B, Haglund P. 2005. Organophosphorus flame retardants and plasticizers in air from various indoor environments. .t Environ. Monit., 7:814-819.
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 2003. Manual for Investigation of HPV Chemicals. Secrétariat de l’OCDE, Paris, France. Avril. [consulté en février 2004]. Accès : http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_34379_1947463_1_1_1_1,00.html
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 2006. SIDS Initial assessment profile for 115-96-8. SIAM 23, 17 au 20 octobre [Internet]. OECD Integrated HPV Database [consulté le 7 août 2008]. Accès : http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/index.asp
[PISSC] Programme international sur la sécurité des substances chimiques. 1998. Flame retardants: Tris(chloropropyl) Phosphate and Tris(2-chloroehtyl) Phosphate. Genève (Suisse). Organisation mondiale de la Santé. (Critère 209 de salubrité de l’environnement). Financé conjointement par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation internationale du travail et l’Organisation mondiale de la Santé.
Sagunski H, Rosskamp H. 2002.Bundesgesundheistsbl-Gesundheits-forch-Gesundheitsschutz45:300
Scott BF, Sverko E, Maguire RJ. 1996. Determination of benzothiazole and alkylphosphates in water samples from the Great Lakes drainage basin by gas chromatography/atomic emission detection. Water Qual. Res. J. Canada 31(2):341-360.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007. Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, Section 4.4. Accès : http://www.regulation.gc.ca/directive/directive01-fra.asp
Technologie des plastiques. 2009. Feature Article: Polyurethanes: Regulatory Cost Pressures Spur Foam Formulators. Rédigé par Lilli Manolis Sherman.
[TRI] Toxic Release Inventory Program [Internet]. 2006. Washington (DC), U.S. Environmental Protection Agency Accès : http://www.epa.gov/triexplorer/
[US EPA] United States Environmental Protection Agency. 1990. High production volume (HPV) challenge program: the HPV voluntary challenge chemical list. Washington (DC), U.S. Environmental Protection Agency. Accès : http://www.epa.gov/hpv/pubs/update/hpvchmlt.htm
Yasuhara A. 1994. Determination of tris(2-chloroethyl) phosphate in leachates from landfills by capillary gas chromatography using flame photometric detection. J. Chromtog. A., 684:366-369.
Yasuhara A, Shiraishi H, Nishikawa M, Yamamoto T, Nakasugi O, Okumura T, Kenmotsu K, Fukui H, Nagase M, Kawagoshi Y. 1999. Organic components in leachates from hazardous waste disposal sites. Waste Manage. Res., 17:186-197.
Notes de bas de page
2 Source : National Chemical Inventories (NCI) 2008 : AICS (inventaire des substances chimiques de l’Australie); ASIA-PAC (inventaires combinés de substances de l’Asie-Pacifique); ECL (liste des produits chimiques existants de la Corée); EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes); ENCS (inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles du Japon); NZIoC (inventaire des substances chimiques de la Nouvelle-Zélande); PICCS (inventaire des produits et substances chimiques des Philippines); SWISS (inventaire des nouvelles substances notifiées de la Suisse et Liste des toxiques 1); TSCA (inventaire des substances chimiques visées par la Toxic Substance Control Act des États-Unis).
3 La section 4.4 de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation précise que « les ministères et les organismes doivent [...] déterminer l'instrument ou la combinaison appropriée d'instruments – y compris des mesures de nature réglementaire et non réglementaire – et justifier leur application avant de soumettre un projet de règlement ».