Hespérie persius de l'est : évaluation et rapport de situation du COSEPAC : chapitre 5
Rapport de situation du COSEPAC
sur
l’Hespérie Persius de l'Est
Erynnis persius persius
au Canada
2006
Information sur l'espèce
L’hespérie Persius de l’Est (Erynnis persius) a été décrite pour la première fois en 1863, mais la description originale est ambiguë, car Scudder (1863) a manifestement confondu l’E. persiusavec deux autres hespéries encore non décrites à l’époque, l’E. baptisiae (Forbes) et l’E. lucilius (Scudder et Burgess), également connue sous le nom d’hespérie de l’ancolie. Cette confusion a persisté au sein de la communauté scientifique pendant de nombreuses années, notamment chez Skinner (1914), qui a décrit les genitalia mâles d’une hespérie qu’il croyait être l’E. persius alors qu’il s’agissait, selon Matt Holder, de l’E. baptisiae. Scudder et Burgess (1870) et Forbes (1936) ont décrit et illustré correctement les genitalia de l’E. persius. Forbes (1936) a mentionné l’existence de matériel type et décrit les genitalia d’après le spécimen type, mais Scudder (1863) n’a pas désigné de types dans sa description originale, et on ne sait pas exactement où se trouve le matériel type, à supposer qu’il existe encore.
Trois des quatre sous-espèces décrites, soit l’E. p. persius, l’E. p. borealis et l’E. p. avinoffi, pourraient être présentes au Canada. L’E. p. borealis a été décrit par Cary (1907), mais il était considéré à l’époque comme une race de l’E. propertius Scudder et Burgess. Cette race commune et largement répandue se rencontre dans tout le nord et l’ouest du Canada, depuis la baie James en Ontario jusqu’au Yukon. Les aires de répartition connues de l’E. p. borealis et de l’E. p. persius ne se chevauchent pas et semblent au contraire séparées par au moins 1 000 km (figure 1), si l’on se fie aux données de collecte présentées par le Système canadien d’information sur la biodiversité (2005) et aux données de l’United States Geological Survey (2005). La description de l’E. p. avinoffi (Holland 1930) est fondée sur une série de spécimens capturés dans la vallée de la rivière Yukon et en divers endroits en Alaska. On connaît très peu de choses sur l’aire de répartition de cette sous-espèce, mis à part les localités énumérées dans la description originale, et Layberry et al. (1998) ne considèrent pas ce taxon comme une sous-espèce valide. La quatrième sous-espèce, l’E. p. fredericki, habite l’ouest des États-Unis et ne se rencontre pas au Canada. Les aires de répartition de l’E. p. persius et des trois autres sous-espèces en Amérique du Nord sont présentées à la figure 1.
D’autres recherches sur la taxinomie du complexe E. persius s’imposent pour éclaircir les limites spatiales et la répartition de ses éléments constitutifs. Burns (1964) n’a pas étudié ce complexe de façon approfondie, se contentant de décrire brièvement les difficultés entourant sa taxinomie et de signaler l’existence d’affinités étroites entre les quatre taxons. Compte tenu de ses caractéristiques biologiques (plantes hôtes et besoins liés à l’habitat) et morphologiques particulières, l’E. p. persius devrait peut-être être considéré comme une espèce distincte des trois sous-espèces de l’Ouest (voir Kondla et Guppy, 2001).
Figure 1 : Aire de répartition de l’Erynnis persius en Amérique du Nord

Aire de l’E. p. persius illustrée en gris; aires des trois autres sous-espèces regroupées et illustrées en noir)
L’hespérie Persius de l’Est est un petit papillon diurne foncé qui mesure de 24 à 31 mm d’envergure (figure 2). Les ailes antérieures sont marquées de plages grises diffuses séparées par une ligne de quatre taches blanches; une cinquième tache blanche peut être présente au bas d’une des plages grises. Le dessus des ailes antérieures est en bonne partie couvert de fines écailles sétiformes, dont une proportion variable est blanche. Une rangée de taches grises subapicales s’étend le long du bord externe des ailes antérieures. Les ailes postérieures sont brun foncé, mouchetées de petites taches d’un brun légèrement plus pâle. La tête, le thorax et l’abdomen sont brun foncé.

Dessin original d’Andrea Kingsley. 3x grandeur nature.
En dépit d’affirmations contraires (Balogh 1981; Nielsen 1999), la répartition et la forme des taches sur les ailes antérieures n’ont aucune valeur diagnostique (D. Lafontaine, comm. pers., 2002; D. Schweitzer, comm. pers., 2002; M. Holder, obs. pers.). Un examen d’une série de spécimens de la collection du Musée royal de l’Ontario et de la Collection nationale canadienne a révélé que l’abondance des poils blancs et la disposition des petites taches blanches sur les ailes antérieures, dont le bord basal détermine une ligne droite, sont caractéristiques de l’espèce, mais si variables chez l’E. persius et ses proches parents, les E. lucilius et E. baptisiae , qu’ils n’ont aucune valeur diagnostique. Les différences relevées dans le choix des plantes hôtes peuvent aider à départager les trois espèces dans une certaine mesure, mais non de façon absolue, car si l’E. lucilius est associé exclusivement à l’ancolie du Canada (Aquilegia canadensis L.), l’E. baptisiae exploite les mêmes plantes hôtes que l’E. persius, à savoir la baptisie des teinturiers (Baptisia tinctoria (L.) R. Br. ex Ait. f.) et le lupin vivace (Lupinus perennis L.), en plus d’autres espèces comme la baptisie bleue (B. australis (L.) R. Br. ex Ait. f.) et la coronille bigarrée (Coronilla varia L.). La méthode la plus fiable pour identifier l’E. persius au stade adulte consiste à examiner les genitalia mâles, leur forme étant un caractère diagnostique (figure 3). Les valves droite et gauche des genitalia de l’E. p. persius, de l’E. baptisiae et de l’E. lucilius sont présentées à des fins de comparaison (figure 3); les caractères distinctifs sur les lobes supérieur et inférieur des valves sont indiqués par des flèches. Les genitalia de l’E. baptisiae ressemblent à bien des égards à ceux de l’E. lucilius, mais ils s’en distinguent par la plus forte épaisseur du lobe supérieur de la valve gauche. L’utilisation d’un microscope à dissection est indispensable pour l’examen des genitalia. Avant d’entreprendre un tel examen, il faut enlever les poils et les écailles qui recouvrent les genitalia à l’aide d’un petit pinceau. L’identification des femelles soulève des difficultés, et Matt Holder ne dispose d’aucun caractère diagnostique utile autre que les caractéristiques générales des ailes décrites précédemment.
Figure 3 : Diagramme illustrant les valves droite (à droite) et gauche des genitalia mâles
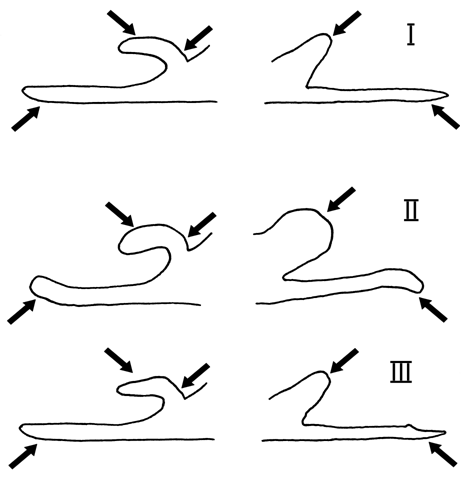
Les valves sont illustrées en position inversée et en vue latérale. Les flèches indiquent les caractères utiles pour départager les trois espèces. i) Erynnis lucilius; ii) Erynnis persius; iii) Erynnis baptisiae (Dessin original de Matt Holder)
Les adultes sont décrits et illustrés dans Klots (1951), Allen (1997), Layberry et al. (1998) et Glassberg (1999). Une description détaillée des adultes est présentée dans Burns (1964).
Selon Layberry et al. (1998), la chenille de l’E. persius est semblable à celle de l’E. afranius, qui est vert pâle, avec des rayures noir et jaune sur le dos. La chenille de l’E. p. borealis est vert pâle, avec de nombreuses taches blanches (Guppy et Shepard, 2001). La tête est ronde et brune, alors qu’elle est angulaire et noire chez l’E. lucilius (figure 4; Lindsey, 1927; Layberry et al., 1998). La chenille de l’E. baptisiae demeure à décrire (Layberry et al. 1998), mais sa description pourrait contribuer à accroître la confusion qui entoure le statut de l’E. p. persius.
Figure 4 : Capsule céphalique d’une chenille du cinquième stade de l’Erynnis persius persius

Dessin de Matt Holder, d’après Lindsey, 1927.