Platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) : évaluation et rapport de situation du COSEPAC 2016
Platanthère blanchâtre de l’Ouest

En voie de disparition
2016
Table des matières
- Table des matières
- COSEPAC Sommaire de l’évaluation
- COSEPAC Résumé
- Résumé technique
- Préface
- Description et importance de l’espèce sauvage
- Répartition
- Habitat
- Biologie
- Taille et tendances des populations
- Menaces et facteurs limitatifs
- Menaces
- 1) Modifications des systèmes naturels (7.0) - Impact calculé moyen-faible.
- 2) Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (11.0, altération de l’habitat, sécheresses, tempêtes et inondations) - Impact calculé moyen-faible.
- 3) Agriculture (2.0) - Impact calculé faible.
- 4) Corridors de transport et de service (4.0, routes et voies ferrées [4.1] et lignes de services publics [4.2]) - Impact calculé faible.
- 5) Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques (8.0) - Impact calculé faible.
- 6) Pollution (9.0, effluents agricoles et sylvicoles [9.3]) - Impact calculé faible.
- Facteurs limitatifs
- Nombre de localités
- Menaces
- Protection, statuts et classements
- Remerciements et experts contactés
- Sources d’information
- Sommaire biographique des rédactrices du rapport
- Collections examinées
- Annexe 1. Évaluation des menaces pesant sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest.
Liste des figures
- Figure 1. Platanthère blanchâtre de l’Ouest.
- Figure 2. Répartition mondiale de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, représentée par les sous-populations existantes.
- Figure 3. Emplacement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba.
- Figure 4. Nombre de tiges florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la région à proximité de Vita, au Manitoba, par rapport au nombre de quarts de section visités (graphique créé à partir des données du tableau 1).
- Figure 5. Nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la région à proximité de Vita, au Manitoba (graphique créé à partir des données du tableau 1, Borkowsky, comm. pers., 2015)
- Figure 6. Platanthères blanchâtres de l’Ouest poussant en bordure d’un chemin.
Liste des tableaux
- Tableau 1. Nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest recensés dans la région près de Vita, au Manitoba. (Borkowsky, comm. pers., 2015.)
- Tableau 2. Plantes vasculaires associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Manitoba (Punter, 2000).
- Tableau 3. Répartition estimative de l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest entre les régimes fonciers / régimes de gestion (Cary Hamel, comm. pers., 2016).
Information sur le document
Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Platanthère blanchâtre de l’Ouest Platanthera praeclara au Canada 2016
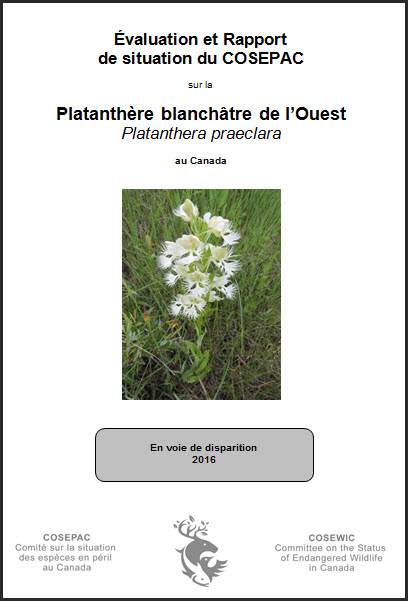
COSEPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril
au Cananda

COSEWIC
Committee on the Status
of Endangered Wildlife
in Canada
Les rapports de situation du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages que l’on croit en péril. On peut citer le présent rapport de la façon suivante :
COSEPAC. 2016. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xii + 54 p.
(Registre public des espèces en péril site Web).
Rapport(s) précédent(s) :
COSEPAC. 2000. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 27 p.
PUNTER, C. E. 2000. Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada – Mise à jour, in Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. Pages 1-27.
COLLICUTT, D. R. 1993. COSEWIC status report on the Western Prairie White Fringed Orchid, Platanthera praeclara in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada. Ottawa. 45 p.
Note de production :
Le COSEPAC remercie Pauline K. Catling et Vivian R. Brownell d’avoir rédigé le rapport de situation sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada, aux termes d’un marché conclu avec Environnement et Changement climatique Canada. La supervision et la révision du rapport ont été assurées par Bruce Bennett, coprésident du Sous-comité de spécialistes des plantes vasculaires du COSEPAC.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s’adresser au :
Secrétariat du COSEPAC
a/s Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : 819-938-4125
Téléc. : 819-938-3984
Courriel : COSEPAC courriel
Site web : COSEPAC
Also available in English under the title COSEWIC Assessment and Status Report on the Western Prairie Fringed Orchid Platanthera praeclara in Canada.
Illustration/photo de la couverture :
Platanthère blanchâtre de l’Ouest - Photo : Pauline K. Catling. Cette photo ne peut pas être reproduite séparément du présent document sans la permission de la photographe.
COSEPAC
Sommaire de l’évaluation
Sommaire de l’évaluation - novembre 2016
- Nom commun
- Platanthère blanchâtre de l’Ouest
- Nom scientifique
- Platanthera praeclara
- Statut
- En voie de disparition
- Justification de la désignation
- Cette espèce est une orchidée rare à l’échelle mondiale qui se trouve dans une partie restreinte des prairies d’herbes hautes restantes du sud–est du Manitoba. Elle est menacée par de larges processus d’intervention touchant l’étendue et la qualité de l’habitat, tels que le changement des régimes des feux et la modification des conditions d’humidité du sol attribuables aux tranchées de drainage et aux changements climatiques.
- Répartition
- Manitoba
- Historique du statut
- Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2016.
COSEPAC
Résumé
Platanthère blanchâtre de l’Ouest
Platanthera praeclara
Description et importance de l’espèce sauvage
La platanthère blanchâtre de l’Ouestest une plante herbacée vivace qui produit une ou parfois deux tiges feuillées glabres hautes d’environ 40 à 90 cm à partir d’un tubercule effilé combiné à un système racinaire épais et charnu. Chaque inflorescence est composée de 4 à 33 fleurs voyantes blanc crème relativement grandes. La platanthère blanchâtre de l’Ouest a connu un déclin de plus de 60 % de son aire de répartition nordaméricaine d’origine, et de nombreuses sous-populations comptent moins de 50 individus.La population de platanthère blanchâtre de l’Ouest située près de Vita, au Manitoba, se trouve à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce et est la plus grande population connue dans le monde. On estime que plus de 70 % de la population mondiale de l’espèce se trouvent au Canada.
Répartition
L’aire de répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest s’étend du sud-est du Manitoba jusqu’au Minnesota, à l’est du Dakota du Nord, au Nebraska, à l’Iowa, au Missouri et au Kansas. L’espèce est apparemment disparue du Dakota du Sud et de l’Oklahoma. Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest se rencontre uniquement dans le sud-est du Manitoba, à l’ouest de Vita, dans une zone d’environ 100 km2.
Habitat
La platanthère blanchâtre de l’Ouest pousse dans des loams sableux calcaires humides à mésiques, dans des prairies à herbes hautes, des prés de carex et des fossés bordant des routes.
Biologie
Dans la population canadienne, les parties aériennes apparaissent à la fin mai, et les inflorescences sont déjà produites à la fin juin. À la mi-juillet, la plupart des individus matures sont en pleine floraison, et chaque nouvelle fleur demeure ouverte durant plusieurs jours. Toutefois, les individus qui n’ont pas atteint la maturité demeurent à l’état végétatif durant toute l’année. La pollinisation est assurée par des sphinx et se déroule durant la nuit. Les individus portent des capsules à la fin août et commencent à se flétrir au début septembre. On dispose de peu de renseignements sur la germination des graines et les premiers stades du développement. On sait toutefois que des champignons mycorhiziens sont nécessaires au développement de l’espèce. La reproduction se produit principalement par voie sexuée. Certains individus peuvent demeurer en dormance dans le sol durant une année ou plus et dépendent alors de leurs champignons mycorhiziens pour obtenir leurs nutriments. La platanthère blanchâtre de l’Ouestentretient une relation symbiotique avec des champignons mycorhiziens, de la germination au stade adulte.
Taille et tendances des populations
La population canadienne, découverte en 1984, est considérée comme la plus grande au monde. Elle pousse dans un des trois seuls sites en Amérique du Nord qui comptent plus de 1 000 individus. L’espèce se caractérise par sa floraison irrégulière et ses pics de floraison survenant les années où les précipitations et la teneur en eau du sol sont élevées. Le nombre d’individus florifères fluctue grandement d’une année à l’autre; 23 500 tiges florifères ont été dénombrées en 2003, contre seulement 763 en 2012. Le nombre d’individus florifères dénombré au cours des 10 dernières années (2006-2015) a varié de 763 à 14 685.
Menaces et facteurs limitatifs
La répartition de l’espèce est limitée au Canada, et il existerait très peu de milieux propices à l’espèce à l’extérieur de la région de Vita, voire aucun. Les individus sont sensibles aux effets climatiques périodiques et aux perturbations anthropiques, notamment la conversion de son habitat en terres agricoles, le surpâturage, le drainage, la modification des fossés, les espèces envahissantes et le changement climatique. Selon le calculateur des menaces, l’impact global des menaces est élevé. Les incendies périodiques sont nécessaires au maintien de l’habitat de prairie à herbes hautes. L’espèce semble posséder une capacité de reproduction relativement faible, puisque seulement une petite proportion des fleurs donnent des capsules. La fluctuation des populations de pollinisateurs, le vent et la température ont une incidence sur la pollinisation.
Protection, statuts et classements
La platanthère blanchâtre de l’Ouesta été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en 1993 et a alors été désignée espèce en voie de disparition, puis son statut a été réévalué et maintenu en 2000. Elle est inscrite comme espèce en voie de disparition aux termes de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba ainsi qu’à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Un programme de rétablissement national a été publié par Environnement Canada en 2006 et comprend une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce. NatureServe a attribué à l’espèce une cote mondiale de G3 (vulnérable), une cote nationale de N1 (gravement en péril) et une cote provinciale de S1.
La platanthère blanchâtre de l’Ouestpousse sur des terrains privés et des terres provinciales au Manitoba. Environ 63 % de la population canadienne se trouvent dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba. Environ 5 170 hectares (12 728 acres) d’habitat d’espèces indigènes des prairies, dont la platanthère blanchâtre de l’Ouest, sont protégés dans cette réserve. Les terres de la réserve appartiennent à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ainsi qu’à Conservation de la nature Canada. Des programmes de suivi de l’espèce et de gestion de son habitat sont menés dans la réserve depuis 1992. Les autres sites au Manitoba ne sont pas protégés ou font l’objet d’une protection minime.
COSEPAC
Résumé technique
- Nom scientifique :
- Platanthera praeclara
- Nom français :
- Platanthère blanchâtre de l’Ouest
- Nom anglais :
- Western Prairie Fringed Orchid
- Répartition au Canada :
- Manitoba
Données démographiques
| Sujet | Information |
|---|---|
| Durée d’une génération (généralement, âge moyen des parents dans la population; indiquez si une méthode d’estimation de la durée d’une génération autre que celle qui est présentée dans les lignes directrices de l’UICN [2011] est utilisée) | Probablement > 12 ans (âge de floraison estimé à 12 ans). |
| Y a-t-il un déclin continu observé, inféré ou prévu du nombre total d’individus matures? | Oui – déclin inféré d’après la perte graduelle de milieux propices, causée par l’empiètement des arbustes et l’agriculture. |
| Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d’individus matures sur cinq ans. | Inconnu en raison des fluctuations |
| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations]. | Inconnu en raison des fluctuations |
| Pourcentage [prévu ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des dix prochaines années. | Inconnu en raison des fluctuations |
| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur. | Inconnu en raison des fluctuations |
| Est-ce que les causes du déclin sont a. clairement réversibles et b. comprises et c. ont effectivement cessé? | a. Non b. Oui c. Non |
| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? | Peut-être; même s’il y a des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (florifères) et qu’on croit que la majorité de ceuxci meurent après avoir fleuri, la notion de fluctuation extrême ne s’applique pas aux critères quantitatifs, car il n’est pas certain que les fluctuations du nombre d’individus matures reflètent des modifications de la population totale. |
Information sur la répartition
| Sujet | Information |
|---|---|
| Superficie estimée de la zone d’occurrence | 120 km2 Par convention, la superficie de la zone d’occurrence ne peut être inférieure à l’IZO. La superficie réelle de la zone d’occurrence est de 101 km2. |
| Indice de zone d’occupation (IZO ) (valeur établie à partir d’une grille à carrés de 2 km de côté). |
120 km2 |
| La population totale est-elle gravement fragmentée, c.-à-d. que plus de 50 % de sa zone d’occupation totale se trouvent dans des parcelles d’habitat qui sont a) plus petites que la superficie nécessaire au maintien d’une population viable et b) séparées d’autres parcelles d’habitat par une distance supérieure à la distance de dispersion maximale présumée pour l’espèce? | Non |
| Nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le site Web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme. |
Il y a une seule localité au Canada (inondations majeures, sécheresses extrêmes ou flambées de maladies). Toutefois, si l’évaluation est faite en fonction du régime foncier, le nombre de localités serait supérieur à 10 (peut-être 21). |
| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de la zone d’occurrence? | Peut-être, d’après les menaces continues pesant sur l’habitat dans les terrains privés et les emprises routières. |
| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de l’indice de zone d’occupation? | Peut-être - l’espèce n’a pas été observée depuis 1998 dans un site à la limite sud-ouest de l’aire de répartition. |
| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de sous-populations? Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de colonies? | Non. La population canadienne est représentée par une seule sous-population. Inconnu – Le nombre d’individus florifères varie d’une année à l’autre, de sorte qu’on ne sait pas avec exactitude quels sont les déclins réels. Peut-être – l’espèce n’a pas été observée depuis 1998 dans un site. |
| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de localités? | Non – Il y a encore une seule localité au Canada |
| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l’étendue ou la qualité] de l’habitat? | Oui, des déclins continus de l’habitat et de la qualité de l’habitat ont été observés sur des terrains privés. |
| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de sous-populations? | Non |
| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités? | Non |
| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d’occurrence? | Non |
| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l’indice de zone d’occupation? | Non |
Nombre d’individus matures (dans chaque sous-population)
| Sous-population (utilisez une fourchette plausible) | Nombre d’individus matures |
|---|---|
| Total : | 763 – 14 685 individus florifères répertoriés au cours des 10 dernières années (2006-2015) |
Analyse quantitative
| Sujet | Information |
|---|---|
| La probabilité de disparition de l’espèce à l’état sauvage est d’au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans] | Non effectuée |
Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou leur habitat, de l’impact le plus élevé à l’impact le plus faible)
| Sujet | Information |
|---|---|
| Selon le calculateur des menaces, l’impact global des menaces est élevé-faible. | Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont la destruction et la dégradation de son habitat et de celui de ses pollinisateurs, causées par l’agriculture (conversion en terres cultivées, surpâturage, fauchage réalisé à un moment inopportun), la prévention des incendies occasionnant une succession végétale et, par conséquent, une perte d’habitat (empiètement de végétaux ligneux), les phénomènes météorologiques extrêmes (gelées printanières tardives, inondations, sécheresses) associés aux changements climatiques, les activités d’entretien des emprises routières et des fossés, les brûlages effectués à un moment inopportun, la modification du régime de drainage, la récolte illégale, les espèces envahissantes, le développement urbain et l’extraction de minerais. L’impact des menaces, qui était élevé-moyen, a été abaissé à élevéfaible, car la majeure partie de la population se trouve sur des terres gérées. |
Immigration de source externe (immigration de l’extérieur du Canada)
| Sujet | Information |
|---|---|
| Situation des populations de l’extérieur les plus susceptibles de fournir des individus immigrants au Canada | Gravement en péril (S1) dans 3 des 8 États où l’espèce a été signalée, et en péril (S2) dans 3 États. Possiblement disparue (SH) au Dakota du Sud et en Oklahoma. |
| Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? | Possible, mais peu probable |
| Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? | Probablement |
| Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus immigrants? | Peut-être; toutefois, l’habitat est très limité au Canada. |
| Les conditions se détériorent-elles au Canada? | Oui |
| Les conditions de la population source se détériorent elles? | Oui |
| La population canadienne est-elle considérée comme un puits? | Non |
| La possibilité d’une immigration depuis des populations externes existe-t-elle? | Non |
Nature délicate de l’information sur l’espèce
| Sujet | Information | |
|---|---|---|
| L’information concernant l’espèce est elle de nature délicate? | Oui |
Historique du statut
| Sujet | Information |
|---|---|
| Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. | Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2016. |
Statut et justification de la désignation
| Sujet | Information |
|---|---|
| Statut recommandé | En voie de disparition |
| Code alphanumérique | B1ab (iii) +2ab (iii) |
| Justification de la désignation | Cette espèce est une orchidée rare à l’échelle mondiale qui se trouve dans une partie restreinte des prairies d’herbes hautes restantes du sud-est du Manitoba. Elle est menacée par de larges processus d’intervention touchant l’étendue et la qualité de l’habitat, tels que le changement des régimes des feux et la modification des conditions d’humidité du sol attribuables aux tranchées de drainage et aux changements climatiques. |
Applicabilité des critères
| Sujet | Information |
|---|---|
| Critère A (déclin du nombre total d’individus matures) | Sans objet. Le déclin est inférieur au seuil établi. |
| Critère B (petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) | Correspond au critère de la catégorie « en voie de disparition », B1ab (iii) +2ab (iii). La zone d’occurrence est de < 5 000 km2, l’IZO est de < 500 km2, il y a une seule localité d’après l’impact possible des changements climatiques, et la qualité de l’habitat est en déclin. Il est possible que les fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (florifères) ne reflètent pas un changement de la population totale (tous les stades du cycle vital). |
| Critère C (nombre d’individus matures peu élevé et en déclin) | Pourrait satisfaire au critère de la catégorie « en voie de disparition », C2a (ii), car il y a moins de 2 500 individus matures (valeur minimale des fluctuations, notamment observée au cours des dernières années), et au moins 95 % des individus matures sont concentrés dans une seule sous-population. |
| Critère D (très petite population totale ou répartition restreinte) | Pourrait satisfaire au critère de la catégorie « menacée », D1, car il a été estimé que la population compte < 1 000 individus matures (valeur minimale des fluctuations, notamment observée au cours des dernières années). |
| Critère E (analyse quantitative) | Non réalisée. |
Préface
La platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) a été reconnue comme une espèce à part entière en 1986 (Sheviak et Bowles, 1986) et a été désignée en voie de disparition par le COSEPAC en 1993. Ce statut a été reconfirmé en 2000.
La mise à jour du rapport de situation, rédigée par E. Punter en 2000, renfermait une revue des recherches additionnelles concernant la platanthère blanchâtre de l’Ouest réalisées depuis la désignation de l’espèce. L’espèce a fait l’objet d’un suivi depuis sa désignation; toutefois, les tendances de la population sont encore très mal comprises, vu les fluctuations extrêmes du nombre d’individus florifères et de la capacité potentielle de l’espèce d’entrer en dormance. L’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest est extrêmement limité, et une gestion et une protection de l’habitat de l’espèce sont essentielles à la survie de celle-ci. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, de nouveaux quarts de section ont été visités à l’extérieur de l’aire de répartition connue de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, mais aucune nouvelle occurrence n’a été découverte.
Historique du COSEPAC
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.
Mandat du COSEPAC
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.
Composition du COSEPAC
Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.
Définitions (2016)
- Espèce sauvage
- Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animal, de plante ou d’un autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
- Disparue (D)
- Espèce sauvage qui n’existe plus.
- Disparue du pays (DP)
- Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.
-
En voie de disparition (VD)
(Remarque : Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003.) - Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.
- Menacée (M)
- Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.
-
Préoccupante (P)
(Remarque : Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000.) - Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
-
En voie de disparition (NEP)
(Remarque : Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999.) - Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.
-
Données insuffisantes (DI)
(Remarque :Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».) - Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l’espèce.
Remarque : Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.
Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.
Description et importance de l’espèce sauvage
Nom et classification
Nom scientifique : Platanthera praeclara Sheviak et Bowles, Rhodora 88: 267-290. 1986.
Synonyme : Habenaria leucophaea (Nutt.) A.S. Gray var. praeclara (Sheviak et Bowles) Cronq., Cronquist, ed. 2, 864. 1991.
Nom français : Platanthère blanchâtre de l’Ouest
Nom anglais : Western Prairie Fringed Orchid
Autres noms anglais : Western Prairie White Fringed Orchid, Western Prairie Whitefringed Orchid, Western Prairie Fringed-orchid
Famille : Orchidacées (Orchidées)
Grand groupe végétal : Monocotylédones
La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été récoltée pour la première fois au Canada le 26 juillet 1984, par P.M. Catling et V.R. Brownell (Catling et Brownell, 1987). La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été décrite comme une espèce à part entière par Sheviak et Bowles en 1986; les renseignements concernant l’espèce datant d’avant cette période sont inclus dans le rapport de situation sur la platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea) (Brownell, 1984). Les deux membres de cette paire d’espèces possèdent une morphologie générale semblable, mais elles se distinguent par la couleur et le parfum de leurs fleurs, leur taille, la morphologie de leurs anthères, la structure de leur colonne, la forme de leurs pétales et la largeur de leurs sépales (Sheviak et Bowles, 1986). Les caractères distinctifs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest les plus facilement observables sont ses fleurs légèrement plus grandes et ses inflorescences moins allongées que celles de la platanthère blanchâtre de l’Est. Chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest, les sacs polliniques sont divergents et éloignés de la viscidie, de manière à ce que celle-ci se fixe aux yeux composés des papillons, alors que chez la platanthère blanchâtre de l’Est les pollinies sont parallèles à la viscidie, de manière à ce que celle-ci se fixe à la trompe (Sheviak et Bowles, 1986).
Description morphologique
La platanthère blanchâtre de l’Ouest (figure 1) est une plante herbacée vivace possédant un tubercule fusiforme et d’épaisses racines charnues; elle produit une ou rarement deux tiges glabres longues de 38 à 88 cm chacune munie de 5 à 7 feuilles glabres devenant plus petites et semblables à des bractées vers le haut de la tige. L’inflorescence est une grappe terminale longue de 5 à 15 cm et large de 5 à 9 cm composée de 4 à 33 (en moyenne 20) fleurs blanc crème devenant blanches avec le temps. Les graines sont minuscules et s’échappent de la capsule mature par des fentes (Sheviak et Bowles, 1986; Smith, 1993; U.S. Fish and Wildlife Service, 1996).

Description longue de la figure 1
Photo d’une platanthère blanchâtre de l’Ouest, où on peut voir la tige, les feuilles (généralement au nombre de cinq à sept par tige) et les fleurs blanc crème (dont le nombre varie de 4 à 33) de la plante.
Structure spatiale et variabilité de la population
La seule population présente au Canada est limitée à un habitat résiduel de prairie à herbes hautes, à l’ouest et au nord de Vita, au Manitoba. L’aire de répartition canadienne actuellement connue de la platanthère blanchâtre de l’Ouest représente probablement un vestige de son aire de répartition passée. On ne dispose pas de suffisamment de données historiques concernant la présence de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ou son aire de répartition dans le passé, mais on suppose que l’espèce était répartie de façon éparse dans la superficie historique de prairie à herbes hautes dans le sud du Manitoba (Collicutt, 1993). L’espèce forme une seule grande population selon les lignes directrices sur la délimitation des occurrences d’élément de végétaux fondée sur l’habitat (NatureServe 2004); en effet, selon ces lignes directrices, les occurrences forment une seule occurrence d’élément (sous-population au sens du COSEPAC) si elles sont séparées par mois de 1 km ou séparées par une distance de 1 à 3 km ne comportant aucune interruption de plus de 1 km des milieux pouvant convenir à l’espèce, ou si elles sont séparées par une distance de 3 à 10 km ne comportant aucune interruption de plus de 3 km des milieux pouvant convenir à l’espèce. L’espèce ne pousse que dans les baissières et les superficies de prairie à herbes hautes mésique qui y sont associées. Même si ce milieu est morcelé, l’habitat convenant à l’espèce y est apparemment continu.
Jusqu’à maintenant, les études sur la diversité génétique de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont porté uniquement sur des sous-populations des États-Unis. Selon deux études faisant appel à des marqueurs isoenzymatiques (Pleasant et Klier, 1995; Sharma, 2002), il y a peu d’indications d’une différenciation génétique entre les souspopulations. Plus récemment, Ross et Travers (2016) ont utilisé six loci microsatellites pour étudier la variation dans huit sous-populations au Minnesota et dans le Dakota du Nord. Ils ont détecté des divergences significatives mais peu nombreuses entre les souspopulations (GST moyen = 0,081), ainsi que certains signes de consanguinité (FIS moyen = 0,230). Toutefois, un FIS > 0,2 a été observé uniquement dans les souspopulations comptant moins de 10 individus florifères.
La population canadienne de platanthère blanchâtre de l’Ouestest séparée des autres grandes sous-populations de l’espèce, situées aux États-Unis, ce qui freine le flux génétique entre les sous-populations des deux pays. La sous-population la plus proche se trouve à 50 km au sud de la Réserve de prairie d’herbes longues, dans le nord-ouest du Minnesota (Westwood et Borkowsky, 2009), et est plutôt petite.
Unités désignables
Il n’y a aucune sous-espèce ou variété reconnue chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest, et la population canadienne est confinée à une petite région du sud du Manitoba. En conséquence, l’espèce est traitée comme formant une seule unité désignable.
Importance de l’espèce
La platanthère blanchâtre de l’Ouest est indigène des prairies à herbes hautes humides à mésiques, depuis le Manitoba jusqu’au Wisconsin (elle est toutefois disparue en Oklahoma). La population de platanthère blanchâtre de l’Ouestsituée près de Vita, au Manitoba, se trouve à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce et représente la plus grande sous-population connue dans le monde (Punter, 2000). Les seules autres souspopulations comptant au moins 3 000 individus se trouvent au Minnesota et dans le Dakota du Nord (Punter, 2000). On estime que plus de 70 % de la population mondiale de l’espèce pourraient se trouver au Canada, selon la taille des sous-populations actuellement connues aux États-Unis (NatureServe, 2015).
La présence de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la prairie à herbes hautes située à l’ouest de Vita a motivé l’acquisition de ces terres en vue de leur intégration à la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba. La platanthère blanchâtre de l’Ouest représente un attrait important pour l’écotourisme dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba ainsi que pour les activités d’éducation et de sensibilisation à l’égard des prairies à herbes hautes.
Répartition
Aire de répartition mondiale
La platanthère blanchâtre de l’Ouest compte 172 occurrences connues dispersées dans l’ouest des basses terres centrales et l’est des Grandes Plaines, aux États-Unis, et dans les plaines intérieures du Manitoba, au Canada (NatureServe, 2015). Son aire de répartition s’étend depuis le sud-est du Manitoba jusqu’au Minnesota et a pour limites l’est du Dakota du Nord, le centre du Nebraska, l’Iowa, le nord du Missouri et l’est du Kansas (figure 2). La limite est de l’aire de l’espèce correspond approximativement au fleuve Mississippi (Bowles et Duxbury, 1986; Watson, 1989). L’espèce est apparemment disparue du Dakota du Sud (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996). L’emplacement où un spécimen aurait été récolté au Wyoming (Bowles, 1983; Sheviak et Bowles, 1986) est jugé douteux, et cet État est exclu de l’aire de répartition (Bjugstad et Bjugstad, 1989). L’espèce est apparemment disparue de l’Oklahoma (University of Oklahoma, 2016). Elle a été observée pour la dernière fois dans cet État en 1990, et aucun individu n’a été signalé depuis, malgré des recherches répétées (Buthod et Fagan, comm. pers., 2016). Le nombre d’occurrences a considérablement diminué en Iowa, dans le sud-est du Kansas, au Missouri et dans l’est du Nebraska (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996).
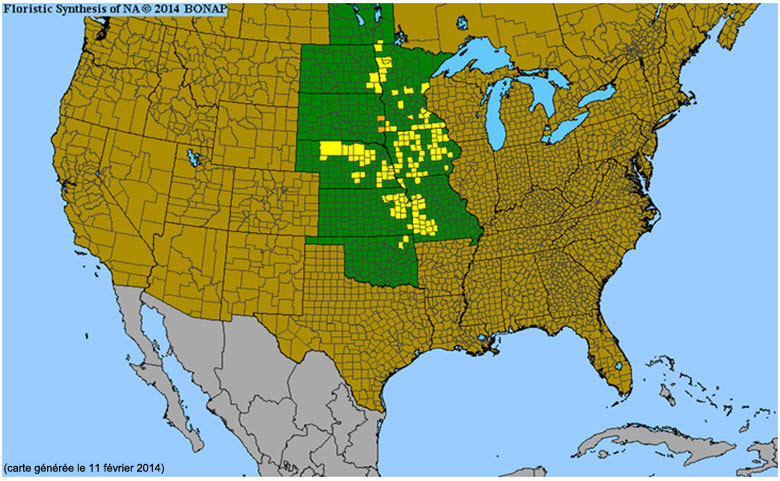
Description longue de la figure 2
Carte de la répartition mondiale de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, fondée sur les 172 occurrences existantes dispersées dans l’ouest des basses terres centrales et l’est des Grandes Plaines, aux États-Unis, et dans les plaines intérieures du Manitoba, au Canada. Les couleurs des comtés indiquent si l’espèce y est présente mais rare, présente et indigène ou disparue.
Aire de répartition canadienne
Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest a été observée uniquement à l’ouest de Vita, dans le sud-est du Manitoba (figure 3), dans une zone d’une superficie d’environ 48 km2. Aucune autre occurrence n’a été signalée au Canada, malgré les vastes recherches menées dans les milieux susceptibles de convenir à l’espèce près de la population de Vita.
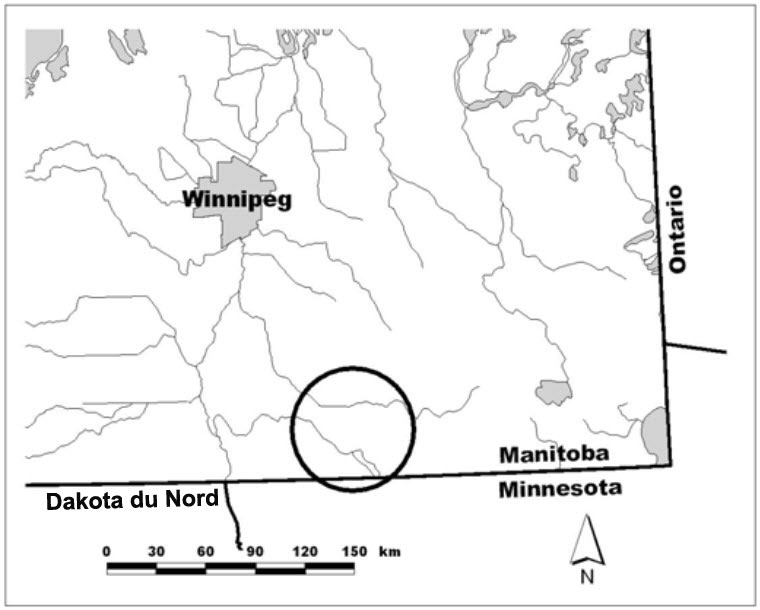
Description longue de la figure 3
Carte montrant l’emplacement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba.
Zone d’occurrence et zone d’occupation
La zone d’occurrence de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Canada représente une zone de 101 km2 qui comprend au total 200 quarts de section et est située à l’ouest de Vita, au Manitoba. La zone d’occupation biologique faisait environ 6,7 km2 (670 ha) en 2006 (Environment Canada, 2006). L’indice de zone d’occupation (IZO) est de 120 km2. Au Manitoba, la platanthère blanchâtre de l’Ouest se rencontre uniquement dans cette zone limitée, et sa répartition à l’intérieur de cette zone est morcelée (mais est continue dans les baissières non cultivées et les superficies de prairie à herbes hautes mésique qui y sont associées).
On présume que l’espèce est disparue d’un site où un seul individu florifère avait été observé, à la limite sud-ouest de l’aire de répartition, car elle n’y a pas été observée depuis 1998 (17 ans), même si un suivi annuel y a été effectué. La disparition de cette occurrence représenterait une diminution d’environ 10 % de la zone d’occurrence de l’espèce au Canada (101 km2 à 111 km2).
Activités de recherche
La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été signalée pour la première fois près de Vita, dans le sud-est du Manitoba, en 1984 (Catling et Brownell, 1987). Dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, le recensement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouestest réalisé par des techniciens du Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune. Des relevés sont réalisés chaque année depuis 1992. Le nombre de quarts de section et de fossés faisant l’objet de relevés a augmenté de manière constante, passant de 61 en 1992 à 225 en 2014 (tableau 1; Borkowsky, comm. pers., 2015). Depuis 1992, en moyenne, des individus florifères de l’espèce ont été observés annuellement dans 60 des 200 quarts de section visités (Borkowsky, comm. pers., 2015). Les relevés sont effectués à pied dans les 30 à 35 quarts de section dont les titres appartiennent à des partenaires de la Réserve de prairie d’herbes longues, alors que les observations sont réalisées depuis la route dans le cas des autres quarts de section (~ 165). Les inflorescences sont hautes, grandes et composées de fleurs blanches, de sorte que les individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest peuvent être observés au moyen de jumelles à une distance de plusieurs centaines de mètres. Dans certains quarts de section ayant fait l’objet de relevés, la platanthère blanchâtre de l’Ouest était présente uniquement dans le fossé bordant les propriétés, en raison du fauchage effectué dans les champs (Borkowsky, comm. pers., 2015).
Les rédactrices du rapport ont visité la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba et la région voisine en 2014 et en 2015 et y ont observé la platanthère blanchâtre de l’Ouestles deux années. En 2015, elles ont visité les régions au nord-ouest et au sud-ouest de l’aire de répartition connue, pour déterminer si des individus additionnels s’y trouvaient. Très peu de milieux propices à l’espèce existent au sud-est et au sud-ouest, à cause du type de sol et du régime hydrique, et la majeure partie des terres y est cultivée. Certains fossés situés au nord du canal de drainage de Vita, dans une réserve de faune du Manitoba, semblent présenter des conditions convenant à l’espèce, mais aucun individu florifère n’y a été observé. Une observation non documentée de l’espèce a toutefois été effectuée dans cette région (Borkowsky, comm. pers., 2015).
| Année | Nbre de quarts de section ayant fait l’objet de relevésa | Nbre de quarts de section contenant des individus florifères | Nbre de tiges florifères Fossés |
Nbre de tiges florifères Champs |
Nbre de tiges florifères Total |
Nbre de tiges florifères % dans les champs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 61 | 45 | 635 | 3 546 | 4 181 | 84,81 |
| 1993 | 61 | 33 | 181 | 3 613 | 3 794 | 95,23 |
| 1994 | 61 | 54 | 606 | 8 509 | 9 115 | 93,35 |
| 1995 | 74 | 37 | 301 | 1 517 | 1 818 | 83,44 |
| 1996 | 94 | 61 | 974 | 20 029 | 21 003 | 95,36 |
| 1997 | 102 | 58 | 1 378 | 14 784 | 16 162 | 91,47 |
| 1998 | 102 | 50 | 948 | 3 972 | 4 920 | 80,73 |
| 1999 | 112 | 58 | 1 394 | 7 426 | 8 820 | 84,20 |
| 2000 | 112 | 64 | 1 213 | 3 900 | 5 113 | 76,28 |
| 2001 | 127 | 52 | 593 | 1 502 | 2 095 | 71,69 |
| 2002 | 127 | 53 | 506 | 4 935 | 5 441 | 90,70 |
| 2003 | 129 | 63 | 1 044 | 22 486 | 23 530 | 95,56 |
| 2004 | 131 | 63 | 932 | 17 906 | 18 838 | 95,05 |
| 2005 | 131 | 60 | 727 | 5 643 | 6 370 | 88,59 |
| 2006 | 133 | 59 | 484 | 4 314 | 4 798 | 89,91 |
| 2007 | 135 | 72 | 1 567 | 4 561 | 6 128 | 74,43 |
| 2008 | 193 | 81 | 1 251 | 4 133 | 5 384 | 76,76 |
| 2009 | 207 | 68 | 485 | 7 981 | 8 466 | 94,27 |
| 2010 | 209 | 69 | 497 | 8 183 | 8 680 | 94,27 |
| 2011 | 216 | 82 | 1 065 | 13 620 | 14 685 | 92,75 |
| 2012 | 227 | 35 | 10 | 753 | 763 | 98,69 |
| 2013 | 214 | 70 | 268 | 2 101 | 2 369 | 88,69 |
| 2014 | 225 | 72 | 920 | 4 247 | 5 167 | 82,19 |
| 2015 | 225 | 69 | 1 044 | 5 807 | 6 851 | 84,76 |
| MOYENNE | 142,0 | 59,5 | 781,7 | 7311,2 | 8103,8 | 84,47 |
a Dans le cas de certains quarts de section, les relevés ont été effectués uniquement dans les fossés, car les champs étaient cultivés.
Habitat
Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest pousse uniquement dans la région de Vita, dans le sud-est du Manitoba. La présence de l’espèce à cet endroit s’explique principalement par le fait que le sol n’y a pas été labouré, vu sa nature pierreuse, ainsi que par la présence de vastes zones humides. Le secteur de Vita se situe dans la région physiographique nommée South-Eastern Lake Terrace, complexe modifié de till et de dépôts fluvio-glaciaires (Ehrlich et al., 1953). Dans cette région, le substratum rocheux sous-jacent est composé de grès, de calcaire, de dolomie, et de schiste du Jurassique (anonyme, 1994). Le substratum est recouvert d’un till à forte proportion de calcaire de 1 à 10 m d’épaisseur, issu principalement de roche carbonatée du Paléozoïque (Manitoba Mineral Resources Division, 1981). La région de Vita a une topographie en pente douce descendant vers le nord-ouest, l’altitude passant de 298 m à 290 m. La surface du till glaciaire a été modifiée par le retrait du lac glaciaire Agassiz, phénomène qui a créé une topographie en crêtes et en creux à l’ouest de Vita. Ces formes ont une orientation nord-ouest/sud-est.
La répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest est limitée au sud et à l’ouest par la rivière Roseau, à l’est par le ruisseau Conroy, et au nord par le marécage de la rivière Rat et la rivière Rat. Le canal de drainage de Vita, construit en 1990 (Collicutt, 1993), traverse la portion sud du marécage de la rivière Rat et relie le ruisseau Conroy à la rivière Roseau près du village de Roseau River (20 km au nord-ouest de Vita).
Besoins en matière d’habitat
La région de Vita se trouve dans la section à chênes et à peupliers de la région de la forêt boréale (Rowe, 1959), où les composants décidus de la forêt boréale se mélangent à la prairie à herbes hautes. Le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) y est l’espèce d’arbres dominante, aux côtés du peuplier baumier (Populus balsamifera) dans les sites humides et du chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa) dans les sites à sol mieux drainé (Rowe, 1959).
Les sols sont des chernozems gris foncé extrêmement calcaires, à drainage imparfait, humides à mésiques, de texture loameuse à loameuse-sableuse (Canada Soil Inventory, 1989), du complexe pédologique de Garson (Ehrlich et al., 1953). Les sols du complexe pédologique de Garson ne sont pas arables, à cause de leur pierrosité excessive (Ehrlich et al., 1953). Le till modifié, plus ou moins pierreux, peut être recouvert d’une mince (jusqu’à 40 cm) couche de sable d’origine lacustre. On trouve généralement des lentilles de gravier ou de galets entre le till et la couche de sable. En outre, on peut généralement observer une strate de carbonate de calcium accumulé dans le till ou entre le till et la couche de sable. La nappe phréatique se situe à une profondeur de 0 à 2 m (Canada Soil Inventory, 1989). Les dépressions sont généralement mal drainées (Ehrlich et al., 1953).
Dans la région de Vita, la platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre le plus souvent dans des prairies à herbes hautes non cultivées et des prés de carex dégagés, à sol calcaire humide à mésique. Elle pousse généralement dans des prairies relativement peu perturbées, mais peut aussi pousser dans des sites subissant des perturbations, notamment des fossés et des pâturages, si ceux-ci sont suffisamment stabilisés et présentent des conditions semblables à celles de la prairie (Sheviak, 1974). Les milieux peuvent être inondés durant 1 ou 2 semaines par année. Selon les dénombrements des individus florifères présents dans des fossés et dans des champs effectués de 1992 à 2014, le pourcentage des individus poussant dans les champs allait de 71,7 % à 98,7 % et était en moyenne de 90,4 % (tableau 1). Même si plusieurs des occurrences situées dans des fossés et en bordure de routes pourraient persister si elles ne sont pas perturbées, certaines de ces occurrences représentent des puits qui dépendent de la dispersion répétée de l’espèce depuis les champs voisins. Puisque le taux de floraison peut être plus élevé dans les fossés que dans les champs les années sèches, les occurrences qui se trouvent dans des fossés peuvent constituer une source de graines pouvant être dispersées dans les champs; la situation inverse peut être vraie les années humides.
Généralement, la nappe phréatique est haute du printemps au début de l’été. Le drainage est lent après les périodes de fortes précipitations. Selon Wolken (2001), la teneur en eau de la couche supérieure du sol (0-4 cm) constitue le plus important facteur pour la répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Ces observations sont appuyées par des études menées par Sieg et Ring (1995), qui ont constaté une corrélation entre la densité d’individus de l’espèce et la teneur en eau de la couche supérieure du sol. Bleho et al. (2015) ont observé que l’enchaînement d’une saison de croissance chaude, d’un hiver frais, court et neigeux et d’un printemps humide donnait un taux de floraison élevé la saison de croissance suivante.
Aux États-Unis, la platanthère blanchâtre de l’Ouestpousse généralement dans des prairies et des prés de carex à sol calcaire non labouré situés en terrain bas. La majorité des sites se trouvent dans la région glaciaire et présentent un sol modérément bien drainé à mal drainé (delta de Sheyenne, Dakota du Nord), un till glaciaire loameux à argileux (plages du lac glaciaire Agassiz, nord du Minnesota), ou un sol humide-mésique à mésique issu du till (sud du Minnesota, Iowa, est du Nebraska, nord-est du Kansas et nord-ouest du Missouri). La platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre dans sept régions non glaciaires dans l’est du Kansas (sud de la rivière Kansas), dans des prairies de terrain élevé mésiques à humides-mésiques, dans des secteurs vallonnés recouverts d’une mince couche de lœss discontinue; dans des prairies à herbes hautes ou des prés de carex, dans les baissières formées entre des dunes, au Nebraska; dans des complexes dunaires dans le centre-nord du Nebraska; dans des prairies et des prés de carex humides-mésiques le long de la plaine inondable de la rivière Platte, dans le centre du Nebraska (U.S. Fish and Wildlife, 1996).
Au Manitoba, la platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre généralement dans des superficies de prairie à herbes hautes humides-mésiques dominées par la spartine pectinée (Spartina pectinata), la deschampsie cespiteuse (Deschampsia caespitosa) et la calamagrostide contractée (Calamagrostis stricta ssp. inexpansa). Du printemps au début de l’été, les carex sont prédominants; les espèces couramment associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouest sont le carex de Buxbaum (Carex buxbaumii) et le carex à fruits tomenteux d’Amérique (Carex lanuginosa), et parfois le carex de Crawe (Carex crawei) et le carex tétanique (Carex tetanica). Dans les sites humides, des joncs (Juncus balticus et autres espèces du genre Juncus) et la campylie à feuilles dorées (Campylium chrysophyllum) sont communément observés. On trouve également de bas (>0,2 à 1 m) arbustes épars dans la prairie à herbes hautes, notamment le saule à long pétiole (Salix petiolaris), la potentille frutescente (Dasiphora fruticosa), le bouleau nain (Betula pumila) et le cerisier nain (Prunus pumila). Les autres espèces couramment rencontrées aux côtés de la platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba sont énumérées dans le tableau 2. L’espèce pousse parfois aussi dans des sites mésiques dominés par le barbon de Gérard (Andropogon gerardii) et le sporobole à glumes inégales (Sporobolus heterolepis). En outre, un certain nombre de plantes rares à l’échelle provinciale, nationale et nord-américaine se rencontrent dans l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Les espèces rares à l’échelle nationale sont le carex tétanique, le cypripède blanc (Cypripedium candidum), la verge d’or de Riddell (Solidago riddellii), le spiranthe des Grandes Plaines (Spiranthes magnicamporum) et la véronique de Virgine (Veronicastrum virginicum). Les espèces rares au Manitoba associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouest sont la gérardie à feuilles ténues (Agalinis tenuifolia), le carex conoïde (Carex conoidea), l’ophioglosse nain (Ophioglossum pusillum) et la lysimaque à quatre fleurs (Lysimachia quadriflora).
| Sans entete | Sans entete |
|---|---|
| Agalinis tenuifolia (Vahl.) Raf. | Lysimachia quadriflora Sims |
| Agoseris glauca (Pursh) Raf. | Pedicularis canadensis L. |
| Anemone canadensis L. | Pedicularis lanceolata Michx. |
| Carex sartwellii Dewey | Poa nemoralis L. |
| Comandra umbellata (L.) Nutt. | Poa palustris L. |
| Cornus stolonifera Michx. | Prunella vulgaris L. |
| Crepis runcinata (James) Torr. & Gray | Salix bebbiana Sarg. |
| Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. | Salix discolor Muhl. |
| Eleocharis elliptica Kunth | Salix lutea Nutt. |
| Equisetum hyemale L. | Sanicula marilandica L. |
| Fragaria virginiana Duchesne | Senecio pauperculus Michx. |
| Galium boreale L. | Sisyrinchium montanum Greene |
| Glycyrrhiza lepidota Pursh | Spiraea alba Du Roi |
| Hierochloë odorata (L.) Beauv. | Solidago riddellii Frank ex Riddell |
| Hypoxis hirsute (L.) Colville | Thalictrum dasycarpum Fisch. & Avé-Lall. |
| Juncus longistylis Torr. | Triglochin maritimum L. |
| Koeleria macrantha (Ledeb.) J.A. Schultes | Viola nephrophylla Greene |
| Krigia biflora (Walt.) Blake | Zizia aptera (Gray) Fern. |
| Lathyrus palustris L. | cellule vide |
Les végétaux ligneux ont tendance à empiéter sur l’habitat des communautés des prairies à herbes hautes en l’absence de perturbations, par exemple les incendies. Dans la région de Vita, les terres sont entretenues pour le pâturage et le fourrage et font occasionnellement l’objet de brûlages au début du printemps. L’absence de perturbations appropriées, qui entraîne une perte d’habitat, est l’une des menaces potentielles pesant sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest. En effet, sans perturbations appropriées, la succession végétale se poursuit et la hauteur et la densité de la végétation augmentent au point où les conditions ne sont plus propices à la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Dans la Réserve de prairie d’herbes longues, des brûlages sont effectués pour prévenir l’empiètement de la végétation et maintenir l’écosystème de prairie (Borkowsky, comm. pers., 2015). Ces brûlages sont réalisés sur les terres de la réserve environ tous les 5 à 6 ans (au printemps ou à l’automne) pour éliminer la couverture de chaume et les végétaux ligneux empiétant sur le milieu (Bleho et al., 2015; Borkowsky, comm. pers., 2015). De plus, des feux de friche se produisent parfois; le dernier feu s’est produit à l’automne 2014 dans la propriété du sentier Agassiz et s’est propagé sur une superficie de 30 hectares. Avant cela, un feu de friche de grande envergure s’est produit en 2012, brûlant sur environ huit quarts de section de la réserve, notamment dans des secteurs où pousse la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Borkowsky, comm. pers., 2015).
Tendances en matière d’habitat
La prairie à herbes hautes est un écosystème gravement menacé en Amérique du Nord. Koper et al. (2010) ont fait un relevé des communautés végétales dans 65 parcelles vestigiales au Manitoba qui avaient également fait l’objet d’un relevé en 1987 ou en 1988. Ils ont constaté que ces parcelles subissent une menace continue, et que 37 % des parcelles de prairie visitées avaient subi un changement de type de milieu, à cause de facteurs comme l’empiètement de végétaux ligneux. Les parcelles petites (de moins de 21 ha) avaient généralement subi une diminution de leur superficie et de leur qualité, alors que les parcelles plus grandes avaient connu une augmentation de leur superficie, mais une diminution de leur qualité. Selon Koper et al. (2010), la proportion de lisières de la parcelle a un plus grand effet sur les espèces indigènes et les espèces envahissantes que la superficie de celle-ci. Les effets de lisière et la végétation empiétant sur l’habitat pourraient expliquer que les parcelles petites sont plus susceptibles de subir un déclin de leur superficie et de leur qualité. La présence d’espèces envahissantes a un effet négatif sur les espèces indigènes, et les espèces envahissantes sont susceptibles de supplanter les espèces indigènes, comme la platanthère blanchâtre de l’Ouest. De nombreuses espèces indigènes de la prairie à herbes hautes pourraient disparaître parce qu’elles seraient incapables de demeurer autosuffisantes si elles devaient subir la concurrence de plantes envahissantes (Koper et al., 2010). Des mesures de gestion immédiates et continues doivent être mises en œuvre pour éviter la disparition des parcelles restantes de prairies à herbes hautes du Nord (Koper et al., 2010).
Biologie
Cycle vital et reproduction
La platanthère blanchâtre de l’Ouest est une plante herbacée vivace. Son système racinaire se compose d’un tubercule fusiforme et de racines rayonnantes. La plante produit un nouveau tubercule ainsi que des bourgeons vivaces durant la saison de croissance et se régénère ainsi (Collicutt, 1993). Ce nouveau tubercule peut produire des parties végétatives l’année suivante (Collicutt, 1993).
Les parties aériennes de la platanthère blanchâtre de l’Ouestémergent du sol à la fin mai. L’inflorescence est présente à la troisième semaine de juin, et les fleurs inférieures sont complètement ouvertes chez certains individus (Borkowsky, comm. pers., 2015). À la deuxième semaine de juillet, la plupart des fleurs de l’inflorescence se sont ouvertes (Punter, 2000). Dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, les fleurs subsistent durant plusieurs jours. Les tiges florifères sont hautes de 35 à 88 cm. Un certain nombre de pousses demeurent à l’état végétatif pendant la saison de croissance. Celles-ci sont plus courtes que les tiges florifères et possèdent 1 à 3 feuilles. En 1994, dans deux parcelles permanentes (5 m sur 20 m) établies dans des quarts de section adjacents à la Réserve de prairie d’herbes longues, 90 à 95 % des individus marqués étaient à l’état végétatif (stades de 1, de 2 et de 3 feuilles), et les autres possédaient une tige florifère (4 à 10 %) (Borkowsky, comm. pers., 2015). Dans la prairie nationale Sheyenne (Sheyenne National Grassland), dans le Dakota du Nord, les fleurs demeurent ouvertes pendant environ sept jours (Pleasants et Moe, 1993), mais peuvent le demeurer jusqu’à dix jours ailleurs; l’ouverture des fleurs se produit de manière séquentielle, de sorte que l’inflorescence peut porter des fleurs durant jusqu’à trois semaines (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996). On ignore si les fleurs demeurent réceptives durant toute leur durée de vie.
La floraison est irrégulière, mais peut se produire durant plusieurs années successives si les régimes d’humidité et de températures le permettent (Collicutt, 1993). Chaque inflorescence renferme 4 à 33 fleurs. Pour que l’espèce fleurisse plusieurs années de suite, il faut que les conditions soient favorables (Collicutt, 1993). Selon Bleho et al. (2015), la succession d’une saison de végétation chaude, d’un hiver frais, court et neigeux et d’un printemps humide bénéficie à l’espèce lors de la saison de végétation suivante. La production de capsules est faible dans la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Manitoba (1 à 6 % des inflorescences) comparativement à celle des sous-populations des États-Unis (5,4 à 39 %) (Sheviak et Bowles, 1986; Pleasants, 1993; Westwood et Borkowsky, 2004; Borkowsky, 2006). De 1994 à 1998, Borkowsky (1998) a observé plus de 1 000 individus et a constaté que 2,1 % des individus florifères avaient produit au moins une capsule au cours de l’année. Les capsules ellipsoïdes se fendent pour libérer des milliers de graines microscopiques dépourvues d’albumen (Bowles, 1983). Selon Bleho et al. (2015), la probabilité et la fréquence de la floraison sont semblables dans les sites brûlés et dans les sites non brûlés. Les brûlages annuels pourraient nuire à l’espèce (Bleho et al., 2015). Selon Morrison et al. (2015), il est possible que les brûlages réalisés au début du printemps n’aient aucun effet sur l’espèce. Biederman et al. (2014) estiment toutefois que les brûlages effectués à la fin du printemps sont nuisibles, puisque la sensibilité au feu est accrue en période de croissance rapide.
La platanthère blanchâtre de l’Ouest est pollinisée uniquement par des sphinx nocturnes (Sphingidés) se nourrissant de nectar (Friesen et Westwood, 2013). La platanthère blanchâtre de l’Ouest est autocompatible, mais un pollinisateur est toutefois nécessaire à l’autopollinisation, et la pollinisation croisée est bénéfique pour l’espèce (Sheviak et Bowles, 1986). Lorsqu’un papillon visite une fleur de l’espèce pour y prélever du nectar, la viscidie adhère à un œil ou à la tête du papillon et y demeure fixée lorsque le papillon quitte la fleur (Sheviak et Bowles, 1986; Pleasants et Moe, 1993; Westwood et Borkowsky, 2004; Friesen et Westwood, 2013). Les pollinies dépassent de la tête du papillon, et leur pollen est transféré au stigmate d’une autre fleur visitée (Friesen et Westwood, 2013). Dans les sous-populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Dakota du Nord, des pollinies avaient été retirées chez 8 à 33 % des individus (Pleasants et Moe, 1993); toutefois, au Canada, ce taux allait de 6 à 10 % (Borkowsky, 2006).
On ignore quelle est la durée de génération exacte de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Canada, mais on estime que les individus pourraient mettre jusqu’à 12 ans avant de fleurir (Bowles, 1983). Le temps nécessaire aux individus issus de graines pour produire des parties aériennes est variable, mais est d’au minimum deux ans (Davis, 1995). Dans la prairie nationale Sheyenne, dans le Dakota du Nord, les individus florifères avaient une durée de vie de trois ans ou moins (Sieg et Ring, 1995), ce qui donne à penser que les individus de l’espèce ne vivent pas longtemps une fois qu’ils ont atteint la maturité. La platanthère blanchâtre de l’Ouest pourrait donc avoir une longévité d’environ 15 ans. Puisque le cycle vital de l’espèce comporte une courte période reproductive et que le taux de mortalité est de 80 % chez les individus qui entrent en dormance, le recrutement dépend fortement de la production de graines (Sieg et Ring, 1995; Borkowsky, 2006).
La reproduction sexuée serait le principal moyen de recrutement de nouveaux individus chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Selon Bowles (1983), les individus seraient longévifs et pourraient subsister sous terre à l’état dormant ou mycotrophique durant une ou plusieurs années (Sheviak et Bowles, 1986); toutefois, de récentes études menées dans des parcelles suggèrent le contraire. Des individus qui sont demeurés à l’état végétatif tout au long de la saison de croissance ont été observés au Manitoba et ailleurs. Les individus végétatifs sont plus courts que les individus florifères, possèdent seulement 1 à 3 feuilles et ont des racines moins nombreuses et plus courtes (Wolken, 1995). Dans deux parcelles permanentes établies dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, 90 à 95 % des individus marqués étaient à l’état végétatif en 1994 (Borkowsky, comm. pers., 2015). Ailleurs dans la réserve, on estime que 40 à 60 % des individus étaient à l’état végétatif (Johnson, comm. pers., in Punter, 2000). Dans la prairie nationale Sheyenne, 32 à 95 % marqués étaient à l’état végétatif entre 1990 et 1994 (Sieg et Ring, 1995).
Dans les parcelles permanentes établies dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, certains individus marqués en 1994 étaient absents en 1999 (Borkowsky, comm. pers., 2015). De même, dans la prairie nationale Sheyenne, des individus étaient absents les années suivant leur marquage (Sieg et Ring, 1995). Il y a une forte probabilité que les individus absents une année soient également absents les années subséquentes (Sieg et Ring, 1995; Sieg et Wolken, 1999). Un examen préliminaire a été réalisé à l’emplacement de 10 individus marqués, mais absents (sans parties aériennes) en 1993 et en 1994; aucun tissu racinaire indiquant la présence d’individus en dormance n’a été déterré (Wolken, 1995; Sieg et Wolken, 1999). Il est possible que la durée de vie de la platanthère blanchâtre de l’Ouestne soit pas aussi longue qu’on le croyait à l’origine (Sieg et Ring, 1995). Ces observations pourraient indiquer que, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport précédent (Bowles, 1983), la platanthère blanchâtre de l’Ouestn’a pas une très longue durée de vie après sa première floraison.
La pollinisation est essentielle à la production de fruits. Dans la prairie nationale Sheyenne, dix individus ont été pollinisés manuellement dans le cadre d’une expérience sur le terrain, et aucun fruit n’a été produit par les fleurs qui n’avaient pas été ainsi pollinisées. Les fleurs pollinisées selon les trois traitements (pollinisation croisée au moyen de pollinies entières, pollinisation croisée au moyen de pollinies partielles et autopollinisation) ont produit des fruits chez six individus, mais quatre individus ayant fait l’objet des mêmes traitements n’ont produit aucun fruit (Pleasants et Moe, 1993). Dans le cadre d’une étude sur la pollinisation naturelle ayant porté sur 130 individus (1 033 fleurs), 33 % des pollinies ont été extraites par les pollinisateurs, et un taux de fructification de 30 % a été observé. Le taux de fructification était beaucoup plus élevé chez les fleurs dont une ou deux pollinies avaient été retirées, et la proportion de fruits produisant des fruits était plus élevée chez les individus dont une proportion élevée des pollinies avait été retirée. Le nombre de visites de pollinisateurs par fleur était le plus élevé durant les périodes où le nombre de fleurs ouvertes par inflorescences était élevé (Pleasants et Moe, 1993).
Au Manitoba, les capsules de la platanthère blanchâtre de l’Ouestarrivent à maturité à la fin août et au début septembre et libèrent leurs graines à partir du début septembre; la plante a alors flétri et est devenue brune (E. Punter, obs. pers.). La production de capsules est irrégulière. Dans une parcelle permanente ayant fait l’objet d’un suivi de 1994 à 1998 et où les individus de l’espèce avaient été marqués, 13 % des fleurs ont produit un fruit en 1996 (Borkowsky, comm. pers., 2015). Dans un autre secteur de la Réserve de prairie d’herbes longues, de 1988 à 1990, 0 %, 81 % et 23 % des fleurs ont produit des capsules chez les individus marqués (Johnson, 1989, 1991). Dans le même secteur où Johnson a réalisé ces relevés de 1988 à 1990, 60 % des fleurs ont produit des capsules en 1994, et 44 %, en 1995 (Dewar, 1996).
Les orchidées entretiennent une relation symbiotique avec des champignons mycorhiziens qui sont nécessaires à leur développement et à leur survie (Currah et al., 1990). Ces champignons sont particulièrement essentiels durant le développement des semis et sont nécessaires à l’établissement de nouveaux individus (Sharma et al., 2003a). Des études sur la platanthère hyperboréale (Platanthera hyperborea) ont montré que les champignons mycorhiziens pénètrent dans la graine par les cellules mortes du suspenseur et déclenchent le développement du protocorme (Richardson et al., 1992). Le champignon mycorhizien fournit du carbone à la plante par ses hyphes en spirale et, en échange, prélève des glucides produits par la plante (Harley, 1959; Smith, 1966, 1967; Harley et Smith, 1983; Alexander, 1987). Selon Smith (1966, 1967), les semis ont un moyen de limiter le prélèvement des sucres par les champignons avant qu’ils puissent effectuer la photosynthèse.
Chez les orchidées, les graines ayant germé forment un protocorme, soit une masse de cellules dont les tissus sont peu différenciés mais chez laquelle il est tout de même possible de reconnaître la région basale et la région apicale. La région apicale produit les pousses et les amorces de racines, qui mènent au développement d’une plantule. Chez les orchidées des régions tempérées du Nord, la germination et les premiers stades du développement se déroulent dans le sol, sans lumière, ce qui signifie que le protocorme est hétérotrophe. Les champignons mycorhiziens pénètrent d’abord les cellules basales du protocorme et s’y installent, mais ils finissent par être confinés aux tissus du parenchyme quand le système vasculaire et les poussent commencent à se développer. Le développement des pousses et la production de chlorophylle permettent à la plante d’effectuer la photosynthèse et de devenir partiellement autotrophe (Hadley, 1982).
On en sait peu sur la viabilité, la longévité et la dormance des graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ainsi que sur les conditions nécessaires à leur germination. Dans le cadre d’essais sur le terrain réalisés dans la Réserve de prairie d’herbes longues en 1992, quelques graines de platanthère blanchâtre de l’Ouestont germé en 45 jours, et des poils épidermiques ont pu être observés après 108 jours. Un protocorme possédant un méristème apical s’est développé en 108 jours, mais il a été impossible de déterminer son état mycorhizien (Zelmer, 1994). La colonisation des graines par les champignons mycorhiziens n’était pas nécessaire pour déclencher la germination chez toutes les espèces d’orchidées des régions tempérées du Nord étudiées par Zelmer (1994). Toutefois, le développement se poursuivait uniquement chez les graines qui ont fini par être colonisées par un champignon mycorhizien (Zelmer et al.,1996). Les racines de la plupart des espèces examinées étaient modérément à fortement colonisées par des champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens ne fournissent pas tous le même type de ressources aux espèces d’orchidées, car leur stratégie nutritionnelle va de la biotrophie facultative à la nécrotrophie facultative, en passant par la saprotrophie (Zelmer, 1994). Dans le cadre d’études du système racinaire de la platanthère blanchâtre de l’Ouest,différents degrés de colonisation du cortex racinaire par des champignons mycorhiziens ont été observés (Zelmer, 1994). Deux champignons, le Ceratorhiza pernacatena et une espèce du genre Epulorhiza, ont été isolés des racines d’individus de la platanthère blanchâtre de l’Ouestprovenant de la région de Vita (Zelmer, 1994; Zelmer et Currah, 1995). Ces deux espèces de champignons peuvent être présents à l’intérieur d’une même racine et de la même partie d’une racine, sous forme de pelote intacte, partiellement digérée et presque entièrement digérée (Zelmer, 1994). Des pelotes de tous les stades de formation et en décomposition peuvent être présentes simultanément dans une portion d’une racine, mais être absentes d’autres parties de la racine (Zelmer et al.,1996). Bjugstad-Porter (1993) a isolé un Rhizoctonia spp. de racines d’individus de la platanthère blanchâtre de l’Ouestqui poussaient dans la prairie nationale Sheyenne. Les jeunes semis et les individus matures d’une même espèce peuvent être associés à des champignons mycorhiziens endophytes différents (Zelmer et al.,1996). Dans le cadre d’études menées par Alexander (2006) dans la prairie nationale Sheyenne, en un an 5 % des graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouest avaient augmenté de volume, et leur tégument s’était fendu, signes de germination. Environ 60 % des graines étaient viables mais sont demeurées en dormance au cours de la première année. Le taux de graines viables varie entre 9 % et 37 % et est plus élevé dans les petites sous-populations (Sharma et al., 2003). La longévité des graines a été évaluée par Whigham et al. (2006). Les graines d’espèces d’orchidées du genre Platanthera placées à l’intérieur de sachets ont été enfouies dans le sol durant 35 mois (3 ans). Tous les sachets renfermaient des graines viables après cette période, mais aucune graine n’avait germé.
Physiologie et adaptabilité
Chez les orchidées matures, les champignons mycorhiziens endophytes sont présents dans les cellules corticales des racines ou d’autres structures absorbantes (Currah et al.,1990). L’inoculation de populations de champignons dans le sol avant la transplantation pourrait augmenter les probabilités de réussite (Zettler et al., 2001; Zettler et Piskin, 2011). La platanthère blanchâtre de l’Ouest (Sharma et al., 2003b) et la platanthère blanchâtre de l’Est (Zettler et al., 2001), espèces étroitement apparentées, ont pu être multipliées en laboratoire à partir de graines aux États-Unis. La meilleure méthode mise à l’essai dans le cadre d’études consistait à effectuer une stratification froide et à inoculer au milieu de culture des champignons mycorhiziens des genres Ceratorhiza et Epulorhiza prélevés chez d’autres semis (Zelmer et Currah, 1997; Sharma et al., 2003b). Des études portant sur le Platanthera integrilabia ont montré que l’exposition des graines à la lumière durant 7 jours suivie par une absence de lumière favorisait la germination (Zettler et McInnis, 1994), mais cette technique n’a pas été mise à l’essai pour la platanthère blanchâtre de l’Ouest. On ignore actuellement le degré de faisabilité de la réintroduction en nature de la platanthère blanchâtre de l’Ouest et le degré de réussite possible d’une telle réintroduction, car on n’est pas parvenus à faire survivre des individus ex vitro dans le cas de la platanthère blanchâtre de l’Est (Zettler et Piskin, 2011).
La plupart des tentatives de transplantation de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont échoué (Borkowsky, comm. pers., 2015). En 1995, un certain nombre d’individus végétatifs et d’individus florifères de l’espèce prélevés dans un fossé ont été transplantés dans un champ dans la Réserve de prairie d’herbes longues. Ces individus (56 florifères et 40 végétatifs) ont été marqués puis ont fait l’objet d’un suivi. Le nombre d’individus de chaque type a diminué dans les années qui ont suivi. En 1999, aucun des individus marqués n’a produit de parties aériennes (Punter, 2000). De plus, en 1995, dix autres individus ont été prélevés dans le même fossé et transplantés dans le parc naturel Rotary Prairie, à Winnipeg. Cinq individus florifères ont été observés en 1996, et deux en juillet en 1997 et en 1998, mais aucun individu n’était présent en 1999 (Punter, 2000). Les tentatives de transplantation d’individus provenant de la portion sud-ouest de l’aire de répartition canadienne de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont donc au final échoué, même si des individus ont au début persisté pendant plusieurs années (Borkowsky, comm. pers., 2015).
Selon les études menées par Sharma et al. (2003a) et par Zelmer et al. (1996), les mycobiontes de la platanthère blanchâtre de l’Ouestpourraient différer d’une région à l’autre et en fonction de l’âge des individus. Les champignons mycorhiziens prélevés chez des semis donnent de meilleurs résultats pour la production in vitro de plantules que ceux prélevés chez des individus adultes (Sharma et al., 2003b).
Dispersion
Les graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouestsont très petites; elles se composent d’un tégument et d’un embryon, mais sont dépourvues d’albumen (Punter, 2000). Le tégument des graines des orchidées présente une surface lipophile texturée qui pourrait favoriser la rétention de bulles d’air et donc la dispersion par l’eau. Chez les graines de certaines espèces d’orchidées terrestres, la présence d’une poche d’air entre le tégument et l’embryon aide les graines à demeurer en suspension et pourrait favoriser leur dispersion par le vent (Peterson et al.,1998). Selon Hof et al. (1999), l’eau serait importante pour la dispersion des graines de l’espèce dans la prairie nationale Sheyenne. Au Manitoba, le mode de dispersion des graines n’a pas été confirmé, mais le vent et l’eau pourraient y être des agents de dispersion.
Les orchidées terrestres ont besoin de la présence de certains champignons dans le sol. La colonisation pourrait être limitée par l’absence de champignons appropriés. De plus, la présence des pollinisateurs obligatoires est essentielle à la production de graines (voir la section ci-dessous).
Relations interspécifiques
Quinze espèces de sphinx, seul groupe de pollinisateurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (voir la section Biologie), sont présentes dans la Réserve de prairie d’herbes longues (Westwood et Borkowsky, 2004). Toutefois, seulement deux de ces espèces, le Sphinx drupiferarum et le Hyles gallii, sont des pollinisateurs confirmés de la platanthère blanchâtre de l’Ouest au Canada (Westwood et Borkowsky, 2004; Borkowsky et al., 2011). La pollinisation de l’espèce par l’Eumorpha achemon a été confirmée dans la prairie nationale Sheyennes, dans le Dakota du Nord (Cuthrell et Rider, 1993). De plus, des papillons des espèces Lintneria eremitus (Harris et al., 2004) et Paratraea plebeja (Ashley, 2001) ont été observés transportant du pollen de la platanthère blanchâtre de l’Ouest aux ÉtatsUnis. Pour qu’ils puissent prélever le nectar de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, les papillons doivent posséder une trompe d’au moins 30 mm de longueur, ce qui correspond à 75 % de la longueur de l’éperon nectarifère (Westwood et al., 2011). D’après la longueur de leur trompe par rapport à la longueur de l’éperon nectarifère, l’Hyles lineata, le Sphinx chersis et le Sphinx kalmiae pourraient aussi être des pollinisateurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Sheviak et Bowles, 1986; Westwood et Borkowsky, 2004). En outre, la pollinisation de la platanthère blanchâtre de l’Ouest par l’Hyles euphorbiae, espèce non indigène,a été confirmée aux États-Unis (Jordan et al., 2006; Fox et al., 2013), mais cette espèce n’est pas présente dans la Réserve de prairie d’herbes longues, au Manitoba (Friesen et Westwood, 2013). Le Sphinx drupiferarum et l’Hyles gallii sont tous deux peu courants au Manitoba, leur effectif fluctue annuellement, et leur période de vol présente un chevauchement limité avec la période de floraison de la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Westwood et Borkowsky, 2004; Westwood et al., 2011). Certaines années, ces deux pollinisateurs n’ont pas été observés dans la région de la prairie à herbes hautes. Cette absence pourrait être attribuable à des facteurs comme une faible abondance de nourriture, une prédation élevée, l’emplacement des pièges installés ou des facteurs météorologiques (Friesen et Westwood, 2013). Le vent et la température ont une incidence sur l’activité des pollinisateurs (Cruden et al., 1976; del Rio et Burquez, 1986; Willmott et Burquez, 1996; Friesen et Westwood, 2013). De plus, les forts vents pourraient faire en sorte que les pollinies se fixent à d’autres végétaux qui entrent en contact avec les fleurs, ce qui pourrait donner une mauvaise estimation des taux de visite par les pollinisateurs (Borkowsky, 2006).
La teneur en sucre du nectar des fleurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest diminue avec le temps (Westwood et al., 2011). La teneur en sucre du nectar est d’environ 25 %, ce qui est semblable à ce qui est observé chez la plupart des autres plantes (Fox et al., 2015). Le volume de nectar augmente durant la nuit, ma sa teneur en sucre demeure continue (Westwood et al., 2011). Le nectar est une récompense qui attire les pollinisateurs, mais également des espèces qui volent le nectar en perçant des trous dans l’éperon nectarifère ou qui ne participent pas à la pollinisation en prélevant le nectar (Fox et al., 2015). Parmi les espèces voleuses de nectar observées dans le Dakota du Nord, on compte le Manduca quinquemaculata, l’Agrius cingulate, l’Apis mellifera, le Bombus bimaculatus, le B. borealis, le B. fervidus, le B. griseocollis, le B. huntii, le B. rufocinctus, le B. ternarius et le B. vagans (Fox et al., 2015).
Au Canada, deux espèces de champignons mycorhiziens du groupe des Basidiomycètes ont été observés chez des individus adultes de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, soit le Ceratorhiza pernacatena et le Epulorhiza calendulina (Zelmer et al., 1996). Toutefois, seulement un champignon du genre Epulorhiza a été détecté chez les graines de l’espèce (Zelmer et al., 1996). Au Minnesota et au Missouri, des champignons mycorhiziens des genres Ceratorhiza et Epulorhiza ont été observés enassociation avec la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Les champignons du genre Ceratorhiza étaient dominants, alors que ceux du genre Epulorhiza étaient moins abondants (Sharma et al., 2003a). Ces observations coïncident avec les résultats d’études sur la platanthère blanchâtre de l’Est, qui ont montré que les champignons du genre Ceratorhiza étaient plus importants pour répondre aux besoins de l’espèce mycotrophique (Zettler et al., 2005).
Taille et tendances des populations
Activités et méthodes d’échantillonnage
L’espèce a fait l’objet de travaux de terrain de grande envergure au cours des 24 dernières années, et des recensements annuels des individus florifères sont réalisés depuis 1992. Le recensement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouestest réalisé par le personnel du Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba (voir la section Activités et méthodes d’échantillonnage).
Les rédactrices du rapport ont visité la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba et la région adjacente en 2014 et en 2015 et y ont observé la platanthère blanchâtre de l’Ouestles deux années. Les quarts de section située dans la réserve ont été visités en 2015, et les individus poussant sur des terrains privés ont été observés depuis le bord de la route.
Abondance
La population canadienne de platanthère blanchâtre de l’Ouest comptait 763 individus florifères en 2012, plus basse valeur observée, et 23 530 individus florifères en 2003, plus haute valeur observée (tableau 1). Le nombre d’individus florifères recensés au cours des 10 dernières années (2005-2014) a varié entre 763 et 14 685 (Borkowsky, comm. pers., 2015). Dans les sites occupés, le nombre de tiges florifères allait de 1 à 2 492, et le nombre moyen d’individus florifères à l’intérieur d’un site allait de 19 à 556 (Bleho et al., 2015). Aucune sous-population additionnelle n’a été découverte.
La population canadienne est la plus grande population connue de l’espèce dans le monde (Punter, 2000). Seulement deux autres grandes sous-populations sont connues (Minnesota et Dakota du Nord), et celles-ci se trouvent dans le nord des États du Midwest (Punter, 2000). La prairie nationale Sheyenne, dans le Dakota du Nord, héberge environ 3 000 individus, et la réserve Pembina Trail, au Minnesota, renferme plusieurs milliers d’individus. Toutes les sous-populations de la moitié sud de l’aire de répartition de l’Espèce aux États-Unis comptent moins de 50 individus. La platanthère blanchâtre de l’Ouest est apparemment disparue de 60 % des comtés pour lesquels il existe des mentions historiques (Harrison, 1989).
Les sous-populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest sont souvent réparties de façon éparse, même dans les milieux les plus propices. La densité d’individus de l’espèce dans deux parcelles permanentes au Manitoba était de 1,36 individus/m2 et de 0,58 individus/m2 en 1994 (Punter, 2000).
Fluctuations et tendances
La population d’individus matures (estimée d’après le nombre d’individus florifères) a connu des fluctuations extrêmes (changements d’un ordre de grandeur) depuis 1992, année où les recensements ont commencé. Depuis 1992, le nombre d’individus florifères a varié entre 763 et 23 530 individus (tableau 1). De multitudes facteurs peuvent avoir une incidence sur la floraison de l’espèce au cours d’une année, de sorte que le nombre de tiges florifères ne constitue pas un indicateur absolu de la taille de la population d’individus matures. Les fluctuations du nombre d’individus florifères peuvent découler de causes naturelles (comme les conditions météorologiques), de pratiques de gestion (notamment le régime de brûlage), de perturbations incontrôlables et de pratiques d’utilisation des terres (Bleho et al., 2015). Cependant, vu la courte durée de vie des individus florifères de l’espèce (1 à 3 ans), on croit que les importantes fluctuations observées reflètent des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures. On dispose de données complètes uniquement pour le nombre d’individus florifères, mais dans les parcelles permanentes établies dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, tous les individus marqués en 1994 (végétatifs et florifères) étaient absents en 1999 (Borkowsky, comm. pers., 2015). De même, dans la prairie nationale Sheyenne, les individus étaient absents les années suivant leur marquage (Sieg et Ring, 1995). Ces observations indiquent que le nombre d’individus florifères et probablement le nombre d’individus végétatifs fluctuent, possiblement sous l’effet des conditions climatiques ou de la pollinisation. Même si ce sont les fluctuations du nombre d’individus matures qui sont supérieures à un ordre de magnitude, on estime que le terme « fluctuation extrême » s’applique à la situation de l’espèce; selon les lignes directrices de l’UICN, les fluctuations doivent représenter un changement au niveau de la population totale (tous stades du cycle vital compris) plutôt qu’un flux d’individus passant d’un stade du cycle vital à un autre. L’ampleur des fluctuations du nombre d’individus florifère observées chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest pourrait être atténuée par le nombre d’individus végétatifs présents les années où le taux de floraison est bas.
L’efficacité des activités de recherche, qui a augmenté depuis 1992, n’a entraîné aucune augmentation du nombre d’individus matures (Bleho et al., 2015). Aucune corrélation n’a été constatée entre le nombre de quarts de section ayant fait l’objet de relevés et le nombre de tiges florifères, ce qui indique que la répartition de la population est bien connue et qu’aucune colonie additionnelle n’a été découverte (figure 4). Un lien a été établi entre la présence de densités élevées d’individus florifères et une teneur en eau élevée dans le sol durant la saison de croissance précédente (Sieg et Ring, 1995). Au Manitoba, un nombre élevé d’individus florifères (total de > 10 000) a été observé en 1996, en 1997, en 2003, en 2004 et en 2011 (figure 5; Borkowsky, comm. pers., 2015). Les effectifs les plus élevés enregistrés pourraient être attribuables aux incendies survenus à l’automne 2000 et au printemps 2001, qui auraient permis une diminution de la couverture de chaume et une augmentation du taux de floraison les années suivantes.
Il est difficile de dégager une tendance globale à cause de la biologie de l’espèce et parce que l’intensification des activités de recherche pourrait biaiser les données et faire paraître que la taille de la population a augmenté ou est demeurée stable. Le nombre de tiges florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Manitoba semble atteindre un pic tous les cinq ou six ans. La figure 5 montre que le dernier pic, qui était de 14 685 individus en 2011, est plus bas que les pics précédents, où plus de 20 000 individus florifères avaient été observés. On ignore si cette constatation indique un déclin de la population ou est simplement attribuable à des conditions défavorables à la floraison. Dans la Réserve de prairie d’herbes longues, il semble exister une corrélation entre la présence de brûlages ou de feux de friche et le taux de floraison élevé l’année suivante; toutefois, la combinaison d’un feu de friche survenant au mauvais moment et d’une année de sécheresse pourrait avoir un effet très négatif sur la population (Bleho et al. 2015). Un tel phénomène est potentiellement responsable du taux de floraison extrêmement faible observé en 2012, où le nombre d’individus florifères (763) le plus faible en 24 ans a été enregistré. Ces tendances représentent une estimation du nombre d’individus matures fondée sur le nombre de tiges florifères, et elles dépendent d’une multitude de facteurs (notamment les incendies et les conditions météorologiques) (Bleho et al., 2015).
.
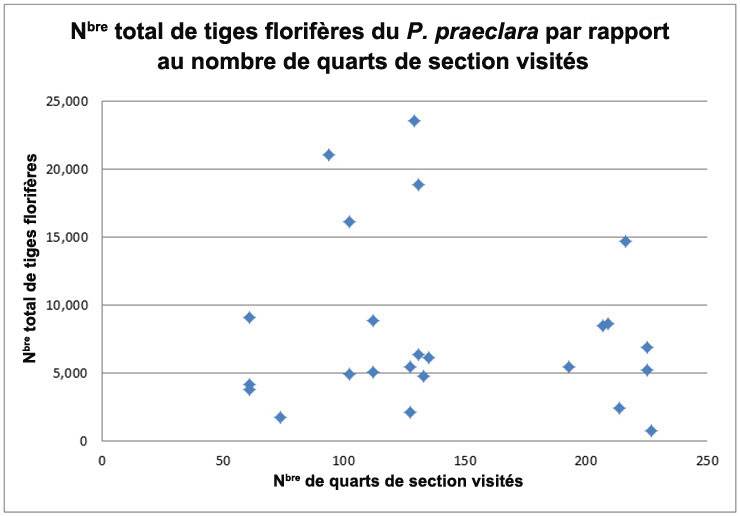
Description longue de la figure 4
Graphique illustrant le nombre de tiges florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest par rapport au nombre de quarts de section visités près de Vita, au Manitoba.
Figure 5. Nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la région à proximité de Vita, au Manitoba (graphique créé à partir des données du tableau 1).
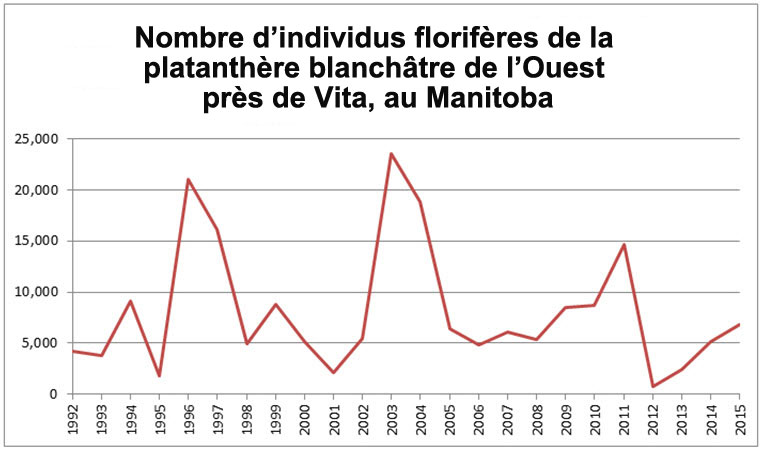
Description longue de la figure 5
Graphique illustrant la fluctuation du nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest près de Vita, au Manitoba, de 1992 à 2015.
Immigration de source externe
Il est peu probable que de nouveaux individus de l’espèce s’établissent grâce à une dispersion depuis les sous-populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest situées à l’extérieur du Canada, à cause de la disponibilité d’habitat limitée. On croit que les graines de l’espèce peuvent être dispersées par le vent, mais la sous-population des États-Unis la plus proche se trouve à environ 50 km au sud de la population canadienne, dans le parc d’État Lake Bronson, au Minnesota, et celle-ci est plutôt petite. La prairie nationale Sheyenne, dans le Dakota du Nord, héberge environ 3 000 individus de l’espèce et se trouve à environ 400 km au sud, et la réserve Pembina Trail, au Minnesota, renferme plusieurs milliers d’individus et se trouve à environ 200 km au sud.
Menaces et facteurs limitatifs
Menaces
Les menaces possibles ont été évaluées au moyen du calculateur de menaces de l’UICN (Salafsky et al., 2008; Master et al., 2012; annexe 1); les menaces les plus importantes sont présentées ci-dessous, en ordre approximatif décroissant d’impact. Les menaces ayant le même niveau d’impact sont présentées selon l’ordre de l’énumération dans l’annexe 1. Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont les modifications de l’écosystème qui entraînent une dégradation et une éventuelle destruction de l’habitat ainsi que les changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes associés aux changements climatiques sont considérés comme la plus grave menace à long terme. Les titres en caractères italiques correspondent à des éléments du tableau d’évaluation des menaces (Salafsky et al., 2008). L’impact global des menaces calculé est « élevé-moyen ». L’impact global des menaces a toutefois été ajusté à « moyen » à la suite de la conférence téléphonique d’évaluation des menaces, car l’espèce fait l’objet d’une gestion, plus de 50 % de sa population se trouve sur des terres protégées, l’habitat essentiel a été désigné pour 24 quarts de section qui hébergent la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans le programme de rétablissement fédéral, et il est possible que certaines menaces ne soient pas d’une portée ou d’une gravité aussi élevée que ce qui est indiqué. Le gouvernement du Manitoba travaille à protéger efficacement ces terres de façon à limiter les activités qui pourraient endommager ou détruire l’habitat essentiel (désigné dans le programme de rétablissement). En outre, la platanthère blanchâtre de l’Ouest est inscrite à la Loi sur les espèces en voie de disparition du Manitoba, ce qui confère une protection aux individus de l’espèce et à l’habitat dont ils dépendent.
1) Modifications des systèmes naturels (7.0) - Impact calculé moyen-faible.
Incendies et suppression des incendies (7.1)
Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre dans la prairie boisée (Wier, 1983), écotone entre la prairie véritable et la forêt boréale. En l’absence de perturbations comme les incendies, les espèces ligneuses envahissent les communautés végétales dominées par les graminées, entraînant ainsi la disparition des espèces intolérantes à l’ombre comme la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Punter, 2000). L’absence de perturbations favorables, qui permet la succession végétale entraînant la présence d’une végétation haute et dense, constitue une des menaces les plus répandues dans les écosystèmes de prairie et pourrait en causer le déclin. La succession végétale représente une menace répandue et imminente, même dans les aires protégées.
Les brûlages sont un outil couramment utilisé pour la gestion des prairies et peuvent favoriser la croissance des individus de l’espèce et la fréquence de la reproduction sexuée (Collins et Wallace, 1990; Pleasants, 1995). Selon une étude sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest menée en Iowa, l’élimination de la litière durant les années sèches accentue le stress hydrique, a un effet négatif sur la croissance des individus et accroît l’avortement des fleurs (Pleasants, 1995). Les années où le printemps est humide, les brûlages peuvent éliminer la concurrence et accroître la teneur en éléments nutritifs du sol, favorisant ainsi la croissance de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, mais les brûlages réalisés à la fin du printemps peuvent endommager les individus de l’espèce (Pleasants, 1995; Biederman et al., 2014; Bohl et al., 2015). Les brûlages réalisés à la suite d’une année humide, et donc durant une saison propice à la floraison, entraînent une diminution du taux de reproduction (Pleasants, 1995). Les brûlages annuels peuvent nuire à l’espèce (Bohl et al., 2015). Les sphinx ont besoin d’un habitat de forêt mixte (Punter, 2000). Le déboisement et la fragmentation de la forêt mixte entraînent la disparition des végétaux nécessaires à l’alimentation des sphinx et sont donc une menace pour leur survie. De même, les brûlages peuvent éliminer les végétaux ligneux, qui sont importants pour la survie des sphinx. Il faudrait que ces facteurs soient pris en compte dans le cadre des activités de gestion de la végétation dense empiétant sur l’habitat et de l’accumulation de litière, pour éviter que les individus de l’espèce soient endommagés et que le taux de reproduction ne soit réduit.
Actuellement, les terres à l’intérieur de la Réserve de prairie d’herbes longues font l’objet de brûlages dirigés ou d’un pâturage en rotation destinés à réduire l’empiètement des végétaux ligneux et de la litière. Les brûlages y sont réalisés à une fréquence de 4 ou 5 ans pour réduire la menace que représente pour la platanthère blanchâtre de l’Ouest l’absence de perturbations. Les superficies brûlées vont d’un demi-quart de section à jusqu’à six quarts de section adjacents. Certains facteurs comme les précipitations font l’objet d’un suivi pour éviter que les brûlages n’aient un effet négatif sur la population de l’espèce (Borkowsky, comm. pers., 2015). Au cours des huit dernières années, les conditions printanières et automnales ont été trop sèches pour que des brûlages soient réalisés ou alors trop humides pour que les brûlages soient efficaces, et il a donc été difficile de maintenir un régime de brûlage idéal (Borkowsky, comm. pers., 2015). Le dernier incendie de grande envergure, causé par un feu de friche, s’est produit il y a environ quatre ans. Huit quarts de section ont été partiellement brûlés en 2014 (Borkowsky, comm. pers., 2015).
Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages (7.2)
La teneur en eau de la couche supérieure du sol est le facteur le plus déterminant pour la répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Sieg et Ring, 1995; Wolken, 2001; Bleho et al., 2015). Des travaux d’amélioration du drainage ayant une incidence sur le régime hydrologique sont réalisés dans la région de Vita, notamment l’approfondissement des fossés bordant les routes et l’installation de drains. Les platesformes surélevées qui entrecoupent les baissières dans lesquelles pousse la platanthère blanchâtre de l’Ouest entravent l’écoulement naturel des eaux souterraines près de la surface, ce qui entraîne une augmentation de la teneur en eau du sol et une élévation de la nappe phréatique du côté le plus élevé de ces barrières, et un assèchement du côté le plus bas (NCC, données inédites). Le canal de drainage de Vita, construit en 1990, s’étend sur les côtés est et nord de la réserve et a entraîné un prélèvement accru des eaux de surface dans la région (Collicutt, 1993), ce qui a mené a un abaissement de la nappe phréatique et à un assèchement des conditions. Durant les années où les précipitations sont faibles, l’abaissement de la nappe phréatique pourrait nuire à la qualité de l’habitat de l’espèce et rendre les sites auparavant humides propices à une conversion en terres agricoles. Les années 1980 se sont caractérisées par des précipitations inférieures à la moyenne, alors que dans les années 1990 les précipitations ont été supérieures à la moyenne. Les effets du canal de drainage sur le régime hydrologique de la région n’ont pas été étudiés, mais on suppose qu’ils sont négatifs, particulièrement durant les périodes où les précipitations sont inférieures à la moyenne.
2) Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (11.0, altération de l’habitat, sécheresses, tempêtes et inondations) - Impact calculé moyen-faible.
Le régime hydrologique de l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest est l’un des plus importants facteurs pour la pérennité de l’espèce, si ce n’est le plus important. Les modèles de changements climatiques prédisent une augmentation de la variabilité des conditions météorologiques et de la fréquence des phénomènes météorologiques violents dans les Prairies canadiennes (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001). Le Manitoba, vu sa position centrale à l’intérieur du continent nord-américain et sa latitude nordique, subira les changements climatiques de façon plus hâtive et plus marquée que de nombreuses autres parties du monde. Une augmentation des températures moyennes est prévue pour le Manitoba. Selon les prévisions, le rapport précipitations hivernales / précipitations estivales augmentera, et l’été et l’automne deviendront plus secs (Government of Canada, 2004; Manitoba Conservation, 2015). Depuis le début des années 1980, les températures ont augmenté de plus de 2 °F dans le nord du Minnesota (région adjacente au sud du Manitoba), et la tendance est à la hausse (Minnesota State Climatology Office, 2015). Le réchauffement enregistré semble s’être majoritairement produit au cours des 20 à 30 dernières années. Il est probable que la variation interannuelle des précipitations augmentera. Il est également prévu que la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les tempêtes intenses, augmentera. Ces conditions auront des conséquences graves dans l’écozone des Prairies, particulièrement dans l’extrême sud du Manitoba.
L’augmentation de la durée et de la fréquence des périodes de sécheresse entraînera une diminution des eaux de surface et des eaux souterraines et, par conséquent, un déclin du nombre d’individus de l’espèce et du succès de la reproduction de celle-ci. Deux des plus graves sécheresses ayant touché les plaines du nord dans un passé récent se sont produites de 1988 à 1992 et dans les années 1930, durant la période dite du « Dust Bowl ». Les conditions de sécheresse seront exacerbées par les nombreux fossés présents dans la région ainsi que par le canal de drainage de Vita, et également par la demande en eau accrue pour l’irrigation des terres agricoles. Les changements climatiques risquent de causer une augmentation de la fréquence des incendies et des superficies brûlées (Flannigan et al., 2009), mais la suppression pourrait atténuer ces effets. La combinaison d’un feu de friche survenu à un moment inopportun (par rapport à la reproduction de l’espèce) et d’une année de sécheresse pourrait être la cause du taux de floraison extrêmement bas observé en 2012 (comme l’indique la figure 5).
En outre, les inondations pourraient nuire à l’espèce si elles se prolongent ou surviennent durant certaines périodes de l’année. En 1997, le Manitoba a connu « l’inondation du siècle », qui a eu des répercussions considérables dans la vallée de la rivière Rouge. Dans la prairie nationale Sheyenne, des niveaux phréatiques élevés en 1993 et en 1994 ont eu un effet différent sur les individus végétatifs et les individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. En 1993, dans les zones basses, 70 % des individus florifères et 3 % des individus végétatifs ont persisté durant la saison de croissance. Le faible taux de persistance des individus végétatifs a été attribué à la faible hauteur de ceux-ci. En 1994, seulement 13 % des individus florifères qui avaient survécu en 1993 sont réapparus en 1994, ce qui est bien inférieur aux taux de réapparition observés de 1991 à 1993 (Sieg et Wolken, 1999).
3) Agriculture (2.0) - Impact calculé faible.
Élevage de bétail (2.3)
Du bétail est actuellement élevé sur les terres privées et les terres publiques. À long terme, le pâturage du bétail peut avoir des répercussions sur les individus de l’espèce, qui peuvent être piétinés ou consommés. Bleho et al. (2015) et Alexander et al. (2010) ont constaté que le pâturage avait un effet négatif sur la présence et la floraison de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Toutefois, cet effet dépend probablement de l’intensité du pâturage et du moment où le bétail est présent, car les effets de cette activité seraient positifs selon d’autres études (p. ex. Bugstad et Fortune, 1989; Sieg et Ring, 1995). Les fauchages annuels effectués au milieu ou à la fin de l’été éliminent les inflorescences et les tissus photosynthétiques des individus de l’espèce, ce qui affaiblit ceux-ci et réduit le recrutement de semis, causant par conséquent une attrition de la population (Punter, 2000). On ignore quels sont les effets exacts de l’élevage du bétail, car ils dépendent fortement des décisions prises par les propriétaires des terres.
Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois (2.1)
Les activités agricoles de grande envergure ont causé la destruction de la majeure partie de la prairie à herbes hautes au Canada et aux États-Unis (Samson et Knopf, 1994; Honey et Oleson, 2006). Au Manitoba, la prairie à herbes hautes se limite aujourd’hui principalement à la municipalité rurale de Stuartburn, située près de Vita et de Tolstoi (Joyce et Morgan, 1989). Bien que 63 % des terres hébergeant la platanthère blanchâtre de l’Ouestsoient gérés par la Réserve de prairie d’herbes longues, les 37 % restants se trouvent sur des terrains privés ou dans des emprises routières et peuvent être menacés par l’agriculture ou d’autres activités de conversion des terres. Les effets des activités agricoles réalisées sur les terrains privés dépendent grandement des décisions du propriétaire du terrain et sont donc incertains. Le labourage des terres qui hébergent la platanthère blanchâtre de l’Ouestdétruit les individus de l’espèce et leur habitat. Dans la région de la Réserve de prairie d’herbes longues, la moitié d’un quart de section (32 ha) qui renfermait l’espèce a été labourée et cultivée en 1992 (Collicutt, 1993).
Pour que la platanthère blanchâtre de l’Ouest puisse se reproduire, elle doit être pollinisée par des sphinx. La survie de ces papillons est menacée par la conversion de leur habitat à des fins agricoles ou à d’autres fins et par la disparition des leurs plantes hôtes. Au Manitoba, deux espèces de sphinx qui pourraient être des pollinisateurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont besoin de forêt mixte comme habitat (Westwood, comm. pers., in Punter, 2000).
4) Corridors de transport et de service (4.0, routes et voies ferrées [4.1] et lignes de services publics [4.2]) - Impact calculé faible.
Environ 12 % des individus florifères poussent dans des emprises routières (bordure de routes et fossés) dans la région de Vita. La figure 6 montre des individus poussant très près d’un chemin. Les activités d’entretien des routes et des fossés, notamment le nivellement, l’excavation, le fauchage et l’application d’herbicides, peuvent causer la destruction de l’habitat et la mort des individus de l’espèce. Les activités de fauchage réalisées durant le pic de floraison risquent d’éliminer les fleurs et de nuire à la reproduction sexuée dans les sites se trouvant en bordure de routes. Durant l’été 1988, 20 individus ont été détruits lors du nettoyage des fossés (Johnson, 1989). En 1995, 56 individus florifères et 40 individus végétatifs ont été prélevés dans une zone où des travaux de nettoyage des fossés étaient prévus, puis ont été transplantés et marqués à des fins de suivi. Le nombre d’individus marqués faisant leur réapparition a diminué d’année en année par la suite, et en 1999 aucun des individus marqués n’a produit de parties aériennes (Punter, 2000). En 1993, des herbicides ont été appliqués dans des emprises routières, à des fins d’entretien, ce qui entraîné la mort d’individus de la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Punter, 2000). Il a été démontré que les herbicides utilisés pour lutter contre les espèces envahissantes telles que l’euphorbe de Tommasini (Euphorbia virgata [très souvent nommée à tort E. esula]) causent des dommages aux orchidées; cependant, les effets varient en fonction du type d’herbicide et de la période d’application (USFW, 2009). Comme dans le cas des emprises routières, les activités d’entretien et l’utilisation d’herbicides le long des lignes des services d’utilité publique posent également problème. En 2015, un câble de télécommunication souterrain a été installé dans une emprise routière hébergeant la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Cary Hamel, obs. pers.).
Actuellement, dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, les techniciens du Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune marquent les individus de l’espèce qui poussent en bordure des principales routes et dans les principaux fossés; toutefois, des individus sont encore tués par accident (Borkowsky, comm. pers. 2015).

Description longue de la figure 6
Photo de platanthères blanchâtres de l’Ouest poussant en bordure d’un chemin.
5) Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques (8.0) - Impact calculé faible.
Espèces exotiques envahissantes (8.1)
Certaines espèces comme le pâturin des prés (Poa pratensis) supplantent les espèces indigènes des prairies et ont un effet négatif sur l’abondance de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Wolken et al., 2001). On prévoit que l’euphorbe de Tommasini pourrait devenir une menace dans les sites hébergeant la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Punter, 2000; Wolken et al., 2001). Parmi les autres espèces exotiques envahissantes présentes dans la Réserve de prairie d’herbes longues, on compte le millepertuis commun (Hypericum perforatum), le brome inerme (Bromus inermis ssp. inermis) et les mélilots (Melilotus alba et M. officinalis) (Punter, 2000). Toutes ces espèces pourraient supplanter les espèces indigènes et perturber les processus des communautés végétales naturelles.
Espèces indigènes problématiques (8.2, herbivores)
La population de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Manitoba est une des plus grandes populations de l’espèce en Amérique du Nord, et il est peu probable que la consommation de quelques individus ou fleurs par des herbivores (si le système racinaire demeure intact) nuise gravement à la population (Borkowsky, 2006). Toutefois, les herbivores pourraient causer la disparition de l’espèce dans les sites comptant seulement quelques tiges florifères. Le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) semble consommer la partie supérieure des plantes de l’espèce (Punter, 2000).
Des cas de prédation par des insectes (fleurs consommées par des criquets du genre Neoconocephalus [Orthoptères] [U.S. Fish and Wildlife Service, 1996]; boutons floraux consommés par le charançon Stethobaris commixta [Coléoptères] [Sieg et O’Brien, 1993]) ont été observés dans les sous-populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest aux États-Unis. Le charançon réduirait le taux de floraison et endommagerait le système racinaire des individus (Sather, comm. pers., 2012). Même si les répercussions du charançon ont été observées aux États-Unis, le phénomène a été signalé à la réserve Pembina Trails, au Minnesota, en 2012 (Sather, comm. pers., 2012), et une expansion vers le nord est possible. Aucune maladie connue n’a d’effets négatifs sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (U.S. Fish and Wildlife Service 1996). Aucune étude sur les maladies ou la prédation par les insectes n’a été menée dans la Réserve de prairie d’herbes longues.
6) Pollution (9.0, effluents agricoles et sylvicoles [9.3]) - Impact calculé faible.
La platanthère blanchâtre de l’Ouest doit être pollinisée par des sphinx (Sphingidés) pour se reproduire. L’utilisation de pesticides n’avait initialement pas été considérée comme une menace pour la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Collicutt, 1993; U.S. Fish and Wildlife Service, 1996; Punter, 2000), mais elle pourrait en fait menacer les pollinisateurs dont dépend l’espèce (U.S. Fish and Wildlife Service, 2009). Les insecticides appliqués dans les terres agricoles pourraient représenter une menace pour ces pollinisateurs.
Les effluents agricoles, notamment ceux issus des engrais et du fumier, pourraient être une menace pour la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Environment Canada, 2006). Ces polluants causent une augmentation des concentrations de nutriments et peuvent ainsi entraîner une modification de la composition en espèces (Environment Canada, 2006). Les effets précis de cette menace sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest sont inconnus, mais il est possible que celle-ci soit supplantée par d’autres espèces à cause de l’augmentation des concentrations de nutriments (Environment Canada, 2006).
Facteurs limitatifs
Certains aspects de la biologie de la platanthère blanchâtre de l’Ouest représentent des facteurs limitatifs (adaptations limitées favorisant la dispersion, besoin de pollinisateurs et de champignons mycorhiziens), tout comme les besoins spécifiques de l’espèce en matière d’habitat. Il faudrait toutefois réaliser de plus amples recherches sur les facteurs limitatifs potentiels, notamment le faible potentiel de dispersion, les associations mycorhiziennes et l’isolement génétique. L’espèce atteint la limite nord de son aire de répartition au Canada, et les effets des changements climatiques sont incertains.
Les populations qui se trouvent aux limites de l’aire de répartition d’une espèce sont plus à risque de disparaître que celles qui se trouvent au cœur de celle-ci, à cause de facteurs liés à la diversité (Environment Canada, 2006). La population de platanthère blanchâtre de l’OuestduManitoba se trouve à environ 50 km au nord de l’autre souspopulation la plus proche, située au Minnesota (Environment Canada, 2006). Si on suppose que les sphinx volent sur des distances de 1 km ou moins pour s’alimenter, alors la population du Manitoba serait isolée sur le plan génétique. Les risques de dérive génétique et de consanguinité menacent l’existence de la population canadienne. La génétique de celle-ci n’a toutefois pas été étudiée. La perte de diversité génétique peut accélérer le déclin des populations de plantes rares (Godt et Hamrick, 2001). Ce phénomène doit être étudié plus en profondeur dans les populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Canada et des États-Unis, mais il est peu probable qu’il soit problématique dans le cas de la population canadienne, vu la grande taille de celle-ci.
Plusieurs facteurs biologiques ont une incidence sur les populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest, notamment l’abondance des pollinisateurs, le synchronisme entre la présence de pollinisateurs et la période de floraison, les effets environnementaux associés au vent et à la température sur la pollinisation (Westwood et Borkowsky, 2004; Borkowsky et Westwood, 2009), la teneur en eau de la couche supérieure du sol (Sieg et Ring, 1995), la formation des capsules (Borkowsky et Westwood, 2009), la viabilité des graines et les interactions avec les champignons mycorhiziens (Sharma et al., 2003b). Le recrutement de nouveaux individus est faible chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest, malgré le nombre élevé de graines produites (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996).
Au Manitoba, les individus de l’espèce sont régulièrement endommagés par le gel durant tous les mois de l’année, sauf juillet (normales climatiques canadiennes, 1981, 1991). À Zhoda, à 17 km au nord de Vita, des températures inférieures ou égales à 0 °C ont été observées cinq fois en mai 1994, sept fois en mai 1995 et une fois en juin 1995 (Dewar, 1996). Des gelées survenues à la mi-juin 1995 et le 14 juin 1999 ont endommagé les fleurs et les feuilles d’individus de l’espèce(Punter, 2000) et pourraient avoir entraîné une diminution de la production de capsules. Des dommages causés par le gel ont été observés chez le cypripède blanc dans la région de Vita en 2009 et en 2012 (COSEWIC, 2014). En outre, les températures basses durant la période de floraison pourraient réduire l’activité des insectes pollinisateurs et, par conséquent, la production de graines. Bien qu’il existe des prédictions des effets des changements climatiques sur les précipitations et les températures, on ignore dans quelle mesure la gravité des gelées printanières tardives et le moment où elles surviennent pourraient avoir des répercussions sur la population.
Nombre de localités
La population de platanthère blanchâtre de l’Ouest représente une seule localité d’après la menace grave et plausible que représentent les changements climatiques. L’espèce a une répartition très limitée au Canada, de sorte qu’elle serait très vulnérable aux phénomènes environnementaux stochastiques (phénomène aléatoire extrême qui aurait une incidence semblable sur tous les individus d’une même localité, par exemple une inondation majeure, une sécheresse extrême ou une flambée de maladie). Le phénomène stochastique le plus susceptible de se produire est la sécheresse extrême, et celui-ci a notamment été observé dans les États du Midwest durant la période du « Dust Bowl » et la crise des années 1930 (1934, 1936, 1939 et 1940). La sécheresse serait aujourd’hui exacerbée par les nombreux fossés présents dans la région ainsi que par le canal de drainage de Vita. De plus, les changements climatiques devraient entraîner une augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse dans la région.
En outre, la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest dans son ensemble est menacée par les modifications des systèmes naturels (suppression des incendies naturels et gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages). Toutefois, si on ignore ces menaces touchant l’ensemble de l’aire de répartition et qu’on tient compte uniquement du régime foncier, alors il y aurait plus de 10 localités (possiblement 21).
Protection, statuts et classements
Statuts et protection juridiques
La platanthère blanchâtre de l’Ouesta été désignée espèce en voie de disparition par le COSEPAC en 1993. Son statut a été réévalué en 2000 et a été maintenu. L’espèce figure à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada, à titre d’espèce en voie de disparition(SARA, 2003). Au Manitoba, elle est inscrite comme espèce en voie de disparition aux termes de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition. Un programme de rétablissement dans lequel l’habitat essentiel à protéger est désigné a été préparé en vue du maintien de la population à sa taille actuelle et de la survie à long terme de l’espèce (Environment Canada, 2006).
Aux États-Unis, la platanthère blanchâtre de l’Ouest a été désignée espèce menacée (Threatened) aux termes de l’Endangered Species Act en octobre 1989 (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996). En 2009, ce statut a été maintenu à la suite d’un réexamen de la situation de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (U.S. Fish and Wildlife Service, 2009). La platanthère blanchâtre de l’Ouest est considérée comme en voie de disparition aux termes des lois sur les espèces en péril des États du Minnesota et du Missouri et comme menacée aux termes des lois de l’Iowa, du Dakota du Sud, de l’Oklahoma et du Nebraska, mais elle ne bénéficie d’aucune protection à l’échelle des États du Dakota du Nord et du Kansas (U.S. Fish and Wildlife Service, 2009, 2010). Aux États-Unis, 83 % des individus de l’espèce se trouvent dans des sites bénéficiant d’une certaine forme de protection (U.S. Fish and Wildlife Service, 2009).
Les espèces du genre Platanthera sont inscrites l’Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui régit le commerce de ces espèces. Cette convention est mise en application au moyen du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages, qui est pris en vertu de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canadian Wildlife Service, 1997).
Statuts et classements non juridiques
NatureServe a attribué à la platanthère blanchâtre de l’Ouest cote mondiale de G3 (vulnérable) et une cote nationale de N1 (gravement en péril) au Canada. Elle est cotée S1 au Manitoba, au Kansas, au Minnesota et au Missouri, et SH en Oklahoma (NatureServe, 2015; University of Oklahoma, 2016). De plus, on lui a attribué les cotes de S2 (en péril) en Iowa, au Nebraska, au Dakota du Nord et de SH (historique) au Dakota du Sud (NatureServe, 2015).
Protection et propriété de l’habitat
Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouestest présente sur environ 2 222 hectares de terres privées et de terres provinciales au Manitoba. Le régime foncier des terres hébergeant l’espèce est présenté au tableau 3 (Hamel, comm. pers., 2016). Environ 63 % de l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Canada se trouvent dans la Réserve de prairie d’herbes longues, qui est divisée entre plusieurs régimes fonciers (Borkowsky, 2006). Après la découverte de la platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba, la réserve a été créée grâce à un partenariat entre la Société des naturalistes du Manitoba, le Fonds mondial pour la nature, Habitat faunique Canada, Conservation Manitoba, la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba, Conservation de la nature Canada et Environnement Canada (Borkowsky, 2006). Dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba sont protégés environ 5 170 hectares (12 728 acres) d’habitat d’espèces indigènes des prairies, dont la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Bleho et al., 2015). Conservation de la nature Canada est propriétaire d’environ 78 % des terres de la réserve, et le reste appartient à Nature Manitoba et à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba (Bleho et al., 2015). Les terres de la Couronne hébergeant l’espèce se trouvent dans l’aire de gestion de la faune de Stuartburn. Environ 34 % des individus poussent dans des emprises routières (fossés) et sur des terrains privés (tableau 3).
| Régime foncier | Hectares | Pourcentage de la superficie |
|---|---|---|
| Conservation de la nature Canada | 1272,4 | 57,3 |
| Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba | 0,1 | 0,0 |
| Société des naturalistes du Manitoba | 183,4 | 8,3 |
| Terres de la Couronne (2 baux agricoles) | 12,7 | 0,6 |
| Terrains privés (au moins 18 parcelles) | 601,3 | 27,1 |
| Emprises de voies publiques provinciales | 59,8 | 2,7 |
| Emprises de voies publiques municipales | 92,3 | 4,2 |
| Total | 2222,0 | 100,0 |
Le programme national de rétablissement de la platanthère blanchâtre de l’Ouest a quatre objectifs principaux : suivi permanent des tendances démographiques de l’espèce, mise en œuvre de pratiques de gestion bénéfiques, élaboration d’une stratégie de recherche en vue de combler les lacunes dans les connaissances, et sensibilisation accrue du public (Environment Canada, 2006). Ces objectifs ont en grande partie été réalisés par les partenaires de la Réserve de prairie d’herbes longues.
Les propriétaires des terrains privés peuvent également participer aux efforts de conservation en laissant l’espèce exister de manière naturelle ou en assurant une gestion appropriée des activités de pâturage, de fauchage et de brûlage (North Dakota Parks and Recreation, 2016). Les activités de pâturages devraient être réalisées de manière durable et flexible, en fonction des capacités de charge appropriées pour l’approvisionnement en fourrage. Les sources d’eau et de nourriture supplémentaires devraient être placées à bonne distance des individus de l’espèce (North Dakota Parks and Recreation, 2016). Il est recommandé d’effectuer les fauchages après la dispersion des graines, et les brûlages, avant l’émergence des individus ou durant la période de dormance de ceux-ci (North Dakota Parks and Recreation, 2016). La gestion peut également consister à maintenir le régime hydrologique naturel, à réduire la présence d’espèces envahissantes, à éliminer ou réduire l’application d’herbicides ainsi qu’à semer des graminées indigènes (North Dakota Parks and Recreation, 2016).
Remerciements et experts contactés
Les rédactrices du rapport remercient chaleureusement les personnes suivantes pour les renseignements sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest qu’elles ont fournis :
Cary Hamel, Conservation de la nature Canada
Chris Friesen et Bill Watkins, Conservation et de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba
Christie Borkowsky
Bruce A. Ford, conservateur, herbier du Département de botanique (WIN), Université du Manitoba
Elizabeth Punter, Special Projects Botanist, Centre de données sur la conservation du Manitoba, et conservatrice adjointe, herbier de l’Université du Manitoba, Université du Manitoba
Nancy Sather, Department of Natural Resources du Minnesota
Les rédactrices remercient également les personnes qui ont révisé et commenté leur travail, dont Candace Neufeld et Syd Cannings, du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada, les membres du Sous-comité de spécialistes des plantes vasculaires du COSEPAC, en particulier Cary Hamel, de Conservation de la nature Canada, Jeannette Whitton, de l’University of British Columbia, Eric Lamb, de l’University of Saskatchewan, Jim Pojar, Del Meidinger et Bruce Bennett, d’Environnement Yukon.
Sources d’information
Alexander, B.W. 2006. An analysis of seed production, viability, germination in situ and gazing impacts on the western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara, Sheviak and Bowles) North Dakota State University, Fargo, ND. pp 171.
Alexander, B.W., D. Kirby, M. Biondini et E. Dekeyser. 2010. Cattle grazing reduces survival and reproduction of the western prairie fringed-orchid. The Prairie Naturalist. 42:46–49.
Alexander, C.E. 1987. Mycorrhial infection in adult orchids. In Proceedings of the 7th North American Conference on Mycorrhizas. Edited by D.M. Sylvia, L.L. Hung et J.H. Graham. Institute of Food and Agriculture Science, University of Florida, Gainesville, Fla. pp. 324-327.
Ashley, D.C. 2001. Monitoring studies on the western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara) in northwest Missouri: Report on the 1999 and 2000 populations. Missouri Department of Conservation, St Joseph, MO, 13 pp.
Biederman, L. A., J. Beckman, J. Prekker, D. Anderson, N. P. Sather et R. Dahle. 2014. Phenological monitoring aids habitat management of threatened plant. Natural Areas Journal. 34:105–110.
Bleho, B.I., N. Koper, C.L. Borkowsky et C.D. Hamel. 2015. Effects of weather and land management on the Western Prairie Fringed-orchid (Platanthera praeclara) at the northern limit of its range in Manitoba, Canada. American Midland Naturalist.174:191-203.
Biederman, L.A., J. Beckman, J. Prekker, D. Anderson, N.P. Sather et R. Dahle. 2014. Phenological monitoring aids habitat management of threatened plan. Natural Areas Journal. 34:105-110.
Bjugstad, R. et A.J. Bjugstad. 1989. The western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara): Monitoring and research. Pages 197-199. In Bragg, T.B. et J. Stubbendieck, Editors. Proceedings of Eleventh North American Prairie Conference. University of Nebraska, Lincoln. 292 pp.
Bjugstad, A.J. et W. Fortune. 1989. The western prairie fringed-orchid (Platanthera praeclara): monitoring and research, p. 197–199 in: T. B. Bragg et J. Stubbendieck (eds.). Proceedings of the 11th North American Prairie Conference, University of Nebraska, Lincoln.
Borkowsky, C.L. 1998. Manitoba Tall Grass Prairie Preserve-Natural resources inventory III. Critical Wildlife Habitat Program. 30 pp.
Borkowsky, C.L. 2006. Enhancing pollination of the endangered western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara) by sphinx moths (Lepidoptera: Sphingidae) in tall grass prairie in southeastern Manitoba and an examination of orchid nectar production. Mémoire de maîtrise ès sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba. 107 pp.
Borkowsky, C.L. et A.R. Westwood. 2009. Seed capsule production in the endangered western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara) in relation to sphinx moth (Lepidoptera:Sphingidae) activity. Journal of the Lepidopterists’ Society 63(2):110-117.
Borkowsky, C.L., A. R. Westwood et K.E. Budnick. 2011. Seasonal variation in the nectar sugar concentration and nectar quality in the Western Prairie Fringed Orchid, Platanthera praeclara. Rhodora 113:201-219.
Borkowsky, C.L. comm. pers. 2015. Correspondance par courriel adressée à P.K. Catling, août 2015, biologiste, Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, Manitoba.
Bowles, M.L. 1983. The tall grass prairie orchids Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl. and Cypripedium candidum Muhl. ex Willd.: some aspects of their status, biology and ecology, and implications towards management. Natural Areas Journal 3:14-37.
Buthod, A. comm. pers. 2016. Correspondance par courriel adressée à Bruce Bennett, 2 septembre 2016, Botanical specialist. Oklahoma Natural Heritage Inventory. Saint Norman, Oklahoma.
Brownell, V.R. 1984. Status report on the Prairie White Fringed Orchid Platanthera leuocphaea in Canada. Prepared for the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada, Ottawa. 39 pp.
Brownell, V.R. et P.M. Catling. 2000. Status report update for the Eastern Prairie Fringed-orchid (Platanthera leucophaea). Prepared for the Ministry of Natural Resources, Kemptville, Ontario.
Canada Soil Inventory. 1989. Soil landscapes of Canada - Manitoba. Land Resource Research Centre, Research Branch, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario. Agric. Can. Publ. 5242/b. 22 pp. 1:1 million scale maps compiled by Canada Manitoba soil survey. (Également disponible en français : Inventaire des sols du Canada. 1989. Pédo-paysages du Canada – Manitoba, Centre de recherches sur les terres, Direction générale de la recherche, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario, Publication / Agriculture Canada. 5242/b. 22 p., carte à échelle de 1 : 1 million, compilé par les membres de l’équipe pédologique Canada-Manitoba.)
Canadian Wildlife Service. 1997. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) control list No. 12. Environment Canada, Ottawa. 62 pp. (Également disponible en français : Service canadien de la faune. 1997. CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) liste de contrôle no 12, Environnement Canada, Ottawa, 62 p.)
Catling, P.M. et V.R. Brownell. 1987. New and significant vascular plant records for Manitoba. Canadian Field-Naturalist 101:437-439.
Collicutt, D.R. 1993. COSEWIC status report on the western prairie white fringed orchid Platanthera praeclara in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. 45 pp.
Collins, S.L. et L.L. Wallace, editors. 1990. Fire in North American Tall Grass Prairies. University of Oklahoma Press, Norman.
COSEWIC. 2003. COSEWIC assessment and update status report on the eastern prairie fringed-orchid Platanthera leucophaea in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. vi + 27 pp. (Également disponible en français : COSEPAC. 2003. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea) au Canada – Mise à jour, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, v + 32 p.
COSEWIC. 2014. COSEWIC assessment and status report on the Small White Lady’s-slipper Cypripedium candidum in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. xii + 48 pp. (Également disponible en français : COSEPAC. 2014. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le cypripède blanc (Cypripedium candidum) au Canada, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa, xiii + 54 p.
Cruden, R.W., S. Kinsrnan, R.E. Stockhouse et Y.B. Linhart. 1976. Pollination, fecundity, and the distribution of moth-flowered plants. Biotropica 8:204-210.
Cuthrell, D.L. et D.A. Rider. 1993. Insects associated with the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara Sheviak and Bowles, in the Sheyenne National Grassland. Report to North Dakota parks and recreation board, Bismarck, North Dakota. 42 pp.
Currah, R.S., E.A. Smreciu et S. Hambleton. 1990. Mycorrhizae and mycorrhizal fungi of boreal species of Platanthera and Coeloglossum (Orchidaceae). Canadian Journal of Botany 68:1171-1181.
Davis, S.K. 1995. National recovery plan for the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara. Canadian Nature Federation, Endangered Plant and Invertebrates of Canada Project. 23 pp.
del Rio, C.M. et A. Búrquez. 1986. Nectar production and temperature dependent pollination in Mirabilis jalapa L. Biotropica 18:28-31.
Dewar, D. 1996. The effect of temperature and precipitation on Platanthera praeclara Sheviak and Bowles. Mémoire de baccalauréat en sciences avec spécialisation, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba. 24 pp.
Ehrlich, W.A., E.A. Poyser, L.E. Pratt et J.H Ellis. 1953. Report of the Reconnaissance Soil Survey of the Winnipeg and Morris map sheet areas. Canada Department of Agriculture, Provincial Department of Agriculture & Soils Department, University of Manitoba: Manitoba Soil Survey, Soils Report No. 5. 111 pp +2 cartes.
Environment Canada. 2006. Recovery Strategy for the Western Prairie Fringed-orchid (Platanthera praeclara) in Canada.Species at Risk Act Recovery Strategy Series. Environment Canada, Ottawa. v + 22 pp. (Également disponible en français : Environnement Canada. 2006. Programme de rétablissement de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada, Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa, vi + 24 p.)
Fagan, T.D. comm. pers. 2016. Correspondance par courriel adressée à Bruce Bennett, 2 septembre 2016, Post-doctoral research associate/Data manager. Oklahoma Natural Heritage Inventory. Saint Norman, Oklahoma.
Flannigan, M.D., B.J. Stocks, M.R. Turetsky et B.M. Wotton. 2009. Impact of climate change on fire activity and fire management in the circumboreal forest. Global Change Biology 15 : 549-560.
Fox, K., P. Vitt, K. Anderson, G. Fauske, S. Travers, D. Vik et M.O. Harris. 2013. Pollinators of a threatened orchid by an introduced hawk moth species in the tall grass prairie of North America. Biological Conservation 167:316-324.
Fox, K., P. Vitt, K. Anderson. R. Andres, M.C. Foster, C.E. Foster, D. Vik, P. Vitt et M.O. Harris. 2015. Nectar Robbery and thievery in the hawk moth (Lepidoptera: Sphingidae) - pollinated western prairie fringed orchid Platanthera praeclara. Annual Entomological Society of America 10:1-14.
Friesen, C. et A.R. Westwood. 2013. Weather conditions and sphinx moth activity in relation to pollination of the endangered Western Prairie Fringed Orchid (Platanthera praeclara) in Manitoba. Proceedings of the Entomological Society in Manitoba 69:5-19.
Government of Canada. 2004. Climate Change Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective. Natural Resources Canada. Ottawa. [consulté le 17 octobre 2015].
Harris, M., K. Fox, G. Fauske et D. Lenz. 2004. Hawkmoth pollinators of the western prairie fringed orchid at the Sheyenne Grasslands, North Dakota. Pages 9-10. Conservation of the western prairie fringed orchid. U.S. Fish and Wildlife Service, Ashland, NE.
Harley, J.L. 1959. The Biology of Mycorrhiza. Loenard Hill, London.
Harley, J.L. et S.E. Smith. 1983. Mycorrhizal symbiosis. Academic Press, London.
Hof, J., C.H. Sieg et M. Bevera. 1999. Spatial and temporal optimization in habitat placement for a threatened plant: the case of the western prairie fringed orchid. Ecological Modeling 115:61-75.
Honey, J. et B. Oleson. 2006. A century of agriculture in Manitoba, a proud legacy. Credit Union Central of Manitoba. 33 pp. [consulté le 8 septembre 2014].
Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate change: The scientific basis. Working Group 1. 94 pp.
Jordan, C. R., G.M. Fauske, M.O. Harris et D. Lenz. 2006. First record of the spurge hawkmoth as a pollen vector for the western prairie fringed orchid. Prairie Naturalist 38:63-68.
Joyce, J. et J.P. Morgan. 1989. Manitoba’s tall grass prairie conservation project. Pp. 71-74, In : Bragg, T.B et J. Stubbendiuk. Ed. Proceedings of the eleventh North American Prairie Conference. University of Nebraska, Lincoln, Nebraska. 292 pp.
Kartesz, J.T. 2015. The Biota of North America Program (BONAP). 2015. North American Plant Atlas (Disponible an anglais seulement). Chapel Hill, N.C. Figure ; Platanthera praeclara map (Disponible an anglais seulement) [consulté en juillet 2015].
Koper, N., K. Mozel et D. Henderson. 2010. Recent declines in northern tall-grass prairies and effects of patch structure on community persistence. Biological Conservation 143 : 220-229.
Manitoba Conservation. 2015. Manitoba’s Climate Change and Green Economy Action Plan. Manitoba Conservation, 60pp. Manitoba’s Climate Change and Green Economy Action Plan (Version PDF; 10,7 Mo) (Disponible an anglais seulement)[consulté le 25 mai 2016].
Manitoba Mineral Resources Division. 1981. Surficial Geological Map of Manitoba, Scale 1:1 000 000 Map 81-1.
Minnesota State Climatology Office. 2015. Climate Change and the Minnesota State Climatology Office. [consulté le 18 octobre 2015].
Morrison, L. W., J. L. Haack-Gaynor, C. C. Young et M. D. Debacker. 2015. A 20-year record of the western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara): population dynamics and modeling of precipitation effects. Natural Areas Journal 35:246–255.
NatureServe. 2010. Population/Occurrence Delineation and Viability Criteria. NatureServe, Arlington, Virginia. (Disponible an anglais seulement)[consulté le 17 octobre 2015].
NatureServe. 2015. NatureServe Explorer: An online encyclopedia of life [application Web]. Version 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. (Disponible an anglais seulement)[consulté le 17 octobre 2015].
North Dakota Parks and Recreation. 2016. A Landowner’s Guide to Conservation of Western Prairie Fringed Orchid in North Dakota (Version PDF; 9,7 Mo) (Disponible an anglais seulement)[consulté le 13 septembre 2016].
Pleasants, J.M. 1993. Pollination ecology of the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara. Parks and Tourism Department, North Dakota. 29 pp.
Pleasants, J.M. 1995. The effects of spring burns on the western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara). Proceedings of the 14th Annual North American Prairie Conference, Prairie Biodiversity, B.C., Hart, 67-73, Kansas State University Press, Manhattan, Kansas.
Pleasants, J.M. et S. Moe. 1993. Floral display size and pollination of the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara (Orchidaceae). Lindleyana 8:32-38.
Punter, C.E. 2000. Update status report on the western prairie fringed orchid Platanthera praeclara in Canada, in COSEWIC assessment and update status report on the western prairie fringed orchid Platanthera praeclara in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. 1-24 pp. (Également disponible en français : Punter, C.E. 2000. Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada – Mise à jour, in Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, 1-27 p.).
Richardson, K.A., R.L. Peterson et R.S. Currah. 1992. Seed reserves and early symbiotic protocorm development of Platanthera hyperborea (Orchidaceae) (Version PDF; 1.3 Mo) (Disponible an anglais seulement). Canadian Journal of Botany 70:291-300.
Ross, A.A., L. Aldrich-Wolfe, S. Lance, T. Glenn et S. E. Travers. 2013. Microsatellite markers in the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara (Orchidaceae) (Version PDF; 77.8 Ko) (Disponible an anglais seulement). Applications in Plant Sciences 1(4):1 200 413.
Ross, A. A. et S.E. Travers. 2016. The genetic consequences of rarity in the western prairie fringed orchid (Platanthera praeclara). Conservation Genetics 17:69–76.
Rowe, J.S. 1959. Forest Regions of Canada. Department of Northern Affairs and National Resources, Forestry Branch. Bulletin 123.
Samson, F.B. et F.L. Knopf. 1994. Prairie conservation in North America. BioScience 44:418-421.
Sharma, J. 2002. Mycobionts, germination, and conservation genetics of federally threatened Platanthera praeclara (Orchidaeceae). Thèse de doctorat. University of Missouri-Columbia, U.S.A.
Sharma, J., L.W. Zettler et J.W. van Sambeek. 2003a. A survey of mycobionts of federally threatened Platanthera praeclara (Orchidaceae). Symbiosis 23:145-155.
Sharma, J., L.W. Zettler, J.W. van Sambeek, M.R. Ellersieck et C.J. Starbuck. 2003 b. Symbiotic seed germination and mycorrhizae of federally threatened Platanthera praeclara (Orchidaceae). American Midland Naturalist 149:104-120.
Sheviak, C.J. et M.L. Bowles. 1986. The prairie fringed orchids: a pollinator-isolates species pair. Rhodora 88:267-290.
Sieg, C.H. et R.M. Ring. 1995. Influence of environmental factors and preliminary demographic analyses of a threatened orchid, Platanthera praeclara. American Midland Naturalist 134:307-323.
Smith, W.R. 1993. Orchids of Minnesota. University of Minnesota Press, Minneapolis. 172 pp.
Smith, S.E. 1966. Physiology and ecology of orchid mycorrhiza fungi with reference to seedling nutrition. New Phytologist 65:488-499.
Smith, S.E. 1967. Carbohydrate translocation in orchid mycrorrhizas. New Phytologist 66:371-378.
Still, S.M., A. L. Frances, A.C. Treher et L. Oliver. 2015. Using Two Climate Change Vulnerability Assessment Methods to Prioritize and Manage Rare Plants: A Case Study (Disponible an anglais seulement). Natural Areas Journal 35(1):106-121. doi.
U.S. Fish and Wildlife Service. 1989. Determination of threatened status for eastern and western prairie fringed orchids. Federal Register 54(187) : 39857-39862.
U.S. Fish and Wildlife Service. 1996. Platanthera praeclara (western prairie fringed orchid) recovery plan. U.S. Fish and Wildlife Service, Ft. Snelling, Minnesota. vi + 101 pp.
U.S. Fish and Wildlife Service. 2009. Western Prairie Fringed Orchid (Platanthera praeclara), 5-year review: Summary and Evaluation. U.S. Fish and Wildlife Service , Bloomington, Minnesota. 36 pp.
U.S. Fish and Wildlife Service. 2010. Endangered and Threatened Wildlife and Plants; 5-year Status Reviews of Seven Midwest Species. Federal Register, 75(177):55820-55823.
University of Oklahoma. 2016. Oklahoma Natural Heritage Inventory Plant Ranking List (Version PDF; 223 Ko) (Disponible an anglais seulement). 15pp. [consulté le 13 septembre 2016].
Westwood, A.R. et C.L. Borkowsky. 2004. Sphinx moth pollinators for the endangered western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara in Manitoba, Canada. Journal of Lepidopterists’ Society, 58:13-20.
Westwood, A.R., C.L. Borkowsky et K.E. Budnick. Seasonal variation in the nectar sugar concentration and nectar quality in the western prairie fringed orchid, Platanthera praeclara (Orchidaceae). Rhodora 113 (945):201-219.
Whigham, D.F., J.P. O’Neill, H.N. Rasmussen, B.A. Caldwell et M.K. McCormick. 2006. Seed longevity in terrestrial orchids – potential for persistent in situ seed banks. Biological Conservation 129:24-30.
Willmott, A.P. et A. Búrquez. 1996. The pollination of Merremia palmeri (Convolvulaceae): can hawk moths be trusted? American Journal of Botany 83:1050-1056.
Wolken, P.M., C.H. Sieg et S.E. Williams. 2001. Quantifying suitable habitat of the threatened western prairie fringed orchid. Journal for Range Management 54(5):611-616.
Young, B.E. 2015. Guidelines for Using the NatureServe Climate Change Vulnerability Index Release 3.0. (Disponible an anglais seulement) PDF file: Guidelines for Using the NatureServe Climate Change Vulnerability Index Release 3.0 (Version PDF; 1.9 Mo) (Disponible an anglais seulement)[consulté le 17 octobre 2015].
Zelmer, C.D. et R.S. Currah. 1995. Ceratorhiza pernacatena and Epulorhiza calendulina spp. nov.: mycrorrhizal fungi of terrestrial orchids. Canadian Journal of Botany 73:1981-1985.
Zelmer, C.D., L. Cuthbertson et R.S. Currah. 1996. Fungi associated with terrestrial orchid mycorrhizae, seeds and protocorms. Mycoscience 37:439-448.
Zelmer, C.D. et R.S. Currah. 1997. Symbiotic germination of Spiranthes lacera (Orchidaceae) with a naturally occurring endophyte. Lindleyana 12:142-148.
Zettler, L.W. et T.M. McInnis Jr. 1994. Light enhancement of symbiotic seed germination and development of an endangered terrestrial orchid (Platanthera integrilabia). Plant Science 102:133-138.
Zettler, L.W., K.A. Piskin, S.L. Stewart, J.J. Hartsock, M.L. Bowles et T.J. Bell. 2005. Protocorm mycobionts of the federally threatened Platanthère blanchâtre de l’Est, Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindley, and a technique to prompt leaf elongation in seedlings. Studies in Mycology 53:163-171.
Zettler, L.W. et K.A. Piskin. 2011. Mycorrhizal fungi from protocorms, seedlng and mature plants of the Platanthère blanchâtre de l’Est, Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindley: A comprehensive list to augment conservation. American Midland Naturalist 166(1):29-39.
Sommaire biographique des rédactrices du rapport
Pauline K. Catling œuvre dans le domaine de la biologie depuis 2007 et a travaillé à l’Agence Parcs Canada, à Études d’Oiseaux Canada et à Wildlife Preservation Canada. Elle a fait du bénévolat pour l’organisme Wild Ontario (2010-2012) et pour le Prairie Wildlife Rehabilitation Centre (2014 à aujourd’hui), où elle renseigne le public au sujet des oiseaux de proie en compagnie d’animaux ambassadeurs. Pauline est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en biologie de la faune de l’Université de Guelph et termine actuellement une maîtrise en sciences biologiques à l’Université du Manitoba, sur la classification de la végétation des alvars du Manitoba. Ses travaux l’ont notamment menée à réaliser des études des écosystèmes d’alvar, des inventaires biologiques des aires naturelles et des relevés des espèces en péril.
Vivian R. Brownell a obtenu un baccalauréat avec spécialisation en botanique de l’Université de Guelph en 1978. Après avoir reçu son diplôme, elle a travaillé pour plusieurs organisations, dont le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, Parcs Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Habitat faunique Canada. De 1983 à 2005, elle a travaillé pour des municipalités, des offices de conservation de la nature et des organismes gouvernementaux, à titre de biologiste-conseil. Depuis 2010, elle est biologiste principale des espèces en péril au ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Ses travaux ont principalement consisté à réaliser des inventaires et des évaluations biologiques, des activités de gestion des espèces rares, des évaluations des aires naturelles et des habitats fauniques ainsi que de la planification des systèmes relatifs au patrimoine naturel. Elle a rédigé ou corédigé de nombreux articles publiés dans des revues scientifiques ainsi que des livres, notamment concernant les alvars, les prairies, les savanes, les landes sableuses et rocheuses, la classification des orchidées, les plantes envahissantes et la phytogéographie.
Collections examinées
Herbier du département de botanique, Université du Manitoba (WIN)
21 June 1988, M. Ross s.n. (WIN)
20 July 1994, L. Reeves s.n. (WIN)
Herbier du département de botanique (MMMN), Musée du Manitoba
26 July 1984, P.M. Catling & V.R. Brownell #84-89 (MMMN)
24 July 1985, K.L. Johnson J85-176 (MMMN)
Herbier national des plantes vasculaires (Agriculture et Agroalimentaire Canada (DAO).
26 July 1984, P.M. Catling & V.R. Brownell #84-89 (DAO)
01 July 1985, P.M. Catling s.n. (DAO)
Annexe 1. Évaluation des menaces pesant sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest.
Tableau d’évaluation des menaces
- Nom scientifique de l’espèce ou de l’écosystème
- Platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara)
- Identification de l’élément
- 1 056 665
- Code de l’élément
- PMORC1Y0S0
- Date
- 01/04/2016
- Évaluateur(s) :
- Bruce Bennett, Kristiina Ovaska, Vivian Brownell, Pauline Catling, Del Meidinger, Ruben Boles, Cary Hamel, Julie Pelc, Christie Borkowsky, Chris Friesen, Tim Teetaert, Candace Neufeld
- Références :
- Version provisoire du rapport du COSEPAC (janvier 2016)
| Impact des menaces | Impact des menaces (descriptions) | Comptes des menaces de niveau 1 selon l’intensité de leur impact : Maximum de la plage d’intensité |
Comptes des menaces de niveau 1 selon l’intensité de leur impact : Minimum de la plage d’intensité |
|---|---|---|---|
| A | Très élevé | 0 | 0 |
| B | Élevé | 0 | 0 |
| C | Moyen | 3 | 0 |
| D | Faible | 3 | 6 |
| - | Impact global des menaces calculé : | Élevé | Moyen |
- Impact global des menaces attribué :
- C = moyen
- Justification de l’ajustement de l’impact :
- L’impact global attribué a été ajusté à la suite de la conférence téléphonique d’évaluation des menaces, car l’espèce fait l’objet d’une gestion, et plus de 50 % de sa population se trouve sur des terres protégées. Dans le programme de rétablissement fédéral, l’habitat essentiel a été désigné pour 24 quarts de section qui hébergent la platanthère blanchâtre de l’Ouest, et il est possible que certaines menaces ne soient pas d’une portée ou d’une gravité aussi élevée que ce qui est indiqué; la province du Manitoba travaille à protéger efficacement ces terres de façon à empêcher les activités qui pourraient endommager ou détruire l’habitat essentiel (désigné dans le programme de rétablissement). En outre, la platanthère blanchâtre de l’Ouest est inscrite à la Loi sur les espèces en voie de disparition du Manitoba, ce qui confère une protection aux individus de l’espèce et à l’habitat dont ils dépendent.
- Commentaires sur l’impact global des menaces
- Durée d’une génération : > 12 ans. Effectif : 763 à 14 685 individus florifères recensés au cours des 10 dernières années (2005-2014), des fluctuations extrêmes ayant été observées. Zone d’occurrence = 48 km2 (200 quarts de section). IZO ~ 670 ha (en 2006).
| Menace | Menace | Impact (calculé) | Impact (calculé) | Portée (10 prochaines années) | Gravité (10 ans ou 3 générations) | Immédiateté | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement résidentiel et commercial | cellule vide | Négligeable | Négligeable (<1 %) | Extrême (71-100 %) | Modérée (possiblement à court terme, < 10 ans/ 3 générations) | cellule vide |
| 1.1 | Zones résidentielles et urbaines | cellule vide | Négligeable | Négligeable (< 1 %) | Extrême (71-100 %) | Modérée (possiblement à court terme, < 10 ans/ 3 générations) | La collectivité de Vita empiète sur la portion est de l’aire de répartition de l’espèce, mais il n’y a apparemment aucun projet de développement dans l’immédiat (c’est pourquoi l’immédiateté est considérée comme modérée). La gravité est considérée comme extrême, vu le potentiel de destruction de l’habitat. |
| 1.2 | Zones commerciales et industrielles | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 1.3 | Zones touristiques et récréatives | cellule vide | Négligeable | Négligeable (< 1 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | De nouveaux sentiers d’interprétation seront aménagés. Les bordures des sentiers peuvent fournir un habitat à l’espèce. |
| 2 | Agriculture et aquaculture | CD | Moyen-faible | Large (31-70 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 2.1 | Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois | CD | Moyen-faible | Restreinte-petite (1-30 %) | Extrême (71-100 %) | Élevée (continue) | L’aire de répartition se trouve à 37 % sur des terrains privés (18 parcelles), où cette menace s’applique, mais la probabilité que tous ces terrains privés soient convertis pour l’installation de cultures autres que le bois au cours des 10 prochaines années est faible. |
| 2.2 | Plantations pour la production de bois et de pâte | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 2.3 | Élevage de bétail | CD | Moyen-faible | Élevée (31-70 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | Plus de la moitié de l’aire de répartition de l’espèce se trouve sur des terres protégées où des mesures de gestion appropriées sont appliquées, mais cette activité est préoccupante dans le cas des terrains privés (aucun plan d’intendance connu). Les fluctuations du nombre d’individus florifères masquent les tendances passées. |
| 2.4 | Aquaculture en mer et en eau douce | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 3 | Production d’énergie et exploitation minière | cellule vide | Négligeable | Négligeable (< 1 %) | Extrême (71-100 %) | Modérée (possiblement à court terme, < 10 ans/ 3 générations) | cellule vide |
| 3.1 | Forage pétrolier et gazier | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 3.2 | Exploitation de mines et de carrières | cellule vide | Négligeable | Négligeable (< 1 %) | Extrême (71-100 %) | Modérée (possiblement à court terme, < 10 ans/ 3 générations) | Aucune exploitation minière et aucun projet minier n’étaient connus du groupe, mais des droits miniers existent pour un certain nombre de propriétés. Des activités d’exploration continues sont possibles. |
| 3.3 | Énergie renouvelable | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 4 | Corridors de transport et de service | D | Faible | Petite (1-10 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 4.1 | Routes et voies ferrées | D | Faible | Petite (1-10 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | On tient compte ici de la construction et de l’amélioration de routes ainsi que des routes existantes. Les individus qui poussent en bordure des routes peuvent être touchés par les activités d’entretien. La portée a été évaluée en fonction de la proportion d’emprises routières dans l’aire de répartition de l’espèce, qui est de 6,9 %. Gravité : un déclin des individus bordant les routes a-t-il été constaté au cours des 10 dernières années (indicateur pour le futur)? Bien que de l’habitat peut être créé en bordure des routes, des menaces considérables sont associées à l’entretien des routes. Les fossés peuvent être considérés comme un habitat temporaire. |
| 4.2 | Lignes de services publics | cellule vide | Négligeable | Négligeable (< 1 %) | Inconnue | Élevée (continue) | Manitoba Hydro travaille à l’installation d’une ligne électrique importante, mais l’habitat de l’espèce devrait être évité selon les plans. L’entretien des lignes électriques existantes est inclus dans la présente catégorie. Des herbicides sont appliqués le long des lignes électriques, mais selon une méthode autre que l’application en pleine surface; les traitements herbicides limitent l’empiètement des espèces concurrentes. Il y a un potentiel de développement associé à la couverture cellulaire, notamment la construction de nouvelles tours, mais on ignore si cela se produira réellement et quand cela se produirait. |
| 4.3 | Voies de transport par eau | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 4.4 | Corridors aériens | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 5 | Utilisation des ressources biologiques | cellule vide | Négligeable | Élevée (31-70 %) | Négligeable (< 1 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 5.1 | Chasse et capture d’animaux terrestres | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 5.2 | Cueillette de plantes terrestres | cellule vide | Négligeable | Élevée (31-70 %) | Négligeable (< 1 %) | Élevée (continue) | Un cas de récolte a été observé il y a un certain nombre d’années. Des individus pourraient être récoltés en bordure des routes et des sentiers, mais on estime que cette activité se produit très rarement et ne devrait pas avoir de répercussions sur la population. |
| 5.3 | Exploitation forestière et récolte du bois | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 5.4 | Pêche et récolte de ressources aquatiques | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 6 | Intrusions et perturbations humaines | cellule vide | Négligeable | Élevée (31-70 %) | Négligeable (< 1 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 6.1 | Activités récréatives | cellule vide | Négligeable | Élevée (31-70 %) | Négligeable (< 1 %) | Élevée (continue) | Cette catégorie comprend l’entretien des sentiers et la circulation pédestre dans les sentiers. L’utilisation de véhicules hors route a été observée dans la région; les individus qui poussent dans les fossés peuvent aussi être touchés par la circulation des véhicules tout-terrain (VTT). |
| 6.2 | Guerre, troubles civils et exercices militaires | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 6.3 | Travail et autres activités | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 7 | Modifications des systèmes naturels | CD | Moyen-faible | Généralisée (71-100 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 7.1 | Incendies et suppression des incendies | CD | Moyen-faible | Élevée (31-70 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | L’espèce pousse dans un système adapté aux incendies, et les effets à long terme des incendies sont bénéfiques/essentiels au maintien de son habitat. Des brûlages dirigés sont réalisés (rotation ~6 ans) dans les terres protégées (~60 % de l’aire de répartition). Il peut être interdit de faire des feux en cas de sécheresse grave ou se prolongeant sur plusieurs années. Le reste de l’aire de répartition chevauche des terrains privés où il y a probablement une suppression des incendies. |
| 7.2 | Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages | D | Faible | Généralisée (71-100 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | Les routes peuvent causer une retenue de l’eau et ainsi avoir une incidence sur l’habitat. Les routes et les fossés modifient les régimes hydrologiques naturels dans l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce au Canada. Il y a beaucoup d’incertitude quant aux effets de ces modifications sur les individus de l’espèce, mais ces effets sont probablement négatifs. La demande en eau pourrait augmenter dans le futur (canal de drainage de Vita). |
| 7.3 | Autres modifications de l’écosystème | cellule vide | Inconnu | Petite (1-10 %) | Inconnue | Élevée (continue) | De fauchages sont réalisés dans les champs naturels situés sur les terres publiques, pour réduire l’empiètement de végétaux ligneux; certaines terres peuvent avoir été cultivées pour la production de fourrage il y a 30 ans, mais présentent aujourd’hui une forte composante naturelle. Le fauchage des bords de route a été évalué dans une autre catégorie, et il n’en est donc pas tenu compte ici. |
| 8 | Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques | D | Faible | Généralisée (71-100 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 8.1 | Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes | D | Faible | Élevée (31-70 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | Pâturin des prés, euphorbe de Tommasini, brome inerme et autres plantes envahissantes exotiques. Les terrains privés, les fossés et les habitats de lisière sont probablement plus touchés que les terres protégées. |
| 8.2 | Espèces indigènes problématiques | cellule vide | Négligeable | Généralisée (71-100 %) | Négligeable (< 1 %) | Élevée (continue) | Cette catégorie comprend la consommation des individus par les cerfs, accentuée par des changements anthropiques. De plus, la présence accrue d’un petit charançon noir non identifié qui se nourrit sur les individus de l’espèce a été constatée (on ignore toutefois si la prédation a augmenté à cause des activités humaines). |
| 8.3 | Matériel génétique introduit | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 9 | Pollution | D | Faible | Élevée (31-70 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 9.1 | Eaux usées domestiques et urbaines | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 9.2 | Effluents industriels et militaires | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 9.3 | Effluents agricoles et sylvicoles | D | Faible | Élevée (31-70 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | L’épandage de fumier et le ruissellement d’effluents existent dans l’habitat de l’espèce. |
| 9.4 | Déchets solides et ordures | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 9.5 | Polluants atmosphériques | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | L’utilisation d’herbicides et d’insecticides dans les emprises des lignes électriques a été traitée plus haut. |
| 9.6 | Apports excessifs d’énergie | cellule vide | Inconnu | Petite (1-10 %) | Inconnue | Élevée (continue) | La pollution lumineuse peut nuire à la pollinisation dans les alentours de la collectivité et aux intersections; les pollinisateurs peuvent être attirés à l’extérieur des zones où les individus se trouvent. |
| 10 | Phénomènes géologiques | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 10.1 | Volcans | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 10.2 | Tremblements de terre et tsunamis | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 10.3 | Avalanches et glissements de terrain | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide | cellule vide |
| 11 | Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents | CD | Moyen-faible | Généralisée (71-100 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée (continue) | cellule vide |
| 11.1 | Déplacement et altération de l’habitat | cellule vide | Non calculé (à l’extérieur de la période d’évaluation) | Généralisée (71-100 %) | Inconnue | Faible (possiblement à long terme, > 10 ans /3 générations) | cellule vide |
| 11.2 | Sécheresses | CD | Moyen-faible | Généralisée (71-100 %) | Modérée-légère (1-30 %) | Élevée-modérée | Il existe des données climatiques recueillies de manière intensive pour les régions où se trouve l’aire de répartition de l’espèce au Manitoba et Minnesota. Les précipitations ont augmenté au cours des 40 dernières années, mais l’intensité des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait augmenter. Il est possible que les prés humides, préférés par l’espèce, deviennent des marais. Il est difficile d’évaluer les répercussions sur la population; l’espèce pourrait se déplacer vers les terrains un peu plus élevés. Les données passées indiquent que le nombre de tiges florifères n’a pas atteint de pointes extrêmes après les sécheresses graves. |
| 11.3 | Températures extrêmes | cellule vide | Non calculé (à l’extérieur de la période d’évaluation) | Généralisée (71-100 %) | Inconnue | Faible (possiblement à long terme, > 10 ans/ 3 générations) | Les fleurs se flétrissent durant les vagues de chaleur, ce qui peut avoir une incidence sur la pollinisation. Les individus au Manitoba fleurissent plus tard dans la saison que ceux des populations du sud, et il est possible qu’il ne soit pas approprié de comparer la tolérance thermique de population canadienne avec le reste de l’aire de répartition en ce qui a trait à température. |
| 11.4 | Tempêtes et inondations | D | Faible | Généralisée (71-100 %) | Légère (1-10 %) | Élevée (continue) | L’espèce peut survivre à de courtes périodes d’inondation au cours de la saison de croissance. |