Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada 2017
Grande salamandre

- Partie 1 - Addition du gouvernement fédéral au Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement et Changement climatique Canada
- 1 Évaluation de l'espèce par le COSEPAC
- 2 Information sur la situation de l’espèce
- 3 Menaces
- 4 Objectifs en matière de population et de répartition
- 5 Stratégies et approches générales pour l’atteinte des objectifs
- 6 Habitat essentiel
- 7 Mesure des progrès
- 8 Énoncé sur les plans d'action
- 9 Effets sur l'environnement et sur les espèces non ciblées
- 10 Références
- Figure 1. Schématisation de la méthodologie utilisée pour calculer la ou les zones renfermant l'habitat essentiel de la grande salamandre.
- Figure 2. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (ouest), en Colombie Britannique.
- Figure 3. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord ouest), en Colombie-Britannique.
- Figure 4. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (sud ouest), en Colombie-Britannique..
- Figure 5. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord), en Colombie-Britannique.
- Figure 6. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord est), en Colombie-Britannique.
- Figure 7. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (sud est), en Colombie-Britannique.
- Figure 8. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (est), en Colombie-Britannique.
- Tableau 1. Cotes de conservation de la grande salamandre (NatureServe, 2016; B.C. Conservation Framework, 2016).
- Tableau 2. Classification de l'IUCN-CMP des menaces pesant sur la grande salamandre au Canada.
- Tableau 3. Résumé des fonctions essentielles, des éléments biophysiques et des caractéristiques générales de l'habitat essentiel principal de la grande salamandre.
- Tableau 4. Résumé des fonctions essentielles, des éléments biophysiques et des caractéristiques générales de l'habitat essentiel connectif de la grande salamandre.
- Tableau 5. Calendrier des études pour la désignation de l'habitat essentiel de la grande salamandre.
- Tableau 6. Activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de la grande salamandre.
- Partie 2 - Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparé par l’Équipe de rétablissement de la grande salamandre pour le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique.
- Table des matières
- Contexte
- Évaluation de l'espèce par le COSEPAC
- Description de l'espèce
- Populations et répartition
- Besoins de la grande salamandre
- Menaces
- Mesures déjà achevées ou en cours
- Lacunes dans les connaissances
- Rétablissement
- Caractère réalisable du rétablissement
- But du rétablissement
- Justification du but du rétablissement
- Objectifs de rétablissement (2009-2013)
- Approches recommandées pour l'atteinte des objectifs
- Tableau de planification du rétablissement
- Description du tableau de planification du rétablissement
- Protection, gestion et intendance de l'habitat
- Cartographie de l'habitat
- Inventaires des populations
- Remise en état de l'habitat
- Suivi des populations et de l'habitat
- Clarification des menaces
- Recherche sur le cycle vital, la dynamique des populations et l'utilisation de l'habitat
- Sensibilisation et communication
- Mesures de rendement
- Habitat essentiel
- Calendrier recommandé des études visant à désigner l'habitat essentiel
- Approches existantes et recommandées pour la protection de l'habitat
- Effets sur les espèces non ciblées
- Considérations socioéconomiques
- Approche recommandée pour la mise en œuvre du rétablissement
- Énoncé sur les plans d'action
- Références
- Figure 1. Répartition mondiale de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus). Carte préparée par H. Welsh pour l'ouvrage Field Guide to the Amphibians of Northwestern North America (Jones et Leonard [eds.], 2005) et reproduite avec l'autorisation de l'auteur et des directeurs de publication.
- Figure 2. Répartition de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique. Carte préparée par K. Welstead d'après les données compilées par le COSEPAC (COSEWIC, 2000) et L. Sopuck et d'autres données provenant des dossiers du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique.
- Figure 3. Carte de la protection existante de l'habitat de la grande salamandre en Colombie-Britannique. Carte préparée par K. Welstead.
- Tableau 1. Cotes de conservation de la grande salamandre du Nord (B.C. Conservation Data Centre, 2009; NatureServe, 2009).
- Tableau 2. Tableau de classification des menaces pour la grande salamandre
- Tableau 2.1 Activités forestières touchant l'habitat aquatique
- Tableau 2.2 Activités forestières touchant l'habitat terrestre
- Tableau 2.3 Aménagement urbain et rural
- Tableau 2.4 Microproduction d'hydroélectricité
- Tableau 2.5 Pollution
- Tableau 2.6 Changements climatiques
- Tableau 2.7 Maladies
- Tableau 2.8 Poissons introduits
- Tableau 2.9 Activités récréatives
- Tableau 3. Stratégies de rétablissement pour la grande salamandre
- Tableau 4. Calendrier des études visant à désigner l'habitat essentiel.
Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada 2017
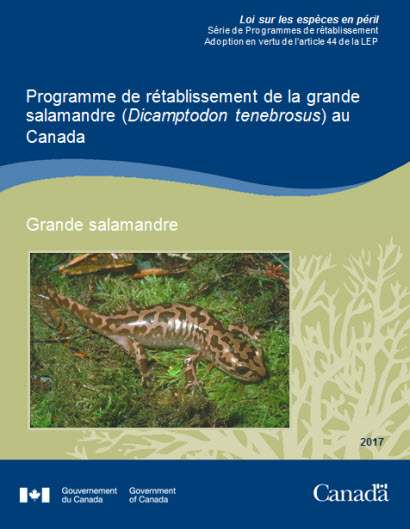
Environnement et Changement climatique Canada. 2017. Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada. Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa. 2 parties, 36 p. + 49 p.
Pour télécharger le présent programme de rétablissement ou pour obtenir un complément d’information sur les espèces en péril, incluant les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les plans d’action et d’autres documents connexes portant sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.
Illustration de la couverture : © Corel Corporation
Also available in English under the title "Recovery Strategy for the Coastal Giant Salamander (Dicamptodon tenebrosus) in Canada"
Le contenu du présent document (à l'exception des illustrations) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d'indiquer la source.
En vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de travailler ensemble pour établir des mesures législatives, des programmes et des politiques visant à assurer la protection des espèces sauvages en péril partout au Canada.
Dans l'esprit de collaboration de l'Accord, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné au gouvernement du Canada la permission d'adopter le Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie Britannique (partie 2) en vertu de l'article 44 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Environnement et Changement climatique Canada a inclus une addition fédérale (partie 1) dans le présent programme de rétablissement afin qu'il réponde aux exigences de la LEP.
Le programme de rétablissement fédéral de la grande salamandre au Canada est composé des deux parties suivantes :
Partie 1 - Addition du gouvernement fédéral au Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement et Changement climatique Canada.
Partie 2 - Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparé par l'Équipe de rétablissement de la grande salamandre pour le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique.
En vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signataires ont convenu d'établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP), les ministres fédéraux compétents sont responsables de l'élaboration des programmes de rétablissement pour les espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et sont tenus de rendre compte des progrès réalisés dans les cinq ans suivant la publication du document final dans le Registre public des espèces en péril.
La ministre de l'Environnement et du Changement climatique est le ministre compétent en vertu de la LEP à l'égard de la grande salamandre et a élaboré la composante fédérale (partie 1) du présent programme de rétablissement, conformément à l'article 37 de la LEP. Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé en collaboration avec la Province de la Colombie-Britannique, en vertu du paragraphe 39(1) de la LEP. L'article 44 de la LEP autorise le ministre à adopter en tout ou en partie un plan existant pour l'espèce si ce plan respecte les exigences de contenu imposées par la LEP au paragraphe 41(1) ou 41(2). La Province de la Colombie-Britannique a remis le programme de rétablissement de la grande salamandre ci-joint (partie 2), à titre d'avis scientifique, aux autorités responsables de la gestion de l'espèce en Colombie-Britannique. Ce programme a été préparé en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada.
La réussite du rétablissement de l'espèce dépendra de l'engagement et de la collaboration d'un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des directives formulées dans le présent programme. Cette réussite ne pourra reposer seulement sur Environnement et Changement climatique Canada ou sur toute autre autorité responsable. Tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à appuyer ce programme et à contribuer à sa mise en œuvre pour le bien de la grande salamandre et de l'ensemble de la société canadienne.
Le présent programme de rétablissement sera suivi d'un ou de plusieurs plans d'action qui présenteront de l'information sur les mesures de rétablissement qui doivent être prises par Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités responsables et/ou organisations participant à la conservation de l'espèce. La mise en œuvre du présent programme est assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des autorités responsables et organisations participantes.
Le programme de rétablissement établit l'orientation stratégique visant à arrêter ou à renverser le déclin de l'espèce, incluant la désignation de l'habitat essentiel dans la mesure du possible. Il fournit à la population canadienne de l'information pour aider à la prise de mesures visant la conservation de l'espèce. Lorsque l'habitat essentiel est désigné, dans un programme de rétablissement ou dans un plan d'action, la LEP exige que l'habitat essentiel soit alors protégé.
Dans le cas de l'habitat essentiel désigné pour les espèces terrestres, y compris les oiseaux migrateurs, la LEP exige que l'habitat essentiel désigné dans une zone protégée par le gouvernement fédéral Note1 soit décrit dans la Gazette du Canada dans un délai de 90 jours après l'ajout dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d'action qui a désigné l'habitat essentiel. L'interdiction de détruire l'habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) s'appliquera 90 jours après la publication de la description de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada.
Pour l'habitat essentiel se trouvant sur d'autres terres domaniales, le ministre compétent doit, soit faire une déclaration sur la protection légale existante, soit prendre un arrêté de manière à ce que les interdictions relatives à la destruction de l'habitat essentiel soient appliquées.
Si l'habitat essentiel d'un oiseau migrateur ne se trouve pas dans une zone protégée par le gouvernement fédéral, sur le territoire domanial, à l'intérieur de la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada, l'interdiction de le détruire ne peut s'appliquer qu'aux parties de cet habitat essentiel - constituées de tout ou partie de l'habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s'applique aux termes des paragraphes 58(5.1) et 58(5.2) de la LEP.
En ce qui concerne tout élément de l'habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial, si le ministre compétent estime qu'une partie de l'habitat essentiel n'est pas protégée par des dispositions ou des mesures en vertu de la LEP ou d'autre loi fédérale, ou par les lois provinciales ou territoriales, il doit, comme le prévoit la LEP, recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret visant l'interdiction de détruire l'habitat essentiel. La décision de protéger l'habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial et n'étant pas autrement protégé demeure à la discrétion du gouverneur en conseil.
L'élaboration du présent programme de rétablissement a été coordonnée par Matt Huntley, Kella Sadler, Lisa Rockwell et Megan Harrison, tous du Service canadien de la faune - Région du Pacifique, d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, SCF). Elke Wind (E.Wind Consulting) a compilé l'information de la première ébauche du présent programme de rétablissement. Kym Welstead (ministère des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique), Purnima Govindarajulu et Peter Fielder (ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique), Dave Trotter (ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique) et Véronique Brondex (ECCC, SCF - Région de la capitale nationale) ont fourni des conseils et des commentaires utiles concernant la rédaction. Kym Welstead a aussi fourni des données complémentaires et des documents de référence. Jeffrey Thomas et Danielle Yu (ECCC, SCF - Région du Pacifique) ont apporté une aide additionnelle pour la cartographie et la préparation des figures.
Les sections suivantes ont été incluses pour satisfaire à des exigences particulières de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral qui ne sont pas abordées dans le Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique (partie 2 du présent document, ci-après appelé « programme de rétablissement provincial ») et/ou pour présenter des renseignements à jour ou additionnels.
En vertu de la LEP, il existe des exigences et des processus particuliers concernant la protection de l'habitat essentiel. Ainsi, les énoncés du programme de rétablissement provincial concernant la protection de l'habitat de survie/rétablissement peuvent ne pas correspondre directement aux exigences fédérales. Les mesures de rétablissement visant la protection de l'habitat sont adoptées; cependant, on évaluera à la suite de la publication de la version finale du programme de rétablissement fédéral si ces mesures entraîneront la protection de l'habitat essentiel en vertu de la LEP.
Le programme de rétablissement provincial contient un court énoncé sur les considérations socioéconomiques. Comme une analyse socioéconomique n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 41(1) de la LEP, la section sur les considérations socioéconomiques du programme de rétablissement provincial n'est pas considérée comme faisant partie du programme de rétablissement établi par la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique pour cette espèce.
La présente section remplace la section « Évaluation de l'espèce par le COSEPAC » du programme de rétablissement provincial, car elle intègre les renseignements les plus récents du COSEPAC (COSEWIC, 2014).
i COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada).
Désignation juridique : annexe 1 de la LEP (espèce menacée) (2003).
| Cote mondiale (G)a | Cote nationale (N)a | Cote infranationale (S)a | Statut selon le COSEPAC | Liste de la C.-B. | Cadre de conservation de la C.-B. |
|---|---|---|---|---|---|
| G5 | Canada (N2); États-Unis (N5) | Canada : Colombie-Britannique (S2) États-Unis : Californie (SNR), Orégon (S4), Washington (S5) |
Menacée (2014) | Liste rouge | Niveau de priorité le plus élevé : 1, aux fins du but 3b |
a La cote de conservation attribuée à une espèce est constituée d’un nombre de 1 à 5 précédé d’un lettre indiquant l’échelle géographique de l’évaluation (G = mondiale, N = nationale, et S = infranationale). La signification des nombres est la suivante : 1 = gravement en péril, 2 = en péril, 3 = vulnérable, 4 = apparemment non en péril, 5 = non en péril. X = vraisemblablement disparue, NR = non classée.
b Les trois buts du cadre de conservation de la Colombie-Britannique (B.C. Conservation Framework) sont les suivants : 1. Participer aux programmes mondiaux de conservation des espèces et des écosystèmes; 2. Empêcher que les espèces et les écosystèmes deviennent en péril; 3. Maintenir la diversité des espèces et des écosystèmes indigènes.
L’aire de répartition et l’effectif de la grande salamandre au Canada représentent moins de 1 % de l’aire de répartition et de l’effectif mondiaux de l’espèce (COSEWIC, 2014).
Le tableau 2 (ci-après) remplace et actualise le tableau 2 de la section « Classification des menaces » du programme de rétablissement provincial.
Le tableau à jour de classification des menaces tient compte des données les plus récentes du COSEPAC (COSEWIC, 2014) et repose sur le système unifié de classification des menaces de l’IUCN-CMP (Union internationale pour la conservation de la nature-Partenariat pour les mesures de conservation) (CMP, 2010). Cette classification est compatible avec les méthodes utilisées par le Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique et le cadre de conservation de la province.
Les menaces sont définies comme étant les activités ou processus immédiats qui ont entraîné, entraînent ou pourraient entraîner à l’avenir la destruction, la dégradation et/ou la détérioration de l’entité évaluée (population, espèce, communauté ou écosystème) dans la zone d’intérêt (mondiale, nationale ou infranationale). Les facteurs limitatifs ne sont pas pris en compte dans le processus d’évaluation des menaces. Aux fins d’évaluation des menaces, seules les menaces actuelles et futures sont prises en considération. Les menaces historiques, les effets indirects ou cumulatifs des menaces ou toute autre information pertinente qui aiderait à comprendre la nature des menaces sont présentés à la section « Description des menaces ». Les menaces sont caractérisées en fonction de leur portée, de leur gravité et de leur immédiateté. L’ « impact » d’une menace est calculé selon la portée et la gravité de celle-ci.
| Menace | Menace | Impactc | Portéed | Gravitée | Immédiatetéf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement résidentiel et commercial | Faible | Petite | Extrême | Élevée |
| 1.1 | Zones résidentielles et urbaines | Faible | Petite | Extrême | Élevée |
| 1.2 | Zones commerciales et industrielles | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |
| 1.3 | Zones touristiques et récréatives | Faible | Petite | Modérée - Légère | Élevée |
| 2 | Agriculture et aquaculture | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |
| 2.1 | Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |
| 2.3 | Élevage de bétail | Négligeable | Négligeable | Modérée | Élevée |
| 3 | Production d’énergie et exploitation minière | Faible | Petite | Extrême | Élevée |
| 3.2 | Exploitation de mines et de carrières | Faible | Petite | Extrême | Élevée |
| 4 | Corridors de transport et de service | Faible | Grande | Légère | Élevée |
| 4.1 | Routes et voies ferrées | Faible | Grande | Légère | Élevée |
| 4.2 | Lignes de services publics | Faible | Petite | Légère | Élevée |
| 5 | Utilisation des ressources biologiques | Moyen | Grande | Modérée | Élevée |
| 5.1 | Chasse et capture d’animaux terrestres | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |
| 5.3 | Exploitation forestière et récolte du bois | Moyen | Grande | Modérée | Élevée |
| 5.4 | Pêche et récolte de ressources aquatiques | Négligeable | Négligeable | Légère | Élevée |
| 6 | Intrusions et perturbations humaines | Faible | Petite | Modérée | Élevée |
| 6.1 | Activités récréatives | Faible | Petite | Modérée | Élevée |
| 7 | Modification des systèmes naturels | Faible | Petite | Extrême - Modérée | Élevée |
| 7.1 | Incendies et suppression des incendies | Négligeable | Négligeable | Légère | Élevée |
| 7.2 | Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrage | Faible | Petite | Extrême - Modérée | Élevée |
| 8 | Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques | Faible | Petite | Légère | Élevée |
| 8.1 | Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes | Faible | Petite | Légère | Élevée |
| 9 | Pollution | Moyen - Faible | Grande | Modérée - Légère | Élevée |
| 9.1 | Eaux usées domestiques et urbaines | Faible | Petite | Modérée - Légère | Élevée |
| 9.3 | Effluents agricoles et sylvicoles | Moyen - Faible | Grande | Modérée - Légère | Élevée |
| 11 | Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |
| 11.1 | Déplacement et altération de l’habitat | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |
| 11.2 | Sécheresses | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |
| 11.3 | Températures extrêmes | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |
| 11.4 | Tempêtes et inondations | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |
c Impact - Mesure dans laquelle on observe, infère ou soupçonne que l’espèce est directement ou indirectement menacée dans la zone d’intérêt. Le calcul de l’impact de chaque menace est fondé sur sa gravité et sa portée et prend uniquement en compte les menaces présentes et futures. L’impact d’une menace est établi en fonction de la réduction de la population de l’espèce, ou de la diminution/dégradation de la superficie d’un écosystème. Le taux médian de réduction de la population ou de la superficie pour chaque combinaison de portée et de gravité correspond aux catégories d’impact suivantes : très élevé (déclin de 75 %), élevé (40 %), moyen (15 %) et faible (3 %). Inconnu : catégorie utilisée quand l’impact ne peut être déterminé (p. ex. lorsque les valeurs de la portée ou de la gravité sont inconnues); non calculé : l’impact n’est pas calculé lorsque la menace se situe en dehors de la période d’évaluation (p. ex. l’immédiateté est non significative/négligeable ou faible puisque la menace n’existait que dans le passé); négligeable : lorsque la valeur de la portée ou de la gravité est négligeable; n’est pas une menace : lorsque la valeur de la gravité est neutre ou qu’il y a un avantage possible.
d Portée - Proportion de l’espèce qui, selon toute vraisemblance, devrait être touchée par la menace d’ici 10 ans. Correspond habituellement à la proportion de la population de l’espèce dans la zone d’intérêt (généralisée = 71-100 %; grande = 31-70 %; restreinte = 11-30 %; petite = 1-10 %; négligeable < 1 %).
e Gravité - Au sein de la portée, niveau de dommage (habituellement mesuré comme l’ampleur de la réduction de la population) que causera vraisemblablement la menace sur l’espèce d’ici une période de 10 ans ou de 3 générations (extrême = 71-100 %; élevée = 31-70 %; modérée = 11-30 %; légère = 1-10 %; négligeable < 1 %; neutre ou avantage possible > 0 %).
f Immédiateté - Élevée = menace toujours présente; modérée = menace pouvant se manifester uniquement dans le futur (à court terme [< 10 ans ou 3 générations]) ou pour l’instant absente (mais susceptible de se manifester de nouveau à court terme); faible = menace pouvant se manifester uniquement dans le futur (à long terme) ou pour l’instant absente (mais susceptible de se manifester de nouveau à long terme); non significative/négligeable = menace qui s’est manifestée dans le passé et qui est peu susceptible de se manifester de nouveau, ou menace qui n’aurait aucun effet direct, mais qui pourrait être limitative.
L’impact global calculé Note2 des menaces pesant sur la grande salamandre est élevé. La description des menaces concorde avec celle qui a été fournie dans le programme de rétablissement provincial (soit dans la section « Description des menaces »), quoique l’information ait été réorganisée en raison du fait que la classification de l’IUCN-CMP des menaces n’a pas été utilisée dans ce document. S’il y avait lieu, les données à jour concernant la description des menaces ont été ajoutées, ou adaptées dans le cas des données du rapport de situation du COSEPAC (COSEWIC, 2014). À ce jour, les principales menaces sont l’exploitation forestière et la récolte du bois (menace 5.3), et les effluents agricoles et sylvicoles (menace 9.3). Les menaces secondaires sont les suivantes : zones résidentielles et urbaines (menace 1.1), zones touristiques récréatives (menace 1.3), exploitation de mines et de carrières (menace 3.2), corridors de transport et de service (menace 4), activités récréatives (menace 6.1), gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages (menace 7.2), espèces exotiques (non indigènes) envahissantes (menace 8.1), eaux usées domestiques et urbaines (menace 9.1) et changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (menace 11). Toutes les autres menaces ont actuellement un impact négligeable.
Menace 1 (IUCN-CMP) : Développement résidentiel et commercial
1.1 Zones résidentielles et urbaines (impact faible), 1.2 Zones commerciales et industrielles (impact négligeable) et 1.3 Zones touristiques et récréatives (impact faible)
On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Aménagement urbain et rural »).
Menace 2 (IUCN-CMP) : Agriculture et aquaculture
2.1 Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois (impact négligeable) et 2.3 Élevage de bétail (impact négligeable)
Comme la majeure partie du développement agricole dans les régions de basse altitude remonte à un certain temps, cette menace est surtout attribuable à l’aménagement possible de nouvelles serres ou pépinières. Les nouveaux aménagements agricoles peuvent entraîner la perte, la fragmentation ou la dégradation d’habitat, mais il est peu probable qu’ils aient un grand impact, car ils devraient très probablement être réalisés dans des zones moins occupées par la grande salamandre (soit dans le fond des vallées de basse altitude). Par ailleurs, comme des fermes laitières longent la rivière Chilliwack, si l’utilisation des zones riveraines par le bétail s’intensifiait, il pourrait y avoir dégradation de cet habitat. Ces deux menaces sont jugées négligeables en raison de leur portée limitée dans l’habitat de la grande salamandre.
Menace 3 (IUCN-CMP) : Production d’énergie et exploitation minière
3.2 Exploitation de mines et de carrières (impact faible)
L’exploitation minière actuelle dans le bassin hydrographique concerne principalement l’extraction de sable et de gravier. En date de 2012, on comptait sept permis en vigueur pour des exploitations de sable et de gravier, proposées ou en activité, dans la vallée de la Chilliwack (COSEWIC, 2014). L’exploitation de mines et de carrières peut entraîner la perte et la dégradation d’habitats aquatiques et riverains.
Menace 4 (IUCN-CMP) : Corridors de transport et de service
4.1 Routes et voies ferrées (impact faible) et 4.2 Lignes de services publics (impact faible)
Les routes d’accès aux ressources utilisées par les secteurs de l’exploitation forestière, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables sont nombreuses dans l’aire de répartition de la grande salamandre et servent surtout à la récolte du bois (COSEWIC, 2014). La dégradation d’habitat est le plus marquée durant la construction de nouvelles routes, qui peut entraîner l’élimination de végétation et une perturbation du sol, d’où une perte d’habitat terrestre, et durant les travaux effectués dans les cours d’eau en vue d’installer des ponceaux ou des ponts, lesquels aboutissent à une perte d’habitat aquatique en raison de la modification du débit des cours d’eau et d’une sédimentation accrue dans ces derniers (se reporter à la menace 9 « Pollution » ci-après).
En outre, les routes et les autres ouvrages linéaires peuvent fragmenter les habitats forestiers et perturber les déplacements et la dispersion des grandes salamandres adultes et juvéniles. La gravité de la menace devrait être légère, car la majorité des routes traversent des habitats de haut de pente (c.-à-d. qui ne sont ni proches des cours d’eau ni parallèles à ceux-ci), habitats qui sont moins occupés par la grande salamandre.
Menace 5 (IUCN-CMP) : Utilisation des ressources biologiques
5.3 Exploitation forestière et récolte du bois (impact moyen)
On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Activités forestières »).
Menace 6 (IUCN-CMP) : Intrusions et perturbations humaines
6.1 Activités récréatives (impact faible)
On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Activités récréatives »).
Menace 7 (IUCN-CMP) : Modification des systèmes naturels
7.2 Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages (impact faible)
On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Microproduction d’hydroélectricité »).
Menace 8 (IUCN-CMP) : Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques
8.1 Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes (impact faible)
L’introduction de poissons prédateurs (ensemencement à des fins de pêche sportive) dans des cours d’eau jamais occupés auparavant par ces espèces est une menace pour les grandes salamandres, le bassin versant de la Chilliwack étant régulièrement ensemencé avec des salmonidés (COSEWIC, 2014). Les poissons prédateurs pourraient se nourrir des petites larves (Rundio et al., 2003) et ainsi aussi restreindre la dispersion parmi des sous-bassins versants reliés par de grands plans d’eau, augmenter la compétition pour les ressources alimentaires dans les cours d’eau occupés ou accroître le risque d’introduction de maladies épizootiques transmissibles des poissons aux amphibiens, comme la saprolégniase, causée par le Saprolegnia ferax (Romansic et al., 2009), ou des maladies causées par divers iridovirus (Daszak et al., 1999; Mao et al., 1999).
On en sait peu sur la vulnérabilité de la grande salamandre aux maladies épizootiques, mais l’accès accru aux cours d’eau d’amont grâce aux chemins forestiers et aux sentiers récréatifs, pourrait se solder par l’introduction ou la propagation de maladies infectieuses aux populations de salamandres. Dans l’immédiat, on s’inquiète du chytride Batrachochytrium dendrobatidis, un champignon pathogène déjà fréquent en Colombie-Britannique (Govindarajulu et al., 2013) qui a joué un rôle dans le déclin d’amphibiens dans l’ouest des États-Unis et dans le monde (Daszak et al., 1999). Une étude menée par Hossack et al. (2010) sur des amphibiens de cours d’eau de régions montagneuses des États-Unis révèle un faible taux de détection (0,93 %) du B. dendrobatidis chez 452 grenouilles-à-queue et 304 salamandres de ruisseaux. Les auteurs laissent entendre que les amphibiens qui vivent dans des cours d’eau tempérés peuvent être moins sensibles à la chytridiomycose attribuable au B. dendrobatidis en raison des périodes saisonnières prolongées au cours desquelles la température de l’eau est basse, ce qui pourrait inhiber la croissance du champignon, bien que des études préliminaires n’appuient pas complètement cette hypothèse (Knapp et al., 2011).
Une nouvelle menace potentielle est le champignon Batrachochytrium salamandrivorans, un chytride récemment décrit qui a causé il y a peu des mortalités massives de salamandres dans certaines parties de l’Europe (Martel et al., 2013). La présence du B. salamandrivorans n’a pas encore été signalée en Amérique du Nord, mais il est adapté à des températures plus basses par rapport au B. dendrobatidis et pourrait donc présenter une menace importante pour la grande salamandre et d’autres salamandres vivant dans des cours d’eau frais, s’il était introduit en Amérique du Nord.
Menace 9 (IUCN-CMP) : Pollution
9.3 Effluents agricoles et sylvicoles (impact moyen-faible) et 9.1 Eaux usées domestiques et urbaines (impact faible)
La description ci-dessous de cette menace est tirée du rapport du COSEPAC (COSEWIC, 2014).
Les routes et les chemins peuvent être une source de pollution en raison de la sédimentation et de l’utilisation de substances chimiques. Les sédiments peuvent aussi pénétrer dans le réseau par des ruptures de versants découlant des activités d’exploitation forestière, des activités de coupe à blanc en amont, ou des projets d’aménagement, notamment des projets de centrales énergétiques au fil de l’eau. De nombreuses études réalisées aux États-Unis ont révélé que la sédimentation des cours d’eau nuit aux grandes salamandres (Hall et al. 1978; Hawkins et al. 1983; Corn et Bury 1989; Welsh et Ollivier 1998; Ashton et al. 2006). Les sédiments fins remplissent les espaces interstitiels entre les roches avec le substrat du cours d’eau, et réduisent la quantité de refuges essentiels pour les larves de salamandre ou les éliminent. Dans la vallée de la Chilliwack, des résultats préliminaires issus de données prélevées par des étudiants du BCIT laissent croire que l’exploitation forestière peut entraîner la sédimentation de tronçons de cours d’eau occupés par des grandes salamandres, même là où des bandes riveraines boisées de 30 à 50 m ont été laissées, dans les zones d’habitat faunique de l’espèce (Welstead comm. pers., 2013). Selon des données anecdotiques, peu de salamandres ont été observées dans les cours d’eau et les fosses contenant beaucoup de limon dans la région de la Chilliwack (Knopp comm. pers., 2012).
Les routes sont également une source d’apports en substances chimiques dans les cours d’eau. Par exemple, les substances chimiques utilisées pour réduire la quantité de poussière de route et pour déglacer les routes pourraient nuire aux grandes salamandres. Les effets de l’utilisation de produits chimiques dépendent en tout temps de la dilution de ces derniers dans le réseau, par exemple par la pluie, et de la portée de leur utilisation. Les herbicides utilisés dans les zones d’aménagement résidentiel, dans les zones commerciales et dans le cadre de pratiques forestières pourraient représenter une menace pour les grandes salamandres. Quatre-vingt-dix pour cent des herbicides utilisés dans la vallée de la Chilliwack est du glyphosate (Vision®). Du triclopyr-acide (Release®) et du 2,4-D sont aussi utilisés de façon limitée pour limiter la croissance des érables et des aulnes (Stad, comm. pers., 2000). La plupart des années, ces traitements chimiques représentent moins de 1 % des activités totales de préparation des sites en Colombie-Britannique, et leur utilisation est bien moindre dans le sud que dans le nord de la province (Govindarajulu, 2008). On connaît peu les effets des herbicides sur les salamandres qui vivent dans les cours d’eau. Des études réalisées sur des anoures ont révélé des malformations et des mortalités associées à l’exposition à des herbicides (voir par exemple Dial et Bauer, 1984; Ouellet et al., 1997). La valeur de la CL10 (dose estimée à laquelle on obtient 10 % de mortalité) pour des amphibiens exposés à du Vision® s’est révélée être égale ou inférieure à la concentration attendue dans l’environnement pour cet herbicide (Govindarajulu, 2008). En 2004, Howe et al. (2004) ont conclu que la toxicité des pesticides à base de glyphosate était due à la présence de surfactant dans les préparations, plutôt qu’aux ingrédients actifs herbicides. On a découvert que les préparations qui ne contiennent pas de surfactant nuisible sont moins toxiques pour les amphibiens (Govindarajulu, 2008).
Menace 11 (IUCN-CMP) : Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents
11.1 Déplacement et altération de l’habitat (impact faible), 11.2 Sécheresses (impact faible), 11.3 Températures extrêmes (impact faible), 11.4 Tempêtes et inondations (impact faible)
La description ci-dessous de cette menace est tirée du rapport du COSEPAC (COSEWIC, 2014).
Les effets potentiels futurs des changements climatiques sur la grande salamandre sont difficiles à estimer, mais des effets négatifs pourraient se traduire par l’assèchement de cours d’eau et la disponibilité réduite d’humidité sur le parterre forestier, menant à des périodes d’activité saisonnières plus courtes en raison des sécheresses plus fréquentes ou plus longues au printemps et à l’été. Les hivers plus humides et plus chauds pourraient contrer ces effets dans une certaine mesure. La fréquence et l’intensité accrues des inondations pourraient provoquer des crues subites et des coulées de débris, et accroître l’envasement des cours d’eau, causant une mortalité directe et réduisant la qualité de l’habitat des larves. Des relevés visant des amphibiens de cours d’eau réalisés dans un paysage non exploité, dans l’État de Washington, ont révélé que le D. copei présentait la plus importante relation avec les variables du climat parmi les trois espèces de grandes salamandres étudiées, et les auteurs ont avancé que des facteurs climatiques (précipitations) pourraient déjà limiter l’aire de répartition de l’espèce dans la péninsule Olympic (Adams et Bury, 2002). La prédiction des effets du changement climatique sur les amphibiens de cours d’eau porte à confusion, car nous ne comprenons pas bien comment les amphibiens utilisent les milieux de subsurface, qui peuvent servir d’importants refuges (p. ex. chambres souterraines pour la nidification : Dethlefsen, 1948; cavernes : base de données du CDC de la Colombie-Britannique; zone hyporhéique des cours d’eau : Feral et al. 2005). De plus, selon un scénario où un cours d’eau permanent deviendrait intermittent en raison de conditions climatiques extrêmes, certaines grandes salamandres de la population (p. ex. les larves de grande taille) pourraient être capables de se transformer (Knopp, comm. pers., 2012).
Pour estimer ce que les conditions environnementales seraient en fonction d’un scénario de changement climatique, des données historiques et prévues ont été regroupées à partir du site Web ClimateBC pour un emplacement aléatoire se trouvant au centre de l’aire de répartition de la grande salamandre en Colombie-Britannique (latitude : 49° 4' 40" N, longitude : -121° 52’ 36”W, altitude 500 m; Spittlehouse, 2006). Des données climatiques normales pour cet emplacement aléatoire en Colombie-Britannique pour 2 périodes se situant entre 1961 et 2000 ont été comparées aux projections climatiques obtenues à partir de 3 modèles différents pour 3 périodes, soit les années 2020, les années 2050, et les années 2080 (Spittlehouse, 2006). La moyenne de l’ensemble de données normales a été comparée au plus grand changement prédit à partir des 3 modèles concernant les précipitations annuelles pour la période de 2020 (de 2010 à 2039).
Pour 2020, le modèle prédit une hausse de la quantité annuelle de précipitations, mais une diminution de la quantité de précipitations sous forme de neige. De plus, les modèles prédisent une hausse de la quantité de précipitations durant les mois d’hiver, et une diminution de la quantité de précipitations durant les mois d’été et d’automne. La température annuelle moyenne devrait augmenter de 0,8 °C, la hausse saisonnière de température la plus importante devant survenir à l’automne (de presque 2 °C). Ces changements climatiques prédits sont dans la fourchette que la grande salamandre connaît à l’extrémité sud de son aire de répartition, où il fait plus chaud et où les conditions sont plus sèches. Par exemple, les populations qui vivent à Weaverville, en Californie, connaissent des températures en moyenne plus élevées de 4 °C, et reçoivent 632 mm de moins de précipitations chaque année que les populations de Chilliwack. Bien que l’espèce puisse être tolérante à de grands extrêmes climatiques, il n’est pas clair si les populations locales auraient besoin ou seraient en mesure de s’adapter à l’intérieur de la période prévue par les modèles. De plus, on en sait peu sur les cours d’eau occupés de la vallée de la Chilliwack dont les débits sont intimement liés à l’accumulation de neige et à la vitesse de la fonte de la neige. En somme, bien que beaucoup d’incertitudes subsistent, les sécheresses et les inondations plus nombreuses associées au changement climatique devraient réduire la quantité d’habitat disponible, limiter la dispersion et fragmenter encore davantage les populations. Ces réponses seront probablement exacerbées par l’exploitation forestière, par la construction de routes et par d’autres activités humaines, qui continuent de modifier les milieux par leurs effets cumulatifs.
La présente section remplace les sections « But du rétablissement », « Justification du but du rétablissement » et « Objectifs de rétablissement (2009-2013)» du programme de rétablissement provincial
Environnement et Changement climatique Canada a déterminé que l’objectif en matière de population et de répartition de la grande salamandre est le suivant :
Maintenir la répartition et maintenir ou accroître (là où cela est réalisable du point de vue technique et biologique) l’effectif de toutes les populations existantes de l’espèce au Canada, y compris de toute nouvelle population qui pourrait être découverte dans le futur.
La grande salamandre est naturellement rare au Canada et présente une petite aire de répartition qui se limite au bassin versant de la rivière Chilliwack et à des cours d’eau adjacents, une capacité de dispersion restreinte, un taux de reproduction faible et des besoins particuliers en matière d’habitat. Actuellement, on manque de données pour effectuer une analyse qui permettrait d’établir la population minimale viable. De même, on ne dispose pas de données indiquant que l’aire de répartition de l’espèce était auparavant plus étendue. L’espèce a été désignée comme étant menacée par le COSEPAC en raison de la baisse du nombre d’individus matures et des pertes prévues dans le futur compte tenu du déclin continu de la superficie, de l’étendue et de la qualité de l’habitat convenable. L’objectif de maintenir les populations de grandes salamandres stables ou à la hausse à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce en Colombie-Britannique est donc jugé pertinent. Il pourrait être possible d’améliorer l’état de l’espèce à l’avenir, pourvu que les menaces qui pèsent sur les individus soient considérablement réduites et que la qualité et la disponibilité de l’habitat convenable restant soient préservées.
Le programme de rétablissement provincial adopté comprend un tableau de planification du rétablissement (section « Approches recommandées pour l’atteinte des objectifs »). Environnement et Changement climatique Canada a adopté ce tableau étant donné que les approches générales aux fins du rétablissement de l’espèce sont encore pertinentes et que toutes les menaces qui pèsent actuellement sur l’espèce y sont prises en compte.
La présente section remplace la section « Habitat essentiel » du programme de rétablissement provincial.
En vertu de l’alinéa 41(1)c) de la LEP, les programmes de rétablissement doivent inclure une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat. Le programme de rétablissement provincial de la grande salamandre comprend une description des caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel. Cet avis scientifique a été utilisé pour orienter le contenu des sections suivantes sur l’habitat essentiel dans le présent programme de rétablissement fédéral.
L’habitat essentiel de la grande salamandre ne peut être que partiellement désigné à l’heure actuelle, car les données sur l’habitat connectif dont l’espèce a besoin sont insuffisantes. Le calendrier des études (section 5.2) présente les activités requises pour compléter la désignation de l’habitat essentiel additionnel nécessaires aux fins de l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition de l’espèce. L’habitat essentiel de la grande salamandre est désigné dans le présent document, dans la mesure du possible; à mesure que les autorités responsables et/ou d’autres parties intéressées effectueront des recherches pour combler les lacunes dans les connaissances, la méthodologie et la désignation de l’habitat essentiel pourront être modifiées et/ou précisées pour tenir compte des nouvelles connaissances.
Emplacement géospatial des zones renfermant l’habitat essentiel
L’habitat essentiel de la grande salamandre est désigné dans le bassin versant de la rivière Chilliwack et des cours d’eau adjacents, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique (figures 2 à 8). La désignation de cet habitat essentiel repose sur toutes les mentions d’occurrence vérifiées Note3 disponibles pour l’espèce.
Dans la région du bassin versant de la rivière Chilliwack où elle est présente, la grande salamandre a besoin tant d’habitat aquatique (reproduction et alimentation, abritement et hivernage des larves et des individus néoténiques Note4) que d’habitat terrestre environnant (alimentation, abritement et hivernage) pour assurer les fonctions de son cycle vital. L’habitat aquatique et l’habitat terrestre environnant forment ensemble l’habitat essentiel « principal », qui est crucial pour la persistance de la population locale. L’habitat essentiel principal est désigné de manière à englober les voies de déplacement et de migration saisonnière régulière entre cet habitat aquatique et cet habitat terrestre.
Il faut effectuer des recherches supplémentaires pour déterminer la zone d’habitat terrestre avoisinant les cours d’eau qui est utilisé par la grande salamandre en Colombie-Britannique; toutefois, selon une étude de radiotélémesure menée dans cette province, on a mesuré une distance maximale par rapport aux cours d’eau de 66 m en terrain élevé (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). En outre, des travaux de recherche pertinents laissent croire qu’une distance d’environ 80 m est nécessaire au maintien des éléments d’habitat riverain et des voies entre les zones riveraines et les cours d’eau (Gomez et Anthony, 1996; Brosofke et al., 1997; Young, 2000). D’après les études mentionnées, il est raisonnable de croire qu’aux fins de délimitation des zones essentielles à la grande salamandre, une distance de 80 m pour l’habitat essentiel principal est nécesssaire au maintien de la gamme complète des caractéristiques écologiques à proximité immédiate des cours d’eau occupés et des cours d’eau adjacents. Comme de nombreux cours d’eau n’ont été l’objet que d’un seul relevé et qu’ils n’ont pas été l'objet d'un échantillonnage sur toute leur longueur, il convient de suivre une approche prudente consistant à appliquer la désignation à tous les cours d’eau d’amont occupés et adjacents situés dans l’aire de répartition connue de l’espèce, étant donné la probabilité élevée de la présence de la grande salamandre dans l’habitat convenable au sein de cette aire de répartition.
La grande salamandre peut effectuer des déplacements plus étendus au-delà de son habitat essentiel principal dans de l’habitat de terrain élevé additionnel. Ces déplacements de dispersion ne font pas partie de l’utilisation saisonnière courante de l’habitat, mais ils permettent la colonisation de nouveaux sites de reproduction, et/ou la recolonisation de sites qui ne sont pas disponibles chaque année; c’est pourquoi ces déplacements sont nécessaires pour assurer le maintien de la persistance à long terme et le flux génique entre populations. L’habitat terrestre supplémentaire requis pour répondre à ce besoin de l’espèce est l’habitat essentiel « connectif ». On a signalé la présence de grandes salamandres à une distance de plus de 300 m de cours d’eau en Colombie-Britannique (Welstead, 2016, données inédites) et on en a capturé à une distance d’au moins 400 m d’un bord de ruisseau (piège à fosse le plus éloigné dans l’étude) en Oregon (McComb et al., 1993). NatureServe recommande que l’étendue minimale de la zone d’utilisation de l’habitat soit de 500 m, d’après la revue de la littérature de Hammerson (2004), et Environnement et Changement climatique Canada a adopté cette distance pour l’habitat essentiel « connectif ».
On a délimité les zones renfermant l’habitat essentiel de la grande salamandre en appliquant de façon séquentielle les méthodes suivantes (se reporter aussi à la figure 1) :
- Sélection des cours d'eau liés aux mentions vérifiées : c'est-à-dire les cours d'eau situés à l'intérieur d'un rayon de 500 m d'une occurrence, les cours d'eau communiquant entre eux entre les occurrences et tous les cours d'eau d'amont adjacents Note5;
- Application d'une distance de 80 m de chaque côté des cours d'eau sélectionnés pour représenter l'habitat essentiel « principal » comprenant les zones aquatiques essentielles et les zones terrestres adjacentes essentielles à l'espèce pour assurer les fonctions de son cycle vital;
- Application d'un rayon de 500 m autour de toutes les mentions vérifiées et là où les zones ainsi définies chevauchent de l'habitat essentiel « principal » (et ne sont pas déjà désignées comme étant de l'habitat essentiel « principal »), pour établir de l'habitat essentiel « connectif » entre les cours d'eau pertinents;
- Exclusion géospatiale de toute zone située à plus de 1 200 m d'altitude Note6.
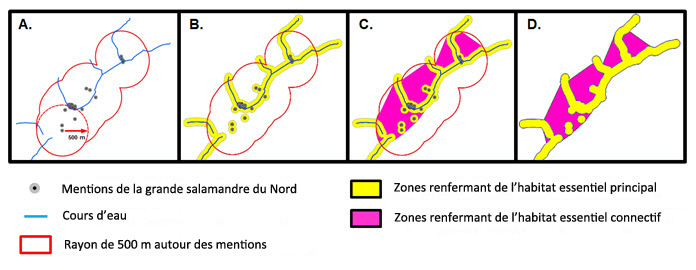
Description longue de la figure 1
La figure est un diagramme en quatre parties désignées étapes A, B, C et D. Les étapes sont présentées en séquence et commencent, à l’étape A, avec les points indiquant les mentions de la grande salamandre du Nord, les lignes illustrant les cours d’eau et les rayons de 500 m autour des points représentant les mentions. À l’étape D, un diagramme illustre l’habitat essentiel résultant, qui renferme l’habitat essentiel principal et connectif, établi à l’aide des étapes précédentes. Se reporter à la légende de la figure 1.
Éléments biophysiques et caractéristiques de l'habitat essentiel « principal »
Le cycle vital de la grande salamandre est complexe, et les besoins en matière d'habitat de tous les stades de ce cycle doivent être satisfaits pour que les populations puissent persister. Les salamandres vivent généralement dans des petits cours d'eau de montagne en cascade et dans les forêts humides et ombragées adjacentes (à une altitude d'au plus 1 200 m). Les grandes salamandres ont besoin d'habitat pour chacune des activités suivantes :
- nidification et ponte des œufs,
- développement des larves en milieu aquatique,
- alimentation, abritement et hivernage des individus néoténiques en milieu aquatique, et
- alimentation, abritement et hivernage des juvéniles et des adultes en milieu terrestre.
Les éléments d'habitat et les caractéristiques requises pour chacune des quatre activités (résumées au tableau 3) se chevauchent sur le plan biophysique, géospatial et saisonnier, et entre stades du cycle vital.
| Stades vitaux | Fonctions | Éléments biophysiques | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Larves aquatiques, individus néoténiques |
Alimentation, abritement, développement, hivernage, dispersion |
Eau douce en mouvement (dont des zones hyporhéiquesg), par exemple :
|
|
| Adultes, œufs | Nidification et ponte des œufs | Eau douce en mouvement (dont des zones hyporhéiquesg), par exemple :
|
|
| Adultes et juvéniles (métamorphosés) | Alimentation, abritement, hivernage, migrations saisonnières | Forêt humide et ombragée, habitats riverains et zones de suintement |
|
g Zone hyporhéique : zone où les eaux de surface et les eaux souterraines se mélangent, en dessous et à côté du lit d'un cours d'eau.
h Johnston, 2004
i Dupuis et al., 1995; Ferguson, 1998
Éléments biophysiques et caractéristiques de l'habitat essentiel « connectif »
Les caractéristiques biophysiques et les caractéristiques des zones d'habitat connectif nécessaires aux fonctions du cycle vital de la grande salamandre sont résumées au tableau 4.
| Stades vitaux | Fonctions | Éléments biophysiques | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Adultes, juvéniles (métamorphosés) | Dispersion entre les zones d'habitat aquatique et terrestre principal | Forêt humide et ombragée |
|
Les zones renfermant l’habitat essentiel principal et connectif de la grande salamandre sont présentées aux figures 2 à 8. Sur ces cartes, l’habitat essentiel principal de la grande salamandre se trouve dans les polygones en jaune là où sont présents les éléments biophysiques et les caractéristiques de l’habitat essentiel principal décrits dans la présente section. L’habitat essentiel connectif de la grande salamandre se trouve dans les polygones en rose là où sont présents les éléments biophysiques et les caractéristiques de l’habitat connectif décrits dans la présente section. À l’intérieur de ces polygones, seules les zones manifestement non convenables qui ne peuvent subvenir aux besoins de l’espèce durant l’un ou l’autre de ses stades vitaux (c.-à-d. qui ne présentent aucun des éléments biophysiques et caractéristiques requis par l’espèce à quelque moment que ce soit) ne sont pas désignées comme habitat essentiel. Parmi les exemples d’habitats manifestement non convenables, citons l’infrastructure permanente existante (surface de roulement des routes asphaltées et/ou surfaces artificielles, bâtiments) et les zones se trouvant à une altitude de plus de 1 200 m. Le quadrillage UTM de 1 km x 1 km superposé sur les cartes est un système de quadrillage national de référence qui indique la zone géographique générale renfermant de l’habitat essentiel, et qui est utilisé à des fins d’aménagement du territoire et/ou d’évaluation environnementale.
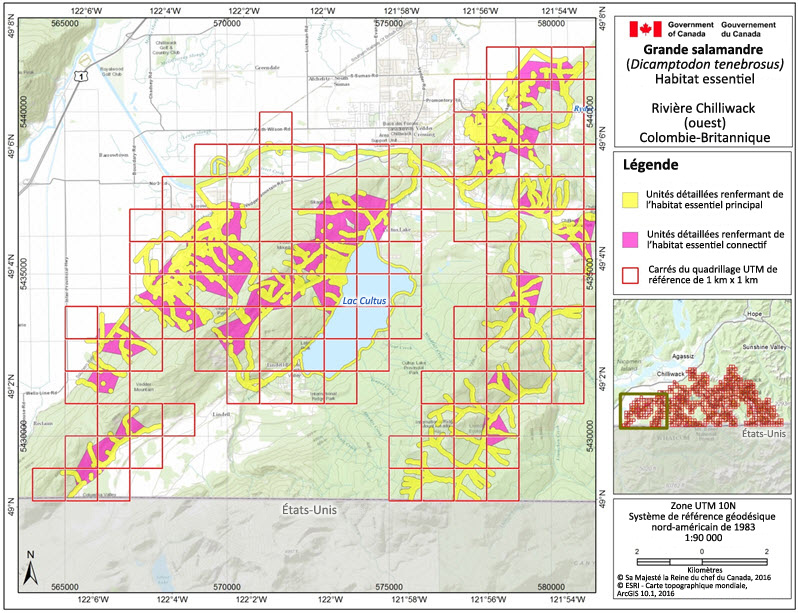
Description longue de la figure 2
La figure 2 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (ouest), en Colombie Britannique, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par les lignes fines ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. La principale zone d’habitat essentiel se trouve directement en périphérie du lac Cultus et à l’ouest de ce lac. De l’habitat est aussi présent le long de la rivière Chilliwack et dans une parcelle à environ 6 km au nord est du lac Cultus, en périphérie de Chilliwack. Au sud est du lac Cultus, dans le parc provincial Cultus Lake, de l’habitat essentiel principal ramifié serpente dans une vallée orientée du nord est au sud est, jusqu’à la frontière entre le Canada et les États Unis. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
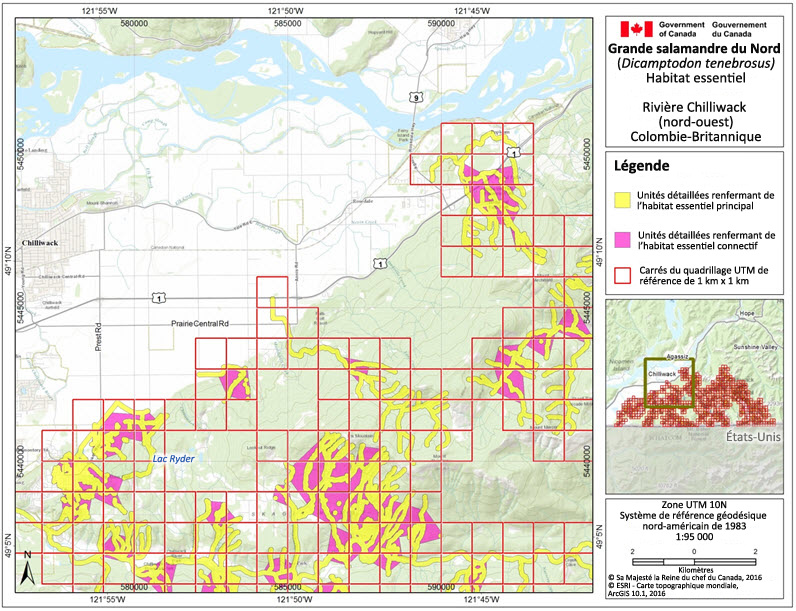
Description longue de la figure 3
La figure 3 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord ouest), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les principales zones d’habitat se trouvent au sud est de Chilliwack et de la route 1, dans la région du lac Ryder, et à l’est de cette zone dans la région de Slesse Park. En outre, on compte d’importantes parcelles dans le parc provincial Bridal Falls. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
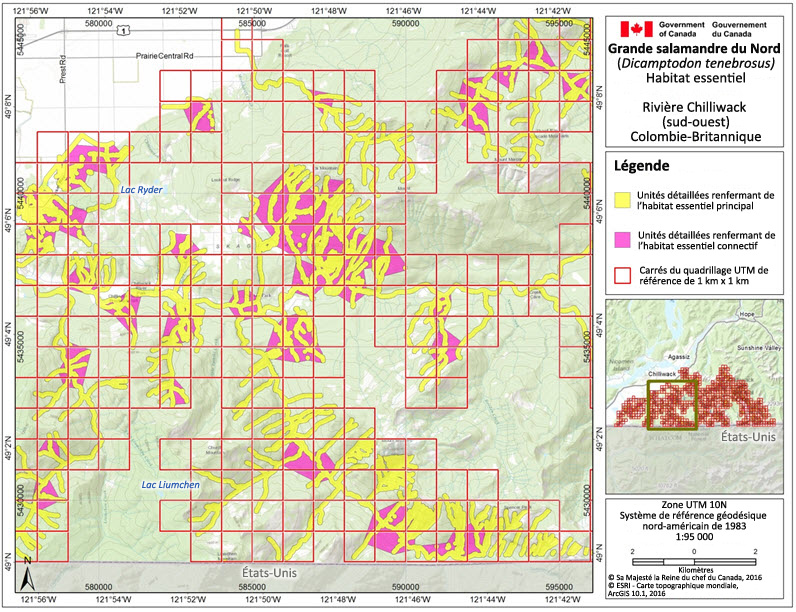
Description longue de la figure 4
La figure 4 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (sud ouest), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Cette région est située au sud est de Chilliwack, dans une région en grande partie boisée contenant de la forêt parc, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. Les parcelles d’habitat les plus importantes se trouvent dans des vallées contenant des cours d’eau traversant la région, par exemple la rivière Chilliwack dans un axe est-ouest et un cours d’eau à l’est de la réserve écologique Liumchen, orienté du sud est au nord ouest et rejoignant la rivière Chilliwack par le sud. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
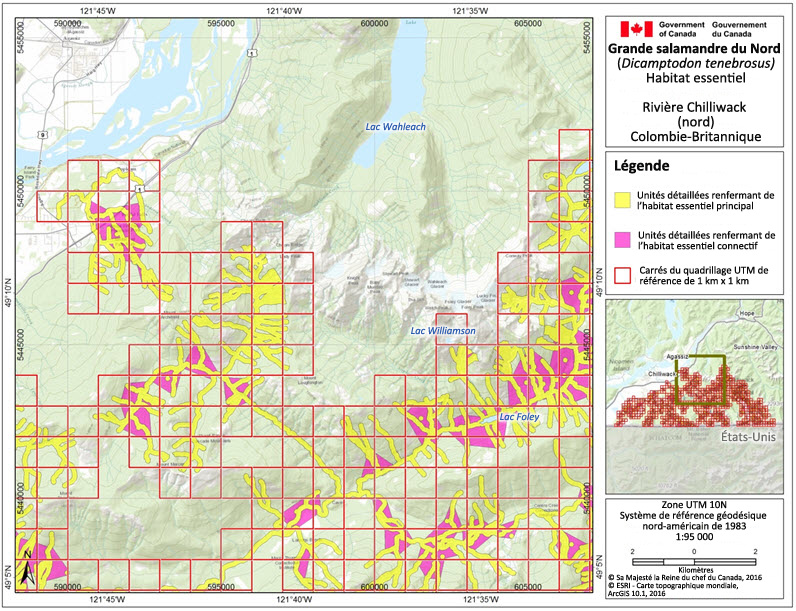
Description longue de la figure 5
La figure 5 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent le long des cours d’eau dans des vallées, par exemple la zone se trouvant au sud du pic Welch mais au nord du pic Williams le long du lac Foley, celle se trouvant le long du chemin de service forestier Foley Creek et celle se trouvant le long du chemin de service forestier Chipmunk Creek. Une autre parcelle est illustrée dans le parc provincial Bridal Veil Falls juste au sud du fleuve Fraser. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
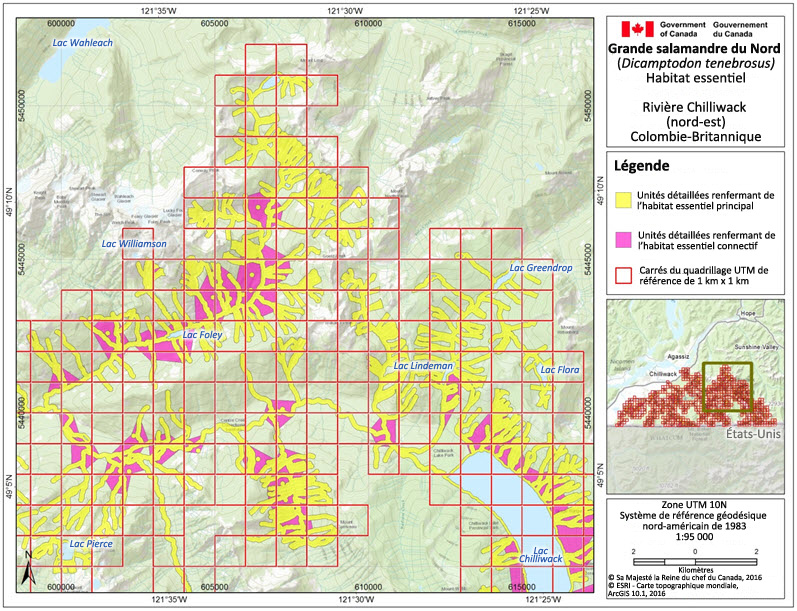
Description longue de la figure 6
La figure 6 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord est), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Ces grandes zones sont situées en périphérie du lac Chilliwack, surtout dans les terres bordant la rive est, et dans une section de vallée reliant le lac Lindeman au sud et le lac Greendrop au nord. On compte aussi la vallée s’étendant de part et d’autre du chemin Chilliwack Lake, et la vallée qui renferme le lac Foley et le chemin de service forestier Foley Creek. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
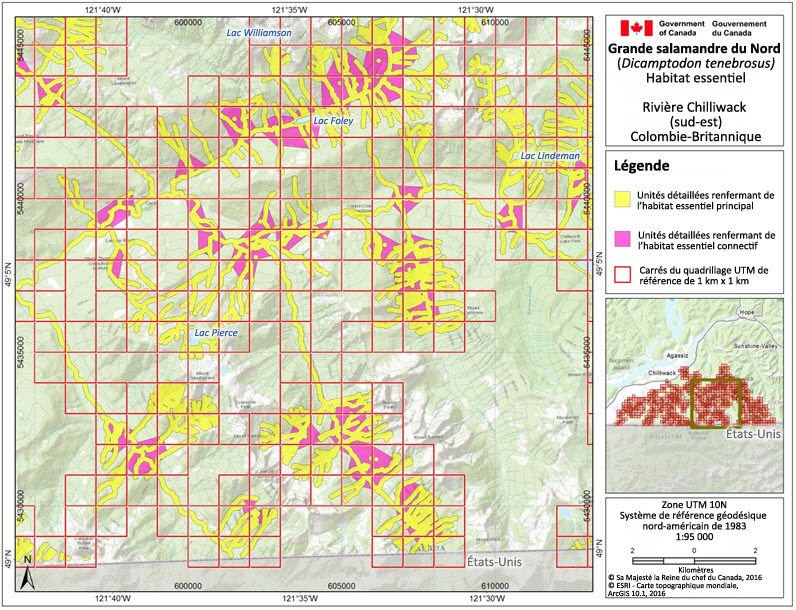
Description longue de la figure 7
La figure 7 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (sud est), en Colombie Britannique, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Les zones notables comprennent une boucle d’habitat ramifié qui suit le chemin Chilliwack River d’est en ouest, contourne une forme de relief et se prolonge le long du chemin de service forestier Foley Creek au-delà du lac Foley. La vallée orientée nord-sud entre deux crêtes importantes juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis, les zones en périphérie du lac Pierce et les vallées au sud de ce lac sont d’autres parcelles importantes. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
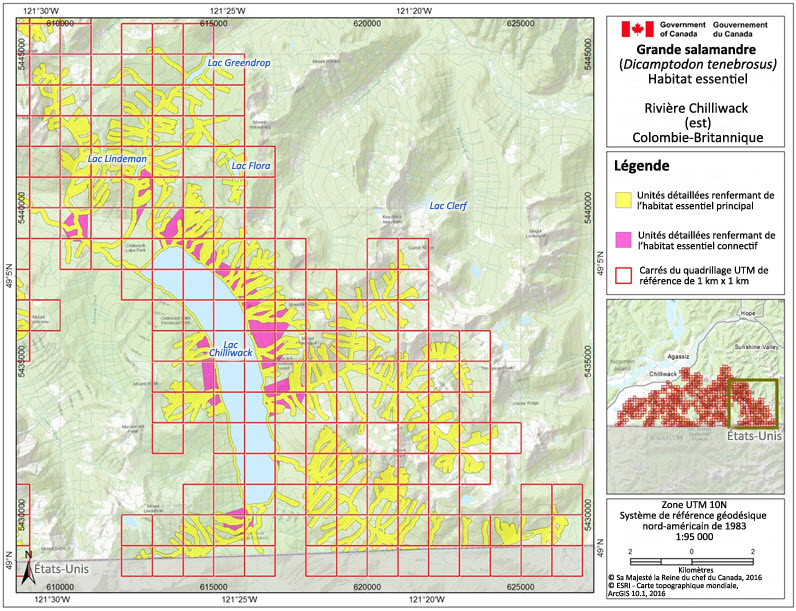
Description longue de la figure 8
La figure 8 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (est), en Colombie Britannique, directement au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Ces grandes zones sont situées en périphérie du lac Chilliwack, en particulier du côté est, et se prolongent en direction nord est jusqu’aux lacs Lindeman, Flora et Greendrop. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.
Le calendrier des études suivant (tableau 5) indique l'activité nécessaire pour compléter la désignation de l'habitat essentiel de la grande salamandre Note7.
| Description de l'activité | Justification | Échéancier |
|---|---|---|
| Mener des recherches ciblées pour déterminer la quantité et la configuration d'habitat connectif additionnel dont la grande salamandre a besoin. | L’habitat essentiel connectif de la grande salamandre n’a été que partiellement désigné; la désignation vise à assurer de l’habitat connectif pour les mentions d’occurrence vérifiées, mais cela ne représente qu’un sous-ensemble de l’habitat connectif nécessaire à tous les individus en dispersion. Il faut davantage d’information sur les besoins en matière d’habitat convenable pour compléter la désignation de l’habitat essentiel connectif parmi les cours d’eau habitables et entre eux. | 2017-2022 |
La compréhension de ce qui constitue la destruction de l'habitat essentiel est nécessaire à la protection et à la gestion de cet habitat. La destruction est déterminée au cas par cas. On peut parler de destruction lorsqu'il y a dégradation d'un élément de l'habitat essentiel, soit de façon permanente ou temporaire, à un point tel que l'habitat essentiel n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions lorsque exigé par l'espèce. La destruction peut découler d'une activité unique à un moment donné ou des effets cumulés d'une ou de plusieurs activités au fil du temps. Le tableau 6 donne des exemples d'activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de l'espèce; il peut toutefois exister d'autres activités destructrices.
| Description des activités | Description des effets | Information supplémentaire; menaces connexes de l'IUCNj |
|---|---|---|
Conversion des terres à des fins de développement anthropique dans l'habitat essentiel principal ou connectif. Exemples : exploitation forestière et récolte du bois, développement résidentiel et commercial, exploitation de mines et de carrières, corridors de transport et de service, et utilisation de cours d'eau (barrages, ouvrages de prise d'eau ou centrales au fil de l'eau). |
Cette activité peut entraîner la perte directe d'habitat essentiel ou pourrait dégrader l'habitat au point où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de l'espèce, p. ex. en modifiant les conditions locales des microsites, l'hydrologie et/ou la qualité de l'eau (voir ci-dessous). | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 7.2 L'exploitation forestière et la récolte du bois sont parmi les principales menaces pesant sur l'espèce et sont fortement susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel. |
Activités causant la modification des caractéristiques hydrologiques locales au point où les caractéristiques biophysiques des cours d'eau de l'habitat essentiel principal sont dégradées ou détruites. Exemples d'activités ayant des effets sur le régime hydrologique : blocage, perturbation ou détournement de l'écoulement d'un cours d'eau. |
Toute modification hydrologique à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de l'habitat essentiel principal peut porter la profondeur, la température et le débit de l'eau hors de l'intervalle des valeurs requises pour la reproduction, l'alimentation et/ou la survie à l'hiver. | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 6.1, 7.2, 9 La destruction peut être directe (en raison de l'aménagement de fossés ou de canaux, de l'installation de ponceaux, de la gestion de l'eau, etc.) et/ou indirecte en raison des activités de conversion des terres décrites plus haut (p. ex., exploitation forestière et récolte du bois) ou d'activités récréatives. Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction (p. ex. modification à grande échelle du réseau hydrographique). Les effets peuvent être cumulatifs. |
Activités qui élevent, dans l'habitat essentiel principal, les quantités de sédiments dans les cours d'eau au-delà des limites recommandées pour la protection de la vie aquatiquek. Exemples : exploitation forestière et récolte du bois, développement résidentiel et commercial, exploitation de mines et de carrières, construction, entretien et réfection de routes et de corridors de service, modification des écosystèmes naturels (p. ex. incendies et lutte contre les incendies), et gestion de l'eau et exploitation de barrages. |
La sédimentation, l'envasement et l'érosion ayant lieu à l'intérieur ou hors de l'habitat essentiel principal peuvent directement affecter la qualité de l'eau et modifier la structure des cours d'eau, ce qui peut porter la quantité de sédiments et la profondeur de l'eau hors de l'intervalle des valeurs requises pour la reproduction, l'alimentation et la survie à l'hiver. | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 6.1, 7.2, 9 Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction. Les effets peuvent être cumulatifs et pourraient interagir avec des activités ayant des effets sur l'hydrologie (voir plus haut) : l'accumulation de sédiments dans les cours d'eau qui alimentent en eau/matériaux les cours d'eau peut mener à des épisodes importants de ruissellement causant un afflux soudain de polluants provenant des environs. |
Activités qui élèvent les concentrations de polluants à des valeurs supérieures aux concentrations de référence locales dans les cours d'eau de l'habitat essentiel principal. Exemples de sources de polluants : ruissellement ou pulvérisation de pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) et d'agents chimiques défoliants. |
Les activités réalisées à l'intérieur ou hors de l'habitat essentiel principal qui introduisent des contaminants dans les cours d'eau sont susceptibles d'endommager ou de détruire l'habitat. Le rejet de polluants peut affecter la qualité de l'eau et nuire ainsi à la survie, à la croissance et à la reproduction dans l'habitat essentiel principal . | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 5.3, 9 Des herbicides peuvent être utilisés aux fins de développement résidentiel et d'exploitation forestière. Le principal herbicide utilisé dans la vallée de la Chilliwack est le glyphosate; le triclopyr et le 2-4-D sont aussi employés de façon restreinte pour limiter la croissance des feuillus (COSEWIC, 2014). Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction (p. ex. ruissellement depuis l'amont). Les effets peuvent être cumulatifs. |
| Introduction délibérée de poissons prédateurs dans des cours d’eau de l’aire de répartition de l’espèce. | La présence de poissons prédateurs introduits peut rendre l'habitat aquatique non convenable pour la reproduction et la dispersion des grandes salamandres. | Menace connexe de l'IUCN-CMP : 8.1 La prédation est préoccupante lorsque des poissons et des salamandres cohabitent, car il se peut que les salamandres soient incapables de se reproduire dans ce contexte. La pression exercée par la prédation peut aussi empêcher la dispersion des salamandres parmi les sous-bassins hydrographiques reliés par des grands ruisseaux ou des rivières. Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction. L'introduction de poissons prédateurs dans de l'habitat essentiel principal est fortement susceptible de causer des dommages. Les effets peuvent être cumulatifs. |
j La classification des menaces est fondée sur le système unifié de classification des menaces de l'IUCN-CMP (Union internationale pour la conservation de la nature-Partenariat pour les mesures de conservation) (disponible en anglais seulement).
k Consulter Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique et Working Water Quality Guidelines for British Columbia
La présente section remplace la section intitulée « Mesure des progrès » du programme de rétablissement provincial.
Les indicateurs de rendement présentés ci-dessous proposent un moyen de définir et de mesurer les progrès vers l'atteinte de l'objectif en matière de population et de répartition :
- La répartition de la grande salamandre au Canada a été maintenue (c.-à-d. que la zone d'occurrence et la zone d'occupation n'ont pas diminué);
- L'abondance de la grande salamandre au Canada s'est maintenue ou augmente naturellement (c.-à-d. que la taille des populations n'a pas diminué).
La présente section remplace la section intitulée « Énoncé sur les plans d'action » du programme de rétablissement provincial.
Un ou plusieurs plans d'action visant la grande salamandre seront publiés dans le Registre public des espèces en péril d'ici 2022.
La présente section remplace la section intitulée « Effets sur les espèces non ciblées » du programme de rétablissement provincial.
Une évaluation environnementale stratégique (EES) est effectuée pour tous les documents de planification du rétablissement élaborés en vertu de la LEP, conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. L'objet de l'EES est d'incorporer les considérations environnementales à l'élaboration des projets de politiques, de plans et de programmes publics pour appuyer une prise de décisions éclairée du point de vue de l'environnement, et d'évaluer si les résultats d'un document de planification du rétablissement peuvent affecter un élément de l'environnement ou tout objectif ou cible de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).
La planification du rétablissement vise à favoriser les espèces en péril et la biodiversité en général. Il est cependant reconnu que des programmes peuvent, par inadvertance, produire des effets environnementaux qui dépassent les avantages prévus. Le processus de planification fondé sur des lignes directrices nationales tient directement compte de tous les effets environnementaux, notamment des incidences possibles sur des espèces ou des habitats non ciblés. Les résultats de l'EES sont directement inclus dans le programme lui-même, mais également résumés dans le présent énoncé, ci-dessous.
La grande salamandre est présente dans la vallée de la Chilliwack et les environs, région où vivent aussi d'autres espèces rares dont plusieurs ont un habitat semblable. La protection de l'habitat recommandée sera indirectement bénéfique à d'autres espèces de la région qui dépendent des petits ruisseaux, des zones riveraines et des forêts avoisinantes. Parmi les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 de la LEP qui pourraient profiter des mesures de protection prises pour la grande salamandre, on compte les suivantes : la Chouette tachetée de la sous-espèce caurina (Strix occidentalis caurina; espèce en voie de disparition), la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei; espèce préoccupante), la cimicaire élevée ( Actaea elata ; espèce en voie de disparition) et le castor de montagne (Aplodontia rufa; espèce préoccupante). D'autres espèces inscrites à la LEP pourraient aussi profiter des mesures de rétablissement, bien que leur répartition soit limitée à des zones de basse altitude, soit la musaraigne de Bendire (Sorex bendirii; espèce en voie de disparition) et l'escargot-forestier de Townsend (Allogona townsendiana; espèce en voie de disparition).
Des effets négatifs sur des espèces proies, comme les têtards de la grenouille-à-queue côtière et des invertébrés aquatiques, sont possibles par endroits. Cependant, la grande salamandre a longtemps coexisté avec ces organismes au cours de l'évolution, et on s'attend à ce que les éventuels effets négatifs soient compensés par les avantages accrus découlant de la gestion et de la protection de l'habitat. On mettra en œuvre les mesures de planification du rétablissement de la grande salamandre en tenant compte de toutes les autres espèces présentes, plus particulièrement les espèces en péril, de manière à ce que les répercussions négatives accidentelles sur les individus et leurs habitats soient évitées.
Adams, M.J., et R.B. Bury. 2002. The endemic headwater stream amphibians of the American Northwest: associations with environmental gradients in a large forested preserve. Global Ecology and Biogeography 11:169-178.
Ashton, D.T., S.B. Marks, et H.H. Welsh Jr. 2006. Evidence of continued effects from timber harvesting on lotic amphibians in redwood forests of northwestern California. Forest Ecology and Management 221:183-193.
B.C. Conservation Framework. 2016. Conservation Framework Summary: Dicamptodon tenebrosus. B.C. Ministry of Environment. Victoria, British Columbia. [consulté en juillet 2016].
Brosofske, K.D., J. Chen, R.J. Naiman, et J.F. Franklin. 1997. Harvesting effects on microclimatic gradients from small streams to uplands in western Washington. Ecological Applications 7:1188-1200.
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 2014. COSEWIC assessment and status report on the Coastal Giant Salamander Dicamptodon tenebrosus in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. xii + 53 pp. (Species at Risk Public Registry website). (Aussi disponible en français : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2014. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la grande salamandre du Nord (Dicamptodon tenebrosus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 63 p. (Site Web du Registre public des espèces en péril).
CMP (Conservation Measures Partnership). 2010. Threats Taxonomy. (disponible en anglais seulement)
Corn, P.S., et R.B. Bury. 1989. Logging in western Oregon: responses of headwater habitats and stream amphibians. Forest Ecology and Management 29:39-57.
Daszak, P., L. Berger, A.A. Cunningham, A.D. Hyatt, D.E. Green, et R. Speare. 1999. Emerging infectious diseases and amphibian population declines. Emerg. Infect. Dis. 5:735-748.
Dethlefsen, E.S. 1948. A subterranean nest of the Pacific Giant Salamander, Dicamptodon ensatus (Eschcholtz). The Wasmann Collector 7(3):81-84.
Dial, N.A., et C.A. Bauer. 1984. Teratogenic and lethal effects of paraquat on developing frog embryos (Rana pipiens). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 33:592-597.
Dupuis, L.A., J.N.M. Smith et F. Bunnell. 1995. Relation of terrestrial-breeding amphibian abundance to tree-stand age. Conservation Biology 9: 645-653.
Feral D., M.A. Camann, et H.H. Welsh Jr. 2005. Dicamptodon tenebrosus larvae within hyporheic zones of intermittent streams in California. Herpetological Review 36(1): 26-27.
Ferguson, H.M. 1998. Demography, dispersal and colonisation of larvae of Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus, Good) at the northern extent of their range. Mémoire de maîtrise, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia. 131 pp.
Gomez, D.M., et R.G. Anthony. 1996. Amphibian and reptile abundance in riparian and upslope areas of five forest types in western Oregon. Northwest Sci. 70, 109-119.
Govindarajulu P., C.Nelson, J. LeBlanc, W. Hintz, et H. Schwantje. 2013. Batrachochytrium dendrobatidis surveillance in British Columbia 2008 - 2009, Canada. British Columbia Ministry of the Environment. Report ID 34795.
Govindarajulu, P.P. 2008. Literature review of impacts of glyphosate herbicide on amphibians: What risks can the silvicultural use of this herbicide pose for amphibians in B.C.? B.C. Wildlife Report No. R-28. Ministry of Environment, Victoria, British Columbia.
Hall, J.D., M.L. Murphy, et R.S. Aho. 1978. Community Ecology and Salamander Guilds. Cambridge University Press, Great Britain. 230 pp.
Hammerson, G. 2005. Population/occurrence delineation. Spadefoots. In NatureServe (2016). NatureServe Explorer: An online encyclopedia of life [application Web]. Version 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [disponible en anglais seulement, consulté en juillet 2016]
Hawkins, C.P., M.L. Murphy, N.H. Anderson, et M.A. Wilzbach. 1983. Density of fish and salamanders in relation to riparian canopy and physical habitat in streams of the northwestern United States. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 40:1173-1185.
Hossack, B.R., M.J. Adams, E.H. Campbell Grant, C.A. Pearl, J.B. Bettaso, W.J. Barichivich, W.H. Lowe, K. True, J.L. Ware, et P.S. Corn. 2010. Low prevalence of chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibians of U.S. headwater streams. Journal of Herpetology 44(2):253-260.
Howe, C.M., M. Berrill, B.D. Pauli, C.C. Helbing, K. Werry, et N. Veldhoen. 2004. Toxicity of glyphosate-based pesticides to four North American frog species. Environmental Toxicology and Chemistry 23(8):1928-1938.
Johnston, B. 1998. Terrestrial Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus Good): natural history and their response to forest practices. Mémoire de maîtrise. Univ. of British Columbia, Vancouver, British Columbia. 98 pp.
Johnston, B.E. 2004. Accounts and Measures for Managing Identified Wildlife. V. 2004. Coastal Giant Salamander (Dicamptodon tenebrosus)(PDF; 154 Ko), (disponible en anglais seulement). Préparé pour le Ministry of Water, Land and Air Protection, Surrey, BC.
Johnston, B., et L. Frid. 2002. Clearcut logging restricts the movements of terrestrial Pacific giant salamanders (Dicamptodon tenebrosus Good). Can. J. Zool. 80, 2170-2177.
Knapp, R. A., C. J. Briggs, T. C. Smith, et J. R. Maurer. 2011. Nowhere to hide: impact of a temperature-sensitive amphibian pathogen along an elevation gradient in the temperate zone. Ecosphere 2(8):1-26
Knopp, D., comm. pers. 2012. Communication adressée à E. Wind. BC's Wild Heritage Environmental. Chilliwack, Colombie-Britannique. Cité dans COSEWIC (2014).
Mao, J., D.E. Green, G. Fellers, et V.G. Chinchar. 1999. Molecular characterization of iridoviruses isolated from sympatric amphibians and fish. Virus Res.63(1-2):45-52.
Martel, A., A. Spitzen-van der Sluijs., M. Blooi, W. Bert, R. Ducatelle, M.C. Fisher, A. Woeltjes, W. Bosman, K. Chiers, F. Bossuyt et F. Pasmans. 2013. Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(38), 15325-15329.
Master, L., D. Faber-Langendoen, R. Bittman, G.A. Hammerson, B. Heidel, J. Nichols, L. Ramsay, et A. Tomaino. 2012. NatureServe conservation status assessments: factors for assessing extinction risk. NatureServe, Arlington, VA.
McComb, W.G., K. McGarigal, et R.G. Anthony. 1993. Small mammal and amphibian abundance in streamside and upslope habitats of mature Douglas-fir stands, western Oregon. Northwest Sci. 67 (1), 7-15.
NatureServe. 2016. NatureServe Explorer: An online encyclopedia of life [application Web]. Version 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [consulté en juillet 2016].
Ouellet, M., J. Bonin, J. Rodrigue, J.L. DesGranges, et S. Lair. 1997. Hindlimb deformities (ectromelia, ectrodactyly) in free-living anurans from agricultural habitats. Journal of Wildlife Diseases 33:95-104.
Romansic, J.M., K.A.Diez, E.M. Higashi, J.E. Johnson, et A.R. Blaustein. 2009. Effects of the pathogenic water mold Saprolegnia ferax on survival of amphibian larvae. Dis. Aquat. Organ. 83(3):187-93.
Rundio, D.E., D.H. Olson et C. Guyer. 2003. Antipredator defenses of larval Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus) against Cutthroat Trout (Oncorhynchus clarki). Copeia 2003(2):402-407.
Spittlehouse, D. 2006. ClimateBC: Your Access to Interpolated Climate Data for BC. Streamline Watershed Management Bulletin Vol. 9/No. 2 Spring 2006. Pp 16-21. [disponible en anglais seulement, consulté en mars 2013].
Stad, L. comm. pers. 2000. District Manager, Ministry of Forests, Chilliwack Forest District. Cité dans Ferguson et Johnson (2000).
Welsh, H.H., Jr., et L.M. Ollivier. 1998. Stream amphibians as indicators of ecosystem stress: a case study from California's redwoods. Ecological Applications 8:1118-1132.
Welstead, K., comm. pers. 2013. Communications par téléphone et par courriel adressées à K. Ovaska. Novembre 2013. Ministry of Forests, Lands, and Natural Resource Operations. Surrey, Colombie-Britannique. Cité dans COSEWIC (2014).
Welstead, K. 2016. [An analysis of the overland adults and juveniles captures from BC data] - données inédites.
Young, K.A., 2000. Riparian zone management in the Pacific Northwest: who's cutting what? Environ. Manage. 26 (2), 131-144.
Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique
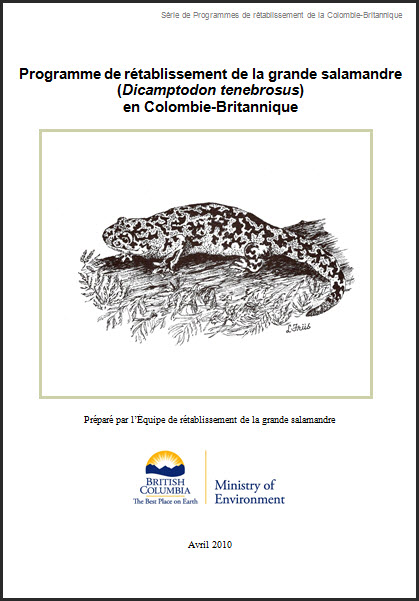
Préparé par l'Équipe de rétablissement de la grande salamandre
Ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique
Avril 2010
La présente série réunit les programmes de rétablissement visant à conseiller le gouvernement de la Colombie-Britannique quant à l'approche stratégique générale à adopter pour le rétablissement des espèces en péril. Le gouvernement provincial prépare les programmes de rétablissement pour respecter ses engagements relativement au rétablissement des espèces en péril dans le cadre de l'Accord pour la protection des espèces en péril au Canada et de l'Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique.
Le rétablissement d'une espèce en péril est le processus visant à arrêter ou à inverser le déclin des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues de la province ainsi qu'à éliminer ou à réduire les menaces auxquelles elles sont exposées, de façon à augmenter leurs chances de survie à l'état sauvage.
Le programme de rétablissement réunit les meilleures connaissances scientifiques disponibles pour déterminer ce qui doit être réalisé afin de rétablir une espèce ou un écosystème. Il décrit les connaissances et les lacunes à propos d'une espèce ou d'un écosystème. Il cerne également les menaces pesant sur une espèce ou un écosystème et explique les mesures à prendre pour les atténuer. Enfin, le programme de rétablissement fixe les buts et les objectifs du rétablissement de l'espèce ou de l'écosystème et recommande des approches à adopter pour les atteindre.
Les programmes de rétablissement sont généralement élaborés par une équipe de rétablissement composée de membres des organismes responsables de la gestion de l'espèce ou de l'écosystème, de spécialistes d'autres organismes, d'universités, de groupes de conservation, de groupes autochtones et de groupes d'intervenants, selon le cas.
Dans la plupart des cas, on procède à l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action pour préciser et orienter la mise en œuvre du programme de rétablissement. Les plans d'action comprennent des renseignements plus détaillés sur ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs établis dans le programme de rétablissement. Le programme de rétablissement fournit toutefois de l'information précieuse sur les menaces qui pèsent sur l'espèce et sur ses besoins en matière de rétablissement. Cette information peut servir aux particuliers, aux collectivités, aux utilisateurs des terres et à toute personne soucieuse du rétablissement des espèces en péril.
Pour en apprendre davantage sur le rétablissement des espèces en péril en Colombie-Britannique, veuillez consulter la page Web du ministère de l'Environnement portant sur la planification du rétablissement (en anglais seulement)
Équipe de rétablissement de la grande salamandre. 2010. Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique. Préparé pour le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, Victoria (Colombie-Britannique), 49 p.
Photographie : © Laura Friis
On peut télécharger la version anglaise du présent document à partir de la page Web du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique portant sur la planification du rétablissement à l’adresse suivante : Web du ministère de l'Environnement portant sur la planification du rétablissement (en anglais seulement)
Le contenu du présent document (sauf les illustrations) peut être utilisé sans permission, à condition que la source en soit adéquatement mentionnée.
Ce programme de rétablissement a été préparé par l'équipe de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) à titre d'avis aux autorités responsables et aux organismes responsables qui pourraient participer au rétablissement de l'espèce. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique a obtenu cet avis afin de respecter ses engagements aux termes de l'Accord pour la protection des espèces en péril au Canada et de l'Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique.
Ce document présente les stratégies de rétablissement jugées nécessaires pour rétablir les populations de grandes salamandres (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, à la lumière des meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles dont nous disposons. Les mesures de rétablissement, qui ont été établies pour atteindre les buts et les objectifs exposés dans le présent document, sont assujetties aux priorités et aux contraintes budgétaires des organismes participants. Ces buts, objectifs et approches pourraient être modifiés de manière à tenir compte de nouveaux objectifs et de nouvelles conclusions.
Les autorités responsables et tous les membres de l'équipe de rétablissement ont eu l'occasion d'examiner ce document. Malgré tout, le contenu ne reflète pas nécessairement la position officielle des organismes concernés ou les opinions personnelles de tous les particuliers qui siègent à l'équipe de rétablissement.
Le rétablissement de cette espèce dépend de l'engagement et de la coopération d'un grand nombre d'intervenants qui participent à la mise en œuvre des orientations exposées dans le présent programme. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique invite tous les citoyens de la province à participer au rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus).
| Nom | Affiliation | Organisation ou poste |
|---|---|---|
| Kym Welstead (présidente) | Province de la C.-B. | Présidente; ministère de l'Environnement de la C.-B. - espèces en péril - Biologiste régionale du rétablissement des espèces en péril |
| Allan Johnsrude | Province de la C.-B. | Ministère des Forêts et des Pâturages de la Colombie-Britannique - Agent d'intendance |
| David Urban | District régional | District régional de la vallée du Fraser |
| Denis Knopp | ONG de l'environnement | Federation of B.C. Naturalists |
| Jan Jonker | Industrie | Tamihi Logging Ltd. |
| Jim Vickerson | Municipalité | Ville de Chilliwack, Département du développement municipal |
| Laura Friis | Province de la C.-B. | Ministère de l'Environnement de la C.-B. |
| John Richardson | Université | Université de la Colombie-Britannique |
| Lucy Reiss | Gouvernement du Canada | Environnement Canada - SCF |
| Marie Goulden | Gouvernement du Canada | Ministère de la Défense nationale (Chilliwack) |
| Todd Ewing | Industrie | Cattermole Timber |
| Matt Wealick | Industrie | Ch-ihl-kway-uhk Forest Limited |
| Purnima Govindarajulu | Province de la C.-B. | Ministère de l'Environnement de la C.-B. |
| Arthur Robinson | Gouvernement du Canada | Service canadien des forêts |
| Observateurs/remplaçants/anciens membres | Affiliation | Organisation ou poste |
|---|---|---|
| Ross Vennesland | Province de la C.-B. | Ancien président; ministère de l'Environnement de la C.-B. - espèces en péril - Biologiste régional du rétablissement des espèces en péril |
| Marc Hayes | Gouvernement des É.-U. | Washington Fish and Wildlife |
| Kelly McAllister | Gouvernement des É.-U. | Washington Fish and Wildlife |
| Gene MacInnis | Province de la C.-B. | Ministère des Forêts et des Pâturages de la Colombie-Britannique - Gestionnaire des opérations |
| David Cunnington | Gouvernement du Canada | Environnement Canada - SCF |
| Meeri Durand | District régional | District régional de la vallée du Fraser |
| Robert Wolf | Municipalité | Ville de Chilliwack |
| Johnathon Stamp | Premières Nations | Nation Sto:lo |
| David Hutchings | ONG de l'environnement | Chilliwack Field Naturalists |
| Danielle Smith | Gouvernement du Canada | Ministère de la Défense nationale (Esquimalt) |
Équipe de rétablissement de la grande salamandre.
Le programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) a été élaboré par l'équipe de rétablissement de la grande salamandre à titre d'avis au gouvernement de la Colombie-Britannique.
Des populations de grandes salamandres sont présentes dans le district forestier de Chilliwack de la Colombie-Britannique. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique est responsable de l'élaboration du programme de rétablissement pour cette espèce en vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril au Canada.
Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada a aussi participé à l’élaboration du présent document, car il est responsable de cette espèce aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP), et il est représenté au sein de l’équipe de rétablissement.
La version originale (2004) du présent rapport a été préparée par Kristina Ovaska, Lennart Sopuck, Ross Vennesland et Christian Engelstoft, selon les conseils de Dennis Knopp et des membres de l'équipe de rétablissement de la grande salamandre. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique a depuis élaboré un nouvel ensemble de lignes directrices sur la mise en forme des programmes de rétablissement; l'équipe de rétablissement présente donc une version mise à jour du programme. Des révisions et des mises à jour ont été apportées par Kym Welstead avec l'aide de Lennart Sopuck et de Kristiina Ovaska. Jeff Brown, David Toews, Stephen Hureau, Marie-José Ribeyron et Todd Manning ont fourni des commentaires utiles sur une version antérieure du programme révisé.
De nombreuses personnes ont généreusement offert de l'information aux fins de la rédaction du présent rapport. Sylvia Letay, Barbara Johnston, Marta Donavan, Erin Prescott, John Richardson, Jim Vickerson, Christine Chapman, Marie Goulden, Arthur Robinson, Gene MacInnes et Todd Ewing ont fourni des données et/ou des renseignements sur l'utilisation des terres au sein de l'aire de répartition de la grande salamandre. Laura Friis, Mark Stone, Laura Matthias et Kevin Chernoff ont fourni des données spatiales, consulté la documentation et examiné et compilé le rapport. Kelly McAllister et Bill Leonard ont gracieusement fourni de l'information sur l'aire de répartition de l'espèce dans l'État de Washington. Hartwell Welsh a généreusement permis à l'équipe d'utiliser sa carte inédite de l'aire répartition mondiale de cette espèce, préparé aux fins de l'ouvrage A Field Guide to the Amphibians of Northwestern North America (Jones et Leonard [eds.], 2005).
La grande salamandre est une grande salamandre à l'apparence charismatique qui peut atteindre 30 cm de long. Cette salamandre marbrée de couleur brun doré est le seul membre de la famille des Dicamptodontidés qui est présent au Canada. L'aire de répartition de l'espèce s'étend de l'extrême sud-ouest de la Colombie-Britannique au nord-ouest de la Californie, en passant par l'ouest de l'État de Washington et de l'Oregon. Au Canada, la répartition de l'espèce se limite largement au bassin versant de la Chilliwack, en Colombie-Britannique. La présence de l'espèce est actuellement connue dans quelque 75 cours d'eau et affluents, dans 15 réseaux fluviaux. Compte tenu de la répartition canadienne limitée de l'espèce et des menaces qui pèsent sur son habitat à cause de la foresterie, de l'aménagement urbain, de la construction de routes et d'autres activités humaines, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué la situation de la grande salamandre à l'échelle du pays, faisant passer son statut de « préoccupante » à « menacée » en 2000. L'espèce figure sur la liste rouge provinciale en Colombie-Britannique, et est inscrite à titre d'espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral. En outre, le cadre de conservation de la Colombie-Britannique (British Columbia Conservation Framework) a attribué à la grande salamandre une priorité de conservation 1, soit la priorité la plus élevée aux termes du But 3 - Maintenir la diversité des espèces et des écosystèmes indigènes (Ministry of Environment, 2010a).
Les caractéristiques du cycle vital et de l'écologie de l'espèce qui contribuent à la vulnérabilité des populations et agissent sur leur potentiel de rétablissement comprennent : une capacité de dispersion limitée tant dans les milieux aquatiques que dans les milieux terrestres; un cycle vital complexe; un faible potentiel reproducteur; une étroite association avec les cours d'eau d'amont et les ruisseaux aux eaux limpides et fraîches.
La grande salamandre possède un cycle vital complexe, qui comprend une phase aquatique et une phase terrestre. Les besoins en matière d'habitat pour tous les stades vitaux doivent être comblés pour que les populations puissent persister. Les salamandres vivent habituellement dans de petits cours d'eau en cascade et dans les forêts humides et ombragées adjacentes. Les larves aquatiques passent plusieurs années dans les cours d'eau, où elles s'abritent sous des pierres dans de petites fosses d'eaux calmes et s'alimentent d'invertébrés aquatiques. Les adultes vivent dans des forêts humides et ombragées à proximité des cours d'eau et ont besoin soit d'une abondance de débris ligneux grossiers, soit d'autres types d'abris sur le parterre forestier. Dans certaines circonstances, les larves atteignent la maturité sans se métamorphoser et demeurent aquatiques de façon permanente; ce processus est appelé « néoténie ».
Le but du rétablissement est d'assurer l'existence d'une population interreliée, viable et autosuffisante de grandes salamandres (Dicamptodon tenebrosus) au sein de l'habitat sécurisé Note1 dans l'ensemble de l'aire de répartition connue Note2 de l'espèce au Canada, là où l'habitat existe toujours ou peut être remis en état (dans les 10 ans). Les objectifs à court terme (sur 5 ans) sont centrés sur le maintien des populations connues, la prévention de la fragmentation, la recherche de populations non identifiées et la restauration de populations historiques par la gestion et la protection des habitats de survie, de rétablissement et de dispersion dans les milieux aquatiques et terrestres.
Les stratégies ou les approches générales pour le rétablissement consistent en la protection, la gestion et l'intendance de l'habitat, la cartographie de l'habitat, l'inventaire des populations, la remise en état de l'habitat, le suivi des populations et de l'habitat, la clarification des menaces, la recherche, la sensibilisation et l'intendance. Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune proposition de désignation de l'habitat essentiel tel que défini aux termes de la LEP, la protection continue de l'habitat est urgente dans les sites occupés, car seulement 40 % des sites occupés sont conservés dans des parcs, des aires protégées, des bassins hydrographiques approvisionnant une collectivité et des aires d'habitat d'espèces sauvages (Wildlife Habitat Areas). À l'heure actuelle, 20 aires d'habitat d'espèces sauvages ont été approuvées et englobent quelque 38 km (longueur linéaire) d'habitat connu occupé au bord des cours d'eau dans le district forestier de Chilliwack (Ministry of Environment, 2010b; voir l'annexe 2). L'augmentation de la couverture des relevés est aussi urgente puisque moins de 20 % de l'habitat fluvial potentiel a été recensé à ce jour. L'habitat situé sur des terres privées peut être conservé par des mesures d'intendance, y compris la collaboration avec les administrations municipales et régionales afin d'atteindre les objectifs en matière d'habitat à l'échelle du paysage et à des échelles plus grandes. Un plan d'action a été ébauché et sera mis à jour après la publication du programme de rétablissement.
La grande salamandre est la plus grande salamandre en Colombie-Britannique; les adultes font de 15 à 30 cm de longueur, queue comprise. Les individus sont robustes et présentent une grande tête, un museau arrondi et des pattes trapues. Les adultes ont souvent une peau réticulée ou marbrée, de couleur havane clair ou or, intercalée de brun foncé ou de gris. Les formes complètement aquatiques (néoténiques) sont grises ou brun terne, et souvent exemptes de marbrures. L'absence de glandes parotoïdes ou « à poison » (une paire de protubérances bien visibles derrière la tête qui ont la capacité d'exsuder des toxines) et une plus grande taille différencient cette espèce de la salamandre foncée (Ambystoma gracile), avec laquelle elle pourrait être confondue. Les larves aquatiques sont brun foncé ou noires, sans marques distinctes. Elles ont des branchies externes courtes et velues ainsi qu'une courte nageoire caudale, et atteignent une longueur de 9 à 17 cm. Voir les guides de terrain (p. ex. Matsuda et al., 2006; Jones et al. [eds.], 2006) pour des photographies et des descriptions détaillées.
L'aire de répartition de la grande salamandre s'étend depuis l'extrême sud-ouest de la Colombie-Britannique jusqu'au nord-ouest de la Californie, en passant par l'ouest de l'État de Washington et de l'Oregon (figure 1). D'est en ouest, l'aire de répartition de l'espèce s'étend depuis l'est de la chaîne des Cascades jusqu'à la côte du Pacifique. Environ 1 % de l'aire de répartition géographique de l'espèce se trouve au Canada.
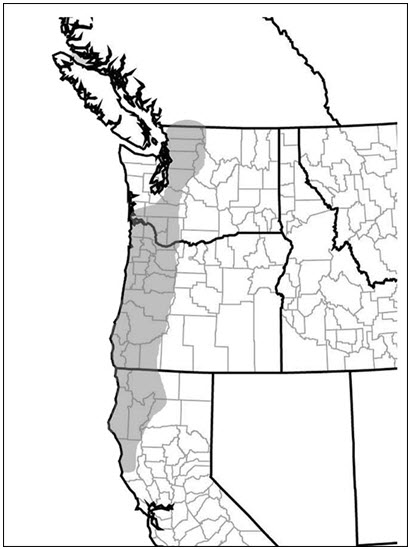
Description longue de la figure 1
La figure 1 est une carte illustrant l'aire de répartition de la grande salamandre, qui s'étend depuis l'extrême sud-ouest de la Colombie-Britannique jusque dans l'ouest de l'État de Washington, en Oregon et dans le nord-ouest de la Californie.
L'aire de répartition connue de la grande salamandre au Canada se limite au bassin versant de la Chilliwack et à des bassins de plus faible envergure situés à proximité, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique (COSEWIC, 2000; données du ministère de l'Environnement; figure 2). Des mentions sur la répartition ont été faites entre les pentes de l'est du lac Chilliwack et le côté ouest du mont Vedder, pour une superficie d'environ 850 km2 (COSEWIC, 2000). On sait que l'espèce occupe 15 réseaux fluviaux ou bassins de quatrième ordre (voir la définition à l'annexe 1). Des mentions ont été faites dans quelque 75 cours d'eau et affluents individuels, d'après les données dont on dispose jusqu'à 2003 (habitat fluvial estimé à 152 km [longueur linéaire]; ministère de l'Environnement, données inédites) Note3. La zone d'occurrence n'est pas connue avec certitude, car moins de 20 % des cours d'eau qui présentent un habitat potentiel ont fait l'objet de relevés. Il n'y a aucune mention confirmée de l'espèce au nord du fleuve Fraser. Par le passé, des individus étaient probablement présents dans d'autres réseaux fluviaux du bassin de la Chilliwack ainsi que dans la région de la prairie Sumas/Chilliwack. La probabilité de détection des larves varie aussi selon l'état des cours d'eau et le moment des relevés Note4. En outre, de nombreux cours d'eau n'ont fait l'objet que d'un seul relevé, et n'ont pas été échantillonnés en totalité. Par conséquent, certains des cours d'eau jugés inoccupés pourraient en fait abriter des salamandres.
La dispersion d'individus de l'espèce depuis les États-Unis est possible, mais peu probable. Dans le nord-ouest de l'État de Washington, la grande salamandre est présente dans les bassins versants des rivières Nooksack et Skagit (McAllister, 1995; Washington Herp Atlas, 2005). Les mentions de localité les plus rapprochées de la population de la vallée de la Chilliwack proviennent du bassin de la branche nord de la rivière Nooksack, quelque 10 km au sud de la frontière canadienne. Les cours d'eau occupés qui s'étendent depuis le Canada jusque dans l'État de Washington s'approchent à une distance de 1 à 2 km des cours d'eau d'amont des bassins versants de la Nooksack et de la Skagit, mais les cols alpins à haute altitude qui les séparent constituent probablement un obstacle aux déplacements. Les salamandres pourraient accéder à un affluent d'amont du ruisseau Tamihi, dans le bassin de la Nooksack, à condition qu'elles soient capables de traverser l'étroite digue boisée qui sépare les deux bassins. Les établissements humains et l'activité agricole dans la vallée du Columbia et le long de la rivière Sumas constituent vraisemblablement des obstacles à la dispersion des salamandres jusqu'au Canada dans l'ouest.
Il n'existe aucune mention de répartition provenant des tronçons d'amont de la Chilliwack ni de ses affluents immédiatement au sud de la frontière canadienne, mais cette région est très isolée et l'entendue des relevés, s'ils ont été réalisés, est inconnue. Une voie de dispersion possible au Canada pourrait se trouver le long de la vallée du cours supérieur de la Skagit dans l'État de Washington. Cette vallée a été inondée aux fins de l'aménagement hydroélectrique et forme aujourd'hui le réservoir du lac Ross, qui s'étend jusqu'au Canada. La mention de localité la plus proche le long de la vallée de la Skagit dans l'État de Washington est située à quelque 45 km au sud de la frontière canadienne. À l'heure actuelle, le barrage Ross, sur la Skagit, pourrait limiter le potentiel de dispersion de ces populations, qui se trouvent en aval du barrage. Il est toutefois possible que des salamandres se soient dispersées au Canada par le passé en empruntant la vallée de la Skagit. D'autres relevés à la recherche de salamandres pourraient s'avérer fructueux dans les bassins versants de la Skagit et de la Silverhope, particulièrement dans les zones adjacentes à la frontière avec les États-Unis.
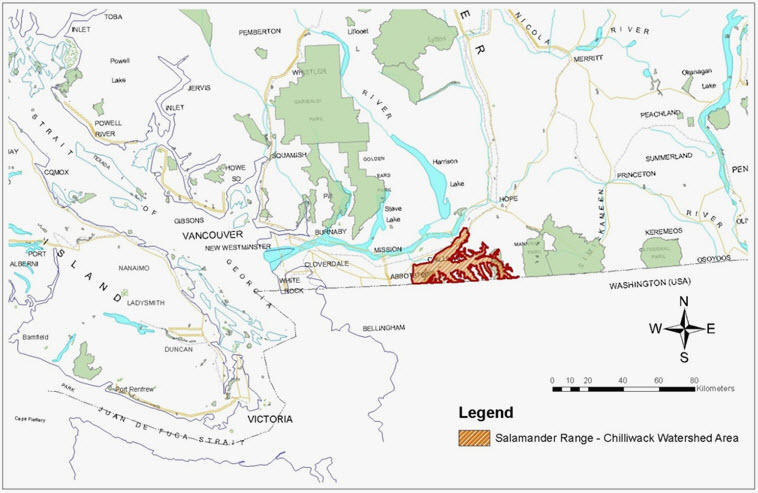
Description longue de la figure 2
La figure 2 est une carte illustrant l'aire de répartition de la grande salamandre dans le sud de la Colombie-Britannique. La zone ombrée englobe le côté ouest d'Abbotsford et la majeure partie de Chilliwack.
On ne dispose d'aucune information sur les tendances en matière de population. Une estimation grossière de la taille de la population dans le bassin versant de la Chilliwack a été fournie par le COSEPAC (COSEWIC, 2000) : environ 13 400 adultes terrestres et de 4 500 à 9 000 adultes néoténiques aquatiques; une marge d'erreur importante pourrait toutefois être associée à cette estimation Note5. On pense que les limites de la répartition globale de l'espèce au Canada auraient peu changé dans l'histoire récente, quoiqu'il soit possible que des cours d'eau actuellement inoccupés et présentant de l'habitat convenable aient pu être occupés par le passé (Haycock, 1991; COSEWIC, 2000). Il existe une exception : la perte possible d'une population locale dans la région de la prairie Sumas, causée par une modification considérable de l'habitat au début du 20e siècle, lorsque le lac Sumas a été drainé.
Au cours du siècle dernier, les activités humaines et les feux de friches ont considérablement modifié les milieux forestiers dans la majeure partie de l'aire de répartition canadienne de l'espèce. Les cartes du couvert forestier indiquent que, en date de 2000, quelque 75 % des forêts dans l'aire de répartition de la grande salamandre (< 1 200 m au-dessus du niveau de la mer [ASL]) avaient moins de 120 ans. La plupart des forêts anciennes restantes se trouvent à des altitudes plus élevées (> 1 000 m ASL) et, par conséquent, pourraient avoir une moins grande valeur pour les salamandres à cause des conditions plus rudes à de telles altitudes. L'exploitation forestière et l'aménagement urbain continuent de modifier les habitats dans la région aujourd'hui.
La grande salamandre est désignée « en péril » au Canada, mais on considère qu'elle est non en péril à l'échelle mondiale et aux États-Unis (voir le tableau 1 pour les cotes infranationales). L'espèce est inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Il s'agit aussi d'une espèce de priorité 1 aux termes du But 3 - Maintenir la diversité des espèces et des écosystèmes indigènes - du Cadre de conservation de la Colombie-Britannique (voir Species and Ecosystems at Risk pour les détails; Ministry of Environment, 2010a).
| C.-B. | Canada | É.-U. | Monde |
|---|---|---|---|
| S2 (en péril); liste rouge | N2 (en péril) | N5 (non en péril) Californie : SNR (non classée) Oregon : S4 (apparemment non en péril) Washington : S5 (non en péril) |
G5 (non en péril) |
Besoins biologiques et besoins en matière d'habitat
La grande salamandre a un cycle vital complexe, qui comprend une phase aquatique et une phase terrestre. Dans certaines conditions, les larves aquatiques atteignent la maturité sexuelle sans se métamorphoser (néoténie facultative). Les besoins en matière d'habitat de tous les stades vitaux de l'espèce doivent être comblés pour que les populations puissent persister.
Espèces associées dans l'habitat général
Au Canada, la grande salamandre est présente dans la zone biogéoclimatique côtière à pruche de l'Ouest. Bien que l'espèce se rencontre occasionnellement dans de grands plans d'eau et cours d'eau (lac Chilliwack et rivière Chilliwack), la plupart des observations ont été faites à proximité de cours d'eau d'amont et dans les milieux terrestres adjacents (COSEWIC, 2000). Les cours d'eau convenables sont petits, habituellement caractérisés par des fosses en cascades, et peuvent traverser une variété de types de forêts humides et de communautés végétales (Farr, 1989; Haycock, 1991). La plupart de ces cours d'eau sont catégorisés comme étant permanents, quoique des mentions de localité provenant du versant ouest du mont Vedder aient été faites dans des cours d'eau trop petits pour figurer sur les cartes. Certains de ces cours d'eau peuvent être partiellement souterrains ou temporaires selon les saisons.
En Colombie-Britannique, l'espèce est habituellement associée aux peuplements forestiers humides, et a été observée dans des peuplements comptant des douglas de Menzies (Pseudotsuga menziesii), des pruches de l'Ouest (Tsuga heterophylla) et des thuyas géants (Thuja plicata) (Haycock, 1991). Il semble que ces salamandres préfèrent les milieux humides, comme l'indique la présence fréquente du bois piquant (Oplopanax horridus) et de la ronce remarquable (Rubus spectabilis) dans la couche arbustive de leur habitat. Dans l'État de Washington, l'espèce a été trouvée dans des forêts dominées par la pruche de l'Ouest, le thuya géant et le sapin grandissime (Abies grandis), et elle est absente de forêts plus sèches, comme celles qui sont dominées par le pin ponderosa (Pinus ponderosa) (Haycock, 1991). Cependant, en Oregon, on sait que la grande salamandre est présente dans des forêts plus sèches où elle est associée aux sources et aux suintements (Farr, 1989).
En Colombie-Britannique, l'espèce semble être limitée aux altitudes inférieures à 1 200 m. La base de données du Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique contient une mention provenant d'une altitude de 1 700 m, mais l'exactitude de cette mention ne peut pas être confirmée. Dans la vallée de la Chilliwack, l'altitude moyenne de 22 sites occupés dans des cours d'eau d'amont est de 600 m (range : 140 à 1 150 m) Note6.
À l'échelle du paysage (comme le bassin versant d'un affluent), l'espèce semble avoir des exigences assez générales en matière d'habitat, et des études réalisées tant aux États-Unis (Corn et Bury, 1991; Welsh et Lind, 2002) qu'en Colombie-Britannique Note7 ont établi peu de corrélations avec les caractéristiques de l'habitat, mis à part une diminution du nombre de larves avec l'altitude. Une étude réalisée en Californie et en Oregon (Welsh et Lind, 2002) n'a révélé aucune corrélation importante dans l'habitat à l'échelle du paysage. À l'échelle du macroenvironnement (bras de cours d'eau), les caractéristiques de l'habitat présentaient un pouvoir de prédiction légèrement supérieur : l'abondance des salamandres variait négativement avec un sous-étage d'arbres feuillus et d'herbacées, ce qui indique un possible évitement des perturbations du sol et des clairières naturelles qui contiennent souvent ces types de végétation. À l'échelle du microenvironnement (caractéristiques de l'eau et du substrat dans une petite partie d'un bras de cours d'eau), les besoins en matière d'habitat de l'espèce sont plus précis, ce qui laisse croire à une influence prépondérante du microhabitat et des caractéristiques microclimatiques sur sa répartition. En Californie, on a établi une corrélation entre l'abondance des salamandres et un nombre accru de fosses et des substrats caillouteux ou pierreux (Welsh et Lind, 2002). Ces résultats s'accordent avec ceux d'études précédentes (examiné dans COSEWIC, 2000), et soulignent l'importance des cours d'eau étroits et ombragés au substrat grossier et rocheux qui présentent un grand nombre de petites fosses et de radiers . Il est toutefois à noter que les études susmentionnées concernent surtout les besoins des phases aquatiques de l'espèce, et moins ceux des phases terrestres.
Les adultes terrestres occupent les milieux riverains boisés situés à proximité des cours d'eau, et ont besoin d'une abondance d'abris (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). Les adultes néoténiques ont besoin d'eaux permanentes relativement profondes et sont souvent présents à des altitudes élevées; à des altitudes moins élevées, on les trouve dans de grands plans d'eau permanents (comme le lac Chilliwack et la rivière Chilliwack).
Besoins en matière d'habitat à différents stades vitaux
Les caractéristiques de l'habitat suivantes ont été jugées importantes pour les différentes phases du cycle vital de la grande salamandre dans la région de Chilliwack (Farr, 1989; Haycock, 1991; COSEWIC, 2000).
Stade reproducteur
En Colombie-Britannique, le développement des individus entre l'éclosion des œufs et la métamorphose peut prendre de 4 à 6 ans, par rapport à 2 ou 3 ans en Oregon (examiné dans COSEWIC, 2000). La grande salamandre est longévive (durée de vie de 20 ans et plus), et son potentiel de reproduction est faible. Ces salamandres établissent un « nid » où la parade nuptiale, l'accouplement et la ponte ont lieu, dans des espaces inondés sous des pierres, des rondins ou d'autres abris, soit dans le cours d'eau ou sur la ligne de rivage immédiate (COSEWIC, 2000; Ministry of Environment, 2004). Des œufs ont été trouvés du printemps à l'automne (Matsuda et al., 2006). La taille des couvées varie entre 85 et 200 œufs, qui sont incolores, très gros (quelque 6,5 mm de diamètre) et individuellement fixés à la partie supérieure du nid par une courte tige gélatineuse (COSEWIC, 2000). On pense que les femelles veillent sur les œufs en développement et les jeunes, et qu'elles peuvent rester avec eux dans le nid durant une période pouvant atteindre 200 jours (Nussbaum et al., 1983).
Larves aquatiques
Les caractéristiques de l'habitat suivantes sont jugées importantes :
- petits cours d'eau fraîche, claire et bien oxygénée à débit modéré ou élevé;
- cours d'eau permanents à chenal stable (non modifiés par l'affouillement au printemps ou par l'assèchement en été);
- présence de petites fosses dans les cours d'eau;
- substrat graveleux et caillouteux avec d'assez grands abris pour recouvrir l'animal.
L'abondance des larves tend à augmenter à mesure que la largeur de la surface mouillée Note8 diminue. La moyenne de largeur de la surface mouillée où des salamandres ont été trouvées était de 2,25 m (fourchette de 0,7 à 10 m). Les autres caractéristiques de l'habitat examinées à différentes échelles spatiales (cours d'eau, bras de cours d'eau et microhabitat) ont révélé peu de corrélations avec l'abondance des larves; la plupart des corrélations ont été établies à l'échelle du microhabitat Note9. L'étude susmentionnée a révélé une corrélation positive entre l'abondance des larves et le nombre de petites fosses, un faible débit d'eau et l'étendue du substrat rocheux. Les fosses caractérisées par la présence de sable et de grosses pierres angulaires (> 2 m de diamètre) offraient une complexité d'habitat et semblaient être préférées par l'espèce (Haycock, 1991). Farr (1989) a aussi insisté aussi l'importance des abris pour les larves et les autres phases de cette espèce en Colombie-Britannique. Plusieurs études réalisées aux États-Unis ont montré des corrélations semblables, et une expérience a démontré que l'abondance des larves augmentait avec la disponibilité des abris, formés de pierres de différentes tailles (Parker, 1991).
Phase terrestre
Les caractéristiques de l'habitat suivantes sont jugées importantes :
- milieu forestier humide et ombragé adjacent à des cours d'eau, comme des forêts anciennes et des forêts matures de seconde venue;
- disponibilité de refuges, comme des rondins en décomposition ou d'autres abris;
- sites de NIDIFICATION dans les cours d'eau ou directement adjacents.
Peu d'études se sont penchées sur les besoins en matière d'habitat des phases terrestres des salamandres. Dans les peuplements anciens dominés par le douglas de Menzies dans l'État de Washington et en Oregon, Corn et Bury (1991) ont constaté que les grandes salamandres étaient surtout communes dans les zones modérément humides. Dans la vallée de la Chilliwack et les régions adjacentes du nord-ouest de l'État de Washington, Johnston (1998) a constaté que les adultes terrestres occupaient habituellement des zones riveraines.
En Colombie-Britannique, Johnston (1998) a aussi constaté la présence de l'espèce dans des zones de coupe à blanc (< 10 ans) et dans des forêts plus anciennes; dans les zones de coupe à blanc, toutefois, les individus modifiaient leur comportement de manière à répondre à un stress d'humidité. Même si les phases terrestres n'ont pas nécessairement besoin de forêts anciennes, elles ont besoin de certaines caractéristiques de celles-ci, comme des arbres abattus en décomposition et d'autres débris ligneux grossiers, ainsi qu'un parterre forestier humide.
Farr (1989) et le COSEPAC (COSEWIC, 2000) ont avancé que les sites de nidification (la résidence) représentaient une caractéristique essentielle de l'habitat pour cette espèce. On pense que les femelles veillent sur les œufs en développement et sur les jeunes, et qu'elles peuvent rester avec eux dans le nid pendant une période pouvant atteindre 200 jours (Nussbaum et al., 1983). À ce jour, très peu de nids ont été trouvés dans l'aire de répartition de l'espèce. En Colombie-Britannique, Farr (1989) mentionnait la présence de très petites larves dans des petits ruisseaux alimentés par des sources sur le mont Vedder, et avançait que les petits ruisseaux stables au couvert abondant offraient un habitat de nidification important.
Il semble que les adultes terrestres utilisent le même type d'abris en hiver qu'au cours des autres saisons, et la disponibilité de l'habitat d'hivernage n'est pas considérée comme un facteur limitatif (COSEWIC, 2000). On dispose toutefois de peu d'information sur l'habitat d'hivernage.
Phase néoténique
Dans la région de Chilliwack, les adultes néoténiques se trouvent à des altitudes élevées (600 à 1 100 m) ainsi que dans de grands plans d'eau permanents à plus faible altitude (lac Chilliwack et rivière Chilliwack) (Haycock, 1991). La néoténie est probablement facultative chez cette espèce, quoique les deux phases (les adultes terrestres et aquatiques) semblent être spatialement isolées dans une certaine mesure. Comme les larves aquatiques, les adultes néoténiques ont besoin d'une abondance d'abris offerts par des pierres, des rochers ou d'autres types de substrats de fond grossiers. Ils ont aussi besoin d'eaux permanentes et relativement profondes. On ne dispose d'aucune information précise sur l'habitat de nidification des individus néoténiques.
Déplacements et dispersion
Les déplacements dans les zones riveraines ont été examinés dans la vallée de la Chilliwack et dans les régions adjacentes, dans le nord-ouest de l'État de Washington. Johnston (1998) et Johnston et Frid (2002) ont constaté que la plupart (moyenne de 67 %) des 18 adultes radiopistés dans des forêts anciennes et des forêts matures de seconde venue se trouvaient à moins de 5 m des berges d'un cours d'eau. De tous les emplacements relevés, 80 % se trouvaient à moins de 20 m, et 88 % se trouvaient à moins de 40 m des berges (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). La plus longue distance entre un adulte et les berges d'un cours d'eau était de 66 m. Par conséquent, une largeur minimale d'habitat de 50 m de chaque côté du cours d'eau engloberait la majeure partie des déplacements normaux des adultes le long de l'habitat riverain. L'étendue d'habitat terrestre dont les salamandres ont besoin varie vraisemblablement en fonction de la configuration et de la qualité de l'habitat. En outre, on ignore les détails sur les déplacements terrestres des différentes classes d'âge et des sexes chez cette espèce.
Bien que les adultes terrestres limitent habituellement leurs déplacements à de petites superficies, ils sont capables de parcourir de grandes distances si les conditions environnementales y sont favorables (p. ex. durant les périodes de pluies abondantes ou lorsque le sol est humide et la température est douce) (Johnston, 1998, 1999). Un habitat de dispersion doit être disponible pour que ces plus longs déplacements puissent avoir lieu, afin de permettre la dispersion des salamandres entre les cours d'eau et les bassins versants. La dispersion des individus entre les cours d'eau est importante pour le maintien de l'hétérogénéité génétique et de la viabilité de la population (COSEWIC, 2000). Plusieurs études réalisées en Oregon ont révélé la présence de la grande salamandre à une distance pouvant atteindre 400 m des berges d'un cours d'eau (examiné dans Olson et al., 2007). Les déplacements des subadultes n'ont pas été examinés, et il est possible que les individus de ce stade soient responsables de la majeure partie de la dispersion, comme c'est le cas pour bon nombre d'autres espèces (Horn, 1983; Duellman et Trueb, 1986, cité dans Ministry of Environment, 2004; Trenham et Shaffer, 2005).
Les salamandres semblent parfois utiliser des cours d'eau souterrains comme corridors de déplacement (D. Knopp, comm. pers., 2003). Ces cours d'eau pourraient favoriser la dispersion, mais on ne dispose que d'indices circonstanciels à cet égard. Les adultes terrestres sont surtout actifs la nuit et, durant les périodes sèches, leurs déplacements sont limités aux périodes de basses températures (Johnston, 1998).
Les larves de salamandres sont très sédentaires et tendent à demeurer dans les mêmes tronçons de cours d'eau, même d'une année à l'autre (Ferguson, 2000) Note10, où elles s'abritent sous des pierres ou dans d'autres refuges. Des expériences de transplantation ont révélé que les larves pouvaient vivre dans les cours d'eau inoccupés à proximité de leur habitat d'origine Note11. Des études de marquage-recapture des larves ont révélé que 73 % des larves demeuraient à moins de 10 m de leur lieu de capture initial durant plus de 3 ans, et que seuls 10 % des larves se déplaçaient sur une distance supérieure à 20 m sur une période de 2 ans (Ferguson, 1998). Cette constatation appuie la notion selon laquelle la majeure partie de la dispersion s'effectue en zone terrestre chez les adultes et les subadultes, et renforce l'importance d'un habitat de dispersion terrestre convenable pour assurer le flux génique.
L'habitat de dispersion terrestre important présente probablement l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- une altitude supérieure à 1 200 m;
- un réseau de zones riveraines;
- un bon couvert forestier, comme des forêts anciennes ou des forêts matures de seconde venue humides;
- des abris abondants sur le parterre forestier, comme des débris ligneux grossiers, y compris de gros rondins à un stade de décomposition avancé.
Rôle écologique
La grande salamandre joue un rôle important dans l'écosystème, dans les interactions prédateur-proie, à titre de prédateur de niveau trophique supérieur. L'espèce atteint la limite nord de son aire de répartition dans le sud de la Colombie-Britannique. Les populations situées à la périphérie de l'aire de répartition d'une espèce peuvent posséder des adaptations uniques et contribuer de manière importante à la diversité génétique (Scudder, 1989); l'effondrement de la répartition de nombreux vertébrés tend généralement à avoir lieu en direction de la périphérie de l'aire de répartition (Lomolino et Channell, 1995, 1998). Les populations périphériques peuvent accroître la capacité d'une espèce à réagir aux perturbations environnementales, dont les changements climatiques. La population de la Colombie-Britannique pourrait devenir de plus en plus importante pour la survie de l'espèce à l'avenir, si le changement climatique planétaire modifiait les milieux fluviaux frais actuellement occupés par l'espèce dans les régions du sud.
Facteurs limitatifs
Capacité de dispersion limitée
Les larves sont relativement sédentaires et limitent habituellement leurs déplacements à de petits tronçons de cours d'eau (Ferguson, 1998, 2000) Note10. La capacité de colonisation des larves est faible (Ferguson, 2000). Les adultes terrestres sont aussi relativement sédentaires, et semblent rarement se déplacer entre les cours d'eau (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). Toutefois, ils sont capables de parcourir de plus grandes distances dans les zones terrestres et possiblement de coloniser les milieux inoccupés lorsque les conditions sont humides et convenables. La capacité de dispersion limitée de l'espèce représente un obstacle au rétablissement dans les milieux perturbés et augmente la vulnérabilité de la population à la fragmentation de l'habitat, qui risque d'isoler les sous-populations.
Cycle vital complexe et besoins précis en matière d'habitat
Une juxtaposition convenable de milieux aquatiques et terrestres est nécessaire pour que les salamandres puissent accomplir leur cycle vital. Même si la résilience de l'espèce est accrue par la complexité de son cycle vital et par les options qui s'offrent à elle, comme la possibilité de se métamorphoser en forme terrestre ou de demeurer en milieu aquatique, les répercussions des activités humaines sur les différents stades vitaux peuvent être cumulatives et donner lieu à des interactions complexes. L'espèce dépend d'un ensemble précis de caractéristiques de l'habitat tant dans les cours d'eau que dans les milieux forestiers adjacents. Elle est étroitement associée aux cours d'eau d'amont limpides et frais, et la disponibilité de l'habitat de dispersion demeure très importante.
Faible potentiel de reproduction
La grande salamandre prend beaucoup de temps à atteindre la maturité, et les femelles se reproduisent peu fréquemment; on pense qu'elles ne se reproduisent qu'une fois aux deux ans (Nussbaum, 1976). Dans la vallée de la Chilliwack, le développement des individus entre l'éclosion des œufs et la métamorphose peut prendre jusqu'à 4 à 6 ans, par rapport à 2 ou 3 ans dans le centre de l'aire de répartition de l'espèce en Oregon (COSEWIC, 2000). Le faible potentiel de reproduction de l'espèce, combiné à sa capacité de dispersion limitée, peut contribuer aux faibles taux de rétablissement après une perturbation.
Vulnérabilité des populations périphériques
L'espèce existe à l'extrémité nord de son aire de répartition dans le sud de la Colombie-Britannique. La persistance des populations périphériques est précaire de par la nature de celles-ci, en raison du climat plus rude, des taux de survie et de l'abondance plus faibles et des fluctuations stochastiques de la taille de ces populations (Lawton, 1993).
Classification des menaces
Tableau 2. Tableau de classification des menaces pour la grande salamandre
Tableau 2.1 Activités forestières touchant l'habitat aquatique
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat (aquatique) |
| Menace générale | Récolte forestière, construction de routes, certaines pratiques sylvicoles |
| Menace spécifique | Envasement/érosion, élimination de la végétation riveraine, hausse de la température de l'eau, obstacles aux déplacements, abondance réduite des proies, dégradation des fosses d'eau, débits irréguliers |
| Facteurs de stress | Mortalité accrue des larves et des individus néoténiques; faible succès de reproduction |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Généralisée, Ensemble de l'aire de répartition |
| Occurrence | Historique et courante |
| Fréquence | Récurrente |
| Certitude causale | Élevée |
| Gravité | Élevée |
| Niveau de préoccupation | Élevé |
Tableau 2.2 Activités forestières touchant l'habitat terrestre
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat (terrestre) |
| Menace générale | Récolte forestière, construction de routes, certaines pratiques sylvicoles |
| Menace spécifique | Perturbation de l'habitat terrestre d'alimentation, d'hivernage et de dispersion; application d'herbicides; perte de couvert forestier et de couvert végétal (arbustes, débris ligneux grossiers); quantité réduite d'abris et d'habitat de nidification |
| Facteurs de stress | Changements du comportement et des déplacements; survie et dispersion réduites; stress d'humidité; réduction du flux génétique |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Généralisée, Ensemble de l'aire de répartition |
| Occurrence | Historique et courante |
| Fréquence | Récurrente |
| Certitude causale | Moyenne |
| Gravité | Élevée |
| Niveau de préoccupation | Élevé |
Tableau 2.3 Aménagement urbain et rural
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat |
| Menace générale | Transformation des terres, élimination de la végétation, altération des cours d'eau, pollution |
| Menace spécifique | Élimination de la végétation riveraine, altération du chenal des cours d'eau, obstacles aux déplacements, abondance réduite des proies, baisse de la qualité de l'eau |
| Facteurs de stress | Taille réduite de la population et disparitions à l'échelle locale (mêmes facteurs de stress que pour les activités forestières; voir ci-dessus) |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Locale et localisée |
| Occurrence | Historique et courante |
| Fréquence | Continue |
| Certitude causale | Élevée |
| Gravité | Élevée |
| Niveau de préoccupation | Élevé |
Tableau 2.4 Microproduction d'hydroélectricité
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat |
| Menace générale | Microproduction d'hydroélectricité |
| Menace spécifique | Altération du débit, hausse de la température de l'eau, élimination de la végétation riveraine, obstacles hors-sol aux déplacements des salamandres |
| Facteurs de stress | Productivité réduite, déplacements réduits, taille réduite de la population |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Locale et localisée |
| Occurrence | Imminente |
| Fréquence | Modérée |
| Certitude causale | Potentiellement élevée |
| Gravité | Inconnue, potentiellement élevée |
| Niveau de préoccupation | Élevé |
Tableau 2.5 Pollution
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Pollution |
| Menace générale | Toxicité, changements dans les interactions avec les communautés et les espèces, perturbation du système endocrinien |
| Menace spécifique | Application d'herbicides ou de pesticides, déversements accidentels dans les ruisseaux, présence de contaminants dans les eaux de ruissellement des zones résidentielles et industrielles |
| Facteurs de stress | Productivité et survie réduites |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Locale et localisée |
| Occurrence | Historique et courante |
| Fréquence | Inconnue |
| Certitude causale | Moyenne |
| Gravité | Inconnue |
| Niveau de préoccupation | Moyen |
Tableau 2.6 Changements climatiques
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Catastrophes climatiques et naturelles |
| Menace générale | Sécheresse estivale accrue; fréquence accrue des épisodes de temps violent |
| Menace spécifique | Débit réduit en été; hausse de la température de l'eau, parterre forestier sec; inondations périodiques et dommages causés aux cours d'eau; propagation et émergence des maladies |
| Facteurs de stress | Réduction de la survie et de la productivité |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Généralisée et ensemble de l'aire de répartition |
| Occurrence | Imminente |
| Fréquence | Continue |
| Certitude causale | Faible |
| Gravité | Modérée |
| Niveau de préoccupation | Moyen |
Tableau 2.7 Maladies
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Maladies |
| Menace générale | Propagation ou introduction de maladies épidémiques, comme la chytridiomycose; maladies ou parasites propagés par les poissons introduits ou les humains |
| Menace spécifique | Mortalité accrue |
| Facteurs de stress | Taille réduite de la population; disparitions à l'échelle locale |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Généralisée et ensemble de l'aire de répartition |
| Occurrence | Inconnue |
| Fréquence | Inconnue |
| Certitude causale | Moyenne |
| Gravité | Inconnue; potentiellement élevée |
| Niveau de préoccupation | Moyen |
Tableau 2.8 Poissons introduits
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Espèces exotiques ou envahissantes |
| Menace générale | Empoissonnement intentionnel des cours d'eau et plans d'eau; lâchers accidentels |
| Menace spécifique | Prédation, concurrence accrue pour les abris et les aliments |
| Facteurs de stress | Taille réduite de la population |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Locale et localisée |
| Occurrence | Historique et courante |
| Fréquence | Récurrente |
| Certitude causale | Moyenne |
| Gravité | Modérée |
| Niveau de préoccupation | Moyen |
Tableau 2.9 Activités récréatives
| Classification de la menace | Description de la classification de la menace |
|---|---|
| Catégorie de menace | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat |
| Menace générale | Activités récréatives intensives, comme l'utilisation de VTT ou de vélos de montagne dans les zones riveraines |
| Menace spécifique | Érosion, envasement, dommages causés à la végétation riveraine |
| Facteurs de stress | Changements comportementaux, survie réduite |
| Caractéristique de la menace | Description de la caractéristique de la menace |
|---|---|
| Étendue | Locale et localisée |
| Occurrence | Courante |
| Fréquence | Inconnue |
| Certitude causale | Inconnue |
| Gravité | Inconnue |
| Niveau de préoccupation | Faible |
Description des menaces
Activités forestières
Les pratiques de foresterie historiques et récentes ont modifié les milieux forestiers dans la majeure partie de l'aire de répartition canadienne de la grande salamandre. Les activités forestières sont encore très répandues, et il reste très peu de forêts, particulièrement dans les régions de basse altitude. Les activités de foresterie comprennent les coupes, la construction de routes forestières, la construction de dépôts de grumes et d'héliports ainsi que diverses activités/prescriptions sylvicoles qui ont le potentiel d'éliminer la végétation au sol ou de perturber le parterre forestier (couche de sol, débris ligneux grossiers, couvert herbacé/arbustif) et qui modifient la composition et les strates des forêts. Dans l'habitat aquatique, l'élimination du couvert forestier a pour effet de hausser la température de l'eau, et les coupes et la construction de routes peuvent donner lieu à de l'envasement, qui comble les fissures et les crevasses et réduit ainsi la quantité des abris nécessaires aux larves de la grande salamandre (Bury et Corn, 1988). Les pratiques d'exploitation forestières peuvent aussi réduire la persistance des petits cours d'eau, particulièrement durant les années de sécheresse, ce qui donne lieu à une perte d'habitat, à l'isolement des sous-populations et, possiblement, à la mortalité directe des individus (Cannings et al., 1999; COSEWIC, 2000). Dans l'habitat terrestre, l'élimination du couvert forestier entraîne des changements du microclimat au niveau du sol, soit sur le plan des régimes de température et d'humidité. Les coupes modifient aussi la structure du tapis forestier (changements du couvert végétal et de la quantité et de la répartition des débris ligneux grossiers), limitant ainsi possiblement la disponibilité et le type d'abris pour les salamandres terrestres. En outre, les coupes à blanc limitent les déplacements et la dispersion des phases terrestres de la grande salamandre (Johnston, 1999; Johnston et Frid, 2002). Ces contraintes ont la capacité d'isoler les populations et, donc, de réduire les taux de survie et la variabilité génétique.
Depuis l'adoption de la Forest Practices Code of British Columbia Act en 1995 et de la Forest and Range Practices Act (FRPA) en 2003, des normes communes s'appliquent aux pratiques de foresterie dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. La réglementation concernant la construction de routes, plus particulièrement, a été bénéfique pour l'habitat de la grande salamandre en réduisant l'envasement des cours d'eau découlant de l'érosion. Cependant, la FRPA n'exige pas l'établissement de zones tampons autour des petits cours d'eau d'amont exempts de poissons, sauf si un autre mécanisme l'exige, par exemple une aire d'habitat d'espèces sauvages. Des plans de restauration des bassins versants ont été adoptés dans certaines zones de la vallée de la Chilliwack en vue de remettre en état des habitats dégradés dans le passé par l'exploitation forestière.
Des études réalisées dans le réseau hydrographique de la Chilliwack depuis 1994 ont révélé que les effets de l'exploitation forestière sur la grande salamandre sont complexes et souvent subtils (Richardson et Neill, 1998; Johnston, 1999; Johnston et Frid, 2002) Note8 . Par exemple, la densité et la taille corporelle des larves diffèrent dans les bras de cours d'eau qui sont adjacents à des zones de coupe à blanc par rapport à ce que l'on observe dans les cours d'eau adjacents à des peuplements anciens, possiblement en raison de changements dans les taux de croissance, d'immigration et/ou de survie (Richardson et Neill, 1998) Note12. Dans les milieux terrestres, les adultes présents dans les zones de coupe à blanc modifient leurs régimes de déplacement en fonction des facteurs de stress liés à l'humidité et à la température par rapport à leur comportement dans la forêt adjacente (Johnston, 1999; Johnston et Frid, 2002). Les effets de tels changements sur la taille et la dynamique des populations sont inconnus et difficiles à examiner.
Aménagement urbain et rural
L'aménagement urbain, industriel et agricole dans le bassin de la Chilliwack et dans les bassins adjacents continue de réduire la quantité d'habitats aquatiques et terrestres. L'élimination du couvert forestier et/ou les changements des régimes de drainage dans les zones aménagées et aux alentours peuvent mener à une perte, à une fragmentation et à une forte dégradation de l'habitat. À l'heure actuelle, les effets des nouveaux aménagements sont locaux et limités aux secteurs de zonage résidentiel, commercial ou agricole, qui représentent quelque 9 % de l'aire de répartition de l'espèce. Toutefois, l'aménagement a lieu dans des régions productives de faible altitude, ce qui mène à la perte et à la dégradation d'un habitat de qualité pour les salamandres.
Microproduction d'hydroélectricité
Les installations de microproduction d'hydroélectricité le long d'un cours d'eau comprennent habituellement une structure de prélèvement d'eau (petits barrages, prises d'eau ou centrales « au fil de l'eau »), une conduite forcée/des structures de conduite d'eau, une petite centrale et des turbines, une route d'accès et un corridor de transport d'électricité. De telles installations pourraient réduire ou autrement modifier les débits d'eau, hausser la température de l'eau, entraîner l'élimination de la végétation riveraine et créer des obstacles hors sol aux déplacements des salamandres. En date de 2009, on compte 17 demandes documentées de permis de microproduction d'hydroélectricité dans l'aire de répartition connue de la grande salamandre (British Columbia Ministry of Environment, 2009), quoiqu'il soit possible que certaines installations ne soient plus actives.
Pollution
Les principales sources de pollution sont les contaminants dans les eaux de ruissellement provenant des zones d'aménagement résidentiel et industriel et l'application de pesticides dans les terres forestières. Les déversements accidentels de matières dangereuses comme des carburants ou des lubrifiants peuvent aussi contaminer les cours d'eau. D'après la réglementation en matière de permis pour la vallée de la Chilliwack, aucun herbicide ne peut être appliqué à moins de 10 m des grands cours d'eau, et la pulvérisation ne peut avoir lieu dans les petits cours d'eau que lorsque ceux-ci sont asséchés, ce qui réduit les répercussions potentielles sur les salamandres et les autres espèces qui utilisent les milieux aquatiques. Il a été démontré que les herbicides comme la formulation de glyphosate Roundup réduisent le taux de survie des larves d'amphibiens lorsque l'herbicide pénètre dans la colonne d'eau (Relyea, 2005). En outre, les interactions synergiques entre les pesticides et les facteurs de stress amplifient les effets chez certaines espèces d'amphibiens (Relyea, 2005).
Changements climatiques
On prévoit que les changements climatiques entraîneront une hausse de l'incidence des sécheresses estivales et des épisodes de temps violent, comme les inondations en hiver (Gates, 1993; IPCC, 2001; Ministry of Environment, 2007). Une aridité accrue peut agir sur la persistance des cours d'eau et sur la disponibilité d'abris humides dans les milieux terrestres, tandis que l'augmentation des inondations causée par les tempêtes violentes peut altérer la structure de l'habitat dans les cours d'eau. En outre, les répercussions des changements climatiques pourraient être exacerbées dans les paysages fragmentés par l'exploitation forestière et d'autres activités humaines. Par exemple, les effets de l'allongement des sécheresses estivales pourraient être particulièrement graves dans les paysages touchés par des coupes, ce qui réduirait davantage le nombre de refuges humides convenables pour les salamandres sur le parterre forestier. De même, l'assèchement des petits cours d'eau pourrait s'intensifier dans les zones où le couvert forestier est réduit, ce qui entraînerait une baisse de qualité et de quantité de l'habitat aquatique.
Maladies
Les routes forestières et les sentiers récréatifs, qui facilitent l'accès aux populations humaines, pourraient entraîner la propagation de maladies infectieuses introduites par les humains au sein de la population de salamandres. Par exemple, les pêcheurs sportifs pourraient propager des organismes pathogènes entre différents cours d'eau, par l'entremise de leur matériel. Un champignon pathogène du groupe des chytrides (Batrachochytrium dendrobatidis), qui contribue au déclin des amphibiens dans l'ouest des États-Unis et à l'échelle de la planète (Daszak et al., 1999), est particulièrement préoccupant. Parmi les autres pathogènes qui sont associés aux maladies épidémiques chez les amphibiens, on compte la moisissure d'eau Saprolegnia ferax, qui peut se transmettre des poissons aux amphibiens, et divers iridovirus (Daszak et al., 1999). La mortalité associée à l'infection au champignon chytride a été signalée chez la salamandre Dicamptodon aterrimus (USGS, 2001). À l'heure actuelle, rien n'indique que les éclosions de maladies représentent un problème pour les populations de grandes salamandres. Cependant, à la lumière du rôle que joue la chytridiomycose dans le déclin précipité des populations d'amphibiens à l'échelle de la planète, cette menace ne doit pas être prise à la légère.
Poissons introduits
Les grandes salamandres, particulièrement les jeunes de l'année, sont vulnérables à la prédation par les salmonidés (Rundio et Olson, 2003). On estime que l'utilisation de petits cours d'eau d'amont comme lieux de reproduction et de croissance découlerait, du moins en partie, d'une adaptation visant à éviter la prédation (COSEWIC, 2000). La présence de poissons peut aussi accroître la concurrence pour les ressources alimentaires dans les cours d'eau. L'introduction de poissons de pêche sportive dans le bassin versant de la Chilliwack pourrait représenter une menace importante pour l'espèce (Orchard, 1984). On ignore toutefois l'étendue de l'introduction et de la propagation des poissons dans les cours d'eau d'amont et les différents plans d'eau dans le bassin.
Activités récréatives
Les milieux riverains et fluviaux peuvent être endommagés par l'utilisation de véhicules tout terrain et de vélos de montagne ou par toute autre activité récréative intensive qui entraîne de l'érosion, de l'envasement et des dommages à la végétation riveraine. De telles activités intensives sont toutefois localisées, et les répercussions sur les salamandres sont actuellement mineures. Il est possible que la propagation de maladies représente une plus grande menace (voir Maladies, ci-devant).
- Recherche : écologie des larves et interactions avec l'exploitation forestière (Ferguson, 1998, 2000; Richardson et Neill, 1998) Note13, Note14.
- Recherche : déplacements des adultes terrestres et interactions avec l'exploitation forestière (Johnston, 1998, 1999; Johnston et Frid, 2002).
- Inventaires :
- Université de la Colombie-Britannique (1994-2000)
- Terres du ministère de la Défense nationale (Knopp et Larkin, 1995)
- B.C. Conservation Corps (2006, terres privées du côté ouest du mont Vedder et flancs de colline à l'est)
- Modélisation de l'habitat : analyses effectuées pour une version antérieure du présent document en 2004 Note15.
- En 2007, 20 aires d'habitat d'espèces sauvages ont été approuvées et totalisent quelque 38 km (longueur linéaire) d'habitat fluvial occupé dans le district forestier de Chilliwack (Ministry of Environment, 2010b; voir l'annexe 2 pour les détails).
- Répartition de l'espèce dans son aire de répartition connue, y compris dans les cours d'eau non examinés et ceux qui n'ont été visités qu'une seule fois, et persistance de l'espèce dans les cours d'eau associés à des mentions historiques seulement; présence possible de l'espèce dans d'autres bassins adjacents contenant de l'habitat convenable.
- Dynamique de la population, particulièrement à l'échelle du paysage.
- Reproduction et cycle vital, y compris les taux de croissance des larves, la période de la phase larvaire et les taux de survie propres à chaque groupe d'âge dans les habitats aquatiques et terrestres.
- Caractéristiques et disponibilité des sites de nidification.
- Caractéristiques de l'habitat de dispersion et déplacements des salamandres.
- Efficacité des zones tampons linéaires dans les zones riveraines qui sont prescrites dans les aires d'habitat d'espèces sauvages pour protéger les populations de salamandres.
- Clarifications des menaces provenant de toutes les sources.
D'après les réponses aux critères définis dans l'ébauche de la politique d'Environnement Canada (2005) sur le caractère réalisable du rétablissement, l'équipe de rétablissement a déterminé que le rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) est réalisable du point de vue technique et biologique en Colombie-Britannique.
1. Des individus capables de se reproduire sont disponibles maintenant pour augmenter le taux de croissance ou l'abondance de la population. Oui.
- La population dans le bassin de la Chilliwack a été estimée à quelque 13 400 adultes terrestres et à quelque 4 500 à 9 000 adultes néoténiques aquatiques (COSEWIC, 2000).
- Il y a des preuves de reproduction réussie dans l'aire de répartition de l'espèce.
2. De l'habitat convenable suffisant est disponible pour soutenir l'espèce, ou pourrait être rendu disponible par des activités de gestion ou de remise en état de l'habitat. Oui.
- On sait que la grande salamandre est présente dans quelque 75 cours d'eau et affluents dans 15 réseaux fluviaux, dans une superficie d'environ 850 km2.
- Il est possible de recruter de l'habitat après la récolte.
3. Les menaces importantes pesant sur l'espèce ou son habitat peuvent être évitées ou atténuées par des mesures de rétablissement. Oui.
- La protection de l'habitat sur les terres de la Couronne provinciale peut être mise en œuvre en partie au moyen d'aires d'habitat d'espèces sauvages établies en vertu de la Forests and Range Practices Act et de la Wildlife Act .
- La perte, la dégradation et la fragmentation de l'habitat peuvent être partiellement atténuées par divers mécanismes, notamment par la planification à l'échelle du paysage, la réduction de l'exploitation forestière, la prolongation des périodes de rotation et la reforestation.
- La gestion appropriée de l'habitat sur les terres privées peut être facilitée par des mesures d'intendance, une bonne communication et une planification soignée.
4. Les techniques de rétablissement nécessaires existent, et leur efficacité a été démontrée. Oui.
- L'habitat actuellement disponible continue de soutenir des populations dans plusieurs zones principales du bassin de la Chilliwack.
- On sait que la grande salamandre occupe 75 cours d'eau (précédemment estimés à 152 km [longueur linéaire] d'habitat fluvial dans le district forestier de Chilliwack). À ce jour, quelque 38 km ou 25 % (d'après la distance de 152 km susmentionnée) des cours d'eau occupés sont gérés dans 20 aires d'habitat d'espèces sauvages approuvées, et quelque 15 % sont situés dans des parcs, des aires protégées et des bassins hydrographiques approvisionnant une collectivité.
L'équipe de rétablissement est d'avis que le rétablissement peut être réalisé en une période relativement courte grâce à des mesures de protection et de remise en état de l'habitat. L'espèce est capable de tolérer un certain degré de perturbation résultant de l'activité humaine, mais on ignore l'ampleur de la modification de l'habitat que la population peut encore supporter. Dans le cas où la réintroduction de l'espèce serait jugée nécessaire à l'avenir, la translocation d'individus dans des cours d'eau actuellement inoccupés qui contiennent de l'habitat convenable serait réalisable Note16.
Le but global à court terme (à atteindre d'ici 10 ans) du rétablissement pour la grande salamandre est le suivant :
Assurer l'existence d'une population interreliée, viable et autosuffisante de grandes salamandres (Dicamptodon tenebrosus) au sein de l'habitat sécurisé Note1 dans l'ensemble de l'aire de répartition connue Note2 de l'espèce au Canada, là où l'habitat existe toujours ou peut être remis en état.
Ce but à long terme peut être atteint par la protection efficace des populations connues, la conservation et la restauration de la connectivité de l'habitat, et l'amélioration des connaissances sur les besoins en matière d'habitat et les occurrences de l'espèce.
Par conséquent, les buts à court terme sont les suivants :
- veiller à ce que la population actuelle de grandes salamandres en Colombie-Britannique soit maintenue, sans nouvelle perte de populations locales Note17 (à atteindre d'ici 5 ans);
- veiller à ce que des régimes de dynamique naturelle de la population et de dispersion puissent être maintenus ou rétablis dans l'aire de répartition connue de l'espèce (à atteindre d'ici 5 ans).
Il pourrait être possible de faire passer le statut de l'espèce selon le COSEPAC de « menacée » à « préoccupante » si les menaces qui pèsent sur l'habitat sont réduites.
Le but du rétablissement est fondé sur l'hypothèse voulant qu'il existe suffisamment d'habitat pour maintenir une population viable dans l'aire de répartition géographique actuelle de l'espèce en Colombie-Britannique. Deux sources d'information soutiennent cette hypothèse : on pense que la répartition globale de l'espèce a peu changé dans l'histoire récente; des populations locales en apparence viables persistent toujours dans différentes parties de l'aire de répartition. Il n'est pas possible d'établir des cibles quantitatives, en raison des incertitudes entourant l'estimation du nombre de sous-populations reliées et de la taille de chaque sous-population requise pour établir une population viable à long terme aux fins de la persistance de l'espèce.
Les critères utilisés par le COSEPAC pour désigner la grande salamandre comme espèce menacée comprennent :
- une petite aire de répartition géographique (zone d'occurrence);
- une petite zone d'occupation combinée à un déclin continu de l'étendue et/ou de la qualité de l'habitat;
- une zone d'occupation ou un nombre de localités très limité, ce qui augmente la vulnérabilité de la population aux activités humaines ou aux événements stochastiques.
Les activités de rétablissement n'auront pas pour effet d'améliorer la petite aire de répartition géographique, mais l'atténuation des menaces dans les sites occupés peut alléger le déclin de l'étendue et de la qualité de l'habitat en plus de réduire la vulnérabilité des populations, permettant possiblement d'inscrire l'espèce dans une catégorie de moindre risque. En outre, l'inventaire des secteurs non examinés dans l'aire de répartition de l'espèce (seulement quelque 20 % de l'habitat convenable potentiel a été examiné) pourrait donner lieu à des augmentations de la zone d'occupation connue.
Les objectifs de rétablissement sont centrés sur les buts à court terme du rétablissement, mais visent finalement à atteindre le but à long terme.
Les objectifs de rétablissement sont les suivants :
Objectif 1 : Protéger toutes les populations locales connues, y compris leurs habitats terrestres et aquatiques, d'ici deux ans.
Objectif 2 : Établir ou maintenir des réseaux d'habitat de dispersion en terrain élevé ou riverain dans les bassins versants occupés et entre ceux-ci dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce en vue de réduire la fragmentation d'ici dix ans.
Objectif 3 : Prévenir la perte accidentelle de populations encore inconnues en précisant les renseignements sur la répartition de l'espèce et en veillant à ce que les données sur l'occurrence et l'habitat soient facilement accessibles d'ici cinq ans.
Objectif 4 : Améliorer la compréhension des besoins en matière d'habitat, du cycle vital, de la dynamique des populations et de l'utilisation de l'habitat de l'espèce, et clarifier quelles sont les menaces qui pèsent sur ces populations, de manière à ce que des mesures de conservation appropriées puissent être prises et que des cibles en matière de population et d'habitat puissent être quantifiées d'ici cinq ans.
Objectif 5 : Obtenir la participation active des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des terres dans le cadre d'activités d'intendance d'ici deux ans.
Tableau de planification du rétablissement
Voici l'approche générale recommandée pour le rétablissement de cette espèce : protection, gestion et intendance de l'habitat; cartographie de l'habitat; inventaire des populations; remise en état de l'habitat; suivi des populations et de l'habitat; clarification des menaces; recherche sur le cycle vital, la dynamique des populations et l'utilisation de l'habitat; sensibilisation et communication (tableau 3). La protection des habitats terrestres et aquatiques occupés et le maintien ou l'amélioration de la connectivité de l'habitat entre les cours d'eau et les réseaux fluviaux sont au sommet des priorités. Les autres stratégies présentées au tableau 3 visent à soutenir la protection de l'habitat en comblant les lacunes dans les données, en fournissant l'information nécessaire à la gestion, en communiquant cette information aux intervenants et en établissant une collaboration et une coordination avec les initiatives de conservation ciblant d'autres espèces.
| Priorité | Obj. no | Menaces visées | Stratégie générale visant à atténuer les menaces | Approche recommandée pour l'atteinte des objectifs du rétablissement |
|---|---|---|---|---|
| Urgente | 1, 2, 5 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat; activités forestières; construction de routes; pollution | Protection, gestion et intendance de l'habitat |
|
| Urgente | 1, 2, 5 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat; aménagement urbain et rural; microproduction d'hydro-électricité; activités récréatives; pollution | Protection, gestion et intendance de l'habitat |
|
| Urgente | 1, 2, 3 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat | Cartographie de l'habitat |
|
| Urgente | 3 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat | Inventaire |
|
| Urgente (i) Élevée (ii-iv) | 1, 2 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat | Remise en état de l'habitat |
|
| Urgente | 4 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat; activités forestières; aménagement urbain et rural; poissons introduits; pollution; activités récréatives; maladies; changements climatiques | Suivi des populations et de l'habitat |
|
| Élevée | 4 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat; toutes les menaces | Clarification des menaces |
|
| Élevée | 4 | Perte et dégradation de l'habitat | Recherche (utilisation de l'habitat) |
|
| Moyenne | 4 | S.O. | Recherche (biologie des populations) |
|
| Urgente | 1, 2, 5 | Perte, dégradation et fragmentation de l'habitat; poissons introduits; pollution; activités récréatives; maladies | Sensibilisation et intendance |
|
| Moyenne | 4 | Changements climatiques | Suivi | Dans le cadre d'un programme de suivi à long terme, évaluer les changements de l'utilisation de l'habitat et de la répartition causés par les effets de la fréquence accrue des sécheresses, des phénomènes météorologiques tels que les inondations, de la hausse de la température de l'eau et des changements de la composition des forêts. |
a Lemieux, 2005.
Description du tableau de planification du rétablissement
Protection, gestion et intendance de l'habitat
Les stratégies visant à protéger les habitats aquatiques et terrestres occupés sont jugées urgentes. La protection de l'habitat doit d'abord être centrée sur les cours d'eau et l'habitat terrestre connexe dans les forêts anciennes (> 100 ans) productives, car la superficie restante de forêt mature et ancienne continue de diminuer. Toutefois, comme la majeure partie de l'habitat de capacité élevée de cette espèce se situe dans des forêts de basse altitude qui ont fait l'objet de coupe ou qui ont été modifiées dans le passé, il faut aussi se concentrer sur la protection de l'habitat de qualité occupé dans les forêts plus jeunes et en maturation dans des secteurs stratégiques, particulièrement dans les régions où l'on trouve des regroupements de mentions de l'espèce. L'établissement de zones tampons boisées assez larges et de grandes zones de réserve représente un outil important dans le maintien des populations de grandes salamandres dans les forêts aménagées (voir l'examen à l'annexe 3). Des zones tampons bien conçues aident à maintenir la qualité des milieux terrestres et fluviaux et à réduire les effets de bordure. Les grandes zones de réserve visent principalement à accroître la connectivité de l'habitat et à fournir de l'habitat de dispersion terrestre pour les salamandres au sein des bassins versants et entre ceux-ci.
La mise en place de voies de dispersion terrestres mérite d'être prise en compte dans le contexte de la protection et de la gestion de l'habitat des salamandres. Dans les secteurs où l'on trouve des regroupements de cours d'eau contenant des mentions de répartition et de l'habitat convenable de qualité additionnel, la protection ou la gestion de l'ensemble du sous-réseau fluvial et de la forêt connexe est souhaitable, particulièrement dans les zones où il reste des parcelles de forêts plus anciennes. La mise en place de voies de dispersion terrestre dans au moins 50 % des sous-bassins occupés (bassins versants de quatrième ordre conformément à l'annexe 1) est recommandée par l'intermédiaire de la gestion de l'exploitation forestière et d'autres activités humaines. Cependant, là où il est possible de le faire, d'autres options visant à obtenir une connectivité semblable à une plus grande échelle entre les bassins versants doivent aussi être explorées, en intégrant les zones protégées existantes dans le réseau dans la mesure du possible. Olson et al. (2007) ont fourni un examen complet de diverses configurations spatiales de réserves pour les amphibiens dans les forêts d'amont du Pacifique Nord-Ouest des États-Unis. Ces options s'appliquent aussi à la gestion de l'habitat de dispersion de la grande salamandre en Colombie-Britannique.
Cartographie de l'habitat
Un modèle de l'habitat initial a été préparé pour l'espèce Note18. Le programme de rétablissement exige la précision et l'extension de ce modèle, notamment par la collecte de nouvelles données de terrain sur les caractéristiques de l'habitat et l'abondance relative des salamandres dans les sites occupés. Le modèle est utile pour la priorisation des activités de relevé, et contribue à la délimitation de l'habitat essentiel.
La production d'une carte SIG est nécessaire pour favoriser la coordination avec d'autres initiatives de conservation; cette carte doit montrer les occurrences d'aires protégées, de zones de gestion spéciales, de projets de remise en état des zones de pêche et d'autres espèces en péril dont l'aire de répartition chevauche celle de la grande salamandre. La carte aidera à définir les possibilités de connecter les habitats, de regrouper les petites aires protégées en unités plus grandes et de veiller à ce que le caractère convenable de l'habitat pour la grande salamandre soit maintenu dans les aires gérées en fonction d'autres espèces.
Inventaires des populations
Moins de 20 % des cours d'eau potentiellement convenables dans l'aire de répartition canadienne de l'espèce ont fait l'objet d'un relevé, et on juge que la réalisation d'inventaires est urgente. Des données exactes sur la répartition de l'espèce sont nécessaires pour protéger l'habitat occupé, préciser le modèle d'habitat existant Note12 et décrire l'habitat essentiel. On s'attend à ce que la majeure partie des activités d'inventaire puisse être effectuée dans le cadre des relevés de vérification sur place aux fins du modèle d'habitat.
Remise en état de l'habitat
Les habitats terrestres et aquatiques peuvent souvent être remis en état de manière à accroître leur caractère convenable pour les salamandres. Il importe de bien cerner et de saisir les occasions de remise en état de l'habitat à mesure qu'elles se présentent. Même si les résultats de certaines mesures, comme l'amélioration de la connectivité de l'habitat entre les cours d'eau et dans les paysages touchés par l'exploitation forestière, peuvent prendre des années à obtenir, d'autres mesures peuvent être mises en œuvre rapidement et relativement facilement une fois qu'un problème a été cerné. Par exemple, il est possible de remplacer ou d'ajuster les ponceaux de façon à les rendre accessibles aux salamandres ou d'enlever les digues rocheuses accidentées le long des routes qui croisent des cours d'eau pour faciliter les déplacements des salamandres.
Suivi des populations et de l'habitat
On dispose de très peu d'information quantitative sur les réactions de la grande salamandre aux diverses largeurs des zones tampons s'étendant de chaque côté d'un cours d'eau et aux diverses tailles et configurations des aires de réserve (voir l'annexe 3). D'après les lignes directrices de la stratégie de gestion des espèces sauvages désignées (Identified Wildlife Management Strategy, ou IWMS), la longueur linéaire d'une aire d'habitat d'espèces sauvages (WHA) pour cette espèce consiste en une zone protégée principale de 30 m de largeur et d'une zone de gestion supplémentaire de 20 m de largeur, des deux côtés du bras de cours d'eau. Il est essentiel d'effectuer un suivi de l'efficacité pour valider ces largeurs de zones tampons et les ajuster au besoin. On recommande d'effectuer des études avant-après ciblant des zones tampons de largeurs différentes ainsi que des comparaisons entre les zones tampons et des sites de référence non touchés par l'exploitation forestière.
L'habitat nécessaire à la dispersion des salamandres et au maintien de la structure de la métapopulation à l'échelle du paysage est difficile à examiner directement, mais peut l'être indirectement grâce à une approche génétique. Par conséquent, il importe d'étendre les études génétiques entreprises par Curtis et Taylor (2004) sur la grande salamandre afin d'examiner la dynamique de la métapopulation dans les paysages présentant différents degrés de connectivité. De telles analyses peuvent être utilisées pour évaluer le caractère adéquat des différentes configurations d'habitat de dispersion dans le paysage.
Des sites de suivi à long terme doivent être établis au cœur et en périphérie de l'aire de répartition de l'espèce pour évaluer les répercussions des changements climatiques. Parmi les effets des changements climatiques, on compte la modification du débit des cours d'eau, une fréquence accrue des sécheresses ou des inondations, et les changements de température. De plus, sur plusieurs décennies, il pourrait se produire des changements de la composition des forêts qui risquent d'agir indirectement sur la qualité de l'habitat des salamandres.
Clarification des menaces
Les stratégies de clarification des menaces comprennent l'évaluation des menaces dans chaque site durant les relevés ainsi que le suivi de certains indicateurs d'habitat dans les sites protégés, comme les aires d'habitat d'espèces sauvages, et dans les régions touchées par les activités forestières, la microproduction d'hydroélectricité ou d'autres formes d'utilisation des ressources. Le suivi des indicateurs d'habitat vise à dégager les tendances dans la qualité de l'habitat des salamandres au fil du temps dans les régions touchées par différents types et différentes intensités d'utilisation des ressources. Les poissons de pêche sportive introduits sont considérés comme une menace pour les salamandres, mais leur répartition dans le bassin du cours supérieur de la Chilliwack est en grande partie inconnue. Il importe de documenter la répartition de ces poissons et d'évaluer s'ils sont introduits dans l'habitat des salamandres ou dans des cours d'eau adjacents depuis lesquels ils sont susceptibles d'accéder à cet habitat. La remise en état des zones de pêche est une activité importante dans le bassin de la Chilliwack, et risque de toucher l'habitat des salamandres. La coordination avec les organismes responsables est nécessaire pour évaluer si de telles activités sont compatibles avec la protection de l'habitat.
Recherche sur le cycle vital, la dynamique des populations et l'utilisation de l'habitat
Les activités de recherche recommandées sont centrées sur l'élimination des lacunes dans les connaissances sur l'écologie de l'espèce. Il est possible que les sites de nidification convenables représentent une ressource limitative pour les salamandres; cette question doit faire l'objet d'un examen plus poussé. Le cycle vital et la dynamique des populations de l'espèce doivent aussi être examinés davantage. Ces renseignements sont nécessaires à la modélisation de la viabilité des populations et à la gestion adéquate de l'habitat pour tous les stades vitaux de la grande salamandre.
Sensibilisation et communication
Une communication efficace avec les intervenants et le public est essentielle pour la réussite de la gestion et de l'intendance des populations de salamandres. Parmi les stratégies recommandées, on compte l'organisation d'ateliers avec les intervenants, l'augmentation de la sensibilisation à l'espèce et à ses besoins en matière d'habitat et de protection auprès des planificateurs et des gestionnaires de l'utilisation des terres, et la promotion de l'adoption de pratiques exemplaires de gestion dans le cadre des mesures d'intendance. La collaboration et la coordination avec les activités de rétablissement ciblant d'autres espèces en péril dont l'aire de répartition chevauche celle de la grande salamandre sont aussi essentielles (voir Approche recommandée pour la mise en œuvre du rétablissement).
Les mesures de rendement ci-dessous consistent en une combinaison de mesures procédurales et d'évaluations des résultats biologiques. Les mesures de rendement visent à indiquer si chaque activité a été menée à bien comme prévu, tandis que les mesures biologiques visent à déterminer si les résultats attendus pour la population de salamandres ont été obtenus.
- Pourcentage de longueur linéaire de cours d'eau occupé et d'habitat terrestre connexe qui est couvert par des aires d'habitat d'espèces sauvages, de nouvelles aires protégées, des plans de gestion visant des aires protégées existantes, des accords d'intendance ou d'autres mesures (préciser) (objectif 1).
- Protection des voies de dispersion terrestre convenables entre les cours d'eau et les réseaux fluviaux par la gestion de l'exploitation forestière et d'autres activités humaines dans au moins 50 % des sous-bassins occupés (bassins hydrographiques de quatrième ordre conformément à l'annexe 1), et exploration des options de connectivité entre les sous-bassins, cotées en fonction des classes d'âge des forêts (objectif 2).
- Pourcentage de nouveaux cours d'eau examinés à la recherche de salamandres par rapport au nombre total de cours d'eau présentant de l'habitat convenable. Clarification de l'occupation au sein de l'aire de répartition de l'espèce par l'augmentation de la couverture des relevés de manière à atteindre au moins 50 % des cours d'eau contenant de l'habitat potentiel pour les salamandres, et application de mesures de protection aux cours d'eau abritant l'espèce (objectifs 3 et 4).
- Persistance des populations dans les sites protégés (objectifs 1 et 2).
- Persistance de conditions convenables de l'habitat dans les sites protégés (objectifs 1 et 2).
- Amélioration des connaissances sur les besoins en matière d'habitat, les processus démographiques, les déplacements terrestres et les menaces, et précision du modèle d'habitat en fonction de ces connaissances et des données de relevé, de manière à ce que l'habitat essentiel puisse être décrit avec exactitude, à ce que les cibles en matière de population et d'habitat puissent être déterminées et, enfin, à ce que le but de rétablissement puisse être atteint (objectifs 1, 2, 3 et 4).
- Nombre de conventions de conservation, d'accords d'intendance ou de contrats de protection de l'habitat, ou nombre de plans de gestion entrepris et achevés; nombre d'hectares d'habitat de la grande salamandre protégés par les mesures susmentionnées (objectif 5).
- Gestion du flux de renseignements et de données visant à soutenir la gestion et la protection de l'habitat, de manière à ce que les objectifs 1 et 2 puissent être atteints.
Désignation de l'habitat essentiel de l'espèce
Le présent document ne propose pas la désignation légale de l'habitat essentiel aux termes de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Pour la grande salamandre, l'habitat essentiel Note19 peut comprendre l'habitat de survie (d'après les occurrences connues) ainsi que l'habitat de rétablissement. D'autres travaux de cartographie détaillée et de consultation devront être effectués avant que de l'habitat essentiel puisse être proposé. L'habitat de rétablissement sera quant à lui déterminé grâce à la liste d'études visant à désigner l'habitat essentiel (ci-après).
Caractéristiques biophysiques de l'habitat essentiel
Les besoins en matière d'habitat de tous les stades vitaux de la grande salamandre doivent être comblés pour que les populations persistent; c'est pourquoi on recommande que l'habitat essentiel soit constitué des cours d'eau d'amont et des zones terrestres de forêts adjacentes. Les cours d'eau occupés sont habituellement petits et en cascades, et peuvent traverser divers types de forêts humides (Farr, 1989; Haycock, 1991; COSEWIC, 2000). Le meilleur habitat aquatique pour l'espèce est formé de cours d'eau étroits, ombragés et à gradient de pente moyen qui présentent des substrats rocheux grossiers et un grand nombre de petites fosses. Les adultes néoténiques ont besoin d'eaux permanentes relativement profondes, et se trouvent souvent à des altitudes élevées; à plus basse altitude, on les trouve souvent dans de grands plans d'eau permanents. Les adultes terrestres occupent les milieux riverains boisés situés à proximité des cours d'eau, et ont besoin d'une abondance d'abris. D'après les besoins biologiques et les besoins en matière d'habitat de l'espèce, on recommande, à titre de superficie nécessaire à la survie de l'espèce, une zone principale de 50 m et une zone de gestion additionnelle de 30 m de chaque côté du cours d'eau associé au lieu de capture (dans la mesure du possible); un habitat de terrain élevé supplémentaire est nécessaire pour maintenir la connectivité, la dispersion des individus et la dynamique de la métapopulation.
D'après les données disponibles, l'habitat de meilleure qualité et les éléments importants de l'habitat pour l'espèce sont actuellement définis comme étant les suivants (d'après Farr, 1989; Haycock, 1991; COSEWIC, 2000; Ovaska et al., 2004 et les références fournies dans le présent document) :
Habitat aquatique : Petits cours d'eau frais et limpides, bien oxygénés et à débit modéré à élevé; largeur moyenne de la surface mouillée des cours d'eau occupés de 2,25 m (fourchette : 0,7 à 10 m) Note8; cours d'eau permanents à chenal stable (non touchés par l'affouillement au printemps ou par l'assèchement en été); présence de petites fosses dans les cours d'eau; substrat graveleux et caillouteux présentant des abris assez grands pour couvrir l'animal.
Habitat terrestre : Forêt humide et ombragée avec pruches de l'Ouest, thuyas géants et/ou douglas de Menzies adjacents aux cours d'eau, comme dans les forêts plus anciennes; abondance de débris ligneux grossiers ou d'autres abris sur le parterre forestier, notamment de gros rondins à un stade de décomposition avancé; sites de nidification convenables dans le cours d’eau ou immédiatement adjacents au cours d’eau.
Habitat de dispersion : Réseau de zones riveraines boisées et de forêts humides de terrain élevé entre les cours d'eau; milieux ombragés, comme dans les forêts anciennes ou les forêts matures de seconde venue; abondance de débris ligneux grossiers ou d'autres abris sur le parterre forestier.
| Description de l'activité | Résultat/justification | Échéancier |
|---|---|---|
| Effectuer l'inventaire des cours d'eau dans tous les bassins hydrographiques qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé; faire passer la couverture des relevés de 16 à 50 % des cours d'eau possiblement convenables. | Élimination des lacunes dans les connaissances sur la répartition de l'espèce | 2011-2015 |
| Effectuer une analyse de la connectivité d'après des données de répartition et des cartes biophysiques existantes et nouvelles; explorer les options liées aux voies de dispersion terrestres entre les cours d'eau, au sein des bassins hydrographiques de quatrième ordre et entre ceux-ci, y compris le rétablissement ou le maintien de la connectivité avec des populations au sud de la frontière. | Détermination des lacunes dans la connectivité de l'habitat - permet d'éviter à la population de devenir disjointe, et améliore les possibilités d'immigration de source externeb | 2012-2015 |
| Mener des consultations avec les propriétaires fonciers et les intervenants en ce qui concerne l'emplacement optimal de l'habitat de dispersion terrestre. | Délimitation de l'habitat de dispersion essentiel - permet un certain degré de flexibilité | 2011-2015 |
| Élaborer un modèle de population pour examiner la viabilité et le risque de disparition selon différentes tailles de population et différents scénarios de protection de l'habitat (%). | Permet de déterminer la quantité d'habitat de rétablissement nécessaire pour soutenir une population minimale viable | 2011-2015 |
| Recueillir de l'information détaillée sur les caractéristiques de l'habitat et l'abondance relative d'après un échantillon de cours d'eau occupés et inoccupés dans chaque bassin hydrographique. | Permet la révision du modèle d'habitatc | 2011-2015 |
| Mettre à jour et préciser le modèle, et appliquer ce dernier aux cours d'eau non examinés restants. | Fournit des recommandations quant à la possibilité de trouver de l'habitat essentiel dans les zones non examinées | 2011-2015 |
b Capacité des individus d'émigrer dans une petite population et d'ainsi empêcher sa disparition.
c Lemieux, 2005.
La majeure partie de l'aire de répartition canadienne de la grande salamandre se trouve sur des terres de la Couronne provinciale visées par des permis d'exploitation forestière. L'IWMS, établie en vertu de la Forest and Range Practices Act de la Colombie-Britannique, fournit les principaux moyens de protection et de gestion de l'habitat des salamandres sur ces terres. En date de janvier 2010, on avait approuvé 20 aires d'habitat d'espèces sauvages (WHA), formées d'une zone principale d'un minimum de 30 m et d'une zone de gestion de 20 m de chaque côté du bras de cours d'eau ciblé.
L'établissement de bandes tampons boisées assez larges et de grandes zones de réserve en terrain élevé représente un outil très important dans le maintien des populations de grandes salamandres dans les forêts aménagées (voir l'examen à l'annexe 3 pour les détails). Des bandes tampons boisées bien conçues le long des cours d'eau aident à conserver la qualité des milieux terrestres et fluviaux pour la grande salamandre, et réduisent les effets de bordure néfastes. L'équipe de rétablissement recommande la protection d'une zone d'habitat principale d'au moins 50 m de chaque côté d'un cours d'eau occupé ainsi que d'une zone de gestion additionnelle de 30 m de chaque côté pour réduire les effets de bordure. Cette largeur de bande tampon est plus grande que ce qui est actuellement prévu pour les WHA (zone principale de 30 m avec bande tampon de 20 m de chaque côté du cours d'eau). L'efficacité de ces bandes tampons moins larges pour cette espèce n'a pas été vérifiée, et les données sur l'espèce et d'autres salamandres indiquent que des bandes plus larges sont nécessaires, tant pour offrir un habitat adéquat pour tous les segments de la population (adultes, subadultes et juvéniles métamorphosés) que pour réduire les effets des chablis et les changements du microclimat dans la zone principale.
Une étude s'est penchée précisément sur l'utilisation de l'habitat terrestre par l'espèce en suivant les déplacements de salamandres munies de radioémetteurs en Colombie-Britannique et dans l'État de Washington (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). Les auteurs ont constaté que, bien que la plupart des déplacements s'effectuent à proximité du cours d'eau, la plus grande distance qu'un individu muni d'un radioémetteur a parcourue depuis la berge d'un cours d'eau durant l'étude a été de 66 m dans une zone de forêt continue (18 individus portaient des radioémetteurs). Des bandes tampons moins larges ne couvriraient donc pas ces grands déplacements potentiellement importants. Aux États-Unis, des déplacements sur une distance pouvant atteindre 400 m depuis un cours d'eau ont été documentés chez la grande salamandre (examiné dans Olson et al., 2007). En outre, l'étude effectuée en Colombie-Britannique a suivi des individus durant seulement 3 à 4 mois, et a ciblé relativement peu de salamandres, dont la plupart étaient des adultes; les déplacements des subadultes n'ont pas été examinés. Chez d'autres espèces de salamandres se reproduisant en milieu aquatique, les subadultes occupent des zones de terrain élevé plus éloignées des habitats aquatiques par rapport aux adultes (Trenham et Shaffer, 2005). Les subadultes jouent un rôle extrêmement important dans le maintien de la taille des populations, de la structure démographique et de la variabilité génétique, et ils représentent des recrues pour la population reproductrice. Il importe aussi de tenir compte de la résistance au vent et des changements du microclimat (température, humidité, vitesse du vent) sur le parterre forestier dans les bandes tampons. Des études indiquent que les effets de bordure sur le microclimat peuvent s'étendre loin à l'intérieur des forêts, selon l'état d'un site donné (Chen et al., 1995; Anderson et al., 2007).
À la lumière des données actuelles sur les déplacements des adultes, des lacunes dans nos connaissances sur les déplacements des subadultes et de l'omniprésence des effets de bordure néfastes, l'équipe de rétablissement recommande une approche prudente et le maintien de bandes tampons plus larges. L'équipe recommande également de suivre l'efficacité de bandes tampons de différentes largeurs, y compris les bandes moins larges déjà établies.
La distance couverte par les WHA approuvées totalise 38 km (longueur linéaire; 320 ha) dans la zone principale, ce qui représente quelque 25 % de la longueur totale estimée des cours d'eau occupés dont on connaît l'existence (figure 3; annexe 2). Parmi les autres mécanismes de protection déjà établis, on compte les parcs et les réserves écologiques (12,6 % de l'habitat de cours d'eau linéaire) ainsi que les bassins hydrographiques approvisionnant une collectivité (2,3 %). Il existe aussi des possibilités de protéger l'habitat des salamandres dans les zones de gestion spéciale (zones spéciales de gestion des ressources, zones d'aménagement de forêt ancienne et WHA ciblant d'autres espèces). La grande salamandre se trouve aussi sur des terres qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral (réserves des Premières Nations : 1 cours d'eau; terrains du ministère de la Défense nationale : 3 sites).
Il importe d'évaluer l'efficacité des WHA sur les terres de la Couronne provinciale et de demander la mise en place d'autres WHA dans les sites occupés. L'habitat dans les aires protégées existantes, comme les parcs, les réserves écologiques, les bassins hydrographiques approvisionnant une collectivité et les zones de gestion spéciale, comme les zones spéciales de gestion des ressources et les zones d'aménagement de forêt ancienne, doit être géré de manière à combler les besoins des salamandres avant d'être considéré comme étant protégé. L'habitat sur les terres privées peut être protégé par des mesures d'intendance, y compris la collaboration avec les administrations municipales et régionales afin de mettre en place une protection de l'habitat à l'échelle du paysage et à plus grande échelle. Les activités d'intendance comprennent la désignation de l'habitat des salamandres, l'adoption de pratiques exemplaires de gestion, la désignation de zones de permis d'aménagement écosensible et l'adoption d'incitatifs fiscaux visant à encourager l'établissement de conventions de conservation et d'accords d'intendance.
Les terres privées ne représentent qu'environ 9 % de l'aire de répartition canadienne de l'espèce, et sont zonées à des fins d'utilisations résidentielles, commerciales et agricoles. Cependant, ces zones contiennent des milieux productifs de faible altitude; c'est pourquoi elles sont très importantes pour les salamandres. L'habitat situé sur des terres privées peut être protégé par des mesures d'intendance; parmi les activités d'intendance recommandées figurent la communication avec les administrations municipales et régionales de manière à ce que des dispositions soient prises au sujet de l'habitat des salamandres dans la planification de l'utilisation des terres, des collectivités et du développement, ainsi que l'adoption de pratiques exemplaires de gestion. La possibilité que la Colombie-Britannique achète directement des terres abritant des sites clés doit aussi être envisagée, particulièrement dans les régions de l'ouest et du nord-ouest de l'aire de répartition de l'espèce, à une altitude faible à modérée, où l'aménagement progresse rapidement.
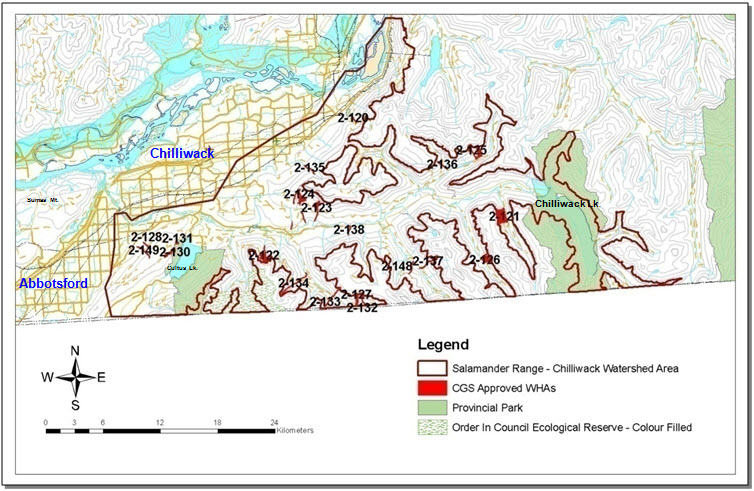
Description longue de la figure 3
La figure 3 est une carte qui démontre l'habitat protégé existant pour la grande salamandre. Cet habitat est composé de vingt petites aires protégées qui sont comprises dans l'aire de répartition de ces salamandres. L'aire de répartition est située à l'est d'Abbotsford et au sud-est de Chilliwack, en Colombie-Britannique et a une forme irrégulière, suivant la ligne de partage des eaux.
De nombreuses espèces en péril se trouvent dans l'aire de répartition de la grande salamandre et utilisent des habitats semblables. Les espèces suivantes, désignées par le COSEPAC, devraient être les plus avantagées :
- La Chouette tachetée (Strix occidentalis; en voie de disparition, liste rouge), qui bénéficiera de la protection des peuplements forestiers anciens dans les zones riveraines.
- La grenouille-à-queue côtière(Ascaphus truei; préoccupante, liste bleue), dont les besoins en matière d'habitat sont très semblables à ceux de la grande salamandre, et qui tirera avantage des mesures de protection et de gestion de l'habitat.
- La cimicaire élevée ( Actaea elata) ;en voie de disparition, liste rouge), une plante dont l'aire de répartition et les besoins en matière d'habitat chevauchent fortement ceux de la grande salamandre. De nombreuses mentions de site pour cette espèce proviennent de zones riveraines boisées, y compris de petits cours d'eau d'amont où la grande salamandre est présente.
- Le castor de montagne de la sous-espèce rufa (Aplodontia rufa rufa; préoccupante, liste bleue), dont l'aire de répartition chevauche largement celle de la grande salamandre. Les réseaux de terriers de cette espèce offrent probablement des refuges souterrains, des sites d'alimentation et des corridors de déplacement aux salamandres.
Les espèces suivantes, désignées par le COSEPAC, pourraient aussi tirer avantage des mesures concernant la grande salamandre, mais leur répartition se limite à des zones de faible altitude :
- La musaraigne de Bendire (Sorex bendirii; en voie de disparition, liste rouge), qui occupe des milieux riverains le long d'étangs et de ruisseaux et cours d'eau à faible débit.
- L'escargot-forestier de Townsend (Allogona townsendiana; en voie de disparition, liste rouge), qui occupe des forêts mixtes de faible altitude. Des mentions de site pour cette espèce se trouvent à proximité de mentions de la grande salamandre.
Les autres espèces susceptibles d'être avantagées par la conservation des forêts anciennes et de leurs caractéristiques et/ou des zones tampons boisées autour des cours d'eau comprennent : la grenouille à pattes rouges (Rana aurora; préoccupante, liste bleue), le Guillemot marbré (Brachyrampus marmoratus; menacée, liste rouge) et la musaraigne de Trowbridge (Sorex trowbridgii; non évaluée par le COSEPAC, liste bleue). Des effets négatifs sur les espèces proies, comme les têtards de la grenouille-à-queue et les invertébrés aquatiques, sont possibles dans certaines zones localisées. Toutefois, la grande salamandre présente un long historique d'évolution en coexistence avec ces organismes, et tout effet négatif sera probablement grandement compensé par les avantages découlant de la gestion et de la protection de l'habitat.
Les écosystèmes riverains situés en bordure des cours d'eau d'amont forestiers seront avantagés par les mesures de protection et de remise en état de l'habitat de la grande salamandre prévues par le programme de rétablissement. D'autres espèces que celles qui ont déjà été mentionnées, comme des mammifères semi-aquatiques (loutres, visons, fouines, musaraignes), des oiseaux (Cincle d'Amérique [Cinclus mexicanus], Arlequin plongeur [Histrionicus histrionicus], oiseaux chanteurs, oiseaux de proie) et des invertébrés aquatiques, sont toutes susceptibles d'être avantagées. Les écosystèmes humides dominés par le thuya géant et contenant du chou puant et d'autres plantes hydrophiles sont des composantes uniques de la forêt pluviale du Pacifique, et peuvent être gravement touchés par l'élimination du couvert forestier et par l'assèchement connexe du parterre forestier. Ces écosystèmes et la faune qui y est associée sont susceptibles de tirer avantage des mesures de gestion et de protection des milieux riverains de la grande salamandre.
Voici un aperçu des coûts et avantages possibles et connus sur le plan socioéconomique.
L'équipe de rétablissement a relevé plusieurs avantages socioéconomiques découlant du rétablissement de la grande salamandre, notamment en ce qui concerne :
- la biodiversité et la gestion durable des ressources;
- les obligations juridiques en matière d'espèces en péril et l'indépendance des administrations;
- le commerce et la coopération à l'échelle internationale;
- la certification des forêts;
- les intérêts scientifiques;
- les intérêts des Premières Nations;
- l'écotourisme.
Les coûts éventuels déterminés par l'équipe comprennent quant à eux :
- les possibles réductions futures de la récolte de bois;
- les coûts de la protection et de la gestion accrues sur les terres privées;
- les coûts de la gestion accrue par le gouvernement;
- l'augmentation des ressources nécessaires pour la recherche en écologie.
L'exploitation forestière est la principale industrie touchée par les mesures de rétablissement de la grande salamandre. On s'attend à d'autres répercussions sur le secteur de la foresterie, car il est peu probable que l'habitat essentiel puisse être protégé dans le cadre de la limite d'impact de 1 % fixée par la politique pour l'approvisionnement en bois d'œuvre, puisque ce budget est aussi utilisé pour gérer d'autres espèces.
Les avantages sociaux résultant de l'amélioration de la qualité des cours d'eau et du maintien des milieux forestiers en bordure des cours d'eau pour le bien de la grande salamandre sont les suivants :
- valorisation de l'habitat en aval aux fins de la pêche commerciale et récréative dans les bassins versants de la Chilliwack et du cours inférieur du Fraser;
- amélioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation par les humains et les animaux d'élevage;
- réduction des dangers de l'érosion dans les zones résidentielles;
- augmentation des possibilités d'activités récréatives à impact faible, comme la randonnée pédestre;
- valorisation des services écosystémiques, notamment le maintien de la biodiversité, de la productivité des forêts, des régimes hydrologiques et de la propreté de l'eau.
Il existe beaucoup d'occasions d'intégrer la mise en œuvre du rétablissement de la grande salamandre à d'autres activités de rétablissement ou de conservation et à la mise en commun des renseignements et des ressources en vue d'avantager de multiples espèces et écosystèmes importants sur le plan de la conservation. Cette intégration peut s'accomplir, en partie, par l'entremise du South Coast Conservation Program (disponible en anglais seulement). L'équipe de rétablissement de la grande salamandre doit coopérer avec les équipes de rétablissement d'autres espèces en péril, notamment la cimicaire élevée, la Chouette tachetée, la grenouille-à-queue côtière, le castor de montagne de la sous-espèce rufa, la musaraigne de Bendire et l'escargot-forestier de Townsend. Les initiatives de rétablissement comme les mesures de protection, de gestion et de remise en état de l'habitat pourraient être améliorées par la mise en commun des ressources, et ce, pour toutes les espèces. Par exemple, en agrandissant une zone protégée afin d'y inclure de multiples espèces en péril, la zone en question serait mieux protégée et moins vulnérable à la fragmentation et aux effets de bordure. La coopération serait renforcée par la création d'une base de données centralisée sur les espèces en péril. La coordination des activités liées aux espèces en péril est aussi importante pour veiller à ne pas nuire accidentellement à d'autres espèces.
Une coordination efficace des nombreux organismes gouvernementaux, programmes et groupes de conservation dont les activités ciblent le bassin versant de la Chilliwack favorisera le rétablissement de la grande salamandre ainsi que d'autres espèces et écosystèmes en péril. Cette coordination peut aussi être obtenue par l'entremise d'organisations telles que le South Coast Conservation Program. Il importe que des objectifs de rétablissement visant des espèces multiples soient pris en compte dans la planification et les activités à l'échelle du paysage. Les mécanismes à l'échelle du paysage qui peuvent aider à atteindre les objectifs de rétablissement visant des espèces multiples comprennent la Forest and Range Practices Act (FRPA), la protection des bassins hydrographiques approvisionnant des collectivités, la Chilliwack River Watershed Strategy et les initiatives de planification de l'utilisation des terres du district régional de la vallée du Fraser. La FRPA est un programme important qui permet de protéger de gérer de multiples espèces en péril dans le bassin versant de la Chilliwack. Toutefois, la limite d'impact sur le territoire de base pour l'approvisionnement en bois d'œuvre (p. ex. 1 % du budget prévu par l'IWMS) devra probablement être augmentée de manière à accommoder la conservation des espèces sauvages désignées. Des organismes gouvernementaux à l'échelle fédérale, provinciale et locale jouent un rôle dans le rétablissement de la grande salamandre. Certaines terres fédérales gérées par le ministère de la Défense nationale et les Premières Nations abritent la grande salamandre et d'autres espèces en péril, et le ministère des Pêches et des Océans entreprend de nombreux projets de remise en état des bassins versants qui peuvent toucher des espèces en péril. À l'échelle provinciale, le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts et des Pâturages et B.C. Parks jouent tous des rôles différents dans l'atteinte des buts du rétablissement, et influent sur la majeure partie de l'habitat occupé par la grande salamandre et d'autres espèces en péril dans le bassin versant de la Chilliwack. Les administrations locales et régionales, dont le district régional de la vallée du Fraser, peuvent contribuer aux activités de rétablissement là où la grande salamandre se trouve sur des terres privées et sur des terres qui relèvent de ces administrations dans la partie ouest du bassin de la Chilliwack.
Un plan d'action est en cours de rédaction et devrait être achevé dans les deux ans suivant la publication du programme de rétablissement.
Anderson, P.D., D.J. Larson et S.S. Chan. 2007. Riparian buffer and density management influences on microclimate of young headwater forests of Western Oregon. For. Sci. 53:254-269.
British Columbia Conservation Data Centre. 2010. BC Species and Ecosystems Explorer. B.C. Minist. of Environ. Victoria, B.C.(disponible en anglais seulement, consulté le 8 février 2010).
British Columbia Ministry of Environment (MoE). 2004. Pacific Giant Salamander (Dicamptodon tenebrosus). In Accounts and Measures for Managing Identified Wildlife, Accounts V. 2004. Original prepared by B. Johnson for B.C. Ministry of Environment, Victoria, BC. 12 pp.
British Columbia Ministry of Environment (MoE). 2007. State of the environment reporting - environmental trends 2007 (disponible en anglais seulement, consulté en février 2009)
British Columbia Ministry of Environment (MoE). 2009 (disponible en anglais seulement, consulté). Water Stewardship Division. Water licensees layer: Freshwater and Marine, Points of diversion, Power-General.
Brosofske, K.D., J. Chen, R.J. Naiman et J.F. Franklin. 1997. Harvesting effects on microclimatic gradients from small streams to uplands in western Washington Ecol. Appl. 7:1188-1200.
Bury, R.B. 2008. Low thermal tolerances of stream amphibians in the Pacific Northwest: Implications for riparian and forest management. Appl. Herpetol. 5:63-74.
Bury, R.B. et P.S. Corn. 1988. Responses of aquatic and streamside amphibians to timber harvest: a review. Pages 165-181 in K.J. Raedeke, ed. Streamside management: riparian wildlife and forestry interactions. Institute of Forest Resources, University of Washington, Seattle, WA. Contribution No. 59.
Cannings, S.G., L.R. Ramsay, D.F. Fraser et M.A. Fraker. 1999. Pacific Giant Salamander Dicamptodon tenebrosus Baird and Girard. Pages 13-14 in Rare amphibians, reptiles, and mammals of British Columbia. B.C. Min. Environ., Lands and Parks, Wildlife Br. and Resource Inventory Br., Victoria, BC. 198 pp.
Chen, J., J.F. Franklin et T.A. Spies. 1995. Growing season microclimatic gradients from clearcut edges into old-growth Douglas-fir forests. Ecol. Appl. 5:74-86.
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 2000. Status report update on the Pacific Giant Salamander, Dicamptodon tenebrosus in Canada. Original report prepared by H.M. Ferguson and B.E. Johnston for the Committee of Endangered Wildlife in Canada, Hull, QC. 41 pp. [Également disponible en français : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2000. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada - Mise à jour. Hull, QC. 47 p.]
Corn, P.S. et R.B. Bury. 1991. Terrestrial amphibian communities in the Oregon Coast Range. Pages 305-317 in L.F. Ruggiero, K.B. Aubry, A.B. Carey et M.H. Huff, tech. coordinators. Wildlife and vegetation of unmanaged Douglas-fir forests. U.S. Dep. Agric. For. Serv., Pac. Northwest Res. Station, Portland, OR. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-285.
Crawford, J.A. et R.D. Semlitsch. 2007. Estimation of core terrestrial habitat for stream-breeding salamanders and delineation of riparian buffers for protection of biodiversity. Conserv. Biol. 21:152-158.
Daszak, P., L. Berger, A.A. Cunningham, A.D. Hyatt, D.E. Green et R. Speare. 1999. Emerging infectious diseases and amphibian population declines. Emerg. Infect. Dis. 5:735-748.
Duellman, W. et L. Trueb. 1986. The biology of amphibians. McGraw-Hill Inc., New York, NY.
Farr, A.C.M. 1989. Status report on the Pacific Giant Salamander Dicamptodon tenebrosus in Canada. Prepared for the Comm. on the Status of Endangered Wildl. in Canada (COSEWIC), Ottawa, Ont.
Ferguson, H.M. 1998. Demography, dispersal and colonisation of larvae of Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus, Good) at the northern extent of their range. Mémoire de maîtrise, Univ. of British Columbia, Vancouver, BC. 131 pp.
Ferguson, H.M. 2000. Larval colonisation and recruitment in the Pacific Giant Salamander (Dicamptodon tenebrosus) in British Columbia. Can. J. Zool. 78:1238-1242.
Gates, D.M. 1993. Climate change and its biological consequences. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA. 280 pp.
Harper, E.B., T.A.G. Rittenhouse et R.D. Semlitsch. 2008. Demographic consequences of terrestrial habitat loss for pool-breeding amphibians: predicting extinction risks associated with inadequate size of buffer zones. Conserv. Biol. 22:1205-1215.
Haycock, R.D. 1991. Pacific Giant Salamander Dicamptodon tenebrosus status report. B.C. Min. Environ., Wildlife Br., Victoria, BC. 55 pp.
Horn, H.S. 1983. Some theories about dispersal. Pages 54-62 in I.R. Swingland and P.J. Greenwood, eds. The ecology of animal movement. Clarendon Press, Oxford, UK.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2001. Climate change 2001: the scientific basis. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
Johnston, B. 1998. Terrestrial Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus Good): natural history and their response to forest practices. Mémoire de maîtrise. Univ. of British Columbia, Vancouver, BC. 98 pp.
Johnston, B. 1999. Terrestrial Pacific Giant Salamanders: natural history and response to forest practices. Pages 303-304 in Proc., Conference on Biology and Management of Species and Habitats at Risk, Feb. 15-19, 1999. Vol. 1.
Johnston, B. et L. Frid. 2002. Clearcut logging restricts the movements of terrestrial Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus Good). Can. J. Zool. 80:2170-2177.
Jones, L.C., W.P. Leonard et D.H. Olson, eds. 2005. Amphibians of the Pacific Northwest. Seattle Audubon Society, Seattle, Wash. 227 pp.
Knopp, D. et L. Larkin. 1995. An inventory of the significant flora and fauna of Canadian Forces Base Chilliwack, B.C. Photographs by D. Knopp, R. Luckow, T. Robertson, and J. Street. Prepared by B.C.'s Wild Heritage Consultants, Sardis, BC, for the Dep. National Defence, Canadian Forces Base, Chilliwack, BC.
Lawton, J.H. 1993. Range, population abundance and conservation. Trends Ecol. Evol. 8:409-413.
Lomolino, M.V. et R. Channell. 1995. Splendid isolation -patterns of geographic range Collapse in Endangered Mammals. J. Mammal. 76:335-347.
Lomolino, M.V. et R. Channell. 1998. Range collapse, re-introductions, and biogeographic guidelines for conservation. Conserv. Biol. 12:481-484.
McAllister, K.R. 1995. Distribution of amphibians and reptiles in Washington State. Northwest Fauna 3:81-112.
Matsuda, B.M., D.M. Green et P.T. Gregory. 2006. Amphibians and reptiles of British Columbia. Royal B.C. Museum Handb., Victoria, BC. 266 pp.
Ministry of Environment. 2010a. Conservation Framework. B.C. Minist. of Environ. Victoria, B.C. (disponible en anglais seulement, consulté le 8 février 2010)
Ministry of Environment. 2010b. Approved Wildlife Habitat Areas (WHAs). B.C. Minist. of Environ. Victoria, B.C. (disponible en anglais seulement, consulté le 8 février 2010)
NatureServe. 2009. NatureServe Explorer: an online encyclopedia of life [application Web]. Version 7.1. Arlington, VA. (disponible en anglais seulement, consulté en février 2009)
Nussbaum, R. A. 1976. Geographic variation and systematics of salamanders of the genus Dicamptodon Strauch (Ambystomatidae). Univ. Mich., Dep. Zool., Ann Arbor, Mich. Misc. Publ. (149). 94 p.
Nussbaum, R.A., E.D. Brodie Jr. et R.M. Storm. 1983. Amphibians and reptiles of the Pacific Northwest. Northwest Univ. Press of Idaho, Moscow, Idaho. 332 p.
Olson, D.H., P.D. Anderson, C.A. Frissell, H.H. Welsh Jr. et D.F. Bradford. 2007. Biodiversity management approaches for stream riparian areas: perspectives for Pacific Northwest headwater forests, microclimate and amphibians. For. Ecol. Manag. 246:81-107.
Orchard, S. 1984. Amphibians and reptiles of British Columbia: an ecological review. B.C. Min. For., Res. Br., Victoria, BC. WHR-15.
Parker, M.S. 1991. Relationship between cover availability and larval Pacific Giant Salamander density. J. Herpetol. 25:355-357.
Relyea, R.A. 2005. The lethal impacts of Roundup and predatory stress on six species of North American tadpoles. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 48:351-357.
Richardson, J.S. et W.E. Neill. 1998. Headwater amphibians and forestry in British Columbia: Pacific Giant Salamanders and Tailed Frogs. Northwest Sci. 72 (special issue):122-123.
Rundio, D.E. et D.H. Olson. 2003. Antipredator defenses of larval Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus) against Cutthroat Trout (Oncorhynchus clarki). Copeia 2003:402-407.
Scudder, G.G.E. 1989. The adaptive significance of marginal populations: a general perspective. Pages 180-185 in C.D. Levings, L.B. Holtby, and M.A. Henderson, eds. Proc. The National Workshop on Effects of Habitat Alteration on Salmonid Stocks.
Stoddard, M.A. et J.P. Hayes. 2005. The influence of forest management on headwater stream amphibians at multiple spatial scales. Ecol. Appl. 15:811-823.
Trenham, P.C. et H.B. Shaffer, 2005. Amphibian upland habitat use and its consequences for population viability. Ecol. Appl. 15:1158-1168.
USGS National Wildlife Health Centre. 2001. Quarterly wildlife mortality report, October 2001 to November 2001. (disponible en anglais seulement, consulté en mars 2007)
Vesely, D.G. et W.C. McComb. 2002. Salamander abundance and amphibian species richness in riparian buffer strips in the Oregon Coast Range. For. Sci. 48:291-297.
Washington Herp Atlas. 2005. (consulté en mars 2007)
Welsh, H.H. Jr. et A.J. Lind. 2002. Multiscale habitat relationships of stream amphibians in the Klamath-Siskiyou region of California and Oregon. J. Wildl. Manag. 66:581-602
Dans son ensemble, le bassin hydrographique (ou bassin versant) est un bassin de quatrième ordre. Les sous-bassins A, B et C sont des bassins de troisième ordre.
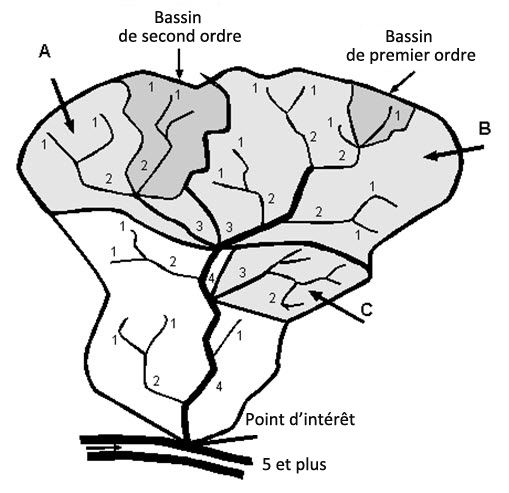
Description longue de l'annexe 2
L’annexe 2 démontre un diagramme d’hiérarchisation de l’écoulement des rivières avec les différentes sections organisées en bassins versants. Les rivières commencent par être classées du premier ordre et joignent éventuellement d’autres rivières, augmentant ainsi leur ordre et leur grosseur. Le résultat final est un système de ramification où les rivières de plus petit ordre dérivent des plus grosses rivières qui ont un ordre plus élevé.
On compte 20 WHA approuvées pour la grande salamandre (en date de janvier 2010). Ces zones sont fondées sur une zone principale de 30 m et sur une zone de gestion de 20 m de chaque côté du bras de cours d'eau. La connectivité est assurée par des zones de terrain élevé.
| No | Caractéristique de WHA | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 2-120 | Zone principale | 6,6 |
| 2-120 | Zone riveraine | 4,4 |
| 2-120 | Superficie totale | 11,0 |
| 2-121 | Zone principale | 31,8 |
| 2-121 | Zone riveraine | 18,6 |
| 2-121 | Zone de terrain élevé | 78,3 |
| 2-121 | Superficie totale | 128,7 |
| 2-122 | Zone principale | 13,4 |
| 2-122 | Zone riveraine | 8,6 |
| 2-122 | Zone de terrain élevé | 39,3 |
| 2-122 | Superficie totale | 61,3 |
| 2-123 | Zone principale | 22,8 |
| 2-123 | Zone riveraine | 14,3 |
| 2-123 | Zone de terrain élevé | 15,5 |
| 2-123 | Superficie totale | 52,5 |
| 2-124 | Zone principale | 35,7 |
| 2-124 | Zone riveraine | 24,7 |
| 2-124 | Zone de terrain élevé | 30,0 |
| 2-124 | Superficie totale | 90,3 |
| 2-125 | Zone principale | 30,3 |
| 2-125 | Zone riveraine | 18,7 |
| 2-125 | Zone de terrain élevé | 31,9 |
| 2-125 | Superficie totale | 80,9 |
| 2-126 | Zone principale | 28,2 |
| 2-126 | Zone riveraine | 16,7 |
| 2-126 | Zone de terrain élevé | 19,8 |
| 2-126 | Superficie totale | 64,6 |
| 2-126 | Zone principale | 28,2 |
| 2-126 | Zone riveraine | 16,7 |
| 2-126 | Zone de terrain élevé | 19,8 |
| 2-126 | Superficie totale | 64,6 |
| 2-127 | Zone principale | 18,4 |
| 2-127 | Zone riveraine | 10,5 |
| 2-127 | Zone de terrain élevé | 3,9 |
| 2-127 | Superficie totale | 32,8 |
| 2-128 | Zone principale | 5,8 |
| 2-128 | Zone riveraine | 4,2 |
| 2-128 | Superficie totale | 10 |
| 2-130 | Zone principale | 10,7 |
| 2-130 | Zone riveraine | 6,8 |
| 2-130 | Zone de terrain élevé | 14,4 |
| 2-130 | Superficie totale | 31,9 |
| 2-131 | Zone principale | 2,2 |
| 2-131 | Zone riveraine | 1,5 |
| 2-131 | Zone de terrain élevé | 5,0 |
| 2-131 | Superficie totale | 8,7 |
| 2-132 | Zone principale | 11,4 |
| 2-132 | Zone riveraine | 7,0 |
| 2-132 | Zone de terrain élevé | 2,3 |
| 2-132 | Superficie totale | 20,7 |
| 2-133 | Zone principale | 18,1 |
| 2-133 | Zone riveraine | 15,4 |
| 2-133 | Superficie totale | 33,5 |
| 2-134 | Zone principale | 24,1 |
| 2-134 | Zone riveraine | 19,0 |
| 2-134 | Superficie totale | 43,1 |
| 2-135 | Zone principale | 9,5 |
| 2-135 | Zone riveraine | 6,3 |
| 2-135 | Superficie totale | 15,8 |
| 2-136 | Zone principale | 8,3 |
| 2-136 | Zone riveraine | 5,8 |
| 2-136 | Superficie totale | 14,2 |
| 2-137 | Zone principale | 14,9 |
| 2-137 | Zone riveraine | 9,9 |
| 2-137 | Superficie totale | 24,8 |
| 2-138 | Zone principale | 6,8 |
| 2-138 | Zone riveraine | 4,6 |
| 2-138 | Superficie totale | 11,4 |
| 2-148 | Zone principale | 9,3 |
| 2-148 | Zone riveraine | 6,2 |
| 2-148 | Superficie totale | 15,4 |
| 2-149 | Zone principale | 11,7 |
| 2-149 | Zone riveraine | 7,9 |
| 2-149 | Superficie totale | 19,6 |
| Caractéristique de WHA | Total |
|---|---|
| Zone principale | 319,9 |
| Zone riveraine | 211,0 |
| Zone de terrain élevé | 240,5 |
| Grand total | 771,4 |
| No | Longueur (km) |
|---|---|
| 2-120 | 1,14 |
| 2-121 | 1,0 |
| 2-122 | 1,49 |
| 2-123 | 2,64 |
| 2-124 | 1,68 |
| 2-124 | 0,69 |
| 2-124 | 1,61 |
| 2-124 | 1,21 |
| 2-125 | 1,26 |
| 2-125 | 1,7 |
| 2-126 | 1,27 |
| 2-127 | 1,31 |
| 2-128 | 0,97 |
| 2-130 | 1,42 |
| 2-131 | 0,37 |
| 2-132 | 1,34 |
| 2-133 | 1,67 |
| 2-133 | 1,27 |
| 2-134 | 3,95 |
| 2-135 | 1,59 |
| 2-136 | 1,45 |
| 2-137 | 2,49 |
| 2-138 | 1,12 |
| 2-148 | 1,52 |
| 2-149 | 1,96 |
| Grand total | 38,13 |
L'établissement de bandes riveraines boisées et de grandes zones de réserve constitue un outil très important dans le maintien des populations de grandes salamandres dans les forêts aménagées, y compris dans le bassin versant de la Chilliwack. Cependant, on dispose de très peu d'information quantitative sur la réaction de l'espèce aux diverses largeurs des bandes tampons s'étendant de chaque côté d'un cours d'eau et aux diverses tailles et configurations des zones de réserve. Les types de bandes tampons boisées et de réserves nécessaires varient en fonction des caractéristiques des sites comme le relief, l'altitude, les propriétés hydrologiques, le type de forêt et la vulnérabilité aux chablis. Des bandes tampons bien conçues aident à maintenir la qualité des milieux terrestres et fluviaux et à réduire au minimum les effets de bordure. Les bandes tampons sont habituellement formées d'une zone principale de végétation non perturbée et d'une zone de gestion extérieure conçue pour maintenir les conditions microclimatiques de la zone principale. Si les bandes tampons sont trop étroites, l'habitat du parterre forestier qui est utilisé par les salamandres sera sujet à des hausses de la température et au dessèchement en raison de l'augmentation du rayonnement solaire, de la pénétration du vent et des chablis. Les milieux fluviaux peuvent aussi être détériorés par des hausses de la température, la réduction de l'ombrage et l'augmentation de l'envasement ou de la pollution, ce qui est particulièrement important pour les espèces qui dépendent des eaux fraîches comme la grande salamandre (Bury, 2008). Les bandes tampons doivent aussi être continues en amont et en aval des bras de cours d'eau occupés de manière à réduire l'envasement et les inondations en aval, à maximiser la connectivité des habitats et à offrir des voies de déplacement aux individus pour qu'ils puissent recoloniser d'autres tronçons du cours d'eau.
Les grandes zones de réserve visent principalement à accroître la connectivité de l'habitat et à fournir de l'habitat de dispersion terrestre aux salamandres au sein des bassins versants et entre ceux-ci. Les réserves doivent être configurées de manière à faciliter la recolonisation de zones précédemment occupées, la colonisation de nouvelles zones et les échanges génétiques entre les populations locales. Elles doivent aussi servir à protéger les grandes superficies de milieux riverains et fluviaux contre les effets catastrophiques éventuels des feux de friches, des inondations, des chablis et des changements climatiques. Les zones de réserve offrent aussi des sites de référence aux fins de la recherche et des études de suivi de l'efficacité des mesures. Elles doivent être assez grandes pour couvrir la longueur totale de plusieurs affluents dans un bassin versant. Elles doivent être directement adjacentes à d'autres zones de protection existantes, dans la mesure du possible, et être largement distribuées dans l'aire de répartition de l'espèce. Olson et al. (2007) fournissent une analyse approfondie des diverses configurations spatiales des réserves destinées aux amphibiens dans les forêts d'amont aménagées du Pacifique Nord-Ouest (voir la figure 3c-g dans Olson et al. [2007] pour des exemples de configurations). Une mesure importante pour maintenir la connectivité entre les populations locales consiste à veiller à ce que des réserves situées dans des bassins versants adjacents s'étendent jusqu'à la ligne de crête et se rencontrent.
Les bandes tampons boisées autour des cours d'eau fournissent un habitat essentiel d'alimentation, de refuge et d'hivernage aux adultes terrestres de la grande salamandre, et aident à maintenir des conditions convenables dans les cours d'eau pour les larves et les individus néoténiques. Elles facilitent aussi les déplacements le long des cours d'eau aux fins de la dispersion. Des bandes tampons boisées plus larges aident à maintenir le microclimat des milieux terrestres et fluviaux de façon à ce que les conditions soient semblables à celles des sites de référence non perturbés (Chen et al., 1995; Brosofske et al., 1997; Johnston et Frid, 2002; Anderson et al., 2007). On sait que les conditions fraîches et humides qui sont produites par un cours d'eau et la végétation riveraine qui y est associée s'imprègnent dans l'habitat de terrain élevé, et créent un microclimat convenable pour les adultes terrestres (Olson et al., 2007). En Oregon, Veseley et McComb (2002) ont constaté que la forêt riveraine non exploitée présentait un couvert forestier plus important que les bandes tampons (largeur moyenne de 21 m) le long des cours d'eau, en plus de contenir davantage de fougères, de mousses et de rondins de grand diamètre. Chen et al. (1995) ont observé une plus grande vitesse du vent ainsi que de plus grandes variations de température et d'humidité dans les bandes forestières par rapport à l'intérieur des forêts, et que les effets des zones adjacentes de coupe à blanc pouvaient s'étendre sur plus de 240 m vers l'intérieur des forêts non exploitées. Anderson et al. (2007) recommandent de protéger la totalité de la zone de végétation riveraine, et d'étendre les bandes tampons jusqu'aux limites topographiques naturelles pour qu'elles soient efficaces contre les effets des zones adjacentes de coupe à blanc ou d'éclaircissement des forêts.
La largeur des bandes tampons boisées doit permettre d'englober les besoins saisonniers en matière d'habitat et les déplacements des grandes salamandres, et de protéger les zones d'activité principales contre les effets de bordure. Dans le cadre de plusieurs études effectuées en Oregon (examiné dans Olson et al., 2007), la présence de l'espèce a été relevée jusqu'à 400 m depuis les berges d'un cours d'eau. Dans une étude de radiotélémétrie réalisée dans les bassins versants de la Chilliwack et de la Nooksack, Johnston et Frid (2002) ont constaté que la distance maximale d'une grande salamandre par rapport aux berges d'un cours d'eau était de 66 m en forêt, de 22 m dans les bandes tampons et de 19 m dans les zones de coupe à blanc. Dans les zones forestières, 94 % des salamandres (16/17) demeuraient à moins de 25 m des berges, et ce, durant une période de 3 à 4 mois. Le comportement des salamandres le long des cours d'eau présentant des bandes tampons de 20 à 30 m était semblable à ce que l'on observe dans les milieux forestiers, mais seul un faible échantillon de salamandres (n = 7) a été muni de radioémetteurs dans des secteurs comptant des bandes tampons. Cette étude laisse croire qu'une zone principale de quelque 25 à 30 m serait nécessaire pour tenir compte de la plupart des déplacements. Cependant, pour réduire au minimum les effets de bordure néfastes, une zone de gestion additionnelle est nécessaire pour maintenir l'intégrité de la zone principale à long terme ainsi que pour tenir compte des déplacements occasionnels sur de grandes distances.
La largeur nécessaire de la zone principale et de la zone de gestion dépend des caractéristiques du site, comme le type de forêt, le relief et la vulnérabilité aux chablis. En Oregon, Stoddard et Hayes (2005) ont constaté que la présence de populations de grandes salamandres dans les cours d'eau d'amont était positivement associée aux tronçons de cours d'eau qui présentaient de chaque côté une bande boisée d'au moins 46 m. Toujours en Oregon, Vesely et McComb (2002) ont indiqué que 80 % des observations de 3 espèces de salamandres se reproduisant en milieu aquatique, dont la grande salamandre, avaient lieu à moins de 20 m du cours d'eau dans les secteurs présentant des bandes tampons de 0 à 64 m. Ils ont estimé qu'une bande tampon de 43 m permettrait de soutenir une abondance de salamandres (10 espèces au total) semblable à ce que l'on observe dans la forêt non exploitée. Ils indiquaient aussi qu'une zone de gestion où les coupes sont interdites pourrait être requise pour protéger l'habitat contre les effets de bordure. Dans l'est des États-Unis, Crawford et Semlitsch (2007) ont constaté que 95 % des observations de 4 salamandres se reproduisant dans des cours d'eau avaient eu lieu à moins de 27 m des berges. Ils ont recommandé l'établissement d'une bande boisée additionnelle de 50 m pour réduire les effets de bordure, pour un total de 77 m de chaque côté du cours d'eau. Harper et al. (2008) ont effectué des simulations sur ordinateur des populations de salamandres tachetées se reproduisant dans des étangs et occupant des bandes tampons boisées de différentes largeurs dans l'est des États-Unis. Pour les bandes d'une largeur de 30 m ou moins, ils ont prévu que les taux de survie baisseraient de 5 % par année, ce qui donnerait lieu à un déclin de population de 94 % et à une probabilité de disparition de 29 % sur 20 ans. Une largeur de bande tampon de 100 à 165 m autour des étangs de reproduction a été recommandée pour obtenir une probabilité de persistance de la population de 95 %.
Il y a un besoin urgent de suivre l'efficacité des différentes largeurs de bandes tampons et des différentes tailles de zones de réserve dans le bassin versant de la Chilliwack, de façon à ce que les mesures de protection futures puissent être ajustées au besoin. On recommande la réalisation d'études avant-après et de comparaisons entre les bandes tampons existantes et des sites de référence non exploités.
Détails de la page
- Date de modification :