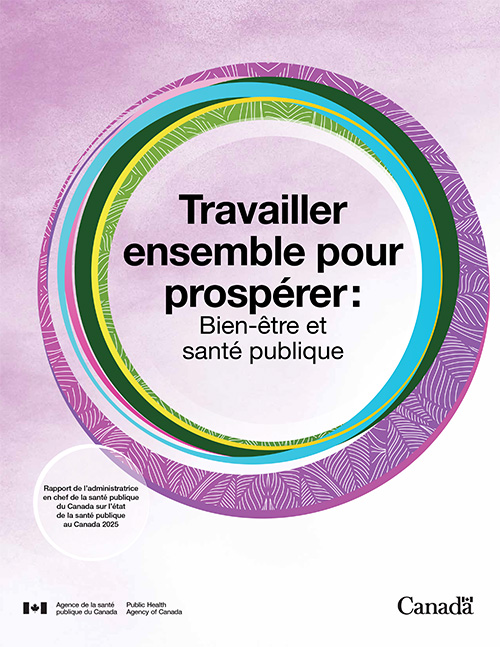Rapport complet : Travailler ensemble pour prospérer : Bien-être et santé publique
Télécharger en format PDF
(5.92 Mo, 84 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : 2025-10-07
Cat. : HP2-10F-PDF
ISBN : 1924-7095
Pub. : 250207
Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada sur l'état de la santé publique au Canada 2025
Sur cette page
- Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada
- À propos du présent rapport
- Sommaire
- Introduction
- Partie 1: Concepts et approches en matière de bien-être
- Partie 2 : Contributions du bien-être à la santé publique
- Partie 3 : Rôles de la santé publique dans les initiatives axées sur le bien-être
- Cadres de santé publique pour comprendre les déterminants structurels du bien-être
- Données sur la santé publique et données probantes pour mesurer les inégalités liées au bien-être
- La santé publique, championne de l'action intersectorielle
- Rôles et responsabilités de la santé publique dans la mise en œuvre des droits autochtones
- La voie à suivre
- Annexe A : Exemples clés d'initiatives axées sur le bien-être
- Annexe B : Méthodologie
- Remerciements
- Références
Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada
Le bien-être est important pour tout le monde. Pour prospérer et être productifs, nous avons besoin de soins de santé, d'un logement de qualité, d'un travail décent, de liens solides avec notre famille et notre communauté et d'espoir pour l'avenir.
Bien que dans l'ensemble, les personnes au Canada jouissent d'une qualité de vie élevée, les dernières années ont entraîné des défis importants pour notre bien-être collectif. Les changements climatiques, la crise des drogues toxiques, les pressions économiques et les maladies infectieuses ont eu de nombreuses répercussions sur notre vie quotidienne. La pandémie de COVID-19 nous a appris que notre façon de relever les défis peut également influencer des aspects fondamentaux du bien-être, comme la santé mentale et physique, l'éducation, la sécurité financière et les liens sociaux.
Or, ces défis n'affectent pas tout le monde de la même manière. Certaines communautés ont été plus durement touchées parce qu'elles n'ont pas ce dont elles ont besoin pour jouir d'une bonne santé et assurer leur bien-être. C'est en partie parce que le racisme, la discrimination et d'autres traitements injustes sont encore bien présents dans nos systèmes et nos institutions, ce qui peut avoir une incidence sur de nombreux aspects différents de la vie quotidienne et sur l'accès à un éventail de possibilités.
De plus en plus, et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, les lieux dans lesquels nous vivons, travaillons et nous divertissons sont devenus des espaces numériques qui évoluent en temps réel. Nous devons tirer parti des avantages du numérique pour tout le monde, tout en nous attaquant aux effets négatifs potentiels sur le bien-être dès qu'ils surviennent.
Aucune communauté, aucun gouvernement ni aucun secteur ne peut à lui seul relever ces défis complexes. Nous devons repenser la façon dont nous travaillons ensemble pour favoriser le changement. Dans cette optique, mon rapport met en lumière le bien-être comme objectif unificateur pouvant favoriser l'action collaborative.
Au Canada et partout dans le monde, des collaborations émergent pour promouvoir des conditions favorables à la prospérité humaine et planétaire. De nombreuses communautés au Canada s'efforcent de transformer leurs milieux afin d'améliorer leur qualité de vie et leur résilience. Le Cadre de qualité de vie pour le Canada vise à mesurer ce qui compte le plus pour les personnes au Canada, afin que la budgétisation et la prise de décisions soient fondées sur des données probantes à l'échelon fédéral. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis montrent comment favoriser le bien-être relationnel des personnes, des animaux, du territoire et des générations futures par l'entremise d'une gouvernance, de recherches et de programmes dirigés et déterminés par les Autochtones. Dans ce rapport, les enseignements autochtones sur le bien-être sont illustrés de façon éloquente par les œuvres d'art de la Dre Lisa Boivin.
Le bien-être suscite également un intérêt croissant à l'échelle internationale en tant que moteur de changement sociétal. Il tient compte des indicateurs économiques, mais va au-delà de ceux-ci pour évaluer comment ça va. C'est important, car nous avons constaté que les indicateurs économiques, comme le produit intérieur brut (PIB), ont progressé tandis que d'autres aspects du bien-être sont demeurés inchangés, voire se sont détériorés. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) encourage une action pansociétale en faveur du bien-être, qu'elle voit comme un nouveau chapitre pour la santé publique, reconnaissant le potentiel d'une telle approche pour atteindre la santé pour toute la population. Cette approche s'appuie sur les valeurs et la pratique de la promotion de la santé, une composante essentielle de la santé publique depuis la Charte d'Ottawa.
Pour privilégier le bien-être, il faut adopter une vision d'ensemble et faire progresser simultanément les priorités en matière de santé, de société, d'économie et d'environnement. Il faut mener des recherches multidisciplinaires pour comprendre la façon dont toutes les politiques et initiatives peuvent influencer ce qui compte le plus dans la vie des gens. En prenant part aux discussions et aux décisions, les responsables de la santé peuvent contribuer à l'élaboration de diverses politiques publiques sur le bien-être en arrimant les données à la prise de décisions, par exemple des données sur l'équité en santé et les nouveaux déterminants de la santé, numériques et commerciaux notamment. Dans les communautés, les personnes œuvrant en santé publique peuvent travailler avec les leaders locaux dans une approche intersectorielle pour échanger des connaissances, combiner des ressources et passer à l'action en fonction d'objectifs communs. L'innovation et la créativité naîtront de notre capacité à apprendre des nombreuses populations et communautés diversifiées qui sont expertes de leur propre bien-être, et à collaborer avec elles. Il est essentiel de mieux comprendre comment le racisme est intégré à nos systèmes, à nos institutions et à nos processus décisionnels, et de soutenir le leadership des populations noires, autochtones et d'autres populations racisées qui œuvrent pour un véritable changement. Nous devons aussi trouver ensemble des moyens de prospérer aux côtés des jeunes d'aujourd'hui, qui sont les leaders de demain. Dans l'ensemble du système de santé, nous devons établir des relations renouvelées avec les leaders, les organisations et les communautés autochtones afin de promouvoir une vision holistique du bien-être, de faire progresser la réconciliation et de protéger les droits des Autochtones.
Il s'agit d'une mission transformatrice, et elle n'est pas facile. Il faudra du temps et une détermination inébranlable pour éliminer les cloisonnements, établir des relations de confiance, modifier les conditions et évaluer les retombées. Les générations futures comptent sur nous pour relever ce défi.
Dre Theresa Tam
Administratrice en chef de la santé publique du Canada
La Dre Theresa Tam a terminé son mandat à titre d'administratrice en chef de la santé publique du Canada en juin 2025. Le présent rapport constitue son dernier rapport annuel sur l'état de la santé publique au Canada. Son successeur par intérim, le Dr Howard Njoo, l'a soumis à la ministre de la Santé pour dépôt au Parlement.
À propos du présent rapport
Le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada (ACSP) est l'occasion d'examiner les questions importantes qui influencent l'état de la santé publique au Canada. Ces rapports visent à susciter le dialogue et à appuyer les mesures visant à améliorer la santé de la population et les conditions favorables à la santé. Le rapport de cette année porte sur l'élan qui entoure le bien-être en tant qu'approche et objectif de politiques publiques intersectoriels, et sur la façon dont les systèmes de santé publique peuvent à la fois s'en inspirer et y contribuer afin d'améliorer la santé et le bien-être des personnes au Canada. Le rapport s'adresse principalement aux personnes œuvrant en santé publique, aux responsables des décisions politiques et à d'autres acteurs des divers établissements, organismes, groupes et communautés qui composent les systèmes de santé publique du Canada. Toutefois, il est également pertinent pour les personnes œuvrant dans d'autres secteurs dont le travail influence les déterminants de la santé et du bien-être.
Le rapport s'appuie sur les thèmes des rapports précédents de l'ACSP, notamment les déterminants sociaux et structurels de la santé, l'action intersectorielle et l'équité en santé. En particulier, il revient sur l'objectif général de la santé publique, qui est de parvenir à un état de santé et de bien-être optimal pour toute la population du Canada.
Aperçu du rapport
La partie 1 décrit brièvement l'émergence et l'importance du bien-être comme objectif et approche pour les communautés et gouvernements au Canada et ailleurs dans le monde. Elle présente les dimensions et les résultats communs associés aux cadres de bien-être, souligne les principales caractéristiques des approches en matière de bien-être et met en valeur le savoir-faire des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que leurs concepts du bien-être.
La partie 2 traite des possibilités associées à l'application d'une approche en matière de bien-être en santé publique, notamment les avantages offerts par une approche positive et fondée sur les forces, l'accent mis sur les générations futures et la planète, ainsi que le potentiel du bien-être en tant que catalyseur de l'action intersectorielle pour faire progresser simultanément les priorités en matière de santé, de société, d'économie et d'environnement.
La partie 3 décrit en détail les rôles proposés pour la santé publique dans le cadre des efforts plus vastes dans le domaine du bien-être, y compris contribuer à comprendre les déterminants structurels de la santé, produire des données probantes et des données sur les iniquités, promouvoir l'action intersectorielle et mettre en œuvre les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Des exemples appliqués sont utilisés tout au long du rapport pour illustrer comment les initiatives axées sur le bien-être soutiennent la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada, et mettre en évidence les rôles de la santé publique.
La voie à suivre offre aux personnes œuvrant en santé publique, aux responsables des politiques et aux scientifiques des occasions d'appliquer les principales caractéristiques des approches en matière de bien-être dans leur travail et de mobiliser, tout en les renforçant, des connaissances et des pratiques en santé publique dans le cadre d'initiatives intersectorielles axées sur le bien-être.
L'annexe A décrit des initiatives axées sur le bien-être au Canada et dans le monde, offrant un aperçu de l'éventail des activités menées par les communautés et les gouvernements dans ce domaine.
L'annexe B résume la méthodologie, les consultations et les activités de mobilisation menées auprès de leaders de la santé publique et du bien-être dans le cadre de l'élaboration du rapport ainsi que les limites.
Tableau de bord sur la santé des personnes au Canada
Les principaux indicateurs de la santé de la population canadienne sont présentés dans un tableau de bord interactif en ligne. Le message de l'ACSP qui accompagne cette ressource donne un aperçu général des tendances actuelles en matière de données sur la santé de la population. Le tableau de bord est mis à jour périodiquement.
Reconnaissance des terres
Les personnes qui ont rédigé le présent rapport reconnaissent respectueusement que les terres sur lesquelles elles ont préparé ce rapport sont les terres ancestrales des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les systèmes et les structures dont il est question dans le présent rapport existent, fonctionnent et sont maintenus sur ces mêmes terres et de nombreuses autres terres autochtones au Canada. Ce rapport a été élaboré dans les villes suivantes :
- À Halifax, également connu sous le nom de K'jipuktuk, le territoire ancestral et non cédé du peuple micmac, faisant partie du Mi'kma'ki. Ce territoire est visé par les « traités de paix et d'amitié » que les Micmacs, les Wolastoqiyik (Malécites) et les Passamaquoddy ont signés entre 1725 et 1779. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient le titre de propriété des Micmacs, des Wolastoqiyik (Malécites) et des Passamaquoddy, et établissaient les règles de ce qui devait être une relation durable de paix et d'amitié entre les nations.
- À Montréal, également connu sous le nom de Tiohti:áke, le territoire traditionnel et non cédé Kanien'kehà:ka, un site qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, notamment les Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee ainsi que les Wendat, les Abénakis et les Anichinabés.
- À Ottawa, également connu sous le nom d'Adawe, sur le territoire traditionnel non cédé et non abandonné du peuple algonquin anichinabé, y compris des signataires de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek.
- À Toronto, également connu sous le nom de Tkaronto, le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas de Credit, les Anichinabés, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et qui est maintenant le lieu de résidence de plusieurs Premières Nations, Inuits et Métis en milieu urbain. Toronto se trouve sur les terres protégées par le pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du « bol à une seule cuillère », qui représente les ententes conclues entre les Haudenosaunee et les Anichinabés ainsi que les nations alliées sur le partage pacifique et le soin des ressources dans la région des Grands Lacs.
- À Elora, dans le comté de Wellington, qui fait partie du Traité de Nanfan (nos 3 et 3 ¾), du Traité de Qu'Appelle (no 4), de l'Achat de Toronto (Traités no 13 et no 13A), de l'Achat de Nottawasaga (Traité no 18), de l'Achat d'Ajetancen (Traité no 19), de l'Achat de la parcelle Huron (Traité no 29) et de l'Achat de la parcelle Saugeen (Traité no 45 ½), et qui est le territoire traditionnel des Anishinabek, des Anishinabewakis, des Attiwonderonk, des Haudenosaunee, des Mississauga, des Mississaugas de Credit, des Odawas, des Tionontati (Pétuns) et des Wendats.
- À New Westminster, constitué d'espaces notamment appelés tsicələs, scłi'qən', Stautlo et sχʷəyem, situé sur le territoire traditionnel, non cédé et non abandonné des peuples traditionnels parlant le Halkomelem des Salish de la côte, et en particulier des Nations qiqéyt (Qayqayt) et xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam).
- À Central Saanich, qui fait partie des Traités de Douglas, plus précisément les Traités de South Saanich et de North Saanich, et sur le territoire traditionnel des Premières Nations SȾÁUTW̱ et W̱JOȽEȽP, deux des cinq communautés qui constituent la Nation W̱SÁNEĆ.
Dans l'esprit de la réconciliation, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour réparer les vastes conséquences dévastatrices du colonialisme et du racisme, qui engendrent encore des iniquités entre les communautés autochtones et non autochtones. Nous souhaitons également reconnaître la force, la résilience et la sagesse inhérentes aux systèmes de connaissances autochtones dont font preuve les Premières Nations, les Inuits et les Métis partout au Canada. Le solide leadership des peuples autochtones en matière d'intendance des terres et des eaux dans un contexte de souveraineté autochtone est indispensable à nos efforts collectifs pour promouvoir le bien-être des personnes et de la planète. Nous demeurons déterminés à collaborer pour lutter contre les iniquités en santé à l'échelle du pays, créer un système de santé publique culturellement sécuritaire et appuyer l'autodétermination des peuples et des communautés autochtones.
Sommaire
Le bien-être prend de l'ampleur à l'échelle mondiale comme approche et objectif de politiques publiques communs, axés sur la création des conditions qui permettront aux générations actuelles et futures de prospérer sur une planète en santé. Cette approche établit un équilibre entre les priorités en matière de santé, de société, d'économie et d'environnement grâce à une mobilisation pansociétale. Au Canada, les gens font face à de nombreux défis liés au bien-être, y compris des conditions météorologiques extrêmes liées aux changements climatiques, des menaces liées aux maladies infectieuses, une crise liée aux drogues toxiques, l'augmentation du coût de la vie et des environnements numériques en évolution rapide. Une perspective de bien-être reconnaît qu'un travail concerté entre les secteurs est nécessaire pour aborder ces questions complexes et soutenir le bien-être individuel et collectif, aujourd'hui et pour l'avenir.
Le bien-être est également utilisé comme mesure du succès de la société, découlant d'une prise de conscience que les indicateurs économiques, comme le produit intérieur brut (PIB), ne permettent pas de saisir pleinement comment se porte la société. Plusieurs groupes ont élaboré des cadres de mesure du bien-être (p. ex. le Cadre de qualité de vie pour le Canada, l'Indicateur du Vivre Mieux de l'Organisation de coopération et de développement économiques). Ces cadres permettent de suivre plusieurs dimensions du bien-être, comme le revenu, le logement, l'emploi, l'environnement, l'éducation, la santé, la cohésion sociale et la satisfaction à l'égard de la vie. Étant donné que ces dimensions sont interreliées, l'amélioration du bien-être global nécessite une collaboration entre les différents secteurs.
Les peuples autochtones du monde entier sont depuis longtemps des leaders dans la promotion d'approches holistiques en matière de bien-être, qui sont relationnelles, fondées sur les forces et enracinées dans les liens avec le territoire et la nature. Les divers systèmes de connaissances sur le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont complexes et dynamiques, avec une histoire profonde qui revêt une grande valeur pour les approches en matière de bien-être. L'Organisation mondiale de la Santé définit le bien-être comme « un état positif vécu par les personnes et les sociétés. À l'instar de la santé, il constitue une ressource pour la vie quotidienne et est déterminé par des conditions sociales, économiques et environnementales. » Comme la santé et le bien-être sont étroitement liés, créer les conditions qui favorisent le bien-être peut également améliorer la santé de la population et l'équité en matière de santé. Les approches en matière de bien-être s'arriment bien avec les principaux aspects de la pratique en santé publique, y compris la promotion de la santé et l'accent mis sur l'action intersectorielle pour agir en amont sur les déterminants de la santé. Ce rapport examine des façons de mettre en commun les forces de la santé publique et du bien-être pour faire progresser les objectifs communs, en mettant en valeur les cadres de bien-être autochtones et occidentaux ainsi que des exemples d'initiatives menées par les gouvernements, les organisations et les communautés.
D'autres liens entre la santé publique et le bien-être sont explorés tout au long du rapport, qui se termine par La voie à suivre, une section qui met en évidence les possibilités d'action future par les personnes travaillant en santé publique pour promouvoir le bien-être des personnes et de la planète.
Les approches et cadres en matière de bien-être peuvent soutenir les priorités en santé publique de plusieurs façons :
- Le bien-être propose une vision positive de populations prospères et résilientes capables de réaliser leur plein potentiel. Cette approche axée sur les forces aide à mobiliser l'action en mettant l'accent sur les capacités et les ressources nécessaires pour que les communautés puissent promouvoir et maintenir la santé et le bien-être. Elle reconnaît également que le bien-être est une ressource universelle, qui est en harmonie avec les savoirs autochtones sur le bien-être.
- Une perspective de bien-être prend en compte à la fois les générations actuelles et futures tout en reconnaissant l'interdépendance du bien-être des humains, des animaux et de la planète. Cette perspective encourage l'atteinte d'un équilibre entre des priorités concurrentes dans la pratique, les politiques et la recherche en santé publique. Les peuples autochtones réclament depuis longtemps des transformations aux systèmes qui nuisent à la terre et compromettent le bien-être de génération en génération.
- Les cadres de bien-être facilitent l'action intersectorielle en mettant en lumière la manière dont un large éventail de facteurs sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux contribuent à la qualité de vie. Ils illustrent les interrelations entre ces facteurs et montrent comment l'amélioration des conditions sociétales dans un domaine peut avoir des effets positifs dans d'autres. Ainsi, le bien-être devient un objectif commun qui répond aux priorités de différents secteurs.
Les systèmes de santé publique peuvent s'appuyer sur leurs forces et leurs fonctions essentielles pour soutenir des initiatives axées sur le bien-être. Les domaines d'action pertinents comprennent :
- La recherche en santé publique sur les déterminants structurels de la santé explore comment les mécanismes sociétaux, économiques, écologiques et politiques influencent la répartition inéquitable du pouvoir et des ressources, ce qui affecte les conditions de vie quotidienne et les résultats en matière de santé. La compréhension de ces facteurs, notamment la colonisation, le racisme systémique, la transformation numérique et l'influence des pratiques commerciales, peut appuyer les initiatives axées sur le bien-être en s'attaquant aux facteurs structurels des iniquités sur le plan du bien-être.
- L'expertise des personnes œuvrant en santé publique en matière de surveillance des inégalités en santé pourrait également être mise à profit pour mesurer les inégalités liées au bien-être. Pour ce faire, il faut recueillir des données désagrégées, appliquer une optique d'équité et d'intersectionnalité et relever les défis persistants en matière de données, comme la nécessité d'améliorer les liens intersectoriels entre les ensembles de données. Les systèmes de santé publique peuvent également continuer à promouvoir la mobilisation communautaire dans la gestion des données et à soutenir la souveraineté des données autochtones.
- Les personnes travaillant en santé publique possèdent des connaissances et de l'expérience en matière d'action intersectorielle pour la santé, notamment en ce qui concerne la coordination des partenaires, l'intégration de la collaboration dans les modèles de financement et l'offre d'un soutien continu pour assurer la pérennité des initiatives. Ces forces sont étroitement alignées avec les approches de promotion de la santé et peuvent contribuer aux initiatives axées sur le bien-être. La santé publique peut également suivre le leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans l'établissement de relations entre les secteurs.
- Soutenir le bien-être des Autochtones en faisant progresser la réconciliation, la sécurité culturelle, l'autodétermination, la souveraineté et les droits des Autochtones, dans un contexte de relations durables et réciproques, constitue un rôle fondamental pour les systèmes de santé publique. Les personnes travaillant en santé publique au Canada peuvent engager un dialogue respectueux avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en tant que leaders d'opinion, universitaires et nations souveraines afin de promouvoir des approches en matière de bien-être qui s'appuient à la fois sur les systèmes de connaissances autochtones et occidentaux.
Introduction
Au Canada et partout dans le monde, le bien-être s'est imposé à la fois comme une approche et un objectif de politiques publiques pouvant favoriser des sociétés prospères sur une planète en santé, aujourd'hui et pour l'avenir. Les initiatives axées sur le bien-être créent des conditions propices à la résilience des personnes et des sociétés qui peuvent répondre aux défis actuels et émergents. Elles favorisent également une bonne qualité de vie, permettant aux gens et aux communautés de contribuer au monde de manière significative, avec un sentiment de sens et une raison d'êtreNote de bas de page 1.
Le bien-être est défini et compris de différentes manières dans différentes communautés et différents contextes (voir l'encadré « Utilisations du terme bien-être »). L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit le bien-être comme « un état positif ressenti par les personnes et les sociétés. À l'instar de la santé, c'est une ressource pour le quotidien et elle est déterminée par les conditions sociales, économiques et environnementales »Note de bas de page 2. Selon la définition de l'OMS, le bien-être est à la fois un état individuel et collectif. Elle reconnaît que le bien-être sociétal ne se limite pas à la somme des états individuels de bien-être. Cette définition s'harmonise avec des concepts et des approches similaires en santé publique, y compris les déterminants sociaux de la santé, la promotion de la santé et les approches sur la santé dans toutes les politiques (SdTP), entre autresNote de bas de page 2Note de bas de page 3Note de bas de page 4.
Utilisations du terme bien-être
Les usages du terme « bien-être » sont nombreux notamment en tant que concept, objectif, résultat, ensemble d'indicateurs, ressource ou encore perspective permettant d'orienter l'action. Dans le présent rapport, le bien-être est principalement utilisé pour décrire un but et une approche visant à orienter l'action. L'objectif du bien-être est multidimensionnel, intégrant des dimensions et des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux ainsi que de santé. Cette optique mène à des approches qui accordent la priorité à l'action intersectorielle et mettent en évidence les co-bénéfices de la collaboration sur les conditions favorables au bien-être des personnes et des sociétés.
La santé et le bien-être sont intrinsèquement liés. Une bonne santé contribue au bien-être général, et les conditions sociales qui favorisent le bien-être correspondent également aux conditions de la santé de la population et de l'équité en matière de santéNote de bas de page 5. Le programme de l'OMS sur le bien-être met l'accent sur le potentiel d'une approche du bien-être pour briser les cloisonnements et favoriser des approches pansociétales pour répondre à des enjeux sociétaux (voir la citation ci-dessou)Note de bas de page 5. Au Canada et partout dans le monde, les gens font face à un certain nombre de défis simultanés qui affectent leur bien-être, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques, des maladies infectieuses nouvelles ou réémergentes, l'augmentation du coût de la vie, la polarisation et les conflits sociaux, de même que les possibles préjudices associés à l'évolution rapide des environnements numériquesNote de bas de page 6Note de bas de page 7. En visant le bien-être, les politiques publiques et les programmes peuvent encourager l'adoption d'approches concertées de collaboration dans tous les secteurs de la société pour relever ces défisNote de bas de page 5. L'objectif est ici de mobiliser les forces collectives pour améliorer les conditions communautaires favorisant la résilience et la prospérité, aujourd'hui et pour l'avenirNote de bas de page 7.
« Le programme sur le bien-être vise à créer des conditions sociales, économiques et environnementales propices à la santé individuelle et collective, à la qualité de vie, à la prospérité, à la répartition équitable des ressources et à la durabilité de la planète. Les sociétés qui se concentrent sur cette idée de bien-être créent intentionnellement des communautés résilientes et autonomes, prêtes à surmonter les défis. » (OMS, 2021. Towards Developing WHO's Agenda on Well-Being. Traduction libre)
Bon nombre des conditions les plus importantes pour la santé et le bien-être, notamment les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, ne relèvent pas du secteur de la santé. Les changements sociaux rapides influencent de plus en plus ces facteurs, ce qui a des répercussions importantes sur la santé. Un bon exemple est la profonde transformation numérique des dernières années. Les déterminants numériques de la santé comprennent tout facteur associé au monde numérique ou dépendant de celui-ci qui peut influencer directement ou indirectement la santé ou le bien-êtreNote de bas de page 8Note de bas de page 9. L'omniprésence croissante des outils numériques dans de nombreux aspects de la vie quotidienne signifie que les déterminants numériques sont intégrés aux processus sociétaux, politiques et économiques qui ont une incidence sur la santéNote de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 10. Par exemple, les déterminants numériques sont liés aux déterminants commerciaux de la santé, soit les systèmes, les pratiques et les canaux par lesquels le secteur privé influence positivement ou négativement les résultats en matière de santéNote de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13. Les plateformes en ligne constituent des moyens par lesquels les gens interagissent avec des acteurs commerciaux et, par conséquent, avec des produits, des services et des stratégies de marketing qui peuvent améliorer ou compromettre la santé et le bien-êtreNote de bas de page 8Note de bas de page 9. L'élan autour du bien-être en tant qu'objectif pour l'action intersectorielle en matière de politiques publiques ouvre de nouvelles possibilités de collaboration pour la santé publique afin de prendre en compte ces déterminants ainsi que d'autres déterminants interreliés de la santé et du bien-être.
La santé publique et le bien-être sont des domaines interreliés, mais distincts. Bien qu'ils ont en commun de nombreux objectifs et priorités, chacun apporte une contribution unique pour améliorer la vie des personnes vivant au Canada. Ce rapport porte à la fois sur les façons dont les approches du bien-être peuvent contribuer à la santé publique (partie 2), ainsi que sur les moyens par lesquels les personnes œuvrant en santé publique peuvent contribuer aux initiatives axées sur le bien-être menées par d'autres (partie 3). Le rapport reconnaît également la diversité des systèmes de connaissances et l'importance du leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans la promotion des approches de bien-être. Les connaissances et les sciences autochtones en matière de bien-être sont profondément ancrées dans l'histoire et sont d'une grande richesse pour la compréhension et la réponse aux défis contemporains du bien-être.
Partie 1 : Concepts et approches en matière de bien-être
Le bien-être a été un catalyseur efficace pour l'action collaborative, en partie parce qu'il répond aux différents objectifs de diverses communautés et de différents secteurs de la sociétéNote de bas de page 4Note de bas de page 5. En tant que concept, le bien-être englobe les dimensions sanitaires, sociales, économiques et environnementales, en réunissant des indicateurs clés de différents secteurs. Ce faisant, le concept de bien-être intègre une diversité de priorités et met en évidence leur interdépendance, créant ainsi une plateforme commune propice à l'action intersectorielle.
Les communautés et les sociétés du monde entier ont des conceptions variées du bien-êtreNote de bas de page 14Note de bas de page 15Note de bas de page 16. Bon nombre de ces concepts et approches reposent sur une longue histoire et trouvent aujourd'hui tout un éventail d'applications contemporaines. Bien qu'elles ne puissent être examinées en détail dans le cadre du présent rapport, la section suivante traitera brièvement des origines de l'élan actuel autour du bien-être en tant qu'objectif sociétal, ainsi que de certaines façons dont les approches en matière de bien-être sont décrites, mesurées et mises en pratique par les principales organisations de bien-être au Canada et à l'étranger. Cette section traite également des systèmes de connaissances et des approches en matière de bien-être propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, qui précèdent de plusieurs millénaires les approches contemporaines du bien-être et offrent une base solide pour une action concertée en la matière au CanadaNote de bas de page 17Note de bas de page 18.
« Le bien-être, c'est se sentir en bonne santé physique et mentale, se sentir stable d'un point de vue social et financier et avoir la résilience nécessaire pour relever les défis de la vie. [...] En tant que personnes travaillant en santé publique, nous voulons contribuer à créer des environnements qui aident les gens à atteindre un sentiment de bien-être. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Remarque sur les termes « bien-être » et « mieux-être »
L'utilisation des termes « bien-être » et « mieux-être » évolue constamment selon les communautés et les contextes. Le terme « mieux-être » est souvent employé dans les contextes occidentaux pour désigner des comportements, des services ou des produits de consommation liés à l'autogestion de la santé, un sujet qui ne relève pas de la portée du présent rapportNote de bas de page 19. Parmi de nombreuses nations, populations et communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, le terme « mieux-être » est souvent utilisé pour décrire un équilibre holistique entre les aspects mental, physique, spirituel et émotionnel d'une bonne vie (voir la citation ci-dessous)Note de bas de page 20Note de bas de page 21. Certains leaders et organisations autochtones distinguent également le mieux-être, en tant que santé holistique, d'un concept plus vaste du bien-être qui comprend des dimensions physiques, économiques, politiques, sociales et culturellesNote de bas de page 22. Le présent rapport utilisera le terme « bien-être » partout, à l'exception de certaines descriptions d'initiatives autochtones qui utilisent le terme « mieux-être » pour décrire un état positif, holistique et multidimensionnel de l'être, ou pour rester fidèle à la terminologie employée dans les documents sources.
« D'un point de vue autochtone, le mieux-être est un concept fondé sur la force, car toute forme de vie a un esprit. L'esprit constitue le cœur de l'orientation de la vie pour chaque être humain et pour les autres êtres, y compris la terre et la nature, l'environnement et tous les êtres de l'univers. Ainsi, nous sommes tous liés… nous avons tous un esprit et une identité qui donnent sens à notre existence et oriente notre raison d'être. Ce fondement est porteur de force. Peu importe les changements dans l'environnement, dans la communauté ou dans la société, ou encore dans la santé et le mieux-être des personnes, cette force demeure, parce qu'elles ont un esprit. Et l'esprit, lui, est toujours orienté vers le bien-être. »
– Carol Hopkins, directrice générale, Thunderbird Partnership Foundation.
Origines des initiatives internationales axées sur le bien-être
Une grande partie de l'élan actuel autour du bien-être en tant que concept et objectif de politiques publiques a été déclenchée par les graves crises interreliées auxquelles font face les sociétés dans le monde. On reconnaît de plus en plus que des interventions à l'échelle de la société sont nécessaires pour relever ces défis complexesNote de bas de page 4. Les populations sont plus en mesure de prévenir, de résister, de se rétablir et de se transformer à la suite d'une crise lorsque les conditions favorables au bien-être des personnes et des communautés sont en placeNote de bas de page 23Note de bas de page 24.
Le bien-être, en tant que ressource importante pour la résilience, peut aussi incarner une vision à long terme de changement positif. Comme objectif de politiques publiques, il offre une occasion de redéfinir la façon dont la réussite sociale est mesurée et comprise, tant en période de crise qu'en d'autres circonstancesNote de bas de page 25. En tant que mesure du statut de la société, le bien-être a pris de l'importance en partie en raison du mouvement « au-delà du PIB », qui met l'accent sur les limites de l'utilisation du produit intérieur brut (PIB) et d'indicateurs économiques semblables pour comprendre et suivre l'état d'une sociétéNote de bas de page 25Note de bas de page 26. Par exemple, le PIB ne tient pas compte des activités non marchandes (p. ex. les tâches domestiques non rémunérées, la prestation de soins par des proches aidants, le bénévolat) ni de la répartition inéquitable des ressources économiquesNote de bas de page 26Note de bas de page 27Note de bas de page 28. Le PIB ne tient pas compte non plus de l'infrastructure sociale, comme le développement communautaire, ni des coûts possibles de la croissance économique pour la société, la santé et l'environnementNote de bas de page 26Note de bas de page 29.
Le mouvement « au-delà du PIB » a donné naissance à plusieurs initiatives visant à mieux mesurer ou orienter l'action politique sur le bien-être de la société. Parmi celles-ci, citons l'Indice canadien du mieux-être et le Cadre de qualité de vie pour le CanadaNote de bas de page 30Note de bas de page 31. À l'échelle internationale, l'OMS et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont accordé la priorité au bien-être, reconnaissant que son potentiel est à la fois un objectif et une approche pour améliorer les conditions socialesNote de bas de page 4Note de bas de page 5. Les objectifs de développement durable des Nations Unies qui appellent les responsables des décisions politiques à protéger les écosystèmes, à promouvoir l'équité et à privilégier le développement inclusif à long terme sont également alignés avec les approches en matière de bien-êtreNote de bas de page 32. Le bien-être a d'ailleurs été explicitement reconnu comme une priorité par l'OMS dans la Charte de Genève pour le bien-être (2021), qui met de l'avant l'importance de bâtir des « sociétés du bien-être » fondées sur l'équité en santé et la durabilité de la planète, au bénéfice des générations présentes et futuresNote de bas de page 3. Dans ces initiatives, le bien-être peut être considéré comme un ensemble de résultats à atteindre (c.-à-d. les dimensions du bien-être) et comme une structure conceptuelle permettant d'orienter les processus vers le bien-être (c.-à-d. les approches en matière de bien-être). Au cœur de ces initiatives se trouve la reconnaissance du fait que tous les secteurs jouent un rôle dans la création des conditions nécessaires au bien-être de la sociétéNote de bas de page 3Note de bas de page 5Note de bas de page 33.
Cadres, dimensions et indicateurs du bien-être
Le bien-être est généralement considéré comme un concept vaste, avec de nombreuses dimensions qui comprennent chacune une combinaison de résultats ou de facteurs. Les communautés, les organisations et les gouvernements ont élaboré divers cadres de bien-être adaptés aux priorités et contextes locauxNote de bas de page 30Note de bas de page 31Note de bas de page 33Note de bas de page 34. Ces cadres servent à plusieurs fins différentes, comme élaborer un concept de bien-être défini localement, fournir des structures pour mesurer et surveiller les indicateurs du bien-être, ou encore catalyser ou évaluer l'action intersectorielle sur les conditions de bien-être.
Bien que les détails des cadres varient, on retrouve souvent des éléments communs qui représentent les conditions nécessaires à la prospérité des personnes et des communautésNote de bas de page 16. Ces éléments comprennent un revenu et un logement adéquats, des emplois et une éducation de qualité, une bonne santé physique et mentale, une forte cohésion sociale et des liens sociaux solides, un sentiment de sécurité, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu'un accès à la démocratie et à la justiceNote de bas de page 16Note de bas de page 33Note de bas de page 35. Une approche axée sur le bien-être englobe également les nécessités de la survie humaine et planétaire immédiate et à long terme, comme la salubrité de l'air, de l'eau et des aliments, ainsi que la protection de l'environnement et la durabilitéNote de bas de page 16Note de bas de page 33Note de bas de page 35. Les cadres de bien-être peuvent inclure à la fois les déterminants et les résultats, puisque certains facteurs influencent le bien-être tout en constituant eux-mêmes des résultats importants en matière de bien-être (p. ex. l'emploi, le logement)Note de bas de page 35.
Les cadres d'indicateurs du bien-être mettent l'accent sur les aspects mesurables des résultats et des déterminants du bien-être. Ils intègrent généralement des données subjectives sur la qualité de vie perçue ainsi que des mesures objectives des déterminants du bien-être. Bien que la satisfaction à l'égard de la vie soit parfois utilisée comme indicateur du bien-être global, les initiatives de politiques publiques l'incluent généralement parmi un large éventail d'indicateursNote de bas de page 5Note de bas de page 35. Les mesures subjectives sont centrées sur le bien-être personnel ou individuel, tandis qu'une évaluation du bien-être sociétal nécessite un examen général des dimensions sociales, économiques, environnementales et de santé ainsi que d'autres facteurs comme l'équité, la durabilité planétaire et les générations futuresNote de bas de page 5Note de bas de page 16. Cette approche globale reconnaît que le bien-être de la société ne se limite pas à la somme des états de bien-être individuelNote de bas de page 5. Les cadres conceptuels du bien-être accordent également souvent une place importante à la question de l'accès aux conditions nécessaires au bien-êtreNote de bas de page 16. Cet aspect pourrait comprendre l'évaluation des iniquités en matière de bien-être et des différences dans les conditions de bien-être d'une population à l'autreNote de bas de page 35Note de bas de page 36.
Le Cadre de qualité de vie pour le Canada et l'Indicateur du Vivre Mieux de l'OCDE sont deux exemples pertinents de cadres de bien-êtreNote de bas de page 35Note de bas de page 37.
Cadre de qualité de vie pour le Canada
Le Cadre de qualité de vie pour le Canada a été conçu pour mesurer ce qui compte le plus pour les gens au CanadaNote de bas de page 35. Il évalue les dimensions du bien-être à l'aide de 91 indicateurs répartis dans cinq domaines et complétés par trois indicateurs centraux : la satisfaction à l'égard de la vie, le sentiment de sens et de but à la vie, et la vision de l'avenir. La diversité des domaines et sous-domaines couverts par ce cadre est illustrée à la figure 1, qui présente également deux perspectives transversales : équité et inclusion, et durabilité et résilienceNote de bas de page 31Note de bas de page 35. Voir l'encadré « Données sur les indicateurs de bien-être tirées du Cadre de qualité de vie pour le Canada » pour une sélection représentative des données subjectives et objectives en matière de bien-être provenant du Carrefour de la qualité de vie. L'annexe A contient plus de détails sur l'élaboration du cadre, son utilisation dans la budgétisation et son rôle dans les processus décisionnels fédéraux.

Figure 1 : Texte descriptif
Aperçu du Cadre de qualité de vie pour le Canada
- Indicateurs centraux : Satisfaction à l'égard de la vie; sentiment de sens et de but à la vie; et vision de l'avenir.
- Prospérité : Revenu des ménages; emploi; jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation; besoins essentiels en matière de logement; logement acceptable; pauvreté; et joindre les deux bouts.
- Saine gouvernance : Perceptions de la sécurité du quartier après la tombée de la nuit; confiance à l'égard des institutions; et discrimination et traitement injuste.
- Santé : Santé mentale perçue; santé perçue.
- Société : Sentiment d'appartenance à une collectivité locale; quelqu'un sur qui compter; confiance à l'égard des autres; et satisfaction à l'égard de l'utilisation du temps.
- Environnement : Qualité de l'air; eau potable; émissions de gaz à effet de serre; et aires conservées.
- Volets transversaux : Équité et inclusion; et durabilité et résilience.
Données sur les indicateurs de bien-être tirées du Cadre de qualité de vie pour le Canada
Satisfaction à l'égard de la vie, sentiment de sens et de but à la vie, et vision de l'avenir :
- En 2024, moins de la moitié (49 %) des personnes vivant au Canada se disaient très satisfaites de leur vie, comparativement à 54 % en 2021. Les jeunes adultes (25 à 34 ans) et les personnes racisées ont connu une baisse plus marquée de la satisfaction à l'égard de la vie que les adultes plus âgés et les personnes non racisées. En particulier, la proportion de personnes racisées ayant une grande satisfaction à l'égard de la vie a diminué de plus de cinq fois comparativement aux personnes non racisées au cours de cette périodeNote de bas de page 38.
- Le sentiment d'espoir envers l'avenir et le sentiment de sens et de but à la vie ont également diminué entre 2021 et 2024 (de 63 % à 56 % et de 59 % à 57 %, respectivement)Note de bas de page 39Note de bas de page 40.
Prospérité :
- En 2024, 45 % des personnes ont déclaré avoir de la difficulté à faire face aux dépenses quotidiennes, comparativement à 33 % en 2022. Plus de la moitié (55 %) des personnes âgées de 25 à 44 ans ont indiqué que la hausse des prix leur causait des difficultés financières en 2024, comparativement à 28 % des personnes âgéesNote de bas de page 41.
- En 2022, 22 % des ménages vivaient dans un logement inabordable, les locataires étant deux fois plus susceptibles de consacrer plus de 30 % de leur revenu aux coûts du logement que les propriétaires (33 % contre 16 %)Note de bas de page 42.
Saine gouvernance :
- La proportion de personnes au Canada qui font confiance aux institutions publiques (p. ex. la police, le système de justice, le système scolaire, les médias canadiens, le parlement fédéral) a diminué dans l'ensemble entre 2020 et 2024Note de bas de page 43Note de bas de page 44. En 2023, les personnes au Canada ayant des difficultés financières étaient plus susceptibles d'avoir une faible confiance dans les institutions (81 %) que celles qui n'en avaient pas (61 %)Note de bas de page 45.
- De 2021 à 2024, 51 % des personnes racisées ont déclaré avoir été victimes de discrimination ou de traitement injuste au cours des cinq dernières années, comparativement à 27 % des personnes non raciséesNote de bas de page 46.
Santé :
- Après trois années de déclin, l'espérance de vie à la naissance au Canada est passée de 81,3 ans en 2022 à 81,7 ans en 2023, demeurant toutefois inférieure à l'espérance de vie prépandémique de 82,2 ans en 2019Note de bas de page 47.
- Bien que la plupart des gens au Canada déclarent avoir une « très bonne » ou une « excellente » santé mentale perçue, cette proportion est passée de 68 % en 2018 à 55 % en 2022. Les femmes demeurent moins nombreuses à déclarer avoir une santé mentale positive que les hommes. Cette mesure est demeurée en grande partie inchangée en 2023 (54 %)Note de bas de page 48.
- En 2023, la plupart des personnes au Canada ont déclaré avoir accès à un prestataire de soins de santé régulier (83 %), une proportion à la baisse par rapport à 2022 (85 %)Note de bas de page 49.
Environnement :
- De 2020 à 2022, 74 % des gens vivaient dans des régions qui respectaient les normes de qualité de l'air, une baisse par rapport à 85 % entre 2019 et 2021, en partie en raison des feux de forêt survenus en 2022 en Colombie-Britannique et aux États-UnisNote de bas de page 50. La fréquence des catastrophes climatiques a augmenté au cours des deux dernières décennies, y compris les feux de forêt qui nuisent à la qualité de l'airNote de bas de page 51.
Société :
- À la fin de 2024, près des trois quarts (73 %) des personnes au Canada déclaraient avoir toujours ou souvent quelqu'un sur qui compter. En comparaison, 18 % disaient avoir parfois quelqu'un sur qui compter lorsqu'elles en ont vraiment besoin, tandis que 9 % indiquaient pouvoir rarement ou jamais compter sur quelqu'unNote de bas de page 52. En 2022, les jeunes (15 à 24 ans) et les adultes âgés de 75 ans et plus ont déclaré des niveaux de soutien plus élevés que les autres groupes d'âgeNote de bas de page 53.
- Un fort sentiment d'appartenance communautaire était associé à une plus grande confiance en l'avenir ainsi qu'à une meilleure santé physique et mentaleNote de bas de page 54. À la fin de 2024, plus de la moitié (54 %) des personnes au Canada déclaraient avoir un fort sentiment d'appartenance à leur communauté localeNote de bas de page 55.
Bon nombre des indicateurs du Cadre de qualité de vie pour le Canada concordent avec ceux qui sont traditionnellement utilisés dans la surveillance de la santé de la population. Toutefois, certains indicateurs, comme l'espoir envers l'avenir ou la confiance à l'égard des institutions publiques, peuvent être moins courants dans la pratique de la santé publiqueNote de bas de page 56. Ces données offrent néanmoins des renseignements précieux sur les tendances nationales liées aux différentes dimensions du bien-être. Bien que les personnes au Canada jouissent généralement d'une longue vie en santé, les baisses récentes observées dans la satisfaction à l'égard de la vie, l'espoir, la santé mentale autodéclarée et la capacité à assumer les dépenses quotidiennes soulignent la nécessité d'une collaboration intersectorielle pour comprendre les facteurs et les conséquences de ces tendancesNote de bas de page 38Note de bas de page 39Note de bas de page 41Note de bas de page 57. Les données peuvent également être croisées entre les domaines pour mettre en lumière les liens entre les principaux indicateurs. Par exemple, de 2021 à 2024, 59 % des personnes sans difficulté financière avaient un niveau élevé de satisfaction à l'égard de leur vie, comparativement à 29 % de celles qui éprouvaient des difficultés financièresNote de bas de page 58. L'analyse de ces indicateurs révèle également des iniquités importantes dans les résultats en matière de bien-être. Par exemple, en combinant neuf indicateurs du Cadre de qualité de vie pour créer un score global de bien-être perçu, on a constaté que les adultes âgés, les personnes sans problème de santé de longue durée et les personnes qui ne s'identifient pas comme des personnes 2ELGBTQI+ ont une perception plus élevée de leur bien-être en 2021 et 2022, comparativement aux autres groupes d'âge, aux personnes vivant avec un problème de santé de longue durée et aux personnes 2ELGBTQI+Note de bas de page 59.
Indicateur du Vivre Mieux de l'OCDE
L'OCDE a lancé son cadre de bien-être en 2011, soulignant la nécessité de bâtir des économies axées sur le bien-êtreNote de bas de page 60. Une économie du bien-être est une économie qui accorde la priorité au bien-être humain, social, planétaire et économique en augmentant les possibilités pour les personnes d'améliorer leur vie, en réduisant les iniquités et en favorisant la durabilité environnementale et socialeNote de bas de page 61Note de bas de page 62. L'Indicateur du Vivre Mieux de l'OCDE repose sur 24 indicateurs pour mesurer 11 thèmes liés au bien-être des pays membresNote de bas de page 37. Selon les résultats de 2024, le Canada se classe au-dessus de la moyenne de l'OCDE dans sept des onze dimensions du bien-êtreNote de bas de page 63. Fait à noter, 89 % des personnes au Canada ont déclaré que leur santé était « bonne » ou « très bonne », l'un des taux les plus élevés parmi les pays de l'OCDENote de bas de page 63. L'OCDE soutient la recherche et l'action en matière de politiques publiques en faveur du bien-être par l'entremise de son Centre pour le bien-être, l'inclusion, la durabilité et l'égalité des chances, ainsi que par l'intermédiaire de sa plateforme d'échange de connaissances sur les indicateurs de bien-être et les pratiques politiquesNote de bas de page 64Note de bas de page 65.
Approches en matière de bien-être
Bien que les cadres d'indicateurs du bien-être mettent l'accent sur le bien-être en tant que résultat multidimensionnel, on reconnaît également la nécessité d'adopter de nouvelles approches intersectorielles pour y parvenir. Par conséquent, le bien-être ne constitue pas seulement un objectif, mais aussi une manière différente de collaborer. Malgré la diversité des initiatives axées sur le bien-être, un certain nombre de caractéristiques reviennent fréquemment, notamment :
- une vision positive de la santé qui englobe les dimensions physique, mentale, spirituelle et sociale;
- un équilibre dans les priorités en matière de santé, de société, d'économie et d'environnement pour les générations actuelles et futures;
- une action intersectorielle dans toutes les dimensions, mettant l'accent sur les co-bénéfices entre les secteursNote de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 27Note de bas de page 66Note de bas de page 67.
Des approches en matière de bien-être ont été appliquées partout au Canada et dans le monde par différents ordres de gouvernement. Un certain nombre de gouvernements centraux, du pays de Galles, de la Finlande et de l'Écosse notamment, ont intégré le bien-être dans leurs modèles de gouvernance, ce qui s'est traduit par des transformations dans la législation, l'élaboration de politiques et les processus budgétaires (les défis et les possibilités associés à ces approches sont détaillés à l'annexe A)Note de bas de page 34. Par exemple, un budget axé sur le bien-être place la qualité de vie et le bien-être de la population et de la planète au cœur des politiques économiques et budgétaires des gouvernementsNote de bas de page 68Note de bas de page 69. Ces initiatives visent à mobiliser les différents secteurs afin de faire du bien-être de la population et de la planète une priorité commune dans les processus décisionnels gouvernementauxNote de bas de page 34. L'intérêt croissant pour le bien-être a également amené les gouvernements municipaux à adopter de nouvelles approches. L'encadré « Initiatives municipales pour le bien-être au Canada : ce que nous avons appris » décrit différentes façons dont les municipalités ont intégré le bien-être comme objectif commun pour favoriser l'action intersectorielle et proposer des solutions adaptées aux communautés. Les personnes travaillant en santé publique peuvent appuyer et contribuer à l'action municipale sur les conditions locales favorisant la santé et le bien-être. Un certain nombre d'initiatives locales sont présentées dans le rapport et détaillées à l'annexe A.
« On entend souvent les municipalités dire : "Bien sûr, les trottoirs et l'infrastructure sont importants, mais on veut aussi s'occuper de l'humain qui marche sur notre trottoir". »
– Extrait d'entrevue (initiative axée sur le bien-être)
Initiatives municipales pour le bien-être au Canada : ce que nous avons appris
En 2024, le Bureau de l'administratrice en chef du Canada a mandaté des entrevues auprès d'un certain nombre de municipalités engagées dans des initiatives axées sur le bien-être. Ces initiatives comprenaient un large éventail de stratégies et d'interventions visant à améliorer les conditions locales de bien-être. Par exemple, en 2024, la Ville de North Vancouver a élaboré une stratégie du bien-être communautaire avec l'apport de la santé publique. Cette stratégie a permis la création d'un cadre de politiques publiques rigoureux pour appuyer des projets favorisant l'équité et les liens sociaux, éclairer les décisions futures et rassembler les partenaires autour d'objectifs communs afin d'améliorer le bien-être collectifNote de bas de page 70. Elle propose également des trajectoires accompagnées de tactiques de soutien, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, le logement, les liens communautaires ainsi que l'équité et l'inclusionNote de bas de page 70.
Adoptant une approche différente, la Ville d'Edmonton s'est associée à des leaders communautaires et à des personnes ayant vécu l'itinérance pour promouvoir le bien-être des populations du centre-ville par l'entremise de Recover EdmontonNote de bas de page 71. Recover a utilisé une approche de recherche sociale et de co-conception pour créer et tester des solutions novatrices pour répondre aux défis auxquels leurs communautés font face, ce qui a mené à des améliorations dans les résultats liés au bien-être rapportés par les personnes participantes, comme la création de liens avec les amis, la famille et la communautéNote de bas de page 71Note de bas de page 72. Le cadre de bien-être Recover a également été intégré à la stratégie de sécurité et de bien-être de la communauté d'Edmonton, ce qui reflète une certaine intégration des concepts de bien-être définis par la communauté dans les décisions politiquesNote de bas de page 73.
Les personnes œuvrant au sein d'initiatives municipales de partout au pays ont insisté sur la façon dont l'accent mis sur le bien-être a favorisé l'adhésion et l'enthousiasme des partenaires intersectoriels. Ils ont insisté sur l'importance d'un leadership engagé et le rôle essentiel de la consultation et de la mobilisation des communautés dans l'élaboration de stratégies et d'interventions en matière de bien-être adaptées aux priorités et aux contextes locaux. Elles ont également discuté d'un certain nombre de défis liés à la pérennité des initiatives, notamment le roulement du personnel de direction, les cycles de financement à court terme, l'accent mis sur les résultats immédiats, les priorités concurrentes et la nécessité de répondre à des enjeux émergents comme la pandémie de COVID-19. La promotion et l'évaluation d'interventions complexes, intersectorielles et en amont en matière de bien-être requérant beaucoup de temps et de ressources, un engagement soutenu en faveur du changement à long terme est nécessaire.
« Parfois, nous participons à l'élaboration de la stratégie, [...] d'autres fois, nous jouons un rôle d'expert-conseil. Cela dépend du contexte propre à chaque administration municipale. En tant que spécialistes en santé publique, notre rôle est avant tout de soutenir le gouvernement local dans sa réussite. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Les peuples autochtones du monde entier sont depuis longtemps des leaders dans la promotion d'approches holistiques du bien-être. Ces approches sont ancrées dans des systèmes de connaissances autochtones qui mettent l'accent sur notre responsabilité envers l'environnement et la préservation des liens avec la terre et la nature. Par exemple, le concept autochtone andin de Buen Vivir (« bien vivre ensemble ») a été intégré à la constitution équatorienne et aux plans nationaux de développement dans le but de placer le bien-être des personnes et de la nature au cœur de ses politiquesNote de bas de page 74. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada ont également réalisé des avancées importantes en appliquant les savoirs autochtones à la promotion du bien-être dans divers contextes et communautés (voir l'annexe A et les exemples présentés dans les sections ci-dessous pour une description de certaines approches autochtones du bien-être au Canada). Les systèmes de connaissances autochtones sur le bien-être ont été élaborés au fil des millénaires et diffèrent souvent des approches et des cadres occidentaux en matière de bien-êtreNote de bas de page 22. Lorsque les initiatives occidentales ne tiennent pas compte des priorités et des approches autochtones, elles risquent de perpétuer des torts en aggravant les iniquités systémiquesNote de bas de page 17. Cependant, il existe aussi des points de convergence entre les concepts et les approches autochtones et occidentaux en matière de bien-être. Ils offrent des occasions de dialogue et de collaboration pour promouvoir le bien-être à la jonction entre différents systèmes de connaissancesNote de bas de page 17.
Concepts de bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis
Les systèmes de connaissances sur le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont complexes, dynamiques et profondément ancrés dans l'histoire. Ils sont porteurs d'une grande richesse pour comprendre les enjeux contemporains du bien-être et y apporter des réponses pertinentesNote de bas de page 21Note de bas de page 75Note de bas de page 76Note de bas de page 77Note de bas de page 78.
Le Canada compte une grande diversité de populations et de nations autochtones, chacune ayant des cultures, des langues, des géographies, des histoires, des systèmes politiques, des gouvernements, des expériences et des priorités distinctes qui façonnent les connaissances et les pratiques en matière de bien-êtreNote de bas de page 22. Il existe toutefois des convergences entre ces différentes conceptions autochtones du bien-être, telles qu'une approche holistique, fondée sur les forces, et une compréhension du bien-être comme intrinsèquement collective et relationnelleNote de bas de page 20Note de bas de page 79Note de bas de page 80. Le bien-être est souvent considéré comme un équilibre entre des dimensions mentales, émotionnelles, spirituelles et physiques, toutes interreliéesNote de bas de page 81. Les modèles autochtones de bien-être sont fondés sur l'idée que le bien-être individuel est indissociable du bien-être de la famille, de la communauté, de la société, de la terre et de la natureNote de bas de page 82. La dimension relationnelle du bien-être autochtone s'inscrit aussi dans une perspective du parcours de vie et une vision intergénérationnelle, ancrées dans un profond respect pour les ancêtres et les générations futuresNote de bas de page 83Note de bas de page 84Note de bas de page 85. Le partage de la nourriture est un exemple de la façon dont la vision collective du monde est mise en pratique. Le partage d'aliments traditionnels ou locaux contribue à la sécurité alimentaire, à la santé et au bien-être, tout en renforçant les liens culturels et en soutenant les efforts de gestion responsable et de protection de l'environnementNote de bas de page 86Note de bas de page 87.
Pour de nombreux peuples autochtones, la terre, la culture et la langue sont au cœur du bien-être, à la fois comme sources de connaissances et d'enseignements sur comment bien vivre, ainsi que comme déterminants du bien-être en soi. Les cultures et les systèmes de connaissances autochtones sont souvent ancrés dans le territoire, enracinés dans des relations profondes et des responsabilités envers la terre et l'eauNote de bas de page 22Note de bas de page 88. Pour beaucoup, le territoire est au cœur de toutes les autres dimensions du bien-être : il est source de culture, de langue et d'identité, et son bien-être est indissociable de celui des peuples autochtonesNote de bas de page 22Note de bas de page 82. L'accès à des territoires relativement intacts permettant la participation à des activités culturelles, la gestion responsable de l'environnement et la durabilité pour les générations futures est essentiel au bien-être des AutochtonesNote de bas de page 22.
Les langues autochtones jouent un rôle central dans la santé, l'identité et l'autodétermination des peuples autochtonesNote de bas de page 89Note de bas de page 90. Plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada, ce qui représente une riche diversité de cultures, de savoirs et de visions du mondeNote de bas de page 91. Ces langues, souvent axées sur les verbes, les actions et les forces, tendent à éviter les expressions qui mettent l'accent sur les lacunesNote de bas de page 92Note de bas de page 93. Plus que de simples moyens de communication, ces cadres linguistiques permettent d'exprimer des lois, des principes, des rôles, des responsabilités et des droits, et de relier les gens à leurs territoires et à leurs ancêtresNote de bas de page 77Note de bas de page 92. Les langues autochtones favorisent la compréhension des concepts et principes fondamentaux du bien-être, qui ne sont pas directement transposables en anglais ou en français. Les mots influencent la réflexion et jettent les bases de la recherche, des politiques et des programmes sur le bien-être autochtoneNote de bas de page 94Note de bas de page 95.
Un certain nombre de langues autochtones ont des termes uniques pour exprimer la nature collective du bien-être. Par exemple, le groupe de travail autochtone du rapport de l'ACSP de 2025 a partagé les termes suivants (voir l'annexe B pour une description du groupe de travail) :
- kaa-wiichihitoyaahk : Mot en michif qui signifie « nous prenons soin les uns des autres ».
- Piliriqatiginniq ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓐᓂ : Mot en inuktitut qui se traduit approximativement par « travailler pour le bien commun ou au profit de la collectivité ».
- Mino Bimaadiziwin : Mot anichinabé et concept philosophique décrivant un sentiment collectif de bien-être et de « bonne vie »Note de bas de page 96Note de bas de page 97Note de bas de page 98.
- Aama didils : Mot qui désigne le bien-être ou la bonne vie en langue nisga'a.
Les systèmes de connaissances autochtones, repris par des recherches occidentales, ont mis en évidence plusieurs déterminants importants de la santé et du bien-être des Autochtones : la connaissance de la langue, les liens culturels, un fort sentiment d'identité culturelle, un sentiment d'appartenance, le lien avec le territoire, les liens familiaux et communautaires, et une image positive de soi Note de bas de page 82Note de bas de page 99Note de bas de page 100Note de bas de page 101Note de bas de page 102Note de bas de page 103Note de bas de page 104Note de bas de page 105Note de bas de page 106Note de bas de page 107. La réconciliation, l'autodétermination et la souveraineté sont reconnues comme des voies vers le bien-être autochtone qui peuvent être appuyées par la mise en œuvre des droits autochtonesNote de bas de page 22Note de bas de page 108. La souveraineté autochtone fait référence au pouvoir et au droit inhérents des peuples autochtones de se gouverner eux-mêmes, de prendre des décisions concernant leurs territoires, leurs cultures et leurs ressources, et d'exercer leur autodétermination sans ingérence extérieureNote de bas de page 109Note de bas de page 110. Au Canada, la mise en œuvre des droits autochtones est enchâssée dans la Constitution, notamment à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui traite des droits ancestraux et droits issus de traités. La mise en œuvre des droits des Autochtones s'appuie également sur des cadres juridiques, comme la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, discutés plus en détail dans la partie 3Note de bas de page 111. Au-delà de ces obligations légales, toutes les personnes au Canada ont la responsabilité de contribuer aux processus de réconciliation, en favorisant des relations renouvelées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis fondées sur la reconnaissance des droits, le respect et les partenariatsNote de bas de page 112.
Les peuples autochtones ont activement résisté à la colonisation, à la dépossession de leurs terres et de leurs cultures, au racisme systémique ainsi qu'à l'exclusion de leurs savoirs et de leur leadership des processus décisionnels. Grâce à cette résistance, ils ont pu préserver et transmettre les savoirs autochtones de génération en générationNote de bas de page 21Note de bas de page 22Note de bas de page 113. Les leaders autochtones revendiquent, revitalisent, développent et mettent en œuvre activement ces visions du monde relationnelles par des approches novatrices et transformatrices en matière de gouvernance, de politiques, de prestation de services, de gestion des données et de recherche au sein des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada (voir la partie 2 et l'annexe A pour des exemples d'initiatives axées sur le bien-être dirigées par les Autochtones).
L'art et les récits autochtones sont au cœur de la création et de la transmission des valeurs du bien-être et des connaissances au fil du temps. La section intitulée « L'art au service des enseignements autochtones sur le mieux-être » donne à voir une galerie d'œuvres d'art originales de la Dre Lisa Boivin illustrant les enseignements autochtones en matière de mieux-être.
L'art au service des enseignements autochtones sur le mieux-être
Unravelling the Whispers of Ancestors (Délier les chuchotements des Ancêtres)

Description de l'image
Illustration d'une jeune femelle bœuf musqué entourée d'un motif floral circulaire composé de fleurs colorées, de feuilles et d'un papillon.
Sur cette image, la jeune femelle bœuf musqué lève les yeux vers le ciel avant de s'endormir. Le cercle qui l'entoure évoque la manière dont la santé, dans les perspectives autochtones, s'étend au monde circulaire dans lequel nous vivons, un écosystème interconnecté et florissant où tous les êtres peuvent prospérer. La jeune bœuf musqué entend les chuchotements des Ancêtres, des récits que seuls les bébés peuvent entendre parce qu'ils sont racontés par les Ancêtres. En tant que peuples autochtones, nous portons en nous des savoirs et des récits ancestraux, qui constituent notre résilience face à la violence coloniale. Même si, bébés, nous sommes trop jeunes pour comprendre les mots, le sens profond des récits ancestraux résonne déjà en nous. Les bébés doivent être laissés en paix lorsqu'ils sont dans un état de tranquillité, car c'est dans ce moment sacré qu'ils reçoivent les sagesses des Ancêtres. Dans le cercle de l'image, un petit papillon repose à gauche de la jeune bœuf musqué. Le papillon, symbole de transformation, incarne aussi la légèreté de la jeunesse. En prêtant attention aux paroles libres des jeunes, nous ouvrons la voie à la transformation de nos pensées d'« adultes ». Le papillon nous enseigne à respecter la vitalité et le savoir des jeunes, à accueillir leurs perspectives et à remettre en question les modèles âgistes de santé publique. Les jeunes sont essentiels pour transformer notre système de santé publique, et notre monde.
Muskox Matriarch (Bœuf musqué matriarche)

Description de l'image
Illustration d'une Aînée et d'un jeune bœuf musqué se faisant face sur la toundra enneigée, avec une petite fleur de renoncule glaciaire fleurissant entre eux.
La fin de l'hiver et le début du printemps sont des périodes critiques pour la survie du bœuf musqué. Les bébés naissent sur des terres encore couvertes de neige, tandis que certains membres âgés du troupeau ne verront pas l'année suivante. Selon les savoirs autochtones, tous les êtres sont les plus proches du Créateur juste après leur naissance et juste avant leur mort. Dans cette image, une Aînée bœuf musqué (qui est sur le point de mourir) salue le plus jeune membre du troupeau. L'image illustre la transmission intergénérationnelle du savoir, une leçon de résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui a de profondes implications pour la santé publique et le bien-être des Autochtones. La renoncule glaciaire, une fleur qui s'épanouit dans les conditions les plus rudes, perce la neige et incarne le passage des saisons dans la splendeur du Nord. La toundra est parfois perçue comme un milieu aride et inhospitalier aux yeux des non-initiés – souvent non autochtones. Les peuples autochtones ont toujours entretenu une connaissance profonde des territoires et des milieux où, en tant que peuples, nous avons prospéré depuis des temps immémoriaux. Nous apprenons de la riche végétation qui soutient un écosystème prospère. La culture autochtone, comme la toundra, est trop souvent perçue comme dépourvue de ressources. Mais avec attention et respect, on découvre, comme dans les fleurs de la toundra, des forces nourricières qui ont soutenu, et continueront de soutenir, les peuples et les populations autochtones pendant des millénaires.
Our Sacred Circle (Notre cercle sacré)

Description de l'image
Illustration de trois bœufs musqués adultes sur la toundra enneigée entourant un veau pour le protéger, sous les aurores boréales et un ciel étoilé.
Lorsqu'ils sont attaqués par leurs prédateurs naturels, les loups arctiques, les bœufs musqués forment un cercle défensif. Les bœufs musqués adultes avancent en tête, les veaux bien protégés, au centre. Cette formation défensive, bien qu'inefficace contre les chasseurs humains, demeure intacte : le cercle (sacré) du bœuf musqué ne se brise pas, car le bœuf musqué n'abandonne jamais sa famille attaquée. Le cercle de l'image et de la formation défensive des bœufs musqués nous rappelle l'importance des liens communautaires dans la préservation de la santé et des pratiques de guérison. Le bœuf musqué nous encourage à sortir de notre solitude et à tisser des liens avec les autres. Les troupeaux de bœufs musqués incarnent l'importance de la coopération et de l'harmonie. Le bœuf musqué, qui survit aux rigueurs de l'Arctique, nous enseigne qu'il est possible de s'épanouir même dans l'adversité. Le bœuf musqué nous appelle à unir nos forces pour reconnaître et surmonter les torts coloniaux passés, présents et futurs.
Hummingbird Medicine (Médecine du colibri)

Description de l'image
Illustration d'un colibri planant au-dessus de diverses fleurs de la toundra, tendant son bec vers une fleur.
Dans la toundra, les fleurs s'épanouissent. Elles nous invitent à ralentir, à regarder de plus près. Ces fleurs soutiennent un écosystème florissant et de puissants pollinisateurs porteurs de vie pour les générations à venir. Tout au long de leur vie, les colibris gardent en mémoire chaque parcelle de fleurs et chaque fleur nourricière qu'ils ont voleté. À la recherche constante de nectar, ils ingèrent de huit à dix fois leur poids chaque jour pour survivre, tout en contribuant à la vitalité des écosystèmes et à l'épanouissement de leur progéniture. Ce sont les seuls oiseaux capables de voler à reculons et à l'envers. Les oreilles sensibles du colibri nous rappellent d'écouter davantage et de parler moins, une leçon essentielle pour toutes les personnes qui travaillent au mieux-être et à la santé des Autochtones. Le colibri et les fleurs de la toundra, ensemble sur cette image brillante et vivante, nous enseignent à voir les choses différemment et à persévérer vers la résilience, l'espoir et la force.
Dre Lisa Boivin est membre de la Première Nation Deninu Kųę, dans le Denendeh (Territoires du Nord-Ouest). Elle est éducatrice autochtone pour le Réseau universitaire de santé et le Center for Wise Practices in Indigenous Health (Ganawishkadawe) du Women's College Hospital à Tkaronto (Toronto). Elle conçoit des programmes d'enseignement axés sur les arts pour les personnes œuvrant dans les domaines de la recherche et de la santé, en s'appuyant sur des ateliers participatifs basés sur l'image pour sensibiliser aux obstacles coloniaux que les patients autochtones doivent surmonter dans le système de soins de santé actuel. Dre Boivin a mené des recherches et élaboré du matériel pédagogique pour de nombreux membres du Sénat, directions scientifiques des Instituts de recherche en santé du Canada, hôpitaux et établissements d'enseignement. Elle s'efforce d'humaniser la médecine clinique en situant son art dans le continuum autochtone de transmission des connaissances par l'image.
Les connaissances et les enseignements sur le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont une valeur inestimable pour guider la promotion du bien-être des Autochtones et enrichir notre vision collective du bien-être au Canada. La partie suivante porte sur les cadres et les approches autochtones et occidentaux en matière de bien-être, en mettant en évidence les contributions qu'ils peuvent apporter à la pratique contemporaine en santé publique.
Partie 2 : Contributions du bien-être à la santé publique
À titre de cadre de mesure et d'objectif de politiques publiques, l'accent mis sur le bien-être peut contribuer à faire progresser les priorités de santé publique grâce à une perspective positive et fondée sur les forces, l'attention portée aux générations futures et à la planète, et son effet catalyseur en faveur de l'action intersectorielle.
Une perspective positive et fondée sur les forces
Le bien-être propose une vision positive de populations prospères et résilientes, capables d'atteindre leur plein potentielNote de bas de page 3Note de bas de page 4. Bien que la pertinence d'une perspective positive soit reconnue depuis longtemps dans le domaine de la santé publique, particulièrement en ce qui concerne la promotion de la santé, son application dans la pratique a variéNote de bas de page 67Note de bas de page 114. Par exemple, la surveillance met souvent l'accent sur la mesure et le suivi des tendances ou des inégalités liées au risque de maladie dans le temps. Bien que ce travail demeure d'une importance capitale pour détecter les écarts et y répondre, il offre un portrait incomplet de la réalité des personnes et des communautés. Il peut également contribuer à la stigmatisation en renforçant les stéréotypes nuisibles ou en présentant une communauté comme étant intrinsèquement « à haut risque », si les iniquités structurelles ne sont pas prises en compteNote de bas de page 115Note de bas de page 116Note de bas de page 117. En complément aux données sur les inégalités, des approches positives et fondées sur les forces pour comprendre et mesurer le bien-être peuvent aider à mettre en évidence la capacité et les ressources communautaires qui favorisent la santé et le bien-êtreNote de bas de page 118Note de bas de page 119Note de bas de page 120.
« Je pense que la santé publique, grâce à sa vision axée sur la population, a la capacité de mobiliser les communautés autour d'une cause commune, puis de dégager une vision collective. Elle peut à la fois cerner les besoins et reconnaître les forces à l'échelle communautaire. Parce qu'à mon avis, il faut absolument trouver un équilibre entre ces deux aspects si l'on veut maintenir la mobilisation. Sinon, on ne fait que parler des problèmes… ce qui n'est pas très mobilisateur. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Les « capitaux du bien-être », c'est-à-dire le bien-être en matière de santé, de conditions sociétales, économiques et planétaires, sont essentiels pour bâtir des sociétés prospères, résilientes et équitables pour de nombreuses générations à venirNote de bas de page 25. Cette approche positive du bien-être va au-delà de la prévention ou du traitement des maladies, reconnaissant que le bien-être est une ressource qui peut être cultivée pour tout le mondeNote de bas de page 25. L'application des cadres axés sur le bien-être positif à certaines priorités de santé publique, comme la santé mentale, en est une illustration concrète.
L'adoption d'une approche axée sur le bien-être en matière de santé mentale signifie d'aller au-delà de la seule prévention de la maladie mentale, vers une vision plus positive et holistique du bien-être émotionnel, psychologique et social. Cette approche fait partie intégrante du concept de « santé mentale positive », qui est défini comme un état de bien-être qui aide les gens à se sentir bien, à penser clairement et à agir de manière à profiter pleinement de la vie et à faire face aux difficultésNote de bas de page 120Note de bas de page 121. Il est important de reconnaître que la santé mentale positive peut coexister avec une maladie mentale, ce qui signifie que toute personne peut être soutenue dans l'atteinte d'un bon état de santé mentale, même en contexte de difficultéNote de bas de page 120. Un exemple d'approche axée sur le bien-être liée à la surveillance de la santé mentale est le Cadre d'indicateurs de surveillance de la santé mentale positive du gouvernement du Canada (voir l'encadré « Une approche fondée sur les forces pour la surveillance de la santé mentale positive »)Note de bas de page 121. Cet exemple peut servir d'inspiration pour les responsables des données en santé publique qui cherchent à déterminer la mesure dans laquelle une approche axée sur le bien-être pourrait permettre d'élargir la perspective dans la surveillance des enjeux prioritaires en santé publique.
Une approche fondée sur les forces pour la surveillance de la santé mentale positive
Publiée en 2012, la première stratégie nationale sur la santé mentale du Canada, intitulée « Changer les orientations, changer des vies », a souligné la nécessité d'améliorer la collecte de données sur la santé mentale positiveNote de bas de page 122. Pour combler cette lacune et surveiller la santé mentale positive à l'échelle de la population, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a lancé le Cadre d'indicateurs de surveillance de la santé mentale positive (CISSMP) en 2016Note de bas de page 121. Le CISSMP comprend des résultats et des indicateurs en matière de santé mentale positive afin de déterminer les facteurs de risque et de protection sur les plans individuel, familial, communautaire et social, pour les jeunes et les adultes. Par exemple, la sphère communautaire comprend des indicateurs liés à l'environnement bâti et aux liens sociaux, tandis que la sphère sociale comprend des mesures de la participation politique et des expériences de stigmatisation et de discrimination. Différents indicateurs sont disponibles selon la région géographique, l'âge, le sexe, le genre, le revenu ou le niveau de scolarité, ce qui permet la comparaison des résultats et des principaux déterminants entre les groupes de populationNote de bas de page 120Note de bas de page 121Note de bas de page 123.
Ce cadre illustre comment une approche positive du bien-être peut être appliquée à la surveillance d'une priorité de santé publique traditionnellement centrée sur les résultats négatifs. L'inclusion de mesures subjectives et fondées sur les forces telles que l'autoévaluation de la santé mentale, le bonheur, la satisfaction à l'égard de la vie, le bien-être psychologique et le bien-être social reflète les perspectives de nombreuses communautés qui s'efforcent d'améliorer leur qualité de vie même lorsqu'elles font face à des défis complexesNote de bas de page 121. La mise en place d'indicateurs liés aux déterminants sociaux de la santé mentale positive peut également appuyer la planification et l'évaluation des politiques et programmes visant à créer les conditions propices au bien-être pour différentes populationsNote de bas de page 120. Cette approche permet d'élargir la portée des interventions en santé mentale au-delà des compétences et comportements individuels, vers une approche davantage axée sur l'équité qui reconnaît l'importance des facteurs sociaux, économiques et environnementaux du bien-être. Par exemple, ce cadre a servi à orienter la conception du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale, décrit à la partie 3.
L'attention portée aux méthodes positives et fondées sur les forces peut également s'harmoniser avec les connaissances et les approches autochtones en matière de bien-êtreNote de bas de page 80Note de bas de page 124. Plusieurs scientifiques et organismes autochtones de partout au pays ont élaboré des cadres et des indicateurs du bien-être fondés sur les forces qui s'inspirent des riches connaissances, des valeurs et des priorités de différentes communautés autochtones. Un exemple est présenté dans l'encadré intitulé « Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations : élaboration d'un système de soins fondé sur les forces »Note de bas de page 21.
Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations : élaboration d'un système de soins fondé sur les forces
Pour appuyer l'élaboration d'un système de soins fondé sur les forces dans les communautés des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations et ses partenaires, dont la Thunderbird Partnership Foundation, ont publié en 2015 le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations. La Thunderbird Partnership Foundation a également élaboré un guide de mise en œuvre connexe en 2018. Ce cadre a été conçu en collaboration avec des Premières Nations de partout au Canada. Les recherches menées par la Fondation ont défini le mieux-être autochtone à partir des savoirs issus des sociétés sacrées de différentes cultures et communautés autochtones au CanadaNote de bas de page 77Note de bas de page 95. Le cadre décrit le mieux-être mental comme un équilibre entre le bien-être mental, physique, spirituel et émotionnel, soutenu par la culture, la langue, les Aînés, les familles et la CréationNote de bas de page 21. Conformément aux quatre directions de la roue de médecine sacrée, le cadre met en évidence quatre résultats fondamentaux :
- l'espoir envers l'avenir, ancré dans l'identité, les valeurs autochtones et la foi en l'esprit;
- un sentiment d'appartenance et de connexion à la famille, à la communauté et à la culture;
- un sentiment de sens et une compréhension de sa propre place dans la Création et l'histoire;
- un but dans la vie quotidienne, que ce soit par l'éducation, l'emploi et les activités de soins, ou les modes culturels d'être et de faireNote de bas de page 77Note de bas de page 125.
Ces résultats peuvent être mesurés au fil du temps grâce à 13 indicateurs décrits dans l'Évaluation du mieux-être des AutochtonesNote de bas de page 77Note de bas de page 95Note de bas de page 125Note de bas de page 126.
Le cadre décrit les éléments d'un système de soins qui sont essentiels au mieux-être mental des Premières Nations, comme les familles et les communautés, les populations et leurs besoins spécifiques tout au long de la vie, les services essentiels dans un continuum de soins, l'autodétermination et le perfectionnement de la main-d'œuvre, ainsi que les partenariats intersectoriels et intergouvernementaux (voir la figure 2). Le maintien de la culture comme fondement est essentiel à la mise en œuvre du cadre, car il favorise l'intégration des connaissances culturelles des Premières Nations dans la conception et la prestation de toutes les politiques, de tous les programmes et de tous les services en matière de mieux-être mental. La mise en œuvre est également soutenue par des descriptions de stratégies et d'interventions qui cadrent avec les principaux thèmes qui sont ressortis des séances de dialogue avec les partenaires, notamment :
- le développement communautaire;
- l'appropriation et le renforcement des capacités;
- un système de soins de qualité et une prestation de services compétente;
- la collaboration avec les partenaires;
- un financement souple et amélioréNote de bas de page 77Note de bas de page 95.

Source de l'image : Thunderbird Partnership Foundation. Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations : Rapport sommaire, 2015
Figure 2 : Texte descriptif
Légende (du centre vers l'extérieur) :
- Quatre directions (résultats) : But; espoir; appartenance; et sens.
- Communauté : Communauté; clan; Aînés; et parenté.
- Populations : Personnes en transition et hors réserve; nourrissons et enfants; jeunes; adultes; genre : hommes, pères et grands-pères; genre : femmes, mères et grands-mères; fournisseurs de soins de santé; travailleurs communautaires; personnes âgées, personnes bispirituelles et GLBTA; communautés du Nord; communautés isolées et éloignées; et familles et communautés.
- Populations ayant des besoins particuliers : Crise; personnes ayant des besoins particuliers; répercussions intergénérationnelles de la colonisation et de l'assimilation; personnes concernées par les systèmes de soin et les systèmes institutionnels; personnes ayant des dépendances comportementales; personnes atteintes de maladies chroniques ou transmissibles; personnes ayant des problèmes concomitants de santé mentale et de dépendance; et personnes ayant des troubles mentaux aigus.
- Continuum de services essentiels : Promotion de la santé, prévention, développement communautaire et éducation; dépistage et intervention précoces; intervention en situation de crise; coordination et planification des soins; désintoxication; soins tenant compte des traumatismes subis; et soutien et suivi.
- Éléments de soutien/infrastructure : Gouvernance; recherche; éducation; perfectionnement de la main-d'œuvre; gestion du changement et gestion du risque; autodétermination; et mesure du rendement.
- Partenaires de la mise en œuvre : Communautés; nations; organismes régionaux; gouvernement fédéral; gouvernements provinciaux et territoriaux; organisations non gouvernementales; et secteur privé.
- Déterminants sociaux de la santé des Autochtones : Soins de santé; logement; gérance de l'environnement; services sociaux; justice; éducation et formation continue; langue, patrimoine et culture; zone urbaine et zone rurale; terres et ressources; et développement économique; emploi.
- La culture comme fondement : Langue; pratiques; cérémonies; savoir; terres et valeurs; Aînés; intervenants culturels; et liens de parenté.
- Principaux thèmes relatifs au mieux-être mental : Développement de la communauté, appropriation par la communauté et renforcement des capacités; système de soins de qualité et prestation de services adaptés à la culture; collaboration avec les partenaires; et financement souple et amélioré.
Les personnes travaillant en santé publique peuvent s'inspirer des initiatives axées sur le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis et suivre leur leadership. Cela implique de faire en sorte que les connaissances autochtones et l'autodétermination soient au cœur des politiques et des approches de bien-être qui concernent les peuples autochtones. Cet effort signifie également qu'il faut appuyer des initiatives communautaires, intersectorielles et axées sur les résultats fondés sur les forces, comme l'espoir, le sentiment d'appartenance, le sentiment de sens et le fait d'avoir un but.
Mettre l'accent sur les générations futures et la planète
Les cadres de bien-être englobent le bien-être des générations actuelles et futures, ainsi que la santé de la planèteNote de bas de page 5Note de bas de page 16Note de bas de page 35Note de bas de page 127. Bien que ces dimensions soient importantes pour les résultats en santé publique, elles ne sont pas toujours prises en compte dans les cadres de santé publique existantsNote de bas de page 128Note de bas de page 129Note de bas de page 130. Une approche axée sur le bien-être peut encourager les personnes travaillant en santé publique à examiner plus attentivement ces dimensions et leur lien avec les priorités actuelles de santé publique.
« [Le bien-être] élargit la notion de ce qu'est la santé, et c'est aussi une façon d'intégrer les choses sur lesquelles nous savons que nous devrions travailler. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Alors que de nombreux cadres de santé publique traditionnels insistent sur la santé humaine comme priorité centrale, le bien-être offre une approche plus relationnelle. Les cadres de bien-être reconnaissent que le bien-être des humains, des animaux et de la planète est indissociableNote de bas de page 4Note de bas de page 5. Ces approches s'accordent avec l'approche « Une seule santé », qui met l'accent sur l'action intersectorielle pour favoriser et équilibrer la santé humaine, animale et planétaireNote de bas de page 4Note de bas de page 6. Il est important de reconnaître cette interdépendance pour comprendre et résoudre les tensions entre ces dimensions, d'autant plus que les activités entreprises pour promouvoir le bien-être humain pourraient avoir des répercussions négatives sur les animaux et l'environnement, aujourd'hui et dans l'avenirNote de bas de page 131. En intégrant explicitement la santé de la planète et les générations futures, une perspective globale du bien-être peut contribuer à faire progresser ces priorités de manière équilibrée. Ce principe est central dans plusieurs conceptions du bien-être, notamment dans la Charte de Genève pour le bien-être de l'OMS et le Cadre de mesure du bien-être de l'OCDENote de bas de page 3Note de bas de page 127. L'accent mis sur l'avenir, en particulier dans le contexte de la transformation numérique, a également été souligné par les Nations Unies, qui ont publié le Pacte pour l'avenir, qui comprend le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Cet accord international porte sur la conception, l'utilisation et la gouvernance de la technologie au bénéfice de l'ensemble de la population, et propose des mesures concrètes pour tenir compte des générations à venir dans les processus décisionnelsNote de bas de page 132.
Les peuples autochtones préconisent depuis longtemps des changements aux systèmes et processus sociétaux qui nuisent à la terre et compromettent le bien-être des générations actuelles et futures. L'accès au territoire et les relations avec celui-ci constituent un déterminant du bien-être des Autochtones, tant en milieu rural qu'urbainNote de bas de page 88. Comme le souligne le rapport de l'ACSP de 2022, le solide leadership et les connaissances approfondies des peuples autochtones en matière de gestion écologique et de relations entre les personnes, les animaux et la nature sont indispensables aux efforts collectifs visant à promouvoir le bien-être des personnes et de la planèteNote de bas de page 51.
« Les peuples autochtones au Canada sont diversifiés, mais ils partagent des perspectives communes concernant leur lien à l'environnement. Plusieurs d'entre nous avons maintenu une relation étroite avec notre milieu environnant, et ce, depuis des générations. La connaissance approfondie d'un milieu, notamment du territoire, de l'eau, des animaux et des plantes, se développe et se partage tout au long d'une vie. C'est ce lien et cette connaissance qui assurent notre santé émotionnelle, physique, mentale et spirituelle et qui nous rappellent que tout est interconnecté. En tant que peuples autochtones, nous avons la responsabilité des êtres qui nous entourent aujourd'hui comme de ceux qui suivront dans les prochaines générations, et nous vivons en réciprocité avec eux. »
– Dre Shannon Waters, médecin-hygiéniste pour la région de la vallée de Cowichan à Island Health – Vancouver Island Health Authority, dans « Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis ».
Une attention simultanée portée à la santé humaine et à la santé de la planète, aujourd'hui et pour les générations futures, favorise le bien-être individuel et sociétal. Une telle approche de la promotion du bien-être est illustrée par le mouvement CittaslowNote de bas de page 133. Ce mouvement, initié en Italie en 1999, fait la promotion du bien-être par plusieurs principes fondamentaux, tels que la philosophie de la lenteur, le soutien de l'économie locale, le patrimoine et les traditions, ainsi que la protection de l'environnement par l'énergie renouvelable, la réduction des déchets et la préservation des espaces vertsNote de bas de page 133. On compte quatre villes Cittaslow au Canada : Naramata et Cowichan Bay en Colombie-Britannique, Wolfville en Nouvelle-Écosse et Lac-Mégantic au QuébecNote de bas de page 134. Lac-Mégantic a entrepris une réflexion holistique sur l'avenir et la reconstruction de son centre-ville à la suite d'un accident ferroviaire dévastateur survenu en 2013 (voir l'encadré « Bien vivre et le mouvement Cittaslow : l'exemple de Lac-Mégantic, Québec »)Note de bas de page 135. Cet exemple illustre comment la santé publique peut s'inspirer des approches de bien-être en favorisant l'action collective intersectorielle et en appliquant des évaluations de la santé de la population pour adapter les solutions aux forces et aux atouts de la communauté.
Bien vivre et le mouvement Cittaslow : l'exemple de Lac-Mégantic, Québec
En 2017, Lac-Mégantic est devenue la première ville certifiée Cittaslow au Québec, avec une vision du « bien vivre » intégrée aux efforts de planification stratégique de la villeNote de bas de page 136. De nouveaux espaces publics ont été créés pour favoriser les liens sociaux et revitaliser la culture et le patrimoine locaux, pour les générations actuelles et futures. Les transformations apportées à l'environnement bâti comprenaient la construction de nouvelles unités de logement social, de grands trottoirs et de pistes cyclables. La durabilité écologique a été encouragée par la création d'un réseau énergétique communautaire reposant sur l'énergie solaire, ainsi que par le développement d'entreprises locales et la revitalisation d'un marché visant à promouvoir les aliments et les biens produits localementNote de bas de page 137.
Faire de Lac-Mégantic une ville Cittaslow est une initiative unificatrice qui a rassemblé de nombreux partenaires, y compris les responsables de la santé publique. Elle constitue un exemple de promotion du bien-être, tout en contribuant à la résilience et au rétablissement à la suite d'un événement tragiqueNote de bas de page 135. La santé publique locale a joué un rôle déterminant dans l'adoption d'une approche de mobilisation ciblée et la mise en œuvre de mesures fondées sur les forces et les atouts de la communauté. Par exemple, une équipe permanente d'intervention en santé publique a mis en place diverses initiatives communautaires, comme un club de marche et la Place éphémère, un espace de rassemblement extérieur dynamique et participatifNote de bas de page 138Note de bas de page 139. La santé publique a fait appel à une solide expertise pour comprendre les déterminants sociaux de la santé, analyser les iniquités et proposer des solutions adaptées aux réalités et aux besoins locauxNote de bas de page 138.
Un engagement profond envers le bien-être des générations futures est au cœur de nombreux concepts et pratiques autochtones en matière de bien-être. À titre d'exemple, l'enseignement des Sept générations est partagé par de nombreuses nations et communautés autochtones et constitue une composante centrale des systèmes de connaissances anichinabésNote de bas de page 140. Cet enseignement met en lumière les répercussions que les choix individuels et collectifs auront sur les sept prochaines générations, ainsi que l'importance des liens avec les ancêtres et les sept générations passées. Cet enseignement peut appuyer une action en faveur du bien-être qui est durable et tournée vers l'avenir. Il est au cœur des efforts contemporains visant à transformer les systèmes de soins pour les peuples autochtones. Par exemple, en 2019, l'Assemblée des Premières Nations a adopté la résolution intitulée Élaboration d'un continuum de soins sur sept générations pour les Premières Nations et par les Premières Nations en matière de santé et de développement économique et socialNote de bas de page 141. Cette résolution appelle à la coordination des soins entre les secteurs et tout au long de la vie, en mettant l'accent sur une transformation durable des systèmes qui profitera aux générations à venirNote de bas de page 142.
La recherche et la science autochtones, ancrées dans des concepts de bien-être holistiques, relationnels et axés sur l'avenir, sont essentielles pour éclairer la transformation des systèmes et l'élaboration de programmes. L'encadré « Renforcer le bien-être des jeunes Inuits grâce au modèle des huit Ujarait (pierres) » présente un modèle d'intervention pour le bien-être des jeunes fondé sur la terminologie, la philosophie et les valeurs sociétales inuites qui met en pratique une vision élargie du bien-être des jeunes. La santé publique peut à la fois soutenir les approches en matière de bien-être dirigées par les Autochtones, qui favorisent la transmission culturelle, le lien avec le territoire et la communauté, et l'autodétermination pour les générations actuelles et futures, et s'en inspirer.
Renforcer le bien-être des jeunes Inuits grâce au modèle des huit Ujarait (pierres)
Face aux enjeux pressants liés au bien-être des jeunes au Nunavut, le Qaujigiartiit Health Research Centre a élaboré le modèle des huit Ujarait (pierres) afin de s'appuyer sur les forces des savoirs inuits pour promouvoir le bien-être collectif des jeunes dans la communauté. Le modèle comprend huit modules visant à améliorer le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Il comprend à la fois l'acquisition de compétences personnelles et des modules qui abordent les fondements du bien-être d'un point de vue inuit, tels que : Avatittinik Kamatsiarniq (gardiens du territoire, axé sur les savoirs liés au territoire et les relations avec celui-ci), Nunalivut (notre communauté, axé sur le renforcement du mieux-être collectif) et Saqqatujuq (horizon lointain, axé sur la planification de l'avenir fondée sur les forces)Note de bas de page 143.
Le modèle des huit Ujarait a été mis en œuvre sous la forme d'un programme de camp de deux semaines sur le territoire appelé Makimautiksat (c.-à-d. bâtir une fondation solide en soi) et offert conjointement par les écoles, les organisations communautaires, les jeunes leaders, les Aînés et les gardiens du savoirNote de bas de page 144. Makimautiksat fait la promotion de l'Inuit Qaujimajatuqangit (c.-à-d. les savoirs inuits) au moyen d'activités telles que des sorties sur le territoire, l'apprentissage auprès des Aînés et des gardiens du savoir, la récolte et le partage de nourriture traditionnelle, et le bénévolat pour redonner à la communauté et renforcer les liens communautaires. Le programme met l'accent sur l'importance fondamentale de la culture, de l'identité, de la communauté et du territoire pour le bien-être des jeunes. Les évaluations ont révélé des résultats positifs pour les personnes participantes, notamment une plus grande fierté culturelle, une plus grande confiance dans leur identité, de meilleures relations familiales et communautaires et une amélioration du mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituelNote de bas de page 143Note de bas de page 144. En s'appuyant sur les forces de la communauté et les savoirs locaux dans tous les modules d'apprentissage, le modèle des huit Ujarait renforce l'identité inuite et donne aux jeunes les moyens de transmettre les valeurs, les connaissances et les pratiques inuites aux générations futures.
Un catalyseur pour l'action intersectorielle
Le bien-être met en valeur les cadres multidimensionnels et holistiques
Les approches en matière de bien-être valorisent la mesure holistique de l'état des individus, des communautés et des sociétés, en tenant compte des iniquités et des tendances émergentesNote de bas de page 127Note de bas de page 145Note de bas de page 146. Les cadres de bien-être comprennent souvent des dimensions liées au bonheur et à la satisfaction à l'égard de la vie, à la santé, à l'emploi, au revenu, au logement, à l'éducation, à la qualité et la durabilité de l'environnement, à la sécurité personnelle, à la participation citoyenne et à la cohésion socialeNote de bas de page 16Note de bas de page 33Note de bas de page 35. Cette perspective globale incite d'autres secteurs s'engager dans des initiatives de bien-être, à mettre en place des structures de gouvernance nécessaires à leur mise en œuvre et à reconnaître les co-bénéfices collectifs qui en découlent.
Un champ de mesure plus large et plus complet peut aider à déterminer les domaines propices à une intervention intersectorielle. Cette approche a été utilisée par Engage Nova Scotia, un organisme qui mesure des indicateurs multidimensionnels du bien-être et utilise ces données pour faciliter les discussions communautaires sur le bien-être en Nouvelle-Écosse (voir l'encadré « Engage Nova Scotia : une initiative sur la qualité de vie »).
Engage Nova Scotia : une initiative sur la qualité de vie
« Et s'il existait une meilleure façon de mesurer comment nous allons? » Cette question a incité Engage Nova Scotia à mettre en œuvre le premier sondage provincial sur la qualité de vie, afin d'aider les responsables des décisions et les communautés à faire progresser des mesures en faveur du bien-être. Cet organisme sans but lucratif a mis au point des outils novateurs pour analyser et communiquer les données d'enquête, qui sont utiles aux municipalités dans l'élaboration de politiques locales et de solutions cibléesNote de bas de page 147.
Le sondage comprend plus de 200 questions qui reflètent les huit domaines multidimensionnels du cadre conceptuel de l'Indice canadien du mieux-être (voir l'annexe A) : populations en santé, niveau de vie, environnement, loisirs et culture, participation démocratique, éducation, emploi du temps et vitalité communautaire. Les questions portent sur les caractéristiques démographiques, les situations personnelles et les contextes de vie, afin de permettre des analyses qui vont au-delà des moyennes populationnelles et qui tiennent compte des raisons et des mécanismes expliquant la prévalence d'inégalités dans certaines communautés et familles. En 2019, près de 13 000 personnes de toute la Nouvelle-Écosse avaient répondu au sondageNote de bas de page 148. Au moment de la rédaction du présent rapport, la tenue du prochain sondage était prévue pour l'automne 2025.
Engage Nova Scotia a communiqué les résultats du sondage de 2019 dans différentes régions et a collaboré avec des partenaires communautaires, des ministères et des municipalités pour stimuler les discussions locales sur l'amélioration de la qualité de vie. Par exemple, Engage Nova Scotia a travaillé avec la municipalité régionale du Cap-Breton et des membres de la communauté pour analyser et présenter les données de l'enquête de manière à refléter les expériences vécues par les parents seuls, les jeunes adultes, les personnes en situation de handicap et les personnes à faible revenu. Les données ont montré l'importance primordiale de l'inclusion sociale, du transport, du logement et des loisirs pour le bien-être de ces groupes prioritaires, ce qui a amené le conseil municipal à réorienter ses priorités budgétaires et à former des groupes de travail sur ces principaux déterminantsNote de bas de page 149.
Dans les cadres de bien-être, ce dernier est souvent conceptualisé comme une combinaison de dimensions interreliées couvrant des contextes sociaux, économiques, environnementaux et de santéNote de bas de page 150. La reconnaissance de ces interdépendances permet de montrer comment les interventions dans une dimension peuvent avoir des effets en cascade sur d'autres.
Le bien-être fixe un objectif commun pour mobiliser l'action collective
Dans le contexte du bien-être comme objectif de politiques publiques, la santé n'est pas seulement un résultat, mais aussi un déterminant. Les résultats positifs en matière de santé peuvent être considérés comme des facteurs importants du succès d'autres secteurs qui favorisent la productivité économique, l'offre de main-d'œuvre, l'innovation, la réussite scolaire, la participation citoyenne et la durabilité environnementaleNote de bas de page 151.
Malgré les bénéfices pour d'autres secteurs, le fait de mettre l'accent uniquement sur les objectifs en matière de santé peut être insuffisant pour stimuler une action intersectorielleNote de bas de page 152Note de bas de page 153Note de bas de page 154Note de bas de page 155Note de bas de page 156Note de bas de page 157. Il peut être difficile pour les secteurs non liés à la santé d'intégrer des considérations de santé s'il n'est pas clair comment elles sont liées à leurs propres prioritésNote de bas de page 151Note de bas de page 158Note de bas de page 159Note de bas de page 160Note de bas de page 161Note de bas de page 162Note de bas de page 163. Adopter le bien-être comme objectif central, plutôt que de se limiter à la santé, pourrait être utile. La recherche montre que l'établissement de priorités communes en utilisant un langage autre que la santé, comme le bien-être, pourrait être mieux accepté comme objectif collectif par les partenaires intersectorielsNote de bas de page 161Note de bas de page 164. Le bien-être propose un objectif qui interpelle les partenaires et englobe les priorités de tous les secteursNote de bas de page 114. Le langage et le cadre conceptuel employés pour décrire les objectifs sont essentiels, car ils influencent la manière dont ces objectifs sont définis, qui devrait les diriger ou y contribuer, et qui en est responsableNote de bas de page 165.
« La compréhension holistique de la santé et du bien-être en tant que cadre pour la durabilité sociale continue vraiment d'interpeller différents secteurs de la communauté. Nous n'avons jamais rencontré de résistance de la part de personnes qui ne se reconnaissaient pas dans la stratégie, ce qui représente un succès particulièrement important. »
– Extrait d'entrevue (initiative axée sur le bien-être)
L'attention portée à la nature multidimensionnelle du bien-être peut également favoriser l'adoption d'une perspective intersectorielle relativement aux déterminants structurels de la santé. En effet, les autres secteurs concernés par les cadres de bien-être sont également responsables des leviers politiques qui influencent les déterminants clés. Par exemple, les pressions financières sont influencées par un certain nombre de facteurs structurels (p. ex. les systèmes macroéconomiques, ainsi que l'éducation, le logement et les politiques de l'emploi qui influencent le revenu et le coût de la vie)Note de bas de page 166. Cependant, les interventions ciblent souvent les connaissances et les comportements financiers individuels, qui sont peu susceptibles de réduire les iniquités attribuables au revenu puisqu'elles ne s'attaquent pas aux obstacles systémiques qui ont une incidence sur la situation financièreNote de bas de page 166. Les conséquences pour la santé publique sont particulièrement importantes, car la précarité financière a des répercussions cumulatives sur la santé physique et mentale tout au long de la vie, et qui se transmettent entre les générationsNote de bas de page 167Note de bas de page 168Note de bas de page 169Note de bas de page 170. L'adoption d'une perspective plus large et multidimensionnelle du bien-être pour s'attaquer aux facteurs structurels qui influencent la stabilité financière peut faciliter les collaborations intersectorielles entre les acteurs ayant des objectifs sur le plan de l'économie, de la santé ou autresNote de bas de page 166. L'encadré « Une vision élargie du bien-être financier pour appuyer l'action intersectorielle en faveur de l'équité en santé » illustre comment une approche axée sur le bien-être peut élargir notre compréhension d'un déterminant social de la santé clé et mettre en évidence les points d'entrée d'une action intersectorielle favorisant l'équité.
Une vision élargie du bien-être financier pour appuyer l'action intersectorielle en faveur de l'équité en santé
Reconnaissant l'incidence du bien-être financier sur l'équité en santé, le Centre pour la santé des communautés de l'Université de l'Alberta a publié un cadre d'action en santé publique sur le bien-être financier intitulé Financial Well-being and Financial Strain, ainsi qu'un guide d'accompagnement de stratégies et d'indicateursNote de bas de page 171. Le cadre établit des liens entre la santé publique et le bien-être en s'inspirant des déterminants sociaux et structurels de la santé et des principes de la Santé dans toutes les politiques (SdTP). Il présente 17 points d'entrée fondés sur des données probantes pour orienter l'action en matière de politiques publiques visant à réduire les pressions financières, à soutenir le bien-être financier à long terme et à promouvoir l'équité en santé. Il comprend des mesures en amont (p. ex. les leviers de gouvernance liés à la redistribution et à la réglementation de la richesse), intermédiaires (p. ex. les obstacles à l'accès aux prestations, aux services et aux programmes) et en aval (p. ex. les services et produits financiers individuels)Note de bas de page 171.
Le cadre encourage différents secteurs (p. ex. santé et services sociaux, éducation, logement, secteur bancaire, transport) à reconnaître comment leurs mandats et leurs initiatives contribuent au bien-être financierNote de bas de page 166Note de bas de page 172. Il aide ces secteurs à explorer les possibilités d'améliorer leur travail en comprenant mieux les facteurs plus larges et les autres acteurs qui influencent les résultats financiersNote de bas de page 166Note de bas de page 172.
Le guide d'accompagnement comprend des cibles, des stratégies et des indicateurs pour appuyer les différents secteurs dans leurs efforts visant à améliorer le bien-être financier. Les deux documents mettent en évidence les principes de SdTP en montrant les interrelations qui créent des synergies entre les gouvernements et les organisations et qui, au bout du compte, peuvent mener à la réalisation de co-bénéfices dans l'ensemble des secteursNote de bas de page 171. À l'avenir, ce cadre peut aider les acteurs de la santé publique à mieux comprendre, mesurer et agir sur le bien-être financier en tant que déterminant de la santé au moyen de partenariats intersectoriels, pour des résultats équitables et durables à l'échelle de la population.
Le bien-être met l'accent sur les co-bénéfices de l'action intersectorielle
En plus de soutenir l'action intersectorielle autour d'objectifs communs, une approche en matière de bien-être peut permettre de mettre l'accent sur les co-bénéfices entre les secteurs. Une même intervention peut faire progresser plusieurs objectifs dans différents secteurs, une idée souvent appelée situation gagnant-gagnant ou retombée multiple, car les politiques sont interreliées et produisent inévitablement des effets d'enchaînementNote de bas de page 173. Par exemple, améliorer l'accès aux espaces verts peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en favorisant les modes de transport actifs. De plus, les co-bénéfices d'un plus grand nombre d'espaces verts comprennent une meilleure qualité de l'air, une activité physique accrue, la réduction de la mortalité toutes causes confondues, l'atténuation des inondations et une meilleure santé mentaleNote de bas de page 174Note de bas de page 175Note de bas de page 176Note de bas de page 177.
Lorsque les décisions sont prises en vase clos, les co-bénéfices ne sont souvent ni recensés ni mesurés, ce qui entraîne leur exclusion des analyses d'investissement et des décisions budgétairesNote de bas de page 178. La prise en compte délibérée des co-bénéfices peut aider à briser ces cloisons et à promouvoir la cohérence des politiques. Mettre l'accent sur les co-bénéfices peut favoriser la formation de coalitions en soulignant les retombées positives pour divers bénéficiaires potentiels d'action politique, et en encourageant les responsables des décisions politiques à collaborer au-delà de leurs mandats habituelsNote de bas de page 151. En soutenant plusieurs objectifs à la fois, les co-bénéfices aident à aller au-delà d'un modèle de politique à somme nulle où les ressources limitées sont perçues comme étant offertes à un secteur au détriment d'un autreNote de bas de page 151.
Les co-bénéfices sont au cœur de l'initiative Finding Common Ground (Trouver un terrain d'entente) de la Région européenne de l'OMS, qui vise à créer de nouveaux outils de modélisation pour les banques centrales et les ministères des Finances afin de mieux comprendre comment les politiques budgétaires et économiques peuvent soutenir simultanément les résultats économiques et de santéNote de bas de page 179. Les plans comprennent l'élaboration de propositions pour intégrer le bien-être et l'équité dans les analyses économiques, repérer les politiques gagnant-gagnant et renforcer les arguments en faveur d'investissements pour des initiatives qui accordent simultanément la priorité à des économies, des populations et des sociétés plus sainesNote de bas de page 179. La Région européenne de l'OMS définit les domaines du bien-être humain, social, économique et planétaire comme des « capitaux » qui se recoupent et qui sont essentiels aux sociétés prospères (voir la figure 3)Note de bas de page 178. Ces recoupements mettent en lumière comment l'action dans un domaine peut générer des retombées positives dans un autre.

Source de l'image : World Health Organization. Harnessing the Benefits of Well-Being Policies and Investments for Health. World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
Figure 3 : Texte descriptif
- Politique et gouvernance
- Bien-être planétaire : Bonne qualité de l'air et de l'eau; milieu de vie sain et durable; transport public durable et déplacements actifs; accès à des espaces verts sûrs; climat stable; biodiversité et capital naturel; et économie circulaire et technologie verte.
- Bien-être humain : Espérance de vie saine; santé mentale et bien-être; capacité de mener nos activités quotidiennes sans maladie; couverture universelle des soins de santé; soins de santé et services sociaux de qualité et non discriminatoires; politiques universelles en matière de logement, d'alimentation et de sécurité d'énergétique; développement de la petite enfance; apprentissage continu et alphabétisation; et migration sécuritaire, ordonnée et régulière.
- Bien-être économique : Salaire viable; protection sociale universelle tout au long de la vie; travail décent et sécuritaire sur le plan psychologique; emploi sensible au genre; dialogue social et négociation collective; et cohésion économique et développement équilibré.
- Bien-être social : Vivre en sécurité et à l'abri de la violence; sentiment d'appartenance (ou d'importance face aux autres); cohésion sociale et acceptation de la diversité; perception d'une capacité à influencer la politique et les décisions (capacité d'agir); soutien social et protection; renforcement de la confiance envers les autres et envers les institutions; dépenses publiques pour les communautés; et participation aux activités de bénévolat.
Les co-bénéfices ont également favorisé l'action intersectorielle sur le bien-être à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). Un engagement provincial en faveur du bien-être a émergé dans le cadre du processus d'élaboration de l'Accord sur la santé de 2022 à T.-N.-L.Note de bas de page 180. Dans l'Accord sur la santé, le bien-être est un principe directeur, défini comme l'expression d'un sentiment de bonheur, de santé, d'appartenance sociale et de déterminationNote de bas de page 180Note de bas de page 181. L'Accord reconnaît la responsabilité partagée des systèmes de santé et des services sociaux avec les établissements d'enseignement dans le domaine de la santé, les municipalités, les organisations communautaires et le secteur privé pour améliorer les résultats en matière de santé et l'équité en santéNote de bas de page 181. Il propose une vision d'une meilleure santé de la population qui s'appuie explicitement sur les politiques publiques existantes, notamment la Stratégie de réduction de la pauvreté adoptée en 2006, des initiatives en matière de santé mentale et de dépendances, un plan d'action climatique et des programmes éducatifsNote de bas de page 182. Voir l'encadré « Mettre en évidence les co-bénéfices pour faire progresser le bien-être à Terre-Neuve-et-Labrador » pour une description de la façon dont le concept de co-bénéfice a mobilisé l'action intersectorielle sur le bien-être dans la province.
Mettre en évidence les co-bénéfices pour faire progresser le bien-être à Terre-Neuve-et-Labrador
Well-Being NL, un organisme central soutenu par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), regroupe des parties prenantes de divers secteurs pour faire progresser le bien-être dans la provinceNote de bas de page 183. Les membres de Well-Being NL visent à déterminer collectivement le potentiel des co-bénéfices dans l'ensemble des initiatives sectorielles, à mettre en évidence les possibilités d'harmoniser les investissements et à tirer parti des structures de gouvernance interministérielles pour favoriser la collaboration et les contributions intersectorielles.
La santé publique participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de Well-Being NL depuis sa création, par l'entremise de comités directeurs, de groupes de travail et de conseils en matière de communication et de mobilisation. Ces efforts ont aidé la santé publique à déterminer et à renforcer les co-bénéfices pour la santé découlant de l'action intersectorielle sur le bien-être. Well-Being NL a indiqué que l'alignement avec les mandats provinciaux et locaux en matière de santé publique, ainsi que l'intégration de la promotion de la santé dans les règlements provinciaux et les principaux programmes de santé publique ont facilité la coordination entre les partenaires. Les principes du bien-être ont également éclairé le Cadre de santé publique de 2023 pour Terre-Neuve-et-Labrador, plaçant le bien-être au centre de l'approche en matière de santé publique de la provinceNote de bas de page 184Note de bas de page 185.
Co-bénéfices à l'échelle locale
Les possibilités offertes par les co-bénéfices peuvent être particulièrement évidentes à l'échelle locale. Les municipalités ont accès à des leviers de changement qui sont directement liés aux conditions du bien-être communautaire, comme l'aménagement du territoire, la gestion de l'infrastructure et la prestation de services essentiels, comme le logement abordable, l'accueil des immigrants et la garde d'enfantsNote de bas de page 186Note de bas de page 187Note de bas de page 188. Les municipalités sont également plus près de leurs communautés que les autres ordres de gouvernement, ce qui les place dans une position idéale pour collaborer avec leur population, les entreprises et les leaders communautaires afin d'adapter les politiques et les programmes à leurs besoins et contextes locauxNote de bas de page 186. L'initiative Villes-Santé de l'OMS vise à exploiter ce potentiel en collaborant avec les gouvernements municipaux pour transformer les programmes sociaux, économiques et culturels afin de mieux soutenir la santé et le bien-être de leur population. Cette initiative définit une ville-santé comme une ville qui place la santé, le bien-être social, l'équité et le développement durable au centre des politiques, stratégies et programmes locauxNote de bas de page 189. En 2023, les membres du Réseau européen Villes-Santé de l'OMS se sont engagés à promouvoir une économie axée sur le bien-être en mettant l'accent sur 12 pistes d'action dans quatre domaines importants, soit le bien-être planétaire, le bien-être humain, le bien-être économique et le bien-être socialNote de bas de page 190. Ces interventions comprennent la protection et l'amélioration de l'environnement, la promotion du bien-être au travail, le renforcement de la participation citoyenne et de l'action communautaire, ainsi que l'inclusion et la valorisation de la diversitéNote de bas de page 190. Des projets pilotes ont été lancés dans neuf villes européennes afin de mettre en œuvre ces pistes d'actionNote de bas de page 190.
Plusieurs administrations au Canada ont mené des réflexions similaires. Par exemple, la Stratégie pour une ville saine de la Ville de Vancouver est un plan intégré à long terme qui vise à améliorer la santé et le bien-être à Vancouver grâce à des mesures intersectorielles et coordonnées en matière de politiques publiques, appuyées par des cadres et la surveillance d'indicateurs de bien-êtreNote de bas de page 191. L'initiative est codirigée par la municipalité et l'autorité locale de santé publique. La santé publique a mis à profit ses relations existantes tout en renforçant la confiance et en établissant de nouveaux partenariats. La santé publique a également transmis de précieuses données locales et ciblées pour aider la municipalité à comprendre et à mettre en œuvre des stratégies efficacesNote de bas de page 191. À titre d'exemple concret de cette stratégie en action, la Ville de Vancouver fait la promotion des co-bénéfices pour l'équité en santé et le développement communautaire dans le cadre de sa politique d'ententes sur les retombées communautaires. La politique propose des possibilités d'emploi local sans obstacle et des bénéfices économiques pour la population, y compris les populations faisant face à des iniquités, grâce à des ententes avec les promoteursNote de bas de page 192. Les leaders des communautés autochtones en milieu urbain à Vancouver ont également collaboré avec la ville pour élaborer des indicateurs du bien-être autochtone adaptés sur le plan culturel et fondés sur les forces afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d'une perspective autochtone urbaineNote de bas de page 193Note de bas de page 194.
Les connaissances et les approches autochtones en matière de bien-être relationnel contrastent souvent avec les initiatives occidentales qui répartissent la responsabilité des différentes dimensions du bien-être entre les secteursNote de bas de page 17. Même lorsqu'elles ne sont pas explicitement désignées comme des initiatives axées sur le bien-être, de nombreuses approches de promotion de la santé menées par les Autochtones couvrent plusieurs dimensions du bien-être de manière intégrée, en insistant sur les relations et l'équilibre entre ces dimensionsNote de bas de page 140. Le travail des centres d'amitié autochtones est un exemple de cette approche holistique à l'égard des programmes sociaux et de santé. Ces centres servent de carrefours pour la promotion du bien-être et l'exercice de l'autodétermination parmi les communautés autochtones urbaines. Ils s'attaquent aux répercussions de la colonisation grâce à la prestation de services de santé et de services sociaux dirigés par des Autochtones, au développement d'une infrastructure sociale pour répondre aux divers besoins des populations autochtones en milieu urbain, à des programmes qui favorisent la continuité culturelle et les liens avec la communauté, et à la revendication de formations en sécurité culturelle et de changements systémiques dans les services non autochtones, en particulier en ce qui concerne les soins de santéNote de bas de page 195Note de bas de page 196.
Partie 3 : Rôles de la santé publique dans les initiatives axées sur le bien-être
Au-delà des contributions potentielles offertes par le bien-être pour la santé publique, cette dernière peut mobiliser et renforcer ses fonctions essentielles et compétences de base afin d'appuyer les initiatives axées sur le bien-être menées par d'autres. Les domaines d'intervention particulièrement pertinents comprennent l'échange des connaissances sur les déterminants structurels de la santé, l'utilisation des données probantes en matière de santé publique, la promotion de l'action intersectorielle et le soutien à la mise en œuvre des droits des Autochtones.
« À mes débuts en santé publique, les gens pensaient que la promotion de la santé consistait à dire aux gens de ne pas fumer, de faire de l'exercice et de bien manger. [Mais] il s'agit vraiment de donner aux gens plus de contrôle sur leur santé en s'attaquant à certains des déterminants physiques, environnementaux, sociaux et politiques sous-jacents de la santé. C'est une grande partie du travail que nous avons accompli… pour réfléchir à l'adoption de politiques publiques saines. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Cadres de santé publique pour comprendre les déterminants structurels du bien-être
Les dimensions du bien-être chevauchent largement les déterminants sociaux de la santé, soit les conditions de la vie quotidienne dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent, jouent, apprennent et vieillissentNote de bas de page 11. Pour comprendre les raisons de la répartition inéquitable de ces conditions dans la société, certains experts en santé publique se sont intéressés aux déterminants structurels de la santé, qui sont les mécanismes (p. ex. les valeurs, les croyances, les normes, les lois, les politiques et les pratiques institutionnelles) qui alimentent la distribution inéquitable du pouvoir et des ressources et influencent ainsi les conditions de vie quotidienneNote de bas de page 5Note de bas de page 11Note de bas de page 155Note de bas de page 197Note de bas de page 198.
Les déterminants structurels ont non seulement une incidence sur la santé, mais ils touchent également toutes les dimensions du bien-être, car ils déterminent la façon dont les sociétés sont structurées, avec des répercussions sur les résultats en matière de santé, de société, d'économie et d'environnement. Les connaissances en santé publique sur les déterminants structurels peuvent être mobilisées pour appuyer des initiatives axées sur le bien-être. Elles permettent de comprendre les conditions sociétales qui créent et maintiennent des iniquités en matière de bien-être et d'agir à cet égardNote de bas de page 199Note de bas de page 200Note de bas de page 201Note de bas de page 202. Cela comprend l'identification des déterminants structurels et la compréhension de leurs répercussions, un domaine d'intérêt croissant en santé publiqueNote de bas de page 197.
Les efforts continus pour distinguer les déterminants structurels de la santé ont donné lieu à des sous-catégories distinctes, comme les déterminants politiques, économiques et écologiquesNote de bas de page 2Note de bas de page 11. Dans ces catégories, les chercheurs peuvent explorer des déterminants structurels précis comme la colonisation et le racisme systémique, les pratiques commerciales ou la numérisation et les environnements en ligne. Chacun de ces déterminants structurels influence significativement toutes les dimensions du bien-être. Il importe d'explorer et d'aborder leurs interrelations pour promouvoir l'équité en matière de bien-être.
La colonisation et le racisme systémique en tant que déterminants du bien-être
La colonisation et le racisme sont des déterminants fondamentaux du bien-être chez les peuples autochtones, les communautés noires et d'autres populations racisées au CanadaNote de bas de page 11Note de bas de page 199Note de bas de page 203. Ils sont étroitement liés, les processus de colonisation ayant mené à un racisme systémique persistant et enraciné. Ce dernier est ancré dans les systèmes, les processus et les relations et contribue à renforcer les croyances, les préjugés et les stéréotypes tout en normalisant les pratiques discriminatoires qui profitent au groupe dominantNote de bas de page 204. Le racisme systémique interagit également avec d'autres déterminants structurels pour influencer les conditions sociales, économiques, écologiques et politiques qui façonnent quotidiennement la santé et le bien-être de diverses populationsNote de bas de page 201.
Les effets persistants du racisme systémique se manifestent dans de nombreux systèmes et structures au Canada. On observe notamment la sous-représentation des peuples autochtones, des personnes noires et d'autres populations racisées dans les postes de direction, de même que leur surreprésentation dans les systèmes de justice pénale et de protection de l'enfance. On constate de plus une répartition inéquitable des ressources essentielles telles que les logements de qualité, les soins de santé, l'eau potable, l'éducation, l'emploi et les services sociauxNote de bas de page 202Note de bas de page 205Note de bas de page 206Note de bas de page 207Note de bas de page 208Note de bas de page 209.
La colonisation et le racisme systémique ont une histoire distincte parmi les groupes de population, avec des répercussions persistantes, de grande portée et intergénérationnellesNote de bas de page 142Note de bas de page 210. Par exemple, le bien-être de diverses communautés noires du Canada est directement influencé par les conséquences du racisme envers les personnes noires sur la santé et la société, qui se caractérise par des préjugés, des attitudes, des croyances, des stéréotypes et de la discrimination à l'égard des personnes d'ascendance africaineNote de bas de page 211. Le racisme contre les personnes noires est enraciné dans la colonisation européenne en Afrique et l'héritage de l'esclavage, qui était légal en Amérique du Nord britannique jusqu'en 1834. Il est profondément enraciné dans les institutions, les politiques et les pratiques canadiennes, et est souvent invisible pour les personnes qui n'en subissent pas les effets. Au Canada, les personnes noires continuent de faire face à des iniquités causées par des processus de stigmatisation et de discrimination qui découlent des idéologies du racisme anti-noirNote de bas de page 210.
Parmi les politiques coloniales ayant eu des répercussions profondes sur les peuples autochtones, on peut citer la Loi de 1870 sur le Manitoba et les fraudes foncières ayant entraîné le déplacement des Métis dans la région; la Loi sur les Indiens de 1876; le système des pensionnats, complètement aboli seulement en 1996; la réinstallation forcée, dans les années 1950, de populations inuites dans des établissements permanents dépourvus d'abris adéquats et de ressources essentiellesNote de bas de page 212Note de bas de page 213Note de bas de page 214. Ces politiques ont perturbé les racines fondamentales du bien-être autochtone, y compris le lien avec le territoire, la langue, la culture, la communauté, la famille et l'identitéNote de bas de page 214Note de bas de page 215Note de bas de page 216. Cette rupture des liens a engendré des traumatismes intergénérationnels, aggravés par les conséquences persistantes de la colonisationNote de bas de page 217Note de bas de page 218. Les systèmes et les processus de discrimination ainsi que l'exclusion sociale et politique des peuples autochtones se sont perpétués et demeurent ancrés dans le tissu de la société canadienneNote de bas de page 217Note de bas de page 219. Cette discrimination se manifeste également dans la dévalorisation et l'exclusion des savoirs et des sciences autochtones dans les processus d'élaboration des politiques, les programmes et les services, contribuant à des environnements potentiellement discriminatoires, culturellement non sécuritaires et qui ne répondent pas aux besoins et aux priorités des communautésNote de bas de page 220Note de bas de page 221Note de bas de page 222.
Déterminants commerciaux et numériques de la santé : des facteurs émergents influençant le bien-être
L'influence de certains déterminants structurels sur la santé et le bien-être s'intensifie, en particulier celle des déterminants commerciaux et numériques. La recherche en santé publique sur ces déterminants émergents pourrait soutenir des initiatives axées sur le bien-être qui tiennent compte des répercussions de ces facteurs sociétaux.
Les déterminants commerciaux sont façonnés par les politiques publiques, les dynamiques du marché et les conditions réglementaires. Ils englobent la production, la commercialisation et la vente de biens et de servicesNote de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13. En 2024, l'OMS a publié un rapport soulignant l'incidence majeure de ces déterminants sur les maladies non transmissibles en EuropeNote de bas de page 13. Ce rapport met en lumière les répercussions de nombreuses pratiques commerciales, telles que la commercialisation de produits nocifs pour la santé, les pratiques de travail qui accentuent la précarisation de l'emploi et l'opposition à des réglementations favorables à la santé publiqueNote de bas de page 13. En ce qui concerne les initiatives axées sur le bien-être, le rapport recommande des interventions systémiques afin de mieux protéger les politiques publiques contre les influences commercialesNote de bas de page 13. Ces interventions comprennent des mesures fiscales, des réformes réglementaires, des restrictions de commercialisation, l'étiquetage obligatoire et des mécanismes de gouvernance visant à limiter le pouvoir et la portée des intérêts commerciaux dans les politiques de santé publiqueNote de bas de page 13.
Les déterminants numériques peuvent avoir des effets à la fois bénéfiques et néfastes sur la santé et le bien-être, en influençant directement ou indirectement d'autres déterminantsNote de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 223Note de bas de page 224. Par exemple, l'accès en ligne à l'information sur la santé, l'accès en ligne aux prestataires de soins, les avancées technologiques en matière de prestation et de qualité des soins, ainsi que l'amélioration des données et des méthodologies de surveillance de la santé de la population peuvent constituer des facteurs de protection en matière de santé. Parallèlement, la numérisation peut engendrer des risques pour la santé, comme la propagation de la mésinformation et de la désinformation sur la santé, l'érosion de la confiance dans les institutions, les biais dans la conception et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, la fraude financière, la cyberintimidation, l'exploitation et le harcèlementNote de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 223Note de bas de page 224Note de bas de page 225. Les intérêts commerciaux influencent également l'environnement en ligne, notamment par la conception d'applications qui créent une dépendance et par le recours à des stratégies de marketing numériques utilisant des algorithmes ciblésNote de bas de page 9Note de bas de page 13. La transformation numérique modifie aussi fondamentalement les conditions de vie et de travail, y compris l'éducation, l'emploi, les liens sociaux et les médias, ce qui a des répercussions importantes sur le bien-êtreNote de bas de page 9. L'accès inégal à la technologie et à la littératie numérique peut moduler ou renforcer ces dynamiques, avec pour effet d'accentuer les disparités existantesNote de bas de page 10Note de bas de page 226.
Ces déterminants sont particulièrement importants pour les enfants et les jeunesNote de bas de page 227. L'enfance et l'adolescence sont des périodes décisives pour le développement du cerveau et la construction de l'identité. Or, les jeunes d'aujourd'hui évoluent dans des environnements numériques de manière plus immersive que toute autre génération précédenteNote de bas de page 223Note de bas de page 225Note de bas de page 227. Cette population est donc la plus susceptible d'être exposée aux effets néfastes des technologies numériquesNote de bas de page 225Note de bas de page 228. La littérature scientifique demeure partagée quant à l'incidence globale des environnements numériques et virtuels sur le bien-être, les bénéfices et les risques pouvant varier selon les groupes concernés. Bien que ces plateformes offrent des possibilités de socialisation et d'apprentissage, l'engagement numérique peut également engendrer du stress, du surmenage et une forme de désengagement social, ce qui souligne la nécessité de réaliser des interventions ciblées pour soutenir le bien-être des jeunesNote de bas de page 227Note de bas de page 229Note de bas de page 230Note de bas de page 231Note de bas de page 232Note de bas de page 233. Ces thèmes ont été soulevés au cours d'un échange avec le Conseil jeunesse du premier ministre (voir l'encadré « Déterminants numériques de la santé et générations futures : ce que nous avons appris du Conseil jeunesse du premier ministre au sujet du bien-être des jeunes »). La santé publique peut continuer de promouvoir le bien-être des jeunes en favorisant les collaborations intersectorielles et en soutenant la recherche nécessaire pour comprendre et relever les nouveaux défis complexes, mais aussi les possibilités qu'offrent les déterminants numériques de la santéNote de bas de page 227Note de bas de page 234Note de bas de page 235.
Déterminants numériques de la santé et générations futures : ce que nous avons appris du Conseil jeunesse du premier ministre au sujet du bien-être des jeunes
En novembre 2024, l'administratrice en chef de la santé publique et les membres de son équipe ont rencontré le Conseil jeunesse du premier ministre pour discuter du bien-être des jeunes et des facteurs sociétaux qui l'influencent, notamment les environnements numériques. Au cours de cet échange, les personnes participantes ont indiqué qu'il peut être particulièrement difficile de se déconnecter des espaces en ligne en l'absence d'incitatifs ou d'autres possibilités pour répondre à leurs besoins sociaux. Ils ont discuté de la façon dont l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans la vie quotidienne, avec des conséquences réelles sur le développement des compétences universitaires, la cohésion sociale et la sécurité en ligne. Les jeunes leaders ont reconnu que bon nombre d'entre eux sont épuisés parce qu'ils sont submergés par l'information numérique. Un participant a mentionné que « […] le rythme de nos vies augmente sans cesse, en partie à cause des médias sociaux […]. On souhaite créer une communauté et entretenir des liens, mais cela peut aussi devenir lourd. »
Les membres participants ont recommandé un certain nombre de mesures pour améliorer le bien-être numérique, y compris l'éducation à la citoyenneté numérique, la mise en place de programmes d'acquisition de compétences sociales post-pandémie et une réglementation accrue des technologies en ligne afin de protéger la sécurité et le bien-être des jeunes en ligne. Les membres du Conseil ont également parlé de l'importance des « lieux tiers », qui sont des endroits qui facilitent les interactions sociales à l'extérieur de la maison ou du travail pour échanger des idées, s'amuser et établir de nouvelles relations.
Données sur la santé publique et données probantes pour mesurer les inégalités liées au bien-être
Par le passé, les indicateurs du bien-être ont été présentés sous forme agrégée ou de moyenne à l'échelle de la population. Les indicateurs agrégés du bien-être fournissent des détails essentiels sur la situation d'une population dans son ensemble et sont utiles pour les comparaisons internationales et régionales. Toutefois, ils ne permettent pas de rendre compte des inégalités possibles entre les groupes de populationNote de bas de page 236. Pour mesurer et surveiller ces inégalités, il est essentiel de recueillir des données désagrégées (p. ex. selon le statut socioéconomique ou la démographie) et d'adopter, lorsque cela est possible, des perspectives d'équité et d'intersectionnalité. Ces approches permettent de saisir les diverses expériences vécues et les effets différenciés des systèmes de pouvoir et d'oppression qui se recoupentNote de bas de page 115Note de bas de page 150Note de bas de page 236. L'amélioration de la collecte et de l'analyse des données pour cerner et surveiller les inégalités en santé est un domaine prioritaire pour la recherche et la surveillance en santé publique. Ces efforts peuvent également contribuer à mesurer les inégalités liées au bien-être. À ce titre, en 2024, l'OMS a publié un guide exhaustif sur la surveillance des inégalités en santé, reconnaissant qu'une caractérisation détaillée des tendances en matière d'inégalité est nécessaire pour éclairer les stratégies visant à améliorer la santé de la populationNote de bas de page 115.
« Pour moi, l'épidémiologie est la science fondamentale de la santé publique. Je pense que c'est là que nous pouvons vraiment apporter quelque chose, c'est-à-dire que nous pouvons examiner les grands ensembles de données, les interpréter et les comprendre comme personne d'autre ne peut le faire. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Afin de soutenir l'intégration des considérations liées à l'équité dans les initiatives portant sur les données et les indicateurs du bien-être, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé et le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses ont élaboré une série de questions visant à orienter la mise en place de processus favorisant l'équité, la prise de décisions, ainsi que les activités de mobilisation (voir l'encadré « Questions en matière d'équité en santé publique pour la mise en œuvre d'un cadre du bien-être »).
Questions en matière d'équité en santé publique pour la mise en œuvre d'un cadre du bien-être
La capacité de surveiller les inégalités dans les résultats en matière de santé et de bien-être et leurs déterminants au fil du temps est essentielle pour orienter les interventions prioritaires, évaluer leurs effets et détecter les conséquences imprévues ou l'aggravation des iniquités à mesure qu'elles surviennent et y réagir. Les questions ci-dessous élaborées par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé et le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses pour le présent rapport visent à soutenir les spécialistes en santé publique dans l'intégration des considérations d'équité en santé aux initiatives de données portant sur la santé publique et le bien-être. Bien qu'ils aient été conçus dans ce contexte, ces questions sont largement applicables à l'utilisation des données démographiques dans l'ensemble des secteurs.
Inclusion dans la prise de décisions en santé publique :
- Comment les populations confrontées à des iniquités sont-elles impliquées dans l'élaboration des indicateurs de la santé du cadre?
- Quelles populations confrontées à des iniquités participent à l'élaboration des indicateurs de la santé pour le cadre?
- Quels obstacles empêchent la participation des populations confrontées à des iniquités et comment seront-ils éliminés?
- Le cadre intègre-t-il les perspectives autochtones et non autochtones en matière de santé afin d'atténuer les biais inhérents et systémiques en santé publique?
Compréhension holistique de la santé et du bien-être :
- Quels déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé sont intégrés dans le cadre?
- Les expériences en matière de santé sont-elles prises en compte à l'échelle individuelle, des quartiers et des communautés dans l'élaboration des indicateurs?
Lutter contre les iniquités structurelles en santé :
- Quels déterminants structurels de la santé sont inclus dans le cadre?
- Comment le cadre s'attaque-t-il aux causes profondes des inégalités en santé, comme le racisme systémique et le colonialisme? Les causes sociales et structurelles sont-elles abordées?
Politiques publiques et responsabilisation pour l'équité en santé :
- Comment le cadre favorise-t-il la collaboration multisectorielle pour s'attaquer aux iniquités en santé?
- Quelles politiques sont en place pour améliorer les résultats en matière de santé?
- Comment les rapports sur les objectifs et les progrès en matière d'équité en santé seront-ils rendus publics?
Résultats sur la santé axés sur la communauté :
- Comment le cadre accorde-t-il la priorité à la santé et à la résilience des communautés?
- Comment les valeurs collectives, comme la cohésion sociale et la santé des communautés, sont-elles intégrées aux indicateurs?
Souplesse et adaptation locale dans les contextes de santé :
- Comment le cadre est-il adapté aux contextes de santé locaux pour assurer la pertinence culturelle?
- Comment les définitions locales et les besoins de santé propres à chaque culture sont-ils intégrés au cadre et aux indicateurs de santé?
Renforcement des capacités pour l'équité en santé :
- Quelles mesures sont prises pour renforcer la capacité de l'organisation à intégrer l'équité dans les politiques de santé publique?
- Comment les responsabilités en matière de surveillance des indicateurs d'équité en santé sont-elles attribuées au sein des établissements de santé publique pour assurer la reddition de comptes?
Réflexivité critique et prévention des préjudices :
- Quelles mesures sont prises pour décoloniser les indicateurs de santé et éviter de renforcer les iniquités systémiques en santé?
- Comment les professionnels de la santé sont-ils encouragés à réfléchir aux préjudices potentiels et aux conséquences imprévues du cadre?
Suivi des progrès en matière d'équité en santé :
- Quels paramètres sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés dans la réduction des iniquités en santé?
- Comment les mécanismes d'évaluation détermineront-ils l'efficacité du cadre dans la promotion et la mise en œuvre de l'équité en santé?
Équilibre entre les données quantitatives et les données qualitatives sur la santé :
- Comment le cadre concilie-t-il les mesures quantitatives de la santé avec des données qualitatives sur les expériences vécues par les populations confrontées à des iniquités?
- Comment les expériences vécues par des populations confrontées à des iniquités seront-elles intégrées pour compléter les données numériques sur la santé?
Relever les défis persistants de l'écosystème des données sur la santé du Canada peut permettre une meilleure mesure des inégalités liées au bien-être et générer des données probantes pour soutenir les interventions intersectorielles. Ces efforts visent notamment à améliorer la collecte, le partage et l'utilisation des données désagrégées, dans le respect de la souveraineté des données, en consolidant les partenariats interorganisationnels, en tenant compte des enjeux de confidentialité et en favorisant la qualité et l'uniformisation des donnéesNote de bas de page 237Note de bas de page 238. Les systèmes de santé publique peuvent également appuyer un meilleur couplage des données sur la santé avec l'information détenue par d'autres secteurs, ainsi que travailler à améliorer l'accès aux données et leur interopérabilitéNote de bas de page 239Note de bas de page 240Note de bas de page 241Note de bas de page 242.
« Les données à l'échelle [locale] sont vraiment utiles. Une zone géographique de taille relativement petite peut être particulièrement pertinente pour repérer les iniquités en santé. [...] Elle permet également de cibler l'action en santé publique, en mettant en lumière les enjeux les plus pressants au sein de la communauté. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Il est important que les responsables des données collaborent avec les communautés pour élaborer conjointement des solutions et empêcher que des populations soient systématiquement sous-représentées dans les ensembles de donnéesNote de bas de page 239Note de bas de page 242Note de bas de page 243Note de bas de page 244. Le savoir communautaire est essentiel pour contextualiser et interpréter les données désagrégées. Ces connaissances permettent de mieux comprendre les iniquités structurelles qui entraînent des écarts dans les résultats de santé, contribuant ainsi à réduire la stigmatisation qui peut se produire lorsque les données sur les résultats négatifs sont ventilées par groupes sociauxNote de bas de page 114Note de bas de page 245. La santé publique, en particulier à l'échelle locale, entretient souvent des relations étroites avec les communautés qui peuvent aider à révéler des interactions d'intérêt entre les déterminants de la santéNote de bas de page 246Note de bas de page 247Note de bas de page 248. La participation significative des communautés dès les premières étapes de conception de l'intervention a été jugée essentielle pour combler les écarts entre la recherche et la pratique, traduire les données probantes en politiques et en pratiques, et évaluer l'efficacité des initiativesNote de bas de page 249Note de bas de page 250Note de bas de page 251Note de bas de page 252Note de bas de page 253.
Partout au Canada, les communautés – y compris les communautés noires et autochtones – ont mis en place des initiatives visant à relever les défis liés aux données sur la santé publique. Les scientifiques, les prestataires de services et les défenseurs des intérêts communautaires noirs au Canada ont insisté sur la nécessité d'avoir de meilleures données désagrégées, dirigées par la communauté, pour documenter les effets du racisme envers les personnes noires sur la santé publique et pour orienter les interventions visant à améliorer l'équité en santéNote de bas de page 254Note de bas de page 255Note de bas de page 256. Il s'agit notamment de comprendre l'importance de l'intendance des données sur les communautés noires en ce qui concerne la collecte, l'analyse, l'accès et l'utilisation des donnéesNote de bas de page 254Note de bas de page 255Note de bas de page 256. Un exemple de ce travail est le cadre Engagement, gouvernance, accès et protection publié par le Groupe de travail sur l'équité en santé pour les Noirs en 2021. Ce cadre vise à s'assurer que les données des communautés noires sont recueillies, protégées et utilisées de manière appropriée dans le but de démanteler le racisme structurelNote de bas de page 255.
Le leadership autochtone dans l'affirmation de la souveraineté des données transforme la façon dont la santé publique aborde les torts causés par les systèmes de données coloniaux. Ce virage marque une avancée vers l'autodétermination et un changement structurel (voir l'encadré « Le leadership autochtone dans la réparation des torts causés par les données déficitaires en santé publique »).
« La communauté est celle qui connaît le mieux ses besoins. Lorsque nous avons [organisé] notre journée de réflexion collective, […] nous avons adopté une approche positive. Nous avons commencé par cartographier nos atouts… Nous n'avons pas seulement des problèmes, nous avons aussi de grandes forces! »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Le leadership autochtone dans la réparation des torts causés par les données déficitaires en santé publique
Les approches de santé publique axées sur les problèmes mettent souvent l'accent sur la surveillance des risques pour la santé et la répartition des résultats défavorables en matière de santé. Ces approches sont importantes pour surveiller les tendances de la santé de la population et les inégalités en matière de santé. Toutefois, isolément, les systèmes de données axés sur le déficit peuvent avoir des conséquences négatives pour les populations qui vivent des iniquités, y compris les peuples autochtones. Lorsque les données révélant des iniquités en santé entre les groupes sont présentées sans tenir compte des déterminants structurels, elles risquent de renforcer des stéréotypes nuisibles, laissant entendre que les peuples autochtones sont intrinsèquement malades ou à risqueNote de bas de page 85. Ces stéréotypes ont des conséquences graves, car ils renforcent les croyances racistes et les pratiques discriminatoires dans le système de santé et ailleurs, tout en occultant les facteurs sous-jacents des inégalités en matière de santé et de bien-êtreNote de bas de page 257.
Les connaissances, la recherche et les sciences autochtones sur le bien-être sont relationnelles. Elles conçoivent le bien-être individuel en relation avec le bien-être des familles et des communautés, et comme indissociable de contextes écologiques et sociétaux plus larges. De nombreux systèmes de connaissances sur le bien-être des Autochtones sont également fondés sur les forces et transmettent des enseignements axés sur les fondements de ce qui constitue une bonne vieNote de bas de page 21. La promotion de données sur le bien-être dirigées par les Autochtones, fondées sur leurs forces, régies par les communautés autochtones et accessibles à celles-ci peut aider à réparer les torts causés par des données sur la santé publique décontextualisées et fondées sur le déficitNote de bas de page 258. Cette démarche favorise également l'équité en accordant de l'importance aux perspectives des Autochtones et en favorisant l'autodétermination des systèmes de données qui répondent aux besoins des peuples autochtones.
Plusieurs communautés, leaders et universitaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont réalisé d'importants progrès en matière de souveraineté des données et de pratiques de données holistiques fondées sur les forcesNote de bas de page 259. De nombreux documents d'orientation sur la gouvernance des données autochtones et les pratiques éthiques en matière de données sont également disponibles pour les responsables de données autochtones et non autochtones. Ceux-ci comprennent :
- Les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des Premières Nations, ou principes PCAP®, mettent l'accent sur le contrôle exercé par les Premières Nations sur les processus de collecte de données ainsi que sur leurs droits de posséder et contrôler la manière dont ces renseignements peuvent être utilisés. Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations fournit des ressources et offre des activités de sensibilisation et de formation pour appuyer l'application de ces principes, tant par les communautés des Premières Nations que par les personnes et organisations souhaitant travailler avec ellesNote de bas de page 260.
- Le Centre des Métis de l'Organisation nationale de la santé autochtone a élaboré les principes d'éthique de la recherche sur les Métis en collaboration avec des personnes issues du milieu de la recherche, de la communauté étudiante et d'organisations métisses afin de soutenir la conduite de la recherche éthique par et avec les communautés métissesNote de bas de page 261.
- L'Inuit Tapiriit Kanatami a publié en 2018 la stratégie nationale inuite de recherche, qui décrit les mesures coordonnées nécessaires pour améliorer la façon dont la recherche est régie, financée, menée et communiquée dans une perspective d'autodéterminationNote de bas de page 262.
Des exemples de ces pratiques éthiques en matière de données peuvent être observés dans les initiatives autochtones visant à mesurer le bien-être, présentées plus en détail à l'annexe A. L'élaboration de données dirigée par les Autochtones respecte les systèmes de connaissances sur le bien-être autochtone enracinés dans le territoire, les histoires, les cultures et les langues distinctes des communautés et des nations des Premières Nations, des Inuits et des MétisNote de bas de page 142. La production de données et l'acquisition de connaissances dirigées par les Autochtones appuient la prise en charge des processus de collecte et d'utilisation des données, ainsi que la planification, la gouvernance et l'action en matière de bien-être répondant aux priorités locales tout en s'appuyant sur les forces, les identités et les aspirations uniques de chaque communautéNote de bas de page 263. Les données et la recherche sur le racisme structurel et systémique vécues par les populations autochtones sont également essentielles pour influencer le changement des systèmes et appuyer les revendications autochtones concernant l'équité en santéNote de bas de page 264Note de bas de page 265Note de bas de page 266.
La santé publique, championne de l'action intersectorielle
La santé publique reconnaît depuis longtemps l'influence d'autres secteurs sur la santé ainsi que l'importance d'une action intersectorielle pour favoriser la santé et l'équité en santé en agissant sur les déterminants de la santéNote de bas de page 267Note de bas de page 268. Cet engagement apparaît clairement dans les documents de politique internationale en matière de santé, depuis la déclaration d'Alma Ata de 1978 sur les soins de santé primaires jusqu'à la Charte de Genève pour le bien-être de 2021Note de bas de page 3Note de bas de page 269. La santé publique a aussi joué un rôle actif de leader ou de participant au sein d'initiatives intersectorielles. Par exemple, l'initiative des Marmot Places (voir l'encadré « Une approche de santé publique pour lutter contre les iniquités en santé : l'exemple des Marmot Places au Royaume-Uni » illustre comment la santé publique peut réunir les secteurs, favoriser le partage des données et appuyer une politique fondée sur des données probantes afin de s'attaquer collectivement aux déterminants sociaux de la santé et de réduire les iniquitésNote de bas de page 270. Réunir des partenaires, intégrer l'action intersectorielle dans les modèles de financement et agir comme facilitateur durable sont des forces essentielles des systèmes de santé publique qui s'harmonisent étroitement avec les approches de promotion de la santé.
« Lorsqu'il s'agit d'aborder des enjeux complexes et multifactoriels, comme l'itinérance et d'autres crises sociales, qui impliquent de nombreux partenaires et une collaboration intersectorielle, et qui semblent souvent être la responsabilité à la fois de tout le monde et de personne, peut-être que la santé publique a un rôle déterminant à jouer, par exemple, pour documenter ce qui se passe et analyser les besoins locaux. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Une approche de santé publique pour s'attaquer aux inégalités en santé : l'exemple des Marmot Places au Royaume-Uni
Inspirées par les contributions de Sir Michael Marmot pour documenter les causes des iniquités en santé et les façons de les atténuer, les Marmot Places sont des autorités locales du Royaume-Uni qui se sont engagées à mettre en œuvre des interventions et des politiques pour réduire les iniquités en santé. Les régions et les villes qui sont désignées comme des Marmot Places suivent huit principes qui misent sur des mesures à long terme pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et améliorer les conditions de vie, d'apprentissage et de travail des populations localesNote de bas de page 270. Bien que le statut de Marmot Place ne soit pas accompagné d'un financement supplémentaire, les autorités locales s'engagent à planifier à long terme, à renforcer les partenariats intersectoriels et à faire participer les communautés aux mesures visant à contrer les facteurs de mauvaise santé, et à élaborer des processus transformationnels qui peuvent mener à des décisions en matière de politiques publiques et à une affectation des ressources plus efficaces. Pour réaliser ce travail, les Marmot Places collaborent avec l'équipe de Sir Michael Marmot de l'Institute of Health Equity de l'University College London. Cette collaboration vise à évaluer les interventions en place et leur capacité d'adaptation, à relever les iniquités, à promouvoir l'action sur les déterminants sociaux de la santé, à encourager des stratégies fondées sur des données probantes, ainsi qu'à faciliter la collaboration intersectorielle et l'échange de connaissances. Les autorités de la santé publique fournissent aux Marmot Places des données et des analyses sur les iniquités en santé, appuient l'élaboration de politiques axées sur l'équité et évaluent l'incidence des interventions sur la santé de la populationNote de bas de page 270.
En 2024, neuf Marmot Places regroupaient plus de 40 autorités locales en Angleterre et au pays de GallesNote de bas de page 270. L'Écosse élabore une stratégie nationale fondée sur les principes de Marmot et collabore avec trois régions écossaises qui les mettront en pratiqueNote de bas de page 271Note de bas de page 272. Depuis qu'elle est devenue la première Marmot Place en 2013, la ville de Coventry, en Angleterre, affiche des tendances encourageantes selon plusieurs indicateurs, notamment l'amélioration de l'espérance de vie, du niveau de scolarité et des taux d'emploiNote de bas de page 273. Le Coventry Marmot Partnership est dirigé par un comité directeur présidé par le membre du Cabinet chargé de la santé. Ce comité réunit des leaders de premier plan des secteurs public, communautaire et bénévole et poursuit ses efforts pour rassembler des partenaires de différents secteurs et agir sur les déterminants sociaux de la santéNote de bas de page 273. En 2023, le partenariat a conçu l'outil de surveillance de Marmot qui décrit comment différents organismes partenaires harmonisent leur travail avec les principes de Marmot et réduisent les iniquités en santéNote de bas de page 274.
En tant que fonction essentielle de la santé publique, la promotion de la santé repose sur une action intersectorielle visant à améliorer un large éventail de facteurs sociaux, économiques et écologiques. Cela signifie travailler en collaboration avec les communautés et d'autres secteurs pour comprendre et améliorer la santé au moyen de politiques publiques saines, d'interventions communautaires, de la participation citoyenne et d'interventions ciblées sur les circonstances sous-jacentes qui influencent la santé (p. ex. les déterminants de la santé comme le logement, le revenu, le racisme systémique)Note de bas de page 275Note de bas de page 276Note de bas de page 277. La promotion de la santé a été proposée comme principal moyen d'établir un lien entre le bien-être et la santé publique par l'OMS dans son rapport intitulé « Atteindre le bien-être : un cadre mondial destiné à intégrer le bien-être à la santé publique au moyen d'une approche axée sur la promotion de la santé », adopté par les États membres lors de la 76e Assemblée mondiale de la santé en mai 2023Note de bas de page 4.
« Le véritable travail consiste à établir des relations, à comprendre le contexte et à aider à renforcer les capacités. C'est là que la promotion de la santé brille et peut vraiment changer les choses. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
De plus, la Santé dans toutes les politiques (SdTP) est une approche de politiques publiques qui offre une voie vers l'action intersectorielle pertinente au bien-être, en particulier si elle accorde une place importante aux co-bénéficesNote de bas de page 151. La SdTP permet aux décideurs de travailler entre secteurs pour améliorer les conditions de santé, d'équité et de bien-être, rechercher des synergies entre les initiatives et éviter d'éventuels préjudicesNote de bas de page 278Note de bas de page 279. Les stratégies de la SdTP peuvent stimuler les discussions pour définir des objectifs communs, coordonner les actions planifiées, mobiliser les forces de chaque partenaire et de maximiser les retombées collectivesNote de bas de page 268Note de bas de page 280. La SdTP peut également être élargie pour reconnaître les co-bénéfices d'une action qui fait progresser simultanément les objectifs des secteurs de la santé et des autres secteurs. C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé a recommandé de passer de « la santé dans toutes les politiques » à « la santé pour toutes les politiques »Note de bas de page 151.
« Pour nous, la santé dans toutes les politiques est un élément essentiel de l'atteinte du bien-être. En fait, je pense que nous ne pouvons pas l'atteindre sans cette approche. Il faut que tous les ministères réfléchissent à la façon dont les politiques et les lois influencent le bien-être et centrent leurs énergies sur l'élaboration de politiques qui ont une influence positive. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Les leaders de la santé publique ont une vaste expérience dans la mobilisation des partenaires issus de différents secteurs en vue d'une action collective. La recherche en santé publique a mis en lumière certains facteurs facilitants et obstacles à l'action intersectorielle qui pourraient être utiles pour renforcer les initiatives axées sur le bien-être. Il s'agit notamment d'un financement soutenu, d'un engagement politique, des mécanismes de responsabilisation clairs, des environnements propices à la collaboration, des capacités organisationnelles adaptées, ainsi que les défis liés à l'évaluation, notamment le décalage entre les interventions et les effets observables sur la santéNote de bas de page 162Note de bas de page 281. Les spécialistes en santé publique disposent également d'une expérience récente acquise durant la pandémie de COVID-19, qui pourrait les aider à concilier des priorités concurrentes et des intérêts divergents dans le cadre d'initiatives visant le bien-êtreNote de bas de page 24Note de bas de page 282Note de bas de page 283Note de bas de page 284. Cette expérience est particulièrement utile lorsqu'une trop grande importance est accordée aux priorités communes, ce qui limite involontairement l'action aux domaines qui sont plus faciles à mettre en œuvre et moins contestésNote de bas de page 151Note de bas de page 285. Une telle approche peut limiter l'action dans les cas où les intérêts de différents secteurs ne sont pas clairement alignés, par exemple lorsqu'il y existe des tensions entre les priorités environnementales et économiquesNote de bas de page 151Note de bas de page 285. Forts de ces acquis en matière de mobilisation de divers partenaires, les experts en santé publique s'efforcent d'améliorer les modèles de gouvernance pour favoriser une action intersectorielle efficace pour la santé des populations et d'équité en santéNote de bas de page 286Note de bas de page 287Note de bas de page 288. Un exemple des efforts déployés par la santé publique pour favoriser l'action intersectorielle est le cadre élaboré par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (voir l'encadré « Leadership en santé publique pour le bien-être : le cadre de l'INSPQ pour des environnements favorables »). En fournissant des cadres et des outils structurés et fondés sur des données probantes, la santé publique peut aider les gouvernements locaux à concevoir et à mettre en œuvre des interventions intersectorielles efficaces qui créent un environnement positif pour l'équité en santé et le bien-être.
Leadership en santé publique pour le bien-être : le cadre de l'INSPQ pour des environnements favorables
Les municipalités sont aux premières lignes des défis complexes et interreliés, mais elles manquent souvent de cadres communs pour orienter leurs interventions. Le cadre d'analyse systémique de l'INSPQ vise à aider les municipalités à collaborer avec les autorités de la santé publique et d'autres secteurs pour créer des environnements plus sains, cultiver une compréhension commune des facteurs qui renforcent la résilience de la communauté et améliorer le bien-êtreNote de bas de page 187. Le cadre propose aux municipalités des conseils pratiques sur la façon d'intégrer les principes de santé publique dans leur planification et leurs politiques en tenant compte de six environnements clés : politique, économique, bâti, naturel, social et culturel. Il repose sur les principes d'inclusion, d'équité, de résilience, de durabilité et de sécurité. Par exemple, les municipalités peuvent intégrer l'agriculture urbaine dans les règlements de zonage et appuyer les jardins communautaires afin d'améliorer la sécurité alimentaire locale tout en augmentant le nombre d'espaces verts qui atténuent la chaleur extrême. De même, l'investissement dans les infrastructures piétonnières et cyclables réduit la dépendance au transport polluant tout en améliorant l'accès aux services essentiels, comme des options alimentaires sainesNote de bas de page 187. Le cadre a également joué un rôle déterminant dans le renforcement de la collaboration entre la santé publique et les municipalités. Par exemple, la Direction de santé publique de l'Outaouais a élaboré des ateliers sur les milieux sains, fondés sur le cadre, adaptés aux besoins des municipalités locales. Ces ateliers ont servi de point d'entrée pour l'établissement de relations, jetant les bases d'une collaboration durable et efficaceNote de bas de page 289. Le cadre de l'INSPQ offre une approche structurée, qui oriente l'analyse des politiques, l'évaluation et d'autres services de santé publique offerts aux municipalités pour élaborer des projets visant à créer des milieux de vie inclusifs et de grande qualitéNote de bas de page 290.
La santé publique a également soutenu l'action intersectorielle en l'intégrant dans des modèles de financement. Les leçons apprises de ces expériences peuvent être utiles pour les initiatives axées sur le bien-être. Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) et le Fonds d'action intersectorielle de l'ASPC en sont deux exemplesNote de bas de page 291Note de bas de page 292. Le FI-PSM finance des initiatives communautaires visant à promouvoir la santé mentale et le bien-être à long terme. Il va au-delà du changement de comportement en soutenant des projets qui favorisent le bien-être durable à plusieurs niveaux (p. ex. individuel, familial, communautaire). Depuis 2019, ce fonds appuie des projets communautaires visant à établir des partenariats intersectoriels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'alimentation et de la culture, en adoptant une approche reconnue à l'international pour mettre à l'échelle des interventions réussies dans plus de 200 communautésNote de bas de page 293Note de bas de page 294. De son côté, le Fonds d'action intersectorielle vise à renforcer la capacité des communautés à agir de manière intersectorielle sur les déterminants sociaux de la santéNote de bas de page 295. Le Fonds vise à améliorer la santé de la population, à réduire les iniquités en santé et à accroître la résilience des communautés. Ces projets présentent la santé comme un objectif collectif, mobilisant divers collaborateurs partenaires pour aborder les enjeux transversaux qui ont une incidence sur la santé et le bien-êtreNote de bas de page 292. Par exemple, le projet de recherche Partnerships for Better Housing à Winnipeg, au Manitoba, a réuni des partenaires de plusieurs secteurs, des membres de la communauté et des personnes ayant une expérience vécue. Ensemble, ils ont réalisé une évaluation des besoins qui a permis de déterminer les domaines prioritaires d'action collective visant à améliorer les conditions de logement des personnes nouvellement arrivées au Canada et à créer un plan d'action communautaireNote de bas de page 292.
« [Le financement des projets] vient aussi avec une responsabilité de bien connaître ce qui est fait, de savoir comment orienter le financement, puis de trouver un équilibre entre ce que nous pensons qui devrait être fait, comparativement à ce que les communautés [disent qu'elles veulent], […] parce qu'on a le pouvoir de dire oui, on s'en va par-là, ou non, on ne s'en va pas par-là. »
– Extrait d'entrevue (spécialiste en santé publique)
Il est important que le financement de l'action communautaire en matière de bien-être soit souple et adapté aux priorités et aux contextes locaux. Certains bailleurs de fonds l'ont fait en adoptant des modèles flexibles dans leurs définitions ou leurs résultats. Le Fonds pour le bien-être des Premières Nations (voir l'encadré « Le leadership des Premières Nations dans la définition et la promotion du bien-être en Colombie-Britannique : le Fonds pour le bien-être des Premières Nations ») peut servir d'exemple aux bailleurs de fonds en santé publique qui cherchent à appuyer les interventions axées sur le bien-être définies par la communauté et adaptées à la cultureNote de bas de page 296. Ce fonds met également en lumière l'importance du leadership et de l'autodétermination autochtones tant dans la répartition du financement que dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes.
Leadership des Premières Nations dans la définition et la promotion du bien-être en Colombie-Britannique : le Fonds pour le bien-être des Premières Nations
En 2021, le First Nations Public Service Secretariat (FNPSS) de la Colombie-Britannique a lancé le Fonds pour le bien-être des Premières Nations, une initiative novatrice visant à soutenir les Premières Nations et les conseils tribaux dans la définition de leur propre conception du bien-être, ainsi que dans la mise en œuvre de projets visant à le promouvoir. Ce fonds a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de tous les membres des communautés, qu'ils vivent en réserve ou hors réserve, et de contribuer à la réduction de la pauvretéNote de bas de page 296. Les projets sont fondés sur les concepts de bien-être propres aux Premières Nations et répondent aux priorités locales comme la sécurité alimentaire, l'emploi, le renforcement des compétences et la revitalisation culturelle. Afin de faciliter l'accès au financement et d'optimiser les retombées des projets, le FNPSS offre, sur demande, un accompagnement aux Premières Nations tout au long du processus de demande et de l'élaboration du projet. Au moment de la rédaction du présent rapport, le Fonds avait versé près de 17 millions de dollars en subventions à 150 Premières Nations de la Colombie-Britannique et cinq conseils tribaux pour appuyer des initiatives de bien-être définies et dirigées par les communautés dans l'ensemble de la province.
Bien que les communautés soient des spécialistes des contextes et des conditions qui favorisent le bien-être local, elles peuvent avoir besoin de soutien pour accroître la portée et la durabilité de leurs initiatives. Les acteurs de la santé publique peuvent s'impliquer dans ces démarches en soutenant le leadership communautaire en lien avec les priorités de la communauté. Les grandes institutions de santé publique peuvent également apporter une aide structurelle pour soutenir les projets locaux, notamment en facilitant la planification et l'évaluation, en favorisant les échanges de connaissances et en créant des liens entre les partenaires. Les Tables de quartier (voir l'encadré « Tirer parti des Tables de quartier pour appuyer l'action intersectorielle locale et améliorer les conditions de vie dans les quartiers de Montréal ») illustrent bien le rôle de la santé publique dans la reconnaissance et valorisation de l'action communautaire locale sur les conditions du bien-être ainsi que dans le soutien à leur croissance et à leur épanouissement à long terme.
Tirer parti des Tables de quartier pour appuyer l'action intersectorielle locale et améliorer les conditions de vie dans les quartiers de Montréal
Depuis plus de 50 ans, les Tables de quartier de Montréal s'emploient à améliorer les conditions de vie et l'environnement des populations locales, ainsi qu'à réduire la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Tables de quartier rassemblent un groupe diversifié de personnes et d'organismes pour travailler à l'amélioration de leur milieu de vie. En 2006, Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) et la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) ont co-créé l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local (ou l'Initiative montréalaise), qui soutient les Tables de quartier au moyen d'une structure permanente et d'un financement durableNote de bas de page 297.
Depuis sa mise en œuvre, l'Initiative montréalaise a permis aux partenaires de mobiliser les tables pour renforcer leur contribution à l'échelle locale et régionale. Par exemple, les Tables de quartier et la CMTQ ont été consultées pour l'élaboration du plan d'action régional de la DRSP. L'Initiative montréalaise a également permis de renforcer les partenariats et la collaboration entre la DRSP et la CMTQ en matière de lutte contre les changements climatiques et d'intervention en cas d'urgence. Cette collaboration a notamment contribué à améliorer la coordination et à mieux connaître les ressources communautaires existantesNote de bas de page 298Note de bas de page 299. En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les approches communautaires et les inégalités en santé, la CMTQ a également conçu un outil pour évaluer les retombées de l'action intersectorielle locale en cartographiant les résultats transitoires qui marquent les principaux jalons d'un projetNote de bas de page 300. Ces efforts démontrent le rôle important que les institutions de santé publique peuvent jouer dans l'optimisation, le soutien et la coordination des efforts locaux de promotion du bien-être pour accroître les retombées à l'échelle de la population.
La santé publique peut également s'inspirer du leadership et des approches de collaboration des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour établir des relations entre les secteursNote de bas de page 17. Par exemple, le M'Wikwedong Indigenous Friendship Centre d'Owen Sound, en Ontario, a conçu et mis en œuvre le modèle Giiwe pour la prévention systémique de l'itinérance. Cette initiative intersectorielle, dirigée par des Autochtones, s'appuie sur la cérémonie, les savoirs autochtones, le dialogue et l'action concertée afin d'améliorer l'accès aux services pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Il a réussi à renforcer les relations et la coordination entre plus de 20 organismes qui ont investi dans la prévention de l'itinérance dans la ville, y compris des organismes de santé publiqueNote de bas de page 296Note de bas de page 301.
Rôles et responsabilités de la santé publique dans la mise en œuvre des droits autochtones
L'un des rôles clés de la santé publique consiste à soutenir le bien-être des Autochtones par la mise en œuvre d'approches fondées sur les droits. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est un important cadre d'action fondé sur les droits. La Déclaration des Nations unies affirme les droits des peuples autochtones dans le monde et établit un cadre universel des normes minimales nécessaires à leur survie, à leur dignité, à leur bien-être et à l'exercice de leurs droitsNote de bas de page 302Note de bas de page 303. Elle décrit une norme à atteindre liée aux fondements mêmes du bien-être des Autochtones décrits dans la partie 1, notamment : le droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale; la reconnaissance des traités; l'accès aux terres et territoires et à leur protection; la protection et la promotion de la culture et de la langue; les droits économiques et sociaux; la participation à la prise de décisions et le renforcement des institutions autochtones. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies dans l'ensemble des administrations et des secteurs constituerait une mesure forte pour agir sur les facteurs structurels des iniquités qui affectent le bien-être des communautés autochtones au Canada.
Depuis plus d'une décennie, les Premières Nations, les Inuits et les Métis travaillent à faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies au CanadaNote de bas de page 304. En 2021, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette loi reconnaît la Déclaration des Nations Unies comme un instrument international universel en matière de droits de la personne, applicable en droit canadien, et fournit un cadre pour sa mise en œuvre par le gouvernement du CanadaNote de bas de page 111. L'article 5 de la Loi exige que le gouvernement fédéral prenne toutes les mesures nécessaires, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, pour s'assurer que les lois canadiennes sont conformes à la Déclaration des Nations Unies. En 2023, après deux ans de consultation et de coopération avec les peuples autochtones, le gouvernement fédéral a publié le Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations UniesNote de bas de page 305. Le plan d'action propose au Canada une feuille de route pour mettre en œuvre les principes et les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, et pour faire progresser la réconciliation de façon tangible. Il décrit les mesures pangouvernementales visant à appuyer le droit de participer à la prise de décisions concernant les lois, les politiques et les programmes pertinents. Le plan d'action s'inspire des priorités des partenaires autochtones ainsi que des recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones, de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinéesNote de bas de page 306.
Il existe des outils pratiques qui peuvent aider les personnes travaillant en santé publique à intégrer des considérations fondées sur les droits dans les politiques et les pratiques organisationnelles. Par exemple, la CVR a élaboré un guide pour aider les personnes et les organisations à élaborer leurs propres plans de RéconciliACTION en réponse aux appels à l'actionNote de bas de page 307. La trousse d'outils de l'analyse comparative entre les sexes plus selon une perspective autochtone fournit des questions et des pistes de réflexion pour aider les organisations à repérer les obstacles systémiques, à faire entendre les voix autochtones et à assurer une inclusion significative des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre dans les politiques, les programmes et les processus décisionnels de santé publiqueNote de bas de page 308.
Conformément aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur le respect et l'autodétermination, les spécialistes en santé publique peuvent établir des partenariats directs avec les peuples autochtones en les reconnaissant en tant qu'experts, collaborateurs et prestataires de services. L'encadré « Comment appuyer les droits des Autochtones en santé publique » décrit des pistes pour orienter les organisations de santé publique dans leur réflexion sur la façon d'intégrer les droits des Autochtones à leur travailNote de bas de page 142.
Comment appuyer les droits des Autochtones en santé publique
La Dre Marcia Anderson, médecin hygiéniste à l'Office régional de la santé de Winnipeg, a proposé une série de questions pour aider les organismes de santé publique à réfléchir à la façon dont ils peuvent respecter les droits des Autochtones dans la pratique de la santé publiqueNote de bas de page 142. Ces questions concernant la mise en œuvre des droits des peuples autochtones sont largement applicables dans différents secteurs et institutions, et peuvent appuyer les processus de changement organisationnel.
Pour les initiatives locales :
- Un organisme communautaire autochtone pourrait-il mettre en œuvre cette initiative ou ce programme?
- De quels outils, ressources et formes de soutien cet organisme aurait-il besoin pour le faire?
- Quelles sont les responsabilités durables de l'organisme de santé publique?
- Comment la relation de travail entre l'organisme de santé publique et l'organisation communautaire autochtone doit-elle changer pour respecter pleinement le droit à l'autodétermination?
Pour les organismes et comités de santé publique régionaux, provinciaux et nationaux :
- Quelle expertise en santé autochtone et des communautés est nécessaire pour prendre des décisions respectueuses du droit des peuples autochtones à jouir du meilleur état de santé possible?
- Comment avons-nous construit cette expertise par l'entremise des compétences internes et des stratégies de recrutement?
- Quels sont les organismes représentatifs qui doivent participer à la prise de décisions et qui pourraient disposer d'autres experts pouvant contribuer à ce travail?
- Quels protocoles de gouvernance des données et ententes de partage d'information doivent être en place pour garantir l'accès à des données probantes de qualité propres aux réalités autochtones et orienter la prise de décisions?
La santé publique est bien positionnée pour mobiliser ses forces et contribuer aux initiatives intersectorielles axées sur le bien-être en recueillant des données probantes sur les déterminants sociaux et structurels de la santé; en mesurant et en surveillant les iniquités en matière de santé et de bien-être ainsi que leurs déterminants; en soutenant l'action intersectorielle; et en établissant des partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour créer des conditions propices au bien-être autochtoneNote de bas de page 92Note de bas de page 214Note de bas de page 217Note de bas de page 302Note de bas de page 307Note de bas de page 309Note de bas de page 310Note de bas de page 311Note de bas de page 312. La santé publique peut également réfléchir à ses propres objectifs et approches, et explorer les moyens de renforcer les approches en matière de bien-être dans le cadre des politiques, de la pratique et de la recherche en santé publique afin de contribuer à accroître le bien-être au Canada.
La voie à suivre
Le présent rapport traite des avantages à faire converger les approches en matière de bien-être et de santé publique. Le fait d'influencer les conditions qui favorisent le bien-être améliorera également la santé de la population et l'équité en matière de santé. Les personnes œuvrant en santé publique et les responsables des initiatives de bien-être peuvent collaborer pour transformer ces conditions et travailler à la réalisation des co-bénéfices dans l'ensemble des secteurs.
Cette section décrit les possibilités offertes aux personnes travaillant en santé publique pour :
- Intégrer les principales caractéristiques des approches en matière de bien-être à la pratique, aux politiques et à la recherche en santé publique;
- Mobiliser et renforcer les connaissances et les approches en santé publique qui peuvent contribuer aux initiatives intersectorielles axées sur le bien-être.
L'élan actuel autour du bien-être offre une nouvelle occasion pour la santé publique de travailler avec d'autres secteurs afin d'améliorer les conditions favorables à la santé humaine et planétaire, maintenant et pour les générations futures.
Appliquer des approches en matière de bien-être en santé publique
Mobiliser des partenariats intersectoriels à l'aide des cadres de bien-être
Les cadres de bien-être offrent différents points d'entrée pour favoriser l'action intersectorielle sur les dimensions sanitaires, sociales, économiques et environnementales du bien-être (p. ex. espaces verts urbains, logements abordables, emplois de qualité). Ces cadres, qui décrivent les interactions entre ces dimensions, peuvent être utilisés pour promouvoir un langage commun autour d'enjeux complexes, atteindre des objectifs mutuels et reconnaître les co-bénéfices d'une action collective intersectorielle. La santé publique peut s'inspirer des cadres de bien-être pour faire progresser l'action intersectorielle en santé :
- Appliquer des cadres de bien-être pour réunir les partenaires, catalyser l'action collaborative et suivre l'évolution des co-bénéfices pour la santé et le bien-être (p. ex. Indicateur du Vivre Mieux de l'OCDE, Cadre canadien sur la qualité de vie, stratégies municipales, provinciales et territoriales en matière de bien-être, cadres des Premières Nations, des Inuits et des Métis).
- Renforcer les compétences des personnes travaillant en santé publique pour qu'elles puissent adopter des approches en matière de bien-être et favoriser l'action intersectorielle, notamment par une formation interdisciplinaire dans les domaines des finances, du logement, des politiques sociales et de l'environnement, ainsi que sur les savoirs et les modes de connaissance autochtones liés au bien-être.
- Collaborer avec d'autres secteurs afin de déterminer les instruments de politiques publiques appropriés afin d'atteindre des objectifs communs, mettre en commun les ressources – notamment au moyen de mécanismes de financement partagés, créer conjointement des milieux institutionnels favorables et concevoir des programmes et des politiques durables et équitables qui améliorent les conditions de santé et de bien-être.
Mettre l'accent sur les résultats positifs grâce à des approches fondées sur les forces
Les approches axées sur le bien-être mobilisent des solutions qui valorisent les forces des communautés. Elles s'appuient sur leurs ressources et leur leadership tout en intégrant des mesures en matière de politiques publiques avec pour objectif de créer des conditions sociétales permettant aux populations de prospérer. Les personnes œuvrant en santé publique peuvent s'appuyer sur les travaux existants pour mesurer et surveiller les résultats positifs en matière de santé et de bien-être, tout en mettant de l'avant ces résultats par des interventions fondées sur les forces :
- Faire progresser l'élaboration et la mise en œuvre de cadres de santé publique, d'indicateurs, d'initiatives de recherche et d'approches de surveillance qui mettent l'accent sur des résultats positifs en matière de santé et de bien-être;
- Apprendre des communautés et les aider à fournir aux responsables des décisions en matière de politiques et de programmes, dans différents secteurs, des données et des recherches sur la santé et le bien-être fondées sur les forces, afin qu'ils préconisent des mesures pour améliorer les conditions favorables à la prospérité des communautés;
- Offrir du soutien, des ressources et du financement durables et culturellement adaptés aux initiatives communautaires de santé et de bien-être axées sur les objectifs, les connaissances, les forces et les atouts des communautés;
- Soutenir les approches en matière de santé et de bien-être dirigées et autodéterminées par les Autochtones, dans un contexte de relations durables, respectueuses et réciproques avec les communautés, les leaders et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Favoriser le bien-être des générations futures et de la planète
Comme le souligne l'approche « Une seule santé », le bien-être des humains, des animaux et de la planète est indissociable. La recherche de l'équilibre entre les personnes, les animaux, les terres et les eaux, l'esprit et les générations futures a toujours été au cœur des connaissances et des pratiques autochtones. Les acteurs de la santé publique peuvent apprendre de ces perspectives et explorer différentes façons de comprendre ces liens, tout en intégrant la prise en compte du bien-être des générations futures et de la planète dans la pratique, les politiques et la recherche en santé publique :
- Appuyer la mise en œuvre et l'évaluation de politiques et de plans d'action tournés vers l'avenir en renforçant la collecte de données et la modélisation à long terme pour mieux comprendre les tendances en matière de santé et de bien-être au fil du temps.
- Élargir et mettre en œuvre des approches de recherche et de surveillance transdisciplinaires (p. ex. Une seule santé) pour éclairer les politiques et les programmes de santé publique qui tiennent compte des interconnexions dynamiques entre la santé humaine, animale et environnementale et le bien-être.
- Assurer un financement et un soutien continus pour favoriser l'enrichissement des savoirs, des sciences et des modes de connaissance des Premières Nations, des Inuits et des Métis en matière de santé et de bien-être relationnels, conformément aux principes de souveraineté des données autochtones et d'éthique de la recherche.
Contribuer au bien-être par l'entremise de la santé publique
Mobiliser les connaissances et les données probantes sur les déterminants sociaux et structurels de la santé et du bien-être
Les dimensions du bien-être chevauchent de façon significative les déterminants sociaux et structurels de la santé. Il y a lieu de mettre à profit et de renforcer la recherche et les données sur ces déterminants pour appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives axées sur le bien-être. En particulier, une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels les déterminants structurels (p. ex. déterminants commerciaux, déterminants numériques, racisme systémique et discrimination) influencent le bien-être au sein des populations à différentes échelles favorise une action intersectorielle équitable et durable, axée sur l'amélioration des conditions du bien-être. Les personnes œuvrant en santé publique peuvent :
- Renforcer les données et la recherche sur les liens entre les déterminants émergents, notamment numériques et commerciaux, et les résultats en matière de bien-être tout au long de la vie, en tenant compte de leurs interactions avec d'autres déterminants.
- Mobiliser les connaissances interdisciplinaires et les données probantes sur les déterminants sociaux et structurels de la santé pour appuyer l'élaboration de politiques et d'initiatives qui agissent sur les principaux facteurs d'iniquité dans les conditions de santé et de bien-être, notamment le racisme systémique et la discrimination.
Mesurer et surveiller les iniquités en matière de bien-être
Le renforcement ainsi que le partage des données et des recherches sur l'équité en santé soutiennent les initiatives et les politiques relatives au bien-être. Les personnes œuvrant en santé publique peuvent également promouvoir la collecte et l'analyse de données éthiques en collaboration avec les communautés concernées. Ces dernières prennent part à la prise de décisions dans tout l'écosystème des données, de la détermination des domaines de recherche et de surveillance prioritaires à l'interprétation des données et leur traduction en action. Les possibilités en la matière comprennent :
- Renforcer les approches existantes de recherche et de surveillance en santé publique pour mieux mesurer, suivre et rendre compte des iniquités et des tendances en ce qui concerne les résultats et les déterminants du bien-être.
- Poser les questions en matière d'équité pour intégrer les considérations relatives à l'équité en santé dans les initiatives de santé publique et de bien-être, notamment lors de la collecte et de l'utilisation de données sur le bien-être.
- Faciliter la collecte et l'interprétation des données désagrégées par groupes de population, en collaboration avec les leaders des communautés, afin de rendre compte des effets différentiels sur le bien-être.
- Contribuer au partage des données et à leur interopérabilité au sein de la santé publique et entre les secteurs afin de faciliter l'analyse des relations entre les dimensions du bien-être, tout en respectant les normes de confidentialité des données, les principes de souveraineté des données autochtones et une gestion appropriée des données communautaires.
- Aider les communautés à définir, mesurer et surveiller le bien-être en améliorant l'accès aux données existantes en santé publique et en facilitant la recherche communautaire sur le bien-être.
Faire progresser l'action intersectorielle
La santé publique reconnaît depuis longtemps l'importance de mobiliser tous les secteurs pour améliorer les conditions favorisant la santé. En s'appuyant sur cette expérience, les personnes œuvrant en santé publique peuvent contribuer à la création de partenariats durables et à la mise en œuvre de mesures de collaboration entre les différents secteurs et les communautés dans le cadre d'initiatives axées sur le bien-être. Elles peuvent également chercher des occasions de contribuer aux initiatives existantes tout en faisant preuve d'humilité, de souplesse et d'adaptabilité. Les possibilités comprennent notamment :
- Définir le rôle de la santé publique dans les initiatives axées sur le bien-être, en déterminant les domaines où elle peut offrir un soutien utile (c.-à-d. réunir les parties prenantes, fournir des données probantes, mobiliser des réseaux existants).
- Promouvoir des possibilités de mobilisation et de collaboration culturellement sécuritaires pour les diverses communautés afin qu'elles apportent leurs connaissances et leur expertise à des initiatives axées sur le bien-être, notamment en créant des occasions pour les jeunes de participer à la prise de décisions.
- Utiliser des approches intersectorielles (p. ex. la promotion de la santé, la Santé dans toutes les politiques et « Une seule santé ») pour appuyer l'élaboration et la gouvernance de modèles de partenariat stratégique et durable et de mécanismes de responsabilisation dans le cadre d'initiatives axées sur le bien-être.
- Soutenir la recherche interdisciplinaire sur les interventions pour en savoir plus sur les résultats et les mécanismes d'action des initiatives axées sur le bien-être, ce qui comprend des analyses des co-bénéfices qui répondent aux objectifs et aux priorités de tous les partenaires.
Collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis
Les Premières Nations, les Inuits et les Métis disposent de nombreux systèmes de connaissances sophistiqués et diversifiés en matière de bien-être, et jouent un rôle de premier plan dans la promotion des approches en matière de bien-être partout au pays. La mise en œuvre d'approches fondées sur les droits des Autochtones appuie la réconciliation, la sécurité culturelle, l'autodétermination et la souveraineté, en tant que voies d'accès au bien-être des Autochtones. La santé publique a la responsabilité de faire progresser la réconciliation et d'établir des relations renouvelées avec les populations et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis fondées sur la reconnaissance des droits, le respect et le partenariat. Les personnes œuvrant en santé publique peuvent notamment :
- S'engager dans un dialogue respectueux et significatif avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, dans une perspective de relations durables et avec une posture d'humilité culturelle, afin de renforcer nos connaissances collectives sur le bien-être en tirant parti à la fois des modes de connaissance autochtones et occidentaux.
- Créer des occasions de partenariat avec les leaders, les organisations et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin d'investir dans les données, la recherche, les politiques et les programmes sur le bien-être conçus et dirigés par les Autochtones.
- Intégrer des approches fondées sur les droits autochtones dans les systèmes de santé publique et les partenariats intersectoriels afin de promouvoir le bien-être des générations actuelles et futures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Annexe A : Exemples clés d'initiatives axées sur le bien-être
Il existe de nombreux exemples de politiques et d'initiatives de mesure du bien-être aux échelons international, national et local. La sélection d'exemples qui suit donne un aperçu du contexte historique et de l'étendue des approches en matière de bien-être.
Initiatives internationales des gouvernements centraux axées sur le bien-être
Au cours des dernières années, un certain nombre de gouvernements ont pris des mesures pour transformer les lois, l'élaboration des politiques et les processus budgétaires afin d'améliorer le bien-être de la populationNote de bas de page 34. Citons la Finlande et l'Écosse, qui ont intégré des indicateurs de bien-être dans les processus budgétaires nationaux afin d'éclairer la prise de décisions et la planification à long terme dans tous les ministèresNote de bas de page 34.
La Loi sur le bien-être des générations futures du pays de Galles, qui établit des objectifs nationaux visant à améliorer le bien-être des générations actuelles et futures, est un exemple de politique sur le bien-être appuyée par une loi. Elle encourage notamment l'action intersectorielle en légiférant sur les exigences relatives aux approches collaboratives et intégrées dans l'ensemble du secteur publicNote de bas de page 313. Afin d'appuyer la mise en œuvre de la loi, le Cadre des générations futures a été créé pour suivre les résultats en matière de bien-être dans les domaines environnemental, social, culturel et économique. La santé publique du pays de Galles a contribué à la Loi sur le bien-être des générations futures en collaborant avec les conseils régionaux et en évaluant les répercussions sur la santé des politiques publiques liées à la loiNote de bas de page 314. En général, les acteurs de la santé publique peuvent jouer un rôle essentiel en assurant le leadership, la coordination, la production de données probantes, la recherche, la consultation et la défense des intérêts dans le cadre d'initiatives gouvernementales axées sur le bien-être.
Malgré des gains importants, ces initiatives rencontrent plusieurs défis, dont la coordination entre les priorités ministérielles, les contextes et les cultures organisationnelles; les contraintes liées aux ressources et à la pérennité du financement; ainsi que les changements dans le leadership politique ou les orientations gouvernementalesNote de bas de page 34Note de bas de page 314Note de bas de page 315. Les leaders de la santé publique peuvent jouer un rôle important pour faire progresser et maintenir l'accent sur le bien-être au fil du temps.
Initiatives canadiennes axées sur le bien-être
En 2021, le gouvernement du Canada a publié le Cadre de qualité de vie pour le Canada (présenté à la partie 1). Le cadre a été conçu pour mesurer le bien-être et intégrer le bien-être dans la budgétisation et la prise de décisions du gouvernement fédéralNote de bas de page 35. Statistique Canada dispose d'un Carrefour de la qualité de vie, qui comprend des tableaux de bord présentant divers indicateurs de qualité de vie à l'échelle des municipalités et des subdivisions de recensement. L'élaboration du cadre a été pilotée par le ministère des Finances Canada et Statistique Canada et passée en revue par plus de 20 ministères et organismes fédéraux (y compris l'Agence de la santé publique du Canada), des représentants provinciaux et territoriaux, des organisations autochtones nationales et des experts en la matière au Canada et à l'étrangerNote de bas de page 316. Le cadre a été intégré en tant que composante des processus budgétaires fédéraux, et le ministère des Finances produit des rapports sur les répercussions prévues des initiatives budgétaires sur la qualité de vie. Depuis décembre 2021, sous la direction du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le cadre a également été adopté dans d'autres secteurs du processus décisionnel du Cabinet et des rapports ministériels au Parlement. Grâce à l'intégration de ces processus pangouvernementaux, il peut servir d'approche normalisée pour examiner et intégrer les bénéfices des politiques proposées dans l'ensemble des secteursNote de bas de page 316.
En dehors du gouvernement, l'Indice canadien du mieux-être (ICM), élaboré par la Fondation Atkinson, est aujourd'hui hébergé à l'Université de Waterloo. Il s'agit d'un indice composite établi à partir de 64 indicateurs dans huit domaines (vitalité communautaire, participation démocratique, éducation, environnement, populations en santé, loisirs et culture, niveau de vie et emploi du temps)Note de bas de page 317. Des résultats sont publiés depuis 2009Note de bas de page 317. Au moment de la rédaction du présent rapport, selon une publication à paraître sur l'Indice canadien du mieux-être, le PIB du Canada a augmenté de 52,8 % entre 1994 et 2022, tandis que l'indice de mieux-être global a progressé de 3,5 %. Les augmentations initiales de l'indice ont été bloquées par la récession économique de 2008 et la pandémie de COVID-19 qui a commencé en 2020. Comparativement à 1994, les domaines de la vitalité communautaire, des loisirs et de la culture, des populations en santé et du niveau de vie ont affiché une baisse en 2022Note de bas de page 318. L'Indice canadien du mieux-être a également produit des indices pour des partenaires provinciaux et territoriaux (soit l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, le Manitoba et le Yukon) qui reflètent les variations régionales du bien-être. Une enquête mesurant le bien-être subjectif des Canadiens et Canadiennes a également été élaborée pour mieux saisir l'expérience de populations dans les petites collectivités, lorsque les données locales ou régionales ne sont pas disponibles. Cette enquête a été utilisée par un certain nombre de provinces et de territoires, de municipalités et d'organisations partout au pays dans le cadre des efforts visant à réduire les iniquités en matière de bien-être pour les groupes prioritairesNote de bas de page 319.
Partout au Canada, des communautés ont réalisé des progrès dans la mesure et le suivi des indicateurs de bien-être afin de mieux saisir les expériences vécues et les iniquités historiques, et de contribuer au changement. Par exemple, la stratégie intersectorielle quinquennale Road to Economic Prosperity (REPP), conçue par la communauté afro-néo-écossaise, vise à répondre aux enjeux systémiques – tels que le racisme envers les personnes noires – et à améliorer le bien-être des Néo-Écossais d'origine africaineNote de bas de page 320. Lancé en mai 2024 dans le cadre de la mise en œuvre du REPP, l'African Nova Scotian Prosperity and Well-being Index utilise les plus récentes données disponibles provenant de diverses sources, dont l'enquête sur la qualité de vie menée par Engage Nova Scotia. Cet indice décrit la situation de la communauté afro-néo-écossaise selon plusieurs dimensions comme la population, le travail, le revenu, l'éducation, le logement et le bien-être subjectifNote de bas de page 321. L'indice est un exemple d'initiative de production de données sur le bien-être conçue et dirigée par la communauté, qui vise à appuyer l'action collaborative en matière d'équité.
De nombreuses communautés et municipalités du pays ont mené des initiatives en matière de politiques, de programmes et de données sur le bien-être adaptées à leurs contextes et priorités. Certaines organisations non gouvernementales assurent également un rôle de leadership, de coordination et de renforcement des capacités et de soutien des initiatives locales afin de favoriser des conditions propices au bien-être et à l'équité en santé. Par exemple, les Réseaux en faveur du changement de l'Institut Tamarack travaillent avec des mouvements collaboratifs locaux et multisectoriels qui élaborent, mettent en œuvre et évaluent des initiatives à grande échelle visant à mettre fin à la pauvreté, à bâtir un sentiment d'appartenance, à établir des liens avec la communauté, à améliorer les résultats auprès des jeunes et à faire progresser une transition socioécologique juste. Ils aident les communautés de plus de 400 municipalités à cartographier leurs atouts, à déterminer les causes profondes des enjeux et à explorer des stratégies d'action. Les réseaux fournissent également des conseils et du soutien pour renforcer la capacité municipale à mobiliser les personnes ayant une expérience vécue dans les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes des iniquités en matière de bien-être. La santé publique joue un rôle de premier plan dans ce travail en participant à des tables rondes multisectorielles, que ce soit en assurant la présidence, en tant que partenaire ou leader, ou en apportant un soutien technique pour mesurer et surveiller les déterminants et les résultats en matière de bien-être. De même, Espace MUNI est un organisme regroupant plus de 400 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui souhaitent créer des milieux de vie durables et inclusifs permettant aux citoyens de réaliser leur plein potentiel. Espace MUNI fournit un soutien financier, des outils et de l'inspiration pour aider les municipalités à renforcer leurs capacités dans les domaines de la participation citoyenne, de l'intersectorialité et des politiques publiques. La santé publique contribue souvent à titre de partenaire à l'échelle municipale et en menant des évaluations d'impact sur la santéNote de bas de page 322.
Initiatives axées sur le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis
Les communautés, les organisations et les gouvernements autochtones de partout au Canada ont réalisé des gains importants en mobilisant leurs savoirs sur le bien-être pour transformer la gouvernance, les programmes, les systèmes de données et les services afin de renforcer les fondements du bien-être dans des divers contextes et communautés.
Il existe de nombreux exemples de mesures de bien-être dirigées par les Autochtones sur le plan des politiques publiques, qui se traduisent par des progrès réalisés en matière d'autonomie gouvernementale des Autochtones et la création de partenariats entre les leaders autochtones et les gouvernements occidentaux. Par exemple, la Vision for Health des Métis, élaborée en 2017 dans le cadre d'une collaboration entre les gouvernements métis de l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique, définit la santé comme un bien-être holistique influencé et façonné par des structures sociales plus vastes et les déterminants de la santé propres aux Métis. Ces déterminants comprennent notamment les liens familiaux et de parenté, la communauté, la culture et le lien avec le territoire. Ce document présente une vision pour la santé et le bien-être des Métis afin d'orienter l'élaboration de lois sur la santé propres aux MétisNote de bas de page 323. Un autre exemple est la stratégie et le cadre de qualité de vie de Nisg̱a'a Lisims. Ce cadre est utilisé par le gouvernement de Nisg̱a'a Lisims pour guider les mesures visant à améliorer les conditions de vie des membres de la communauté. La stratégie a été élaborée au moyen d'une approche participative et comprend des indicateurs de rendement clés qui reflètent la façon dont les gens perçoivent et décrivent les relations entre la gouvernance, les politiques publiques et la qualité de vieNote de bas de page 324. À l'échelle fédérale, la politique sur l'Inuit Nunangat a été élaborée conjointement par le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. Elle vise à promouvoir la prospérité et à favoriser le bien-être des communautés et des personnes dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat en ayant pour objectif l'équité socioéconomique et culturelle entre les Inuits et les autres personnes vivant au Canada. La politique guide tous les ministères et organismes gouvernementaux dans la répartition équitable des ressources et dans la collaboration avec les gouvernements et les organisations inuites, afin de renforcer l'autodétermination et la compétence dans la conception et la prestation de politiques, de programmes et de services qui ont une incidence sur les InuitsNote de bas de page 325.
Des scientifiques et des organisations autochtones ont également élaboré et mis en œuvre de nouveaux cadres d'indicateurs et de mesures fondés sur les savoirs autochtones et les principes de la souveraineté des données. Par exemple, l'Enquête régionale sur la santé, menée par le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, mesure la santé et le bien-être holistiques des enfants, des jeunes et des adultes des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les communautés du Nord. L'Enquête nationale sur la santé des Inuits Qanuippitaa?, dirigée par les Inuits, vise à mesurer la santé et le bien-être tout en tenant compte des valeurs, des forces et des priorités de recherche des Inuits. En Colombie-Britannique, la Régie de la santé des Premières Nations et l'agente provinciale de la santé ont collaboré à l'élaboration du Programme de santé et de bien-être de la population (PHWA). Ce programme consiste en une série de rapports sur dix ans qui permet de suivre et de rendre compte de la santé et du bien-être des Premières Nations en Colombie-Britannique en utilisant 22 indicateurs de santé et de bien-être. Enraciné dans les enseignements des Premières Nations, le PHWA adopte une approche fondée sur les forces, mettant l'accent sur la résilience, l'autodétermination et l'approche à double regard (Two-Eyed Seeing) pour intégrer les systèmes de connaissances autochtones et occidentauxNote de bas de page 326.
Annexe B : Méthodologie
Le rapport annuel 2025 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada (ACSP) a été rédigé à la suite d'une revue des meilleures données disponibles, y compris des recherches provenant de sources universitaires, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des consultations auprès d'experts de la santé publique, des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des communautés.
Les données probantes ont été recueillies selon les approches résumées ci-dessous.
Revues des données scientifiques
- L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a demandé au Centre de collaboration nationale des méthodes et outils de procéder à une revue rapide des données probantes afin de répondre à la question suivante : « Quelles interventions ou politiques à l'échelle nationale ou populationnelle, qui tiennent compte des déterminants sociaux de la santé mentale, ont un effet sur la santé mentale et le bien-être? »
- À la demande du Bureau de l'ACSP (BACSP), l'ASPC a également commandé des mises à jour de la revue existante suivante :
- Approches pangouvernementales en matière de bien-être : Analyse comparative de quatre initiatives de gouvernements centraux (mise à jour par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé)
- Des recherches documentaires continues ont été effectuées par le BACSP, avec des sous-thèmes en anglais et en français, selon les besoins, en consultant des bases de données en ligne comme MEDLINE et Scopus.
Rapports sur la santé publique et autre littérature grise
- Le BACSP a mené des recherches documentaires continues pour repérer la littérature grise et les rapports de santé publique sur le bien-être provenant de sources clés telles que des organismes de santé publique (p. ex. l'Organisation mondiale de la Santé) et des publications gouvernementales (p. ex. des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux, municipaux et autochtones).
- Des exemples concrets et études de cas en santé publique ont été recueillis grâce à la collaboration d'experts dans les domaines de la santé publique et du bien-être. Ces exemples ont été sélectionnés pour illustrer la diversité des initiatives en cours au Canada, en mettant l'accent sur différentes régions géographiques et communautés.
Activités de mobilisation et entrevues auprès d'experts
Le BACSP a mené un processus de mobilisation ciblé axé sur les éléments suivants :
- des pratiques prometteuses et des exemples appliqués qui ont réussi à mobiliser différents secteurs pour promouvoir l'équité en santé et améliorer le bien-être de la communauté et de la population;
- le rôle de la santé publique dans la promotion ou le soutien d'une action intersectorielle sur le bien-être des communautés et des populations;
- les défis liés à la mise en œuvre, à l'évaluation et au maintien des initiatives axées sur le bien-être;
- les perspectives et connaissances des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur le bien-être et ses déterminants.
Ce processus de mobilisation comprenait des activités d'échange de connaissances, une série d'entrevues sous contrat avec des représentants d'initiatives axées sur le bien-être au Canada, des entrevues avec des responsables de la santé publique et des experts impliqués dans des initiatives axées sur le bien-être, ainsi que des activités de mobilisation autochtone ciblées décrites ci-dessous.
Activité d'échange de connaissances d'experts sur le bien-être et la santé publique
En juin 2024, le BACSP et le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé ont organisé un événement virtuel d'échange de connaissances pour recueillir les diverses expériences et points de vue sur le bien-être. L'activité a rassemblé un grand nombre d'experts issus des milieux de la recherche, de la pratique et des politiques publiques en santé publique, ainsi que des leaders d'organisations et des voix communautaires. À la suite des présentations d'ouverture, quatre groupes de discussion se sont concentrés sur l'un des quatre principaux sujets, soit les politiques publiques en matière de bien-être, le bien-être et le système de santé publique, la promotion du bien-être dans les communautés et l'équité en matière de bien-être. Cet événement a éclairé le cadre général du rapport de 2025 de l'ACSP.
Conseil jeunesse du premier ministre
En novembre 2024, l'ACSP a rencontré le Conseil jeunesse du premier ministre pour discuter du bien-être des jeunes et des facteurs sociaux qui influencent le bien-être. Le Conseil présente au gouvernement fédéral les perspectives des jeunes sur les principaux enjeux qui les touchent au Canada. Les membres du Conseil proviennent de régions de partout au Canada, y compris des régions rurales et urbaines, et représentent un éventail d'expériences en matière d'éducation, d'emploi et de parcours de vie. Le conseil comprend également des jeunes autochtones et issus d'autres groupes racisés, ainsi que des jeunes qui s'identifient comme étant 2ELGBTQIA+. Les échanges ont été structurés autour des questions suivantes :
- En tant que jeune leader au Canada, qu'est-ce que le concept de bien-être signifie pour vous?
- Une approche de bien-être, telle que décrite dans la Charte de Genève, peut offrir des bases sur lesquelles les générations futures pourront s'épanouir sur une planète en santé. À votre avis, quels sont les trois changements que nous devrions apporter maintenant pour que les générations futures puissent s'épanouir?
- Selon vous, quelles politiques sont nécessaires pour mettre en œuvre une approche en matière de bien-être?
Entrevues auprès d'experts
Le BACSP a réalisé sous contrat des entrevues avec des représentants de 11 initiatives axées sur le bien-être à l'échelle du pays. Les initiatives choisies répondaient aux critères suivants :
- un accent était mis sur le bien-être de la population;
- une perspective d'équité était mise de l'avant;
- les communautés locales étaient mobilisées;
- une approche intersectorielle était adoptée.
D'autres considérations comprenaient la représentation géographique et linguistique. Les questions d'entrevue portaient sur l'origine de l'initiative, son organisation et sa gouvernance, les réussites et les défis en matière de conception et de mise en œuvre, les résultats tangibles, les partenariats entre les secteurs ainsi que la manière dont le bien-être était intégré à l'ensemble des activités.
Le BACSP a mené quatre entrevues complémentaires avec des spécialistes de la santé publique qui participent directement à des initiatives axées sur le bien-être au Canada afin d'en apprendre davantage du point de vue de la santé publique sur les rôles actuels et potentiels de la santé publique pour faire progresser le bien-être au Canada.
Les entrevues ont toutes eu lieu entre juin 2024 et mars 2025, en français ou en anglais.
Collaboration avec des groupes et experts autochtones
Afin de mettre en valeur l'expertise considérable des leaders autochtones en matière de bien-être et d'apprendre de celle-ci, le BACSP a collaboré tout au long de l'élaboration du rapport avec un groupe de travail composé d'experts et de leaders autochtones en matière de bien-être et de mieux-être. Le groupe de travail autochtone du rapport de 2025 de l'ACSP comprenait des experts des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que des représentants du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Ce groupe de travail a prodigué des conseils et des orientations sur le cadrage et le contenu du rapport, les activités de consultation et de mobilisation, ainsi que sur la façon de présenter les concepts autochtones du bien-être et les initiatives dirigées par les Autochtones.
Dans le cadre de la conférence annuelle sur le bien-être des Autochtones qui a eu lieu en octobre 2024 à Kelowna, en Colombie-Britannique, les membres du groupe de travail ont animé une discussion interactive sur le bien-être autochtone et la santé publique. Le public a été invité à partager ses points de vue, idées et connaissances en répondant aux questions suivantes :
- Comment la culture contribue-t-elle au mieux-être dans votre communauté?
- Comment pouvons-nous surmonter les principaux obstacles au mieux-être?
- Qu'est-ce qui a été le plus important pour votre mieux-être?
- De quoi avons-nous besoin pour le mieux-être communautaire?
- Comment la santé publique peut-elle soutenir nos communautés pour favoriser le mieux-être?
- Quels résultats rendent compte du mieux-être de la communauté?
Les personnes présentes ont répondu par la discussion et des moyens d'expression artistiques comme le dessin, l'écriture, des autocollants et le collage. Au cours de la conférence, l'artiste de la Première Nation Deninu Kųę, Dre Lisa Boivin, a animé des ateliers d'échange de connaissances sur le thème du mieux-être autochtone. Ses œuvres d'art originales figurent dans le présent rapport.
Ce riche contenu, qui illustre à la fois les perspectives communes et les expériences et connaissances distinctes sur ce que signifie être bien et ce qu'il faut pour favoriser le mieux-être, a éclairé la réflexion de l'équipe de rédaction et les discussions du groupe de travail.
En outre, le BACSP a mené des activités de mobilisation ciblées avec les organisations suivantes pour obtenir des suggestions et des exemples d'initiatives dirigées par des Autochtones : l'Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis, la Manitoba Métis Federation, l'Association des femmes autochtones du Canada, l'Association nationale des centres d'amitié et la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario. Le BACSP est engagé à améliorer les possibilités et les mécanismes de collaboration significative avec les leaders et les organisations autochtones tout au long de l'élaboration du rapport, dans un esprit d'apprentissage continu, d'humilité culturelle et de construction de relations durables.
Rétroaction et révision des ébauches
Les ébauches du rapport ont été soumises à un examen critique par divers experts à différentes étapes de l'élaboration du rapport, y compris des experts nationaux et étrangers sélectionnés en santé publique et bien-être, des experts communautaires, ainsi que des experts et des organisations autochtones en matière de bien-être.
Limites
Portée et recherche documentaire
Le rapport annuel 2025 de l'ACSP se penche sur l'élan qui entoure le bien-être en tant qu'approche et objectif de politiques publiques intersectoriels, ainsi que sur la façon dont les systèmes de santé publique peuvent s'en inspirer et y contribuer afin d'améliorer la santé et le bien-être des personnes au Canada. Compte tenu de l'ampleur du sujet, le niveau de détail fourni dans chaque partie est nécessairement limité. Par conséquent, le rapport ne constitue pas une revue exhaustive des données probantes, mais plutôt une synthèse des publications clés. Seuls les documents publiés en anglais et en français ont fait l'objet d'une revue. Aucune évaluation détaillée de la qualité des études et du risque de biais n'a été effectuée dans le cadre de cette revue.
Langue
Dans la mesure du possible, l'équipe de rédaction a tenté d'utiliser un langage normalisé, inclusif et culturellement approprié lorsqu'elle a eu recours à des données relatives à différentes communautés et à leurs expériences en matière de santé et de bien-être. Cependant, dans certains cas, l'équipe s'est fiée à la terminologie employée dans les documents sources (p. ex. les aînés ou les personnes âgées), si cette terminologie avait une signification ou une pertinence particulière dans ces documents.
Remerciements
De nombreuses personnes et organisations ont contribué à l'élaboration du présent rapport.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes conseillères et conseillers, qui ont fait part de leur expertise et fourni des conseils stratégiques :
- Dr Evan Adams, boursier canadien Harkness 2024-2025, Université d'Hawaï à Mānoa; médecin en chef adjoint, Santé publique, Régie de la santé des Premières Nations
- Dre Margaret Barry, titulaire établie de la chaire en promotion de la santé et santé publique, responsable du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la Santé pour la recherche en promotion de la santé, Université de Galway (Irlande); présidente sortante de l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé
- Sir Michael Marmot, professeur d'épidémiologie et directeur de l'Institute for Health Equity, University College London (Grande-Bretagne); président sortant de l'Association médicale mondiale
- Dr Cory Neudorf, professeur, santé communautaire et épidémiologie, Université de la Saskatchewan
- Dre Candace Nykiforuk, professeure, École de santé publique, Université de l'Alberta; titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les milieux communautaires et les politiques publiques pour le bien-être
- Dre Gaynor Watson-Creed, doyenne associée de la Serving and Engaging Society, professeure adjointe, Santé communautaire et épidémiologie, Faculté de médecine, Université Dalhousie
Je remercie du fond du cœur les membres du groupe de travail autochtone de 2025 pour leurs précieux conseils et points de vue :
- Dr Evan Adams, boursier canadien Harkness 2024-2025, Université d'Hawaï à Mānoa; médecin en chef adjoint, Santé publique, Régie de la santé des Premières Nations
- Dre Gwen Healey Akearok, directrice exécutive et scientifique, Qaujigiartiit Health Research Centre, Iqaluit (Nunavut); professeure adjointe, Division des sciences humaines, École de médecine du Nord de l'Ontario
- Dre Carol Hopkins, directrice générale, Thunderbird Partnership Foundation
- Dre Gabrielle Legault, professeure adjointe en études autochtones, Département des études communautaires, culturelles et mondiales, Université de la Colombie-Britannique (campus de l'Okanagan)
- Dre Deanna Nyce, présidente-directrice générale, Wilp Wilxo'oskwhl Nisga'a Institute; membre du comité consultatif, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone
Je tiens également à souligner la contribution de la Dre Lisa Boivin de la Première Nation Deninu Kųę, dans le Denendeh (Territoires du Nord-Ouest), éducatrice autochtone pour le Réseau universitaire de santé et le Center for Wise Practices in Indigenous Health (Ganawishkadawe) du Women's College Hospital de Tkaronto (Toronto), pour avoir créé des œuvres d'art originales illustrant les enseignements autochtones en matière de mieux-être. Je tiens à remercier l'Aîné Parry Francois, de l'Assemblée des chefs du Manitoba, d'avoir ouvert notre activité d'échange de connaissances d'expert de façon positive et d'avoir fait part de ses enseignements et de ses réflexions sur le bien-être.
Je remercie très sincèrement les spécialistes de partout au Canada, notamment les médecins hygiénistes, les personnes œuvrant en santé publique, les scientifiques, les organisations non gouvernementales et les leaders communautaires, qui ont participé aux discussions et aux entrevues sur le rôle de la santé publique dans l'atteinte du bien-être au Canada.
J'en profite pour remercier les analystes et les experts issus des organisations autochtones suivantes pour leurs conseils et leur révision du contenu du rapport : l'Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis, la Fédération des Métis du Manitoba, l'Association des femmes autochtones du Canada, l'Association nationale des centres d'amitié et la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario.
J'aimerais également remercier les membres du personnel des Centres de collaboration nationale en santé publique de leur soutien et de leur contribution. Je remercie sincèrement la Dre Ilona Kickbusch (Centre de santé mondiale, Institut de hautes études de Genève), Chris Barrington-Leigh (Réseau canadien de connaissances sur le bien-être), Danya Pasturszek (Institut Tamarack), Danny Graham (Engage Nova Scotia), Bryan Smale (Indice canadien du mieux-être) ainsi que le Dr Ruediger Krech et la Dre Faten Ben Abdelaziz (Département de la promotion de la santé, Organisation mondiale de la Santé) d'avoir passé en revue ce rapport.
Je remercie nos collègues de l'Agence de la santé publique du Canada, de Santé Canada, de Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, de Statistique Canada, du Secrétariat du Conseil du Trésor et du ministère de la Justice, qui nous ont fait part de leurs idées, de leurs conseils et de leurs commentaires sur les versions préliminaires du rapport.
Enfin, merci aux membres de mon bureau qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Je remercie tout particulièrement les équipes des rapports et des politiques scientifiques pour leur engagement et leur dévouement, de la conception à la publication : Fabienne Boursiquot, Dre Marie Chia, Dre Charlene Cook, Stephanie Cunningham-Reimann, Janis Ellis-Claypool, Elyse Fortier, Rhonda Fraser, Dre Kimberly Girling, Dre Kimberly Gray, Dr David Grote, Tasha Lake, Jessica Lepage, Jennifer Lew, Sarah Maxwell, Danielle Noble, Batul Presswala, Saïdou Sabi Boun, Shauna Sanvido, Dre Sarah Schwarz et Ashley Shaw.
Références
- Notes de bas de page 1
-
World Health Organization. Promoting well-being. World Health Organization; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 2
-
World Health Organization. Health Promotion Glossary of Terms 2021. World Health Organization; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 3
-
Organisation mondiale de la Santé. Charte de Genève pour le bien-être. Organisation mondiale de la Santé; 2022.
- Notes de bas de page 4
-
Organisation mondiale de la Santé. Atteindre le bien-être : un cadre mondial destiné à intégrer le bien-être à la santé publique au moyen d'une approche axée sur la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé; 2023.
- Notes de bas de page 5
-
World Health Organization. Towards Developing WHO's Agenda on Well-Being. Geneva: World Health Organization; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 6
-
World Health Organization. Bending the Trends to Promote Health and Well-Being: A Strategic Foresight on the Future of Health Promotion. Geneva: World Health Organization; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 7
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Comment va la vie? 2024 : Bien-être et résilience en temps de crise. Paris: Éditions OCDE; 2024.
- Notes de bas de page 8
-
van Kessel, R, Seghers, LE, Anderson, M, Schutte, NM, Monti, G, Haig, M, et al. A Scoping Review and Expert Consensus on Digital Determinants of Health. Bulletin of the World Health Organization. 2025; 103(2):110-25h. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 9
-
World Health Organization. Addressing Health Determinants in a Digital Age: Project Report. World Health Organization; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 10
-
Kickbusch, I, Piselli, D, Agrawal, A, Balicer, R, Banner, O, Adelhardt, M, et al. The Lancet and Financial Times Commission on Governing Health Futures 2030: Growing up in a Digital World. The Lancet. 2021; 398(10312):1727-76. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 11
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Déterminants de la santé : Parlons-en. Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2024.
- Notes de bas de page 12
-
de Lacy-Vawdon, C, Livingstone, C. Defining the Commercial Determinants of Health: A Systematic Review. BMC Public Health. 2020; 20(1):1022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 13
-
World Health Organization. Commercial Determinants of Noncommunicable Diseases in the WHO European Region. World Health Organization; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 14
-
Sanmartin, C, Schellenberg, G, Kaddatz, J, Mader, J, Gellatly, G, Clarke, S, et al. Améliorer les mesures du bien-être (qualité de vie) au Canada. Statistique Canada; 2021.
- Notes de bas de page 15
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Comment va la vie? Mesurer le bien-être. Éditions OCDE; 2011.
- Notes de bas de page 16
-
Zeidler, L, Cairns, M, Laurence, R, Wallace, J, Paylor, H. The Shared Ingredients for a Wellbeing Economy. Centre for Thriving Places; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 17
-
Mackean, T, Shakespeare, M, Fisher, M. Indigenous and Non-Indigenous Theories of Wellbeing and Their Suitability for Wellbeing Policy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(18). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 18
-
Podlasly, M, von der Porten, S, Kelly, D, Lindley-Peart, M. Centering First Nations Concepts of Wellbeing: Toward a GDP-Alternative Index in British Columbia. British Columbia Assembly of First Nations; 2020. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 19
-
Carlisle, S, Henderson, G, Hanlon, PW. 'Wellbeing': A Collateral Casualty of Modernity? Social Science & Medicine. 2009; 69(10):1556-60. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 20
-
First Nations Health Authority. First Nations Perspective on Health and Wellness. First Nations Health Authority. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 21
-
Santé Canada, Assemblée des Premières Nations. Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations - Rapport sommaire. Ottawa, Ont. : Santé Canada; 2015.
- Notes de bas de page 22
-
Tsuji, SRJ, Zuk, AM, Solomon, A, Edwards-Wheesk, R, Ahmed, F, Tsuji, LJS. What Is Wellbeing, and What Is Important for Wellbeing? Indigenous Voices from across Canada. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(17). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 23
-
Armitage, D, Béné, C, Charles, AT, Johnson, D, Allison, EH. The Interplay of Well-being and Resilience in Applying a Social-Ecological Perspective. Ecology and Society. 2012; 17(4). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 24
-
Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada sur l'état de la santé publique au Canada 2023 : Créer les conditions favorables à la résilience des communautés : Une approche de santé publique en matière d'urgences. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2023.
- Notes de bas de page 25
-
World Health Organization. Health in the Well-Being Economy - Background Paper: Working Together to Achieve Healthy, Fairer, Prosperous Societies Across the WHO European Region. World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 26
-
Jansen, A, Wang, R, Behrens, P, Hoekstra, R. Beyond GDP: A Review and Conceptual Framework for Measuring Sustainable and Inclusive Wellbeing. The Lancet Planetary Health. 2024; 8(9):e695-e705. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 27
-
Corbin, JH, Abdelaziz, FB, Sørensen, K, Kökény, M, Krech, R. Wellbeing as a Policy Framework for Health Promotion and Sustainable Development. Health Promotion International. 2021; 36(Supplement_1):i64-i9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 28
-
Stiglitz, JE, Sen, A. K., Fitoussi, J-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. France: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress; 2009. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 29
-
Adler, A, Seligman, M. Using Wellbeing for Public Policy: Theory, Measurement, and Recommendations. International Journal of Wellbeing. 2016; 6:1-35. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 30
-
Canadian Index of Wellbeing. Wellbeing as the Lens for Decision-Making in Canada. University of Waterloo. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 31
-
Statistique Canada. Carrefour de la qualité de vie. Statistique Canada; 2023.
- Notes de bas de page 32
-
United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations; 2015. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 33
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Mesurer le bien-être et le progrès. OCDE.
- Notes de bas de page 34
-
Poliquin, H. Les approches pangouvernementales de bien-être : une analyse comparative de quatre initiatives de gouvernements. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2022.
- Notes de bas de page 35
-
Ministère des Finances Canada. Mesurer ce qui importe : Vers une stratégie sur la qualité de vie pour le Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Notes de bas de page 36
-
Organisation for Economic Co-operation and Development. How's Life? 2020 Well-being Database: Definitions and Metadata. OECD Publishing; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 37
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Indicateur du Vivre Mieux. OCDE.
- Notes de bas de page 38
-
Statistique Canada. Étude : Suivre l'évolution du bien-être au sein de la population canadienne grâce aux données de séries chronologiques. Le Quotiden; 2024.
- Notes de bas de page 39
-
Statistique Canada. Tableau 13-10-0847-01 La vision de l'avenir selon le genre et la province. Gouvernement du Canada; 2025.
- Notes de bas de page 40
-
Statistique Canada. Tableau 13-10-0845-01 Le sentiment de sens et de but à la vie selon le genre et la province. Gouvernement du Canada; 2025.
- Notes de bas de page 41
-
Statistique Canada. Près de la moitié des Canadiennes et des Canadiens déclarent que la hausse des prix a une grande incidence sur leur capacité d'assumer leurs dépenses quotidiennes. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 42
-
Statistique Canada. L'abordabilité du logement au Canada, 2022. Le Quotidien; 2024.
- Notes de bas de page 43
-
Statistique Canada. Tableau 43-10-0062-01 Confiance envers les institutions canadiennes, selon les groupes désignés comme minorités visibles et certaines caractéristiques sociodémographiques, 2020. Gouvernement du Canada; 2022.
- Notes de bas de page 44
-
Statistique Canada. Tableau 45-10-0073-01 Confiance à l'égard des institutions, selon le genre et la province. Gouvernement du Canada; 2025.
- Notes de bas de page 45
-
Statistique Canada. La confiance à l'égard des institutions et des médias, 2023. Le Quotidien; 2024.
- Notes de bas de page 46
-
Statistique Canada. La moitié des personnes racisées ont vécu de la discrimination ou ont été traitées de manière injuste au cours des cinq dernières années. Le Quotidien; 2024.
- Notes de bas de page 47
-
Statistique Canada. Décès, 2023. Le Quotidien; 2024.
- Notes de bas de page 48
-
Statistique Canada. Résultats en matière de santé. La santé de la population canadienne: Statistique Canada; 2024.
- Notes de bas de page 49
-
Statistique Canada. Accès aux soins de santé. Dans : La santé de la population canadienne. Statistique Canada; 2025.
- Notes de bas de page 50
-
Environnement et Changement climatique Canada. Exposition de la population aux polluants atmosphériques extérieurs. Gouvernement of Canada; 2025.
- Notes de bas de page 51
-
Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2022 : Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2022.
- Notes de bas de page 52
-
Statistique Canada. Avoir quelqu'un sur qui compter selon le genre et la province. Statistique Canada; 2025.
- Notes de bas de page 53
-
Statistique Canada. Avoir quelqu'un sur qui compter, janvier à mars 2022. Le Quotidien; 2022.
- Notes de bas de page 54
-
Statistique Canada. Près de la moitié des Canadiens déclarent avoir un fort sentiment d'appartenance à leur collectivité locale. Le Quotidien; 2022.
- Notes de bas de page 55
-
Statistique Canada. Le sentiment d'appartenance à une collectivité locale selon le genre et la province. Statistique Canada; 2025.
- Notes de bas de page 56
-
Agence de la santé publique du Canada. Tableau de bord des indicateurs de santé publique au Canada. Gouvernement du Canada.
- Notes de bas de page 57
-
Statistique Canada. Tableau 13-10-0096-03 Santé mentale perçue, selon le groupe d'âge. Gouvernement du Canada; 2023.
- Notes de bas de page 58
-
Statistique Canada. L'évolution du bien-être mental et financier des Canadiens et Canadiennes, 2021 à 2024. Statistique Canada; 2024.
- Notes de bas de page 59
-
Statistique Canada. Les jeunes Canadiens ont un bien-être perçu plus faible : renseignements tirés de l'Enquête sociale canadienne. Le Quotidien; 2023.
- Notes de bas de page 60
-
Durand, M. The OECD Better Life Initiative: How's Life? and the Measurement of Well-Being. Review of Income and Wealth. 2015; 61(1):4-17. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 61
-
WHO Regional Office for Europe. Deep Dives on the Well-Being Economy Showcasing the Experiences of Finland, Iceland, Scotland and Wales: Summary of Key Findings. World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 62
-
Llena-Nozal, A, Martin, N, Murtin, F. The Economy of Well-Being: Creating Opportunities for People's Well-Being and Economic Growth. Organisation for Economic Co-operation and Development; 2019. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 63
-
OCDE. Canada. L'Indicateur du Vivre Mieux de l'OCDE; Disponible : https://www.oecd.org/fr/data/tools/oecd-better-life-index.html.
- Notes de bas de page 64
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Centre sur le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances (WISE). OCDE.
- Notes de bas de page 65
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Plateforme d'échange de connaissances sur les indicateurs et les pratiques en matière de bien-être (KEP). OCDE; Disponible : https://www.oecd.org/en/about/programmes/kep.html.
- Notes de bas de page 66
-
Heimburg, DV, Prilleltensky, I, Ness, O, Ytterhus, B. From Public Health to Public Good: Toward Universal Wellbeing. Scandinavian Journal of Public Health. 2022; 50(7):1062-70. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 67
-
Ben Abdelaziza, F, Williams, C, Anwara, YJ, Linc, V, Krech, R. Creating 'Wellbeing Societies': Moving from Rhetoric to Action. Public Health Research & Practice. 2023; 33(2). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 68
-
Morrison, V, Lucyk, K. Rebâtir en mieux : des budgets bien-être pour une relance post-COVID-19? : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2021.
- Notes de bas de page 69
-
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Budgétisation bien être : une perspective critique en santé publique. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2022.
- Notes de bas de page 70
-
City of Vancouver. Community Wellbeing Strategy. City of Vancouver; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 71
-
City of Edmonton. Recover: Edmonton's Urban Wellness Plan. City of Edmonton; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 72
-
Kitt, C, Nieuwenhuis, R, Saliss, H, Schulman, S. So Loss, What Have We Learned About Making Sacred Space for You? Reflecting on New Roles and Rituals for Grief and Loss. InWithForward, REACH Edmonton, RECOVER Edmonton; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 73
-
City of Edmonton. Community Safety and Well Being Strategy. City of Edmonton; Disponible : https://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/community-safety-well-being-strategy. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 74
-
Chassagne, N. Rethinking Sustainability: Recalibrating the Global SDGs to Align With Local Principles for Buen Vivir. Community Development Journal. 2022; 58(3):383-401. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 75
-
Fletcher, C, Riva, M, Lyonnais, M-C, Saunders, I, Baron, A, Lynch, M, Baron, M. Definition of an Inuit Cultural Model and Social Determinants of Health for Nunavik - Community Component. Nunavik Regional Board of Health and Social Services & Institut national de santé publique du Québec; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 76
-
Atkinson, D, Landy, R, St. Denys, R, Ogilvie, K, Lund, C, Worthington, C, et al. The Red River Cart Model: A Métis Conceptualization of Health and Well-Being in the Context of HIV and Other STBBI. Canadian Journal of Public Health. 2023; 114(5):856-66. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 77
-
Thunderbird Partnership Foundation. Guide de référence du cadre de mieux-être autochtone. Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances; 2020.
- Notes de bas de page 78
-
Greenwood, M. Web of Being: Social Determinants and Indigenous People's Health. National Collaborating Centre for Aboriginal Health; 2009. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 79
-
MacDougall, B. La terre, la famille et l'identité : Contextualiser la santé et le bien-être des Métis. Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2017.
- Notes de bas de page 80
-
Bryant, J, Bolt, R, Botfield, JR, Martin, K, Doyle, M, Murphy, D, et al. Beyond Deficit: 'Strengths-Based Approaches' in Indigenous Health Research. Sociology of Health & Illness. 2021; 43(6):1405-21. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 81
-
Toombs, E, Kowatch, K, Mushquash, C. Resilience in Canadian Indigenous Youth: A Scoping Review. International Journal of Child and Adolescent Resilience. 2016; 4:4-32. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 82
-
Gall, A, Anderson, K, Howard, K, Diaz, A, King, A, Willing, E, et al. Wellbeing of Indigenous Peoples in Canada, Aotearoa (New Zealand) and the United States: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(11):5832. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 83
-
Bear, LL. Jagged Worldviews Colliding. in M. Battiste (Ed.). Reclaiming Indigenous Voice and Vision. 2000:77-85. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 84
-
Wilson, S. Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods. Fernwood Publishing; 2008. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 85
-
Kennedy, A, Sehgal, A, Szabo, J, McGowan, K, Lindstrom, G, Roach, P, et al. Indigenous Strengths-Based Approaches to Healthcare and Health Professions Education - Recognising the Value of Elders' Teachings. Health Education Journal. 2022; 81(4):423-38. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 86
-
Trott, N, Mulrennan, ME. "Part of Who We Are…": A Review of the Literature Addressing the Sociocultural Role of Traditional Foods in Food Security for Indigenous People in Northern Canada. Societies. 2024; 14(3). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 87
-
Tsuji, LJS, Tsuji, SRJ, Zuk, AM, Davey, R, Liberda, EN. Harvest Programs in First Nations of Subarctic Canada: The Benefits Go Beyond Addressing Food Security and Environmental Sustainability Issues. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(21). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 88
-
Josewski, V, de Leeuw, S, Greenwood, M. Grounding Wellness: Coloniality, Placeism, Land, and a Critique of "Social" Determinants of Indigenous Mental Health in the Canadian Context. Int J Environ Res Public Health. 2023; 20(5). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 89
-
Harding, L, DeCaire, R, Ellis, U, Delaurier-Lyle, K, Schillo, J, Turin, M. Language Improves Health and Wellbeing in Indigenous Communities: A Scoping Review. Language and Health. 2025; 3(1):100047. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 90
-
Patrimoine canadien. Loi sur les langues autochtones. Gouvernement du Canada; 2021.
- Notes de bas de page 91
-
Statistique Canada. Les langues autochtones au Canada. Gouvernement du Canada; 2023.
- Notes de bas de page 92
-
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Volume 1b. Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; 2019.
- Notes de bas de page 93
-
Hopkins, C, Thunderbird Partnership Foundation. Comment utiliser le Cadre de continuum de mieux-être des Premières Nations. Présentation de Carol Hopkins à la Issues of Substance Conference, Calgary, Alberta, novembre 2017; Disponible avec sous-titrage en français : https://thunderbirdpf.org/?resources=how-to-use-the-first-nations-mental-wellness-continuum-framework.
- Notes de bas de page 94
-
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Tagalik S. Inuit Qaujimajatuqangit : le rôle du savoir autochtone pour favoriser le bien-être des communautés inuites du Nunavut. 2010.
- Notes de bas de page 95
-
Santé Canada, Assemblée des Premières Nations. Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations. Ottawa, Ont. : Santé Canada; 2015.
- Notes de bas de page 96
-
Thunderbird Partnership Foundation. Podcast: Mino Bimaadiziwin. Thunderbird Partnership Foundation; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 97
-
Hayward, A. Languages of the Land: Aimée Craft on Mino-Bimaadiziwin, the Good Life. Canadian Geographic; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 98
-
Assembly of First Nations. Seven Generations Continuum of Care. Assembly of First Nations; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 99
-
Gmitroski, KL, Hastings, KG, Legault, G, Barbic, S. Métis Health in Canada: A Scoping Review of Métis-Specific Health Literature. CMAJ Open. 2023; 11(5):E884-e93. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 100
-
Redvers, N, Reid, P, Carroll, D, Kain, MC, Kobei, DM, Menzel, K, et al. Indigenous Determinants of Health: A Unified Call for Progress. The Lancet. 2023; 402(10395):7-9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 101
-
Okpalauwaekwe, U, Ballantyne, C, Tunison, S, Ramsden, VR. Enhancing Health and Wellness by, for and with Indigenous Youth in Canada: A Scoping Review. BMC Public Health. 2022; 22(1):1630. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 102
-
Snowshoe, A, Crooks, CV, Tremblay, PF, Hinson, RE. Cultural Connectedness and Its Relation to Mental Wellness for First Nations Youth. The Journal of Primary Prevention. 2017; 38(1):67-86. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 103
-
Tanner, B, Plain, S, George, T, George, J, Mushquash, CJ, Bernards, S, et al. Understanding Social Determinants of First Nations Health Using a Four-Domain Model of Health and Wellness Based on the Medicine Wheel: Findings from a Community Survey in One First Nation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(5). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 104
-
Gray, AP, Cote, W. Cultural Connectedness Protects Mental Health Against the Effect of Historical Trauma Among Anishinabe Young Adults. Public Health. 2019; 176:77-81. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 105
-
Poliakova, N, Riva, M, Fletcher, C, Desrochers-Couture, M, Courtemanche, Y, Moisan, C, et al. Sociocultural Factors in Relation to Mental Health within the Inuit Population of Nunavik. Canadian Journal of Public Health. 2024; 115(1):83-95. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 106
-
Crooks, C, Burleigh, D, Sisco, A. Promoting First Nations, Metis, and Inuit Youth Wellbeing through Culturally-Relevant Programming: The Role of Cultural Connectedness and Identity. International Journal of Child and Adolescent Resilience. 2015; 3(1):101-16. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 107
-
Harding, L, DeCaire, R, Delaurier-Lyle, K, Ellis, U, Schillo, J, Turin, M. Linguistic Vitality Improves Health and Wellbeing in Indigenous Communities: A Scoping Review. medRxiv. 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 108
-
McGregor, D. Chapter 1: Mino-Mnaamodzawin - Achieving Indigenous Environmental Justice in Canada. In: Dhillon J, editor. Indigenous Resurgence: Decolonialization and Movements for Environmental Justice. New York: Berghahn Books; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 109
-
Karim, N. Indigenous Sovereignty in Canada. The Indigenous Foundation. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 110
-
Indigenous Environmental Network. What is: Indigenous Sovereignty and Tribal Sovereignty. Indigenous Environmental Network. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 111
-
Ministère de la Justice du Canada. Document d'information : Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Gouvernement of Canada; 2021.
- Notes de bas de page 112
-
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Réconciliation. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 113
-
Rowe, G, Straka, S, Hart, M, Callahan, A, Robinson, D, Robson, G. Prioritizing Indigenous Elders' Knowledge for Intergenerational Well-being. Canadian Journal on Aging. 2020; 39(2):156-68. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 114
-
Fisher, M. A Theory of Public Wellbeing. BMC Public Health. 2019; 19(1):1283. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 115
-
World Health Organization. Health Inequality Monitoring: Harnessing Data to Advance Health Equity. World Health Organization; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 116
-
Réseau pancanadien de santé publique. Les principales inégalités en santé au Canada : un portrait national. Réseau pancanadien de santé publique; 2018.
- Notes de bas de page 117
-
British Columbia's Office of the Human Rights Commissioner. Disaggregated Demographic Data Collection in British Columbia: The Grandmother Perspective. British Columbia's Office of the Human Rights Commissioner; 2020. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 118
-
First Nations Information Governance Centre. Strengths-Based Approaches to Indigenous Research and the Development of Well-Being Indicators. Ottawa, ON: First Nations Information Governance Centre; 2020. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 119
-
Agence de la santé publique du Canada. Vision 2030 : Utiliser les données pour de meilleures interventions en santé publique. Gouvernement du Canada; 2025.
- Notes de bas de page 120
-
Orpana, H, Vachon, J, Dykxhoorn, J, McRae, L, Jayaraman, G. Surveillance de la santé mentale positive et de ses facteurs déterminants au Canada : élaboration d'un cadre d'indicateurs de surveillance de la santé mentale positive. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2016; 36(1):1-10.
- Notes de bas de page 121
-
Surveillance de la santé mentale positive. Cadre d'indicateurs de surveillance de la santé mentale positive, Canada, Édition 2024. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 122
-
Commission de la santé mentale du Canada. Changer les orientations, changer des vies : La Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Calgary, Alb. : Commission de la santé mentale du Canada; 2012.
- Notes de bas de page 123
-
Agence de la santé publique du Canada. Infographie: Santé mentale positive. Agence de la santé publique du Canada.
- Notes de bas de page 124
-
O'Keefe, VM, Maudrie, TL, Cole, AB, Ullrich, JS, Fish, J, Hill, KX, et al. Conceptualizing Indigenous Strengths-Based Health and Wellness Research Using Group Concept Mapping. Archives of Public Health. 2023; 81(1):71. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 125
-
Fiedeldey-Van Dijk, C, Rowan, M, Dell, C, Mushquash, C, Hopkins, C, Fornssler, B, et al. Honoring Indigenous Culture-as-Intervention: Development and Validity of the Native Wellness Assessment™. Journal of Ethnicity in Substance Abuse. 2017; 16(2):181-218. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 126
-
Thunderbird Partnership Foundation. Évaluation du mieux-être des Autochtones (ÉMA)™. Thunderbird Partnership Foundation; 2024.
- Notes de bas de page 127
-
Organisation de coopération et de développement économiques. Bien-être et au-delà du PIB. OCDE.
- Notes de bas de page 128
-
Hancock, T. Population Health Promotion 2.0: an Eco-Social Approach to Public Healthin the Anthropocene. Canadian Journal of Public Health. 2015; 106(4):e252-e5.
- Notes de bas de page 129
-
Parkes, MW, Poland, B, Allison, S, Cole, DC, Culbert, I, Gislason, MK, et al. Preparing for the Future of Public Health: Ecological Determinants of Health and the Call for an Eco-Social Approach to Public Health Education. Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(1):60-4. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 130
-
Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé. Examen des cadres relatifs aux déterminants de la santé. Ottawa, Ont. : Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé; 2015.
- Notes de bas de page 131
-
Helne, T, Hirvilammi, T. Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development. 2015; 23(3):167-75. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 132
-
Organisation des Nations Unies. Pacte pour l'avenir : le Pacte mondial pour le numérique et la Déclaration sur les générations futures. Organisation des Nations Unies; 2024.
- Notes de bas de page 133
-
Presenza, A, Abbate, T, Micera, R. The Cittaslow Movement: Opportunities and Challenges for the Governance of Tourism Destinations. Tourism Planning & Development. 2015; 12(4):479-88. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 134
-
Cittaslow. About Cittaslow. Cittaslow; Disponible : https://www.cittaslow.org/network. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 135
-
Morin, J. Lac-Mégantic, l'humain au cœur de la reconstruction. Présentation. Journées annuelles de santé publique; 2024. Disponible : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2024/ppt/3-decembre/04_Julie_Morin_Ville_LacM%C3%A9gantic.pdf.
- Notes de bas de page 136
-
Ville de Lac-Mégantic. Planification stratégique 2020-2025. Ville de Lac-Mégantic; 2020.
- Notes de bas de page 137
-
Ville de Lac-Mégantic. Lac-Mégantic certifiée « Ville du bien-vivre ». Ville de Lac-Mégantic; Disponible : https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/fr/la-ville/cittaslow-megantic.
- Notes de bas de page 138
-
Généreux, M. Des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté locale en contexte de rétablissement. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke; 2021.
- Notes de bas de page 139
-
Généreux, M, Petit, G, Lac-Mégantic Community Outreach Team, O'Sullivan, T. Public Health Approach to Supporting Resilience in Lac-Mégantic: The EnRiCH Framework. In: Ziglio E, editor. Health 2020 Priority Area Four: Creating Supportive Environments and Resilient Communities - A Compendium of Inspirational Examples. World Health Organization; 2018. p. 156-62. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 140
-
Lavallee, LF, Poole, JM. Beyond Recovery: Colonization, Health and Healing for Indigenous People in Canada. International Journal of Mental Health and Addiction. 2010; 8(2):271-81. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 141
-
Assembly of First Nations. Developing a Seven Generations Continuum of Care for First Nations by First Nations of Health, Economic and Social Services [Resolution 19/2019]. Assembly of First Nations; 2019. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 142
-
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Prince George, C.B.: Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2021.
- Notes de bas de page 143
-
Healey Akearok, G, Noah, J, Mearns, C. The Eight Ujarait (Rocks) Model: Supporting Inuit Adolescent Mental Health With an Intervention Model Based on Inuit Ways of Knowing. International Journal of Indigenous Health. 2016; 11:92. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 144
-
Makimautiksat. Makimautiksat Youth Wellness and Empowerment Camp. Qaujigiartiit Health Research Centre; 2014. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 145
-
Voukelatou, V, Gabrielli, L, Miliou, I, Cresci, S, Sharma, R, Tesconi, M, Pappalardo, L. Measuring Objective and Subjective Well-Being: Dimensions and Data Sources. International Journal of Data Science and Analytics. 2021; 11(4):279-309. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 146
-
Halleröd, B, Seldén, D. The Multi-dimensional Characteristics of Wellbeing: How Different Aspects of Wellbeing Interact and Do Not Interact with Each Other. Social Indicators Research. 2013; 113(3):807-25. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 147
-
Engage Nova Scotia. Home Page. Engage Nova Scotia; Disponible : https://engagenovascotia.ca/. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 148
-
Engage Nova Scotia. Overview of the NS Quality of Life Initiative. Engage Nova Scotia. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 149
-
Engage Nova Scotia. When We Know Better, We Do Better: How Cape Breton Regional Municipality is moving data into action. Engage Nova Scotia; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 150
-
Betley, EC, Sigouin, A, Pascua, PA, Cheng, SH, MacDonald, KI, Arengo, F, et al. Assessing Human Well-Being Constructs with Environmental and Equity Aspects: A Review of the Landscape. People and Nature. 2021; 5(6):1756-73. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 151
-
World Health Organization. Health for All Policies: The Co-Benefits of Intersectoral Action. European Observatory on Health Systems and Policies; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 152
-
Khayatzadeh-Mahani, A, Labonté, R, Ruckert, A, de Leeuw, E. Using Sustainability as a Collaboration Magnet to Encourage Multi-Sector Collaborations for Health. Global Health Promotion. 2019; 26(1):100-4. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 153
-
Frank, J, Abel, T, Campostrini, S, Cook, S, Lin, VK, McQueen, DV. The Social Determinants of Health: Time to Re-Think? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(16). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 154
-
Baker, P, Friel, S, Kay, A, Baum, F, Strazdins, L, Mackean, T. What Enables and Constrains the Inclusion of the Social Determinants of Health Inequities in Government Policy Agendas? A Narrative Review. International Journal of Health Policy and Management. 2018; 7(2):101-11. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 155
-
World Health Organization. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. World Health Organization; 2010. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 156
-
de Leeuw, E. Health Beyond Borders: The Future of Health Promotion. Scandinavian Journal of Public Health. 0(0):14034948241288272. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 157
-
Howard, R, Gunther, S. Health in All Policies: An EU Literature Review 2006 – 2011 and Interview with Key Stakeholders. Equity Action; 2012. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 158
-
Molnar, A, Renahy, E, O'Campo, P, Carles, M, Freiler, A, Shankardass, K. Using Win-Win Strategies to Implement Health in All Policies: A Cross-Case Analysis. PloS one. 2016; 11:e0147003. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 159
-
Freiler, A, Muntaner, C, Shankardass, K, Mah, CL, Molnar, A, Renahy, E, Campo, P. Glossary for the Implementation of Health in All Policies (HiAP). Journal of Epidemiology and Community Health. 2013; 67(12):1068. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 160
-
Lilly, K, Kean, B, Hallett, J, Robinson, S, Selvey, LA. Factors of the Policy Process Influencing Health in All Policies in Local Government: A Scoping Review. Frontiers in Public Health. 2023; 11. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 161
-
Cairney, P, St Denny, E, Mitchell, H. The Future of Public Health Policymaking after COVID-19: A Qualitative Systematic Review of Lessons from Health in All Policies. Open Research Europe. 2021; 1(23). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 162
-
Amri, M, Chatur, A, O'Campo, P. An Umbrella Review of Intersectoral and Multisectoral Approaches to Health Policy. Social Science & Medicine. 2022; 315:115469. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 163
-
Guglielmin, M, Muntaner, C, O'Campo, P, Shankardass, K. A Scoping Review of the Implementation of Health in All Policies at the Local Level. Health Policy. 2018; 122(3):284-92. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 164
-
Kokkinen, L, Freiler, A, Muntaner, C, Shankardass, K. How and Why Do Win–Win Strategies Work in Engaging Policy-Makers to Implement Health in All Policies? A Multiple-Case Study of Six State- and National-Level Governments. Health Research Policy and Systems. 2019; 17(1):102. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 165
-
Trowbridge, J, Tan, JY, Hussain, S, Osman, AEB, Di Ruggiero, E. Examining Intersectoral Action as an Approach to Implementing Multistakeholder Collaborations to Achieve the Sustainable Development Goals. International Journal of Public Health. 2022; 67:1604351. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 166
-
Nykiforuk, CIJ, Belon, AP, de Leeuw, E, Harris, P, Allen-Scott, L, Atkey, K, et al. An Action-Oriented Public Health Framework to Reduce Financial Strain and Promote Financial Wellbeing in High-Income Countries. International Journal for Equity in Health. 2023; 22(1):66. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 167
-
French, D, Vigne, S. The Causes and Consequences of Household Financial Strain: A Systematic Review. International Review of Financial Analysis. 2019; 62:150-6. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 168
-
Dijkstra-Kersten, SMA, Biesheuvel-Leliefeld, KEM, van der Wouden, JC, Penninx, BWJH, van Marwijk, HWJ. Associations of Financial Strain and Income with Depressive and Anxiety Disorders. Journal of Epidemiology and Community Health. 2015; 69(7):660. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 169
-
Hassan, MF, Mohd Hassan, N, Kassim, E, Said, Y. Financial Wellbeing and Mental Health: A Systematic Review. Studies of Applied Economics. 2021; 39. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 170
-
Netemeyer, RG, Warmath, D, Fernandes, D, Lynch, JG, Jr. How Am I Doing? Perceived Financial Well-Being, Its Potential Antecedents, and Its Relation to Overall Well-Being. Journal of Consumer Research. 2017; 45(1):68-89. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 171
-
University of Alberta. Action-Oriented Public Health Resources on Financial Wellbeing and Financial Strain. University of Alberta; Disponible : https://www.ualberta.ca/en/public-health/research/centres/centre-for-healthy-communities/what-we-do/financial_wellbeing.html. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 172
-
Centre for Healthy Communities (CHC), Centre for Health Equity Training, RaEC. Action-Oriented Public Health Framework on Financial Wellbeing and Financial Strain - Executive Summary. Edmonton: Centre for Healthy Communities; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 173
-
Bain, Paul G, Milfont, Taciano L, Kashima, Y, Bilewicz, M, Doron, G, Garðarsdóttir, Ragna B, et al. Co-benefits of Addressing Climate Change Can Motivate Action around the World. Nature Climate Change. 2016; 6(2):154-7. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 174
-
Zhao, D, Cai, J, Xu, Y, Liu, Y, Yao, M. Carbon Sinks in Urban Public Green Spaces Under Carbon Neutrality: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Urban Forestry & Urban Greening. 2023; 86:128037. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 175
-
Kingsley, M, EcoHealth Ontario. Commentaire – Changements climatiques, santé et avantages connexes des espaces verts. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2019; 39(4).
- Notes de bas de page 176
-
Nguyen, P-Y, Astell-Burt, T, Rahimi-Ardabili, H, Feng, X. Green Space Quality and Health: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(21). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 177
-
Lee, AC, Maheswaran, R. The Health Benefits of Urban Green Spaces: A Review of the Evidence. Journal of Public Health. 2011; 33(2):212-22. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 178
-
World Health Organization. Harnessing the Benefits of Well-Being Policies and Investments for Health. World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 179
-
WHO Regional Office for Europe. Shifting Towards Fiscally Resilient, Healthy Societies: Finding Common Ground Between Public Health and Finance Sectors and Central Banks. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 180
-
Health Accord for Newfoundland & Labrador. Health Accord NL Final Reports. Health Accord for Newfoundland & Labrador; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 181
-
Health Accord NL. Our Province. Our Health. Our Future. A 10-Year Health Transformation: The Report. Health Accord for Newfoundland & Labrador; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 182
-
Bernier, NF. Vers une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques aux paliers fédéral, provincial et territorial? : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2023.
- Notes de bas de page 183
-
Well-Being NL. Home Page. Well-Being NL; Disponible : https://wellbeingnl.ca/. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 184
-
Government of Newfoundland and Labrador. A Public Health Framework for Newfoundland and Labrador: Preventing Disease, Promoting Health and Protecting Current and Future Generations. Government of Newfoundland and Labrador; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 185
-
Well-Being NL. A New Public Health Framework. Well-Being NL; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 186
-
Taylor, Z, Bradford, N. Governing Canadian Cities. In: Moos M, Walker R, Vinodra T, editors. Canadian Cities in Transition. 6th ed. Toronto: Oxford University Press; 2020. p. 33–50. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 187
-
Lévesque, J, Gervais, M-J, Robitaille, É, Couture-Ménard, M-È. L'action municipale pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie : un cadre d'analyse systémique. Institut national de santé publique du Québec; 2024.
- Notes de bas de page 188
-
Cabaj, JL, Fierlbeck, K, Loh, LC, McLaren, L, Watson-Creed, G. The Municipal Role in Public Health. Toronto, ON: Institute on Municipal Finance and Governance, University of Toronto; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 189
-
World Health Organization. Healthy Cities Effective Approach to a Changing World. Geneva: World Health Organization; 2020. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 190
-
Organisation mondiale de la Santé. Pas de prospérité ni de bonne santé dans les villes sans bien-être social, économique, humain et planétaire. Organisation mondiale de la Santé; 2023.
- Notes de bas de page 191
-
City of Vancouver. Healthy City Strategy. City of Vancouver. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 192
-
City of Vancouver. Community Benefit Agreements Policy. City of Vancouver. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 193
-
Heggie, K. Indigenous Wellness Indicators: Including Urban Indigenous Wellness Indicators in the Healthy City Strategy. University of British Columbia; 2018. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 194
-
Kāhui Tautoko Consulting Ltd. City of Vancouver - Healthy City Dashboard Urban Indigenous Indicators. City of Vancouver; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 195
-
Firestone, M, McConkey, S, Beaudoin, E, Bourgeois, C, Smylie, J. Mental Health and Cultural Continuity among an Urban Indigenous Population in Toronto, Canada. Canadian Journal of Public Health. 2024; 115(2):263-72. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 196
-
Association nationale des centres d'amitié. À propos de l'ANCA - Autochtonie urbaine. Association nationale des centres d'amitié; Disponible : https://nafc.ca/about-the-nafc/urban-indigenous?lang=fr.
- Notes de bas de page 197
-
Heller, JC, Givens, ML, Johnson, SP, Kindig, DA. Keeping It Political and Powerful: Defining the Structural Determinants of Health. The Milbank Quarterly. 2024; 102(2):351-66. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 198
-
Dyar, OJ, Haglund, BJA, Melder, C, Skillington, T, Kristenson, M, Sarkadi, A. Rainbows Over the World's Public Health: Determinants of Health Models in the Past, Present, and Future. Scandinavian Journal of Public Health. 2022; 50(7):1047-58. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 199
-
Paradies, Y, Ben, J, Denson, N, Elias, A, Priest, N, Pieterse, A, et al. Racism as a Determinant of Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2015; 10(9):e0138511. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 200
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Le racisme et l'équité en santé : Parlons-en. Antigonish, N.-É. : Université St. Francis Xavier; 2018.
- Notes de bas de page 201
-
Hankivsky, O, Christoffersen, A. Intersectionality and the Determinants of Health: A Canadian Perspective. Critical Public Health. 2008; 18(3):271-83. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 202
-
Loppie, S, Reading, C, de Leeuw, S. L'effet du racisme sur les autochtones et ses conséquences. Prince George, C.B. : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2014.
- Notes de bas de page 203
-
Phelan, JC, Link, BG. Is Racism a Fundamental Cause of Inequalities in Health? Annual Review of Sociology. 2015; (Volume 41, 2015):311-30. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 204
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Le racisme et l'équité en santé : Parlons-en. Antigonish, N.-É. : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2018.
- Notes de bas de page 205
-
Mosher, J, Hewitt, J. Reimagining Child Welfare Systems in Canada. Journal of Law and Social Policy. 2018; 28(1):1-9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 206
-
Hamed, S, Bradby, H, Ahlberg, BM, Thapar-Björkert, S. Racism in Healthcare: A Scoping Review. BMC Public Health. 2022; 22(1):988. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 207
-
Block, S, Galabuzi, G-E, Tranjan, R. Canada's Colour Coded Income Inequality. Canadian Centre for Policy Alternatives; 2019. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 208
-
Owusu-Bempah, A, Wortley, S. Chapter 10: Race, Crime and Criminal Justice in Canada. In: Bucerius SM, Tionry M, editors. The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime and Immigration. New York: Oxford University Press; 2014. p. 281-320. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 209
-
Sergeant, A, Saha, S, Lalwani, A, Sergeant, A, McNair, A, Larrazabal, E, et al. Diversité dans la haute hiérarchie des organisations de santé au Canada : étude transversale sur la perception de la race et du gendre. Journal de l'Association médicale canadienne. 2022; 194(10):E371.
- Notes de bas de page 210
-
Agence de la santé publique du Canada. Déterminants sociaux et iniquités en santé des Canadiens Noirs : un aperçu. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2020.
- Notes de bas de page 211
-
Patrimoine canadien. Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 212
-
Legault, G. From (Re)Ordering to Reconciliation: Early Settler Colonial Divide and Conquer Policies in Canada. Journal of Indigenous Social Development. 2022; 11(2). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 213
-
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Présentation des excuses pour la réinstallation d'Inuit dans l'Extrême Arctique. Gouvernement du Canada; 2010.
- Notes de bas de page 214
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Commission de vérité et réconciliation du Canada; 2015.
- Notes de bas de page 215
-
Loi sur les indiens. Lois révisées du Canada (1985, ch. I-5); Disponible : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/section-81.html.
- Notes de bas de page 216
-
Reading, CL, Wien, F. Inégalités en matière de santé et déterminants sociaux de la santé des peuples autochtones. Prince George, C.-B. : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2013.
- Notes de bas de page 217
-
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Volume 1a. Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; 2019.
- Notes de bas de page 218
-
Matheson, K, Seymour, A, Landry, J, Ventura, K, Arsenault, E, Anisman, H. Canada's Colonial Genocide of Indigenous Peoples: A Review of the Psychosocial and Neurobiological Processes Linking Trauma and Intergenerational Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(11):6455. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 219
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Commission de vérité et réconciliation du Canada : appels à l'action. Commission de vérité et réconciliation du Canada; 2015.
- Notes de bas de page 220
-
Greenwood, M, Lindsay, N, King, J, Loewen, D. Ethical Spaces and Places: Indigenous Cultural Safety in British Columbia Health Care. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples. 2017; 13(3):179-89. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 221
-
Fallon, B, Lefebvre, R, Trocmé, N, Richard, K, Hélie, S, Montgomery, HM, et al. Denouncing the Continued Overrepresentation of First Nations Children in Canadian Child Welfare: Findings from the First Nations/Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect-2019. Ontario: Assembly of First Nations; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 222
-
Christensen, J. Indigenous Housing and Health in the Canadian North: Revisiting Cultural Safety. Health & Place. 2016; 40:83-90. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 223
-
Castro Lopes, S, Holly, L, Kickbusch, I. Mapping Policies and Regulations for Safe and Healthy Digital Environments for Children and Adolescents. Global Policy; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 224
-
Jahnel, T, Dassow, H-H, Gerhardus, A, Schüz, B. The Digital Rainbow: Digital Determinants of Health Inequities. Digital Health. 2022; 8:20552076221129093. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 225
-
Tefera, Y, Williams, C, Stankov, I, Kickbusch, I. Digital Determinants of Health: Futureproofing the Health Promotion Community to Navigate Societal Digital Transformation. Health Promotion Journal of Australia. 2025; 36(1):e914. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 226
-
Chidambaram, S, Jain, B, Jain, U, Mwavu, R, Baru, R, Thomas, B, et al. An Introduction to Digital Determinants of Health. PLOS Digital Health. 2024; 3(1):e0000346. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 227
-
Holly, L, Demaio, S, Kickbusch, I. Public Health Interventions to Address Digital Determinants of Children's Health and Wellbeing. Lancet Public Health. 2024; 9(9):e700-e4. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 228
-
World Health Organization. New WHO and London School of Economics Study Identifies Key Digital Factors Affecting Health. World Health Organization; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 229
-
Kerr, S, Kingsbury, M. L'utilisation des médias numériques en ligne et la santé mentale des adolescents. Statistique Canada; 2023.
- Notes de bas de page 230
-
Benvenuti, M, Wright, M, Naslund, J, Miers, AC. How Technology Use is Changing Adolescents' Behaviors and their Social, Physical, and Cognitive Development. Current Psychology. 2023; 42(19):16466-9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 231
-
Colder Carras, M, Aljuboori, D, Shi, J, Date, M, Karkoub, F, García Ortiz, K, et al. Prevention and Health Promotion Interventions for Young People in the Context of Digital Well-Being: Rapid Systematic Review. Journal of Medical Internet Research. 2024; 26. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 232
-
Dienlin, T, and Johannes, N. The Impact of Digital Technology Use on Adolescent Well-Being. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2020; 22(2):135-42. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 233
-
Chen, T, Ou, J, Li, G, Luo, H. Promoting Mental Health in Children and Adolescents Through Digital Technology: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. 2024; Volume 15 - 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 234
-
Lee, J, Zarnic, Z. The Impact of Digital Technologies on Well-Being: Main Insights from the Literature. OECD Papers on Well-being and Inequalities. 2024; (No. 29). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 235
-
United Nations High-Level Panel on Digital Cooperation. The Age of Digital Interdependence: Report of the UN Secretary-General's High-Level Panel on Digital Cooperation. United Nations; 2019. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 236
-
Peterson, L. The Measurement of Non-economic Inequality in Well-Being Indices. Social Indicators Research. 2014; 119(2):581-98. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 237
-
Direction générale de la politique stratégique. Rapport ce que nous avons entendu : Renforcer l'intégration de l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre Plus dans la surveillance. [Interne]. Agence de la santé publique du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 238
-
Statistique Canada. Le système de statistiques nationales sur la qualité de vie : orientations futures. Statistique Canada; 2022.
- Notes de bas de page 239
-
Pearce, LA, Borschmann, R, Young, JT, Kinner, SA. Advancing Cross-Sectoral Data Linkage to Understand and Address the Health Impacts of Social Exclusion: Challenges and Potential Solutions. International Journal of Population Data Science. 2023; 8(1):2116. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 240
-
Lawson, J. eHealth Data Standards and Data Stewardship for Social Determinants of Health in Support of Ontario Learning Health Systems: A State-of-the-Art Review of the Literature. McMaster University; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 241
-
de Bienassis, K, Fujisawa, R, Hashiguchi, TCO, Klazinga, N, Oderkirk, J. Health Data and Governance Developments in Relation to COVID-19: How OECD Countries are Adjusting Health Data Systems for the New Normal. OECD Publishing; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 242
-
Buckeridge, D. Une vision éclairée par des données probantes concernant l'établissement d'un système de données en santé publique au Canada. Centres de collaboration nationale en santé publique; 2022.
- Notes de bas de page 243
-
Naumova, EN. Public Health Inequalities, Structural Missingness, and Digital Revolution: Time to Question Assumptions. Journal of Public Health Policy. 2021; 42(4):531-5. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 244
-
Shaghaghi, A, Bhopal, RS, Sheikh, A. Approaches to Recruiting 'Hard-To-Reach' Populations into Re-search: A Review of the Literature. Health Promotion Perspectives. 2011; 1(2):86-94. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 245
-
Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2019 : Lutte contre la stigmatisation : vers un système de santé plus inclusif. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2019.
- Notes de bas de page 246
-
Kelly-Irving, M, Ball, WP, Bambra, C, Delpierre, C, Dundas, R, Lynch, J, et al. Falling Down the Rabbit Hole? Methodological, Conceptual and Policy Issues in Current Health Inequalities Research. Critical Public Health. 2023; 33(1):37-47. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 247
-
Hulvej Rod, M, Hulvej Rod, N, Russo, F, Klinker, CD, Reis, R, Stronks, K. Promoting the Health of Vulnerable Populations: Three Steps Towards a Systems-Based Re-Orientation of Public Health Intervention Research. Health & Place. 2023; 80:102984. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 248
-
Thimm-Kaiser, M, Benzekri, A, Guilamo-Ramos, V. Conceptualizing the Mechanisms of Social Determinants of Health: A Heuristic Framework to Inform Future Directions for Mitigation. Milbank Q. 2023; 101(2):486-526. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 249
-
Adsul, P, Shelton, RC, Oh, A, Moise, N, Iwelunmor, J, Griffith, DM. Challenges and Opportunities for Paving the Road to Global Health Equity Through Implementation Science. Annual Review of Public Health. 2024; 45(Volume 45, 2024):27-45. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 250
-
Longworth, GR, Goh, K, Agnello, DM, Messiha, K, Beeckman, M, Zapata-Restrepo, JR, et al. A review of Implementation and Evaluation Frameworks for Public Health Interventions to Inform Co-Creation: A Health CASCADE Study. Health Research Policy and Systems. 2024; 22(1):39. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 251
-
Lobb, R, Colditz, GA. Implementation Science and Its Application to Population Health. Annual Review of Public Health. 2013; 34(Volume 34, 2013):235-51. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 252
-
Isaranuwatchai, W, Bayoumi, AM, Renahy, E, Cheff, R, O'Campo, P. Using Decision Methods to Examine the Potential Impact of Intersectoral Action Programs. BMC Research Notes. 2018; 11(1):506. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 253
-
Asirvatham, R, Nelson, A, Northam, J, Lucyk, K. Methods for Evaluating Intersectoral Action Partnerships to Address the Social Determinants of Health: A Scoping Rreview. Health Promotion and Chronic Disease Prevention Canada. 2024; 44(10):440-9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 254
-
Owino, M, Dryden, O, Este, D, Etowa, J, Husbands, W, Nelson, L, et al. A Manifesto for Transformative Action on HIV Among Black Communities in Canada. Canadian Journal of Public Health. 2024; 115(2):245-9. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 255
-
Black Health Equity Working Group. Engagement, Governance, Access, and Protection (EGAP): A Data Governance Framework for Health Data Collected from Black Communities in Ontario. Alliance for Healthier Communities; 2021. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 256
-
Husbands, W, Massaquoi, N, Owino, M, Este, D. Black Scholarship on HIV and Health: Configuring Public Health for Black Emancipation. Canadian Journal of Public Health. 2025; 116(2):170-3. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 257
-
Muller da Silva, M. A Moral Economy of Care: How Clinical Discourses Perpetuate Indigenous-Specific Discrimination and Racism in Western Canadian Emergency Departments. Medical Anthropology Quarterly. 2024; 38(3):328-41. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 258
-
Lines, L-A, Jardine, CG. Identifying and Applying a Strength-Based Research Approach in Indigenous Health. International Journal of Qualitative Methods. 2025; 24:16094069241310273. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 259
-
Rowe, R, Bull, J, Walker, J. Indigenous Self-Determination and Data Governance in the Canadian Policy Context. In: Indigenous Data Sovereignty and Policy; 2020. p. 81-98. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 260
-
Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Les principes de PCAP® des Premières Nations. Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations; 2021. Disponible : https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/.
- Notes de bas de page 261
-
Métis Centre of the National Aboriginal Health Organization. Principles of Ethical Métis Research. Ottawa, ON: National Aboriginal Health Organization; 2011. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 262
-
Inuit Tapiriit Kanatami. National Inuit Strategy on Research. Inuit Tapiriit Kanatami; 2018. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 263
-
Geddes, B. Measuring Wellness: An Indicator Development Guide for First Nations. First Nations of British Columbia, Ktunaxa Nation Council; 2015. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 264
-
Wien, S, Miller, AL, Kramer, MR. Structural Racism Theory, Measurement, and Methods: A Scoping Review. Front Public Health. 2023; 11:1069476. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 265
-
Redvers, N, Lockhart, F, Zoe, JB, Nashalik, R, McDonald, D, Norwegian, G, et al. Indigenous Elders' Voices on Health-Systems Change Informed by Planetary Health: A Qualitative and Relational Systems Mapping Inquiry. Lancet Planet Health. 2024; 8(12):e1106-e17. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 266
-
Fraser, SL, Gaulin, D, Fraser, WD. Dissecting Systemic Racism: Policies, Practices and Epistemologies Creating Racialized Systems of Care for Indigenous Peoples. International Journal for Equity in Health. 2021; 20(1):164. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 267
-
Davey, F, McGowan, V, Birch, J, Kuhn, I, Lahiri, A, Gkiouleka, A, et al. Levelling Up Health: A Practical, Evidence-Based Framework for Reducing Health Inequalities. Public Health in Practice. 2022; 4:100322. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 268
-
World Health Organization. Working Together for Equity and Healthier Populations: Sustainable Multisectoral Collaboration Based on Health in All Policies Approaches. Geneva: World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 269
-
Déclaration d'Alma-Ata. Organisation mondiale de la Santé; 2019. Disponible : https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-EURO-1978-3938-43697-61471.
- Notes de bas de page 270
-
Institute of Health Equity. Marmot Places. Institute of Health Equity; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 271
-
Public Health Scotland. Bold New Collaboration to Tackle Health Inequalities Launches in Three Local Areas in Scotland. Public Health Scotland; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 272
-
Kerr, D, Barnes, E. Ending Heath Inequalities: A New Network of 'Marmot Cities'. Our Scottish Future; 2022. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 273
-
Alice Munro. Coventry - A Marmot City: An Evaluation of a City-Wide Approach to Reducing Health Inequalities. Institute of Health Equity; 2020. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 274
-
Marmot Monitoring Tool. Coventry City Council; Disponible : https://www.coventry.gov.uk/marmot-monitoring-tool. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 275
-
Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé : Une conférence internationale pour la promotion de la santé. Ottawa, Ont. : Governement du Canada; 1986.
- Notes de bas de page 276
-
Agence de la santé publique du Canada. Nouvelle perspective de la santé des Canadiens. Gouvernement du Canada; 2001.
- Notes de bas de page 277
-
Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2021 : Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada. Ottawa, Ont. : Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Notes de bas de page 278
-
Puska, P, Ståhl, T. Health in All Policies—The Finnish Initiative: Background, Principles, and Current Issues. Annual Review of Public Health. 2010; 31(Volume 31, 2010):315-28. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 279
-
Villegas-Gomez, TM, Sundewall, J. "Health in All Policies": Effect on Health Outcomes and Collaboration among Welfare Actors. European Journal of Public Health. 2024; 34(Supplement_3). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 280
-
World Health Organization. Health in All Policies: Helsinki Statement - Framework for Country Action. World Health Organization; 2014. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 281
-
Brown, AF, Ma, GX, Miranda, J, Eng, E, Castille, D, Brockie, T, et al. Structural Interventions to Reduce and Eliminate Health Disparities. American Journal of Public Health. 2019; 109(S1):S72-S8. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 282
-
Kapiriri, L, Essue, BM. Lessons Learned from a Global Analysis of Priority Setting Practices in Pandemic Response Planning. Health Policy. 2024; 144:105075. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 283
-
Dedewanou, FA, Allin, S, Guyon, A, Pawa, J, Ammi, M. Prioritization of Public Health Financing, Organization, and Workforce Transformation: A Delphi Study in Canada. BMC Public Health. 2023; 23(1):544. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 284
-
Kapiriri, L, Essue, B, Bwire, G, Nouvet, E, Kiwanuka, S, Sengooba, F, Reeleder, D. A Framework to Support the Integration of Priority Setting in the Preparedness, Alert, Control and Evaluation Stages of a Disease Pandemic. Global Public Health. 2022; 17(8):1479-91. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 285
-
Mikkonen, J. Intersectoral Action for Health: Challenges, Opportunities, and Future Directions in the WHO European Region. Faculty of Graduate Studies, Graduate Program in Health. Toronto: York University; 2018. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 286
-
de Leeuw, E. Intersectoral Action, Policy and Governance in European Healthy Cities. Public Health Panorama. 2015; 1(2):175-82. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 287
-
Such, E, Smith, K, Woods, HB, Meier, P. Governance of Intersectoral Collaborations for Population Health and to Reduce Health Inequalities in High-Income Countries: A Complexity-Informed Systematic Review. International Journal of Health Policy and Management. 2022; 11(12):2780-92. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 288
-
Mondal, S, Van Belle, S, Maioni, A. Learning from Intersectoral Action Beyond Health: A Meta-Narrative Review. Health Policy and Planning. 2021; 36(4):552-71. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 289
-
Poirier, M. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Cadre d'analyse systémique en Outaouais : Présentation : Journées annuelles de santé publique (JASP); 2024. Disponible : https://www.inspq.qc.ca/jasp/municipalites-inclusives-resilientes-et-durables-approche-systemique-pour-guider-laction.
- Notes de bas de page 290
-
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Infographie - Ensemble pour des milieux de vie de qualité. Gouvernement du Québec; 2023. Disponible : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/11/Offre-de-services-aux-municipalites.pdf.
- Notes de bas de page 291
-
Agence de la santé publique du Canada. Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale. Gouvernement du Canada; 2023.
- Notes de bas de page 292
-
Agence de la santé publique du Canada. Aperçu : Fonds d'action intersectorielle. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 293
-
Organisation for Economic Co-operation and Development. How to Make Societies Thrive? Coordinating Approaches to Promote Well-being and Mental Health. OECD Publishing; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 294
-
Agence de la santé publique du Canada. Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) - Action et savoir sur les déterminants de la santé des individus et des communautés au Canada. Gouvernement du Canada; 2020.
- Notes de bas de page 295
-
World Health Organization. Global Mapping Report on Multisectoral Actions to Strengthen the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases and Mental Health Conditions: Experiences from Around the World. Geneva: World Health Organization; 2023. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 296
-
First Nations Public Service Secretariat. First Nations Well Being Fund: Program & Application Guide. First Nations Public Service Secretariat; 2025. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 297
-
Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Cadre de référence. Coalition montréalaise des Tables de quartier; 2024.
- Notes de bas de page 298
-
Coalition montréalaise des Tables de quartier. Rapport d'activités 2022-2023. Coalition montréalaise des Tables de quartier; 2023.
- Notes de bas de page 299
-
Coalition montréalaise des Tables de quartier. Rapport d'activités 2023-2024. Coalition montréalaise des Tables de quartier; 2024.
- Notes de bas de page 300
-
Chaire de recherche du Canada : Approches communautaires et inégalité de santé. Outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale. Chaire de recherche du Canada : Approches communautaires et inégalité de santé.
- Notes de bas de page 301
-
Sanchez-Pimienta, CE, Giroux, D, Masuda, J. Giiwe: An Indigenous-Led Model for Inter-organizational Homelessness Prevention. The International Indigenous Policy Journal. 2024; 15(1). (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 302
-
Assemblée générale des Nations Unies. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones. Assemblée générale des Nations Unies; 2007.
- Notes de bas de page 303
-
Ministère de la Justice du Canada. À propos de la Loi. Gouvernement du Canada; 2025. Disponible : https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/legislation.html.
- Notes de bas de page 304
-
Assemblée des Premières Nations. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Assemblée des Premières Nations; Disponible : https://afn.ca/fr/droits-justice/declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones/.
- Notes de bas de page 305
-
Ministère de la Justice. Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 306
-
Ministère de la Justice du Canada. Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : plan d'action. Gouvernement du Canada; 2023.
- Notes de bas de page 307
-
National Centre for Truth and Reconciliation. ReconciliACTION Plans. National Centre for Truth and Reconciliation; Disponible : https://nctr.ca/education/educational-programs/reconciliaction-plans/. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 308
-
Government of British Columbia. Indigenous Gender Based Analysis Plus (IGBA+) Toolkit. Government of British Columbia. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 309
-
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Appels à la justice. Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; 2019.
- Notes de bas de page 310
-
Assembly of First Nations. National Action Plan to Implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [Resolution 17/2021]. Assembly of First Nations. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 311
-
Government of British Columbia. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act. Government of British Columbia; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 312
-
Ministère de la Justice Canada. Communiqué de presse - Le troisième rapport d'avancement annuel sur la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones souligne les progrès accomplis et relève les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires. Gouvernement du Canada; 2024.
- Notes de bas de page 313
-
Welsh Government. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015: The Essentials - Guidance on our Law to Improve Social, Economic, Environmental and Cultural Well-Being. Welsh Government; 2015. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 314
-
Welsh Government. Statistics: Wellbeing of Wales: 2024. Welsh Government; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 315
-
Green, L, Ashton, K, Azam, S, Dyakova, M, Clemens, T, Bellis, MA. Using Health Impact Assessment (HIA) to Understand the Wider Health and Well-Being Implications of Policy Decisions: The COVID-19 'Staying at Home and Social Distancing Policy' in Wales. BMC Public Health. 2021; 21(1):1456. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 316
-
World Health Organization. Compendium Report on Multisectoral Actions for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases and Mental Health Conditions: Country Case Studies: World Health Organization; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 317
-
University of Waterloo. Canadian Index of Wellbeing: Our Index. University of Waterloo; Disponible : https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/what-we-do/how-it-works/our-index. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 318
-
Canadian Index of Wellbeing. How are Canadians Really Doing? The CIW National Report 2025. Waterloo, ON: Canadian Index of Wellbeing, University of Waterloo; [In Press]. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 319
-
Canadian Index of Wellbeing. Our Wellbeing Survey. University of Waterloo. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 320
-
African Nova Scotian Road to Economic Prosperity. Halifax Partnership; Disponible : https://halifaxpartnership.com/research-strategy/african-nova-scotian-economic-strategy/#:~:text=Launched%20in%202021%2C%20the%20African,outcomes%20for%20African%20Nova%20Scotians. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 321
-
African Nova Scotian Road to Economic Prosperity. African Nova Scotian Prosperity and Well-Being Index 2024. African Nova Scotian Road to Economic Prosperity; 2024. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 322
-
Espace MUNI. Évaluation d'impact sur la santé. Espace MUNI; Disponible : https://espacemuni.org/programmes/communautes-en-sante/evaluation-dimpact-sur-la-sante/.
- Notes de bas de page 323
-
Métis Nation. Métis Vision for Health. Métis Nation. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 324
-
Nisga'a Lisims Government. Strategy. Nisg̱a'a Lisims Government; Disponible : https://www.nisgaanation.ca/government/quality-of-life/strategy/. (en anglais seulement)
- Notes de bas de page 325
-
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Politique sur l'Inuit Nunangat. Gouvernement du Canada; 2022.
- Notes de bas de page 326
-
First Nations Health Authority, Office of the Provincial Health Officer. First Nations Population Health and Wellness Agenda. First Nations Health Authority, Office of the Provincial Health Officer; 2021. (en anglais seulement)