Évaluation du programme sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale de l'Agence de la santé publique du Canada de 2017-2018 à 2021-2022

Téléchargez le format alternative
(Format PDF, 767 Ko, 45 pages)
Organization : Agence de la santé publique du Canada
Publiée : 2023-07-27
Rédigé par le Bureau de l’audit et de l’évaluation
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada
Avril 2023
Table des matières
- Liste des acronymes
- Résumé
- Objet de l’évaluation
- Portée de l’évaluation
- Profil du programme
- Contexte
- Principales constatations : Rôle
- Principales constatations : Efficacité
- Conclusions
- Recommendations
- Réponse et plan d’action de la direction
- Annexe 1 - Méthodes de collecte et d’analyse de données
- Annexe 2 - Dépenses du programme et défis internes
- Annexe 3 - Harmonisation des résultats prévus avec le modèle en quatre volets de prévention
- Annexe 4 - Fonds national de projets stratégiques pour le TSAF : Description et résultats des projets
- Notes de fin
Liste des acronymes
- ASPC
- Agence de la santé publique du Canada
- CPS
- Centre pour la promotion de la santé
- CSRA
- Centre de surveillance et de recherche appliquée
- DGPSPMC
- Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques
- ETCAF
- Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
- FNAPS
- Fonds national d’aide aux projets stratégiques
- PACE
- Programme d’action communautaire pour les enfants
- PAPACUN
- Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques
- PCNP
- Programme canadien de nutrition prénatale
- SAC
- Services aux Autochtones Canada
- TSAF
- Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
Résumé
Contexte
Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) est un terme diagnostique utilisé pour décrire les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool sur le cerveau et l’organisme. Les personnes qui en sont atteintes éprouveront, toute leur vie, des difficultés en ce qui concerne la motricité, les aptitudes sociales et cognitives, la santé physique et la régulation émotionnelleNote de bas de page 1. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est l’un des nombreux intervenants qui participent à la lutte contre le TSAF au Canada. Parmi les autres intervenants clés, il y a les autorités de santé publique locales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, d’autres ministères et de nombreux organismes communautaires.
Le programme sur le TSAF a pour but d’assurer un leadership et une coordination stratégiques à l’échelle fédérale, de prévenir le TSAF et de favoriser un bon état de santé et une bonne situation sociale pour les personnes atteintes du TSAF. Dans le cadre du programme sur le TSAF, l’ASPC assure la gestion du financement sous forme de subventions et de contributions et mène des activités relatives aux politiques et à la surveillance.
Au sein de l’ASPC, le Centre pour la promotion de la santé (CPS) dirige les efforts stratégiques et gère le Fonds national d’aide aux projets stratégiques (FNAPS) sur le TSAF. Ce fonds affecte 1,5 million de dollars par année à des projets nationaux qui appuient la prévention du TSAF, l’éducation et l’échange de connaissances à son sujet, ainsi que le renforcement des capacités, la coordination, la collecte de données et la recherche. Le Centre de surveillance et de recherche appliquée (CSRA) de l’ASPC, en collaboration avec les principaux intervenants, effectue une surveillance et un suivi pour progresser vers l’établissement d’une base de données de surveillance nationale sur le TSAF. Ensemble, ces activités forment le programme sur le TSAF, qui fait l’objet de cette évaluation.
L’évaluation porte sur les activités de 2017-2018 à 2021 2022, et l’on a évalué le rôle de l’ASPC et l’efficacité de ses activités à partir de plusieurs sources de données.
Ce que nous avons constaté
À ce jour, l’ASPC a entrepris des activités de lutte contre le TSAF qui correspondent bien à son rôle fédéral en matière de santé publique. Toutefois, malgré des objectifs ambitieux, le financement consacré au TSAF est limité. D’importantes lacunes subsistent, dont certaines semblent relever du rôle du gouvernement fédéral en matière de santé publique dans les domaines du renforcement de la surveillance, de la planification stratégique nationale, de la mobilisation des intervenants, de la collaboration avec les intervenants, de la consignation des pratiques prometteuses et du soutien à l’élaboration et à la diffusion de lignes directrices.
Tous les projets financés par le FNAPS ont recueilli et communiqué des renseignements pertinents pour accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances, à divers niveaux du modèle de prévention du TSAF en quatre volets, et tous ces projets semblent principalement axés sur la prévention. Le public, les femmes enceintes ou en âge de procréer et leur réseau, ainsi que plusieurs catégories de professionnels, dont les professionnels de la santé, faisaient partie des populations cibles des projets financés par le FNAPS. La plupart des projets ont dû s’adapter à la pandémie de COVID-19 et effectuer une transition vers des activités virtuelles plutôt qu’en personne. Les données sur le rendement que devaient fournir les projets financés couvraient principalement les extrants et la portée; toutefois, certains projets ont pu démontrer que les participants en avaient retiré une prise de conscience et de nouvelles connaissances. Il serait utile de recueillir des données supplémentaires permettant de déterminer les réalisations des divers projets, par exemple sur le plan des connaissances, de l’utilisation et du changement de comportement, comme c’est le cas pour d’autres programmes de subventions et de contributions de l’ASPC.
Certains projets financés ont aussi aidé à améliorer les données de surveillance du TSAF, alors que les activités de surveillance de l’ASPC consistaient à examiner diverses sources de données en vue d’établir une surveillance nationale du TSAF. Toutefois, l’absence de données nationales sur la prévalence du TSAF continue de représenter une lacune, laquelle est exacerbée par la tendance à sous-diagnostiquer et à sous-déclarer les cas de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.
Recommandations
Recommandation 1 : Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.
Les activités exploratoires actuelles sont nécessaires à la mise en place d’un système national de surveillance. La collecte des données utiles à la prise de décisions, en particulier en ce qui concerne les populations en quête d’équité, nécessitera de déterminer les sommes qui doivent être investies dans la surveillance et la collaboration avec les provinces et territoires. De telles mesures iraient également dans le sens de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation concernant la nécessité de cerner et de combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones.
Recommandation 2 : Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.
L’évaluation a révélé que l’ASPC pourrait user de son rôle fédéral en matière de santé publique pour combler certaines lacunes qui concernent le TSAF; toutefois, certaines activités ne font pas partie de l’approche intégrée. En effet, plusieurs équipes de l’ASPC assurent des activités liées au TSAF (au sein du CPS, du CSRA et des bureaux régionaux), mais il n’existe actuellement aucune structure globale pour coordonner tous ces efforts. De plus, le TSAF est une question complexe, qui exige de tenir compte de déterminants sociaux de la santé allant au-delà des programmes classiques de santé publique. Le TSAF est aussi lié à des enjeux comme la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et relève donc d’équipes du domaine de la consommation d’alcool, mais aussi, plus largement, de la consommation de substances. Ces deux enjeux sont en effet traités par d’autres groupes du portefeuille de la Santé. Une meilleure compréhension de la structure des activités actuelles, mais aussi de la façon de coordonner ces activités à l’interne et à l’externe, constitue une étape préliminaire vers plus d’uniformité en vue de faciliter la mise en place d’approches nationales des politiques et de la planification relatives au TSAF. Bien que l’évaluation précédente du TSAF ait recommandé d’améliorer la mobilisation des intervenants, de plus amples travaux seront nécessaires pour améliorer la coordination à cet égard.
Recommandation 3 : Améliorer l’approche de mesure du rendement du programme sur le TSAF en mettant l’accent sur l’incidence du programme.
Une fois que les activités et les rôles seront schématisés et mieux définis, les activités liées au TSAF devraient être clairement organisées suivant un modèle logique qui mettrait en évidence les objectifs du programme sur le TSAF et les façons d’atteindre chacun de ceux-ci. Le modèle de prévention du TSAF en quatre volets pourrait aider à concevoir les efforts par population cible. Il permettrait aussi de mieux cerner les éléments par rapport auxquels le programme sur le TSAF est le mieux placé pour servir chaque population et de clarifier les frontières par rapport aux programmes généraux relatifs à l’enfance. Grâce à un tel cadre, il serait aussi possible de trouver des synergies entre divers projets financés qui sont axés sur les mêmes objectifs et ont une ampleur comparable. Une fois le modèle logique clarifié, il faudrait identifier et recueillir des indicateurs pertinents et réalistes pour surveiller les progrès. Dans le cas du FNAPS, l’ASPC devrait s’assurer que les équipes des projets financés planifient les efforts et s’engagent à en assurer la surveillance dès le début. Bien que l’évaluation précédente du programme sur le TSAF ait déjà recommandé d’améliorer la mesure du rendement, seuls des progrès limités ont depuis été réalisés en matière de collecte de données, et des mesures du rendement plus précises et complètes seraient donc avantageuses pour le programme.
Objet de l’évaluation
Cette évaluation visait à fournir des conseils et de l’information à l’ASPC sur la pertinence et l’efficacité du programme sur le TSAF.
Il s’agit de la troisième évaluation de ce programme :
- L’évaluation précédente, intitulée Évaluation de l’Initiative sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) de 2008-2009 à 2012-2013, visait à évaluer la pertinence et le rendement du FNAPS pour la période de 2008-2009 à 2012-2013. Cette évaluation a permis de constater d’importants progrès sur le plan de la collaboration entre les intervenants et en matière d’élaboration d’outils et de ressources, mais a aussi mis en évidence la nécessité pour le gouvernement fédéral de maintenir son engagement.
- La toute première évaluation, intitulée Évaluation sommative : Initiative sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, visait à évaluer la pertinence, l’incidence et l’effet, la conception et l’exécution ainsi que la rentabilité du FNAPS et des activités relatives aux politiques pour la période d’avril 2004-2005 à avril 2007-2008. Cette évaluation avait également examiné les projets à venir reportés en 2009. Elle avait recommandé que l’on poursuive le FNAPS et les activités relatives aux politiques, dont les résultats étaient conformes aux objectifs fédéraux et provinciaux de l’époque. L’évaluation avait aussi aidé à cerner les principaux domaines que les intervenants souhaitaient voir l’ASPC aborder, y compris la collaboration avec les autres ministères, la coordination et la collaboration pour éviter le dédoublement des efforts et l’adoption d’une approche globale.
Portée de l’évaluation
Cette évaluation porte sur les activités menées de 2017-2018 à 2021-2022. Cette évaluation s’est appuyée sur des données probantes issues de multiples méthodes de collecte de données, y compris des entrevues, l’examen de documents et de dossiers, l’examen de la documentation et l’examen des données financières. L’annexe A du présent document indique la méthode d’évaluation détaillée, ses limites et les stratégies d’atténuation.
Voici les questions qui ont orienté l’évaluation :
- Quel devrait être le rôle de l’ASPC en ce qui concerne le TSAF? L’ASPC investit-elle dans des domaines conformes à son mandat fédéral en matière de santé publique et pour obtenir une incidence optimale? Y a-t-il des besoins qui ne sont pas comblés?
- Le programme atteint-il les résultats attendus en ce qui concerne le FNAPS et les activités relatives aux politiques?
- Dans quelle mesure pourrait-on élargir les projets financés, afin d’accroître leur incidence et de mieux répondre aux besoins de la population canadienne, de façon durable?
- Les équipes chargées de la surveillance et des politiques s’appuient-elles sur une approche intégrée et collaborative pour prendre les décisions liées au TSAF? Existe-t-il des lacunes?
Bien que les bureaux régionaux ne jouent pas un rôle direct dans l’exécution du programme sur le TSAF, l’évaluation a tenu compte du lien entre les activités régionales liées au TSAF et le programme sur le TSAF, mais n’a pas évalué les activités régionales en tant que telles.
Profil du programme
Le programme sur le TSAF de l’ASPC vise à réduire le nombre de nouveau-nés affectés par l’alcool et à s’attaquer aux conditions sous-jacentes de la consommation d’alcool chez les Canadiennes durant leur grossesse. Le programme sur le TSAF a pour but d’assurer un leadership et une coordination stratégiques à l’échelle fédérale, de prévenir le TSAF et d’améliorer l’état de santé et la situation sociale des personnes qui en sont atteintes. En 2016, l’ASPC a élaboré un plan stratégique quinquennal sur le TSAF (2016-2021) afin de déterminer les priorités en vue de renforcer son programme sur le TSAF, plan qui comprend un financement sous forme de subventions et de contributions, des politiques et des données. Celui-ci définit également les objectifs des demandes de subventions et de contributions relatives au FNAPS pour la période.
Le programme comprend les activités de financement et les activités relatives aux politiques dirigées par le CPS, ainsi que les activités de surveillance dirigées par CSRA. Le CPS et le CSRA opèrent tous deux au sein de la Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques (DGPSPMC).
Activités principales du CPS
- Gérer le FNAPS;
- Rassembler les partenaires et les intervenants de la lutte contre le TSAF;
- Superviser le contenu consacré à le TSAF sur le site Web de l’ASPC.
Activités principales du CSRA
- Élaborer des renseignements de surveillance et des données probantes sur le TSAF;
- Explorer la faisabilité d’un système de surveillance du TSAF selon une approche multisource.
L’ASPC affecte aux organismes 1,5 million de dollars par année en subventions et en contributions dans le cadre du FNAPS pour les aider à élaborer des produits de connaissances, des outils et des ressources dans l’objectif de régler les problèmes liés au TSAF et de faire progresser les activités de sensibilisation, de prévention et d’intervention. Depuis 2017-2018, l’ASPC a aidé dix organismes provinciaux/territoriaux et organisations non gouvernementales (ONG) à élaborer et à évaluer des projets novateurs visant à améliorer les résultats sanitaires et sociaux pour les personnes atteintes du TSAF. Le dernier appel de propositions a été lancé en août 2018Note de bas de page 2.
Contexte
Il est certains éléments clés que l’on doit prendre en considération pour bien comprendre les activités de l’ASPC en matière de lutte contre le TSAF. Aux fins d’une telle compréhension, la section ci-dessous fournit un aperçu de la prévalence et des coûts sociétaux du TSAF au Canada, suivi d’un bref historique des programmes du portefeuille de la Santé et des programmes du gouvernement fédéral dans son ensemble. On présente ensuite certaines politiques et priorités gouvernementales plus récentes qui ont une incidence sur le TSAF et ses programmes, avant d’aborder la récente pandémie de COVID-19, dont on reconnaît l’impact sur l’exécution des activités pour la période à l’étude.
Prévalence et coût sociétal du TSAF au Canada
En 2019, approximativement 0,1 % des enfants et des jeunes canadiens de 1 à 17 ans avaient reçu un diagnostic de TSAF. Ce chiffre atteignait 1,2 % chez les Autochtones hors réserveNote de bas de page 3. En 2015-2016, la prévalence du TSAF chez les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves était estimée à 0,5 %Note de bas de page 4.
En 2017, une méta-analyse révélait que, parmi la population générale, environ 10 % et 15 % des femmes enceintes consomment de l’alcool, respectivement au Canada et aux États-Unis. La prévalence est environ trois à quatre fois plus élevée chez les peuples autochtonesNote de bas de page 5. De plus, la consommation globale d’alcool a augmenté pendant la pandémie, ce qui pourrait aussi avoir touché les femmes enceintesNote de bas de page 6. Cette tendance regrettable s’explique par des facteurs contextuels indépendants de la portée du programme. Néanmoins, il pourrait être pertinent de s’attaquer à ce problème croissant dans le cadre des efforts de rétablissement post-COVID 19.
Les coûts économiques du TSAF, y compris les coûts liés à la santé, à l’éducation spécialisée, à l’emploi, aux services sociaux et au système de justice pénale, varient entre 1,3 et 2,3 milliards de dollars par année au CanadaNote de bas de page 7. Les principaux facteurs qui contribuent aux coûts globaux liés au TSAF sont la perte de productivité attribuable à la morbidité et à la mortalité prématurée, qui vont d’environ 532 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars. Cela représente 41 % des coûts totaux liés au TSAF au Canada. Les autres facteurs sont notamment le coût des services correctionnels, à l’exclusion des services de police et des tribunaux, qui s’élèvent à 378,3 millions de dollars (soit 29 % des coûts totaux liés au TSAF), et le coût des soins de santé, qui varie de 128,5 à 226,3 millions de dollars (soit 10 % des coûts totaux)Note de bas de page 8.
Programmes sur le TSAF à l’échelle du gouvernement fédéral
Alors que les activités fédérales liées au TSAF étaient gérées, depuis 1999, par la Direction générale de la promotion et des programmes de la santé de Santé Canada et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI), elles ont été transférées à l’ASPC lors de la création de cet organisme en 2004-2005 et à Services aux Autochtones Canada (SAC) lors de la création de ce ministère en 2017-2018, SAC étant plus précisément responsable des communautés des Premières Nations et des populations inuites. Les activités de l’ASPC qui se rapportent au TSAF sont orientées par un leadership national et s’appuient sur les stratégies antérieures, sur le FNAPS en ce qui concerne les subventions et les contributions, et sur les renseignements issus de la surveillance continue. De plus, les bureaux régionaux de l’ASPC, au sein de la Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales (DGSSOR), assurent un rôle de liaison avec les partenaires et les intervenants locaux de lutte contre l’ETCAF, et offrent trois programmes axés sur les enfants et les jeunes, qui couvrent certains aspects des efforts liés au TSAF : le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) et le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN).
Bien que l’ASPC se concentre principalement sur les activités de prévention du TSAF, d’autres ministères fédéraux, dont le ministère de la Justice et le Service correctionnel du Canada, offrent aussi des services aux personnes atteintes du TSAF. SAC s’occupe à la fois des activités de prévention et des services pour les personnes atteintes du TSAF, tandis que le mandat d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) se rapporte aux personnes handicapées et aux questions d’inclusion, y compris le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Politiques et priorités gouvernementales ayant une incidence sur les activités liées au TSAF
Le TSAF s’inscrit dans le cadre de nombreuses politiques et initiatives du gouvernement du Canada. Dans le contexte de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, et, plus récemment, au cours de l’intervention du gouvernement face à la crise des opioïdes, l’ASPC a adopté une approche de réduction des méfaits à l’égard des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la consommation de substances pour les personnes, leurs familles et les collectivités. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à réduire les méfaits liés à l’alcool en appuyant les Repères canadiens sur l’alcool et la santé, publiés au début de 2023 par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.
Puisque le TSAF est particulièrement répandu chez les populations autochtones, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé des appels à l’action concernant cet enjeu à l’intention des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :
- Appel à l’action 33 : « […] élaborer, en collaboration avec les Autochtones, des programmes de prévention du TSAF [trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale] qui sont adaptés à la culture autochtone ».
- Appel à l’action 34 : « […] entreprendre des réformes du système de justice pénale afin de mieux répondre aux besoins des délinquants atteints du TSAF ».
Enfin, la Loi canadienne sur l’accessibilité et le Règlement canadien sur l’accessibilité (https ://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2021-241/index.html) sont entrés en vigueur respectivement en 2019 et 2021, et s’appliquent implicitement au TSAF. Leur principal objectif est de faire du Canada un pays exempt d’obstacles d’ici 2040. Le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, publié par EDSC en 2022, met particulièrement l’accent sur l’inclusion économique et le soutien financier des personnes handicapées.
Le TSAF dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Enfin, on ne connaît pas encore toutes les répercussions qu’aura eues la pandémie de COVID-19 sur les personnes atteintes du TSAF. En raison de la pandémie, certaines activités menées dans le cadre du programme sur le TSAF de l’ASPC ont dû être modifiées aux fins d’une prestation en ligne, et, dans certains cas, les échéanciers ont aussi dû être modifiés en raison des efforts d’intervention liés à la COVID-19 qui ont mobilisé temporairement le personnel de l’Agence. Quelques sections du présent rapport rendent compte de ces défis.
Principales constatations : Rôle
Afin d’évaluer la pertinence du programme, on a vérifié si le rôle actuel de l’ASPC relativement au TSAF allait dans le sens de son mandat et des priorités fédérales. On a aussi relevé les lacunes du programme sur le TSAF, tout particulièrement celles qui étaient susceptibles de relever du rôle fédéral en matière de santé publique.
Cohérence du rôle actuel de l’ASPC en matière du TSAF par rapport à son mandat et aux priorités fédérales
Les activités actuelles de l’ASPC liées au TSAF correspondent à son rôle fédéral en matière de santé publique : L’ASPC appuie les projets communautaires et les lignes directrices en matière de santé publique, assure la surveillance, appuie et entreprend des initiatives de transfert et d’échange des connaissances et joue un rôle de rassembleur. Les travaux de l’ASPC liés au TSAF correspondent bien aux priorités actuelles du gouvernement du Canada; toutefois, l’intégration des efforts relatifs au TSAF dans l’ensemble de l’ASPC est actuellement lacunaire.
Mandat de l’ASPC ayant trait au TSAF
Bien que la santé publique soit, au Canada, une responsabilité que se partagent le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’ASPC joue un rôle de leader dans la promotion et la protection de la santé des Canadiennes et Canadiens. Conformément au mandat de l’ASPC, ce rôle consiste notamment à renforcer la collaboration intergouvernementale dans le domaine de la santé publique, et à faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publiqueNote de bas de page 9. Les domaines d’action de l’ASPC dans le cadre des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies comprennent l’élaboration de programmes, le renforcement des capacités communautaires, l’éducation du public, la collaboration intersectorielle, ainsi que la synthèse et la mise en commun des informations.
Bien que les activités liées au TSAF soient financées depuis plus de 20 ans, il ne s’agit pas d’une priorité énoncée dans les principaux documents du gouvernement fédéral (p. ex. le discours du Trône, les lettres de mandat du ministre de la Santé ou d’un ministre associé ou les budgets fédéraux), sauf dans le budget de 1999. Par conséquent, le mandat de l’ASPC en ce qui concerne le TSAF est défini par les autorisations de programme et comprend la prévention, l’éducation du public, le renforcement des capacités et la coordination. Plus récemment, le Plan stratégique quinquennal 2016-2021 de l’Initiative sur le TSAF énonçait la mission du programme, qui consiste à assurer un leadership fédéral dans la prévention de nouvelles naissances affectées par l’alcool et à favoriser le bon état de santé et la bonne situation sociale des personnes qui subissent les effets du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Deux objectifs importants du programme ont été ajoutés aux autorisations de programme de 1999 : améliorer l’état de santé et la situation sociale des personnes touchées par le TSAF et améliorer les données sur la prévalence du TSAF et la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréerNote de bas de page 10.
Le financement initial alloué en 1999 comprenait 1,5 million de dollars en subventions et contributions. Depuis, ce budget est demeuré le même, comme pour des programmes tels que le PACE et le PCNP, et n’a pas été corrigé par rapport à l’inflationNote de bas de page 11. Si l’on utilise un calcul semblable à celui utilisé dans l’évaluation du PACE et du PCNP, la somme de 1,5 million de dollars de 1999 devrait être d’environ 2,45 millions de dollars en 2022 pour tenir compte de l’inflation. Les activités de surveillance liées au TSAF n’y ont pas été incluses et sont toujours sans financement.
Cohérence par rapport au rôle de l’ASPC
En ce qui concerne le TSAF, l’ASPC s’est acquittée d’un rôle fédéral en matière de santé publique qui va dans le sens de son vaste mandat dans les domaines de la mobilisation des intervenants, des politiques et de la surveillance, en plus de donner suite aux engagements plus précis énoncés dans les autorisations du programme sur le TSAF dans le cadre d’une gestion continue du FNAPS. Les autorisations de programme de 1999 ont clarifié les rôles des directions générales de Santé Canada au sujet de le TSAF, lesquels demeurent à ce jour. Ainsi, l’ASPC est chargée de lutter contre le TSAF chez les populations autochtones vivant hors réserve, tandis que la DGSPNI, ou SAC, offre aux Autochtones dans les réserves et aux populations inuites des programmes liés au TSAF axés sur la prévention auprès des femmes enceintes ainsi que des services de dépistage et de prise en charge des cas infantiles.
Rôles d’autres ministères liés au TSAF
En plus du rôle que joue SAC, d’autres ministères contribuent à soutenir les adultes vivant avec le TSAF, dont Emploi et Développement social Canada, le ministère de la Justice du Canada, Sécurité publique Canada et le Service correctionnel du Canada, qui mènent des efforts visant à mieux comprendre les points de vue des personnes atteintes du TSAF dans différents milieux, sensibilisent les gens au TSAF dans ces milieux et fournissent des ressources propres au TSAF. Enfin, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) investissent dans la recherche axée sur au TSAF par l’intermédiaire du Réseau pour la santé du cerveau des enfants et d’autres programmes de neurosciencesNote de bas de page 12.
Continuum de prévention du TSAF à l’échelle de l’ASPC
L’évaluation visait à comprendre, à partir du modèle de prévention du TSAF en quatre volets, les cibles des efforts de l’ASPC dans le continuum de la prévention et les résultats obtenus. Ce modèle, illustré ci-dessous (voir la figure 1), comporte quatre niveaux de prévention, qui se renforcent mutuellement dans le cadre de la lutte contre le TSAF et sont liés aux stratégies globales des politiques. Ces quatre niveaux vont des pratiques générales aux pratiques spécifiques qui aident les femmes à améliorer leur santé et celle de leurs enfants, avec l’aide de la famille, des réseaux de soutien, des services et de la collectivité.
Tandis que les projets financés par l’entremise du FNAPS se concentrent principalement sur la sensibilisation du grand public et des femmes en âge de procréer (soit les niveaux 1 et 2), les programmes pour enfants financés par l’ASPC visent principalement à fournir un soutien global aux femmes enceintes et aux mères, y compris ce qui concerne certains aspects du TSAF (niveaux 3 et 4). Les programmes pour enfants sont adéquats pour aborder les enjeux des niveaux trois et quatre, compte tenu de leur ancrage dans la collectivité et de leur financement continu. À l’heure actuelle, les programmes pour enfants relèvent du CPS; toutefois, les bureaux régionaux de l’ASPC jouent aussi un rôle dans l’exécution et la gestion du financement des programmes. À l’échelle organisationnelle, les bureaux régionaux relèvent d’une direction générale distincte : la Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales. L’intégration des efforts contre le TSAF dans l’ensemble de l’ASPC est actuellement lacunaire, comme l’ont souligné plusieurs personnes interrogées parmi les employés des bureaux régionaux de l’ASPC et au sein d’organisations non gouvernementales.
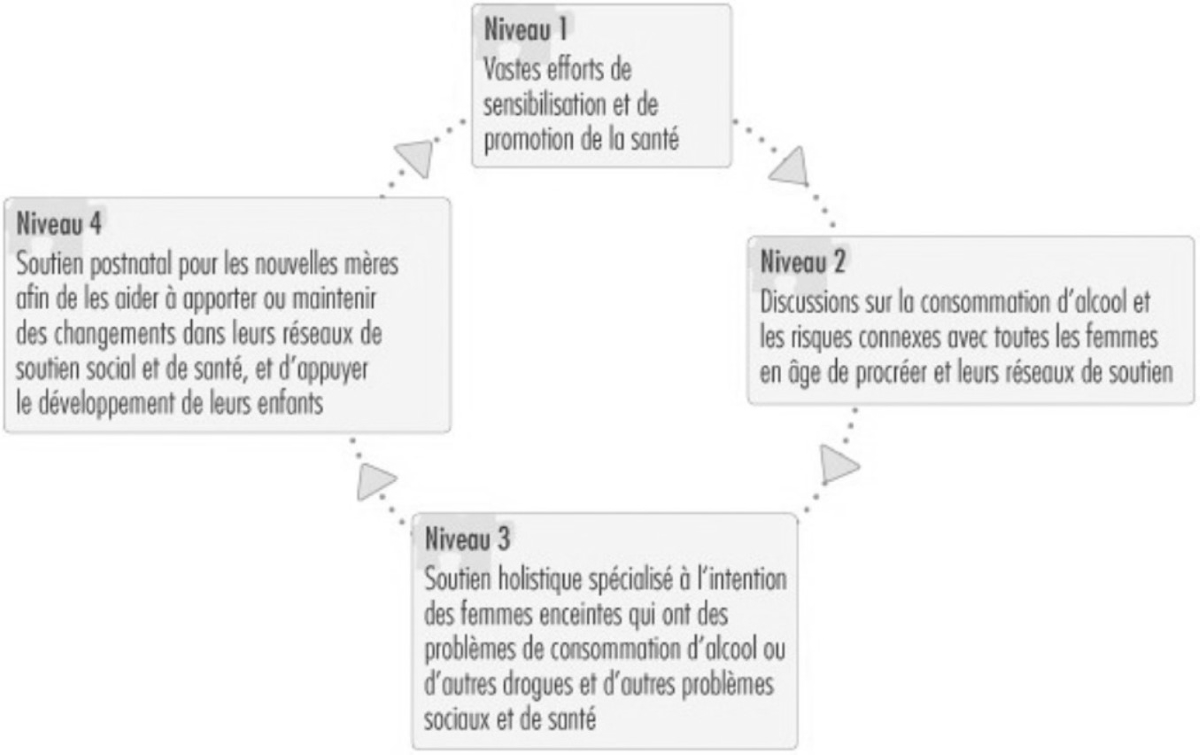
Figure 1 - Équivalent textuel
Un diagramme du modèle de prévention en quatre parties qui démontre 4 boîtes liées par une flèche circulaire dans un sens horaire. Le texte compris dans chaque boîte est comme suit :
- Niveau 1
- Vastes efforts de sensibilisation et promotion de la santé
- Niveau 2
- Discussions sur la consommation d’alcool et les risques connexes avec toutes les femmes en âge de procréer et leurs réseaux de soutien
- Niveau 3
- Soutien holistique spécialisé à l’intention des femmes enceintes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou d’autres drogues et d’autres problèmes sociaux et de santé
- Niveau 4
- Soutien postnatal pour les nouvelles mères afin de les aider à apporter ou maintenir des changements dans leurs réseaux de soutien social et de santé, et d’appuyer le développement de leurs enfants
Source : Poole, N. (2008). La prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : Perspectives canadiennes. Agence de la santé publique du Canada.
Lacunes et possibilités
Les lacunes qui persistent en matière de lutte contre le TSAF au Canada sont solidement documentées et relèvent principalement du mandat des provinces et des territoires. Afin de combler certaines de ces lacunes, l’ASPC pourrait mieux définir les rôles et responsabilités à l’échelle de l’Agence, améliorer la surveillance du TSAF, réunir les intervenants et contribuer à l’uniformité des messages, ainsi qu’à une meilleure adoption des lignes directrices relatives au TSAF.
Comme souligné précédemment, le TSAF constitue un problème complexe qui nécessite les efforts de multiples administrations. La présente évaluation a révélé la persistance de nombreuses lacunes dans la lutte contre le TSAF : certaines des lacunes et possibilités relèvent des provinces et territoires ou d’autres ministères fédéraux (p. ex. l’uniformité des diagnostics et des ressources à l’échelle du pays et le dépistage dans les écoles)Note de bas de page 13, et d’autres se situent au-delà de la portée des efforts liés au TSAF, dont la nécessité d’une politique nationale sur l’alcool, semblable à celle sur le tabacNote de bas de page 14. Toutefois, quelques lacunes semblent relever du rôle fédéral en matière de santé publique comme indique le tableau suivant.
| Lacune | Lien possible avec le rôle de l’ASPC |
|---|---|
| En 2003, l’ASPC a élaboré le cadre d’action sur le TSAF afin d’orienter ses travaux et ses priorités à l’égard de la lutte contre le TSAF. Le plan stratégique quinquennal est le plus récent document d’orientation de l’ASPC concernant les travaux liés au TSAF. Toutefois, aucune approche ni aucune stratégie nationale ne définit les rôles et les responsabilités de chacun des principaux partenaires et intervenants, ce qui permettrait de mieux coordonner les efforts liés au TSAF.Note de bas de page 15 Nombre des personnes interrogées parmi les bénéficiaires, les ONG et les bureaux régionaux ont évoqué une approche plus intégrée, qui irait de la sensibilisation et la prévention à des interventions qui tiennent compte des déterminants sociaux de la santé, ainsi que des actions réalisées sous l’angle de la réduction des méfaits, qui cadreraient mieux avec l’approche employée en matière de consommation de substances en général et assureraient une prestation de services uniforme aux peuples autochtones dans les réserves et hors réserve. Elles ont également évoqué une approche de planification stratégique plus dynamique et collaborative. | Cet élément correspond au mandat général de l’ASPC, qui consiste notamment à « faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publique ». Cependant, dans le cadre du contexte susmentionné, l’ASPC aurait à examiner la façon dont elle peut assumer ce rôle tout en tenant compte des autres enjeux connexes (p. ex. la stratégie sur la consommation de substances). |
| La mobilisation des intervenants à l’échelle nationale est limitée et fragmentée en ce qui concerne la mise en commun d’informations sur les mises à jour, les pratiques exemplaires et les possibilités de financement. À l’heure actuelle, les efforts sont mal coordonnés à l’échelle du pays. Certains des moyens de rassemblement, comme le réseau CanFASD et la pNAT (Prevention Network Action Team), sont dirigés par des ONG, tandis que le Canada Northwest FASD Partnership rassemble les provinces et les territoires depuis 1999, sauf l’Ontario, le Québec et les provinces de l’AtlantiqueNote de bas de page 16. Depuis 2019, l’ASPC appuie le renforcement de la mobilisation des intervenants dans les provinces de l’Atlantique (voir la section ci-dessous). | Cet élément correspond au mandat général de l’ASPC, qui consiste notamment à « faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publique », et pourrait s’inscrire dans le cadre des activités liées au TSAF, car l’ASPC procède ainsi pour d’autres secteurs de programme. |
| La prévalence nationale du TSAF est inconnue en raison de l’absence de données de surveillance fiables à l’échelle nationale, données qui permettraient de déterminer l’ampleur de la population touchée. Cette lacune a des retombées dans d’autres sphères, par exemple les décisions du gouvernement en matière d’affectation des fonds. | La surveillance fait partie du rôle principal de l’ASPC, qui l’accomplit en collaboration avec d’autres intervenants, dont les provinces et les territoires, à qui il incombe de recueillir des données à l’appui des efforts de surveillance. Des détails à ce sujet figurent dans la section du présent document qui porte sur la surveillance. |
| Les personnes interrogées parmi les ONG et au sein des bureaux de l’ASPC ont souligné un manque d’uniformité dans les messages de prévention et l’application des directives en matière de diagnostic selon les différents groupes sociodémographiques, ainsi que l’absence de la perspective de réduction des méfaits dans les approches de dépistageNote de bas de page 17Note de bas de page 18. Certains experts ont suggéré d’intégrer ces aspects dans les lignes directrices de 2016 en matière de diagnostic, et de diffuser cette mise à jour à grande échelle pour en encourager l’adoption, en collaboration avec les associations professionnelles. | Bien que les services de diagnostic relèvent des administrations provinciales et territoriales, l’ASPC a élaboré de nombreuses lignes directrices en matière de santé publique ou en a appuyé l’élaboration ou la mise à jour. L’ASPC continue de le faire pour des enjeux semblables au TSAF, par exemple la démence. Bien que ce rôle ne soit pas officiellement consigné, l’ASPC a appuyé l’élaboration des toutes premières lignes directrices canadiennes sur le TSAF en matière de diagnostic, publiées en 2005 par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), ainsi que celle de la mise à jour de 2016Note de bas de page 19. |
| Malgré la répartition claire du mandat entre l’ASPC et la DGSPNI concernant les Autochtones, ces populations ne sont pas cloisonnées, et les déplacements entre secteurs peuvent générer des lacunes en matière de couverture. | La mise en œuvre d’une approche plus intégrée de la couverture de l’ASPC et de SAC irait dans le sens des appels à l’action 33 et 34 que la Commission de vérité et réconciliation a formulés en 2012, y compris la nécessité d’élaborer des approches qui tiennent compte des traumatismes et sont adaptées à la cultureNote de bas de page 20. |
| La plupart des bénéficiaires et des ONG ont souligné que le gouvernement fédéral doit consacrer des efforts aux intersections entre le TSAF et de nombreux déterminants sociaux de la santé, au-delà de la prévention. Cela pourrait supposer de consigner les coûts sociétaux comme ceux engagés dans le système de justice, par exemple. | Bien que cet élément dépasse la portée de l’ASPC, la coordination avec d’autres ministères (p. ex. Justice Canada ou Service correctionnel Canada) et avec les provinces et les territoires serait essentielle au traitement de ces enjeux complexes. |
Lignes directrices relatives au TSAF dans d’autres pays
Le renouvellement des lignes directrices relatives au TSAF est désigné ci-dessus comme un domaine d’action potentiel. Il est nécessaire de tenir les lignes directrices à jour et de les diffuser à grande échelle parmi les praticiens pour assurer l’uniformité des messages et des pratiques. Ce qui est fait dans des pays comparables au Canada peut servir de référence. Des approches diagnostiques semblables aux lignes directrices canadiennes ont été adoptées à l’échelle internationale, mais elles diffèrent en ce qui concerne les recommandations, les critères et les seuils cliniquesNote de bas de page 21. À titre comparatif, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis s’appuie sur un document de 2004 intitulé Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis, des lignes directrices qui visent à sensibiliser les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux au TSAFNote de bas de page 22. L’Allemagne a publié ses propres lignes directrices sur le diagnostic du TSAF en 2013Note de bas de page 23. En Australie, l’Australian Guide to the Diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorder a été élaboré en 2016 en réponse à des lacunes telles que des possibilités limitées de formation sur le TSAF, l’absence d’une approche diagnostique uniforme à l’échelle nationale et la confusion entourant les critères de diagnosticNote de bas de page 24. En 2019, l’Écosse a été le premier pays du Royaume-Uni à publier des lignes directrices sur le diagnostic du TSAFNote de bas de page 25, et le National Institute for Health Care Excellence du Royaume-Uni a publié, en 2022, des lignes directrices sur la façon d’améliorer le diagnostic, l’évaluation et la prévention du TSAFNote de bas de page 26. Les lignes directrices écossaises et australiennes mentionnent explicitement être en grande partie inspirées des lignes directrices canadiennes de 2016 sur le diagnostic du TSAF, lesquelles étaient perçues comme un ensemble complet et transférable de recommandationsNote de bas de page 27Note de bas de page 28.
Principales constatations : Efficacité
La présente évaluation a permis d’examiner les progrès réalisés par rapport à l’atteinte des résultats pour les principales activités de l’ASPC, soit la surveillance et le financement communautaire par l’intermédiaire du FNAPS. L’examen tenait compte des résultats applicables indiqués dans les profils d’information sur le rendement suivants :
- Programme de promotion de la santé (FNAPS)
- Données probantes liées à la promotion de la santé et à la prévention des maladies chroniques et des blessures (surveillance)
Principales réalisations liées au FNAPS
Tous les projets financés par le FNAPS offraient une solide représentation du Canada : certains avaient une portée nationale, et d’autres ciblaient des provinces, des territoires ou des collectivités précises. Les projets couvraient les quatre niveaux du modèle de prévention du TSAF et affichaient une diffusion réussie de l’information pertinente, ainsi qu’une importante concentration des efforts sur la prévention. Les projets étaient collaboratifs, créaient de nouvelles possibilités de partenariat et intégraient des personnes ayant une expérience vécue des enjeux en question. La plupart des projets s’étaient adaptés aux restrictions liées à la pandémie et étaient passés avec succès à la prestation virtuelle des activités. Étant donné la nature du FNAPS, le programme n’a pas été en mesure de déterminer s’il y avait eu une réduction du nombre de nouveau-nés affectés par l’alcool.
Accès aux renseignements pertinents et utilisation de ces renseignements pour prévenir le TSAF et soutenir les personnes qui en sont atteintes
Tous les projets financés, qui semblent axés sur la prévention, ont communiqué des renseignements pertinents pour sensibiliser les gens à divers niveaux. Le grand public, les populations visées et les professionnels du domaine de la santé et d’autres secteurs pertinents étaient les populations cibles des projets financés par le FNAPS. Selon le format de prestation des activités, certains projets étaient d’envergure nationale, tandis que d’autres visaient les provinces de l’Atlantique, le Québec, des régions des provinces de l’Ouest ou l’Inuit Nunangat. Par conséquent, le programme offrait une bonne couverture géographique de l’ensemble du Canada.
La plupart des projets ont dû s’adapter aux restrictions liées à la pandémie et sont passés avec succès à la prestation virtuelle des activités. Cette transition a eu lieu à différents rythmes en fonction de la nature du contenu à livrer et des populations cibles. Les réalisations des projets sont présentées ci-dessous selon le modèle de prévention du TSAF en quatre volets. Un même projet peut couvrir plusieurs niveaux de prévention.
Accroître la sensibilisation et la prévention
Niveau 1 : Trois projets étaient axés sur la population générale et visaient à sensibiliser la population au risque de consommer de l’alcool pendant la grossesse. Ces projets ont utilisé les médias sociaux et la radio dans les provinces de l’Atlantique, des publicités destinées aux personnes âgées de 18 à 44 ans dans certaines villes du pays, en plus de produire d’autres documents de sensibilisation. Une campagne communautaire a été mise en place dans l’Inuit Nunangat et d’autres régions nordiques comptant de nombreux Inuits afin de réduire la stigmatisation associée au TSAF. Au total, ces projets ont touché environ 500 000 personnes au Canada.
Niveau 2 : Quatre projets ont porté spécifiquement sur les femmes en âge de procréer et leurs réseaux, notamment dans le cadre de campagnes sur les médias sociaux. L’un de ces projets a aussi porté sur l’élaboration et la publication d’un dictionnaire sur le TSAF afin d’enseigner les bases du TSAF et ce qu’il faut faire pour réduire la stigmatisation liée au TSAF chez les populations marginalisées de la région métropolitaine de Vancouver. Enfin, on a élaboré des séances d’enseignement, en personne et préenregistrées ainsi que sous d’autres formats virtuels, diffusées à l’intention des adolescentes dans les écoles de l’Ontario et du Québec. Au terme d’une campagne médiatique au Québec, 70 % des jeunes femmes sondées avaient très bien retenu les principaux messages, et 48 % avaient l’intention de parler des risques de la consommation d’alcool pendant la grossesse à leur famille et à leurs amis. Au total, ces projets ont touché environ 900 000 personnes au Canada.
Niveau 3 : Un projet consistait à examiner la mise en œuvre et le rendement des projets financés par un programme de l’ASPC (PAPACUN) liés au TSAF, puis à aider ce programme à déterminer les leçons apprises ayant trait à la mise en œuvre de projets. Les huit projets financés offraient des services aux femmes enceintes autochtones, notamment de lutte contre la consommation d’alcool. Les résultats ont été communiqués à d’autres programmes communautaires et, plus largement, au moyen de conférences et de publications.
Renforcer la capacité de soutenir les personnes atteintes du TSAF
Niveau 4 : Huit projets, axés sur les professionnels et les intervenants de la santé, comprenaient la diffusion de lignes directrices en matière de diagnostic financées par l’ASPC et publiées en 2016, la prestation d’un cours en ligne, en 2018, sur les pratiques exemplaires et les ressources afin de discuter de la consommation d’alcool avec les femmes, et la publication, en 2020, de nouvelles lignes directrices sur le dépistage de la consommation d’alcool pendant la grossesse et l’assistance en la matière. Les cliniciens formés dans le cadre du cours en ligne avaient une connaissance et une compréhension accrues du TSAF après leur participation au cours, selon des tests effectués avant et après. Au total, les lignes directrices de 2020 ont été consultées 54 000 fois en ligne au cours des quelques mois qui ont suivi leur publication.
De plus, les professionnels de la justice et de la police des provinces de l’Atlantique ont reçu des séances de formation virtuelles sur le TSAF ainsi que du matériel à diffuser auprès de leurs collègues. Enfin, le personnel du PAPACUN a reçu une formation pour mieux faire connaître le TSAF dans les collectivités autochtones. Certains membres du personnel du PAPACUN ont mentionné l’application d’une « perspective de le TSAF » lorsqu’ils abordent les clients, et d’autres ont indiqué être en mesure de remarquer les « signes du TSAF » chez les enfants et d’adapter leur approche en conséquence. Au total, ces projets ont touché environ 2 000 professionnels.
Recueillir les données
Enfin, en plus des efforts de sensibilisation et de mise en commun des connaissances, un projet était axé sur la mise à jour de la base de données de CanFASD, qui enregistre les cas de TSAF que détectent les cliniques de diagnostic associées, tandis qu’un autre projet estimait la prévalence du TSAF selon la population chez les élèves du primaire âgés de 7 à 9 ans dans la région du Grand Toronto en 2019. Selon cette étude, la prévalence du TSAF chez les élèves du primaire dans cette région variait probablement entre 2 et 3 %Note de bas de page 29.
Nouveau-nés affectés par l’alcool
La réduction de l’incidence des cas de naissances affectées par l’alcool est un résultat final ambitieux, mais il est trop tôt dans le cycle de vie du projet pour discuter de cet objectif dans la présente évaluation. Les projets (de niveaux 1, 2 et 4) n’étaient pas tenus de faire le suivi de ce résultat parmi leurs participants. Dans la mesure du possible, un suivi auprès des participants au projet pourrait toutefois fournir des renseignements à ce sujet. Cette question est abordée plus en détail dans la sous-section de la présente évaluation qui porte sur la mesure du rendement.
Par ailleurs, les projets du PAPACUN financés par l’ASPC (de niveau 3) offrent un soutien direct aux femmes enceintes dans le cadre d’un financement continu. Le FNAPS a fourni un certain soutien à l’évaluation de huit projets financés par le PAPACUN, car il leur a permis de consigner les résultats des projets et l’information sur leur mise en œuvre. Par exemple, ce soutien a permis aux projets de démontrer que, parmi les femmes qui cherchaient à obtenir du soutien dans le cadre de projets globaux sur la consommation problématique de substances ou les traumatismes, 84 % avaient réussi à arrêter ou à réduire leur consommation, ou à consommer plus prudemmentNote de bas de page 30.
Possibilités de collaboration
Pour mener à bien leurs activités, les projets bénéficiaires du financement ont misé sur les partenariats existants, collaborant avec un large éventail de partenaires pour orienter et adapter la livraison des produits, y compris les outils et les ressources de sensibilisation. Tous les projets planifiaient et exécutaient leurs activités selon une approche collaborative. Certains projets comprenaient des personnes ayant une expérience vécue liée au TSAF, ce qui s’est avéré un aspect important, qui a permis une conception et une exécution appropriées des projets, répondant aux besoins des populations cibles.
Pendant la pandémie, la nécessité accrue de sensibiliser les gens au risque associé à la consommation d’alcool pendant la grossesse a donné lieu à plusieurs projets mettant en œuvre des efforts similaires. Bien que les efforts cumulatifs aient pu être bénéfiques, rien n’indique que l’on ait cherché à tirer profit de la collaboration et de synergies. Il convient toutefois de noter que, même si les projets financés par le FNAPS et les programmes pour enfants sont distincts, il y a eu deux cas d’interactions fructueuses : un projet FNAPS a permis de consigner les réalisations des sites du PAPACUN en matière de soutien aux femmes enceintes ayant des problèmes d’alcoolNote de bas de page 31, et l’autre a permis d’offrir du mentorat dans les sites du PAPACUN afin d’accroître les connaissances au sujet du TSAF dans les collectivités autochtonesNote de bas de page 32. Dans le cadre de ce projet, les bureaux régionaux de l’ASPC ont fourni du soutien pour stimuler l’inscription, au besoin.
Évolutivité et viabilité des projets financés
Pour obtenir un financement du FNAPS, les requérants doivent démontrer le potentiel d’évolutivité et de viabilité de leur projet, car le financement de l’ASPC est limité dans le temps. Selon les bénéficiaires de ce financement, les stratégies de durabilité réussies comprenaient le maintien des relations, le fait de rendre les programmes de formation payants et la création de services avec abonnement. La courte durée du financement des projets par l’ASPC (2 ans) a amené les bénéficiaires à chercher d’autres sources de financement, dont des subventions et des partenariats, pour maintenir les programmes et la poursuite de leurs objectifs.
Difficultés relatives à la mesure du rendement
Les projets financés par le FNAPS étaient tenus, dans le cadre de leur plan d’évaluation, de fournir des données sur le rendement axées sur les produits livrables et la portée. Les résultats à court et à moyen terme, comme l’accès global à l’information et l’utilisation de l’information par la population cible pour prévenir le TSAF ou en réduire les méfaits, ne peuvent pas être mesurés de façon appropriée étant donné que ces types de résultats nécessiteraient un suivi auprès des populations cibles une fois le projet terminé. À l’heure actuelle, de tels suivis ne sont pas couverts dans le cadre de la conception actuelle du programme et ne sont pas requis en vertu des ententes de financement.
Certains projets, comme celui du Saskatchewan Prevention Institute, sont néanmoins parvenus à décrire leurs réalisations. Le programme de mentorat a formé des mentors qui ont mieux fait connaître le TSAF au personnel et aux parents dans les établissements du PAPACUN. Une évaluation officielle a permis de consigner l’information relative à l’acquisition et à l’utilisation des connaissances dans le cadre de suivis plusieurs mois après l’offre de la formation. Bien que ces renseignements aient été obtenus au moyen de témoignages plutôt que de façon structurée et systématique, le projet a permis de recueillir de solides données d’évaluation et pourrait servir d’inspiration à d’autres.
De nombreux autres programmes de subventions et de contributions exigent que les projets fournissent des données de mesure du rendement plus rigoureuses dans leurs ententes de contribution, y compris le Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C de l’ASPC, le Programme de partenariats multisectoriels, et le Fonds pour la santé mentale des communautés noires. L’amélioration des données sur le rendement est importante pour l’ASPC aux fins de la responsabilisation et du processus décisionnel, ainsi que pour la capacité des projets d’attirer d’autres fonds devant soutenir leurs efforts une fois le financement de l’ASPC terminé.
Réalisations en matière de surveillance
Les données sur le TSAF proviennent de plusieurs sources qui fournissent toutes de l’information sur divers aspects du TSAF au Canada. Le TSAF est insuffisamment diagnostiqué et déclaré, ce qui constitue un défi majeur pour la mesure exacte de la prévalence du TSAF au Canada. L’ASPC étudie actuellement les diverses sources de données qui pourraient alimenter la surveillance nationale du TSAF.
Disponibilité des données de surveillance et de suivi
La surveillance consiste en un suivi et des prévisions relatifs aux ennuis de santé et aux déterminants de la santé au moyen de la collecte et de l’analyse de données et de rapports. Comme mentionné précédemment, la surveillance nationale constitue un rôle important dans le cadre du mandat de l’ASPC, y compris en ce qui concerne le TSAF. Or, les activités de surveillance dépendent de la disponibilité du personnel et d’autres ressources financières internes.
En réponse à l’absence de données nationales bien établies sur la prévalence du TSAF au début de la période visée par le présent rapport, l’ASPC a financé les travaux du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour la période de 2017 à 2021. Le CAMH a effectué une analyse des sources de données de surveillance existantes sur le TSAF et sur l’exposition prénatale à l’alcool au Canada. Le rapport final de cette analyse, rendu public sur le site Web du CAMH en 2021, a aidé à décrire les sources de données disponiblesNote de bas de page 33.
Les données sur le TSAF proviennent de différentes sources qui fournissent de l’information sur différents aspects du TSAF au Canada, parmi lesquelles :
- L’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ), une enquête nationale qui identifie les répondants atteints du TSAF au moyen d’un questionnaire, auquel répond la personne qui connaît le mieux le jeune ou l’enfant en question. L’ASPC a contribué financièrement aux versions de 2019 et de 2023. À partir de ces données d’enquête, l’ASPC a publié en 2021 une estimation de la prévalence du TSAF chez les enfants et les jeunes de 1 à 17 ans au Canada, et a abordé les défis liés à l’estimation de la prévalence du TSAFNote de bas de page 34. Il s’agit de la principale source de données qu’utilisait l’ASPC à la fin de la période à l’étude, pour éclairer les activités relatives au programme et aux politiques.
- Le Système canadien de surveillance des anomalies congénitales de l’ASPC, qui n’enregistre que les cas graves du TSAFNote de bas de page 35
- Le Système canadien de surveillance périnatale de l’ASPC, qui aborde la consommation d’alcool pendant la grossesseNote de bas de page 36
Au-delà des travaux liés à l’ECSEJ, l’équipe de surveillance examine actuellement des données qui pourraient alimenter la surveillance nationale du TSAF ou compléter les données sur le TSAF, ainsi que l’état de préparation de la base de données CanFASD et d’autres plateformes et initiatives de surveillance existantes, en vue d’aider à évaluer la prévalence et l’incidence du TSAF, de même que pour orienter les pratiques en matière de diagnostic et les trajectoires de soins pour les enfants atteints du TSAF.
Autres sources de données sur le TSAF
Mise en place à l’automne 2016, la base de données CanFASD recueille des renseignements et des caractéristiques sur les personnes atteintes du TSAF au Canada, y compris le profil fonctionnel des personnes ayant reçu un diagnostic de TSAF, les maladies concomitantes dont elles sont atteintes, les interventions dont elles ont besoin et les difficultés qu’elles ont au quotidien tout au long de leur vie. Elle ne tient pas compte de toutes les administrations du pays. Cette base de données a été financée en partie par l’ASPC au cours de la période visée par la présente évaluation.
Difficultés relatives aux données
La surveillance nationale du TSAF comporte nombre de difficultés et défis, par exemple les suivants :
- Un diagnostic de TSAF nécessite une évaluation multidisciplinaire et la connaissance de l’exposition prénatale à l’alcool.
- Il existe, à l’échelle du Canada, des variations entre la prévalence diagnostiquée et la prévalence autodéclarée du TSAF, en partie en raison de la stigmatisation associée à la consommation d’alcool pendant la grossesse.
- Seul un certain nombre de provinces et de territoires consignent des codes utilisés par les médecins suffisamment précis pour détecter le TSAFNote de bas de page 37.
- Les pratiques en matière de diagnostic et l’accessibilité des services (surtout pendant la pandémie) varient d’une administration à l’autreNote de bas de page 38.
En raison de ces difficultés, la disponibilité de données de surveillance complètes, exactes et comparables et, par conséquent, l’estimation de la prévalence du TSAF à l’échelle du pays demeurent lacunaires. Ces difficultés se répercutent sur la collecte de données et l’estimation de la prévalence parmi les populations en quête d’équité, dont les communautés autochtones. Les États Unis et l’Europe doivent également composer avec de telles difficultés en matière de surveillanceNote de bas de page 39.
Données sur le TSAF à l’étranger
Les estimations de la prévalence du TSAF sont également limitées dans la plupart des pays. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Angleterre et la France, utilisent des systèmes génériques de surveillance hospitalière pour identifier les anomalies congénitales majeures. Toutefois, ces systèmes présentent des problèmes d’exactitude diagnostique et de collecte; il s’agit d’une surveillance passive qui n’est pas suffisante pour l’obtention de chiffres sur la prévalence dans le cas de diagnostics complexes tels que celui du TSAFNote de bas de page 40Note de bas de page 41. À l’échelle internationale, la norme mondiale de déclaration des maladies est la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la Santé. La structure de codes de la 10e version (utilisée de 1990 à 2021) représente une difficulté par rapport à l’acquisition de données sur le TSAFNote de bas de page 42. La 11e version (utilisée depuis 2022) comprend un terme pour les troubles neurodéveloppementaux associés à l’exposition prénatale à l’alcool, mais elle ne comprend pas de code propre au TSAFNote de bas de page 43.
Utilisation de la surveillance pour la prise de décisions
L’un des principaux critères de résultats associés à la fonction de surveillance est l’utilisation des données pour orienter les politiques et les programmes. Puisque les données de surveillance disponibles sur le TSAF sont limitées, et compte tenu du manque d’information à l’interne sur les travaux relatifs aux politiques, cette évaluation n’a pas permis de déterminer si les données de surveillance sont utilisées pour orienter les politiques et les programmes, et la façon dont elles le sont. Cependant, depuis 2021, le CPS collabore avec le CSRA à des projets visant à combler les lacunes dans les connaissances grâce à des estimations nationales de la prévalence du TSAF ou des composantes du TSAF, en plus de collaborer avec des partenaires et des intervenants clés.
Les exemples suivants donnent un aperçu de l’utilisation externe et de la coordination interne :
- Les partenaires et les intervenants utilisent des données générales de l’ECSEJ pour accroître la sensibilisation, demander du financement ou faire du lobbying en vue de l’élaboration de politiques dans leur propre province/territoire ou organisation. De nombreuses personnes interrogées à l’externe n’utilisent pas les données actuelles en raison de leurs importantes limites.
- Les personnes interrogées à l’interne ont indiqué que même si l’échange d’informations entre les équipes de surveillance et des politiques a été limité pendant la période à l’étude, cela s’est grandement amélioré depuis 2021-2022, bien qu’aucun moyen de communication officiel n’ait été mis en place. Contrairement à d’autres programmes du CPS (p. ex. pour le trouble du spectre de l’autisme), pour lesquels l’élaboration d’une stratégie nationale comprend des consultations intensives, l’équipe de surveillance du TSAF a moins d’occasions de mobiliser les intervenants externes et l’équipe des politiques. Les données quantitatives sont communiquées à l’équipe des politiques lorsqu’elles sont disponibles. Il n’y a toutefois aucune planification collaborative ou conjointe entre les équipes des politiques et de la surveillance, ce qui limite les possibilités pour les deux équipes de tirer parti du travail l’une de l’autre.
Autres domaines
En plus de surveiller et de financer les projets, le programme sur le TSAF transmet de l’information à ses collègues des régions et rencontre d’autres ministères chaque année; il a déployé des efforts de communication dans le cadre d’activités de sensibilisation durant la pandémie et dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation au TSAF. Parmi les activités stratégiques, notons une tentative de demande de financement visant à mieux soutenir les activités liées au TSAF.
Comme mentionné précédemment dans le présent rapport, le seul élément de financement du programme sur le TSAF est le FNAPS. Quoi qu’il en soit, l’ASPC a été en mesure de mener de nombreuses autres activités pour soutenir les efforts liés au TSAF. En plus de la surveillance et des projets financés par le FNAPS, le programme sur le TSAF a entrepris les activités suivantes :
- Activités de mobilisation des intervenants – ce qui comporte l’organisation de plusieurs réunions par année réunissant le personnel du programme sur le TSAF et des bureaux régionaux de le TSAF qui assurent la liaison avec les intervenants locaux du TSAF (responsables régionaux du TSAF). Le groupe de travail interministériel se réunit également une fois par année à des fins de mise en commun d’informations. Les personnes interrogées ont indiqué que, avant la COVID-19, on organisait aussi des réunions avec les bénéficiaires du financement pour faire le point, mais que de telles réunions n’avaient plus lieu. À l’heure actuelle, il n’y a pas de table de gouvernance ni d’activité de mobilisation engageant les provinces et les territoires au-delà des tables générales comme le Réseau pancanadien de santé publique.
- Activités stratégiques – dans le cadre desquelles le CPS a tenté de tirer parti du renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances comme nouvelle possibilité de financement pour le TSAF, mais sans succès en raison d’autres domaines concurrents hautement prioritaires. Récemment, le 19 octobre 2022, le projet de loi S-253 : Loi concernant un cadre national sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale a été déposé au Sénat du Canada. La deuxième lecture au Sénat est en cours. Si la loi est adoptée, elle aura une incidence sur les travaux futurs de l’ASPC. Il est à noter que les récentes activités stratégiques se rapportant à ce projet de loi ne font pas l’objet de la présente évaluation.
- Les activités relatives aux communications – qui comprenaient la mise à jour des pages Web de l’ASPC consacrées au TSAF (en 2018 et 2022) et la participation de l’ASPC à la campagne de la Journée internationale de sensibilisation au TSAF (9 septembre). En 2020, l’ASPC a financé une campagne de sensibilisation en matière de prévention en réponse à des besoins précis dans le contexte de la pandémie de COVID-19, fournissant des montants complémentaires aux bénéficiaires de subventions et de contributions.
La figure 1 permet de constater que, au cours des trois dernières années, les activités de communication de l’ASPC sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont généré du trafic Web, tandis que le nombre de visites des pages sur le TSAF demeurait stable, indiquant une divergence de tendances. Les pages sur le TSA ont en effet reçu plus de visites, ce qui peut s’expliquer par l’intérêt public qu’a généré la future Stratégie nationale sur le TSA. De plus, les pages consacrées au TSAF en français représentaient environ 5 % de tout le trafic vers ces pages au Canada au cours de la période de trois ans, ce qui est très faible par rapport à la population francophone du Canada. À l’inverse, le trafic sur les pages consacrées au TSA est bien équilibré entre le contenu anglais et le contenu français.

Figure 2 - Équivalent textuel
Cette figure démontre un diagramme à barres empilées qui démontre les visites uniques à la page web du gouvernement du Canada en entre 2019-2020 et 2021-2022. Il fait un comparaison entre les visites aux pages liées à l’ECTAF (à gauche) et les visites aux pages liées au TSA (à droite). La section au sommet de la barre (chaque an) démontre le pourcentage de visites aux pages en anglais (orange) et la section en bas démontre le pourcentage de visites aux pages en français (bleu).
Les nombres de visites sur l’ECTAF sont comme suit :
- 2019-2020:
- Nombre total de visites uniques : 16,273, dont 96 pourcent sont en anglais et 4 pourcent en français.
- 2020-2021:
- Nombre total de visites uniques : 17,999, dont 96 pourcent sont en anglais et 5 pourcent sont en français.
- 2021-2022:
- Nombre total de visites uniques : 18,039, dont 93 pourcent sont en anglais et 7 pourcent sont en français.
Le nombre de visites sur le TSA sont comme suit :
- 2019-20:
- Nombre total de visites uniques : 36,132, dont 59 pourcent sont en anglais et 41 pourcent sont en français.
- 2020-21:
- Nombre total de visites uniques : 70,153, dont 50 pourcent sont en anglais et 50 pourcent sont en français.
- 2021-22:
- Nombre total de visites uniques : 92,154, dont 50 pourcent sont en anglais et 50 pourcent sont en français.
Source : Direction générale des communications et des affaires publiques, Division des communications numériques
Conclusions
À ce jour, l’ASPC a entrepris des activités de lutte contre le TSAF qui correspondent bien à son rôle fédéral en matière de santé publique. Toutefois, malgré des objectifs ambitieux, le financement consacré au TSAF est limité. D’importantes lacunes subsistent, dont certaines semblent relever du rôle du gouvernement fédéral en matière de santé publique dans les domaines du renforcement de la surveillance, de la planification stratégique nationale, de la mobilisation des intervenants, de la collaboration avec les intervenants, de la consignation des pratiques prometteuses et du soutien à l’élaboration et à la diffusion de lignes directrices.
Tous les projets financés par le FNAPS ont recueilli et communiqué des renseignements pertinents pour accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances dans les quatre domaines du modèle de prévention du TSAF, et tous ces projets semblent principalement axés sur la prévention. Le public, les femmes enceintes ou en âge de procréer et leurs réseaux, ainsi que plusieurs catégories de professionnels, y compris des professionnels de la santé, étaient les populations cibles des projets financés par le FNAPS. La plupart des projets ont dû s’adapter à la pandémie de COVID-19 et effectuer une transition vers des activités virtuelles plutôt qu’en personne. Les données sur le rendement que devaient fournir les projets financés couvraient principalement les extrants et la portée; toutefois, certains projets ont pu démontrer que les participants en avaient retiré une prise de conscience et de nouvelles connaissances. Il serait utile de recueillir des données supplémentaires permettant de déterminer les réalisations des divers projets, par exemple sur le plan des connaissances, de l’utilisation et du changement de comportement, comme c’est le cas pour d’autres programmes de subventions et de contributions de l’ASPC.
Certains projets financés ont aussi aidé à améliorer les données de surveillance du TSAF, alors que les activités de surveillance de l’ASPC examinaient diverses sources de données pour établir une surveillance nationale. Cependant, l’absence de données nationales sur la prévalence du TSAF continue de représenter une lacune, laquelle est exacerbée par la tendance à sous-diagnostiquer le TSAF et, donc, à déclarer un nombre de cas inférieur à la réalité.
Recommandations
Recommandation 1 : Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.
Les activités exploratoires actuelles sont nécessaires à la mise en place éventuelle d’un système national de surveillance. La collecte des données qui sont requises pour orienter la prise de décisions, en particulier en ce qui concerne les populations en quête d’équité, nécessitera la détermination des investissements à effectuer dans la surveillance et la collaboration avec les provinces et territoires. Cela irait également dans le sens de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation concernant la nécessité de cerner et de combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones.
Recommandation 2 : Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.
L’évaluation a révélé que l’ASPC pourrait user de son rôle fédéral en matière de santé publique pour combler certaines lacunes qui concernent le TSAF; toutefois, certaines activités ne font pas partie de l’approche intégrée. En effet, plusieurs équipes de l’ASPC assurent des activités liées au TSAF (au sein du CPS, du CSRA et des bureaux régionaux), mais il n’existe actuellement aucune structure globale pour coordonner tous ces efforts. De plus, le TSAF est une question complexe, qui exige de tenir compte de déterminants sociaux de la santé allant au-delà des programmes classiques de santé publique. Le TSAF est aussi lié à des enjeux comme la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et relève donc d’équipes du domaine de la consommation d’alcool, mais aussi, plus largement, de la consommation de substances. Ces deux enjeux sont en effet traités par d’autres groupes du portefeuille de la Santé. Une meilleure compréhension de la structure des activités actuelles, mais aussi de la façon de coordonner ces activités à l’interne et à l’externe, constitue une étape préliminaire vers plus d’uniformité en vue de faciliter la mise en place d’approches nationales des politiques et de la planification relatives au TSAF. Bien que l’évaluation précédente du TSAF ait recommandé d’améliorer la mobilisation des intervenants, de plus amples travaux seront nécessaires pour améliorer la coordination à cet égard.
Recommandation 3 : Améliorer l’approche de mesure du rendement du programme sur le TSAF en mettant l’accent sur l’incidence du programme.
Une fois que les activités et les rôles seront schématisés et mieux définis, les activités liées au TSAF devraient être clairement organisées suivant un modèle logique qui mettrait en évidence les objectifs du programme sur le TSAF et les façons d’atteindre chacun de ceux-ci. Le modèle de prévention du TSAF en quatre volets pourrait aider à concevoir les efforts par population cible. Il permettrait aussi de mieux cerner les éléments par rapport auxquels le programme sur le TSAF est le mieux placé pour servir chaque population et de clarifier les frontières par rapport aux programmes généraux relatifs à l’enfance. Grâce à un tel cadre, il serait aussi possible de trouver des synergies entre divers projets financés qui sont axés sur les mêmes objectifs et ont une ampleur comparable. Une fois le modèle logique clarifié, il faudrait identifier et recueillir des indicateurs pertinents et réalistes pour surveiller les progrès. Dans le cas du FNAPS, l’ASPC devrait s’assurer que les équipes des projets financés planifient les efforts et s’engagent à en assurer la surveillance dès le début. Bien que l’évaluation précédente du programme sur le TSAF ait déjà recommandé d’améliorer la mesure du rendement, seuls des progrès limités ont depuis été réalisés en matière de collecte de données, et des mesures du rendement plus précises et complètes seraient donc avantageuses pour le programme.
Réponse et plan d’action de la direction
Recommandation 1
Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.
Réponse de la direction
En accord. En s’appuyant sur les activités passées et actuelles, le CSRA continuera de mettre à l’essai des méthodes et des options prometteuses pour l’estimation nationale de la prévalence du TSAF.
Le CSRA continuera d’engager des ressources, limitées, dans la poursuite de ces activités, y compris des ETP se consacrant exclusivement à mener les projets.
Nous convenons que la collaboration avec les intervenants internes et externes sera essentielle à ce que l’ASPC dispose des données et de l’information utiles à la prise de décisions concernant les populations en quête d’équité. Il sera essentiel de tirer parti des tables existantes pour atteindre cet objectif. Par l’entremise du Groupe de travail interministériel sur le TSAF, nous veillerons non seulement à ce que les activités de surveillance continue servent à clarifier les besoins de l’ASPC en matière de politiques, mais aussi à orienter la réponse à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
| Plan d’action pour la direction – mesures à suivre pour traiter de la recommandation | Produits livrables – produits réels qui vont mettre en œuvre le plan d’action | Date d’achèvement prévue – la date qu’on prévoit que les produits livrables seront disponibles | Responsabilité – les personnes responsables pour la mise en œuvre du plan d’action | Ressources – finances et personnel requis pour la mise en œuvre du plan d’action |
|---|---|---|---|---|
| L’ASPC continue d’explorer des options pour l’estimation de la prévalence nationale du TSAF au moyen d’une approche multisource. Cela comprend la production continue de rapports sur le TSAF s’appuyant sur les sources de données existantes, dont les enquêtes pancanadiennes, ainsi que des évaluations de faisabilité relatives aux bases de données administratives sur la santé qui existent dans les provinces et territoires. | 1) À l’aide de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (2019 et 2023), élaborer un plan analytique en vue de la production continue de rapports sur le TSAF. | 1) Mars 2024 | Directrice générale, Centre de surveillance et de recherche appliquée (CSRA) | Ressources existantes |
| 2) Élaborer un rapport sommaire sur les bases de données administratives sur la santé qui existent dans les provinces et territoires, et déterminer leur utilité pour estimer la prévalence du TSAF. | 2) Mars 2025 | |||
| En partenariat avec d’autres ministères et organismes externes, l’ASPC s’assurera qu’elle dispose des données et des renseignements nécessaires pour orienter la prise de décisions concernant les populations en quête d’équité. | 3) En tirant parti du Groupe de travail interministériel sur le TSAF, élaborer un plan de consultation pour obtenir des conseils sur une stratégie de collecte de données, de production de rapports et de diffusion de l’information sur les populations en quête d’équité. | 3) Mars 2024 |
Recommandation 2
Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.
Réponse de la direction
En accord. On déterminera les possibilités de renforcer l’intégration et la coordination des efforts liés au TSAF dans l’ensemble de l’ASPC pour une approche plus uniforme, afin de favoriser des approches nationales en matière de politiques et de planification relatives au TSAF.
| Plan d’action pour la direction – mesures à suivre pour traiter de la recommandation | Produits livrables – produits réels qui vont mettre en œuvre le plan d’action | Date d’achèvement prévue – la date qu’on prévoit que les produits livrables seront disponibles | Responsabilité – les personnes responsables pour la mise en œuvre du plan d’action | Ressources – finances et personnel requis pour la mise en œuvre du plan d’action |
|---|---|---|---|---|
| Examiner les efforts liés au TSAF et déterminer la façon de renforcer la collaboration et l’intégration en la matière dans l’ensemble de l’ASPC. | 1) Liste recensant les activités et les pistes actuelles dans l’ensemble de l’ASPC concernant la consommation d’alcool, la réduction des méfaits connexes (y compris sur le plan de la santé mentale et de la violence familiale et sexiste) et le TSAF. | 1) Septembre 2023 | Directrice générale, Centre pour la promotion de la santé (DG, CPS) Directrice générale, Centre de santé mentale et de mieux-être (DG, CSMB) Directrice générale, Centre de surveillance et de recherche appliquée (DG, CSRA) Vice-président, Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques (VP, DGPSPMC) |
Ressources existantes dans le CPS, le CSMB et le CSRA |
| 2) Élaboration d’une structure de gouvernance et/ou d’une stratégie de communication de l’information en vue de coordonner les activités relatives aux programmes, aux politiques et à la surveillance liées à l’alcool, à la réduction des méfaits et au TSAF, ainsi que la mobilisation des intervenants (y compris la clarification des rôles et des responsabilités). | 2) Avril 2024 |
Recommandation 3
Améliorer l’approche de mesure du rendement du programme sur le TSAF en mettant l’accent sur l’incidence du programme.
Réponse de la direction
En accord. Dans le cadre du renforcement de la collaboration et de l’intégration des efforts liés au TSAF dans l’ensemble de au TSAF, un nouveau modèle logique du programme sera élaboré; il définira mieux les liens entre la sensibilisation et la prévention et incorporera des mesures de rendement liées aux grands déterminants sociaux de la santé et à la réduction des méfaits.
| Plan d’action pour la direction – mesures à suivre pour traiter de la recommandation | Produits livrables – produits réels qui vont mettre en œuvre le plan d’action | Date d’achèvement prévue – la date qu’on prévoit que les produits livrables seront disponibles | Responsabilité – les personnes responsables pour la mise en œuvre du plan d’action | Ressources – finances et personnel requis pour la mise en œuvre du plan d’action |
|---|---|---|---|---|
| Mettre à jour le modèle logique du programme sur le TSAF et la stratégie de mesure du rendement en fonction de la clarification des objectifs et des résultats du programme, y compris ceux liés à la consommation d’alcool, à la réduction des méfaits et à la surveillance. | 1) Mise à jour du modèle logique du programme | 1) Juin 2024 | DG, CPS DG, CSMB DG, CSRA VP, DGPSPMC |
Ressources existantes dans le CPS, le CSMB et le CSRA |
2) Mise à jour de la stratégie de mesure du rendement, ce qui comprend :
|
2) Septembre 2024 |
Annexe 1 : Méthodes de collecte et d’analyse des données
L’évaluation portait sur les activités de l’ASPC liées au TSAF d’avril 2018 à mars 2022. Elle était conçue pour aborder les résultats attendus des activités de l’ASPC relatives au TSAF et répondre à certaines questions.
L’équipe d’évaluation a recueilli des données au moyen de diverses sources et méthodes, notamment les suivantes :
Examen de documents et de dossiers
Le personnel du CPS et du CSRA a fourni des documents aux évaluateurs aux fins de l’examen. Au total, l’équipe d’évaluation a examiné environ 120 documents, dont 30 ont fait l’objet d’un examen détaillé.
Analytique Web
Des données d’analytique Web sur le TSAF étaient disponibles pour les exercices 2019 2020 à 2021-2022. Ces données mesurent le nombre de visites des pages liées au TSAF sur le site Web de l’ASPC. Chaque consultation de page a été comptée une fois par session, qui est la période durant laquelle un utilisateur demeure sur site Web. Les données antérieures à 2019-2020 ne sont pas stockées sur les serveurs de Santé Canada et de l’ASPC.
Entrevues
Les évaluateurs ont mené des entrevues auprès de 49 personnes : 9 personnes de l’ASPC, 6 des provinces et territoires, 10 bénéficiaires et 24 autres intervenants, issus d’autres ministères, d’ONG ou à titre d’experts. Les évaluateurs ont utilisé le logiciel d’analyse qualitative NVIVO pour cerner les thèmes soulevés lors de ces entrevues.
Analyse des données financières et relatives aux ressources humaines
La Direction générale du dirigeant principal des finances et services intégrés de gestion de l’ASPC a fourni des données financières sur les dépenses de programme prévues et réelles. On a aussi recueilli des données sur les ressources humaines pour garder une trace du roulement des ressources humaines affectées au programme.
Documentation universitaire et parallèle
Les constatations issues de l’évaluation s’appuient sur un examen ciblé de la documentation universitaire et parallèle.
Données de mesure du rendement
L’ASPC a fourni des données de mesure du rendement, que l’équipe d’évaluation a analysées pour cerner les principales tendances et évaluer les résultats.
L’équipe d’évaluation a utilisé une méthode de validation pour analyser les données des diverses sources et ainsi accroître la fiabilité et la crédibilité des constatations et conclusions. Néanmoins, la plupart des évaluations sont limitées par des contraintes pouvant avoir une incidence sur la validité et la fiabilité des constatations et des conclusions; celle-ci ne fait pas exception.
Le tableau suivant présente les contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre des méthodes sélectionnées pour cette évaluation et les stratégies d’atténuation que l’on a adoptées afin que les constatations soient suffisamment fiables.
| Contrainte | Incidence possible | Stratégie d’atténuation |
|---|---|---|
| Les entrevues sont de nature rétrospective, ne fournissant qu’une perspective récente sur des événements passés. | Cela peut nuire à la validité des évaluations des activités ou des résultats, qui peuvent avoir changé au fil du temps. | La validation avec d’autres sources de données a permis de corroborer les données recueillies lors des entrevues ou de fournir des renseignements supplémentaires sur ces dernières. L’examen des documents a aussi permis d’obtenir des renseignements organisationnels. |
| Certaines personnes susceptibles d’être interrogées n’étaient pas disponibles pour les entrevues en raison de congés prolongés postérieurs au financement. | Certaines personnes susceptibles d’être interrogées n’ont pas pu contribuer à l’évaluation. L’évaluation pourrait ne pas incorporer certains points de vue importants. | L’équipe d’évaluation a communiqué avec d’autres personnes susceptibles d’être interrogées dans la même catégorie afin d’assurer une représentation de l’éventail des intervenants et des partenaires avec qui l’ASPC collabore. |
| Les données sur la mesure du rendement de l’ASPC étaient limitées à un petit nombre d’indicateurs. | Il peut être plus difficile d’évaluer les progrès réalisés en vue de l’atteinte des résultats pour lesquels il n’y a pas d’indicateurs de mesure de rendement. | La validation avec d’autres sources de données probantes a permis d’obtenir des renseignements supplémentaires lorsqu’il y avait des lacunes dans les données sur la mesure du rendement. |
| La structure des données financières n’est pas liée aux extrants et aux résultats. | La capacité d’évaluer l’efficacité de façon quantitative est limitée. | Des sources de données qualitatives (dont les entrevues et l’examen des documents) ont été utilisées. |
| Les données sur les résultats à moyen et à long terme étaient limitées en raison du calendrier de financement. | Il est difficile d’évaluer les progrès réalisés en vue de l’atteinte de tels résultats. | On a axé l’évaluation sur d’autres domaines de résultats et eu recours à la validation avec d’autres sources de données, dans la mesure du possible. |
Une démarche d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACSG+) a été appliquée à l’évaluation des activités liées au TSAF, y compris des discussions quant aux données désagrégées disponibles et nécessaires. Les langues officielles ont été examinées dans les produits livrables des projets financés ainsi que pour les pages Web de l’ASPC liées au TSAF.
Par ailleurs, les objectifs de développement durable ne s’appliquaient pas à la présente évaluation et n’ont donc pas été examinés.
La portée de cette évaluation a été présentée au Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation (CMRE) le 21 juin 2022, et le rapport final, en mars 2023.
Annexe 2 – Dépenses du programme et défis internes
Dépenses du programme
Les dépenses prévues pour les activités liées au TSAF s’élevaient à environ 9,9 millions de dollars pour la période visée par l’évaluation.
| CPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année financière | Dépenses prévues | Dépenses réelles | Écart | % du budget prévu dépensé |
| 2017-2018 | 2 106 346 $ | 1 861 684 $ | -224 662 $ | 88 % |
| 2018-2019 | 2 122 749 $ | 1 346 148 $ | -776 601 $ | 63 % |
| 2019-2020 | 2 082 327 $ | 2 176 415 $ | 94 088 $ | 105 % |
| 2020-2021 | 1 820 591 $ | 1 651 808 $ | -168 783 $ | 91 % |
| 2021-2022 | 1 820 591 $ | 1 096 866 $ | -723 725 $ | 60 % |
| CPS – Total | 9 952 603 $ | 8 132 921 $ | -1 819 681 $ | 80 % |
Enjeux internes qui entravent les résultats
Le roulement des ressources humaines a eu une incidence sur la prestation du programme sur le TSAF à au moins deux reprises au cours de la période à l’étude. Comme de nombreux employés de l’ASPC, les employés chargés du dossier de le TSAF ont également dû être affectés à d’autres fonctions pour soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19. Selon les intervenants interrogés, le roulement du personnel et la perte d’expertise au sein du programme ont entraîné une rupture du lien avec les intervenants. De plus, des problèmes de gestion de l’information, combinés au roulement des ressources humaines, ont entraîné une perte de mémoire organisationnelle. Les données passées au sujet du programme ne sont plus disponibles, et les nouveaux employés ont de la difficulté à accéder à l’information pertinente et à s’appuyer sur le travail effectué par les anciens employés.
Annexe 3 – Correspondance entre les résultats prévus et le modèle de prévention en quatre volets
Les résultats prévus dans le cadre du plan stratégique 2016-2021 sur le TSAF sont mis en correspondance avec le modèle de prévention de l’ETCAF à quatre niveaux dans le tableau ci-dessous (voir aussi la figure 1). S’ajoute au modèle ci-dessous un autre résultat prévu, soit « accroître la compréhension de l’ampleur et du fardeau du TSAF au Canada à l’appui de la planification et de la prise de décisions ».
| Niveau | Modèle de prévention à quatre niveaux | Résultats attendus du plan stratégique 2016-2021 |
|---|---|---|
1 |
Mener de vastes efforts de sensibilisation et de promotion de la santé. |
Accroître la sensibilisation du public. |
2 |
Discuter de la consommation d’alcool et des risques connexes avec les femmes en âge de procréer et les personnes qui composent leurs réseaux de soutien. |
Prévenir la consommation d’alcool pendant la grossesse grâce à des messages cohérents sur ses répercussions. |
3 |
Donner un soutien global et spécialisé aux femmes enceintes qui ont des problèmes de consommation d’alcool et d’autres problèmes sociaux ou de santé. |
Élaborer des ressources pertinentes à l’intention des fournisseurs de services pour aider les femmes qui ont de la difficulté à arrêter ou à réduire leur consommation d’alcool pendant la grossesse. |
4 |
Fournir aux nouvelles mères un soutien après l’accouchement pour les aider à maintenir ou à amorcer des changements dans leur santé et leurs réseaux sociaux et pour soutenir le développement de leur enfant. |
Soutenir les personnes touchées par le TSAF au moyen d’interventions fondées sur des données probantes et adaptées à la culture, par des possibilités de formation et grâce à la communication de pratiques exemplaires. |
Annexe 4 – Fonds national de projets stratégiques pour le TSAF : Description et résultats des projets
Cinq projets ciblaient la population générale et visaient à sensibiliser la population aux risques de consommer de l’alcool pendant la grossesse (niveau 1).
- Le projet Toward Prevention: An Atlantic FASD awareness and collaborative action-building initiative (« Vers la prévention : initiative de sensibilisation et de mobilisation collaborative au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale en Atlantique »), mené par le Fetal Alcohol Spectrum Disorder Newfoundland and Labrador Network (fasdNL), a élaboré des messages et des ressources sur la prévention et la sensibilisation à l’égard du TSAF à l’intention du grand public pour les provinces de l’Atlantique. Ces activités comprenaient une campagne sur les médias sociaux comportant 14 affiches en anglais, en français et en inuktitut, alors qu’une traduction en langue micmaque était prévue selon le plus récent rapport. La campagne a touché plus de 477 000 personnes, a intégré les commentaires des partenaires et des personnes atteintes du TSAF et se poursuivra en 2023. Deux publicités radiophoniques ont aussi été diffusées dans tout le Canada atlantique en janvier 2021. Enfin, dans le cadre du mois de sensibilisation au TSAF de 2021, fasdNL a tenu un webinaire gratuit au sujet du projet et du travail effectué au Canada atlantique.
- Le projet Using Diagnosis and Data to Improve Outcomes in FASD (« Recours au diagnostic et aux données pour améliorer les résultats en ce qui concerne le TSAF »), mené par CanFASD, comprenait de multiples volets, dont l’un consistait à élaborer et à rendre accessible en ligne un guide sur le diagnostic du TSAF à l’intention des soignants. Ce guide a touché plus de 11 000 personnes à l’occasion d’une publication Facebook, tandis que les publications sur Twitter et LinkedIn ont aussi donné lieu à un certain nombre d’expositions, soit plus de 4 000 et 240 respectivement.
- L’Association pour la santé publique du Québec a élaboré une campagne de sensibilisation bilingue intitulée « Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale : il faut en parler pour mieux agir! », qui visait à prévenir la consommation d’alcool pendant la grossesse et à lutter contre la stigmatisation associée au TSAF au Québec. Le programme visait à accroître les connaissances et la compréhension de la consommation d’alcool pendant la grossesse et du TSAF parmi la population générale, à modifier les perceptions du public, à réduire la stigmatisation associée au TSAF et à évaluer les ressources et les pratiques exemplaires bilingues à l’appui de l’action communautaire. La campagne a donné lieu à environ 11 millions d’expositions sur diverses plateformes, y compris les médias sociaux, le Web, la télévision et d’autres moyens comme les documents imprimés.
- Le projet « Programme de prévention du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale en milieu scolaire pour les enfants et les adolescents fréquentant certaines écoles urbaines, rurales et des Premières Nations en Ontario, au Canada » est le deuxième projet mené par le Centre de toxicomanie et de santé mentale. Ce projet pilote vise à modifier, à adapter culturellement, à traduire et à offrir le programme d’éducation et de prévention scolaires de la National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS) dans des écoles et à en évaluer l’efficacité dans certaines écoles de l’Ontario auprès des enfants et des jeunes (12-18 ans) des collectivités urbaines, rurales et des Premières Nations. Un comité directeur interdisciplinaire a été convoqué à l’automne 2019. Jusqu’à présent, la collaboration avec les comités consultatifs et les groupes de défense des intérêts comprenait Shkaabe Makwa, CanFASD, FASD One, la NOFAS, des experts en prévention de la toxicomanie, des éducateurs et des personnes ayant une expérience vécue liée au TSAF. À la fin de 2022, les premiers objectifs avaient été atteints pour ce qui était d’adapter culturellement le programme-cadre de la NOFAS en vue de sa mise en œuvre dans certaines écoles de l’Ontario et d’encourager la tolérance et un langage non stigmatisant. La mise en œuvre de l’outil pilote a commencé en mars 2022 et s’est poursuivie jusqu’en janvier 2023. Les objectifs finaux comprennent l’évaluation de l’outil et, s’il est jugé efficace, la fourniture d’une trousse devant orienter sa mise en œuvre.
- L’organisme Pauktuutit Inuit Women of Canada a mené une campagne de sensibilisation communautaire intitulée « Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale : Soutenons nos familles et nos communautés inuites » à l’échelle de l’Inuit Nunangat, qui comprend des parties du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Québec, du Labrador, de l’Ontario et de l’Alberta; elle visait à promouvoir la prévention du TSAF dans les collectivités inuites, à réduire la stigmatisation associée au TSAF, et à améliorer les résultats maternels et infantiles. Pour y arriver, le projet a tenté d’améliorer les données ayant trait au TSAF propres aux Inuits et d’orienter le développement de ressources au moyen de groupes de discussion en personne et virtuels et d’entrevues téléphoniques. En septembre 2021, le comité directeur a résumé les résultats de recherche de la première phase du projet dans deux rapports : le rapport d’analyse environnementale et de recherche et le rapport communautaire (version en langage clair). Les deux rapports ont donné un aperçu des connaissances, des attitudes et de la compréhension relatives au TSAF dans les collectivités, en plus de mettre en évidence certains services liés au TSAF dirigés par des Inuits et adaptés sur le plan culturel qui sont offerts dans la région.
Quatre projets visaient les femmes en âge de procréer et leurs réseaux de soutien (niveau 2).
- Le projet Using Diagnosis and Data to Improve Outcomes in FASD (« Recours au diagnostic et aux données pour améliorer les résultats en ce qui concerne le TSAF »), mené par CanFASD, a élargi ses activités au début de la pandémie de COVID-19 pour faire face à une hausse de la consommation d’alcool. CanFASD a élaboré un document d’une page pour accroître les connaissances sur les risques associés à la consommation d’alcool pendant la grossesse et pour mieux faire connaître les ressources qui offrent un soutien aux femmes et aux familles en période d’isolement. Ce document, publié sous la forme d’un billet de blogue de CanFASD, a fait l’objet d’une promotion sur de nombreux canaux ayant permis de joindre environ 2 400 personnes sur Facebook, ainsi que 18 000 personnes par l’intermédiaire de plateformes de partenaires sur les médias sociaux (dont la SOGC).
- L’Association pour la santé publique du Québec a mené une campagne de sensibilisation bilingue intitulée « Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale : il faut en parler pour mieux agir! ». Les femmes de 12 à 25 ans étaient l’une des populations cibles de cette campagne de sensibilisation. Selon l’enquête menée au terme de la campagne auprès de jeunes femmes du groupe d’âge ciblé, la rétention des principaux messages sur le TSAF et la consommation d’alcool était excellente (70 %), et près de 90 % avaient trouvé la campagne compréhensible et bienveillante. Environ 48 % avaient l’intention de parler des risques liés à la consommation d’alcool lors de la grossesse avec leur famille et leurs amis.
- L’organisme Young Women’s Christian Association (Metro Vancouver) a mené le projet Culturally Sensitive Awareness to Prevent FASD in Marginalized Communities (« Sensibilisation tenant compte des différences culturelles pour prévenir le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale dans les communautés marginalisées »), un projet pilote communautaire commencé en 2019-2020 et ayant pris fin en mai 2022. Ce projet visait à sensibiliser les femmes en âge de procréer à la consommation d’alcool pendant la grossesse et à concevoir des ressources pour enseigner les bases du TSAF. Il ciblait les membres de communautés marginalisées et mal desservies, y compris les immigrants, les réfugiés, les personnes à faible revenu, les Autochtones et les non-Autochtones à Vancouver (Colombie-Britannique). Le projet s’est appuyé sur les commentaires de divers experts, de personnes ayant une expérience vécue liée au TSAF et de différents organismes pour planifier, élaborer et mettre à l’essai son matériel, qui a donné lieu à des produits livrables clés, dont une analyse documentaire sur le contexte du TSAF, un dictionnaire pour l’enseignement des bases du TSAF et de ce qu’il faut faire pour aider à réduire la stigmatisation associée au TSAF, et une trousse d’outils pour aider d’autres organismes à reproduire la campagne de prévention du projet. Le projet a également organisé et tenu deux conférences. Une évaluation a conclu que les facteurs de réussite du projet étaient l’inclusion des personnes ayant une expérience vécue liée au TSAF, l’établissement de protocoles de collaboration en tant que collectif, la production de contenu pour le dictionnaire du TSAF, l’accessibilité du dictionnaire, de même que la passion, le temps et la bienveillance qui ont permis l’élaboration de cette ressource.
- Le Saskatchewan Prevention Institute Inc. a mené le National FASD Mentoring Project (« Projet national de mentorat sur le TSAF »), qui offrait, dans les sites du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN), de la formation au personnel du PAPACUN et des organismes partenaires par l’entremise de mentors spécialisés dans le TSAF. Le projet visait à accroître les connaissances à l’égard du TSAF chez les personnes qui travaillent auprès des familles dans les communautés autochtones afin que ces intervenants puissent, à leur tour, renforcer leurs compétences et leurs outils et élaborer des services appropriés. Dans le cadre d’une approche de « formation des formateurs », 17 mentors qui avaient été désignés pour animer des ateliers ont reçu de la formation et des ressources sur une période de trois jours. Au total, les mentors ont donné 63 ateliers dans 84 établissements du PAPACUN auxquels ont participé plus de 600 personnes, dont 50 % étaient des membres du personnel du PAPACUN. L’évaluation du projet a révélé qu’il avait atteint son objectif de renforcer la capacité au Nunavut de lutter contre le TSAF et que la mise en œuvre des leçons tirées des ateliers après la conclusion du projet se passait bien.
Un certain projet a appuyé un projet du PAPACUN financé par l’ASPC pour l’aider à consigner ses réalisations en matière de soutien aux femmes enceintes selon une approche globale, y compris concernant la consommation d’alcool (niveau 3).
- Le projet du Nota Bene Consulting Group intitulé Multi-Site Evaluation on FASD Prevention, with Holistic Programs Reaching Pregnant Women at Risk (« Évaluation multisite de la prévention du TSAF par des programmes globaux visant les femmes enceintes à risque ») consistait à effectuer une évaluation multisite des programmes de prévention globaux de niveau 3 à l’échelle de huit sites au Canada. Ces programmes suivaient un ensemble similaire de méthodes, dont des démarches tenant compte des traumatismes, axées sur les relations, centrées sur la femme, adaptées à la culture et visant la réduction des méfaits. L’organisme a formé un comité consultatif composé de personnes ayant une expertise en matière du TSAF dans divers domaines d’activités. L’évaluation a contribué à accroître la base de connaissances destinée à aider les programmes globaux actuels et futurs à atteindre leurs objectifs. Elle y est arrivée en publiant trois articles au cours du projet et en présentant les résultats lors de diverses conférences. Les constatations portaient sur certains des résultats de l’évaluation, comme les perspectives des femmes sur la recherche d’aide, et sur les plus importants changements connexes. En plus de diffuser son rapport d’évaluation, Nota Bene a produit une série de fiches d’information en ligne portant sur divers aspects des constatations issues de l’évaluation. Selon les résultats des divers programmes examinés, les principaux changements observés chez les participantes étaient la réduction ou l’abandon de la consommation de substances, le soutien accru qu’elles obtenaient des programmes, et un renforcement des liens avec les services de soutien personnelNote de bas de page 44.
Cinq projets visaient les professionnels et les intervenants de la santé, leur fournissant des lignes directrices et des outils pour dépister le TSAF et soutenir les personnes qui en sont atteintes (niveau 4).
- Le projet Toward Prevention: An Atlantic FASD awareness and collaborative action-building initiative, mené par le Fetal Alcohol Spectrum Disorder Newfoundland and Labrador Network (fasdNL) et déjà présenté ci-dessus, a aussi publié du matériel et des séances de formation à l’intention des professionnels de soutien. Cela comprend une formation virtuelle intitulée FASD 101 and the Justice System (« TSAF 101 et le système judiciaire »), offerte en octobre 2021 et en mars 2022 à 143 professionnels de la justice et 20 animateurs. De plus, en avril 2022, une séance de formation a été offerte à 43 membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la police provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. Les participants ont reçu des copies du matériel de formation pour diffusion ultérieure.
- L’Association pour la santé publique du Québec, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation bilingue « Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale : il faut en parler pour mieux agir! », a touché les professionnels de la santé et les décideurs. Dix-neuf présentations ont été données à des conseils scolaires et à des professionnels de la santé, touchant chacune un public allant de 80 à 800 participants, et des trousses d’outils ont été distribuées à d’autres organismes plus difficiles à joindre.
- Le Saskatchewan Prevention Institute Inc. a mené le National FASD Mentoring Project (« Projet national de mentorat sur le TSAF »), qui offrait, dans les sites du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN), de la formation au personnel du PAPACUN et des organismes partenaires par l’entremise de mentors spécialisés dans le TSAF. Ce projet visait à accroître les connaissances à l’égard du TSAF chez les personnes qui travaillent auprès des familles dans les collectivités autochtones afin que ces intervenants puissent, à leur tour, renforcer les compétences et les outils de ces dernières et élaborer des services appropriés. À la suite des ateliers, les participants et les directeurs de site ont confirmé que les enseignements et les stratégies de l’atelier étaient déjà mis en œuvre. Certains participants ont mentionné avoir adopté une « perspective du TSAF » afin d’aborder diverses situations, et d’autres ont été en mesure de remarquer des « signes du TSAF » chez certains enfants, ce qui leur a permis de mieux soutenir les familles et les clients.
- Le projet Dialogue + Action: Women and Substance Use (« Dialogue + Action : Les femmes et la consommation de substances ») a été mené par le Centre d’excellence pour la santé des femmes de la Colombie-Britannique. Ce projet visait à recenser dans un document de synthèse les outils, les approches et les pratiques de dépistage que peuvent utiliser les fournisseurs de soins de santé pour discuter de consommation d’alcool avec les femmes. Le projet visait également à compléter cette information, puis à effectuer une analyse de la documentation, dont les résultats ont ensuite été compilés dans un rapport à l’intention de l’ASPC. L’équipe du projet s’est aussi penchée sur les modifications à apporter aux plateformes de prestation existantes, de façon à promouvoir les pratiques exemplaires liées à l’examen de la situation et au dépistage relatifs à la consommation d’alcool. Les résultats de l’analyse documentaire et des séances régionales ont été compilés en plusieurs documents, près de 500 exemplaires ayant été distribués à des lecteurs francophones et anglophones, et près de 150 participants ayant participé au webinaire connexe. Les projets étaient de nature hautement collaborative et ont donné lieu à des partenariats réunissant des professionnels de la santé, des organismes de recherche et des bureaux du gouvernement provincial.
- Le projet Using Screening, Training and Data to Address Women’s Alcohol Use During Pregnancy (« Recours au dépistage, à la formation et aux données pour lutter contre la consommation d’alcool chez les femmes enceintes ») a été élaboré et mené par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). Ce projet a donné lieu à l’élaboration de lignes directrices pour la pratique clinique, de programmes de formation et de trousses d’outils. De plus, le projet a permis d’apporter des mises à jour aux outils de dépistage et aux protocoles de traitement actuels. Au cours de la première année du projet, la SOGC a créé deux sondages, a effectué une analyse documentaire et une synthèse des données probantes, en plus d’effectuer une évaluation des besoins des prestataires de soins de santé chez les femmes afin de déterminer les obstacles et les facteurs favorables à la lutte contre la consommation d’alcool pendant la grossesse. On a adopté diverses approches pour promouvoir les lignes directrices et former les professionnels, y compris l’utilisation d’une trousse d’outils, d’un forum Web interactif, d’ateliers virtuels et d’un cours en ligne. Selon les résultats préliminaires de ce projet, il y a eu 646 téléchargements des lignes directrices, 200 participants aux ateliers et 54 000 consultations du site Web du projet. La mise à jour des facteurs de risque qu’a effectuée la SOGC a donné lieu à une campagne de sensibilisation ayant généré 1 million d’expositions sur les médias sociaux et 60 000 consultations du site Web en 5 semaines.
- CanFASD a mené le projet Using Diagnosis and Data to Improve Outcomes in FASD (« Recours au diagnostic et aux données pour améliorer les résultats en ce qui concerne le TSAF »). Ce projet a donné lieu au lancement d’un cours en ligne sur l’amélioration de la pratique clinique, accessible par la plateforme d’apprentissage en ligne de CanFASD en 2018 et suivi par un total de 71 personnes. Toutefois, étant donné la participation limitée à ce cours (seulement 71 apprenants), il a depuis été intégré à un nouveau cours intitulé « Identifier les meilleures pratiques pour les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale ». Vers la fin du projet, ce cours avait été suivi par 336 apprenants en ligne, et avait été promu dans le cadre d’un webinaire auquel avaient participé 96 fournisseurs de services. La formation en ligne est la première formation offerte à tous les nouveaux cliniciens au sein de l’équipe d’une clinique de diagnostic du TSAF et aux professionnels qui lancent une nouvelle clinique. Les résultats de tests effectués par les 613 apprenants avant et après la « Formation équipe multidisciplinaire de diagnostic de TSAF : un programme en ligne » ont montré une amélioration des connaissances et de la compréhension.
Enfin, deux projets ont permis de mieux comprendre l’ampleur de la prévalence du TSAF.
- Le CAMH a mené une étude de dépistage s’appuyant sur une conception observationnelle transversale pour déterminer la prévalence du TSAF en fonction de la population chez les élèves du primaire de la région du Grand Toronto (RGT) en Ontario, au Canada. Cette étude présente la toute première estimation démographique de la prévalence du TSAF chez les élèves du primaire âgés de 7 à 9 ans au Canada. Elle a été publiée dans BMC Public Health, une revue scientifique à accès ouvert et à comité de lecture, reprise sur les sites Web du CAMH et de CanFASD. La publication a recueilli au moins 50 citations selon ResearchGate, ce qui n’inclut pas les consultations de l’article à partir d’autres sites WebNote de bas de page 45.
- CanFASD a mené le projet Using Diagnosis and Data to Improve Outcomes in FASD (« Recours au diagnostic et aux données pour améliorer les résultats en ce qui concerne le TSAF ») de 2016-2017 à 2020-2021. Le projet visait à élargir et à mettre à jour le forum de collaboration en ligne de CanFAST ainsi que les renseignements sur l’exposition prénatale dans sa base de données. La base de données nationale de CanFASD sur le TSAF a aussi été mise à jour. Près de 300 dossiers ont été recodés et ajoutés, et des données importantes sur les caractéristiques démographiques et les facteurs de risque ont été recueillies au moyen d’une enquête menée auprès des cliniques.
Notes de fin
- Note de bas de page 1
-
Cook, J. L., Green, C. R., Lilley, C. M., Anderson, S. M., Baldwin, M. E., Chudley, A. E., & Rosales, T. (2016). Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan. Cmaj, 188(3), p. 191-197. https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/11/FASD-Basic-Information.pdf
- Note de bas de page 2
-
Funds for NGOs. (2018). PHAC: Increasing Awareness of Fetal Alcohol Spectrum Disorder and the Prevention of Alcohol Use in Pregnancy. En ligne (en anglais seulement) : https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/phac-increasing-awareness-of-fetal-alcohol-spectrum-disorder-and-the-prevention-of-alcohol-use-in-pregnancy/
- Note de bas de page 3
-
Palmeter, S., Probert, A. et Lagacé, C. (2021). Aperçu – Prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les enfants et les adolescents : résultats de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada : Recherche, politiques et pratiques, 41(9), 300.
- Note de bas de page 4
-
Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (2016). FNIGC data online: percentage of First Nations children diagnosed with a mental health condition or FASD [database]. En ligne (en anglais seulement) : https://fnigc.ca/dataonline/charts-list?term_node_tid_depth_1=All&term_node_tid_depth=10&keys=FASD
- Note de bas de page 5
-
Popova, S., Lange, S., Probst, C., Parunashvili, N. & Rehm, J. (2017). Prevalence of alcohol consumption during pregnancy and Fetal Alcohol Spectrum Disorders among the general and Aboriginal populations in Canada and the United States. European journal of medical genetics, 60(1), 32-48.
- Note de bas de page 6
-
Agence de la santé publique du Canada (2022). Infographie : Examen de l’évolution de la consommation d’alcool et de cannabis et de la stigmatisation pendant la pandémie de COVID-19 au Canada. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/infographie-examin-evolution-consommation-alcool-cannabis-stigmatisation-pandemie-covid.html
- Note de bas de page 7
-
Popova, S., Lange, S., Burd, L., Rehm, J. The Burden and Economic Impact of Fetal Alcohol Spectrum Disorder in Canada (2015). Centre for Addiction and Mental Health.
- Note de bas de page 8
-
Popova, S., Green, C. et Cook, J. (2014). Social and economic cost of fetal alcohol Spectrum Disorder. CanFASD. En ligne (en anglais seulement) : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2016/05/IssuePaper_CostFASD-Final.pdf
- Note de bas de page 9
-
Agence de la santé publique du Canada (2011). Mandat. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/mandat.html
- Note de bas de page 10
-
ASPC (2016). Plan stratégique quinquennal de l’Initiative sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (2016-2021). En ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aspc-phac/HP35-73-2016-fra.pdf
- Note de bas de page 11
-
Agence de la santé publique du Canada (2021). Évaluation du Programme d’action communautaire pour les enfants et du Programme canadien de nutrition prénatale – 2015-2016 à 2019-2020.
- Note de bas de page 12
-
Agence de la santé publique du Canada (2016). Plan stratégique quinquennal de l’Initiative sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (2016-2021). En ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aspc-phac/HP35-73-2016-fra.pdf
- Note de bas de page 13
-
Burns, J., Harding, K., Flannigan, K., Unsworth, K. & McFarlane, A. (2020). Provincial and territorial strategies for fetal alcohol spectrum disorder in Canada.
- Note de bas de page 14
-
Centre de toxicomanie et de santé mentale (2019). Cadre stratégique sur l’alcool. Toronto : CAMH. En ligne : https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/camh-alcohol-framework_french-2019-pdf.pdf
- Note de bas de page 15
-
Burns, J., Harding, K., Flannigan, K., Unsworth, K. & McFarlane, A. (2020). Provincial and territorial strategies for fetal alcohol spectrum disorder in Canada.
- Note de bas de page 16
-
Partnering Jurisdictions. (s.d.) CanFASD. En ligne (en anglais seulement) : https://canfasd.ca/about/partnering-jurisdictions/
- Note de bas de page 17
-
CanFASD (2022). Messages communs – Lignes directrices pour parler et écrire sur le TSAF. En ligne : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/Common-Messages-FR.pdf
- Note de bas de page 18
-
Dugas, E. N., Poirier, M., Basque, D., Bouhamdani, N., LeBreton, L., & Leblanc, N. (2022). Canadian clinical capacity for fetal alcohol spectrum disorder assessment, diagnosis, disclosure and support to children and adolescents: a cross-sectional study. BMJ open, 12(8), e065005.
- Note de bas de page 19
-
Gouvernement du Canada (2022). Lignes directrices de lutte contre la maladie. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/lignes-directrices-lutte-contre-maladie.html
- Note de bas de page 20
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada (2012). Commission de vérité et de réconciliation du Canada : Appels à l’action. En ligne : https://nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
- Note de bas de page 21
-
Cook, J. L., Green, C. R., Lilley, C. M., Anderson, S. M., Baldwin, M. E., Chudley, A. E., & Rosales, T. (2016). Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan. Cmaj, 188(3), p. 191-197.
- Note de bas de page 22
-
National Task Force on Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effect (2004). Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis. Centers for Disease Control and Prevention. En ligne (en anglais seulement) : https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/documents/fas_guidelines_accessible.pdf
- Note de bas de page 23
-
Landgraf, M. N., Nothacker, M. & Heinen, F. (2013). Diagnosis of fetal alcohol syndrome (FAS): German guideline version 2013. European journal of paediatric neurology, 17(5), p. 437-446.
- Note de bas de page 24
-
Bower C, Elliott EJ 2016, on behalf of the Steering Group. Report to the Australian Government Department of Health: Australian Guide to the diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).
- Note de bas de page 25
-
Healthcare Improvement Scotland (2019). SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 156 Children and Young People Exposed Parentally to Alcohol Guidelines (2019). En ligne (en anglais seulement) : https://www.sign.ac.uk/media/1092/sign156.pdf
- Note de bas de page 26
-
National Institute for Health and Care Excellence (2022). Le NICE publie une norme de qualité complète conçue pour améliorer le diagnostic et l’évaluation de l’ensemble des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale. En ligne (en anglais seulement) : https://www.nice.org.uk/news/article/nice-publishes-comprehensive-quality-standard-designed-to-improve-the-diagnosis-and-assessment-of-fetal-alcohol-spectrum-disorder
- Note de bas de page 27
-
Society for the Study of Addition (2021). Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) guidelines on fetal alcohol spectrum disorders. En ligne (en anglais seulement) : https://www.addiction-ssa.org/scottish-intercollegiate-guidelines-network-sign-guidelines-on-fetal-alcohol-spectrum-disorders/
- Note de bas de page 28
-
Bower C, Elliott EJ 2016, on behalf of the Steering Group. Report to the Australian Government Department of Health: Australian Guide to the diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).
- Note de bas de page 29
-
Popova, S., Lange, S., Poznyak, V., Chudley, A. E., Shield, K. D., Reynolds, J. N., & Rehm, J. (2019). Population-based prevalence of fetal alcohol spectrum disorder in Canada. BMC public health, 19(1), 1-12.
- Note de bas de page 30
-
Gouvernement du Canada (2022). Lignes directrices de lutte contre la maladie. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/lignes-directrices-lutte-contre-maladie.html
- Note de bas de page 31
-
Rutman, D., Hubberstey, C., Poole, N., Schmidt, R. A., & Van Bibber, M. (2020). Multi-service prevention programs for pregnant and parenting women with substance use and multiple vulnerabilities: Program structure and clients’ perspectives on wraparound programming. BMC Pregnancy and Childbirth, 20(1), 1-14.
- Note de bas de page 32
-
Saskatchewan Prevention Institute (2020). Understanding Fetal Alcohol Syndrome Disorder: A resource for service providers.
- Note de bas de page 33
-
Popova, S. (2021). Élaboration d’un système de surveillance multisource du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et de l’exposition prénatale à l’alcool (SSTSAF/EPA). En ligne : https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/phac-report-fr-pdf.pdf
- Note de bas de page 34
-
Palmeter, S., Probert, A. et Lagacé, C. (2021). Aperçu – Prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les enfants et les adolescents : résultats de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada : Recherche, politiques et pratiques, 41 (9), 300.
- Note de bas de page 35
-
Agence de la santé publique du Canada (2013). Les anomalies congénitales au Canada 2013 : Rapport de surveillance sur la santé périnatale. En ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aspc-phac/HP35-40-2013-fra.pdf
- Note de bas de page 36
-
Gouvernement du Canada (2004). Système canadien de surveillance périnatale. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/division-surveillance-sante-epidemiologie/sante-maternelle-infantile/systeme-canadien-surveillance-perinatale.html
- Note de bas de page 37
-
Flannigan, K., Unsworth, K., & Harding, K. (2018). The prevalence of fetal alcohol spectrum disorder. Vancouver, BC: Canada FASD Research Network. En ligne (en anglais seulement) : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/Prevalence-1-Issue-Paper-FINAL.pdf
- Note de bas de page 38
-
Chudley, A. E., Conry, J., Cook, J. L., Loock, C., Rosales, T. et LeBlanc, N. (2005). Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale : Lignes directrices canadiennes concernant le diagnostic. CMAJ, 172(5 suppl), SF1-SF21.
- Note de bas de page 39
-
Popova, S., Lange, S., Probst, C., Parunashvili, N. & Rehm, J. (2017). Prevalence of alcohol consumption during pregnancy and Fetal Alcohol Spectrum Disorders among the general and Aboriginal populations in Canada and the United States. European journal of medical genetics, 60(1), 32-48.
- Note de bas de page 40
-
Mukherjee, R., Cook, P. A., Fleming, K. M., & Norgate, S. H. (2017). What can be done to lessen morbidity associated with fetal alcohol spectrum disorders? Archives of disease in childhood, 102(5), 463-467.
- Note de bas de page 41
-
Lange, S., Probst, C., Gmel, G., Rehm, J., Burd, L., & Popova, S. (2017). Global prevalence of fetal alcohol spectrum disorder among children and youth: a systematic review and meta-analysis. JAMA pediatrics, 171(10), 948-956.
- Note de bas de page 42
-
Government of UK – Department of Health and Social Care (2021). Fetal alcohol spectrum disorder: health needs assessment. En ligne (en anglais seulement) : https://www.gov.uk/government/publications/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment
- Note de bas de page 43
-
Organisation mondiale de la Santé (s.d.) Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM). En ligne (en anglais seulement) : https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
- Note de bas de page 44
-
Rutman, D; Hubberstey, C.; Van Bibber, M.; Poole, N. and R. Schmidt (22 février 2020). Multi-Service Programs for Pregnant and Parenting Women with Substance Use Concerns: Women’s Perspectives on Why They Seek Help and Their Significant Changes [présentation de conférence; en anglais seulement]. Conférence du HBHM 2020, Vancouver (Colombie-Britannique), Canada. https://fasd-evaluation.ca/wp-content/uploads/2020/08/CCE-presentation-for-HBHM-conference-February-22-2020-.pdf https://convention.apa.org/2019-video
- Note de bas de page 45
-
Popova, S., Lange, S., Poznyak, V., Chudley, A. E., Shield, K. D., Reynolds, J. N., & Rehm, J. (2019). Population-based prevalence of fetal alcohol spectrum disorder in Canada. BMC public health, 19(1), 1-12.