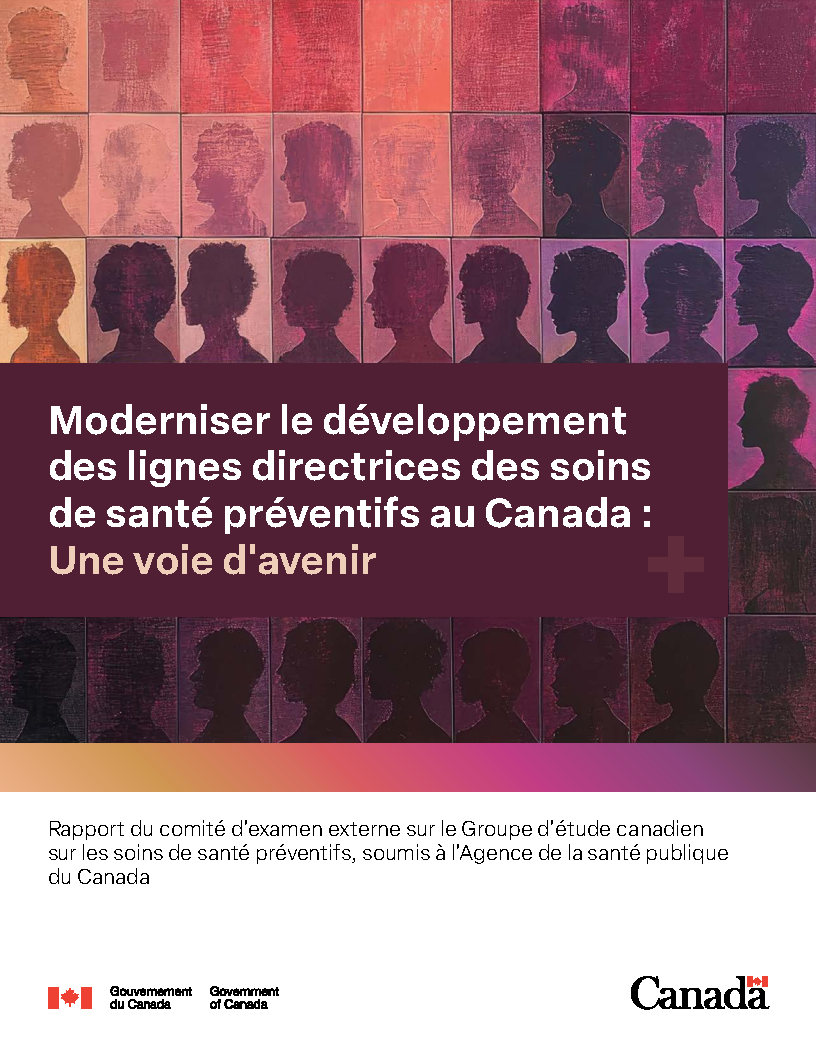Moderniser le développement des lignes directrices des soins de santé préventifs au Canada : Une voie d'avenir
Télécharger au format PDF
(13,68 Mo, 112 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date publiée : 2025-06-13
Préface du Président
Les soins de santé préventifs constituent la pierre angulaire d'un système de santé fort et équitable — un système qui ne se limite pas à traiter les maladies, mais qui agit activement pour les prévenir. Tout au long de ma carrière en santé publique, en recherche et en élaboration de politiques fondées sur des données probantes, j'ai été témoin des bienfaits des mesures préventives sur l'amélioration de la santé de la population, la réduction des inégalités en santé et le renforcement de nos systèmes de soins. Consolider notre cadre de soins préventifs demeure l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer le bien-être de la population canadienne.
Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP) est depuis longtemps une voix respectée dans l'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes, et son travail est reconnu à l'échelle internationale. Alors que le paysage des soins de santé continue d'évoluer, les structures et les processus qui l'orientent doivent eux aussi s'adapter. Le Comité d'examen externe, composé de treize experts provenant de disciplines variées, a mené ses travaux avec un engagement commun à faire en sorte que le Groupe d'étude demeure un chef de file en matière de soins de santé préventifs — attentif aux besoins des professionnels des soins de santé primaires et de la population, ainsi qu'aux gestionnaires des programmes de dépistage provinciaux et territoriaux, aux conseils de la qualité et d'autres parties prenantes clés qui soutiennent à la fois les professionnels et le public dans la prestation des soins primaires et des services cliniques de prévention.
Tout au long de ce processus, nous avons écouté des médecins de famille, des médecins spécialistes, d'autres professionnels de la santé et des membres du public. Nous avons également recueilli les points de vue d'établissements universitaires, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvernementales, d'autorités sanitaires provinciales et territoriales, ainsi que d'autres parties prenantes. Leurs contributions ont brossé un tableau clair : bien que le Groupe d'étude soit reconnu pour sa rigueur scientifique, il est urgent de moderniser son approche pour qu'elle soit plus inclusive, plus transparente, plus adaptable et plus sensible à la diversité des contextes de prestation des soins de santé à travers le Canada. Plusieurs ont notamment souligné l'importance de veiller à ce que les lignes directrices soient contextualisables — c'est-à-dire adaptables aux différents systèmes provinciaux et territoriaux, aux rôles des prestataires et aux besoins des populations — afin que les recommandations fondées sur les données probantes puissent être mises en œuvre de manière pertinente là où elles sont le plus nécessaires. Pour répondre pleinement aux attentes, il est essentiel que le Groupe d'étude dispose des ressources et du soutien nécessaires. Les soins de santé préventifs ne sont pas statiques — et les structures qui les soutiennent ne devraient pas l'être non plus.
Ce rapport présente des constats et des recommandations qui visent non seulement à renforcer la crédibilité du Groupe d'étude, mais aussi à accroître sa capacité à répondre aux besoins des professionnels de soins de santé primaires et des personnes vivant au Canada. En élargissant les sources de données probantes, en intégrant une flexibilité contextuelle dans ses méthodes et en adoptant une approche d'engagement plus systématique et axée sur l'équité, notamment en améliorant l'engagement des parties prenantes et en consolidant sa gouvernance, nous pouvons faire en sorte que les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs demeurent rigoureuses sur le plan scientifique et pertinentes sur le plan pratique.
Les recommandations de ce rapport visent non seulement à moderniser l'approche, mais aussi à garantir que les soins de santé préventifs demeurent réactifs aux données scientifiques émergentes, ouvertes à la diversité des perspectives et adaptées aux réalités concrètes de prestation des soins et aux priorités locales de santé publique.
À une époque où la mésinformation et la désinformation minent la confiance, du public envers le système de santé, le rôle d'organismes indépendants fondés sur des données probantes, tel que le Groupe d'étude est plus essentiel que jamais. Pendant la préparation de ce rapport, les travaux du Groupe d'étude ont été temporairement suspendus. Il est primordial de lui permettre de reprendre pleinement ses activités et de poursuivre sa contribution essentielle aux soins de santé préventifs au Canada.
Je remercie sincèrement mes collègues du Comité d'examen externe pour avoir partagé leurs connaissances, leur expertise et la diversité de leurs points de vue, exprimés dans un climat d'ouverture et de respect lors de nos travaux. Leur collaboration et leur engagement ont été essentiels à la réalisation de notre mandat. Je suis également reconnaissant aux nombreux experts nationaux et internationaux, ainsi qu'aux parties prenantes qui ont généreusement consacré leur temps et leur expertise à cet examen, de même qu'aux organisations qui ont partagé leurs idées et perspectives. Ensemble, ils ont contribué à façonner les recommandations présentées dans ce rapport.
Ce rapport n'est pas une conclusion, mais plutôt le point de départ d'une transformation importante. Dans la dernière section de ce rapport, nous proposons une réflexion élargie sur la nécessité de moderniser l'approche pancanadienne en matière d'élaboration des lignes directrices. J'invite les décideurs, les responsables du système de santé et l'ensemble de la population à considérer ces pistes de réflexion et à œuvrer ensemble, de manière coordonnée, à la mise en place d'une approche solide, sensible aux contextes et mieux adaptée aux besoins en matière de services préventifs et d'élaboration de lignes directrices au Canada.
Vivek Goel, C.M., O.Ont.
Président du Comité d'examen externe
Mars 2025
Sur cette page
- Chapitre 1 : Introduction et contexte
- Chapitre 2 : Principales constatations
- 2.1 Redéfinition du mandat et des priorités stratégiques
- 2.2 Renforcer les données probantes, les approches méthodologiques et la pertinence des lignes directrices
- 2.3 Intégration de l'équité : vers des lignes directrices inclusives
- 2.4 Renforcer la gouvernance pour des lignes directrices inclusives et contextualisables
- 2.5 Garantir la viabilité et l'indépendance du Groupe d'étude à long terme
- Chapitre 3 : Considérations plus générales
- 3.1 Possibilités d'action à l'échelle du système pour un écosystème de lignes directrices coordonné et résilient
- 3.2 Mettre en place une infrastructure intégrée en matière de lignes directrices
- 3.3 Intégrer les perspectives de santé publique et de santé communautaire
- 3.4 Harmoniser les organismes de financement de la recherche, les agences de données, les conseils de la qualité et les partenariats internationaux
- 3.5 Regard vers l'avenir
- Conclusion : Une voie d'avenir
- Glossaire
- Annexes
- Annexe 1 : Comité d'examen externe — Cadre de référence
- Annexe 2 : Membres du Comité d'examen externe
- Annexe 3 : Experts techniques
- Annexe 4 : Personnes ayant fourni une présentation écrite
- Annexe 5 : Personnes, organisations parties prenantes, entités gouvernementales et institutions académiques ayant fourni des contributions
- Annexe 6 : Synthèse des mémoires des parties prenantes -"Ce que nous avons entendu"
- Annexe 7 : Comparaison avec des organismes internationaux d'élaboration de lignes directrices
- Annexe 8 : Proposition d'organigramme pour le Groupe d'étude
- Figures
- Références
- Notes de bas de page
Remerciements
Nous exprimons notre plus profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à cet examen et joué un rôle clé dans l'élaboration de ce rapport.
Nous souhaitons tout d'abord souligner la contribution essentielle du secrétariat dédié de l'Agence de la santé publique du Canada pour son accompagnement avisé et son expertise précieuse. Sous la direction du Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique, et de Mme Marie-Hélène Lévesque, directrice générale, l'équipe a assuré un soutien constant, rigoureux et attentionné tout au long du processus d'examen. En particulier, nous adressons nos sincères remerciements à Mariellen Chisholm, Kim Davis, Sylvie Desjardins, Ashley Gilbert, Vivianne Z. Lamoureux et Marisha Tardif pour leur engagement exemplaire et la qualité remarquable de leur travail.
Nous exprimons également notre vive reconnaissance aux conseillères et conseillers techniques, dont les expertises complémentaires en santé publique, en politiques de santé, en recherche et participation citoyenne ont profondément enrichi notre analyse. Leurs observations rigoureuses, leur participation active et leurs conseils éclairés ont contribué à renforcer la cohérence et la crédibilité du présent rapport.
Nous remercions chaleureusement les parties prenantes et experts consultés qui ont généreusement partagé leur savoir et leurs points de vue sur les meilleures pratiques, tant au niveau national qu'international, en matière d'élaboration de lignes directrices. Leurs perspectives ont permis d'approfondir notre compréhension des enjeux émergents et d'appuyer la formulation de recommandations solides et pragmatiques.
Nous avons eu le privilège de dialoguer avec un large éventail de personnes et de groupes d'intérêt de toutes les régions du pays. Leurs réflexions constructives ont constitué une précieuse source d'inspiration pour nos travaux.
Bien que ces contributions aient été déterminantes dans l'élaboration de ce rapport, nous assumons l'entière responsabilité de son contenu, y compris les éventuelles limitations ou erreurs qui subsistent. Les interprétations, conclusions et recommandations présentées ici reflètent notre évaluation et notre jugement indépendants.
Liste des acronymes
- AC
- Application des connaissances
- ASPC
- Agence de la santé publique du Canada
- CCNI
- Comité consultatif national de l'immunisation
- CEE
- Comité d'examen externe
- CESP
- Centre d'examen et de synthèse des données probantes
- CI
- Conflit d'intérêts
- É.-U.
- États-Unis
- ECR
- Essai contrôlé randomisé
- EM
- Expert en la matière
- GECSSP
- Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs
- GRADE
- « Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation »
- GT
- Groupe de travail
- HHS
- Health and Human Services ( département fédéral aux États-Unis)
- IA
- Intelligence artificielle
- IRSC
- Instituts de recherche en santé du Canada
- NHMRC
- National Health and Medical Research Council
- NICE
- National Institute for Health and Care Excellence
- OCE
- Organisme consultatif externe
- PT
- Provinces et territoires
- RCP GEC
- Réseau des Conseillers publics du Groupe d'étude canadien
- SRAP
- Stratégie de recherche axée sur le patient
- UK
- Royaume-Uni
- USPSTF
- United States Preventive Services Task Force
Résumé exécutif
En mai 2024, le ministre de la Santé a mandaté l'Agence de la santé publique du Canada afin de lancer un examen externe du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP — ci-après appelé le Groupe d'étude). Cet examen portait sur la gouvernance, le mandat et les processus méthodologiques du Groupe.
Composé de treize experts indépendants, le Comité d'examen externe (CEE — ci-après appelé le Comité) s'est vu confier le mandat de formuler des recommandations concrètes visant à renforcer la capacité du Groupe d'étude à soutenir le système de santé canadien, en faisant des soins de santé primaires le levier pour améliorer les résultats en matière de santé de la population.
Le Comité a mené une analyse ciblée, consulté un large éventail de parties prenantes et examiné des modèles internationaux ainsi que des analyses d'experts, afin d'identifier des leviers stratégiques de modernisation du Groupe d'étude. Alors que le paysage des soins de santé préventifs continue d'évoluer au Canada, le Groupe devra s'adapter pour mieux répondre aux besoins des patients, des familles et des divers professionnels de la santé en soins primaires qui les accompagnent.
Cette évolution est essentielle pour garantir que les lignes directrices demeurent rigoureuses sur le plan scientifique, inclusives, adaptables aux contextes locaux et applicables en pratique clinique.
La vision ayant guidé cet examen visait à faire en sorte que toutes les personnes au Canada — quel que soit leur lieu de résidence, leur origine, leur statut socioéconomique ou leur identité — y compris celles issues de groupes privés d'équité, tels que les communautés autochtones et noires — aient accès à des lignes directrices en matière de services de santé préventifs de grandes qualités, fondées sur les données probantes, axées sur l'équité, sensibles aux contextes, et coordonnées.
Le Groupe d'étude joue un rôle central dans la formulation de recommandations scientifiquement rigoureuses pour soutenir les soins préventifs dans les milieux de soins primaires à l'échelle du pays. Afin d'assurer une meilleure harmonisation avec les réalités actuelles des systèmes de santé et de garantir son efficacité à long terme, le présent rapport propose douze recommandations qui constituent une feuille de route claire et cohérente en matière de modernisation, de renforcement de la gouvernance et de stabilité opérationnelle. Il comprend également trois recommandations complémentaires visant à répondre à des défis systémiques plus larges et à renforcer la coordination nationale dans d'élaboration de lignes directrices en matière de santé préventive.
A. Redéfinir le mandat pour refléter le système de santé d'aujourd'hui
- Moderniser le mandat et renommer le Groupe d'étude (Recommandation 1) : L'ASPC devrait établir un mandat clair et actualisé pour le Groupe d'étude, afin de refléter son rôle évolutif dans le soutien à la prestation des services de santé préventifs. Ce mandat devrait mettre l'accent sur l'élaboration de lignes directrices inclusives, à jour, axé sur l'équité et contextualisables pour les professionnels de la santé de première ligne. Dans le cadre de ce réalignement, l'ASPC devrait envisager de renommer le groupe en Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de mieux refléter son orientation vers l'ensemble des interventions préventives offertes dans les milieux de soins primaires.
- Clarifier le rôle du Groupe d'étude dans un paysage saturé (Recommandation 2) : L'ASPC devrait mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude devrait diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices en santé préventive, et à quel moment il serait plus efficace d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité existantes. Ce processus devrait être guidé par un cadre transparent de priorisation et éclairer l'élaboration d'un plan de travail annuel définissant l'orientation stratégique du Groupe d'étude sur un horizon de trois ans. En clarifiant le rôle du Groupe d'étude au sein de l'écosystème plus large des lignes directrices au Canada, cette approche contribuera à réduire la duplication, améliorer la coordination et atténuer la fragmentation du système.
B. Renforcer les méthodes et les données probantes pour plus de rigueur et de pertinence
- Faire évoluer le cadre méthodologique du Groupe d'étude (Recommandation 3) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la modernisation du cadre méthodologique du Groupe d'étude, en s'appuyant sur l'évolution de l'approche GRADE — notamment « Core GRADE » — afin d'assurer une élaboration de lignes directrices à la fois rigoureuse et inclusive. Ce cadre devrait aussi inclure d'autres outils décisionnels adaptés à la formulation de recommandations dans des domaines où les données probantes sont limitées ou en émergence, notamment pour les populations défavorisées sur le plan de l'équité. L'ASPC devrait également appuyer le raffinement des méthodes et des stratégies de communication relatives aux interventions populationnelles appliquées en soins primaires (p. ex. le dépistage), afin d'en assurer la clarté et la pertinence pour des publics variés.
- Mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes ») (Recommandation 4) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la mise en œuvre, par le Groupe d'étude, d'une approche progressive visant à maintenir et à mettre à jour en continu les lignes directrices jugées prioritaires, en s'appuyant sur les méthodes des lignes directrices évolutives (« vivantes »). Cela comprend la surveillance continue des données probantes, l'utilisation de technologies émergentes et la collaboration avec des partenaires internationaux. L'ASPC devrait saisir les occasions de mutualiser les infrastructures de synthèse des données probantes afin d'accroître l'efficience et de réduire les dédoublements. Cette approche permettrait également aux provinces et territoires d'accéder à des données probantes communes, et de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale.
- Renforcer l'adoption des lignes directrices par des partenariats et une adaptation contextuelle (Recommandation 5) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la collaboration du Groupe d'étude avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de réunir les conditions systémiques nécessaires à la mise en œuvre efficace des lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Cela comprend une collaboration structurée avec les programmes de prestation d'interventions préventives, les conseils de la qualité et d'autres partenaires de mise en œuvre et en évaluation afin de co-développer des outils pratiques et cerner les obstacles et les facilitateurs dans divers contextes de soins.
- Chaque cycle de production de lignes directrices devrait intégrer des ressources de transfert des connaissances — telles que des aides à la décision pour les prestataires, des trousses de mise en œuvre et des résumés adaptés aux différents types d'utilisateurs — conçues pour répondre aux besoins des équipes de soins primaires et des systèmes qui les soutiennent. L'ASPC devrait également appuyer le développement de mécanismes permettant d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les retombées en coordination avec les provinces et territoires.
C. Intégrer l'équité et la voix du public dans l'élaboration des lignes directrices
- Donner la priorité à l'équité dans la sélection des sujets (Recommandation 6) : L'ASPC devrait soutenir le Groupe d'étude dans l'application de critères transparents et axés sur l'équité pour la sélection des sujets, en mettant l'accent sur les groupes privés d'équité — y compris les communautés noires et autochtones — ainsi que sur les priorités des provinces et territoires. Une approche de séquençage des sujets devrait orienter les progrès vers une couverture complète des services préventifs, tout en répondant à la couverture inégale actuelle — notamment les chevauchements dans certains domaines (p. ex. le cancer) et les lacunes de lignes directrices dans d'autres (p. ex. la santé mentale).
- L'élaboration des sujets devrait mettre en valeur les occasions d'améliorer les résultats à l'échelle du système de santé, en particulier dans les domaines qui soutiennent l'équité en santé et qui s'alignent avec les objectifs de la quadruple visée (« quadruple aim »)Note de bas de page 1.
- Mettre en place un modèle de mobilisation axé sur l'équité des patients et du public (Recommandation 7) : L'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption, par le Groupe d'étude, de mécanismes structurés et cohérents pour mobiliser les patients, les groupes communautaires — y compris les communautés noires, autochtones et autres communautés historiquement sous-représentées dans les politiques de santé et les décisions cliniques — ainsi que le public tout au long du processus d'élaboration des lignes directrices, afin que les expériences vécues, les préférences des patients et les valeurs des communautés soient véritablement prises en compte dans les recommandations finales.
D. Renforcer la gouvernance, la représentativité et l'intégration des experts
- Établir un cadre de composition et de nomination inclusif et fondé sur les compétences (Recommandation 8) : L'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption, par le Groupe d'étude, d'un cadre intégré de composition inclusive et fondé sur les compétences, ainsi qu'un processus de nomination ouvert et transparent. Ce cadre devrait définir les qualifications essentielles, les domaines d'expertise et les expériences vécues requises — en veillant à une représentation des communautés en situation d'équité compromise, ainsi que des systèmes de soins primaires, de santé publique et de santé autochtone. Il devrait également prévoir un processus public de mise en candidature, incluant des critères d'admissibilité clairs, des efforts de mobilisation ciblée, et un comité de nomination indépendant composé de membres issus de divers horizons. Ces mesures garantiront que le Groupe d'étude est en mesure de produire des lignes directrices pertinentes, équitables et adaptables aux divers systèmes de santé du Canada.
- Formaliser l'engagement des experts en la matière (EM) (Recommandation 9) : L'ASPC devrait permettre et soutenir le Groupe d'étude dans la création de rôles structurés lors de la participation des experts en la matière au sein de groupes de travail, afin qu'ils puissent contribuer à des étapes clés de l'élaboration des lignes directrices, sans compromettre l'indépendance du Groupe d'étude dans la prise de décisions. Cette approche favorisera l'intégration de l'expertise clinique des prestataires de soins primaires avec l'expertise spécialisée propre à certains domaines.
- Adopter un cadre de gestion des conflits d'intérêts (CDI) à deux niveaux (Recommandation 10) : L'ASPC devrait permettre et appuyer le Groupe d'étude dans l'adoption d'une approche à deux niveaux pour la gestion des conflits d'intérêts — en distinguant les membres votants du Groupe d'étude des participants aux groupes de travail thématiques — afin de favoriser la participation des experts en la matière (EM) transparente et proportionnée au risque, notamment dans le cadre de groupes de travail thématiques.
E. Assurer un financement stable et une infrastructure opérationnelle durable
- Assurer un financement à long terme et un soutien par un secrétariat (Recommandation 11) : Pour remplir efficacement son mandat, le Groupe d'étude a besoin d'un financement stable et pluriannuel, incluant, au besoin, une rémunération adéquate pour ses membres. L'ASPC devrait appuyer la mise en place d'un secrétariat — dédié ou partagé — afin d'assurer la continuité, l'infrastructure, ainsi qu'un soutien méthodologique et opérationnel.
F. Transition vers un modèle de gouvernance indépendant et responsable
- Reconstituer le Groupe d'étude en un organisme consultatif externe (OCE) (Recommandation 12) : L'ASPC devrait reconstituer le Groupe d'étude en tant qu'organisme consultatif externe indépendant, appuyé par une gouvernance transparente, des mécanismes structurés d'engagement avec les parties prenantes et des mécanismes décisionnels imputables.
Regarder au-delà du Groupe d'étude : possibilités d'amélioration à l'échelle du système
Au-delà du Groupe d'étude, le Comité a relevé des lacunes systémiques plus vastes qui limitent la capacité du Canada à fournir des lignes directrices destinées aux professionnels de la santé de manière coordonnée et à promouvoir des soins de santé préventifs axés sur l'équité aux niveaux clinique, communautaire et populationnel. Ces lacunes comprennent notamment : l'absence d'un organisme national chargé d'évaluer les données probantes et de formuler des recommandations sur les interventions communautaires; une coordination limitée entre les organismes de financement de la recherche, les agences de données, les conseils de la qualité et les instances responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des lignes directrices; ainsi que l'absence de cadres communs pour mobiliser des parties prenantes.
Il est également urgent de veiller à ce que les lignes directrices soient non seulement rigoureuses sur le plan scientifique, mais aussi adaptables aux structures de santé, aux besoins des populations et aux contextes de prestation propres à chaque province et territoire.
Bien que ces enjeux dépassent le mandat formel de l'examen, le Comité estime qu'ils méritent une attention particulière. Il encourage un leadership fédéral soutenu, en collaboration avec les provinces et territoires, afin d'explorer des solutions structurelles — telles que : la création d'un centre national de coordination pour les lignes directrices fondées sur des données probantes en matière de santé, la mise en place d'un groupe de travail dédié aux services préventifs communautaires, ainsi que le développement d'un réseau de coordination avec les organismes concernés — pour renforcer l'alignement et bâtir un système de lignes directrices et de soins préventifs plus inclusif et tourné vers l'avenir.
À cette fin, le Comité présente trois recommandations complémentaires :
Recommandation complémentaire A :
Établir un centre national de coordination : Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait envisager la création d'un centre national de coordination pour l'élaboration de lignes directrices — rassemblant les bailleurs de fonds, les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les responsables de la mise en œuvre, afin de renforcer l'alignement, de réduire les chevauchements et d'accélérer la traduction des données probantes en politiques et pratiques efficaces.
Ce centre devrait permettre une coordination formelle entre les structures consultatives et décisionnelles, y compris les plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, et appuyer l'intégration à l'échelle des systèmes. Il devrait également favoriser la contextualisation, en facilitant l'adaptation des lignes directrices aux contextes provinciaux et territoriaux, soutenue par une infrastructure partagée pour la production de résumés localisés des recommandations clés. Cela comprend l'harmonisation des mécanismes de financement et des leviers opérationnels afin d'ancrer une approche modernisée et adaptée à la population, pour l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices cliniques.
Recommandation complémentaire B :
Mettre sur pied un groupe d'étude sur la prévention en milieu communautaire :
Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait étudier la création d'un groupe de travail sur les services préventifs communautaires, en collaboration avec des organisations telles que les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN), afin de fournir des orientations indépendantes et fondées sur des données probantes pour la santé publique et les interventions au niveau de la communauté au-delà des soins cliniques.
Recommandation complémentaire C :
Mettre en place un réseau pour l'alignement en recherche, données et évaluation
Le gouvernement fédéral est encouragé à mettre en place un réseau visant à renforcer la coordination avec les organismes canadiens de financement de la recherche en santé, les agences de données et les conseils de la qualité.
Il devrait également permettre au Canada de participer activement à l'émergence d'une infrastructure mondiale de synthèse continue des données probantes (living evidence synthesis), offrant ainsi aux provinces et territoires un accès à une base commune de données probantes de haute qualité — leur permettant ainsi de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale plutôt que sur la duplication des processus de synthèse ou d'élaboration de lignes directrices redondantes.
En mettant ces constats en action, nous pouvons contribuer à une approche de la santé préventive plus cohérente, coordonnée et tournée vers l'avenir — une approche qui garantit à l'ensemble de la population au Canada un accès équitable à des lignes directrices à jour, fondées sur les données probantes, et qui favorisent la santé et le bien-être des communautés, aujourd'hui et pour les générations à venir.
Chapitre 1 : Introduction et contexte
1.1 Mandat du Comité d'examen externe
En mai 2024, le ministre de la Santé du Canada a demandé à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) de lancer un examen indépendant du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP — ci-après appelé le Groupe d'étude). Cet examen visait à évaluer la gouvernance, le mandat et les processus du Groupe d'étude, ainsi qu'à formuler des recommandations concrètes et réalisables sur la modernisation de son rôle et de sa structure.
L'objectif était de veiller à ce que ses lignes directrices demeurent fondées sur des données probantes, actuelles et pertinentes pour les professionnels de la santé en soins primaires. Cet effort vise à harmoniser les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs avec les besoins évolutifs des systèmes de soins de santé du Canada et à appuyer des résultats équitables en matière de santé populationnelle.
Bien que les préoccupations entourant la publication par le Groupe d'étude, en 2024, de son projet de recommandations sur le dépistage du cancer du sein aient servi de catalyseur pour l'examen, le Comité n'avait pas pour mandat d'examiner ou d'évaluer les événements ou décisions spécifiques ayant conduit à leur élaboration.
1.2 Approche
L'ASPC a nommé les membres du Comité d'examen externes (CEE) en septembre 2024, formant un comité indépendant de treize experts chargés d'évaluer la structure, la gouvernance et les méthodes scientifiques du Groupe d'étude. Le mandat complet de l'examen est présenté à l'annexe 1, tandis que les biographies des membres du Comité d'examen externe peuvent être consultées à l'annexe 2. De plus, quatre conseillers techniques ont fourni des contributions spécialisées dans des domaines clés comme la recherche médicale, la santé publique, la mobilisation des patients et l'équité en santé. Ces experts ont joué un rôle essentiel en veillant à ce que l'examen tienne compte à la fois des enjeux systémiques et des préoccupations centrées sur les patients. Les biographies des conseillers techniques figurent à l'annexe 3.
Le Comité a commencé ses travaux en octobre 2024, à l'aide d'une approche structurée qui tenait compte des évaluations antérieures du Groupe d'étude, des pratiques exemplaires nationales et internationales en matière d'élaboration de lignes directrices et des commentaires découlant des consultations. Il a terminé son mandat en publiant ce rapport.
Le Comité a consulté des experts nationaux et internationaux, incluant des professionnels de la santé, des chercheurs et des représentants des patients, afin d'intégrer un large éventail de perspectives. La liste complète des personnes consultées figure à l'annexe 4.
Le Comité a également collaboré directement avec les responsables actuels et passés du Groupe d'étude et a recueilli les commentaires du public au moyen d'un processus de consultation mixte. La collaboration comprenait des mémoires écrits et une série de tables rondes avec des particuliers, des associations de professionnels de la santé, des organisations non gouvernementales et des établissements universitaires. Elle comprenait également la mobilisation des concepteurs de lignes directrices au Canada. Une liste complète des participants est présentée à l'annexe 5, et un résumé des points de vue découlant de la consultation est présenté dans le rapport « Ce que nous avons entendu » à l'annexe 6.
Afin de comparer l'approche du Canada aux modèles internationaux et de déterminer les pratiques exemplaires qui pourraient éclairer des améliorations au système canadien, le Comité a examiné les structures de gouvernance, les pratiques de mobilisation des parties intéressées et les processus d'élaboration de lignes directrices au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. L'annexe 7 présente une analyse comparative internationale.
Afin de mettre en contexte davantage ses constatations, le Comité a également examiné des documents clés retraçant l'évolution du Groupe d'étude, ses réussites et ses défis. Les observations recueillies dans le cadre de ce processus ont éclairé la formulation des recommandations du Comité visant à renforcer le système canadien d'élaboration de lignes directrices sur les soins de santé préventifs.
Enfin, le Comité d'examen a porté une attention particulière au choix de la terminologie dans l'ensemble du rapport, reconnaissant son importance dans l'expression d'une vision modernisée du Groupe. Des termes clés — tels que « axé sur l'équité » — ont été sélectionnés pour refléter un engagement envers la clarté, la pertinence et la rigueur. Un glossaire détaillé est fourni à la fin du rapport pour assurer une compréhension partagée.
1.3 Principes directeurs pour les recommandations
Pour veiller à ce que le processus d'examen soit indépendant et transparent, le Comité a adhéré à trois principes fondamentaux visant à maintenir la confiance du public et à renforcer l'intégrité de l'examen :
Indépendance : L'examen a été effectué sans influence externe, pression politique ou conflits d'intérêts, assurant que les conclusions et recommandations reposent uniquement sur des données probantes. Le Comité remercie le soutien fourni par le personnel du Secrétariat de l'ASPC; une relation sans lien de dépendance a été maintenue tout au long de ce processus. Le Comité a tenu des discussions à huis clos au besoin pour appuyer les délibérations indépendantes. Le Comité assume l'entière responsabilité du contenu de ce rapport.
Transparence et responsabilité : Une attention particulière a été donnée à la transparence et à la responsabilisation à chaque étape du processus d'examen. Le Comité a discuté régulièrement de son mandat, de sa méthodologie et de son approche en matière de prise de décisions par consensus. Afin d'appuyer la transparence, des résumés de réunion ont été publiés afin d'informer le public des sujets examinés et des points discutés.
Inclusion et équité : Afin de renforcer la confiance du public dans le processus d'élaboration des lignes directrices, le Comité a mobilisé un large éventail d'intervenants, y compris les professionnels de la santé, les chercheurs, les représentants des patients, du public, ainsi que des experts en méthodologie. Cette approche a permis de tenir compte d'une diversité de points de vue tout au long de l'examen, renforçant ainsi la crédibilité et l'équité du processus.
En respectant ces principes, le Comité a cherché à établir un processus solide, digne de confiance et à poser les bases d'un système d'élaboration de lignes directrices sur les soins préventifs plus inclusif, réactif et transparent au Canada.
1.4 Structure du rapport
Le présent rapport est structuré de manière à fournir un examen complet du Groupe d'étude, en décrivant les constats, les recommandations et une vision prospective.
Le chapitre 2 présente les principales conclusions de l'examen. Il analyse le mandat, la gouvernance et la structure du Groupe d'étude, tout en identifiant les forces et les points à améliorer. Il examine également comment le Groupe d'étude s'inscrit dans le paysage plus large des soins de santé au Canada, et met en lumière des leviers pour accroître son alignement et son impact.
Le chapitre 3 propose des considérations stratégiques pour l'avenir. Il s'appuie sur les constats tirés des consultations et des délibérations du Comité pour proposer des pistes de modernisation à l'échelle du système, notamment en élargissant la portée des lignes directrices aux dimensions communautaires, publiques et populationnelles de la santé.
La conclusion résume les messages clés et insiste sur l'importance d'adopter une approche plus inclusive, transparente et réactive dans l'élaboration de lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada.
Chapitre 2 : Principales constatations
Ce chapitre présente les principales constatations de l'examen concernant l'élaboration de lignes directrices en matière de médecine préventive clinique, en mettant en évidence tant les points forts de l'approche actuelle que les aspects à améliorer. Il propose une synthèse des points de vue recueillis lors des consultations menées auprès des parties prenantes, des analyses d'experts et des comparaisons internationales, tout en identifiant des possibilités d'amélioration en matière de gouvernance, d'inclusivité, de transparence et de réactivité. Ces constatations soulignent la nécessité de moderniser les processus et servent de fondement aux recommandations du Comité.
2.1 Redéfinition du mandat et des priorités stratégiques
Depuis sa création en 1976 à titre de Groupe d'étude canadien sur l'examen médical périodique, le Groupe d'étude a joué un rôle essentiel dans la définition de l'approche canadienne en matière de soins préventifs. Initialement centré sur les bilans de santé réguliers, il a évolué pour appuyer des services de prévention ciblés et fondés sur des données probantes dans les milieux de soins primaires. Il est reconnu à l'échelle internationale pour ses contributions et a servi de modèle à d'autres organismes dans diverses juridictions.
Au cours des années 1980, le Groupe d'étude a élaboré des lignes directrices sur le dépistage préventif chez les personnes en bonne santé, mettant l'accent sur l'importance d'approches fondées sur la population. Ces travaux ont contribué à poser les bases de programmes aujourd'hui bien établis de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du cancer colorectal dans les provinces et territoires.
Bien qu'il ait été dissous en 2005 à la suite d'une décision de la Conférence des sous-ministres de la Santé, le Groupe d'étude a été rétabli en 2009 avec l'appui de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Depuis, il a élaboré des lignes directrices cliniques à l'intention des professionnels des soins primaires, avec un accent particulier sur les médecins de famille.
Le Groupe d'étude constitue depuis longtemps une source fiable de recommandations fondées sur des données probantes, destinées à orienter les professionnels des soins primaires, en particulier les médecins de famille, dans la prestation de soins préventifs. Toutefois, à mesure que la structure de prestation des soins primaires et l'organisation des services préventifs évoluent, le mandat du Groupe d'étude doit lui aussi évoluer, afin de demeurer inclusif, transparent et adapté à l'ensemble des prestataires de soins primaires, aux mécanismes de mise en œuvre provinciaux et territoriaux, ainsi qu'à la diversité des besoins des populations.
S'adapter au paysage changeant des soins primaires
Le paysage des soins primaires au Canada évolue, passant d'un modèle centré sur les médecins à un modèle plus interdisciplinaire de soins en équipe, où les infirmiers praticiens, les pharmaciens et d'autres professionnels des soins de santé primaires jouent un rôle croissant dans la prestation de services préventifs. Parallèlement, le système passe d'un modèle dans lequel les médecins et leurs équipes géraient de manière autonome tous les services préventifs à un modèle où ils s'appuient de plus en plus, avec leurs patients, sur les programmes provinciaux.
Malgré cette évolution, les recommandations du Groupe d'étude demeurent largement perçues comme étant centrées sur les médecins, ce qui limite leur accessibilité et leur applicabilité à l'ensemble des effectifs œuvrant en soins primaires.
Au-delà des soins primaires, les recommandations du Groupe d'étude influencent fréquemment les programmes de santé publique et de santé des populations, y compris les initiatives provinciales de dépistage. Bien qu'élaborées pour éclairer la pratique clinique, ces lignes directrices ont une portée bien plus large : elles contribuent à orienter les politiques de santé publique et la prestation des services à l'échelle populationnelle. Cela souligne l'importance d'assurer leur pertinence non seulement pour les professionnels des soins primaires, mais aussi leur alignement efficace avec les programmes de santé publique afin d'optimiser leur portée et leur efficacité.
La prestation des services préventifs continue d'évoluer alors que les provinces et territoires élargissent leurs programmes de dépistage du cancer et élaborent des lignes directrices adaptées pour les soutenir. Pour assurer la cohérence, l'élaboration de lignes directrices cliniques doit être coordonnée avec les programmes provinciaux et territoriaux responsables de leur mise en œuvre.
Afin d'accroître son impact, un Groupe d'étude modernisé doit intégrer explicitement les perspectives d'un éventail plus large de professionnels des soins primaires et veiller à ce que ses lignes directrices soient inclusives, pertinentes, contextualisables et adaptées aux réalités opérationnelles des divers milieux de soins, notamment ceux fondés sur des modèles de soins collaboratifs. En reformulant ses recommandations comme des « lignes directrices sur les services de santé préventifs à l'intention des professionnels des soins primaires », on renforcerait leur application pratique dans des contextes cliniques et organisationnels variés.
Bien que les médecins de famille continuent de jouer un rôle central dans la prestation des services préventifs, d'autres parties prenantes clés — notamment la santé publique, d'autres professionnels de soins de santé primaires, ainsi que les responsables des programmes provinciaux et territoriaux de dépistage et les conseils de la qualité — pourraient également bénéficier d'outils et ressources de transfert de connaissances et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre, de façon cohérente, des recommandations fondées sur des données probantes. Intégrer une capacité d'adaptation contextuelle dans le cycle d'élaboration des lignes directrices contribuerait également à garantir que celles-ci demeurent pertinentes dans un environnement de soins en constante évolution.
Par ailleurs, un nombre important de personnes au Canada n'ont pas un accès régulier aux soins primaires, qu'il s'agisse de médecins ou d'autres professionnels de la santé. Les lignes directrices doivent donc être conçues pour être flexibles et adaptables, en tenant compte des différentes modalités d'accès selon les juridictions — et rester pertinentes même dans des contextes de soins non traditionnels. Leur mise en œuvre doit envisager la manière dont certaines populations accèdent à des services préventifs par l'entremise d'autres points de contact, tels que les cliniques sans rendez-vous ou les services d'urgence, tout en reconnaissant que certaines personnes n'ont pas recours aux services de santé.
Le Comité a entendu des préoccupations selon lesquelles les médecins ayant une expertise dans le diagnostic et la prise en charge de maladies particulières ne sont pas toujours intégrés de façon systématique aux travaux du Groupe d'étude. Certaines parties prenantes ont suggéré que les lignes directrices portant sur des maladies spécifiques devraient être dirigées par des experts du domaine concerné. Le Comité reconnaît qu'une mobilisation accrue des experts en la matière est souhaitable afin de tirer parti de leur expertise scientifique et clinique. Toutefois, l'élaboration de lignes directrices préventives à l'intention de personnes en bonne santé exige une expertise distincte, axée sur la santé des populations. Les médecins en soins primaires et en santé publique ont une formation unique pour travailler avec des individus, des collectivités et des populations en bonne santé. Leur expertise et leur leadership demeurent donc essentiels dans l'élaboration de lignes directrices sur les services de santé préventifs.
De même, l'expérience vécue par les personnes atteintes d'une maladie particulière est précieuse pour le développement de lignes directrices cliniques et d'outils propres à la maladie, notamment en ce qui concerne les traitements. En revanche, l'élaboration de lignes directrices destinées à des personnes en bonne santé doit également tenir compte du point de vue de celles qui ne sont pas atteintes de la maladie, ainsi que de celles ayant vécu des effets indésirables liés à des interventions préventives — tels que de faux positifs, un surdiagnostic, un surtraitement ou une détresse psychologique.
Comme le Groupe d'étude fonctionne de manière indépendante des systèmes de soins provinciaux et territoriaux, son rôle est d'éclairer — et non de mettre en œuvre — les décisions stratégiques prises aux échelons provinciaux et territoriaux. Toutefois, l'absence d'un mécanisme structuré de liaison entrave l'alignement entre les différents ordres de gouvernement. L'établissement d'un tel mécanisme est essentiel pour améliorer la coordination et renforcer la cohérence des politiques en matière de soins préventifs.
Naviguer dans un paysage de soins de santé préventifs fragmentés
Le paysage canadien de l'élaboration des lignes directrices est devenu de plus en plus complexe et fragmenté. Les organismes de santé provinciaux et territoriaux, les associations professionnelles, les sociétés savantes et le secteur privé publient, de façon indépendante, leurs propres recommandations en matière de soins préventifs et de santé publique. La figure 1 illustre la croissance rapide du nombre de lignes directrices produites chaque année par différentes organisations — une tendance qui est probablement sous-estimée(SPOR Evidence Alliance, 2025).
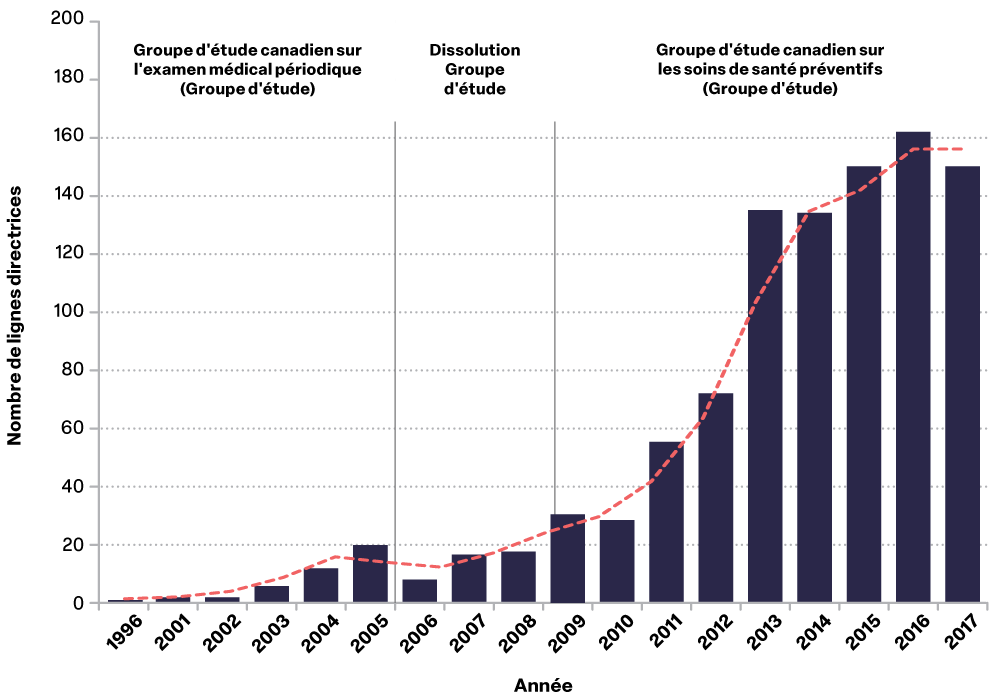
Figure 1 : Équivalent textuel
La figure 1 montre combien de lignes directrices nationales en santé préventive ont été publiées chaque année au Canada, entre 1996 et 2017. Ces lignes directrices proviennent de plusieurs organisations, y compris le Groupe d'étude, et la figure est divisée en trois périodes, selon les changements dans le fonctionnement du Groupe d'étude.
Période 1 (1996 à 2005) :
Pendant cette période, le Groupe d'étude canadien sur l'examen périodique de l'état de santé était actif. Il a participé à l'élaboration de lignes directrices nationales. Le nombre de lignes directrices publiées était encore faible, mais augmentait peu à peu. Par exemple, en 1996, une seule ligne directrice a été publiée, contre 12 en 2004 et 20 en 2005.
| Lignes directrices publiées au Canada | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Période 2 (2005 à 2008) :
Le Groupe d'étude a été mis sur pause pendant ces années. Malgré cela, d'autres organisations ont continué à produire des lignes directrices, mais à un rythme plus lent. Entre 2005 et 2008, le nombre de lignes directrices publiées chaque année variait entre 8 et 18.
| Lignes directrices publiées au Canada | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 8 | 17 | 18 |
Période 3 (2009 à 2017) :
Le Groupe d'étude a été relancé en 2009. À partir de ce moment, le nombre de lignes directrices publiées chaque année a beaucoup augmenté. On est passé de 31 lignes directrices en 2009 à un sommet de 164 en 2016. En 2017, 152 lignes directrices ont été publiées — bien plus que dans les années précédentes.
| Lignes directrices publiées au Canada | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 29 | 56 | 73 | 137 | 136 | 152 | 164 | 152 |
Cette fragmentation entraîne des chevauchements, une incohérence dans la production des lignes directrices et, parfois, des recommandations contradictoires. Cela engendre de l'incertitude tant pour les professionnels des soins primaires que pour les patients et le grand public. De plus, l'élaboration de lignes directrices peut, à l'occasion, être influencée par des facteurs externes, comme l'évolution des priorités de recherche, des pressions liées à la représentation d'intérêts ou la disponibilité de financements ciblés.
Comme le montre la figure 2, des efforts considérables sont consacrés à la production de lignes directrices sur le cancer. Cela peut contribuer à des déséquilibres, laissant apparaître des lacunes dans des domaines comme la santé mentale ou la prévention des maladies chroniques.

Figure 2: Équivalent textuel
La figure 2 montre combien de lignes directrices nationales en santé préventive ont été publiées au Canada, par domaine, pour les années 2015, 2016 et 2017. Le total pour chaque domaine est aussi indiqué.
- Le cancer est le domaine où le plus grand nombre de lignes directrices ont été publiées, avec 127 au total : 42 en 2015, 47 en 2016 et 38 en 2017.
- La santé du cœur et des poumons vient ensuite, avec 51 lignes directrices publiées de façon assez régulière.
- La santé mentale, les neurosciences et les dépendances comptent 37 lignes directrices, surtout en 2015 et 2016.
- La santé des femmes et les questions liées au genre regroupent 33 lignes directrices, dont 19 en 2015 seulement.
- Les infections et le système immunitaire sont le sujet de 29 lignes directrices, réparties assez également sur les trois années.
- La nutrition, le métabolisme et le diabète comptent 25 lignes directrices, avec une nette hausse en 2017.
- La santé des os et des articulations (comme l'arthrite) est abordée dans 6 lignes directrices, surtout en 2015 et 2016.
- La santé publique et la prévention pour toute la population comptent 3 lignes directrices, soit une par année.
- La santé des peuples autochtones comprend aussi 3 lignes directrices, toutes publiées en 2016 et 2017.
Ce tableau montre que, même si plusieurs domaines sont couverts, une grande partie des efforts porte surtout sur le cancer et certaines maladies chroniques. D'autres sujets importants en prévention reçoivent moins d'attention.
Pour remédier à cette couverture inégale et à cette fragmentation, il serait pertinent d'établir un groupe d'étude approprié au sein d'un mécanisme fédéral-provincial territorial afin de soutenir la collaboration pancanadienne dans l'élaboration de lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Ce groupe pourrait contribuer à clarifier et à coordonner le rôle du Groupe d'étude, notamment en ce qui concerne les cas où il devrait diriger, adopter ou adapter des lignes directrices relevant de son mandat.
La mise en place d'un mécanisme structuré de partage et d'harmonisation des recommandations avec d'autres entités — y compris les programmes provinciaux et territoriaux — permettrait d'assurer une approche plus cohérente, d'améliorer l'alignement et de réduire les redondances. Une telle collaboration poserait aussi les bases nécessaires pour tirer parti de l'infrastructure mondiale émergente en matière de synthèse évolutive des données probantes, et pour adapter ou adopter des lignes directrices internationales de grande qualité.
Le Groupe d'étude devrait accorder la priorité à la réduction des lacunes en matière de services préventifs, plutôt qu'à l'élaboration de recommandations dans des domaines où des lignes directrices rigoureuses existent déjà à l'échelle provinciale, territoriale ou nationale. L'établissement d'un processus clair pour déterminer à quel moment il convient de diriger, d'adopter ou d'adapter des lignes directrices permettrait de réduire les chevauchements, de favoriser l'harmonisation et d'optimiser sa contribution au système dans son ensemble.
Dans les domaines où des processus bien établis existent — comme les programmes de dépistage du cancer — le Groupe d'étude devrait réévaluer son rôle et se concentrer sur les secteurs dans lesquels il apporte une valeur ajoutée significative. Cette approche permettrait de renforcer la cohérence des recommandations et de maximiser leur impact. L'objectif ultime est de garantir la disponibilité de lignes directrices fondées sur des données probantes pour l'ensemble des interventions préventives tout au long de la vie.
Au cours du processus de consultation, plusieurs parties prenantes ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention aux déterminants de la santé en amont et à l'orientation vers la prévention primordiale. Le Comité estime qu'un Groupe d'étude modernisé devrait conserver un mandat clairement ciblé sur les services de santé préventifs à l'intention des professionnels des soins primaires, afin que ses recommandations demeurent claires, ciblées et directement applicables à la pratique clinique en première ligne.
Comme le détaille le chapitre 3, le Comité recommande que l'ASPC explore des options pour combler les lacunes identifiées en matière de prévention primordiale — notamment une coordination accrue avec les Centres de collaboration nationale en santé publique, ou la mise sur pied d'un groupe d'étude communautaire distinctNote de bas de page 2.
Faire fonctionner les lignes directrices : le besoin d'orientations préventives contextualisables
Compte tenu des défis et des possibilités recensés, le Comité considère qu'un Groupe d'étude modernisé doit adopter une approche qui ne soit pas seulement fondée sur les données probantes, mais aussi opérationnellement pertinente dans le contexte des divers systèmes de santé du pays.
Pour être efficaces, les lignes directrices en santé préventive doivent être conçues comme contextualisables — c'est-à-dire adaptables aux réalités locales tout en conservant leur rigueur scientifique. Cela suppose une harmonisation avec les structures organisationnelles, les ressources disponibles, les caractéristiques des populations et les environnements politiques propres à chaque province et territoire. Sans cette capacité d'adaptation, même les recommandations les plus rigoureuses risquent d'être sous-utilisées, mal interprétées ou difficilement intégrées à la pratique locale.
À l'heure actuelle, les recommandations du Groupe d'étude sont généralement publiées sous forme d'orientations générales, avec peu de soutien pour leur adaptation locale. Cette approche transfère la responsabilité de la contextualisation aux provinces, territoires et professionnels de la santé locaux, qui doivent souvent réinterpréter ou réélaborer les lignes directrices pour les adapter à leur réalité. Ce processus engendre des duplications d'efforts, un gaspillage de ressources, ralentit l'adoption, et augmente le risque de désalignement avec les programmes ou priorités provinciaux et territoriaux.
L'intégration d'une capacité de contextualisation dans le processus d'élaboration permettrait de surmonter plusieurs de ces obstacles. Les systèmes de santé provinciaux et territoriaux pourraient ainsi adapter les recommandations en fonction de leur infrastructure, de leurs priorités, de leurs effectifs et des besoins de leurs populations. Les professionnels de la première ligne — qu'ils exercent en milieu urbain ou rural — pourraient appliquer les lignes directrices de manière cohérente avec leur réalité opérationnelle.
La contextualisation est également un levier important pour la réduction des inégalités en santé. Elle permet une adaptation ciblée aux besoins des populations marginalisées ou mal desservies, dont l'accès aux soins est influencé par les déterminants sociaux de la santé, des obstacles géographiques ou des inégalités systémiques. En renforçant l'alignement avec les priorités locales, elle soutient une approche plus inclusive, équitable et percutante de la santé des populations.
Cependant, le Groupe d'étude ne dispose actuellement pas de la capacité nécessaire pour produire régulièrement des résumés contextualisés ou des outils concrets de soutien à la mise en œuvre. Une clarification du rôle en amont — déterminer s'il s'agit de développer une nouvelle ligne directrice ou d'adapter une source existante — permettrait de cibler plus efficacement les efforts de contextualisation.
À court terme, la mesure la plus stratégique consisterait à impliquer directement les provinces et territoires dans le processus d'élaboration, afin que leurs modèles de prestation, leurs systèmes et leurs priorités soient pris en compte dès le départ. Cela pourrait se faire par une collaboration structurée avec les programmes provinciaux de dépistage, les réseaux professionnels et les organismes responsables de la mise en œuvre.
À plus long terme, la création d'un centre national de coordination, telle que proposée au chapitre 3, représente une occasion d'investir dans l'infrastructure nécessaire à une contextualisation systématique. Un tel centre pourrait appuyer un processus de priorisation récurrent, permettant de déterminer si le Groupe d'étude doit diriger le développement d'une nouvelle ligne directrice ou plutôt adopter ou adapter du contenu existant. Il pourrait également faciliter le partage d'information, la valorisation des résultats de synthèses évolutives en libre accès, ainsi que la diffusion d'outils pratiques que les provinces et territoires pourraient utiliser pour adapter rapidement leurs lignes directrices.
Cette approche permettrait au Groupe d'étude de rester concentré sur la rigueur scientifique, tout en renforçant la capacité des partenaires locaux à traduire les recommandations en actions concrètes, et en favorisant les échanges avec des partenaires internationaux pour partager les travaux réalisés et adaptés.
En définitive, intégrer la contextualisation dans le mandat du Groupe d'étude renforcera la clarté, l'utilisabilité et la portée des lignes directrices — en veillant à ce qu'elles soient fondées sur les meilleures données probantes disponibles, tout en étant adaptées aux contextes locaux et mises en œuvre de manière équitable à l'échelle du pays.
Recommandation 1 : Moderniser le mandat et renommer le Groupe d'étude — L'ASPC devrait établir un mandat clair et actualisé pour le Groupe d'étude, afin de refléter son rôle évolutif dans le soutien à la prestation des services de santé préventifs. Ce mandat devrait mettre l'accent sur l'élaboration de lignes directrices inclusives, à jour, axé sur l'équité et contextualisables pour les professionnels de la santé de première ligne. Dans le cadre de ce réalignement, l'ASPC devrait envisager de renommer le groupe en Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de mieux refléter son orientation vers l'ensemble des interventions préventives offertes dans les milieux de soins primaires.
Pour soutenir un Groupe d'étude modernisé et tourné vers l'avenir, l'ASPC devrait revoir son mandat afin de définir clairement son rôle dans le renforcement des services de santé préventifs, par l'élaboration de lignes directrices à jour, inclusives et axées sur l'équité.
Ce mandat renouvelé devrait aller au-delà d'une simple consultation des parties prenantes clés, en intégrant des mécanismes formalisés d'alignement avec les processus consultatifs et décisionnels provinciaux et territoriaux — notamment les programmes de dépistage — ainsi qu'avec les plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, tels que les conseils de la qualité.
Dans cette optique, l'ASPC devrait envisager de renommer le Groupe d'étude en tant que Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de refléter l'ensemble de son champ d'action.
Ces changements devraient être officialisés par la publication d'un mandat révisé, d'une nouvelle lettre de mandat, ainsi que par des mises à jour correspondantes aux structures de gouvernance, aux attentes en matière de rendement et des ententes de financement.
L'ASPC devrait également coordonner l'élaboration d'un plan de travail annuel présentant les priorités du Groupe d'étude sur un horizon de planification standard de trois ans, ajusté annuellement. Ce plan de travail devrait être communiqué aux comités provinciaux et territoriaux concernés, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes clés, afin de soutenir la coordination, la planification et la priorisation des travaux à l'échelle pancanadienne.
Recommandation 2 : Clarifier le rôle du Groupe d'étude dans un paysage saturé — L'ASPC devrait mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude devrait diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices en santé préventive, et à quel moment il serait plus efficace d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité existantes. Ce processus devrait être guidé par un cadre transparent de priorisation et éclairer l'élaboration d'un plan de travail annuel définissant l'orientation stratégique du Groupe d'étude sur un horizon de trois ans. En clarifiant le rôle du Groupe d'étude au sein de l'écosystème plus large des lignes directrices au Canada, cette approche contribuera à réduire la duplication, améliorer la coordination et atténuer la fragmentation du système.
Pour assurer une coordination optimale et réduire la duplication, l'ASPC devrait mettre en œuvre un processus structuré et récurrent pour clarifier le rôle le plus approprié du Groupe d'étude — qu'il s'agisse de diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices sur des sujets émergents ou d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité déjà existantes. Ce processus devrait s'appuyer sur un cadre méthodologique transparent de priorisation des sujets, élaboré conjointement avec les principales parties prenantes (y compris les provinces et territoires), et tenant compte des besoins de la population, des lignes directrices existantes élaborées à d'autres échelons, ainsi que des ressources disponibles. Une fois établi, il devrait être appliqué de façon uniforme au début de chaque cycle de planification et intégré aux mécanismes de production de rapports et de responsabilisation du Groupe d'étude afin d'appuyer l'harmonisation, l'efficience et la valeur à l'échelle du système.
Résumé : Moderniser le mandat du Groupe d'étude
La modernisation du mandat du Groupe d'étude est essentielle pour assurer sa pertinence et son efficacité continues dans un système de santé en évolution rapide. Les recommandations 1 et 2 préconisent un mandat recentré qui définit clairement le rôle du Groupe d'étude dans la prestation de conseils inclusifs, fondés sur des données probantes, et axés sur l'équité et contextualisables en matière de services de soins de santé préventifs à tous les professionnels de la santé en soins primaires. Il s'agit notamment de renommer le Groupe d'étude afin qu'il reflète mieux son orientation et ses responsabilités élargies.
Afin de promouvoir l'harmonisation et de réduire la duplication au sein de l'écosystème des lignes directrices du Canada, l'ASPC devrait également mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude doit élaborer de nouvelles recommandations, adopter des lignes directrices existantes de grande qualité provenant d'autres sources, ou en adapter le contenu. Ce processus devrait s'appuyer sur un cadre méthodologique transparent de priorisation des activités, fondé sur les lacunes dans les données probantes, les besoins de la population et les considérations liées aux ressources. L'intégration de l'adaptabilité contextuelle comme principe directeur de conception contribuera par ailleurs à faire en sorte que les recommandations puissent être véritablement adaptées aux différentes juridictions — facilitant ainsi leur mise en œuvre et améliorant l'équité. Ensemble, ces mesures permettront de clarifier l'orientation stratégique du Groupe d'étude, de renforcer sa valeur à l'échelle des juridictions, et de favoriser une approche plus coordonnée, pertinente et efficiente des lignes directrices en matière de soins préventifs.
2.2 Renforcer les données probantes, les approches méthodologiques et la pertinence des lignes directrices
Dans un système de santé en évolution rapide, il est essentiel de moderniser l'approche méthodologique du Groupe d'étude. Les attentes envers les lignes directrices sur les soins de santé préventifs sont plus élevées : elles doivent non seulement s'appuyer sur les meilleures données probantes disponibles, mais aussi être pertinentes dans divers contextes cliniques, adaptables aux structures des systèmes de santé (et idéalement appuyés par celles-ci), sensibles aux iniquités en santé, et représentatives de diverses formes d'expériences vécues. Pour améliorer leur inclusivité, leur applicabilité et leur impact, il est nécessaire de repenser la manière dont les données probantes sont définies, évaluées et utilisées.
Moderniser et diversifier les approches méthodologiques
L'élaboration de lignes directrices rigoureuses en matière de services de santé préventifs exige une méthodologie solide, appuyée par un processus structuré d'examen des données et de formulation des recommandations conçues pour être contextualisées dans une diversité de milieux réels.
La méthode GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) constitue depuis longtemps la pierre angulaire de l'approche du Groupe d'étude. Sa structure transparente a largement contribué à la crédibilité scientifique des recommandations. Toutefois, dans un contexte où les interventions sont de plus en plus interdisciplinaires, ancrées dans les communautés et axées sur l'équité, une dépendance excessive à GRADE peut devenir limitative.
Le Groupe d'étude devrait faire évoluer son cadre méthodologique en s'appuyant sur les développements récents de GRADE — notamment GRADE Core, qui offre une base plus souple pour pondérer différents types de données selon le type d'intervention (Iorio, 2024). Ce cadre devrait être complété par des outils décisionnels complémentaires, particulièrement utiles lorsque les données sont limitées ou émergentes — notamment pour les populations historiquement désavantagées.
Bien que les tableaux « Evidence to Decision » (EtD) soient généralement publiés, certaines parties prenantes ont exprimé des préoccupations sur la subjectivité entourant l'interprétation des critères, surtout en l'absence d'une revue exhaustive des données. Des inquiétudes subsistent également quant à la pondération des critères utilisée pour établir les seuils de recommandation, notamment dans le domaine du dépistage du cancer.
Le Groupe devrait envisager l'intégration de cadres complémentaires permettant de rendre plus explicite et transparente la logique sous-jacente aux recommandations. Ces outils ne visent pas à remplacer GRADE, mais à en renforcer l'application — particulièrement dans les cas où les jugements de valeur doivent être clarifiés, où la mise en œuvre varie selon les juridictions, ou encore lorsque l'équité a historiquement été négligée.
Parallèlement, les méthodes et les communications devraient être raffinées afin de bien distinguer les interventions en soins primaires ciblant les individus des interventions à visée populationnelle (comme le dépistage) qui sont appliquées en contexte clinique. Cette distinction est essentielle pour garantir que les recommandations soient interprétées et appliquées de manière appropriée, tant dans les milieux cliniques qu'à l'échelle des systèmes de santé.
Une approche plus inclusive et pluraliste — fondée sur des critères d'évaluation transparents et axés sur l'équité, et appuyée par une méthodologie clarifiée — permettrait de renforcer les bases scientifiques des recommandations et de favoriser des résultats de santé plus équitables à l'échelle nationale.
Recommandation 3 : Faire évoluer le cadre méthodologique du Groupe d'étude
L'ASPC devrait permettre et appuyer la modernisation du cadre méthodologique du Groupe d'étude, en s'appuyant sur l'évolution de l'approche GRADE — notamment « Core GRADE » — afin d'assurer une élaboration de lignes directrices à la fois rigoureuse et inclusive. Ce cadre devrait être complété par d'autres outils décisionnels adaptés à la formulation de recommandations dans des domaines où les données probantes sont limitées ou en émergence, notamment pour les populations défavorisées sur le plan de l'équité. L'ASPC devrait également appuyer le raffinement des méthodes et des stratégies de communication relatives aux interventions populationnelles appliquées en soins primaires (p. ex. le dépistage), afin d'en assurer la clarté et la pertinence pour des publics variés.
Il convient de souligner que GRADE est en constante évolution. Core GRADE, en particulier, vise à harmoniser des recommandations parfois contradictoires, et offre un socle actualisé pour une utilisation flexible des données probantes.
Les interventions préventives ciblent souvent des personnes en bonne santé. L'évaluation des bénéfices et des risques y est donc plus complexe que dans des contextes de diagnostic ou de traitement. Cette complexité exige la prise en compte d'un éventail plus large de données probantes, incluant les études observationnelles, la modélisation économique et la recherche qualitative.
Transition vers un modèle de lignes directrices vivantes
Pour assurer la pertinence continue des lignes directrices, le Groupe d'étude devrait adopter graduellement un modèle « vivant » qui permet la mise à jour continue des recommandations à mesure que de nouvelles données probantes émergent.
La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance d'actualiser rapidement les recommandations et a mis en lumière la valeur de la synthèse en temps réel et de la collaboration internationale.
Compte tenu de la complexité d'une telle transition, le Comité recommande une mise en œuvre progressive. Celle-ci pourrait débuter avec un nombre limité de sujets prioritaires, en adoptant une approche hybride : adapter des lignes directrices internationales fiables lorsque c'est possible, tout en développant des recommandations spécifiques au contexte canadien lorsque nécessaire.
La collaboration internationale jouera un rôle clé. Des initiatives comme « l'Evidence Synthesis Infrastructure Collaborative et l'Alliance for Living Evidence on Anxiety, Depression, and Psychosis » démontrent le potentiel de plateformes partagées pour produire des synthèses en temps réel, réduire les coûts et élargir l'accès aux données probantes de qualité. Le Groupe d'étude pourrait à la fois contribuer à ces efforts et en tirer parti.
L'ASPC devrait aussi explorer l'utilisation accrue d'outils numériques prometteurs (p. ex. : surveillance automatisée de la littérature, IA appliquée à la synthèse), actuellement à l'étape de projet pilote. Ces outils peuvent accélérer les mises à jour, réduire la charge de travail et améliorer l'efficience. Des projets pilotes ciblés pourraient permettre d'en évaluer la faisabilité, l'utilisabilité et les effets sur l'équité.
La réussite de cette transition repose sur des investissements ciblés, une infrastructure robuste, du personnel spécialisé et un engagement clair envers l'équité d'accès et d'application.
Recommandation 4 : Mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes »)
L'ASPC devrait permettre et appuyer la mise en œuvre, par le Groupe d'étude, d'une approche progressive visant à maintenir et à mettre à jour en continu les lignes directrices jugées prioritaires, en s'appuyant sur les méthodes des lignes directrices évolutives (« vivantes »). Cela comprend la surveillance continue des données probantes, l'utilisation de technologies émergentes et la collaboration avec des partenaires internationaux. L'ASPC devrait saisir les occasions de mutualiser les infrastructures de synthèse des données probantes afin d'accroître l'efficience et de réduire les dédoublements. Cette approche permettrait également aux provinces et territoires d'accéder à des données probantes communes, et de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale.
L'ASPC devrait appuyer le Groupe d'étude dans la mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes »), en commençant par une approche graduelle axée sur des sujets hautement prioritaires, afin que les lignes directrices demeurent à jour, pertinentes et adaptées aux nouvelles données probantes. Ce processus devrait comprendre la détermination des zones de référence appropriées, l'établissement de mécanismes continus de surveillance des données probantes et l'application de protocoles de réévaluation continue. L'ASPC devrait également mettre à l'échelle les outils numériques établis et émergents qui en sont actuellement aux étapes pilotes au sein de l'Agence, et fournir l'infrastructure opérationnelle et le personnel nécessaires pour une mise en œuvre durable. Les partenariats avec des organisations internationales et des méthodologistes expérimentés dans les modèles de lignes directrices évolutives peuvent accélérer le renforcement des capacités et assurer l'harmonisation avec les pratiques exemplaires mondiales. Cette transition progressive devrait ultimement permettre l'élargissement de lignes directrices évolutives dans le champ complet des services préventifs, en veillant à ce que les recommandations soient à la fois actualisées et adaptées à la diversité des systèmes de santé du Canada.
Soutenir l'adoption équitable de lignes directrices en santé préventive
Pour veiller à ce que les lignes directrices sur les services de soins de santé préventifs soient non seulement fondées sur des données probantes, mais aussi mises en œuvre efficacement dans les divers milieux de soins de santé du Canada, le Groupe d'étude devrait renforcer sa capacité d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les répercussions sur l'équité. À l'heure actuelle, le Groupe d'étude n'a guère la capacité d'évaluer comment ses recommandations sont appliquées dans la pratique ou d'appuyer une mise en œuvre adaptative. En l'absence de tels mécanismes, des renseignements précieux sont oubliés et des lacunes dans la prestation équitable des services pourraient persister.
À cette fin, le Groupe d'étude devrait établir un cadre de soutien à la mise en œuvre et d'évaluation des répercussions dans le cadre de son processus d'élaboration des lignes directrices. Ce cadre devrait comprendre une consultation structurée avec des organisations — tels que les programmes de dépistage, les conseils de la qualité (là où ils existent) et les organisations responsables de la prestation de services préventifs — afin d'identifier les facilitateurs et les obstacles concrets, de favoriser l'harmonisation avec les ressources locales et de soutenir une planification de mise en œuvre à l'échelle du système.
Cette évolution ne nécessite pas la création de nouvelles structures, mais repose plutôt sur le renforcement de l'alignement et des partenariats avec les acteurs de la mise en œuvre déjà en place et bien positionnés pour jouer ce rôle — comme les programmes de dépistage, les conseils de la qualité et les initiatives liées aux dossiers médicaux électroniques.
Chaque cycle de production de lignes directrices devrait inclure des outils de transfert des connaissances codéveloppés, tels que des aides à la décision destinées aux prestataires, des résumés adaptés à différents types d'utilisateurs, et des trousses de mise en œuvre conçues pour les professionnels de soins primaires et les programmes de santé publique.
Dans le cadre de cette démarche, une attention particulière devrait être portée à l'amélioration de la clarté et de l'accessibilité des communications entourant les risques et les avantages associés aux recommandations du Groupe d'étude, afin que tant les prestataires que le public soient en mesure de prendre des décisions éclairées.
Recommandation 5 : Renforcer l'adoption des lignes directrices par des partenariats et une adaptation contextuelle
L'ASPC devrait permettre et appuyer la collaboration du Groupe d'étude avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de réunir les conditions systémiques nécessaires à la mise en œuvre efficace des lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Cela comprend une collaboration structurée avec les programmes de prestation d'interventions préventives, les conseils de la qualité et d'autres partenaires de mise en œuvre et en évaluation afin de co-développer des outils pratiques et cerner les obstacles et les facilitateurs dans divers contextes de soins. Chaque cycle de production de lignes directrices devrait intégrer des ressources de transfert des connaissances — telles que des aides à la décision pour les prestataires, des trousses de mise en œuvre et des résumés adaptés aux différents types d'utilisateurs — conçues pour répondre aux besoins des équipes de soins primaires et des systèmes qui les soutiennent. L'ASPC devrait également appuyer le développement de mécanismes permettant d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les retombées en coordination avec les provinces et territoires.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur le comportement individuel des cliniciens, cette approche met l'accent sur la collaboration avec les acteurs du système de santé afin d'adapter et de renforcer les programmes, les politiques et les infrastructures opérationnelles — en veillant à ce que les recommandations du Groupe d'étude soient non seulement fondées sur les données probantes, mais aussi réalisables en pratique. En favorisant une collaboration continue avec les partenaires provinciaux et territoriaux responsables de la mise en œuvre, le Groupe d'étude pourra réduire l'écart entre les données probantes et l'action, et ainsi soutenir une adoption plus cohérente des recommandations en santé préventive.
Résumé : Modernisation de la synthèse et de l'examen des données probantes
Pour maintenir la pertinence, l'équité et l'impact de ses recommandations, le Groupe d'étude doit moderniser son approche méthodologique. Pour ce faire, il faut élargir de façon réfléchie les types d'éléments de preuve pris en compte, intégrer des cadres complémentaires avec la méthode GRADE et accroître la transparence dans les processus décisionnels. L'adoption d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes ») facilitera les mises à jour continues fondées sur des données probantes émergentes, augmentant la réactivité et la pertinence. L'ASPC peut appuyer cette évolution par des investissements stratégiques dans les outils numériques, la collaboration internationale et une stratégie de mise en œuvre progressive. Le renforcement des cadres de mise en œuvre et d'évaluation des répercussions permettra d'optimiser davantage les applications des lignes directrices et les services publics dans l'ensemble des contextes de soins de santé. Le renforcement de l'engagement auprès des partenaires provinciaux et territoriaux responsables de la mise en œuvre contribuera à faire en sorte que les recommandations du Groupe d'étude soient non seulement fondées sur les données probantes, mais également réalisables en pratique, favorisant ainsi une adoption cohérente et réduisant l'écart entre les données probantes et leur application concrète.
2.3 Intégration de l'équité : vers des lignes directrices inclusives
L'intégration systématique de l'équité dans toutes les étapes du processus d'élaboration des lignes directrices est essentielle pour garantir que les recommandations en matière de soins de santé préventifs soient pertinentes, réalisables et inclusives pour l'ensemble de la population canadienne. Bien que le Groupe d'étude s'appuie sur une base méthodologique rigoureuse, les considérations relatives à l'équité ne sont pas encore pleinement intégrées, de la sélection des sujets à la mobilisation des parties prenantes, en passant par l'examen des données probantes et la planification de la mise en œuvre. Sans une approche structurée et délibérée, les lignes directrices risquent de reproduire involontairement les inégalités existantes, en négligeant les besoins spécifiques et les expériences vécues des communautés autochtones, noires, rurales, et d'autres groupes désavantagés sur le plan de l'équité.
Par ailleurs, en l'absence de critères explicites et sensibles à l'équité pour orienter la priorisation, les enjeux de santé qui touchent de manière disproportionnée les groupes privés d'équité risquent de demeurer sous-représentés dans les travaux du Groupe d'étude. Renforcer l'intégration de l'équité dans l'élaboration des recommandations contribuera à en accroître la pertinence, la crédibilité scientifique et les retombées concrètes, tout en favorisant des résultats de santé plus équitables à l'échelle nationale.
Accroître la transparence dans le choix des sujets
Adopter une approche transparente et centrée sur l'équité dans le choix des sujets constitue une première étape déterminante. Pour s'assurer que les lignes directrices répondent aux priorités de santé les plus pressantes — notamment celles qui concernent les populations confrontées à des obstacles systémiques — le Groupe d'étude doit clarifier et uniformiser son processus de sélection.
Plusieurs parties prenantes ont soulevé un manque de transparence dans la priorisation des sujets et l'absence de critères clairs intégrant les dimensions d'équité. Certaines ont exprimé ne pas comprendre comment les sujets sont choisis ni dans quelle mesure les besoins de la population, les impacts sur l'équité ou les considérations systémiques sont pris en compte.
Des enjeux majeurs comme la prévention des maladies chroniques ou le dépistage en santé mentale — qui touchent de manière disproportionnée les populations marginalisées — n'ont pas toujours reçu l'attention nécessaire dans le processus actuel (Georgiades, 2021; Price et coll., 2013). Cela risque de perpétuer les inégalités que les lignes directrices visent précisément à réduire.
Pour établir la confiance, assurer la réceptivité et renforcer la responsabilisation, le Groupe d'étude devrait adopter un cadre structuré et public pour la sélection des sujets, intégrant explicitement des critères liés à l'équité. Ce cadre devrait inclure, entre autres, le fardeau de la maladie, la pertinence pour les soins primaires, les lacunes dans la couverture actuelle, et l'impact potentiel sur les inégalités. Il devrait également être élaboré en concertation avec les partenaires provinciaux et territoriaux et s'appuyer sur l'expertise et les perspectives d'un large éventail d'acteurs.
L'intégration de l'équité dans la sélection des sujets ne relève pas uniquement de la justice sociale — elle est indispensable pour garantir que les futures lignes directrices ciblent les besoins prioritaires, soient mises en œuvre de manière effective, et contribuent à améliorer l'équité et la performance du système de santé.
Recommandation 6 : Donner la priorité à l'équité dans la sélection des sujets
L'ASPC devrait appuyer le Groupe d'étude dans l'application de critères transparents et axés sur l'équité pour la sélection des sujets, en mettant l'accent sur les groupes privés d'équité — y compris les communautés noires et autochtones — ainsi que sur les priorités des provinces et territoires. Une approche de séquençage des sujets devrait orienter les progrès vers une couverture complète des services préventifs, tout en répondant à la couverture inégale actuelle — notamment les chevauchements dans certains domaines (p. ex. le cancer) et les lacunes de lignes directrices dans d'autres (p. ex. la santé mentale).L'élaboration des sujets devrait mettre en valeur les occasions d'améliorer les résultats à l'échelle du système de santé, en particulier dans les domaines qui soutiennent l'équité en santé et qui s'alignent avec les objectifs de la quadruple visée (« quadruple aim »)Note de bas de page 1.
Pour renforcer l'équité dans l'élaboration des lignes directrices, l'ASPC devrait permettre et appuyer le Groupe d'étude dans l'adoption d'une approche transparente et axée sur l'équité pour la sélection des sujets — une approche qui accorde explicitement la priorité aux groupes privés d'équité et qui s'harmonise avec les priorités des programmes provinciaux et territoriaux. Ce cadre devrait comprendre des critères publiés pour l'établissement des priorités, y compris le fardeau de la maladie au sein de la population, l'accès aux services et les résultats de santé associés à ces services.
L'ASPC devrait appuyer la mise en place de mécanismes de mobilisation réguliers, comme des conseils provenant de communautés privées d'équité, de partenaires autochtones et de fournisseurs de soins primaires de première ligne, ainsi que les bureaux de l'équité au sein des programmes provinciaux et des conseils de la qualité — pour cerner les enjeux émergents et valider la pertinence du sujet. En outre, l'ASPC devrait permettre et appuyer les cycles de révision continue pour réévaluer les priorités à la lumière des tendances changeantes de la santé de la population et des commentaires du système. Ces attentes devraient être officialisées dans la lettre de mandat du Groupe d'étude et appuyées par des ressources dédiées à la coordination, aux consultations et aux rapports transparents sur les décisions de sélection.
Intégrer les perspectives des patients et du public pour des lignes directrices plus inclusives
Les lignes directrices en matière de services préventifs doivent tenir compte des expériences vécues, des valeurs et du contexte culturel des personnes qu'elles visent à servir. À l'heure actuelle, la participation des patients et du public au processus d'élaboration des lignes directrices du Groupe d'étude est limitée. Cette lacune représente des occasions manquées de cerner les obstacles à l'accès, la faisabilité dans des contextes réels et d'intégrer divers points de vue sur le risque, les avantages et l'acceptabilité des soins, ainsi que l'acceptabilité et la faisabilité des soins.
Une mobilisation systématique et axée sur l'équité auprès des patients et les communautés, en particulier ceux qui ont toujours été sous-représentés dans la politique de santé et la prise de décisions cliniques, renforcerait la légitimité, l'équité et l'acceptation des recommandations. Elle améliorerait également la pertinence des lignes directrices dans divers contextes sociaux, culturels et géographiques.
Des exemples internationaux, comme le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni et le National Health and Medical Research Council (NHMRC) de l'Australie, démontrent la valeur d'une participation significative par des mécanismes tels que des groupes consultatifs publics, des consultations ciblées incluant des sondages, des groupes de discussion, et des jurys de citoyens. Ces approches améliorent non seulement la transparence et la confiance, mais aussi l'applicabilité pratique des recommandations.
Le Groupe d'étude devrait adopter un modèle semblable, en intégrant les points de vue des patients et du public à toutes les étapes de son travail, du choix des sujets et l'interprétation des données probantes jusqu'à la formulation des lignes directrices et la planification de la mise en œuvre. À l'appui de cet objectif, l'ASPC pourrait également envisager la création d'une infrastructure de mobilisation des organismes d'élaboration de lignes directrices transversale (p. ex. un réseau partagé de comités consultatifs publics et de patients) pour appuyer l'uniformité, l'efficience et l'inclusivité dans l'ensemble des organismes d'orientation fédéraux.
Recommandation 7 : Mettre en place un modèle de mobilisation axé sur l'équité des patients et du public
L'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption, par le Groupe d'étude, de mécanismes structurés et cohérents pour mobiliser les patients, les groupes communautaires -y compris les communautés noires, autochtones et autres communautés historiquement sous-représentées dans les politiques de santé et les décisions cliniques — ainsi que le public tout au long du processus d'élaboration des lignes directrices, afin que les expériences vécues, les préférences des patients et les valeurs des communautés soient véritablement prises en compte dans les recommandations finales.
Afin d'intégrer l'expérience vécue et les perspectives communautaires dans l'orientation sur les services préventifs, l'ASPC devrait permettre au Groupe d'étude de mettre en œuvre une stratégie officielle de mobilisation des patients et du public axée sur l'équité. Cela devrait comprendre la création de comités consultatifs permanents, des possibilités structurées de commentaires à chaque étape de l'élaboration des lignes directrices et des rapports transparents sur la façon dont les commentaires ont été pris en compte. Les processus de mobilisation devraient accorder la priorité à l'inclusion des personnes provenant de collectivités mal desservies et privées d'équité. L'ASPC devrait également envisager la mise en place d'une infrastructure partagée, comme un répertoire national ou des services de soutien à la mobilisation, afin d'améliorer l'uniformité et l'efficience dans les organismes fédéraux d'orientation en matière de santé. Des ressources dédiées devraient être allouées au renforcement des capacités afin de soutenir une participation significative, accessible et soutenue.
L'équité doit constituer un principe directeur dans l'élaboration des lignes directrices sur les services préventifs — depuis la sélection des sujets jusqu'à la mise en œuvre. Une telle approche inclusive, transparente, et adaptable, permettra de s'assurer que les lignes directrices servent l'ensemble de la population canadienne de manière juste et efficace. Avec un appui stratégique soutenu, des ressources adéquates et une volonté d'innovation, le Groupe d'étude peut établir une nouvelle norme en matière de lignes directrices équitables au Canada.
Résumé : Intégration de l'équité : vers des lignes directrices inclusives
Pour garantir que les lignes directrices sur les soins de santé préventifs soient pertinentes, inclusives et applicables à l'ensemble de la population canadienne, l'intégration de l'équité doit être au cœur de chaque étape du travail du Groupe d'étude. Les recommandations 6 et 7 fournissent une feuille de route pour réaliser cet engagement, du choix de sujets axés sur l'équité à la mobilisation inclusive des patients et du public. Ces réformes renforceront la capacité du Groupe d'étude à s'attaquer aux disparités en matière de santé et feront en sorte que les orientations reflètent les expériences vécues et les priorités des groupes privées d'équité. Ensemble, elles renforcent l'importance d'élaborer des recommandations sur les services de soins de santé préventifs qui sont non seulement rigoureuses sur le plan scientifique, mais également équitables, pratiques et harmonisées avec les besoins des personnes les plus souvent laissées pour compte.
2.4 Renforcer la gouvernance pour des lignes directrices inclusives et contextualisables
Un cadre de gouvernance robuste et transparent est essentiel pour assurer la viabilité à long terme, la crédibilité et l'efficacité opérationnelle du Groupe d'étude. Il est également nécessaire de soutenir l'élaboration de lignes directrices qui soient à la fois méthodologiquement rigoureuses et adaptables à la diversité des contextes opérationnels à travers le Canada. Des réformes ciblées peuvent améliorer sa capacité de répondre aux défis changeants en matière de soins de santé tout en préservant la confiance du public. La section présente les principaux changements visant à renforcer le Groupe d'étude, en commençant par l'élargissement de son effectif afin d'y intégrer une expertise diversifiée permettant d'enrichir l'élaboration des lignes directrices grâce à un éventail plus large de perspectives. Elle explore également l'équilibre entre une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts et l'inclusivité, en veillant à ce que diverses perspectives puissent être intégrées sans compromettre l'impartialité. L'obtention d'un financement stable et suffisant est considérée comme essentielle au maintien des activités du Groupe d'étude et au soutien des activités à forte intensité de ressources, comme une plus grande mobilisation et une meilleure synthèse des données probantes.
Collectivement, les améliorations proposées jettent les bases d'une recommandation fondamentale, à savoir que l'ASPC rétablit le Groupe d'étude en tant qu'un organisme consultatif externe doté d'une structure organisationnelle remaniée. S'appuyant sur le cadre établi d'autres organismes consultatifs externes, tels que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), ces réformes ont pour objectif de renforcer la prise de décision, d'améliorer la transparence et de garantir que l'élaboration des lignes directrices prenne en compte à la fois l'expertise de pointe et l'expérience vécue par les différentes populations partout au Canada.
Renforcer la diversité des membres grâce à une sélection inclusive et à un processus de nomination transparent
Pour que les lignes directrices en matière de services de santé préventifs soient pertinentes, crédibles et applicables dans la diversité des contextes canadiens, la composition du Groupe d'étude doit refléter un équilibre entre expertise, expériences vécues et perspectives systémiques. Cela suppose une représentation de diverses professions, juridictions et communautés — en particulier celles confrontées à des obstacles systémiques à l'accès équitable aux soins.
Veiller à ce que les membres du Groupe d'étude reflètent une diversité de milieux de prestation des soins — y compris des représentants de juridictions ayant des structures de programme particulières ou des défis d'accès — renforcera également la capacité du Groupe d'étude à formuler des recommandations contextualisables, pouvant être adaptées de manière significative par les provinces, les territoires et les divers groupes de prestataires de soins.
Les commentaires recueillis lors de la consultation ont soulevé des préoccupations au sujet du manque de clarté du processus de sélection actuel, certains détenteurs d'intérêts percevant une surreprésentation de certaines disciplines et une sous-représentation dans des domaines essentiels comme l'équité en santé, l'expérience vécue et la mise en œuvre. Le renforcement de l'inclusivité et de la transparence du processus d'adhésion et de mise en candidature est essentiel au maintien de la crédibilité, de l'indépendance et du lien du Groupe d'étude avec les réalités du terrain.
L'ASPC devrait permettre et soutenir l'élaboration d'un cadre transparent et fondé sur les compétences pour la composition du Groupe d'étude, jumelé à un processus de nomination révisé et inclusif. Ce cadre devrait définir l'ensemble des qualifications et des perspectives disciplinaires requises — notamment en soins primaires, en santé autochtone, en santé des personnes noires, en santé publique, ainsi que l'expérience vécue en tant que patient ou proche aidant.
Il devrait désigner des rôles spécifiques pour les médecins de famille en milieux rural et urbain, les infirmières praticiennes, les leaders autochtones en santé, les professionnels de la santé publique, les partenaires citoyens et les personnes ayant une expérience vécue, y compris celles issues de communautés en situation d'équité compromise. Le cadre devrait également inclure une expertise disciplinaire en épidémiologie, en sciences comportementales et sociales, en matière d'équité en santé, en santé publique et en transfert des connaissances, ainsi qu'une expertise méthodologique en matière de synthèses évolutives de données probantes et de lignes directrices évolutives (« vivantes »).
À partir de ce cadre, l'ASPC devrait lancer des appels de candidatures ouverts et transparents, accompagnés d'une stratégie de mobilisation ciblée auprès d'organismes professionnels, académiques et communautaires afin d'identifier des candidats issus de milieux diversifiés (Agence de la santé publique du Canada, 2022a)Note de bas de page 3. Un comité permanent de nomination — indépendant de la composition du Groupe d'étude — devrait être mis sur pied pour évaluer les candidatures en fonction de la matrice de compétences et formuler des recommandations. Les sélections finales devraient être approuvées par l'administratrice en chef de la santé publique afin d'assurer la reddition de comptes et de maintenir la confiance du public dans le processus.
Ces mesures permettront de s'assurer que le Groupe d'étude dispose de l'expertise nécessaire pour élaborer des lignes directrices inclusives, axées sur l'équité et sensibles au contexte, qui reflètent les besoins des diverses communautés et des systèmes de santé à travers le Canada.
Recommandation 8 : Établir un cadre de composition et de nomination inclusif et fondé sur les compétences
L'ASPC devrait permettre et soutenir l'adoption, par le Groupe d'étude, d'un cadre intégré de composition inclusif et fondé sur les compétences, ainsi qu'un processus de nomination ouvert et transparent. Ce cadre devrait définir les qualifications essentielles, les domaines d'expertise et les expériences vécues requises — en veillant à une représentation des communautés en situation d'équité compromise, ainsi que des systèmes de soins primaires, de santé publique et de santé autochtone. Il devrait également prévoir un processus public de mise en candidature, incluant des critères d'admissibilité clairs, des efforts de mobilisation ciblée, et un comité de nomination indépendant composé de membres issus de divers horizons. Ces mesures garantiront que le Groupe d'étude est en mesure de produire des lignes directrices pertinentes, équitables et adaptables aux divers systèmes de santé du Canada.
Pour veiller à ce que le Groupe d'étude reflète l'expertise et la diversité nécessaires pour guider une orientation équitable en matière de santé préventive fondée sur des données probantes, l'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption d'un cadre transparent et axé sur les compétences pour le choix des membres. Ce cadre devrait définir l'éventail complet des compétences, des expériences vécues et des perspectives disciplinaires requises comme les soins primaires, la santé autochtone, l'équité en santé, la santé publique, la science du comportement et l'expérience vécue en tant que patient ou soignant. L'ASPC devrait appuyer les efforts visant à accroître la représentation des personnes appartenant à des groupes privés d'équité et sous-représentés, y compris les Autochtones, les Noirs et d'autres communautés racisées, en intégrant ces attentes dans la lettre de mandat et les mesures du rendement du Groupe d'étude. L'officialisation de ce cadre permettra de garantir que le Groupe d'étude soit bien équipé pour élaborer des lignes directrices inclusives, pertinentes et adaptées aux différentes réalités du système de santé.
Amélioration de l'orientation grâce à la mobilisation ciblée des EM
Tout en maintenant une base de membres votants possédant les compétences clés mentionnées ci-dessus — afin de garantir que les lignes directrices sur les services préventifs demeurent pertinentes sur les plans pratique, clinique et programmatique — le Groupe d'étude devrait élargir sa portée multidisciplinaire en mobilisant officiellement, à titre non-votant, des experts en la matière (EM) au sein de ses groupes de travail. Ces experts peuvent inclure des spécialistes médicaux et des cliniciens dont l'expertise sur certaines maladies est essentielle pour interpréter les données probantes émergentes et contextualiser les recommandations à l'échelle de la population, ainsi que des experts universitaires ou des personnes possédant une connaissance approfondie des besoins de certaines communautés.
Afin de tirer pleinement parti de cette expertise, le Groupe d'étude devrait mettre en place un mécanisme structuré et thématique de mobilisation des EM, permettant une contribution consultative à des étapes clairement définies dans le processus d'élaboration des lignes directrices — notamment lors de l'interprétation des données probantes et de l'examen des recommandations préliminaires. Leur apport est particulièrement précieux pour cerner les facteurs contextuels — tels que la capacité du système, les modèles de prestation ou les caractéristiques de la population — qui peuvent influencer l'interprétation et la mise en œuvre des recommandations en pratique. Les experts devraient être mobilisés selon les besoins, ligne directrice par ligne directrice, par l'intermédiaire de groupes de travail dédiés. Ce modèle de participation ciblée et à durée limitée permettra de garantir que les lignes directrices s'appuient sur une expertise technique approfondie, tout en préservant l'indépendance et la rigueur méthodologique du Groupe d'étude.
Le pouvoir décisionnel doit demeurer uniquement entre les mains des membres votants principaux. La participation des EM devrait être guidée par des protocoles clairs qui définissent les rôles, les échéanciers, les critères de participation et les attentes en matière de transparence, de documentation et de divulgation publique. Afin de maintenir l'impartialité et de renforcer la confiance du public, un cadre modernisé sur les conflits d'intérêts (dont il est question dans la section suivante) devrait être appliqué uniformément à tous les EM contributeurs.
Ensemble, ces mesures permettront au Groupe d'étude de tirer parti d'une expertise spécialisée tout en préservant son indépendance, sa crédibilité et sa capacité à produire des directives impartiales et fondées sur des données probantes en matière de soins de santé préventifs.
Recommandation 9 : Formaliser l'engagement des experts en la matière (EM)
L'ASPC devrait permettre et soutenir le Groupe d'étude dans la création de rôles structurés lors de la participation des experts en la matière au sein de groupes de travail, afin qu'ils puissent contribuer à des étapes clés de l'élaboration des lignes directrices, sans compromettre l'indépendance du Groupe d'étude dans la prise de décisions. Cette approche favorisera l'intégration de l'expertise clinique des prestataires de soins primaires avec l'expertise spécialisée propre à certains domaines.
Afin de renforcer la qualité scientifique et la pertinence de ses lignes directrices, l'ASPC devrait permettre au Groupe d'étude d'établir un processus structuré pour faire appel à des experts en la matière (EM) et appuyer ce dernier à titre consultatif et sans droit de vote à des moments précis du processus d'élaboration des lignes directrices, en particulier pendant l'examen des données probantes et la formulation de recommandations provisoires. L'engagement des EM devrait être organisé sujet par sujet, ce qui permettrait au Groupe d'étude d'accéder à une expertise pertinente sans compromettre son impartialité ou son intégrité dans la prise de décisions. Ce processus devrait être régi par des protocoles transparents qui décrivent les rôles, les échéanciers et les critères de participation, et tous les intrants devraient être adéquatement documentés. L'ASPC devrait intégrer cette exigence dans la lettre de mandat du Groupe d'étude et veiller à produire des rapports réguliers sur les activités de mobilisation des EM. Cette approche rehaussera la crédibilité, la profondeur et l'exactitude contextuelle du contenu des lignes directrices tout en préservant l'indépendance scientifique et la confiance du public.
Équilibrer la gestion des conflits d'intérêts et l'inclusion
La politique rigoureuse du Groupe d'étude sur les conflits d'intérêts a été une pierre angulaire de sa crédibilité et de son indépendance. Cependant, des préoccupations ont été soulevées quant au fait que des règles trop rigides en matière de conflits d'intérêts pourraient exclure involontairement et sans discernement une expertise précieuse, particulièrement dans la communauté d'experts relativement petite du Canada. À mesure que le paysage des soins de santé préventifs devient de plus en plus complexe, une approche plus pragmatique et structurée est nécessaire pour équilibrer l'indépendance avec le besoin de connaissances spécialisées.
Pour moderniser son cadre de conflits d'intérêts tout en préservant la confiance du public, le Groupe d'étude devrait adopter un modèle à deux niveaux, semblable à celui utilisé par le United States Preventive Services Task Force (USPSTF) et le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Ce modèle distingue deux niveaux de responsabilité : il impose des règles strictes de conflits d'intérêts pour les membres votants principaux, tout en permettant à un nombre limité de conseillers sans droit de vote, dont les conflits sont divulgués et gérés, de participer à certaines étapes de l'élaboration des lignes directrices. Il offre la souplesse nécessaire pour accéder à une expertise approfondie tout en préservant l'intégrité des recommandations finales.
En vertu de ce cadre de ce modèle, les normes en matière de conflits d'intérêts (COI) applicables aux membres votants demeureront rigoureuses. Les membres ne doivent pas avoir d'intérêts financiers significatifs, tels que le financement de la recherche ou des revenus de consultation ni d'autres liens financiers susceptibles d'influencer leur jugement. De plus, leurs conflits d'intérêts intellectuels ou non financiers doivent être minimaux, entièrement divulgués et gérés de manière proactive. Cela garantirait que la prise de décision finale demeure transparente, fondée sur des données probantes et exempte d'influence indue.
En revanche, les conseillers sans droit de vote, comme les spécialistes de la médecine ou les experts universitaires, pourraient être sollicités par le biais de groupes d'étude spécialisés, à condition que leur nombre soit limité et contrôlé, et que les conflits d'intérêts divulgués et gérés soient autorisés dans une proportion restreinte. Ces personnes ne participeraient pas à la prise de décision finale, mais fourniraient néanmoins des renseignements essentiels lors de l'évaluation des données probantes ou de la rédaction des recommandations.
Ce modèle reflète les pratiques exemplaires actuelles en matière de gouvernance des comités consultatifs externes, ce qui permet au Groupe d'étude d'accéder à une expertise pertinente sans compromettre l'indépendance. Comme on l'a vu dans l'approche utilisée par le CCNI, des mesures de protection telles que la divulgation publique des déclarations sur les conflits d'intérêts et la documentation transparente des processus des groupes d'étude renforceront davantage la responsabilisation et renforceront la confiance du public.
En adoptant un cadre à deux niveaux pour les conflits d'intérêts, l'ASPC et le Groupe d'étude peuvent améliorer la qualité et la légitimité de l'élaboration des lignes directrices, en veillant à ce que les recommandations soient non seulement fondées sur le plan scientifique, mais aussi éclairées par l'expertise nécessaire dans les services de santé préventifs.
Recommandation 10 : Adopter un cadre de gestion des conflits d'intérêts (CDI) à deux niveaux
L'ASPC devrait permettre et appuyer le Groupe d'étude dans l'adoption, d'une approche à deux niveaux pour la gestion des conflits d'intérêts — en distinguant les membres votants du Groupe d'étude des participants aux groupes de travail thématiques — afin de favoriser une participation transparente et proportionnée au risque des experts en la matière (EM), notamment dans le cadre de groupes de travail thématiques.
Ce cadre devrait établir des distinctions claires entre les conflits d'intérêts (CI) financiers, intellectuels et non financiers. Il devrait également inclure un mécanisme de divulgation publique des CI afin de renforcer la transparence et la confiance des parties prenantes. L'ASPC devrait officialiser cette exigence dans la lettre de mandat du Groupe d'étude et en assurer le suivi par des rapports périodiques. Cette approche permettra de préserver la crédibilité du Groupe d'étude tout en élargissant l'accès à une expertise essentielle.
En conclusion, l'ensemble de ces réformes garantira que les processus d'adhésion, de mise en candidature et de consultation du Groupe d'étude sont inclusifs, transparents et conformes aux réalités complexes des soins de santé préventifs partout au Canada.
L'intégration de ces points de vue à la gouvernance et à la structure du Groupe d'étude renforcera sa capacité de s'attaquer aux disparités systémiques et de promouvoir un service de soins préventifs équitable pour l'ensemble de la population canadienne.
2.5 Garantir la viabilité et l'indépendance du Groupe d'étude à long terme
Un modèle de financement prévisible et durable est essentiel pour assurer la viabilité à long terme, l'efficacité opérationnelle et la crédibilité du Groupe d'étude. À l'heure actuelle, un financement incohérent et irrégulier limite la capacité du Groupe à mettre à jour ses lignes directrices en temps opportun, à soutenir une participation inclusive — notamment celle des membres non rémunérés à plein temps, comme les partenaires citoyens et les cliniciens rémunérés à l'acte — et à mobiliser de manière significative les principaux détenteurs d'intérêts. Cette situation nuit à la confiance du public et compromet le succès de la mise en œuvre.
Une comparaison internationale révèle que le Groupe d'étude fonctionne avec des ressources beaucoup plus limitées et moins stables que celles d'autres organismes semblables, qui bénéficient d'une infrastructure robuste et d'une plus grande capacité d'élaboration de lignes directrices axées sur l'équité et produites à un volume élevé.
Actuellement, le Groupe d'étude est financé au moyen d'une entente de contribution entre l'ASPC et l'établissement auquel est affilié un membre actuel ou ancien du Groupe d'étude, habituellement le président. Cet établissement agit comme bénéficiaire principal des fonds et gère les contrats de sous-traitance conclus avec d'autres fournisseurs de services pour appuyer les activités du Groupe d'étude. Bien que ce modèle offre une certaine souplesse, il comporte également des limites, en particulier lors des transitions de leadership qui nécessitent la renégociation des ententes avec l'établissement hôte. De tels facteurs imposent des fardeaux administratifs et peuvent restreindre la capacité du Groupe d'étude à réagir efficacement à l'évolution des priorités.
Afin d'assurer la production continue de lignes directrices en santé préventive à jour, crédibles et fondées sur des données probantes — qui tiennent compte des besoins des divers systèmes de santé du Canada — un financement stable et un soutien institutionnel accrus sont indispensables. La mise en place d'un modèle de financement pluriannuel restructuré, assorti d'une rémunération appropriée pour les membres non-salariés et d'un soutien méthodologique et opérationnel intégré, renforcerait la capacité du Groupe d'étude à s'acquitter efficacement de son mandat national.
Recommandation 11 : Assurer un financement à long terme et un soutien par un secrétariat
Pour remplir efficacement son mandat, le Groupe d'étude a besoin d'un financement stable et pluriannuel, incluant, au besoin, une rémunération adéquate pour ses membres. L'ASPC devrait appuyer la mise en place d'un secrétariat — dédié ou partagé — afin d'assurer la continuité, l'infrastructure, ainsi qu'un soutien méthodologique et opérationnel.
Pour remplir son mandat et maintenir la confiance du public, le Groupe d'étude a besoin d'un modèle de financement pluriannuel stable, soutenu par un secrétariat spécialisé. L'ASPC devrait établir un mécanisme de financement structuré, semblable à celui utilisé par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Ce mécanisme garantirait un financement opérationnel sûr et indexé, ainsi qu'une rémunération appropriée pour les membres non-salariés, y compris les partenaires patients et les cliniciens communautaires. Ce modèle devrait également inclure l'intégration d'un secrétariat permanent au sein de l'ASPC — qu'il soit dédié au Groupe d'étude ou partagé — pour assurer la coordination, l'infrastructure et la continuité administrative.
Une entente officielle devrait par ailleurs préciser les attentes en matière de rendement et les exigences de reddition de comptes, afin de garantir la transparence et la responsabilisation. La mise en place de cette structure de financement permettrait au Groupe d'étude de continuer à fournir des conseils en matière de soins de santé préventifs à jour, crédibles et indépendants, adaptés à l'évolution des systèmes de santé du Canada.
Établissement du Groupe d'étude en tant qu'un organisme consultatif externe (OCE)
Une structure de gouvernance modernisée et clairement définie est essentielle pour renforcer la crédibilité, la transparence et les retombées à long terme du Groupe d'étude en tant que chef de file dans l'élaboration des lignes directrices. Pour remédier aux inefficacités structurelles, comme le manque de clarté dans la répartition des rôles et des responsabilités entre les diverses directions générales du Groupe d'étude, les fardeaux administratifs et les préoccupations au sujet de l'indépendance, il faut un modèle de gouvernance amélioré qui équilibre la stabilité avec la souplesse opérationnelle.
Optimisation de la structure pour une plus grande efficacité
La structure de gouvernance actuelle du Groupe d'étude a fait l'objet d'un examen continu, et des préoccupations ont été soulevées quant à sa capacité à appuyer efficacement son mandat. Les commentaires des membres actuels et anciens, ainsi que les consultations menées auprès des parties prenantes, ont mis en évidence des possibilités d'accroître la transparence, de renforcer la responsabilisation et de clarifier la relation entre le Groupe d'étude et l'ASPC. Des préoccupations semblables avaient déjà été relevées lors d'évaluations antérieures, lesquelles soulignaient le manque de clarté dans le partage des responsabilités entre le Groupe d'étude, ses centres d'analyse et de synthèse des données probantes (CASDP) et l'ASPC (Agence de la santé publique du Canada, 2022b). Ces défis limitent ultimement la capacité du Groupe d'étude à fonctionner de manière claire, indépendante et efficace.
Renforcement de l'indépendance et des mécanismes de gouvernance
Il est essentiel d'assurer l'indépendance du Groupe d'étude vis-à-vis de toute influence politique afin de préserver sa crédibilité. Au cours des consultations menées par le Comité, les parties prenantes ont insisté sur l'importance de garantir que ses recommandations fondées sur des données probantes soient exemptes de toute pression externe, y compris de la perception d'une influence indue. Bien que certains aient proposé de rattacher le Groupe d'étude à une institution non gouvernementale, comme une association professionnelle, une telle approche risquerait de simplement déplacer le problème plutôt que de le résoudre. Une solution plus durable consisterait à renforcer les mesures de protection et les mécanismes de gouvernance afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et la transparence du Groupe d'étude, quel que soit son lieu d'ancrage institutionnel.
Améliorer la transparence et l'accessibilité
La transparence est un catalyseur essentiel de la confiance du public et des professionnels. De nombreux détenteurs d'intérêts ont souligné que certains processus décisionnels clés demeurent opaques, notamment en ce qui concerne la sélection des sujets et la synthèse des données probantes. Bien que les principaux éléments des méthodes et processus du Groupe d'étude soient décrits dans son Manuel des méthodes (Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, 2023), les parties prenantes ont exprimé le besoin d'une plus grande clarté, y compris la publication des procès-verbaux des réunions, la communication des justifications entourant certaines décisions, ainsi qu'un accès simplifié à l'information de base et aux documents pertinents. Il a également été souligné que l'accessibilité des documents est essentielle pour favoriser une mobilisation équitable, notamment en assurant leur disponibilité dans les deux langues officielles.
Alléger le fardeau administratif
Les problèmes de gouvernance sont exacerbés par des ressources limitées et des inefficacités opérationnelles. Les membres bénévoles doivent composer avec des fardeaux administratifs persistants, ce qui détourne leur temps et leur énergie de leur fonction principale : l'élaboration de lignes directrices de grande qualité. La coordination entre le Groupe d'étude, ses centres d'analyse et de synthèse des données probantes (CASDP) et l'ASPC manque souvent de cohésion. Les évaluations précédentes (Agence de la santé publique du Canada, 2022b) ainsi que les commentaires recueillis lors des consultations ont également fait ressortir la nécessité d'une rémunération équitable pour les membres non-salariés, en particulier pour les représentants des patients et de la collectivité. Ces constats soulignent la nécessité non seulement d'un soutien financier accru, mais aussi de réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance, clarifier les rôles et rationaliser les activités.
Pour relever ces défis, le Comité recommande la transition du Groupe d'étude vers un organisme consultatif externe (OCE)Note de bas de page 4, semblable au modèle du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Cette approche permettrait de préserver le soutien fédéral tout en renforçant l'indépendance du Groupe d'étude et en réduisant les pressions administratives grâce à une structure de gouvernance clairement définie, un secrétariat permanent et une responsabilisation publique accrue. Bien que ce modèle puisse limiter dans une certaine mesure la souplesse des processus administratifs, il offre néanmoins d'importants avantages, notamment une plus grande stabilité, une meilleure coordination et un renforcement de la confiance du public. Le succès de cette transition dépendra de la transparence des principaux processus de gouvernance, notamment en ce qui concerne la sélection des membres et les décisions liées aux lignes directrices.
Remanier la structure organisationnelle
Pour réaliser ce nouveau modèle de gouvernance, l'organisme consultatif externe (qui prend la relève du Groupe d'étude) devrait adopter un cadre organisationnel à plusieurs niveaux, conçu pour intégrer une expertise diversifiée ainsi que des expériences vécues. À la base, un groupe de membres superviserait l'élaboration des recommandations, appuyé par un secrétariat permanent chargé de fournir une capacité administrative, scientifique et de communication.
Ce groupe serait conseillé par un comité consultatif permanent sur l'équité, composé d'experts en équité en santé, en lutte contre le racisme, en pratiques décoloniales et en systèmes de savoirs autochtones. Ce niveau structurel contribuerait également à faire en sorte que les lignes directrices produites par l'organisme consultatif externe (anciennement le Groupe d'étude) soient mieux adaptées aux contextes sociaux, culturels et juridictionnels dans lesquels elles seront mises en œuvre, renforçant ainsi l'objectif de formuler des recommandations pertinentes et applicables.
L'actuel Réseau de mobilisation des patients du Groupe d'étude canadien (RMP GEC) devrait être maintenu et intégré officiellement à la nouvelle structure, afin de garantir que les points de vue des patients, des soignants et des membres de la collectivité soient pleinement pris en compte dans l'élaboration des lignes directrices. Pour les lignes directrices individuelles, des groupes de travail thématiques, présidés par un membre du nouvel organisme consultatif externe et composés d'experts en la matière, fourniraient des conseils ciblés. Un mandat clair devrait définir les rôles, les responsabilités et les mécanismes de responsabilisation pour chaque composante de cette structure.
La structure proposée est présentée à l'annexe 7 : Organigramme proposé pour le Groupe d'étude.
Recommandation 12 : Reconstituer le Groupe d'étude en un organisme consultatif externe (OCE)
L'ASPC devrait reconstituer le Groupe d'étude en tant qu'organisme consultatif externe indépendant, appuyé par une gouvernance transparente, des mécanismes structurés d'engagement avec les parties prenantes et des mécanismes décisionnels imputables.
Pour mettre en œuvre cette transition, l'ASPC devrait adopter un modèle de gouvernance inspiré de celui du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), en restructurant le Groupe d'étude en tant qu'organisme consultatif externe.
Cette nouvelle structure devrait être appuyée par un secrétariat permanent intégré à l'ASPC ou hébergé par une institution appropriée, avec un mandat clair pour assurer la coordination administrative, scientifique et opérationnelle.
Un comité de membres sélectionnés sur la base de leurs compétences superviserait l'élaboration des lignes directrices, avec le soutien d'organismes consultatifs permanents, notamment un comité consultatif sur l'équité, le Réseau de mobilisation des patients et des groupes de travail spécialisés. L'ASPC devrait définir un mandat transparent pour chaque composante de la gouvernance et établir des processus officiels de reddition de comptes et de nomination afin de protéger l'indépendance, d'assurer la responsabilisation et de favoriser une mobilisation inclusive — conformément à sa Politique sur les organismes consultatifs externes (Agence de la santé publique du Canada, 2024). La transition vers ce modèle rehausserait la crédibilité du Groupe d'étude, améliorerait sa souplesse opérationnelle et renforcerait sa capacité à fournir des conseils opportuns, fiables et pertinents en matière de services de santé préventifs dans l'ensemble des systèmes de santé du Canada.
Résumé : Renforcement de la gouvernance
Le renforcement de la gouvernance du Groupe d'étude est essentiel pour assurer sa pertinence, son indépendance et ses retombées continues. Les recommandations 8 à 12 établissent une feuille de route exhaustive pour moderniser sa structure, ses processus et sa composition. Cela comprend la mise en place d'un cadre d'adhésion transparent, basé sur les compétences, qui reflète la diversité de la population et des systèmes de santé du Canada; l'établissement d'un processus de nomination structuré pour améliorer la légitimité et la responsabilité; et la formalisation des mécanismes d'engagement des experts en la matière tout en préservant l'indépendance de la prise de décision. De plus, un cadre progressif pour les conflits d'intérêts donnera accès à des connaissances spécialisées tout en maintenant la confiance du public dans l'intégrité des recommandations. Afin d'améliorer la viabilité à long terme et l'efficacité opérationnelle, le Groupe d'étude devrait passer à un organisme consultatif externe soutenu par un financement pluriannuel stable et prévisible et un secrétariat permanent. Ensemble, ces réformes permettront au Groupe d'étude d'offrir des recommandations en matière de soins de santé préventive scientifiquement rigoureuses, à jour, crédibles, inclusives et fondées sur des données probantes d'une manière plus réactive, transparente et coordonnée.
Chapitre 3 : Considérations plus générales
3.1 Possibilités d'action à l'échelle du système pour un écosystème de lignes directrices coordonné et résilient
Bien que cet examen ait porté sur le mandat, la gouvernance et les processus du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, les consultations et les délibérations du Comité ont mis en lumière des défis systémiques qui dépassent le cadre de nos termes de référence officiels. Même s'ils ne relèvent pas du mandat du Comité, ces enjeux sont importants et méritent une attention sérieuse de la part de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
3.2 Mettre en place une infrastructure intégrée en matière de lignes directrices
Une préoccupation récurrente soulevée par les détenteurs d'intérêts de partout au Canada était le chevauchement généralisé des efforts dans l'élaboration de lignes directrices de pratique clinique. À l'heure actuelle, de nombreux intervenants, y compris les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les organismes et instituts de santé, les associations professionnelles et les organisations du secteur privé, élaborent des lignes directrices de façon indépendante. Cette situation entraîne des chevauchements inutiles, des directives incohérentes et parfois conflictuelles et, au bout du compte, de la confusion pour les professionnels de la santé de première ligne.
Pour répondre à cet enjeu, il est urgent non seulement d'améliorer la coordination, mais aussi de formaliser les mécanismes d'alignement à l'échelle de l'ensemble des processus consultatifs et décisionnels — tels que les programmes provinciaux et territoriaux de dépistage — ainsi que des plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, y compris les conseils de la qualité. Cet alignement doit aller au-delà des consultations traditionnelles des parties prenantes, et s'étendre aux infrastructures opérationnelles et systémiques nécessaires pour intégrer les lignes directrices à la pratique. Il devrait également inclure des mécanismes communs permettant d'adapter les lignes directrices élaborées à l'échelle nationale aux modèles locaux de prestation de soins, facilitant ainsi la production et l'utilisation de résumés contextualisables au point de service.
Cela comprend la prise en compte de leviers essentiels du système de santé qui peuvent contribuer à institutionnaliser une approche modernisée de l'élaboration des lignes directrices. Parmi ces leviers clés figurent la mise à jour des dossiers médicaux électroniques (DME) et des dossiers de santé électroniques (DSE), l'intégration de rappels cliniques dans les outils numériques et les charges de travail des prestataires, ainsi que l'ajustement des mécanismes de financement afin de soutenir la mise en œuvre des lignes directrices dans l'ensemble des juridictions.
Recommandation supplémentaire A : Établir un centre national de coordination : Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait envisager la création d'un centre national de coordination pour l'élaboration de lignes directrices — rassemblant les bailleurs de fonds, les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les responsables de la mise en œuvre, afin de renforcer l'alignement, de réduire les chevauchements et d'accélérer la traduction des données probantes en politiques et pratiques efficaces.
Ce centre devrait permettre une coordination formelle entre les structures consultatives et décisionnelles, y compris les plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, et appuyer l'intégration à l'échelle des systèmes. Il devrait également favoriser la contextualisation, en facilitant l'adaptation des lignes directrices aux contextes provinciaux et territoriaux, soutenue par une infrastructure partagée pour la production de résumés localisés des recommandations clés. Cela comprend l'harmonisation des mécanismes de financement et des leviers opérationnels afin d'ancrer une approche modernisée et adaptée à la population, pour l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices cliniques.
L'établissement d'un tel centre ne nécessiterait pas nécessairement la création d'une nouvelle organisation. Un organisme de santé pancanadien existant pourrait agir comme secrétariat pour appuyer cette fonction. Les modèles d'autres administrations — comme le NICE — pourraient offrir des leçons utiles en matière de coordination efficace.
3.3 Intégrer les perspectives de santé publique et de santé communautaire
Les soins de santé préventifs sont essentiels pour améliorer les résultats en matière de santé de la population, réduire les coûts à long terme du système et s'attaquer aux iniquités en santé. Toutefois, l'approche actuelle du Canada en matière de prévention demeure fragmentée et la coordination entre les administrations et les secteurs est limitée.
Au cours du processus de consultation, les participants — notamment des responsables de la santé publique, des cliniciens, des chercheurs et des partenaires patients — ont systématiquement souligné l'absence d'un mécanisme national permettant d'aligner les lignes directrices cliniques en matière de prévention avec les initiatives et les travaux de recherche en santé communautaire, publique et populationnelle. Plusieurs ont également souligné la nécessité de soutenir les stratégies de prévention en amont, ou primordiales, qui s'attaquent aux déterminants sociaux et structurels de la santé.
Veiller à ce que les lignes directrices cliniques et de santé publique soient alignées contextuellement — entre elles et avec les réalités locales des systèmes — sera essentiel pour maximiser la pertinence, l'équité et l'adoption des orientations préventives au Canada.
Recommandation supplémentaire B : Mettre sur pied un groupe d'étude sur la prévention en milieu communautaire — Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait étudier la création d'un groupe de travail sur les services préventifs communautaires, en collaboration avec des organisations telles que les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN), afin de fournir des orientations indépendantes et fondées sur des données probantes pour la santé publique et les interventions au niveau de la communauté au-delà des soins cliniques.
3.4 Harmoniser les organismes de financement de la recherche, les agences de données, les conseils de la qualité et les partenariats internationaux
Un autre sujet de préoccupation clé est la coordination limitée entre le financement de la recherche, l'infrastructure des données sur la santé et l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des lignes directrices. Cette déconnexion contribue à l'inefficacité, au dédoublement inutile et au ralentissement de l'adoption des données probantes dans la pratique.
Il faut des outils partagés, des cadres communs et un investissement soutenu dans la recherche axée sur l'équité pour mieux appuyer la mobilisation des détenteurs d'intérêts, l'application des connaissances et l'apprentissage à l'échelle du système dans les écosystèmes de soins de santé préventifs du Canada. Parallèlement, des initiatives mondiales comme l'Evidence Synthesis Infrastructure Collaborative démontrent comment des plateformes partagées et des méthodes soutenues par l'intelligence artificielle peuvent considérablement réduire le temps et les coûts associés à la production de synthèses évolutives (« vivantes ») des données probantes — créant ainsi des occasions pour le Canada de s'aligner, de collaborer et de contribuer à cette infrastructure internationale en pleine évolution. Grâce à ces plateformes, le Canada peut veiller à ce que les provinces et territoires aient un accès équitable à des synthèses vivantes des données probantes, réduisant ainsi le besoin de revues redondantes et permettant aux juridictions de concentrer leurs efforts sur la contextualisation des résumés en fonction des besoins de leur population et de leurs modèles de prestation.
Dans le même temps, le Canada doit dépasser une vision strictement nationale et s'engager activement dans cette infrastructure mondiale des données probantes, qui prend rapidement forme. En s'alignant sur ces initiatives internationales — et en y contribuant — le gouvernement fédéral peut éviter les dédoublements, partager les coûts et s'assurer que le système canadien bénéficie des avancées mondiales en matière de production et d'utilisation des données probantes.
Recommandation supplémentaire C : Mettre en place un réseau pour aligner la recherche, les données et l'évaluation — Le gouvernement fédéral est encouragé à mettre en place un réseau visant à renforcer la coordination avec les organismes canadiens de financement de la recherche en santé, les agences de données et les conseils de la qualité.
Il devrait également permettre au Canada de participer activement à l'émergence d'une infrastructure mondiale de synthèse continue des données probantes (living evidence synthesis), offrant ainsi aux provinces et territoires un accès à une base commune de données probantes de haute qualité — leur permettant ainsi de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale plutôt que sur la duplication des processus de synthèse ou d'élaboration de lignes directrices redondantes.
3.5 Regard vers l'avenir
Bien que les propositions décrites dans le présent chapitre dépassent le mandat immédiat du Comité, elles reflètent un message fort et récurrent qui a été entendu tout au long du processus d'examen : Le Canada doit se doter d'une infrastructure nationale intégrée et d'une coordination stratégique pour maximiser les retombées des lignes directrices et des services de soins de santé préventifs.
En tenant compte de ces connaissances, nous pouvons contribuer à une approche plus cohésive, coordonnée et prête pour l'avenir en matière de santé préventive — une approche qui garantit que l'ensemble de la population canadienne a un accès équitable à des directives à jour, et fondées sur des données probantes qui favorisent la santé et le bien-être dans les collectivités et les générations.
Conclusion : Une voie d'avenir
Ce rapport donne suite à la directive du ministre de la Santé visant à évaluer la gouvernance, le mandat et les processus du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. Les constatations du Comité soulignent l'importance de moderniser le Groupe d'étude afin qu'il demeure une source crédible, indépendante et inclusive d'orientation en matière de soins de santé préventifs pour les professionnels de soins primaires partout au Canada.
Les douze recommandations présentées au chapitre 2 offrent une feuille de route claire et réalisable pour son renouvellement. Elles mettent l'accent sur une gouvernance renforcée, une transparence accrue, une approche méthodologique plus adaptable et un engagement ferme envers l'équité — en veillant à ce que le Groupe d'étude soit bien équipé pour répondre aux besoins évolutifs du système de santé canadien. Fondées sur des consultations, des examens de données probantes et des pratiques exemplaires internationales, ces recommandations visent à renforcer la capacité, la pertinence et les retombées du Groupe d'étude pour de nombreuses années à venir.
Au-delà du Groupe d'étude lui-même, le chapitre 3 met en évidence des possibilités plus vastes d'améliorer la cohérence et l'efficacité de l'écosystème canadien d'élaboration des lignes directrices. Il propose des mesures pour renforcer la coordination, réduire les chevauchements et élargir la portée des orientations afin de mieux répondre aux besoins en matière de santé communautaire, publique et populationnelle.
Bien que ce rapport trace une voie claire et réalisable vers la modernisation, plusieurs défis stratégiques devront être relevés pour assurer une mise en œuvre réussie. Une coordination soutenue entre les partenaires nationaux, provinciaux et territoriaux sera essentielle pour réduire la fragmentation et favoriser l'alignement dans l'élaboration et l'utilisation des lignes directrices en santé préventive. La production d'impacts durables nécessitera un investissement fédéral prévisible ainsi que des réformes structurelles garantissant un financement stable et une capacité opérationnelle adéquate.
La transition vers un modèle de lignes directrices évolutives nécessitera la création de nouveaux partenariats, l'adoption d'outils et d'infrastructures numériques, le recrutement de personnel technique qualifié ainsi qu'une gestion du changement réfléchie. L'intégration systématique de l'équité à toutes les étapes — de la sélection des sujets à la mise en œuvre — exigera un engagement soutenu, des stratégies ciblées et des mécanismes transparents de reddition de comptes.
Les structures et processus proposés renforceront le Groupe d'étude, mais nécessiteront également des ressources suffisantes et une coordination accrue entre ses membres, ses groupes de travail et ses partenaires. L'inclusion de différents types de membres — votants, non-votants, experts en la matière et représentants du public — ajoutera de la complexité à sa gouvernance et exigera une supervision plus structurée. Dans ce contexte, un soutien adéquat — en particulier pour la présidence du Groupe d'étude — sera essentiel pour gérer les différents niveaux de gouvernance et assurer le bon fonctionnement de l'ensemble.
Le succès reposera également sur la capacité à rendre les lignes directrices véritablement contextualisables, en permettant aux provinces et territoires d'adapter les recommandations à leurs systèmes et à leurs populations, sans devoir répliquer les efforts de développement. Cela implique la mise en place d'une infrastructure partagée, de processus collaboratifs et d'une conception délibérée des lignes directrices, conciliant rigueur scientifique et applicabilité dans la diversité des contextes de soins au Canada.
Ensemble, les constatations et recommandations contenues dans ce rapport offrent une voie pragmatique pour aller de l'avant, en fournissant aux dirigeants et aux décideurs de l'ASPC un guide clair pour mettre en œuvre des changements capables de créer un système de soins de santé préventifs plus intégré, réactif et tourné vers l'avenir, favorisant l'équité en santé et procurant des avantages réels aux personnes et aux collectivités partout au Canada.
Glossaire
- Application des connaissances (AC)
- L'application des connaissances (AC) est définie comme un processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l'échange et l'application conforme à l'éthique des connaissances dans le but d'améliorer la santé des Canadiens, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé (Agence de la santé publique du Canada, 2017).
- Centré sur l'équité
- Une approche axée sur l'équité place la justice et l'équité au cœur du processus décisionnel, en veillant à ce que les politiques et les pratiques s'attaquent activement aux inégalités en santé et contribuent à les corriger. Cela implique de mobiliser les communautés touchées par ces inégalités pour définir les enjeux, coconstruire des solutions et participer aux processus décisionnels (Venkateswaran et coll., 2023).
- Contextualisable
- La contextualisation d'une ligne directrice se produit lorsqu'une ligne directrice élaborée ailleurs est adoptée ou adaptée, et que sa mise en œuvre efficace nécessite l'ajout de mises en garde et/ou de considérations complémentaires pour tenir compte des contextes locaux (Dizon et coll., 2016).
- Diversité
- Caractéristiques démographiques attribuables aux différences ethniques, linguistiques, culturelles, visibles et sociales parmi des sous-groupes de personnes au sein d'une population (Agence de la santé publique du Canada, 2022c).
- Lignes directrices évolutives (« vivantes »)
- Les synthèses « vivantes » de données probantes sont des résumés de la recherche systématiquement évalués et continuellement mis à jour. Elles reposent sur une veille constante et fréquente des nouvelles données probantes, la fréquence étant déterminée par la probabilité d'émergence de nouvelles publications, des changements prévus dans les politiques publiques ou les contextes de pratique, ou encore par la nécessitée et l'urgence de soutenir la prise de décision (Chakraborty et coll., 2024).
- Équité en santé
- L'équité en santé correspond à l'absence de différences injustes, évitables ou remédiables entre des groupes de personnes, que ces groupes soient définis socialement, économiquement, démographiquement, ou géographiquement (Organisation mondiale de la santé, 2021).
- Expérience vécue
- L'expérience vécue est définie comme la connaissance personnelle du monde acquise par une participation directe et concrète aux événements quotidiens plutôt que par des représentations faites par d'autres personnes. Il peut également s'agir de la connaissance des personnes acquise par une interaction directe en face à face, plutôt que par le biais d'un moyen technologique (Oxford University Press, 2025).
- Fondée sur des données probantes
- L'expression "fondé sur des preuves" fait référence à des pratiques ou à des décisions qui s'appuient sur les meilleures preuves scientifiques disponibles. Dans le contexte de la médecine, ce concept trouve son application dans les principes de la médecine fondée sur les preuves, qui met l'accent sur l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves actuelles dans la prise de décisions concernant les soins aux patients individuels (Sackett et coll., 1996).
- Gouvernance
- La gouvernance fait référence aux processus et aux structures utilisés pour diriger et gérer les opérations et les activités d'une organisation. Elle définit la répartition des pouvoirs et établit des mécanismes de responsabilisation entre les parties prenantes, le conseil d'administration et la direction. (SaskCulture, 2024).
- GRADE
- GRADE (« Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation ») est une approche systématique et transparente utilisée pour évaluer la qualité des données scientifiques et la force des recommandations en matière de soins de santé. La méthode GRADE aide à faire en sorte que les décisions relatives aux lignes directrices soient fondées sur les meilleures recherches disponibles et qu'elles soient clairement liées à la certitude des données probantes sous-jacentes. Elle a été adaptée pour différents types de données probantes, y compris la recherche qualitative (« GRADE-CerQual ») et les études diagnostiques (The GRADE Working Group, 2025).
- Groupe privé d'équité
- Groupe de personnes qui, parce qu'elles font l'objet de discrimination systémique, sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d'avoir le même accès aux ressources et aux occasions auxquelles ont accès d'autres membres de la société et qui sont nécessaires pour qu'elles obtiennent des résultats justes. Au Canada, les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes faisant partie des communautés 2ELGBTQI+, les groupes religieux minoritaires, ainsi que les personnes noires et les personnes racisées sont parmi les groupes considérés comme des groupes privés d'équité. Les types de groupes privés d'équité peuvent varier en fonction de facteurs tels que la géographie, le contexte socioculturel ou la présence de sous-groupes de populations spécifiques (Comité interministériel de terminologie sur l'équité, 2024).
- Groupe racisé
- Groupe de personnes classées selon des caractéristiques ethniques ou raciales et, sur ce fondement, soumises à un traitement discriminatoire (Comité interministériel de terminologie sur l'équité, 2022).
- Lignes directrices cliniques (de soins)
- Également appelées lignes directrices de pratique clinique, ce sont des déclarations élaborées de manière systématique afin d'aider les professionnels de la santé à fournir des soins appropriés et fondés sur des données probantes aux patients. Les lignes directrices formulent des recommandations explicites en matière de soins dans le but d'orienter les pratiques des professionnels de la santé. Toutefois, elles ne constituent pas des règles : elles visent à soutenir la prise de décision clinique, et non à la remplacer(Agence de la santé publique du Canada, 2017).
- Quadruple visée (quatre objectifs) (« Quadruple Aim »)
- Les quatre objectifs fondamentaux de la restructuration des systèmes de soins de santé (quadruple visée), sont les suivants : améliorer de l'expérience des soins pour les patients; l'améliorer de la santé des populations, améliorer l'expérience des fournisseurs de soins et améliorer du rapport qualité-prix (Instituts de recherche en santé du Canada, 2022).
- Organisme consultatif externe (OCE)
- Établi par le ministre de la Santé ou le ministère ou l'agence pour fournir des conseils touchant des questions médicales, scientifiques, techniques, de politiques ou de programme qui relèvent de son mandat. Tous les membres proviennent de l'extérieur du gouvernement fédéral et fournissent des conseils collectivement, et non pas à titre de particuliers ou de représentants d'organismes (Santé Canada, 2023).
- Prévention primordiale
- La prévention primordiale désigne les mesures visant à modifier les déterminants de la santé et ainsi d'empêcher l'apparition de facteurs environnementaux, économiques, sociaux, comportementaux, ou culturels qui augmentent l'incidence de la maladie. Elle agit en amont, sur les déterminants sociaux, plutôt que sur les facteurs de risque chez l'individu, lesquels sont l'objectif principal de la prévention primaire (Association des facultés de médecine du Canada, 2025).
- Professionnels en soins de santé primaires
- Prestataires de soins de santé qui fournissent des soins de première ligne aux individus. Ce groupe comprend les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les physiothérapeutes et les diététiciens (Institut canadien d'information sur la santé, 2025; Santé Canada, 2025a, 2025b).
- Soins de santé préventifs
- Les soins de santé préventifs sont des mesures proactives visant à réduire le risque de maladie ou de blessure avant qu'elles ne surviennent. Ils comprennent notamment, les vaccinations, les examens de routine et les interventions sur le mode de vie, telles qu'une alimentation saine et de l'activité physique régulière. Ils englobent également les stratégies de dépistage visant à détecter les problèmes de santé à un stade précoce — avant l'apparition des symptômes — moment où les traitements sont généralement plus efficaces et le risque de complications, moins élevé (Lenartowicz, 2023; Nyantakyi, 2023).
- Soins de santé primaires
- Les soins de santé primaires constituent une approche globale de l'organisation des systèmes de santé qui englobe les trois aspects de la politique et des mesures multisectorielles visant à tenir compte des déterminants plus généraux de la santé : habiliter les personnes, les familles et les collectivités, et répondre aux besoins essentiels des gens en matière de santé tout au long de leur vie (Santé Canada, 2012; Organisation mondiale de la santé 2025).
- Synthèse des évidences
- La synthèse des données probantes est une méthode de recherche qui combine l'ensemble des informations pertinentes issues d'études primaires et de la littérature grise afin de répondre à une question de recherche. Il existe différents types de synthèses des données probantes, notamment les revues systématiques, les revues de portée, les revues rapides, les revues parapluies et les méta-analyses. Dans le cadre du processus de revue systématique, la synthèse des données probantes consiste à combiner les données évaluées provenant d'études admissibles, puis à les analyser afin de déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour conclure que, collectivement, ces études permettent de répondre de façon concluante à la question de recherche (University of Texas Libraries, 2025).
Annexes
Annexe 1 : Comité d'examen externe — Cadre de référence
- 1.0 Préambule
- 1.1 Ce Comité d'examen externe du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (« le Comité ») est mis en place conformément à la Politique sur la gestion des organismes consultatifs externes de l'ASPC (Agence de la santé publique du Canada) (« la politique sur la gestion des OCE ») en vertu de laquelle l'Agence sollicite des avis d'experts externes auprès de personnes possédant les connaissances, l'expertise et l'expérience nécessaires pour donner des conseils sur des questions scientifiques, techniques, de politiques ou de programmes particuliers. L'article 14 de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada confère le pouvoir législatif d'établir un tel examen.
- 1.2 Le cadre de référence est conforme à la Politique sur la gestion des OCE, qui garantit la transparence et le recours à une expertise diversifiée pour recueillir des conseils indépendants, éclairés, et documentés.
- 1.3 Le Comité fournit des conseils indépendants sous la forme d'un rapport final au Secrétaire général de l'examen, qui le recevra au nom de la Présidente de l'Agence de la santé publique du Canada. L'ASPC conserve le pouvoir de décision et la responsabilité de toutes les décisions prises à la suite des recommandations formulées par le Comité.
- 1.4 Dans ses délibérations et ses conclusions, le Comité appliquera les principes suivants :
- Maintenir l'excellence et l'intégrité scientifique;
- Contribuer à la réconciliation en prenant en compte les peuples autochtones, qui sont fondés sur la base de la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
- Soutenir la mise en œuvre d'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre Plus (ACSG Plus) en garantissant la prise en compte de la manière dont des facteurs tels que le sexe, le genre, la race, l'origine ethnique, l'âge, le handicap et d'autres facteurs interagissent et se recoupent entre eux et avec les autres. Cette approche permet de connaître comment les diverses personnes et populations du Canada peuvent vivre nos politiques et nos programmes.
- 2.0 Mandat de l'examen
- 2.1 Le Comité a pour mandat d'examiner le modèle du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (« le Groupe d'étude ») et de formuler des recommandations d'amélioration.
- Plus précisément, le mandat du Comité comporte deux volets :
- 2.1.1 Examiner si le Groupe d'étude est structuré de manière appropriée pour élaborer des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs pour les soins primaires qui répondent aux besoins du système de soins de santé du Canada, et recommander des améliorations ou des modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour moderniser l'élaboration de lignes directrices en matière de soins de santé préventifs; et
- 2.1.2 Évaluer la rigueur, l'agilité, l'inclusivité et la rapidité des processus d'examen scientifique de données probantes et des sources de données nécessaires pour soutenir l'élaboration de lignes directrices étoffées, utiles et pertinentes.
- Le Comité est chargé de faire ce qui suit :
- 2.1.3 Examiner les approches et les meilleures pratiques nationales et internationales pour l'élaboration de lignes directrices en santé publique et médecine préventive, et tenir compte des conclusions de cette analyse comparative dans ses recommandations; et
- 2.1.4 Collaborer avec des experts et des intervenants clés, tant au niveau national qu'international, afin d'assurer un examen complet des meilleures pratiques intégrant les éléments tels que les aspects cliniques (des patients), l'expérience vécue, la santé sociale et préventive, l'éthique et l'analyse économique.
- 2.1.5 Prendre en considération les résultats des analyses, de consultations et d'évaluations complémentaires dans la mesure où ils fournissent des renseignements pertinents pour l'examen du Comité.
- 2.2 Le Comité produira un rapport final décrivant ses conclusions et comprenant une série de recommandations concrètes pour un cadre de gouvernance, une structure et une administration solide, ainsi que pour des processus d'examen scientifique.
- 3.0 Calendrier de l'examen
- Phase 1 : Recherche préliminaire et collecte de données (septembre 2024)
- Phase 2 : Collecte d'information (octobre à décembre 2024)
- Phase 3 : Analyse et rédaction du rapport (janvier à mars 2025)
- Phase 4 : Présentation des conclusions et des recommandations à l'ASPC (mars 2025)
- 4.0 Membres
- 4.1 Le Comité est composé de 13 membres, dont un Président
- 4.2 Le Secrétaire général ou son représentant sera membre d'office. Les membres d'office ne seront pas membres votants.
- 4.3 Les membres ont été sélectionnés de manière à ce que le Comité soit composé d'un éventail d'experts ayant les connaissances, l'expertise et l'expérience pertinentes, notamment en matière de pratiques cliniques, de bioéthique et de méthodologie, et qu'il soit représentatif de la diversité du Canada. Les membres comprennent l'engagement de l'ASPC à l'égard de l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre Plus (ACSG Plus). Dans le cadre de leur analyse, ils assureront une approche intersectionnelle pour évaluer comment des facteurs tels que le sexe, le genre, l'âge, la race, l'origine ethnique, le statut socioéconomique, le handicap, l'orientation sexuelle, le contexte culturel et l'emplacement géographique interagissent et se recoupent.
- 4.4 Tous les membres ont accepté les obligations suivantes comme conditions préalables à leur nomination :
- 4.4.1 être assujetti aux conditions énoncées dans la Politique sur la gestion des organismes consultatifs externes de l'ASPC, et s'y conformer;
- 4.4.2 obtenir une habilitation de sécurité de niveau fiabilité;
- 4.4.3 signer un formulaire d'accord de confidentialité;
- 4.4.4 remplir et signer un formulaire de déclaration d'affiliation et d'intérêts et, si la participation est autorisée en dépit d'un conflit d'intérêts, accepter les limites de participation décrites au chapitre 3 de la politique sur la gestion des OCE; et
- 4.4.5 Fournir une brève biographie et un résumé, notamment un sommaire de leurs affiliations et de leurs intérêts (sachant que ces documents seront publiés en ligne par l'ASPC).
- 4.5 Conditions d'adhésion
- 4.5.1 Les membres du Comité sont nommés par l'ASPC uniquement pour la durée du Comité d'examen externe. Les activités du Comité devraient se terminer en mars 2025 ou peu après.
- 4.5.2 Le Président du Comité est nommé par le Secrétaire général, pour servir à sa guise.
- 4.6 Procédure de démission
- 4.6.1 Un membre peut démissionner du Comité en envoyant un avis écrit au Secrétaire général, avec copie au Président du Comité, en précisant la date d'entrée en vigueur de la démission. Il est préférable que le membre donne un préavis de 14 jours de son intention de démissionner. Lorsqu'un membre du Comité décide de démissionner, il doit se faire proposer un entretien de départ.
- 4.6.2 Le Secrétaire général déterminera si un membre de remplacement doit être nommé..
- 4.7 Motifs de résiliation
- Le Secrétaire général peut mettre fin au mandat d'un membre pour diverses raisons, notamment : le mandat du membre est terminé; le mandat du Comité est terminé; le mandat du Comité a changé, ce qui nécessite une composition différente, etc. Le Secrétaire général peut également mettre fin à une nomination si un membre n'a pas agi conformément au cadre de référence. Le Secrétaire général peut également mettre fin à la nomination d'un membre, s'il n'a pas agi conformément au cadre de référence, par exemple si un membre enfreint ses obligations de confidentialité ou ne participe pas aux activités du Comité, notamment aux réunions. L'ASPC informera le membre par écrit de la résiliation de sa nomination et lui indiquera la raison pour laquelle il est mis fin à sa nomination ainsi que la date de la résiliation.
- 4.8 Rémunération
- Les membres acceptent de participer à titre bénévole
- 5.0 Secrétaire général et secrétariat de l'examen
- 5.1 Le sous-administrateur en chef de la santé publique fait office de Secrétaire général de l'examen. Le Secrétaire général assure la bonne gestion de l'examen au nom du Président de l'Agence, donne des conseils au secrétariat et au Président du Comité concernant la politique des organismes consultatifs externes de l'ASPC, et collabore avec les principaux responsables de l'ASPC (par exemple, le conseiller scientifique en chef), de processus administratifs ainsi que sur des questions de clarification du mandat.
- 5.2 Un secrétariat, composé de fonctionnaires de l'ASPC, fournit un soutien organisationnel et administratif au Président du Comité et aux membres, conformément aux directives du Secrétaire général. Le secrétariat veille généralement à assurer un soutien continu au Comité d'examen conformément aux politiques et pratiques internes de l'ASPC, et s'acquitte particulièrement de ses responsabilités telles que décrites à la section 4.10 de la politique relative des organismes consultatifs externes.
- 6.0 Experts non membres
- 6.1 Le Comité d'examen doit faire tout en son pouvoir pour inviter des experts à se présenter devant lui, ou obtenir des soumissions, dans la mesure où ces experts non membres font progresser la compréhension, tout en reconnaissant la contrainte de temps imposée pour l'examen.
- 6.2 Les experts non membres qui ne font pas partie du Comité d'examen peuvent participer en qualité d'observateurs lors de réunions ou de parties de réunions sur des sujets particuliers ou des points à l'ordre du jour. Ces personnes n'ont pas accès aux renseignements ou documents, et leur participation est à la discrétion du Président du Comité ou du secrétariat. Les experts non membres ne participent pas à la formulation de conseils ou de recommandations à l'intention de l'ASPC.
- 6.3 La rémunération sous forme d'honoraires ne sera envisagée que pour les experts non membres en situation économique précaire, et à ceux qui doivent renoncer à un salaire horaire pour participer, ce qui sera évalué au cas par cas.
- 7.0 Transparence
- 7.1 L'ASPC s'engage à faire de la transparence un principe de fonctionnement. Les documents suivants seront au minimum mis en ligne par l'ASPC :
- 7.1.1 Cadre de référence.
- 7.1.2 Mandat;.
- 7.1.3 Liste des membres, ainsi que leur biographie et le sommaire de leurs affiliations et de leurs champs d'intérêt; et
- 7.1.4 Coordonnées (courriel) pour le secrétariat.
- 8.0 Gestion des réunions
- 8.1 En tenant compte du Guide des réunions écologiques de l'ASPC, le secrétariat veillera à la planification, aux communications, à la sélection des lieux de réunion, à l'hébergement, à l'accueil, à l'approvisionnement et aux déplacements. En suivant ce Guide, le secrétariat s'efforcera de réduire au minimum les déchets, la consommation d'eau et d'énergie et les émissions atmosphériques liées aux réunions, et de maximiser les avantages économiques et sociaux.
- 8.1.1 Fréquence et lieu des réunions. Les réunions se tiendront environ toutes les trois (3) semaines, durant toute la durée du mandat, et ce, jusqu'à la remise du rapport final. Les réunions se tiendront soit en personne dans un lieu qui convient aux deux parties, soit par vidéoconférence. Des réunions supplémentaires pourront être organisées en fonction des besoins, à la discrétion du secrétariat, en consultation avec le Président du Comité.
- 8.1.2 Participation aux réunions et invitations. Les réunions seront limitées aux membres votants et non-votants du Comité et au personnel du secrétariat. Les présentateurs et les autres participants n'y assisteront que sur invitation.
- 8.1.3 Ordres du jour des réunions. Le secrétariat, en consultation avec le Président du Comité et la contribution des membres, rédige un ordre du jour de réunion et envoie les documents avant la réunion prévue. Le secrétariat soutient les membres en contribuant à la détermination des questions et des sujets de discussion.
- 8.1.4 Quorum, recommandations et vote. Le quorum doit être atteint lorsque le Comité formule des recommandations ou des conseils à l'intention de l'ASPC. Le quorum est constitué de six (6) membres et du Président du Comité. Le groupe est encouragé à parvenir à un consensus lorsqu'il prodigue des conseils, dans la mesure du possible. Lorsqu'un consensus n'est pas possible, le compte rendu de la réunion reflétera la diversité des opinions.
- 8.2 Délibérations et rapports. Les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions résument les échanges afin de bien refléter les délibérations. Les propos ne seront pas attribués à des personnes dans les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions.
- 8.2.1 Les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions sont préparés par le secrétariat et distribués aux membres pour examen et approbation.
- 8.2.2 L'avis du Comité sera transmis à l'ASPC sous la forme d'un rapport final.
- 8.1 En tenant compte du Guide des réunions écologiques de l'ASPC, le secrétariat veillera à la planification, aux communications, à la sélection des lieux de réunion, à l'hébergement, à l'accueil, à l'approvisionnement et aux déplacements. En suivant ce Guide, le secrétariat s'efforcera de réduire au minimum les déchets, la consommation d'eau et d'énergie et les émissions atmosphériques liées aux réunions, et de maximiser les avantages économiques et sociaux.
- 9.0 Communication publique et médias sociaux
- 9.1 Les membres qui reçoivent des demandes de la part des médias ou du public concernant l'examen doivent en informer le secrétariat dès réception et avant d'y répondre. Les membres des médias doivent être dirigés vers la ligne de relations avec les médias du portefeuille de la Santé. L'ASPC peut demander à un membre du Comité de répondre à une question des médias.
- 9.2 Conformément à la politique relative aux OCE (section 4.7), les membres du Comité doivent obtenir le consentement de l'ASPC avant de divulguer dans toute communication publique des renseignements au sujet de leur rôle, leurs fonctions et les sujets de l'examen. Ces communications publiques, notamment le contenu des médias sociaux rédigé par un membre du Comité, doivent être examinées et approuvées par l'ASPC avant d'être diffusées. De manière plus générale, les attentes relatives à l'utilisation des médias sociaux par les membres, en ce qui concerne la communication sur l'examen, sont définies et convenues en vertu du Cadre de l'accord de confidentialité signé avant la nomination.
- 10.0 Voyages et dépenses
- 10.1 Les membres du Comité qui sont autorisés à voyager par le Secrétaire général ou une autre autorité compétente, à des fins officielles pour le Comité, verront leurs frais de voyage, d'hébergement et de séjour remboursés conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte d'examen et à la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'évènements du Secrétariat du Conseil du Trésor.
- 10.2 Les membres du Comité obtiendront un remboursement pour les frais d'enquête de sécurité applicables conformément à l'alinéa 4.4.2, notamment la prise d'empreintes digitales.
Annexe 2 : Membres du Comité d'examen externe
Dr Vivek Goel, Président
Le Dr Vivek Goel est président et vice-chancelier de l'Université de Waterloo. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de haute direction à l'Université de Toronto, notamment ceux de vice-président et de vice-recteur principal, puis plus récemment, de vice-recteur, Recherche et innovation. Il a été président-directeur général fondateur de la direction de Santé publique Ontario de 2008 à 2014, et l'un des scientifiques fondateurs de l'Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES). Ses domaines d'expertise en recherche incluent l'évaluation économique des interventions de santé, le dépistage du cancer, ainsi que l'analyse de l'accessibilité et de la qualité des services de santé à partir des données administratives. Le Dr Goel a obtenu son diplôme en médecine de l'Université McGill et a suivi une formation postdoctorale en santé publique et en médecine préventive à l'Université de Toronto. Il détient une maîtrise ès sciences (M.Sc.) en santé communautaire de l'Université de Toronto et une maîtrise (MS) en biostatistique de la Harvard University School of Public Health. Il est actuellement le président du conseil d'administration de l'Institut canadien d'information sur la santé.
Madame Brenda Andreas
Madame Brenda Andreas possède une expérience vécue et actuelle du système de santé. Elle collabore à l'échelle provinciale, nationale et internationale avec des partenaires du système de santé dans les domaines de l'agrément, de l'évaluation, de la recherche axée sur le patient, de la politique, ainsi que de la mobilisation des patients et de la collectivité. Elle est actuellement membre du Conseil consultatif de l'Institut des services et des politiques de la santé des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) à titre de représentante de la communauté, partenaire-patiente du Réseau canadien de recherche en soins primaires, membre du Conseil de leadership des patients et des familles de l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan, et membre du conseil d'administration du North American Primary Care Research Group. Elle est également membre du comité d'éthique de la recherche de l'Université de la Saskatchewan et évaluatrice-patiente pour Agrément Canada. Brenda est une travailleuse sociale retraitée agréée. Elle détient un baccalauréat en travail social de l'Université de Calgary ainsi d'un certificat en administration des soins de santé de l'Université de la Saskatchewan. Elle est autrice publiée, collaboratrice de recherche, et partenaire-patiente, en plus d'être une membre active de la collectivité, profondément engagée envers la transformation du système de santé. En 1992, elle a reçu la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada en reconnaissance de son engagement bénévole.
Dr Michael Barry
Le Dr Michael Barry dirige le Informed Medical Decisions Program (IMDP) au Massachusetts General Hospital (MGH). Il a auparavant occupé le poste de chef de l'unité de médecine générale de cet établissement. Il prodigue des soins primaires pour adultes au MGH depuis plus de 40 ans. Le Dr Barry est un champion de la prise de décision partagée entre le clinicien et le patient. Il a été président de la Society for Medical Decision Making ainsi que de la Society of General Internal Medicine. Il a également été conseiller scientifique en chef chez Healthwise et président de la Fondation Informed Medical Decisions. Il détient le titre de Master de l'American College of Physicians (ACP). En 2020, il s'est vu décerner le prix commémoratif Henry D. Bruce de l'ACP pour ses contributions remarquables à la médecine préventive. Le Dr Barry a été membre, vice-président, puis président du US Preventive Services Task Force (USPSTF) de 2017 jusqu'à 2024, dont il est désormais président sortant. Il est diplômé du Trinity College et de la faculté de médecine de l'Université du Connecticut. Par la suite, il a complété sa résidence en médecine interne au Strong Memorial Hospital à Rochester, dans l'État de New York. Il participe à ce panel à titre personnel, et non au nom de l'USPSTF. Ses contributions ne représentent donc pas nécessairement les opinions et les politiques de l'USPSTF.
Monsieur Gregory Doyle
Monsieur Gregory Doyle est directeur du dépistage du cancer du sein et des registres de la population pour les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est également président du Réseau canadien de dépistage du cancer du sein et conseiller expert auprès du Partenariat canadien contre le cancer. Il possède plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la santé des populations et du système de soins aux personnes atteintes de cancer. M. Doyle a contribué activement depuis de nombreuses années, tant à l'échelle provinciale que nationale, aux programmes de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus, du côlon et du poumon. Il est actuellement membre du Conseil canadien des registres du cancer et a été président du comité consultatif translationnel du projet PERSPECTIVE, qui vise à orienter le dépistage du cancer du sein fondé sur les risques ainsi que l'intégration de l'oncogénétique dans le paradigme du dépistage du cancer du sein. Il a publié de nombreux travaux sur le dépistage du cancer dans la population et a contribué à l'avancement des connaissances sur la mise en œuvre du dépistage. M. Doyle est diplômé de l'Université Memorial de Terre-Neuve et de l'Université Queens à Kingston.
Dr Alika Lafontaine
Le Dr Alika Lafontaine est un médecin primé et le premier médecin autochtone à figurer parmi les 50 médecins les plus influents selon le Medical Post. Il est également le plus jeune et le premier médecin autochtone à avoir présidé l'Association médicale canadienne en 156 ans d'histoire. D'origine métisse de la rivière Rouge et issue d'ancêtres autochtones de diverses origines, le Dr Lafontaine œuvre depuis plus de 20 ans dans divers domaines de la défense des intérêts. Il a siégé aux conseils d'administration du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, de HealthCareCAN, du Journal de l'Association médicale canadienne, de l'Association médicale de l'Alberta et de l'Association médicale canadienne. Spécialiste en milieu rural, il offre des soins de première ligne et a été chef de zone dans le passé. Il est également le fondateur et dirigeant de plusieurs initiatives nationales, dont l'Alliance pour la santé des Autochtones et Safespace Networks. Le 18 septembre 2024, l'Association médicale canadienne (AMC) a présenté des excuses officielles aux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, un processus que le Dr Lafontaine a dirigé au cours de son mandat de trois ans à la présidence de l'AMC. Il continue de jouer un rôle de premier plan en tant que leader d'opinion en matière de politiques de santé, de gestion du changement et en défense des intérêts.
Dr John Lavis
Le Dr John Lavis appuie les efforts visant à relever les défis liés à la santé et des enjeux sociétaux plus larges en s'appuyant sur les meilleures données probantes disponibles, ainsi que sur les expériences et les perspectives des citoyens, des professionnels, des dirigeants d'organisations et des décideurs gouvernementaux. Il est co-responsable et principal rédacteur du rapport de la Global Commission on Evidence to Address Societal Challenges, ainsi que co-responsable de l'initiative Rapid Improvement Support and Exchange (RISE). Il a dirigé l'élaboration des éléments « SHOW ME the evidence », qui font partie d'une approche visant à transmettre de manière fiable des données probantes aux décideurs et aux parties prenantes qui en ont besoin. Il a également été co-responsable du Réseau de données sur la COVID-19 pour appuyer la prise de décisions (COVID-END). Le Dr Lavis est directeur du Forum sur la santé de McMaster et du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé sur les politiques fondées sur des données probantes. Il est professeur au Département des méthodes, des données probantes et des impacts en santé de l'Université McMaster et titulaire d'une Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les systèmes de soutien aux données probantes. Il détient un doctorat en médecine (MD) de l'Université Queens, est titulaire d'une maîtrise ès sciences (M.Sc.) de la London School of Economics et un doctorat (Ph.D.) en en politiques de santé de l'Université Harvard.
Dr Lawrence Loh
Le Dr Lawrence Loh est un médecin-hygiéniste au sein des services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est un leader en santé publique et en médecine possédant une expérience de haut niveau aux trois paliers de gouvernement dans deux provinces canadiennes, ainsi que dans le secteur sans but lucratif, où il a été le sixième chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada. Reconnu notamment pour son leadership durant la pandémie de COVID-19, le Dr Loh s'est vu décerner plusieurs distinctions en reconnaissance de son service en santé publique, notamment la clé de la Ville de Mississauga, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, un doctorat honorifique de l'Université métropolitaine de Toronto, ainsi qu'une place sur la liste des 50 personnes les plus influentes de Toronto publiée par Toronto Life en 2021, parmi d'autres prix académiques et professionnels. Le Dr Loh est titulaire de bourses de perfectionnement en médecine familiale au Canada, ainsi qu'en santé publique et médecine préventive au Canada et aux États-Unis. Il a obtenu son diplôme en médecine à l'Université Western, une maîtrise en santé publique (MPH) de l'Université Johns Hopkins et a effectué sa résidence à l'École de la santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, où il est toujours professeur associé.
Dre Onye Nnorom
La Dre Onye Nnorom est médecin de famille et spécialiste de la santé publique et de la médecine préventive. Elle est conseillère médicale principale au ministère de la Santé de l'Ontario, au sein du Bureau de médecin hygiéniste en chef. Elle est également responsable du dossier de la santé des Noir·e·s au sein du Département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto, et consultante clinique au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). La Dre Nnorom a consacré sa carrière à la réduction des inégalités en santé et à l'amélioration des résultats en matière de santé au sein des communautés marginalisées, en mettant l'accent sur les populations noires. Elle a effectué ses études de médecine à l'Université McGill, et a obtenu une maîtrise en santé publique (MPH) avec spécialisation en épidémiologie à l'École de la santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, puis a complété sa résidence à cette même université. Elle est cofondatrice du Black Health Education Collaborative, une initiative visant à offrir des ressources pédagogiques en ligne sur le racisme anti-noir et la santé des personnes noires, destinées aux étudiant·e·s en sciences de la santé, aux clinicien·ne·s et aux professionel·le·s de la santé publique. Elle a également été présidente de l'Association des médecins noirs de l'Ontario.
Dre Gina Ogilvie
La Dre Gina Ogilvie est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada sur le contrôle mondial des maladies liées au VPH et leur prévention, ainsi que professeure à l'Université de la Colombie-Britannique, à l'École de la santé des populations et de la santé publique de la Faculté de médecine. Elle est également directrice associée de l'Institut de recherche en santé des femmes et scientifique principale en santé publique au Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Actuellement, la Dre Ogilvie est chercheuse principale pour des projets de recherche représentant plus de 10 millions de dollars en subventions. Elle a obtenu son doctorat en médecine (MD) de l'Université McMaster, a terminé une spécialité en médecine familiale et a obtenu une bourse de recherche en santé des populations et en soins primaires. Elle est titulaire d'une maîtrise en épidémiologie clinique de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un doctorat en santé publique de l'Université de la Caroline du Nord. Elle est membre du Collège des médecins de famille du Canada. La Dre Ogilvie a conseillé de nombreuses institutions nationales et mondiales sur les infections transmissibles sexuellement, le VIH, la vaccination contre le VPH et les politiques et programmes relatifs au cancer du col de l'utérus. Elle a reçu de nombreuses distinctions, notamment son élection comme membre de la Société royale du Canada (2024) et de l'Académie canadienne des sciences de la santé (2022). Elle a également reçu le prix de recherche Killam de l'Université de la Colombie-Britannique (2021), le prix d'excellence du médecin-hygiéniste en chef en santé publique (2015), ainsi que le titre de Chercheuse de l'année décerné par le Collège des médecins de famille du Canada (2014).
Dre Louise Potvin
La Dre Potvin est professeure titulaire à l'École de Santé publique de l'Université de Montréal. Elle est directrice scientifique du Centre de recherche en santé publique et titulaire de la Chaire de Recherche du Canada sur les Approches communautaires et les inégalités de santé. Ses recherches portent sur les interventions communautaires en prévention et le rôle des conditions de vie dans la création des inégalités sociales de santé. Elle a dirigé ou codirigé la publication de onze anthologies, douze numéros thématiques dans des revues spécialisées, et a publié plus de 350 articles, chapitres de livre, éditoriaux et commentaires. Elle a été rédactrice en chef de la Revue canadienne de santé publique de 2014 à 2023. Elle est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Elle est récipiendaire du Prix Pionnier 2019 de l'Institut de santé publique et des populations des Instituts de recherche en santé du Canada, ainsi que le prix R.D. Defries 2021 de l'Association canadienne de santé publique, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au domaine de la santé publique. La Dre Potvin est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université Concordia et d'un doctorat en santé communautaire de l'Université de Montréal.
Dre Caroline Quach-Thanh
La Dre Caroline Quach-Thanh a débuté sa carrière à l'Université McGill dans le département de Pédiatrie avant de se joindre à l'Université de Montréal à titre de professeure titulaire aux départements de microbiologie, maladies infectieuses et immunologie, ainsi que de pédiatrie. Clinicienne chercheuse, elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada, niveau 1 en prévention et contrôle des infections : de l'hôpital à la communauté. Elle est la directrice du réseau POPCORN. La Dre Quach-Thanh a été présidente du Comité consultatif national en immunisation de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et elle est actuellement la présidente du Comité sur l'immunisation du Québec. Elle a été nommée membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et de la Society for Healthcare Epidemiology of America, et a été reconnue parmi les femmes les plus influentes du Canada. En 2022, elle a été nommée officière de l'Ordre national du Québec, a reçu le prix du Distinguished Scientist Award de la Société canadienne d'investigation clinique, ainsi que le Women of Distinction Award — Public Service décerné par la Fondation du Y des femmes. En 2023, elle a reçu le Certificate of Merit de l'Association canadienne de santé publique et, en 2024, elle a été admise comme membre étrangère de l'Académie royale de médecine de Belgique. La Dre Quach-Thanh est diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a complété sa résidence en pédiatrie au CHU Sainte-Justine, puis sa formation postdoctorale en maladies infectieuses et microbiologie médicale à l'Université McGill, où elle a également obtenu une maîtrise en épidémiologie.
Dre Janet Tootoosis
La Dre Janet Tootoosis est une femme crie de la Nation crie de Poundmaker. Elle exerce la médecine de famille depuis 2001 à North Battleford, en Saskatchewan. Elle est professeure associée d'enseignement clinique au Collège de médecine de l'Université de Saskatchewan depuis 2008 et est propriétaire et directrice de la clinique médicale de North Battleford Inc. La Dre Tootoosis est profondément engagée dans l'amélioration de l'offre de soins de santé et dans les initiatives de formation médicale, tant au niveau régional que provincial. Elle a également été formatrice et directrice de site pour le programme de résidence de North Battleford du Collège de médecine de l'Université de Saskatchewan. De plus, elle possède une solide expérience en gouvernance, ayant siégé au conseil d'administration de l'Association médicale de la Saskatchewan de 2014 à 2017, ainsi qu'au tout premier conseil d'administration de l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan de 2017 à 2021. La Dre Tootoosis occupe actuellement le poste de vice-doyenne à la santé des Autochtones au Collège de médecine de l'Université de Saskatchewan.
Dre Gaynor Watson-Creed
La Dre Gaynor Watson-Creed s'est jointe à l'Université Dalhousie en 2018 à titre de première vice-doyenne du programme de l'engagement social à la Faculté de médecine. Elle est également professeure adjointe au Département de santé communautaire et d'épidémiologie. Spécialiste en santé publique, elle a été médecin-hygiéniste pour la région d'Halifax de 2005 à 2017, puis médecin-hygiéniste en chef adjointe pour la Nouvelle-Écosse de 2017 à 2021. La Dre Watson-Creed est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Dalhousie, d'une maîtrise ès sciences (M.Sc.) de l'Université de Guelph, et d'un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle a également reçu des doctorats honorifiques de l'Université Acadia et de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle siège à titre de présidente ou de membre de plusieurs conseils nationaux liés à la santé des populations, et a été nommée en 2023 au Conseil consultatif de l'Institut de la santé publique et des populations des Instituts de recherche en santé du Canada. La Dre Watson-Creed est actuellement la présidente du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé.
Annexe 3 : Experts techniques
Dre Ève Dubé
Ève Dubé est professeure d'anthropologie à l'Université Laval à Québec, Canada, et chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval. Son domaine d'expertise est l'anthropologie de la santé publique. Elle s'intéresse particulièrement aux aspects sociaux, culturels, historiques et religieux de la prévention des maladies infectieuses. Elle est titulaire d'une chaire de recherche appliquée en santé publique des Instituts de recherche en santé du Canada sur l'anthropologie de la vaccination. Depuis 2014, elle préside le Réseau des sciences sociales et humaines du Réseau canadien de recherche sur l'immunisation. Elle siège à plusieurs comités canadiens (par exemple, le Comité consultatif national de l'immunisation, l'Association canadienne pour la recherche et l'évaluation en immunisation) et internationaux (par exemple, le Groupe consultatif stratégique et technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les risques infectieux, le Comité consultatif mondial de l'OMS sur la sécurité des vaccins) en tant qu'experte en acceptabilité vaccinale.
Dr Craig Earle
Craig Earle, MD MSc FRCP(C), est le directeur général du Partenariat canadien contre le cancer, oncologue médical à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, spécialisé dans les cancers gastro-intestinaux, chercheur en services de santé et scientifique principal à l'Institut des sciences évaluatives cliniques (ICES), ainsi que professeur de médecine à l'Université de Toronto. Le Dr Earle a d'abord été formé et a exercé à Ottawa avant de passer dix ans (de 1998 à 2008) à Boston, où il a travaillé à la Harvard Medical School, au Dana-Farber Cancer Institute et à la Harvard School of Public Health. De 2008 à 2017, il a été directeur de la recherche sur les services de santé et responsable de la traduction clinique à l'Ontario Institute for Cancer Research.
Dr Cordell (Cory) Neudorf
Le Dr Cordell Neudorf est un médecin comptant plus de 30 ans d'expérience en leadership en santé publique et professeur au Département de santé communautaire et d'épidémiologie de la Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Il a occupé les fonctions de médecin-hygiéniste principal au sein de l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan et de la Région sanitaire de Saskatoon. Parmi ses anciens rôles, il a été président du Conseil de l'Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), président de l'Association canadienne de santé publique et président des Médecins de santé publique du Canada. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de la Saskatchewan et a suivi une formation médicale postdoctorale en santé publique et médecine préventive à l'Université de Toronto, où il a également obtenu une maîtrise en sciences de la santé (MHSc).
Le Dr Neudorf est rédacteur en chef principal du Canadian Journal of Public Health, président du Réseau de santé publique urbaine du Canada et membre de liaison avec le Réseau des Régions pour la Santé (OMS Europe). En 2020, il a reçu la médaille R.D. Defries de l'Association canadienne de santé publique pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la santé publique.
Mme Maureen Smith
Mme Smith est une partenaire patiente/citoyenne qui collabore à des projets nationaux et internationaux. Elle est profondément engagée dans les partenariats avec les citoyens et les patients, selon le contexte. Son intérêt, tant en tant qu'utilisatrice que productrice de données probantes, est ancré dans son parcours de soins depuis l'enfance et dans son désir de veiller à ce que les voix des patients et du public soient intégrées à la recherche en santé et aux lignes directrices. Elle a dirigé l'engagement citoyen du COVID-END (Réseau de données probantes sur la COVID-19 pour soutenir la prise de décision). Mme Smith a été commissaire à la Commission mondiale sur les données probantes pour répondre aux défis sociétaux et a co-dirigé le Groupe de leadership citoyen de son Conseil de mise en œuvre. En 2024, elle a été nommée au Conseil d'administration de l'Agence canadienne des médicaments en tant que première membre ayant une expérience vécue. Mme Smith est professeure associée à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, une reconnaissance de son expertise en participation des patients depuis plus de 25 ans.
Annexe 4 : Personnes ayant fourni une présentation écrite
| Nom | Nom Organisations |
|---|---|
| Elie Akl | Université américaine de Beyrouth |
| Lisa Askie | L'Organisation mondiale de la santé |
| Julian Elliott | Université McMaster, Forum sur la santé |
| Jeremy Grimshaw | Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa/Université d'Ottawa |
| Doris Grinspun | Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario |
| Alfonso Iorio | Université McMaster, Département des méthodes, des données probantes et de l'impact de la recherche en santé |
| Gillian Leng | National Institute for Health and Care Excellence, Angleterre |
| Jennifer Petkovic | Le Centre pour l'équité en santé d'Ottawa |
| Rob Reid | Rapid Improvement and Support Exchange (RISE), Trillium Health Partners' Institute for Better Health, Canada |
| Donna Reynolds | Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs |
| Lena Salach | Centre for Effective Practice, University of Toronto, Canada |
| Sharon Straus | Université de Toronto, Département de médecine/Unity Health Toronto |
| Guylaine Thériault | Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs |
| Matthew Tunis | Agence de la santé publique du Canada |
| Ross Upshur | Université de Toronto, Centre conjoint de bioéthique, École Dalla Lana |
| Per Olav Vandvik | MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, Norvège |
| Sarah Viehbeck | Agence de la santé publique du Canada |
Annexe 5 : Personnes, organisations parties prenantes, entités gouvernementales et institutions académiques ayant fourni des contributionsNote de bas de page 5
Personnes
- Kimberly Anderson-hill
- Shiela Appavoo
- Monique A Bertrand
- Mylaine Breton
- Samuel Boudreault
- Carol Cancelliere
- Simon Coiteux
- Nicole Corrado
- James A. Dickinson
- Michel Donoff
- Andrea Douglas
- Maxine Dumas Pilon
- Duncan Etches
- Isabelle Gaboury
- Roland Grad
- Ilona Hale
- Jason Hamm
- Beth Hayhoe
- Fanny Hersson-Edery
- Chloé Jamaty
- Ian Johnston
- Ümit Kiziltan
- Julie Laurence
- Michael May
- Adrienne Lindblad
- Samantha Moe
- Anthony Morham
- Kim Moshurchak
- Eli Newman
- Jessica Otte
- Nav Persaud
- Donna Reynolds
- Janet Reynolds
- Davin Shikaze
- Daniel Sin
- E. R. Snyman
- Jerrett Stephenson
- Marcello Tonelli
- Mark Tremblay
- Joan Tu
- Anna Wilkinson
- Martin J. Yaffe
Organisations parties prenantes, et entités gouvernementales et institutions académiques
- Action Cancer Manitoba
- Alberta Health Services Soins du cancer
- Allergies alimentaires Canada
- Association canadienne d'oncologie psychosociale
- Association canadienne des aliments de santé (Sonia Parmar)
- Association canadienne des radiologistes
- Association canadienne des troubles anxieux
- Association canadienne pour la prévention cardiovasculaire et de réadaptation
- Association chiropratique canadienne (Ayla Azad)
- Association des infirmières et infirmiers du Canada (Valerie Grdisa, Kimberly Leblanc)
- Association des médecins omnipraticiens de l'Outaouais
- Association des pharmaciens du Canada (Danielle Paes)
- Association des psychiatres du Canada
- Association des spécialistes en médecine préventive du Québec
- Association des urologues du Canada
- Association québécoise de physiothérapie
- BC Cancer Autorité provinciale des services de santé
- Projet canadien des guides de pratique Chiropratique
- Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety
- Cancer du sein du Canada (Kimberly Carson)
- Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
- Centre de surveillance et de programmes de vaccination
- Centre for Effective Practice
- Choisir avec soin Canada (Wendy Levinson)
- Choisir avec soin Québec (René Wittmer)
- Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
- Collège des médecins de famille du Canada (Michael Allan)
- Collège des médecins du Québec
- Collège québécois des médecins de famille
- Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages
- Congrès du travail du Canada
- Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé
- Dense Breast Canada (Jennie Dale)
- Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
- Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario
- Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
- Ostéoporose Canada
- Partenariat canadien contre le cancer
- Réseau canadien d'angiœdème héréditaire
- Réseau canadien du cancer du sein
- Rethink Breast Cancer
- Santé Manitoba
- Société canadienne d'imagerie mammaire
- Société canadienne des anesthésistes
- Société canadienne du cancer
- Société d'oncologie gynécologique du Canada (Sharon Salvador)
- Université de McGill, Département de médecine de famille (Marion Dove)
Annexe 6 : Synthèse des mémoires des parties prenantes
Ce que nous avons entendu : Contribuez à moderniser le développement des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada
Contexte
Le 9 octobre 2024, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'un Comité d'examen externe (CEE — ci-après appelé le Comité) du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (le Groupe d'étude). Le Comité, composé de 13 experts de divers domaines du secteur de la santé avait pour mandat d'évaluer le Groupe d'étude et de proposer des améliorations à sa gouvernance, à son mandat et à ses activités.
Dans le cadre de ses travaux, le Comité a tenu une consultation publique du 21 novembre au 21 décembre 2024 afin de recueillir des points de vue sur la façon de moderniser l'élaboration des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada.
Qui a participé
Le Comité a reçu 74 mémoires écrits provenant de particuliers et d'organisations de l'ensemble du pays.
Par région
La répartition géographique des mémoires est présentée à la Figure A :
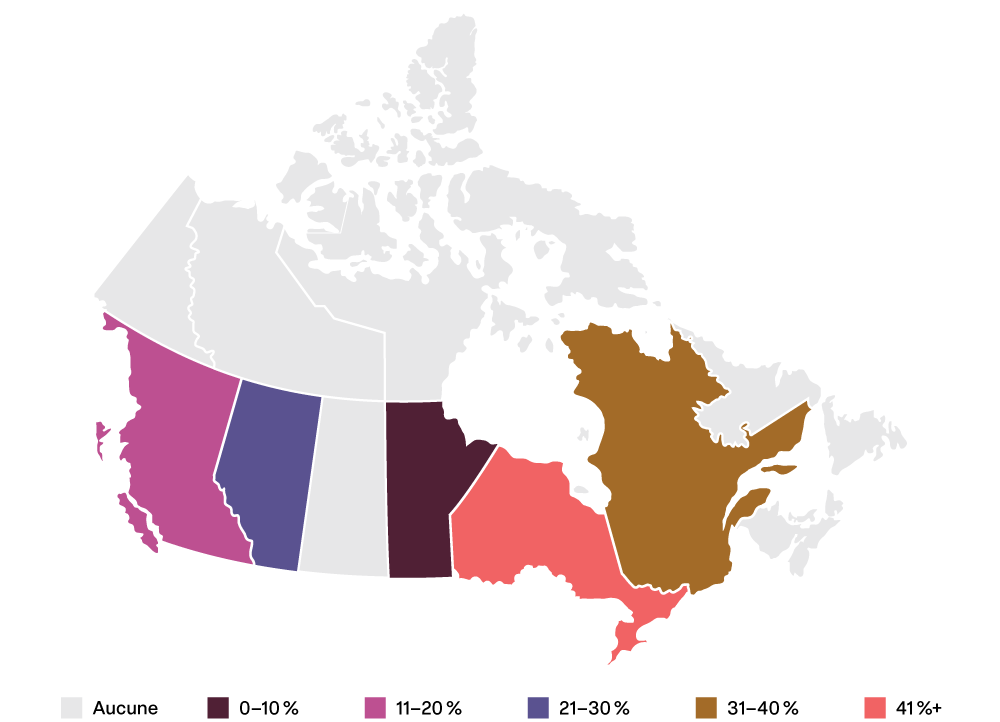
Figure A : Équivalent textuel
La Figure A illustre la répartition géographique des mémoires reçus dans le cadre d'une consultation publique ou d'un processus de rétroaction à l'échelle du Canada. Les données sont présentées par province ou territoire, et le nombre de mémoires varie selon les régions.
- L'Ontario a enregistré le plus grand nombre de mémoires, soit 35 au total, représentant la plus forte participation.
- Le Québec arrive en deuxième position avec 17 mémoires.
- L'Alberta a soumis 12 mémoires, témoignant également d'un engagement important.
- La Colombie-Britannique a transmis 7 réponses, indiquant une participation modérée.
- Le Manitoba a présenté 1 mémoire.
- Aucun mémoire n'a été reçu des autres provinces ou territoires.
La majorité des mémoires provenaient de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta, avec des contributions supplémentaires en provenance de la Colombie-Britannique et du Manitoba.
Par type de participants :
53 % des mémoires reçus provenaient de personnes, plus précisément :
- Des médecins de famille (19)
- Des médecins spécialistes [5]
- Des experts non-médecins [6]
- Des membres du public et représentants du secteur privé [9]
47 % des mémoires reçus provenaient d'organisations, notamment :
- Des associations de professionnels de la santé (15)
- Des organisations non gouvernementales (15)
- Des institutions universitaires (1)
- Des autorités sanitaires provinciales et territoriales (2)
- D'autres organisations [2]
Cette consultation a permis de recueillir un large éventail de points de vue, provenant de personnes et d'organisations de différents milieux et de partout au pays.
Questions de la consultation :
Les participants étaient invités à répondre à trois questions :
- Gouvernance : Quels aspects de la gouvernance ou de la structure du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (Groupe d'étude) devraient être maintenus ou modifiés pour favoriser davantage la transparence, la responsabilisation, l'indépendance et le leadership, en vue de lignes directrices scientifiquement rigoureuses, opportunes, souples et inclusives?
- Mandat : Compte tenu des multiples acteurs qui œuvrent dans le domaine de la santé préventive, quel devrait être le mandat futur du Groupe d'étude et comment devrait-il collaborer avec les autres entités qui contribuent à l'élaboration de lignes directrices aux niveaux national et international?
- Engagement : Comment le Groupe d'étude peut-il renforcer l'engagement des parties prenantes, y compris les experts en la matière, les communautés méritant l'équité et d'autres groupes, pour remédier aux disparités en matière d'équité en santé et refléter la diversité canadienne dans l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices?
Ce que nous avons entendu
Les réactions au Groupe d'étude ont été mitigées, les répondants ayant exprimé des points de vue variés sur sa gouvernance, son mandat et ses efforts de mobilisation, soulignant à la fois leur soutien et les domaines à améliorer. Les répondants ont proposé une série de changements qui ont été classés comme étant peu importants, assez importants ou très importants. De nombreux répondants ont noté que le Groupe d'étude accomplit beaucoup, malgré des ressources limitées et sa dépendance à l'égard des membres bénévoles, dont beaucoup renoncent à des revenus cliniques pour participer à ses travaux.
Ils ont mis en évidence à la fois les défis et les possibilités d'amélioration, une forte majorité des personnes ayant répondu recommandant des changements, soulignant la nécessité de nouvelles approches, comme le montre la figure B.

Figure B : Équivalent textuel
La figure B présente les commentaires recueillis lors de la consultation publique sur le Groupe d'étude, en mettant particulièrement l'accent sur les points de vue des participants concernant l'importance d'apporter des changements dans trois domaines : la gouvernance, le mandat et la mobilisation.
Les répondants devaient indiquer s'ils jugeaient les changements dans chacun de ces domaines comme étant très importants, assez importants, peu importants, ou s'ils préféraient maintenir le statu quo. Une catégorie « aucune réponse » regroupe ceux qui n'ont pas donné d'avis pour un domaine donné.
Gouvernance :
- 15 % des répondants ont estimé que des changements à la gouvernance du Groupe d'étude étaient très importants.
- 23 % ont répondu que c'était assez important.
- 45 % ont indiqué que ce n'était pas très important.
- 11 % ont préféré maintenir la structure actuelle (statu quo).
- 7 % n'ont pas répondu.
Mandat :
- 0 % des répondants ont jugé que modifier le mandat était très important.
- 27 % l'ont considéré assez important.
- Une majorité (51 %) a estimé que ce changement n'était pas très important.
- 8 % ont préféré maintenir le statu quo.
- 14 % n'ont pas répondu.
Mobilisation :
- 9 % des participants ont considéré que changer les pratiques de mobilisation du Groupe d'étude était très important.
- 26 % les ont jugées assez importantes.
- 45 % ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un enjeu très important.
- 5 % ont préféré maintenir les pratiques actuelles.
- 15 % n'ont pas répondu.
La suite de ce rapport résume les principales idées de la consultation organisée par thème.
Principaux thèmes
- Gouvernance :
Le Groupe d'étude bénéficie généralement d'une bonne réputation, mais plusieurs estiment qu'il pourrait être mieux structuré et mieux soutenu. Certains suggèrent d'élargir sa composition au-delà des médecins, en intégrant d'autres professionnels de la santé, des patients, des éthiciens et des représentants communautaires, afin d'apporter une plus grande diversité de perspectives. D'autres soulignent toutefois l'importance de maintenir les médecins de famille au cœur du groupe, compte tenu de leur rôle central dans les soins primaires et la prévention.
Une autre préoccupation est liée à l'appui essentiel des bénévoles au Groupe d'étude. Beaucoup estiment que cette approche restreint la participation, en particulier pour ceux qui ne bénéficient pas de financement institutionnel, comme les professionnels exerçant hors du milieu universitaire. Offrir une compensation ou un autre type de soutien pourrait permettre d'attirer un groupe plus diversifié et de consolider l'expertise du Groupe d'étude.
De plus, certains répondants remettent en question le processus décisionnel actuel et recommandent une meilleure intégration des médecins spécialistes afin d'enrichir la diversité des perspectives. Une approche combinant généralistes et spécialistes, tout en assurant une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, pourrait renforcer la crédibilité et la confiance du public envers les recommandations du Groupe d'étude.
Dans l'ensemble, de nombreux répondants ont souligné la nécessité d'accroître la transparence et l'obligation de rendre des comptes afin de maintenir et de renforcer la confiance du public dans les recommandations du Groupe d'étude.
Mandat :
Le Groupe d'étude est reconnu pour la qualité de ses recommandations fondées sur des données probantes en matière de soins préventifs. Son travail bénéficie d'un soutien de nombreux médecins de famille, mais certains répondants estiment que des améliorations sont possibles afin d'accroître son impact et son adaptabilité aux réalités actuelles.
L'un des points soulevés concerne la prise en compte des facteurs sociaux, économiques, et d'accessibilité aux services dans l'élaboration des recommandations. Ces éléments jouent un rôle essentiel dans le bien-être des individus et influencent directement l'efficacité des soins préventifs. En intégrant davantage ces dimensions, le Groupe d'étude pourrait mieux répondre aux défis en matière d'équité en santé, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à soutenir les communautés les plus vulnérables.
Bien que la rigueur scientifique de sa méthodologie soit reconnue, certaines préoccupations ont été exprimées quant à l'importance accordée aux études plus anciennes dans l'évaluation des données probantes. Pour améliorer encore la pertinence des recommandations, plusieurs suggèrent d'élargir la base de données probantes en intégrant des sources complémentaires, telles que des données du monde réel, des études observationnelles et des analyses de coût-efficacité.
Un autre défi identifié concerne la fréquence de mises à jour des recommandations, les personnes interrogées souhaitant des mises à jour plus fréquentes. Une solution proposée serait d'adopter des lignes directrices évolutives (« vivantes »), mises à jour en continu au fur et à mesure de l'émergence de nouvelles données scientifiques. De plus, renforcer les collaborations avec les organisations nationales et internationales de santé faciliterait l'actualisation des recommandations et garantirait que les lignes directrices restent alignées sur les meilleures pratiques mondiales, tout en répondant aux besoins spécifiques du Canada.
Engagement :
Les opinions divergent quant à la manière dont le Groupe d'étude interagit avec les autres professionnels de la santé dans son écosystème. Certains apprécient son engagement étroit auprès des médecins de famille. Toutefois, avec l'évolution des systèmes de santé et la diversification des acteurs impliqués dans les soins préventifs, d'autres estiment qu'il devrait également renforcer ses liens avec d'autres acteurs des soins de santé primaires.
Cette collaboration élargie favoriserait une meilleure intégration des différentes expertises et permettrait de développer des recommandations plus représentatives des réalités et défis terrain, tout en s'adaptant aux besoins changeants du système de santé.
De nombreuses personnes ont suggéré de mettre en place des groupes consultatifs réunissant des professionnels de la santé en soins primaires, des chercheurs, des patients et des membres du public, afin d'intégrer un plus large éventail de points de vue. L'accent a été mis sur la nécessité d'accroître la diversité des voix consultées et d'adopter des processus décisionnels plus inclusifs. Pour améliorer la communication, les recommandations incluaient l'utilisation d'un langage simple et accessible, la diffusion de matériel dans les deux langues officielles et une interaction plus proactive avec le public. Un dialogue renforcé avec les médecins spécialistes, les communautés autochtones et les groupes touchés par des inégalités est jugé essentiel pour élaborer des lignes directrices pertinentes et inclusives.
Pour encourager une participation plus active, plusieurs approches ont été suggérées. Parmi elle, l'organisation de consultations structurées, telles que des groupes de discussion, des sondages et des périodes de commentaires publics afin de recueillir un large éventail de perspectives. Il a aussi été recommandé de mettre en place un programme d'intégration pour les partenaires patients afin de faciliter leur engagement, ainsi que d'utiliser les outils numériques pour mieux rejoindre les populations vivant dans des régions éloignées.
La mise en place de mécanismes de rétroaction structurés assurerait une amélioration continue et permettrait de mieux intégrer les points de vue des différents groupes concernés. En adoptant ces mesures, le groupe d'étude pourrait formuler des recommandations encore mieux adaptées aux besoins et à la diversité des personnes vivant au Canada.
Conclusion
En tenant compte des évolutions du système de santé et des attentes croissantes en matière d'équité, d'inclusivité et de rigueur scientifique, il est essentiel que le Groupe d'étude continue d'adapter ses méthodes et son mandat. Renforcer la diversité des perspectives, mettre à jour régulièrement les recommandations et favoriser une collaboration accrue avec les parties prenantes contribueront à assurer des lignes directrices plus représentatives et adaptées aux besoins des personnes vivant au Canada. En poursuivant ces améliorations, le Groupe d'étude pourra consolider son rôle en tant que référence en matière de soins préventifs et renforcer la confiance du public et des professionnels de la santé.
Le Comité remercie tous les participants pour leurs contributions puisqu'elles fournissent des perspectives essentielles qui guideront les efforts de modernisation du groupe d'étude et l'amélioration du processus d'élaboration des lignes directrices.
Annexe 7 : Comparaison avec des organismes internationaux d'élaboration de lignes directrices
L'annexe 7 compare la façon dont quatre pays — les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada — développent leurs lignes directrices nationales en santé préventive. Cette comparaison porte sur le rôle de chaque organisation, leur structure de gouvernance, leurs méthodes d'évaluation des données probantes et leurs approches d'engagement du public et des professionnels de santé.
États-Unis — US Preventive Services Task Force (USPSTF)
Rôle :
Ce groupe élabore des recommandations pour prévenir les maladies, par exemple sur le dépistage, les conseils de prévention ou certains médicaments. Il a publié 13 lignes directrices entre 2022 et 2023.
Gouvernance :
Le groupe est indépendant, mais reçoit du soutien d'un organisme fédéral. Il regroupe 16 experts bénévoles en prévention. Il est financé par le gouvernement des États-Unis.
Méthodologie :
Ils utilisent des revues scientifiques rigoureuses pour évaluer les données, avec une méthode semblable à celle appelée « GRADE ». Le coût des interventions n'est pas pris en compte dans leurs décisions.
Engagement du public :
Le public peut commenter les plans de recherche et les recommandations provisoires. Tout est disponible en ligne.
Royaume-Uni — National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Rôle :
NICE produit des recommandations sur les soins de santé, la santé publique et l'utilisation judicieuse des ressources. Il a publié 17 lignes directrices entre 2022 et 2023.
Gouvernance :
C'est un organisme indépendant financé par le gouvernement du Royaume-Uni. Son conseil comprend des professionnels de la santé, des représentants du public et des gestionnaires.
Méthodologie :
Ils évaluent à la fois l'efficacité clinique et le coût. Leurs groupes de travail incluent des économistes, des statisticiens, des patients et des experts médicaux. Ils consultent les parties prenantes à chaque étape.
Engagement du public :
NICE organise des consultations publiques et publie ses décisions et rapports en ligne.
Australie — National Health and Medical Research Council (NHMRC)
Rôle :
Le NHMRC finance la recherche en santé, mais il élabore aussi des lignes directrices en prévention. Il en a publié 11 entre 2022 et 2023.
Gouvernance :
Il s'agit d'un organisme public dont le conseil regroupe 19 membres issus du gouvernement et d'autres secteurs. Il est financé par des fonds publics et des subventions de recherche.
Méthodologie :
Ils utilisent des analyses scientifiques basées sur des méthodes reconnues. Les comités incluent différents experts (santé, économie, patients, etc.). Ils consultent largement les milieux universitaires, cliniques et communautaires.
Engagement du public :
Le NHMRC consulte régulièrement les groupes concernés et rend ses travaux accessibles au public.
Canada — Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP)
Rôle :
Le Groupe d'étude développe des lignes directrices adaptées au système de santé canadien. Il a publié 2 lignes directrices entre 2022 et 2023.
Méthodologie :
Le Groupe est indépendant, mais il rend compte à l'Agence de la santé publique du Canada. Il est composé de 15 experts bénévoles. Il est financé par le gouvernement fédéral.
Gouvernance :
Ils s'appuient sur des revues systématiques et utilisent la méthode GRADE. Leurs panels incluent des experts cliniques, de santé publique et en méthodologie. Comme aux États-Unis, le coût n'est pas considéré.
Engagement du public :
Le Groupe consulte les cliniciens, les chercheurs et le public. Ses lignes directrices, résumés scientifiques et méthodes sont disponibles en ligne.
Conclusion
Ces quatre pays partagent un engagement envers des lignes directrices en santé préventive fondées sur les données probantes, mais leurs approches varient. En comprenant ces différences, le Canada peut tirer parti des pratiques exemplaires internationales pour renforcer la transparence, la pertinence et l'impact de son propre processus d'élaboration de lignes directrices en santé préventive.
Annexe 8 : Proposition d'organigramme pour le Groupe d'étude
Organigramme proposé pour le Groupe d'étude
Cette structure proposée décrit comment le Groupe d'étude devrait être organisé afin d'améliorer la transparence, l'équité et la reddition de comptes dans l'élaboration des lignes directrices en santé préventive. Elle comprend trois niveaux avec des rôles et responsabilités bien définis, ainsi que plusieurs groupes consultatifs pour garantir l'inclusion de points de vue diversifiés.
Niveau 1 : Surveillance fédérale et soutien central
Au plus haut niveau, la présidence de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) assurerait la surveillance fédérale et la reddition de comptes.
À ce niveau, les éléments de soutien suivants sont proposés :
- Un comité permanent de mise en candidature, chargé de conseiller la sélection des membres du Groupe d'étude. Ce comité devrait inclure des représentants de groupes d'intérêt clé, notamment des communautés en quête d'équité et des professionnels des soins primaires.
- Un secrétariat permanent au sein de l'ASPC, responsable du soutien administratif et scientifique. Cette équipe à temps plein assurerait la coordination, les communications et l'examen des données probantes pour appuyer les travaux du Groupe d'étude.
Niveau 2 : Prise de décision et conseils en équité
Au cœur de la structure se trouve l'organisme consultatif externe (anciennement appelé Groupe d'étude). Cet organisme serait responsable de la prise de décisions et du vote sur les lignes directrices en santé préventive.
Des groupes consultatifs à ce niveau comprendraient :
- Un comité consultatif sur l'équité, pour veiller à ce que tous les travaux soient réalisés avec une forte perspective d'équité. Ce comité devrait inclure des personnes ayant une expertise en équité en santé, en décolonisation, en lutte contre le racisme et en savoirs autochtones.
- Un réseau de conseillers publics du Groupe d'étude (TF-PAN), pour intégrer une perspective axée sur la communauté. Ce réseau devrait inclure des membres diversifiés du public, comme des patients, des proches aidants et des leaders communautaires de partout au Canada.
Niveau 3 : Groupes de travail thématiques
Le troisième niveau serait composé de groupes de travail temporaire (ad hoc) centrés sur des sujets précis de lignes directrices. Ces groupes :
- Seraient dirigés par un membre du Groupe d'étude,
- Comprendraient des experts cliniques et des spécialistes du sujet traité,
- N'auraient pas de droit de vote, mais fourniraient des avis techniques pour éclairer les recommandations.
Résumé
Cette structure vise à :
- Garantir une surveillance nationale et une transparence accrue,
- Fournir un soutien constant grâce à un secrétariat dédié,
- Renforcer l'équité et la participation du public par des comités consultatifs spécialisés,
- Intégrer l'expertise grâce à des groupes de travail qui alimentent les décisions fondées sur des données probantes.
Références
- Agence de la santé publique du Canada. (2017). Glossaire : Préparation du Canada en cas de grippe pandémique : Guide de planification pour le secteur de la santé - Canada.ca.
- Agence de la santé publique du Canada. (2022a). Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Mandat - Canada.ca.
- Agence de la santé publique du Canada. (Évaluation du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 2022b). - Canada.ca.
- Agence de la santé publique du Canada. (2022c). Glossaire - Canada.ca.
- Agence de la santé publique du Canada. (2024). Politique sur les organismes consultatifs externes - Canada.ca.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/organismes-consultatifs-externes/politique.html - Akl, E. (2024). Key Principles and Best Practices for the Management of Conflicts of Interest [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Askie, L. (2024). WHO Normative Product Development: What Works, What Could we Still do Better? [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Association des facultés de médecine du Canada. (2025). Chapitre 4 Les concepts de base de la prévention et de la promotion de la santé | AFMC Primer on Population Health.
- Chakraborty, S., Kuchenmüller, T., Lavis, J., El-Jardali, F., Mahlanza-Langer, L., Green, S., Reveiz, L., Carter, V., McFarlane, E., Pace, C., Askie, L., Glen, F., & Turner, T. (2024). Implications of living evidence syntheses in health policy. 102, 757.
- Comité interministériel de terminologie sur l'équité, l. d. e. l. i. (2022). Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et l'inclusion | Ressources du Portail linguistique du Canada.
- Comité interministériel de terminologie sur l'équité, l. d. e. l. i. (2024). Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et l'inclusion | Ressources du Portail linguistique du Canada.
- Dizon, J. M., Machingaidze, S., & Grimmer, K. (2016). To adopt, to adapt, or to contextualise? The big question in clinical practice guideline development. BMC Research Notes, 9(1).
- Elliott, J. H. (2024). Living Evidence: Accelerating Research to Use and Enabling Better Health Outcomes for All [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Georgiades, K. (2021). Expanding the evidence for population mental health in Canada: A call to action for evidence-informed policy and practice. Health Promot Chronic Dis Prev Can.
- Grimshaw, J. (2024). Presentation to the External Expert Review of the CTFPHC [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Grinspun, D. (2024). BPSO Program and its Social Movement [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE),Canada.
- Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. (2023). Méthodologie – Canadian Task Force on Preventive Health Care.
https://canadiantaskforce.ca/methodologie/?lang=fr - Institut canadien d'information sur la santé. (2025). Soins de santé primaires | ICIS.
- Instituts de recherche en santé du Canada. (2022). Repenser la santé par des soins intégrés : Domaines d'intérêt et éléments essentiels - IRSC.
- Iorio, A. (2024). Core GRADE [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Lenartowicz, M. (2023). Overview of Preventive Care - Fundamentals - Merck Manual Consumer Version.
- Leng, G. (2024). Experience from the NICE guidelines programme [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Nyantakyi, A. (2023). The Importance of Preventive Healthcare: Strategies for Better Health and Wellness. American Journal of Preventive Medicine and Public Health.
- Organisation mondiale de la santé. (2021). Health Promotion Glossary of Terms 2021.
- Organisation mondiale de la santé. (2025). Primary health care.
- Oxford University Press. (2025). Lived experience - Oxford Reference.
- Petkovic, J. (2024). GIN-McMaster Guideline Development Checklist - Engagement Extension [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Price, J. H., Khubchandani, J., McKinney, M., & Braun, R. (2013). Racial/Ethnic Disparities in Chronic Diseases of Youths and Access to Health Care in the United States. BioMed Research International, 2013, 787616.
- Reid, R. (2024). Learning Health System Action Framework [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., Richardson, W. S., & (1996). Evidence-based medicine: what it is and what it isn't. 312, 71-72.
- Salach, L. (2024). External Expert Review - Canadian Task Force on Preventive Health Care [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Santé Canada. (2012). ARCHIVÉE À propos des soins de santé primaires - Canada.ca.
- Santé Canada. (2023). Lignes directrices sur la participation du public 2023 : Glossaire - Canada.ca.
- Santé Canada. (2025a). Effectif en santé - Canada.ca.
- Santé Canada. (2025b). Les soins offerts aux Canadiens : l'avenir de l'effectif en santé au Canada -Étude sur l'éducation, la formation et la répartition de l'effectif en santé au Canada - Canada.ca.
- SaskCulture. (2024). Definitions of Governance.
- SPOR Evidence Alliance. (2025). Asset Map of Canadian Clinical Practice Guidelines
- Straus, S. E. (2024). Optimizing Guideline Development and Dissemination [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- The GRADE Working Group. (2025). GRADE home.
- Thériault, G., & Reynolds, D. (2024). The Canadian Task Force on Preventive Health Care [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Tunis, M. (2024). NACI approach to interest holders [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- University of Texas Libraries. (2025). Glossary of Terms - Systematic Reviews & Evidence Synthesis Methods - LibGuides at University of Texas at Austin.
- Upshur, R. E. G. (2024). Ethics and Evidence [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Vandvik, P. O. (2024). MAGICapp and Guidelines - Enhancing the Evidence Ecosystem in Canada [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.
- Venkateswaran, N., Feldman, J., Hawkins, S., Lewis, M. A., Armstrong-Brown, J., Comfort, M., Lowe, A., & Pineda, D. (2023). Bringing an Equity-Centered Framework to Research: Transforming the Researcher, Research Content, and Practice of Research
- Viehbeck, S. (2024). Administrative Mechanisms for Guidance Development at the Public Health Agency of Canada [Présentation PowerPoint]. Réunion du Comité d’examen externe (CEE), Canada.