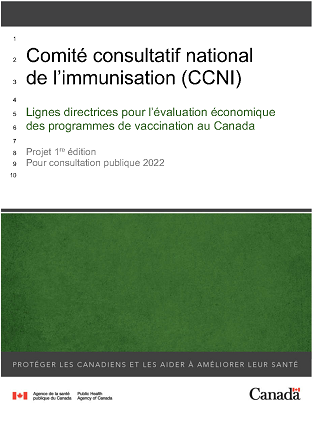Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI): Lignes directrices pour l’évaluation économique des programmes de vaccination au Canada
Télécharger en format PDF
(1,4 Mo, 134 pages)
Télécharger en format Word
(1,4 Mo, 134 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Publiée : 2022-04-14
Projet 1re édition
Pour consultation publique 2022
Sur Cette Page
- Remerciements
- Déclaration de conflits d'intérêts
- Abréviations
- Glossaire
- Introduction
- Énoncés des lignes directrices
- Les lignes directrices en détail
- Annexe 1 : Tableau d'inventaire des effets
- Annexe 2 : Spécifications des analyses de référence
- Références
Remerciements
Membres et agents de liaison du groupe de travail sur les lignes directrices économiques du CCNI
Les membres du groupe de travail étaient responsables de la détermination et de la discussion des principales questions liées à chaque sujet, de la rédaction des sections des sujets, de l’examen de toutes les sections provisoires des sujets, de l’examen du projet de rapport consolidé, de l’examen par les pairs et des commentaires des intervenants, ainsi que de l’examen et de l’approbation de la version finale des lignes directrices.
Membres de l’ASPC :
- Man Wah Yeung, M. Sc.
Économiste principale de santé
ASPC
Toronto (Ontario) - Austin Nam, Ph. D.
Économiste principale de santé
ASPC
Toronto (Ontario) - Ashleigh Tuite, Ph. D.
Gestionnaire
| ASPC
Toronto (Ontario) - Althea House, B. Sc. nat.
Gestionnaire
ASPC
Ottawa (Ontario) - Matthew Tunis, Ph. D.
Secrétaire général
ASPC
Ottawa (Ontario)
Entrepreneur :
- Nina Lathia, Ph. D.
Économiste de la santé
Pas d’affiliation
Toronto (Ontario)
Membres académiques :
- Beate Sander, Ph. D., inf. aut., M.B.A., M. Dév. éc.
Coprésidente du groupe de travail et membre du CCNI
Directrice, Toronto Health Economics and Technology Assessment (THETA) Collaborative
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Murray Krahn, M.D., M. Sc., FRCPC
Coprésident du groupe de travail
Directeur, Toronto Health Economics and Technology Assessment (THETA) Collaborative
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Stirling Bryan, Ph. D., M. Sc.
Professeur
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver (Colombie-Britannique) - Werner Brouwer, Ph. D., M. Sc.
Professeur
Université Erasmus de Rotterdam
Rotterdam, Pays-Bas - Mark Jit, Ph. D., MSP
Professeur
École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres
Londres, Royaume-Uni - Karen M. Lee, M.A.
Agente de liaison avec l’ACMTS
Directrice, Économie de la santé
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)
Ottawa (Ontario) - Monika Naus, M.D., M.Sc.S., FRCPC, FACPM
Agente de liaison provinciale-territoriale et agente de liaison avec le CCNI
Directrice médicale, Service des maladies transmissibles et de l’immunisation
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Vancouver (Colombie-Britannique) - Sachiko Ozawa, Ph. D., M.Sc.S.
Professeure agrégée
Université de Caroline du Nord à Chapel Hill
Chapel Hill, Caroline du Nord - Lisa Prosser, Ph. D.
Professeure
Université du Michigan
Ann Arbor, Michigan
Examinateurs
L’ASPC tient à remercier les examinateurs universitaires et le groupe de travail sur l’économie du CCNI (groupe de travail jumeau) pour leur examen par les pairs des lignes directrices complètes.
Examinateurs universitaires :
- Bohdan Nosyk, Ph. D.
Université Simon Fraser
Burnaby (Colombie-Britannique) - Christopher McCabe, Ph. D.
Ellen Rafferty, Ph. D.
Jeff Round, Ph. D.
Sasha van Katwyk, M. Sc.
Kate Harback, Ph. D.
Erin Kirwin, M.A.
au nom de
Institut d’économie de la santé
Edmonton (Alberta) - David Fisman, Ph. D.
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Wendy Ungar, Ph. D.
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Ava John-Baptiste, Ph. D.
Université Western
London (Ontario) - Lauren Cipriano, Ph. D.
Université Western
London (Ontario) - Kim Dalziel, Ph. D.
Université de Melbourne
Melbourne, Australie - Susan Kirkland, Ph. D.
Université de York
York, Angleterre
Membres du groupe de travail sur l’économie du CCNI :
- Beate Sander, Ph. D., inf. aut., M.B.A., M. Dév. éc.
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Ellen Rafferty, Ph. D.
Institut d’économie de la santé
Edmonton (Alberta) - David Fisman, Ph. D.
Université de Toronto
Toronto (Ontario) - Bernice Tsoi, Ph. D.
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)
Ottawa (Ontario) - Philippe De Wals, M.D., Ph. D.
Université Laval
Québec (Québec) - Joanne Langley, M.D., FRCPC
Université Dalhousie
Halifax (Nouvelle-Écosse) - Monika Naus, M.D., M.Sc.S., FRCPC, FACPM
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Vancouver (Colombie-Britannique) - Kristin Klein, M.D., FRCPC
Organisme de santé publique Alberta Health Services
Edmonton (Alberta)
Collaborateurs
L’ASPC tient à remercier les personnes suivantes pour leurs contributions :
Collaborateurs universitaires :
- Lisa Schwartz, Ph. D., M.A. – a contribué à l’élaboration du chapitre sur l’équité
- Richard Cookson, Ph. D., MPhil – a contribué à l’élaboration du chapitre sur l’équité
- Pieter van Baal, Ph. D. – a contribué à l’élaboration du chapitre sur l’utilisation et les coûts des ressources
Collaborateurs de Services aux Autochtones Canada (SAC) :
- Kendra Hardy, M.A. – a révisé l’avant-propos, le chapitre sur l’équité et le chapitre sur les types d’évaluation
- Melanie Knight, B. Sc. Inf., i.a. – a révisé le chapitre sur l’équité et le chapitre sur les types d’évaluation
- Andrea Monahan, B. Sc. Inf., i.a., MSP – a révisé l’avant-propos
- Denise Hamilton, MPA – a révisé l’avant-propos
- Tom Wong, M.D. – a révisé l’avant-propos, le chapitre sur l’équité et le chapitre sur les types d’évaluation
- Kim Daly, B. Sc. Inf., i.a., M. Nurs. – a révisé l’avant-propos
- Pamela Wolfe-Roberge, B.A. – a révisé le chapitre sur l’équité et le chapitre sur les types d’évaluation
Collaborateurs du Groupe consultatif en matière d’éthique en santé publique :
- Diego Silva, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’équité
- Béatrice Godard, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’équité
- Boluwaji Ogunyemi, M.D. – a révisé le chapitre sur l’équité
- Cassandra Opikokew Wajuntah, Ph. D. (c) – a révisé le chapitre sur l’équité
- Maxwell J. Smith, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’équité
- A.M. Viens, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’équité
- Alice Virani, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’équité
Collaborateurs du CCNI :
- Sheela Ramanathan, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’efficacité
- Kyla Hildebrand, M.D., M. Sc. SC – a révisé le chapitre sur l’efficacité
- Matthew Miller, Ph. D. – a révisé le chapitre sur l’efficacité
Collaborateurs de l’ASPC :
- Shainoor Ismail, M.D., M. Sc. – a révisé le chapitre sur l’équité
- Angela Sinilaite, MSP – a révisé le chapitre sur l’équité
- Alexandra Cernat, M. Sc. – a fourni un soutien en matière de référencement
- Amanda Sumner, M.A. – a fourni un soutien technique au début du projet
- Christine Mauviel, B.A. – a fourni un soutien à la gestion de projet.
- Chantale Tremblay, B. Sc. – a fourni un soutien à la gestion de projet
- Caroline Rodriguez-Charette, B.J. – a fourni un soutien à la gestion de projet
- Siobhan Kelly, B.A. – a fourni un soutien à la gestion de projet
- Jennifer Daniel – a fourni un soutien à la gestion de projet
- L’ASPC tient à souligner les discussions qui ont eu lieu lors des réunions du CCNI avec les membres du CCNI, les agents de liaison et les membres d’office, ainsi que l’examen de ces derniers.
Membres du CCNI :
- Shelley Deeks, M.D., Santé et Mieux-être (Nouvelle-Écosse)
- Robyn Harrison, M.D., M. Sc., FRCPC, organisme de santé publique Alberta Health Services
- Melissa Andrew, M.D., M. Sc., Université Dalhousie
- Julie Bettinger, Ph. D., MSP, Institut de recherche de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique
- Nicholas Brousseau, M.D., M. Sc., Institut national de santé publique du Québec
- Philippe De Wals, M.D., Ph. D., Université Laval
- Hélène Decaluwe, M.D., Ph. D., Université de Montréal
- Ève Dubé, Ph. D., Université Laval
- Vinita Dubey, M.D., MSP, Université de Toronto
- Kyla Hildebrand, M.D., M. Sc. SC, Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique
- Kristin Klein, M.D., organisme de santé publique Alberta Health Services
- Jesse Papenburg, M.D., Hôpital de Montréal pour enfantsAnne Pham-Huy, M.D., Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario
- Susan Smith, inf. aut., gouvernement de l’Alberta
- Sarah Wilson, M.D., M. Sc., Santé publique Ontario
Agents de liaison avec le CCNI :
- Lucie Marisa Bucci, Association canadienne de santé publique
- Eliana Castillo, M.D., Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
- Kathleen Dooling, M.D., Centers for Disease Control and Prevention
- Lorette Dupuis, inf. aut., Association des infirmières et infirmiers du Canada
- Jia Hu, M.D., Collège des médecins de famille du Canada
- Deshayne Fell, Ph. D., M. Sc., Université d’Ottawa
- Martin Lavoie, M.D., Vancouver Coastal Health
- Dorothy Moore, M.D., Université McGill
- Amanda Ung, Association des pharmaciens du Canada
- Lea Bill, inf. aut., B. Sc. nat., Association canadienne des infirmières et infirmiers autochtones
- Marilee Nowgesic, Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada
- Sarah Funnell, M.D., Association des médecins autochtones du Canada
Membres d’office du CCNI :
- Erin E. Henry, B. Sc. nat., Agence de la santé publique du Canada
- Guillaume Poliquin, M.D., Ph. D., Agence de la santé publique du Canada
- Diane MacDonald, MSP, Agence de la santé publique du Canada
- Susanna Ogunnaike-Cooke, M. Sc., Agence de la santé publique du Canada
- Mireille Lacroix, LL. M., Groupe consultatif en matière d’éthique en santé publique
- Kelly Robinson, M. Sc., Santé Canada
- Celia Lourenco, Ph. D., Santé Canada
- Vincent Beswick-Escanlar, M.D., MSP, Forces armées canadiennes
- Tom Wong, M.D., MSP, Services aux Autochtones Canada
Déclaration de conflits d’intérêts
Dans le cadre des procédures standard d'identification et de traitement des affiliations et des intérêts, les membres du groupe de travail sur les orientations économiques ont rempli des formulaires de divulgation individuels qui ont été évalués par l'ASPC afin de s'assurer de l'absence d'influence indue ou de conflit d'intérêts perçu.
Beate Sander n'avait aucune déclaration d'intérêts et d'affiliations à faire.
Murray Krahn n'avait aucune déclaration d'intérêts et d'affiliations à faire.
Stirling Bryan n'a fait aucune déclaration d'intérêts et d'affiliations.
Werner Brouwer n'avait pas de déclaration d'intérêts ni d'affiliations à faire.
Mark Jit a déclaré avoir reçu des fonds de recherche d'organisations à but non lucratif (Commission européenne et OMS).
Karen M. Lee n'avait pas de déclaration d'intérêts ni d'affiliations à faire.
Monika Naus n'avait pas de déclaration d'intérêts ni d'affiliations à faire.
Sachiko Ozawa a déclaré avoir reçu des fonds de recherche de Merck Sharp & Dohme Corporation, de la Fondation Bill & Melinda Gates, du North Carolina Department of Health and Human Services et du National Cancer Institute.
Lisa Prosser n'avait aucune déclaration d'intérêts et d'affiliations à faire.
Abréviations
- Évaluation de la QDV
- Évaluation de la qualité de vie
- ACMTS
- Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
- ACA
- Analyse coûts-avantages
- CARCE
- Courbe d’acceptabilité du rapport coût/efficacité
- FARCE
- Frontière d’acceptabilité du rapport coût/efficacité
- CHU9D
- Mesure de l’utilité reliée à la santé chez l’enfant
- CP
- Corrélat de protection
- COVID-19
- Maladie à coronavirus 2019
- ACU
- Analyse coûts-utilité
- ASD
- Analyse de sensibilité déterministe
- EEFA
- Éthique, équité, faisabilité et acceptabilité
- EQ-5D
- Questionnaire sur la santé EQ-5D
- EQ-5D-Y
- Questionnaire sur la santé EQ-5D-Y (pour enfant)
- Hib
- Haemophilus influenzae de type b
- VIH
- Virus de l’immunodéficience humaine
- VPH
- Virus du papillome humain
- QVLS
- Qualité de vie liée à la santé
- HUI
- Health Utilities Index
- RCED
- Rapport coût/efficacité différentiel
- CCNI
- Comité consultatif national de l’immunisation.
- PedsQL
- Pediatric Quality of Life Inventory
- VCP
- Vaccin conjugué contre le pneumocoque
- ASP
- Analyse de sensibilité probabiliste
- AVAQ
- Année de vie ajustée par la qualité
- ERC
- Essai randomisé contrôlé
- SF-6D
- Short Form 6-Dimensions
- TB
- Tuberculose
Glossaire
Administration des doses : Accumulation du nombre requis de doses d’un schéma vaccinal pendant une période donnée.
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) : Organisme indépendant et sans but lucratif chargé de fournir aux responsables des politiques de santé du Canada des données probantes sur l’utilisation optimale des médicaments et des instruments médicaux dans le cadre du système public de soins de santé.
Analyse coûts-avantages (ACA) : Évaluation économique dans laquelle les coûts et les résultats sont exprimés en termes monétaires.
Analyse coûts-conséquence (ACC) : Évaluation économique dans laquelle les résultats en matière de santé sont exprimés en unités naturelles (p. ex. les infections évitées).
Analyse coûts-efficacité distributive : Extension du cadre conventionnel de l’ACE qui quantifie les impacts distributifs des interventions sanitaires en fonction de différents critères d’équité tels que le statut socio-économique ou la gravité de la maladie.
Analyse coûts-efficacité étendue : Extension du cadre conventionnel de l’analyse coûts-efficacité qui quantifie les impacts distributifs des interventions sanitaires en fonction de critères d’équité ainsi que de la protection contre les risques financiers.
Analyse coûts-utilité (ACU) : Évaluation économique dans laquelle les résultats en matière de santé sont exprimés en années de vie gagnées ajustées en fonction de la qualité (ou autre mesure générique de l’utilité reliée à la santé). On parle parfois d’une analyse coûts-efficacité (ACE) ou ACE avec AVAQ. Il s’agit de l’évaluation économique privilégiée par les responsables des politiques de santé publique au Canada.
Analyse de la valeur de l’information : Analyse utilisée pour estimer la valeur, en termes de coûts et de résultats pour la santé, de la collecte de davantage de données sur les paramètres clés influençant une décision de financement. Elle est particulièrement utile lorsque le résultat d’une évaluation économique est incertain, mais proche d’un seuil de décision et qu’un paramètre clé sur lequel repose le résultat est incertain. Voir les définitions de la valeur attendue de l’information parfaite (VAIP) et de la valeur attendue de l’information partielle parfaite (VAIPP).
Analyse de scénario : Analyse qui teste des scénarios de rechange de modèles sous-tendus par différentes hypothèses structurelles plausibles.
Analyse de sensibilité déterministe (ASD) : Méthode utilisée pour explorer l’incertitude des résultats d’une évaluation économique fondée sur un modèle, dans laquelle on fait varier un ou plusieurs paramètres dans une fourchette prédéfinie tout en maintenant les autres paramètres fixes, afin de déterminer l’influence de la variation sur les résultats de l’analyse.
Analyse de sensibilité probabiliste (ASP) : Voir la définition de l’analyse probabiliste.
Analyse probabiliste : Méthode utilisée pour quantifier l’incertitude relative aux paramètres dans une analyse économique où une distribution de probabilité est attribuée à chaque paramètre incertain et où les valeurs sont échantillonnées au hasard de manière répétée à partir de chaque distribution afin de générer une distribution de résultats qui peuvent être analysés.
Année de vie gagnée ajustée en fonction de la qualité (AVAQ) : Mesure de résultat sommaire utilisée pour quantifier les résultats en matière de santé associés à une intervention particulière. Les AVAQ combinent l’impact des avantages liés à la fois à la survie et à la qualité de vie liée à la santé exprimés en tant qu’utilités de la santé, et permettent de comparer les interventions entre les différents états pathologiques.
Avantage monétaire net : Statistique sommaire qui représente la valeur d’une intervention en tant qu'impact sur la santé de la population, exprimée en termes monétaires, ajustée en fonction des coûts prévus en cas d'achat de soins au rythme d'une stratégie marginalement rentable. Il est calculé en multipliant les AVAQ attendues par le coût d’opportunité pour la santé et en soustrayant les coûts attendus associés à l’intervention.
Avantage net pour la santé : Statistique sommaire, exprimée en AVAQ, qui représente l’impact sur la santé de la population liée à une intervention donnée, corrigée des coûts attendus si l’on achète les soins au rythme d’une stratégie marginalement rentable.Il est calculé en soustrayant le rapport entres les coûts attendus et le coût d’opportunité pour la santé.
Biais confusionnel : Estimation biaisée de la relation entre une exposition et un résultat dans une étude, résultant d’une troisième variable, la variable confusionnelle, qui est liée à la fois à l’exposition et au résultat.
Biais de sélection : Biais dans une étude non randomisée résultant de différences systématiques dans l’échantillonnage des individus qui sont dans le groupe exposé par rapport à ceux qui ne le sont pas, ce qui entraîne une distribution des expositions et des résultats qui n’est plus représentative de la population source. Un biais de sélection peut également se produire dans les études randomisées en raison de l’attrition après la randomisation.
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) : Comité consultatif national formé d’experts dans les domaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, de la pharmacie, des soins infirmiers, de l’épidémiologie, de la pharmaco-économie, des sciences sociales et de la santé publique. Le Comité formule des recommandations sur l’utilisation des vaccins dont l’administration chez l’homme est actuellement ou récemment approuvée au Canada, notamment en signalant les groupes à risque pour les maladies évitables par la vaccination qui devraient être la cible des campagnes de vaccination.
Consommation : Valeur des biens et services achetés par les individus.
Corrélat de protection (CP) : Biomarqueur immunitaire qui prédit l’efficacité potentielle d’un vaccin chez les personnes vaccinées et peut être utilisé comme critère de substitution dans les études sur l’efficacité potentielle ou réelle des vaccins.
Courbe d’acceptabilité du rapport coût-efficacité (CARCE) : Résumé graphique de l’incertitude des résultats d’une évaluation économique, où une gamme de seuils de coût-efficacité est représentée en fonction de la probabilité qu’une intervention soit rentable.
Coûts différentiels : Différence entre les coûts moyens attendus associés à l’utilisation d’une intervention par rapport à l’utilisation d’une option. Il s’agit d’un résultat clé d’une évaluation économique.
Couverture : Pourcentage estimé de personnes admissibles ayant reçu un vaccin particulier.
Dominance étendue : Scénario dans lequel une stratégie peut être exclue lorsqu’elle coûte plus cher et offre moins d’avantages qu’une combinaison de deux autres options.
Dominance : Désigne un scénario dans lequel une stratégie entraîne des avantages plus importants et des coûts moindres par rapport à son alternative.
Efficacité potentielle : Bénéfice d’une intervention produit dans un cadre expérimental et contrôlé, comme dans un essai randomisé contrôlé (ERC).
Efficacité réelle : Mesure dans laquelle une intervention donne les résultats souhaités dans la population de patients concernée dans le monde réel.
Élimination de la maladie : L’incidence localed’une infection particulière a été réduite à un niveau inférieur à celui nécessaire pour maintenir une transmission continue dans une zone géographique donnée, mais des efforts continus sont nécessaires pour maintenir cette réduction.
Équilibre épidémiologique : Situation dans laquelle le taux de nouvelles infections circulant dans une population est égal au taux de guérison de l’infection, ce qui donne lieu à un état stable ou immuable.
Équité en santé : Voir la définition de l’équité.
Équité intergénérationnelle : Concept selon lequel les personnes de différentes générations devraient bénéficier équitablement des décisions politiques comme les dépenses liées aux programmes de vaccination.
Équité : Absence de différences injustes et évitables ou remédiables en matière de santé entre des groupes de population définis par toute caractéristique pertinente (p. ex. sociale, économique, démographique ou géographique). L’équité horizontale consiste à traiter de la même manière des individus présentant des caractéristiques similaires (d’une pertinence éthique), tandis que l’équité verticale permet de traiter différemment des individus présentant des caractéristiques différentes (d’une pertinence éthique) afin d’obtenir des résultats plus équitables.
Éradication de la maladie : L’incidence d’une infection a été définitivement réduite à zéro dans le monde entier, l’organisme causal n’est plus présent dans la nature et des efforts ne sont plus nécessaires pour maintenir cette réduction.
Essai randomisé contrôlé (ERC) : Étude comparative, conçue pour vérifier l’efficacité potentielle d’une intervention dans le domaine de la santé, dans laquelle des unités comme les individus sont réparties au hasard entre le groupe d’intervention et le groupe témoin.
Évaluation des technologies de la santé (ETS) : Évaluation multidisciplinaire de divers domaines d’une technologie de la santé afin d’éclairer son utilisation, ce qui peut inclure l’efficacité clinique, le rapport coût-efficacité, les impacts sociaux, les impacts éthiques, entre autres.
Externalités : Coûts et conséquences d’une intervention telle qu’un programme de vaccination qui retombent sur d’autres membres de la population que ceux qui produisent, achètent ou consomment l’intervention (p. ex., immunité collective, déplacement de la maladie en fonction de l’âge).
Force de l’infection : Taux d’infection des individus réceptifs par unité de temps. C’est une fonction du nombre d’individus infectieux dans la population à un moment donné et de la transmissibilité de l’infection.
Frontière d’acceptabilité du rapport coût-efficacité (FARCE) : Résumé graphique de l’incertitude des résultats d’une évaluation économique, qui indique la stratégie économiquement préférable pour différentes valeurs seuils du rapport coût-efficacité et la probabilité que cette stratégie soit efficace par rapport au coût. À mesure de l’augmentation du seuil, le traitement économiquement privilégié peut changer, le point de basculement étant le moment où la valeur seuil dépasse le rapport coût-efficacité différentiel pertinent indiqué pour l’intervention en question. Les FARCE sont les plus utiles lorsque l’on compare au moins trois options, auquel cas il peut y avoir deux points de basculement ou plus à des valeurs seuils différentes.
Frontière d’efficience : Résumé graphique des résultats de l’analyse coût-efficacité comparant plusieurs interventions. Le graphique compare l’effet sur l’axe des y et les coûts sur l’axe des x. La frontière relie les interventions qui ne sont pas dominées. Une intervention située sur ou en dessous de la frontière peut être considérée comme raisonnablement efficace.
Hétérogénéité : Différences entre les personnes qui peuvent, en partie, être expliquées. Cela diffère du hasard qui veut que des individus ayant les mêmes caractéristiques sous-jacentes connaissent un résultat différent.
Horizon temporel : Période sur laquelle les résultats et les coûts sont quantifiés dans une évaluation économique.
Immunité collective : État dans lequel une proportion suffisante de la population est immunisée contre une maladie infectieuse, soit par la vaccination, soit par une infection antérieure, ce qui empêche l'apparition d'épidémies et rend la propagation entre individus moins probable. Le terme est couramment utilisé pour désigner la protection indirecte dont bénéficient les personnes non vaccinées du fait de la présence d'individus immunisés dans une population. Ce terme est également désigné par l’expression « immunité collective ».
Immunité de groupe : Voir la définition de l’immunité collective.
Incertitude de premier ordre : Incertitude liée à la variabilité aléatoire. Ce type d’incertitude est également appelé incertitude stochastique.
Incertitude de second ordre : Voir la définition de l’incertitude des paramètres.
Incertitude des paramètres : Incertitude des estimations des paramètres qui sont utilisées pour alimenter un modèle. Ce type d’incertitude est également appelé incertitude de second ordre.
Incertitude méthodologique : Incertitude liée aux différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser une évaluation économique.
Incertitude structurelle : Incertitude liée à la structure d’un modèle et autres sources d'incertitude non paramétrées. L'analyse de scénarios est une approche permettant d'évaluer ce type d'incertitude.
Lutte contre la maladie : L’état dans lequel l’incidence, la prévalence, la morbidité ou la mortalité d’une maladie donnée a été réduit au niveau local, mais des efforts continus sont nécessaires pour maintenir cette réduction.
Microsimulation : Voir la définition du modèle individuel.
Modèle (de population) fermé : Modèle qui suit une ou plusieurs tranches fixes de personnes. Les personnes ne sont pas en mesure d’entrer ou de sortir dans le modèle par l’intermédiaire de naissances, de décès ou de l’immigration au fil du temps.
Modèle (de population) ouvert : Modèle qui permet à de nouveaux individus d’entrer dans le modèle par des naissances ou par des migrations entrantes, ou de sortir du modèle par des décès ou par des migrations sortantes au fil du temps.
Modèle (de temps) continu : Modèle dans lequel les événements peuvent se produire à tout moment.
Modèle (temporel) discret : Modèle dans lequel les événements ne peuvent se produire qu’à des moments prédéterminés dans le temps.
Modèle basé sur les populations : Modèle dans lequel des groupes d’individus sont assignés à des compartiments ou à des états de santé en fonction de leur état de santé ou d’autres caractéristiques. Les individus de chaque compartiment se déplacent en fonction des valeurs des paramètres définis au niveau agrégé et le modèle enregistre le nombre d'individus dans chaque compartiment au fil du temps. Ce type de modèle peut également être appelé modèle agrégé.
Modèle déterministe : Un modèle qui décrit ce qui se passe en moyenne et dans lequel les événements ne peuvent pas se produire de manière aléatoire (par hasard). Pour un ensemble défini de paramètres et de conditions de départ, ces modèles génèrent toujours les mêmes résultats, chaque fois qu’ils sont exécutés.
Modèle dynamique (de transmission) : Modèle dans lequel la force de l’infection peut varier dans le temps. L’incidence est fonction du nombre (ou de la proportion) de personnes infectées et réceptives et de la transmissibilité du virus. On peut également parler d'un modèle avec une force d'infection endogène.
Modèle individuel/Microsimulation : Modèle dans lequel l'individu, plutôt que le groupe, est l'unité qui est modélisée. Les modèles de microsimulation qui ne permettent pas d'interactions entre les individus sont classés comme des modèles de microsimulation statiques. Les modèles de microsimulation qui permettent des interactions entre les individus ou avec l'environnement (tel que le système de santé) sont classés comme des modèles de microsimulation dynamiques. Un modèle à base d'agents est un type de modèle de simulation dynamique.
Modèle multi-agents : Un type de modèle de microsimulation dynamique qui permet aux individus d'agir de manière autonome sur la base de règles comportementales définies.
Modèle statique : Modèle dans lequel la force de l’infection est constante dans le temps ou dépend uniquement des caractéristiques de chaque individu, et non du nombre d’autres individus qui sont infectieux. On peut également parler d'un modèle avec une force d'infection exogène.
Modèle stochastique : Aux fins des présentes lignes directrices, modèle qui tient compte de l’incertitude de premier ordre où les événements sont programmés pour se produire de manière aléatoire.
Paramètres : Variables qui déterminent les taux de mouvement entre les états du modèle ou les probabilités d'événements dans un modèle.
Période d’incubation : Temps qui s’écoule entre l’infection et l’apparition de la maladie clinique.
Période de latence : Période de temps entre le moment où un hôte acquiert une infection et celui où il peut la transmettre à un autre hôte. On l’appelle parfois la période pré-infectieuse.
Période infectieuse : Période allant de la fin de la période de latence ou de la période pré-infectieuse jusqu’à ce que l’hôte ne soit plus en mesure de transmettre l’infection à d’autres individus.
Perspective : Point de vue à partir duquel une évaluation économique sera menée. La perspective détermine les résultats et les coûts qui seront inclus dans l’analyse.
Peuples autochtones : Premiers groupes humains connus sur n’importe quelle terre dans le monde. Aux fins des présentes lignes directrices, l’expression « peuples autochtones » désigne les individus qui sont des Premières nations, des Inuits et des Métis.
Préférence temporelle positive : Préférence pour les avantages actuels par rapport aux avantages à venir.
Preuve dans le monde réel : Preuve utilisée pour la prise de décision, qui est recueillie au moyen d’études non expérimentales.
Problème de décision : Déclaration explicite des interventions, des populations étudiées, des mesures de résultats et de la perspective adoptée dans une évaluation économique, liée spécifiquement aux décisions que l’évaluation cherche à guider.
Productivité : Mesure de l’efficacité avec laquelle les facteurs de production, tels que le travail et le capital, sont utilisés dans une économie pour produire un niveau donné d’extrants.
Qualité de vie liée à la santé (QVLS) : Combinaison du fonctionnement physique, mental et social d’une personne.
Rapport coût-efficacité différentiel (RCED) : Rapport calculé en divisant la différence entre les coûts moyens attendus et la différence entre les résultats ou effets moyens attendus sur la santé entre deux options comparées dans une évaluation économique. Le comparateur représente généralement la norme de soins actuelle.
Référence : Ensemble de méthodes permettant d’effectuer une évaluation économique spécifiée par le décideur. Le but de l’analyse de référence est d’assurer la cohérence entre les méthodes qui sous-tendent les analyses et le processus décisionnel qui est employé.
Remplacement du sérotype : Expansion des sérotypes non vaccinaux d’un agent pathogène résultant de l’élimination de la population des sérotypes propres au vaccin qui leur font concurrence pour la colonisation d’hôtes.
Retombées : Effets des pathologies et des traitements sur différents aspects du bien-être d’autres individus comme des membres de la famille, y compris les effets sur la santé des soignants, les coûts en temps des soins informels ou les deux.
Stratégie de rattrapage : Stratégie consistant à vacciner les personnes qui n’ont pas reçu une vaccination particulière à l’âge recommandé. Cette stratégie peut être utilisée chez les personnes qui n’étaient pas admissibles à la vaccination, qui ont manqué une dose de vaccin prévue ou qui n’ont pas terminé une série de vaccins.
taux d’escompte : Les coûts et les résultats en matière de santé qui se produiront à l’avenir généralement considérés comme ayant une valeur moindre que ceux qui se produisent aujourd’hui; on les actualise donc dans une évaluation économique pour déterminer leur valeur actuelle. Le facteur par lequel les coûts et les résultats en matière de santé sont actualisés est exprimé en tant que taux d’escompte.
Taux de reproduction de base : Lenombre moyen de cas secondaires infectés par une personne infectieuse dans une population complètement réceptive.
Taux de reproduction effectif : Nombre moyen de cas secondaires infectés par une personne infectieuse dans une population dans une population dont certains individus sont immunisés contre l’infection, en raison de la vaccination ou de l'infection.
Utilité de la santé : Mesure de la qualité de vie liée à la santé qui représente les préférences que les personnes attachent à leur état de santé général. Par convention, les évaluations sont ancrées à 0 (représentant un état de santé équivalent à la mort) et à 1 (représentant un état de santé équivalent à une santé parfaite). Les utilités de la santé sont également appelées mesures de la qualité de vie liée à la santé fondées sur les préférences.
Valeur attendue de l’information parfaite (VAIP) : Prix maximal qu’un décideur serait prêt à payer pour avoir une information parfaite sur toutes les valeurs de paramètres qui influencent l’intervention à privilégier en fonction des résultats d’une ACE. Cela représente la valeur (en termes monétaires) de l’élimination de toute l’incertitude liée aux paramètres de l’analyse. La VAIP peut également être exprimée pour la population totale qui devrait bénéficier de l’intervention pendant la durée prévue de celle-ci (désignée comme VAIP de population).
Valeur attendue de l’information parfaite partielle (VAIPP) : Prix maximal qu’un décideur serait prêt à payer pour obtenir une information parfaite pour une ou plusieurs entrées d’un modèle économique.
Variation de l’âge d’infection : Phénomène qui peut se produire lorsqu’une tranche d’âge particulière de la population est vaccinée, ce qui réduit la force d’infection dans cette tranche et déplace l’âge moyen de l’infection.
Variations de l’agent pathogène : Différences entre les souches d’un agent pathogène liées aux sérotypes, aux sérogroupes ou aux génotypes.
Introduction
Le présent document constitue la première édition des Lignes directrices du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) sur l’évaluation économique des programmes de vaccination au Canada; dans le texte qui suit, elles seront désignées par Lignes directrices. Les Lignes directrices ont été établies afin de définir les meilleures pratiques pour la réalisation et la communication des évaluations économiques des programmes de vaccination au Canada, au niveau régional, provincial ou national. L'adhésion à des pratiques exemplaires communes peut permettre aux décideurs du système de santé public du Canada d’avoir accès à des renseignements cohérents et crédibles qui orienteront les décisions de financement relatives aux programmes de vaccination. Les Lignes directrices portent sur les informations propres aux programmes de vaccination. Dans ses Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au CanadaNote de bas de page 1, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé présente des renseignements plus généraux applicables aux technologies de la santé au Canada. Lorsque les énoncés des Lignes directrices de l’ACMTS peuvent s’appliquer aux évaluations économiques des programmes de vaccination, ils ont été repris dans les présentes Lignes directrices.
La principale caractéristique qui distingue les programmes de vaccination des autres technologies de la santé est leur effet au niveau de la population, qui résulte du fait qu’ils peuvent toucher à la fois les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas. Les Lignes directrices présentent des informations détaillées sur la manière d’intégrer ces effets au niveau de la population dans les évaluations économiques des programmes de vaccination, y compris les méthodes permettant de prendre en compte leurs impacts en dehors du secteur de la santé.
Les recommandations formulées dans les Lignes directrices ont été préparées par le Groupe de travail sur les lignes directrices en matière d’économie du CCNI, composé d’experts canadiens et internationaux en maladies infectieuses et en économie de la santé. Ce groupe a mené une série de discussions qui ont abouti à des décisions prises par consensus et étayées par des analyses documentaires pour certains sujets. Un processus d’examen par les pairs et de consultation publique a été entrepris après l’achèvement de la première version des Lignes directrices et a permis de rédiger les recommandations et le texte définitifs du présent document.
Un cadre décisionnel social a été adopté pour les Lignes directrices. Il repose sur le fait que le responsable des politiques de santé agit au nom d’une autorité supérieure socialement légitime (p. ex. un gouvernement démocratiquement élu) pour atteindre un objectif politique explicite (p. ex. améliorer la santé globale de la population). Dans ce cadre, la fonction d’une évaluation économique est d’étayer les décisions socialesNote de bas de page 2 Note de bas de page 3 Note de bas de page 4.
Les évaluations économiques se sont traditionnellement concentrées sur les compromis entre les coûts et les effets différentiels de différentes interventions dans le domaine de la santé afin de permettre aux décideurs de porter des jugements sur l’efficience. Les Lignes directrices élargissent l’approche traditionnelle en présentant des recommandations sur l’intégration des considérations d’équité dans les évaluations économiques des programmes de vaccination. L’intégration de l’équité dans les évaluations économiques est conforme au cadre d’éthique, d’équité, de faisabilité et d’acceptabilité (EEFA) du CCNI, qui fournit un mécanisme permettant aux décideurs de prendre systématiquement en compte des facteurs programmatiques importants, outre l’efficacité et la rentabilité, lorsqu’ils formulent des recommandations sur les programmes de vaccinationNote de bas de page 5.
Les Lignes directrices recommandent l’adoption de deux analyses de cas de référence dans le cadre de l’évaluation économique des programmes de vaccination : l’une menée du point de vue du système de santé public et l’autre du point de vue de la société. Cette dernière vise à tenir compte de l’ensemble des avantages associés aux programmes de vaccination, y compris ceux qui reviennent aux secteurs ne relevant pas de la santé. Ces références servent à encourager l’utilisation d’un ensemble standard de méthodes pour réaliser les évaluations économiques de programmes de vaccination et à permettre aux décideurs de comparer les résultats entre différents programmes.
Des recommandations sont présentées pour les aspects suivants des évaluations économiques des programmes de vaccination : problème de décision, types d’évaluations, populations étudiées, comparateurs, perspectives, horizon temporel, actualisation, modélisation, efficacité réelle, mesure et évaluation de la santé, utilisation et coûts des ressources, analyse, incertitude, équité et compte rendu de l’évaluation. Les conseils sur chacun de ces sujets sont donnés dans un chapitre distinct. Les énoncés des lignes directrices sont présentés au début de ce document et au début de chaque chapitre pour en faciliter l’utilisation, et suivis d’une discussion détaillée des recommandations. Les Lignes directrices sont rédigées à l’intention des utilisateurs finaux, y compris les chercheurs et les décideurs, qui maîtrisent techniquement les méthodes d’évaluation économique; c’est pourquoi le contexte de ces méthodes a été omis. De même, les Lignes directrices ne contiennent pas d’informations générales détaillées sur les sujets scientifiques et techniques liés aux vaccins et à l’immunisation, car on s’attend à ce que les chercheurs qui entreprennent des évaluations économiques des programmes de vaccination consultent des experts en la matière. Les références figurant dans ce document constituent des sources permettant aux chercheurs d’obtenir des informations supplémentaires si nécessaire.
Les conseils présentés dans ce document représentent les recommandations actuelles du CCNI pour la conduite des évaluations économiques des programmes de vaccination. Le CCNI et son Groupe de travail sur les lignes directrices en matière d’économie ont tenté de refléter les pratiques exemplaires actuelles, mais les recommandations contenues dans les Lignes directrices évolueront en fonction des progrès scientifiques et méthodologiques dans ce domaine. Les sujets pour lesquels il n’existe pas de consensus actuel sur les pratiques exemplaires et qui nécessitent des recherches supplémentaires sont indiqués dans les Lignes directrices. Ainsi, la fonction de ces Lignes directrices n’est pas seulement de recommander des pratiques actuelles pour l’évaluation économique des programmes de vaccination, mais aussi de suggérer des orientations pour les recherches futures, qui contribueront à faire progresser les méthodes utilisées dans ce domaine.
L’objectif de ces Lignes directrices est de spécifier des méthodes pour mener des évaluations économiques des programmes de vaccination, et non de fournir des conseils ou des idées sur le processus décisionnel. Ainsi, les considérations ou facteurs liés à la prise de décisions sur le financement des programmes de vaccination ne sont pas inclus dans les Lignes directrices.
Énoncés des lignes directrices
1. Problème de décision
1.1 Énoncer clairement le problème de décision devant faire l’objet de l’évaluation économique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS]
1.2 Dans l’énoncé du problème de décision, préciser les interventions à comparer, le cadre ou le contexte de la comparaison, la perspective de l’évaluation, la nature des coûts et des résultats ou des paramètres pris en considération, l’horizon temporel et la population cible de l’évaluation. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS]
1.3 Un énoncé distinct du problème de décision est requis pour chaque perspective et chaque analyse proposée se rapportant à un groupe distinct de la population auquel le programme de vaccination peut être destiné.
1.4 En plus de spécifier la population visée par le programme de vaccination, le problème de décision doit également déterminer d’autres groupes de population qui pourraient être touchés par le programme de vaccination, y compris la population exposée à la maladie en question et les populations indirectement touchées par le programme de vaccination, par l’intermédiaire d’externalités ou de retombées.
2. Types d’évaluations
2.1 L’analyse de référence dans l’évaluation économique devrait être une analyse coûts-utilité (ACU) dans laquelle les résultats sont exprimés en années de vie gagnées ajustées pour la qualité de vie (AVAQ). Justifier clairement tout autre choix. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié]
2.2 Il est possible de recourir à une analyse coûts-avantages (ACA) en plus des ACU de référence lorsque le programme de vaccination peut être comparé à une intervention autre que de santé.
3. Populations étudiées
3.1 Les chercheurs doivent identifier les populations visées par le programme de vaccination, la population vulnérable face à la maladie en question et toutes les populations qui peuvent être indirectement touchées par le programme de vaccination, que ce soit par des externalités ou par des retombées.
3.2 Les chercheurs doivent présenter une analyse globale qui inclut les coûts et les résultats en matière de santé pour toutes les populations concernées. Le cas échéant, les chercheurs doivent également résumer les résultats séparément pour chaque groupe touché (par exemple, la population visée, la population subissant des externalités ou des retombées) qui a été inclus dans l’analyse globale.
3.3 Lorsqu’il existe des facteurs susceptibles d’entraîner des différences de coûts et de résultats liés au programme de vaccination entre les sous-groupes, les chercheurs doivent réaliser des évaluations économiques distinctes pour chaque sous-groupe. Ces facteurs peuvent inclure des facteurs démographiques, des facteurs comportementaux, des facteurs liés à la maladie et l’efficacité du vaccin ou des interventions de comparaison.
4. Comparateurs
4.1 Choisir les comparateurs en fonction de la portée du problème de décision. Les comparateurs choisis doivent être adaptés à la population visée par le programme de vaccination et à la région où la décision s’appliquera. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
4.2 Les chercheurs doivent prendre en considération les approches préventives et thérapeutiques dans le choix des comparateurs pour les évaluations économiques des programmes de vaccination. Les interventions préventives peuvent inclure des mesures basées sur les vaccins, des programmes de dépistage, des interventions préventives fondées sur des médicaments et des interventions préventives non médicales.
5. Perspectives
5.1 Il faut présenter deux analyses de référence dans le cadre de l’évaluation économique des programmes de vaccination : l’une menée dans la perspective du système de santé financé par l’État et l’autre dans la perspective sociétale.
5.2 Veiller à ce que les coûts comme les résultats ou effets des interventions soient compatibles avec la perspective déterminée. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
6. Horizon temporel
6.1 Dans l’analyse de référence, l’horizon temporel doit être suffisamment long pour détecter toutes les différences pertinentes entre les interventions quant à leurs coûts et à leurs résultats (effets sur la santé) futurs connexes. L’horizon temporel devrait être déterminé en fonction de la maladie et de l’effet probable de l’intervention. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
6.2 Les chercheurs doivent justifier leur choix d’horizon temporel. Lorsqu’il s’étend sur une longue période (c’est-à-dire sur plusieurs décennies), les chercheurs doivent estimer le RCED à partir de divers points dans le temps tout au long de l'horizon temporel.
7. Actualisation
7.1 Dans l’analyse de référence, actualiser les coûts et les résultats (effets) des interventions pour une période dépassant la première année afin de présenter les valeurs selon un taux de 1,5 % par an. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
7.2 Évaluer le retentissement de l’incertitude liée au taux d’escompte en comparant les résultats de l’analyse de référence à ceux d’analyses complémentaires à l’aide des taux de 0 % et de 3 % par an. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
8. Modélisation
8.1 Conceptualiser et élaborer le modèle en fonction du problème de décision. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
8.2 Dans la conceptualisation du modèle, prendre en considération tout modèle bien construit et validé qui incorpore adéquatement le cheminement clinique dans la maladie d’intérêt. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
8.3 La structure du modèle doit refléter l’évolution naturelle de la maladie et du cheminement clinique ou de soin et tenir compte de la réceptivité, de l’infectiosité et de l’immunité liées à l’infection.
8.4 Le cas échéant, il faut intégrer au modèle les dynamiques comportementales pertinentes, y compris les habitudes de contact entre les individus et les comportements liés à la prévention et au contrôle des infections.
8.5 Des modèles dynamiques doivent être pris en considération dans les évaluations économiques des vaccins et associés à des externalités comme la prévention de la transmission interhumaine de l’infection et le déplacement lié à l’âge de la maladie.
8.6 D’autres attributs du modèle, notamment le fait qu’il soit déterministe ou stochastique, basé sur les populations ou sur les individus, et ouvert ou fermé, doivent être considérés dans le contexte du problème de décision.
8.7 Les chercheurs doivent rendre compte de manière transparente des processus de calage et de validation du modèle qui ont été entrepris et de leurs résultats.
9. Efficacité
9.1 Effectuer une recherche documentaire exhaustive afin d’appuyer l’estimation de l’efficacité clinique et de l’innocuité des interventions à l’étude. Faire état des études retenues et des méthodes de sélection ou de regroupement des données. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
9.2 Évaluer les sources de données selon leur aptitude à l’emploi, leur crédibilité et leur cohérence. Décrire les compromis consentis entre ces critères et justifier les sources choisies. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
9.3 Les critères suivants doivent être pris en considération dans l’évaluation des estimations de l’efficacité réelle des vaccins : l’efficacité réelle du vaccin par dose; la couverture vaccinale attendue; l’efficacité réelle en fonction des variations de l’agent pathogène (sérotypes, sérogroupes, souches); les facteurs géographiques et liés à l’hôte qui peuvent avoir une incidence sur l’efficacité réelle.
9.4 Les chercheurs doivent s’assurer que les biomarqueurs immunitaires utilisés comme résultats de substitution dans les études sur l’efficacité potentielle ou réelle des vaccins répondent aux critères des corrélats de protection.
10. Mesure et évaluation de la santé
10.1 Dans les deux analyses de référence, il convient d’utiliser la survie ajustée pour la qualité de vie (QALY) comme méthode pour évaluer les résultats en matière de santé.
10.2 Prendre en considération les préférences en matière de santé qui correspondent à celles de la population canadienne en général. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
10.3 Dans les analyses de référence, les chercheurs doivent utiliser les préférences en matière de santé qui sont obtenues par une méthode de mesure indirecte reposant sur un système de classification générique (p. ex. le questionnaire EuroQol 5-Dimensions [EQ-5D], le Health Utilities Index [HUI], le Short-Form 6-Dimensions [SF-6D], les Child Health Utility 9-Dimensions [CHU9D], l’évaluation de la qualité de vie [AQoL]). Les chercheurs doivent présenter une justification s’ils n’utilisent pas de méthode indirecte. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
10.4 La sélection des sources de données à propos de la valeur d’utilité des états de santé est dictée par les motifs d’aptitude à l’emploi, de crédibilité et de cohérence. Décrire les compromis consentis entre ces critères et justifier les sources choisies. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
11. Utilisation et coût des ressources
11.1 Pour chaque analyse de référence, les chercheurs doivent relever, mesurer et valoriser de manière systématique toutes les ressources pertinentes, consommées ou économisées à la suite de l’administration ou de l’exécution du programme de vaccination, et en faire état.
11.2 Dans la mesure du possible, les chercheurs doivent évaluer des ressources pertinentes relevées pour tous les secteurs, sur le plan pécuniaire. Lorsque ce n’est pas possible, les chercheurs doivent présenter aux décideurs les ressources pertinentes qui ont été relevées dans l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination.
11.3 « L’utilisation et les coûts des ressources doivent être basés sur des sources canadiennes et refléter la ou les juridictions d'intérêt (comme il est précisé dans le problème de décision). » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
11.4 Dans la valorisation et la monétisation des ressources, les chercheurs doivent choisir les sources de données les plus exactes quant au coût de renonciation selon la perspective de l’analyse. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
11.5 Les chercheurs doivent évaluer les sources utilisées pour les coûts des ressources en fonction de leur aptitude à l’emploi, de leur crédibilité et de leur cohérence. La sélection des sources de données doit reposer sur des compromis entre ces critères.
12. Analyse
12.1 Les rapports coûts-efficacité différentiels (RCED) et, lorsque cela est utile pour l’interprétation, les avantages monétaires nets ou les avantages nets pour la santé, doivent être calculés pour les deux analyses de référence.
12.2 « Si l’analyse englobe plus de deux interventions, effectuer une analyse séquentielle du rapport coût-efficacité dans les règles standards de l’estimation du RCED, y compris l’exclusion des interventions dominées. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
12.3 Autant que possible, il faut générer les valeurs attendues des coûts et des résultats de manière probabiliste afin de refléter l’incertitude globale des paramètres du modèle.
13. Incertitude
13.1 Les chercheurs doivent aborder l’incertitude des paramètres en recourant à une analyse probabiliste de référence, si possible, ainsi qu’à des analyses de sensibilité déterministes.
13.2 Étudier l’incertitude méthodologique en comparant les résultats de l’analyse de référence à ceux d’une analyse complémentaire fondée sur d’autres choix méthodologiques que ceux recommandés pour examiner l’incidence des différences d’ordre méthodologique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
13.3 Il convient d’utiliser les courbes d’acceptabilité du rapport coût-efficacité (CARCE) et les frontières d’efficience (FE) pour représenter l’incertitude des estimations des coûts et des résultats lorsque celles-ci ont été générées de manière probabiliste. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
13.4 Lorsque le problème de décision comprend l’option de commander ou d’effectuer un projet de recherche, l’analyse de la valeur de l’information peut être utile dans l’attribution d’une valeur à ces options et dans la conception du projet de recherche; cette analyse doit alors être comprise dans l’analyse de référence. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
13.5 Évaluer l’incertitude structurelle par des analyses de scénarios. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
14. Équité
14.1 Les chercheurs et les décideurs doivent travailler ensemble pour déterminer les dimensions et les objectifs d’équité à inclure dans l’évaluation économique du programme de vaccination envisagé. L’équité doit être considérée dans le contexte du cadre d’éthique, d’équité, de faisabilité et d’acceptabilité (ÉÉFA) du CCNI.
14.2 Les analyses qui intègrent les préoccupations pertinentes en matière d’équité doivent accompagner l’analyse de référence (par exemple, l’analyse coût-efficacité distributive, l’analyse coût-efficacité étendue ou d’autres méthodes émergentes) et être présentées avec l’analyse de référence.
15. Production de rapports
15.1 Présenter les résultats de l’évaluation économique de façon détaillée et transparente. Fournir suffisamment de renseignements pour que le lecteur ou l’utilisateur (le décideur, par exemple) puisse faire une analyse critique de l’évaluation. Utiliser une présentation bien structurée. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.2 Prévoir un sommaire de l’évaluation dans un langage non technique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.3 Présenter les résultats de l’évaluation économique à l’aide d’éléments graphiques ou visuels en plus de tableaux. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.4 Inclure des renseignements ou des documents sur les processus d’assurance de la qualité et les résultats de l’évaluation économique dans le compte rendu. Fournir une copie du modèle par voie électronique aux fins d’examen ainsi que de la documentation connexe afin de faciliter la compréhension du modèle, de son déroulement et de son fonctionnement. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.5 Préciser les sources de financement et les liens hiérarchiques dans le cadre de l’évaluation et mentionner tout conflit d’intérêts éventuel. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.6 Les chercheurs doivent utiliser les lignes directrices pour la présentation des évaluations économiques des programmes de vaccination au Canada du CCNI et remplir l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination, qui se trouve à l’annexe 1).
Les lignes directrices en détail
1. Problème de décision
1.1 Énoncer clairement le problème de décision devant faire l’objet de l’évaluation économique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS]
1.2 Dans l’énoncé du problème de décision, préciser les interventions à comparer, le cadre ou le contexte de la comparaison, la perspective de l’évaluation, la nature des coûts et des résultats ou des paramètres pris en considération, l’horizon temporel et la population cible de l’évaluation. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS]
1.3 Un énoncé distinct du problème de décision est requis pour chaque perspective et chaque analyse proposée se rapportant à un groupe distinct de la population auquel le programme de vaccination peut être destiné.
1.4 En plus de spécifier la population visée par le programme de vaccination, le problème de décision doit également déterminer d’autres groupes de population qui pourraient être touchés par le programme de vaccination, y compris la population exposée à la maladie en question et les populations indirectement touchées par le programme de vaccination, par l’intermédiaire d’externalités ou de retombées.
Le problème de décision visé par l’évaluation économique d’un programme de vaccination doit répondre à des préoccupations pertinentes pour le décideur et être clairement formulé dès le début de l’analyse, tout en affichant une cohérence avec d’autres évaluations vaccinales, lorsque cela est possible. Les décideurs qui évaluent les paramètres économiques des programmes de vaccination au Canada comprennent le CCNI, les groupes consultatifs techniques d’immunisation provinciaux/territoriaux et les ministères de la Santé provinciaux/territoriaux. Le CCNI élabore des recommandations non contraignantes et éclairées par des données probantes pour faciliter la prise de décisions en temps opportun concernant les programmes de vaccination financés à même les fonds publics et appliqués aux échelons provincial et territorial. Certaines provinces et certains territoires ont mis sur pied des groupes consultatifs techniques officiels sur l’immunisation, tandis que d’autres ne l’ont pas fait. Les groupes consultatifs officiels et les ministères de la Santé décident si un programme de vaccination sera financé dans une administration donnée, et comment il sera mis en œuvre.
Le problème de décision doit fournir une description détaillée et une justification du programme de vaccination évalué, y compris : 1) les perspectives selon lesquelles l’analyse est effectuée; 2) le type d’évaluation économique réalisée; 3) les coûts et les résultats qui seront quantifiés dans l’analyse; 4) l’horizon temporel sur lequel l’analyse sera effectuée; 5) les comparateurs qui seront pris en considération; 6) les populations concernées par le programme de vaccination. Ces populations comprennent la population visée par le programme de vaccination et, le cas échéant, la population vulnérable face à la maladie en question, ainsi que la population susceptible de subir des retombées (p. ex. les aidants).
Le problème de décision doit indiquer tous les sous-groupes de population que le décideur envisage de vacciner (p. ex. les groupes d’âge, les groupes à risque clinique, les personnes exerçant certaines professions, les zones géographiques, les personnes qui possèdent certains biomarqueurs ou affichent certains profils génétiques) ainsi que le mode d’administration potentiel du vaccin (cliniques médicales, pharmacies, écoles, lieux de travail, etc.). Il convient d’évaluer ensemble toutes les options présentant un intérêt pour le décideur selon les principes de l’analyse différentielle complète.
Les chercheurs doivent s’efforcer de s’entretenir avec un certain nombre de décideurs concernés et se mobiliser auprès d’eux afin de comprendre les préoccupations auxquelles ces derniers tentent de répondre en mettant en place le programme de vaccination. Certains aspects du problème de décision sont particulièrement pertinents pour les décideurs, notamment : 1) l’horizon temporel de l’évaluation; 2) les effets possibles du programme de vaccination au-delà du secteur de la santé; 3) les inégalités en matière de santé qui pourraient éventuellement être atténuées par l’introduction du programme de vaccination.
Il est particulièrement important de s’assurer que l’horizon temporel est pertinent pour les décideurs lorsqu’un programme de vaccination permet de protéger les personnes non vaccinées grâce à l’immunité collective (de groupe), avec un potentiel d’élimination de la maladie. Il faut souvent un horizon temporel très long (parfois plusieurs décennies) pour que tous les coûts et les effets d’un programme de vaccination deviennent apparents. Les chercheurs doivent noter que ces longs horizons temporels peuvent ne pas refléter les résultats et les coûts actuels qui sont pertinents pour les décideurs. Dans ces cas, les chercheurs doivent s’assurer que les résultats d’une évaluation économique font l’objet de rapports selon plusieurs points dans le temps pour permettre aux décideurs de déterminer quand les gains du programme deviennent positifs.
Compte tenu des résultats plus généraux, non liés à la santé, qui sont associés à de nombreuses stratégies de vaccination, une perspective plus large que celle du système de santé sera généralement pertinente. Dans les présentes lignes directrices, le système de santé désigne à la fois les services de traitement des soins de santé et la santé publique. Les chercheurs doivent essayer de comprendre les coûts et les avantages plus vastes du programme de vaccination, qui ne concernent pas nécessairement le secteur de la santé, mais qui sont utiles au décideur. Par exemple, la prévention de la rougeole, une maladie qui peut entraîner des lésions neurologiques, par la vaccination des enfants, améliore les résultats scolaires. De même, la prévention de la grippe au sein de la population grâce à un programme de vaccination universelle procure des avantages liés à la productivité. Le chapitre 5, Perspectives, donne davantage de détails sur ce sujet.
Certains groupes sont vulnérables face aux maladies infectieuses et aux effets négatifs des politiques de contrôle des maladies infectieuses en raison de préjudices historiques et d’obstacles sociaux. Les vaccins ont été relevés comme étant une stratégie permettant de réduire potentiellement des inégalités spécifiques liées au risque d’infection ou au fardeau de la maladie en question. Les chercheurs, en collaboration avec les décideurs, doivent identifier les groupes précis qui pourraient particulièrement bénéficier du programme de vaccination. Par exemple, l’incidence du cancer du col de l’utérus et la mortalité liée à cette maladie sont plus élevées chez les personnes affichant un statut socio-économique inférieur et les membres de minorités, mais elles pourraient être évitées grâce à un programme de vaccination contre le papillome humain (VPH)Note de bas de page 6. À l’inverse, les chercheurs, en collaboration avec les décideurs, doivent également se demander si certains groupes pourraient ne pas bénéficier du programme de vaccination, ce qui pourrait accroître les inégalités en matière de santé. Le chapitre 14, Équité, propose une discussion plus approfondie à ce sujet.
Le type d’évaluation économique doit être précisé et justifié. Le type d’évaluation économique, de pair avec la perspective adoptée, doit déterminer quels coûts et résultats devraient être inclus (et comment). Les mesures des résultats incluses, qui doivent être les mêmes pour chaque comparateur, doivent être explicitement mentionnées dans le problème de décision et énumérées par secteur (par exemple, résultats en matière de santé, réussite scolaire). De même, les coûts inclus doivent être explicitement indiqués et répertoriés par catégorie de coûts (par exemple, les coûts des soins de santé, les coûts liés à l’éducation, les coûts liés à la productivité).
Il convient de fournir une description claire du vaccin évalué, y compris le dosage, le nombre de doses nécessaires, le calendrier d’administration, si des doses de rappel sont nécessaires, l’administration prévue des doses, la manipulation des déchets, les hypothèses sur l’affaiblissement, les estimations de la couverture et le lieu d’administration du vaccin, ainsi que des descriptions détaillées des comparateurs. Les comparateurs peuvent inclure d’autres vaccins préventifs existants, des approches préventives non vaccinales et les approches thérapeutiques actuelles, y compris les meilleurs soins de soutien.
2. Types d’évaluations
2.1 L’analyse de référence dans l’évaluation économique devrait être une analyse coûts-utilité (ACU) dans laquelle les résultats sont exprimés en années de vie gagnées ajustées pour la qualité de vie (AVAQ). Justifier clairement tout autre choix. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié]
2.2 Il est possible de recourir à une analyse coûts-avantages (ACA) en plus des ACU de référence lorsque le programme de vaccination peut être comparé à une intervention autre que de santé.
Dans le cadre de l’analyse de référence, l’évaluation économique est une analyse coûts-utilité (ACU) dans laquelle les résultats sont exprimés en années de vie ajustées par la qualité (AVAQ). Il est toutefois reconnu qu’il existe des populations au sein desquelles les ACU ne peuvent pas être menées de manière robuste parce qu’il n’existe pas d’instruments valides pour l’élicitation directe de l’utilité, comme chez les enfants de moins de 8 ans. Dans ces cas, des approches analytiques de rechange comme l’analyse coût-efficacité (ACE), avec une mesure de résultat pertinente en unités de santé naturelles, doivent être justifiées.
Outre les ACU de l’analyse de référence, une analyse coûts-avantages (ACA) peut être présentée dans les cas où des répercussions au-delà du secteur de la santé sont des facteurs importants pour les décideurs. L’analyse coûts-avantages (ACA) a été proposée comme méthode d’évaluation des programmes de vaccination associés à des conséquences qui ne relèvent pas du secteur de la santéNote de bas de page 7 Note de bas de page 8 Note de bas de page 9. La recommandation du CCNI de réaliser une analyse coûts-utilité de référence dans la perspective sociétale devrait permettre aux chercheurs de tenir compte des avantages non liés au secteur de la santé en les monétisant et en les incluant dans le numérateur de l’estimation du rapport coût-efficacité différentiel (RCED). Cependant, cette approche ne permet pas aux décideurs de comparer les avantages non liés à la santé d’autres programmes ou de comparer des programmes de vaccination à des programmes autres que de santé puisque le dénominateur de l’estimation du rapport coût-efficacité différentiel est exprimé en années de vie ajustées par la qualité. Lorsqu’un décideur souhaite comparer l’attrait économique d’un programme de vaccination à une intervention non sanitaire (comme un programme de repas scolaires), les chercheurs pourraient présenter une analyse coûts-avantages parallèlement à l’analyse de référence menée dans la perspective sociétale afin de permettre une telle comparaisonNote de bas de page 7. Les chercheurs doivent être conscients du fait que différentes approches peuvent servir à monétiser les avantages dans une analyse coûts-avantages et que cela peut donner de grandes variations dans les résultats d’une telle analyseNote de bas de page 8. Le choix d’une approche particulière doit être précisé et justifié.
3. Populations étudiées
3.1 Les chercheurs doivent identifier les populations visées par le programme de vaccination, la population vulnérable face à la maladie en question et toutes les populations qui peuvent être indirectement touchées par le programme de vaccination, que ce soit par des externalités ou par des retombées.
3.2 Les chercheurs doivent présenter une analyse globale qui inclut les coûts et les résultats en matière de santé pour toutes les populations concernées. Le cas échéant, les chercheurs doivent également résumer les résultats séparément pour chaque groupe touché (par exemple, la population visée, la population subissant des externalités ou des retombées) qui a été inclus dans l’analyse globale.
3.3 Lorsqu’il existe des facteurs susceptibles d’entraîner des différences de coûts et de résultats liés au programme de vaccination entre les sous-groupes, les chercheurs doivent réaliser des évaluations économiques distinctes pour chaque sous-groupe. Ces facteurs peuvent inclure des facteurs démographiques, des facteurs comportementaux, des facteurs liés à la maladie et l’efficacité du vaccin ou des interventions de comparaison.
Les résultats de toute évaluation économique d’un programme de vaccination dépendent de l’incidence du programme de vaccination sur trois populations : 1) les populations visées par le programme de vaccination; 2) la population vulnérable face à la maladie en question; et 3) les populations qui peuvent subir des externalités ou des retombées. Dans les cas où un programme de vaccination est associé à des externalités, la population visée par le programme de vaccination et la population susceptible de subir des externalités doivent être identifiées dans le problème de décision. Les chercheurs doivent relever toutes les externalités associées aux programmes de vaccination (par exemple, l’immunité collective, le déplacement lié à l’âge de la maladie), et les populations qu’elles sont censés toucher. Par exemple, on peut s’attendre à ce qu’un programme de vaccination contre la rougeole destiné aux nourrissons et aux enfants entraîne une immunité collective susceptible d’éliminer la maladie à l’échelle de la population. Un autre exemple est le vaccin préventif contre la varicelle destiné aux jeunes enfants, qui pourrait accroître l’incidence du zona dans la population générale. De plus amples détails sur l’incorporation des externalités dans les évaluations économiques sont fournis au chapitre 8, Modélisation. En outre, les chercheurs doivent identifier les populations au sein desquelles le programme de vaccination pourrait avoir des retombées (p. ex. les aidants naturels).
Ils doivent fournir une description détaillée de chaque population prise en considération dans l’analyse, y compris l’âge, le sexe et l’emplacement géographique. Les chercheurs doivent également décrire tous les autres facteurs qui déterminent l’admissibilité au programme de vaccination évalué, ainsi que les facteurs susceptibles de toucher l’ampleur des externalités ressenties.
Les chercheurs doivent présenter une analyse globale qui inclut les coûts et les résultats pour toutes les populations concernées, y compris les groupes identifiés pour le programme de vaccination et tous les groupes qui pourraient subir des externalités ou des retombées. Cette analyse doit être présentée pour chaque stratégie de mise en œuvre envisagée (par exemple, vaccination universelle, vaccination des groupes à haut risque uniquement, vaccination des enfants uniquement). Le cas échéant, les chercheurs doivent également résumer les résultats séparément pour chaque groupe touché (par exemple, la population visée, la population subissant des externalités ou des retombées) qui a été inclus dans l’analyse globale.
Cependant, dans les situations où des hétérogénéités susceptibles d’influer sur les résultats d’une évaluation économique ont été relevées entre des groupes d’individus, il convient d’entreprendre des évaluations économiques pour différentes stratégies qui améliorent la couverture au sein de chacun des sous-groupes et présenter des résultats stratifiés par sous-groupe. Dans l’idéal, cela devrait reposer sur un modèle mathématique sous-jacent qui prenne en considération tous les sous-groupes et leurs interactions. Les hétérogénéités importantes concernant les programmes de vaccination peuvent être des facteurs démographiques (p. ex. l’âge, le genre, la situation géographique), des facteurs comportementaux (p. ex. l’adoption prévue du programme de vaccination, les comportements liés à la prise de risque), des facteurs liés à la maladie (p. ex. l’histoire naturelle de la maladie, le risque de transmission de la maladie), l’efficacité réelle du vaccin ou des interventions de comparaison ainsi que l’utilité pour la santé ou les coûts associés aux états pathologiques ou aux interventions inclus dans l’analyse.
4. Comparateurs
4.1 Choisir les comparateurs en fonction de la portée du problème de décision. Les comparateurs choisis doivent être adaptés à la population visée par le programme de vaccination et à la région où la décision s’appliquera. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
4.2 Les chercheurs doivent prendre en considération les approches préventives et thérapeutiques dans le choix des comparateurs pour les évaluations économiques des programmes de vaccination. Les interventions préventives peuvent inclure des mesures basées sur les vaccins, des programmes de dépistage, des interventions préventives fondées sur des médicaments et des interventions préventives non médicales.
Lorsqu’ils choisissent les comparateurs pour les évaluations économiques des programmes de vaccination, les chercheurs doivent prendre en considération toutes les interventions actuelles, celles qui pourraient devenir disponibles dans un avenir proche et celles qui pourraient être déplacées en raison du programme de vaccination évalué. Les interventions utilisées à la fois pour la prévention et le traitement de la maladie en question doivent être prises en considération. Les interventions préventives peuvent inclure des mesures basées sur les vaccins, des programmes de dépistage, des interventions préventives fondées sur des médicaments et des interventions préventives non médicales. Souvent, plus d’un comparateur sera pertinent pour l’évaluation économique et, par conséquent, tous les comparateurs pertinents doivent être inclus.
Les mesures fondées sur les vaccins pourraient inclure d’autres vaccins contre le même agent pathogène (par exemple, vaccin inactivé trivalent parentéral contre vaccin vivant atténué intranasal antigrippal, vaccins à cellules entières contre vaccins acellulaires contre la coqueluche, vaccins à ARNm contre vaccins à vecteur viral pour l’infection au coronavirus 2019 [COVID-19] ou vaccins avec des valences supplémentaires (par exemple, vaccins conjugués antipneumococciques 10-valents et 13-valents [PCV10 et PCV13]). Les mesures fondées sur les vaccins pourraient également inclure une mise en œuvre ou une livraison différente avec le même produit vaccinal. Parmi les exemples figurent la vaccination universelle contre la vaccination des groupes à haut risque uniquement; la vaccination du groupe d’âge prévu sans stratégie de rattrapage contre la vaccination du groupe d’âge prévu avec une stratégie de rattrapage pour d’autres groupes d’âge; la stratégie de vaccination sans doses de rappel contre la stratégie avec doses de rappel; les stratégies de vaccination reposant sur un nombre de doses différent ou des calendriers d’administration différents; des milieux d’administration différents, comme une stratégie de vaccination dans les écoles, une stratégie de vaccination dans un centre de santé publique ou une stratégie de vaccination de masse dans un vaccinodrômeNote de bas de page 10 Note de bas de page 11 Note de bas de page 12 Note de bas de page 13.
Les programmes de dépistage (également connus sous le nom de prévention secondaire) pourraient inclure des examens et des tests réguliers permettant de détecter la maladie à son stade le plus précoce. Ceux-ci pourraient être modifiés en raison de l’introduction des programmes de vaccination. Par exemple, la vaccination contre le VPH peut modifier la valeur et la nécessité des frottis cytologiques de routine pour le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les interventions préventives médicamenteuses peuvent nécessiter l’administration de médicaments avant ou après l’exposition. Il s’agit, par exemple, des médicaments antipaludéens destinés aux voyageurs canadiens se rendant dans des régions où le paludisme est endémique, et de la prophylaxie pré et post-exposition au virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Les interventions préventives non médicales pourraient inclure des mesures physiques comme les préservatifs pour prévenir les infections transmissibles sexuellement, les masques faciaux pour prévenir la transmission des infections respiratoires ou des modifications comportementales comme le respect de la distanciation physique et le lavage des mains pour prévenir les infections qui se transmettent par des contacts personnels étroits entre individus.
Lorsque des comparateurs fondés sur le traitement sont envisagés, les chercheurs doivent savoir que les soins de soutien optimaux doivent être considérés comme étant le comparateur pertinent dans les cas où il n’existe aucun traitement curatif pour la maladie en question.
5. Perspectives
5.1 Il faut présenter deux analyses de référence dans le cadre de l’évaluation économique des programmes de vaccination : l’une menée dans la perspective du système de santé financé par l’État et l’autre dans la perspective sociétale.
5.2 « Veiller à ce que les coûts comme les résultats ou effets des interventions soient compatibles avec la perspective déterminée. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
Il faut réaliser deux analyses de référence dans le cadre de l’évaluation économique des programmes de vaccination : l’une menée dans la perspective du système de santé financé par l’État et l’autre dans la perspective sociétale. Dans les présentes lignes directrices, le système de santé désigne à la fois les services de traitement des soins de santé et la santé publique.
Perspective du système de santé financé à même les fonds publics
En ce qui concerne l’analyse de référence menée du point de vue du système de santé financé par l’État, le champ d’application de la perspective doit être défini de manière à inclure un seul système de santé provincial/territorial à financement public, plusieurs systèmes de santé régionaux à financement public ou un système national. Les chercheurs doivent inclure : 1) les résultats en matière de santé expérimentés par les personnes vaccinées et leurs soignants informels; 2) les coûts encourus par le système de santé. Il faut reconnaître que, lorsque l’analyse de référence concerne plusieurs systèmes de santé financés par l’État, les éléments de coût financés par l’État peuvent varier d’une administration à l’autre (p. ex. les médicaments sur ordonnance), voire au sein d’une même administration (soins de longue durée). Les variations dans les éléments inclus entre les systèmes doivent être rendues transparentes.
Dans les cas où les vaccins sont associés à des externalités, les coûts et les résultats en matière de santé pris en considération dans l’analyse doivent inclure également les coûts et les résultats pour les personnes non vaccinées, car le vaccin joue un rôle essentiel dans la santé de la populationNote de bas de page 14. Les résultats en matière de santé à l’échelle de la population qui doivent être pris en considération sont les suivants 1) l’incidence de l’infection et de la maladie chez les personnes vaccinées et non vaccinées; 2) les changements dans la répartition par âge des personnes infectées à la suite du déplacement lié à l’âge du programme de vaccination (lorsque cela a des conséquences sur le fardeau global de la maladie en raison de la dépendance à l’âge de la gravité de la maladie; 3) l’émergence de nouvelles maladies liées à des variations de l’agent pathogène (c.-à-d. sérotypes, sérogroupes, souches) ou à des agents pathogènes non apparentés qui peuvent remplacer ceux visés par le vaccin; 4) l’éradication de la maladie.
Les coûts à l’échelle de la population qui doivent être pris en considération selon cette perspective sont les suivants : les coûts de mise en œuvre, de prestation et de maintien en puissance du programme de vaccination, y compris les campagnes de santé publique et les coûts de transaction relatifs à l’introduction de nouveaux vaccins ou au passage d’un vaccin à l’autre; les coûts du dépistage, du diagnostic et du traitement de la maladie; les coûts de la surveillance épidémiologique, de la recherche des contacts, des enquêtes sur les cas et des enquêtes sur les éclosions. Le chapitre 11, Utilisation et coût des ressources, donne des conseils sur la quantification des coûts associés à ces résultats.
Perspective sociétale
Il est également recommandé de procéder à une analyse de référence supplémentaire dans une perspective sociétale, car bon nombre de vaccins préviennent des maladies qui ont des répercussions au-delà du secteur de la santé. Par exemple, le vaccin contre l’Haemophilus influenzae type b (Hib) administré aux nourrissons prévient les séquelles neurologiques (par exemple, la surdité, la cécité, les retards de développement), qui ont toutes une incidence sur la fréquentation scolaire de l’enfant, sa productivité et sa consommation futures, ainsi que sur son bien-être global.Note de bas de page 15 Note de bas de page 16 Même des maladies relativement bénignes, comme la diarrhée infantile résultant d’une infection à rotavirus, peuvent avoir des répercussions au-delà du secteur de la santé. Dans bon nombre de cas, des soins médicaux ne sont pas nécessaires pour traiter ces infections; néanmoins, un parent doit s’absenter de son travail pour s’occuper de l’enfant malade.Note de bas de page 17 Note de bas de page 18 Enfin, les maladies comme la COVID-19 ont des conséquences sanitaires et économiques considérables qui s’étendent à tous les domaines de l’économie,Note de bas de page 19 et ces effets pourraient être atténués par des programmes de vaccination.Note de bas de page 20 Note de bas de page 21 Ne pas prendre en considération l’ensemble des avantages associés aux vaccins revient à sous-estimer le rôle de la santé comme moteur de l’activité économique et du bien-être et pourrait conduire à une sous-évaluation des programmes de vaccinationNote de bas de page 14.
L’analyse effectuée dans une perspective sociétale permet de refléter tous les résultats en matière de santé et les coûts pour le système de santé, dans la perspective de celui-ci. En outre, elle permet de refléter les répercussions qui ne relève pas du système de santé financé à même les fonds publics, notamment : les coûts des soins de santé non financés par le système de santé, les coûts directs à la charge des patients, la productivité, la consommation, l’éducation, les services sociaux et l’environnement. Les effets à plus long terme, comme l’effet des maladies infantiles sur les troubles du développement neurologique, le niveau d’éducation et la productivité (et la consommation) à long terme subséquente, doivent également être pris en considération lorsque cela est pertinent et possible. Ces effets potentiels sont énumérés, accompagnés d’exemples, dans le tableau 1 de l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination. Ce tableau a été adapté à partir de l’inventaire des effets publié par le deuxième groupe d’experts sur les coûts-avantagesNote de bas de page 22 pour inclure également les effets plus vastes associés aux vaccins décrits dans la littérature. Note de bas de page 14 Note de bas de page 22 Note de bas de page 23 Note de bas de page 24 Note de bas de page 25 Ce tableau fournit la liste complète des effets sur la santé et autres qui pourraient résulter des programmes de vaccination. L’intention est de permettre aux chercheurs de prendre en considération de manière systématique les effets lorsqu’ils planifient et réalisent des évaluations économiques des programmes de vaccination. Des conseils précis sur la quantification de ces effets et de leurs coûts connexes se trouvent au chapitre 11, Utilisation et coût des ressources.
Les chercheurs doivent remplir et présenter le tableau 1 dans le cadre de leur analyse afin d’indiquer de manière explicite quels effets sont inclus et exclus de l’évaluation économique pour chacune des deux analyses de référence. La colonne des commentaires peut être utilisée pour justifier l’inclusion ou l’exclusion de certains effets ou pour fournir des renseignements supplémentaires.
6. Horizon temporel
6.1 Dans l’analyse de référence, l’horizon temporel doit être suffisamment long pour détecter toutes les différences pertinentes entre les interventions quant à leurs coûts et à leurs résultats (effets sur la santé) futurs connexes. L’horizon temporel devrait être déterminé en fonction de la maladie et de l’effet probable de l’intervention. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
6.2 Les chercheurs doivent justifier leur choix d’horizon temporel. Lorsqu’il s’étend sur une longue période (c’est-à-dire sur plusieurs décennies), les chercheurs doivent les chercheurs doivent estimer le RCED à partir de divers points dans le temps tout au long de l'horizon temporel.
Les modèles utilisés pour estimer la rentabilité des programmes de vaccination peuvent être des modèles fermés ou ouverts. Les modèles fermés suivent une cohorte d’individus sur une période et ne permettent pas l’entrée de nouveaux individus dans le modèle. La plupart des modèles de Markov (transition entre des états de santé) sont des modèles fermés. Les modèles fermés sont généralement statiques, ce qui signifie qu’ils ne tiennent pas compte de la dynamique de transmission de la maladie entre les individus. Les modèles ouverts, en revanche, permettent l’entrée de nouveaux individus (par exemple, par le biais de nouvelles naissances, de l’immigration) dans le modèle au fil du temps, en particulier pour tenir compte de la dynamique de transmission de la maladie dans une population au fil du temps.Note de bas de page 26
Étant donné que les modèles fermés de programmes de vaccination suivent une seule groupe d’individus, ils doivent la suivre sur un horizon temporel suffisamment long pour saisir toutes les différences importantes dans les coûts et résultats futurs liés aux stratégies de vaccination comparées.
Les modèles ouverts peuvent avoir des horizons temporels qui s’étendent au-delà de la vie d’un individu vivant au début de la simulation, et peuvent donc nécessiter un horizon temporel qui s’étend sur plusieurs générations. Cela est particulièrement vrai pour les vaccins qui assurent une protection au niveau de la population grâce à une immunité collective sur plusieurs générations. Par exemple, une cohorte d’individus vaccinés contre la rougeole aujourd’hui peut empêcher la transmission de cette infection à une autre génération des années plus tard. Les personnes qui ne sont pas vaccinées bénéficieraient de cette protection pour le reste de leur vie, et ne contamineraient pas les futures génération de rougeole qui en bénéficieraient également pour le reste de leur vie.Note de bas de page 27 Note de bas de page 28
Les modèles ouverts comportent généralement trois phases : 1) la phase de rodage, 2) la phase d’évaluation et 3) la phase de stabilité. La phase de rodage doit tenir compte des caractéristiques épidémiologiques de la maladie avant l’introduction du vaccin afin de prévoir de façon réaliste et précise l’adoption du vaccin. Les estimations épidémiologiques utilisées pendant la phase de rodage doivent être validées à partir des données historiques sur la maladie en question. Le chapitre 8, consacré à la modélisation, donne plus de précisions sur la validation. La phase d’évaluation commence lorsque le programme de vaccination est mis en œuvre dans la population visée et doit être suffisamment longue pour tenir compte des externalités associées au vaccin. La phase de stabilité commence lorsque la variation épidémiologique prend fin.Note de bas de page 29
Pour l’exemple de la rougeole ci-dessus, et pour des vaccins similaires, l’horizon temporel du modèle doit se poursuivre jusqu’à ce que les RCED non actualisés atteignent un état stable. C’est le moment où le rapport entre les coûts incrémentaux cumulatifs et les résultats de santé incrémentaux cumulatifs (QALY) entre les interventions comparées se stabilise. Dans ces cas, il faut déterminer la durée appropriée de l’horizon temporel du modèle pendant l’analyse, plutôt qu’avant.Note de bas de page 9
La stabilité des estimations supplémentaires et du rapport coût-efficacité différentiel non actualisé en tant que critère devrait signifier que l’horizon temporel du modèle sera suffisamment long pour refléter l’ensemble des coûts et des avantages de l’immunité collective, ainsi que toutes les autres externalités (comme la variation de l’âge de maladie) associées à un programme de vaccination. Les chercheurs doivent noter que les modèles peuvent atteindre l’état de stabilité épidémiologique avant que les estimations supplémentaires et du rapport coût-efficacité différentiel se soient stabilisées. Par exemple, un programme peut continuer à accumuler des coûts ou des AVAQ par rapport à l’autre même après que l’équilibre épidémiologique a été atteint. Dans ces cas, l’horizon temporel du modèle doit être maintenu jusqu’à ce que l’estimation du rapport coût-efficacité différentiel se soit stabilisée.
Pour certains programmes de vaccination, il peut être nécessaire de modéliser un très grand nombre de générations pour obtenir des estimations stables du rapport coût-efficacité différentiel, mais cette approche n’est pas toujours pratique ou appropriée pour le processus décisionnel.Note de bas de page 28 Par exemple, les chercheurs doivent noter que la modélisation d’un grand nombre de générations n’est pas nécessaire dans les situations où l’on ne s’attend pas à ce que le programme de vaccination entraîne l’élimination de la maladie ou qu’il faille de nombreuses années pour qu’il produise tous ses effets, comme dans le cas de certaines maladies saisonnières (par exemple tétanos). Si le modèle n’est pas exécuté jusqu’à ce que les estimations supplémentaires et du rapport coût-efficacité différentiel soient stabilisés, les chercheurs doivent en justifier la raison et définir la durée d’exécution en termes d’horizon temporel ou de nombre de cohortes, et fournir une justification de ce choix.Note de bas de page 30
En justifiant l’horizon temporel et le nombre de cohortes, les chercheurs doivent être conscients des compromis à faire entre le biais et l’incertitude. Des horizons temporels plus courts peuvent introduire un biais dans les estimations du rapport coût-efficacité car ils ne laissent pas suffisamment de temps pour tenir compte des changements épidémiologiques résultant du programme de vaccination. Des horizons temporels plus courts donnent plus de poids aux coûts anticipés liés au lancement du programme de vaccination par rapport aux coûts ultérieurs ou annuels, et réduisent les conséquences de l’actualisation sur les résultats mesurés. Des horizons temporels plus courts peuvent également ne pas permettre de quantifier tous les avantages obtenus par les générations finales vaccinées. Cela peut ne pas être un problème pour les programmes de vaccination à grande échelle où le payeur emprunte pour financer le programme, et où les coûts sont en annuités.
Pour les modèles à long terme, les chercheurs doivent tenir compte de la possibilité de changements futurs qui pourraient modifier les coûts et les avantages du vaccin (par exemple, changements technologiques, estimations à long terme de l’efficacité du vaccin, projections démographiques).Note de bas de page 10 Note de bas de page 31 Note de bas de page 32 Bien qu’une partie de cette incertitude puisse être prise en compte dans le taux d’escompte (notamment par le « risque catastrophique » - le risque qu’un événement imprévu fasse disparaître une grande partie de la valeur de l’intervention), les chercheurs peuvent souhaiter tenir compte d’incertitudes à long terme propres au contexte, comme l’émergence de maladies résistantes au traitement. Lorsque l’horizon temporel s’étend sur une longue période (c’est-à-dire plusieurs décennies), les chercheurs doivent présenter les estimations du rapport coût/efficacité différentiel à partir de divers points temporels tout au long de l’horizon temporel.
Dans certaines juridictions, les effets des coûts élevés de mise en œuvre anticipée des programmes de vaccination peuvent être tempérés par la conversion en annuités, reflétant les pratiques d’emprunt des agences gouvernementales pour financer des programmes à grande échelle. Quelle que soit la durée de l’horizon temporel, les analyses doivent indiquer les taux utilisés pour la conversion en annuités et l’amortissement (le cas échéant). Il peut être approprié de mener l’analyse avec et sans annuités des coûts de mise en œuvre anticipés.
7. Actualisation
7.1 Dans l’analyse de référence, actualiser les coûts et les résultats (effets) des interventions pour une période dépassant la première année afin de présenter les valeurs selon un taux de 1,5 % par an. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
7.2 Évaluer le retentissement de l’incertitude liée au taux d’escompte en comparant les résultats de l’analyse de référence à ceux d’analyses complémentaires à l’aide des taux de 0 % et de 3 % par an. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
L’actualisation des coûts, des résultats sanitaires et non sanitaires dans les évaluations économiques reflète la préférence sociétale pour la consommation actuelle par rapport à la consommation future. En effet, l’actualisation réduit la valeur des coûts et des résultats futurs par rapport à leur valeur actuelle. Le taux d’escompte tient compte du taux social de préférence temporelle, des taux de croissance des ressources de santé et de la valeur de consommation de la santé, ainsi que de l’incertitude quant à la réalisation des résultats de santé futurs.Note de bas de page 33 Note de bas de page 34
L’actualisation en matière de santé dans les évaluations économiques des programmes de vaccination peut avoir un effet profond sur la rentabilité des programmes, en particulier dans les situations où les avantages attendus du programme de vaccination peuvent ne pas se manifester avant des années, voire des générations (par exemple, la prévention du cancer du col de l’utérus par un programme de vaccination contre le VPH). Les populations pédiatriques sont particulièrement sensibles à ces effets. L’actualisation des résultats en matière ou non de santé qui s’accumulent dans un avenir lointain peut entraîner une réduction considérable de leur valeur actuelle. Par exemple, dans une analyse coûts-efficacité d’un programme de vaccination contre le VPH, les auteurs font état d’un rapport coût-efficacité non actualisé de 7 600 €/AVAQ, qui passe à 59 100 €/AVAQ lorsqu’on applique un taux d’escompte de 4 % aux coûts et aux avantages (3 462 AVAQ non actualisées contre 438 AVAQ actualisées).Note de bas de page 35
Les deux approches les plus courantes de l’actualisation dans les évaluations économiques des programmes de vaccination sont les suivantes : 1) l’actualisation constante, où le même taux d’escompte fixe est appliqué aux résultats et aux coûts; et 2) l’actualisation différentielle, où un taux d’escompte inférieur est appliqué aux résultats par rapport aux coûts.Note de bas de page 33 Note de bas de page 34 Note de bas de page 35 Note de bas de page 36
L’approche d’actualisation la plus couramment employée dans les évaluations économiques des programmes de vaccination est l’actualisation constante, qui est également l’approche la plus souvent appliquée dans les évaluations économiques des interventions sanitaires non vaccinales.Note de bas de page 34 Certaines lignes directrices des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination et certaines lignes directrices sur l’évaluation des technologies de la santé (ETS) recommandent des approches d’actualisation différentielle dans les analyses d’incertitude ou dans des circonstances particulières.Note de bas de page 37 Note de bas de page 38 Les arguments en faveur de l’actualisation constante sont la cohérence et l’équité horizontale.Note de bas de page 34 L’argument de la cohérence part du postulat selon lequel les technologies de santé associées aux mêmes résultats et coûts sur le même horizon temporel analytique reçoivent la même priorité de la part des décideurs, quel que soit le moment où elles sont initiées.Note de bas de page 39 Cela s’explique par la valeur constante de la santé dans le temps. L’argument de l’équité horizontale part du postulat selon lequel tous les individus qui peuvent bénéficier d’un programme de vaccination, quel que soit le moment où ils en bénéficient par rapport au moment où le programme a été lancé, sont traités de la même manière. L’actualisation constante empêche de donner la préférence aux programmes de vaccination qui s’étendent sur plusieurs générations par rapport aux programmes durent moins longtemps.Note de bas de page 33
Un argument en faveur d’une actualisation différentielle avec un taux d’escompte plus faible pour les résultats liés ou non à la santé par rapport aux coûts est d’accorder sur le plan normatif plus de poids aux avantages futurs. Un autre argument principal en faveur de l’actualisation différentielle est la valeur croissante que représente la santé future, ou l’évolution des seuils permettant de juger de la rentabilité.Note de bas de page 40 Les taux d’escompte pourraient être ajustés pour refléter ces changements, mais ils pourraient aussi être traités de manière plus explicite dans une analyse. En ce qui concerne les programmes de vaccination, de longs horizons temporels – souvent des générations – sont nécessaires pour obtenir des résultats liés aux effets indirects de l’immunité collective, qui profitent non seulement aux personnes vaccinées mais aussi aux cohortes futures par l’élimination ou l’éradication de la maladie.Note de bas de page 34 L’utilisation d’une actualisation constante, en particulier avec des taux d’escompte plus élevés, peut rendre la valeur actuelle de ces programmes proche de zéro. Lorsque des taux d’escompte non constants sont appliqués, la valeur actuelle des résultats en matière de santé survenant dans un avenir lointain augmente par rapport à une stratégie d’actualisation constante.
Un inconvénient de l’actualisation différentielle (et non constante) est que l’utilisation stratégique des horizons temporels et du nombre de cohortes incluses pourrait modifier les estimations du rapport coût-efficacité. O’Mahony et ses collaborateurs, par exemple, donnent un exemple dans lequel ils comparent les approches d’actualisation constante et différentielle dans une analyse coûts-efficacité d’un programme de vaccination contre le VPH chez les filles de 12 ans. Les auteurs ont examiné des cohortes de 1, 10, 20 et 30 naissances. Ils ont actualisé les résultats et les coûts de santé avec un taux égal de 4 %, et avec des taux différentiels de 1,5 % et 4 % respectivement. Comme prévu, ils ont démontré que le rapport coût-efficacité différentiel diminuait à mesure que le nombre de cohortes augmentait avec la stratégie d’actualisation différentielle, mais pas avec la stratégie constante.Note de bas de page 41 Bien que des solutions normatives et analytiques à ce problème aient été formulées,Note de bas de page 41 Note de bas de page 42 il soulève des préoccupations potentielles quant au fait que des choix analytiques injustifiés dans les analyses économiques pourraient entraîner des variations dans les résultats. Cela souligne la nécessité d’une orientation appropriée sur l’utilisation de l’actualisation différentielle.
Les chercheurs doivent actualiser les résultats en matière de santé et les coûts après un an à un taux de 1,5 % par an dans les analyses de référence. Cette valeur représente le coût réel des emprunts à long terme pour les provinces canadiennes, qui sont les autorités responsables du financement de la majorité du système de soins de santé canadien,Note de bas de page 4 et se rapproche du taux auquel la société est prête à échanger sa consommation actuelle contre une consommation future.Note de bas de page 34
Il faut effectuer des analyses de sensibilité en utilisant des taux de 0 % et de 3 % par an, appliqués à la fois aux résultats en matière de santé et aux coûts pour tenir compte de toute incertitude dans le taux d’escompte. Le faible taux d’escompte dans les analyses de référence atténue certaines des préoccupations concernant les valeurs actuelles des résultats en matière de santé attendus dans un avenir lointain. Dans les situations où les effets d’un programme de vaccination s’étendent sur plusieurs générations et peuvent être influencés par la stratégie ou le taux d’escompte utilisé dans l’analyse, la présentation de résultats non actualisés aidera les décideurs à évaluer les effets intergénérationnels potentiels. Le chapitre 14 consacré à l’équité propose une discussion plus approfondie sur l’équité intergénérationnelle.
8. Modélisation
8.1 Conceptualiser et élaborer le modèle en fonction du problème de décision. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
8.2 Dans la conceptualisation du modèle, prendre en considération tout modèle bien construit et validé qui incorpore adéquatement le cheminement clinique dans la maladie d’intérêt. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
8.3 La structure du modèle doit refléter l’évolution naturelle de la maladie et du cheminement clinique ou de soin et tenir compte de la réceptivité, de l’infectiosité et de l’immunité liées à l’infection.
8.4 Le cas échéant, il faut intégrer au modèle les dynamiques comportementales pertinentes, y compris les habitudes de contact entre les individus et les comportements liés à la prévention et au contrôle des infections.
8.5 Des modèles dynamiques doivent être pris en considération dans les évaluations économiques des vaccins et associés à des externalités comme la prévention de la transmission interhumaine de l’infection et le déplacement lié à l’âge de la maladie.
8.6 D’autres attributs du modèle, notamment le fait qu’il soit déterministe ou stochastique, basé sur les populations ou sur les individus, et ouvert ou fermé, doivent être considérés dans le contexte du problème de décision.
8.7 Les chercheurs doivent rendre compte de manière transparente des processus de calage et de validation du modèle qui ont été entrepris et de leurs résultats.
Ce chapitre présente les considérations liées à la construction des modèles utilisés pour estimer la rentabilité des programmes de vaccination. Un examen des modèles dynamiques et statiques dans le contexte de la modélisation des maladies infectieuses est présenté, suivi d’un aperçu des autres attributs des modèles. La section se termine par des recommandations sur le calage et la validation du modèle.
Structure et attributs du modèle
La structure et les attributs du modèle doivent refléter l’histoire naturelle de la maladie et inclure tous les états de santé pertinents et les transitions entre ces états. Deux considérations principales entrent en jeu lors de la conceptualisation d’un modèle utilisé pour estimer la rentabilité d’un programme de vaccination : la transmission de l’infection entre individus est-elle importante pour estimer les effets d’un programme de vaccination, et les comportements et caractéristiques individuels sont-ils importants pour comprendre les résultats liés à un programme de vaccination? Les chercheurs doivent se référer aux taxonomies de modèles plus détaillées dans Brennan et al.Note de bas de page 43, Kim et Goldie,Note de bas de page 26 StahlNote de bas de page 44 et Mac et al.Note de bas de page 45 pour obtenir des détails supplémentaires si nécessaire.
D’autres conseils sur la construction de modèles pour l’évaluation économique des programmes de vaccination figurent au chapitre 13 consacré à l’incertitude (par exemple, veiller à ce que la structure du modèle tienne compte des facteurs liés à la transmission de l’infection entre individus, de l’histoire naturelle de la maladie modélisée, ainsi que des effets directs et indirects du programme de vaccination).Note de bas de page 28 Note de bas de page 46
Taux d’infection endogène ou exogène
Les modèles doivent tenir compte des externalités liées aux programmes de vaccination, comme l’immunité collective et la variation de l’âge de maladie. Dans ces lignes directrices, les termes « modèle dynamique » et « modèle statique » font référence à la nature du taux d’incidence qui est dynamique ou non (c’est-à-dire qui évolue dans le temps en fonction de la proportion de la population qui est infectieuse). On peut également dire qu’ils ont un taux d’infection « endogène » ou « exogène », respectivement.
Les modèles statiques, qui utilisent généralement un risque d’exposition constant, ne représentent pas explicitement la transmission dynamique de l’infection. Les modèles sont acceptables dans les évaluations économiques des programmes de vaccination lorsqu’il n’y a pas de transmission interhumaine (par exemple, le tétanos ou la rage).Note de bas de page 9 Ils sont également acceptables dans les situations où le groupe visé par la vaccination n’a pas d’influence épidémiologique sur la transmission (par exemple, la vaccination contre l’hépatite A du personnel de santé, la vaccination contre la grippe ou le pneumocoque chez les personnes âgées).Note de bas de page 9 Note de bas de page 28 Les modèles statiques peuvent également être acceptables pour les infections où l’individu est déjà un « hôte » (par exemple, certaines souches de pneumocoques; le virus varicelle-zona où l’incidence de l’infection est plutôt un événement aléatoire dans la vie d’une personne après une colonisation de longue date). Enfin, un modèle statique est acceptable dans les cas suivants : 1) il est démontré qu’un programme de vaccination est rentable, et un modèle dynamique ne servirait qu’à renforcer cette conclusion en comptabilisant les infections évitées par la protection indirecte ou la transmission secondaire; ou 2) il n’est pas démontré qu’un programme de vaccination est rentable, mais il existe des données épidémiologiques ou de modélisation qui permettront d’estimer l’ampleur de l’immunité collective ou de la transmission secondaire dans le même contexte ou un contexte très similaire.Note de bas de page 28 Note de bas de page 47
Bien que les scénarios précédents décrivent des situations où les modèles statiques peuvent être acceptables pour estimer la rentabilité des programmes de vaccination, les chercheurs doivent être conscients de leurs limites. Tout d’abord, lorsqu’un modèle statique a démontré la rentabilité d’un vaccin sans tenir compte des effets de l’immunité collective ou de la transmission secondaire, la rentabilité réelle de l’intervention peut être sous-estimée, ce qui pourrait se traduire par des décisions d’allocation des ressources biaisées dans le cadre d’un budget fixe des soins de santé.Note de bas de page 28 Deuxièmement, lorsque des données épidémiologiques ou de modélisation sont utilisées pour estimer l’ampleur de l’immunité collective ou de la transmission secondaire dans le contexte de modèles statiques, les estimations du rapport coût-efficacité peuvent être biaisées lorsque les données utilisées proviennent d’une population différente de celle considérée dans le modèle et lorsqu’il existe d’autres différences importantes. De plus, si les données utilisées sont issues de l’équilibre épidémiologique, la fluctuation de la prévalence dans la période initiale post-vaccination ne sera pas prise en compte. Cette limitation est particulièrement importante pour les programmes de vaccination avec une préférence temporelle positive, étant donné que la période initiale est celle où la plupart des coûts et des avantages liés au vaccin sont accumulés.Note de bas de page 47 Les arbres de décision, les modèles de Markov fondés sur les cohortes et les simulations d’événements discrets sont des exemples de modèles statiques.
Les modèles dynamiques, qui représentent explicitement la transmission de l’infection, doivent être pris en compte dans les évaluations économiques des programmes de vaccination où la transmission interhumaine est un facteur important. Par exemple, il faut utiliser des modèles dynamiques lorsqu’un programme de vaccination à grande échelle est censé modifier la force de l’infection, ce qui permet de contrôler, d’éliminer ou d’éradiquer une maladie en empêchant sa transmission.
Les modèles dynamiques doivent également être utilisés lorsqu’un programme de vaccination peut entraîner le remplacement du sérotype et la variation de l’âge de maladie. Les vaccins qui sont spécifiques à une certaine variation de l’agent pathogène (c’est-à-dire un sérotype, un sérogroupe ou une souche) peuvent réduire une variation de la maladie, mais en présence de multiples variations, la prévalence de l’infection due à des variations non vaccinales peut encore augmenter.Note de bas de page 48 Note de bas de page 49 Pour les maladies causées par de multiples variations d’un agent pathogène, les chercheurs doivent inclure chaque variation séparément dans le modèle afin de pouvoir tenir compte des infections et des maladies liées à l’émergence de nouvelles variations. Les situations où un programme de vaccination se traduit par une augmentation ou une diminution de l’âge moyen des individus touchés par une infection peuvent conduire à une augmentation correspondante de la gravité de la maladie, des coûts des traitements et de la mortalité, ce qui doit également être pris en compte dans une analyse coûts-efficacité.Note de bas de page 50 Note de bas de page 51 Les modèles de cohorte dynamiques et les modèles de simulation individuels sont des exemples de modèles dynamiques.
Pour choisir entre un modèle dynamique ou statique, les chercheurs doivent tenir compte des compromis entre la nécessité de représenter la transmission et les complexités supplémentaires associées aux modèles dynamiques. Dans certaines situations, la décision de choisir un type de modèle plutôt qu’un autre n’est pas toujours simple à prendre. Les modèles dynamiques sont conceptuellement et informatiquement plus complexes que les modèles statiques. Les décideurs qui sont les utilisateurs finaux des résultats produits doivent être en mesure de comprendre et d’interpréter la structure du modèle. Ils doivent également être convaincus que les résultats sont une représentation raisonnable de ce qui devrait se produire dans le monde réel après la mise en œuvre du programme de vaccination. Il existe également un compromis entre la complexité (et le réalisme) d’un modèle et la facilité avec laquelle il peut être compris, communiqué et validé. Dans certains cas, la transmissibilité entre individus peut entraîner la propagation d’une infection, mais la représentation de la transmission dans un modèle économique peut être inutile du fait de la nature du programme de vaccination. Par exemple, un modèle statique peut être adéquat pour prédire les effets d’un programme de vaccination universelle qui devrait atteindre un niveau élevé de couverture dans la population. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur l’utilisation d’un modèle statique ou dynamique lors de l’estimation de la rentabilité d’un programme de vaccination, les chercheurs peuvent consulter les schémas publiés par Jit et Brisson et l’Organisation mondiale de la Santé, qui délimitent les considérations liées à ce choix (figure 4, tableau 8).Note de bas de page 9 Note de bas de page 47
Il convient de noter qu’il existe des modèles « hybrides » entre les modèles dynamiques et statiques, dans lesquels les chercheurs ne tiennent pas entièrement compte de la transmission de l’infection. Ils estiment plutôt le nombre moyen d’infections secondaires évitées grâce à la prévention d’un cas et intègrent les coûts et les avantages de la prévention de ces cas dans l’analyse.
Autres attributs
Bien que le choix fondamental auquel sont confrontés les chercheurs qui modélisent la rentabilité des vaccins consiste à sélectionner des techniques de modélisation statique ou dynamique, ils doivent également tenir compte d’autres attributs liés à la structure du modèle. Les considérations liées à ces attributs sont examinées ci-après.
Modèle déterministe ou modèle stochastique
Dans les modèles déterministes, les événements dépendent de paramètres pré-spécifiés et de la structure du modèle; autrement dit, l’incertitude de premier ordre n’est pas prise en compte puisque les événements ne peuvent pas se produire de manière aléatoire (par hasard). Dans les modèles stochastiques, en revanche, les événements sont programmés pour se produire de manière aléatoire, en tenant compte de l’incertitude de premier ordre.Note de bas de page 26 Note de bas de page 52 Pour une discussion sur l’incertitude de second ordre (paramètres), les chercheurs se reporteront au chapitre 14 consacré à l’incertitude.
Les valeurs moyennes des paramètres utilisées dans les modèles déterministes peuvent se rapprocher de manière réaliste des processus modélisés si la population à risque est nombreuse et si l’infection n’est pas proche de l’élimination ou de l’éradication mondiale (par exemple, le VPH). Pour les petites populations (comme une éclosion d’infection à méningocoque B dans un collège) ou lors de la modélisation de l’augmentation d’une infection émergente ou rare qui est sur le point d’être éliminée (par exemple, la rougeole et la polio dans certains pays), les modèles qui intègrent la variabilité individuelle et l’incertitude de premier ordre (par exemple, les modèles individuels) sont plus appropriés car ils peuvent tenir compte des événements de transmission aléatoires qui sont importants dans ces situations.Note de bas de page 9 Note de bas de page 28
Modèle agrégé ou individuel
Dans les modèles agrégés (également appelés modèles populationnels ou modèles de cohorte) tels que les modèles de cohorte de Markov et les modèles dynamiques à compartiments, les groupes d’individus sont agrégés en compartiments représentant les états de santé en fonction de leurs caractéristiques. Les changements dans le temps représentent l’évolution de la proportion de la population dans chaque état de santé en fonction des valeurs moyennes des paramètres.Note de bas de page 26 Note de bas de page 53
Dans les modèles individuels (également appelés microsimulations ou modèles multi-agents), l’unité modélisée est l’individu, plutôt que le groupe. Les modèles qui simulent la transmission entre les individus infectés et les individus sensibles sont dynamiques, en ce sens que le risque d’infection évolue au cours de la simulation, tandis que ceux qui supposent un risque d’infection exogène indépendant de la présence ou non de personnes infectées dans la population sont statiques.Note de bas de page 26 Ce type de modèle est généralement plus complexe et nécessite plus de données qu’un modèle populationnel, et peut être programmé de manière stochastique afin que la probabilité d’événements futurs d’un individu tienne compte de l’incertitude liée au hasard.Note de bas de page 45
Les modèles individuels sont également appropriés en cas d’hétérogénéités importantes entre les individus d’une population. Ces hétérogénéités peuvent être liées à des facteurs génétiques, au statut socio-économique, à l’âge, à l’accès aux services de santé, au risque professionnel et aux changements de comportement en réaction aux éclosions de maladie, pour n’en citer que quelques-uns. Voir le chapitre 14 consacré à l’équité pour plus de différences liées à l’équité. Ces modèles peuvent être programmés de telle sorte que les individus sont capables de modifier leurs comportements au fil du temps en fonction de leurs interactions passées.Note de bas de page 52
Les modèles individuels sont également appropriés en cas d’hétérogénéités importantes entre les individus d’une population. Ces hétérogénéités peuvent être liées à des facteurs génétiques, au statut socio-économique, à l’âge, à l’accès aux services de santé et aux changements de comportement en réaction aux éclosions de maladie, pour n’en citer que quelques-uns. Voir le chapitre 14 consacré à l’équité pour plus de différences liées à l’équité. Ces types de modèles tiennent compte de ces caractéristiques et de l’effet qu’elles pourraient avoir sur les résultats de l’introduction d’un programme de vaccination.Note de bas de page 54
Les modèles populationnels, en revanche, sont appropriés pour les programmes de vaccination destinés à des groupes homogènes d’individus (par exemple, un programme de vaccination contre le pneumocoque pour les personnes âgées dans une zone géographique donnée)Note de bas de page 55 car ils présentent des caractéristiques similaires qui pourraient être raisonnablement représentées par des valeurs moyennes lorsqu’ils passent d’un état de santé à l’autre. Il faut noter que les modèles populationnels peuvent néanmoins incorporer une certaine hétérogénéité en stratifiant par risque et/ou en intégrant un mélange assortatif par groupes d’âge et sur d’autres facteurs de risque.
Pour modéliser les hétérogénéités entre les groupes ou les individus (y compris les différences liées à l’équité), les chercheurs doivent déterminer le niveau de détail requis pour modéliser correctement la rentabilité d’un programme de vaccination, et prendre en compte les compromis entre les différents types de modèles qui pourraient être utilisés pour intégrer ces hétérogénéités.
Modèle ouvert ou modèle fermé
Les modèles peuvent représenter des populations ouvertes ou fermées. Les modèles ouverts permettent à de nouveaux individus réceptifs, par le biais des naissances et de l’immigration, d’entrer dans le modèle et d’en sortir au fil du temps, alors que les modèles fermés ne le permettent pas. Bien que les modèles ouverts puissent être plus complexes sur le plan informatique, ils permettent aux chercheurs d’estimer l’évolution de la population visée par la vaccination et de tenir compte de ses caractéristiques telles que l’exposition au risque, l’âge et la gravité de la maladie.Note de bas de page 26 Note de bas de page 56
En règle générale, les modèles ouverts sont utiles pour prévoir l’évolution des coûts des soins de santé et des résultats des traitements pour les maladies infectieuses à différents moments de leur horizon temporel.Note de bas de page 57 Ils devraient être utilisés lorsque les effets des programmes de vaccination dans une cohorte influenceront d’autres cohortes de population (par exemple, les programmes d’immunisation des enfants contre des maladies comme la rougeole ou la polio). Les modèles fermés sont appropriés pour examiner les programmes de vaccination de petits groupes d’individus qui sont peu susceptibles d’avoir une influence épidémiologique dans la population plus large (par exemple, le programme de vaccination contre l’hépatite A pour les travailleurs de la santé) ou lorsque les effets du vaccin sont de courte durée (par exemple, le programme de vaccination antigrippale saisonnière). Il convient de noter que les modèles fermés avec de longs horizons temporels peuvent sous-estimer les coûts potentiels et les avantages pour la santé.
Modèle discret ou modèle continu
Les modèles continus sont recommandés lorsqu’il faut modéliser plusieurs événements simultanément, comme dans le cas d’éclosions de maladie où, par exemple, la transmission de l’infection entre individus peut dépendre de multiples facteurs tels que les habitudes de contact entre individus ou le nombre d’individus infectieux dans une population donnée.Note de bas de page 43 Bien que les modèles continus puissent fournir des résultats plus précis dans de telles situations, ces modèles sont plus complexes sur le plan informatique. Ils nécessitent l’utilisation d’équations différentielles ordinaires pour lesquelles les solutions peuvent être difficiles à obtenir. On peut déterminer approximativement les résultats des modèles continus en utilisant des modèles discrets avec un petit pas de temps et en redimensionnant les paramètres de manière appropriée.Note de bas de page 26 Note de bas de page 43
Calage du modèle
Le calage du modèle désigne le processus qui sert à estimer les paramètres inconnus du modèle en les réglant et en veillant à ce que les données de sortie du modèle correspondent bien aux données observées (cibles du calage).Note de bas de page 58 Dans la modélisation des maladies infectieuses, de nombreux paramètres peuvent être inconnus ou ne peuvent pas être estimés directement à partir des données disponibles. Il peut s’agir de paramètres liés à la progression naturelle de l’infection ou de la maladie, de détails relatifs aux comportements sexuels dans le cas des infections transmissibles sexuellement et de données concernant l’adoption et la distribution des résultats des interventions de dépistage.Note de bas de page 59 Les cibles de calage sélectionnées doivent être des données indépendantes, rapportées avec précision et présentant un degré élevé de validité interne et externe. Le cas échéant, ces données doivent être stratifiées par sous-groupes pertinents afin de garantir une performance adéquate du modèle dans les principales strates de population.Note de bas de page 60 Les chercheurs pourraient également envisager de solliciter l’avis d’experts lors de la sélection des cibles de calage.
Les chercheurs doivent garder à l’esprit que comme des décisions subjectives sont nécessaires au cours du processus de calage, telles que la sélection des cibles de calage, les mesures de qualité de l’ajustement et la méthode de calage, une incertitude entoure les méthodes de calage utilisées. Ces incertitudes peuvent se traduire par des différences considérables dans les résultats des évaluations économiques. Bien que le calage soit souvent gourmand en ressources informatiques, les chercheurs devraient, dans la mesure du possible, envisager d’utiliser plus d’une approche pour le calage des modèles et plusieurs statistiques de qualité d’ajustement.Note de bas de page 61 Les chercheurs doivent conserver l’incertitude dans les paramètres estimés du calage, qui peuvent ensuite être utilisés dans une analyse probabiliste.
La difficulté à caler plusieurs paramètres du modèle peut indiquer que la structure du modèle ou ses hypothèses sous-jacentes sont incorrectes. Elle peut également suggérer une compréhension limitée de l’évolution naturelle de la maladie modélisée ou des comportements qui influencent sa transmissibilité, sa détection ou son traitement. Elle peut aussi révéler des biais, des incohérences ou des imprécisions dans les données utilisées comme cibles de calage. Ainsi, elle ne doit pas être réduite ou ignorée, mais plutôt utilisée pour aider à établir les futures priorités de recherche.Note de bas de page 28
Validation du modèle
La validation est le processus utilisé pour garantir l’exactitude des résultats générés par les modèles utilisés dans les évaluations économiques. La validité d’un modèle doit être examinée dans un contexte décisionnel pertinent afin que les décideurs soient en mesure de déterminer si le modèle considéré répond au problème de décision en question.Note de bas de page 62 Les chercheurs doivent évaluer les divers aspects de la validité du modèle grâce à différentes méthodes.
La validité apparente consiste à déterminer si un modèle reflète la compréhension actuelle et les preuves liées à la maladie et au programme de vaccination envisagé. Elle demande l’évaluation subjective de la structure, des hypothèses, des sources de données et des résultats d’un modèle. Il est préférable de confier cette tâche à des experts cliniques dans le domaine, et il est également possible de comparer la structure du modèle à des algorithmes cliniques acceptés pour les maladies. La validité interne, souvent appelée vérification, consiste à déterminer si le modèle se comporte comme il le devrait. Il s’agit de vérifier que les équations mathématiques utilisées dans le modèle ont été programmées correctement. Cela permet de s’assurer que le modèle ne comporte pas d’erreurs de calcul. La validation croisée consiste à comparer les résultats générés par un modèle et à déterminer dans quelle mesure ils correspondent aux résultats d’autres modèles.Note de bas de page 63 La validité externe consiste à comparer les résultats générés par un modèle avec des données existantes provenant de sources indépendantes telles que des essais cliniques, des études épidémiologiques, des statistiques démographiques couramment disponibles, comme les données de mortalité, ou des dossiers médicaux électroniques. La validation externe n’est pas possible dans les situations où le modèle utilise toutes les données pertinentes connues. Elle peut être difficile dans les situations où ces types de données n’existent pas ou lorsqu’elles ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une comparaison appropriée.Note de bas de page 64 La validité prédictive consiste à déterminer si un modèle remplit l’objectif pour lequel il a été conçu, à savoir prédire les résultats d’un programme de vaccination. C’est également le type de validation le plus difficile à réaliser, car les résultats doivent se rapporter à des événements ou à des études qui auront lieu dans le futur. Ce type de validation n’est généralement pas applicable au processus décisionnel relatif à un nouveau programme de vaccination.Note de bas de page 64 Cependant, elle peut être pertinente lors de l’élaboration d’un modèle basé sur des modèles plus anciens. Les chercheurs peuvent évaluer les anciens modèles avant de les réutiliser. Comme pour le calage des modèles, les chercheurs pourraient envisager de solliciter l’avis d’experts lorsqu’ils entreprennent des processus de validation des modèles.
9. Efficacité
9.1 Effectuer une recherche documentaire exhaustive afin d’appuyer l’estimation de l’efficacité clinique et de l’innocuité des interventions à l’étude. Faire état des études retenues et des méthodes de sélection ou de regroupement des données. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
9.2 Évaluer les sources de données selon leur aptitude à l’emploi, leur crédibilité et leur cohérence. Décrire les compromis consentis entre ces critères et justifier les sources choisies. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
9.3 Les critères suivants doivent être pris en considération dans l’évaluation des estimations de l’efficacité réelle des vaccins : l’efficacité réelle du vaccin par dose; la couverture vaccinale attendue; l’efficacité réelle en fonction des variations de l’agent pathogène (sérotypes, sérogroupes, souches); les facteurs géographiques et liés à l’hôte qui peuvent avoir une incidence sur l’efficacité réelle.
9.4 Les chercheurs doivent s’assurer que les biomarqueurs immunitaires utilisés comme résultats de substitution dans les études sur l’efficacité potentielle ou réelle des vaccins répondent aux critères des corrélats de protection.
Ce chapitre décrit les facteurs à prendre en compte pour évaluer l’efficacité réelle des vaccins, ainsi que les considérations liées à la synthèse des données, à l’interprétation et à l’utilisation des résultats de substitution, ainsi qu’à l’extrapolation des estimations de l’efficacité réelle.
Évaluation des estimations de l’efficacité réelle des vaccins
Plusieurs facteurs particuliers aux vaccins doivent être pris en compte pour interpréter les données sur l’efficacité réelle. Ils sont examinés ci-après.
Les chercheurs doivent connaître les différences entre l’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des vaccins. L’efficacité est établie par des essais contrôlés randomisés (ECR), qui évaluent les modifications des marqueurs immunitaires, la réduction de la gravité des maladies et l’amélioration de l’état de santé des personnes vaccinées. L’efficacité réelle des vaccins chez les individus est souvent différente de l’efficacité potentielle. Par exemple, les taux d’achèvement de la série vaccinale sont souvent plus élevés dans les ECR que dans le monde réel; le plan d’ECR présente des limites quant à la prise en compte de l’immunité communautaire; et il existe d’autres différences entre les populations des ECR et les populations du monde réel dans lesquelles le vaccin est utilisé.
L’achèvement de la série vaccinale est une considération importante pour les nombreux vaccins qui nécessitent l’administration de doses multiples à des intervalles de temps définis. Par exemple, le vaccin contre le VPH était initialement administré selon un calendrier à trois doses, mais on recommande désormais un calendrier à deux doses pour certains. Pour le calendrier à trois doses, la deuxième dose est administrée un à deux mois après la première, et la troisième dose six mois après la première.Note de bas de page 65 Les chercheurs doivent garder à l’esprit que chez les personnes qui ne reçoivent pas toutes les doses d’une série de vaccins recommandée, les taux d’efficacité réelle des vaccins peuvent être inférieurs à ceux observés chez les personnes qui reçoivent la série complète. Les chercheurs doivent évaluer à la fois les données des essais cliniques et les estimations de l’administration prévue des doses dans le monde réel, car les deux ont des points forts et des limites. Les données du monde réel peuvent provenir d’études d’acceptabilité sur l’administration de la série de vaccins ou de données sur l’administration d’autres séries de vaccins utilisées dans des populations similaires avec un nombre de doses similaire. Les chercheurs doivent garder à l’esprit que des facteurs de confusion résiduelle peuvent altérer les résultats des études d’observation qui examinent la relation entre les taux d’achèvement des doses et l’efficacité du vaccin. Plus précisément, les facteurs qui prédisent une probabilité moindre d’achèvement de la dose peuvent également augmenter le risque sous-jacent d’infection (p. ex. une exposition sexuelle plus précoce chez les filles qui reçoivent moins de trois doses de vaccin contre le VPH).Note de bas de page 13 Pour les analyses de référence, les chercheurs doivent utiliser les estimations de l’administration prévue des doses dans le monde réel en fonction des régions concernées et de la population visée par le programme de vaccination.
En ce qui concerne l’immunité communautaire, les ECR peuvent sous-estimer les effets d’un vaccin dans la population. C’est-à-dire que l’immunité communautaire n’est pas observée chez les participants à l’ECR puisqu’ils représentent une très faible proportion de la population. L’immunité collective dépend de la distribution de l’immunité conférée par le vaccin et de l’infection naturelle dans la population, de la transmissibilité de l’infection et des habitudes de contact des individus dans la population.Note de bas de page 66 L’efficacité au niveau de la population est généralement établie par des études d’observation, qui permettent normalement de saisir les effets indirects d’un vaccin. Les chercheurs ne doivent toutefois pas oublier que les études utilisant des données de surveillance sont soumises aux mêmes limites que les autres études d’observation et qu’il n’est peut-être pas approprié de les extrapoler à des milieux différents.Note de bas de page 28 Dans ces cas, il est possible d’utiliser des modèles dynamiques paramétrés grâce à des données épidémiologiques locales pour estimer les effets indirects des vaccins. Lorsqu’ils évaluent s’il convient d’inclure les estimations de l’efficacité potentielle ou de l’efficacité réelle des vaccins provenant d’ECR ou d’études d’observation dans les analyses de référence, les chercheurs doivent justifier quelles sources de données représentent le mieux les résultats obtenus dans les populations les plus semblables aux populations concernées par le programme de vaccination à mettre en œuvre.
Les variations géographiques doivent être prises en compte pour l’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des vaccins. Plusieurs études ont montré que l’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des vaccins peuvent varier selon les pays. On a envisagé divers facteurs pour expliquer ces différences, notamment : 1) les différences de prévalence des sérotypes ou des souches; 2) le rôle du climat et des températures moyennes quotidiennes; 3) les hétérogénéités de la population en ce qui concerne les facteurs sociaux et démographiques qui influencent l’efficacité potentielle du vaccin; 4) la co-administration d’autres vaccins (p. ex. la co-administration de vaccins oraux contre le rotavirus et la polio); et 5) les différences de prévalence d’autres infections endémiques.Note de bas de page 67 Note de bas de page 68
Les facteurs liés à l’hôte doivent également être pris en compte dans l’évaluation de l’adéquation des données sur l’efficacité potentielle et l’efficacité réelle des vaccins. Ces facteurs sont notamment l’âge, la prédisposition génétique à l’infection, les déficiences immunitaires congénitales, l’effet de la nutrition sur les réponses de l’hôte, la sensibilisation antérieure à des organismes antigéniquement apparentés à l’agent pathogène, les comorbidités, en particulier celles qui peuvent toucher la réponse immunitaire, les immunodéficiences secondaires dues aux médicaments et les éventuelles différences génétiques dans la réaction à un vaccin particulier.Note de bas de page 69 Les essais randomisés contrôlés ont tendance à ne porter que sur des adultes en bonne santé, alors que les études en situation réelle comprennent des populations vulnérables qui seraient autrement exclues des essais randomisés contrôlés, notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées.
La couverture vaccinale peut varier selon les groupes d’individus ou les zones géographiques. Par exemple, la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) de quatre doses ou plus chez les enfants de deux ans diffère entre les provinces canadiennes; elle est la plus élevée à Terre-Neuve-et-Labrador (89 %) et la plus faible au Manitoba (66 %), selon l’Enquête canadienne sur la couverture vaccinale de 2017.Note de bas de page 70 La couverture est un facteur important pour déterminer l’efficacité réelle au niveau de la population grâce à l’immunité collective. L’obtention de niveaux élevés de couverture vaccinale dépend de la stratégie de mise en œuvre adoptée lors de l’introduction d’un nouveau programme de vaccination, ainsi que des stratégies permanentes employées pour étendre et maintenir le programme. Par exemple, la promotion de la santé, les campagnes d’information et d’autres efforts visant à renforcer la confiance de la communauté peuvent contrer la réticence à l’égard de la vaccination. Le succès de ces stratégies dépendra de la capacité des ressources déployées, de la facilité d’accès aux doses de vaccins dans la population visée, de la préparation des fournisseurs de soins de santé et de l’attitude de ces derniers et du public. Ce sont tous des éléments distincts liés à la couverture vaccinale, et différents leviers peuvent être actionnés pour obtenir de meilleurs résultats. Les chercheurs devraient intégrer ces facteurs dans les évaluations économiques afin de mieux aligner ces évaluations sur les besoins pratiques des décideurs. Il est important de noter que l’inclusion de ces facteurs attire l’attention des décideurs sur des stratégies de mise en œuvre particulière, sur le temps et l’effort relatifs nécessaires à l’exécution de chacune d’elles, sur les compromis inhérents à ces autres plans d’action et sur leurs effets indépendants et conjoints sur la couverture de la population.Note de bas de page 71
Certains vaccins ne protègent que contre certaines variations d’un agent pathogène. Par exemple, le VCP13 est actif contre 13 des plus de 90 sérotypes connus du pneumocoque,Note de bas de page 9 Note de bas de page 72 et le vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque (VPSP23) est actif contre 23 sérotypes du pneumocoque.Note de bas de page 73 Les vaccins contre le VPH sont disponibles sous forme bivalente et quadrivalente, bien qu’il existe plus de 100 sérotypes du VPH.Note de bas de page 74 Pour ces types de vaccins, les chercheurs doivent s’assurer que les données d’efficacité réelle envisagées sont particulières aux maladies causées par les variations de l’agent pathogène ciblé par les vaccins. Les chercheurs doivent également savoir que dans certains cas, les vaccins particuliers à certaines variations de l’agent pathogène peuvent également conférer un certain degré de protection contre des variations de l’agent pathogène non couvertes par le vaccin. Un exemple de cette protection croisée a été démontré avec les vaccins bivalents et quadrivalents contre le VPH, qui ont conféré une certaine protection contre les infections et les lésions associées aux VPH 31, 33 et 45, qui sont des sérotypes non vaccinaux.Note de bas de page 74
Synthèse des données
Les chercheurs doivent être attentifs aux considérations propres aux vaccins lorsqu’ils combinent des données provenant de différentes sources, notamment des facteurs potentiels géographiques et liés à l’hôte décrits précédemment, qui peuvent être différents entre les populations étudiées et la population visée dans une analyse économique réalisée dans le contexte canadien.
Résultats de substitution
Dans la mesure du possible, il faut déterminer l’efficacité potentielle ou l’efficacité réelle des vaccins par des études comparatives (essais randomisés contrôlés ou études d’observation) qui indiquent l’incidence de la maladie infectieuse ciblée par le vaccin, dans le groupe vacciné par rapport aux comparateurs pertinents.
Le critère d’évaluation primaire de ces études doit être défini comme une infection cliniquement apparente répondant aux critères de diagnostic clinique et en laboratoire. Dans certaines situations, il peut être impossible de mesurer les cas d’infection cliniquement apparente. Un exemple d’une telle situation se présente lorsque l’incidence de l’infection est trop faible pour être mesurée dans une étude, généralement limitée par sa période d’étude et la taille de la population étudiée. Cette situation se produit avec des maladies infectieuses rares (comme la méningite due à une infection à méningocoque du groupe B) ou celles qui touchent rarement la population parce que les vaccins actuels assurent une prévention efficace.Note de bas de page 75 Note de bas de page 76 Un autre exemple est celui des vaccins antigrippaux saisonniers, dont beaucoup reçoivent une autorisation provisoire fondée sur la seule immunogénicité.Note de bas de page 77
Dans de tels cas, les corrélats de protection (CP), qui sont des biomarqueurs immunitaires (anticorps ou cellules T) permettant de prédire l’efficacité potentielle du vaccin chez les personnes vaccinées, peuvent être utilisés comme paramètres de substitution.Note de bas de page 75 Note de bas de page 78 Note de bas de page 79 Les chercheurs doivent savoir que plusieurs corrélats de protection peuvent exister pour le même vaccinNote de bas de page 80 Note de bas de page 81 et que différents types et formulations de vaccins contre la même maladie peuvent être associés à différents corrélats de protection.Note de bas de page 82 Note de bas de page 83 Pour les vaccins multivalents qui protègent contre plusieurs variations d’un agent pathogène, des titres plus élevés du corrélat de protection peuvent être nécessaires pour offrir une protection contre certaines variations par rapport à d’autres.Note de bas de page 84 Enfin, il est important que les chercheurs déterminent la dimension de la prévention (p. ex. la prévention de l’infection, la prévention de la maladie, la réduction de la gravité de la maladie) qui est liée à un corrélat de protection puisque les corrélats peuvent différer quantitativement et qualitativement selon le résultat préventif considéré.Note de bas de page 85
Extrapolation
La durée des essais cliniques n’est souvent pas assez longue pour déterminer la durée de la protection conférée par un vaccin et les chercheurs doivent extrapoler des estimations de la durée de la protection à partir des données des essais cliniques.Note de bas de page 86 Note de bas de page 87 Un certain nombre de techniques de modélisation différentes (p. ex. la décroissance logarithmique, la décroissance exponentielle) peuvent être utilisées pour générer des estimations de la durée de protection, qui peuvent varier considérablement en fonction de la technique choisie. Les estimations de la rentabilité peuvent donc être sensibles aux hypothèses sur la durée de la protection.Note de bas de page 86 Cela a été démontré par des analyses coûts-efficacité du vaccin contre le zona (Zostavax®) en Belgique, où les auteurs ont constaté que les estimations de la rentabilité variaient considérablement en fonction du modèle utilisé pour estimer l’efficacité potentielle du vaccin.Note de bas de page 31 Des conseils précis sur la manière d’aborder l’incertitude sur les estimations de la durée de la protection sont donnés dans le chapitre 13, Incertitude.
10. Mesure et évaluation de la santé
10.1 Dans les deux analyses de référence, il convient d’utiliser la survie ajustée pour la qualité de vie (QALY) comme méthode pour évaluer les résultats en matière de santé.
10.2 Prendre en considération les préférences en matière de santé qui correspondent à celles de la population canadienne en général. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
10.3 Dans les analyses de référence, les chercheurs doivent utiliser les préférences en matière de santé qui sont obtenues par une méthode de mesure indirecte reposant sur un système de classification générique (p. ex. le questionnaire EuroQol 5-Dimensions [EQ-5D], le Health Utilities Index [HUI], le Short-Form 6-Dimensions [SF-6D], les Child Health Utility 9-Dimensions [CHU9D], l’évaluation de la qualité de vie [AQoL]). Les chercheurs doivent présenter une justification s’ils n’utilisent pas de méthode indirecte. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
10.4 La sélection des sources de données à propos de la valeur d’utilité des états de santé est dictée par les motifs d’aptitude à l’emploi, de crédibilité et de cohérence. Décrire les compromis consentis entre ces critères et justifier les sources choisies. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
La QALY est la mesure métrique utilisée pour quantifier les résultats en matière de santé dans une ACU. Les estimations de la QALY sont générées en combinant les données sur la survie et la qualité de vie liée à la santé (QVLS). Pour pouvoir estimer la QALY, il faut disposer de données sur la QVLS sous la forme d’une mesure sommaire, souvent appelée utilité en santé. Comme l’ACU épouse implicitement un fondement extrapartisan de l’assistance sociale, les décideurs se préoccupent de la QVLS parce que le principal résultat des interventions en matière de santé est l’état de santé.
Données sur l’utilité en santé
Les coefficients d’utilité tirés des instruments de QVLS doivent représenter les préférences de la population canadienne en général, conformément au point de vue de la prise de décision sociale adopté par les présentes lignes directrices. Les préférences de la population pour les états de santé définis dans un instrument de QVLS sont normalement obtenues à partir d’un échantillon de la population générale selon des méthodes telles que le pari standard ou l’arbitrage temporel.
Bien qu’il soit possible d’obtenir les utilités en santé directement auprès des répondants, les instruments conçus pour saisir les utilités en santé indirectement constituent une méthode plus efficace et plus cohérente pour obtenir ces renseignements. Il existe des instruments de mesure de la QVLS propres à une maladie ou génériques permettant de mesurer indirectement l’utilité en santé. Les instruments génériques les plus couramment utilisés sont le questionnaire EuroQol 5-Dimensions (EQ-5D), le Health Utilities Index (HUI), le Short Form 6-Dimensions (SF-6D) et l’évaluation de la qualité de vie (AQoL). Les instruments de mesure de la QVLS des enfants comprennent le Child Health Utility 9-Dimensions (CHU9D), le questionnaire sur la qualité de vie KISCREEN, le Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) Generic Cores Scales et l’EQ-5D-Youth (EQ-5D-Y). Les chercheurs doivent utiliser les données sur la QVLS provenant d’un instrument générique pour estimer la QALY afin de garantir la comparabilité des programmes de vaccination envisagés par les responsables des politiques. Lorsque plusieurs estimations des utilités sont disponibles, les études sources doivent être soumises à une évaluation formelle de la qualité à l’aide d’un outil d’évaluation de la qualité approprié.Note de bas de page 88
Les données sur l’utilité en santé utilisées pour alimenter un modèle économique sont souvent tirées des ouvrages publiés. Pour garantir la cohérence dans un modèle, les évaluations de l’utilité de tous les états de santé compris dans le modèle doivent être issues du même instrument et utiliser des pondérations des préférences provenant de la même population, dans la mesure du possible.Note de bas de page 89 Lorsque ce n’est pas possible, les chercheurs doivent envisager des compromis entre l’aptitude à l’emploi, la crédibilité et la cohérence des données disponibles. Dans ces cas, les chercheurs peuvent également regrouper les données sur l’utilité en santé en utilisant des techniques telles que la méta-analyse ou la métarégression, bien que l’utilité de ces méthodes puisse être limitée par l’hétérogénéité considérable des méthodes d’évaluation et des populations étudiées.Note de bas de page 90 Les chercheurs devraient explorer l’incertitude des utilités en santé dans les analyses de sensibilité.
Il faut reconnaître qu’il n’existe pas d’instruments valides pour mesurer directement l’utilité chez les nouveau-nés, les nourrissons ou les jeunes enfants, bien qu’il s’agisse d’un domaine actif de la recherche actuelle.Note de bas de page 91 De plus, le concept de QVLS pour les enfants diffère selon le groupe d’âge et est conceptuellement différent de celui des adultes.Note de bas de page 92 Bien que plusieurs mesures de la qualité de vie liée à la santé basées sur les préférences et particulières à l’enfant aient été développées récemment (p. ex. EQ-5D-Y, CHU-9D, A-QOL), toutes ont des limites d’âge inférieures et reposent généralement sur des ensembles de tarifs dérivés de populations adultes. La validité convergente des mesures de QVLS particulières à la pédiatrie et basées sur les préférences des adultes doit être étudiée. Malgré ces limites, les chercheurs devraient idéalement utiliser des utilités pour les états de santé des enfants provenant d’un instrument générique particulier à la pédiatrie, plutôt que d’utiliser des utilités pour adultes. Si un instrument générique particulier à la pédiatrie n’est pas utilisé pour un état de santé de l’enfant, il convient de le justifier et de tester son incidence dans une analyse de sensibilité. L’utilisation d’instruments génériques est encouragée en pédiatrie, bien que les méthodes d’élicitation directe soient fréquemment utilisées. Les utilités générées par l’élicitation directe pour les états de santé sont sensibles au cadrage. Dans les cas où les utilités peuvent manquer en raison du jeune âge de l’enfant (p. ex., moins de cinq ans), les hypothèses utilisées doivent être explicites et justifiées. Les préférences doivent provenir d’une population générale, complétées par des évaluations d’enfants si elles sont disponibles. Les enquêtés-substituts (p. ex. les parents ou les fournisseurs de soins de santé) sont souvent nécessaires en pédiatrie parce que les méthodes d’évaluation peuvent être difficiles sur le plan cognitif ou nécessiter une compréhension de la lecture. Cependant, les réponses des enquêtés-substituts peuvent systématiquement différer de l’autoévaluation de l’enfant, la direction de la divergence étant difficile à prévoir.Note de bas de page 93 Les chercheurs doivent utiliser les utilités des enfants à partir d’instruments autodéclarés lorsque cela est possible, et préciser si des substituts sont utilisés. Par ailleurs, de nombreux vaccins sont administrés pendant la petite enfance ou l’enfance, dont certains préviennent des maladies de l’enfance et d’autres des maladies qui apparaissent à l’âge adulte. Les chercheurs doivent indiquer explicitement quels états de santé d’un modèle sont liés aux états de santé de l’enfant et quels sont ceux qui concernent les futurs états de santé de l’adulte. Dans les évaluations économiques où les adultes et les enfants sont modélisés, la cohérence dans l’utilisation de l’instrument à travers les âges est encouragée.
En plus d’inclure des données sur l’utilité en santé de la population visée par le programme de vaccination et de toutes les populations susceptibles de subir des externalités liées au programme, les chercheurs doivent inclure des données sur l’utilité pour la santé des aidants dans les cas où des retombées potentielles ont été cernées et pourraient influencer l’état de santé de cette population.
Le chapitre 10, Mesure et évaluation de la santé du document de l’ACMTS intitulé Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au Canada, 4e édition, propose une discussion plus détaillée sur la mesure et les données de la QVLSNote de bas de page 1.
Années de vie gagnées ajustées en fonction de la qualité dans les évaluations économiques réalisées dans la perspective sociétale
Il n’est pas certain que la QALY tient compte uniquement des avantages pour la santé ou qu’elle saisisse également, implicitement ou explicitement, les effets non liés à la santé. Cette incertitude est particulièrement importante pour les ACU réalisées dans une perspective sociétale, car ces analyses portent non seulement sur les coûts et les résultats pour le système de santé, mais aussi sur les coûts et les résultats qui concernent des secteurs autres que la santé. Plus précisément, des incertitudes entourent la manière d’inclure les effets de la productivité et de la consommation dans l’estimation du RCED.
Comme indiqué ci-dessus, la QALY est estimée à partir des données de survie et des données sur la QVLS. Les données sur la QVLS sont souvent obtenues à partir de domaines de santé compris dans les instruments courants de QVLS. Cependant, il n’est pas clair si, ou dans quelle mesure, les répondants considèrent implicitement des facteurs non liés à la santé lorsqu’ils évaluent ces états de santé. En particulier, on s’est intéressé à la mesure dans laquelle les répondants considèrent comment les changements de productivité et de consommation peuvent influencer leur QVLS, et à la mesure dans laquelle ces considérations sont implicitement incorporées dans l’évaluation par les répondants de leur état de santé. Selon les preuves disponibles, leur influence est limitée.Note de bas de page 94 Note de bas de page 95 Note de bas de page 96 Note de bas de page 97
Si les individus devaient tenir compte des effets économiques de la productivité lorsqu’ils évaluent leur état de santé, alors l’inclusion des estimations pécuniaires de la productivité dans le numérateur de l’estimation du RCED, avec les coûts des autres ressources, entraîne un double comptage de ces effets.Note de bas de page 96 Le consensus actuel est que les changements de productivité et de revenu ne sont pas susceptibles d’être pris en compte dans les estimations de la QALY.Note de bas de page 98 Note de bas de page 99 Cela justifie l’inclusion des coûts de productivité dans le numérateur de l’estimation du RCED.
De même, des questions ont été posées pour savoir si les personnes interrogées dans le cadre des évaluations de l’état de santé prennent en compte et valorisent la consommation non médicale, comme les vêtements et le logement. L’un des arguments avancés est que si la valeur d’utilité de cette consommation n’est pas (implicitement) saisie dans la QALY, il serait incohérent d’inclure les changements de cette consommation dans les coûts de l’évaluation et, par conséquent, ces coûts devraient être exclus.Note de bas de page 97 Un autre argument veut qu’une consommation non médicale (p. ex. l’apport alimentaire quotidien) soit nécessaire pour rester en vie. Même si les répondants n’en tiennent pas compte dans leur évaluation des états de santé, il faut néanmoins l’inclure comme un coût. Cela serait encore plus évident si les répondants supposaient des niveaux de consommation habituels dans leurs réponses aux questions d’évaluation de l’état de santé. Le même argument s’applique aux autres consommations non médicales qui, dans une certaine mesure, peuvent également contribuer à la QVLS d’un individu.Note de bas de page 95
Contrairement aux résultats liés à la prise en compte par les répondants des changements de productivité dans leur évaluation des états de santé, les preuves donnent à penser que les répondants intègrent l’utilité de la consommation lorsqu’ils évaluent les états de santé.Note de bas de page 100 On peut en déduire que les améliorations de la santé peuvent entraîner une augmentation de l’utilité marginale de la consommation non liée à la santé. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour corroborer ces résultats, ils justifient l’inclusion des coûts de consommation dans le numérateur de l’estimation du RCED.
En résumé, pour l’analyse de référence dans une perspective sociétale, les changements liés à la productivité et les coûts de la consommation non liée à la santé doivent être compris dans le numérateur de l’estimation du RCED. Davantage de précisions sur la quantification des coûts de la productivité et de la consommation figurent dans le chapitre 11, Utilisation et coûts des ressources.
11. Utilisation et coût des ressources
11.1 Pour chaque analyse de référence, les chercheurs doivent relever, mesurer et valoriser de manière systématique toutes les ressources pertinentes, consommées ou économisées à la suite de l’administration ou de l’exécution du programme de vaccination, et en faire état.
11.2 Dans la mesure du possible, les chercheurs doivent évaluer la consommation des ressources pertinentes relevées pour tous les secteurs, sur le plan pécuniaire. Lorsque ce n’est pas possible, les chercheurs doivent présenter aux décideurs les ressources pertinentes qui ont été relevées dans l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination.
11.3 S’appuyer sur des sources d’information canadiennes pour déterminer l’utilisation et le prix unitaire/coût des ressources, de préférence des sources d’information applicables dans les provinces ou territoires d’intérêt (comme il est précisé dans le problème de décision). » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
11.4 Dans la valorisation et la monétisation des ressources, les chercheurs doivent choisir les sources de données les plus exactes quant au coût de renonciation selon la perspective de l’analyse. [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
11.5 Les chercheurs doivent évaluer les sources utilisées pour les données sur l’utilisation et le prix unitaire/coût des ressources en fonction de leur aptitude à l’emploi, de leur crédibilité et de leur cohérence. La sélection des sources de données doit reposer sur des compromis entre ces critères.
Les programmes de vaccination peuvent entraîner à la fois une augmentation et une diminution de la consommation de ressources et de services. Ils sont liés à la fois à la mise en œuvre du programme de vaccination et à son exécution continue, ainsi qu’aux effets en aval du programme. La consommation des ressources peut toucher les personnes vaccinées, la population vulnérable pour la maladie en question lorsque le programme de vaccination est associé à des externalités, et la population qui subit les retombées (comme les aidants). Par ailleurs, les ressources consommées à la suite des programmes de vaccination peuvent relever du secteur du système de santé ou de l’extérieur de celui-ci. Les chercheurs doivent utiliser le tableau d’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination pour déterminer systématiquement toutes les ressources et tous les services potentiels associés au programme de vaccination envisagé. Une fois que l’éventail des ressources et des services résultant d’un programme de vaccination a été précisé, les chercheurs doivent déterminer lesquelles des ressources consommées peuvent être mesurées et évaluées sur le plan pécuniaire.Note de bas de page 101 Note de bas de page 102
Secteur du système de santé
Pour l’analyse de référence dans la perspective du système de santé, les chercheurs doivent déterminer et inclure toutes les ressources au sein du système de santé financé à même les fonds publics qui sont consommées par l’exécution du programme de vaccination, ainsi que les ressources qui sont consommées ou économisées grâce à sa mise en œuvre. Tous les coûts du système de santé encourus sur l’horizon temporel du modèle doivent être compris.
Coûts des soins de santé
Lorsqu’ils attribuent des coûts unitaires locaux aux ressources qui ont été déterminées comme pertinentes pour le problème décisionnel modélisé, les chercheurs doivent consulter la deuxième édition du Guide pour l’évaluation des coûts des ressources en soins de santé dans le contexte canadien,Note de bas de page 103 qui fournit des recommandations clés et des sources de données pour déterminer, évaluer et mesurer les coûts au sein du système de santé canadien. Pour les analyses menées au sein d’une province ou un territoire ou entre plusieurs provinces ou territoires, les variations dans le financement public de ressources et de services particuliers doivent être indiquées. Les chercheurs doivent indiquer si un seul ensemble de prix est utilisé ou si des ensembles de prix entre plusieurs provinces ou territoires sont appliqués et les méthodes utilisées pour attribuer des ensembles de prix aux données de plusieurs provinces ou territoires.
Soins formels
Les personnes qui ont besoin d’un soignant peuvent recevoir ces soins soit d’un soignant professionnel tel qu’une infirmière ou une infirmière auxiliaire qui est embauchée pour effectuer ces services, soit d’un soignant informel, généralement un membre de la famille. Le temps des aidants professionnels doit être évalué au taux de salaire horaire qui serait versé à une personne qui effectue ce service. Les coûts des soins formels peuvent être ou non pris en charge par le système de santé financé à même les fonds publics, selon la nature précise de ces coûts et la province ou le territoire concerné. La question des soins informels est abordée plus loin dans le chapitre Productivité.
Coûts futurs des soins de santé
Pour les programmes de vaccination qui confèrent un avantage sur le plan de la survie par rapport aux comparateurs pris en compte dans l’évaluation économique, les chercheurs doivent inclure dans les analyses du scénario de référence les coûts futurs des soins de santé, qu’ils soient liés ou non à l’infection et à la maladie en question. Cette recommandation est étayée par les considérations suivantes : 1) il y a un coût de renonciation associé aux interventions visant à prolonger la vie puisqu’elles augmentent les dépenses de santé futures de ces personnes, des dépenses qui auraient pu être utilisées pour répondre aux besoins de santé d’autres personnes; 2) il est souvent difficile de distinguer les coûts liés des coûts non liés, comme dans le cas de différentes maladies dont les voies physiologiques se chevauchent (p. ex. le diabète et les coronaropathies), ce qui peut conduire à des décisions arbitraires quant aux coûts qui sont liés et non liés; et 3) la cohérence interne : les avantages liés aux dépenses médicales futures sont déjà compris dans les ACU par l’intermédiaire d’estimations de la survie et de la qualité de vie, et sont basés sur l’hypothèse que l’individu reçoive des soins médicaux futurs, qu’ils soient liés ou non à la maladie en question.Note de bas de page 95 Note de bas de page 101 Note de bas de page 104 Note de bas de page 105
L’exclusion des coûts futurs conduit à des estimations de coûts incrémentaux et des estimations du RCED plus faibles pour les interventions qui prolongent la vie, et peut les faire paraître plus attrayantes économiquement que celles qui améliorent la qualité de vie. Cependant, l’inclusion des coûts futurs augmente les estimations de coûts incrémentiels et les RCED pour les interventions visant à prolonger la vie, ce qui conduit dans certains cas à ce qu’une option de non-intervention (c.-à-d. où les patients ne survivent pas) soit plus rentable que de fournir un traitement pour une maladie.Note de bas de page 106 Dans certains cas, même des interventions de maintien en vie relativement peu coûteuses chez des patients dont les coûts de soins continus sont élevés peuvent ne pas être rentables lorsque les coûts futurs sont pris en compte dans une évaluation économique.Note de bas de page 107 Les chercheurs doivent présenter les résultats et les coûts de manière désagrégée afin que les décideurs sachent comment les différents éléments compris dans l’analyse contribuent au rapport coût-efficacité global du programme de vaccination. Les chercheurs doivent présenter : 1) les résultats sanitaires attendus du programme de vaccination et des comparateurs; 2) les coûts directs du système de santé résultant du programme de vaccination et des comparateurs, mais à l’exclusion des coûts des soins futurs; et 3) l’augmentation attendue des coûts des soins continus résultant de l’amélioration de la survie pour le programme de vaccination et les comparateurs.Note de bas de page 107
Les estimations des coûts futurs des soins de santé peuvent être obtenues à partir des données publiées par les Tendances des dépenses nationales de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé.Note de bas de page 108 Dans les situations où des estimations de coûts sont nécessaires pour des populations dont les coûts de soins continus sont élevés (p. ex. les patients sous dialyse, les receveurs de transplantation d’organe plein),Note de bas de page 109 Note de bas de page 110 les chercheurs devront peut-être consulter les ouvrages médicaux publiés pour obtenir ces estimations.
Coûts de santé publique
Les coûts de santé publique peuvent représenter une part importante des coûts des programmes de vaccination et de gestion des maladies infectieuses. Il est nécessaire de les quantifier précisément pour garantir que les résultats des évaluations économiques des programmes de vaccination sont valides et conduisent à des décisions de financement optimales. Les coûts de santé publique peuvent être classés en deux catégories : les coûts liés aux programmes et les coûts liés aux interventions. Les coûts liés au programme sont les coûts de mise en œuvre, d’exécution et de maintien du programme. Ils comprennent les coûts des campagnes de santé publique et des activités de promotion de la santé, les coûts de transaction liés à l’introduction de nouveaux vaccins ou au passage d’un vaccin à un autre, et les coûts liés au dépistage dans la population, à la surveillance épidémiologique, à la recherche des contacts, aux enquêtes sur les cas et aux enquêtes sur les épidémies. Les éléments précis à prendre en compte dans la quantification de ces coûts sont les coûts de personnel, les frais généraux, les frais de déplacement et les autres coûts administratifs et coûts liés au service.Note de bas de page 103 Note de bas de page 111 Les éléments précis à prendre en compte dans la quantification des coûts des éclosions de maladie comprennent les tests sérologiques en laboratoire; le temps du personnel consacré à la recherche des contacts, au dépistage des symptômes, aux déplacements, à la surveillance et au suivi; les vaccins ou les doses d’immunoglobulines pour la prophylaxie post-exposition et les coûts administratifs correspondants.Note de bas de page 112 Note de bas de page 113 Note de bas de page 114 Note de bas de page 115 Les coûts liés aux interventions sont les coûts des doses de vaccin, de la distribution (p. ex. le transport et le stockage au froid) et de l’administration du vaccin, y compris les pertes et les fournitures auxiliaires nécessaires. Les chercheurs doivent présenter les coûts liés aux différents aspects de la mise en œuvre et de l’exécution continue du programme de vaccination de manière désagrégée. Par ailleurs, les chercheurs devraient préciser les différents niveaux d’intensité de la stratégie de mise en œuvre, ce qui est particulièrement pertinent pour les campagnes de santé publique et les activités de promotion de la santé par exemple, car elles peuvent produire différents niveaux de bénéfices.
Étant donné la rareté des données publiées sur l’utilisation et les coûts de santé publique liés aux programmes dans le contexte canadien, les chercheurs devront peut-être faire appel aux données obtenues auprès des autorités en matière de santé publique locales ou des ministères provinciaux de la Santé par le biais de communications personnelles. Bien que les coûts des autorités en matière de santé publique ou des ministères provinciaux soient propres à chaque province ou territoire, ils peuvent être généralisables à d’autres régions. Pour déterminer l’applicabilité des données d’un territoire de compétence à un autre, les chercheurs doivent tenir compte de facteurs tels que les similitudes géographiques, les caractéristiques de la population et les caractéristiques épidémiologiques.
On dispose de peu de données canadiennes sur l’utilisation et le coût des ressources de santé publique dans le cadre d’interventions. Certains organismes provinciaux de santé publique, comme l’Institut national de santé publique du Québec,Note de bas de page 116 publient en ligne les résultats de leurs travaux, qui peuvent inclure des données de surveillance épidémiologique et de coûts pertinentes pour l’évaluation économique d’un programme de vaccination. Si les données requises ne sont pas disponibles dans les publications des organismes provinciaux de santé publique, les chercheurs devront peut-être les demander aux ministères provinciaux de la Santé ou aux autorités locales en matière de santé publique. Le prix réel des doses de vaccin payé par les gouvernements est confidentiel. Les chercheurs doivent utiliser le prix courant du fabricant dans les analyses de référence et effectuer des analyses de sensibilité déterministes en utilisant des prix réduits plausibles. Ils doivent également tenir compte des éléments de coût liés à l’administration des doses de vaccin, qui peuvent varier considérablement en fonction du lieu d’administration. Par exemple, en Alberta, l’administration communautaire du vaccin contre le VPH est considérablement plus coûteuse que l’administration en milieu scolaire.Note de bas de page 117 Les ressources et les services liés à la fourniture d’un accès culturellement sûr aux soins de santé et au matériel de communication du programme de vaccination doivent également être pris en compte lorsqu’ils sont applicables.
Coûts des soins de santé non financés par le système de santé
Certains services associés aux programmes de vaccination peuvent ne pas être remboursés ou financés par le système de santé public. Les services qui sont exclus du système de santé public peuvent varier selon les administrations ou les régions. Il s’agit notamment des services de soins de longue durée, des soins infirmiers privés, des traitements médicamenteux pour les personnes qui ne sont pas couvertes par un programme d’assurance-médicaments financé par l’État, des médicaments sans ordonnance, ainsi que des coûts auxiliaires liés à des éléments tels que les quotes-parts des assurances privées, les soins dentaires et ophtalmologiques, les appareils fonctionnels, la physiothérapie et autres. Ces coûts peuvent être assumés par des régimes d’assurance privés, par les particuliers ou par les deux à la fois. Quel que soit le mode de prise en charge de ces coûts, ils doivent être quantifiés et inclus dans les coûts différentiels et dans le rapport coût-efficacité différentiel (le cas échéant) pour l’analyse de référence dans une perspective sociétale.
Secteurs autres que celui des soins de santé
Les chercheurs doivent également déterminer toutes les ressources consommées du fait de la mise en œuvre ou de l’exécution continue du programme de vaccination qui ne relèvent pas du système de santé public et quantifier les coûts correspondants. Par exemple, les secteurs autres que celui de la santé pertinents aux fins de l’analyse du cas de référence dans une perspective sociétale pourraient inclure : les coûts directs à la charge des patients (p. ex. les quotes-parts, les frais de transport, les frais associés aux soignants privés), les pertes de temps de travail rémunéré et non rémunéré, la consommation non médicale et les services non financés par d’autres secteurs, notamment l’éducation, les services sociaux et l’environnement. Des conseils sur la détermination des ressources et la quantification des coûts pour les secteurs autres que celui des soins de santé sont présentés ci-après.
Frais directs assumés de leur poche
Les évaluations économiques des programmes de vaccination doivent inclure des estimations des frais directs à la charge des patients (p. ex., les frais de transport et d’hébergement). Les coûts de transport comprennent les coûts liés aux transports en commun, y compris l’accès exempt d’obstacles à des transports entièrement accessibles si nécessaire, les taxis, l’utilisation de véhicules personnels et les frais de stationnement.Note de bas de page 118
Productivité
Les chercheurs doivent examiner les effets des programmes de vaccination sur la productivité des personnes et des soignants et, le cas échéant, sur les conséquences macroéconomiques. Dans le premier cas, la vaccination peut améliorer la productivité par deux moyens distincts : 1) une augmentation de la productivité du travail rémunéré et non rémunéré liée soit à la prévention de la maladie, soit à la diminution de la gravité de la maladie chez les personnes vaccinées; et 2) une augmentation de la productivité des soignants liée à la diminution des besoins requis par les personnes malades.Note de bas de page 7 Note de bas de page 25 Note de bas de page 119 Lorsque les gains de productivité des interventions visant à prolonger la vie sont inclus dans une analyse du point sociétal, ils peuvent atténuer ou compenser l’augmentation des coûts différentiels due à l’augmentation de l’éventuelle consommation de soins de santé chez les survivants.
Productivité individuelle
Les coûts de productivité sont les pertes de production associées au temps productif consacré au travail rémunéré, ou au travail non rémunéré (p. ex. le bénévolat, l’aide, le tutorat), y compris la production domestique (p. ex. la cuisine, le nettoyage, les courses, l’éducation des enfants).Note de bas de page 101
Les deux principales méthodes d’évaluation du temps de travail rémunéré perdu sont celles du capital humain et du coût de friction. La méthode du capital humain est fondée sur le coût du temps productif perdu, tandis que l’approche du coût de friction tente d’estimer les pertes de production globales pour la société, en supposant le remplacement des travailleurs malades sur le marché du travail. Note de bas de page 101 Note de bas de page 120 Note de bas de page 121 Note de bas de page 122
La méthode du capital humain est couramment utilisée pour évaluer la production perdue. Elle nécessite habituellement d’estimer le temps de travail rémunéré perdu et les taux de rémunération moyens des personnes concernées. On peut donc la considérer comme une estimation de la perte de production (ou de revenu) d’un point de vue individuel, due à une maladie, à une invalidité ou au décès. Comme la méthode du capital humain ne tient pas compte des mécanismes de remplacement sociétaux, en particulier pour les périodes d’absence plus longues (p. ex. en cas d’invalidité ou de décès prématuré), elle surestime probablement le coût réel de la perte de production d’un point de vue sociétal.Note de bas de page 123 Il s’agit d’une considération particulièrement importante dans les situations où un programme de vaccination pourrait permettre d’éviter le décès d’un enfant ou un handicap à vie.
L’approche du coût de friction, quant à elle, tente de quantifier la perte de productivité au niveau sociétal en partant du principe que l’absence d’un employé se limite à la période nécessaire à l’organisation pour le remplacer et retrouver le niveau de productivité initiale (p. ex. en cas de chômage) ou par du capital.Note de bas de page 120 Cela implique qu’après une certaine « période de friction », les pertes de production cessent de se produire d’un point de vue sociétal. On a estimé que les conséquences macroéconomiques des changements dans l’offre de main-d’œuvre et les prestations d’assurance-emploi sont faibles pour les programmes de soins de santé typiques. L’application de cette méthode nécessite des renseignements plus détaillés sur les périodes d’absence, le bassin de main-d’œuvre et la période de friction pertinente dans un pays ou une province.Note de bas de page 122
Bien que ces deux méthodes se concentrent principalement sur la valorisation de la production perdue dans le contexte du travail rémunéré, les changements de productivité liés au travail non rémunéré doivent également être pris en compte. La perte de productivité dans le contexte du travail non rémunéré peut être mesurée en évaluant les heures perdues avec une valeur appropriée. Les estimations du (changement de) temps productif dans le travail non rémunéré pour la population concernée peuvent être difficiles à obtenir dans certains cas.Note de bas de page 124 Outre l’utilisation d’estimations générales provenant de sources existantes, on peut avoir recours à des questionnaires pour estimer ces changementsNote de bas de page 125.
Les chercheurs doivent mesurer la variation totale du temps productif découlant du programme de vaccination, qu’il s’agisse de travail rémunéré ou non rémunéré. Les chercheurs doivent tenir compte des pertes de temps productif d’un individu liées à l’obtention d’un vaccin, à la recherche d’un traitement, à la maladie, à l’invalidité et au décès des personnes vaccinées ou autrement touchées. Les changements dans la productivité associés aux programmes de vaccination devraient être quantifiés en utilisant la méthode du capital humain. C’est l’approche la plus couramment recommandée dans les directives pharmacoéconomiques de plusieurs pays du monde,Note de bas de page 126 et elle permet d’accroître la comparabilité entre les évaluations économiques des programmes de vaccination entreprises dans différentes régions.
Pour l’analyse de référence dans une perspective sociétale, les chercheurs doivent inclure la période complète au cours de laquelle les personnes touchées subiront des pertes de production rémunérées. Ces pertes doivent être évaluées en fonction du revenu moyen et du nombre d’heures travaillées selon l’âge, d’après les données de Statistique Canada,Note de bas de page 127 Note de bas de page 128 combinés à la probabilité, selon la maladie, qu’une personne participe à la population active. L’utilisation du même taux de salaire pour les deux sexes est une correction du biais de mesure, car les femmes sont en moyenne moins bien payées que les hommes pour le même travail.Note de bas de page 129
Dans la plupart des cas, des considérations d’équité se poseront pour savoir si et comment le temps productif est valorisé. S’il est valorisé de manière différentielle en fonction d’attributs tels que l’âge, le sexe ou l’état de santé, les résultats d’une évaluation économique pourraient favoriser les groupes ayant le plus grand potentiel de revenus et désavantager d’autres groupes tels que les enfants qui ne travaillent pas ou les personnes souffrant de handicaps ou de graves problèmes de santé qui les empêchent d’occuper des emplois à haut revenu.Note de bas de page 101 Dans ces situations, les chercheurs devraient effectuer une analyse de sensibilité supplémentaire en utilisant le revenu moyen et le nombre moyen d’heures travaillées à temps plein pour tous les Canadiens, selon les données de Statistique Canada.Note de bas de page 127 Note de bas de page 128 Bien que la mesure de ces pertes soit imparfaite et biaisée en faveur des hauts salaires, cette approche révèle les pertes d’efficience que les responsables des politiques doivent être prêts à accepter chaque fois qu’ils choisissent une option de production neutre par rapport aux caractéristiques individuelles.
Pour tenir compte de la surestimation probable des pertes de production associées à l’approche du capital humain, les chercheurs devraient inclure une analyse de sensibilité supplémentaire qui prend en compte les pertes de production pour une seule année en se servant du nombre moyen d’heures travaillées à temps plein pour tous les Canadiens, selon les données de Statistique Canada.Note de bas de page 127 Note de bas de page 128 Le revenu annuel moyen et le nombre annuel moyen d’heures travaillées pour tous les Canadiens devraient être utilisés aux fins de cette analyse. Cette approche représente une approximation naïve des coûts de friction.
Bien que les pertes de productivité puissent découler à la fois de l’absentéisme (temps d’arrêt de travail) et du présentéisme (continuer à travailler, mais en accusant une productivité réduite), les chercheurs ne sont pas tenus de tenir compte des effets du présentéisme dans leurs estimations de la perte de productivité dans l’analyse de référence. Il est souvent difficile de collecter ces informations étant donné qu’elles nécessitent des données d’enquête auprès des personnes concernées et que le souvenir peut être subjectif dans de nombreux cas.Note de bas de page 125 Note de bas de page 130
Pour évaluer la perte de production non rémunérée, il faut estimer les heures perdues de travail non rémunéré et les évaluer selon la méthode du coût de remplacement. Bien que le travail non rémunéré puisse différer en termes de tâches effectuées et de compétences requises, pour l’analyse de référence, il faut appliquer le taux de salaire d’un professionnel pour évaluer les heures perdues. Les chercheurs doivent exclure les coûts du temps de loisirs de l’évaluation économique des programmes de vaccination.
Productivité des aidants naturels
Comme décrit ci-dessus, les personnes ayant besoin d’un aidant peuvent recevoir des soins d’un aidant professionnel ou d’un aidant non professionnel, la plupart du temps un membre de la famille. Deux approches ont été proposées pour évaluer le temps des aidants naturels : 1) l’approche du coût de remplacement et 2) l’approche du coût de renonciation. L’approche du coût de remplacement repose sur le coût estimé de l’embauche d’un aidant rémunéré si les soins ne peuvent pas être prodigués par un aidant naturel. L’approche du coût de renonciation est basée sur le coût du temps productif déplacé qui résulte du temps passé à fournir des soins informels.Note de bas de page 131 Étant donné que les personnes peuvent recevoir à la fois des soins formels et informels, les chercheurs doivent utiliser l’approche du coût de remplacement pour évaluer le temps des aidants pour l’analyse de référence de la perspective sociétale. Ces estimations peuvent être utilisées parallèlement aux estimations des retombées potentielles sur la santé des aux soins informels, exprimées en années de vie ajustées par la qualité (AVAQ) des aidants.Note de bas de page 132
Conséquences macroéconomiques
Bien qu’il soit peu probable que la plupart des programmes de vaccination aient des répercussions macroéconomiques importantes, ceux qui sont conçus pour prévenir les pandémies généralisées telles que la pandémie de COVID-19 de 2020 causée par le virus SRAS-CoV-2 pourraient atténuer les conséquences graves. L’incidence macroéconomique comprend les chocs de l’offre de main-d’œuvre et les fermetures généralisées d’entreprises, qui peuvent affecter les bassins de main-d’œuvre et les taux de participation à la population active, ainsi que les changements dans les préférences de consommation des ménages.Note de bas de page 133
Consommation non médicale
La consommation non médicale représente les dépenses consacrées aux éléments non liés à la santé qui contribuent au bien-être global. Cela comprend les dépenses financières personnelles et la consommation de biens et services publics, comme l’accès à de l’eau potable et à des routes sécuritaires.Note de bas de page 95 Note de bas de page 101 Les chercheurs doivent inclure les coûts de consommation chaque fois qu’ils sont modifiés par le programme de vaccination.
Ils doivent utiliser les données de Statistique Canada sur les dépenses des ménages comme source d’information pour la consommation non médicale (Tableau : 11-10-0222-01, auparavant CANSIM 203-0021, « Dépenses des ménages, Canada, régions et provinces »).Note de bas de page 134 Afin d’obtenir une estimation de la consommation non médicale, les chercheurs doivent exclure la consommation de santé de la consommation totale. Pour produire les estimations de la consommation individuelle, il faut ajuster les estimations de la consommation des ménages à l’aide d’une échelle d’équivalence, afin que la consommation reflète la taille du ménage, pour ainsi refléter le fait que les ménages d’une personne ont une consommation par personne plus élevée que les ménages de plusieurs personnes.Note de bas de page 135 Pour les programmes de vaccination qui entraînent des changements dans la consommation, les chercheurs doivent soustraire les estimations individuelles de la consommation des estimations individuelles de la productivité pendant la période concernée. Pour assurer la cohérence entre les estimations de la productivité et de la consommation, il ne faut pas, dans l’analyse de référence, stratifier les estimations de la consommation en fonction du sexe.
Études
Les programmes de vaccination peuvent influer sur les résultats scolaires en prévenant les maladies qui entraînent des morbidités graves qui, à leur tour, pourraient se répercuter sur le niveau de réussite scolaire d’un individu. Par exemple, une étude danoise a révélé que les enfants ayant souffert d’une méningite bactérienne présentaient des niveaux inférieurs de réussite scolaire et d’autosuffisance économique à l’âge adulte.Note de bas de page 136
Des niveaux d’éducation plus élevés sont associés à une plus grande probabilité de participation au marché du travail et à des revenus plus élevés sur le marché du travail.Note de bas de page 137 Note de bas de page 138 Au Canada, on estime que chaque année supplémentaire de scolarité augmente les revenus à vie d’environ 11 à 12 %. En supposant que la diminution du niveau d’éducation d’un individu entraîne une diminution similaire des gains au cours de la vie, on estime que chaque mois de perte d’éducation se traduira par une baisse d’environ 1 % du revenu à vie.Note de bas de page 139 Les changements de revenus liés à la réussite scolaire doivent être pris en compte dans les estimations de la productivité perdue (ou gagnée) et les chercheurs doivent s’assurer que ces coûts ne sont pas comptés deux fois lorsqu’ils examinent les effets des programmes de vaccination sur l’éducation.
Outre les effets sur les résultats scolaires et la productivité du marché du travail, les programmes de vaccination peuvent avoir des effets directs sur le secteur de l’éducation. Par exemple, les enfants qui ont souffert d’une méningite bactérienne peuvent présenter des troubles cognitifs, une perte auditive, des crises d’épilepsie et des difficultés d’apprentissage,Note de bas de page 140 qui peuvent nécessiter des ressources en éducation spécialisée à l’école. Les conseils scolaires et les écoles peuvent également investir dans des programmes de vaccination, ainsi que dans des programmes auxiliaires visant à améliorer l’environnement d’apprentissage en temps de pandémie (p. ex. amélioration du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, réduction de la taille des classes, apprentissage virtuel).
Les chercheurs doivent tenir compte des résultats potentiels liés à l’éducation et des effets directs sur le secteur de l’éducation qui pourraient résulter du programme de vaccination et des comparateurs envisagés. Dans la mesure du possible, ils doivent les monétiser pour les inclure dans l’estimation du rapport coût-efficacité différentiel (RCED). En ce qui concerne les résultats qui peuvent être difficiles à monétiser (comme les perturbations des résultats d’apprentissage découlant de l’administration du vaccin en milieu scolaire, les maladies et les handicaps pédiatriques ou le décès/le handicap d’un membre de la famille proche), les chercheurs doivent néanmoins les déterminer et les inclure dans l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination, afin que les décideurs puissent en tenir compte.
Services sociaux
Les programmes de vaccination peuvent avoir une incidence sur les services sociaux, les services communautaires et les services aux enfants et aux jeunes en prévenant les maladies qui entraînent de graves morbidités. Les services sociaux incluent notamment le soutien aux personnes handicapées, les programmes de sensibilisation, le répit pour les familles et les programmes visant à améliorer l’accès aux programmes de vaccination. Les chercheurs devraient déterminer (et si possible monétiser) les conséquences des services sociaux.
Environnement
Les programmes de vaccination et les comparateurs pris en compte dans l’analyse peuvent avoir des impacts environnementaux liés à la fabrication ou à la distribution des doses de vaccin, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme. Par exemple, il a été démontré que les vaccins réduisent l’utilisation des antibiotiques,Note de bas de page 141 Note de bas de page 142 ce qui peut faire baisser la quantité de résidus d’antibiotiques provenant de sources telles que les ménages, l’industrie pharmaceutique et les hôpitaux dans les eaux usées, connues comme un réservoir d’organismes résistants aux antibiotiques.Note de bas de page 143
Les conséquences environnementales peuvent être déterminées et incluses dans l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination afin que les décideurs puissent en tenir compte. Dans la mesure du possible, elles doivent être monétisées, bien que cela soit parfois difficile à faire.
Autres domaines
Les chercheurs doivent tenir compte des autres secteurs susceptibles d’offrir des services ou des programmes pertinents pour des programmes de vaccination en particulier. Il peut s’agir, par exemple, de la justice ou du système pénal (p. ex. les coûts pour l’État de la gestion des poursuites potentielles contre les fabricants de vaccins en raison des effets indésirables des vaccins ou les coûts pour le système de santé des poursuites engagées par les patients si un vaccin n’est pas introduit), ou du logement (p. ex. les changements de type de logement ou les adaptations du logement nécessaires en raison des handicaps fonctionnels résultant de l’infection, ou pour améliorer la ventilation/réduire l’encombrement afin de réduire la transmission de l’infection).
12. Analyse
12.1 Les rapports coûts-efficacité différentiels (RCED) et, lorsque cela est utile pour l’interprétation, les avantages monétaires nets ou les avantages nets pour la santé, doivent être calculés pour les deux analyses de référence.
12.2 Si l’analyse englobe plus de deux interventions, effectuer une analyse séquentielle du rapport coût-efficacité dans les règles standards de l’estimation du RCED, y compris l’exclusion des interventions dominées. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
12.3 Autant que possible, il faut générer les valeurs attendues des coûts et des résultats de manière probabiliste afin de refléter l’incertitude globale des paramètres du modèle.
Les chercheurs doivent générer deux séries d’estimations des valeurs attendues pour les coûts liés à chaque intervention considérée dans l’évaluation économique : l’une pour l’analyse de référence de la perspective du système de santé financé par les fonds publics, et l’autre pour l’analyse de référence de la perspective sociétale. Une estimation des valeurs prévues des résultats (c’est-à-dire les AVAQ) doit être générée pour servir aux deux analyses de référence. Ces estimations, si possible, doivent être produites de manière probabiliste afin que les valeurs attendues reflètent l’incertitude globale des paramètres du modèle. Dans la plupart des cas, l’analyse probabiliste prendra la forme d’une simulation de Monte-Carlo, qui consiste à appliquer à chaque paramètre une estimation ponctuelle, une étendue et une distribution de probabilité appropriées. Chaque simulation doit produire des estimations des coûts moyens et de l’efficacité moyenne pour chaque comparateur, ainsi que des estimations des coûts différentiels et de l’efficacité différentielle. Toutes les valeurs, y compris les estimations différentielles, doivent être rapportées avec des intervalles de confiance ou crédibles à 95 % comme indicateurs de précision. Ces intervalles peuvent être obtenus à partir des limites de 2,5 % et 97,5 % des simulations générées. Il peut également être approprié d’utiliser des indicateurs de précision supplémentaires si la distribution des résultats incertains n’est pas approximativement gaussienne. Dans les cas où les analyses probabilistes ne sont pas possibles, les estimations de ces valeurs doivent être générées de manière déterministe. Ce scénario est le plus susceptible de se produire lorsque la puissance de calcul requise pour une analyse probabiliste est un facteur limitant, surtout pour les modèles axés sur les agents.
Les coûts et les résultats suivants doivent être intégrés dans l’analyse de référence du système de santé public : tous les coûts directement encourus par le système de santé public au Canada et les AVAQ pour les personnes vaccinées, les personnes qui subissent des externalités liées au programme de vaccination, ainsi que les AVAQ pour les aidants non professionnels. En ce qui concerne l’analyse de référence dans une perspective sociétale, elle doit inclure les coûts et les résultats du point de vue du système de santé public, ainsi que les éléments suivants, au minimum : les coûts pour les patients, les coûts des aidants et les coûts de productivité. Lorsque cela est pertinent, les conséquences qui ne sont pas liées à la santé, comme la consommation, les services sociaux, l’éducation et l’environnement, doivent également être prises en compte.
Selon le positionnement des scénarios dans le plan coût-efficacité, il peut ne pas être judicieux de calculer les RCED, par exemple en cas de domination de la stratégie de vaccination ou du comparateur en matière de soins. Dans tous les cas, cependant, les valeurs moyennes des coûts, de l’efficacité, des coûts différentiels et de l’efficacité différentielle doivent être rapportées avec des intervalles de confiance ou crédibles à 95 %. Lorsque les valeurs différentielles moyennes des coûts et de l’efficacité sont toutes deux positives, des RCED doivent être présentés (c’est-à-dire le rapport entre la différence des coûts prévus et la différence des résultats attendus pour les deux interventions comparées). Plus précisément, lorsque deux interventions sont comparées, il doit y avoir un RCED pour chaque perspective de l’analyse de référence. Lorsque plus de deux interventions sont prises en compte dans l’analyse, des RCED séquentiels doivent être présentés. Cette approche consiste à comparer chaque intervention suivante la plus coûteuse, et à exclure toutes les interventions qui sont soit dominées, soit sujettes à une dominance étendue. Graphiquement, les résultats doivent être présentés sous forme de fonctions de production de la santé ou de frontières d’efficacité coût-efficacité.
Dans les cas où des analyses de sous-groupes ont été réalisées, les valeurs prévues des coûts et des résultats ainsi que les rapports coût-efficacité différentiels doivent être générés pour chaque sous-groupe pertinent conformément aux recommandations formulées dans ce chapitre. Dans les cas où plusieurs perspectives de systèmes de santé publics régionaux ou provinciaux/territoriaux ont été analysées, les résultats doivent être rapportés pour chacune d’entre elles.
13. Incertitude
13.1 Les chercheurs doivent aborder l’incertitude des paramètres en recourant à une analyse probabiliste de référence, si possible, ainsi qu’à des analyses de sensibilité déterministes.
13.2 Étudier l’incertitude méthodologique en comparant les résultats de l’analyse de référence à ceux d’une analyse complémentaire fondée sur d’autres choix méthodologiques que ceux recommandés pour examiner l’incidence des différences d’ordre méthodologique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
13.3 Il convient d’utiliser les courbes d’acceptabilité du rapport coût-efficacité (CARCE) et les frontières d’efficience (FE) pour représenter l’incertitude des estimations des coûts et des résultats lorsque celles-ci ont été générées de manière probabiliste. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
13.4 Lorsque le problème de décision comprend l’option de commander ou d’effectuer un projet de recherche, l’analyse de la valeur de l’information peut être utile dans l’attribution d’une valeur à ces options et dans la conception du projet de recherche; cette analyse doit alors être comprise dans l’analyse de référence. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
13.5 Évaluer l’incertitude structurelle par des analyses de scénarios. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS, modifié].
Les décideurs ont besoin d’informations sur l’incertitude liée aux résultats des évaluations économiques des programmes de vaccination afin d’éviter de prendre des décisions de financement moins qu’optimales. Plus précisément, ils doivent examiner et présenter trois types d’incertitude : l’incertitude liée aux paramètres, l’incertitude liée à la structure et l’incertitude liée à la méthodologie.
Incertitude liée aux paramètres
L’incertitude paramétrique, également appelée incertitude de second ordre, fait référence à l’incertitude dans les estimations des paramètres qui sont utilisés pour alimenter un modèle.Note de bas de page 46 Note de bas de page 144 Note de bas de page 145 Elle diffère de la variabilité aléatoire, également appelée incertitude de premier ordre ou incertitude stochastique, ainsi que de l’hétérogénéité. La plupart des lignes directrices sur la réalisation des évaluations économiques d’interventions dans le domaine des soins de santé recommandent d’utiliser une analyse probabiliste de référence et/ou une analyse de sensibilité probabiliste pour explorer l’incertitude paramétrique, mais dans de rares situations, cette technique peut ne pas être réalisable avec des modèles dynamiques. De telles situations se présentent lorsque les modèles sont particulièrement complexes (p. ex. les simulations fondées sur des agents) ou lorsque la puissance de calcul disponible est limitée. Dans les modèles dynamiques, de nombreux paramètres liés à la transmission, tels que les habitudes de contact entre individus et les comportements liés à la prévention, peuvent être corrélés et il convient de préserver ces corrélations dans les modèles afin de générer des résultats sensés et adaptés aux données existantes (p. ex. données de surveillance épidémiologique). Dans certains cas, les corrélations entre les paramètres peuvent être inconnues,Note de bas de page 28 Note de bas de page 52 bien qu’on puisse parfois les établir à l’aide de méthodes bayésiennes d’inférence des paramètres.Note de bas de page 146 Note de bas de page 147 Dans ces cas, les chercheurs peuvent être amenés à choisir entre une structure de modèle complexe qui ne permet pas de réaliser d’analyse probabiliste et une structure plus simple qui permet d’étudier les conséquences des incertitudes liées aux paramètres.
Lorsque cela est possible, il faut traiter l’incertitude paramétrique de manière probabiliste par des analyses probabilistes de référence. Les fourchettes de paramètres choisies pour évaluer l’incertitude doivent, dans la mesure du possible, être fondées sur des estimations provenant d’études d’observation ou de données de surveillance. Les résultats de ces analyses doivent être présentés sous forme de CARCE ou sous forme de FE. Des diagrammes de dispersion peuvent être fournis pour présenter le plan coût-avantage avec les CARCE et les FE. Les diagrammes de dispersion sont utiles pour observer la densité et la dispersion des itérations, et pour évaluer les points d’inflexion et la forme des ellipses produites.
En plus de quantifier l’incertitude de manière probabiliste dans la référence, les chercheurs doivent effectuer des analyses de sensibilité déterministes (ASD) sur les différents paramètres du modèle afin d’avoir un aperçu des effets isolés des variations de ces paramètres, lequel est fourni par les méthodes déterministes. En particulier, les chercheurs devraient mener une ASD sur le prix des vaccins en utilisant un certain nombre de valeurs plausibles puisque le prix unitaire réel des doses de vaccin au Canada est souvent confidentiel. Il faut également réaliser des analyses de sensibilité déterministes sur les estimations de l’efficacité réelle des vaccins, car ces paramètres présentent souvent un degré élevé d’incertitude. Idéalement, l’ASD devrait reposer sur les résultats de l’analyse probabiliste plutôt que de supposer des valeurs de base (p. ex. en utilisant des coefficients de corrélation partielle des rangs ou une régression linéaire).
Les chercheurs devraient envisager de mener des analyses de seuil sur les paramètres les plus incertains qui peuvent ne pas être fondés sur des preuves empiriques (p. ex. les paramètres de mise en œuvre, comme la couverture de la population), afin que les décideurs soient en mesure de désigner une gamme de valeurs de paramètres qui donnent lieu à un programme de vaccination rentable.
Les chercheurs peuvent présenter les résultats des ASD unidirectionnelles (ou univariées) à l’aide d’un graphique en tornade, et les ASD bidirectionnelles à l’aide de graphiques de seuil bidirectionnels.Note de bas de page 145
Lorsqu’ils effectuent des analyses de sensibilité déterministes, les chercheurs doivent déterminer les régions des paramètres associées à des comportements distincts du modèle, comme la propagation épidémique ou l’extinction de la maladie, et indiquer si l’analyse de sensibilité a été limitée à une seule région. Si l’analyse de sensibilité porte sur plus d’une région, ils doivent indiquer la probabilité d’atteindre différents états d’équilibre de la maladie lorsque les valeurs des paramètres varient.Note de bas de page 28
Lorsque les analyses probabilistes ne sont pas entreprises dans le contexte de modèles dynamiques non linéaires, les chercheurs doivent effectuer des analyses de sensibilité déterministes complètes sur les paramètres incertains. Ils peuvent alors envisager d’utiliser de nouvelles méthodes d’analyses de sensibilité déterministes telles que l’analyse de sensibilité déterministe par étapes et l’analyse de sensibilité déterministe distributionnelle.Note de bas de page 148
Les effets de l’incertitude paramétrique peuvent être particulièrement prononcés dans les modèles dynamiques par rapport aux modèles statiques, car leur non-linéarité peut entraîner un comportement plus variable du modèle de résultats pour la population dans différentes régions des paramètres. Par exemple, une légère modification des valeurs des paramètres peut faire passer le modèle d’un état sans maladie à un état d’équilibre endémique lorsque le taux de reproduction de base (R0) est proche de 1. Ces comportements modèles ont des répercussions sur l’efficacité réelle des programmes de vaccination. Les effets indirects d’un programme introduit près d’un état seuil (p. ex. le début d’une épidémie) peuvent être importants par rapport à ceux d’un programme introduit à l’équilibre de la maladie, où son efficacité réelle peut présenter une relation linéaire entre le nombre d’individus vaccinés et la prévention de la maladie en question.Note de bas de page 28
Il est souvent difficile d’obtenir des estimations précises des paramètres des modèles de maladies infectieuses, car les chercheurs doivent souvent s’appuyer sur des études d’observation ou des données de surveillanceNote de bas de page 28. Les valeurs des paramètres tirées des données de surveillance peuvent être biaisées, car la proportion de cas détectés est souvent faible et varie considérablement entre les différentes maladies, même pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire dans le cadre des exigences de surveillance de la santé publique.Note de bas de page 149 La gravité de la maladie infectieuse influe sur la détection. Par exemple, l’infection par la coqueluche peut être asymptomatique, associée à des symptômes légers, à une toux grave, voire à la mort.Note de bas de page 150 Ainsi, les systèmes de surveillance qui reposent sur la déclaration passive surestiment souvent la gravité de la maladie, la morbidité et la mortalité, tout en sous-estimant l’incidence réelle de l’infection dans la population.Note de bas de page 28 Note de bas de page 150
L’incertitude des estimations de l’efficacité réelle des vaccins peut résulter des différences entre les données obtenues à partir des essais randomisés contrôlés et celles tirées de grandes études d’observation. Dans les essais randomisés contrôlés, la force de l’infection ne change pas et conduit à une sous-estimation de la véritable efficacité du vaccin dans la population puisque ces études ne tiennent pas compte des effets indirects de la vaccination (c’est-à-dire de l’effet de l’immunité collective). Par ailleurs, les grandes études d’observation de l’efficacité réelle des vaccins basées sur la population tiennent compte des effets indirects, mais elles sont limitées par le risque de biais de sélection et de la confusion non mesurée.Note de bas de page 28 Note de bas de page 151 Le biais de sélection peut résulter de différences systématiques dans l’échantillonnage des individus vaccinés et ceux qui ne le sont pas, se traduisant par une distribution des expositions et des résultats qui n’est plus représentative de la population source. Il y a confusion lorsque la totalité ou une partie de l’association apparente entre l’exposition (le programme de vaccination) et le résultat (p. ex. les hospitalisations évitées et les décès évités) est en fait expliquée par d’autres variables qui influent sur le résultat et ne sont pas elles-mêmes influencées par l’exposition. Ces facteurs sont notamment le niveau d’accès aux services de soins de santé, le statut socio-économique et la prévalence de l’immunité naturelle.Note de bas de page 151 Les chercheurs doivent noter que les études d’observation de l’efficacité réelle des vaccins sont généralement difficiles à réaliser et ne peuvent être entreprises avant l’homologation du vaccin. De plus, l’efficacité des programmes de vaccination pour prévenir la maladie chez les personnes vaccinées et non vaccinées dans la population (immunité communautaire) dépend de la couverture vaccinale et des taux d’achèvement des doses. L’incertitude de ces paramètres doit être prise en compte. Lorsqu’ils envisagent d’inclure des études d’observation de l’efficacité des vaccins dans des évaluations économiques, les chercheurs peuvent considérer de se référer aux directives publiées pour évaluer les preuves provenant d’études d’efficacité comparative.Note de bas de page 152 Note de bas de page 153
L’incertitude des paramètres liés à la transmission de l’infection entre individus doit être reflétée dans une analyse d’incertitude. Ces paramètres comprennent les habitudes de contact entre les individus, ainsi que d’autres comportements qui peuvent influencer la prévention et le contrôle des maladies. Les chercheurs doivent tenir compte de toutes les différences dans ces paramètres entre les groupes. Par exemple, dans les maladies où les individus asymptomatiques ou légèrement symptomatiques peuvent transmettre l’infection à d’autres, ces individus sont moins susceptibles de modifier leurs comportements pour réduire la transmission que les individus dont les symptômes sont plus graves.Note de bas de page 28
Dans certains cas, les valeurs des paramètres sont estimées à l’aide de modèles, qui peuvent être considérés comme des sous-modèles du modèle primaire d’analyse décisionnelle.Note de bas de page 144 Par exemple, un modèle prédictif peut être nécessaire pour établir la relation entre les biomarqueurs immunitaires qui sont des corrélats de protection du vaccin et l’incidence de la maladie cliniquement apparente. Dans ce cas, il faut tenir compte de l’incertitude des valeurs liées aux corrélats de protection ainsi que de l’incertitude des méthodes utilisées pour modéliser la relation entre les corrélats de protection et la maladie clinique.
Lorsqu’on a recours au calage pour estimer les paramètres du modèle, il faut étudier l’incertitude des estimations dérivées du processus de calage.Note de bas de page 145 Comme Taylor et ses collaborateurs l’ont démontré dans leur analyse coûts-efficacité du vaccin contre le VPH, le fait de ne pas tenir compte de l’incertitude liée aux paramètres calibrés du modèle sous-estime l’ampleur réelle de l’incertitude dans les estimations du rapport coût-efficacité.Note de bas de page 61
Incertitude structurelle
L’incertitude structurelle concerne le choix de la structure du modèle. Lorsqu’ils construisent des modèles pour l’évaluation économique des programmes de vaccination, les chercheurs doivent s’assurer que la structure du modèle tient compte des facteurs liés à la transmission de l’infection entre les individus, y compris le rôle des sous-groupes de la population qui peuvent présenter un risque élevé de transmission ou d’acquisition de l’infection, l’évolution naturelle de la maladie modélisée, ainsi que les effets directs et indirects du programme de vaccination.Note de bas de page 28 Note de bas de page 46
L’incertitude structurelle liée à la transmission de l’infection peut dépendre de l’un des facteurs suivants : 1) le mode de transmission; 2) la relation entre la gravité des symptômes et la transmissibilité (c’est-à-dire la possibilité pour les individus asymptomatiques ou peu symptomatiques de transmettre l’infection); 3) les habitudes de mélange et de contact des individus dans les populations; et 4) les changements de comportement en réaction aux éclosions de maladie.Note de bas de page 28 Note de bas de page 154 Note de bas de page 155 Les chercheurs doivent tester d’autres hypothèses sur ces facteurs dans toutes les situations applicables afin de s’assurer que l’incertitude liée à la transmission a été examinée de manière adéquate.
Pour certaines maladies infectieuses, des sous-groupes de population peuvent être épidémiologiquement importants pour la transmission de la maladie ou le risque d’infection dans la population globale. Ces sous-groupes peuvent recouper des sous-groupes liés à l’équité, qui sont abordés au chapitre 14, Équité. Par exemple, dans le cas de l’hépatite A, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et les utilisateurs de drogues injectables courent un risque élevé de transmettre et de contracter l’infection.Note de bas de page 156 Il faut mettre à l’essai les hypothèses du modèle sur le rôle de ces groupes à haut risque pour la transmission pour comprendre le degré d’incertitude qu’elles apportent.
L’incertitude relative à l’évolution naturelle d’une maladie infectieuse porte souvent sur le fait de savoir si elle conduit à une infection latente ou à une immunité naturelle. C’est le cas de certaines souches à haut risque du VPH. Des modèles d’analyse décisionnelle pour lesquels on a utilisé différentes hypothèses sur la latence et l’immunité naturelle à ces souches de VPH ont démontré que les résultats sont très sensibles à ces hypothèses.Note de bas de page 157 Les chercheurs doivent donc tenir compte de ces incertitudes dans la structure d’un modèle. Dans cet exemple du VPH, on pourrait examiner à la fois les cadres susceptible-infectieux-susceptible (SIS) et susceptible-infectieux-remis (immunisé) (SIR) pour évaluer comment les résultats varient avec différentes structures de modèle.Note de bas de page 28
Les aspects importants de l’incertitude structurelle liée aux programmes de vaccination sont le moment où les doses de vaccin sont administrées, la durée de la protection conférée par la vaccination et tous les effets indirects possibles du vaccin.Note de bas de page 28 Note de bas de page 86 Le cas échéant, il convient d’évaluer également l’utilisation de doses de rappel du vaccin.
Lorsqu’on ne sait pas si la protection conférée par un vaccin s’estompe, les chercheurs doivent tester différentes hypothèses plausibles relatives à la durée de la protection. Ces hypothèses, lorsque cela est possible, doivent être fondées sur des preuves immunologiques de la relation entre les corrélats immunitaires de la protection à long terme et l’apparition de la maladie clinique dans la période après la vaccination.Note de bas de page 86 Note de bas de page 158 Les données épidémiologiques sur les éclosions de maladie, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent également être utiles pour modéliser la durée de la protection conférée par les vaccins, comme l’ont montré les exemples des vaccins des enfants contre les oreillonsNote de bas de page 159 et des vaccins à cellules entières et acellulaires contre la coqueluche.Note de bas de page 12 Les fonctions linéaires, les fonctions logarithmiques et les fonctions exponentielles sont des exemples de méthodes utilisées pour prédire la durée de l’effet. Les fonctions constantes sont employées dans les modèles qui supposent l’absence de déclin de la protection.Note de bas de page 31 Note de bas de page 86
L’une des décisions critiques pour les chercheurs qui effectuent des évaluations économiques de programmes de vaccination est de savoir s’il faut modéliser les effets indirects des vaccins à l’aide de modèles dynamiques. Il a été avancé que si le seul effet indirect d’un programme de vaccination est l’immunité collective, alors la seule incertitude dans les résultats d’un modèle statique qui ne tient pas compte de ces effets est de savoir dans quelle mesure les résultats de l’évaluation économique seront plus favorables au programme de vaccination évalué.Note de bas de page 9 Cette incertitude n’est toutefois acceptable que dans les situations où un modèle statique a démontré qu’un programme de vaccination est rentable; dans les cas où le programme de vaccination n’a pas été jugé rentable, elle est problématique, car un modèle dynamique pourrait soit confirmer l’absence de rentabilité, soit produire un résultat démontrant que le programme de vaccination est en fait rentable.
Lorsque des effets indirects sont associés à un vaccin, comme la variation de l’âge de maladie ou le remplacement du sérotype, la décision d’utiliser un modèle statique au lieu d’un modèle dynamique pourrait entraîner un plus grand degré d’incertitude. Les modèles dynamiques sont requis pour tenir compte des incertitudes sur la variation de l’âge de maladie dans les évaluations économiques des programmes de vaccination. Les chercheurs doivent envisager divers scénarios liés à l’évolution de l’épidémiologie de la maladie après l’introduction d’un programme de vaccination pour évaluer les effets de la variation de l’âge sur les résultats d’une évaluation économique. Les effets du remplacement du sérotype doivent également être étudiés à l’aide de modèles dynamiques.
Les décisions sur la façon d’aborder l’incertitude liée aux différentes dimensions de l’efficacité réelle des vaccins (prévention de la maladie clinique, gravité de la maladie clinique, infection et infectiosité) peuvent être compliquées dans les cas où ces effets ne sont pas bien compris. Par exemple, on pense que les vaccins contre le méningocoque B ne confèrent pas une immunité collective en empêchant la transmission de la bactérie entre les individus, mais les données sur la véritable ampleur de l’efficacité réelle de ce vaccin sont limitées.Note de bas de page 160 Les chercheurs doivent utiliser différentes structures de modèles pour explorer ce type d’incertitude, le cas échéant.
L’incertitude structurelle influence les résultats des évaluations économiques au moins dans la même mesure que l’incertitude paramétrique, et souvent davantage.Note de bas de page 46 Note de bas de page 145 Il est particulièrement important d’explorer l’incertitude structurelle dans les modèles dynamiques avec l’analyse d’incertitude en raison de leurs effets non linéaires, qui peuvent conduire à un comportement variable du modèle.Note de bas de page 28 On doit avoir recours à une analyse de scénarios pour explorer les incertitudes structurelles des modèles. Cette technique consiste à mettre à l’essai d’autres scénarios du modèle qui sont étayés par différentes hypothèses structurelles plausibles. Les résultats de chaque analyse de scénario doivent être présentés individuellement. On peut ensuite faire la moyenne des modèles pour synthétiser les résultats de tous les scénarios de modèles de rechange qui ont été mis à l’essai. Au moment de l’établissement de la moyenne des résultats des analyses de scénarios, il convient d’utiliser des pondérations pour chaque modèle en fonction de la capacité de prédiction du modèle, en fonction des données disponibles (par exemple, des mesures d’applicabilité).Note de bas de page 161 Note de bas de page 162 Lorsqu’il est impossible d’établir les pondérations à partir des données, le jugement des chercheurs et l’avis d’experts peuvent être requis.
La paramétrisation est une méthode émergente pour traiter l’incertitude structurelle. Elle consiste à ajouter à un modèle des paramètres censés être les sources de l’incertitude structurelle et à leur attribuer une valeur unique, souvent extrême, de sorte que, dans certains cas, ils peuvent être complètement exclus du modèle alors que dans d’autres, ils en constituent une composante importante. Cette méthode permet d’internaliser l’incertitude structurelle dans le modèle et pourrait être utilisée pour orienter les décisions sur les recherches à venir visant à résoudre ces incertitudes.Note de bas de page 145 Note de bas de page 161 Il convient de justifier toutes les incertitudes structurelles qui n’ont pas été abordées.Note de bas de page 145
Incertitude méthodologique
L’incertitude méthodologique est liée aux différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser une évaluation économique. Lorsqu’ils procèdent à des évaluations économiques de programmes de vaccination, les chercheurs doivent faire des choix méthodologiques importants, notamment le type d’analyse, la perspective, l’approche et le taux d’escompte, ainsi que l’horizon temporel.Note de bas de page 46 Note de bas de page 144
Étant donné que les programmes de vaccination préviennent souvent des maladies qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques (p. ex. la vaccination contre le méningocoque de type B pourrait empêcher la mort ou des séquelles neurologiques permanentes résultant d’une méningite due à la bactérie méningocoque de sérogroupe B), ils offrent des avantages liés à la santé et d’autres tels que des améliorations de l’éducation ou de la productivité tout au long de la vie. C’est pourquoi certains auteurs ont fait valoir que les analyses coûts-avantages devraient être prises en compte dans l’évaluation économique des programmes de vaccination afin de rendre compte de l’ensemble des avantages de ceux-ci.Note de bas de page 8 Dans la pratique, cependant, l’incertitude liée au type d’évaluation réalisée est rarement examinée.Note de bas de page 46 En principe, les coûts autres que pour la santé des programmes de vaccination pourraient être pris en compte dans une analyse coûts-utilité si une perspective plus large (sociétale par exemple) est adoptée pour l’analyse, mais la prise en compte des avantages autres que pour la santé pourrait être plus difficile.Note de bas de page 8 Note de bas de page 144 Les expériences de choix discret sont une option de plus en plus prisée pour capturer les compromis pertinents relatifs aux avantages autres que pour la santé des interventions dans le cadre des ACA et des ACU. En conséquence, les présentes Lignes directrices recommandent de réaliser deux analyses de référence : l’une du point de vue du système de santé financé par l’État et l’autre du point de vue de la société.
Les évaluations économiques des programmes de vaccination sont particulièrement sensibles à la stratégie d’actualisation, au recours à l’annualisation et à l’horizon temporel choisis pour l’analyse, car les coûts de lancement d’un programme de vaccination sont engagés au moment de l’introduction du programme, alors qu’il faut souvent beaucoup plus de temps, parfois plusieurs années ou décennies, pour en retirer tous les avantages.Note de bas de page 9 Note de bas de page 46 Les chercheurs doivent ainsi examiner l’influence de la variation de l’approche d’actualisation et de l’horizon temporel de l’analyse sur les résultats. Lorsque l’horizon temporel de l’analyse est très long (p. ex. plusieurs décennies), il faut présenter les résultats de l’évaluation économique pour différents horizons temporels afin que les décideurs prennent en compte les coûts et les résultats pertinents pour le problème de décision qu’ils traitent.
Pour examiner en profondeur de nombreux volets de l’incertitude méthodologique, il faudrait idéalement disposer de plusieurs modèles distincts, ce qui est souvent difficile en pratique. À ce titre, les chercheurs devraient, dans la mesure du possible, collaborer de manière transparente avec d’autres groupes qui se penchent sur des problèmes décisionnels semblables, afin de pouvoir explorer l’étendue de l’incertitude liée aux choix méthodologiques.
Valeur de l’information
S’il y a analyse de la valeur de l’information, illustrer la valeur de l’information supplémentaire par la valeur probable de l’information parfaite sur le paramètre et la valeur escomptée par la population de l’information parfaite sur le paramètre. Voir les lignes directrices de l’ACMTS pour obtenir des renseignements supplémentaires.
14. Équité
14.1 Les chercheurs et les décideurs doivent travailler ensemble pour déterminer les dimensions et les objectifs d’équité à inclure dans l’évaluation économique du programme de vaccination envisagé. L’équité doit être considérée dans le contexte du cadre d’éthique, d’équité, de faisabilité et d’acceptabilité (ÉÉFA) du CCNI.
14.2 Les analyses qui intègrent les préoccupations pertinentes en matière d’équité doivent accompagner l’analyse de référence (par exemple, l’analyse coût-efficacité distributive, l’analyse coût-efficacité étendue ou d’autres méthodes émergentes) et être présentées avec l’analyse de référence.
Les évaluations économiques des interventions dans le domaine des soins de santé mettent traditionnellement l’accent sur l’efficience. Cet exercice s’inscrit dans le cadre décisionnel plus large de l’évaluation des technologies de la santé (ETS), qui synthétise et évalue principalement les données cliniques et économiques relatives à une nouvelle intervention ou technologie de la santé. Cependant, il est de plus en plus reconnu que les questions éthiques et morales liées à la manière dont une technologie est évaluée et utilisée doivent être abordées dans le cadre des décisions relatives à l’adoption de nouvelles technologies de la santé.Note de bas de page 163 Note de bas de page 164
Le CCNI a mis en place le cadre d’éthique, d’équité, de faisabilité et d’acceptabilité (ÉÉFA) pour prendre systématiquement en compte ces facteurs dans le cadre d’une approche multicritère des recommandations sur les vaccins. Dans ce cadre, l’éthique et l’équité sont prises en compte avec la faisabilité et l’acceptabilité d’une recommandation, ainsi que l’efficacité clinique, l’immunogénicité, l’innocuité et la rentabilité d’un vaccinNote de bas de page 5. L’éthique de la santé publique est le domaine de l’éthique appliquée en vaccination. Elle s’intéresse principalement aux dimensions éthiques fondamentales suivantes : 1) le respect des personnes et des communautés; 2) la non-malfaisance et la bienfaisance; 3) la confiance; et 4) la justice.Note de bas de page 165
L’équité est considérée comme faisant partie de la dimension éthique fondamentale de la justice, et est définie comme « l’absence de différences injustes, évitables et remédiables dans la santé entre différents groupes de la population, définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques ou par des moyens de stratification ».Note de bas de page 5 Note de bas de page 166 Dans les évaluations économiques, l’équité est une approche de la justice distributive qui concerne les jugements sur l’équité dans la distribution des résultats et des expériences de santé dans une population, et elle est liée à l’allocation équitable des ressources et à la réalisation d’amélioration de la santé entre les individus ou les groupes.Note de bas de page 167 L’équité dans l’évaluation économique des technologies de la santé a fait l’objet d’une activité et d’un développement méthodologique considérables récemment.164,168-170
Les conséquences distributives liées à l’adoption d’une nouvelle technologie de la santé deviennent particulièrement importantes dans les situations où les décideurs doivent faire des compromis entre les attributs des technologies de la santé. Par exemple, les économistes de la santé signalent fréquemment des compromis entre la rentabilité et l’équité en santé. Ces situations se présentent lorsqu’une technologie est rentable, mais accroît les inégalités entre les groupes d’une population, parce que certains segments de la société peuvent tirer parti de la technologie plus que d’autres. En revanche, elles se présentent lorsqu’une technologie n’est pas rentable, mais que son adoption améliorerait l’équité entre les groupes en réduisant les disparités en matière de gains en matière de santé, ou lorsqu’une technologie augmenterait l’équité entre certains groupes (par exemple, les strates de revenus), mais diminuerait l’équité entre d’autres (par exemple, géographiques).Note de bas de page 171
Les chercheurs et les décideurs doivent travailler en collaboration pour déterminer l’objectif d’équité que le programme de vaccination vise à atteindre parmi les suivants : 1) améliorer l’équité dans l’accès au programme de vaccination pour les personnes admissibles; 2) améliorer l’équité dans l’adoption du programme de vaccination chez les personnes admissibles; 3) améliorer l’équité dans les avantages pour la santé liés aux conditions de santé visées par le programme de vaccination; 4) réduire les inégalités en matière de santé au cours de la vie entre les groupes au moyen du programme de vaccination; ou 5) réduire les inégalités globales (c’est-à-dire liées à la santé et autres) entre les groupes au moyen du programme de vaccination. Différentes approches peuvent être utilisées pour conceptualiser les objectifs d’équité (p. ex. l’universalisme proportionné, l’égalitarisme). Les chercheurs peuvent trouver utile de se référer aux ouvrages publiés sur ce sujet lorsqu’ils conceptualisent les objectifs d’équité à inclure dans une évaluation économique.Note de bas de page 172 Note de bas de page 173 Note de bas de page 174
Pour établir des objectifs d’équité, les chercheurs doivent se demander s’il existe des groupes clés d’individus souffrant d’inégalités en matière de santé et d’obstacles à la santé qui pourraient être réduits ou éliminés par le programme de vaccination. Parmi les groupes susceptibles d’être victimes d’iniquités en matière de santé au Canada, citons les peuples autochtones (plus précisément les Premières Nations, les Inuits et les Métis, aux fins des présentes lignes directrices), les personnes à faible statut socioéconomique, les personnes appartenant à des groupes minoritaires ethniques, sexuels ou de genre, les populations vivant dans certaines régions géographiques (urbaines, rurales, éloignées ou isolées), les personnes handicapées et les groupes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes vivant dans des établissements.Note de bas de page 5 Note de bas de page 117 Note de bas de page 170 Note de bas de page 175 Note de bas de page 176
Les chercheurs doivent également prendre en compte les facteurs qui pourraient causer des différences dans les avantages pour la santé résultant du programme de vaccination entre les groupes victimes d’inégalités en matière de santé, comme les pathologies sous-jacentes, le potentiel d’avantage à vie, les comportements de recherche de santé, l’utilisation du vaccin et le rôle de l’immunité collective dans la réduction ou l’augmentation des inégalités entre les groupes, les comportements à risque, les différentes habitudes de mélange ou de contact dans les groupes, et l’accès à des soins de santé culturellement sûrs.Note de bas de page 6 Note de bas de page 177
Les chercheurs doivent reconnaître que certains groupes peuvent tirer parti du programme de vaccination, et d’autres non, ce qui pourrait accroître les inégalités. Par exemple, un accès différentiel à un programme de vaccination contre le VPH peut aggraver l’inégalité en réduisant le taux de cancer du col de l’utérus au sein d’une population qui était déjà moins exposée, mais qui tire parti d’un meilleur accès, accroissant ainsi la différence de résultats entre les groupes. Les interventions qui semblent réduire les inégalités devraient faire l’objet d’un examen afin de déterminer la manière de surmonter les obstacles pertinents en matière d’accès que rencontre la population.
Une fois que les chercheurs ont établi les résultats visés en matière d’équité, ils doivent examiner les caractéristiques du programme de vaccination destinées à atteindre ces résultats. Par exemple, si l’objectif du programme est d’améliorer l’équité dans l’accès au vaccin pour toutes les personnes admissibles, il faudrait envisager un programme qui réduit les obstacles à l’accès. Un exemple d’un tel programme serait un programme de vaccination contre le VPH en milieu scolaire qui élimine les obstacles pour les individus comme le coût des doses de vaccin et la nécessité de se rendre dans une clinique ou un cabinet médical.Note de bas de page 117 Toutefois, si l’objectif du programme est d’améliorer l’équité dans l’utilisation du vaccin, les chercheurs pourraient envisager des scénarios dans lesquels les vaccins sont obligatoires ou qui traitent de la mésinformation sur le vaccin. Un exemple d’un tel programme serait un programme scolaire légalement obligatoire pour la vaccination contre le VPH, avec une clause de renonciation active.Note de bas de page 178 Si l’objectif est de réduire les inégalités en matière de santé entre les groupes au cours de la vie grâce au programme de vaccination, il convient d’envisager un programme conforme au principe d’équité verticale, qui nécessite de traiter différemment les individus présentant des caractéristiques d’importance éthique différentes.Note de bas de page 179 Un exemple serait un programme de vaccination visant à atteindre des niveaux élevés de couverture vaccinale parmi les peuples autochtones. Au Canada, les peuples autochtones sont plus touchés par les maladies évitables par la vaccination que les populations non autochtones (p. ex. le cancer du col de l’utérus, l’hépatite A) en raison d’inégalités systématiques telles que la pauvreté, les logements surpeuplés, le manque d’eau courante et un mauvais état de santé sous-jacent, qui accroissent le risque de contracter ces infections.Note de bas de page 180 Note de bas de page 181 En outre, les peuples autochtones vivant dans des réserves et des communautés isolées peuvent également être victimes d’inégalités dans l’accès aux traitements lorsqu’ils tombent malades, ce qui aggrave leur risque de morbidité et de mortalité liées aux infections.Note de bas de page 182 Toutefois, les chercheurs doivent être conscients que les programmes de vaccination réservés à certains groupes à haut risque, vulnérables ou marginalisés, peuvent accroître la stigmatisation de ces groupes. Des approches de rechange, comme des programmes plus universels, devraient être envisagées. Enfin, si l’objectif est d’améliorer l’équité en santé et autre entre les groupes, les chercheurs pourraient envisager des programmes de vaccination qui contribuent à améliorer la santé et la productivité économique. Il s’agit par exemple des programmes de vaccination des enfants, qui permettent aux enfants de participer à l’éducation, ainsi que de devenir des adultes en bonne santé et économiquement productifs.Note de bas de page 183 Pour prendre en compte des résultats pertinents en matière d’équité concernant la sélection et la définition des comparateurs à intégrer dans l’analyse, les chercheurs doivent se reporter au chapitre 3 des présentes lignes directrices, consacré aux comparateurs.
Pour présenter les résultats des évaluations économiques par sous-groupes pertinents pour l’équité, les chercheurs doivent s’assurer que les critères d’établissement de ces sous-groupes ont été délimités et justifiés de manière transparente. Un examen récent des évaluations des effets cumulatifs tenant compte de l’équité a relevé onze critères différents qui ont été utilisés pour incorporer explicitement l’équité dans un cadre de coût-efficacité, le statut socioéconomique et la race ou l’ethnicité étant les plus fréquemment utilisés.Note de bas de page 184 Les cadres de l’analyse coûts-efficacité distribuée (ACED) et étendue (ACEE) fournissent des conseils et des méthodes pour mener des évaluations des effets cumulatifs tenant compte de l’équité.Note de bas de page 168 Note de bas de page 185
En plus de tenir compte des résultats liés à l’équité associés aux programmes de vaccination, les chercheurs doivent également tenir compte de la distribution des coûts de renonciation liés à la mise en œuvre de ces programmes.Note de bas de page 171 Cette redistribution des ressources pourrait, par exemple, entraîner une diminution des dépenses consacrées aux programmes de dépistage ou aux mesures préventives non vaccinales liées à l’infection visée par le programme de vaccination. Les coûts de renonciation peuvent également concerner d’autres secteurs que celui de la santé, par exemple, par une diminution du financement des programmes éducatifs ou sociaux.Note de bas de page 171 Bien que, dans de nombreux cas, il puisse être difficile de déterminer explicitement les coûts de renonciation liés à la mise en œuvre de programmes de vaccination, les chercheurs doivent, dans la mesure du possible, les quantifier d’une manière pertinente pour les décideurs. Dans certains cas, les interventions visant à améliorer l’équité peuvent ne pas avoir de coût de renonciation net, puisqu’il peut être efficace d’affecter des ressources aux groupes dont la charge sanitaire est plus élevée.
Le cas échéant, ils doivent tenir compte des conséquences des programmes de vaccination sur l’équité intergénérationnelle. Les programmes de vaccination qui entraînent des externalités ont des effets sur des cohortes d’individus autres que celle qui est vaccinée.Note de bas de page 34 Par exemple, un programme de vaccination contre la varicelle pendant l’enfance peut provoquer une augmentation des cas de zona chez les personnes plus âgées;Note de bas de page 186 inversement, un programme de vaccination contre le VPH peut conduire à l’éradication de la maladie pour les générations futures.Note de bas de page 187 Dans ces deux exemples, il faut intégrer les effets indirects sur des cohortes d’individus non visées par le programme de vaccination dans les modèles dynamiques utilisés pour générer des estimations de la rentabilité. Les chercheurs doivent alors tenir compte explicitement des conséquences de ces résultats sur le plan de l’équité. Dans le premier exemple, les chercheurs doivent recenser de manière qualitative des compromis entre l’amélioration de la santé des enfants et les résultats négatifs en matière de santé éventuels chez les personnes plus âgées. Quantitativement, le résumé des coûts et les résultats estimés dans le cadre de l’analyse tiennent compte des compromis. Dans le second exemple, ils doivent se demander comment évaluer en termes actuels les résultats en matière de santé obtenus par des cohortes dans un avenir lointain.
Une telle évaluation des résultats de santé dans des cohortes dans un avenir lointain dépend de la stratégie d’actualisation employée dans le cadre de l’évaluation économique. Un taux d’escompte égal se traduit par une plus grande valeur accordée aux résultats en matière de santé de la cohorte actuelle et des cohortes proches dans le temps, et une valeur moindre aux résultats en matière de santé des cohortes dans un avenir lointain, ce qui, selon certains auteurs, est une caractéristique injuste de cette stratégie.Note de bas de page 33 L’application de taux d’escompte plus faibles pourrait toutefois avoir pour conséquence d’accorder plus de poids aux résultats en matière de santé dans les cohortes susceptibles d’avoir des revenus plus élevés et accès à davantage d’interventions sanitaires, et donc d’avoir plus de chances d’améliorer la santé. Compte tenu des résultats variables liés aux effets intergénérationnels des programmes de vaccination qui peuvent résulter de différentes stratégies d’actualisation, les chercheurs doivent examiner et signaler les conséquences sur le plan de l’équité intergénérationnelle des programmes de vaccination qui se traduisent par des avantages sanitaires pour les cohortes dans un avenir lointain.Note de bas de page 33 Note de bas de page 34 Note de bas de page 188
15. Production de rapports
15.1 Présenter les résultats de l’évaluation économique de façon détaillée et transparente. Fournir suffisamment de renseignements pour que le lecteur ou l’utilisateur (le décideur, par exemple) puisse faire une analyse critique de l’évaluation. Utiliser une présentation bien structurée. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.2 Prévoir un sommaire de l’évaluation dans un langage non technique. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.3 Présenter les résultats de l’évaluation économique à l’aide d’éléments graphiques ou visuels en plus de tableaux. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.4 Inclure des renseignements ou des documents sur les processus d’assurance de la qualité et les résultats de l’évaluation économique dans le compte rendu. Fournir une copie du modèle par voie électronique aux fins d’examen ainsi que de la documentation connexe afin de faciliter la compréhension du modèle, de son déroulement et de son fonctionnement. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.5 Préciser les sources de financement et les liens hiérarchiques dans le cadre de l’évaluation et mentionner tout conflit d’intérêts éventuel. » [Énoncé des lignes directrices de l’ACMTS].
15.6 Les chercheurs doivent utiliser les lignes directrices pour la présentation des évaluations économiques des programmes de vaccination au Canada du CCNI et remplir l’inventaire des effets à prendre en considération dans l’évaluation économique des stratégies de vaccination, qui se trouve à l’annexe 1.
La présentation des résultats des évaluations économiques doit fournir aux décideurs des informations transparentes et crédibles qui leur permettent d’aborder le problème de décision qui les intéresse et de prendre une décision de financement optimale concernant le programme de vaccination envisagé.
Il convient d’aborder les considérations relatives aux rapports spécifiques aux vaccins, notamment l’horizon temporel de l’évaluation et les mécanismes par lesquels les vaccins exercent leurs effets. Dans les cas où l’horizon temporel du modèle d’une évaluation économique s’étend sur une longue période, il convient de présenter les résultats à partir de divers points temporels sur l’horizon temporel du modèle pour que les conclusions de l’analyse soient pertinentes pour l’horizon temporel considéré par les décideurs. Étant donné que les vaccins peuvent exercer leurs effets par le biais de divers mécanismes (p. ex. la prévention de la transmission d’une infection, la prévention d’une infection, la prévention d’une maladie ou la diminution de sa gravité), les chercheurs doivent rendre compte des résultats des programmes de vaccination non seulement en termes d’AVAQ, mais aussi en nombre de cas évités, en nombre d’unités d’utilisation des soins de santé pertinentes (p. ex. les hospitalisations) évitées, en nombre de décès évités et en nombre d’individus à vacciner, le cas échéant. La présentation de ces unités de mesure en plus des AVAQ améliore la crédibilité et la transparence de l’analyse pour les décideurs.
L’utilisation des ressources, les coûts et les résultats doivent être présentés de manière désagrégée pour chaque comparateur faisant l’objet d’un examen dans le cadre de l’analyse et pour les deux analyses de référence. Si les analyses sont effectuées du point de vue de plusieurs payeurs publics (par exemple, pour plusieurs provinces ou territoires), chacune d’elles doit être présentée séparément.
Toutes les hypothèses et règles de décision utilisées dans le cadre des analyses doivent être présentées de manière transparente.
Les chercheurs doivent donner des détails sur les processus d’assurance qualité et les résultats obtenus dans le cadre du processus de vérification du modèle. Une copie électronique entièrement exécutable du modèle doit être mise à disposition, ainsi que les détails relatifs à la fonctionnalité du modèle, afin de permettre au décideur de vérifier les résultats de l’analyse ou de réaliser des analyses supplémentaires si nécessaire.
Les chercheurs doivent divulguer toutes les sources de financement de l’évaluation économique et indiquer le rôle des bailleurs de fonds dans l’identification, la conception, la réalisation et le compte rendu de l’analyse. Les sources non monétaires de soutien (par exemple, en nature) doivent également être divulguées.Note de bas de page 189
Les chercheurs doivent indiquer tous les conflits d’intérêts potentiels, d’ordre financier ou non. Les types d’affiliations et d’intérêts devant être divulgués comprennent : la participation à la recherche, la participation financière, la propriété intellectuelle , et tout autre intérêt que les lecteurs pourraient percevoir comme un intérêt concurrent (par exemple, les déclarations publiques sur le sujet).Note de bas de page 190
Les « lignes directrices pour la présentation des évaluations économiques des programmes de vaccination au Canada du CCNI », se trouvant sur le site Web du CCNI, fournissent un format standard pour la présentation des résultats des évaluations économiques des programmes de vaccination.Note de bas de page 191 Les chercheurs doivent suivre la structure décrite dans ce document pour présenter leurs résultats.
Annexe 1 : Tableau d’inventaire des effets
| Domaine touché | Définitions/Exemples | Inclus dans la référence? | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
| Perspective du système de santé financé à même les fonds publics | Perspective sociétale | |||
| Santé | ||||
| Effets sur la santé | Résultats en matière de santé chez les personnes destinées à la vaccination | |||
| Mortalité | S.O. | |||
| Qualité de vie liée à la santé | S.O. | |||
| Innocuité (p. ex. incidents indésirables) | S.O. | |||
| Effets sur la santé irréversibles qui ne sont pas reflétés dans la QALY (p. ex. infertilité liée à une infection transmissible sexuellement). | S.O. | |||
| Résultats individuels en matière de santé pour les aidants naturels | ||||
| Qualité de vie liée à la santé | S.O. | |||
| Résultats en matière de santé de la population | ||||
| Incidence de la maladie chez les personnes vaccinées et non vaccinées | S.O. | |||
| Évolution de la pyramide des âges des personnes qui contractent l’infection ou la maladie | S.O. | |||
| Évolution de l’incidence de l’infection et de la maladie liée à des variations de l’agent pathogène ou à d’autres agents pathogènes qui remplacent celui ciblé par le vaccin | S.O. | |||
| Éradication de la maladie | S.O. | |||
| Coûts du système de santé | Coûts des traitements médicaux | |||
| Services de soins de santé financés par des fonds publics (par exemple, visites chez le médecin, tests diagnostiques, traitement médicamenteux le cas échéant, hospitalisation, soins formels,Note de bas de page a rééducation dans un établissement ou à domicile,Note de bas de page a soins à domicile,Note de bas de page a soins de longue durée dans des maisons de soins infirmiersNote de bas de page a) | S.O. | |||
| Coûts futurs des soins de santé liés et non liés | S.O. | |||
| Coûts de santé publique | ||||
| Coûts liés au programme (par exemple, coûts de mise en œuvre, d’exécution et récurrents, campagnes de santé publique, activités de promotion de la santé, coûts de transaction, dépistage dans la population, surveillance épidémiologique, recherche des contacts, enquête et gestion des épidémies). | S.O. | |||
| Coûts liés à l’intervention (par exemple, coût des doses de vaccin, distribution comme transport et entreposage frigorifique, administration, y compris le personnel, le gaspillage et les fournitures auxiliaires) | S.O. | |||
| Coûts des soins de santé NON financés par le système de santé | Traitements médicamenteux (dans certains cas) | S. O. | S.O. | |
| Services de soins formels,Note de bas de page a rééducation dans un établissement ou à domicile,Note de bas de page a soins à domicile,Note de bas de page a soins de longue durée en maison de soins infirmiersNote de bas de page a (dans certains cas) | S. O. | S.O. | ||
| Divers coûts directs (p. ex. médicaments sans ordonnance) | S. O. | S.O. | ||
| Coûts accessoires (p. ex. quotes-parts des assurances privées, soins dentaires, soins de la vue, appareils fonctionnels, physiothérapie) | S. O. | S.O. | ||
| Domaines non liés à la santé | ||||
| Frais directs assumés de leur poche | Frais de transport | S. O. | S.O. | |
| Frais d’hébergement | S. O. | S.O. | ||
| Perte de productivité | Travail rémunéré | |||
| Temps d’arrêt de travail résultant d’un traitement, d’une maladie, d’une invalidité ou d’un décès Présentéisme | S. O. | S.O. | ||
| Conséquences des maladies infantiles sur la productivité tout au long de la vie | S. O. | S.O. | ||
| Travail non rémunéré | ||||
| Temps d’arrêt de travail sur le marché du travail non organisé résultant d’un traitement, d’une maladie, d’un handicap ou d’un décès | S. O. | S.O. | ||
| Production domestique non rémunérée (p. ex. cuisiner, nettoyer, faire les courses, élever les enfants, autres tâches liées à la gestion du ménage) | S. O. | S.O. | ||
| Productivité des aidants naturels | ||||
| Temps d’arrêt de travail résultant de la prise en charge de personnes malades | S. O. | S.O. | ||
| Présentéisme des aidants | S. O. | S.O. | ||
| Conséquences macroéconomiques | ||||
| Chocs de l’offre de main-d’œuvre, fermetures généralisées d’entreprises | S. O. | S.O. | ||
| Consommation | Consommation future non médicale | S. O. | S.O. | |
| Changements dans la consommation des ménages | S. O. | S.O. | ||
| Effets de la consommation sur la santé (par exemple, associés à la perte d’emploi) | S. O. | S.O. | ||
| Études | Niveau de réussite scolaire résultant de la santé physique, de la santé mentale et de la cognition | S. O. | S.O. | |
| Coûts liés aux besoins éducatifs spéciaux résultant d’une maladie ou d’un handicap | S. O. | S.O. | ||
| Services sociaux et services communautaires | Services sociaux et services communautaires (par exemple, soutien aux personnes handicapées, programmes visant à améliorer l’accès aux programmes de vaccination pour les adultes) | S. O. | S.O. | |
| Services aux enfants et aux jeunes (par exemple, programmes de sensibilisation, répit pour les familles, programmes visant à améliorer l’accès aux programmes de vaccination pour les enfants et les jeunes) | S. O. | S.O. | ||
| Environnement | Effet environnemental des programmes de vaccination et des comparateurs (par exemple, fabrication, distribution et mise en œuvre) | S. O. | S.O. | |
| Autres domaines | Tenir compte des domaines tels que la justice, le système pénal ou le logement, le cas échéant | S. O. | S.O. | |
|
||||
Annexe 2 : Spécifications des analyses de référence
Le tableau 2 présente les recommandations ayant trait aux analyses de référence. Lorsque les analyses ne suivent pas les recommandations présentées ci-après, les chercheurs doivent préciser les écarts et les justifier en fonction du problème de décision.
| Partie | Recommandation |
|---|---|
| Problème de décision | Préciser le programme de vaccination, le cadre d’intervention, la perspective, les coûts, les résultats, l’horizon temporel et la population cible de l’évaluation. |
| Types d’évaluations | Procéder à une analyse coûts-utilité (ACU) avec présentation des résultats sur la santé en années de vie gagnées ajustées en fonction de la qualité (AVAQ). |
| Populations étudiées | Désigner la ou les populations visées par les interventions et, le cas échéant, les populations qui pourraient subir des externalités résultant du programme de vaccination. Effectuer une analyse stratifiée lorsque des sous-groupes distincts sont désignés. |
| Comparateurs | Comparer toutes les interventions pertinentes, y compris les autres programmes de vaccination, les interventions de dépistage, les interventions préventives médicales et non médicales, ainsi que les approches thérapeutiques d’usage courant dans un contexte canadien. |
| Perspective | Réaliser deux analyses de référence : l’une du point de vue du système de santé financé par des fonds publics et l’autre du point de vue de la société. |
| Horizon temporel | Sélectionner un horizon temporel suffisamment long pour détecter toutes les différences pertinentes entre les interventions quant à leurs coûts et à leurs résultats (effets sur la santé) futurs. |
| Actualisation | Actualiser les coûts et les résultats à un taux de 1,5 % par an. |
| Mesure et évaluation de la santé | Relever, mesurer et évaluer tous les résultats pertinents en matière de santé selon les perspectives du système de santé public et de la société. Utiliser des préférences en matière de santé qui correspondent à celles de la population canadienne générale. Obtenir les préférences en matière de santé par une méthode de mesure indirecte reposant sur un système de classification générique. |
| Utilisation et coût des ressources | Répertorier, mesurer et évaluer toutes les ressources pertinentes utilisées, et établir les coûts selon les perspectives du i) système de santé public et de la ii) société. Estimer les ressources et les coûts canadiens en fonction de données applicables dans la région d’intérêt. |
| Analyse | Déterminer la valeur probable des coûts et des résultats pour chaque intervention selon les perspectives du système de santé public et de la société par une analyse probabiliste, en incorporant la corrélation potentielle entre les paramètres, lorsque cela est possible. Si la population cible est constituée de sous-groupes distincts, effectuer une analyse stratifiée et présenter les résultats pour chaque sous-groupe. Calculer les coûts différentiels, l’efficacité différentielle et les rapports coût-efficacité différentiels (RCED) pour les analyses selon les perspectives du système de santé public et de la société. Lorsque l’évaluation porte sur plus de deux comparateurs, calculer les rapports coût-efficacité différentiel de manière séquentielle. |
| Incertitude | Évaluer l’incertitude méthodologique en comparant les résultats de l’analyse de référence à ceux d’une analyse complémentaire. Résumer l’incertitude décisionnelle à l’aide de courbes d’acceptabilité du rapport coût-efficacité (CARCE) et de frontières d’efficience (FE), si possible. Évaluer l’incertitude structurelle par l’analyse de scénarios. S’il y a analyse de la valeur de l’information, illustrer la valeur de l’information supplémentaire par la valeur probable de l’information parfaite sur le paramètre et la valeur escomptée par la population de l’information parfaite sur le paramètre. |
| Équité | Déterminer s’il existe des inégalités dont souffrent certains groupes et que le programme de vaccination pourrait corriger. Il convient d’étudier l’équité à l’aide de méthodes comme l’analyse coût-efficacité distributive et l’analyse coût-efficacité étendue. Toute analyse supplémentaire doit accompagner les analyses de référence, le cas échéant. |
Références
- Note de bas de page 1
-
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Guidelines for the Economic Evaluation of Health
- Note de bas de page 2
-
Baron J. A theory of social decisions. J Theory Soc Behav. 1995; 25.
- Note de bas de page 3
-
Claxton K., Paulden M., Gravelle H., Brouwer W., Culyer A.J. Discounting and decision making in the economic evaluation of health-care technologies. Health Econ. 2011; 20(1): 2-15. doi:10.1002/hec.1612
- Note de bas de page 4
-
Paulden M., Galvanni V., Ghakraborty S., Kudinga B., McCabe C. Discounting and the evaluation of health care programs. n.d.
- Note de bas de page 5
-
Ismail S.J., Hardy K., Tunis M.C., Young K., Sicard N., Quach C. A framework for the systematic consideration of ethics, equity, feasibility, and acceptability in vaccine program recommendations. Vaccine. 2020; 38(36): 5861-76. doi:10.1016/j.vaccine.2020.05.051
- Note de bas de page 6
-
Brisson M., Drolet M., Malagón T. Inequalities in Human Papillomavirus (HPV)-associated cancers: implications for the success of HPV vaccination. J Natl Cancer Inst. 2013; 105(3): 158-61. doi:10.1093/jnci/djs638
- Note de bas de page 7
-
Bloom D.E., Brenzel L., Cadarette D., Sullivan J. Moving beyond traditional valuation of vaccination: Needs and opportunities. Vaccine. 2017; 35 Suppl 1: A29-a35. doi:10.1016/j.vaccine.2016.12.001
- Note de bas de page 8
-
Park M., Jit M., Wu J.T. Cost-benefit analysis of vaccination: a comparative analysis of eight approaches for valuing changes to mortality and morbidity risks. BMC Med. 2018; 16(1): 139. doi:10.1186/s12916-018-1130-7
- Note de bas de page 9
-
Walker D.G., Hutubessy R., Beutels P. WHO Guide for standardisation of economic evaluations of immunization programmes. Vaccine. 2019; 28(11): 2356-9. doi:10.1016/j.vaccine.2009.06.035
- Note de bas de page 10
-
Brisson M., Edmunds W.J. The cost-effectiveness of varicella vaccination in Canada. Vaccine. 2002; 20(7-8): 1113-25. doi:10.1016/s0264-410x(01)00437-6
- Note de bas de page 11
-
Christensen H., Hickman M., Edmunds W.J., Trotter C.L. Introducing vaccination against serogroup B meningococcal disease: an economic and mathematical modelling study of potential impact. Vaccine. 2013; 31(23): 2638-46. doi:10.1016/j.vaccine.2013.03.034
- Note de bas de page 12
-
Gambhir M., Clark T.A., Cauchemez S., Tartof S.Y., Swerdlow D.L., Ferguson N.M. A change in vaccine efficacy and duration of protection explains recent rises in pertussis incidence in the United States. PLoS Comput Biol. 2015; 11(4): e1004138. doi:10.1371/journal.pcbi.1004138
- Note de bas de page 13
-
Markowitz L.E., Drolet M., Perez N., Jit M., Brisson M. Human papillomavirus vaccine effectiveness by number of doses: Systematic review of data from national immunization programs. Vaccine. 2018; 36(32 Pt A): 4806-15. doi:10.1016/j.vaccine.2018.01.057
- Note de bas de page 14
-
Bärnighausen T., Bloom D.E., Cafiero-Fonseca E.T., O'Brien J.C. Valuing vaccination. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014; 111(34): 12313-9. doi:10.1073/pnas.1400475111
- Note de bas de page 15
-
Chandran A., Herbert H., Misurski D., Santosham M. Long-term sequelae of childhood bacterial meningitis: an underappreciated problem. Pediatr Infect Dis J. 2011; 30(1): 3-6. doi:10.1097/INF.0b013e3181ef25f7
- Note de bas de page 16
-
Grimwood K., Anderson P., Anderson V., Tan L., Nolan T. Twelve year outcomes following bacterial meningitis: further evidence for persisting effects. Arch Dis Child. 2000; 83(2): 111-6. doi:10.1136/adc.83.2.111
- Note de bas de page 17
-
Soriano-Gabarró M., Mrukowicz J., Vesikari T., Verstraeten T. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J. 2006; 25(1 Suppl): S7-s11. doi:10.1097/01.inf.0000197622.98559.01
- Note de bas de page 18
-
Standaert B., Van De Mieroop E., Nelen V. Exploring the potential impact of rotavirus vaccination on work absenteeism among female administrative personnel of the City of Antwerp through a retrospective database analysis. BMJ Open. 2015; 5(6): 1-9. doi:10.1136/bmjopen-2014-007453
- Note de bas de page 19
-
Kim D.D., Neumann P.J. Analyzing the Cost Effectiveness of Policy Responses for COVID-19: The Importance of Capturing Social Consequences. Med Decis Making. 2020; 40(3): 251-3. doi:10.1177/0272989x20922987
- Note de bas de page 20
-
Folegatti P.M., Ewer K.J., Aley P.K., Angus B., Becker S., Belij-Rammerstorfer S., et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2020; 396(10249): 467-78. doi:10.1016/s0140-6736(20)31604-4
- Note de bas de page 21
-
Zhu F.-C., Guan X.-H., Li Y.-H., Huang J.-Y., Jiang T., Hou L.-H., et al. Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet. 2020; 396(10249): 479-88. doi:10.1016/S0140-6736(20)31605-6
- Note de bas de page 22
-
Sanders G.D., Neumann P.J., Basu A., Brock D.W., Feeny D., Krahn M., et al. Recommendations for Conduct, Methodological Practices, and Reporting of Cost-effectiveness Analyses: Second Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. Jama. 2016; 316(10): 1093-103. doi:10.1001/jama.2016.12195
- Note de bas de page 23
-
Bärnighausen T., Bloom D.E., Canning D., O'Brien J. Accounting for the full benefits of childhood vaccination in South Africa. S Afr Med J. 2008; 98(11): 842, 4-6.
- Note de bas de page 24
-
Bloom B.S., Bruno D.J., Maman D.Y., Jayadevappa R. Usefulness of US cost-of-illness studies in healthcare decision making. Pharmacoeconomics. 2001; 19(2): 207-13. doi:10.2165/00019053-200119020-00007
- Note de bas de page 25
-
Jit M., Hutubessy R., Png M.E., Sundaram N., Audimulam J., Salim S., et al. The broader economic impact of vaccination: reviewing and appraising the strength of evidence. BMC Med. 2015; 13: 209. doi:10.1186/s12916-015-0446-9
- Note de bas de page 26
-
Kim S.Y., Goldie S.J. Cost-effectiveness analyses of vaccination programmes : a focused review of modelling approaches. Pharmacoeconomics. 2008; 26(3): 191-215. doi:10.2165/00019053-200826030-00004
- Note de bas de page 27
-
Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Measles (Rubeola). 2020. Available from: https://www.cdc.gov/measles/hcp/index.html.
- Note de bas de page 28
-
Pitman R., Fisman D., Zaric G.S., Postma M., Kretzschmar M., Edmunds J., et al. Dynamic transmission modeling: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--5. Value Health. 2012; 15(6): 828-34. doi:10.1016/j.jval.2012.06.011
- Note de bas de page 29
-
Ultsch B., Damm O., Beutels P., Bilcke J., Brüggenjürgen B., Gerber-Grote A., et al. Methods for Health Economic Evaluation of Vaccines and Immunization Decision Frameworks: A Consensus Framework from a European Vaccine Economics Community. Pharmacoeconomics. 2016; 34(3): 227-44. doi:10.1007/s40273-015-0335-2
- Note de bas de page 30
-
Mauskopf J., Talbird S., Standaert B. Categorization of methods used in cost-effectiveness analyses of vaccination programs based on outcomes from dynamic transmission models. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2012; 12(3): 357-71. doi:10.1586/erp.12.11
- Note de bas de page 31
-
Bilcke J., Marais C., Ogunjimi B., Willem L., Hens N., Beutels P. Cost-effectiveness of vaccination against herpes zoster in adults aged over 60 years in Belgium. Vaccine. 2012; 30(3): 675-84. doi:10.1016/j.vaccine.2011.10.036
- Note de bas de page 32
-
Zechmeister I., Blasio B.F., Garnett G., Neilson A.R., Siebert U. Cost-effectiveness analysis of human papillomavirus-vaccination programs to prevent cervical cancer in Austria. Vaccine. 2009; 27(37): 5133-41. doi:10.1016/j.vaccine.2009.06.039
- Note de bas de page 33
-
Attema A.E., Brouwer W.B.F., Claxton K. Discounting in Economic Evaluations. Pharmacoeconomics. 2018; 36(7): 745-58. doi:10.1007/s40273-018-0672-z
- Note de bas de page 34
-
Jit M., Mibei W. Discounting in the evaluation of the cost-effectiveness of a vaccination programme: A critical review. Vaccine. 2015; 33(32): 3788-94. doi:10.1016/j.vaccine.2015.06.084
- Note de bas de page 35
-
Westra T.A., Parouty M., Brouwer W.B., Beutels P.H., Rogoza R.M., Rozenbaum M.H., et al. On discounting of health gains from human papillomavirus vaccination: effects of different approaches. Value Health. 2012; 15(3): 562-7. doi:10.1016/j.jval.2012.01.005
- Note de bas de page 36
-
OECD. Economic Valuation of Environmental Health Risks to Children: OECD Publishing; 2006.
- Note de bas de page 37
-
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Discounting of health benefits in special circumstances. 2011.
- Note de bas de page 38
-
STIKO. Modelling methods for predicting epidemiological and health economic effects of vaccinations - guidance for analyses to be presented to the German Standing Committee on Vaccination (STIKO). 2016.
- Note de bas de page 39
-
Weinstein M.C., Stason W.B. Foundations of cost-effectiveness analysis for health and medical practices. N Engl J Med. 1977; 296(13): 716-21. doi:10.1056/nejm197703312961304
- Note de bas de page 40
-
Gravelle H., Smith D. Discounting for health effects in cost-benefit and cost-effectiveness analysis. Health Econ. 2001; 10(7): 587-99. doi:10.1002/hec.618
- Note de bas de page 41
-
O'Mahony J.F., de Kok I.M., van Rosmalen J., Habbema J.D., Brouwer W., van Ballegooijen M. Practical implications of differential discounting in cost-effectiveness analyses with varying numbers of cohorts. Value Health. 2011; 14(4): 438-42. doi:10.1016/j.jval.2010.09.009
- Note de bas de page 42
-
O’Mahoney J.F., Postma M.J., Boersma C., Van Rosmalen J., Jit M., editors. Correcting for Multiple Future Cohorts When Applying Differential Discounting of Costs and Health Effects. Society for Medical Decision Making 14th Bienniel European Meeting; 2012.
- Note de bas de page 43
-
Brennan A., Chick S.E., Davies R. A taxonomy of model structures for economic evaluation of health technologies. Health Econ. 2006; 15(12): 1295-310. doi:10.1002/hec.1148
- Note de bas de page 44
-
Stahl J.E. Modelling methods for pharmacoeconomics and health technology assessment: an overview and guide. Pharmacoeconomics. 2008; 26(2): 131-48. doi:10.2165/00019053-200826020-00004
- Note de bas de page 45
-
Mac S., Mishra S., Ximenes R., Barrett K., Khan Y.A., Naimark D.M.J., et al. Modeling the coronavirus disease 2019 pandemic: A comprehensive guide of infectious disease and decision-analytic models. J Clin Epidemiol. 2021; 132: 133-41. doi:10.1016/j.jclinepi.2020.12.002
- Note de bas de page 46
-
Brisson M., Edmunds W.J. Impact of model, methodological, and parameter uncertainty in the economic analysis of vaccination programs. Med Decis Making. 2006; 26(5): 434-46. doi:10.1177/0272989x06290485
- Note de bas de page 47
-
Jit M., Brisson M. Modelling the epidemiology of infectious diseases for decision analysis: a primer. Pharmacoeconomics. 2011; 29(5): 371-86. doi:10.2165/11539960-000000000-00000
- Note de bas de page 48
-
Lipsitch M. Bacterial vaccines and serotype replacement: lessons from Haemophilus influenzae and prospects for Streptococcus pneumoniae. Emerg Infect Dis. 1999; 5(3): 336-45. doi:10.3201/eid0503.990304
- Note de bas de page 49
-
Weinberger D.M., Malley R., Lipsitch M. Serotype replacement in disease after pneumococcal vaccination. Lancet (London, England). 2011; 378(9807): 1962-73. doi:10.1016/S0140-6736(10)62225-8
- Note de bas de page 50
-
Berge J.J., Drennan D.P., Jacobs R.J., Jakins A., Meyerhoff A.S., Stubblefield W., et al. The cost of hepatitis A infections in American adolescents and adults in 1997. Hepatology. 2000; 31(2): 469-73. doi:10.1002/hep.510310229
- Note de bas de page 51
-
Edmunds W.J., Brisson M. The effect of vaccination on the epidemiology of varicella zoster virus. J Infect. 2002; 44(4): 211-9. doi:10.1053/jinf.2002.0988
- Note de bas de page 52
-
Chhatwal J., He T. Economic evaluations with agent-based modelling: an introduction. Pharmacoeconomics. 2015; 33(5): 423-33. doi:10.1007/s40273-015-0254-2
- Note de bas de page 53
-
Marshall D.A., Burgos-Liz L., MJ I.J., Crown W., Padula W.V., Wong P.K., et al. Selecting a dynamic simulation modeling method for health care delivery research-part 2: report of the ISPOR Dynamic Simulation Modeling Emerging Good Practices Task Force. Value Health. 2015; 18(2): 147-60. doi:10.1016/j.jval.2015.01.006
- Note de bas de page 54
-
Grefenstette J.J., Brown S.T., Rosenfeld R., DePasse J., Stone N.T.B., Cooley P.C., et al. FRED (A Framework for Reconstructing Epidemic Dynamics): an open-source software system for modeling infectious diseases and control strategies using census-based populations. BMC Public Health. 2013; 13(1): 940. doi:10.1186/1471-2458-13-940
- Note de bas de page 55
-
Wolff E., Storsaeter J., Örtqvist Å., Naucler P., Larsson S., Lepp T., et al. Cost-effectiveness of pneumococcal vaccination for elderly in Sweden. Vaccine. 2020; 38(32): 4988-95. doi:10.1016/j.vaccine.2020.05.072
- Note de bas de page 56
-
Ethgen O., Standaert B. Population- versus cohort-based modelling approaches. Pharmacoeconomics. 2012; 30(3): 171-81. doi:10.2165/11593050-000000000-00000
- Note de bas de page 57
-
Mauskopf J. Meeting the NICE requirements: a Markov model approach. Value Health. 2000; 3(4): 287-93. doi:10.1046/j.1524-4733.2000.34006.x
- Note de bas de page 58
-
Vanni T., Karnon J., Madan J., White R.G., Edmunds W.J., Foss A.M., et al. Calibrating models in economic evaluation: a seven-step approach. Pharmacoeconomics. 2011; 29(1): 35-49. doi:10.2165/11584600-000000000-00000
- Note de bas de page 59
-
Van de Velde N., Boily M.C., Drolet M., Franco E.L., Mayrand M.H., Kliewer E.V., et al. Population-level impact of the bivalent, quadrivalent, and nonavalent human papillomavirus vaccines: a model-based analysis. J Natl Cancer Inst. 2012; 104(22): 1712-23. doi:10.1093/jnci/djs395
- Note de bas de page 60
-
Zang X., Krebs E., Min J.E., Pandya A., Marshall B.D.L., Schackman B.R., et al. Development and Calibration of a Dynamic HIV Transmission Model for 6 US Cities. Med Decis Making. 2020; 40(1): 3-16. doi:10.1177/0272989x19889356
- Note de bas de page 61
-
Taylor D.C., Pawar V., Kruzikas D.T., Gilmore K.E., Sanon M., Weinstein M.C. Incorporating calibrated model parameters into sensitivity analyses: deterministic and probabilistic approaches. Pharmacoeconomics. 2012; 30(2): 119-26. doi:10.2165/11593360-000000000-00000
- Note de bas de page 62
-
Eddy D.M., Hollingworth W., Caro J.J., Tsevat J., McDonald K.M., Wong J.B. Model transparency and validation: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--7. Value Health. 2012; 15(6): 843-50. doi:10.1016/j.jval.2012.04.012
- Note de bas de page 63
-
Van de Velde N., Brisson M., Boily M.C. Modeling human papillomavirus vaccine effectiveness: quantifying the impact of parameter uncertainty. Am J Epidemiol. 2007; 165(7): 762-75. doi:10.1093/aje/kwk059
- Note de bas de page 64
-
Ghabri S., Stevenson M., Möller J., Caro J.J. Trusting the Results of Model-Based Economic Analyses: Is there a Pragmatic Validation Solution? Pharmacoeconomics. 2019; 37(1): 1-6. doi:10.1007/s40273-018-0711-9
- Note de bas de page 65
-
Government of Canada. Recommended immunization schedules: Canadian Immunization Guide. 2020. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-1-key-immunization-information/page-13-recommended-immunization-schedules.html.
- Note de bas de page 66
-
Fine P., Eames K., Heymann D.L. "Herd immunity": a rough guide. Clin Infect Dis. 2011; 52(7): 911-6. doi:10.1093/cid/cir007
- Note de bas de page 67
-
Czerkinsky C., Holmgren J. Vaccines against enteric infections for the developing world. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015; 370(1671). doi:10.1098/rstb.2015.0142
- Note de bas de page 68
-
Gjini E. Geographic variation in pneumococcal vaccine efficacy estimated from dynamic modeling of epidemiological data post-PCV7. Sci Rep. 2017; 7(1): 3049. doi:10.1038/s41598-017-02955-y
- Note de bas de page 69
-
Plotkin S.A. Complex correlates of protection after vaccination. Clin Infect Dis. 2013; 56(10): 1458-65. doi:10.1093/cid/cit048
- Note de bas de page 70
-
Government of Canada. Vaccine Coverage in Canadian Children: Results from the 2017 Childhood National Immunization Coverage Survey (cNICS). 2020.
- Note de bas de page 71
-
Krebs E., Nosyk B. Cost-Effectiveness Analysis in Implementation Science: a Research Agenda and Call for Wider Application. Curr HIV/AIDS Rep. 2021; 18(3): 176-85. doi:10.1007/s11904-021-00550-5
- Note de bas de page 72
-
Andrews N.J., Waight P.A., Burbidge P., Pearce E., Roalfe L., Zancolli M., et al. Serotype-specific effectiveness and correlates of protection for the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine: a postlicensure indirect cohort study. Lancet Infect Dis. 2014; 14(9): 839-46. doi:10.1016/s1473-3099(14)70822-9
- Note de bas de page 73
-
Daniels C.C., Rogers P.D., Shelton C.M. A Review of Pneumococcal Vaccines: Current Polysaccharide Vaccine Recommendations and Future Protein Antigens. J Pediatr Pharmacol Ther. 2016; 21(1): 27-35. doi:10.5863/1551-6776-21.1.27
- Note de bas de page 74
-
Malagón T., Drolet M., Boily M.C., Franco E.L., Jit M., Brisson J., et al. Cross-protective efficacy of two human papillomavirus vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2012; 12(10): 781-9. doi:10.1016/s1473-3099(12)70187-1
- Note de bas de page 75
-
Plotkin S.A. Updates on immunologic correlates of vaccine-induced protection. Vaccine. 2020; 38(9): 2250-7. doi:10.1016/j.vaccine.2019.10.046
- Note de bas de page 76
-
World Health Organization (WHO). Guidelines on clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations. 2017.
- Note de bas de page 77
-
Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Immunogenicity, Efficacy, and Effectiveness of Influenza Vaccines. 2019. Available from: https://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/immunogenicity.htm.
- Note de bas de page 78
-
Plotkin S.A., Gilbert P.B. Nomenclature for immune correlates of protection after vaccination. Clin Infect Dis. 2012; 54(11): 1615-7. doi:10.1093/cid/cis238
- Note de bas de page 79
-
World Health Organization (WHO). Correlates of vaccine-induced protection: methods and implications. 2013.
- Note de bas de page 80
-
Cowling B.J., Lim W.W., Perera R., Fang V.J., Leung G.M., Peiris J.S.M., et al. Influenza Hemagglutination-inhibition Antibody Titer as a Mediator of Vaccine-induced Protection for Influenza B. Clin Infect Dis. 2019; 68(10): 1713-17. doi:10.1093/cid/ciy759
- Note de bas de page 81
-
Gilbert P.B., Luedtke A.R. Statistical Learning Methods to Determine Immune Correlates of Herpes Zoster in Vaccine Efficacy Trials. J Infect Dis. 2018; 218(suppl_2): S99-s101. doi:10.1093/infdis/jiy421
- Note de bas de page 82
-
Belshe R.B., Gruber W.C., Mendelman P.M., Mehta H.B., Mahmood K., Reisinger K., et al. Correlates of immune protection induced by live, attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenza virus vaccine. J Infect Dis. 2000; 181(3): 1133-7. doi:10.1086/315323
- Note de bas de page 83
-
Bentebibel S.E., Lopez S., Obermoser G., Schmitt N., Mueller C., Harrod C., et al. Induction of ICOS+CXCR3+CXCR5+ TH cells correlates with antibody responses to influenza vaccination. Sci Transl Med. 2013; 5(176): 176ra32. doi:10.1126/scitranslmed.3005191
- Note de bas de page 84
-
Cooper L.V., Boukary R.M., Aseffa A., Mihret W., Collard J.M., Daugla D., et al. Investigation of correlates of protection against pharyngeal carriage of Neisseria meningitidis genogroups W and Y in the African meningitis belt. PLoS One. 2017; 12(8): e0182575. doi:10.1371/journal.pone.0182575
- Note de bas de page 85
-
Plotkin S.A. Correlates of protection induced by vaccination. Clin Vaccine Immunol. 2010; 17(7): 1055-65. doi:10.1128/cvi.00131-10
- Note de bas de page 86
-
Bilcke J., Ogunjimi B., Hulstaert F., Van Damme P., Hens N., Beutels P. Estimating the age-specific duration of herpes zoster vaccine protection: a matter of model choice? Vaccine. 2012; 30(17): 2795-800. doi:10.1016/j.vaccine.2011.09.079
- Note de bas de page 87
-
Li X., Zhang J.H., Betts R.F., Morrison V.A., Xu R., Itzler R.F., et al. Modeling the durability of ZOSTAVAX® vaccine efficacy in people ≥60 years of age. Vaccine. 2015; 33(12): 1499-505. doi:10.1016/j.vaccine.2014.10.039
- Note de bas de page 88
-
Zoratti M.J., Pickard A.S., Stalmeier P.F.M., Ollendorf D., Lloyd A., Chan K.K.W., et al. Evaluating the conduct and application of health utility studies: a review of critical appraisal tools and reporting checklists. Eur J Health Econ. 2021; 22(5): 723-33. doi:10.1007/s10198-021-01286-0
- Note de bas de page 89
-
Brazier J., Ara R., Azzabi I., Busschbach J., Chevrou-Séverac H., Crawford B., et al. Identification, Review, and Use of Health State Utilities in Cost-Effectiveness Models: An ISPOR Good Practices for Outcomes Research Task Force Report. Value Health. 2019; 22(3): 267-75. doi:10.1016/j.jval.2019.01.004
- Note de bas de page 90
-
Peasgood T., Brazier J. Is Meta-Analysis for Utility Values Appropriate Given the Potential Impact Different Elicitation Methods Have on Values? PharmacoEconomics. 2015; 33(11): 1101-5. doi:10.1007/s40273-015-0310-y
- Note de bas de page 91
-
Ungar W.J. Challenges in Health State Valuation in Paediatric Economic Evaluation. PharmacoEconomics. 2011; 29(8): 641-52. doi:10.2165/11591570-000000000-00000
- Note de bas de page 92
-
Oliveira C., de Silva N.T., Ungar W.J., Bayoumi A.M., Avitzur Y., Hoch J.S., et al. Health-related quality of life in neonates and infants: a conceptual framework. Quality of Life Research. 2020; 29(5): 1159-68. doi:10.1007/s11136-020-02432-6
- Note de bas de page 93
-
Ungar W.J., editor. Economic evaluation in child health: Oxford University Press; 2019.
- Note de bas de page 94
-
Cookson R., Skarda I., Cotton-Barratt O., Adler M., Asaria M., Ord T. Quality adjusted life years based on health and consumption: A summary wellbeing measure for cross-sectoral economic evaluation. Health Econ. 2021; 30(1): 70-85. doi:10.1002/hec.4177
- Note de bas de page 95
-
de Vries L.M., van Baal P.H.M., Brouwer W.B.F. Future Costs in Cost-Effectiveness Analyses: Past, Present, Future. Pharmacoeconomics. 2019; 37(2): 119-30. doi:10.1007/s40273-018-0749-8
- Note de bas de page 96
-
Feeny D., Krahn M., Prosser L.A., Salomon J.A. Valuing Health Outcomes. Cost-Effectiveness in Health and Medicine. 2 ed. New York: Oxford University Press; 2016.
- Note de bas de page 97
-
Nyman J.A. Should the consumption of survivors be included as a cost in cost-utility analysis? Health Econ. 2004; 13(5): 417-27. doi:10.1002/hec.850
- Note de bas de page 98
-
Shiroiwa T., Fukuda T., Ikeda S., Shimozuma K. QALY and productivity loss: empirical evidence for "double counting". Value Health. 2013; 16(4): 581-7. doi:10.1016/j.jval.2013.02.009
- Note de bas de page 99
-
Tilling C., Krol M., Tsuchiya A., Brazier J., Brouwer W. In or out? Income losses in health state valuations: a review. Value Health. 2010; 13(2): 298-305. doi:10.1111/j.1524-4733.2009.00614.x
- Note de bas de page 100
-
Adarkwah C.C., Sadoghi A., Gandjour A. Should Cost-Effectiveness Analysis Include the Cost of Consumption Activities? AN Empirical Investigation. Health Econ. 2016; 25(2): 249-56. doi:10.1002/hec.3162
- Note de bas de page 101
-
Basu A. Estimating Costs and Valuations of Non-Health Benefits in Cost-Effectiveness Analysis. Cost-Effectiveness in Health and Medicine. 2 ed. New York: Oxford University Press; 2016.
- Note de bas de page 102
-
Salomon J.A., Trikalinos T.A., Sanders G.D., Mandelblatt J.S. Identifying and Quantifying the Consequences of Interventions. Cost-Effectiveness in Health and Medicine. 2 ed. New York: Oxford University Press; 2016.
- Note de bas de page 103
-
Jacobs P., Budden A., Lee K.M. Guidance document fo rthe costing of health care resources in the Canadian setting. 2nd edition. 2016.
- Note de bas de page 104
-
Feenstra T.L., van Baal P.H., Gandjour A., Brouwer W.B. Future costs in economic evaluation. A comment on Lee. J Health Econ. 2008; 27(6): 1645-9; discussion 50-1. doi:10.1016/j.jhealeco.2008.07.007
- Note de bas de page 105
-
Morton A., Adler A.I., Bell D., Briggs A., Brouwer W., Claxton K., et al. Unrelated Future Costs and Unrelated Future Benefits: Reflections on NICE Guide to the Methods of Technology Appraisal. Health Econ. 2016; 25(8): 933-8. doi:10.1002/hec.3366
- Note de bas de page 106
-
Meltzer D. Accounting for future costs in medical cost-effectiveness analysis. J Health Econ. 1997; 16(1): 33-64. doi:10.1016/s0167-6296(96)00507-3
- Note de bas de page 107
-
Manns B., Meltzer D., Taub K., Donaldson C. Illustrating the impact of including future costs in economic evaluations: an application to end-stage renal disease care. Health Econ. 2003; 12(11): 949-58. doi:10.1002/hec.790
- Note de bas de page 108
-
Canadian Institutes for Health Information (CIHI). National Health Expenditure Trends. 2021. Available from: https://www.cihi.ca/en/national-health-expenditure-trends.
- Note de bas de page 109
-
Levy A.R., Sobolev B., James D., Barrable W., Clarke-Richardson P., Sullivan S.D., et al. The costs of change: direct medical costs of solid organ transplantation in British Columbia, Canada, 1995-2003. Value Health. 2009; 12(2): 282-92. doi:10.1111/j.1524-4733.2008.00445.x
- Note de bas de page 110
-
Manns B.J., Mendelssohn D.C., Taub K.J. The economics of end-stage renal disease care in Canada: incentives and impact on delivery of care. Int J Health Care Finance Econ. 2007; 7(2-3): 149-69. doi:10.1007/s10754-007-9022-y
- Note de bas de page 111
-
Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Evaluating Surveillance Systems. 1988. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001769.htm.
- Note de bas de page 112
-
Coleman M.S., Garbat-Welch L., Burke H., Weinberg M., Humbaugh K., Tindall A., et al. Direct costs of a single case of refugee-imported measles in Kentucky. Vaccine. 2012; 30(2): 317-21. doi:10.1016/j.vaccine.2011.10.091
- Note de bas de page 113
-
Dalton C.B., Haddix A., Hoffman R.E., Mast E.E. The cost of a food-borne outbreak of hepatitis A in Denver, Colo. Arch Intern Med. 1996; 156(9): 1013-6.
- Note de bas de page 114
-
Dayan G.H., Ortega-Sánchez I.R., LeBaron C.W., Quinlisk M.P. The cost of containing one case of measles: the economic impact on the public health infrastructure--Iowa, 2004. Pediatrics. 2005; 116(1): e1-4. doi:10.1542/peds.2004-2512
- Note de bas de page 115
-
Parker A.A., Staggs W., Dayan G.H., Ortega-Sánchez I.R., Rota P.A., Lowe L., et al. Implications of a 2005 measles outbreak in Indiana for sustained elimination of measles in the United States. N Engl J Med. 2006; 355(5): 447-55. doi:10.1056/NEJMoa060775
- Note de bas de page 116
-
Institut national de sante publique du Quebec. Publications. n.d. Available from: https://www.inspq.qc.ca/en/publications/.
- Note de bas de page 117
-
Musto R., Siever J.E., Johnston J.C., Seidel J., Rose M.S., McNeil D.A. Social equity in Human Papillomavirus vaccination: a natural experiment in Calgary Canada. BMC Public Health. 2013; 13: 640. doi:10.1186/1471-2458-13-640
- Note de bas de page 118
-
Workplace Safety and Insurance Board. Operational policy manual: travel and related expenses. 2017.
- Note de bas de page 119
-
Doherty M., Buchy P., Standaert B., Giaquinto C., Prado-Cohrs D. Vaccine impact: Benefits for human health. Vaccine. 2016; 34(52): 6707-14. doi:10.1016/j.vaccine.2016.10.025
- Note de bas de page 120
-
Koopmanschap M.A., Rutten F.F., van Ineveld B.M., van Roijen L. The friction cost method for measuring indirect costs of disease. J Health Econ. 1995; 14(2): 171-89. doi:10.1016/0167-6296(94)00044-5
- Note de bas de page 121
-
Krol M., Brouwer W. How to estimate productivity costs in economic evaluations. Pharmacoeconomics. 2014; 32(4): 335-44. doi:10.1007/s40273-014-0132-3
- Note de bas de page 122
-
Pike J., Grosse S.D. Friction Cost Estimates of Productivity Costs in Cost-of-Illness Studies in Comparison with Human Capital Estimates: A Review. Appl Health Econ Health Policy. 2018; 16(6): 765-78. doi:10.1007/s40258-018-0416-4
- Note de bas de page 123
-
Goeree R., O'Brien B.J., Blackhouse G., Agro K., Goering P. The valuation of productivity costs due to premature mortality: a comparison of the human-capital and friction-cost methods for schizophrenia. Can J Psychiatry. 1999; 44(5): 455-63. doi:10.1177/070674379904400505
- Note de bas de page 124
-
Hank K., Stuck S. Volunteer work, informal help, and care among the 50+ in Europe: further evidence for 'linked' productive activities at older ages. Soc Sci Res. 2008; 37(4): 1280-91. doi:10.1016/j.ssresearch.2008.03.001
- Note de bas de page 125
-
Bouwmans C., Krol M., Severens H., Koopmanschap M., Brouwer W., Hakkaart-van Roijen L. The iMTA Productivity Cost Questionnaire: A Standardized Instrument for Measuring and Valuing Health-Related Productivity Losses. Value Health. 2015; 18(6): 753-8. doi:10.1016/j.jval.2015.05.009
- Note de bas de page 126
-
Pearce A. Productivity losses and how they are calculated. In: (CHERE) C.f.H.E.R.a.E., editor. 2016.
- Note de bas de page 127
-
Statistics Canada. Average usual and actual hours worked in a reference week by type of work (full- and part-time), annual. 2021. Available from: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410004301.
- Note de bas de page 128
-
Statistics Canada. Income of individuals by age group, sex and income source, Canada, provinces and selected census metropolitan areas. 2021. Available from: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1110023901.
- Note de bas de page 129
-
Prosser L.A. SMDM President’s Column: Gender bias and cost-effectiveness analysis. 2020. Available from: https://myemail.constantcontact.com/SMDM-Newsletter---Issue-4--September-2020.html?soid=1116971938232&aid=ywAYbDuCkUY.
- Note de bas de page 130
-
Zhang W., Bansback N., Boonen A., Severens J.L., Anis A.H. Development of a composite questionnaire, the valuation of lost productivity, to value productivity losses: application in rheumatoid arthritis. Value Health. 2012; 15(1): 46-54. doi:10.1016/j.jval.2011.07.009
- Note de bas de page 131
-
Grosse S.D., Pike J., Soelaeman R., Tilford J.M. Quantifying Family Spillover Effects in Economic Evaluations: Measurement and Valuation of Informal Care Time. Pharmacoeconomics. 2019; 37(4): 461-73. doi:10.1007/s40273-019-00782-9
- Note de bas de page 132
-
Hoefman R.J., van Exel J., Brouwer W. How to include informal care in economic evaluations. Pharmacoeconomics. 2013; 31(12): 1105-19. doi:10.1007/s40273-013-0104-z
- Note de bas de page 133
-
McKibbin W.J., Fernando R. Global macroeconomic scenarios of the COVID-19 pandemic. CAMA Working Papers. 2020.
- Note de bas de page 134
-
Statistics Canada. Household spending, Canada, regions and provinces. 2021. Available from: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1110022201.
- Note de bas de page 135
-
Statistics Canada. Unit of analysis: the household. 2020. Available from: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-607-x/2016001/952-eng.htm.
- Note de bas de page 136
-
Roed C., Omland L.H., Skinhoj P., Rothman K.J., Sorensen H.T., Obel N. Educational achievement and economic self-sufficiency in adults after childhood bacterial meningitis. Jama. 2013; 309(16): 1714-21. doi:10.1001/jama.2013.3792
- Note de bas de page 137
-
Federal Reserve Bank of Cleveland. Educational attainment and employment. 2011. Available from: https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/publications/economic-trends/2011-economic-trends/et-20110302-educational-attainment-and-employment.aspx.
- Note de bas de page 138
-
US Bureau of Labor Statistics. Earnings and unemployment rates by educational attainment, 2020. 2021.
- Note de bas de page 139
-
Gallagher-Mackay K., Srivastava P., Underwood K., Dhuey E., McCready L., Born K.B., et al. COVID-19 and education disruption in Ontario: emerging evidence on impacts. 2021.
- Note de bas de page 140
-
Grimwood K., Anderson V.A., Bond L., Catroppa C., Hore R.L., Keir E.H., et al. Adverse outcomes of bacterial meningitis in school-age survivors. Pediatrics. 1995; 95(5): 646-56.
- Note de bas de page 141
-
Klein E.Y., Schueller E., Tseng K.K., Morgan D.J., Laxminarayan R., Nandi A. The Impact of Influenza Vaccination on Antibiotic Use in the United States, 2010-2017. Open Forum Infect Dis. 2020; 7(7): ofaa223. doi:10.1093/ofid/ofaa223
- Note de bas de page 142
-
Klugman K.P., Black S. Impact of existing vaccines in reducing antibiotic resistance: Primary and secondary effects. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018; 115(51): 12896-901. doi:10.1073/pnas.1721095115
- Note de bas de page 143
-
Pruden A., Larsson D.G.J., Amézquita A., Collignon P., Brandt K.K., Graham D.W., et al. Management options for reducing the release of antibiotics and antibiotic resistance genes to the environment. Environ Health Perspect. 2013; 121(8): 878-85. doi:10.1289/ehp.1206446
- Note de bas de page 144
-
Bilcke J., Beutels P., Brisson M., Jit M. Accounting for methodological, structural, and parameter uncertainty in decision-analytic models: a practical guide. Med Decis Making. 2011; 31(4): 675-92. doi:10.1177/0272989x11409240
- Note de bas de page 145
-
Briggs A.H., Weinstein M.C., Fenwick E.A., Karnon J., Sculpher M.J., Paltiel A.D. Model parameter estimation and uncertainty: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--6. Value Health. 2012; 15(6): 835-42. doi:10.1016/j.jval.2012.04.014
- Note de bas de page 146
-
Mahsin M.D., Deardon R., Brown P. Geographically dependent individual-level models for infectious diseases transmission. Biostatistics. 2020. doi:10.1093/biostatistics/kxaa009
- Note de bas de page 147
-
Popinga A., Vaughan T., Stadler T., Drummond A.J. Inferring epidemiological dynamics with Bayesian coalescent inference: the merits of deterministic and stochastic models. Genetics. 2015; 199(2): 595-607. doi:10.1534/genetics.114.172791
- Note de bas de page 148
-
Vreman R.A., Geenen J.W., Knies S., Mantel-Teeuwisse A.K., Leufkens H.G.M., Goettsch W.G. The Application and Implications of Novel Deterministic Sensitivity Analysis Methods. Pharmacoeconomics. 2021; 39(1): 1-17. doi:10.1007/s40273-020-00979-3
- Note de bas de page 149
-
Sickbert-Bennett E.E., Weber D.J., Poole C., MacDonald P.D., Maillard J.M. Completeness of communicable disease reporting, North Carolina, USA, 1995-1997 and 2000-2006. Emerg Infect Dis. 2011; 17(1): 23-9. doi:10.3201/eid1701.100660
- Note de bas de page 150
-
Mattoo S., Cherry J.D. Molecular pathogenesis, epidemiology, and clinical manifestations of respiratory infections due to Bordetella pertussis and other Bordetella subspecies. Clin Microbiol Rev. 2005; 18(2): 326-82. doi:10.1128/cmr.18.2.326-382.2005
- Note de bas de page 151
-
Lipsitch M., Jha A., Simonsen L. Observational studies and the difficult quest for causality: lessons from vaccine effectiveness and impact studies. Int J Epidemiol. 2016; 45(6): 2060-74. doi:10.1093/ije/dyw124
- Note de bas de page 152
-
Berger M.L., Sox H., Willke R.J., Brixner D.L., Eichler H.G., Goettsch W., et al. Good practices for real-world data studies of treatment and/or comparative effectiveness: Recommendations from the joint ISPOR-ISPE Special Task Force on real-world evidence in health care decision making. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017; 26(9): 1033-9. doi:10.1002/pds.4297
- Note de bas de page 153
-
Sterne J.A., Hernán M.A., Reeves B.C., Savović J., Berkman N.D., Viswanathan M., et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016; 355: i4919. doi:10.1136/bmj.i4919
- Note de bas de page 154
-
Del Valle S.Y., Hyman J.M., Chitnis N. Mathematical models of contact patterns between age groups for predicting the spread of infectious diseases. Math Biosci Eng. 2013; 10(5-6): 1475-97. doi:10.3934/mbe.2013.10.1475
- Note de bas de page 155
-
Funk S., Bansal S., Bauch C.T., Eames K.T., Edmunds W.J., Galvani A.P., et al. Nine challenges in incorporating the dynamics of behaviour in infectious diseases models. Epidemics. 2015; 10: 21-5. doi:10.1016/j.epidem.2014.09.005
- Note de bas de page 156
-
Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Hepatitis A Questions and Answers for Health Professionals. 2020. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/havfaq.htm.
- Note de bas de page 157
-
Gravitt P.E. The known unknowns of HPV natural history. J Clin Invest. 2011; 121(12): 4593-9. doi:10.1172/jci57149
- Note de bas de page 158
-
Campbell H., Andrews N., Borrow R., Trotter C., Miller E. Updated postlicensure surveillance of the meningococcal C conjugate vaccine in England and Wales: effectiveness, validation of serological correlates of protection, and modeling predictions of the duration of herd immunity. Clin Vaccine Immunol. 2010; 17(5): 840-7. doi:10.1128/cvi.00529-09
- Note de bas de page 159
-
Lewnard J.A., Grad Y.H. Vaccine waning and mumps re-emergence in the United States. Sci Transl Med. 2018; 10(433). doi:10.1126/scitranslmed.aao5945
- Note de bas de page 160
-
Centres for Disease Control and Prevention (CDC). About Meningococcal Vaccines. 2021. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/mening/hcp/about-vaccine.html.
- Note de bas de page 161
-
Bojke L., Claxton K., Sculpher M., Palmer S. Characterizing structural uncertainty in decision analytic models: a review and application of methods. Value Health. 2009; 12(5): 739-49. doi:10.1111/j.1524-4733.2008.00502.x
- Note de bas de page 162
-
Jackson C.H., Thompson S.G., Sharples L.D. Accounting for uncertainty in health economic decision models by using model averaging. J R Stat Soc Ser A Stat Soc. 2009; 172(2): 383-404. doi:10.1111/j.1467-985X.2008.00573.x
- Note de bas de page 163
-
Hofmann B. Toward a procedure for integrating moral issues in health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2005; 21(3): 312-8. doi:10.1017/s0266462305050415
- Note de bas de page 164
-
Krahn M.D., Bielecki J.M., Bremner K.E., de Oliveira C., Almeida N., Clement F., et al. Picturing ELSI+: a visual representation of ethical, legal, and social issues, and patient experiences in Health Technology Assessment in Canada. Int J Technol Assess Health Care. 2020; 36(1): 40-9. doi:10.1017/s0266462319000722
- Note de bas de page 165
-
Public Health Agency of Canada (PHAC). Framework for ethical deliberation and decision-making in public health: a tool for public health practitioners, policy makers and decision-makers. Ottawa, Canada2017.
- Note de bas de page 166
-
World Health Organization (WHO). Health equity. n.d. Available from: https://www.who.int/health-topics/health-equity#tab=tab_1.
- Note de bas de page 167
-
Rawlins M., Barnett D., Stevens A. Pharmacoeconomics: NICE's approach to decision-making. Br J Clin Pharmacol. 2010; 70(3): 346-9. doi:10.1111/j.1365-2125.2009.03589.x
- Note de bas de page 168
-
Cookson R., Griffin S., Norheim O.F., Culyer A.J. Distributional Cost-Effectiveness AnalysisQuantifying Health Equity Impacts and Trade-Offs: Quantifying Health Equity Impacts and Trade-Offs. Oxford, UK: Oxford University Press; 2020 2020-10.
- Note de bas de page 169
-
Johri M., Norheim O.F. Can cost-effectiveness analysis integrate concerns for equity? Systematic review. Int J Technol Assess Health Care. 2012; 28(2): 125-32. doi:10.1017/s0266462312000050
- Note de bas de page 170
-
Norheim O.F., Baltussen R., Johri M., Chisholm D., Nord E., Brock D., et al. Guidance on priority setting in health care (GPS-Health): the inclusion of equity criteria not captured by cost-effectiveness analysis. Cost Eff Resour Alloc. 2014; 12: 18. doi:10.1186/1478-7547-12-18
- Note de bas de page 171
-
Cookson R., Mirelman A.J., Griffin S., Asaria M., Dawkins B., Norheim O.F., et al. Using Cost-Effectiveness Analysis to Address Health Equity Concerns. Value Health. 2017; 20(2): 206-12. doi:10.1016/j.jval.2016.11.027
- Note de bas de page 172
-
Converge3. Equity, values, and health decisions in Ontario: a Converge3 methods report. 2019.
- Note de bas de page 173
-
O'Neill J., Tabish H., Welch V., Petticrew M., Pottie K., Clarke M., et al. Applying an equity lens to interventions: using PROGRESS ensures consideration of socially stratifying factors to illuminate inequities in health. J Clin Epidemiol. 2014; 67(1): 56-64. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.08.005
- Note de bas de page 174
-
Powers M., Powers A.P.P.M., Faden R.R., Faden R.R. Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy: Oxford University Press; 2006.
- Note de bas de page 175
-
Flannery B., Schrag S., Bennett N.M., Lynfield R., Harrison L.H., Reingold A., et al. Impact of childhood vaccination on racial disparities in invasive Streptococcus pneumoniae infections. Jama. 2004; 291(18): 2197-203. doi:10.1001/jama.291.18.2197
- Note de bas de page 176
-
Public Health Agency of Canada (PHAC). Key health inequalities in Canada: a national portrait. 2018.
- Note de bas de page 177
-
Castle P.E., Zhao F.-H. Population Effectiveness, Not Efficacy, Should Decide Who Gets Vaccinated Against Human Papillomavirus via Publicly Funded Programs. J Infect Dis. 2011; 204(3): 335-7. doi:10.1093/infdis/jir287
- Note de bas de page 178
-
Blakely T., Kvizhinadze G., Karvonen T., Pearson A.L., Smith M., Wilson N. Cost-effectiveness and equity impacts of three HPV vaccination programmes for school-aged girls in New Zealand. Vaccine. 2014; 32(22): 2645-56. doi:10.1016/j.vaccine.2014.02.071
- Note de bas de page 179
-
Culyer A.J. Equity of what in healthcare? Why the traditional answers don't help policy--and what to do in the future. Healthc Pap. 2007; 8 Spec No: 12-26. doi:10.12927/hcpap.2007.19216
- Note de bas de page 180
-
Menzies R.I., Singleton R.J. Vaccine preventable diseases and vaccination policy for indigenous populations. Pediatr Clin North Am. 2009; 56(6): 1263-83. doi:10.1016/j.pcl.2009.09.006
- Note de bas de page 181
-
Veras M., Zakus D. Equity Aspects of Canadian Immunization Programs: Differences within and between countries. 2011. 2011: 22. doi:10.5195/hcs.2011.45
- Note de bas de page 182
-
Brearley L., Eggers R., Steinglass R., Vandelaer J. Applying an equity lens in the Decade of Vaccines. Vaccine. 2013; 31 Suppl 2: B103-7. doi:10.1016/j.vaccine.2012.11.088
- Note de bas de page 183
-
Quilici S., Smith R., Signorelli C. Role of vaccination in economic growth. J Mark Access Health Policy. 2015; 3: 10.3402/jmahp.v3.27044. doi:10.3402/jmahp.v3.27044
- Note de bas de page 184
-
Avanceña A.L.V., Prosser L.A. Examining Equity Effects of Health Interventions in Cost-Effectiveness Analysis: A Systematic Review. Value Health. 2021; 24(1): 136-43. doi:10.1016/j.jval.2020.10.010
- Note de bas de page 185
-
Verguet S., Kim J.J., Jamison D.T. Extended Cost-Effectiveness Analysis for Health Policy Assessment: A Tutorial. Pharmacoeconomics. 2016; 34(9): 913-23. doi:10.1007/s40273-016-0414-z
- Note de bas de page 186
-
van Hoek A.J., Melegaro A., Gay N., Bilcke J., Edmunds W.J. The cost-effectiveness of varicella and combined varicella and herpes zoster vaccination programmes in the United Kingdom. Vaccine. 2012; 30(6): 1225-34. doi:10.1016/j.vaccine.2011.11.026
- Note de bas de page 187
-
Crosignani P., De Stefani A., Fara G.M., Isidori A.M., Lenzi A., Liverani C.A., et al. Towards the eradication of HPV infection through universal specific vaccination. BMC Public Health. 2013; 13: 642. doi:10.1186/1471-2458-13-642
- Note de bas de page 188
-
Tinghög G. Discounting, preferences, and paternalism in cost-effectiveness analysis. Health Care Anal. 2012; 20(3): 297-318. doi:10.1007/s10728-011-0188-6
- Note de bas de page 189
-
Husereau D., Drummond M., Petrou S., Carswell C., Moher D., Greenberg D., et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) statement. Eur J Health Econ. 2013; 14(3): 367-72. doi:10.1007/s10198-013-0471-6
- Note de bas de page 190
-
Government of Canada. National Advisory Committee on Immunization (NACI): membership and representation. 2021. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/naci-membership-representation.html.
- Note de bas de page 191
-
Government of Canada. National Advisory Committee on Immunization (NACI): methods and process. 2021. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/methods-process.html.