Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés : un guide
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport complet peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (58 Pages - 989 Ko)
Table des matières
- Vieillissement en santé des aînés des collectivités rurales et éloignées
- Élaboration du guide
- Le guide
- Utilisation du guide — un point de départ
Points saillants des discussions de groupes, par thème
- Les espaces extérieurs et les immeubles
- Le transport
- Le logement
- Le respect et l’inclusion sociale
- La participation sociale
- La communication et l’information
- La participation communautaire et les possibilités d’emploi
- Le soutien communautaire et les services de santé
Comment rendre une collectivité l'amie des aînés – prévoir un plan d'action
Liste de contrôle des caractéristiques d'une collectivité amie des aînés
Remerciements
Membres du Comité fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires responsables des aînés
Gouvernement de l’Alberta
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Gouvernement du Nunavut
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Gouvernement du Québec
Gouvernement de la Saskatchewan
Gouvernement du Yukon
Gouvernement du Canada
Membres du Groupe de travail sur le vieillissement en santé et le mieux-être
Colombie-Britannique
Canada
Manitoba
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Ce document a été préparé pour le Groupe de travail sur le vieillissement en santé et le mieux-être du Comité fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires responsables des aînés. Le Groupe tient à remercier les chercheurs – Mesdames Elaine Gallagher, Verena Menec, Janice Keefe et leurs équipes de recherche pour leur travail acharné. Nous aimerions tout particulièrement remercier les collectivités participantes, les personnes‑ressources de ces collectivités et les membres des groupes de consultation pour leur contribution inestimable, sans laquelle ce projet n’aurait pas pu être mené à terme. Nous souhaitons enfin remercier l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour sa méthodologie puisque l’initiative s’inspire du projet mondial de villes‑amies des aînés ainsi que la Division du vieillissement et des aînés de l’Agence de la santé publique du Canada pour les services de secrétariat et l’aide reçue pour la compilation du Guide.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position d’une juridiction particulière.
Introduction
En septembre 2006, les ministres FPT responsables des aînés approuvaient l’Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés (ICREAA). Cette initiative est assortie de deux objectifs principaux :
- accroître la sensibilisation par rapport à ce dont les aînés ont besoin pour maintenir une vie active, en santé et productive au sein de leur communauté en déterminant des indicateurs de collectivités rurales ou éloignées amies des aînés;
- produire un guide pratique que les collectivités rurales et éloignées du Canada pourront utiliser pour cerner les obstacles communs et promouvoir un dialogue et des mesures en faveur du développement de collectivités amies des aînés.
Dans une collectivité amie des aînés, les politiques, services, aménagements et structures assurent un soutien aux aînés et leur permettent de vieillir tout en demeurant actifs parce qu’ils tiennent compte de ce qui suit :
- reconnaissance de la vaste gamme de capacités et de ressources des aînés;
- anticipation des besoins et préférences des aînés et capacité d’y répondre avec souplesse;
- respect des décisions et des choix de style de vie des personnes âgées;
- protection des personnes âgées qui sont les plus vulnérables;
- promotion de l’inclusion et de la contribution des personnes âgées dans tous les domaines de la vie communautaireNote de bas de page 1.
L’idée de collectivités rurales ou éloignées amies des aînés s’inspire des travaux en cours de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les « villes du monde amies des aînés », lesquels s’inspirent à leur tour du modèle de vieillissement actifNote de bas de page 2. Ce projet mondial de villes‑amies des aînés a suscité beaucoup d’enthousiasme dès sa présentation en juin 2005, à l’occasion de la séance d’ouverture du XVIIIe Congrès mondial de gérontologie et de gériatrie, qui se déroulait à Rio de Janeiro, au Brésil. L’intérêt manifesté s’est transformé en actions; 33 villes dans plus de 22 pays ont participé au projet. L’ICREAA canadienne a été élaborée à partir du modèle et du cadre de recherche des villes du monde amies des aînésNote de bas de page 3. Le projet canadien met l’accent sur les collectivités rurales et éloignées. Cette initiative a remporté un franc succès à ce jour, avec la participation de dix collectivités provenant de huit juridictions.
Vieillissement en santé des aînés des collectivités rurales et éloignées
Compte tenu des coûts et avantages associés au vieillissement et de ses répercussions sur les collectivités et la société dans son ensemble, il est impératif d’investir dans le vieillissement en santé. Bien que la majorité des personnes âgées vivant chez elles se disent en bonne santé, les problèmes de santé à long terme tendent à augmenter avec l’âge – tel est le cas de la plupart des conditions chroniques, des incapacités et des démences. À titre d’exemple, des données de 2001 révèlent que les taux d’incapacité passent de 31 % chez les personnes âgées de 65 à 74 ans à 53 % chez celles de 75 ans et plusNote de bas de page 4. On prévoit qu’au cours des dix prochaines années, les Canadiens de plus de 65 ans seront plus nombreux que ceux de moins de 15 ans. En l’espace de 30 ans, alors que la génération du baby-boom va continuer de vieillir, la population de plus de 65 ans passera de 4,2 millions à 9,8 millionsNote de bas de page 5.
Le vieillissement de la population canadienne a des incidences significatives sur le système de santé. À l’heure actuelle, 44 % des dépenses totales en santé au Canada sont attribuées aux aînés qui représentent 13 % de la populationNote de bas de page 6.
Par ailleurs, les personnes âgées continuent à contribuer à la société de manière importante sur de nombreux fronts – famille (en apportant de l’aide à leurs époux, enfants et petits-enfants), amis et voisins, communauté (dans le cadre d’activités de bénévolat) et économie (à titre de travailleurs qualifiés et expérimentés).
Les études démontrent que la promotion de la santé et les stratégies de prévention de la maladie peuvent aider autant les personnes qui vieillissent bien que celles atteintes de conditions chroniques ou à risque de développer de graves problèmes de santé, et ce, même à un âge très avancé. Il est de plus en plus reconnu qu’en encourageant les collectivités à créer des environnements sociaux et physiques favorables aux aînés, les personnes âgées seront mieux soutenues dans leurs choix visant à améliorer leur santé et leur bien-être. Ainsi, elles pourront davantage participer à la vie communautaire et mettre à profit leurs compétences, leurs connaissances et leur expérienceNote de bas de page 7.
Bien qu’une majorité de Canadiens vivent en milieu urbain, une grande partie de la population âgée vit toujours en région rurale ou éloignée – ce qui explique pourquoi ce guide met l’accent sur les collectivités rurales et éloignées. On estime qu’approximativement 23 % des aînés au Canada vivent dans les zones rurales et les petites villesNote de bas de page 8. Il semblerait, en fait, que certaines régions du Canada rural aient connu une augmentation de la proportion de leurs aînés, compte tenu de l’arrivée de retraités qui quittent la ville pour s’installer à la campagne.
Les recherches actuelles sur les collectivités rurales et éloignées révèlent que celles-ci font face à des enjeux sociaux et environnementaux uniques, susceptibles d’avoir un impact sur la santé et le vieillissement en santé, qui diffèrent de ceux auxquels sont confrontées les populations urbaines. Les aînés qui souhaitent « rester » dans les collectivités rurales, par exemple, peuvent être confrontés à des obstacles à leur maintien à domicile, ainsi qu’à leur participation active au sein de la communauté. Au nombre de ces obstacles, il faut noter l’absence ou la quantité limitée de services de soutien à leur disposition pour les aider à demeurer indépendants, et le très peu de choix en matière de logement et de transport. Par ailleurs, les aînés qui vivent dans les régions rurales et éloignées ont souvent besoin de se déplacer en dehors de leur collectivité pour accéder aux services de santé, ce qui pose divers défis, tant pour eux que pour leur famille.
Élaboration du guide
Ce sont les gouvernements provinciaux et territoriaux à l’aide de divers mécanismes dont des appels à tous et des invitations adressées à des collectivités spécifiques, qui ont choisi les collectivités visées par l’initiative. Toutes les collectivités participantes répondaient à un certain nombre de critères ayant trait à la taille de la population (5 000 habitants ou moins), à l’expérience en matière de vieillissement de la population, au degré d’éloignement (proximité d’une ville), à la structure économique (agricole, axée sur les ressources primaires, axée sur le tourisme et les loisirs) et à la diversité ethnoculturelle.
Un total de dix collectivités réparties dans huit provinces ont participé à la recherche par groupes de discussion (voir la figure 1). Ces collectivités sont de diverse taille, de moins de 600 habitants à approximativement 5 000 habitants, et représentent divers degrés de ruralité et d’éloignement. Certaines sont isolées pendant les mois d’hiver et ont peu de contacts avec les autres collectivités; certaines ont une économie axée sur l’agriculture, alors que d’autres sont des villes de tourisme. Le degré de diversité culturelle est également très différent de l’une à l’autre.
Figure 1 : Collectivités participantesNote de bas de page 9
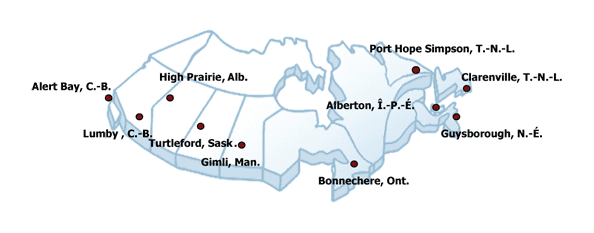
Une approche participative attentive aux besoins locaux et ascendante a été adoptée afin d’impliquer les personnes âgées et encourager leur participation active à l’examen des problèmes liés au vieillissement dans leur collectivité et aux discussions connexes. Cette approche participative à la prise de décisions et aux engagements sociaux a été recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour renforcer l’autonomie des aînés. Les aînés sont les experts de leur propre vie – le projet (ICREAA) canadien visait donc la participation pleine et entière des personnes âgées dans toutes les collectivités ayant fait l’objet de l’étude.
Groupes de discussion
Dix groupes de discussion, la plupart constitués de huit à dix personnes, ont été tenus avec des personnes âgées (de 60 ans et plus) et des aidants naturels d’aînés qui n’étaient pas en mesure de participer en raison d’une déficience physique ou mentale. Chaque groupe de personnes âgées reflétait diverses tranches d’âge, déficiences physiques et différences de statut socio-économique. Les participants potentiels ont été présélectionnés afin d’assurer une diversité appropriée au regard de ces caractéristiques. Tous les participants aux groupes de discussion ont été recrutés au sein de la collectivité géographique qui faisait l’objet de l’étude. Des efforts ont été consacrés au recrutement de participants suggérés par différentes sources. Divers mécanismes ont été utilisés pour recruter les participants, notamment des conférences de presse, des annonces dans les journaux, des avis sur les tableaux d’affichage, le bouche à oreille et des contacts dans la collectivité (des membres de la communauté faisant la liaison entre la collectivité et les chercheurs). Les lieux de culte, les centres sociaux, de bénévolat et de loisirs communautaires où les personnes âgées se rassemblent ainsi que les organismes et services communautaires dotés d’une importante clientèle de personnes âgées ont également constitué des sites de recrutement. Au total, 107 participants (96 personnes âgées et 11 aidants) ont participé aux groupes de discussion de février à avril 2007.
Dix autres groupes de discussion ont été constitués avec un total de 104 fournisseurs de services issus des secteurs public, privé et caritatif. L’information complémentaire recueillie portait sur les interactions entre les fournisseurs de services et les personnes âgées. Dans certains cas, les aidants et les fournisseurs de services ont donné de l’information que les personnes âgées n’avaient pas communiquée.
Thèmes abordés
L’étude a été conçue de manière à avoir une vue d’ensemble de la convivialité de chaque collectivité à l’égard des aînés. Les groupes de discussion ont abordé huit sujets ou thèmes généraux – ces thèmes portaient sur les caractéristiques essentielles de la structure communautaire et son environnement physique, ainsi que la mesure dans laquelle les services et les politiques tenaient compte des facteurs déterminants du vieillissement actif. Ces huit thèmes sont identiques à ceux utilisés par l’Organisation mondiale de la Santé dans son guide sur les villes du monde amies des aînés . Les mêmes questions d’ordre général ont été posées dans chaque collectivité. Les discussions visaient à développer les points suivants :
- les éléments de la collectivité qui sont favorables aux aînés (avantages);
- les obstacles et les problèmes de la collectivité à l’endroit des aînés (obstacles);
- les suggestions pour améliorer les problèmes et autres obstacles mentionnés.
Les trois premiers thèmes concernaient les espaces extérieurs et les immeubles, le transport et le logement. Caractéristiques fondamentales de l’environnement physique d’une collectivité, ces éléments ont une forte influence sur la mobilité personnelle, la sécurité par rapport aux risques de blessures, la protection contre le crime, les comportements liés à la santé et la participation sociale. Trois autres thèmes reflétaient divers aspects des environnements sociaux et culturels qui influent sur la participation et le bien-être psychologique – le thème Respect et inclusion sociale traite des attitudes, comportements et messages des autres personnes et de la collectivité dans son ensemble envers les personnes âgées; le thème Participation sociale fait référence à la participation des personnes âgées dans les activités sociales, culturelles, pédagogiques, spirituelles et de loisirs; le thème Participation communautaire et possibilités d’emploi aborde les possibilités en matière de participation citoyenne et d’activités rémunérées et bénévoles – ils sont liés aux environnements sociaux et aux déterminants économiques du vieillissement actif. Les deux derniers thèmes, Communication et information et Soutien communautaire et services de santé, impliquent les environnements sociaux et les déterminants des services sociaux et de santé.
Ces aspects de la vie communautaire, bien que représentés séparément dans ce guide, sont clairement interdépendants et les discussions au sein des groupes ont fréquemment traité diverses questions communes aux différents thèmes. Le respect et l’inclusion sociale, par exemple, sont reflétés dans l’accessibilité des immeubles et espaces, ainsi que dans la gamme de possibilités offertes aux personnes âgées en matière de participation sociale, de divertissement ou d’emploi. Le logement a une incidence sur les besoins en matière de services de soutien communautaire – la participation sociale, communautaire et économique dépend en partie de la sécurité des espaces extérieurs et des édifices publics et de l’accès à ceux‑ci. Le transport, la communication et l’information interagissent notamment avec les autres thèmes – sans modes de transport ou de moyens appropriés d’obtenir l’information permettant aux personnes de se rencontrer et de communiquer, les autres installations et services ruraux susceptibles de soutenir le vieillissement actif deviennent inaccessibles.
Le guide
Le présent guide a été organisé de manière à refléter les discussions et suggestions relatives aux huit thèmes définis plus haut. Dans la section II, chaque thème est abordé séparément. Après un bref exposé des points saillants de la discussion associée à un thème, un résumé des principales constatations fait état des aspects d’une collectivité (en rapport avec le thème) qui la rendent favorable aux aînés, ainsi que des obstacles à surmonter et de certaines suggestions pour atteindre une plus grande convivialité, tels qu’ils ont été relevés dans les discussions de groupes. La section III établit un processus général que les collectivités peuvent suivre pour déterminer leur convivialité à l’égard des aînés et l’améliorer, et comprend une liste de contrôle détaillée des attributs en faveur des aînés susceptibles d’aider les collectivités à mieux répondre aux besoins de leurs personnes âgées.
Il convient de noter que ce guide présente les attributs et obstacles généraux les plus fréquemment mentionnés dans les discussions à l’échelle du pays, y compris certaines suggestions de la part des participants pour rendre leur collectivité plus conviviale à l’égard des aînés. Le guide n’est pas exhaustif. Chaque collectivité est unique en soi, de sorte que les discussions ont également fait ressortir que chacune présentait ses propres besoins, circonstances et possibilités pour améliorer son degré de convivialité à l’égard des aînés. Les idées et suggestions présentées dans le présent document devront faire l’objet d’une réflexion dans chaque collectivité qui les adaptera et les organisera de manière à répondre au mieux aux conditions et aux besoins locaux.
Utilisation du guide — un point de départ
Le présent guide s’adresse aux personnes et aux groupes qui souhaitent rendre leur collectivité plus favorable aux personnes âgées, notamment les municipalités et les provinces, les organismes bénévoles, le secteur privé, les personnes âgées, les organismes s’adressant aux aînés et les groupes de citoyens. Il s’agit d’une responsabilité partagée par de nombreux groupes, dont les divers gouvernements. Le guide vise à illustrer ce que l’on entend par « amies des aînés » et à donner aux collectivités un point de départ qui leur permettra de cerner les obstacles et les atouts qu’elles ont en commun, ainsi que de promouvoir le dialogue et l’action à l’appui du développement de collectivités amies des aînés.
Il est de la responsabilité de chacun d’amorcer un dialogue dans sa collectivité, afin de déterminer ses atouts, ses forces et ses faiblesses dans ce domaine. La méthode adoptée par chacune peut varier.
Idéalement, tous les membres de la collectivité devraient prendre part à l’exploration de ses attributs en faveur des aînés, puisqu’un bon nombre de ces caractéristiques bénéficient également à d’autres groupes dans la collectivité. Une collectivité qui aide ses aînés aide tout le monde.
Points saillants des discussions de groupes, par thème
Les espaces extérieurs et les immeubles
L’environnement physique est un déterminant important de la santé physique et mentale de toute personne. La création d’environnements favorables, notamment d’espaces extérieurs et d’immeubles adaptés aux aînés, peut améliorer le bien-être physique et la qualité de la vie, contribuer à l’individualité et à l’indépendance, promouvoir l’interaction sociale et permettre à chacun de vaquer à ses activités quotidiennes.
Les résultats des groupes de discussion ont permis de cibler des éléments importants des espaces extérieurs et des immeubles pour les aînés et les aidants. Les personnes âgées et les fournisseurs de services dans les collectivités rurales et éloignées ont mentionné que les trottoirs, les sentiers et les pistes « praticables » étaient très importants pour les aînés, non seulement parce qu’ils contribuent à la sécurité et à l’activité physique, mais également parce qu’ils permettent aux personnes âgées de se déplacer et de s’occuper de leurs propres besoins personnels et sociaux. Les participants ont par ailleurs rappelé l’importance d’avoir des commodités à proximité. Ils ont mentionné un certain nombre d’obstacles, notamment l’absence de trottoirs (ou de trottoirs continus) dans certaines collectivités, ainsi que les dangers liés au fait de marcher ou d’utiliser un scooter dans les rues et les routes très fréquentées. Même dans les collectivités où il y a des trottoirs, certains participants s’inquiètent de l’état général de délabrement et du manque d’entretien tant des trottoirs que des sentiers.
« Beaucoup de portes sont extrêmement lourdes, très lourdes. J’ai fait deux chutes. Je me suis cassé le poignet en marchant sur un trottoir inégal et puis je suis tombé et me suis fait très mal à l’épaule. Et j’ai beaucoup de difficultés à ouvrir les portes très lourdes, qui sont partout, où que vous alliez. »
« Je ne me suis jamais senti nerveux et pourtant je marche beaucoup. L’hiver, je promène le chien à six heures du matin et il fait très, très noir. Non, je ne me suis jamais senti nerveux nulle part – c’est la pure vérité. »
Outre l’importance de marcher pour vaquer à des occupations courantes comme faire quelques courses, la marche en tant qu’activité physique s’est très largement répandue chez les personnes âgées. Faire en sorte que les sentiers, les chemins et les voies piétonnières soient dotés de toilettes et d’espaces de repos (en particulier des bancs) en quantité suffisante rendrait ces espaces nettement plus accessibles aux aînés.
Les conditions saisonnières varient tout au long de l’année et ont de toute évidence un impact sur les déplacements à pied dans les collectivités. Les aînés apprécient particulièrement le dégagement rapide de la neige, bien que cette activité génère parfois d’autres problèmes. Les chasse-neige, par exemple, tendent à amonceler la neige sur le bord des routes, ce qui, comme l’ont fait remarquer plusieurs participants, peut engendrer des difficultés pour ouvrir les portières des voitures bloquées par les bancs de neige.
Les immeubles ne comportant que quelques marches, les portes à bouton-poussoir et les rampes pour fauteuils roulants sont très importants pour faciliter l’accessibilité. Les immeubles anciens, toutefois, sont fréquemment pointés du doigt pour leurs problèmes d’accessibilité. Plusieurs participants ont souligné, par exemple, que les toilettes des vieilles églises sont situées au sous-sol, ce qui pose un problème aux aînés qui ont de la difficulté à se déplacer. En fait, les toilettes ou cabines de toilette inaccessibles, les marches et les portes lourdes ont été mentionnées à maintes reprises comme autant d’obstacles pour les personnes âgées.
Dans l’ensemble, les participants aux groupes de discussion ont indiqué le fait qu’ils se sentent bien et en sécurité dans leur collectivité et qu’il y avait peu de criminalité. Les préoccupations des aînés en matière de sécurité concernent davantage les accidents potentiels, notamment la peur de tomber, qui est perçue comme un obstacle à l’indépendance et à la mobilité. De la même manière, les rues ou les trottoirs glissants ou ayant des trous sont perçus comme des dangers qui rendent la marche à pied périlleuse pour les personnes âgées.
Résumé des principales constatations
Les résultats des groupes de discussion révèlent les points saillants suivants relativement à ce que les personnes âgées et les aidants perçoivent comme des enjeux et des possibilités d’importance pour la planification de l’aménagement d’espaces extérieurs et d’immeubles amis des aînés :
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- Des trottoirs, des sentiers et des pistes praticables.
- Une bonne accessibilité aux édifices publics ainsi qu’à l’intérieur de ceux‑ci (p. ex., peu de marches, rampes pour fauteuils roulants pas trop inclinées, toilettes accessibles).
- Le long des voies piétonnières, des toilettes accessibles (p. ex., larges portes à bouton-poussoir, rampes) et des espaces de repos, notamment des bancs installés à une hauteur appropriée.
- Des ajustements et des adaptations qui aident les personnes âgées à se sentir en sécurité dans la collectivité.
- Des services offerts à distance de marche du lieu de résidence des personnes âgées.
Obstacles
- Le manque d’accessibilité aux édifices publics et à l’intérieur de ces derniers.
- L’absence de trottoirs, de bordures de trottoir et de passages pour piétons ou leur mauvaise qualité.
- Les conditions saisonnières qui nuisent à la marche ou aux balades en scooter (p. ex., la neige, la glace).
- Le manque de toilettes accessibles et d’espaces de repos le long des voies piétonnières.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Prévoir des activités intergénérationnelles à l’extérieur afin de favoriser la socialisation entre les jeunes et les moins jeunes de la collectivité et d’aider les personnes ayant des problèmes de mobilité.
- Mettre sur pied des clubs de marche à l’intérieur pour les périodes où la météo est moins clémente.
- Installer des panneaux de signalisation indiquant les toilettes publiques.
- Éclairer suffisamment les quartiers et les sentiers.
Le transport
Qu’il s’agisse de conduire une voiture ou d’utiliser les transports publics ou privés, l’accès au transport permet aux personnes âgées de participer à des activités sociales, culturelles, bénévoles et récréatives, ainsi que de vaquer à des activités quotidiennes comme aller travailler, faire des courses ou se rendre à un rendez-vous.
La majorité des personnes âgées qui ont participé aux groupes de discussion ont signalé qu’elles avaient un véhicule et qu’elles conduisaient. Des routes de bonne qualité, une circulation fluide, le dégagement rapide de la neige et de bonnes possibilités de stationnement en général comptaient parmi les avantages de la conduite automobile dans les collectivités rurales et éloignées mentionnés par les personnes âgées. Toutefois, le manque de places de stationnement pour les personnes présentant des difficultés physiques (places de stationnement pour les personnes « handicapées ») et l’absence d’un contrôle de ces places réservées par les autorités locales, comptaient au nombre des obstacles les plus couramment mentionnés. En outre, une signalisation routière de piètre qualité, des voies de circulation mal conçues et une application insuffisante des règlements en matière de circulation automobile et de stationnement étaient perçus comme des facteurs négatifs.
« Maintenant que je vieillis, je devrais plutôt dire, maintenant que je suis vieux, je sais qu’un de ces jours, je vais me faire dire : « fini, plus de permis pour toi… ». C’est ce qui nous attend tous. »
Les personnes âgées ont également exprimé des inquiétudes par rapport à leur avenir en tant que conducteurs âgés; nombre d’entre elles craignaient la perte de leur indépendance avec celle de leur permis.
Contrairement à ceux qui vivent en ville, les aînés installés dans les régions rurales et éloignées ont moins aisément accès aux transports publics ou autres. En fait, certaines collectivités n’offrent aucune forme de transport public ou privé. Dans celles où il existe un système de transport public, il est fréquent que celui‑ci ne réponde pas aux besoins des personnes âgées. Par exemple, les aînés ont souvent des habitudes différentes des autres utilisateurs des transports publics – elles se déplacent en dehors des heures de pointe pour les travailleurs et les utilisent pour différentes raisons (rendre visite à des amis, participer à des activités, accéder à des services ou faire des courses). Les transports publics, lorsqu’ils sont proposés, ne sont pas nécessairement organisés de manière à répondre à ces besoins. Par conséquent, ils sont moins utilisés, ce qui entraîne une réduction ou même l’annulation pure et simple des services.
Les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité ou des déficiences utilisent peu les transports publics pour un certain nombre de raisons. Les horaires fixes, par exemple, ne tiennent pas compte de leurs besoins, et l’accès aux piétons (trottoirs, etc.) peut également poser problème. Les personnes âgées qui n’ont pas de véhicule sont particulièrement vulnérables à l’isolement et peuvent également éprouver de la difficulté à accéder aux services communautaires et médicaux. Les fournisseurs de services ont mentionné le manque de transports publics (ou d’une solution de rechange pratique) comme la raison pour laquelle les personnes âgées continuent de conduire leur voiture même s’il n’est plus sécuritaire de le faire.
Les participants ont parlé des solutions et des approches qui fonctionnent bien dans leur collectivité – en particulier, le recours à des camionnettes ou des services de navette, la plupart exploités bénévolement et/ou avec une subvention du gouvernement, ainsi que des programmes de transport des personnes âgées vers les grands centres pour leurs rendez-vous médicaux. Ces programmes s’avèrent de plus en plus nécessaires et représentent un net avantage pour les personnes âgées. Par ailleurs, lorsque de tels programmes sont en place, ils sont généralement bien utilisés par les aînés. Les aînés estiment qu’il est important d’avoir accès à un service de taxis.
« Nous avons deux Handivans – une avec un accès pour les fauteuils roulants, l’autre pour les personnes qui ont besoin du transport mais ne sont pas en fauteuil. Le service fonctionne merveilleusement bien. »
« Nous croyons tous que le transport est indispensable. La famille et les amis, c’est bien. Mais on ne peut pas non plus trop leur en demander. »
« Ma mère qui est âgée dépend des autres pour ses déplacements, mais après cinq appels téléphoniques, on finit par se décourager. On est triste de dépendre autant des autres. »
Les résultats des groupes de discussion révèlent que, mêmes dans les très petites collectivités, beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas les possibilités de transport à leur disposition. Dans d’autres cas, elles savent que ces services existent, mais elles n’en connaissent pas les détails, comme le prix, l’horaire et les critères d’admissibilité.
Par ailleurs, il est ressorti des discussions que, les services de transport assurés par les membres de la famille (en particulier les filles), les amis et les voisins, sont de loin la solution la plus fréquemment utilisée. Un fournisseur de services parlait des voisins et des bénévoles comme d’un système « parallèle » de taxi ou de transport public, soulignant ainsi leur générosité dans ce domaine. Ce dernier faisait également remarquer que la montée des prix de l’essence devenait très problématique pour ces chauffeurs bénévoles.
Comme l’illustre le commentaire d’un aidant, toutefois, les coûts vont bien au-delà du cours de l’essence. Le coût réel de ce système de transport « parallèle » est le malaise que ressentent les personnes âgées par rapport à leur dépendance à l’égard des autres pour se déplacer dans la collectivité et au-delà – une atteinte à leur indépendance et à leur fierté. Plusieurs participants ont également soulevé une question fondamentale : que font les personnes qui n’ont ni famille, ni voisins généreux pour les aider?
Le transport est ressorti comme un enjeu majeur dans la plupart des autres thèmes abordés dans les groupes de discussion – logement, inclusion et participation sociale et, en particulier, soutien et services de santé communautaires.
Résumé des principales constatations
Les discussions de groupes ont révélé les enjeux, besoins et suggestions qui suivent pour les collectivités, en ce qui concerne les transports.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
Pour les conducteurs âgés
- Routes en bon état, circulation fluide.
- Dégagement rapide de la neige.
- Stationnement approprié.
Pour les personnes âgées utilisant les transports publics
- Des chauffeurs bénévoles et/ou des réseaux informels qui assurent des services de transport.
- Des camionnettes ou des services de navettes à l’intention des aînés.
- Des services de transport pour les besoins en santé (notamment vers les grands centres).
- La disponibilité d’un transport adapté (avec plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants).
- Des services de taxis abordables et accessibles.
Obstacles
Pour les conducteurs âgés
- Les difficultés de stationnement ou l’absence de zones de chargement et de déchargement.
- Les autres conducteurs et les problèmes liés aux horaires et à la circulation.
- L’éclairage et les autres problèmes de visibilité.
Pour les personnes âgées utilisant les transports publics
- Dépendance excessive sur les membres de la famille, les amis et les voisins pour les services de transport.
- L’absence de possibilités – aucun autobus ou taxis.
- Les coûts pour se déplacer en dehors de la collectivité.
- Mauvais aménagement des horaires ou piètre qualité de la correspondance.
- Le manque d’accessibilité.
- Le manque d’information à propos des possibilités de transport.
- La sous-utilisation des services (p. ex., les autobus publics, les autobus à la demande, les Handivans), ce qui mène à leur annulation en raison du faible taux de fréquentation.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
Pour les conducteurs âgés
- Proposer des cours de conduite aux personnes de plus de 50 ans, afin de rafraîchir leurs connaissances.
- Proposer un « permis de conduire limité » aux personnes qui autrement perdrait leur permis, afin, par exemple, qu’elles puissent conduire le jour ou dans un rayon de 10 km de leur domicile.
- Désigner des places de stationnement pour les personnes qui ont des problèmes de santé qui limitent leur mobilité (c.-à-d., les personnes qui ne peuvent pas marcher très longtemps) mais qui ne sont pas admissibles à utiliser une vignette pour handicapé.
Pour les autres modes de transport
- Assurer un service de taxis sur un itinéraire précis s’arrêtant à deux ou trois endroits plusieurs fois par jour – et envisager le subventionnement d’un tel service afin de le rendre viable économiquement et accessible aux personnes âgées.
- Assurer un service de transport public plus fréquent la nuit et en hiver.
Le logement
Les discussions de groupes portant sur le logement rappellent l’importance de permettre aux personnes âgées de demeurer indépendantes aussi longtemps que possible. La capacité à vivre en autonomie dans sa propre maison dépend de plusieurs facteurs, dont la santé, les finances et la présence de services de soutien (soins médicaux et personnels). De nombreuses personnes âgées estiment qu’elles pourraient continuer à vivre chez elles, comme elles l’ont fait pendant des années voire des décennies, si certaines conditions sont satisfaites. Par exemple, l’existence de services d’aide pour l’entretien ménager, le jardinage ou les travaux d’entretien, permettrait aux aînés de demeurer chez eux.
« Les taxes sont élevées et les factures de chauffage leur font très peur. Souvent, ils ont tellement peur de chauffer qu’ils ne montent le chauffage que lorsqu’ils ont de la visite. Ils ont un chandail et un manteau sur le dos, et un châle sur les épaules. Ils mettent une courtepointe roulée au bas de la porte pour empêcher l’air froid d’entrer. »
« Dans le cas d’un couple qui vit dans une vieille maison, si les deux reçoivent une pension de vieillesse, le couple n’a pas droit à une subvention. Je tente continuellement de dénicher des subventions pour les personnes dans cette situation, et c’est réellement frustrant. Parce que les deux époux perçoivent une pension de retraite, leurs revenus s’élèvent probablement à 21 000 $ ou 22 000 $, et comme ils dépassent le plafond de 1 000 $, ils n’ont droit à rien. »
Nombreuses sont les personnes âgées qui sont propriétaires de leur maison. Les maisons des aînés sont souvent plus anciennes que celles des Canadiens plus jeunes. Divers coûts sont plus élevés pour les maisons plus anciennes – notamment l’entretien et les services publics. Bien que certains aînés reconnaissent que leur vieille maison n’est pas très fonctionnelle pour une personne âgée, ils n’ont bien souvent pas les moyens de financer les améliorations et les adaptations qui amélioreraient leurs conditions de vie. La plomberie intérieure était l’objet de préoccupations dans une collectivité. Dans une autre, la dépendance aux poêles à bois a été abordée, ainsi que les problèmes qui en résultaient lorsque les personnes âgées n’étaient plus en mesure de couper le bois et de le transporter à l’intérieur. Certains participants aux discussions ont fait remarquer que des bénévoles aidaient les personnes âgées dans l’exécution de ces tâches, soit de manière informelle (de bons voisins) ou dans le cadre d’un service de bénévolat communautaire organisé. Les plus gros obstacles financiers auxquels font face les aînés qui souhaitent demeurer chez eux semblent être associés au chauffage et aux coûts d’entretien de la maison.
Les problèmes de conception constituaient un autre obstacle fréquemment mentionné. Bien qu’un certain nombre de participants savaient que des subventions gouvernementales existent s’ils ont besoin de rénover des parties de leur maison à des fins d’accessibilité ou de mobilité, l’information relative à ces programmes administrés par les gouvernements fédéraux ou provinciaux est moins connue. Dans d’autres cas, les participants ont exprimé leurs frustrations par rapport au processus d’obtention d’une telle aide. Comme le mentionnait un fournisseur de services, les critères d’admissibilité excluent parfois des personnes qui pourraient clairement bénéficier de subventions pour améliorer leur domicile.
Lorsque viendra le moment de quitter leur maison, les participants aux groupes de discussion souhaitent avoir accès à diverses options qui leur assurent une continuité des soins. Ceux qui ont les moyens d’acheter une nouvelle maison ont mentionné la nécessité de construire des maisons plus petites ou des condominiums. D’autres sont moins intéressées ou sont incapables d’acheter une nouvelle maison et cherchent un appartement.
« Tout ce qui se construit ici comme dans les autres collectivités sont les condominiums pour des personnes très aisées. »
« Mais pour ce qui est d’obtenir un prêt hypothécaire… C’est une autre paire de manches – pouvez-vous emprunter quand vous êtes une personne âgée? »
« Je pense que tout le monde cherche cette étape intermédiaire, vous savez, entre quitter la maison et aller en résidence. Vous savez, où vous pouvez vivre seul, mais bénéficier d’une certaine forme d’assistance. Vous n’avez pas à vous occuper de votre propre maison, mais vous n’êtes pas totalement pris en charge par un établissement non plus. »
Les logements à louer sont généralement des maisons isolées, des maisons de ville, des duplex, des appartements accessoires ou des petits immeubles résidentiels. Les nouveaux logements à louer ne sont pas toujours économiquement viables dans la plupart des collectivités rurales, en raison notamment de l’étroitesse du marché local, des conditions économiques risquées et d’une industrie de la construction limitée.
En plus de vouloir un logement « entre les deux », c’est-à-dire entre la grande maison familiale et l’appartement, les personnes âgées des groupes de discussion ont signalé qu’elles recherchaient également des choix de vie avec davantage d’assistance, décrits par un participant comme une étape « intermédiaire ».
La disponibilité, le choix et le coût du logement sont autant de facteurs importants pour les personnes vieillissantes. Les résultats des groupes de discussion révèlent que même dans les collectivités offrant une série de possibilités de logement indépendant et assisté, la plupart observent des pénuries à certains égards.
L’absence ou le manque de choix de soins de longue durée a également été mentionné comme un obstacle important pour les personnes âgées dans les collectivités rurales et éloignées. Bien que la séparation involontaire des époux ait été mentionnée comme une conséquence très malheureuse de la pénurie de certains types de logement, avoir à quitter la collectivité pour accéder aux soins de longue durée s’est révélé être une situation nettement plus courante.
Résumé des principales constatations
Les discussions de groupes révèlent un certain nombre d’enjeux et de possibilités en matière de logement que les collectivités rurales et éloignées du Canada pourraient prendre en considération.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- La disponibilité d’appartements et de possibilités de vie indépendante abordables.
- La disponibilité de logements abordables (notamment subventionnés).
- La disponibilité d’aides pour le maintien à domicile.
- La disponibilité de possibilités de vie avec assistance.
- La disponibilité de condominiums et de maisons plus petites.
- La disponibilité de choix de soins de longue durée.
- La proximité des services.
Obstacles
- La capacité financière, en particulier en ce qui concerne l’entretien général des maisons – factures de chauffage, de services, réparations et rénovations.
- L’absence d’aides permettant aux aînés de demeurer autonomes.
- Les maisons mal conçues, notamment les obstacles à la mobilité.
- L’absence ou le manque de choix de logements pour les personnes âgées – notamment les unités résidentielles autonomes, les logements avec assistance, et ceux offrant des soins de longue durée.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Assurer la continuité des soins dans la collectivité – coordination des soins à domicile, de l’aide à la vie autonome et des soins en établissement.
- Développer un niveau « intermédiaire » de logement, entre l’autonomie et la prise en charge complète.
- Mettre à la disposition des aînés des appartements de dimensions différentes visant à accommoder les époux qui veulent rester ensemble et les personnes qui souhaitent davantage (ou moins) d’espace.
- Veiller à ce que les nouveaux logements puissent s’adapter aux personnes âgées présentant des déficiences.
Le respect et l’inclusion sociale
Les personnes âgées veulent faire bien davantage que simplement continuer à résider dans leur collectivité – elles veulent pouvoir contribuer à la vie communautaire et bénéficier de celle-ci. Les aînés actifs et impliqués sont moins à risque de vivre de l’isolement social et plus susceptible de ressentir un sentiment d’appartenance à l’égard de leur collectivité. Ceci est particulièrement important, compte tenu des liens étroits qui existent entre l’isolement social et la santé. Bien que l’isolement social tende à augmenter avec l’âge, les collectivités qui encouragent la participation sociale et l’inclusion sont davantage en mesure de protéger la santé de leurs citoyens, y compris de ceux qui sont isolés socialementNote de bas de page 10. Les études révèlent par ailleurs qu’un des facteurs associés au sentiment de solitude est le sentiment d’un manque de respect. Tout comme l’isolement social, la solitude peut avoir un impact négatif sur la santéNote de bas de page 11.
« Ils (les aînés) ont besoin de sentir qu’ils sont toujours une partie essentielle de la communauté. »
« Je pense que nous sommes tous profondément conscients que nos aînés constituent la membrane de base, le tissu fondamental qui nous aide à être la collectivité que nous sommes. Et il n’y a pas une personne qui ne comprenne pas cela ou qui l’apprécie. »
« Je pense que c’est une sorte de philosophie de vie silencieuse dans une région rurale, ici, que d’être invité, sollicité ou consulté. »
Les discussions de groupes révèlent que les personnes âgées des collectivités rurales et éloignées sont généralement traitées avec grand respect, gentillesse et courtoisie par toutes les générations – un point de vue que partagent les participants âgés et qui est confirmé par les fournisseurs de services. Bien que plusieurs fournisseurs de services aient observé que les commerçants et les clients tendent à s’impatienter avec les aînés dont le rythme est plus lent, rares sont les participants qui ont exprimé leur insatisfaction par rapport à la façon dont les personnes âgées étaient traitées et intégrées dans la vie communautaire. En fait, la plupart ont dit que les personnes âgées étaient intégrées à la collectivité, consultées et sentaient qu’elles faisaient partie de la communauté et ont attribué cette caractéristique à la philosophie « rurale » des collectivités éloignées.
Les résultats des discussions signalent quelques différences culturelles quant à la manière dont le respect des personnes âgées se manifeste. Un participant a mentionné, par exemple, que le fait d’appeler les personnes âgées « Monsieur » ou « Madame » était chose courante dans la communauté. Un participant d’une autre collectivité (constituée d’une population autochtone importante) a fait remarquer que le fait d’appeler une femme plus âgée « Ma tante » était une grande marque de respect. Dans une autre collectivité ayant fait l’objet de l’étude, les personnes âgées se sont autodésignées, de sorte que les autres les appellent les « anciens » plutôt que les aînés. Ce phénomène a été attribué au fait que la collectivité en question était constituée d’une population « mixte » (autochtone/non autochtone). Bien qu’il ait été suggéré par au moins un participant que les jeunes gens étaient parfois perçus comme quelque peu irrespectueux en raison de la manière « sans façon » dont ils abordent les aînés (c.-à-d., sans dire « Monsieur » ou « Madame ») – d’autres ont supposé qu’il s’agissait davantage d’un manque d’éducation que d’un manque de respect.
« Je pense que c’est quelque chose qui vient de ce que nous avons appris de nos voisins les Premières nations, parce que dans cette culture les aînés sont vraiment respectés. En fait, ce sont eux qui gardent la culture vivante; c’est ce que vivre dans une communauté près de la leur nous a, en quelque sorte, permis d’apprendre. »
« Si une personne est absente, il y a toujours quelqu’un qui cherche à découvrir pourquoi. Si on remarque que quelqu’un manque à l’appel, il y a forcément quelqu’un qui ira vérifier immédiatement. Il y a une entraide incroyable entre voisins ici, et les gens font réellement attention les uns aux autres. »
Les participants de toutes les régions du Canada ont apporté de nombreux exemples de respect et d’interactions entre les générations, la plupart se rapportant aux écoles. Les activités intergénérationnelles sont autant d’occasions pour les personnes âgées d’interagir avec les jeunes – ce qui leur permet de transmettre leur savoir, leurs traditions et leurs compétences. Les résultats des groupes de discussion révèlent que les collectivités font preuve de respect et d’appréciation envers leurs aînés, par l’entremise d’une vaste gamme d’activités et de récompenses qui reconnaissent et célèbrent les personnes âgées. Des activités telles que le « Souper des aînés » ont été fréquemment mentionnées comme des manifestations de reconnaissance. D’autres ont mentionné l’inclusion d’aide-mémoire communautaire qui raconte l’histoire des aînés.
Certains participants ont suggéré qu’un moyen de faire preuve de respect serait d’admettre et d’accepter que toutes les personnes âgées ne souhaitent pas nécessairement être actives dans la communauté.
Les questions graves de violence et de négligence à l’égard des aînés ont été abordées pendant les discussions sur les défis auxquels font face les membres de la famille et les autres aidants. Les fournisseurs de services ont rappelé l’importance et la nécessité que les fournisseurs soient informés et sachent comment soutenir les familles qui se trouvent dans des situations difficiles.
En dépit des efforts des personnes et des communautés, l’isolement des personnes âgées existe et demeure une réalité dans les collectivités rurales et éloignées. Cet isolement est souvent, mais pas toujours, le fruit de problèmes de santé ou de mobilité. Les personnes âgées et les fournisseurs de services ont avancé que la raison pour laquelle certains aînés sont seuls tient de notre époque – caractérisée par des voisins qui ne « voisinent » pas comme avant. Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que dans certaines collectivités, de véritables efforts sont consentis pour tendre la main aux personnes âgées qui vivent l’isolement – en les invitant et en les incluant dans les activités communautaires, ou en prenant simplement note du fait qu’une personne âgée n’était pas présente à une activité à laquelle elle devait participer.
Résumé des principales constatations
Les discussions portant sur le respect des aînés et l’importance de prévenir l’isolement social ont fait ressortir certaines idées propres à une collectivité amie des aînés, ainsi que les obstacles et des suggestions d’améliorations.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- Le respect, la gentillesse et la courtoisie – y compris entre les générations.
- L’adaptation, y compris l’action sociale.
- Le sentiment d’être inclus, consulté et de faire partie de la communauté.
- Les activités ou les prix de reconnaissance des aînés.
Obstacles
- Les problèmes de santé et de mobilité qui entraînent l’isolement des personnes âgées.
- L’irrespect, l’âgisme ou la violence à l’égard des personnes âgées.
- On n’entend pas ou ne voit pas toujours les personnes âgées.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Créer des possibilités d’activités intergénérationnelles – ne pas isoler les personnes âgées.
- Assurer un soutien aux familles qui vivent dans des conditions difficiles afin de prévenir les risques de violence et de négligence à l’égard des aînés.
- Sensibiliser les jeunes aux problèmes entourant le vieillissement et à l’importance de traiter les personnes âgées avec respect – penser à offrir des ateliers sur ce que c’est que de vieillir.
- Démarrer un programme de grands-parents honoraires – cela peut constituer un point de départ pour des contacts et activités intergénérationnelles dans la collectivité.
- Promouvoir les qualités du vieillissement et des personnes âgées (au lieu de se concentrer sur le négatif).
- Mettre en place un programme de « mémoires communautaires » dans un musée local (ou promouvoir ceux qui existent déjà). La période du troisième âge est importante, et peut être saisie et conservée à l’aide des histoires des personnes âgées.
- Envisager la mise sur pied de programmes d’action sociale, tels que le programme de « contacts téléphoniques » utilisé dans certaines collectivités.
- Élaborer et soutenir des mesures clés d’action sociale – les réseaux bénévoles et informels de transport qui sont essentiels pour faire en sorte que les personnes âgées qui manquent d’options de transport ne soient pas isolées.
La participation sociale
Les réseaux sociaux, la participation sociale et le sentiment d’appartenance sont importants pour demeurer en santé et prévenir les maladies et l’isolement chez les aînés. Les personnes âgées qui demeurent actives et maintiennent des liens sociaux sont plus heureuses, sont en meilleure santé physique et mentale, et plus à même de faire face aux hauts et aux bas de la vieNote de bas de page 12.
Les discussions de groupes ont fait quelque peu la lumière sur les activités sociales des aînés qui vivent dans les collectivités rurales et éloignées du Canada. Voici les activités sociales mentionnées le plus fréquemment :
- les activités physiques récréatives ou sportives, y compris les sports de salon;
- les activités ou les programmes organisés par les églises ou les écoles;
- les activités qui ont trait à la nourriture, dont les potlatchs, les repas communautaires et même les funérailles.
« Les autres possibilités sont, je suppose, que vous avez intérêt à être là depuis un moment ou vous intégrer dans le bon groupe et ensuite faire des soirées sociales et chez les gens, ou ce genre de choses. Vous devez faire les premiers pas et c’est quelque chose qui peut paraître difficile pour les aînés. Si vous avez vécu ici toute votre vie, vous avez un bon réseau, mais si vous arrivez ici à l’âge adulte, cela devient un peu plus difficile. »
« Je dois dire que je suis déménagé ici lorsque nous avons pris notre retraite et il nous a été très difficile de nous intégrer dans des cercles d’amis, jusqu’à ce que je sorte de chez moi et que je m’implique. »
Ces activités communautaires fréquentes rassemblent toutes les générations. Les personnes âgées dans les groupes de discussion ont fréquemment parlé de l’importance et de leur désir d’être mélangés à d’autres adultes et enfants de tous âges. On a notamment mentionné un programme novateur de natation intitulé « Aînés, mamans et bébés ». D’autres ont mentionné qu’ils jouaient régulièrement au curling avec des gens plus jeunes dans la collectivité, et d’autres encore qu’ils se retrouvaient avec leur famille et d’autres membres de la communauté à l’aréna ou au gymnase de l’école pour encourager les équipes de sport communautaires. Certains participants plus âgés, mais pas tous, ont dit qu’ils préféraient ne pas participer aux activités pour les « aînés » ou fréquenter seulement les gens de leur âge.
La nourriture peut constituer un excellent moyen de connexion entre les membres des collectivités rurales et éloignées, ce qui est apparu très clairement et très tôt dans les discussions. De la même manière, les funérailles et les veillées, ainsi que les autres activités qui réunissent les gens au moment de la mort, sont revenus très fréquemment dans les discussions. Bien que des participants aient mentionné que les activités communautaires et les autres programmes organisés étaient importants, d’autres formes de contact social moins organisées sont également clairement importantes pour nombre d’entre eux. Il s’agira, par exemple, d’un fournisseur de services qui prend la peine de s’arrêter pour boire une tasse de thé ou de café tout en s’occupant de son « client ».
La marche constitue également un passe-temps participatif particulièrement prisé des personnes âgées (voir également la discussion sur les espaces extérieurs et les immeubles). En outre, les cours – en particulier les cours d’informatique – sont très populaires chez les résidents âgés dans certaines collectivités rurales et éloignées, tout comme le sont les clubs de cartes, de bingo et de fléchettes.
Certains participants ont mentionné que, dans certaines collectivités, les personnes âgées qui viennent d’arriver dans la collectivité (p. ex., celles qui optent pour une communauté rurale à leur retraite) doivent faire face à des réalités sociales différentes que celles auxquelles sont confrontées les personnes qui ont vécu dans la collectivité toute leur vie.
Certaines des personnes plus âgées ont indiqué que de nombreux aînés ne profitent pas des programmes qui leur sont consacrés. Dans certains cas, ce désintéressement a entraîné la fermeture de certaines installations de loisirs. D’autres ont signalé que des problèmes de financement ont fait en sorte que certaines installations se sont retrouvées sans direction ou personnel de programme. Le manque de services de transport est mentionné, une fois encore, comme un obstacle majeur à la participation des personnes âgées aux activités sociales. D’autres obstacles communs concernaient le manque d’information au sujet des activités prévues (l’information ne parvient pas aux personnes de manière opportune ou efficace) et les problèmes de moyens financiers et d’accessibilité qui empêchent certains aînés de participer à des activités et programmes sociaux.
Résumé des principales constatations
Les participants aux groupes de discussion ont proposé un certain nombre de suggestions pour les collectivités en matière de planification et de programmation sociales pour les aînés.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- Des possibilités d’activité physique récréative ou sportive, y compris les sports de salon.
- Des activités pour les aînés proposées dans les lieux de culte ou les écoles.
- Des activités associées à la nourriture – notamment les réunions autour d’un café ou d’un thé.
- Des activités culturelles – notamment les spectacles de musique et de théâtre.
- Des loisirs non physiques (activités à l’intérieur) comme le bingo, les cartes, les fléchettes, etc.
- Des cours d’artisanat ou sur les passe-temps.
- Réunir toutes les activités dans des endroits pratiques et accessibles (notamment par les transports publics) aux aînés.
- Prévoir des activités abordables pour tous.
- Proposer des activités intergénérationnelles et familiales (multigénérationnelles).
Obstacles
- Les difficultés de transport et la trop grande quantité d’activités qui exigent des déplacements.
- La faible participation qui entraîne l’annulation des activités.
- La sous-utilisation des installations de loisirs.
- Le manque d’installations ou de personnel de programme.
- Les barrières sociales (réelles et/ou perçues) pour les aînés nouvellement arrivés.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés…
- Trouver des moyens d’encourager diverses personnes à participer aux activités sociales ou autres – notamment celles qui ont un revenu fixe, celles qui vivent seules et celles qui sont moins mobiles – afin d’assurer une très large représentation de la communauté.
- Couvrir les coûts des cours proposés aux aînés.
- Des ressources supplémentaires sont nécessaires dans les collectivités rurales.
- Établir des programmes de jour pour les aînés atteints de démence afin qu’ils développent des systèmes de soutien pour améliorer leur état de santé.
- Proposer des programmes de jour aux personnes âgées dans les centres de santé/centres de loisirs communautaires, afin de leur assurer des services de santé et de mieux-être (p. ex., programmes sur la santé, prévention des maladies, capacités d’adaptation) et offrir d’autres activités. De tels programmes donneraient l’occasion aux aînés de socialiser, et permettraient aux familles d’avoir un peu de répit.
- Organiser des visites à domicile par les voisins et les autres membres de la collectivité.
La communication et l’information
Un consensus général a été établi concernant la nécessité de tenir les personnes âgées informées – non seulement des événements communautaires, mais également de ce qui se passe dans la communauté en général – afin de leur permettre de mieux s’intégrer à leur collectivité et de les soutenir dans leurs activités courantes.
« Les potins restent le moyen le plus rapide de diffuser de l’information. »
« Dans nombre de collectivités rurales, il n’y a pas de bande passante, donc pas d’accès à haute vitesse. Je rentre à la maison et je m’arrache les cheveux parce que le téléchargement d’une image prend des siècles. Je sais que c’est bien trop long pour les personnes âgées qui ont des ordinateurs, mais pas l’accès à l’Internet. »
L’information fournie par les participants aux groupes de discussion semble indiquer que les méthodes de communication les plus utilisées dans les collectivités rurales et éloignées demeurent les méthodes traditionnelles – à savoir le bouche à oreille, le téléphone, les tableaux d'affichage, les journaux et la radio – ainsi que les événements communautaires. D’après les commentaires des participants, l’outil de communication le plus efficace est, de loin, l’affiche ou le prospectus affiché sur les tableaux d’affichage dans des endroits stratégiques, notamment à la poste ou à l’épicerie. Le bouche à oreille – en personne ou par téléphone, par l’entremise de la famille et des amis ou par l’intermédiaire des clubs, des associations, des centres communautaires et des lieux de culte – est également perçu comme un important moyen de diffusion de l’information.
Les bulletins et les répertoires semblent être une autre source importante d’information pour les personnes âgées et nombre de participants et de fournisseurs de services constatent l’utilité d’un calendrier d’activités et d’une liste de programmes et de services (provenant de la municipalité, d’un centre communautaire/de loisirs, etc.). Les publications sont d’autant plus utiles quand elles mentionnent le nom et le numéro de téléphone de personnes-ressources clés. Dans de nombreuses collectivités, ces publications ne sont malheureusement guère plus produites ni diffusées.
De nombreux participants aux groupes de discussion ont exprimé la crainte d’être oubliés et que l'information soit diffusée de plus en plus uniquement sur Internet ou par le biais de services automatisés complexes.
Les participants plus âgés en particulier avaient de nombreuses plaintes à formuler au sujet des systèmes téléphoniques automatisés. En effet, les problèmes liés aux systèmes automatisés ou complexes, surtout aux systèmes téléphoniques, figuraient en tête de la liste des obstacles à une communication et à un échange d’information efficaces. Il semble particulièrement frustrant d’essayer d’obtenir une information d’importance vitale de sources gouvernementales.
De toute évidence, les personnes âgées qui ont participé aux groupes de discussion préfèrent avoir quelqu’un à qui parler. Elles ont exprimé leur intérêt à participer à des séances d’information dirigées par des experts, à prendre part à des rencontres sociales, voire même à se joindre à des programmes d'alphabétisation, comme autant de moyens de communiquer et d’obtenir de l’information. Elles se sont aussi montrées intéressées par des visites à domicile effectuées par des aînés et d’autres groupes, de même que par des services de bibliothèque itinérante. Les contacts en personne sont perçus comme étant particulièrement utiles pour diffuser de l’information, surtout à ceux qui connaissent un isolement social ou ont un niveau d’alphabétisation inférieur.
Dans l’ensemble, les personnes âgées craignaient de ne pas être suffisamment informées et ont fréquemment été incapables d’obtenir de l’information pertinente sur des activités se déroulant dans la communauté, sur des personnes-ressources ou sur des programmes mis à leur disposition – surtout lorsque l’information provenait de sources gouvernementales.
« À présent, j’envoie des courriels et c’est très agréable. »
« Je tenais seulement à réitérer que le gouvernement semblait réellement s’appuyer de plus en plus sur la technologie, les services téléphoniques et Internet. Il se contente très souvent de donner des adresses www et, pour la majorité des aînés, ces adresses sont tout simplement inaccessibles. »
« Les systèmes téléphoniques automatisés sont de loin l’expérience la plus exaspérante qui soit. »
Bien que les aînés accueillent volontiers les nouvelles technologies, ces dernières entraînent fréquemment de l’inquiétude et de la frustration. Les commentaires des participants semblent indiquer que la diffusion d’information sur Internet n’est pas le moyen le plus efficace d’atteindre la majeure partie de la population âgée. Les personnes âgées n’ont pas toutes accès aux ordinateurs ni les capacités nécessaires pour les utiliser comme outils d'information et de communication. Par ailleurs, de nombreuses collectivités rurales et éloignées ne sont pas dotées de services Internet à haute vitesse, ce qui peut être très irritant, en particulier pour les personnes âgées qui commencent seulement à découvrir la technologie. Présumer que la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde, ont accès à Internet dans les collectivités rurales et éloignées relève de l’utopie.
En dépit des nombreux commentaires concernant les craintes qu’ont les personnes âgées à l’égard des nouvelles technologies, les participants qui ont suivi des cours d’informatique exprimaient généralement une grande satisfaction tant en ce qui a trait aux cours qu’à leur perfectionnement dans le domaine. Certains ont souligné que ces cours constituaient une autre occasion pour les jeunes et les plus vieux d’interagir puisque ce sont souvent des étudiants d’écoles secondaires qui assurent la formation informatique des aînés.
Résumé des principales constatations
Les participants aux groupes de discussion présentent les observations et les suggestions ci-dessous en ce qui concerne l’intégration des personnes âgées dans leur communauté :
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- L’affichage de l’information relative à des activités sur des tableaux d’affichage, dans des endroits fréquentés par les aînés.
- La communication par téléphone ou le bouche à oreille, dans les journaux et les bulletins paroissiaux.
- L'annonce d’activités et la publication d’information importante aux aînés dans les journaux locaux et sur le câble ou les chaînes communautaires.
- L’accès pour les aînés à des ordinateurs ainsi qu’à une formation sur l'utilisation d’un ordinateur et d'Internet.
- La création et la gestion d’un centre de ressources pour les aînés et/ou sur le bénévolat.
- L’information sur les activités qui ont lieu dans la communauté, diffusée à la radio.
- Faciliter aux aînés l’accès à l’information contenue dans des sites Web.
- Création d’un répertoire de services communautaires pour les personnes âgées, qui contient de l’information sur les responsables de programmes susceptibles d’intéresser les personnes âgées.
Obstacles
- Le manque d’information sur les programmes et services existants.
- L’utilisation de systèmes automatisés et/ou complexes (systèmes téléphoniques donnant accès à l’information gouvernementale).
- L’information gouvernementale difficile à trouver et à obtenir.
- Les déficiences visuelles et les difficultés de lectures auxquelles sont confrontées les personnes âgées.
- L’information obsolète ou absente au sujet d’activités.
- L'accès inexistant ou de mauvaise qualité à des services de câblodiffusion, de radio et de bande passante.
- Les sollicitations téléphoniques dirigées vers les aînés.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Créer dans les centres communautaires un comité téléphonique qui contacterait chaque mois les aînés (qui le désirent) pour leur rappeler les activités qui se tiendront au centre.
- Célébrer la vie des aînés dans les journaux locaux.
- Trouver des moyens d’intégrer les aînés qui connaissent un isolement social au processus d'échange de l'information.
La participation communautaire et les possibilités d’emploi
Les aînés ont une grande variété de compétences et de connaissances, de même que du temps à consacrer à leur collectivité dans divers domaines, notamment la participation communautaire, les activités bénévoles et l’emploi rémunéré. Leur participation est liée non seulement à la prospérité et à la viabilité économique de leur communauté, mais également au maintien de leur propre santé mentale et physique et à leur appartenance sociale.
Les discussions tirées des groupes de discussion ont révélé que de nombreux aînés s’impliquaient dans des activités communautaires. Nombre de participants ont mentionné qu’ils siégeaient (ou avaient siégé) au conseil municipal de leur ville, à des comités et à des conseils d’administration, indiquant ainsi l’importance de la participation politique et de la responsabilité civique pour les personnes âgées. Peu d'obstacles à l'implication des aînés aux activités communautaires ont été soulevés lors des discussions – bien que certains aient exprimé leurs préoccupations au sujet de la participation inadéquate des jeunes aux activités communautaires, vraisemblablement attribuable à l’emploi du temps de ces derniers.
Dans bon nombre de groupes de discussion, les personnes âgées et les fournisseurs de services ont mis l’accent sur le rôle très important que joue le bénévolat dans la vie des aînés et la collectivité. Plusieurs ont exprimé combien ils trouvaient gratifiant de contribuer à la société par le biais du bénévolat.
« Cette ville s’effondrerait s’il n’y avait pas de bénévoles. »
« Au cours des dernières années, 90 % de nos bénévoles étaient des aînés. »
« Je pense que les aînés font tourner la machine, parce que je dois dire que – peut-être pas exclusivement – la grande majorité des bénévoles sont des aînés. Des bénévoles très, très dévoués. »
Le bénévolat a été déterminé comme étant une activité importante pour garder les personnes âgées actives, intégrées et impliquées. Il est également perçu comme essentiel au bien-être d’une collectivité, en particulier parce que nombre de services bénévoles rendus par des aînés assurent un soutien à d’autres personnes âgées. Parallèlement, le bénévolat des aînés ne se limite pas au seul groupe des personnes âgées. La participation des aînés à des activités scolaires et sportives signifie également que ceux-ci soutiennent activement tous les groupes d’âges. En effet, certaines personnes vivant dans des collectivités rurales et éloignées ont indiqué que leur communauté restait unie grâce aux bénévoles – dont la plupart sont des personnes âgées.
Certains membres des groupes de discussion ont indiqué que les personnes âgées aimaient être invitées à faire du bénévolat et qu’elles se sentaient reconnues lorsqu’on les appelait afin de leur demander de faire une chose pour laquelle la collectivité les savait compétentes – comme cuisiner un petit déjeuner de crêpes ou faire une collecte de fonds.
« En réalité, j’ai fait beaucoup de bénévolat et je ne me suis jamais vraiment arrêtée jusque récemment, quand je n’ai plus eu d’énergie. »
« Parce que vous savez, ce sont toujours les mêmes bénévoles qui font tout dans une petite communauté, alors vous finissez par vous épuiser. »
« Être bénévole dans cette ville…, je pense que les bénévoles en ont marre, si je peux m’exprimer ainsi. Parce que, vous savez, on nous utilise vraiment beaucoup. »
Certains ont mentionné que les problèmes liés à l’accessibilité et à l’adaptation étaient importants pour les bénévoles plus âgés. Selon des études, les personnes qui ont des incapacités physiques peuvent apporter une contribution importante en utilisant les moyens mis à leur disposition. Ces personnes peuvent par exemple vendre des tickets (tout en restant assis) ou contribuer par téléphone à des programmes de sécurité dans les écoles.
Certains des obstacles au bénévolat mentionnés par les participants concernent ceux associés au manque de services de transport, à la distance à parcourir jusqu’aux activités de bénévolat et au besoin de s’engager à long terme, ce qui peut compromettre des projets personnels (comme les voyages). Ces obstacles ne semblent pourtant pas décourager certains aînés de faire du bénévolat, d’une manière ou d’une autre.
Les discussions semblent indiquer que, parce que les aînés se portent volontaires pour faire du bénévolat (ou sont constamment sollicités pour en faire), les personnes et les organismes concernés commencent à se sentir épuisés. Parallèlement, un certain nombre de participants jugeait que les occasions de contribuer la communauté étaient limitées.
Bien que les participants aient indiqué que l’existence de possibilités d’emplois rémunérés variées était importante, le point d’intérêt principal de cette discussion était le bénévolat. Il est à noter néanmoins que, parmi les collectivités qui ont participé aux groupes de discussion, les emplois rémunérés semblent varier d'une collectivité à l'autre. Dans certaines collectivités, les pénuries de main-d’œuvre étaient autant d’occasions pour les aînés de demeurer actifs ou de réintégrer le marché du travail. Dans d’autres, les possibilités se limitaient à un emploi dans les magasins et à des postes au salaire minimum. Au moins un participant a fait remarquer que, si on demandait aux aînés d’utiliser de nouvelles technologies dans le cadre d’un emploi rémunéré, il importait de les former.
Résumé des principales constatations
Les discussions menées dans l’ensemble du Canada ont permis de fournir des informations sur certains aspects et certaines suggestions que les collectivités pourraient prendre en compte pour déterminer de quelle façon les aînés participent aux questions communautaires et liées à l’emploi.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- Reconnaissance et appréciation du travail fourni par des bénévoles âgés.
- Possibilités d’emplois rémunérés.
- Possibilité pour les aînés de faire du bénévolat et d’aider d’autres personnes âgées.
- Activités et occasions de bénévolat qui sont accessibles afin de répondre aux besoins des bénévoles âgés et d’apporter à ces derniers une gratification.
- Possibilités pour les aînés d’être actifs sur le plan politique, notamment en matière d’ouverture à l’égard de leur participation à des conseils locaux et à d’autres organisations du genre.
- Opportunités générales pour les aînés de contribuer à la vie communautaire.
- Demander aux personnes âgées de faire du bénévolat – en particulier dans des domaines qui permettent de tirer parti de leurs compétences.
- Opportunités pour les aînés de participer à des activités de collecte de fonds.
- Possibilités de contacts intergénérationnels lors d’activités communautaires et de bénévolat.
Obstacles
- Une dépendance excessive sur les aînés, entraînant trop d’engagements et de l’épuisement.
- La difficulté de trouver suffisamment d’aînés apportant leur participation.
- Les défis liés au transport et aux déplacements.
- Le manque de possibilités et/ou les obstacles liés aux emplois rémunérés.
- Les obstacles physiques et liés à la santé qui empêchent certains aînés d’apporter leur participation.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Recruter des aînés de tous âges du fait de la diversité de leurs points de vue – mettre l’accent sur les aînés plus jeunes.
- Travailler à encourager les aînés plus âgés qui peuvent être timides ou hésitants à apporter davantage leur participation (p. ex., au moyen d’un appel téléphonique ou de mots encourageants).
- Élaborer des stratégies de recrutement et de motivation pour donner aux aînés le goût de faire du bénévolat.
- Recruter des aînés pour des projets à court terme.
Le soutien communautaire et les services de santé
Que les personnes âgées puissent ou non vieillir chez eux dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la disponibilité d’un soutien et de services qui répondent aux besoins changeant des aînés. Il s’agit notamment de services professionnels tels que des services de soins médicaux et de soins personnels.
Dans le cadre des différents groupes de discussion, des personnes âgées, des aidants naturels et des fournisseurs de services ont parlé de façon positive des nombreux soins et du soutien offerts dans leur communauté. Ils ont exprimé leur immense gratitude aux professionnels de la santé de leur collectivité, pour leur empathie et leur attention – en particulier aux médecins, aux infirmières et aux pharmaciens. Toutefois, dans de nombreuses collectivités, la pénurie de professionnels de la santé a été identifiée comme étant un problème important pour les aînés.
Certaines collectivités ont souligné les aspects positifs du soutien médical et communautaire, notamment des services de santé et de mieux-être à guichet unique ainsi que des services de soins de santé à domicile. Elles ont aussi souligné les aspects positifs liés à la diversité des soins de santé, notamment aux services non traditionnels comme les massages et la chiropraxie. Certains ont souligné les avantages liés aux programmes de soins palliatifs, aux programmes de prêt d’aides techniques et de matériel (notamment des systèmes d’alerte médicale) ainsi qu’à d’autres services essentiels comme les programmes de repas abordables (y compris de repas en commun et de repas individuels livrés à domicile). Les services de livraison, en particulier ceux offerts par les épiceries et les pharmacies, étaient perçus comme très importants pour de nombreux participants des groupes de discussion.
« Mon seul commentaire serait que lorsque quelqu’un en arrive au point où il ne peut plus prendre soin de sa personne, on l’expédie en dehors de la communauté. Cette personne a grandi ici. Vous lui enlevez tous ses amis, sa famille peut-être, et elle se sent alors véritablement déconnectée. »
Bien qu’une vaste gamme de services ait été déployée pour aider les aînés, nombre de ces services – livraison de repas, transport spécialisé, soins à domicile, aide familiale, conseils et information – ne sont pas accessibles ou sont beaucoup trop chers dans de nombreuses collectivités rurales ou éloignées. Des participants ont mentionné fréquemment la compression des dépenses en matière de soins à domicile (notamment des services de relève) effectuée au cours des dix dernières années comme étant à la base du manque de soutien offert aux personnes qui souhaitent rester chez elles. Les compressions en matière de services d’aide familiale ont été très souvent mentionnées et, dans une moindre mesure, celles exercées dans les services de relève. De nombreux participants plus âgés ont indiqué que leur plus grande crainte était d’être obligés de quitter leur collectivité une fois que les services dont ils ont besoin ne seraient plus disponibles sur place.
L’une des questions qui a engagé de nombreuses discussions concernait la nécessité pour les aînés de se déplacer hors de la collectivité pour obtenir des services de soins de santé et les défis qui s’y rapportaient – en particulier en ce qui avait trait à la distance, au temps et aux coûts. L’ajout prévu de services télésanté dans quelques collectivités participantes est attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Ces nouveaux services devraient permettre de réduire la nécessité de se déplacer pour une journée ou plus pour une rencontre de moins d’une heure avec un spécialiste. Les frais personnels de déplacement associés aux rendez-vous médicaux à l’extérieur de la ville dépassent fréquemment les seuls coûts de transport et comprennent les frais d'une nuit à l'hôtel.
Résumé des principales constatations
Les participants aux groupes de discussion ont présenté de l’information et des suggestions aux collectivités afin de rappeler à ces dernières qu’elles doivent répondre aux besoins de leurs citoyens âgés lorsqu’elles planifient des services de santé et d’autres services de soutien.
Caractéristiques d’une collectivité amie des aînés
- Des professionnels empathiques et attentifs (médecins, infirmières, pharmaciens et spécialistes).
- La prestation de soins de santé à domicile.
- L’accès à des programmes de repas abordables.
- La prestation de divers services de santé – notamment de soins palliatifs – et l’existence d’établissements de santé dans la collectivité.
- L’existence de services d’entretien ménager.
- L'existence de services de livraison (p. ex., épicerie et médicaments) et/ou de services d’accompagnement pour l’achat d’articles essentiels.
- Des guichets uniques de services de santé et de mieux-être qui couvrent divers domaines – médecins, infirmières, dentistes, podologues, pharmaciens et ergothérapeutes.
- La disponibilité de matériel et d’aides techniques – notamment d’alertes médicales.
- Des programmes d’appui aux aidants naturels – notamment des services de relève.
Obstacles
- Les coûts et autres difficultés liés à la nécessité de se déplacer à l’extérieur de la collectivité pour se rendre chez le médecin.
- Le manque de professionnels de la santé dans les collectivités, en particulier de médecins.
- Les frais personnels de soins de santé, notamment ceux relatifs aux déplacements.
- L’insuffisance de services de soins à domicile, y compris de services de relève pour les aidants naturels.
- L’absence ou le nombre limité de soutien aux aînés leur permettant de demeurer indépendants.
- Le coût des services d’aide familiale.
- L’obligation pour les aînés de quitter la collectivité pour obtenir des soins.
- Le manque de coordination, d’uniformité et de continuité en matière de soins pour les aînés.
Suggestions des participants pour accroître la convivialité des collectivités à l’égard des aînés
- Utiliser des modèles de soins regroupés pour offrir des services intégrés aux aînés.
- Faire appel à des professionnels retraités (p. ex., à des pharmaciens, à des infirmières et à des enseignants) qui offriraient une entraide bénévole à des cliniques et à des centres pour personnes âgées – pour expliquer, par exemple, des notions relatives à des traitements et à des soins de santé.
- Mettre sur pied un programme Sécu-retour pour venir en aide aux personnes ayant une déficience cognitive par l’entremise de la Société Alzheimer.
- Offrir des services de repas deux fois par jour aux aînés qui vivent dans des logements avec services de soutien.
- Travailler à attirer davantage de médecins dans les régions rurales et éloignées.
- Fournir des services de supervision à domicile pour assurer l’administration appropriée de traitements.
- Offrir des services de relève aux aidants naturels.
- Établir des services de garde de jour pour les aînés, permettant ainsi à ces derniers de participer à des activités et de laisser un peu de répit aux aidants naturels.
- Mettre sur pied un programme de visites à domicile à l’intention des aînés.
- Créer des groupes de soutien pour les aidants naturels et élaborer des séances d’information sur les soins offerts aux personnes âgées, dans le cadre desquelles les familles pourront s’informer des programmes et des services communautaires offerts.
Comment rendre une collectivité l'amie des aînés – prévoir un plan d'action
Ce guide comportait un résumé des pensées, des idées et des suggestions prises en comptes relativement à ce qui constitue une collectivité amie des aînés et glanées de discussions qui ont eu lieu dans l’ensemble du Canada avec des citoyens âgés, des aidants naturels et des fournisseurs de services. Il vise à favoriser le dialogue et à mettre en œuvre des mesures qui permettront de soutenir les personnes âgées et de permettre à ces dernières de vieillir tout en restant actives – c’est-à-dire de vivre en sécurité, de jouir d’une bonne santé et de continuer à participer pleinement à la société.
Ce guide relate des discussions qui ont porté sur huit thèmes importants en matière de vieillissement actif et en santé. Les groupes de discussion ont fait ressortir un certain nombre de caractéristiques générales et spécifiques dont des planificateurs communautaires, des organismes et d’autres éléments pourront tenir compte lorsqu’ils examineront et élaboreront des services et des mesures de soutien pour les personnes âgées. Des obstacles aux mesures visant à accroître la convivialité à l’égard des aînés ont également été identifiés au cours des discussions – là encore, l’intention est de donner matière à penser aux collectivités dans l’ensemble du Canada pour qu’elles s’assurent que leurs politiques, leurs services et leurs structures tiennent compte des besoins et de la volonté des personnes âgées.
Comment une collectivité devient-elle amie des aînés? Ni le présent guide ni le guide Villes amies des aînés de l’OMS, dont la méthodologie a servi de base à l'étude qualitative sous-jacente au présent guide, n’ont pour objet de fournir des conseils sur la meilleure manière de mettre en œuvre un plan de développement d’une collectivité amie des aînés. Les deux guides reconnaissent plutôt qu’une démarche originale des gouvernements locaux et des aînés est essentielle – et que chaque partie d’une collectivité (notamment les gouvernements provinciaux, les organismes de bénévolat, le secteur privé et les groupes de citoyens) peut jouer un rôle dans la création de collectivités amies des aînés. En ce qui concerne des façons de créer un environnement ami des aînés, les processus sont presque aussi variés que la nature et la composition des collectivités elles-mêmes. Nous laissons donc à ces dernières le soin de faire déterminer les meilleures façons de procéder.
En corollaire, des exemples issus de travaux de recherche et de la pratique peuvent donner un aperçu et des mesures à suivre pour aider les collectivités à démarrer et/ou à déployer des effortsNote de bas de page 13. L’approche graduelle indiquée ci-dessous est une fusion de processus, d’étapes et d’astuces pris en compte et/ou mis en place ailleurs. Cette approche vise à fournir des suggestions et non à s’imposer comme mesure normative.
Phase de création d'un comité – Former un comité/une équipe amie des aînés
Une façon de lancer le processus de création d’une collectivité amie des aînés consiste à faire participer divers intervenants, tant publics que privés, par exemple des représentants des gouvernements locaux, provinciaux et territoriaux qui sont bien placés pour favoriser une collaboration dans ce domaine. Les représentants peuvent d’abord fournir aux principaux participants l’occasion de s’impliquer. Les provinces et les territoires peuvent se révéler particulièrement utiles et permettent de recruter des intervenants pour des rôles stratégiques.
Ces intervenants peuvent comprendre, mais non de façon limitative, des responsables élus et des directeurs provenant du domaine communautaire ainsi que des représentants du secteur privé, du milieu des affaires et du milieu bénévole. Les personnes âgées et les organismes qui s’occupent des aînés sont également des acteurs essentiels dans la création d’un comité ami des aînés. Ils peuvent donner leur avis sur ce qui leur convient ou non. Ils peuvent en outre présenter des idées et des solutions novatrices selon leur propre point de vue. Bien entendu, les aînés ne constituent pas un groupe homogène et il convient de veiller à inclure des personnes d’âge, de sexe, de culture et de capacité variés – ce qui permettra d’avoir une perspective aussi globale qu’inclusive de leurs besoins, de leurs points de vue et de leurs suggestions.
Phase d’évaluation – Une évaluation communautaire
Une fois créé, une équipe/un comité local ami des aînés peut accomplir l’importante tâche qui consiste à évaluer la convivialité de la collectivité à l’égard des aînés au moyen de ce guide ou d’autres outils.
Une évaluation des atouts de la communauté, qui contribuent à la convivialité de la collectivité à l’égard des aînés ou qui y font obstacle, est souvent un bon point de départ et la liste de contrôle fournie dans ce guide peut servir à cette fin. Une évaluation détaillée permet idéalement de repérer les réalisations d’une collectivité, notamment la façon dont ses initiatives et ses programmes appuient la convivialité de la collectivité à l’égard des aînés. Les résultats de l’évaluation des services, des programmes et d’autres initiatives offerts dans la collectivité peuvent servir d’élément de discussion central et permettre à de nombreux groupes de participer au dialogue. De surcroît, les résultats peuvent contribuer à l’élaboration d’une « base de référence » permettant d’évaluer les progrès réalisés et d’aider à établir des priorités en matière de mesures à prendre et de changements à apporter.
Voici comment certaines collectivités ont utilisé les résultats de leur évaluation :
- contribution des ministères locaux, provinciaux et territoriaux – peut permettre de déterminer l’état de préparation de la collectivité, les mesures déjà en cours, les plans stratégiques existants et les budgets disponibles;
- contribution de la collectivité – peut aider à l’organisation de sondages, de séances de discussion ouverte ou de forums ainsi que de groupes de discussion, dont les résultats permettront aux planificateurs de comprendre la structure actuelle et celle qui est souhaitable dans la collectivité.
Phase de planification – Définition des défis et des opportunités
Les résultats d’une évaluation permettent au comité/à l’équipe d’identifier les atouts, les obstacles et les forces de la collectivité, de même que les problèmes à aborder au cours de la planification. L’équipe de planification, par exemple, pourra définir différentes méthodes afin de mettre à profit les points forts, de prioriser les problèmes relevés et d’élaborer des recommandations en matière de mesures qui pourront, à leur tour, permettre de guider l’élaboration de stratégies, de plans d’action et de calendriers ainsi qu’une analyse des ressources à mobiliser. L’implication des intervenants locaux permettra d’assurer un soutien continu de la collectivité tant pour les plans que pour les mesures. Idéalement, les forces et les rôles correspondants des divers intervenants doivent être articulés dans le plan.
Un ou plusieurs « champions » peuvent être désignés comme mécanismes utiles permettant de poursuivre sur la lancée en matière de planification et d’action. Les champions (personnes ou groupes) peuvent être des aînés, des membres des médias, des gens d’affaires ou d’autres membres de la collectivité bien placés pour influencer et promouvoir l’engagement.
Phase de mise en œuvre – Application du plan à l’action
La mise en œuvre d’un plan communautaire peut s’effectuer de diverses manières, selon les besoins de la collectivité, les priorités établies, les ressources financières et humaines disponibles ainsi que la portée et la nature de la participation des intervenants. Elle peut s’effectuer par petites étapes, menées par des membres de la communauté locale, ou au moyen d’initiatives d’envergure nécessitant des ressources et des contributions dans un domaine plus étendu (des gouvernements provinciaux et territoriaux, par exemple) et des efforts de collaboration de divers groupes.
Suivi des progrès
En fixant des buts et des objectifs clairs et mesurables dans les plans de mise en œuvre, les collectivités peuvent suivre les progrès réalisés en vue d’accroître la convivialité à l’égard des aînés. Un suivi peut aussi permettre aux planificateurs de réévaluer leurs plans et de revoir leurs priorités et leurs buts, à intervalles prédéterminés, et doit, de préférence, être assuré de manière continue.
Préparer l’avenir
En s’inspirant des travaux en cours, un certain nombre de partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et internationaux (dont l’OMS) collaboreront à des évaluations, à des recherches et à un partage des connaissances afin d’appuyer le développement de collectivités amies des aînés. Les résultats de leurs travaux permettront, entre autres, de créer des possibilités d’échange d’apprentissage et d’outils pouvant être adaptés à d’autres collectivités. Il s’agira notamment de pratiques exemplaires et de conseils sur la manière de planifier et de mettre en œuvre des plans communautaires amis des aînés ainsi que d’outils permettant de mesurer des progrès et des réussites.
Liste de contrôle des caractéristiques d'une collectivité amie des aînés
Les espaces extérieurs et les immeubles
Trottoirs, sentiers et pistes
- Les trottoirs, les sentiers et les pistes sont bien entretenus, dégagés, non glissants et accessibles.
- Les trottoirs sont continus, ont des bordures basses et permettent le passage de fauteuils roulants et de scooters.
- La neige est rapidement dégagée et on tient compte des aînés dans la façon, par exemple, d’amonceler la neige pour permettre aux gens d’entrer dans leur voiture et d’en sortir et permettre aux aînés en fauteuil roulant ou en scooter de circuler.
- Les espaces de stationnement sont bien entretenus, et la neige et la glace sont dégagées.
- Les rues sont bien entretenues.
- Des abris contre la pluie sont à la disposition des piétons.
Toilettes publiques et zones de repos
- Les toilettes publiques sont accessibles et adaptées aux personnes présentant divers handicaps (boutons-poussoirs, portes larges, rampes, verrous faciles à actionner pour les personnes ayant des problèmes d’arthrite, etc.), et elles sont situées à des endroits stratégiques et sont bien affichées.
- Des bancs accessibles (hauteur appropriée aux aînés) sont installés le long des trottoirs, des sentiers et des pistes, et ce, à intervalles réguliers.
Sûreté et sécurité
- Des mesures sont prises pour réduire le taux de criminalité.
- Les quartiers et les sentiers sont bien éclairés.
- Le volume de circulation est faible et/ou bien contrôlé.
Immeubles
- Les immeubles sont accessibles et équipés des éléments suivants :
- rampes avec pente adaptée aux fauteuils roulants;
- moins de marches pour l’accès aux immeubles et à l’intérieur de ces derniers;
- planchers non glissants;
- toilettes accessibles et situées au rez-de-chaussée;
- stationnement bien entretenu et situé près des édifices publics pour en faciliter l’accès.
Commodités (épiceries, églises, édifices gouvernementaux, centres communautaires, etc.)
- Les services sont regroupés au même endroit, situés à proximité des lieux de résidence des personnes âgées et facilement accessibles (se trouvent par exemple au rez‑de‑chaussée d’un immeuble ou sont dotés d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant).
Le transport
Routes
- Les routes sont bien entretenues, bien éclairées et dotées de panneaux de signalisation clairement lisibles.
- La circulation est bien réglementée (en particulier dans les collectivités comptant des résidences d’été et qui connaissent une augmentation du volume de circulation pendant la période estivale).
- Règles routières assouplies – les limites de vitesse ne sont pas imposées (circulation plus lente), il n’y a pas trop de feux de circulation, les conducteurs permettent aux aînés de circuler aisément sur les routes.
- Les lignes de séparation sur la chaussée sont claires et visibles.
Déneigement
- Les routes et les stationnements sont déneigés rapidement.
Stationnement
- Les parcs de stationnement et les stationnements dans la rue sont situés près des commodités.
- La réglementation est imposée (empêcher les gens de se garer dans des zones d’urgence et des espaces réservés aux personnes handicapées).
- Les aires d’embarquement et de débarquement sont clairement identifiées.
- Suffisamment d'espaces de stationnement sont réservés aux personnes handicapées.
Services de transports communautaires
- Des services de transports communautaires abordables et accessibles (par exemple des services de navette) sont offerts aux aînés pour les amener à des activités ou leur permettre de faire des courses ou des sorties à l’extérieur.
- Un réseau bénévole et/ou informel de chauffeurs est disponible et ces derniers sont rétribués (p. ex., essence payée).
Services de transport permettant d’avoir accès à des soins de santé (notamment dans les plus grands centres)
- Des services de transport sont offerts aux aînés pour les conduire à des rendez-vous chez le médecin et les ramener (y compris dans les plus grandes villes) – comprend le transport par bateau et par avion depuis des collectivités éloignées.
Transport adapté
- Toute une gamme de services de transport est offerte aux personnes ayant divers handicaps.
Transport en commun
- Du transport en commun accessible, abordable et pratique (autobus, traversiers, etc.) est mis à la disposition des personnes âgées pour leur permettre de mener leurs activités courantes – par exemple pour se rendre à l'hôpital, dans des centres de santé/communautaires, des centres commerciaux et à la banque.
- Les services de transport en commun sont coordonnés.
- Les services sont offerts en journée comme en soirée.
Taxis
- Des services de taxi accessibles et abordables sont offerts aux aînés.
Information
- De l’information sur la gamme de services de transport (en commun et privé) offerte aux aînés est fournie à ces derniers, notamment des renseignements sur l’utilisation, l’accès, les horaires et les tarifs.
- L’utilisation du transport en commun et de modes de transport alternatifs est encouragée par la collectivité.
Le logement
Choix de logement
- Divers logements appropriés et abordables (à vendre ou à louer) sont offerts; cela comprend des appartements, des unités résidentielles autonomes, des copropriétés plus petites et des logements unifamiliaux.
- Les logements sont abordables et il existe des logements subventionnés.
- La superficie des maisons est fonction des besoins et du style de vie des aînés d’aujourd’hui.
- Les logements sont situés à proximité des services.
- Les logements sont adaptés aux aînés et aux personnes ayant des handicaps.
Vieillir chez soi
- Des services d’aide abordables sont offerts aux aînés pour leur permettre de rester chez eux.
- Des options de logements adaptés sont à la disposition de tous.
- Des logements de « transition » sont disponibles (c.-à-d., choisir entre une grande maison unifamiliale et un petit appartement offrant davantage d’options de logements adaptés que l’on peut considérer comme étant « intermédiaires »).
- Des « systèmes d’alerte » (c.-à-d., des systèmes qui signalent qu'un aîné a besoin d'aide) sont à la disposition des aînés qui vivent seuls.
Soins de longue durée
- Des services abordables de soins de longue durée sont offerts afin d’empêcher la séparation des familles et la nécessité de quitter la collectivité.
Entretien et modifications
- Les services d'entretien général des maisons sont abordables pour les aînés ayant un revenu fixe.
- Des services d’entretien général abordables ou gratuits (p. ex., pour l’entretien de la cour) sont mis à la disposition des aînés.
- Les logements sont adaptés aux aînés, au besoin, et l’on pense au bien-être des aînés lors de la construction de logements.
- Les logements (maisons et appartements) répondent aux besoins des personnes ayant un handicap.
- Les frais liés aux modifications apportées aux logements sont raisonnables et une aide financière sous forme de bourses ou de subventions peut être offerte.
- L’information relative aux programmes d’aide financière permettant d’apporter des modifications au domicile est mise à la disposition des aînés et est facilement accessible.
- L'assurance habitation est abordable.
Le respect et l’inclusion sociale
Preuves de respect, de gentillesse et de courtoisie
- Les aînés sont traités avec respect par la collectivité dans son ensemble – on les aborde en utilisant les titres appropriés, on sollicite leur avis sur des questions liées à la communauté, leurs contributions sont honorées et leurs besoins satisfaits.
Respect et interaction entre les générations
- Les activités communautaires rassemblent les différentes générations – elles comprennent les activités de loisir (arts et artisanat, etc.) et les activités pratiques (p. ex., l’enseignement de l’informatique par des jeunes et les programmes de bénévolat effectué par des grands-parents « honoraires »).
- Des programmes sont offerts aux enfants et aux jeunes et portent principalement sur la manière de traiter avec respect les personnes âgées et expliquent ce que représente le fait de vieillir.
Collectivités inclusives
- Les aînés sont sollicités pour participer à des réunions de conseils et autres activités de cet ordre, et leurs contributions sont reconnues.
- L’avis des personnes âgées est sollicité sur des questions d’intérêt public (au niveau local comme provincial).
- Les aînés reçoivent des visites de membres de leur collectivité.
Activités ou prix de reconnaissance
- La collectivité reconnaît la contribution des aînés par le biais d’activités et/ou de prix.
- Les aînés sont « célébrés » dans les médias (on y présente par exemple leurs histoires).
La participation sociale
Événements et activités
- Divers événements et activités sont offerts aux aînés de tous âges – certains s’adressent à un groupe d’âge spécifique et d’autres sont intergénérationnels. Il peut s’agir notamment d’activités physiques/récréatives, de spectacles sportifs, d’événements dans des lieux de culte et des écoles et de rassemblements où de la nourriture est offerte.
- Des activités ont lieu à l’extérieur (de la marche par exemple) et d’autres à l’intérieur (bingo ou jeux de cartes ou de fléchettes, etc.).
Transport
- Les événements et activités se déroulent dans des endroits desservis par des services de transports abordables et accessibles.
Prévention de l’isolement
- Des visites au domicile sont prévues pour les personnes qui ne sortent pas ou qui ne peuvent pas quitter la maison.
- Un réseau d’entraide est établi pour intégrer les aînés qui ne sont généralement pas actifs dans la collectivité.
- Les besoins des aînés qui ne souhaitent pas participer à la vie communautaire sont respectés.
Cours, artisanat et loisirs
- Divers cours abordables (ou gratuits) sont offerts dans des endroits facilement accessibles (un centre communautaire ou une université, par exemple) et bien desservis par le transport en commun.
Capacité financière et accessibilité
- Les activités et événements se déroulent dans des lieux facilement accessibles à tous – y compris aux personnes ayant un handicap.
- Les événements, les activités culturelles (musique, théâtre, etc.) et autres sont à la mesure des moyens de tous les aînés.
Accent sur la famille
- Les activités et les événements sont intergénérationnels et visent à attirer les personnes d’âges et de milieux différents.
Promotion des activités
- L’information sur les activités organisées est bien transmise aux aînés.
La communication et l’information
Communication générale
- Le gouvernement local et/ou les organismes de bénévolat diffusent de manière régulière et fiable l’information sur les activités et les programmes offerts (notamment les coordonnées de personnes-ressources).
- L’information est diffusée/affichée où les aînés mènent leurs activités courantes – bureau de poste, lieu de culte, centre local et mairie.
- Les chaînes locales (télévision et radio) annoncent les activités communautaires et présentent les nouvelles qui intéressent les aînés – par le biais par exemple de chaînes communautaires.
- Il existe un répertoire central où les personnes âgées peuvent trouver de l’information sur les activités et les services mis à leur disposition et sur la façon d’obtenir des renseignements (y compris des numéros de téléphone).
Interaction (bouche à oreille)
- L’information importante est diffusée dans des forums publics (assemblées publiques et séances d’information).
- L’information destinée aux personnes âgées qui connaissent un isolement social est communiquée par téléphone ou au moyen de visites.
- Un réseau d’intervenants est créé pour diffuser l’information importante (p. ex., sur les questions de santé et la prévention des fraudes).
Information accessible
- Les communications écrites sont imprimées clairement en gros caractères et sont faciles à lire et formulées simplement.
- Des programmes d’alphabétisation sont offerts.
- Des aînés sont recrutés pour offrir bénévolement des services d’experts, de diffuseurs d'information et de formateurs.
Nouvelles technologies
- L’accès aux ordinateurs et à Internet est offert dans un centre local ouvert au public.
- Des cours de formation sur les nouvelles technologies sont offerts et accessibles aux aînés.
Types d’information
- L’information d’intérêt pour les aînés est diffusée – activités locales (liées notamment aux articles nécrologiques), information vitale (santé, sécurité, etc.) et programmes et services mis à la disposition des personnes âgées.
- Les réalisations des aînés sont parfois soulignées dans les médias.
La participation communautaire et les possibilités d’emploi
Bénévolat
- Les activités de bénévolat sont appuyées – on assure, par exemple, le transport des bénévoles, rembourse les dépenses et/ou paie une rétribution.
- Diverses occasions de bénévolat sont créées, selon les intérêts des aînés.
- Les options de bénévolat favorisent l’implication intergénérationnelle.
- Les occasions de bénévolat sont souples (p. ex., court terme) afin d’accommoder les aînés qui voyagent ou ont d’autres engagements.
Emploi
- Une gamme d’emplois rémunérés s’offre aux aînés.
- Les personnes âgées sont rémunérées convenablement pour leur travail.
Accessibilité
- Des mesures sont mises en place pour accommoder les aînés qui ont un handicap et leur permettre de faire du bénévolat ainsi que de participer à des activités communautaires et professionnelles.
- Des services de transport sont offerts et accessibles aux personnes âgées qui souhaitent faire du bénévolat ou participer à des activités communautaires ou rémunérées.
Participation encouragée
- Les personnes âgées sont encouragées à faire du bénévolat et à demeurer engagées dans la collectivité grâce à des modes de participation souples et accessibles.
- Les personnes sont sollicitées pour participer à des activités bénévoles.
Possibilités de formation
- Les personnes âgées devant utiliser des nouvelles technologies lors d'activités rémunérées, communautaires ou bénévoles reçoivent une formation appropriée.
Reconnaissance et gratitude
- Les personnes âgées sont reconnues pour leur participation à des activités bénévoles, communautaires et rémunérées.
Participation communautaire
- Les personnes âgées sont bien représentées dans les conseils, commissions et comités.
Le soutien communautaire et les services de santé
Professionnels empathiques et attentifs
- La collectivité compte des médecins.
- Des infirmières de santé publique sont présentes dans les centres de santé et font des visites à domicile.
- Des spécialistes (notamment des gérontologues) effectuent régulièrement des évaluations dans la collectivité et aménagent un suivi en collaboration avec les médecins de première ligne.
Services de soins de santé et de soutien à domicile
- Des services de soins de santé à domicile abordables et disponibles sont offerts et comprennent les soins personnels et l’entretien ménager.
- Un soutien à domicile est offert dans les meilleurs délais.
- Des programmes de repas abordables sont mis à la disposition de tous les aînés dans la collectivité, quel que soit leur état de santé.
- Des services de livraison (épicerie, médicaments, etc.) ou d’accompagnement pour du magasinage sont offerts aux aînés.
- Les services de livraison sont bien coordonnés (grâce par exemple à des modèles de soins regroupés).
- Des examens de santé sont effectués lors des visites à domicile.
Diversité des établissements et des services de soins de santé
- Les établissements de soins de santé comportent des regroupements de services (médecins, podologues, ergothérapeutes, pharmaciens, etc.), permettant ainsi d’avoir un guichet unique pour les soins de santé ou de mieux-être.
- Des services de soins palliatifs abordables sont offerts dans la collectivité.
- Des services spécialisés sont disponibles dans la collectivité, comme des services de santé mentale, des mammographies, des cliniques du diabète et des soins aux personnes atteintes du cancer.
Disponibilité du matériel et des aides techniques
- De l’équipement médical (notamment des systèmes d’alertes médicales) est disponible par le biais d’un programme de prêts, et ce, sans frais pour les aînés.
Soutien aux aidants naturels (y compris des services de relève)
- Les aidants naturels peuvent bénéficier d’un répit grâce à des programmes, par exemple, de soutien à domicile et de services de garde de jour pour les aînés.
- Des programmes d’éducation sur les soins aux personnes âgées et des services similaires sont offerts aux familles qui s’occupent d’une personne âgée.
L’information
- Les personnes âgées sont bien informées, par le biais de divers médias, des services auxquels elles peuvent avoir droit et des moyens d’avoir accès à ces services.
- Des intervenants fournissent aux aînés de l’information sur divers sujets liés à la santé et au mieux-être.
Notes de fin d’annexe
- 1
-
Organisation mondiale de la Santé, Des « villes-amies » des aînés : un projet mondial , Brochure publiée par l'Organisation mondiale de la Santé, mai 2006.
- 2
-
Pour une introduction au vieillissement actif, veuillez vous reporter au document de l’Organisation mondiale de la Santé, intitulé Vieillissement actif : un cadre d'action .
- 3
-
Pour plus de détails sur la méthodologie et le modèle, veuillez visiter le site de l'Organisation mondiale de la santé et télécharger le document du Protocole de Vancouver .
- 4
-
Ressources humaines et Développement social Canada, L’incapacité au Canada : un profil en 2001. Rapport préparé par le Bureau de la condition des personnes handicapées, Ressources humaines et Développement social Canada.
- 5
-
M. Turcotte et G. Schellenberg, Un portrait des aînés au Canada , 2006 (Ottawa, ON : ministre de l’Industrie), février 2007.
- 6
-
Idem.
- 7
-
Le vieillissement en santé au Canada : une nouvelle vision, un investissement vital; Des faits aux gestes — un document d'information préparé pour le Comité des hauts fonctionnaires (aînés) des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, en septembre 2006.
- 8
-
M. Turcotte et G. Schellenberg, Un portrait des aînés au Canada , 2006 (Ottawa, ON : ministre de l’Industrie), février 2007.
- 9
-
Ce graphique a été créé par The Healthy Children, Women and Seniors Branch, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique .
- 10
-
J. Veninga, « Le capital social et la santé , » Bulletin de recherche sur les politiques en matière de santé, (12 septembre 2006) : p. 21–27.
- 11
-
M. Hall, B. Haven, and G. Sylvestre. The Experience of Social Isolation and Loneliness among Older Men in Manitoba , January 2003. Aging in Manitoba Study, University of Manitoba.
- 12
-
J. Veninga, « Le capital social et la santé , » Bulletin de recherche sur les politiques de santé, (12 septembre 2006) : p. 21–27.
- 13
-
Starting Up: Tips to Begin the “ Measuring Up ” Process.
Cuyahoga County Planning Commission en collaboration avec The Cleveland Foundation, Guide to Elder-friendly Community Building , juin 2004.
Partners for Livable Communities and National Association of Area Agencies on Aging, A Blueprint for Action: Developing a Livable Community for All Ages (Washington, DC), mai 2007.