Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel 2019-2020
C’est avec respect que nous tenons à souligner que la terre sur laquelle nous avons élaboré le présent rapport se trouve sur le territoire ancestral non cédé du peuple Algonquin Anishinaabe. Nous invitons tous les lecteurs de l’île de la Tortue à prendre quelques instants pour reconnaître la terre sur laquelle ils vivent et vaquent à leurs occupations. D’un océan à l’autre, nous reconnaissons le territoire ancestral non cédé de tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui le considèrent comme le leur.
En outre, nous encourageons les lecteurs à réfléchir au passé, à être conscients de la façon dont une dynamique néfaste peut continuer d’être engendrée jusqu’à ce jour et à examiner la manière dont nous pouvons chacun, à notre façon, poursuivre la guérison collective et la véritable réconciliation.
Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel
2019-2020
Table des matières
- Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel 2019-2020
- Message du sous-commissaire principal
- Résumé
- Aperçu des résultats pour 2019-2020
- Texte historique et profil de la population
- Évaluation et admission
- Interventions correctionnelles
- Aperçu des interventions correctionnelles
- Inscriptions aux programmes
- Nombre médian de jours avant l’inscription à un programme
- Achèvement des programmes
- Aiguillage vers des programmes d’éducation et hausse du niveau de scolarité
- Projet de loi C-83, loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi
- Project de loi C-83pour les délinquants autochtones
- Accusations d’infractions disciplinaires et incidents de sécurité
- Sentiers autochtones
- Réinsertion sociale
- Surveillance
- Plan national relatif aux autochtones
- Délinquantes
- Population de délinquantes autochtones purgeant une peine ressort fédéral
- Evaluation et admission
- Interventions correctionnelles
- Réinsertion sociale : audiences de semi-liberté et de libération conditionnelle totale
- Réinsertion sociale
- Réinsertion sociale : emploi et formation professionnelle
- Surveillance
- Considérations relatives aux inuits
- Conclusion
- Ressources supplémentaires
Message du sous-commissaire principal
À titre de sous-commissaire principal, je suis fier de présenter le Rapport annuel 2019-2020 sur le Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA). Il s’agit du 11e rapport annuel qui fournit des résultats sur le rendement des services correctionnels pour Autochtones au sein du Service correctionnel du Canada (SCC). Le rapport examine des points de réussite ainsi que des occasions pour améliorer les résultats correctionnels et répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones dans le cadre du Continuum de soins pour les Autochtones.
L’une des priorités durables de l’organisation consiste à compter sur une approche culturellement adaptée à l’égard des services correctionnels fédéraux, qui répond aux besoins particuliers des délinquants autochtones et qui tient compte de leurs réalités culturelles. Au Canada et à l’étranger, le SCC est largement considéré comme un chef de file dans l’élaboration et l’amélioration continue des services correctionnels fondés sur des données probantes.
Le SCC, conscient des besoins culturels et spirituels propres aux délinquants autochtones, a officiellement adopté le Plan national relatif aux Autochtones pour orienter ses programmes et ses activités et en a poursuivi la mise en œuvre. En 2019-2020, le SCC a connu du succès en ce qui concerne de multiples résultats correctionnels pour les délinquants autochtones, ce qui souligne son engagement à appuyer la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones.
Les tendances à la hausse sont encourageantes, et le SCC demeure déterminé à exercer une influence positive encore plus grande sur ces tendances, tout en se concentrant sur les écarts endémiques qui persistent dans l’ensemble des résultats correctionnels entre les populations de délinquants autochtones et non autochtones. S’attaquer à la représentation disproportionnée des Autochtones dans les services correctionnels et veiller à ce que les intervenants autochtones participent de manière significative, en tant que partenaires autonomes, à la réhabilitation et à la réinsertion sociale efficaces des délinquants autochtones sont des questions de justice sociale pressantes.
En 2019, afin de combler ces écarts continus, le SCC a mis sur pied un Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones pour qu’il fournisse au Comité de direction une analyse stratégique, des conseils horizontaux et des recommandations sur les questions liées aux interventions et aux mesures de soutien à la réinsertion sociale efficaces et adaptées à la culture des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits. C’est un honneur pour moi de présider cet important comité, et j’ai hâte de vous faire part des progrès réalisés à l’échelle du SCC dans les prochaines versions du rapport annuel.
À la suite de consultations avec les intervenants régionaux, nationaux et externes, une liste de priorités thématiques a été dressée pour éclairer l’orientation du Sous-comité. Ces priorités initiales comprennent le Plan national relatif aux Autochtones et le modèle d’intervention des centres d’intervention pour Autochtones (CIA), les programmes correctionnels, les résultats au chapitre de la mise en liberté sous condition, les initiatives des Sentiers autochtones et le recrutement et le maintien en poste d’employés autochtones. Les résultats liés au rendement présentés dans le CRSCA permettent d’adopter une approche fondée sur des données probantes pour formuler des recommandations afin d’améliorer les services correctionnels pour Autochtones au SCC.
À la fin de l’exercice 2019-2020, les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 ont eu une incidence importante sur les opérations du SCC, y compris les interventions, le soutien et les services offerts aux délinquants autochtones. Plus précisément, les services des Aînés ont été fournis dans le cadre d’une approche axée sur le télétravail, et certaines activités, comme la prestation de programmes, ont été suspendues par intermittence conformément aux mesures de santé publique locales, provinciales et fédérales. L’incidence complète de ces mesures sera présentée dans le rapport sur le CRSCA du prochain exercice.
Quoi qu’il en soit, au cours de la dernière année, le SCC a mis davantage l’accent sur la transformation exhaustive des services correctionnels pour Autochtones, au moyen d’activités touchant les dispositions législatives, les politiques et les programmes, afin de trouver des solutions de rechange à l’incarcération et d’améliorer l’offre d’interventions et de mesures de soutien à la réinsertion sociale continues, holistiques, adaptées sur le plan culturel et significatives pour les délinquants autochtones.
Au cours de la prochaine année, j’ai hâte de poursuivre nos efforts collectifs pour aider les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits purgeant une peine de ressort fédéral à retourner dans leur collectivité pour y apporter une contribution positive.
Alain Tousignant
Sous-commissaire principal
Résumé
En 2019, afin de combler les écarts continus dans les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones, le SCC a mis sur pied le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction pour favoriser l’intégration et l’atteinte des objectifs dans les services correctionnels pour Autochtones et effectuer le suivi des résultats organisationnels dans ce domaine. Les commentaires et les recommandations du Sous-comité apporteront une perspective élargie au Comité de direction et aux responsables de secteur et aideront à établir les priorités, à collaborer et à diriger des initiatives organisationnelles clés visant à améliorer les interventions et les mesures de soutien à la réinsertion sociale pour les délinquants issus des Premières Nations et les délinquants métis et inuits.
Il y a de nombreux aspects à explorer dans le cadre d’une transformation complète des services correctionnels fédéraux pour Autochtones. Les domaines qui devraient entraîner les plus importantes répercussions potentielles, sur le plan tant social qu’économique, mettent l’accent sur l’achèvement des programmes correctionnels, les interventions adaptées à la culture, l’affectation des ressources et la collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux.
Le Sous-comité examinera la possibilité d’offrir des services complémentaires et d’élargir les partenariats axés sur les résultats avec les fournisseurs de services autochtones, en plus des approches transformatrices à l’égard de l’affectation des ressources financières et humaines et des façons de régler les problèmes permanents touchant le recrutement et le maintien en poste d’employés autochtones.
Voici les domaines d’intérêt prioritaires cernés :
- lndice du risque criminel (IRC) : Répercussions de l’outil d’évaluation sur les délinquants autochtones.
- Plan national relatif aux Autochtones et centres d’intervention pour Autochtones;
- Taux de suspension et de révocation.
- Initiatives des Sentiers autochtones
- Plans de libération en vertu de l’article 84 de la LSCMLC
- Augmentation du nombre de délinquantes autochtones
- Ressources – Recrutement et maintien en poste
- Domaines globaux
En réponse à l’augmentation mesurable des taux de changement du degré d’intensité des programmes chez les délinquants autochtones depuis l’adoption de IRC, les délinquants autochtones seront aiguillés vers des programmes d’intensité inférieure, le cas échéant, auxquels s’ajouteront des interventions adaptées à leur culture afin de répondre à leurs besoins. Un cadre et des orientations stratégiques claires seront élaborés afin de garantir l’uniformité de l’approche et de l’application.
La restriction relative aux infractions sexuelles sera retirée des critères d’admissibilité pour la participation au modèle des CIA afin de tenir compte des taux de participation inférieurs aux attentes observés dans toutes les régions pour les délinquants autochtones dans les CIA.
Une équipe spéciale se réunira afin d’examiner les domaines d’intérêt prioritaires cernés qui appuieront l’élaboration de stratégies à court et à long terme afin d’améliorer les taux de suspension et de révocation des délinquants autochtones. Une analyse ciblée des raisons expliquant les écarts dans les taux de suspension et de révocation, particulièrement entre les délinquantes autochtones et non autochtones, sera l’une des priorités de l’équipe spéciale.
Le modèle des Sentiers autochtones et ses critères d’admission seront revus afin d’en donner l’accès aux détenus des établissements à sécurité moyenne, ce qui comprend les nouveaux détenus, et de donner plus de chances aux délinquants autochtones des établissements à sécurité maximale d’interagir avec des Aînés, en se concentrant sur la qualité de la participation, plutôt que sur des exigences préétablies en matière de temps. Un examen supplémentaire de la capacité d’accueil des Sentiers autochtones sera mené dans les régions afin de s’assurer que chaque établissement a la bonne capacité d’accueil. Un cadre de mesure des résultats amélioré, fondé sur des définitions de la réussite élargies pour le modèle des Sentiers autochtones, sera élaboré afin de répondre à la perception d’échec et ainsi d’augmenter l’adhésion au sein du personnel.
Des objectifs propres à chaque unité seront mis en œuvre en ce qui concerne la représentation proportionnelle du personnel autochtone, en fonction de la disponibilité au sein de la population active régionale et du modèle de représentation des délinquants. Une plus grande souplesse sera appliquée aux processus de recrutement, ce qui comprend le recours au recrutement non annoncé de candidats autochtones et l’utilisation accrue des bassins de candidats autochtones, établis avec les collectivités, afin d’accroître le recrutement d’Autochtones.
De plus, les examens en cours visant à déterminer et à améliorer les outils et les stratégies d’évaluation normalisés touchant précisément le recrutement se poursuivront en collaboration avec les partenaires. Les stratégies comprendront la mise en œuvre d’initiatives régionales propres aux Autochtones dans le cadre du Programme de formation correctionnelle et d’autres pratiques d’embauche, comme des entrevues garanties et le traitement prioritaire.
Finalement, le Sous-comité examinera la possibilité de renforcer les aspects liés à la gouvernance du portefeuille des initiatives pour les Autochtones et de tirer parti des engagements intersectoriels pour obtenir du soutien financier supplémentaire et établir des synergies dans les domaines de préoccupation commune.
Aperçu des résultats pour 2019-2020
Titre : Aperçu des résultats pour 2019 2020. « Les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne totale » et un groupe de cinq figures féminines accompagnées de puces portant sur les femmes autochtones incarcérées. Au bas de la page, un graphique d’une ampoule allumée accompagne les renseignements sur le Plan national relatif aux Autochtones. Les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne totale. Cependant, ils représentent 26 % de la population totale sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC). La population de délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral a augmenté de 21 % depuis 2015 2016. Au total, 86 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant la première mise en liberté. Le pourcentage de délinquantes autochtones qui obtiennent une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté s’est considérablement amélioré. La première série de résultats est liée aux indicateurs de rendement ventilés intégrés à la stratégie de suivi du rendement du Plan national relatif aux Autochtones.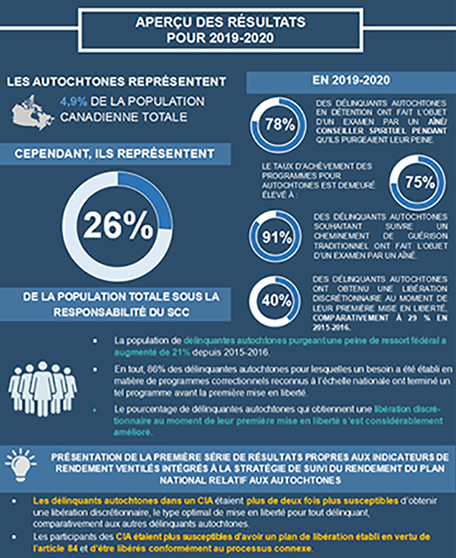
Aperçu des résultats pour 2019-2020
Les autochtones représentent 4,9% de la population canadienne totale cependant, ils représentent 26% de la population totale sous la responsabilité du SCC. En 2019-2020 78% des délinquants autochtones en détention ont fait l’objet d’un examen par un aîné/ conseiller spirituel pendant qu’ils. le taux d’achèvement des programmes pour autochtones est demeuré élevé à 75%. 91% des délinquants autochtones souhaitant suivre un cheminement de guérison traditionnel ont fait l’objet d’un examen par un aîné. 40% des délinquants autochtones ont obtenu une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté, comparativement à 29 % en 2015-2016.
- La population de délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral a augmenté de 21% depuis 2015-2016.
- En tout, 86% des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant la première mise en liberté.
- Le pourcentage de délinquantes autochtones qui obtiennent une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté s’est considérablement amélioré.
- Présentation de la première série de résultats propres aux indicateurs de rendement ventilés intégrés à la stratégie de suivi du rendement du plan national relatif aux autochtones
- Les délinquants autochtones dans un CIA étaient plus de deux fois plus susceptibles d’obtenir une libération discrétionnaire, le type optimal de mise en liberté pour tout délinquant, comparativement aux autres délinquants autochtones.
- Les participants des CIA étaient plus susceptibles d’avoir un plan de libération établi en vertu de l’article 84 et d’être libérés conformément au processus connexe.
Texte historique et profil de la population
Contexte historique et surreprésentation dans le système de justice pénale
<< Au moment de l’arrivée des Européens, les Autochtones leur ont enseigné comment survivre aux quatre saisons sur l’île de la Tortue. À mesure que les Européens ont pris leur aise, les peuples autochtones ont entravé leur désir de prendre le contrôle des terres. De nombreuses politiques coloniales ont tenté de se débarrasser des Autochtones et, à mesure que les Européens se sont déplacés vers l’intérieur des terres, des Autochtones ont été tués ou déplacés. À mesure que de nouveaux gouvernements ont été formés, ils ont pris des décisions stratégiques comme l’établissement des pensionnats, retirant les enfants de leur foyer. La raison était de “faire sortir l’Indien de l’enfant”. Eh bien, en plus de 500 ans, les Autochtones ont fait preuve de résilience et ont survécu malgré les obstacles.
Dans les pensionnats, il n’y avait aucun contact avec la famille ni aucune vie familiale. À la maison, les parents n’avaient pas d’enfants, et on avait l’impression que la vie n’avait pas de but. Les enfants ont été victimes de sévices physiques, psychologiques et sexuels dans les pensionnats. Le nombre de décès y était étonnamment élevé. Finalement, ceux qui ont eu la chance de retourner chez eux l’ont fait. Il n’y avait pas de liens familiaux et ils ne pouvaient plus parler leur langue. Les cérémonies autochtones ont été interdites. Les enfants se sont retrouvés avec des parents qu’ils connaissaient à peine. Beaucoup se sont tournés vers la toxicomanie pour s’en sortir. Il n’y avait pas d’amour, la famille n’était plus la famille et la toxicomanie a envahi de nombreuses collectivités. Les parents et les enfants avaient l’impression qu’ils n’avaient aucune identité ni aucun but dans la vie. La colère à l’égard des systèmes coloniaux et de la vie elle-même a été transmise aux enfants. Beaucoup sont partis ou se sont enfuis de chez eux.
Bon nombre d’entre eux finissent par être incarcérés, après être passés par un système de justice pénale principalement dirigé par des personnes qui ne comprennent pas fondamentalement ce que c’est que d’être un Autochtone. En raison du passé, les jeunes et les adultes font face à des problèmes d’identité, à un manque d’amour et à l’absence de but et ressentent de la haine, de la colère, de la douleur intérieure et de la méfiance. Maintenant que les gardiens du savoir autochtone, les Aînés et les agents de liaison autochtones travaillent avec notre peuple à l’intérieur, en tenant des séances individuelles et des cérémonies et en faisant preuve d’amour, nous constatons un certain succès. Certaines personnes sont toujours en contact avec les Aînés du SCC après leur libération, car elles continuent de recevoir leur soutien. »
- Aîné Dan Ross
Les politiques gouvernementales passées, principalement conçues pour assimiler la population autochtone, ont instauré un climat négatif chez des générations d’Autochtones. Ces politiques étaient fondées en partie sur la croyance européenne selon laquelle les Premières Nations, les Métis et les Inuits n’étaient pas civilisés, perception dont l’ampleur était proportionnelle au besoin de terres des colonisateurs. Les politiques comprenaient les pensionnats, la rafle des années 1960, la réinstallation forcée, la sédentarisation et l’institutionnalisation. Différentes mesures ont touché principalement certains groupes, et les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont des histoires et des expériences divergentes par rapport au gouvernement.
En plus d’autres lois et pratiques nuisibles, les efforts d’assimilation ont conduit à la rupture des normes et des valeurs des collectivités autochtones, au déplacement et à la perte des terres traditionnelles et à la perte des rituels et des traditions qui avaient maintenu la stabilité de la société, comme les systèmes de croyances, les codes moraux, les règles de comportement, les rites de passage, l’histoire culturelle et les réseaux de soutien.
Les crises économiques, politiques et sociales qu’ont subies les Autochtones en conséquence sont évidentes lorsqu’on examine les problèmes qui touchent actuellement de nombreuses collectivités, y compris les niveaux disproportionnés d’incarcération, de pauvreté, de chômage, de toxicomanie et de violence familiale chez les Autochtones et l’absence d’autonomie économique et d’infrastructure commerciale.
La surreprésentation des Autochtones dans le système de justice a mené la Cour suprême du Canada (R. c. Gladue – 1999) à informer les juges de leur responsabilité de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques qui ont touché négativement, de façon directe ou indirecte, les délinquants autochtones, ainsi que de l’histoire individuelle et collective des peuples autochtones au moment d’imposer une peine à un délinquant autochtone. Les juges ont le devoir, s’il y a lieu, de chercher des solutions de rechange à l’emprisonnement qui conviennent mieux aux délinquants autochtones.
Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques
Un fil chronologique montre les événements du processus de désintégration culturelle par l’État entre 1763 et 1982. Détails : 1763 – Proclamation royale; 1831 – Ouverture du Mohawk Indian Residential School; 1867 – Acte de l’Amérique du Nord britannique; 1876 – Loi sur les Indiens; 1892 – Convention officielle entre le Canada et les églises chrétiennes concernant les pensionnats indiens; Années 1950 1970 – Massacre des chiens de traîneaux des Inuits; 1960 – Droit de vote aux élections fédérales; Années 1960 1980 – Rafle des années soixante; 1982 – Loi constitutionnelle (article 35 sur les droits des Autochtones) Suite du fil chronologique de la page précédente montrant les événements du processus de résurgence. Détails : 1985 – Projet de loi C 31 et modifications à la Loi sur les Indiens concernant le genre; 1995 – Reconnaissance du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale; 1996 – Fermeture du dernier pensionnat indien; 2007 – Convention de règlement relative aux pensionnats indiens; 2008 – Excuses du gouvernement du Canada; 2015 – Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens; 2016 – Le Canada adopte la DNUDPA et lance l’Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées; 2019 – Le GC présente ses excuses pour les mauvais traitements coloniaux et intentionnels infligés aux Inuits atteints de tuberculose/Convention de règlement relative aux externats indiens.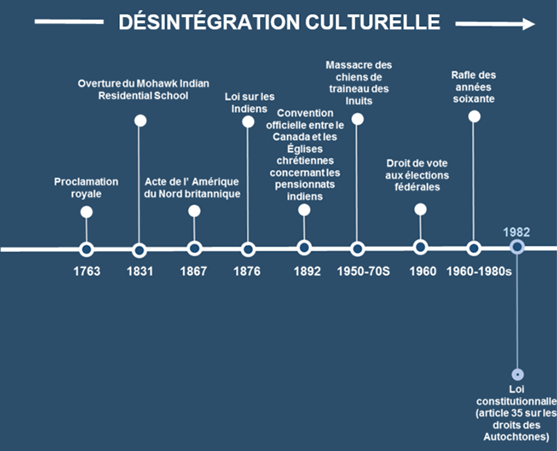
Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques, 1763 1982.
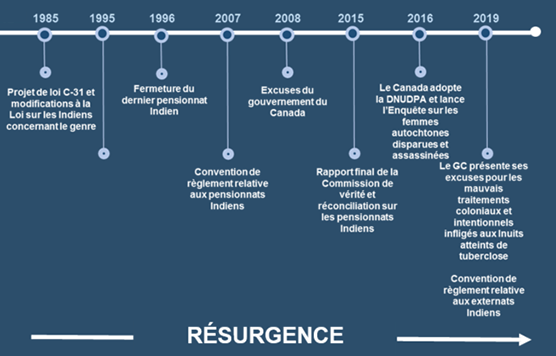
Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques, 1985 2019.
Priorités du gouvernement du canada et du SCC
Pandémie de COVID-19
Comme pour d’autres ministères et organismes du gouvernement du Canada, les opérations du SCC ont été grandement touchées par la pandémie mondiale de COVID-19 vers la fin de la période visée par le rapport. Les mesures de santé publique efficaces prises pour prévenir la propagation du virus et protéger les délinquants sous la responsabilité du SCC ont eu des répercussions variées sur la prestation des interventions et des services. Guidé par les organismes de santé publique locaux, provinciaux et fédéraux, le SCC a élaboré et mis en œuvre un cadre de gestion du risque (CGR) pour passer à la nouvelle normalité. Le CGR définit les activités correctionnelles, les risques et les stratégies d’atténuation pour protéger le personnel et les délinquants du SCC, dans le respect de la loi et compte tenu de la réalisation du mandat législatif du SCC.
Lutte contre le racisme et la discrimination systémiques dans les institutions fédérales
Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022 est orientée par la vision d’un Canada où tous les Canadiens bénéficient d’un accès et d’une participation équitables aux sphères économique, culturelle, sociale et politique. Elle jette les bases d’une action à long terme en soutenant les trois principes directeurs suivants : faire preuve de leadership fédéral, habiliter les communautés et sensibiliser les gens et changer les attitudes.
Le gouvernement du Canada s’engage à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques lorsqu’il est constaté qu’ils existent au sein des institutions fédérales et dans les politiques, les programmes et les services publics. Compte tenu de la nécessité d’une intervention gouvernementale coordonnée, un Secrétariat de lutte contre le racisme a été mis sur pied pour diriger les efforts dans l’ensemble du gouvernement en vue de coordonner les mesures fédérales et pour cerner et élaborer d’autres domaines d’intervention en collaboration avec les collectivités et les peuples autochtones, les intervenants et les autres ordres de gouvernement.
Unis dans la diversité
En 2017, Gina Wilson, sous-ministre championne des employés fédéraux autochtones, a dirigé des cercles interministériels sur la représentation autochtone. Dans le cadre de consultations avec des fonctionnaires fédéraux actuels et passés, on a cherché à mieux comprendre les défis et les obstacles auxquels font face les peuples autochtones dans la fonction publique.
La stratégie élaborée par les cercles, intitulée Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation, est une stratégie pangouvernementale qui vise à réduire et à éliminer les obstacles à l’emploi dans la fonction publique auxquels font face les peuples autochtones et à tirer parti de la diversité des expériences et des idées que les employés autochtones apportent à la fonction publique.
En réponse, le SCC a lancé l’initiative Relier les esprits, créer des occasions (RECO) en 2019. L’initiative vise à appuyer le perfectionnement professionnel des employés autochtones qui travaillent dans le Continuum de soins pour les Autochtones (CSA). RECO est une initiative qui vise à soutenir les employés autochtones qui œuvrent dans le CSA de manière à favoriser leur avancement et à conserver leurs compétences et leurs perspectives au sein du SCC. Les délinquants autochtones pourront ainsi avoir accès à du personnel autochtone et à des interventions et à des programmes adaptés à leur culture et recevoir le soutien axé sur la culture dont ils ont besoin. Le SCC reconnaît que les employés autochtones jouent un rôle essentiel pour soutenir les délinquants autochtones tout au long de leur processus de guérison.
Au-delà de 2020
Le SCC est guidé par les principes d’Au-delà de 2020, l’engagement pris à l’échelle de la fonction publique en vue d’examiner les mentalités et les comportements qui aident à bâtir une fonction publique plus agile, novatrice, plus inclusive et mieux outillée. Diverses initiatives sont en place pour veiller à ce que l’organisation soit outillée pour promouvoir des pratiques de dotation inclusives et la résolution créative de problèmes afin d’offrir des interventions et des services pertinents et adaptés sur le plan culturel en vue de répondre aux besoins des délinquants autochtones.
Commission de vérité et réconciliation
En 2009, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a amorcé un processus pluriannuel visant à écouter les survivants, les collectivités et les autres personnes touchées par le système des pensionnats. En tout, 94 appels à l’action ont été lancés pour corriger les torts causés par ces pensionnats et faire progresser la réconciliation, y compris trois (3) qui ont une incidence directe sur les activités du SCC, soit les appels à l’action 35, 36 et 37.
Le SCC utilise ces appels à l’action comme guide afin de combler davantage les écarts dans les résultats correctionnels entre les délinquants autochtones et non autochtones purgeant une peine de ressort fédéral.
Femmes et filles autochtones disparues et assassinées
Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées révèle que les taux renversants de violence dirigée contre les femmes, les filles et les personnes ayant diverses identités de genre des collectivités autochtones au Canada sont le fruit de violations persistantes et délibérées des droits de la personne et des droits des Autochtones. Le rapport a donné lieu à 231 appels à la justice adressés aux gouvernements, aux institutions, aux fournisseurs de services sociaux, aux industries et à tous les Canadiens. Douze (12) de ces appels à la justice visent le SCC et quatre (4) visent tous les ordres de gouvernement liés aux services correctionnels.
Le SCC continue de répondre aux appels à la justice 157 à 167 et 169. Ces appels à la justice guident le travail du SCC visant à améliorer les résultats correctionnels pour les femmes autochtones et les personnes ayant diverses identités de genre.
Déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones
Le gouvernement du Canada s’est engagé à établir une relation de nation à nation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat et enracinée dans les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Depuis mai 2016, le Canada appuie pleinement, et sans réserve, la déclaration.
La DNUDPA est un document qui décrit les droits individuels et collectifs des peuples autochtones du monde entier. Elle fournit aux États, aux Nations Unies et à d’autres organisations internationales des lignes directrices sur l’établissement de relations axées sur la collaboration avec les peuples autochtones et fondées sur les principes d’égalité, de partenariat, de bonne foi et de respect mutuel.
Déterminants socioéconomiques de la criminalité
Les Autochtones sont surreprésentés de façon disproportionnée dans les pénitenciers fédéraux, comparativement aux délinquants non autochtones. Les taux élevés d’incarcération des Autochtones peuvent être attribués aux effets passés et continus du colonialisme. L’histoire de la colonisation continue d’avoir des répercussions sur les collectivités autochtones en raison de l’aliénation culturelle, de la dépossession territoriale, du déplacement, des traumatismes intergénérationnels, de la discrimination systémique et de la marginalisation socioéconomique.
Comprendre les répercussions du colonialisme et la façon dont les systèmes de justice peuvent contribuer aux séquelles qui en découlent nous permet de cerner les déterminants socioéconomiques de la criminalité chez les peuples autochtones. Ce faisant, le SCC peut reconnaître ces besoins et y répondre d’une manière appropriée sur le plan culturel afin d’accroître la réussite de la réhabilitation et de la réinsertion sociale.
Un ensemble vertical de cinq graphiques liés entre eux, qui représentent chacun les principaux points contenus dans un certain nombre de catégories. Détails : Image comportant cinq icônes distinctes. La première icône est une balance qui représente la justice avec le texte suivant : La deuxième icône, un groupe de trois maisons, représente les conditions de vie et est accompagnée du texte suivant : La troisième icône est celle de deux adultes et d’un enfant représentant les mauvais traitements durant l’enfance, accompagnée du texte suivant : La quatrième icône est le profil d’une tête avec une croix de premiers secours représentant la santé et le bien être, accompagnée du texte suivant : La cinquième et dernière icône, une personne tenant des livres et une mallette, représente l’éducation et l’emploi et est accompagnée du texte suivant :
Déterminants socioéconomiques de la criminalité.
Profil des délinquants
Les principaux points sont accompagnés de graphiques simples pour appuyer l’énoncé suivant : « Comparativement aux délinquants non autochtones, les délinquants autochtones sont plus susceptibles de répondre aux critères suivants : » Détails : Comparativement aux délinquants non autochtones, les délinquants autochtones sont plus susceptibles de répondre aux critères suivants :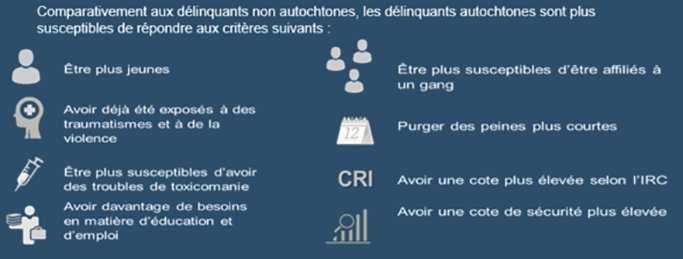
Profil des délinquants.
Besoins globaux les délinquants autochtones représentent 8 % des délinquants ayant de faibles besoins, mais 37 % de ceux ayant des besoins élevés.
Risque global les délinquants autochtones représentent 14 % des délinquants à faible risque, mais 34 % des délinquants à risque élevé.
À bien des égards, la population de délinquants autochtones diffère grandement de la population de délinquants non autochtones. Comme le montre le graphique ci-dessous, les délinquants autochtones sont plus jeunes, sont plus susceptibles d’avoir purgé une peine de ressort fédéral par le passé, sont incarcérés plus souvent pour une infraction avec violence, présentent un risque et des besoins plus élevés et sont plus susceptibles d’être associés à un gang.
Il existe également des différences dans les profils criminogènes des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits purgeant une peine de ressort fédéral. Ces tendances complexifient l’harmonisation entre les initiatives stratégiques, la prise de décisions concernant les interventions correctionnelles et les profils criminogènes et les besoins uniques des différents groupes de délinquants autochtones.
Bien que les délinquants autochtones soient souvent examinés comme une seule sous-population, les délinquants issus des Premières Nations et les délinquants métis et inuits ont des traditions, des cultures et des visions du monde distinctes. Les recherches du SCC soulignent qu’ils présentent des caractéristiques uniques qui doivent être comprises et prises en compte par les décideurs.
Un graphique à barres horizontales compare les statistiques concernant les délinquants autochtones et non autochtones. Les délinquants autochtones sont généralement plus jeunes, plus susceptibles d’avoir déjà purgé une peine de ressort fédéral, d’être plus souvent en détention pour une infraction avec violence, d’avoir une cote de risque et de besoin plus élevée et d’être plus souvent affiliés à un gang. Détails : 44 % des délinquants autochtones et 35 % des délinquants non autochtones sont âgés de 30 ans ou moins au moment de leur incarcération; 37 % des délinquants autochtones et 32 % des délinquants non autochtones purgent une peine de moins de quatre (4) ans; 69 % des délinquants autochtones et 57 % des délinquants non autochtones purgent une peine pour meurtre au premier ou au second degré, ou pour une infraction prévue à l’annexe I; 16 % des délinquants autochtones et 23 % des délinquants non autochtones sont incarcérés pour une infraction sexuelle; 95 % des délinquants autochtones et 86 % des délinquants non autochtones présentent un niveau de risque statique initial moyen ou élevé; 98 % des délinquants autochtones et 93 % des délinquants non autochtones ont un besoin lié aux facteurs dynamiques moyen ou élevé; 77 % des délinquants autochtones et 59 % des délinquants non autochtones ont un premier résultat sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité moyen ou élevé; 84 % des délinquants autochtones et 65 % des délinquants non autochtones ont une CSD moyenne ou élevée lors de la première décision.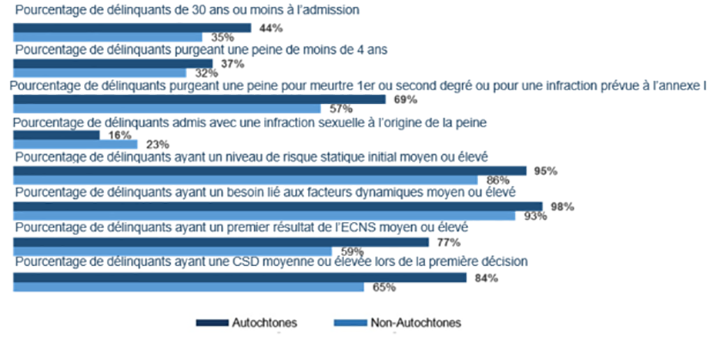
Profil des délinquants.
Profil de la population
Selon le Recensement de 2016 de Statistique Canada, les Autochtones représentaient alors 4,9 % (n=1 673 780) de la population totale canadienne. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la proportion observée en 2006 et en 1996, qui était respectivement de 3,8 et 2,8 %. D’après les renseignements recueillis dans le Recensement de 2016, la population autochtone a augmenté de 42,5 % depuis 2006. Ces données sont importantes puisqu’elles jettent un éclairage sur la surreprésentation et la diversité des délinquants autochtones dans le système correctionnel fédéral.
Le nombre total de délinquants sous la responsabilité du SCC est demeuré stable au cours des dernières années. À la fin de l’exercice 2019-2020, le SCC était responsable de 23 101 délinquants. De ce nombre, 13 719 étaient incarcérés et 9 382 faisaient l’objet d’une surveillance dans la collectivité.
Les Autochtones représentaient environ 5 % de la population canadienne, mais 26 % de la population sous la responsabilité du SCC à la fin de 2019-2020. Les délinquants autochtones représentaient 30 % de la population sous garde et 20 % de la population sous surveillance dans la collectivité.
La population de délinquantes autochtones a augmenté de 21 % depuis 2015-2016. Ces dernières représentent maintenant 34 % des délinquantes sous la responsabilité du SCC. La surreprésentation était encore plus prononcée pour la population carcérale, puisque les délinquantes autochtones représentaient 41 % de la population totale des délinquantes sous garde à la fin de l’exercice 2019- 2020.
Une carte du Canada en bleu pâle et bleu foncé montre le changement de la population de délinquants autochtones de 2015 2016 à 2019 2020 dans les régions du Pacifique, des Prairies, de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique du SCC en 2019 2020 et le pourcentage d’augmentation ou de diminution de la population de délinquants autochtones (de 2015 2016 à 2019 2020). Détails : Dans la région du Pacifique, 19 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 16 % (de 970 à 1 128); dans la région des Prairies, 50 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 13 % (de 2 638 à 2 989); dans la région de l’Ontario, 16 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 34 % (de 720 à 966); dans la région du Québec, 10 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage de diminution est de 12 % (de 652 à 573); et dans la région de l’Atlantique, 6 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 50 % (de 247 à 371). Un graphique à lignes horizontales rouge et bleu montre le pourcentage de délinquants autochtones en détention et la population autochtone au Canada de 2010 2011 à 2019 2020. Détails : En 2010 2011, 21 % des délinquants en détention étaient des autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2011 2012, 22 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2012 2013, 22 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2013 2014, 23 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2014 2015, 25 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2015 2016, 26 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2016 2017, 27 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2017 2018, 28 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2018 2019, 29 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2019 2020, 30 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale.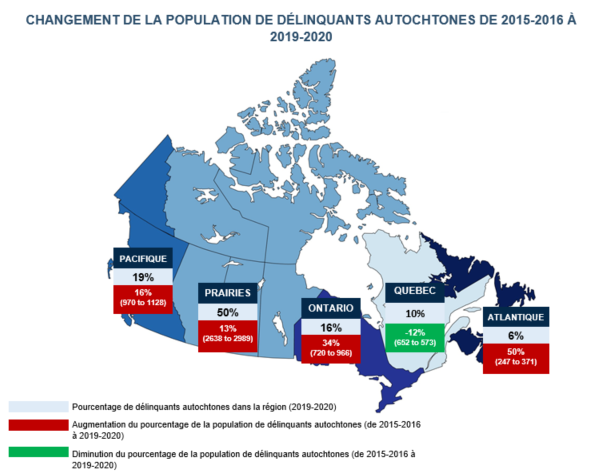
Changement de la population de délinquants autochtones de 2015 2016 à 2019 2020.
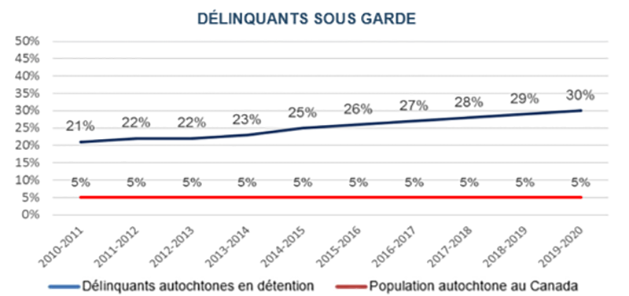
Délinquants sous garde.
En 2019-2020, les délinquants autochtones représentaient 30 % de la population sous garde. Cela constitue une augmentation de 35 % depuis 2009-2010. Les délinquants métis et issus des Premières Nations étaient plus susceptibles d’être incarcérés et de faire l’objet d’une surveillance dans les régions des Prairies et du Pacifique, comparativement aux délinquants inuits, qui étaient plus susceptibles de résider dans les régions de l’Ontario et du Québec.
Deux graphiques circulaires comparent le pourcentage de groupes de délinquants autochtones des Premières Nations, des Inuits et des Métis sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada en 2019 2020 et en 2015 2016. Détails : En 2019 2020, 3 % des délinquants autochtones étaient des Inuits, 29 % des Métis et 68 % des membres des Premières Nations. En 2015 2016, 4 % des délinquants autochtones étaient des Inuits, 28 % des Métis et 68 % des membres des Premières Nations.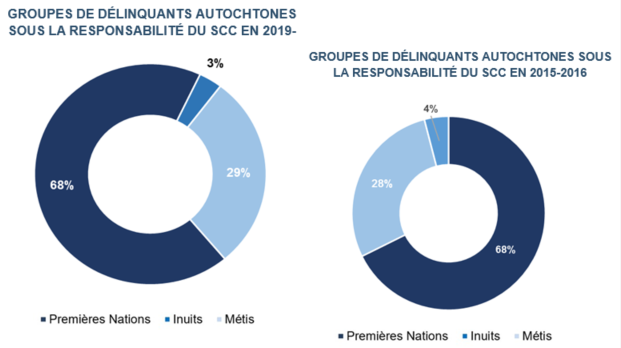
Groupes de délinquants autochtones sous la responsabilité du SCC en 2019 2020 et en 2015 2016.
La population de délinquants des Premières Nations est le groupe autochtone sous la responsabilité du SCC dont la croissance est la plus rapide, ayant augmenté de 17 % (passant de 3 520 à 4 109) depuis 2015-2016. En comparaison, la population de délinquants métis a augmenté de 16 % (passant de 1 473 à 1 721) depuis 2015-2016. Cependant, la population de délinquants inuits a diminué de 14 % (passant de 229 à 197) au cours de la même période.
Évaluation et admission
L’étape d’évaluation pour les délinquants autochtones est un moment crucial, car le SCC a alors l’occasion de recueillir et d’étudier des facteurs relatifs aux antécédents sociaux des Autochtones (ASA) individuels et collectifs et cette étape encourage les délinquants à prendre part au Continuum de soins pour les Autochtones. À cette étape, les délinquants autochtones reçoivent des services de la part d’Aînés/de conseillers spirituel et d’agents de liaison autochtones, ainsi que des renseignements sur les programmes culturels et spirituels, les pavillons de ressourcement et les articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
Au sein du SCC, il n’y a pas de demande officielle à présenter relativement aux services pour Autochtones. L’un des repères utilisés est la réponse donnée par le délinquant à la question posée au moment de l’admission concernant son intérêt à suivre un cheminement de guérison traditionnel. À la fin de 2019-2020, environ 4 000 délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral souhaitaient suivre un cheminement de guérison traditionnel.
Les cotes de sécurité des délinquants et le placement de ces derniers dans les établissements du SCC sont fondés sur des mesures qui assurent la protection de la société, du personnel et des délinquants ainsi que sur la gestion efficace de la peine des délinquants et du soutien nécessaire à la réussite de leur réhabilitation et de leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.
La politique du SCC exige la prise en compte des ASA dans les décisions liées à la gestion des cas ayant une incidence sur les délinquants autochtones, y compris la cote de sécurité initiale et le placement pénitentiaire. Les ASA consistent à tenir compte des facteurs systémiques et historiques qui ont touché la vie des Autochtones. Ils fournissent une justification fondée sur des données probantes pour envisager des solutions de rechange axées sur la justice réparatrice et adaptées à la culture des délinquants autochtones dans le milieu correctionnel.
Une compréhension des ASA aide le SCC à travailler de façon plus efficace et mieux adaptée sur le plan culturel auprès de chaque délinquant autochtone. Cela lui permet de mieux répondre aux besoins d’un délinquant, augmentant ainsi son potentiel de réinsertion sociale et de guérison.
En 2019-2020, les délinquants autochtones (n=1 265) représentaient 28 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt (MD). Au cours des cinq (5) dernières années, il y a eu une augmentation graduelle du pourcentage d’admissions de délinquants autochtones, qui s’établissait à 25 % en 2015-2016. Les délinquantes autochtones (n=120) représentaient 34 % des délinquantes admises en vertu d’un MD en 2019- 2020. Cette proportion était de 33 % (n=128) en 2015-2016.
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le nombre de délinquants autochtones et non autochtones admis en vertu d’un mandat de dépôt de 2015-2016 à 2019-2020. En 2015 2016, 25 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 25 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 27 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 27 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 28 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones.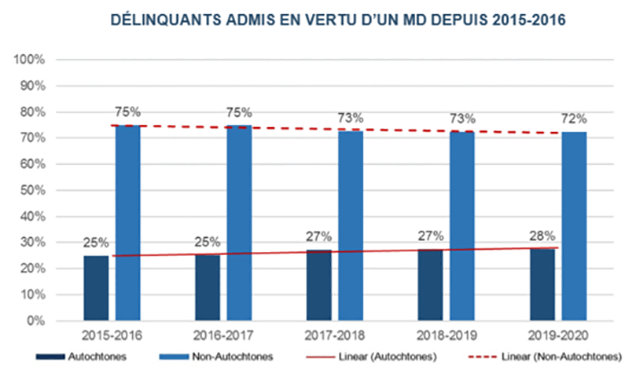
Délinquants admis en vertu d’un MD depuis 2015 2016.
Les réévaluations de la cote de sécurité et les placements pénitentiaires sont des décisions distinctes prises par les directeurs d’établissement à la suite d’un examen approfondi du dossier d’un délinquant. Les principaux facteurs qui entrent en compte dans ces décisions comprennent l’évaluation clinique, réalisée par une équipe de gestion de cas qualifiée, de l’adaptation à l’établissement, du risque d’évasion et du risque pour la sécurité publique; le résultat à l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) fondée sur des données probantes; et, le cas échéant, l’évaluation du risque psychologique, les antécédents sociaux des Autochtones (ASA), ou tout autre renseignement propre au cas.
De manière générale, en 2019-2020, un taux plus élevé de délinquants autochtones pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés par rapport aux délinquants non autochtones. Comme il est illustré ci-dessous, 47 % (n=150) des délinquants autochtones pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés, comparativement à 31 % (n=418) des délinquants non autochtones. L’écart dans les résultats correctionnels à ce chapitre entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones demeure important.
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le nombre de délinquants autochtones et non autochtones pour lesquels l’Échelle de classement par niveau de sécurité recommandait une cote minimale et qui ont obtenu une cote supérieure de 2015 2016 à 2019 2020. En 2015 2016, 42 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 33 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2016 2017, 41 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2017 2018, 38 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 29 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2018 2019, 45 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2019 2020, 47 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones.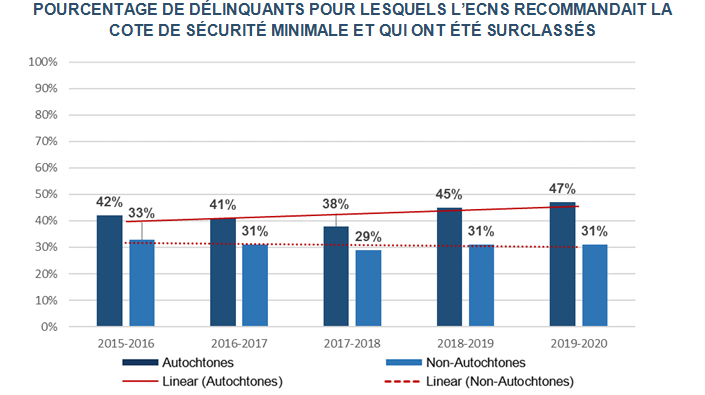
Pourcentage de délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont été surclassés.
Conformément aux exigences législatives, le SCC classe les délinquants et les place dans les établissements en fonction du niveau de risque qu’ils présentent et leur offre l’accès aux interventions, programmes et services qui répondront à leurs besoins.
En 2019-2020, 19 % des délinquants autochtones sous garde avaient une cote de sécurité minimale, 70 %, une cote de sécurité moyenne et 12 %, une cote de sécurité maximale. En comparaison, 38 % des délinquants non autochtones sous garde avaient une cote de sécurité minimale, 54 %, une cote de sécurité moyenne et 8 %, une cote de sécurité maximale.
Le pourcentage de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité maximale est demeuré relativement stable au cours des trois (3) dernières années. Le nombre de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité moyenne a légèrement augmenté (passant de 64 % en 2017-2018 à 70 % en 2019-2020), tandis que le nombre de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité minimale a diminué (passant de 25 % en 2017-2018 à 19 % en 2019-2020).
Un graphique à lignes horizontales montre les pourcentages de la répartition des cotes de sécurité initiales, soit minimale, moyenne ou maximale, pour les délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : Comparaison des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020, les délinquants autochtones ayant systématiquement une répartition plus fréquente des cotes de sécurité maximale et moyenne, et une répartition moins fréquente de la cote de sécurité minimale que les délinquants non autochtones. Cote de sécurité moyenne : Les pourcentages pour les Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit dans l’ordre 71 %, 69 %, 64 %, 67 % et 70 %; les pourcentages pour les non Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit dans l’ordre 55 %, 54 %, 50 %, 54 % et 54 %. Cote de sécurité minimale : Les pourcentages pour les Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit 18 %, 19 %, 25 %, 21 % et 19 %; les pourcentages pour les non Autochtones ont fluctué chaque année, soit 37 %, 39 %, 42 %, 38 % et 38 %. Cote de sécurité maximale : Les pourcentages pour les Autochtones sont demeurés relativement stables chaque année de 2015 à 2020, soit 11 %, 12 %, 12 %, 12 % et 12 %; les pourcentages pour les non Autochtones sont demeurés relativement stables chaque année, soit 8 %.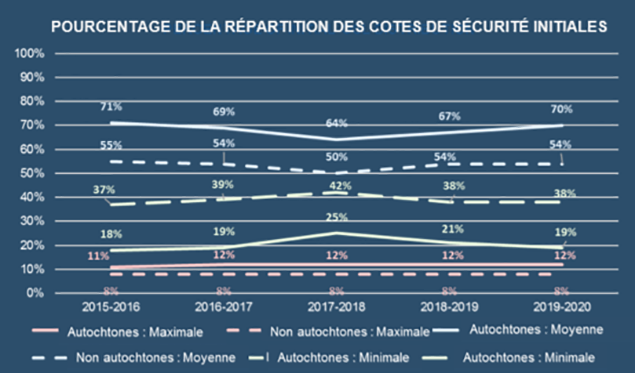
Pourcentage de la répartition des cotes de sécurité initiales.
En 2018-2019, un taux plus élevé de délinquants autochtones lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés par rapport aux délinquants non autochtones.
Un graphique à barres verticales compare les délinquants autochtones et non autochtones ayant obtenu une cote inférieure ou supérieure à la cote qui leur avait été attribuée initialement de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : Un taux plus élevé de délinquants autochtones, pour lesquels l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) indiquait une cote de sécurité minimale, a été transféré à un niveau de sécurité plus élevé, comparativement aux délinquants non autochtones. En 2015 2016 : En 2016 2017 : En 2017 2018 : En 2018 2019 : En 2019 2020 :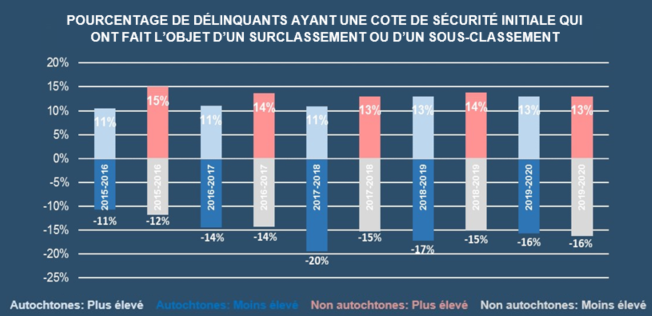
Pourcentage de délinquants ayant une cote de sécurité initiale qui ont fait l’objet d’un surclassement ou d’un sous classement.
Pavillons de ressourcement
Une participation accrue des collectivités autochtones à la planification de la mise en liberté des délinquants autochtones est essentielle à l’obtention de meilleurs résultats correctionnels pour ceux-ci. Pour régler le problème du nombre disproportionné de délinquants autochtones incarcérés, le SCC encourage les collectivités autochtones à tirer pleinement parti du potentiel de la LSCMLC, en particulier les articles 81 et 84. Les pavillons de ressourcement et les mises en liberté en vertu de l’article 84 continuent de jouer un rôle clé en offrant aux délinquants autochtones des interventions et des mesures de soutien adaptées à leur culture qui favorisent leur réinsertion sociale réussie.
Les pavillons de ressourcement sont gérés soit par le SCC, en étroite collaboration avec les collectivités autochtones, soit par un corps dirigeant ou un organisme autochtone en vertu de l’article 81 de la LSCMLC. Il y a actuellement quatre (4) pavillons de ressourcement exploités par le SCC dans les régions du Pacifique et des Prairies.
Aux termes de l’article 81 de la LSCMLC, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ou une personne autorisée par ce dernier) peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. À l’heure actuelle, cinq (5) accords en vertu de l’article 81 ont été conclus avec des corps dirigeants et des organismes autochtones en ce qui concerne six (6) pavillons de ressourcement visés à l’article 81.
Des dix (10) pavillons de ressourcement qui hébergent des délinquants sous responsabilité fédérale, sept (7) sont des établissements à sécurité minimale pour hommes et trois (3) sont des établissements à niveaux de sécurité multiples qui accueillent des femmes classées à sécurité minimale et, au cas par cas, à sécurité moyenne.
En 2019, le SCC a signé un accord avec l’Eagle Women’s Lodge de l’Indigenous Women’s Healing Centre, qui est devenu le sixième pavillon de ressourcement établi en vertu de l’article 81 pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral.
L’Eagle Women’s Lodge propose des programmes holistiques qui mettent l’accent sur l’identité de soi, l’estime de soi, le cycle intergénérationnel de violence, le deuil et la perte, ainsi que les traumatismes intergénérationnels. Les occasions fournies sur place pour améliorer l’éducation et les compétences professionnelles favorisent également la croissance personnelle et spirituelle. Les résidentes ont la possibilité de guérir, de grandir et de renouer avec la culture autochtone grâce à des activités, des mesures de soutien et des cérémonies offertes par des Aînés/conseillers spirituels. Les délinquantes autochtones bénéficient d’un meilleur accès à la famille, à un soutien communautaire et à des programmes ainsi que d’une mise en liberté graduelle et structurée dans un environnement culturel autochtone, ce qui entraîne de meilleurs résultats au chapitre de la réinsertion sociale à long terme. Cette installation à niveaux de sécurité multiples peut accueillir jusqu’à 30 délinquantes.
Le SCC a examiné et met actuellement à jour un certain nombre de ses politiques afin d’assurer l’évaluation en temps opportun des demandes présentées par des corps dirigeants et des organismes autochtones en vue de conclure un accord en vertu de l’article 81, tout en améliorant la façon dont il traite le transfèrement des délinquants autochtones vers les pavillons de ressourcement dans le cadre de leur plan de réinsertion sociale.
Le SCC est actuellement en pourparlers avec un certain nombre de corps dirigeants et d’organismes autochtones intéressés à conclure un accord en vertu de l’article 81 avec le ministre pour assurer les soins et la garde de délinquants autochtones. Le SCC s’engage toujours à conclure des partenariats continus avec les collectivités autochtones par la tenue régulière de séances de mobilisation.
Zone de texte: Appel à l’action 35 de la Commission de vérité et réconciliation : Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer les obstacles à la création de pavillons de ressourcement additionnels pour détenus autochtones au sein du système correctionnel fédéral.
Aperçu : Carte du Canada en bleu pâle et bleu foncé indiquant l’emplacement de 10 pavillons de ressourcement visés par l’article 81 ou exploités par le Service correctionnel du Canada dans les provinces du pays. Détails : Pavillons de ressourcement exploités par le SCC : • Village de guérison Kwìkwèxwelhp situé à Harrison Mills (Colombie Britannique); Pavillons de ressource visés à l’article 81 et gérés par la collectivité ou par des organismes partenaires conformément à la LSCMLC : • Centre de guérison Stan Daniels (géré par l’organisme Native Counselling Services of Alberta) situé à Edmonton (Alberta);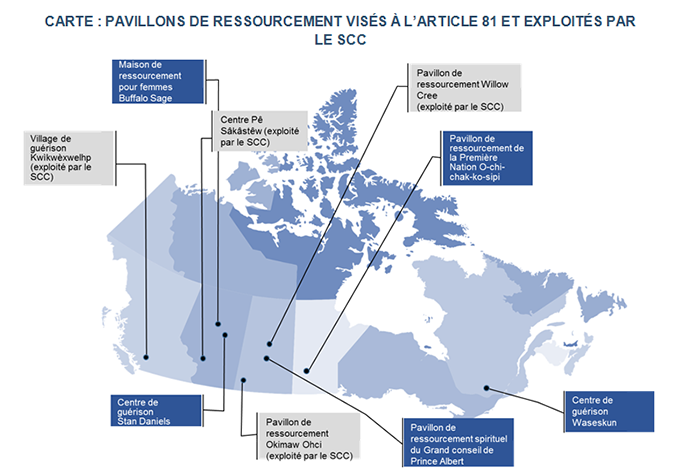
Pavillons de ressourcement visés par l’article 81 et exploités par le SCC.
• Centre Pê Sâkâstêw situé à Mâskwâcîs (Alberta);
• Pavillon de ressourcement Willow Cree situé dans la réserve Beardy’s (Saskatchewan);
• Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci situé à Maple Creek (Saskatchewan).
• Pavillon de ressourcement de la Première Nation O chi chak ko sipi (géré par la Première Nation O chi chak ko sipi) situé à Crane Lake (Manitoba);
• Centre de guérison Waseskun situé à Saint Alphonse Rodriguez (Québec);
• Maison de ressourcement pour femmes Buffalo Sage (gérée par l’organisme Native Counselling Services of Alberta) située à Edmonton (Alberta);
• Pavillon de ressourcement spirituel du Grand conseil de Prince Albert situé à Prince Albert (Saskatchewan);
Dans l’ensemble, 1 106 délinquants autochtones admis en vertu d’un MD en 2019-2020 ont été informés des dispositions législatives de l’article 81 de la LSCMLC. De ce nombre, 64 % (n=713) ont dit vouloir être transférés sous les soins et la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtone, conformément à un accord conclu en vertu de l’article 81 de la LSCMLC.
Aperçu : Un graphique à barres verticales et à ligne horizontale compare l’évolution du nombre de délinquants autochtones informés de l’article 81, puis y ayant manifesté de l’intérêt. Détails : Le graphique à barres montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés de l’article 81 a diminué, passant de 94 % en 2015 2016 à 87 % en 2019 2020. Le graphique linéaire montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés qui ont manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 81 a augmenté, passant de 60 % en 2015 2016 à 64 % en 2019 2020.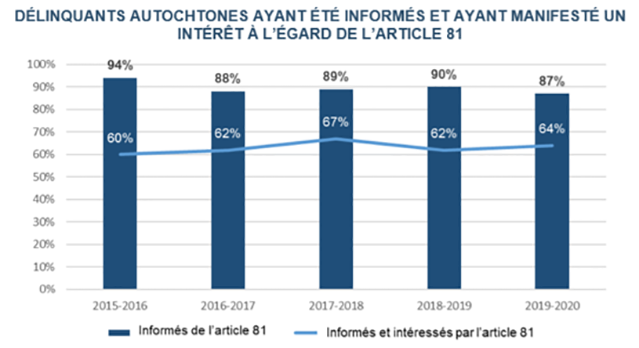
Délinquants autochtones ayant été informés et ayant manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 81.
Planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84
L’article 84 de la LSCMLC offre le cadre législatif permettant au SCC de collaborer avec les collectivités autochtones à l’élaboration des plans de libération des délinquants autochtones.
Les plans de libération en vertu de l’article 84 s’appliquent aux délinquants qui souhaitent passer leur période de mise en liberté sous condition ou de libération d’office dans une collectivité autochtone ou en milieu urbain avec le soutien et l’orientation d’un organisme autochtone. L’article 84 de la LSCMLC s’applique également aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. Le délinquant est informé du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 à l’étape de l’évaluation préliminaire du processus d’admission. En amorçant le processus tôt au début de leur peine, les détenus ont le temps et la possibilité d’obtenir le soutien de leur collectivité aussitôt que possible. Une communication en temps opportun, avec la permission du délinquant, peut aider l’EGC à formuler un plan de libération graduel et structuré.
Sous-comité sur les services Correctionnels pour Autochtones du Comité de direction
Les Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les plans de libération en vertu de l’article 84 constituaient l’un des huit domaines d’intérêt prioritaires. Au cours des deux prochaines années, le Sous-comité examinera le processus de planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 afin de le simplifier et d’accroitre la participation.
Le Sous-comité a déterminé que la surestimation de l’intérêt à l’égard du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 était un domaine qui exigeait une attention particulière. Le Sous‑comité a jugé que l’activation de l’indicateur de l’article 84 pendant l’évaluation préliminaire était un facteur contributif. Il a été souligné que l’intérêt devrait être confirmé de nouveau à l’admission et que l’indicateur devrait être désactivé, au besoin; toutefois, la désactivation n’a pas eu lieu de façon uniforme.
Des notes de service ont été envoyées à toutes les régions afin d’insister sur la nécessité de confirmer, à l’admission, l’intérêt à l’égard de la planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 de la LSCMLC et de désactiver l’indicateur, s’il y a lieu, afin d’assurer une utilisation uniforme de l’outil Le Chemin du retour – article 84. De plus, le Sous-comité continue d’explorer les occasions de simplifier le processus de mise en liberté, de réduire la complexité administrative de celui-ci et d’améliorer les résultats globaux
Zone de text: Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les plans de libération en vertu de l’article 84 constituaient l’un des huit domaines d’intérêt prioritaires. Au cours des deux prochaines années, le Sous-comité examinera le processus de planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 afin de le simplifier et d’accroître la participation.
Un graphique à barres verticales et à ligne montre et compare l’évolution du nombre de délinquants autochtones ayant été informés de l’article 84 et y ayant manifesté de l’intérêt. Détails : Le graphique à barres montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés de l’article 84 a diminué, passant de 94 % en 2015 2016 à 87 % en 2019 2020. Le graphique linéaire montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés qui ont manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 84 a augmenté, passant de 61 % en 2015 2016 à 62 % en 2019 2020.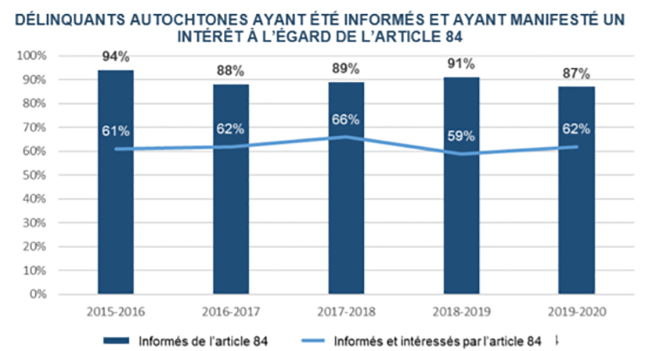
Délinquants autochtones ayant été informés et ayant manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 84
Services offerts par les Aînés
Les Aînés et les conseillers spirituels offrent un soutien spirituel et lié aux cérémonies et du counseling aux délinquants autochtones qui souhaitent participer au Continuum de soins pour les Autochtones. Les services comprennent une aide offerte aux délinquants pour qu’ils puissent suivre un cheminement de guérison qui appuie leur plan correctionnel et la fourniture de conseils au personnel de l’établissement sur les cérémonies, les objets de cérémonie, les pratiques traditionnelles et les protocoles.
Afin de fournir le soutien, l’orientation et les recommandations nécessaires au SCC dans le cadre de la passation de contrats avec des Aînés/conseillers spirituels, chaque région a établi un cercle des Aînés, un groupe consultatif ou un conseil des Aînés. Dans le cadre de l’engagement continu du SCC à améliorer les résultats pour les délinquants autochtones, une orientation destinée aux Aînés a été élaborée et mise en œuvre dans les régions au moment où les Aînés/ conseillers spirituels ont entamé leur contrat conclu avec le SCC.
La première icône représente une ampoule accompagnée du texte suivant : « Les examens par les Aînés aident le SCC à mieux comprendre les facteurs systémiques et historiques propres à chaque délinquant et à appuyer l’élaboration des composantes de guérison du plan correctionnel de celui ci ». La deuxième icône est un point d’exclamation accompagné du texte suivant : « Le SCC conclut des marchés avec environ 140 Aînés/conseillers spirituels pour offrir du soutien spirituel et lié aux cérémonies, du counseling et des enseignements aux délinquants issus des Premières Nations et aux délinquants métis et inuits qui souhaitent participer au Continuum de soins pour les Autochtones ». La troisième icône est une planchette à pince accompagnée du texte suivant : « Les Aînés/conseillers spirituels participent à la prestation d’interventions correctionnelles destinées aux délinquants autochtones. En tant que membres de l’EGC, ils contribuent au processus de gestion des cas en menant des examens qui fournissent des renseignements détaillés sur les facteurs systémiques et historiques du délinquant et qui donnent un aperçu des progrès réalisés par celui ci ». La quatrième et dernière icône est un groupe de personnes accompagné du texte suivant : « Grâce à des interventions culturelles et spirituelles traditionnelles, les Aînés/conseillers spirituels aident les délinquants à aborder les facteurs découlant de leurs antécédents sociaux, qui peuvent avoir contribué à les amener à avoir des démêlés avec la justice ».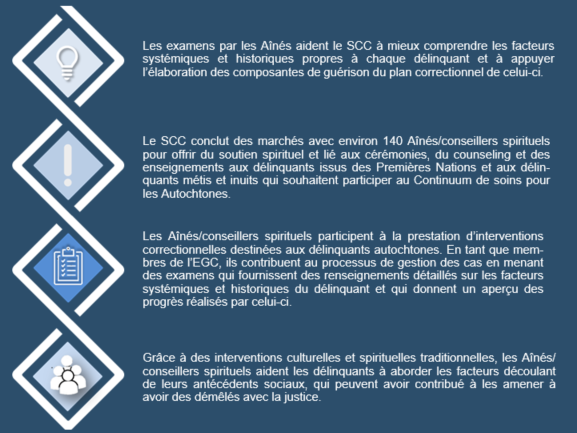
Aperçu : Un ensemble de quatre graphiques simples présentés à la verticale à la gauche représente des énoncés concernant les services offerts par les Aînés.
En 2019-2020, 78% des délinquants autochtones sous garde ont fait l’objet d’un examen par un aîné pendant leur peine
Zone de texte: Afin d’améliorer la prestation de services par les Aînés et d’élaborer des stratégies de planification de la relève pour faciliter le recrutement d’Aînés, le SCC élabore actuellement un contrat normalisé pour les assistants des Aînés. Il a établi des taux de rémunération nationaux pour les assistants des Aînés, au moyen de la méthode utilisée pour définir les taux de rémunération des Aînés. De plus, le SCC a entrepris un audit interne de la gestion des services offerts par les Aînés.
Interventions correctionnelles
Aperçu des interventions correctionnelles
L’étape d’intervention du Continuum de soins pour les Autochtones jette les fondements de la réinsertion sociale des délinquants autochtones. Les interventions auprès des délinquants autochtones doivent tenir compte de leur culture et de leur identité autochtones, ainsi que des facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué à leurs démêlés avec le système de justice pénale. La reconnaissance constante des traumatismes historiques vécus par les Autochtones demeure un facteur clé dans l’amélioration continue des initiatives de guérison du SCC.
Programmes correctionnels
Les programmes correctionnels sont conçus pour répondre aux besoins liés aux facteurs criminogènes et renforcer les occasions en vue de la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones. Les programmes pour les Autochtones ont été élaborés de manière à répondre aux besoins spirituels et culturels des délinquants autochtones. Lorsqu’ils sont offerts avec le soutien des Aînés/conseillers spirituels, ils appuient et facilitent la guérison des délinquants autochtones et favorisent la réussite de leur réinsertion sociale.
Sentiers autochtones
Par la mise en place d’interventions intensives, les initiatives des Sentiers autochtones visent à offrir un environnement de guérison aux délinquants autochtones qui s’investissent déjà dans leur propre cheminement de guérison. Ces initiatives donnent des résultats positifs pour les délinquants autochtones, ce qui comprend une augmentation du niveau de scolarité, une réduction du nombre d’accusations d’infractions disciplinaires graves, un plus faible taux d’implication dans des incidents de sécurité, un moins grand nombre d’analyses d’urine aléatoires positives et un taux plus élevé de mise en liberté discrétionnaire, comparativement aux délinquants autochtones qui n’ont pas participé aux Sentiers autochtones.
Éducation et formation professionnelle
Les délinquants autochtones continuent d’afficher des résultats positifs sur le plan de l’amélioration de leur niveau de scolarité, de la participation à une formation professionnelle ou de l’obtention d’une certification pendant leur incarcération. Depuis 2009-2010, le pourcentage de délinquants autochtones ayant un besoin en matière d’éducation et ayant été aiguillés vers un programme connexe s’est considérablement amélioré. En 2019-2020, dans l’ensemble, les délinquants autochtones ont terminé avec succès 96 % des placements à l’extérieur.
Pavillons de ressourcement
Les pavillons de ressourcement offrent aux délinquants autochtones des services et des programmes dans un environnement qui honore et intègre les traditions, les croyances et les pratiques des peuples autochtones. Des interventions, y compris des services d’Aînés et de conseillers spirituels et des cérémonies, sont offertes aux délinquants autochtones afin d’aborder les facteurs ayant mené ou contribué à leur incarcération. L’un des principaux objectifs des pavillons de ressourcement est de préparer les délinquants à une transition et à une réinsertion sociale graduelles, tout en leur offrant un milieu adapté à leur culture.
Centres d’intervention pour autochtones
En tant que fondement de la prochaine phase des services correctionnels pour Autochtones, le Plan national relatif aux Autochtones a introduit le modèle des (CIA), un schéma conceptuel établi pour faciliter la prestation d’interventions améliorées et adaptées à la culture des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits, en plus d’un soutien à leur réinsertion sociale. Le modèle d’intervention des CIA est décrit en détail dans une section ultérieure du présent rapport.
Inscriptions aux programmes
Un graphique circulaire montre la répartition totale et le pourcentage des délinquants autochtones inscrits à des programmes propres ou non aux Autochtones. Détails : En 2019 2020, 54 % (2 341 délinquants) des programmes étaient propres aux Autochtones et 46 % (1 964 délinquants) des programmes étaient non propres aux Autochtones. Total : 4 305 délinquants.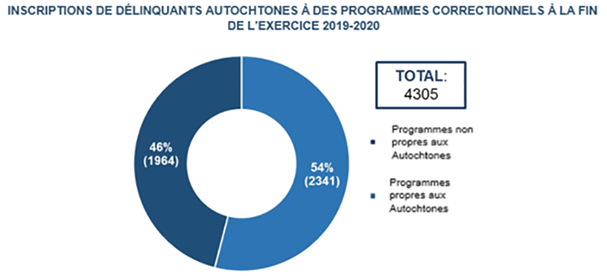
Inscriptions de délinquants autochtones à des programmes correctionnels à la fin de l’exercice 2019 2020.
L’IRC, l’Indice du risque criminel, est un outil fondé sur la recherche qui sert à évaluer le risque statique et à déterminer le niveau d’intervention requis pour les délinquants. L’IRC a été mis en œuvre pour aiguiller vers des programmes correctionnels tous les délinquants condamnés le 8 janvier 2018 ou après cette date.
Depuis la mise en œuvre de l’IRC, il y a eu des augmentations mesurables des taux de changement de l’intensité des programmes pour les délinquants autochtones, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur le plan opérationnel. Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a fait de l’IRC une de ses grandes priorités. Les discussions du Sous-comité se sont concentrées sur le fait que, étant donné que la recherche a validé l’IRC comme un outil déterminant avec exactitude les besoins en matière de programmes, les dérogations vers un programme d’intensité moindre peuvent mener à un traitement inadéquat, à moins que les programmes correctionnels ne soient combinés à des interventions complémentaires axées sur la justice réparatrice et adaptées à la culture, ce qui aide à réduire le risque.
Par conséquent, le Sous-comité a décidé que, pour les clients issus des Premières Nations et les clients métis et inuits, il faudrait envisager l’adoption d’approches plus holistiques, y compris la prise en compte des options de justice réparatrice adaptées à la culture, des Sentiers autochtones, des programmes communautaires, des services offerts par les Aînés, etc., en tant que services complémentaires valides qui, lorsqu’ils sont combinés à des programmes, augmentent l’efficacité des interventions au chapitre de la réhabilitation pour répondre aux besoins et réduire le risque.
Cette approche représente un changement important par rapport au modèle actuel de planification correctionnelle, qui est normalisé pour une population non autochtone. Un cadre et des orientations stratégiques claires seront élaborés afin de garantir l’uniformité de l’approche et de l’application.
Zone de texte: Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que l’incidence de l’IRC sur l’aiguillage vers les programmes pour les délinquants autochtones était l’une de ses priorités thématiques. Ses membres continuent de se pencher sur la nécessité de fournir en temps opportun des interventions efficaces pour répondre aux besoins des délinquants autochtones.
Nombre médian de jours avant l’inscription à un programme
Aperçu : Un graphique à lignes horizontales compare la hausse régulière du nombre médian de jours entre l’admission et l’inscription au premier programme correctionnel de préparation des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. En 2019 2020, les délinquants autochtones ont attendu un nombre médian de 22 jours de plus que les délinquants non autochtones pour entreprendre leur premier programme correctionnel de préparation (108 jours contre 86 jours), une amélioration par rapport à l’exercice précédent, où l’écart entre les délinquants autochtones et non autochtones présentait un nombre médian de 35 jours (200 jours contre 165 jours). Il subsiste toujours un écart entre les délinquants autochtones et non autochtones.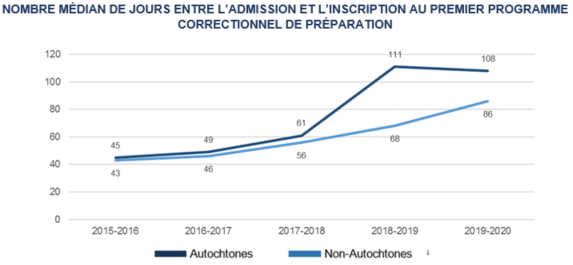
Nombre médian de jours entre l’admission et l’inscription au premier programme correctionnel de préparation.
En 2019-2020, les délinquants autochtones ont attendu, selon la médiane, 22 jours de plus que les délinquants non autochtones (108 jours comparativement à 86 jours) pour commencer leur premier programme correctionnel de préparation, une amélioration importante par rapport à un (1) an plus tôt, lorsque l’écart entre les délinquants autochtones et non autochtones était de 35 jours (200 jours comparativement à 165 jours), toujours selon la médiane. En 2019-2020, les délin- quants autochtones et non autochtones ont connu des temps d’attente semblables pour com- mencer leur premier programme correctionnel principal.
Aperçu : Un graphique à lignes horizontales compare l’évolution régulière du nombre médian de jours entre l’admission et le premier programme correctionnel principal des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. En 2019 2020, les délinquants autochtones et non autochtones faisaient face à des délais d’attente similaires avant de commencer leur premier programme correctionnel principal. Le nombre de jours est passé de 144 en 2015 2016 à 188 en 2019 2020 pour les délinquants autochtones et de 194 en 2015 2016 à 182 en 2019 2020 pour les délinquants non autochtones.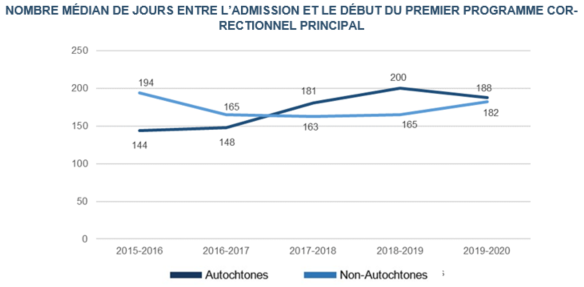
Nombre médian de jours entre l’admission et le premier programme correctionnel principal.
Achèvement des programmes
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare l’achèvement d’un programme correctionnel avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de 2015-2016 à 2019-2020 pour les délinquants autochtones et non autochtones. Détails : La tendance envers l’achèvement est demeurée relativement stable pour les délinquants autochtones, soit de 77 % en 2015 2016 à 75 % en 2019 2020, tout comme pour les délinquants non autochtones, de 83 % en 2015 2016 à 81 % en 2019 2020. En 2015 2016, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 83 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 82 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 78 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 84 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 83 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 75 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 81 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi.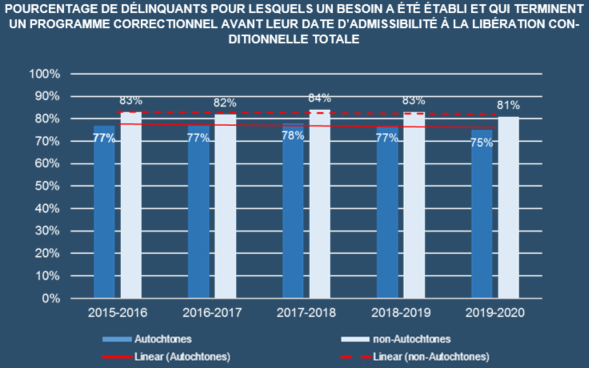
Pourcentage de délinquants pour lesquels un besoin a été établi et qui terminent un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
L’achèvement de programmes correctionnels constitue un facteur principal permettant d’optimiser le pourcentage de délinquants qui obtiennent une libération discrétionnaire à la première date d’admissibilité à la mise en liberté.
Le SCC continue de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les résultats en matière d’achèvement des programmes correctionnels avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (DALCT) en favorisant la prestation des programmes correctionnels dès que possible pendant la peine des délinquants. En 2019-2020, le taux d’achèvement des programmes destinés aux Autochtones est demeuré élevé, à 79 %. Cependant, le taux d’achèvement a diminué par rapport aux années précédentes.
Zone de texte: Le SCC a créé le Groupe consultatif sur la planification des programmes et la production des rapports pour accroître la communication sur la prestation des programmes correctionnels et déterminer les pratiques exemplaires afin d’améliorer les résultats en matière de rendement des programmes correctionnels. Ce groupe comprend des représentants régionaux qui souhaitent renforcer la prestation des programmes correctionnels.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’examen de fin d’exercice 2019-2020.
Aiguillage vers des programmes d’éducation et hausse du niveau de scolarité
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes rouges compare les améliorations du niveau de scolarité avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale de 2015-2016 à 2019-2020 pour les délinquants autochtones et non autochtones. Détails : La tendance à l’amélioration du niveau de scolarité est demeurée assez stable à environ 56 % pour les délinquants autochtones de 2015 2016 à 2019 2020, ainsi que pour les délinquants non autochtones qui ont légèrement augmenté, passant de 55 % en 2015 2016 à 56 % en 2019 2020. En 2015 2016, 56 % des délinquants autochtones ont amélioré leur niveau de scolarité avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 55 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 58 % des délinquants autochtones ont amélioré leur niveau de scolarité avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 54 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 63 % des délinquants autochtones ont amélioré leur niveau de scolarité avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 56 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 62 % des délinquants autochtones ont amélioré leur niveau de scolarité avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 58 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 56 % des délinquants autochtones ont amélioré leur niveau de scolarité avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 56 % des délinquants non autochtones.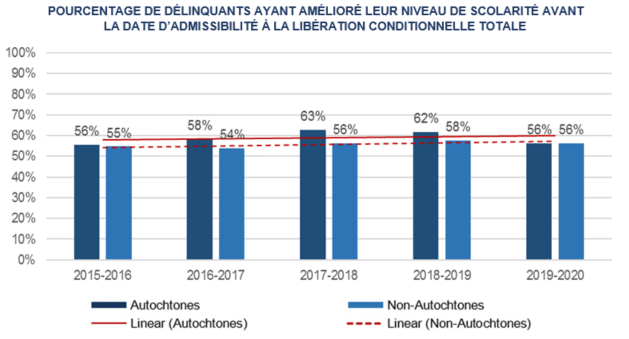
Pourcentage de délinquants ayant amélioré leur niveau de scolarité avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Le Programme d’éducation des délinquants contribue aux interventions correctionnelles grâce à des services conçus pour fournir aux délinquants des compétences de base en matière d’alphabétisation, d’aptitudes aux études et de perfectionnement personnel qui améliorent leur capacité de participer efficacement à d’autres interventions correctionnelles. Il leur donne également la possibilité d’améliorer leurs qualifications scolaires, ce qui augmente leurs chances d’obtenir un emploi dans la collectivité et de réussir leur réinsertion sociale.
Depuis 2015-2016, le pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’éducation a été établi et qui ont été aiguillés vers un programme d’éducation dans les 120 jours suivant leur admission est demeuré élevé.
De plus, les délinquants autochtones ayant un besoin en matière d’éducation sont aiguillés vers un programme d’éducation en plus grand nombre que les délinquants non autochtones. En 2019- 2020, 86 % des délinquants autochtones ont été aiguillés vers un programme d’éducation dans un délai de 120 jours suivant leur admission, comparativement à 71 % des délinquants non autochtones.
Zone de texte: Le SCC a élaboré le Guide de ressources à l’intention des enseignants – Travailler avec les étudiants autochtones en salle de classe afin d’aider les enseignants à tenir compte des besoins des étudiants autochtones et à intégrer ces derniers au groupe. Ce guide de ressources a été conçu pour appuyer les enseignants dans leurs efforts continus pour travailler de façon efficace et collaborative avec les étudiants autochtones, tout en tenant compte des antécédents sociaux des Autochtones. Au cours de l’exercice 2019-2020, le guide de ressources a été terminé et mis à la disposition de tous les enseignants ayant suivi la formation.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’examen de fin d’exercice 2019-2020.
Projet de loi C-83, loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi
Aperçu : Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare l’isolement préventif par tranche de 1 000 délinquants de 2015-2016 à 2019-2020 pour les délinquants autochtones et non autochtones. L’isolement préventif par tranche de 1 000 délinquants autochtones est passé de 373 en 2015 2016 à 166 en 2019 2020. L’isolement préventif des délinquants non autochtones a également diminué, passant de 307 en 2015 2016 à 108 en 2019 2020. En 2015 2016, 373 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont été placés en isolement préventif, comparativement à 307 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2016 2017, 371 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont été placés en isolement préventif, comparativement à 285 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2017 2018, 315 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont été placés en isolement préventif, comparativement à 230 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2018 2019, 289 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont été placés en isolement préventif, comparativement à 210 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2019 2020, 166 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont été placés en isolement préventif, comparativement à 108 délinquants non autochtones par tranche de 1 000.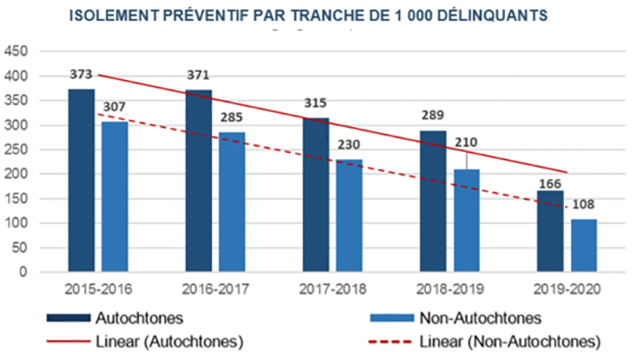
Isolement préventif par tranche de 1 000 délinquants.
Bien que le nombre total de placements en isolement par tranche de 1 000 délinquants se soit amélioré depuis 2015-2016, les délinquants autochtones continuent d’être placés en isolement plus fréquemment que les délinquants non autochtones.
L’Association canadienne des libertés civiles et la British Columbia Civil Liberties Association ont contesté devant les tribunaux l’isolement préventif. Les deux affaires ont été portées en appel devant les cours d’appel provinciales. Bien que les deux cours d’appel aient tranché les affaires compte tenu de motifs différents, elles ont au bout du compte déclaré inconstitutionnelles les pratiques d’isolement préventif énoncées dans les lois fédérales.
Le 21 juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, a reçu la sanction royale. Les modifications apportées à la LSCMLC ont éliminé l’isolement préventif et disciplinaire et introduit un nouveau modèle correctionnel, qui comprend le recours aux unités d’intervention structurée (UIS) pour les détenus qui ne peuvent être gérés en toute sécurité dans la population carcérale régulière. Les UIS ont été mises en œuvre et sont devenues opérationnelles le 30 novembre 2019.
Les UIS diffèrent de l’isolement préventif. Les détenus placés dans une UIS ont la possibilité de passer au moins quatre (4) heures par jour à l’extérieur de leur cellule et d’avoir des contacts humains réels pendant au moins deux (2) heures par jour. Ils peuvent également continuer de suivre leurs programmes, d’être rémunérés, d’avoir du temps de loisir et de recevoir des visiteurs, l’objectif étant de faciliter leur retour parmi la population carcérale régulière le plus tôt possible.
Le nouveau modèle des UIS constitue une initiative de transformation qui a d’importantes répercussions sur les activités du SCC et son travail auprès des délinquants. Des interventions structurées, des programmes et des soins de santé sont offerts aux détenus dans un environnement sûr et sécuritaire pour aborder le risque et les besoins particuliers qu’ils présentent
Project de loi C-83 pour les délinquants autochtones
Aperçu : Un ensemble de six graphiques simples accompagne les principaux énoncés concernant le modèle des unités d’intervention structurée. La première icône affiche deux personnes assises face à face qui discutent autour d’une table. Le texte à côté se lit comme suit : « Augmentation des contacts humains réels avec un Aîné ». La deuxième icône est un groupe de trois têtes et épaules avec le texte suivant : « Promotion de l’autodétermination des collectivités autochtones en leur assurant des ressources communautaires suffisantes ». La troisième icône est une horloge analogique affichant 2 h 50, entourée d’une flèche circulaire pointant dans le sens antihoraire et accompagnée du texte suivant : « Prise en compte des facteurs systémiques et historiques propres aux délinquants autochtones dans toutes les décisions liées aux services ». La quatrième icône est un cœur traversé d’une ligne graphique, accompagné du texte suivant : « Visite quotidienne d’un professionnel de la santé ». La cinquième icône est une ampoule allumée accompagnée du texte suivant : « Interventions reposant sur une approche individualisée qui comprennent des activités et des modules axés sur les compétences ». La cinquième et dernière icône est un doigt pointé vers le haut dans un cercle, accompagné du texte suivant : « L’objectif consiste à fournir au délinquant les outils nécessaires pour qu’il puisse retourner le plus rapidement possible dans la population carcérale régulière et à empêcher son retour dans une UIS ».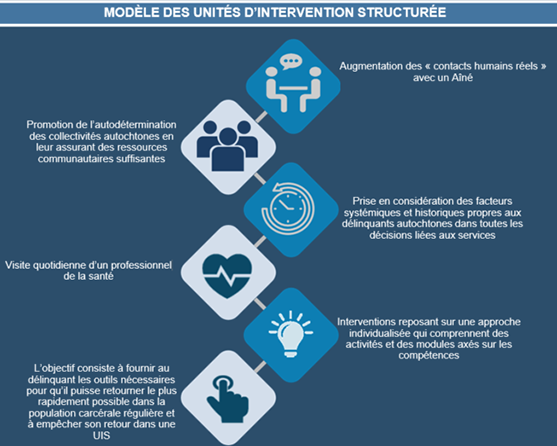
Modèle des unités d’intervention structurée
Le projet de loi C-83 a apporté des modifications à la LSCMLC qui favorisent l’autodétermination des collectivités autochtones en leur assurant des ressources communautaires suffisantes pour soutenir la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones grâce à une meilleure application des articles 81 et 84 de la LSCMLC.
Le projet de loi C-83 a également changé le terme « collectivité autochtone », aux articles 81 et 84, pour le remplacer par « tout corps dirigeant ou organisme autochtone ». Le nouveau libellé vise à faire en sorte que les organismes autochtones fournissent des services appropriés aux délinquants autochtones.
Conformément à la priorité du gouvernement du Canada visant le renouvellement des liens de nation à nation avec les Autochtones, il est essentiel, en vue d’atteindre les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones, de mobiliser davantage les collectivités autochtones au moment de la planification de la mise en liberté de ces délinquants.
Accusations d’infractions disciplinaires et incidents de sécurité
Aperçu : Un graphique à barres verticales et à lignes horizontales compare les accusations d’infractions disciplinaires graves de 2015-2016 à 2019-2020 par tranche de 1 000 délinquants autochtones et non autochtones. Le nombre d’accusations d’infractions disciplinaires graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones a augmenté, passant de 554 en 2015 2016 à 644 en 2019 2020. Pour les délinquants non autochtones, le nombre d’accusations est demeuré assez stable, passant de 374 en 2015 2016 à 379 en 2019 2020. En 2015 2016, 554 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont fait l’objet d’accusations d’infractions disciplinaires graves, comparativement à 374 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2016 2017, 585 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont fait l’objet d’accusations d’infractions disciplinaires graves, comparativement à 383 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2017 2018, 618 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont fait l’objet d’accusations d’infractions disciplinaires graves, comparativement à 347 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2018 2019, 724 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont fait l’objet d’accusations d’infractions disciplinaires graves, comparativement à 396 délinquants non autochtones par tranche de 1 000. En 2019 2020, 644 délinquants autochtones par tranche de 1 000 ont fait l’objet d’accusations d’infractions disciplinaires graves, comparativement à 379 délinquants non autochtones par tranche de 1 000.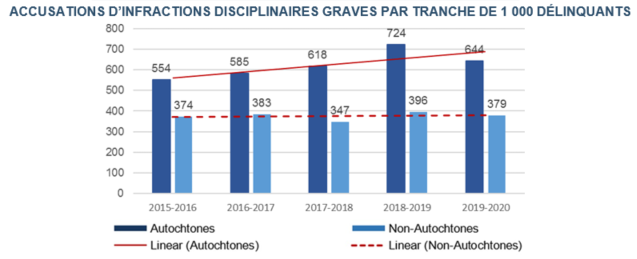
Accusations d’infractions disciplinaires graves par tranche de 1 000 délinquants.
Zone de texte: Les délinquants autochtones continuent d’être impliqués en plus grand nombre que les délinquants non autochtones dans des incidents liés à l’adaptation à l’établissement, par tranche de 1 000 délinquants. Le nombre d’accusations d’infractions disciplinaires graves par tranche de 1 000 délinquants s’est chiffré à 379 pour les délinquants non autochtones et à 644 pour les délinquants autochtones.
L’augmentation du nombre d’incidents de sécurité impliquant des délinquants autochtones peut avoir une incidence négative sur des aspects clés de la réinsertion sociale, dont les permissions de sortir avec ou sans escorte, les recommandations positives en vue d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle totale, ainsi que la reclassification à un niveau de sécurité moindre.
Une réunion virtuelle des directeurs de district de toutes les régions a eu lieu en 2020 pour éclairer le Sous- comité en ce qui concerne les écarts dans les taux de suspension et de révocation pour les délinquants autochtones.
Les directeurs de district ont souligné la présence croissante de groupes menaçant la sécurité et leur incidence sur la participation aux programmes et le taux croissant d’incidents de sécurité graves.
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le nombre d’incidents de sécurité graves de 2015-2016 à 2019-2020 par tranche de 1 000 délinquants autochtones et non autochtones. Le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones est passé de 458 en 2015 2016 à 915 en 2019 2020. Le nombre pour les délinquants non autochtones a aussi augmenté, passant de 323 en 2015 2016 à 501 en 2019 2020. En 2015 2016, le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 458, comparativement à 323 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2016 2017, le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 679, comparativement à 328 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2017 2018, le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 683, comparativement à 331 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2018 2019, le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 735, comparativement à 383 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2019 2020, le nombre d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 915, comparativement à 501 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones.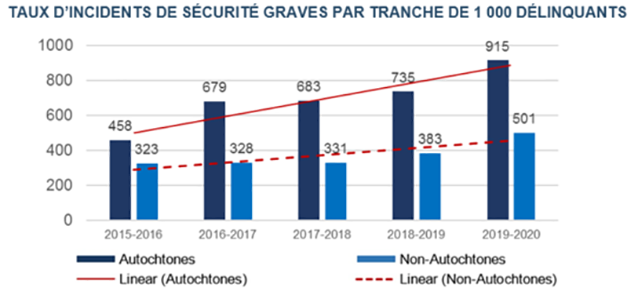
Taux d’incidents de sécurité graves par tranche de 1 000 délinquants.
Sentiers autochtones
En 2019-2020, il y a eu un total de 429 départs des Sentiers autochtones, dont 53 % (n=229) ont été considérés comme une réussite.
Parmi ces délinquants :
- 55 % (n=125) ont été transférés dans un établissement à niveau de sécurité inférieur ou dans un pavillon de ressourcement.
- 45 % (n=104) ont obtenu une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale
Une série de quatre graphiques simples et liés entre eux accompagne les principaux titres. Deux personnes assises face à face discutent autour d’une table; cela représente les initiatives de guérison dirigées par des Aînés; une main noire et une main blanche se tiennent l’une l’autre; cela représente une guérison intensive; une tête et des épaules dans un cercle représentent un plan de guérison individuel, et une planchette à pince représente la réévaluation de la cote de sécurité.
Sentiers autochtones.
Dirigée par des Aînés
- Initiative de guérison dirigée par des Aînés at fondée sur la roue de médecine qui favorise la guérison holistique at renforce un mode de vie autochtone traditionnel
Guérison intensive
- Guérison intensive au moyen de la prestation de services individuels de counseling, d’un accès aux cérémonies et de programmes.
Plan de guérison individuel
- Appui au plan de guérison et au plan correctionnel de chaque délinquant. Les participants aux Sentiers autochtones s’engagent a adopter un comportement responsable et a participer plus activement et intensément aux activités de counseling et aux cérémonies autochtones traditionnelles
Réévaluation de la cote de sécurité
- Tremplin pour abaisser le taux de la cote de sécurité au moment de la réévaluation
Zone de texte: Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les initiatives des Sentiers autochtones constituaient l’une de ses priorités thématiques. Une réunion avec les coordonnateurs des Sentiers autochtones de toutes les régions a eu lieu en 2020 afin d’aborder et de déterminer les pratiques exemplaires pour ces initiatives et de formuler des recommandations précises pour améliorer le modèle des Sentiers autochtones.
Réinsertion sociale
Audiences de semi-liberté et de libération conditionnelle totale
L’une des priorités organisationnelles durables du SCC consiste à aborder la surreprésentation des Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral en veillant à ce que le processus correctionnel soit axé sur l’amélioration des résultats au chapitre des libérations discrétionnaires et la réussite de la surveillance dans la collectivité pour les délinquants autochtones. Les pratiques de gestion des cas continuent d’être renforcées pour raccourcir le délai avant la première date d’admissibilité à la libération conditionnelle pour les délinquants autochtones, afin d’accroître les possibilités de surveillance dans la collectivité par l’intermédiaire du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 et d’améliorer la réussite de la réinsertion sociale.
La surveillance de la liberté conditionnelle est considérée comme un élément essentiel de la réinsertion sociale réussie du délinquant dans la collectivité. Le report des audiences de semi-liberté et de libération conditionnelle totale ou la renonciation à celles-ci réduit en réalité la durée pendant laquelle les délinquants peuvent bénéficier d’une mise en liberté surveillée et structurée dans la collectivité.
Les délinquants peuvent renoncer à la libération conditionnelle ou reporter leur demande de libération conditionnelle pour un certain nombre de raisons, notamment le non-achèvement des programmes correctionnels et le manque de confiance.
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le pourcentage de délinquants autochtones et non autochtones ayant retiré leur demande d’audience de semi liberté de 2015-2016 à 2019-2020. Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont retiré leur demande d’audience de semi liberté est passé de 13 % en 2015 2016 à 10 % en 2019 2020. Le pourcentage pour les délinquants non autochtones a aussi reculé, passant de 10 % en 2015 2016 à 7 % en 2019 2020. En 2015 2016, 13 % des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 10 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 11 % des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 8 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 10 % des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 9 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 10 % des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 8 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 10 % des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 7 % des délinquants non autochtones.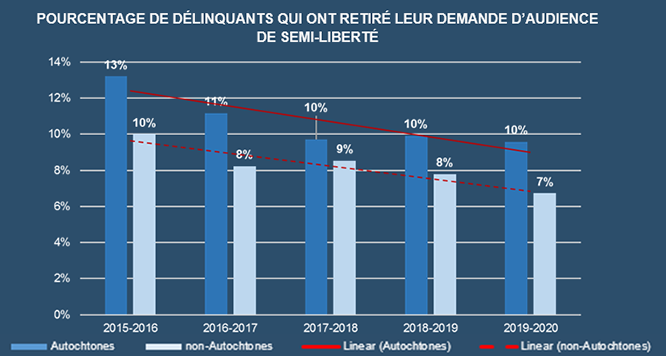
Pourcentage de délinquants qui ont retiré leur demande d’audience de semi liberté.
Au cours des cinq (5) dernières années, le pourcentage de demandes d’audience de semi-liberté retirées a diminué chez les délinquants autochtones et non autochtones. En 2019-2020, 10 % (n=191) des délinquants autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi-liberté, comparativement à 13 % (n=178) en 2015- 2016.
Un écart demeure entre les délinquants autochtones et non autochtones en ce qui a trait au pourcentage de demandes d’audience de semi-liberté retirées. Cet écart pourrait s’expliquer par divers facteurs, notamment des cotes de sécurité plus élevées, l’institutionnalisation et des obstacles linguistiques, en particulier pour les délinquants inuits. Le SCC s’efforce de transformer de façon holistique les services correctionnels pour Autochtones afin de cibler les causes profondes de cet écart endémique.
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le pourcentage de délinquants autochtones et non autochtones ayant renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : La tendance du pourcentage de délinquants autochtones ayant renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale a diminué, passant de 45 % en 2015 2016 à 28 % en 2019 2020. La tendance pour les délinquants non autochtones a reculé, passant de 30 % en 2015 2016 à 19 % en 2019 2020. En 2015 2016, 45 % des délinquants autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 30 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 38 % des délinquants autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 26 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 31 % des délinquants autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 21 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 27 % des délinquants autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 18 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 28 % des délinquants autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 19 % des délinquants non autochtones.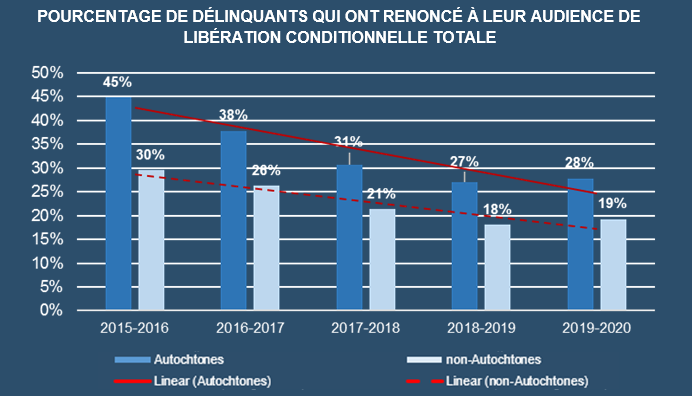
Pourcentage de délinquants qui ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale.
Le pourcentage d’audiences de libération conditionnelle totale auxquelles les délinquants autochtones ont renoncé au cours des cinq (5) dernières années s’est également amélioré. En 2019-2020, 28 % (n=947) des audiences de libération conditionnelle totale concernant des délinquants autochtones avaient fait l’objet d’une renonciation, comparativement à 19 % (n=1 828) pour les délinquants non autochtones. Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2015-2016, où 45 % (n=1 196) des audiences de libération conditionnelle totale concernant des délinquants autochtones avaient fait l’objet d’une renonciation, comparativement à 30 % (n=2 705) pour les délinquants non autochtones. Malgré une certaine amélioration, le pourcentage de délinquants autochtones qui renoncent à leur audience de libération conditionnelle totale demeure plus élevé que celui des délinquants non autochtones, quoique l’écart se rétrécisse.
Audiences tenues avec l’aide d’un Aîné
Les audiences tenues avec l’aide d’un Aîné sont offertes aux délinquants autochtones ou aux délinquants qui ont montré un engagement sérieux à l’égard d’un mode de vie autochtone. L’objectif des audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada tenues avec l’aide d’un Aîné ou de membres de la collectivité est de créer un processus d’audience adapté aux délinquants autochtones. Ces audiences doivent respecter les critères habituels relatifs à la prise de décision. Si le délinquant en fait la demande, un Aîné peut procéder, avant l’audience, à une cérémonie, comme une cérémonie de purification par la fumée, une prière ou un chant.
Audiences tenues avec l’aide de membres de la collectivité
Une audience tenue avec l’aide de membres de la collectivité est une audience qui est tenue en application de l’article 84 de la LSCMLC. Elle comprend la participation de membres de la collectivité autochtone dans laquelle le délinquant pourrait être mis en liberté. L’audience suit le modèle d’une audience tenue avec l’aide d’un Aîné et peut avoir lieu dans la collectivité autochtone (réserve ou collectivité urbaine).
Libération discrétionnaire
Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges montre une augmentation du pourcentage de délinquants autochtones et non autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : Le pourcentage de délinquants autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire est passé de 29 % en 2015 2016 à 40 % en 2019 2020. Le pourcentage chez les délinquants non autochtones est passé de 47 % en 2015 2016 à 60 % en 2019 2020. En 2015 2016, 29 % des délinquants autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 47 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 36 % des délinquants autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 54 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 40 % des délinquants autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 58 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 45 % des délinquants autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 60 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 40 % des délinquants autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 60 % des délinquants non autochtones.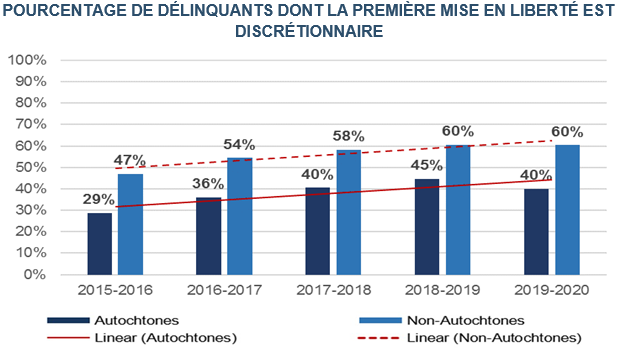
Pourcentage de délinquants dont la première mise en liberté est discrétionnaire.
La libération discrétionnaire, soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale, représente la mise en liberté optimale pour tous les délinquants. Le pourcentage de délinquants autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire a considérablement augmenté depuis 2015‑2016, mais on continue d’observer un écart important entre les délinquants autochtones et non autochtones. L’achèvement de programmes correctionnels constitue un facteur principal permettant d’optimiser le pourcentage de délinquants qui obtiennent une libération discrétionnaire à la première date d’admissibilité à la mise en liberté.
Zone de texte: En 2019-2020, les délinquants autochtones ayant participé aux initiatives des Sentiers autochtones présentaient un taux de mise en liberté discrétionnaire supérieur à celui des délinquants autochtones qui n’avaient pas participé aux Sentiers autochtones (56 %, comparativement à 44 %).
Deux graphiques circulaires rouge, bleu et jaune comparent les types de mise en liberté (semi liberté, libération conditionnelle totale, ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD], libération d’office et expiration du mandat) pour les délinquants autochtones et non autochtones. Chez les délinquants autochtones, 58 % étaient en libération d’office, 38 % en semi liberté, 2 % en expiration de mandat, 2 % en libération conditionnelle totale et 1 % en ordonnance de surveillance de longue durée. Chez les délinquants non autochtones, 39 % étaient en libération d’office, 56 % en semi liberté, 1 % en expiration de mandat, 4 % en libération conditionnelle totale et 0 % en ordonnance de surveillance de longue durée.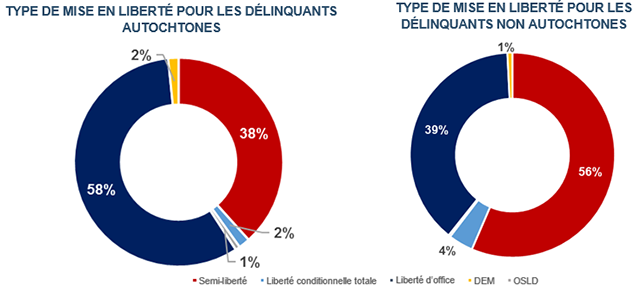
Type de mise en liberté pour les délinquants autochtones et non autochtones.
Libération discrétionnaire et article 84
Un graphique à barres verticales montre une augmentation du pourcentage de délinquants autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire avec et sans plan de libération en vertu de l’article 84 de 2015-2016 à 2019-2020. Le pourcentage de délinquants autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire et s’assortit d’un plan de libération en vertu de l’article 84 est passé de 47 % en 2015 2016 à 73 % en 2019 2020. Le pourcentage de ceux qui n’ont pas de plan de libération en vertu de l’article 84 est passé de 22 % en 2015 2016 à 33 % en 2019 2020. En 2015 2016, 47 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire assortie d’un plan de libération en vertu de l’article 84, alors que 22 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire sans plan de libération en vertu de l’article 84. En 2016 2017, 58 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire assortie d’un plan de libération en vertu de l’article 84, alors que 28 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire sans plan de libération en vertu de l’article 84. En 2017 2018, 55 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire assortie d’un plan de libération en vertu de l’article 84, alors que 35 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire sans plan de libération en vertu de l’article 84. En 2018 2019, 69 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire assortie d’un plan de libération en vertu de l’article 84, alors que 37 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire sans plan de libération en vertu de l’article 84. En 2019 2020, 73 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire assortie d’un plan de libération en vertu de l’article 84, alors que 33 % des délinquants autochtones ont obtenu une première mise en liberté discrétionnaire sans plan de libération en vertu de l’article 84.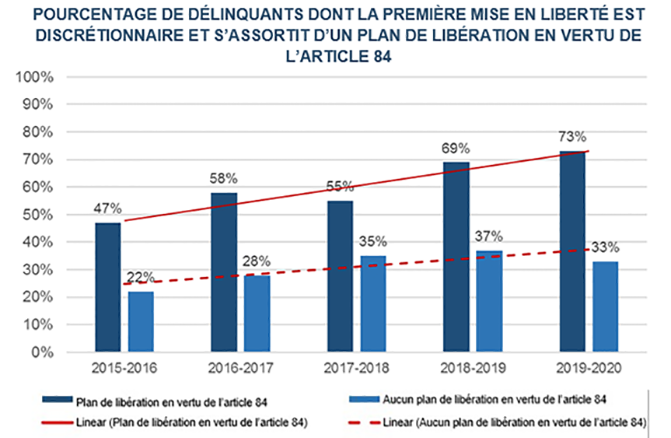
Pourcentage de délinquants dont la première mise en liberté est discrétionnaire et s’assortit d’un plan de libération en vertu de l’article 84.
En 2019-2020, 73 % des délinquants autochtones ayant un plan de libération établi en vertu de l’article 84 ont obtenu une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté, comparativement à 33 % des délinquants autochtones qui n’avaient pas établi de tel plan.
Les avantages d’un plan de libération en vertu de l’article 84 sont illustrés par ces résultats positifs. Des interventions adaptées sur le plan culturel améliorent les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones. À l’aide d’une approche fondée sur des données probantes, le SCC concentre ses efforts sur le recours optimal à ces initiatives et l’amélioration de leur accès. Plus particulièrement, les taux de participation laissent entendre que la planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 est sous-utilisée, en partie en raison de la complexité du processus et des limites des capacités des collectivités
Afin d’optimiser le recours au processus de mise en liberté prévu à l’article 84 et d’améliorer les résultats en matière de réinsertion sociale des délinquants autochtones, le SCC a créé l’outil Le Chemin du retour – article 84, un système automatisé de rappel qui envoie des courriels au personnel au sujet des délinquants qui ont manifesté un intérêt à l’égard d’une mise en liberté sous condition en vertu de l’article 84 de la LSCMLC. Le système est conçu pour faciliter le processus de demande prévu à l’article 84 pour l’EGC.
Ce système vise à favoriser la réussite de la réinsertion sociale des délinquants autochtones dans leur collectivité d’origine, ce qui contribue à rendre les collectivités plus saines et plus sûres partout au pays.
Zone de texte: Veuillez consulter la page 23 pour en savoir plus sur les mesures prises par le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction afin d’améliorer le processus de mise en liberté prévu à l’article 84.
Libération discrétionnaire et pavillon de ressourcement visé à l’article 81
Afin de comparer avec exactitude les résultats entre les délinquants autochtones libérés d’un pavillon de ressourcement (exploité par le SCC et/ ou visé à l’article 81) et ceux libérés d’un autre établissement, seuls les résultats pour les délinquants classés à sécurité minimale avant la mise en liberté ont été inclus dans l’analyse du graphique ci-dessous.
Le profil des délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui séjournent dans un pavillon de ressourcement diffère considérablement de celui des délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui sont incarcérés dans les établissements du SCC. En outre, le profil de risque des délinquants autochtones qui sont libérés d’un pavillon de ressourcement diffère de celui des délinquants autochtones qui sont libérés d’un autre établissement du SCC.
En comparant tous les délinquants autochtones classés à sécurité minimale avant leur première mise en liberté, on constate que les délinquants autochtones dans les pavillons de ressourcement présentent un niveau de risque plus élevé que les délinquants autochtones incarcérés dans un autre établissement du SCC.
Ces différences observées dans les profils de population peuvent expliquer, du moins en partie, le fait que le pourcentage de délinquants autochtones classés à sécurité minimale qui ont séjourné dans un pavillon de ressourcement et qui ont obtenu une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale lors de leur première mise en liberté est inférieur à celui des délinquants autochtones classés à sécurité minimale qui ont été libérés d’un autre établissement du SCC.
Le pourcentage de premières mises en liberté sous forme de semi liberté et de libération conditionnelle totale pour les délinquants autochtones classés à sécurité minimale et qui se trouvent dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté est passé de 53 % en 2015 2016 à 73 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants qui ne sont pas dans un pavillon de ressourcement a augmenté, passant de 65 % en 2015 2016 à 82 % en 2019 2020. En 2015 2016, 53 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et placés dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté ont obtenu une première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale, comparativement à 65 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et ne se trouvant pas dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté. En 2016 2017, 59 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et placés dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté ont obtenu une première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale, comparativement à 75 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et ne se trouvant pas dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté. En 2017 2018, 69 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et placés dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté ont obtenu une première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale, comparativement à 76 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et ne se trouvant pas dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté. En 2018 2019, 77 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et placés dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté ont obtenu une première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale, comparativement à 78 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et ne se trouvant pas dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté. En 2019 2020, 73 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et placés dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté ont obtenu une première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale, comparativement à 82 % des délinquants autochtones classés à sécurité minimale et ne se trouvant pas dans un pavillon de ressourcement avant leur mise en liberté.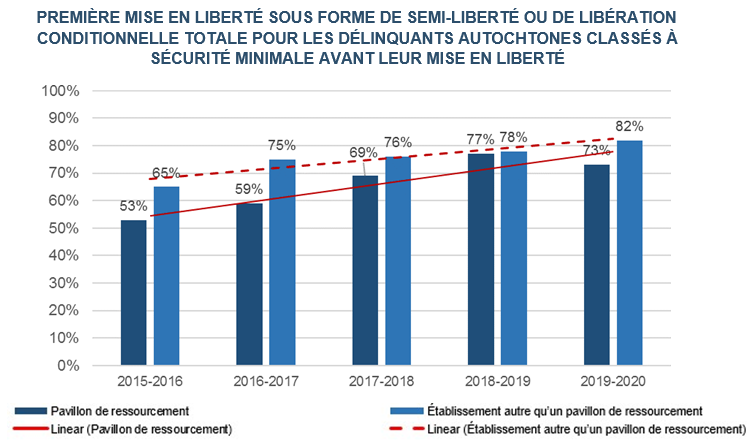
Première mise en liberté sous forme de semi liberté ou de libération conditionnelle totale pour les délinquants autochtones classés à sécurité minimale avant leur mise en liberté.
Une vie enrichissante après la libération
Comme il est décrit dans la section du présent rapport portant sur le profil des délinquants, la colonisation a eu des répercussions sur les collectivités autochtones et les déterminants socioéconomiques de la criminalité, qui comprennent le manque d’éducation formelle et le manque d’emploi. Selon des recherches universitaires, ces facteurs sont directement liés à l’augmentation des taux de criminalité.
Le SCC a la responsabilité légale de fournir des services de réhabilitation aux délinquants dont il a la garde afin de prévenir la récidive et d’assurer la sécurité des collectivités.
La notion de réhabilitation a évolué au fil du temps et s’étend maintenant au-delà des programmes comportementaux. Pour assurer une réhabilitation réussie, le SCC doit libérer les délinquants en les munissant de tous les outils essentiels dont ils ont besoin pour fonctionner et s’épanouir dans la collectivité, y compris pour trouver un emploi intéressant. Cela est particulièrement important pour les délinquants autochtones qui sont plus susceptibles d’être désavantagés et de faire face à des obstacles qui nuisent à l’emploi.
Le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral pour les délinquants autochtones a augmenté, passant de 64 % en 2015 2016 à 79 % en 2019 2020. Le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral pour les délinquants non autochtones est passé de 68 % en 2015 2016 à 77 % en 2019 2020. En 2015 2016, le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral s’élevait à 64 % pour les délinquants autochtones, comparativement à 68 % pour les délinquants non autochtones. En 2016 2017, le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral s’élevait à 68 % pour les délinquants autochtones, comparativement à 68 % pour les délinquants non autochtones. En 2017 2018, le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral s’élevait à 69 % pour les délinquants autochtones, comparativement à 68 % pour les délinquants non autochtones. En 2018 2019, le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral s’élevait à 70 % pour les délinquants autochtones, comparativement à 70 % pour les délinquants non autochtones. En 2019 2020, le pourcentage de demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral s’élevait à 79 % pour les délinquants autochtones, comparativement à 77 % pour les délinquants non autochtones.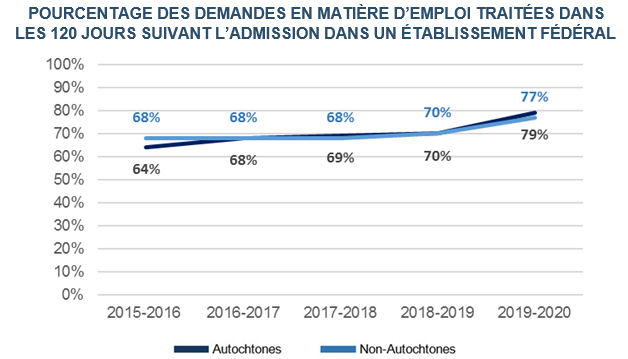
Pourcentage des demandes en matière d’emploi traitées dans les 120 jours suivant l’admission dans un établissement fédéral.
Initiative d’emploi pour les délinquants autochtones de CORCAN
Le gouvernement du Canada et Sécurité publique Canada ayant mis l’accent sur l’amélioration des occasions et des services offerts aux Autochtones, le SCC a entrepris la mise en œuvre de l’Initiative d’emploi pour les délinquants autochtones (IEDA). Destiné précisément aux délinquants autochtones, l’IEDA améliore la formation en cours d’emploi et la formation professionnelle, les apprentissages liés à l’emploi dans le domaine de la construction et les emplois dans le secteur de la fabrication. L’IEDA offre également des emplois de transition et améliore les services de soutien pour aider les délinquants à trouver et à conserver un emploi dans la collectivité. En 2019-2020, deux nouveaux ateliers industriels en milieu communautaire ont été mis en œuvre, l’un à Vancouver et l’autre à Ottawa. Une nouvelle formation professionnelle et en cours d’emploi a été offerte dans les établissements pour délinquantes, en collaboration avec les centres d’intervention pour Autochtones dans les régions de l’Ontario et du Pacifique.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020.
Emploi
Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont obtenu un emploi avant la date d’expiration de leur peine a légèrement augmenté, passant de 60 % en 2015 2016 à 64 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones qui ont trouvé un emploi avant l’expiration de leur peine est demeuré stable à 81 % de 2015 2016 à 2019 2020. En 2015 2016, 60 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 81 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 63 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 81 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 62 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 80 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 62 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 84 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 64 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 81 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi.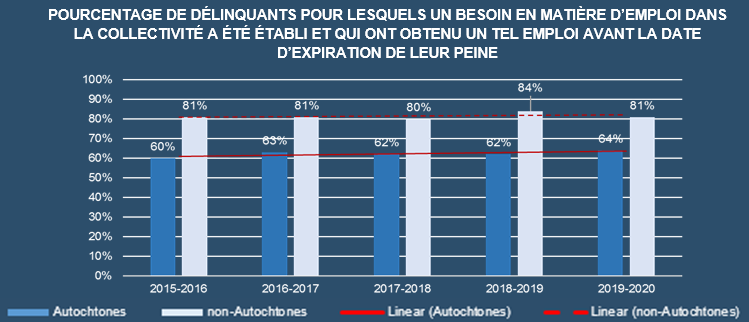
Pourcentage de délinquants pour lesquels un besoin en matière d’emploi dans la collectivité a été établi et qui ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine.
Fonds pour la réinsertion sociale
Le SCC poursuivra l’examen d’un éventail d’occasions permettant de collaborer avec des collectivités et des partenaires autochtones à l’échelle locale, régionale et nationale pour répondre aux besoins des délinquants autochtones. Dans le cadre du budget de 2017, des fonds ont été réservés aux séances de counseling touchant les traumatismes, la toxicomanie et la préparation à la vie active pour les délinquants autochtones dans les CIA des établissements du SCC et dans le Pavillon de ressourcement Okimaw Ochi.
Le pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté a légèrement augmenté, passant de 60 % en 2015 2016 à 63 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté a légèrement augmenté, passant de 60 % en 2015 2016 à 67 % en 2019 2020. En 2015 2016, 60 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 60 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 60 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 57 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 60 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 58 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 60 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 61 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 63 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 67 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi.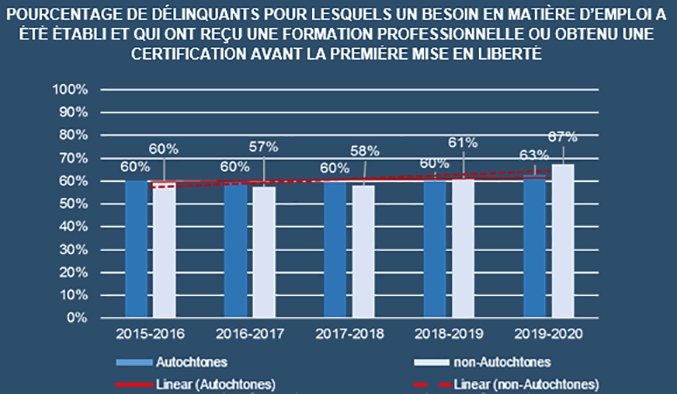
Pourcentage de délinquants pour lesquels un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant la première mise en liberté.
Surveillance
Taux de suspension et de révocation
Titre : Sous-comité sur les services correctionnels pour autochtones du comité de direction
Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a fait des taux de suspension et de révocation l’une de ses huit priorités. Des réunions ont eu lieu avec les directeurs de district, et une série d’occasions ont été cernées pour réaliser des gains rapides, tout comme les domaines nécessitant une analyse plus poussée ou des investissements en ressources. Les commentaires des régions ont aidé à déterminer sept domaines d’intérêt nécessitant une analyse plus poussée par une équipe intersectorielle spécialisée.
Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans faire l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance a légèrement augmenté, passant de 37 % en 2015 2016 à 45 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones qui ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans faire l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance est demeuré relativement stable, passant de 62 % en 2015 2016 à 65 % en 2019 2020. En 2015 2016, 37 % des délinquants autochtones ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans avoir fait l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance, comparativement à 62 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 42 % des délinquants autochtones ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans avoir fait l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance, comparativement à 64 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 43 % des délinquants autochtones ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans avoir fait l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance, comparativement à 67 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 45 % des délinquants autochtones ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans avoir fait l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance, comparativement à 67 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 45 % des délinquants autochtones ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans avoir fait l’objet d’une révocation ou d’une condamnation pendant leur période de surveillance, comparativement à 65 % des délinquants non autochtones.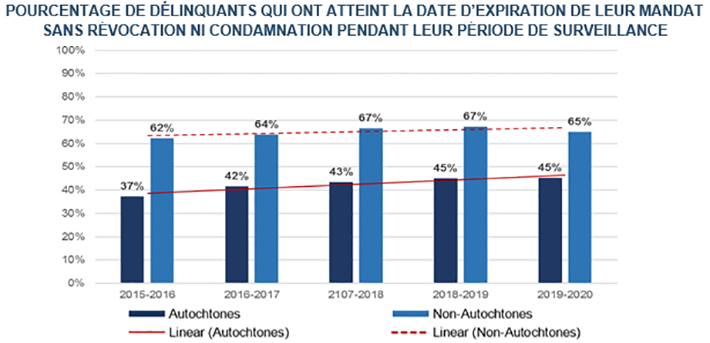
Pourcentage de délinquants qui ont atteint la date d’expiration de leur mandat sans révocation ni condamnation pendant leur période de surveillance.
Au chapitre des résultats correctionnels relatifs à la surveillance des délinquants, on continue d’observer un écart entre les délinquants autochtones et non autochtones. Malgré l’amélioration constante de leurs résultats au fil des années, les délinquants autochtones affichent toujours un taux supérieur de révocation sans infraction.
Le taux de révocations pour les délinquants autochtones a diminué, passant de 432 en 2015 2016 à 300 en 2019 2020. Le taux de révocations pour les délinquants non autochtones est passé de 179 en 2015 2016 à 137 en 2019 2020. En 2015 2016, le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 432, comparativement à 179 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2016 2017, le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 348, comparativement à 148 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2017 2018, le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 315, comparativement à 134 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2018 2019, le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 297, comparativement à 137 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2019 2020, le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 300, comparativement à 137 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones.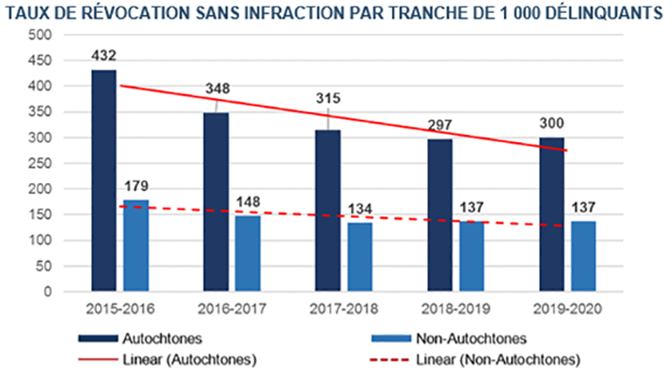
Taux de révocation sans infraction par tranche de 1 000 délinquants.
Condamnations pendant la période de surveillance
Les condamnations mineures et moyennement graves pendant la période de surveillance comprennent toute infraction visée à l’annexe II de la LSCMLC, ainsi que toute infraction ne figurant pas aux annexes. Bien qu’un écart demeure dans ce domaine entre les délinquants autochtones et non autochtones, le nombre de condamnations mineures et moyennement graves prononcées contre des délinquants autochtones pendant la période de surveillance s’est considérablement amélioré par rapport à 2014-2015.
Les condamnations graves pendant la période de surveillance comprennent toute infraction visée à l’annexe I. Il y a encore davantage de délinquants autochtones que de délinquants non autochtones qui sont visés par une condamnation grave pendant leur période de surveillance.
Le nombre de condamnations mineures et moyennement graves encourues par les délinquants autochtones est passé de 349 à 288, alors que le nombre pour les délinquants non autochtones est passé de 142 à 93 pendant cette période. Les délinquants autochtones continuent de faire l’objet d’une condamnation grave pendant la période de surveillance plus souvent que les délinquants non autochtones. Le nombre de condamnations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones a augmenté, passant de 48 à 74, alors que le nombre pour les délinquants non autochtones a diminué, passant de 25 à 19. En 2019 2020, le nombre de condamnations mineures et moyennement graves par tranche de 1 000 délinquants non autochtones s’élevait à 93, alors qu’il était de 288 par tranche de 1 000 délinquants autochtones. En 2015 2016, le nombre de condamnations mineures et moyennement graves par tranche de 1 000 délinquants non autochtones s’élevait à 142, alors qu’il était de 349 par tranche de 1 000 délinquants autochtones. En 2019 2020, le nombre de condamnations graves par tranche de 1 000 délinquants non autochtones s’élevait à 19, alors qu’il était de 74 par tranche de 1 000 délinquants autochtones. En 2015 2016, le nombre de condamnations graves par tranche de 1 000 délinquants non autochtones s’élevait à 25, alors qu’il était de 48 par tranche de 1 000 délinquants autochtones.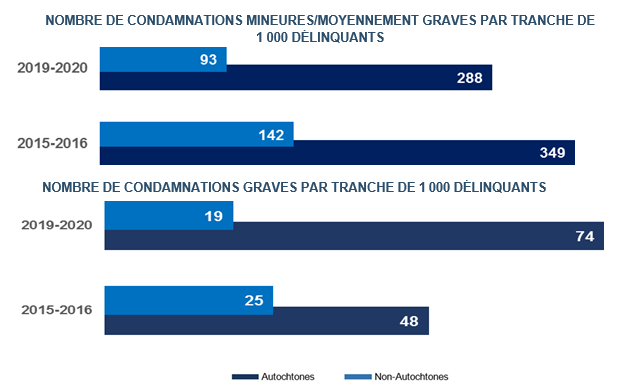
Nombre de condamnations mineures et moyennement graves par tranche de 1 000 délinquants.
Les recherches du SCC montrent que les délinquants qui obtiennent une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale affichent des taux de récidive plus faibles avant la fin de leur peine que ceux qui sont libérés d’office. Elles indiquent également que la plupart des délinquants qui sont évalués comme présentant un faible risque de récidive sont plus susceptibles de réussir leur période de surveillance dans la collectivité et sont moins susceptibles de récidiver avant la fin de leur peine.
Le SCC a réalisé des progrès en ce qui concerne les phases d’évaluation et d’intervention du Continuum de soins pour les Autochtones; toutefois, il doit en faire davantage pour appuyer la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones, principalement grâce à un accès accru à la mise en liberté discrétionnaire.
Comme le montre la page précédente, bien que l’écart entre les délinquants autochtones et non autochtones qui terminent avec succès leur période de surveillance se soit rétréci au cours des cinq (5) dernières années, il demeure important. Ainsi, 45 % des délinquants autochtones qui ont atteint la date d’expiration de leur peine (DEP) en 2019-2020 ont terminé avec succès leur période de surveillance, comparativement à 65 % des délinquants non autochtones.
Le pourcentage de délinquants qui ont été réincarcérés dans un établissement fédéral dans les cinq (5) années suivant leur DEP a diminué pour les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones. Malgré une amélioration à ce chapitre, un écart important persiste entre les délinquants autochtones et non autochtones qui ont été réincarcérés dans un établissement fédéral dans les cinq (5) années suivant leur DEP, et cet écart a peu varié au cours des cinq (5) dernières années.
Résultats au chapitre de la surveillance dans les pavillons de ressourcement
Comme ils mettent l’accent sur la justice réparatrice et la réhabilitation adaptée à la culture, les pavillons de ressourcement, qui sont indépendants des établissements réguliers, méritent une considération particulière. Le travail qui y est accompli est consacré à des engagements de grande valeur, comme la préservation et la restauration de la culture, dont les répercussions sont vitales pour les Autochtones. Les pavillons de ressourcement permettent de combler des lacunes dans les services fournis aux délinquants autochtones, en plus d’améliorer les résultats sur le plan de la réinsertion sociale.
73 % des délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui ont été libérés d’un pavillon de ressourcement ont bénéficié d’une première mise en liberté de nature discrétionnaire.
90 % des délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui ont atteint la DEP à la fin de l’exercice 2019-2020 et qui ont été libérés d’un pavillon de ressourcement ont terminé avec succès leur période de surveillance.
Un pourcentage moins élevé de délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui ont été libérés d’un pavillon de ressourcement ont réussi leur période de surveillance, comparativement aux délinquants autochtones libérés d’un autre établissement du SCC. Malgré ces résultats, et malgré le fait qu’ils affichent un taux moins élevé au chapitre des libérations discrétionnaires lors de la première mise en liberté, les délinquants autochtones ayant une cote de sécurité minimale qui sont libérés d’un pavillon de ressourcement présentent un taux moins élevé de réincarcération dans un établissement fédéral dans les cinq (5) années suivant la DEP, comparativement à ceux libérés d’un autre établissement du SCC.
Les risques et les besoins varient d’un délinquant à l’autre au cours de la peine, et le SCC doit être en mesure d’offrir le bon type de logement au bon endroit et au bon moment pour mieux répondre aux demandes changeantes et croissantes en ce qui a trait au logement des délinquants dans la collectivité.
Les résultats correctionnels reflètent l’importance des pavillons de ressourcement pour la réinsertion sociale des délinquants autochtones. Des résultats favorables sont également associés à la participation à des initiatives comportant un contact direct avec la collectivité; un pourcentage plus élevé de délinquants autochtones ayant un plan de libération établi en vertu de l’article 84 ont terminé avec succès leur période de surveillance, comparativement aux délinquants autochtones qui n’avaient pas de plan de libération établi en vertu de l’article 84, ce qui met davantage l’accent sur la participation accrue de la collectivité à la réinsertion sociale des délinquants.
La Direction des initiatives pour les Autochtones (DIA) collabore avec la Direction de la recherche à un projet d’étude visant à examiner l’effet des séjours en pavillon de ressourcement sur la réinsertion sociale des délinquants autochtones, ainsi qu’à analyser l’expérience globale de ces séjours en pavillon de ressourcement. L’étude se fondera sur une conception faisant appel à une méthode mixte qui prévoit l’examen de données quantitatives et qualitatives.
Plan national relatif aux autochtones
Le Plan national relatif aux Autochtones constitue le fondement de la réponse du SCC à la majorité des recommandations formulées dans le rapport de l’automne 2016 du Bureau du vérificateur général intitulé La préparation des détenus autochtones à la mise en liberté. Il fournit un cadre national pour transformer la gestion des cas des Autochtones et les services correctionnels pour Autochtones. Le plan comprend la rationalisation des ressources et des services existants, pour que les délinquants qui choisissent d’accéder aux interventions du Continuum de soins pour les Autochtones se voient accorder la priorité pour le placement dans des établissements bien précis à sécurité maximale, moyenne et minimale.
Dans le cadre du plan, les services d’Aînés et de liaison continuent d’être offerts dans tous les établissements. De plus, la planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 commence deux (2) ans avant la date d’admissibilité d’un délinquant à la semi-liberté pour s’assurer que les collectivités autochtones peuvent participer activement à la planification de la mise en liberté de leurs membres.
Le Plan national relatif aux Autochtones du SCC transforme la gestion des cas et les services correctionnels pour Autochtones en améliorant les diverses politiques, opérations et pratiques en vue de mieux répondre aux besoins des délinquants autochtones. En voici les composantes clés :
- modèle d’intervention des CIA établi partout au pays, dans tous les établissements pour femmes et dans certains établissements pour hommes;
- modifications apportées aux politiques pour permettre l’examen automatique du cas des délinquants autochtones après l’achèvement d’un programme correctionnel ou d’une initiative des Sentiers autochtones ou après tout événement important;
- amélioration des pratiques de gestion des cas pour consigner adéquatement la façon dont les interventions adaptées à la culture contribuent aux résultats au chapitre de la réinsertion sociale.
Le Plan national relatif aux Autochtones fait partie de l’engagement du SCC à concentrer l’attention collective sur les services correctionnels pour Autochtones, en prêtant une attention particulière à la gestion de cas proactive, éclairée et engagée afin d’améliorer les résultats des délinquants autochtones en matière de réinsertion sociale.
Les CIA sont l’une des composantes du Plan national relatif aux Autochtones. Ils garantissent l’accès à des programmes pour Autochtones, à la planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 de la LSCMLC et aux options de réinsertion sociale plus tôt dans la peine d’un délinquant, avec le soutien des ressources communautaires.
Qui est admissible? Tout délinquant autochtone qui:
- souhaite participer au Continuum de soins pour les Autochtones
- est disposé à travailler avec un Aîné
- purge une courte peine (moins de six ans)
- s’engage à participer à des programmes d’intensité modérée pour Autochtones (ou n’en a pas besoin)
Sous-comité sur les services correctionnels pour autochtones du comité de direction
Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les CIA représentaient l’une de ses priorités thématiques. Compte tenu des taux de participation plus faibles que prévu chez les délinquants autochtones dans les CIA de toutes les régions, le SCC a retiré la restriction relative aux infractions sexuelles des critères d’admissibilité à la participation au modèle des CIA.
Inscription à des programmes adaptés à la culture
Le Plan national relatif aux Autochtones a introduit une stratégie améliorée de suivi du rendement afin de renforcer l’approche intégrée de responsabilité partagée visant l’amélioration des résultats correctionnels pour les délinquants autochtones dans l’ensemble des opérations du SCC, du personnel de première ligne aux cadres supérieurs. Cette approche, pierre angulaire du CRSCA, a été conçue pour favoriser des résultats démontrables et durables.
La Direction des initiatives pour les Autochtones continue de travailler en collaboration avec la Division de la mesure du rendement et des rapports de gestion afin d’améliorer la collecte de données liées au modèle d’intervention des CIA et leur incidence sur les résultats correctionnels pour la cohorte des participants des CIA et l’ensemble de la sous-population autochtone.
La première série de résultats propres aux indicateurs de rendement ventilés intégrés à la stratégie de suivi du rendement du Plan national relatif aux Autochtones sera présentée tout au long de la présente section du CRSCA.
Le pourcentage de délinquants autochtones qui se sont inscrits a diminué, passant de 98 % en 2015 2016 à 85 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones (CIA) en 2019 2020 était de 94 %. En 2015 2016, 98 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2016 2017, 95 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2017 2018, 92 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2018 2019, 89 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 85 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 94 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté.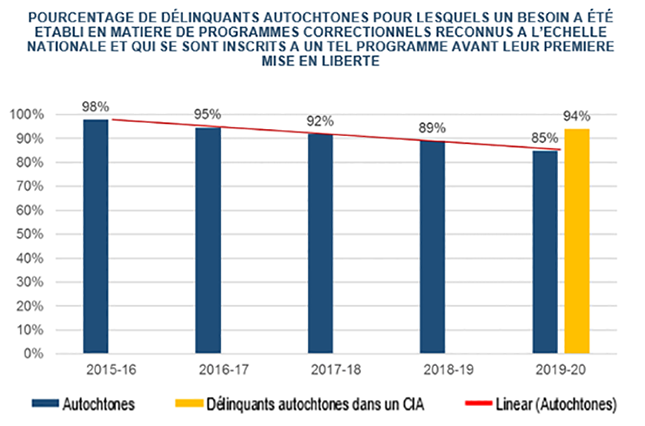
Pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et qui se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté.
Le modèle des CIA a été conçu pour accélérer l’accès aux programmes grâce à l’introduction de programmes hybrides d’intensité modérée, permettant aux délinquants de commencer les programmes à l’admission. Ce début précoce des programmes permet aux délinquants autochtones qui y participent d’avoir accès à des occasions supplémentaires, telles que les placements à l’extérieur, la mise en liberté sous condition, le transfèrement dans des pavillons de ressourcement et une planification complète de la mise en liberté en vertu de l’article 84, de manière plus rapide.
En 2019-2020, 85 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale (PCREN) se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté. Il importe de souligner que 94 % des délinquants autochtones dans un CIA pour lesquels un besoin a été établi en matière de PCREN se sont inscrits à un tel programme avant leur première mise en liberté.
Détails : Le pourcentage de délinquants autochtones qui se sont inscrits a augmenté, passant de 68 % en 2015 2016 à 74 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un CIA en 2019 2020 était de 82 %. En 2015 2016, 68 % des délinquants autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture. En 2016 2017, 65 % des délinquants autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture. En 2017 2018, 67 % des délinquants autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture. En 2018 2019, 75 % des délinquants autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture. En 2019 2020, 74 % des délinquants autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture. En 2019 2020, 82 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones qui étaient inscrits dans des programmes correctionnels avant leur première mise en liberté l’étaient dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture.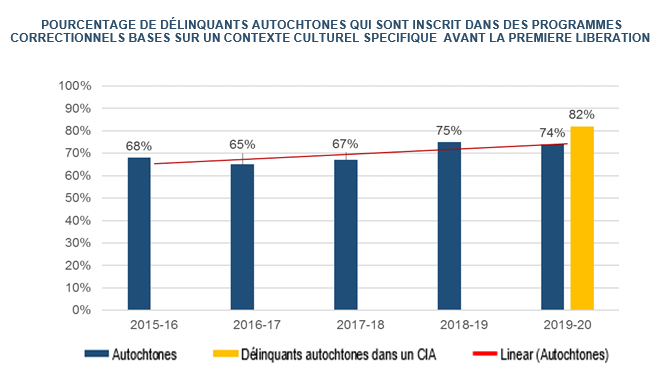
Pourcentage de délinquants autochtones inscrits dans des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture avant leur première mise en liberté.
À la fin de l’exercice 2019-2020, 74 % des délinquants autochtones s’étaient inscrits à des programmes correctionnels adaptés à leur culture, plutôt qu’à des programmes correctionnels réguliers, avant leur première mise en liberté. Cela représente une hausse de 8 % par rapport à 2015-2016.
Le pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et qui ont préféré des programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou des programmes correctionnels réguliers a augmenté, passant de 74 % en 2015 2016 à 84 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 23 %. En 2015 2016, 74 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers. En 2016 2017, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers. En 2017 2018, 84 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers. En 2018 2019, 88 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers. En 2019 2020, 84 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers. En 2019 2020, 23 % des délinquants autochtones qui ont été placés dans un centre d’intervention pour Autochtones et pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont été aiguillés en tenant compte de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers.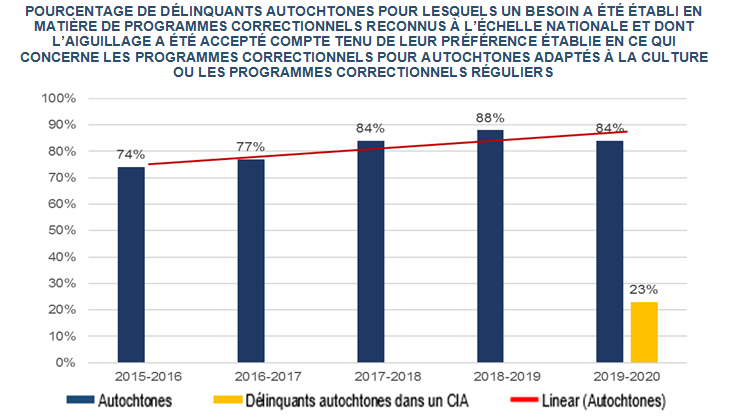
Pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et dont l’aiguillage a été accepté compte tenu de leur préférence établie en ce qui concerne les programmes correctionnels pour Autochtones adaptés à la culture ou les programmes correctionnels réguliers.
Achèvement des programmes adaptés à la culture
Le pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté a diminué, passant de 90 % en 2015 2016 à 72 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones dans cette catégorie a aussi diminué, passant de 87 % en 2015 2016 à 80 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 86 %. En 2015 2016, 90 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2015 2016, 87 % des délinquants non autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2016 2017, 88 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2016 2017, 82 % des délinquants non autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2017 2018, 83 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2017 2018, 83 % des délinquants non autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2018 2019, 78 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2018 2019, 79 % des délinquants non autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 72 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 80 % des délinquants non autochtones pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 86 % des délinquants autochtones qui avaient été placés dans un centre d’intervention pour Autochtones et pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté.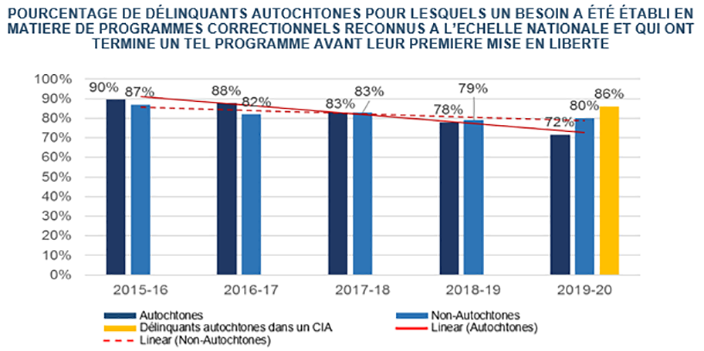
Pourcentage de délinquants autochtones pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté.
Comme il a été mentionné précédemment, l’achèvement d’un programme correctionnel constitue un facteur principal en ce qui a trait à l’obtention d’une libération discrétionnaire au moment de la première mise en liberté admissible. Le SCC continue de mettre en œuvre des mesures pour améliorer les résultats au chapitre de l’achèvement des programmes correctionnels.
On s’attend à ce que les résultats relatifs à la participation aux programmes correctionnels et à l’achèvement de ces derniers par les délinquants autochtones s’améliorent à mesure que les agents de programmes correctionnels (APC)/agents de programmes correctionnels pour Autochtones (APCA) seront mieux outillés pour répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones, grâce à la formation sur la façon de tenir compte des ASA dans la prise de décisions et à des partenariats améliorés entre les Aînés et les APC/APCA.
Détails : Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à leur culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier, avant leur première mise en liberté, est passé de 60 % en 2015 2016 à 52 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 76 %. En 2015 2016, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 60 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier. En 2016 2017, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 55 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier. En 2017 2018, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 53 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier. En 2018 2019, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 58 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier. En 2019 2020, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 52 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier. En 2019 2020, parmi les délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel avant leur première mise en liberté, 76 % ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier.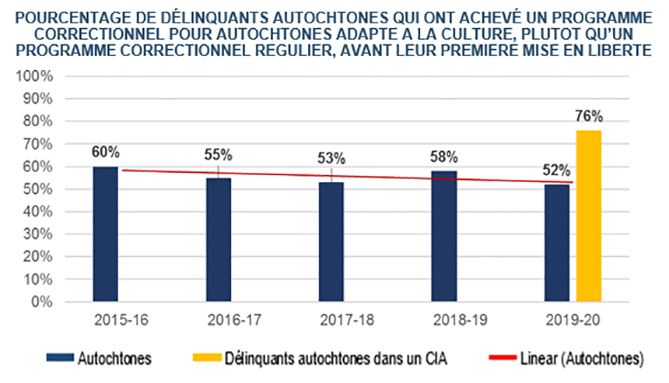
Pourcentage de délinquants autochtones qui ont achevé un programme correctionnel pour Autochtones adapté à la culture, plutôt qu’un programme correctionnel régulier, avant leur première mise en liberté.
Transitions et transfèrements réussis
Le pourcentage de délinquants autochtones ayant réussi leur transition vers une cote de sécurité inférieure a légèrement augmenté, passant de 94 % en 2015 2016 à 95 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones dans cette catégorie a légèrement diminué, passant de 96 % en 2015 2016 à 95 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 95 %. En 2015 2016, 94 % des délinquants autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur, comparativement à 96 % des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 96 % des délinquants autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur, comparativement à 96 % des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 93 % des délinquants autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur, comparativement à 96 % des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 91 % des délinquants autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur, comparativement à 95 % des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 95 % des délinquants autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur, comparativement à 95 % des délinquants non autochtones. En 2015 2016, 95 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones ont réussi leur transition vers un niveau de sécurité inférieur. Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement est passé de 92 % en 2015 2016 à 96 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 100 %. En 2015 2016, 92 % des délinquants autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement. En 2016 2017, 96 % des délinquants autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement. En 2017 2018, 93 % des délinquants autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement. En 2018 2019, 82 % des délinquants autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement. En 2019 2020, 96 % des délinquants autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement. En 2015 2016, 100 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones ont réussi leur transfèrement vers un pavillon de ressourcement.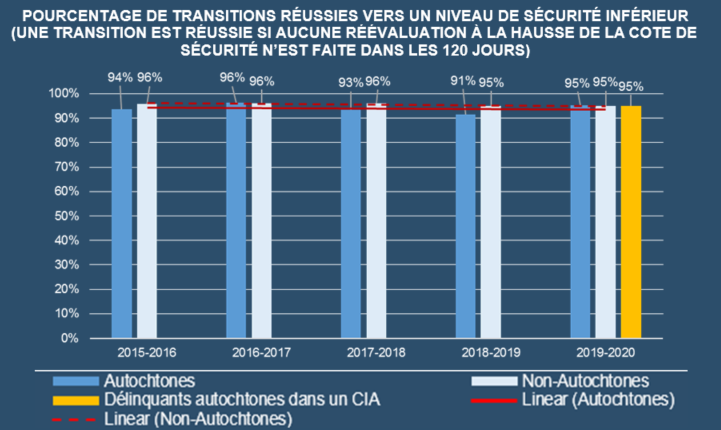
Pourcentage de transitions réussies vers un niveau de sécurité inférieur (une transition est réussie si aucune réévaluation à la hausse de la cote de sécurité n’est faite dans les 120 jours).
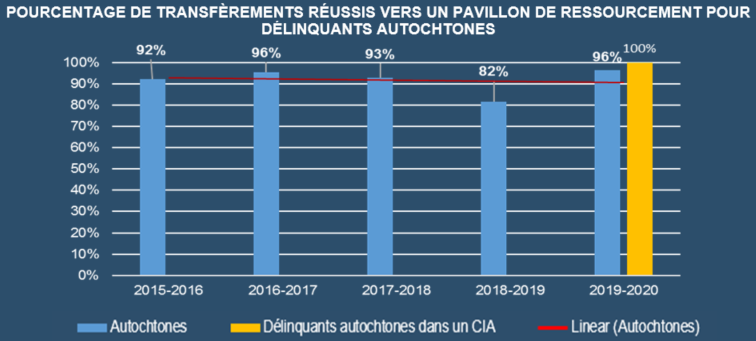
Pourcentage de transfèrements réussis vers un pavillon de ressourcement pour délinquants autochtones.
Le SCC évalue rigoureusement le risque qu’un délinquant pourrait présenter pour la sécurité publique avant de prendre une décision concernant son transfèrement éventuel dans un pavillon de ressourcement. La sécurité des employés, des détenus et de l’établissement revêt une importance primordiale dans la prise des décisions concernant le logement et le transfèrement des détenus.
Tous les transfèrements sont effectués conformément à la LSCMLC, et le SCC mène des évaluations du risque avant de procéder au transfèrement d’un délinquant. Les transfèrements jouent un rôle important dans la capacité du SCC de gérer la population carcérale, tout en permettant aux détenus d’avoir accès à des programmes qui ne sont peut-être pas offerts dans leur établissement actuel. Cela permet également aux détenus d’être logés dans un milieu qui répond à leurs besoins culturels et linguistiques.
Accusations liées à des incidents de sécurité
Étant donné que la participation à des incidents de sécurité peut avoir un effet négatif sur des aspects clés de la réinsertion sociale, l’amélioration dans ce domaine est particulièrement importante.
Comme il est illustré ci-dessous, les participants des CIA présentent des taux considérablement plus faibles d’accusations liées à des incidents de sécurité graves pendant leur détention, comparativement aux délinquants non autochtones et aux délinquants autochtones qui n’ont pas participé au modèle des CIA. Cette conclusion donne à penser que les participants des CIA sont susceptibles d’avoir un meilleur accès à des mesures de soutien à la réinsertion sociale et qu’ils sont donc plus susceptibles de réussir leur réinsertion sociale en toute sécurité.
Ces premiers résultats indiquent qu’une stratégie novatrice, comme le Plan national relatif aux Autochtones, promet de réduire les écarts au chapitre des résultats entre les délinquants autochtones et non autochtones, signalant ainsi un changement de cap pour contrer la surreprésentation endémique des Autochtones dans le système correctionnel fédéral.
À la fin de l’exercice 2019-2020, les participants des CIA affichaient un taux de 310 accusations graves par tranche de 1 000 délinquants sous responsabilité fédérale, comparativement à 403 accusations graves pour les délinquants non autochtones et à 645 pour les délinquants autochtones n’ayant pas participé au modèle des CIA.
Ce résultat laisse entendre qu’un accès accru à des mesures de soutien, des interventions et des services adaptés à la culture visant à répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones pourrait avoir une incidence positive sur les résultats correctionnels.
Détails : Le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones a augmenté, passant de 537 en 2015 2016 à 645 en 2019 2020. Le nombre par tranche de 1 000 délinquants non autochtones dans cette catégorie a augmenté, passant de 377 en 2015 2016 à 403 en 2019 2020. Le nombre par tranche de 1 000 délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 310. En 2015 2016, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale s’élevait à 537, comparativement à 377 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. En 2016 2017, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale s’élevait à 568, comparativement à 389 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. En 2017 2018, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale s’élevait à 601, comparativement à 351 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. En 2018 2019, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale s’élevait à 713, comparativement à 399 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. En 2019 2020, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale s’élevait à 645, comparativement à 403 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. En 2019 2020, le nombre d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale placés dans un centre d’intervention pour Autochtones s’élevait à 310.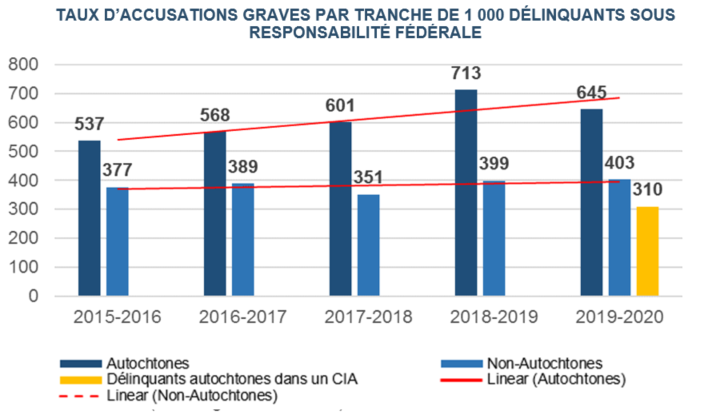
Taux d’accusations graves par tranche de 1 000 délinquants sous responsabilité fédérale.
Bien que les succès préliminaires du Plan national relatif aux Autochtones puissent être attribués à la rationalisation des ressources autochtones existantes afin d’améliorer l’accès pour les délinquants qui choisissent le Continuum de soins pour les Autochtones, ils peuvent également être attribuables, du moins en partie, au degré de mobilisation des délinquants qui sont disposés à participer au continuum et à travailler avec un Aîné. Le SCC devrait continuer d’explorer des façons d’accroître la participation des délinquants afin d’améliorer les résultats correctionnels pour tous.
Processus de mise en liberté prévu à l’article 84
Détails : Le pourcentage de délinquants autochtones ayant un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) avant leur première mise en liberté a diminué, passant de 45 % en 2015 2016 à 37 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 49 %. En 2015 2016, 45 % des délinquants autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté. En 2016 2017, 41 % des délinquants autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté. En 2017 2018, 43 % des délinquants autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté. En 2018 2019, 38 % des délinquants autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 37 % des délinquants autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 49 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones avaient un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté.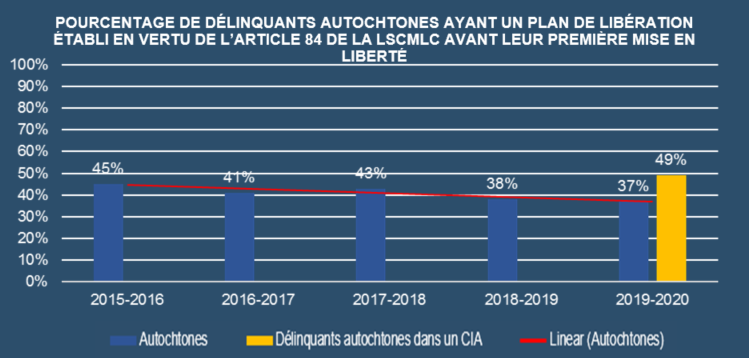
Pourcentage de délinquants autochtones ayant un plan de libération établi en vertu de l’article 84 de la LSCMLC avant leur première mise en liberté.
À la fin de l’exercice 2019-2020, les participants des CIA étaient plus susceptibles d’avoir un plan de libération établi en vertu de l’article 84 et d’être libérés conformément au processus connexe.
Les mises en liberté en vertu de l’article 84 sont importantes, car elles permettent aux collectivités et aux corps dirigeants autochtones de participer au retour des personnes dans la collectivité, ce qui favorise la sécurité et la participation significative des collectivités, tout en soutenant la réussite de la réinsertion sociale.
Détails : Le pourcentage de délinquants autochtones mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC a diminué, passant de 55 % en 2015 2016 à 41 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 61 %. En 2015 2016, 55 % des délinquants autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC. En 2016 2017, 59 % des délinquants autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC. En 2017 2018, 56 % des délinquants autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC. En 2018 2019, 53 % des délinquants autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC. En 2019 2020, 41 % des délinquants autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC. En 2019 2020, 61 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones ont été mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC.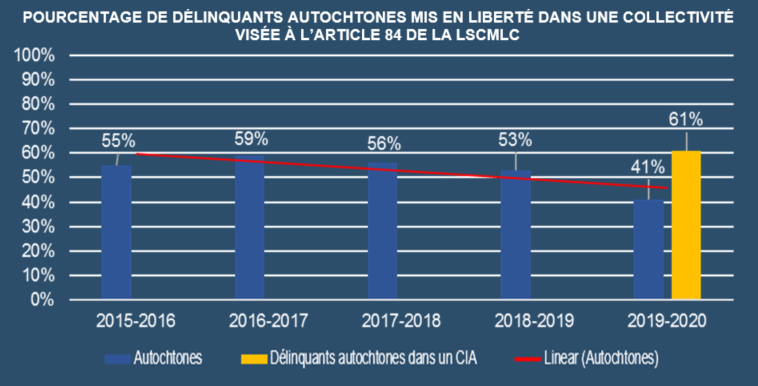
Pourcentage de délinquants autochtones mis en liberté dans une collectivité visée à l’article 84 de la LSCMLC.
Mise en liberté et surveillance
Détails : En 2019 2020, 40 % des délinquants autochtones ont obtenu une libération discrétionnaire, comparativement à 85 % des délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones.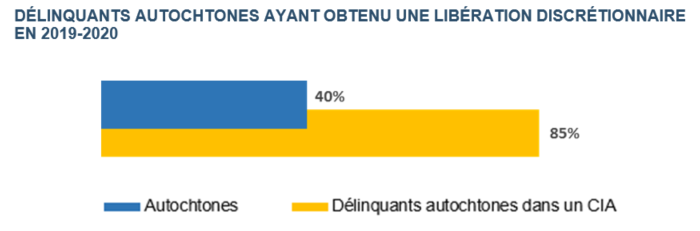
Délinquants autochtones ayant obtenu une libération discrétionnaire en 2019 2020.
À la fin de l’exercice 2019-2020, les participants des CIA étaient plus de deux fois plus susceptibles d’obtenir une libération discrétionnaire, le type optimal de mise en liberté, comparativement aux délinquants autochtones n’ayant pas participé au modèle des CIA. L’augmentation des taux de mise en liberté discrétionnaire des délinquants autochtones constitue une priorité stratégique du SCC.
De plus, les taux de suspension de la surveillance pour les participants des CIA à la fin de l’exercice 2019-2020 étaient bien inférieurs à ceux des autres délinquants autochtones et non autochtones, et cette différence importante est illustrée dans le graphique ci-dessous. Des taux plus faibles de suspension de la surveillance peuvent être une indication de la réussite des interventions, des services et du soutien reçus par les participants des CIA.
Le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones a diminué, passant de 1 250 en 2015 2016 à 1 087 en 2019 2020. Le nombre par tranche de 1 000 délinquants non autochtones de cette catégorie a aussi diminué, passant de 541 en 2015 2016 à 457 en 2019 2020. Le nombre par tranche de 1 000 délinquants autochtones de cette catégorie dans un centre d’intervention pour Autochtones en 2019 2020 était de 329. En 2015 2016, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 1 250, comparativement à 541 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2016 2017, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 1 229, comparativement à 497 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2017 2018, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 1 170, comparativement à 478 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2018 2019, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 1 135, comparativement à 471 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2019 2020, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones s’élevait à 1 087, comparativement à 457 par tranche de 1 000 délinquants non autochtones. En 2019 2020, le nombre de suspensions de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants autochtones placés dans un centre d’intervention pour Autochtones s’élevait à 329.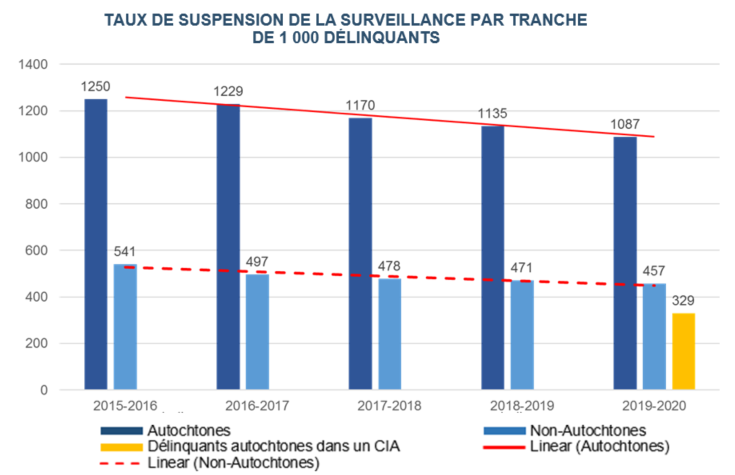
Taux de suspension de la surveillance par tranche de 1 000 délinquants.
Les délinquants en liberté sous condition qui atteignent la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés sont un indicateur clé d’une réinsertion sociale réussie en toute sécurité.
Comme il est illustré sur la présente page, un écart demeure entre les résultats des délinquants autochtones et non autochtones pour cet indicateur de rendement. Les résultats initiaux pour les participants des CIA semblent montrer l’efficacité des interventions et des services adaptés à la culture des délinquants autochtones pour combler cet écart de longue date dans les résultats.
Le pourcentage de délinquants autochtones en liberté sous condition atteignant avec succès la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés (aucune révocation, accusation, ni condamnation) est passé de 37 % en 2015 2016 à 45 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquants non autochtones dans cette catégorie est passé de 62 % en 2015 2016 à 65 % en 2019 2020. En 2015 2016, 37 % des délinquants autochtones en liberté sous condition ont atteint la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés, comparativement à 62 % des délinquants non autochtones en liberté sous condition. En 2016 2017, 42 % des délinquants autochtones en liberté sous condition ont atteint la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés, comparativement à 64 % des délinquants non autochtones en liberté sous condition. En 2017 2018, 43 % des délinquants autochtones en liberté sous condition ont atteint la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés, comparativement à 67 % des délinquants non autochtones en liberté sous condition. En 2018 2019, 45 % des délinquants autochtones en liberté sous condition ont atteint la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés, comparativement à 67 % des délinquants non autochtones en liberté sous condition. En 2019 2020, 45 % des délinquants autochtones en liberté sous condition ont atteint la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés, comparativement à 65 % des délinquants non autochtones en liberté sous condition.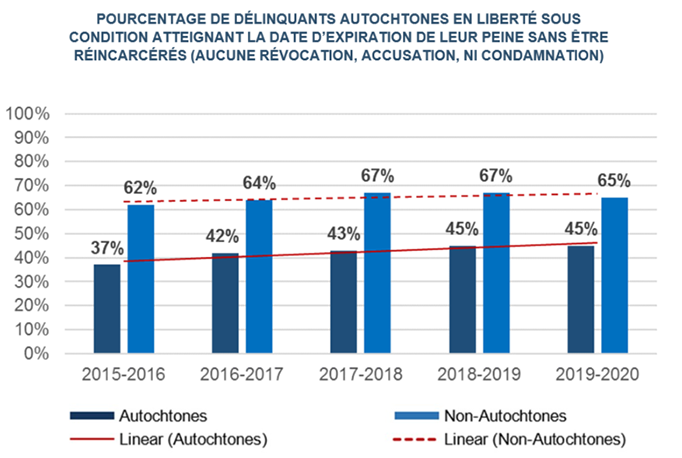
Pourcentage de délinquants autochtones en liberté sous condition atteignant la date d’expiration de leur peine sans être réincarcérés (aucune révocation, accusation, ni condamnation).
Dans l’ensemble, les résultats initiaux en matière de mise en liberté et de surveillance pour les participants des CIA indiquent que le Plan national relatif aux Autochtones contribue à améliorer les résultats pour les délinquants autochtones et à combler les écarts endémiques entre les résultats pour les délinquants autochtones et non autochtones.
Le SCC continuera de redoubler d’efforts pour appuyer la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones, favoriser la sécurité des collectivités et réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel fédéral.
Délinquantes
Population de délinquantes autochtones purgeant une peine ressort fédéral
En 1989, le gouvernement fédéral a confié à un groupe d’étude le mandat d’examiner la situation des délinquantes sous responsabilité fédérale et d’établir une nouvelle orientation. Le rapport du groupe d’étude, intitulé La Création de choix, a été publié en avril 1990.
Depuis 30 ans, les cinq principes de La Création de choix– pouvoir contrôler sa vie, choix valables et responsables, respect et dignité, environnement de soutien et responsabilité partagée – ont guidé le SCC dans l’élaboration de politiques, de programmes et d’interventions qui répondent aux besoins et aux risques de la population diversifiée de délinquantes du SCC. Ces principes ont appuyé un certain nombre d’améliorations apportées, notamment en ce qui concerne la conception des établissements, les interventions correctionnelles, les opérations, les interventions en matière de santé mentale et les ressources humaines.
Dans son travail auprès des délinquantes autochtones, le SCC adopte une approche holistique, axée sur les femmes et fondée sur les principes énoncés dans le rapport La Création de choix, la Stratégie nationale sur les services correctionnels pour Autochtones et le Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones. Le fait de répondre aux besoins des délinquantes autochtones au moyen d’une approche adaptée à leur culture et axée sur les femmes contribue à améliorer leur qualité de vie et la sécurité publique.
La population de délinquantes autochtones au SCC a augmenté de 21 % depuis 2015-2016. Ces dernières représentent maintenant 34 % des délinquantes sous la responsabilité du SCC. Bien que certaines régions aient réduit le nombre de délinquantes autochtones incarcérées dans leurs établissements, d’autres ont connu une croissance presque exponentielle. La région de l’Atlantique a connu la plus forte croissance, avec une augmentation de 41 % en cinq (5) ans.
Détails : Dans la région du Pacifique, 18 % des délinquantes sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 34 % (de 65 à 87). Dans la région des Prairies, 56 % des délinquantes sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 29 % (de 210 à 271). Dans la région de l’Ontario, 16 % des délinquantes sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 22 % (de 63 à 77). Dans la région du Québec, 4 % des délinquantes sont Autochtones et le pourcentage de diminution est de 50 % (de 42 à 21). Dans la région de l’Atlantique, 6 % des délinquantes sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 41 % (de 22 à 31).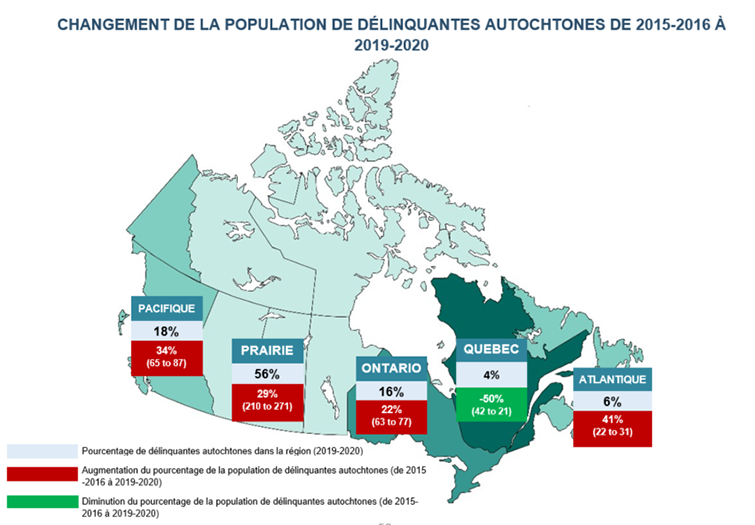
Changement de la population de délinquantes autochtones de 2015 2016 à 2019 2020.
Le nombre total de délinquantes autochtones sous la responsabilité du SCC est demeuré stable au cours des dernières années. À la fin de l’exercice 2019- 2020, le SCC était responsable de 487 délinquantes autochtones. De ce nombre, 284 étaient incarcérés, tandis que 203 étaient sous surveillance dans la collectivité. Bien que les femmes autochtones représentent environ 4 % de la population canadienne, elles représentaient 34 % de la population de délinquantes sous la responsabilité du SCC à la fin de 2019-2020. Comme le montre le graphique ci-dessous, les femmes autochtones représentaient 41 % de la population de délinquantes sous garde, une augmentation de 28 % depuis 2009- 2010.
L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a relevé cette surreprésentation croissante des femmes autochtones dans les services correctionnels. Le SCC comprend que la surreprésentation des femmes autochtones dans le système de justice pénale, en tant que victimes et délinquantes, est enracinée dans une discrimination sociale, économique, culturelle et juridique endémique.
Le SCC est déterminé à régler le problème de l’incarcération disproportionnée des Autochtones et à veiller à ce que les intervenants autochtones participent de façon significative à la réhabilitation et à la réinsertion sociale efficaces des délinquants autochtones au moyen de programmes, d’interventions et de services de soutien offerts dans la collectivité, dans le cadre de ses efforts visant à contribuer, selon l’objectif du gouvernement, à l’établissement d’une relation de nation à nation renouvelée entre le Canada et les peuples autochtones.
Le règlement du problème lié à la surreprésentation des femmes autochtones dans les services correctionnels fédéraux constitue l’une des huit priorités stratégiques clairement établies comme un domaine d’intérêt dans le cadre des travaux du Sous-comité. Plus précisément, en ce qui concerne les femmes autochtones, le Sous-comité examine les facteurs liés à la participation et à l’achèvement des programmes, à la récidive et à la réinsertion sociale, ainsi qu’à la formation du personnel de première ligne, dans le but d’aider les femmes à adopter un mode de vie sain et productif.
Détails : De 2010 2011 à 2019 2020, le pourcentage de délinquantes autochtones en détention a augmenté de façon constante, passant de 32 % à 41 %. Au cours de cette même période, la population autochtone au Canada est demeurée stable, à environ 5 %. En 2010 2011, 32 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2011 2012, 33 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2012 2013, 34 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2013 2014, 34 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2014 2015, 36 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2015 2016, 37 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2016 2017, 36 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2017 2018, 40 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2018 2019, 41 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2019 2020, 41 % des délinquantes sous la garde du SCC étaient des Autochtones, alors que la population autochtone ne représentait qu’environ 5 % de la population canadienne totale.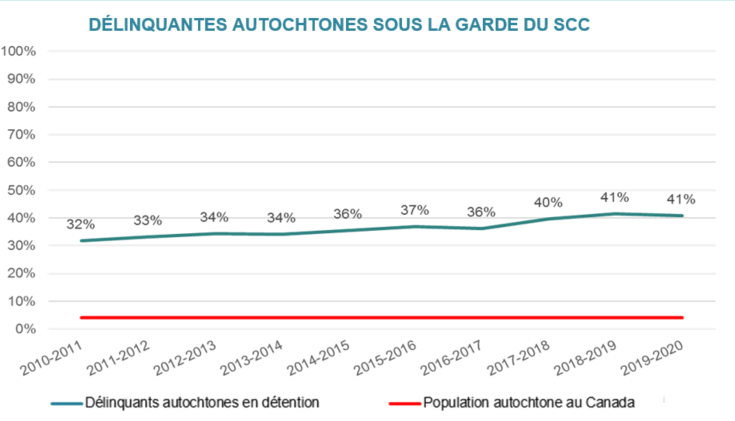
Délinquantes autochtones sous la garde du SCC.
Evaluation et admission
En 2015 2016, 33 % des délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones, alors que les autres 67 % étaient des délinquantes non autochtones. En 2016 2017, 32 % des délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones, alors que les autres 68 % étaient des délinquantes non autochtones. En 2017 2018, 37 % des délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones, alors que les autres 63 % étaient des délinquantes non autochtones. En 2018 2019, 35 % des délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones, alors que les autres 65 % étaient des délinquantes non autochtones. En 2019 2020, 34 % des délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones, alors que les autres 66 % étaient des délinquantes non autochtones.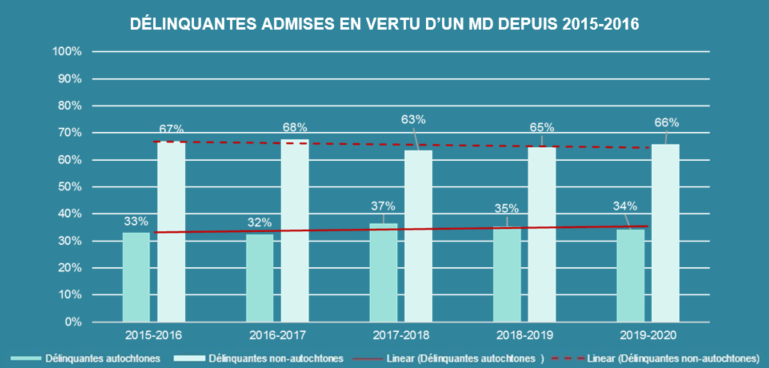
Délinquantes admises en vertu d’un mandat de dépôt depuis 2015 2016.
Les femmes autochtones représentent 34 % des délinquantes admises en vertu d’un MD en 2019-2020. Ce taux s’établissait à 33 % en 2015-2016.
Les délinquantes autochtones continuent d’être surreprésentées dans les établissements à sécurité moyenne, comparativement aux délinquantes non autochtones (69 % comparativement à 40 %). Parallèlement, les délinquantes autochtones sont sous- représentées dans les établissements à sécurité minimale, comparativement aux délinquantes non autochtones (22 % comparativement à 60 %).
Le graphique montre que de 2015 2016 à 2019 2020, les femmes autochtones ont continué d’être surreprésentées dans la cote de sécurité moyenne par rapport aux femmes non autochtones (69 % et 40 %), ainsi que dans la cote de sécurité maximale (9 % et 1 %). De même, les femmes autochtones sont sous représentées dans la cote de sécurité minimale par rapport aux femmes non autochtones (22 % et 60 %). En 2015 2016, 11 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 63 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 27 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2015 2016, 6 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 38 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 56 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2016 2017, 5 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 60 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 35 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2016 2017, 5 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 38 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 57 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2017 2018, 8 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 62 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 32 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2017 2018, 3 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 35 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 62 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2018 2019, 8 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 55 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 37 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2018 2019, 4 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 31 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 65 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2019 2020, 9 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 69 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 37 % des délinquantes autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale. En 2019 2020, 1 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale maximale, 40 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale moyenne et 65 % des délinquantes non autochtones avaient une cote de sécurité initiale minimale.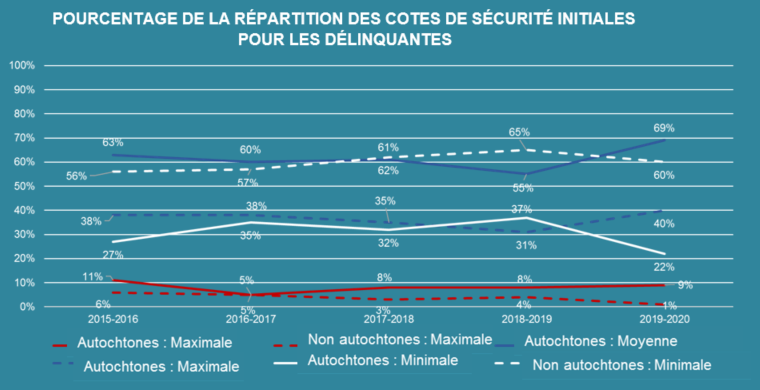
Pourcentage de la répartition des cotes de sécurité initiales pour les délinquantes.
Interventions correctionnelles
En 2010, le SCC a mis en œuvre un modèle complet de programmes correctionnels pour délinquantes. Ce modèle comprend les Programmes correctionnels pour délinquantes autochtones (PCDA), aussi connus sous le nom de cercles de soins. Les PCDA répondent aux besoins culturels particuliers des délinquantes autochtones.
Ce modèle a été conçu pour établir un équilibre entre l’approche de la guérison et celle de l’acquisition de compétences. Tous les programmes des PCDA sont offerts avec l’aide d’Aînés, tiennent compte des traumatismes et comprennent du contenu sur la consommation problématique de substances, la violence et la victimisation. Avec l’aide d’Aînés, les participantes élaborent des plans de guérison qui comportent des stratégies pour composer avec la vie quotidienne. Des programmes de soutien par des pairs éducateurs autochtones sont également en place.
Le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale pour les délinquantes autochtones est passé de 119 en 2015 2016 à 125 en 2019 2020, tandis que le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme principal en établissement à l’échelle nationale pour les délinquantes non autochtones est passé de 83 en 2015 2016 à 101 en 2019 2020. En 2015 2016, le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale était de 118 pour les délinquantes autochtones, alors qu’il était de 83 pour les délinquantes non autochtones. En 2016 2017, le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale était de 83 pour les délinquantes autochtones, alors qu’il était de 70 pour les délinquantes non autochtones. En 2017 2018, le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale était de 107 pour les délinquantes autochtones, alors qu’il était de 80 pour les délinquantes non autochtones. En 2018 2019, le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale était de 111 pour les délinquantes autochtones, alors qu’il était de 84 pour les délinquantes non autochtones. En 2019 2020, le nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale était de 125 pour les délinquantes autochtones, alors qu’il était de 101 pour les délinquantes non autochtones.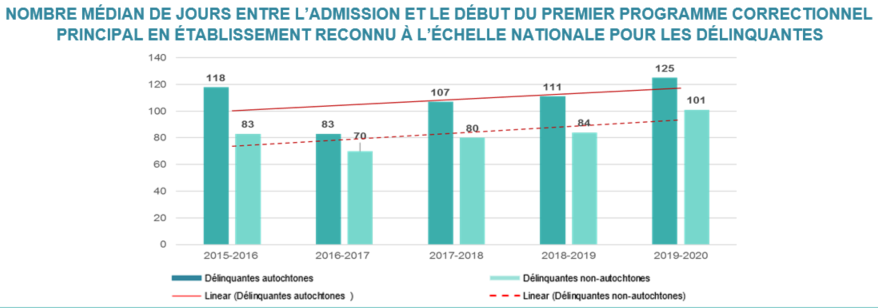
Nombre médian de jours entre l’admission et le début du premier programme correctionnel principal en établissement reconnu à l’échelle nationale pour les délinquantes.
Les délinquantes autochtones continuent d’attendre plus longtemps que les délinquantes non autochtones pour commencer leur premier PCREN en établissement. En 2019-2020, les délinquantes autochtones ont attendu 125 jours, comparativement à 101 jours pour les délinquantes non autochtones. Comme on peut le voir ci- dessous, 86 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de PCREN a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 94 % des délinquantes non autochtones. Il convient de souligner que le pourcentage de délinquantes autochtones qui terminent un tel programme a considérablement diminué depuis 2015-2016.
Détails : Le pourcentage de délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin a été établi en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté a diminué, passant de 93 % en 2015 2016 à 86 % en 2019 2020, tandis que le pourcentage de délinquantes non autochtones dans la même catégorie est demeuré stable à 94 % de 2015 2016 à 2019 2020. En 2015 2016, 93 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 94 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 93 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 96 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 92 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 93 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 85 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 97 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 86 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale a été établi ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté, comparativement à 94 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi.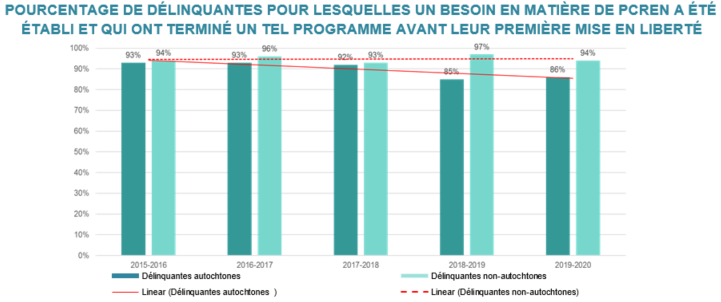
Pourcentage de délinquantes pour lesquelles un besoin en matière de PCREN a été établi et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté.
Réinsertion sociale : audiences de semi-liberté et de libération conditionnelle totale
Le pourcentage de délinquantes autochtones qui ont retiré leur demande d’audience de semi liberté est passé de 15 % en 2015 2016 à 11 % en 2019 2020, tandis que le pourcentage de délinquantes non autochtones dans la même catégorie est passé de 12 % en 2015 2020 à 7 % en 2019 2020. En 2015 2016, 15 % des délinquantes autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 12 % des délinquantes non autochtones. En 2016 2017, 12 % des délinquantes autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 8 % des délinquantes non autochtones. En 2017 2018, 9 % des délinquantes autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 7 % des délinquantes non autochtones. En 2018 2019, 11 % des délinquantes autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 6 % des délinquantes non autochtones. En 2019 2020, 11 % des délinquantes autochtones ont retiré leur demande d’audience de semi liberté, comparativement à 7 % des délinquantes non autochtones.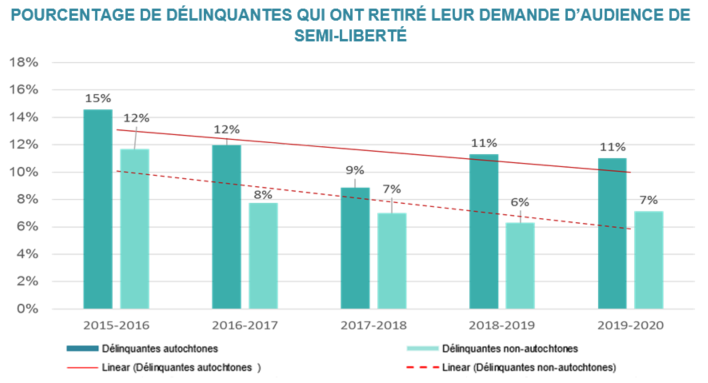
Pourcentage de délinquantes qui ont retiré leur demande d’audience de semi liberté.
Le pourcentage de délinquantes autochtones et non autochtones qui ont retiré leur demande d’audience de semi- liberté et qui ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale s’est amélioré. Le pourcentage de délinquantes autochtones qui retirent leur demande d’audience de semi-liberté continue de demeurer plus élevé que celui des délinquantes non autochtones, et l’écart se creuse. En particulier, il y a eu une diminution de 27 % du nombre d’audiences de semi-liberté retirées pour les délinquantes autochtones entre 2015-2016 et 2019-2020.
Détails : Le pourcentage de délinquantes autochtones qui ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale est passé de 47 % en 2015 2016 à 20 % en 2019 2020, tandis que le pourcentage de délinquantes non autochtones dans la même catégorie est passé de 29 % en 2015 2020 à 16 % en 2019 2020. En 2015 2016, 47 % des délinquantes autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 29 % des délinquantes non autochtones. En 2016 2017, 32 % des délinquantes autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 24 % des délinquantes non autochtones. En 2017 2018, 33 % des délinquantes autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 17 % des délinquantes non autochtones. En 2018 2019, 23 % des délinquantes autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 12 % des délinquantes non autochtones. En 2019 2020, 20 % des délinquantes autochtones ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale, comparativement à 16 % des délinquantes non autochtones.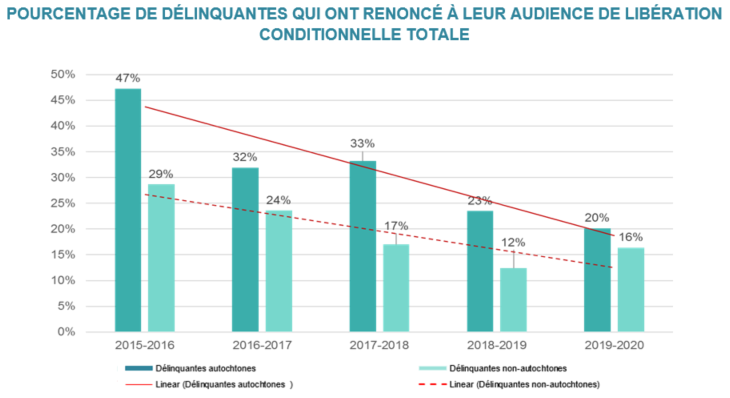
Pourcentage de délinquantes qui ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale.
Réinsertion sociale
Le pourcentage de délinquantes autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire est passé de 45 % en 2015 2016 à 66 % en 2019 2020, tandis que le pourcentage de délinquantes non autochtones appartenant à la même catégorie est passé de 68 % en 2015 2020 à 83 % en 2019 2020. En 2015 2016, 45 % des délinquantes autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 68 % des délinquantes non autochtones. En 2016 2017, 65 % des délinquantes autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 77 % des délinquantes non autochtones. En 2017 2018, 72 % des délinquantes autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 83 % des délinquantes non autochtones. En 2018 2019, 69 % des délinquantes autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 83 % des délinquantes non autochtones. En 2019 2020, 66 % des délinquantes autochtones ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté, comparativement à 83 % des délinquantes non autochtones.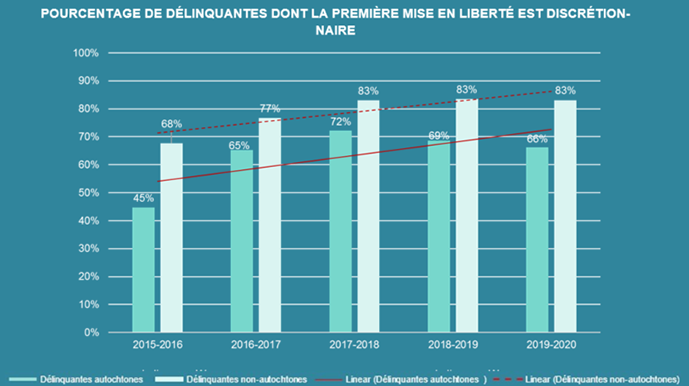
Pourcentage de délinquantes dont la première mise en liberté est discrétionnaire.
Comme il a été mentionné précédemment, la libération discrétionnaire représente la mise en liberté optimale pour tout délinquant. Le pourcentage de délinquantes autochtones dont la première mise en liberté est discrétionnaire s’est considérablement amélioré depuis 2015- 2016. Toutefois, l’écart entre les délinquantes autochtones et non autochtones demeure important.
Deux graphiques à secteurs rouge, bleu et jaune comparent les types de mise en liberté (semi liberté, libération conditionnelle totale, ordonnance de surveillance de longue durée, libération d’office et expiration du mandat) pour les femmes autochtones et non autochtones en 2019 2020. Pour les femmes autochtones, 66 % ont bénéficié d’une libération d’office, 33 % d’une semi liberté, 1 % d’une libération conditionnelle totale et 1 % d’une ordonnance de surveillance de longue durée. Pour les femmes non autochtones, 80 % ont bénéficié d’une libération d’office, 17 % d’une semi liberté et 3 % d’une ordonnance de surveillance de longue durée.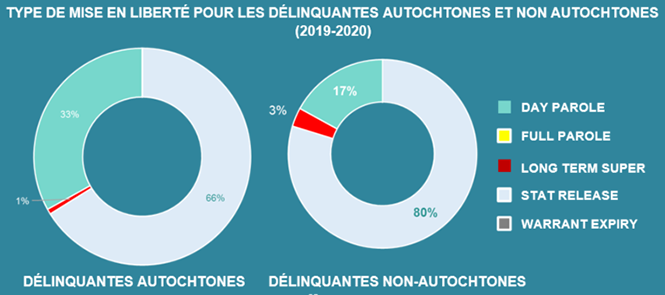
Type de mise en liberté pour les délinquantes autochtones et non autochtones (2019 2020).
Réinsertion sociale : emploi et formation professionnelle
Détails : Le pourcentage de délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté a légèrement augmenté, passant de 81 % en 2015 2016 à 82 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquantes non autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté a augmenté, passant de 80 % en 2015 2016 à 94 % en 2019 2020. En 2015 2016, 81 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 80 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 81 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 70 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 85 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 80 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 89 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 87 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 82 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi avait été établi ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté, comparativement à 94 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. Le pourcentage de délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité a été établi et qui ont obtenu un emploi avant la date d’expiration de leur peine est passé de 61 % en 2015 2016 à 67 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquantes non autochtones qui ont obtenu un emploi avant la date d’expiration de leur peine est passé de 74 % en 2015 2016 à 83 % en 2019 2020. En 2015 2016, 61 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 74 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 48 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 79 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 57 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 81 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 62 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 76 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 67 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité avait été établi ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine, comparativement à 83 % des délinquantes non autochtones pour lesquelles un tel besoin avait été établi.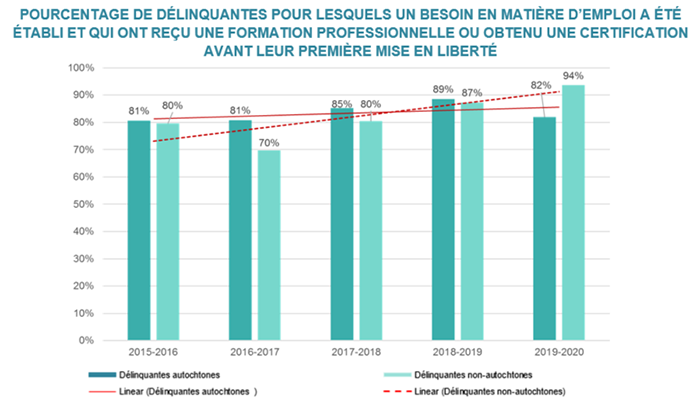
Pourcentage de délinquantes pour lesquelles un besoin en matière d’emploi a été établi et qui ont reçu une formation professionnelle ou obtenu une certification avant leur première mise en liberté.
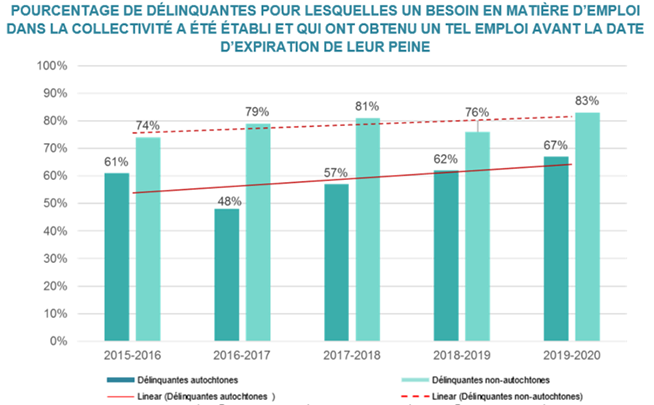
Pourcentage de délinquantes pour lesquelles un besoin en matière d’emploi dans la collectivité a été établi et qui ont obtenu un tel emploi avant la date d’expiration de leur peine.
Surveillance
Le taux de révocations pour les délinquantes autochtones est passé de 355 en 2015 2016 à 331 en 2019 2020. Le taux de révocations pour les délinquantes non autochtones est passé de 145 en 2015 2016 à 105 en 2019 2020. En 2015 2016, le nombre de révocations pendant la période de surveillance par tranche de 1 000 délinquantes autochtones s’élevait à 355, alors qu’il était de 145 par tranche de 1 000 délinquantes non autochtones. En 2016 2017, le nombre de révocations pendant la période de surveillance par tranche de 1 000 délinquantes autochtones s’élevait à 267, alors qu’il était de 134 par tranche de 1 000 délinquantes non autochtones. En 2017 2018, le nombre de révocations pendant la période de surveillance par tranche de 1 000 délinquantes autochtones s’élevait à 298, alors qu’il était de 121 par tranche de 1 000 délinquantes non autochtones. En 2018 2019, le nombre de révocations pendant la période de surveillance par tranche de 1 000 délinquantes autochtones s’élevait à 295, alors qu’il était de 88 par tranche de 1 000 délinquantes non autochtones. En 2019 2020, le nombre de révocations pendant la période de surveillance par tranche de 1 000 délinquantes autochtones s’élevait à 331, alors qu’il était de 105 par tranche de 1 000 délinquantes non autochtones. Le pourcentage de délinquantes autochtones qui ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance est passé de 36 % en 2015 2016 à 46 % en 2019 2020. Le pourcentage de délinquantes non autochtones qui ont atteint la date d’expiration de leur peine dans la même catégorie est demeuré relativement stable, passant de 72 % en 2015 2016 à 74 % en 2019 2020. En 2015 2016, 36 % des délinquantes autochtones ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance, comparativement à 72 % des délinquantes non autochtones. En 2016 2017, 49 % des délinquantes autochtones ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance, comparativement à 72 % des délinquantes non autochtones. En 2017 2018, 51 % des délinquantes autochtones ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance, comparativement à 76 % des délinquantes non autochtones. En 2018 2019, 55 % des délinquantes autochtones ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance, comparativement à 79 % des délinquantes non autochtones. En 2019 2020, 46 % des délinquantes autochtones ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance, comparativement à 74 % des délinquantes non autochtones.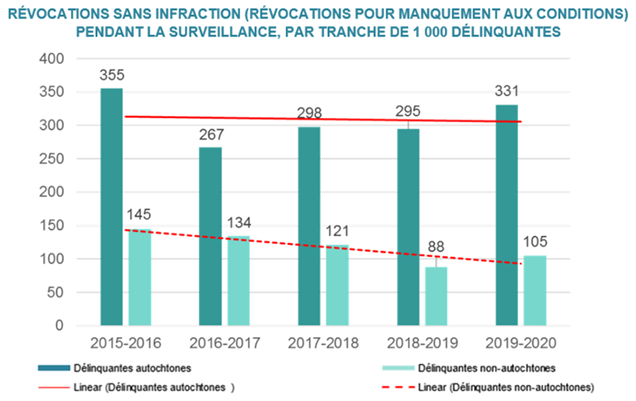
Révocations sans infraction (révocations pour manquement aux conditions) pendant la surveillance, par tranche de 1 000 délinquantes.
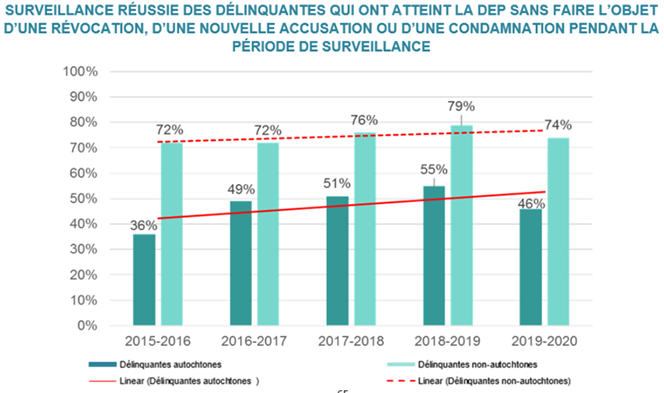
Surveillance réussie des délinquantes qui ont atteint la DEP sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance.
Au chapitre des résultats correctionnels relatifs à la surveillance des délinquantes, on continue d’observer un écart entre les Autochtones et les non-Autochtones. Les délinquantes autochtones affichent toujours un taux supérieur de révocation sans infraction. Malgré l’amélioration des résultats de 2015-2016 à 2018-2019, le nombre de délinquantes autochtones qui ont fait l’objet d’une révocation sans infraction a considérablement augmenté au cours du présent exercice. De plus, l’écart entre les délinquantes autochtones et non autochtones s’est creusé au cours des cinq (5) dernières années.
De plus, en 2019-2020, les délinquantes autochtones étaient moins susceptibles que les délinquantes non autochtones d’atteindre la DEP sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance.
Veuillez consulter la page 59 pour obtenir un aperçu de la façon dont le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones aborde la surreprésentation des délinquantes autochtones.
Dans le cadre des efforts déployés par le Sous-comité pour analyser les raisons expliquant les écarts dans les taux de suspension et de révocation des délinquantes autochtones et non autochtones, le Secteur des délinquantes a entrepris un examen qualitatif d’un échantillon de dossiers de révocation et a déterminé qu’un pourcentage élevé de délinquantes dont la mise en liberté a été révoquée avaient manqué à leur condition de s’abstenir de consommer des substances ou étaient sans emploi au moment de la suspension.
L’examen a permis de constater que les délinquantes autochtones dont la mise en liberté a été révoquée étaient plus susceptibles de voir leur mise en liberté maintenue au moins une fois avant d’être révoquée, ce qui laisse entendre que le SCC a déployé des efforts pour maintenir la mise en liberté.
Alors que le SCC continue de mettre en œuvre des initiatives de réinsertion sociale, redoublant d’efforts pour renforcer le soutien à la réinsertion sociale des délinquantes autochtones pendant leur transition de l’établissement à la vie dans la collectivité, on s’attend à ce que les résultats en matière de réinsertion sociale s’améliorent.
Considérations relatives aux inuits
Aperçu de la population de délinquants inuits
Les délinquants inuits présentent des caractéristiques linguistiques, culturelles, spirituelles et géographiques uniques. Les peuples autochtones du Canada partagent certaines similitudes pour ce qui est de leur vision du monde, mais chaque groupe a des valeurs spirituelles et culturelles, des langues, des dialectes et des coutumes qui lui sont propres.
Les Inuits parlent l’inuktitut, et de nombreux dialectes varient d’une région à l’autre. Les Inuits entretiennent aussi des croyances spirituelles uniques qui sont distinctes de celles des cultures des Premières Nations et des Métis, et ils ont des cérémonies et des pratiques culturelles différentes.
En plus de ces distinctions, de nombreux délinquants inuits sous responsabilité fédérale proviennent de régions géographiquement isolées de l’Arctique canadien (Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Nord québécois et Labrador) et, lorsqu’ils sont incarcérés dans le Sud, ils peuvent subir un important choc culturel.
Aperçu : Un ensemble vertical de quatre graphiques liés entre eux, chacun représentant les principaux points contenus dans un certain nombre de catégories. Détails : Deux adultes et un enfant représentent la « population »; un groupe de trois maisons représente « les conditions de vie et les besoins fondamentaux »; le profil d’une tête avec une croix de premiers secours représente « la santé et le bien être »; une personne qui tient des livres et une mallette représente « l’éducation et l’emploi ».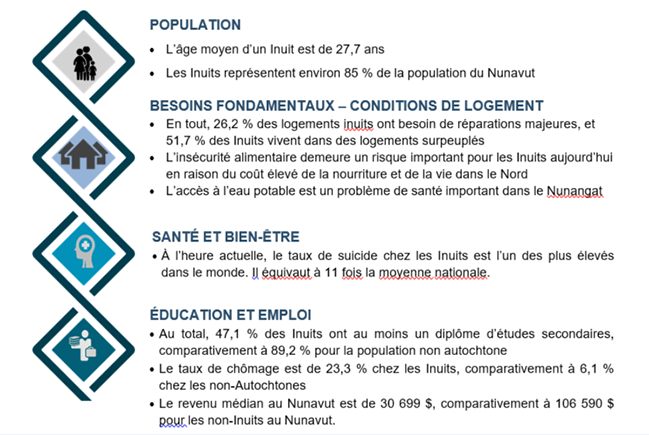
Aperçu de la population de délinquants inuits.
Population
- L’âge moyen d’un Inuit est de 27,7 ans
- Les Inuits représentent environ 85 % de la population du Nunavut
Besoins fondamentaux – conditions de logement
- En tout, 26,2 % des logements inuits ont besoin de réparations majeures, et 51,7 % des Inuits vivent dans des logements surpeuplés
- L’insécurité alimentaire demeure un risque important pour les Inuits aujourd’hui en raison du coût élevé de la nourriture et de la vie dans le Nord
- L’accès à l’eau potable est un problème de santé important dans le Nunangat
Santé et bien-être
- À l’heure actuelle, le taux de suicide chez les Inuits est l’un des plus élevés dans le monde. Il équivaut à 11 fois la moyenne nationale.
Éducation et emploi
- Au total, 47,1 % des Inuits ont au moins un diplôme d’études secondaires, comparativement à 89,2 % pour la population non autochtone
- Le taux de chômage est de 23,3 % chez les Inuits, comparativement à 6,1 % chez les non-Autochtones
- Le revenu médian au Nunavut est de 30 699 $, comparativement à 106 590 $
- pour les non-Inuits au Nunavut.
Les données ci-dessus sont tirées du Recensement du Canada de 2016. Il importe de souligner que ce ne sont pas tous les Autochtones qui participent au recensement canadien. Certains Autochtones choisissent de ne pas participer parce qu’ils ne considèrent pas le Canada comme leur pays. Certains vivent dans des collectivités isolées et ont un accès limité à Internet et à d’autres moyens de communication. Ces facteurs ont une incidence sur l’exactitude des données.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la formation de l’École de la fonction publique du Canada intitulée Les Inuits au Canada (K103)
En 2019-2020, les délinquants inuits représentaient :
- 3,41 % (n=141) du nombre total de délinquants autochtones sous garde
- 2,96 % (n=56) du nombre total de délinquants autochtones sous surveillance dans la collectivité
Au total, 49 % des délinquants inuits purgent une peine de moins de quatre (4) ans.
En tout, 48 % des délinquants inuits purgent une peine pour une infraction sexuelle.
Dans l’ensemble, 75 % des délinquants inuits sont évalués comme présentant un risque élevé.
Dans la région du Pacifique, 8 % des délinquants sont Inuits et le pourcentage d’augmentation est de 36 % (de 11 à 15). Dans la région des Prairies, 12 % des délinquants sont Inuits et le pourcentage de diminution est de 8 % (de 36 à 24). Dans la région de l’Ontario, 30 % des délinquants sont Inuits et le pourcentage de diminution est de 29 % (de 84 à 60). Dans la région du Québec, 42 % des délinquants sont Inuits et le pourcentage de diminution est de 10 % (de 92 à 83). Dans la région de l’Atlantique, 8 % des délinquants sont Inuits et le pourcentage de diminution est de 6 % (de 16 à 15).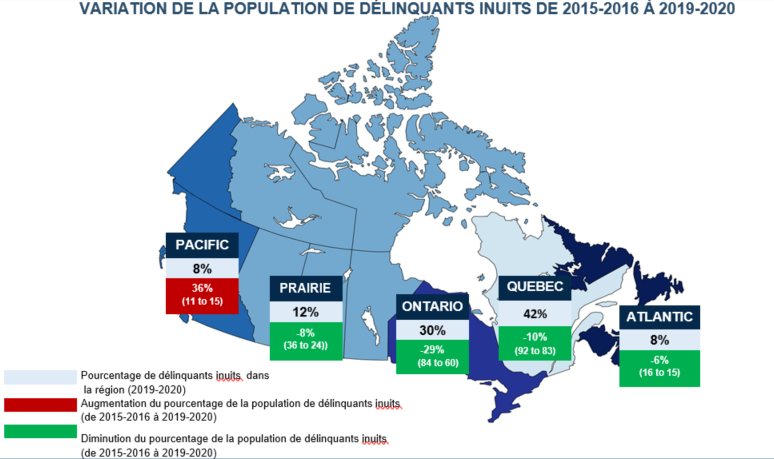
Variation de la population de délinquants inuits de 2015 2016 à 2019 2020
La population totale de délinquants inuits a diminué de 14 % (n=-32) depuis 2015-2016. Par contre, la population de délinquants autochtones a augmenté de 15 % (n=800).
Comparativement aux délinquants issus des Premières Nations et aux délinquants métis sous garde, on compte :
- Un plus grand nombre de délinquants inuits incarcérés purgeant une peine pour une infraction prévue à l’annexe I (72 % contre 62 %)
- Un plus grand nombre de délinquants inuits incarcérés purgeant une peine pour une infraction sexuelle (56 % contre 85 %)
- Un plus grand nombre de délinquants inuits incarcérés manifestant un intérêt à l’égard de la mise en liberté en vertu de l’article 84 (74 % contre 43 %)
- Un plus petit nombre de délinquants inuits incarcérés ayant fait l’objet d’un examen par un Aîné
- (63 % contre 74 %)
De 2015 2016 à 2019 2020, le nombre de délinquants inuits en détention a diminué progressivement, passant de 168 à 141. Au cours de cette même période, le nombre de délinquants inuits sous surveillance dans la collectivité a progressivement diminué, passant de 61 à 56. En 2015 2016, 168 des délinquants inuits sous la responsabilité du SCC étaient en détention, alors que les 61 autres étaient sous surveillance dans la collectivité. En 2016 2017, 160 des délinquants inuits sous la responsabilité du SCC étaient en détention, alors que les 52 autres étaient sous surveillance dans la collectivité. En 2017 2018, 146 des délinquants inuits sous la responsabilité du SCC étaient en détention, alors que les 57 autres étaient sous surveillance dans la collectivité. En 2018 2019, 153 des délinquants inuits sous la responsabilité du SCC étaient en détention, alors que les 45 autres étaient sous surveillance dans la collectivité. En 2019 2020, 141 des délinquants inuits sous la responsabilité du SCC étaient en détention, alors que les 56 autres étaient sous surveillance dans la collectivité. Deux graphiques bleu pâle et bleu foncé comparent le pourcentage de délinquants inuits sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada qui sont des hommes et des femmes en 2019 2020. 97 % (192) sont des hommes et 3 % (5) sont des femmes. De ce nombre, 71 % (137) des hommes inuits sont en détention et 29 % (55) sont dans la collectivité. 80 % (4) des délinquantes inuites sont en détention et 20 % (1) sont dans la collectivité.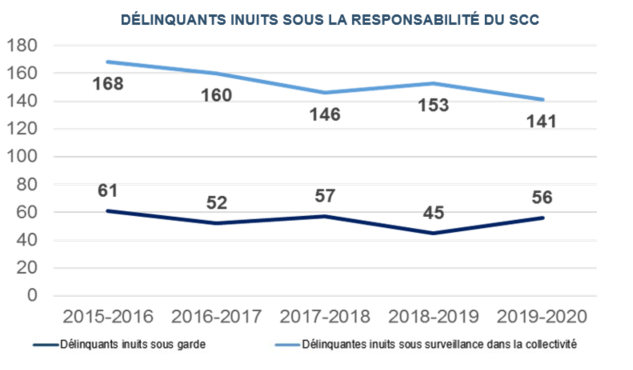
Délinquants inuits sous la responsabilité du SCC.
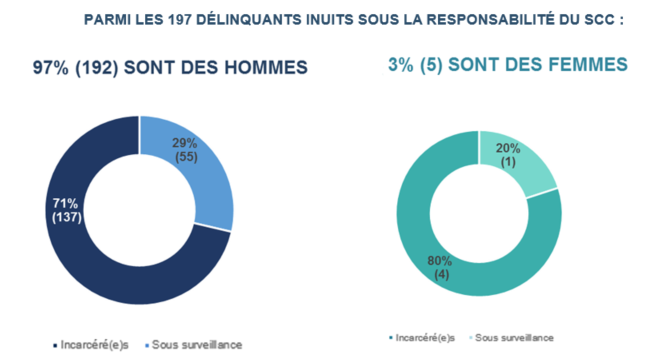
Parmi les 197 délinquants inuits sous la responsabilité du SCC.
En 1941, le gouvernement du Canada a enregistré chaque Inuit au moyen d’un identificateur numérique, puisqu’on éprouvait des difficultés avec les noms inuits traditionnels. Les Inuits devaient porter en tout temps un disque sur lequel figurait un numéro d’identification. De nombreux Inuit ont cousu le disque sur leurs vêtements ou l’ont suspendu à leur cou ou ont tatoué le numéro sur leur avant-bras. Le recours à ces disques a été interrompu au début des années 1970.
Stratégie Anijaarniq
Les délinquants inuits continuent d’être surreprésentés dans le système correctionnel fédéral. Par conséquent, le SCC établit des programmes et des services qui favorisent précisément la guérison et la réinsertion sociale des délinquants inuits. La Stratégie Anijaarniq pour les délinquants inuits facilite le retour graduel des délinquants inuits dans la collectivité, au lieu que ceux-ci soient mis en liberté d’office ou soient libérés à l’expiration de la peine.
La Stratégie Anijaarniq pour les délinquants inuits aide les délinquants inuits à connaître les ressources dont ils ont besoin pour retourner dans leur collectivité et y demeurer à titre de membres actifs.
Principes directeurs de la Stratégie Anijaarniq pour les délinquants inuits :
- les délinquants inuits qui le souhaitent devraient être logés et faire l’objet d’une surveillance dans leur collectivité d’origine;
- il faut établir des partenariats fructueux avec les collectivités du Nord afin d’orienter la stratégie relative aux Inuits;
- le Continuum de soins pour les Inuits doit aborder les risques que présentent ces délinquants et répondre à leurs besoins pour favoriser leur réinsertion sociale.
Principaux éléments de la Stratégie Anijaarniq pour les délinquants inuits :
- établissement de quatre (4) centres d’excellence inuits;
- déplacement des délinquants inuits vers ces centres;
- fourniture d’interventions et de services adaptés à la culture des délinquants inuits.
Dans le sud de la Colombie Britannique, l’Établissement de Bowden : 50 % (7/14); dans le sud de l’Ontario, Établissement de Beaver Creek : 60 % (25/42); dans le sud du Québec, Centre fédéral de formation : 64 % (39/61); au Nouveau Brunswick, Pénitencier de Dorchester : 62 % (5/8).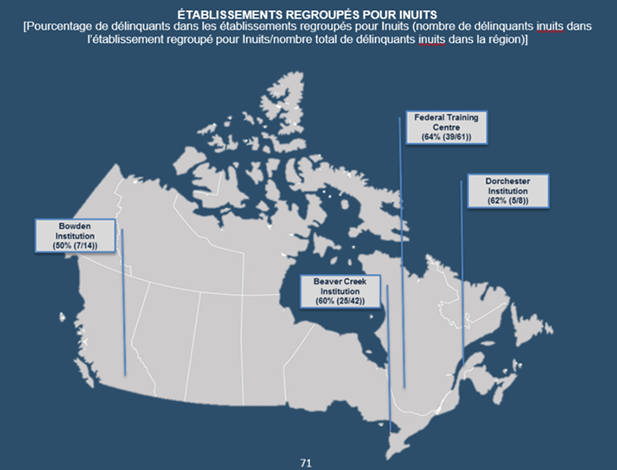
Établissements regroupés pour Inuits.
Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) est le terme utilisé pour décrire l’épistémologie inuite ou le savoir autochtone des Inuits. Le terme se traduit directement par « ce que les Inuits ont toujours tenu pour être vrai ». Comme d’autres systèmes de connaissances autochtones, l’IQ est reconnu comme un système unifié de croyances et de connaissances propres à la culture inuite.
La Stratégie Anijaarniq est fondée sur l’IQ.
| Inuktitut (Nunavik et Nunavut) Inuit Qaujimajatuqangit | Inuttitut (Côte Nord du Labrador) Inuit Kaujimajatukagit | Description |
|---|---|---|
| Inuuqatigiitsiarniq | InoKatigetsianik | Respect des autres, relations et souci des personnes |
| Tunnganarniq | Tunganatsianik | Promotion d’un esprit positif en étant ouvert, accueillant et inclusif |
| Pijitsirniq | kiKatunnik pitaKatitsigiamut | Service à la famille et à la collectivité et satisfaction de leurs besoins |
| Aajiiqatigiinniq | AngiKatigennik | Prise de décisions grâce à la discussion et au consensus |
| Pilimmaksarniq/ Pijariuqsarniq | Pivalliatitsinik ilisimajaugialinnik | Acquisition de compétences par l’observation, le mentorat, l’expérience et l’effort |
| Piliriqatigiinniq/ Ikajuqatigiinniq | IkajuKatigennik InoKatigetsianikkut | Collaboration pour une cause commune |
| Qanuqtuurniq | Pilluangnugiamut sakKititsinik | Innovation et ingéniosité |
| Avatittinnik Kamatsiarniq | Avatittinik kamatsianik | Respect et soin de la terre, de la faune et de l’environnement |
« En fait, l’IQ est une technologie vivante. C’est un moyen de rationaliser et d’agir, un moyen d’organiser les tâches et les ressources, un moyen d’organ- iser la famille et la société en un tout cohérent. »
Jaypeetee Arnakuk (2000)
Programmes correctionnels
Le Programme correctionnel intégré pour les Inuits (PCII) est un modèle de programme correctionnel complet, destiné aux délinquants inuits, qui couvre toute la durée de la peine d’un délinquant. Il aborde également les multiples facteurs de risque d’une manière approfondie et intégrée par l’entremise de programmes préparatoires et principaux et de programmes de maintien des acquis.
Le programme est axé sur la culture afin de répondre aux besoins des délinquants inuits. Étant adapté à la culture, le programme reconnaît le caractère unique de la population inuite et comprend des activités cérémonielles. Les Aînés jouent un rôle important en offrant des enseignements et du soutien pertinents sur le plan culturel.
De plus, les pratiques exemplaires contemporaines sont intégrées tout au long du programme. Elles comprennent des influences théoriques comme la thérapie cognitivo-comportementale, la théorie de l’apprentissage social, la réduction des méfaits, les étapes du changement, l’entrevue motivationnelle et la prévention des rechutes.
Le PCII a été mis en œuvre en 2017-2018. Au cours de la première année, il y a eu 31 inscriptions. Pendant l’exercice 2019-2020, il y a eu 69 inscriptions, soit :
- 18 à un programme préparatoire du PCII
- 25 à un programme multicible d’intensité modérée du PCII
- 13 à un programme d’intensité modérée/élevée pour délinquants sexuels du PCII
- 13 à un programme de maintien des acquis dans la collectivité du PCII
En 2019-2020, 136 délinquants inuits de sexe masculin se sont inscrits à un programme.
De ce nombre, 57 % (n=77) se trouvaient dans des établissements regroupés pour Inuits, soit :
- 5 au Pénitencier de Dorchester
- 48 au Centre fédéral de formation
- 14 à l’Établissement de Beaver Creek
- 10 à l’Établissement de Bowden
Aperçu : Un graphique à barres verticales bleues et à ligne horizontale rouge montre la baisse du pourcentage de délinquants inuits qui terminent un programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale avant leur première mise en liberté de 2015 2016 à 2019 2020. Détails : Le pourcentage de délinquants inuits pour lesquels un besoin a été établi en matière de programme correctionnel reconnu à l’échelle nationale et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté a diminué, passant de 84 % en 2015 2016 à 55 % en 2019 2020. En 2015 2016, 84 % des délinquants inuits pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2016 2017, 66 % des délinquants inuits pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2017 2018, 64 % des délinquants inuits pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2018 2019, 64 % des délinquants inuits pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté. En 2019 2020, 55 % des délinquants inuits pour lesquels un besoin avait été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté.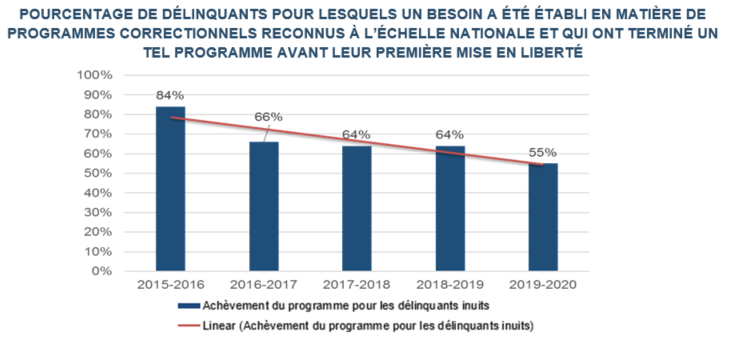
Pourcentage de délinquants pour lesquels un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale et qui ont terminé un tel programme avant leur première mise en liberté.
Réinsertion sociale
Un graphique à barres verticales bleues et à ligne horizontale rouge montre l’augmentation du pourcentage de délinquants inuits dont la première mise en liberté est discrétionnaire de 2015-2016 à 2019-2020. Le pourcentage de délinquants inuits dont la première mise en liberté est discrétionnaire a augmenté, passant de 15 % en 2015 2016 à 28 % en 2019 2020. En 2015 2016, 15 % des délinquants inuits ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté. En 2016 2017, 18 % des délinquants inuits ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté. En 2017 2018, 26 % des délinquants inuits ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté. En 2018 2019, 33 % des délinquants inuits ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté. En 2019 2020, 28 % des délinquants inuits ont obtenu une mise en liberté discrétionnaire comme première mise en liberté.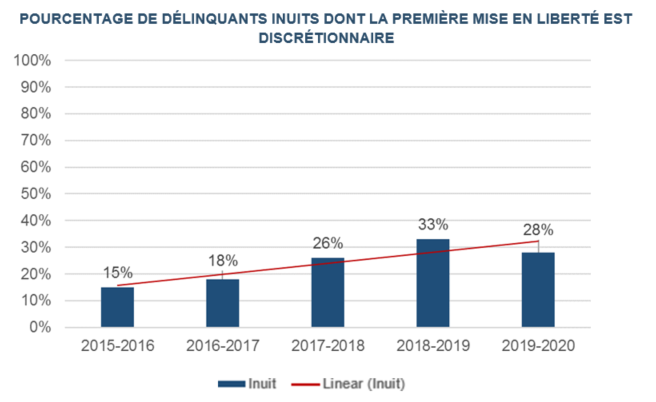
Pourcentage de délinquants inuits dont la première mise en liberté est discrétionnaire.
Mise en liberté en vertu de l’article 84 et délinquants inuits
En 2019-2020, 20 % des délinquants inuits ont utilisé le processus de mise en liberté prévu à l’article 84 pour leur première mise en liberté. Cela représente une diminution de 52 % par rapport aux résultats de 2018-2019, lorsque le taux de mise en liberté en vertu de l’article 84 était de 42 %.
Deux graphiques à secteurs rouge, bleu, gris et jaune comparent les types de mise en liberté (semi liberté, libération conditionnelle totale, ordonnance de surveillance de longue durée, libération d’office et expiration du mandat) pour les délinquants inuits en 2015 2016 et en 2019 2020. En 2015 2016, 62 % étaient en libération d’office, 22 % en expiration de mandat, 13 % en semi liberté, 1 % en ordonnance de surveillance de longue durée et 1 % en libération conditionnelle totale. En 2019 2020, 66 % étaient en libération d’office, 28 % en semi liberté, 4 % en expiration de mandat, 2 % en ordonnance de surveillance de longue durée et 0 % en libération conditionnelle totale.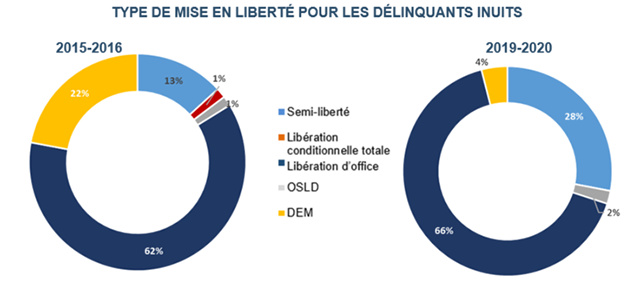
Type de mise en liberté pour les délinquants inuits.
Surveillance
Le nombre de révocations chez les délinquants inuits a augmenté, passant de 267 en 2015 2016 à 442 en 2016 2017, a baissé à 368 en 2017 2018, puis a augmenté de nouveau à 411 en 2019 2020. En 2015 2016, il y a eu 267 révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants inuits. En 2016 2017, il y a eu 442 révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants inuits. En 2017 2018, il y a eu 368 révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants inuits. En 2018 2019, il y a eu 356 révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants inuits. En 2019 2020, il y a eu 411 révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants inuits.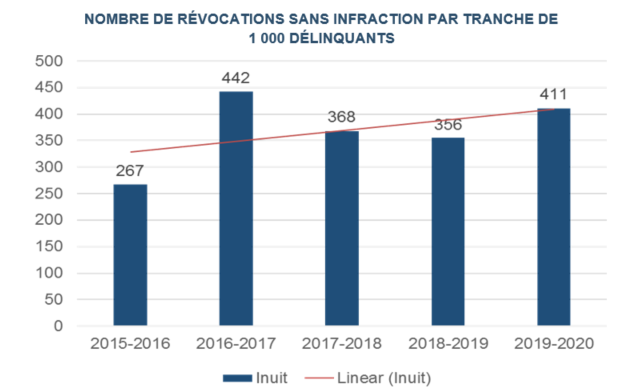
Nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants.
Le nombre de révocations sans infraction par tranche de 1 000 délinquants s’est amélioré pour les délinquants inuits. Toutefois, les délinquants inuits affichent un taux de révocation pour manquement aux conditions plus élevé que celui des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis.
Le pourcentage de résultats positifs de la surveillance pour les délinquants inuits est passé de 42 % en 2015 2016 à 61 % en 2016 2017, a reculé à 43 % en 2017 2018, puis a de nouveau augmenté à 55 % en 2019 2020. En 2015 2016, 42 % des délinquants inuits ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation. En 2016 2017, 61 % des délinquants inuits ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation. En 2017 2018, 43 % des délinquants inuits ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation. En 2018 2019, 58 % des délinquants inuits ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation. En 2019 2020, 55 % des délinquants inuits ont atteint la date d’expiration de leur peine sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation. Le pourcentage de réincarcérations dans les cinq ans suivant la date d’expiration de la peine pour les délinquants inuits a diminué, passant de 87 % en 2010 2011 à 79 % en 2014 2015. En 2010 2011, 87 % des délinquants inuits ont été réincarcérés dans les cinq ans suivant la date d’expiration de leur peine. En 2011 2012, 93 % des délinquants inuits ont été réincarcérés dans les cinq ans suivant la date d’expiration de leur peine. En 2012 2013, 83 % des délinquants inuits ont été réincarcérés dans les cinq ans suivant la date d’expiration de leur peine. En 2013 2014, 87 % des délinquants inuits ont été réincarcérés dans les cinq ans suivant la date d’expiration de leur peine. En 2014 2015, 79 % des délinquants inuits ont été réincarcérés dans les cinq ans suivant la date d’expiration de leur peine.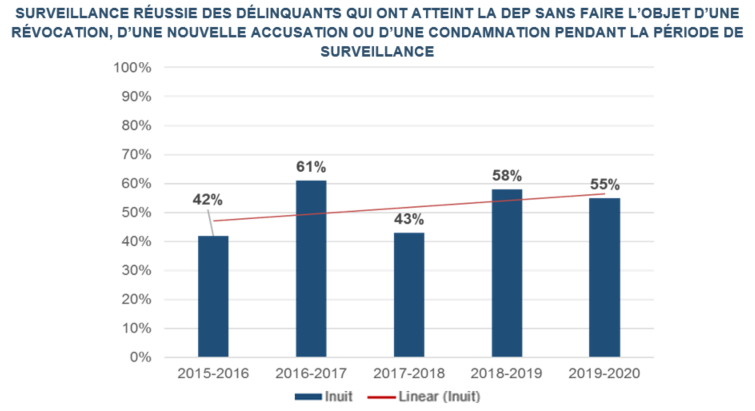
Surveillance réussie des délinquants qui ont atteint la DEP sans faire l’objet d’une révocation, d’une nouvelle accusation ou d’une condamnation pendant la période de surveillance.
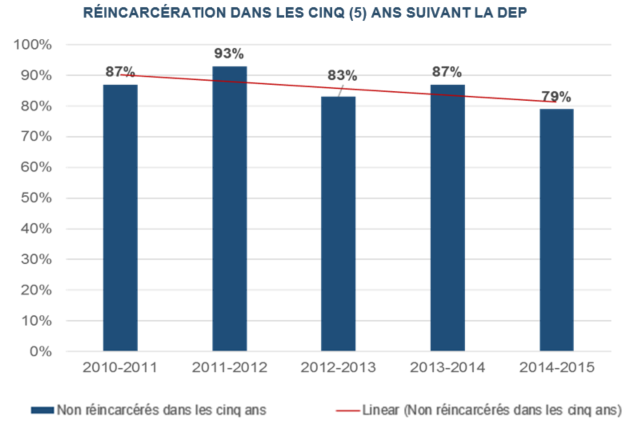
Réincarcération dans les cinq (5) ans suivant la DEP.
Dans l’ensemble, 79 % des délinquants inuits qui ont atteint la DEP en 2014-2015 n’ont pas été réincarcérés dans un établissement fédéral dans les cinq (5) années suivantes. Plus particulièrement, le pourcentage de délinquants inuits qui n’ont pas été réincarcérés dans un établissement fédéral a diminué au cours des cinq (5) dernières années.
Sous-comité sur les services correctionnels pour autochtones du comité de direction
Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que le besoin de continuer de surveiller les progrès réalisés à l’égard des résultats propres aux Inuits constituait l’un de ses principaux domaines d’intérêt.
Au cours du prochain exercice, on tiendra une réunion virtuelle avec le personnel inuit de toute l’organisation pour échanger sur les expériences, les difficultés et les besoins. De plus, une analyse de la population de délinquants inuits dans chaque région sera préparée pour examiner les possibilités d’optimiser les ressources régionales.
Conclusion
Le Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones donne aux responsables de la Direction des initiatives pour les Autochtones l’occasion de réfléchir au travail accompli au cours du dernier exercice, aux réussites et aux problèmes auxquels ils ont fait face en tentant d’améliorer les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones. C’est grâce à cette réflexion que la DIA peut procéder à une planification et recentrer ses efforts sur la recherche de mesures de soutien toujours plus pertinentes pour les Autochtones qui ont des démêlés avec le système de justice pénale.
Le CRSCA fournit des renseignements utiles au Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction et permet l’adoption d’une approche fondée sur des données probantes pour améliorer les services correctionnels pour Autochtones. Le renouvellement du Sous- comité en 2019 pour combler les écarts au chapitre des résultats correctionnels entre les délinquants autochtones et non autochtones illustre l’importance que le SCC continue d’accorder à la transformation exhaustive des services correctionnels pour Autochtones.
Cette année, le CRSCA comprend de nouveaux indicateurs tirés du Plan national relatif aux Autochtones (PNA). Dans l’ensemble, le PNA a réussi à améliorer les résultats en matière de mise en liberté et de surveillance pour les Autochtones sous garde. Cela montre que des stratégies novatrices sont essentielles, à mesure que nous travaillons à réduire les écarts au chapitre des résultats entre les Autochtones et les non- Autochtones sous garde. Un aspect crucial de ces stratégies consiste à renforcer les relations de nation à nation en faisant participer les collectivités et les corps dirigeants autochtones aux services correctionnels pour Autochtones et en veillant à ce que les Autochtones qui purgent une peine de ressort fédéral aient accès à des services adaptés à la culture pendant la période de détention et de surveillance dans la collectivité.
Alors que nous entamons le prochain chapitre, la DIA continuera de renforcer les relations avec les intervenants et les collectivités autochtones en explorant les occasions d’accroître le recours aux pavillons de ressourcement visés à l’article 81, en améliorant le processus de planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 et en examinant d’autres options de financement pour les fournisseurs de services autochtones.
La dernière année a été marquée par des défis uniques et des expériences extraordinaires. En raison de la pandémie de COVID-19, bon nombre des opérations du SCC ont été modifiées ou temporairement suspendues. Certains Autochtones sous garde n’ont peut-être pas eu le même accès aux services offerts par les Aînés, aux programmes ou à d’autres mesures de soutien. Dans la prochaine version du CRSCA, on tentera de saisir les répercussions importantes de la pandémie de COVID-19 et des mesures connexes sur les interventions et les services correctionnels destinés aux Autochtones sous responsabilité fédérale. Les considérations continues, et parfois concurrentes, en matière de santé et de sécurité publiques et l’accès aux programmes pour Autochtones et aux Aînés, entre autres, ont rendu cette année particulièrement difficile pour la DIA.
On a toutefois eu également l’occasion d’examiner et d’optimiser les processus internes et de continuer à travailler à l’optimisation des services correctionnels pour Autochtones. Plus particulièrement, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière, souvent péniblement, les inégalités chroniques qui persistent. Le SCC joue un rôle important dans la compréhension et l’élimination du racisme systémique dans les services correctionnels canadiens, en particulier pour les Autochtones et les Noirs. Il est essentiel d’agir immédiatement. Les changements apportés aux politiques, aux procédures et à la culture sont cruciaux pour tenir le SCC et le personnel responsables de la sécurité des personnes sous garde.
Au cours de la dernière année, le SCC a continué d’accorder la priorité aux services correctionnels pour Autochtones et aux initiatives qui soutiennent les Autochtones sous garde. Comme les tendances positives touchant les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones sont à la hausse, le SCC espère que le travail entrepris en vue de la réinsertion sociale des Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral continuera de contribuer à des collectivités plus saines et plus sécuritaires pour tous.
Ressources supplémentaires
Directives du commissaire et lignes directrices
- Directive du commissaire 702 : Délinquants autochtones
- Lignes directrices 702-1 : Création et fonctionnement des initiatives des Sentiers autochtones
Série d’apprentissage sur les questions autochtones—L'École de la fonction publique du Canada
Sous les thèmes de la reconnaissance, du respect, des relations et de la réconciliation, la Série d’apprentissage sur les questions autochtones donne accès à des ressources, à des cours, à des ateliers et à des événements portant sur l’histoire, le patrimoine, les cultures, les droits et les perspectives des peuples autochtones du Canada, ainsi que sur leurs rapports variés et de longue date avec l’État.
La série de balados Autour du feu propose des thèmes afin de mieux connaître les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
L’application d’apprentissage intitulée La réconciliation : un point de départ sert d’outil de référence pour en apprendre sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis, y compris les événements historiques clés et les
Autres ressources
- Le chemin du retour : Trousse de planification prélibératoire – Article 84 de la Loi sur le système cor- rectionnel et la mise en liberté sous condition
- Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition