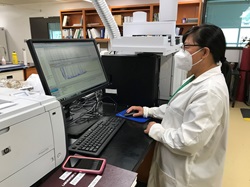Améliorer la préparation et l’intervention en cas d’urgences

Le Plan de protection des océans – faire avancer la science pour soutenir la préparation et l’intervention en cas d’urgence
Le Plan de protection des océans (PPO) est le plan du Canada pour protéger nos côtes et nos voies navigables pour les générations futures.
Dans le cadre du Plan de protection des océans, les scientifiques d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) recueillent et étudient les renseignements sur les espèces sauvages, les habitats et les répercussions de la pollution sur différents environnements. Ces activités de recherche aident nos experts à fournir des avis et des données à jour lors d’une urgence environnementale.
Protéger les océans et les littoraux du Canada
Voici le type de soutien que nous offrons en cas d’urgence environnementale :
- repérer les ressources environnementales importantes, comme les espèces fauniques et les écosystèmes vulnérables;
- fournir des prévisions météorologiques propres au site et le mouvement des produits déversés sur l’eau selon une modélisation de la trajectoire;
- offrir des avis sur la manière d’atténuer les dommages environnementaux et de nettoyer les produits dangereux.
Nous collaborons avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi qu’avec d’autres ministères, l’industrie et des communautés côtières afin d’améliorer ces avis.
Histoires témoignant de ce que nous faisons pour protéger les terres et les eaux dans le cadre du Plan de protection des océans
Apprenez-en plus sur le travail que les scientifiques et les experts d’ECCC effectuent tout au long de l’année dans l’ensemble du pays, et découvrez comment ce travail contribue à protéger les terres et les eaux en cas d’urgence environnementale.
- Toujours prêts! Aider les intervenants à rester en sécurité pendant les urgences environnementales
- Bye bye bouée! Mettre à l’essai les modèles actuels pour l’Arctique afin d’appuyer les interventions d’urgence
- Retour à l’île Triangle : le paradis unique du Macareux huppé en Colombie-Britannique
- Vue du ciel : inventorier les côtes de l’Arctique
Toujours prêts! Aider les intervenants à rester en sécurité pendant les urgences environnementales

Des compétences et des connaissances spécialisées sont nécessaires pour intervenir en toute sécurité en cas d’urgences environnementales liées à des déversements dangereux.
Pour en savoir plus
La Section des urgences – Sciences et technologie (SUST) d’Environnement et Changement climatique Canada est le centre d’expertise en science des déversements de matières dangereuses.
Elle appuie les intervenants en cas d’urgence environnementale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fournissant des conseils scientifiques, des analyses de laboratoire et des techniques spécialisées, notamment en matière d’évaluation du site et d’échantillonnage.
Dans le cadre du Plan de protection des océans, la Section des urgences – Sciences et technologie est responsable de faire progresser la science sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour améliorer la préparation et les interventions en cas d’urgence.
La Section des urgences – Sciences et technologie élabore et offre également de la formation à ses partenaires d’intervention. Le cours Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) [Gestion des déchets dangereux et intervention d’urgence] aide les intervenants à rester en sécurité lorsqu’ils interviennent en cas d’urgence environnementale pouvant être liée à des produits chimiques dangereux.


Le cours HAZWOPER est l’un des moyens qui permettent à la Section des urgences – Sciences et technologie de communiquer ses connaissances aux intervenants en cas d’urgence et de former ces derniers sur l’équipement et les méthodes à utiliser pour intervenir en cas de déversement dangereux dans l’environnement.
Les interventions en cas de déversement dangereux peuvent être risquées, car il y a de nombreux facteurs inconnus.
Les intervenants ne peuvent pas toujours savoir quels produits chimiques ou dangers ils rencontreront lors d’un déversement.
Les substances peuvent atteindre les intervenants par inhalation, par ingestion ou même par perméation, lorsqu’un produit chimique traverse la peau.
Plus le niveau d’incertitude concernant les produits chimiques en cause augmente, plus le niveau de protection requis augmente également.


Le cours d’une durée d’une semaine combine la théorie et l’apprentissage pratique, basculant entre temps en classe le matin et exercices pratiques l’après-midi.
Au moyen d’exercices pratiques et théoriques, les intervenants apprennent comment repérer les dangers et établir des plans de sécurité. Ils s’exercent également à effectuer des tâches de base comme recueillir des renseignements et prélever des échantillons tout en portant l’équipement de sécurité supplémentaire.
Les formateurs montrent aux participants comment utiliser l’équipement de protection, allant des bottes et des gants aux combinaisons spécialisées de protection chimique entièrement étanches qui peuvent les protéger contre des produits chimiques inconnus.
Une bonne compréhension des diverses options d’équipement de sécurité et du moment où les utiliser confère aux intervenants les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour se protéger dans le cadre de leur travail.


À la fin de chaque exercice, les participants et les instructeurs font un bilan des notions vues afin de renforcer l’acquisition de connaissances.
Le cours HAZWOPER est un élément important du programme d’intervention en cas de déversement de produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada. Il permet de veiller à ce que les intervenants possèdent les outils nécessaires pour prendre des décisions efficaces afin de se protéger dans leurs efforts de protection de l’environnement lors d’une intervention en cas de déversement dangereux.


Apprenez-en davantage sur le travail de la Section des urgences – Sciences et technologie relatif aux déversements de matières dangereuses en découvrant l’évolution du Colloque technique des déversements d’hydrocarbures marins dans l’Arctique au fil du temps.
Bye bye bouée! Mettre à l’essai les modèles actuels pour l’Arctique afin d’appuyer les interventions d’urgence

Comme l’intervention d’urgence commence par la préparation, les agents chargés des urgences environnementales et les scientifiques mettent à l’essai les modèles de prévision des courants dans la baie Frobisher.
Pour en savoir plus
Comment se prépare-t-on à faire face à une situation d’urgence? C’est une question à laquelle les agents des urgences environnementales d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) s’attaquent tous les jours. Lors d’une urgence environnementale, comme un déversement d’hydrocarbures, ces agents fournissent des conseils essentiels aux équipes d’intervention sur les meilleures façons de nettoyer. Ils aident également à prévoir les répercussions possibles d’un déversement dans l’eau en anticipant où celui-ci pourrait se déplacer sur la base de modèles ou de simulations de l’écoulement de l’eau ou des courants.
Pour être en mesure d’offrir ces conseils rapidement lorsqu’une urgence survient, il faut une préparation constante. Selon Simon Despatie, agent principal au sein de l’équipe de Préparation et intervention : « Être prêt, ce n’est pas seulement dire que l’on est prêt, c’est une question de se préparer à intervenir en cas d’urgence. »
Mettre les modèles à l’essai

C’est cette attitude qui a mené Simon et Frédéric Chantal-Fortin, agent des urgences environnementales, à Iqaluit, au Nunavut, en 2022 afin de recueillir de l’information sur la manière dont les bouées de repérage des déversements répondent au vent et aux courants.
Leur projet consistait principalement à lancer des bouées de repérage des déversements dans la baie de Frobisher. Les bouées, des boules orange vif de la taille d’un ballon de basketball, transmettent de l’information horodatée sur leur emplacement et la température de l’eau à mesure qu’elles dérivent au gré des vents et des courants. Ce travail a permis aux scientifiques de la Section des urgences – Sciences et technologie d’ECCC, qui sont chargés de générer des modèles pour anticiper le déplacement et le comportement d’un déversement en cas d’urgence, de vérifier le déplacement réel de la bouée par rapport à son déplacement prévu par un modèle.

Cette comparaison est importante pour comprendre la précision des déplacements calculés par le modèle. Avec les travaux déjà en cours, cet exercice a permis d’améliorer la modélisation des courants océaniques dans les eaux canadiennes.
Accroître la préparation
L’équipe a également tiré de cet exercice une importante expérience pratique, qu’il s’agisse de composer avec les températures froides en mer ou avec les énormes marées de la baie de Frobisher qui peuvent amener certains bateaux à se retrouver immobilisés sur le fond marin à marée basse.
« C’est très intéressant, » souligne Frederic. « C’est une autre facette dont il faut tenir compte pour vraiment planifier le travail. »

Enfin, la rencontre avec leurs homologues d’autres organisations dans la région a été un point fort additionnel de ce voyage, qui s’est greffé à plusieurs exercices supplémentaires d’intervention d’urgence dans la baie.
« Les urgences environnementales et les déversements sont des événements stressants », explique Simon. « Plus nous nous connaissons et plus nous savons à quoi nous attendre les uns des autres, plus nous pouvons améliorer notre préparation. »
Retour à l’île Triangle : le paradis unique du Macareux huppé en Colombie-Britannique

Chaque année, des scientifiques retournent sur l’île Triangle pour étudier les Macareux huppés et déterminer la manière de les protéger en cas d’urgence environnementale.
Pour en savoir plus
Si vous vous rendiez sur l’île Triangle un jour de printemps, vous ne vous imagineriez pas être au beau milieu de la plus grande colonie d’oiseaux de mer de la Colombie-Britannique. Par contre, à la nuit tombée, le ciel aux abords de l’île regorge d’oiseaux qui font la navette entre l’océan et leurs terriers à flanc de falaise, afin d’y rapporter de la nourriture.
L’île Triangle est la plus éloignée d’un chapelet d’îles situées au large de la côte de la Colombie-Britannique et entourées par la réserve nationale de faune en milieu marin des îles-Scott. Elle est située dans une zone de transition où le courant du Pacifique Nord se sépare en deux, formant le courant de Californie qui circule vers le sud et le courant de l’Alaska qui circule vers le nord. Elle se trouve également à proximité du rebord du plateau continental et des eaux plus profondes.
« C’est unique », lance Mark Hipfner, chercheur à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). « En raison de son emplacement, il s’agit d’un habitat idéal pour une communauté diversifiée d’oiseaux de mer. »
Un retour annuel
Étant donné que l’île présente des pentes abruptes et est balayée par de forts vents, il est plus facile d’y accéder par hélicoptère, et seul le personnel autorisé peut y atterrir. Dans le cadre du Plan de protection des océans, des scientifiques d’ECCC retournent chaque année sur l’île lors de la période de reproduction printanière, alors que les oiseaux de mer viennent sur la terre ferme pour nicher.

Comme ces oiseaux vivent principalement en mer, la saison de reproduction est l’une des rares occasions pour les scientifiques d’étudier certaines espèces de près : mesure du poids et de l’envergure, prélèvement d’échantillons et marquage des oiseaux à l’aide d’une balise GPS pour suivre leurs déplacements.
Ces études continues fournissent aux équipes d’intervention de l’information sur les zones et les espèces qui devraient être protégées en cas d’urgence environnementale.
Étudier les macareux

Depuis les années 1970, les scientifiques d’ECCC étudient les Macareux huppés de l’île – un gros oiseau de mer fouisseur doté d’un bec coloré et de deux aigrettes de plumes dorées qu’il perd l’hiver venu.
Les macareux sont en déclin partout dans leur aire de répartition, mais encore plus dans les colonies situées plus au sud. L’île Triangle abrite la plus grande colonie de Macareux huppés au sud de l’Alaska, qui compte près de 30 000 couples reproducteurs. « Cela peut sembler beaucoup, mais dans l’ensemble, comparativement aux colonies des îles Aléoutiennes orientales qui abritent des centaines de milliers de couples, c’est assez peu », explique Mark.
Chaque printemps, les macareux reviennent sur l’île pour profiter de son sol profond et de ses nombreuses falaises, une « combinaison idéale » pour la nidification dans des terriers, selon Mark.
Dans le cadre du Plan de protection des océans, les scientifiques recueillent actuellement des renseignements sur les zones d’alimentation des macareux et leur répartition en mer. Ces données aideront les scientifiques à mieux comprendre comment les macareux utilisent leur habitat au fil du temps. En cas d’urgence environnementale, ces renseignements seront essentiels pour protéger l’espèce et l’environnement unique dont elle dépend.
Vue du ciel : inventorier les côtes de l’Arctique

Des milliers de kilomètres d’images aident les scientifiques à déterminer les zones sensibles qu’il faut protéger en cas d’urgence environnementale.
Pour en savoir plus
À l’été 2023, Valerie Wynja et Zhaohua Chen d’Environnement et Changement climatique Canada étaient au Nunavut, à bord d’un hélicoptère volant à 300 pieds d’altitude, prenant des photos et des vidéos des époustouflants littoraux.
Mais Valerie et Zhaohua n’étaient pas là pour admirer le paysage. Les photos et les séquences vidéo qu’ils ont recueillies servent à classer les littoraux en zones prioritaires dans l’ensemble de l’Arctique canadien, afin de permettre aux scientifiques de repérer les zones vulnérables qui doivent être protégées en cas de déversement d’hydrocarbures ou d’autre urgence environnementale et de fournir une mine de données ouvertes pour tous.
Explorez les littoraux de l’Arctique dans la galerie ci-dessous et découvrez comment le travail de Valerie et Zhaohua nous aide à nous préparer et à intervenir en cas d’urgence environnementale.
Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous nous efforçons de fournir aux équipes d’intervention les renseignements dont elles ont besoin pour protéger l’environnement contre les déversements et contribuer à son rétablissement après une situation d’urgence.

Valerie et Zhaohua préparent leur vol de la journée.

Type de littoral : plage de gravier et de galets
Sur une période de six jours, Valerie et Zhaohua ont cumulé 18 heures de vol et recueilli des renseignements sur plus de 2 300 kilomètres de littoraux autour du détroit de Lancaster et du chenal Parry.
Ce voyage était leur deuxième vol d’études de l’été, alors qu’ils travaillaient à recueillir des données de base sur l’Arctique dans le cadre du Plan de protection des océans.

Type de littoral : plage de sable

Type de littoral : glace de glacier
Les divers types de littoraux sont affectés de manière différente par les déversements : les hydrocarbures peuvent durcir sur les côtes rocheuses ou s’enfoncer dans la vase d’un replat de marée.
En volant à basse altitude le long de la côte, Valérie et Zhaohua ont photographié et filmé les différents types de littoraux de la région.

Type de littoral : ouvrage perméable

Type de littoral : batture de sable
Les photos et les vidéos ont été géolocalisées, c’est-à-dire que leur emplacement géographique a été enregistré, afin que les analystes puissent examiner les images plus tard et consigner les types de littoraux sur une carte.
Les ensembles de données de ce type sont fournis aux équipes d’intervention, qui peuvent utiliser ces renseignements pour préparer rapidement un plan d’intervention et de remise en état dès qu’un déversement se produit.

Type de littoral : plage de blocs rocheux avec polygones à coins de glace

Type de littoral : rampe rocheuse se transformant en plage de sédiments mixtes
Les ensembles de données terminés sont aussi accessibles à tous par le truchement du portail Gouvernement ouvert.
Les renseignements recueillis dans le cadre des études peuvent contribuer à l’aménagement du littoral local, au développement côtier, à la gestion de l’habitat ou encore à l’étude de l’érosion côtière.

Type de littoral : batture de sédiments mixtes

Type de littoral : falaise rocheuse avec talus d’éboulis
Visitez le portail Gouvernement ouvert pour consulter les résultats d’autres études des littoraux et apprenez-en plus sur les divers types de littoraux au Canada!
Explorez toute l’étendue des activités que nous réalisons dans le cadre du Plan de protection des océans pour appuyer les interventions d’urgence
Ces vignettes vous feront découvrir comment les renseignements recueillis par les scientifiques et les experts d’ECCC aident les équipes d’intervention à se préparer aux urgences environnementales et à intervenir.
Inventaires du littoral côtier
Les inventaires de littoral permettent de recueillir des renseignements importants sur le milieu côtier, entre autres les zones sensibles, ou encore les types de sédiment. Ces renseignements aident les équipes d’intervention à déterminer le meilleur moyen de nettoyer et de remettre en état les environnements côtiers après un déversement.
Recherche sur la faune
Les chercheurs étudient comment des espèces marines clés, comme le Macareux moine, utilisent l’environnement durant leur cycle de vie annuel. Cette information aide les chercheurs et les équipes d’intervention à comprendre les menaces auxquelles ces espèces pourraient être exposées à long terme ou lors d’une urgence environnementale, et à déterminer comment les protéger.
Étudier la pollution
Les scientifiques étudient la pollution afin de prévoir les répercussions qu’elle pourrait avoir sur l’environnement lors d’un déversement. Durant une urgence, ils utilisent ces études pour fournir des avis scientifiques aux intervenants d’urgence, afin de les aider à déterminer les efforts recommandés pour protéger l’environnement, nettoyer le déversement et atténuer les répercussions.
Activités d’intervention
Les renseignements que les scientifiques recueillent grâce à leurs activités de recherche sur le terrain et en laboratoire aident les équipes d’intervention à se préparer à une urgence environnementale et déterminent les mesures à prendre pour protéger et remettre en état l’environnement.
Renseignements supplémentaires
- Augmentation du soutien scientifique pour répondre aux urgences environnementales
- Mise sur pied de partenariats communautaires pour la surveillance de la faune
- Détermination des écosystèmes marins et de la faune vulnérables
- Élaboration de la stratégie du Canada pour le rétablissement de l’environnement à la suite de déversements d’hydrocarbures