Évaluation préalable pour le Défi concernant le
Archivée
4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol
Disperse Orange 29
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
19800-42-1
Environnement Canada
Santé Canada
Septembre 2011
Table des Matières
- Sommaire
- Introduction
- Identité de la substance
- Propriétés physiques et chimiques
- Sources
- Utilisations
- Rejets dans l'environnement
- Devenir dans l'environnement
- Persistance et potentiel de bioaccumulation
- Potentiel d'effets nocifs sur l'environnement
- Potentiel d'effets nocifs sur la santé humaine
- Conclusion
- Références
- Annexe 1 : Sommaires de rigueur d'étude pour les études clés
- Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité
- Annexe 3 : Absorption estimée de la limite supérieure d’absorption de Disperse Orange 29 à partir des textiles par divers groupes d’âge (µg/kg p.c. par jour) (Limite inférieure : exposition maximale estimée par les textiles grand teint. Limite supérieure : exposition maximale prudente)
- Annexe 4 : Estimation de l'exposition par la migration des colorants à partir des vêtements
- Annexe 5 : Sommaire des résultats de RQSA pour le Disperse Orange 29 et les produits potentiels de rupture des liaisons azoïques
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 19800-42-1.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances.
Le Disperse Orange 29 est une substance organique principalement utilisée au Canada comme teinture à textile. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements fournis par l’industrie en réponse à l’enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999) au Canada, le Disperse Orange 29 n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 ou en 2005. Une entreprise a importé 2 000 kg de cette substance au pays en 2006. En 2005, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Disperse Orange 29 au Canada : une entreprise a importé entre 100 et 1 000 kg de cette substance, tandis qu’une autre en a importé entre 1 001 et 100 000 kg, soit dans des produits ou soit pour la fabrication de divers produits colorés.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la majorité des quantités de Disperse Orange 29 utilisées au Canada se retrouvent en grande partie dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouve dans les égouts. On croit que cette substance n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatile, mais qu’elle est adsorbée sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, le Disperse Orange 29 se retrouvera sans doute dans les sédiments s’il est rejeté directement dans l’eau, et peut-être dans une moindre mesure dans les sols agricoles amendés avec des biosolides provenant de stations de traitement des eaux usées, après leur rejet dans l’eau. On est d’avis que le Disperse Orange 29 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation de deux analogues à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans leRèglement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Disperse Orange 29 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Pour la présente version finale de l’évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition de l’environnement prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette la quantité maximum de Disperse Orange 29 selon les sondages les plus récents. De plus, étant donné que le Disperse Orange 29 peut être utilisé dans des produits de consommation, un scénario prudent de rejet provenant de l’utilisation par les consommateurs a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant dans les produits commerciaux au Canada. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.
À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au Disperse Orange 29 dans les milieux environnementaux soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 en raison de son utilisation comme colorant pour les textiles et les tissus, cependant on s’attend à ce que l’exposition cutanée et orale soit faible. Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’était disponible pour le Disperse Orange 29 ou pour des analogues fiables. Les dangers potentiels du Disperse Orange 29 sont reconnus à cause de sa possibilité de former de composés aromatiques aminés à partir de clivages azoïques. Toutefois, lorsque que considère que l’exposition prévue à la population est faible, les risques potentiels à la santé humaine sont considérés faibles aux présents niveaux d’exposition. On conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) exige que les ministres de l’Environnement et de la Santé procèdent à une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si elles présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.
En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (Ti), et que l’on pense être commercialisées au Canada;
- celles qui répondent aux critères de catégorisation pour le plus fort risque d’exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.
Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada(Canada, 2006a), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances d’importance prioritaire.
L’évaluation des risques écologiques présentés par la substance 4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- (qui sera appelée Disperse Orange 29 aux fins du présent document) a été jugée hautement prioritaire, car cette substance répond aux critères environnementaux de catégorisation pour la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et elle semble être commercialisée au Canada. Le volet du Défi portant sur cette substance a été publié dans la Gazette du Canada le 31 mai 2008 (Canada, 2008a, 2008b). En même temps a été publié le profil de cette substance qui présentait l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé sa catégorisation. Dans le cadre du Défi, des renseignements ont été fournis relativement aux propriétés, à la persistance, aux dangers et aux utilisations du Disperse Orange 29 et de certains de ses produits de formulation.
Même si l’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour l’environnement est jugée hautement prioritaire, cette substance ne répond pas aux critères de catégorisation pour le PFRE ou le REI ni aux critères définissant un grave risque pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d’autres organismes nationaux ou internationaux quant à sa cancérogénicité, à sa génotoxicité ou à sa toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.
Les évaluations préalables mettent l’accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Les évaluations préalables visent à examiner des renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence[1].
La présente évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers, les utilisations et l’exposition, y compris ceux fournis dans le cadre du Défi. Les données pertinentes pour l’évaluation préalable de cette substance sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d’évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d’autres documents consultés lors de recherches documentaires menées récemment, jusqu’en juillet 2010. Les études importantes ont fait l’objet d’une évaluation critique; les résultats de la modélisation ont pu être utilisés dans la formulation des conclusions. Les informations disponibles et pertinentes présentées dans des évaluations des risques effectuées par d’autres instances ont été prises en compte. L’évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Il s’agit plutôt d’un sommaire des renseignements essentiels qui appuient la conclusion.
La présente évaluation préalable finale a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada et elle intègre les résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. La section de la présente évaluation portant sur l’écologie a fait l’objet d’une étude consignée par des pairs ou d’une consultation de ces derniers. Des commentaires sur les portions techniques concernant la santé humaine ont été reçus de la part d’experts scientifiques désignés et dirigés par la Toxicology Excellence for Risk Assessment (TERA), notamment M. Larry Claxton, M. Bernard Gadagbui, M. Pertti Hakkinen, M. Glenn Talaska et Mme Pam Williams. De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable a fait l’objet d’une période de commentaires de 60 jours par le public. Bien que les commentaires venus de l’extérieur aient été pris en considération, Santé Canada et Environnement Canada sont seuls responsables du contenu final et des résultats de l’évaluation préalable. Les approches suivies lors des évaluations préalables dans le cadre du Défi ont été examinées par un groupe indépendant, soit le Groupe consultatif du Défi.
Les considérations et renseignements importants qui sous-tendent la présente évaluation sont présentés ci-après.
Nom de la substance
Aux fins du présent document, la substance phénol,
4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- sera appelée Disperse Orange 29, conformément à son nom dans le Colour Index (numéro dans le Colour Index : 26077; CII 2002-). Les renseignements sur l’identité de cette substance sont indiqués dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Identité de la substance pour le Disperse Orange 29
| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) | 19800-42-1 |
| Nom dans la LIS | 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol |
| Noms dans les inventaires[1] | Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (TSCA, AICS, PICCS, ASIA-PAC) 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol(EINECS) Disperse Orange 29 (ENCS) C.I. disperse orange 029 (ECL) C.I. Disperse Orange 29, (4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo)]phenol)(PICCS) |
| Autres noms | 4-[[4-[(p-nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azo]phenol; C.I. Disperse Orange 29; Dianix Yellow Brown SE-R; Foron Yellow Brown SE-RL; Hisperse Orange C-GS; Intrasil Orange L 2R; Intrasil Orange L 2R200; Palanil Orange GL; phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phe-nyl]azo]-; Resolin Yellow Brown 3GL; Samaron Yellow Brown HRSL; Sumikaron Orange SE-RBL; Synten Orange P-GRL; 4-({2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl}azo)phenol |
| Catégorie de la substance | Substances organiques définies |
| Classe chimique | Composés azoïques |
| Groupechimique | Composés diazoïques |
| Formule chimique | C19H15N5O4 |
| Structure chimique |  |
| SMILES[2] | N(=O)(=O)c(ccc(N=Nc(ccc(N=NC(ccc(O)c1)c1)c2OC)c2)c3)c3 |
| Poids moléculaire | 377,36 g/mol |
[2] Simplified Molecular Input Line Entry System
La substance Disperse Orange 29 est un colorant diazoïque dispersé. Les deux liaisons azoïques (-N=N-) de cette molécule sont des groupes fonctionnels qui produisent de la couleur (EPA du Danemark, 1999). Les colorants peuvent être classés selon leur structure chimique, mais aussi selon leurs applications industrielles et les méthodes de teinture du substrat considéré (ETAD, 1995). Leur classification, qui inclut les colorants acides et directs, tend à refléter les regroupements basés sur les propriétés physiques et chimiques des substances. Un bref exposé des usages de ce colorant est consultable à la partie « Utilisations » du présent document.
On dispose de peu de données expérimentales sur les propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29. À l’occasion de l’atelier sur les relations quantitatives structure-activité (RQSA) organisé par Environnement Canada en 1999 (Environnement Canada, 2000), des experts en modélisation ont déterminé que de nombreuses classes structurelles de pigments et de teintures sont « difficiles à modéliser » à l’aide de modèles RQSA. Les propriétés physiques ou chimiques de nombreuses classes structurelles de teintures et de pigments se prêtent mal à la prévision par modélisation, car on considère qu’elles « ne font pas partie du domaine d’applicabilité » (p. ex. domaines de la structure ou des paramètres des propriétés). Par conséquent, pour déterminer leur utilité potentielle, les domaines d’applicabilité des modèles RQSA aux teintures et aux pigments sont évalués au cas par cas.
Pour la présente évaluation, on considère que les modèles des RQSA utilisés pour prévoir les propriétés physiques et chimiques pour lesquels on manque de substances analogues au Disperse Orange 29 dans leur domaine d’applicabilité peuvent produire des résultats ayant un degré d’incertitude élevé. Par conséquent, une méthode par analogie a été employée pour déterminer les propriétés physiques et chimiques approximatives au tableau 2. Par la suite, ces propriétés ont été considérées dans l’évaluation de différentes sources de données. Le tableau 2 présente certaines propriétés physiques et chimiques (valeurs calculées et extrapolées) du Disperse Orange 29.
Un analogue est un produit chimique dont la structure est similaire à celle de la substance évaluée; il devrait donc avoir des propriétés physiques et chimiques, un comportement dans l’environnement et une toxicité semblables. Lorsque ce sont des données expérimentales pour un paramètre donné d’une substance analogue, celles-ci peuvent être directement utilisées ou avec un ajustement, comme estimation de cette valeur de paramètre pour la substance en cours d’évaluation.
Pour trouver des analogues acceptables, une revue des données pour plusieurs colorants azoïques dispersés a été effectuée (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988; ETAD, 1995; Brown, 1992; Yen et al. 1989; Sijm et al., 1999). En plus de leurs similitudes structurelles avec le Disperse Orange 29, ces composés partagent d’autres caractéristiques importantes avec la substance, qui renforcent leur pertinence en tant qu’analogues. Cela comprend les propriétés influant sur leur devenir dans l’environnement comme des masses moléculaires élevées (généralement supérieures à 300 g/mol), un diamètre transversal similaire (entre 1,3 et 2,2 nm), des structures particulaires solides, un point de décomposition supérieur à 120 ºC et une « dispersabilité » dans l’eau (c’est-à-dire que ces composés ne sont pas entièrement « solubles »). De plus, leur pression de vapeur à température ambiante est négligeable, et ils sont stables dans des conditions environnementales, car ils ont été conçus pour l’être. D’autres analogues ont été sélectionnés aux fins de l’évaluation des effets sur la santé humaine, lorsque des données pertinentes existaient (voir la section du présent rapport consacrée au potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine pour des précisions à cet égard).
Comme certains des colorants diazoïques ont été étudiés dans des conditions environnementales non pertinentes (à des températures élevées, par exemple) ou qu’ils ont été testés sous forme de composés purs, ou encore comme peu de renseignements permettaient d’évaluer la fiabilité de certaines études, des données confirmatoires sur les colorants dispersés azoïques, en général, sont incluses dans le tableau 2.
Tableau 2. Propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29 et des analogues pertinents
| Propriété | Type[1] | Valeur | Température (°C) | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État physique | Disperse Orange 29 | Poudre | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Point de décomposition[2] (ºC) |
Disperse Orange 29 | 223 à 223,8 | ETAD, 2005 | ||||||
| Analogue : Solvent Red 23 |
195 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) | 185 | MITI, 1992 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 | 158 178 | Odabasoglu et al., 2003; Datyner, 1978 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 153 à 156,5 | Nishida et al., 1989 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 126,9 à 128,5 | ETAD, 2005 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 157 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 132 153 |
Sijm et al., 1999; Yen et al., 1989 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 117 à 175 74 à 236 |
Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| Point d’ébullition[3] (ºC) |
Sans objet | ||||||||
| Masse volumique (kg/m3) |
Non disponible | ||||||||
| Pression de vapeur (Pa) |
Analogue : Disperse Blue 79 | 4,53 x 10-7 | Clariant, 1996 | ||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 5,3 x 10-12 à 5,3 x 10-5) (4 x 10-14 à 4 x 10-7 mm Hg) |
25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,18 à 0,42[4] | 191,5 à 211[4] | Nishida et al., 1989 | ||||||
| Constante de la loi de Henry (Pa·m3/mol) | Données déduites à partir d’analogues des colorants azoïques | 10-8 à 10-1 (10-13 à 10-6atm·m3/mol)[5] |
Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Log Koe (coefficient de partage octanol-eau) (sans dimension) |
Disperse Orange 29 | 4,6[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 4,1; 4,3[7] | Clariant, 1996; Brown, 1992 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 4,4; 4,8 | Sijm et al., 1999; Yen et al.,1989 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 4,2[8] | Brown, 1992 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 1,8 à 5,1 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| > 2 à 5,1 | Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987 | ||||||||
| Log Kco (coefficient de partage carbone organique-eau) (sans dimension) |
Données déduites à partir d’analogues, calculées | 3,4 à 4,2[9] | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Solubilité dans l’eau (mg/L) |
Analogue : Disperse Orange 29 | 42,9[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Substance d’essai peu soluble dans l’eau | Présentation de projet, 2008a | ||||||||
| 0,0037 | 25 | Baughman et al., 1996 (estimé) | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,345 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 | 0,00006 | 25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| 0,00052 | Baughman et al., 1996 (estimé) | ||||||||
| 15,7 à 34,8[4] | 130 | Braun, 1991 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 68 | 16,6[4] | 125 | Prikryl et al., 1979 | ||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 0,0054 | 25 | Clariant, 1996 | ||||||
| 0,02[7] | Brown, 1992 | ||||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 0,02 | Sijm et al., 1999 | |||||||
| 0,0052 | Yen et al., 1989 | ||||||||
| 0,00063[4] | 100 à 125 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 0,07[8] | Brown, 1992 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | < 0,01 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||
| Très peu soluble dans l’eau | ETAD, 1995 | ||||||||
| 1,2 x 10-5 à 35,5 (4 x 10-11à 1,8 x 10-4 mol/L) |
Baughman et Perenich, 1988 | ||||||||
| Solubilité dans le n-octanol (mg/L) | Analogue : Disperse Orange 29 | 5 086 | ETAD, 2005 | ||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 576 | ETAD, 2005 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 14 | Sijm et al., 1999 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 81 à 2 100 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||
| pKa (constante de dissociation) (sans dimension) |
Analogue : isperse Orange 29 |
9,03 | ACD/pKa DB, 2005 | ||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 |
8,1 | Haag et Mill, 1987 | |||||||
[2] On utilise l’expression « point de décomposition », plutôt que le point de fusion car il est du domaine connu qu’à des températures élevées (supérieures à 200 °C), les colorants dispersés ne fondent pas, mais se carbonisent (ETAD, 1995).
[3] En général, la notion de point d’ébullition ne s’applique pas aux colorants dispersés. Dans le cas des colorants en poudre, on observe, à température élevée, une carbonisation ou une décomposition de la substance plutôt qu’une ébullition. Pour ce qui est des liquides et des pâtes colorantes, on observe l’ébullition du solvant seulement, alors que le composant solide qui ne s’est pas évaporé se décompose ou se carbonise (ETAD, 1995).
[4] Il est à noter que les essais de solubilité dans l’eau, dans ces études, ont été effectués à température très élevée et, par conséquent, les valeurs sont supérieures à celles auxquelles on peut s’attendre à température ambiante.
[5] Les valeurs de solubilité de cinq colorants azoïques dispersés (Disperse Orange 3, Disperse Red 1, Solvent Yellow 2, Dis. A. 5, Dis. A. 7) à 25 et 80 °C ont été utilisées par Baughman et Perenich (1988) pour calculer les constantes de la loi de Henry de ces colorants. Une plage de valeurs est utilisée pour signifier que la constante de la loi de Henry prévue, en ce qui concerne les colorants azoïques, se situe dans cette gamme.
[6] L’étude indique que le Disperse Orange 29 utilisé dans l’essai avait une dispersion de 20 % du colorant testé (70 % d’eau et 10 % de Reax).
[7] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 76 % et une dispersion à 20 % du colorant.
[8] L’étude indique que le Disperse Orange 30 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 73 % et une dispersion à 20 % du colorant.
[9] Les valeurs du log Kcosont fondées sur les calculs que Baughman et Perenich (1988) ont réalisés en utilisant une solubilité mesurée pour des colorants commerciaux, à un point de fusion supposé de 200 ºC.
En raison du peu de données empiriques sur le Disperse Orange 29 et de l’erreur associée aux prédictions de la modélisation portant sur les colorants dispersés, certaines données empiriques sur les propriétés physiques et chimiques (tableau 2), des données sur la bioaccumulation (tableaux 6a et 6b) et des données sur la toxicité provenant d’analogues (tableau 7b) ont été utilisées pour étayer la preuve et les conclusions proposées dans cette évaluation préalable. Plus précisément, des données ont été obtenues sur quatre colorants diazoïques ayant une structure similaire : Disperse Yellow 23, Disperse Yellow 68, Disperse Orange 13, Solvent Red 23 et Solvent Sudan IV/Solvent Red 24) et six colorants monoazoïques ayant une structure similaire (Disperse Blue 79, Disperse Blue 79:1, Disperse Orange 30, Disperse Red 73, Disperse Orange 25 et Disperse Red 17). Les renseignements sur les substances, de même que les données empiriques sur les analogues utilisés dans le présent rapport, sont présentés dans le tableau 3a, alors que les poids moléculaires et les diamètres transversaux sont présentés dans le tableau 3b.
Tableau 3a. Analogues structuraux du Disperse Orange 29 pris en compte dans l’évaluation environnementale
| Nom commun (n° CAS) |
Nom dans la LIS | Structure | Similarités et différences de structure majeures avec le Disperse Orange 29 | Données empiriques disponibles[1] |
|---|---|---|---|---|
| Disperse Orange 29 (19800-42-1) |
4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)] phénol |  |
Sans objet. Même substance. | État physique, point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, solubilité dans le n-octanol |
| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |
p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 23 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers |
Point de fusion, solubilité dans l’eau, pKa et toxicité aquatique |
| Disperse Yellow 68 (21811-64-3) |
p,p’-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 68 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers, et comporte un groupement hydroxyle additionnel |
Solubilité dans l’eau |
| Disperse Orange 13 (6253-10-7) |
p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Orange 13 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal |
Point de fusion, hydrosolubilité, pression de vapeur |
| Solvent Red 23 (85-86-9) |
1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle Différences : Solvent Red 23 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal ou d’éthers |
Point de fusion |
| Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) (85-83-6) |
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique possédant un anneau naphtalène avec un substituant hydroxyle. Même nombre d’anneaux. Différences : Deux groupements méthyle de plus – un sur chacun des anneaux simples. |
Point de fusion, toxicité, FBC |
| Disperse Orange 25 (31482-56-1) |
3-[Éthyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl] amino]propionitrile |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 25 contient un groupe fonctionnel nitrile et un groupe d’amines |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
| Disperse Orange 30 (5261-31-4) |
Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle |  |
Similarité : Composé azoïque aromatique avec un groupement nitro terminal. Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 30 contient des groupes fonctionnels nitriles et carboxyliques et deux chlores. |
Bioaccumula-tion, toxicité pour les organismes aquatiques, log Koe |
| Disperse Blue 79 (12239-34-8) |
Diacétate de 2,2’-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle |  |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et d’un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro additionnel, un aniline avec deux chaînes carbonées et un groupement de brome |
Point de fusion, pression de vapeur, log Koe, solubilité dans l’eau et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |
| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |
Diacétate de 2,2’-{[5-acétamido-4-(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino} diéthyle |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79:1 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, bioaccumulation et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |
| Disperse Red 17 (3179-89-3) |
2,2'-{[3-Méthyl-4-(4-nitrophénylazo)phényl]imino}diéthanol |  |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : pas de second groupe azoïque, Disperse Red 17 contient un groupement hydroxyle additionnel et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
| Disperse Red 73 (16889-10-4) |
2-({4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl} azo)-5-nitrobenzonitrile |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Red 73 contient deux groupements fonctionnels nitriles et aucun groupe d’éthers, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
Tableau 3b. Comparaison de la masse moléculaire et du diamètre transversal des colorants dispersés monoazoïques et diazoïques considérés comme des analogues structuraux
| Substance | N° CAS | Nom commun | Masse moléculaire (g/mol) | Minimum-maximum Dmax(nm)[1] |
|---|---|---|---|---|
| Colorants diazoïques | 19800-42-1 | Disperse Orange 29 | 377 | 1,56-2,19 |
| 6250-23-3 | Disperse Yellow 23 | 302 | 1,50-2,07 | |
| 6253-10-7 | Disperse Orange 13 | 352 | 1,56-2,07 | |
| 85-86-9 | Solvent Red 23 | 352 | 1,50-2,03 | |
| 85-83-6 | Sudan IV | 380 | 1,50-2,03 | |
| 21811-64-3 | Disperse Yellow 68 | 318 | 2,09-2,14 | |
| Colorants monoazoïques analogues | 12239-34-8 | Disperse Blue 79 | 639 | 1,69-2,05 |
| 3618-72-2 | Disperse Blue 79:1 | 625 | 1,43-2,03 | |
| 5261-31-4 | Disperse Orange 30 | 450 | 1,75-1,98 | |
| 16889-10-4 | Disperse Red 73 | 348 | 1,31-1,93 | |
| 31482-56-1 | Disperse Orange 25 | 323 | 1,37-1,95 | |
| 3179-89-3 | Disperse Red 17 | 344 | 1,41-1,86 |
Il faut noter qu’il existe plusieurs incertitudes associées à l’utilisation des données physiques, chimiques, toxicologiques et de bioaccumulation disponibles pour les substances. Toutes ces substances appartiennent à la même classe chimique, à savoir les composés azoïques (un sous-ensemble comporte deux liaisons azoïques et un autre comporte une liaison azoïque) et sont utilisées à des fins industrielles similaires (colorants dispersés et teintures avec deux solvants). Toutefois, ces substances présentent des différences liées à leur groupement fonctionnel propre (voir le tableau 3a ci-après) et à leur taille moléculaire. En dépit du fait que les colorants monoazoïques comportent des masses moléculaires plus élevées que les colorants diazoïques, leur état physique, leur point de fusion, leur solubilité dans l’eau, leur log Koe et leurs diamètres transversaux comparables (tableau 3b) offrent un fondement raisonnable permettant de conclure que les colorants monoazoïques auront un comportement semblable à celui des colorants diazoïques dans l’environnement, et présenteront une biodisponibilité à peu près égale, et que leur utilisation comme analogues du Disperse Orange 29 était donc acceptable.
Le Disperse Orange 29 n’est pas produit naturellement dans l’environnement.
Des enquêtes menées récemment auprès de l’industrie en 2005 et 2006 par le truchement d’avis publiés dans laGazette du Canada conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), ont permis de recueillir des renseignements récents (Canada, 2006b et 2008b). Ces avis nécessitaient la fourniture de données sur la fabrication, l’importation et l’utilisation du Disperse Orange 29 au Canada. Dans l’avis de 2006, on demandait aussi des données sur les quantités de ce colorant utilisées. Dans le contexte des avis émis en vertu de l’article 71 de 2005 et 2006, les entreprises qui n’étaient pas tenues de fournir des données selon les critères établis, mais qui avaient un intérêt commercial se rapportant au Disperse Orange 29, ont été invitées à s’identifier en tant que parties intéressées.
En 2006, une entreprise a déclaré avoir importé 2 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2008a). En 2005, moins de quatre entreprises ont déclaré avoir importé de 100 à 100 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2006). Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué du Disperse Orange 29 à des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/année durant l’une ou l’autre année.
En 2006, un importateur de Disperse Orange 29 a déclaré en avoir vendu à 13 entreprises, la quantité maximale vendue étant de 261 kg au cours de cette année. Au total, trois entreprises se sont identifiées en tant que partie intéressée pour le Disperse Orange 29 en 2005 et 2006 (Environnement Canada, 2006, 2008a).
Au cours de l’élaboration de la Liste intérieure des substances (LIS), la quantité de Disperse Orange 29 déclarée avoir été fabriquée, importée ou commercialisée en 1986 était de 42 000 kg par huit entreprises (Environnement Canada, 1988).
Le Disperse Orange 29 a été reconnu comme substance chimique produite en faible quantité dans l’Union européenne (UE). Sa production au sein de l’Union européenne a été estimée entre 10 et 1 000 tonnes par an, environ (ESIS, 2008). Aux États-Unis, la production nationale de Disperse Orange 29 se situait dans l’intervalle de 10 000 à 500 000 livres pour les cycles de déclaration de 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002 du programme Inventory Update Reporting de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA, 1986-2002). Le Disperse Orange 29 a également été utilisé en Suède de 1999 à 2006, et au Danemark de 2003 à 2006 (SPIN, 2008).
Les produits contenant du Disperse Orange 29 peuvent entrer au Canada même s’ils n’ont pas été recensés en tant que tels dans l’enquête menée en vertu de l’article 71, en raison de leur importation involontaire dans les articles manufacturés ou de leurs quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg établi pour l’enquête.
Des renseignements relatifs aux utilisations pour les années civiles 2005 et 2006 ont été recueillis en réponse aux avis publiés en application de l’article 71 de la LCPE (1999) (Canada, 2006b, 2008b). Les entreprises qui ont importé du Disperse Orange 29 en 2005 et en 2006 ont déclaré que leurs activités commerciales étaient liées au finissage de textiles et de tissus, et à la préparation de produits chimiques. L’importateur de Disperse Orange 29 en 2006 a indiqué avoir vendu la substance à 13 autres entreprises (Environnement Canada, 2008a). D’après des recherches additionnelles, ces entreprises font partie de l’industrie du textile et produisent des tissus d’intérieur, des vêtements de travail, des tissus techniques, des vêtements pour enfants, des sangles pour ceintures de sécurité et autres usages, des fermetures à glissière et d’autres produits textiles. Ces entreprises utilisent des textiles tels que le coton, le jersey, le molleton, le polyester et le tissu éponge (Industrie Canada, 2008a).
Au cours du processus d’inscription des substances dans la LIS (1984-1986), les codes d’utilisation « colorant - pigments/colorants/teintures/encre », « pigments, teintures et encres d’imprimerie », « secteur textile, fabrication primaire » et « produits textiles » ont été attribués au Disperse Orange 29.
Une analyse de l’information scientifique et technique révèle que le Disperse Orange 29 est surtout utilisé dans l’industrie du textile (SPIN, 2008) pour teindre le polyester, l’acétate et le nylon (CII, 2002). Les méthodes employées pour son application comprennent le thermosolage et l’impression (QPC, 2004), et les textiles colorés au Disperse Orange 29 peuvent servir à teindre des vêtements de travail et de sport ainsi que des tissus d’ameublement et pour automobile (Farbchemie Braun KG, 2008).
Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas dans la liste des additifs alimentaires autorisés du Règlement sur les aliments et drogues et n’est pas utilisé dans l’emballage alimentaire (Santé Canada, 2007)
Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas à l’article C.01.040.2 du Règlement sur les aliments et drogues parmi les colorants autorisés dans les médicaments (Canada, 1978). De plus, le Disperse Orange 29 n’est inscrit ni dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP), ni dans la base de données sur les ingrédients non médicinaux interne de la Direction des produits thérapeutiques, ni dans la Base de données sur les ingrédients de produits de santé naturels (BDIPSN), ni dans la Base de données des produits de santé naturels homologués (BDPSNH) en tant qu’ingrédient médicinal ou non médicinal dans les produits pharmaceutiques finaux, les produits de santé naturels ou les médicaments vétérinaires (BDPP, 2010; BDIPSN, 2010; BDPSNH, 2010; courriel de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada adressé au Bureau de gestion du risque de Santé Canada en avril 2010, source non citée).
Débit massique
Environnement Canada a développé une méthode pour estimer les pertes d’une substance pendant différentes étapes de son cycle de vie, y compris son devenir dans un produit ou un article fini (Environnement Canada, 2008). Cette méthode comprend une analyse du cycle de vie et un tableur (outil de débit massique) qui intègrent les renseignements sur la fabrication, l’importation et l’utilisation de la substance. En commençant par une masse définie de la substance, chaque étape du cycle de vie est par la suite évaluée jusqu'à ce que toute la masse ait été comptabilisée. Les facteurs pertinents sont étudiés, les incertitudes sont déterminées et des hypothèses peuvent être faites pendant chaque étape, selon les renseignements disponibles. Les pertes estimées représentent le bilan massique complet de la substance au cours de son cycle de vie et elles comprennent les rejets dans les eaux usées et dans d’autres milieux récepteurs (sol, air), la transformation chimique, le transfert vers les activités de recyclage et le transfert vers les sites d’élimination des déchets (sites d’enfouissement, incinération). Toutefois, à moins de disposer de données précises sur le taux ou le potentiel de rejet de cette substance provenant des sites d’enfouissement et des incinérateurs, la méthode ne permet pas de quantifier les rejets dans l’environnement à partir de ces sources. En fin de compte, les pertes estimées fournissent le premier volet de l’analyse de l’exposition à une substance et aident à estimer les rejets dans l’environnement et à mettre l’accent sur la caractérisation de l’exposition plus tard dans l’évaluation.
En général, les rejets d’une substance dans l’environnement peuvent découler de différentes pertes de la substance lors de sa fabrication, de son utilisation industrielle, de son utilisation commerciale et de son utilisation par les consommateurs. Ces pertes peuvent être regroupées en sept types : 1) déversements dans les eaux usées; 2) émissions atmosphériques; 3) perte dans le sol; 4) transformation chimique; 5) élimination sur les sites d’enfouissement; 6) perte par incinération; 7) élimination par recyclage (p. ex. le recyclage est jugé comme une perte et n’est plus pris davantage en compte). Ces pertes sont estimées à partir de données d’enquêtes réglementaires, de données de l’industrie, et de données publiées par différents organismes. Les rejets dans les eaux usées font référence aux eaux usées brutes avant tout traitement par des systèmes d'assainissement publics ou privés. De la même manière, les pertes par transformation chimique font référence aux modifications de l'identité de la substance qui peuvent avoir lieu au cours des étapes de fabrication, d'utilisation industrielle ou d'utilisation commerciale ou par les consommateurs, mais elles excluent celles qui ont lieu pendant les opérations de gestion des déchets telles que l'incinération et le traitement des eaux usées. La perte dans le sol inclut le transfert accidentel ou les fuites dans le sol ou sur les surfaces pavées ou non pavées pendant l'utilisation de la substance et sa durée de vie utile (p. ex. lors de l'utilisation de machinerie agricole ou d'automobiles). La perte dans le sol n'inclut toutefois pas les transferts après l'utilisation de la substance ou sa vie utile (p. ex. application sur le sol des biosolides et dépôts atmosphériques).
Les pertes estimées pour le Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie (fondées sur des hypothèses prudentes) sont présentées au tableau 4 (Environnement Canada, 2010a). Le Disperse Orange 29 n’est pas fabriqué au Canada au-delà des seuils de déclaration, par conséquent, les pertes estimées sont fondées sur les quantités importées déclarées en 2006.
Tableau 4. Estimation des pertes de Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie
| Type de perte | Proportion (%) | Étapes pertinentes du cycle de vie |
|---|---|---|
| Eaux usées | 14,8 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Émissions atmosphériques | 0 | |
| Sol | 0 | |
| Transformation chimique | 0 | |
| Sites d’enfouissement | 82,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Incinération | 2,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Recyclage | 0 | |
| Total | 100 |
Comme le Disperse Orange 29 est principalement utilisé dans l’industrie textile, l’outil du débit massique a été alimenté en données concernant spécifiquement les colorants textiles pour la présente évaluation.
Selon les estimations, le Disperse Orange 29 est rejeté dans les eaux usées à 14,8 % durant son utilisation à des fins industrielles et aux étapes d’utilisation par les commerces et les consommateurs. Les hypothèses émises pendant cette étape comprennent les pertes pendant la manutention des contenants et les activités de coloration. On estime que la majorité du Disperse Orange 29 dans les textiles se perd dans l’élimination des déchets provenant d’article manufacturés (incinération 2,6 % et décharges 82,6 %). On suppose que les pertes dans le recyclage des textiles sont négligeables.
Les pertes estimées ci-dessus indiquent que le Disperse Orange 29 utilisé dans les textiles présente un potentiel de rejets dans l’environnement. En général, les eaux usées constituent un point d’entrée commun des substances dans l’eau, cela par l’intermédiaire des installations de traitement des eaux usées, et un point d’entrée dans le sol par l’intermédiaire de la gestion subséquente des boues résiduelles. Les émissions atmosphériques peuvent donner lieu à des dépôts atmosphériques dans le sol et l’eau. Lorsqu’une substance est transférée accidentellement vers les terres, elle peut pénétrer dans les égouts ou être transférée par le vent ou la pluie vers le sol proche. Lors d’activités de recyclage, la substance peut être acheminée dans l’eau ou le sol, selon les caractéristiques opérationnelles des installations. Enfin, les décharges ont le potentiel de lessiver des substances dans l’eau souterraine ou d’en rejeter dans l’atmosphère.
Selon les données de Statistique Canada et une analyse réalisée par Industrie Canada (2008b), on propose que les colorants textiles tels que le Disperse Orange 29 évalué dans le présent rapport pourraient être importés dans des articles manufacturés. À la suite de cette hypothèse, le rapport de textiles fabriqués au Canada et importés de 30/70 a été utilisé pour estimer la quantité de teinture importée dans les textiles (Industrie Canada, 2008b; Environnement Canada, 2008c). Cette quantité importée a été prise en compte dans les calculs de l’outil de débit massique pour le Disperse Orange 29 utilisé dans le secteur des textiles.
Les calculs présument qu’il n’y a aucun rejet de cette substance à partir des sites d’enfouissement, bien que des rejets à long terme soient possibles. Une petite fraction des déchets solides est incinérée, ce qui peut engendrer la transformation chimique de la substance. D’après les renseignements contenus dans les documents sur les scénarios d’émission de l’OCDE concernant la transformation et les utilisations associées à ce type de substance (OCDE, 2004), on estime que 14,8 % du Disperse Orange 29 utilisé dans les colorants textiles peuvent être rejetés dans les égouts (5,4 % découlant du traitement industriel et 9,4 % provenant des utilisations par les consommateurs).
D’après ce qui précède, les effluents d’eaux usées constituent le milieu qui reçoit la plus grande proportion de Disperse Orange 29 rejeté pendant l’utilisation du produit. On prévoit que la plus grande partie de la substance, qu’elle soit fixée aux textiles manufacturés ou aux boues des installations de traitement des eaux usées à la suite de rejets aux égouts, sera envoyée sous une forme solide (textiles) ou entraînée dans les boues vers des sites d’enfouissement (décharges). En plus d’être mis en décharge, une partie des biosolides produits par les installations de traitement des eaux usées peuvent être épandus sur des terres comme engrais ou comme amendement des sols destinés à des utilisations agricoles ou forestières ou encore devant être mis en valeur, et un petit pourcentage peut être incinéré.
Selon les résultats obtenus à l’aide de l’outil de débit massique (tableau 4), la substance Disperse Orange 29 est susceptible d’être rejetée dans les effluents d’eaux usées issus de sa transformation industrielle et de ses utilisations associées à des rejets dans les égouts. Les valeurs élevées de log Koe (4,6) et les valeurs élevées de log Kco déterminées par analogie (3,4 à 4,2) [voir le tableau 2] indiquent que cette substance pourrait avoir une affinité pour les solides. Toutefois, les log Kco sont des valeurs calculées, et non strictement expérimentales (voir la note 8 du tableau 2), et le potentiel d’adsorption des structures particulaires solides des colorants n’est généralement pas bien compris; par conséquent, l’importance de ce comportement particulier est incertaine.
Selon les modèles de biodégradation aérobie, il est attendu que la biodégradation du Disperse Orange 29 soit lente (voir le tableau 5 ci-dessous). Cette substance peut être épandue sur des sols au Canada involontairement du fait de sa présence dans les biosolides souvent utilisés pour enrichir le sol. De plus, la substance pourrait être libérée des textiles teints qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement.
Étant donné les valeurs du pKa de 8,1 pour l’analogue Disperse Yellow 23 et une valeur pKaestimée à 9,03 pour le Disperse Orange 29 (tableau 2), on peut s’attendre à ce que cette substance chimique se comporte comme un acide faible et soit partiellement ionisée dans l’eau aux valeurs élevées de la gamme normale du pH dans l’environnement (8 à 9). Toutefois, en raison de la faible solubilité dans l’eau attendue du Disperse Orange 29 (tableau 2) et de son état particulaire, il est peu probable que l’ionisation à un pH élevé influe significativement sur la répartition de ces substances dans l’environnement ou sur leur solubilité dans l’eau. De ce fait, lorsqu’elle est rejetée dans l’eau, cette substance devrait se retrouver principalement sous forme solide ou être adsorbée aux particules en suspension pour enfin se déposer sur les matériaux du lit où elle devrait demeurer sous une forme qui n’est relativement pas biodisponible. Il a été indiqué que, vu le caractère récalcitrant des colorants azoïques en milieu aérobie, ces produits finissent par se retrouver dans des sédiments anaérobies, dans des aquifères peu profonds et dans l’eau souterraine (Razo-Flores et al., 1997). Cependant, comme le Solvent Red 23 est faiblement soluble dans l’eau et possède un Kco relativement élevé, il est peu susceptible d’être lessivé à partir des sédiments et des sols.
La vitesse de volatilisation à partir de la surface de l’eau est proportionnelle à la constante de la loi de Henry (Baughman et Perenich, 1988). Baughman et Perenich (1988) mentionnent également que la volatilisation à partir de systèmes aquatiques devrait être un processus de perte peu important pour les colorants dont la valeur de la constante de la loi de Henry pour les analogues est faible à négligeable
(10-8 à 10-1 Pa·m3/mol, tableau 2). Le transport dans l’air qui résulte de la perte de cette substance des sols superficiels humides et secs n’est pas très important pour cette substance comme l’indique sa très faible pression de vapeur (5,33 x (10-12 à 10-5) Pa; tableau 2). Ces données sont compatibles avec l’état physique (particule solide) des colorants diazoïques qui les rend peu sujets à la volatilisation. La valeur expérimentale de la pression de vapeur du Disperse Orange 13 n’est pas un indicateur utile de la volatilisation du Disperse Orange 29 étant donné qu’elle a été obtenue à une température élevée.
Persistance dans l’environnement
Les colorants doivent être très stables, d’un point de vue chimique, et résister à la photolyse pour être utiles. Ils sont donc pour la plupart considérés comme non biodégradables dans les conditions aérobies ambiantes (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995). Des études dans lesquelles les épreuves généralement reconnues (p. ex., les lignes directrices de l’OCDE) de biodégradabilité immédiate et intrinsèque ont été appliquées ont permis de confirmer ce point (ETAD, 1992; Pagga et Brown, 1986). La dégradation abiotique, dont la photolyse et l’hydrolyse, ne devrait pas jouer un rôle important dans le devenir des colorants azoïques dans l’environnement (EPA du Danemark, 1999), même si une étude a montré une photodécomposition fortement accélérée de tels colorants en présence de matières humiques naturelles (Brown et Anliker, 1988).
La dégradation biotique des colorants azoïques peut se produire relativement rapidement dans des conditions anaérobies ou réductrices (Baughman et Weber, 1994; EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995; Isik et Sponza, 2004; Yen et al., 1991). Il a été déterminé que la perméabilité de la paroi cellulaire des bactéries constitue l’étape limitante du processus de réduction (EPA du Danemark, 1999). On observe chez les colorants azoïques une forte tendance à la rupture de la liaison azoïque avec formation d’amines aromatiques (EPA du Danemark, 1999; Hunger, 2005). Le potentiel de cancérogénicité des amines aromatiques varie considérablement en fonction de la structure moléculaire, des produits de décomposition cancérogènes étant associés avec des groupements fonctionnels de la benzidine, de l’aniline, du toluène et du naphtalène. Cependant, la formation de tels métabolites dans les sédiments anoxiques profonds n’entraînera habituellement pas d’exposition des organismes aquatiques. La minéralisation totale ou la dégradation subséquente de ces métabolites est une possibilité si ceux-ci sont déplacés (p. ex., par remise en suspension des sédiments) dans un milieu aérobie (EPA du Danemark, 1999; Isik et Sponza, 2004). Des amines aromatiques peuvent également être présentes comme impuretés dans les colorants azoïques offerts sur le marché, mais la rupture de la liaison de ces colorants lors du métabolisme demeure la principale source de telles amines (EPA du Danemark, 1999).
D’après une étude présentée sur la bioélimination du Disperse Yellow 23, cette substance est dégradée à 51 % en 14 jours (présentation de projet, 2008b). Toutefois, cette valeur expérimentale n’a pas pu être utilisée pour l’évaluation de la persistance du Disperse Orange 29, car l’étude a été considérée peu fiable en raison de renseignements insuffisants sur les conditions expérimentales (voir le sommaire de rigueur d’étude à l’annexe 1). Outre cette étude, aucune autre donnée expérimentale ou de comparaison sur la dégradation du Disperse Orange 29 n’a été relevée. Aucune donnée de surveillance environnementale n’ayant trait à la présence de ces colorants dans l’environnement canadien (air, eau, sol et sédiments) n’a été relevée.
Comme on s’attend à ce que le Disperse Orange 29 soit rejeté dans les eaux usées, sa persistance a surtout été examinée à l’aide de modèles de prévision RQSA sur la biodégradation aérobie dans l’eau. L’utilisation de ces modèles est jugé acceptable dans cette situation puisqu’ils sont fondés sur la structure chimique et que la structure diazoïque est représentée dans les ensembles d’étalonnage de tous les modèles BIOWIN utilisés, ce qui augmente la fiabilité des prédictions (Environnement Canada, 2007). L’analyse suivante concerne principalement la partie de cette substance actuellement dissoute dans l’environnement, tout en tenant compte du fait qu’il est probable qu’une grande partie de cette substance soit dispersée sous la forme de particules solides. Le Disperse Orange 29 et ses analogues ne contiennent pas de groupements fonctionnels susceptibles d’entreprendre une hydrolyse dans un milieu anaérobie (les colorants sont connus pour être stables dans les milieux aqueux). Le tableau 5 résume les résultats des modèles RQSA disponibles sur la biodégradation aérobie dans l’eau.
Tableau 5. Données modélisées sur la biodégradation du Disperse Orange 29
| Processus du devenir | Modèle et base du modèle |
Résultat et prévision du modèle | Demi-vie extrapolée (jours) |
|---|---|---|---|
| Biodégradation primaire | |||
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 4 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |
3,2[2] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation ultime | |||
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 3 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |
1,6[2] « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 5 : Probabilité linéaire, MITI |
-0,34[3] « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 6 : Probabilité non linéaire, MITI |
0[3] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | TOPKAT, 2004 Probabilité |
0[3] n.d.[4] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | CATABOL, C2004-2008 % DBO[5] (demande biochimique en oxygène) |
% DBO = 0 « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
[2] Le résultat s’exprime par une valeur numérique de 0 à 5.
[3] Le résultat s’exprime par un taux de probabilité.
[4] n.d. : non disponible (hors du domaine du modèle).
[5] DBO : demande biochimique en oxygène.
Comme le montre le tableau 5, tous les modèles de biodégradation ultime (BIOWIN 3, 5, 6, CATABOL et TOPKAT) portent à croire que la biodégradation du Disperse Orange 29 se fait lentement en conditions aérobies dans l’eau. Toutefois, le résultat du modèle TOPKAT a été étiqueté non fiable pour ce type de structure. En fait, les résultats de probabilité des modèles BIOWIN 5 et 6 sont bien inférieurs à 0,3, ce qui est la limite suggérée par Aronson et al. (2006) pour trouver les substances qui ont une demi-vie de plus de 60 jours (selon les modèles de probabilité du MITI). En outre, les deux autres modèles de dégradation ultime, à savoir BIOWIN 3 et CATABOL, indiquent que le Disperse Orange 29 sera persistant dans l’eau.
Lorsque les résultats de probabilité et les modèles de dégradation ultime sont pris en compte, il y a un important consensus qui suggère que la demi-vie de la biodégradation ultime dans l’eau est supérieure ou égale à 182 jours. Ce résultat correspond à ce qu’on s’attend de ces structures chimiques (c.-à-d., peu de groupements fonctionnels dégradables, particules solides peu solubles).
Selon un ratio d’extrapolation de 1:1:4 pour la demi-vie associée à la biodégradation dans l’eau, le sol, les sédiments (Boethling et al., 1995), la demi-vie de dégradation ultime dans le sol aérobie est également supérieure ou égale à 182 jours, et la demi-vie dans les sédiments est supérieure ou égale à 365 jours. Cela indique que le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans le sol et les sédiments.
D’après les données modélisées pour la dégradation ultime (voir tableau 5 ci-dessus) et l’avis d’expert (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995), le Disperse Orange 29 répond aux critères de persistance dans l’eau, le sol (demi-vies en conditions aérobies dans le sol et dans l’eau ≥ 182 jours), les sédiments (demi-vie dans les sédiments aérobies de ≥ 365 jours) énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Potentiel de bioaccumulation
On ne dispose pas de données expérimentales sur la bioaccumulation du Disperse Orange 29. Comme il est connu que les modèles de la bioaccumulation s’appliquent mal aux pigments et aux colorants, leurs prévisions ne sont pas considérées comme fiables pour les colorants diazoïques. La modélisation de la bioaccumulation n’a donc pas été employée pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de ces substances.
Vu l’absence de données expérimentales et modélisées, les facteurs de bioconcentration (FBC) et de bioaccumulation (FBA) d’analogues structuraux ont été utilisés pour estimer le potentiel de bioaccumulation du Disperse Orange 29. D’après des études sur la bioconcentration d’analogues structuraux relativement proches, le Sudan IV (MITI, 1992) et le Disperse Orange 30 (Shen et Hu, 2008), l’accumulation du Solvent Red 23 dans les poissons serait peu probable (Sten et Hu, 2008). L’essai sur le Solvent Red 23 (tableau 6a) effectué par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI) à l’aide de carpes a généré une série de facteurs de bioconcentration faibles (inférieurs à 11 L/kg).
Tableau 6a. Données empiriques sur la bioaccumulation et la bioconcentration du Sudan IV, analogue du Solvent Red 23
| Organisme d’essai | Concentrations expérimentale (mg/L) et/ou source d’exposition | Paramètre (FBC, L/kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| Carpe (Cyprinus carpio) |
0,35 | < 0,29 à 2,9 | MITI, 1992 |
| Carpe (Cyprinus carpio) |
0,035 | < 2,9 à 11 | MITI, 1992 |
L’essai de bioconcentration effectué par Shen et Hu (2008) a été réalisé selon les lignes directrices de l’OCDE (OCDE, 1996). La bioconcentration du Disperse Orange 30 chez le poisson zèbre (Brachydanio rerio) a été déterminée par un test semi-statique sur 28 jours, avec renouvellement du milieu de test tous les deux jours. Afin de vérifier le potentiel de bioconcentration de la substance d’essai, un essai en phase d’exposition à une concentration nominale de 20 mg/L (concentration moyenne mesurée entre 0,028 et 0,28 mg/L approximativement) a été mené en tenant compte du résultat obtenu lors de l’essai de toxicité aiguë pour le poisson. Des échantillons des deux solutions de test et des organismes d’essai ont été pris du 26e jour au 28ejour de la période de test d’exposition sur 28 jours. Les échantillons ont été préparés en extrayant le composant lipidique des poissons testés. La concentration mesurée de la substance d’essai, la teneur en lipides et le facteur de bioconcentration (FBC) figurent au tableau 6b.
Tableau 6b. Concentrations mesurées, teneur en lipides et calcul du FBC d’une substance analogue du Disperse Orange 30, d’après Shen et Hu (2008)
| Traitements (20 mg/L) | Durée d’échantillonnage | ||
|---|---|---|---|
| 26e jour | 27e jour | 28e jour | |
| Concentration mesurée de la substance d’essai dans les solutions extraites (mg/L) | < 0,028 | < 0,028 | < 0,028 |
| Contenu de la substance test dans les lipides du poisson (mg) | < 1,68 | < 1,68 | < 1,68 |
| Poids total des poissons (g) | 2,07 | 2,13 | 2,53 |
| Concentration de la substance d’essai dans les poissons Cp (mg/kg) | < 0,81 | < 0,79 | < 0,66 |
| Concentration mesurée de la substance test dans le Ce de l’eau (mg/L) | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 |
| Contenu lipidique du poisson (%) | 0,81 | 0,57 | 1,25 |
| FBC | < 100 | < 100 | < 100 |
| FBC moyen | < 100 | ||
L’étude de Shen et Hu (2008) a été révisée et considérée comme acceptable (voir l’annexe 1). Le très faible niveau de détection dans les extraits de poisson (< 0,028 mg/L) indiquerait une solubilité limitée dans les lipides ou un potentiel limité de répartition dans les tissus des poissons des systèmes aqueux. Toutefois, il existe une incertitude associée aux valeurs limites dans toute étude, car la « vraie » valeur n’est pas connue. Par contre, étant donné la structure et le comportement probable des colorants dispersés dans les systèmes aqueux, le faible résultat obtenu pour le FBC n’est pas inattendu. La plupart des colorants dispersés, ainsi que leur nom le laisse entendre, se présentent sous la forme de fines particules dispersibles avec des fractions réellement solubles limitées. Leur solubilité peut, toutefois, être augmentée en ajoutant à la molécule des groupements fonctionnels polarisés. Or, même si le Disperse Orange 29 comprend certains groupements fonctionnels solubilisants (groupements phénols), les valeurs expérimentales disponibles pour leur solubilité (qui varient de 0,000 06 à 0,345 mg/L) sont relativement faibles, soit inférieures ou comparables, par moins d’un ordre de grandeur, à la solubilité dans l’eau du Disperse Orange 30 (c.-à-d. 0.07 mg/L). Par conséquent, le Disperse Orange 29 devrait avoir une biodisponibilité et un potentiel de bioconcentration similaires ou inférieurs à ceux du Disperse Orange 30.
L’étude susmentionnée constitue un élément de preuve de première importance permettant de croire que le Disperse Orange 29 ne serait pas bioaccumulable, et d’autres recherches viennent appuyer également cette conclusion. Anlikeret al., (1981) présentent des valeurs expérimentales sur la bioaccumulation dans les poissons pour 18 colorants monoazoïques dispersés, valeurs obtenues suivant les méthodes prescrites par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI). Le log des facteurs de bioaccumulation (FBC) variait entre 0,00 et 1,76 et est exprimé en fonction du poids humide total des poissons (Anliker et al., 1981). L’absence d’information sur le numéro de registre et la structure chimique précise limite toutefois l’utilité de cette étude pour des déductions par analogie au sujet du Disperse Orange 29. Néanmoins, des études complémentaires fournissant des précisions sur la structure chimique des colorants dispersés testés ont confirmé le faible potentiel de bioaccumulation de dix colorants azoïques nitrosubstitués pour lesquels les valeurs déterminées du log du facteur de bioaccumulation varient de 0,3 à 1,76 (Anliker et Moser, 1987; Anliker et al., 1988). Des études du MITI viennent également appuyer le faible potentiel de bioaccumulation des colorants azoïques dispersés. Les FBC déclarés de trois colorants azoïques dispersés (nos CAS 40690-89-9, 61968-52-3 et 71767-67-4) testés à une concentration de 0,01 mg/L variaient de moins de 0,3 à 47 L/kg (MITI, 1992). Une étude sur l’accumulation d’une durée de huit semaines réalisée par Brown (1987) montre également qu’aucun des douze colorants dispersés ayant été testés ne s’accumulait chez la carpe.
Les seules données qui indiqueraient que la substance pourrait avoir un potentiel élevé de bioaccumulation sont une valeur élevée du log Koe pour le Disperse Orange 29 et des valeurs se rapportant à des analogues azoïques apparentés (tableau 2). Malgré les valeurs élevées du log Koedéduites du Disperse Orange 29 et d’analogues structurels azoïques, la preuve de la bioaccumulation des colorants azoïques dispersés est insuffisante (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Ankiler et al.,. 1988; MITI, 1992). Selon les auteurs qui ont mesuré des valeurs élevées du log Koe et de faibles facteurs de bioaccumulation concomitants pour les colorants azoïques dispersés, les facteurs d’accumulation faibles pourraient s’expliquer, dans certains cas, par leur faible liposolubilité absolue (Brown, 1987) ou leur poids moléculaire relativement élevé, ce qui pourrait rendre difficile le transport de ces substances à travers les membranes des poissons (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987). Il se peut aussi que le manque de biodisponibilité et le comportement de répartition limité imposés par les conditions d’essai sur le FBC restreignent l’accumulation dans les tissus lipidiques des poissons.
De récentes études liées aux données sur le FBC chez les poissons et aux paramètres de la taille moléculaire (Dimitrovet al. (2002, 2005) laissent entendre que la probabilité qu’une molécule traverse des membranes cellulaires à la suite d’une diffusion passive diminue de façon importante avec l’augmentation du diamètre maximal (Dmax). La probabilité qu’une diffusion passive se produise diminue de façon notable lorsque le diamètre maximal est supérieur à environ 1,5 nm et diminue de façon encore plus significative dans le cas des molécules ayant un diamètre maximal supérieur à 1,7 nm. Sakuratani et al., (2008) ont également étudié l’effet du diamètre transversal sur la diffusion passive à l’aide d’un ensemble d’essais du FBC comptant environ 1 200 substances chimiques nouvelles et existantes. Ils ont observé que les substances qui n’ont pas un potentiel de bioconcentration très élevé (FBC < 5 000 ont souvent un Dmax > 2,0 nm et un diamètre effectif (Deff) > 1,1 nm.
Le Disperse Orange 29 et ses analogues les plus proches (les colorants diazoïques) ont des poids moléculaires variant de 302 à 377 g/mol (voir le tableau 3b) et des structures moléculaires relativement peu compliquées; ces deux caractéristiques indiquent une capacité de bioaccumulation si le poids moléculaire est le seul indicateur utilisé. En revanche, Arnot et al., (2010) indiquent qu’il n’y a pas de rapports nets qui permettraient de fixer une valeur limite de la taille moléculaire de démarcation pour l’évaluation du potentiel de bioaccumulation. Ce rapport ne met toutefois pas en cause la notion selon laquelle la réduction du taux d’absorption pourrait être associée à l’augmentation du diamètre transversal, comme cela a été démontré par Dimitrov et al. (2002, 2005). Le diamètre maximal du Disperse Orange 29, de ses analogues les plus proches et de ses conformères varie de 1,5 à 2,2 nm (BBM, 2008), ce qui indiquerait une possibilité de réduction significative de l’absorption à partir de l’eau et de la biodisponibilité in vivo pour ces colorants.
Cependant, comme l’ont évoqué Arnot et al. (2010), il existe des incertitudes quant aux seuils proposés par Dimitrovet al., (2002, 2005) et Sakuratani et al. (2008), étant donné que les études sur le FBC utilisées pour calculer ces seuils n’ont pas fait l’objet d’évaluations critiques. Selon Arnot et al. (2010), la taille moléculaire a un effet sur la solubilité et la capacité de diffusion dans l’eau et dans les phases organiques (membranes), et les plus grosses molécules peuvent avoir un taux d’absorption plus lent. Toutefois, ces mêmes contraintes liées aux facteurs cinétiques s’appliquent aux voies de diffusion de l’élimination chimique (c.-à-d., absorption lente = élimination lente). Un potentiel de bioaccumulation important peut donc s’appliquer aux substances qui sont soumises à un processus d’absorption lent, si elles sont biotransformées ou éliminées lentement par d’autres processus. Par conséquent, lorsqu’on évalue le potentiel de bioaccumulation, les données sur la taille moléculaire doivent être utilisées avec discernement et de pair avec des éléments de preuve pertinents dans le cadre d’une méthode du poids de la preuve.
Étant donné l’absence d’accumulation observée dans les études sur la bioconcentration du Sudan IV, du Disperse Orange 30 et d’autres colorants azoïques dispersés apparentés ayant donné des résultats similaires, et compte tenu du grand diamètre transversal du Disperse Orange 29 et de ses analogues, qui restreint vraisemblablement leur comportement de partage, le Disperse Orange 29 devrait présenter un faible potentiel de bioaccumulation. Par conséquent, en considérant les données disponibles, le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères de bioaccumulation (FBC ou FBA ≥ 5 000) du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Évaluation des effets écologiques
A – Dans le milieu aquatique
Des études de la toxicité du Disperse Orange 29 et du Disperse Yellow 23 analogue (présentation de projet, 2008a, b) ont été présentées pour étayer l’évaluation des dangers que posent ces substances. Selon ces études, le Disperse Orange 29 a une CE50 après 72 h de 6 mg/L pour l’algueScenedesmus subspicatus et une CE50 après 48 h de 70 mg/L pour Daphnia magna (tableau 7a). Elles indiquent également dans le cas du Disperse Yellow 23 une CL50 après 48 h supérieure à 1 000 mg/L pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et dans le cas du Disperse Orange 29 une CL50 après 96 h de 480 mg/L pour le poisson zèbre (Brachydanio rerio) [tableau 10b]. La fiabilité de ces études est toutefois considérée comme incertaine en raison de l’absence de certains détails sur leur réalisation (voir l’annexe 1). Néanmoins, il a été jugé que leurs données pouvaient être utilisées dans cette évaluation préalable aux fins de l’établissement du poids de la preuve.
Tableau 7a. Données empiriques sur la toxicité du Disperse Orange 29 pour les organismes aquatiques
| Substance | Organisme d’essai | Type d’essai | Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Disperse Orange 29 | Scenedesmus subspicatus | Toxicité chronique (72 heures) |
CE50[1] | 6 | Présentation de projet, 2008a[3] |
| Daphnia magna | Toxicité aiguë (48 heures) |
CE50 | 70 | ||
| Brachydanio rerio | Toxicité aiguë (96 heures) |
CL50[2] | 480 |
[2] CL50 – La concentration d’une substance estimée létale pour 50 % des organismes d’essai.
[3] Il est indiqué dans l’étude qu’une dispersion à 20 % du colorant a été utilisée pour ces essais de toxicité.
Des données écotoxicologiques additionnelles ont été recensées pour plusieurs analogues du Disperse Orange 29. Une étude présentée au nom de l’ETAD fournit des données sur la toxicité aiguë chez les poissons, les invertébrés, les algues et les bactéries pour cinq colorants azoïques dispersés nitro-substitués (Brown, 1992). La toxicité aiguë chez les poissons-zèbres, Daphnia magna et Scenedesmus subspicatus, pour les cinq analogues variait de 17 à 710 mg/L, 4,5 à 110 mg/L et 6,7 à 54 mg/L, respectivement (tableau 7b). De plus, tous les essais à l’aide de bactéries avaient une CI50 dépassant 100 mg/L. Le protocole expérimental détaillé de l’étude portant sur les colorants testés n’a pas été fourni, ce qui restreint grandement l’évaluation de ces études (Brown, 1992). Toutefois, on a jugé que ces données pouvaient être utilisées et elles sont comprises dans cette ébauche d’évaluation préalable en tant qu’élément du poids de la preuve.
Une autre étude de la toxicité aiguë d’un poisson a été présentée pour l’analogue Disperse Blue 79 (BASF, 1990). Elle a indiqué une CL50 après 96 h entre 100 et 220 mg/L pour l’ide dorée (tableau 7b). Toutefois, sa fiabilité est aussi considérée comme incertaine en raison de l’absence de détails (annexe 1). Une étude sur la toxicité de l’analogue Sudan IV en concentration supérieure à 100 mg/L (MITI, 1992) a également été intégrée au tableau 7b comme contribution aux éléments probants, mais elle n’a pas été retenue dans le choix des valeurs critiques parce que le paramètre n’est pas une valeur finie.
Des données écotoxicologiques sur un autre colorant azoïque dispersé ont été reçues en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(Environnement Canada, 1995). Une étude de la toxicité aiguë d’un poisson soumise afin de satisfaire les exigences en matière de déclaration a révélé que cette substance à une CL50 de 505 mg/L dans la truite arc-en-ciel après 96 heures (tableau 7b). Cet essai a été mené en conformité avec les Lignes directrices de l’OCDE n° 203. La fiche signalétique fournie avec cette déclaration contient également des renseignements sur les effets toxiques chez les bactéries. Les résultats indiquent une CE50 supérieure à 1 000 mg/L pour l’inhibition de la respiration de boues activées. À la lumière des données disponibles sur l’écotoxicité, les effets toxiques de la nouvelle substance pour les organismes aquatiques ont été considérés comme peu préoccupants. La fiabilité de cet essai a été évaluée à l’aide d’un sommaire de rigueur d’études et elle est jugée satisfaisante (annexe 1).
Enfin, une étude présentée sur la toxicité chronique de l’analogue Disperse Blue 79:1 a indiqué une concentration sans effet observé (CSEO) de 122 jours supérieure à 0,0048 mg/L chez la truite arc-en-ciel (tableau 7b). Cette étude a été évaluée et jugée très fiable (annexe 1). Toutefois, comme la valeur susmentionnée est un résultat non lié (seuil d’effet incertain), elle n’a pas été utilisée pour calculer la concentration estimée sans effet. À la lumière de toute l’information sur la toxicité des analogues structuraux et compte tenu des données sur la toxicité du Disperse Yellow 23 et du Disperse Orange 29, il y a lieu de croire que le Disperse Orange 29 n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (valeurs de la CL50 aiguë supérieures à 1 mg/L).
Tableau 7b. Données empiriques sur la toxicité pour les analogues du Disperse Orange 29
| Nom usuel ou n° CAS |
Organisme d’essai | Gravité (durée) |
Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |
Oncorynchus mykiss | Aiguë (48 heures) |
CL50[1] | > 1 000 | Présentation de projet, 2008b |
| Sudan IV (85-83-6) |
Oryzias latipes | Aiguë (48 heures) |
CL50[1] | > 100 | MITI, 1992 |
| Disperse Blue 79[2] (12239-34-8) |
Ide dorée | Aiguë (96 heures) |
CL50[1] | 100 < CL50 < 220 | BASF, 1990 |
| Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 340 | Brown, 1992 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50[3] | 4,5[*] | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | 9,5 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50[4] | > 100 | ||
| Disperse Red 73[5] (16889-10-4) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 17 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50 | 23 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | > 10 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Disperse Orange 30[6] (5261-31-4) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 710 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50[2] | 5,8 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | 6,7 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Disperse Orange 25[7] (31482-56-1) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CI50 | 268 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CL50 | 110 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |
CE50 | 54 | ||
| Bactérie | Non disponible | CE50 | > 100 | ||
| Disperse Red 17[8] (3179-89-3) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 103 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50 | 98 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |
CE50 | 7 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Colorant azoïque dispersé analogue (n° CAS confidentiel) |
Truite arc-en-ciel | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 505 | Environnement Canada, 1995 |
| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |
Truite arc-en-ciel | Chronique 122 jours |
CSEO[9] | > 0,0048 | Cohle et Mihalik, 1991 |
[2] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans le test (en tant que matière organique) avait une pureté de 76 % et une dispersion du colorant à 20 %.
[3] CE50 - La concentration d’une substance qui est jugée causer un effet sublétal toxique chez 50 % des organismes d’essai.
[4] CI50 - Concentration inhibitrice pour un pourcentage donné d’un effet. Estimation ponctuelle de la concentration d’une substance d’essai causant une réduction de 50 % d’une mesure biologique quantitative comme le taux de croissance.
[5] L’étude indique que la pureté du Disperse Red 73 utilisé dans le test était de 96 6 %.
[6] L’étude indique que le Disperse Orange 30 utilisé dans le test (en tant que matière organique) avait une pureté de 73 % et une dispersion du colorant à 20 %.
[7] L’étude indique que la pureté du Disperse Orange 25 utilisé dans le test était de 94 %.
[8] L’étude indique que la pureté du Disperse Red 17 utilisé dans le test était de 98,8 %.
[9] CSEO - La concentration sans effet observé est la concentration la plus élevée, au cours d’un essai sur la toxicité, à laquelle on n’obtient pas d’effet statistiquement significatif, par comparaison aux témoins.
[*] La valeur critique de toxicité utilisée pour calculer une concentration estimée sans effet.
En général, en raison de leur faible solubilité (c’est-à-dire < 1 mg/L), les colorants dispersés sont supposés avoir un impact écologique faiblement aigu (Hunger, 2003). Les résultats des études empiriques sur la toxicité portant sur le Disperse Orange 29 et ses analogues concordent avec ces prévisions, indiquant pour le poisson des valeurs CL50 comprises entre 17 et 505 mg/L, laDaphnia étant l’organisme testé le plus sensible (CE50/CL50 allant de 4,5 à 110 mg/L). La valeur critique sélectionnée pour calculer une concentration estimée sans effet était la CE50 chez Daphnia magna, soit 4,5 mg/L (Brown, 1992).
L’interprétation des résultats de ces essais est compliquée par le fait que certaines des valeurs obtenues (c.-à-d. CE50 et CL50) sont supérieures à la solubilité indiquée pour les substances d’essai. En effet, certaines des concentrations figurant aux tableaux 7a et 7b pourraient représenter la charge de la substance d’essai. Ainsi, le sous-ensemble des valeurs de CE50 et CL50réelles pourrait être inférieur aux concentrations indiquées, car la concentration réellement dissoute dans l’eau pouvant entraîner un effet est inconnue. Dans d’autres cas (voir les notes au bas du tableau 7b), les substances d’essai se trouvaient sous forme de préparations et n’étaient donc pas pures à 100 %. Par conséquent, d’autres produits chimiques dans la préparation pourraient avoir accru la solubilité dans l’eau et la pureté de certains analogues. Les données expérimentales et sur les analogues disponibles indiquent vraiment que la toxicité du Disperse Orange 29 est sans doute faible.
Des prévisions de la toxicité du Disperse Orange 29 pour les organismes aquatiques ont aussi été obtenues à l’aide de modèles RQSA. Toutefois, tout comme pour la bioaccumulation, les estimations de l’écotoxicité fondées sur des RQSA de ces substances ne sont pas jugées fiables à cause de l’erreur pouvant être associée aux paramètres d’entrée des modèles et de la nature particulière des colorants dispersés − état physique, caractéristiques structurales et/ou propriétés physiques et chimiques hors du domaine d’applicabilité des modèles.
Les données empiriques disponibles sur l’écotoxicité du Disperse Orange 29 et de ses analogues permettent de croire que cette substance n’est probablement pas très dangereuse pour les organismes aquatiques.
B – Dans d’autres milieux naturels
On n’a trouvé aucune étude concernant les effets du Disperse Orange 29 sur l’environnement dans d’autres milieux que l’eau. Cette substance pourrait cependant se retrouver dans le sol ou les sédiments après son rejet dans le milieu aquatique l’élimination dans un site d’enfouissement de boues usées provenant d’usines de traitement des eaux usées, l’élimination de produits contenant cette substance ou l’application de biosolides sur les sols. Il serait donc souhaitable d’obtenir des données sur sa toxicité pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments.
Ceci étant dit, le potentiel de toxicité de cette substance est probablement faible pour les espèces vivant des le sol ou les sédiments, étant donné son faible potentiel de bioaccumulation et ses propriétés physiques et chimiques. Toutefois, cette hypothèse ne peut être confirmée en raison du manque de données pertinentes sur la toxicité de cette substance chez des organismes entiers.
Évaluation de l’exposition écologique
Aucune donnée sur les concentrations de Disperse Orange 29 dans l’eau au Canada n’a été retracée. Les concentrations dans l’environnement sont donc estimées à partir des renseignements disponibles, comme les quantités de la substance, les estimations des rejets dans l’environnement et les caractéristiques des plans d’eau récepteurs.
L’outil de débit massique a été utilisé pour prévoir des rejets vers les eaux (égouts) en se basant sur l’utilisation de produits de formulation et l’utilisation par les consommateurs de produits contenant cette substance.
A – Rejets industriels
On s’attend à une exposition aquatique au Disperse Orange 29 si cette substance est rejetée après une utilisation industrielle vers une usine de traitement des eaux usées et que les effluents de cette usine sont envoyés vers des eaux réceptrices. La concentration de cette substance dans les eaux réceptrices près du point de rejet de l’usine de traitement des eaux usées est utilisée comme la concentration environnementale estimée (CEE) dans l’évaluation du risque présenté par cette substance en milieu aquatique. On peut la calculer à l’aide de l’équation
Ceau-ind = [1000 × Q × L × (1 - R)] / [N × F × D]
où
Ceau-ind : concentration en milieu aquatique due aux rejets industriels, en mg/L
Q : quantité de substance totale utilisée chaque année sur un site industriel, en kg/an
L : pertes dans les eaux usées, fraction
R : taux d’élimination de l’usine de traitement des eaux usées, fraction
N : nombre de jours de rejets annuels, en jour/an
F : débit de l’effluent de l’usine de traitement des eaux usées, en m3/jour
D : facteur de dilution dans l’eau réceptrice, sans dimension
Un scénario prudent concernant les rejets industriels est utilisé pour évaluer la concentration du Disperse Orange 29 dans l’eau comme colorant dans la fabrication de produits textiles, à l’aide du modèle Industrial Generic Exposure Tool − Aquatic (IGETA) d’Environnement Canada (2009). Le scénario est rendu prudent en assumant que la quantité totale de cette substance utilisée par l’industrie au Canada est utilisée par une seule installation industrielle sur un petit site hypothétique. Un tel petit site est retenu afin d’avoir un débit d’effluent au 10e centile (3 456 m3/jour) des taux de rejet des usines de traitement des eaux usées au Canada. Ce scénario suppose également que le rejet a lieu 150 jours par année, car les colorants textiles sont utilisés en très faibles quantités et appliqués en fonction de la spécialité. De plus, on suppose que 16 % (c.-à-d. une perte de 14 % du colorant non fixé et une perte de 2 % du transfert et du nettoyage des bassins) est perdu pendant les activités industrielles, dont un taux d’élimination primaire de 60 % à l’usine de traitement des eaux usées, dans un cours d’eau récepteur relativement petit ayant une capacité de dilution de 10.
Pour les hypothèses susmentionnées, le modèle IGETA a indiqué une concentration dans l’eau de 0,0247mg/L (Environnement Canada, 2010b). Ces valeurs des CEE représentent le niveau d’exposition dans les eaux réceptrices près du point de rejet de l’usine de traitement des eaux usées sur chaque site.
B – Rejets par les consommateurs
L’outil Mega Flush d’Environnement Canada qui sert à estimer les rejets à l’égout issus d’utilisations par les consommateurs a été utilisé pour estimer la concentration possible de la substance dans différents cours d’eau récepteurs d’effluents issus des usines de traitement des eaux usées dans lesquelles ont été rejetés par les consommateurs des produits contenant cette substance (Environnement Canada, 2008c). Le tableur fournit ces estimations pour environ 1 000 sites de rejet dans tout le Canada, et ce, d’après des hypothèses prudentes.
Ces dernières incluent :
- pertes dans les égouts à 100 %;
- taux d’élimination des usines de traitement des eaux usées de 0,0 %;
- nombre de jours de rejets annuels de 365 jours/an;
- facteur de dilution dans l’eau réceptrice sur une échelle de 1 à 10.
Le scénario des rejets des consommateurs était fondé sur des quantités maximales importées de 2 000 kg de Disperse Orange 29 d’après le plus récent sondage (c.-à-d., 2 000 kg). Seule la quantité restant après la fabrication des articles au Canada (c.-à-d. après la prise en compte de la perte de 16 % à l’étape du traitement industriel) a été considérée. Ont également été comptabilisées les quantités potentiellement présentes dans les textiles au Canada d’après le rapport 30/70 entre les textiles fabriqués au Canada et les textiles importés (Industrie Canada, 2008b). La quantité totale considérée dans le scénario des utilisations des consommateurs de Disperse Orange 29 pour les colorants textiles était donc de 5 628 kg. Une perte potentielle donnant lieu à des rejets annuels dans l’eau (perte dans les égouts lors du lavage des articles fabriqués contenant ces colorants) de 10 % des colorants textiles a été prévue (EPA du Danemark, 1999). Le modèle Mega Flush a indiqué une CEE maximale de 8,6 x 10-4 mg/L (Environnement Canada, 2010c), en considérant le 10e centile du débit pour tous les cours d’eau.
Caractérisation du risque écologique
La démarche utilisée pour cette évaluation écologique préalable examinait les renseignements scientifiques disponibles et dégageait des conclusions en appliquant la méthode du poids de la preuve et une approche préventive conformément à la LCPE (1999).
Si l’on se fonde sur les propriétés physiques et chimiques de substances analogues, le Disperse Orange 29 devrait se dégrader lentement en milieu aérobie et devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance devrait présenter un faible potentiel de bioaccumulation. Bien que la proportion de Disperse Orange 29 qui devrait être rejetée dans les égouts soit assez élevée (14,8 %), les faibles quantités importées de ce colorant au Canada ainsi que les données sur leurs propriétés physiques et chimiques et ses utilisations indiquent, dans l’ensemble, un faible potentiel de rejet dans l’environnement canadien. Si elle est rejetée dans l’environnement, on s’attend à ce que cette substance soit principalement déversée dans les eaux de surface où elle devrait finir par se déposer dans les sédiments. L’utilisation de données expérimentales et déduites à partir d’analogues a permis de démontrer que le Disperse Orange 29 présente seulement un potentiel moyen de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.
La concentration estimée sans effet (CESE) a été évaluée en se fondant sur la CE50 de 48 h de 4,5 mg/L chez laDaphnia magna pour un analogue du Disperse Blue 79 (tableau 7b). On a ensuite appliqué un facteur de 100 pour tenir compte de la toxicité aiguë à la toxicité chronique et des extrapolations au terrain des résultats en laboratoire et de l’utilisation d’une substance de remplacement. La CESE ainsi obtenue est de 0,045 mg/L.
Une analyse du quotient de risque, mettant en relation une CEE prudente avec une estimation prudente du potentiel d’effets nocifs ou une CESE, a été effectuée pour le milieu aquatique. Le quotient de risque (CEE/CESE) qui en découle est un élément de preuve important à considérer dans l’évaluation du risque pour l’environnement.
Quand on le compare à la CEE calculée ci-dessus pour les rejets industriels dans l’eau passant par une installation de traitement des eaux usées (0,0147 mg/L), le quotient de risque résultant (CEE/CESE) est de 0,0247/0,045 = 0,55. Par conséquent, il est estimé que la concentration de Disperse Orange 29 dans les eaux de surface au Canada qui résulteraient des rejets industriels passant par une installation de traitement primaire des eaux usées ne devrait pas être nocive pour les organismes aquatiques.
Concernant l’exposition attribuable aux rejets à l’égout issus d’utilisations par les consommateurs (scénario prudent), il est estimé d’après les résultats de Mega Flush que la CEE pour le Disperse Orange 29 ne dépassera pas la CESE quel que soit le site (c.-à-d. que tous les quotients de risque sont < 1). Le quotient de risque maximal calculé à partir de la CEE la plus élevée (8,6 x 10-4 mg/L) divisé par la CESE (0,045 mg/L) est de 0,019. Cela montre que les rejets des consommateurs dans le réseau d’égouts de Disperse Orange 29 ne devraient pas être nocifs pour les organismes aquatiques.
Par conséquent, il est peu probable que le Disperse Orange 29 soit nocif pour des populations d’organismes aquatiques au Canada.
Incertitudes dans l’évaluation des risques pour l’environnement
L’évaluation de la persistance est limitée par le manque de données sur la biodégradation, ce qui a nécessité la production de prévisions modélisées. Bien que toutes les prévisions modélisées comportent un certain degré d’erreur, les résultats du modèle de biodégradation aérobie ont confirmé la persistance attendue du Disperse Orange 29, compte tenu de ses utilisations et de ses caractéristiques structurales. De plus, l’évaluation de la persistance est limitée par les incertitudes quant à la vitesse de dégradation et à la mesure dans laquelle cette dégradation se produit dans des sédiments anaérobies ainsi qu’à la détermination de la biodisponibilité des produits de dégradation (p. ex. amines). On prévoit que les produits de dégradation seront peu biodisponibles étant donné qu’ils se forment seulement dans des sédiments anoxiques relativement profonds, mais la possibilité de perturbation de ces sédiments demeure. Ce point constitue donc une source d’incertitude dans l’évaluation de la toxicité du Disperse Orange 29.
L’évaluation de la bioaccumulation de cette substance a été limitée par le manque de données empiriques sur le Disperse Orange 29 et l’incapacité des modèles disponibles à estimer de façon fiable la bioaccumulation de colorants azoïques. L’évaluation était plutôt fondée sur l’utilisation de données sur la bioaccumulation pour un analogue structural (Disperse Orange 30).
Il existe également des incertitudes en raison de l’absence de données sur les concentrations de Disperse Orange 29 dans l’environnement au Canada. Cependant, l’absence de rapports sur la fabrication au Canada, les faibles quantités importées, le degré de fixation relativement élevé de ces colorants sur les textiles et le taux d’élimination prévu dans les effluents permettent de croire à un faible potentiel de rejet de ces substances dans les milieux aquatiques au Canada.
La fraction de la substance qui est rejetée et celle qui est éliminée dans les stations d’épuration des eaux usées constituent une autre source d’incertitude. Ces incertitudes ont été étudiées par l’utilisation d’hypothèses prudentes dans la modélisation de l’exposition.
Les concentrations expérimentales, associées à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, peuvent constituer une source additionnelle d’incertitude lorsqu’elles dépassent la solubilité du produit chimique dans l’eau (expérimentale ou prédite). Il existe également des incertitudes relativement à la pureté des substances utilisées dans les tests de solubilité et de toxicité. En raison de leur faible solubilité, les colorants sont souvent mélangés avec de l’eau et un agent solubilisant afin d’effectuer le test. Cette convention peut produire des valeurs de solubilité qui sont artificiellement élevées et qui peuvent également influer sur les résultats des tests de toxicité sur les organismes aquatiques. Toutefois, des mesures visant à rendre les colorants plus solubles peuvent augmenter artificiellement la biodisponibilité plutôt que de la diminuer. Par conséquent, malgré ces incertitudes, les données disponibles indiquent que le Disperse Orange 29 et ses analogues ne sont pas très dangereux pour les organismes aquatiques dans la colonne d’eau.
De plus, en ce qui concerne l’écotoxicité, le comportement de répartition prévu du Disperse Orange 29 et de ses analogues montre que les données disponibles sur les effets ne permettent pas d’évaluer comme il se doit l’importance du sol et des sédiments comme milieu d’exposition. En effet, les seules données sur les effets qui ont été trouvées s’appliquent principalement aux expositions aquatiques pélagiques, même si la colonne d’eau peut ne pas être le moyen le plus préoccupant à long terme d’après les estimations sur la répartition et les modèles de rejets.
Étant donné que la substance est utilisée dans d’autres pays, il est possible qu’elle entre sur le marché canadien comme composant d’articles manufacturés ou de produits de consommation. Les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête menée en vertu de l’article 71 et d’autres sources de renseignements indiquent qu’elle est peut-être présente dans un certain nombre de ces produits au Canada. Les renseignements disponibles ne sont actuellement pas suffisants pour donner une estimation quantitative permettant de définir l’importance de cette source dans l’évaluation écologique. Cependant, on prévoit que les volumes de rejets de Disperse Orange 29 dans les divers milieux naturels ne différeraient pas énormément des quantités estimées ici, bien que les quantités transférées vers le recyclage ou l’élimination des déchets puissent être supérieures. On reconnaît également la possibilité que des rejets proviennent des sites d’enfouissement, bien qu’ils soient difficiles à quantifier en raison du manque de données, et qu’ils contribuent à des concentrations environnementales globales.
Évaluation de l’exposition
Aucune donnée n’a été relevée sur le Disperse Orange 29 dans les milieux naturels. Les concentrations estimées dans l’environnement produites à l’aide de la version 6 du logiciel ChemCAN (ChemCAN, 2003) étaient fondées sur les pourcentages de pertes prévus par l’outil de débit massique tels qu’ils figurent au tableau 4 (Environnement Canada, 2010a). Les pourcentages ont été appliqués à la quantité totale de 2 000 kg de Disperse Orange 29 dans le commerce au Canada en 2006 (Environnement Canada, 2008a). Les quantités de pertes sont estimées à 296 kg pour les pertes dans l’eau à partir des eaux usées, à 0 kg pour les pertes dans l’air à partir des émissions atmosphériques, et à 0 kg dans le sol à partir des pertes vers les terres. La tranche supérieure des estimations de l’absorption de Disperse Orange qui en résulte pour chaque groupe d’âge de la population générale au Canada devrait être négligeable pour tous les milieux naturels.
Le Disperse Orange 29 est principalement utilisé dans le secteur du textile et du tissage pour teindre ou imprimer des tissus, des textiles et des vêtements comme les polyesters et les polyamides. Les colorants dispersés tirent leur nom du processus de teinture utilisé (EPA du Danemark, 1999). En raison de leur faible solubilité dans l’eau, les composés de colorant sont traditionnellement moulus en vue d’obtenir une fine poudre qui est ensuite dispersée dans de l’eau.
Les vêtements fabriqués à partir de tissu teint au Disperse Orange 29 sont une source d’exposition potentielle de la population générale. Les nourrissons et les tout-petits pourraient aussi être exposés par la voie orale en mâchonnant du tissu contenant ce colorant. La tranche supérieure des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée est présentée à l’annexe 3. Les détails des hypothèses utilisées dans ces estimations de l’exposition sont indiqués à l’annexe 4. L’exposition cutanée a été évaluée entre 0,1 et 2 µg/kg p.c. par jour pour les adultes et entre 0,2 et 4 µg/kg p.c. par jour pour les nourrissons de 0 à 6 mois à un taux de lessivage évalué entre 0,03 % et 0,5 % (ETAD, 2004; Kraetke et Platzek, 2005). La plage du taux de lessivage représente un nouveau vêtement non lavé qui possède des propriétés de solidité de la couleur de bonnes à faibles (ETAD, 1997). L’exposition des nourrissons et des tout-petits (âgés de 6 mois à 4 ans) au Disperse Orange 29 devrait en outre avoir une composante orale, attribuable au mâchonnement; elle est estimée à 0,1 µg/kg p.c. par jour. Ces estimations représentent les expositions aux limites supérieures, car les colorants devraient être lessivés du tissu principalement pendant le lavage. De plus, une récente étude a comparé la migration d’un colorant dispersé d’un vêtement vers la peau de volontaires humains avec sa migration d’un vêtement vers un produit simulant de la sueur. Une étude récente a déterminé que la quantité de colorant dispersé migrant sur la peau de volontaires humains était jusqu’à 600 fois plus faible que celle émise par les stimulants sudorifiques (Meinke et al., 2009). Dans l’ensemble, cela confirme la nature prudente de la tranche supérieure des estimations de l’exposition.
Évaluation des effets sur la santé
Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’a été relevée pour le Disperse Orange 29 et aucun colorant azoïque dispersé analogue apparenté sur lequel on aurait disposé de données concernant la santé n’a été relevé. Par conséquent, le profil toxicologique du Disperse Orange 29 est principalement fondé sur les données relatives aux produits potentiels de rupture des liaisons azoïques et la prise en compte des résultats de modèles de relations quantitatives structure-activité (RQSA).
Étant donné que le Disperse Orange 29 est un membre de la famille des colorants azoïques, les données sur la classe azoïque des substances ont été considérées dans la présente évaluation. Il a été démontré que les colorants azoïques peuvent subir une rupture réductrice par des enzymes azoréductase présents dans les tissus mammaires et dans les bactéries de l’intestin et de la peau (p. ex., Golka et al., 2004; Platzek, 1999; Chen, 2006; Stingley et al., 2010). Même s’il est reconnu que le degré de réduction azoïque est susceptible d’être influencé par divers facteurs (p. ex. la solubilité du composé d’origine, présence ou position des substituants moléculaires), les données relatives aux effets sur la santé sur des produits potentiels de rupture des liaisons azoïques sont considérées comme pertinentes pour la caractérisation des effets sur la santé du composé d’origine, car l’exposition au colorant azoïque peut entraîner une exposition à ses produits apparentés de rupture des liaisons azoïques, habituellement des amines aromatiques. D’après le potentiel du Disperse Orange 29 à subir une rupture de ses liaisons azoïques, des données utiles sur les produits potentiels issus de cette rupture sont aussi considérées dans la présente évaluation : 4-aminophénol (n° CAS 123-30-8), 2,5-diaminoanisole (n° CAS 5307-02-8), et 4-nitroaniline (n° CAS 100-01-6) (voir le tableau 8 pour connaître leurs structures et le type de données disponibles). Des évaluations et des profils de toxicité internationaux des produits potentiels susmentionnés résultant de la rupture des liaisons azoïques ont été pris en compte dans l’établissement de la base de données concernant les effets du Disperse Orange 29 sur la santé. Un sommaire de ces données est présenté ci-dessous.
Tableau 8. Structure chimique du Disperse Orange 29 et possibles produits de rupture des liaisons azoïques pris en compte dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
| Identification de la substance | Structure | Données considérées/disponibles |
|---|---|---|
| Disperse Orange 29 | ||
| Disperse Orange 29 CI 26077 N° CAS 19800-42-1 |
 |
RQSA |
| Possibles produits de rupture des liaisons azoïques | ||
| 4-nitroaniline N° CAS 100-01-6 |
 |
RQSA Bioessais de deux ans chez les rats et les souris Étude de la reproduction et du développement des rats et des souris Test d’Ames |
| 4-aminophénol N° CAS 123-30-8 |
RQSA Ensemble de données IUCLID (IUCLID, 2000) Essai sur des lymphomes de souris Essai du micronoyau in vivo Tests d’Ames Étude orale de six mois chez les rats Étude de la reproduction et du développement chez les rats |
|
| 2,5-diaminoanisole N° CAS 5307-02-8 |
 |
RQSA Test d’Ames Essai létal dominant chez les rats Données d’analogues sur l’isomère (2,5-diaminoanisole) |
La Commission européenne a classé le 4-aminophénol (n° CAS 123-30-8) parmi les mutagènes conformément à la directive du CLP[2] (Commission européenne, 2008; ESIS, 2010). L’analyse de mutation du lymphome de la souris a donné des résultats positifs (Majeska et Holden, 1995). Le 4-aminophénol a induit un accroissement du nombre d’hépatocytes micronucléés lorsqu’il a été administré par voie intrapéritonéale (IP) à des souris (Cliet et al., 1989). De plus, l’administration par voie IP à des souris a entraîné la formation de micronoyaux dans la moelle osseuse (Wildet al., 1981). Cependant, le 4-aminophénol n’a pas induit d’augmentation de la formation de micronoyaux dans la moelle osseusse lorsqu’il a été administré par voie orale à des souris (Wild et al., 1981). Des tests in vitro de mutagénicité dans les bactéries étaient principalement négatifs (Zeiger et al., 1988). Le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) a conclu que la substance 4-aminophénol était génotoxique in vivo etin vitro (CSPC, 2005). On ne dispose d’aucune donnée empirique permettant d’évaluer la cancérogénicité du 4-aminophénol. La substance 4-aminophénol a eu des effets sur des tubes contournés proximaux rénaux dans un modèle in vitro (Lock et al., 1993) et a eu des effets sur les reins (néphropathie) chez les rats ayant reçu une dose élevée de 0,07, 0,2 ou 0,7 % dans leur alimentation pendant six mois (Burnett et al., 1989). Une récente étude portrait sur la toxicité du 4-aminophénol sur la reproduction et le développement dans des groupes de 12 rats à qui l’on administrait 0, 20, 100 ou 500 mg/kg p.c. par jour par gavage. Chez les femelles, l’exposition débutait 14 jours avant l’accouplement et se poursuivait jusqu’au troisième jour de lactation. Les mâles recevaient des doses pendant une période de 49 jours qui débutait 14 jours avant l’accouplement. Parmi ceux qui ont reçu une dose élevée, quatre mâles et deux femelles sont décédés et ceux qui ont survécu avaient une urine brune à 100 mg/kg p.c. par jour et plus. Le gain de poids et la consommation de nourriture ont diminué à 500 mg/kg p.c. par jour. À dose élevée, les effets sur l’appareil reproducteur des mâles et sur les fœtus en développement étaient évidents. Dans cette étude, les auteurs ont constaté une dose sans effet nocif observé (DSENO) sur la reproduction ou le développement de 100 mg/kg p.c. par jour (Harada et al., 2008).
Un test de mutagénicité inverse de la substance 2,5-diaminoanisole (n° CAS 5307-02-8) a été positif dans des tests d’Ames standards sur des souches de Salmonella typhimurium TA98 et TA100 avec et sans activation S9 (Degawaet al., 1979; Koovi et al., 1987; Esancy et al., 1990), dans TA1538 avec activation S9 (Ames et al., 1975; White et al., 1977; Robertson et al., 1983), et dans TA100 avec un système d’activation modifié dans lequel était utilisée une cyclo-oxygénase H purifiée (Sarkar et al., 1992). Cette substance a également causé des fractions de l’ADN en simple brin dans des lymphocytes de peau humaine cultivée sans activation métabolique, ce qui indique une interaction directe avec l’ADN (Nordenskjoldet al., 1984), et a induit une synthèse imprévue de l’ADN dans les hépatocytes primaires de rats (Bradlaw et al., 1981). Toutefois, la mutagénicité du 2,5-diaminoanisole était négative au locus TK des cellules de lymphomes de souris (L5781Y) avec et sans activation S9 (Palmer et al., 1978). Elle était également négative dans le test létal dominant chez les rats (Sheu et Green, 1979). Il n’existe aucune donnée empirique permettant d’évaluer la cancérogénicité du 2,5-diaminoanisole. Dans une étude de l’administration périodique, l’isomère structural du 2,5-diaminoanisole et du 2,4-diaminoanisole (n° CAS 615-05-4) était positif pour la cancérogénicité chez les souris et les rats des deux sexes (NTP, 1978) et pour le National Toxicology Program, il est « raisonnablement considéré comme un agent cancérogène pour les humains » (NTP, 2005). De plus, la Commission européenne a classé l’isomère 2,4- comme cancérogène et mutagène dans son règlement CLP (Commission européenne, 2008), comme agent cancérogène 2B du CIRC (CIRC, 2001) et il est réglementé en Europe dans le cadre du programme REACH parmi les 22 amines aromatiques libérés des colorants diazoïques qui pourraient ne pas se trouver dans certains articles textiles ou de cuir (Commission européenne, 2006). L’utilisation du diaminoanisole 2,5- et 2,4-, ainsi que de leurs sels, a été interdite dans les cosmétiques en vertu de la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques (Santé Canada, 2009) et de l’Annexe II de la Directive européenne sur les cosmétiques (Commission européenne, 2010).
Le test de mutagénicité de la substance 4-nitroaniline (n° CAS 100-01-6) a été positif dans certains essais bactériologiques in vitro, mais pas dans les autres (ACGIH, 1991). Un activateur S9 dérivé du foie de hamster rendait la 4-nitroaniline plus mutagène que celui dérivé du foie de rat dans les essais de mutation inverse sur bactéries (ACGIH, 1991). La cancérogénicité et la toxicité sur le plan de la reproduction se sont également révélées nulles pour la 4-nitroaniline d’après une étude sur l’exposition des rats par voie orale (Nair et al., 1990. Chez les souris, des hémangiosarcomes ont été observés, et étaient considérés comme une preuve équivoque de cancérogénicité (CCRIS, 2009). La 4-nitroaniline induit de la méthémoglobine chez les humains, ce qui peut mener à l’anoxie et à l’hémolyse si l’exposition est suffisamment élevée ou prolongée. Des effets nocifs sur le foie ont également été constatés chez les humains (ACGIH, 1991).
Dans une récente étude, un mélange renfermant du 4-aminophénol, de la 4-nitroaniline et un autre composé (du 4-nitrophénol) a été administré par voie gastrique à des rats mâles et femelles, cela en doses de 5, 25 ou 50 mg/kg p.c. par jour pendant 4 semaines. Des différences significatives ont été observées entre les témoins et les animaux ayant reçu des doses de 25 ou 50 mg/kg p.c. par jour au plan de la prise de poids corporel (p < 0,05 pour les femelles). Les paramètres biochimiques (SGPT, SGOT, GTP, urée, cholestérol total, protéines totales, albumine et créatinine) avaient tous connu une hausse significative chez les animaux traités à 50 mg/kg p.c. par jour. Le nombre d’érythrocytes, de leucocytes et de réticulocytes ainsi que la teneur en hémoglobine étaient significativement accrus chez le groupe traité à la plus forte dose, comparativement aux témoins. Les concentrations de méthémoglobine avaient subi une hausse importante au bout de 3 semaines de traitement chez les sujets exposés à 50 mg/kg p.c. par jour, et au bout de 4 semaines chez les animaux exposés à 25 ou à 50 mg/kg p.c. par jour. On a observé des lésions au niveau du foie, des reins, de la rate, du cervelet et du système hématopoïétique (Zhang et Wang, 2009).
Les prévisions tirées des modèles de relation quantitative structure-activité (RQSA) (CASETOX, DEREK, TOPKAT) sur la génotoxicité et la cancérogénicité du Disperse Orange 29 ont également été considérées dans la présente évaluation. Les prévisions relatives au cancer d’après le modèle DEREK étaient positives. Toutefois, les prévisions tirées du modèle CASETOX étaient en grande partie non concluantes. Les résultats du modèle TOPKAT étaient équivoques. Pour les modèles de génotoxicité, le modèle DEREK prédisait que le Disperse Orange 29 serait positif dans le test d’Ames et était non concluant dans un modèle d’aberration chromosomique. CASETOX a prédit un résultat négatif dans le test d’Ames, un résultat positif dans le test d’aberration chromosomique, était négatif pour l’induction du micronoyau, et non concluant dans un modèle d’étude de la mutation du lymphome chez les souris. TOPKAT a été non concluant pour la mutagénicité in vitro. Les résultats des prévisions des modèles pour le Disperse Orange 29 et ses produits potentiels de rupture des liaisons azoïques sont présentés à l’annexe 6.
Caractérisation du risque pour la santé humaine
On ne dispose d’aucune donnée empirique sur la santé pour le Disperse Orange 29.
Cette substance appartient au groupe des substances azoïques qui peuvent rejeter des amines aromatiques par rupture réductrice de la liaison azoïque. Bien qu’aucune donnée chimique sur la réduction des liaisons azoïques du Disperse Orange 29 n’ait été relevée, une hypothèse prudente a été de supposer le rejet potentiel d’amines aromatiques après une exposition de cette substance. Comme une cancérogénicité et une génotoxicité sont souvent associées aux amines aromatiques, on a considéré ces paramètres comme étant les effets critiques qui pourraient découler de l’exposition au Disperse Orange 29. Par conséquent, les données relatives aux effets sur la santé des amines aromatique pouvant être libérées du Disperse Orange 29 ont été prises en compte. L’Union européenne a classé la substance 4-aminophénol comme mutagène (ESIS, 2010). De plus, des tests de mutagénicité de la substance 2,5-diaminoanisole ont été positifs, elle comporte une structure similaire à celle du 2,4’-diaminoanisole, ce qui a démontré un potentiel génotoxique et cancérogène (CIRC, 2001; NTP, 2005). Les résultats des tests de mutagénicité de la substance 4-Nitroaniline étaient mixtes. D’après les renseignements sur ces produits potentiels de rupture des liaisons azoïques, on estime que le Disperse Orange 29 peut présenter un danger potentiel.
On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au Disperse Orange 29 provenant des milieux naturels soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 dans ses utilisations comme colorant dans les textiles et les tissus; toutefois, l’exposition cutanée et orale estimée devrait être faible.
Bien qu’on reconnaisse les dangers potentiels du Disperse Orange 29 en raison de la formation possible d’amines aromatiques provenant de la rupture des liaisons azoïques, compte tenu de la faible exposition prévue de la population générale, le risque pour la santé humaine est jugé faible aux niveaux d’exposition actuels.
Incertitudes de l’évaluation des risques pour la santé humaine
La confiance dans la base de données concernant les effets du Disperse Orange 29 sur la santé est considérée comme faible puisqu’on n’a trouvé aucune donnée empirique à ce sujet pour le Disperse Orange 29 ou des colorants azoïques structurels analogues. De plus, comme il n’y a aucune donnée empirique indiquant le potentiel de cette substance de subir une rupture réductrice de ses liaisons azoïques, les données examinées sur les métabolites potentiels ne sont peut-être pas nécessairement associées à l’exposition au Disperse Orange 29.
Des incertitudes existent quant à l’évaluation de l’exposition. Les sources d’exposition au Disperse Orange 29 ont été caractérisées principalement comme étant les tissus synthétiques, et des estimations de l’exposition ont été dérivées pour des scénarios prudents comprenant les vêtements, étant donné l’absence de données plus précises sur le profil d’utilisation de la substance. Toutefois, on a confiance que les valeurs d’exposition modélisées présentées dans la présente évaluation surestiment la véritable exposition en raison de la nature prudente des hypothèses émises.
D’après les renseignements contenus dans la présente version finale de l’évaluation préalable, le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, cette substance répond aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Même si le danger potentiel du Disperse Orange 29 est reconnu, d’après un examen global des données disponibles sur les effets sur la santé et la faible exposition prévue de la population générale, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Il est donc conclu que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Par conséquent, il est conclu que le Disperse Orange 29 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Considérations dans le cadre d’un suivi
Le Disperse Orange 29 appartient à un groupe des substances azoïques qui peuvent être métabolisées en amines aromatiques, une classe de composés chimiques connus pour présenter des propriétés dangereuses, notamment une cancérogénicité. Par conséquent, des activités supplémentaires (p. ex., recherche, évaluation, contrôle et surveillance) peuvent être entreprises afin de caractériser le risque présenté par ce vaste groupe de substances azoïques pour la santé humaine au Canada. Un avis d’intention décrivant la façon dont Santé Canada et Environnement Canada étudieront ce groupe de substances se trouve à l’adresse Internet des Substances chimiques.
ACD/pKaDB [module de prévision]. 2005. Version 9.04. Toronto (Ont.) : Advanced Chemistry Development. [réserve de consultation].
[ACGIH] American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. 1991. Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. 6th ed. Volumes I, II, III. Cincinnati (OH) : ACGIH, p. 1094.
Ames, B.N., Kammen, H.O., Yamasaki, E. 1975. Hair Dyes Are Mutagenic: Identification of a Variety of Mutagenic Ingredients.Proc. Nat. Acad. Sci. 72(6):2423-2427.
Anliker, R., Clarke, E.A., Moser, P. 1981. Use of the partition coefficient as an indicator of bioaccumulation tendency of dyestuffs in fish. Chemosphere 10(3):263-274.
Anliker, R., Moser, P. 1987. The limits of bioaccumulation of organic pigments in fish: their relation to the partition coefficient and the solubility in water and octanol.Ecotoxicol. and Environ. Safety 13:43-52.
Anliker, R., Moser, P., Poppinger, D. 1988. Bioaccumulation of dyestuffs and organic pigments in fish. Relationships to hydrophobicity and steric factors. Chemosphere17(8):1631-1644.
Arnot, J.A., Arnot, M., Mackay, D., Couillard, Y., MacDonald, D., Bonnell, M., Doyle, P. 2010. Molecular size cut-off criteria for screening bioaccumulation potential: Fact or fiction?Integrated Environmental Assessment and Management6(2):210-224.
Aronson, D., Boethling, B., Howard, P., Stiteler, W. 2006. Estimating biodegradation half-lives for use in chemical screening.Chemosphere 63:1953-1960.
BASF. 1990. Bericht uber die Prufung der akuten Toxizitit an der Goldorfe (Leuciscus idus L.,. Goldvariante). Présenté par ETAD à Environnement Canada le 13 août 2008 par courriel.
Baughman, G.L., Perenich, T.A. 1988. Fate of dyes in aquatic systems: I. Solubility and partitioning of some hydrophobic dyes and related compounds. Environ. Toxicol. Chem.7(3):183-199.
Baughman, G.L., Weber, E.J. 1994. Transformation of dyes and related compounds in anoxic sediment: kinetics and products.Environ. Sci. Technol. 28(2):267-276.
Baughman, G.L., Bannerjee, S., Perenich, T.A. 1996. Dye Solubility. In: Physico-chemical Principles of Color Chemistry. Peters, A.T., Freeman, H.S. (éditeurs). Advances in Color Chemistry Series, Vol. 4. Glasgow (Écosse) : Blackie Academic and Professional Publishers. p. 145-195.
[BBM] Baseline Bioaccumulation Model. 2008. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. [modèle basé sur celui de Dimitrov et al., 2005]. Document disponible sur demande.
[BIOWIN] Biodegradation Probability Program for Windows [modèle d’estimation]. 2008. Version 4.02. Washington (DC) : US Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics; Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation. Outils d'évaluation de l'exposition et des modèles.
Boethling, R.S., Howard, P.H., Beauman, J.A., Larosche, M.E. 1995. Factors for intermedia extrapolations in biodegradability assessment. Chemosphere 30(4):741-752.
Bradlaw, J.A., Hauswirth, J.W., Thomas, C.A. 1981. Induction of unscheduled DNA synthesis (UDS) in primary rat hepatocytes by some hair dye components. Environ. Mut. 3:398 (extrait de la rencontre).
Braun, H. 1991. A new method for the determination of the solubility of disperse dyes. JSDC 107:77-83.
Brown, D. (ICI Group Environmental Laboratory, Brixham, Royaume-Uni). Environmental assessment of dyestuffs. Rédigé pour le compte de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers, Bâle (Suisse), ETAD ecological sub-committee project E3020, 1992. Présenté à Environnement Canada le 9 mai 2008.
Brown, D. 1987. Effects of colorants in the aquatic environment.Ecotox Environ. Safe 13:139-147.
Burnett, C.M., Ta, R.E., Rodiguez, S., Loehr, R.F., Dressler, W.E. 1989. The toxicity of p-aminophenol in the Sprague-Dawley rat: effects on growth, reproduction and foetal development. Fd. Chem. Toxic. 27(10):691-698.
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C., 1999, ch. 33.
Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107.Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, n° 7.
Canada, Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 49.
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorité pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 9.
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2008a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis de sixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi. Canada Gazette. Partie I, vol. 142, n° 22.
Canada. Ministère de l’Environnement. 2008b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le sixième lot du Défi. Canada Gazette. Partie I, vol. 142, n° 22.
CASETOX [module de prévision]. 2008. Version 2.0. Beachwood (OH) : MultiCASE Inc. CASETOX [réserve de consultation].
[CATABOL] Probabilistic assessment of biodegradability and metabolic pathways [modèle informatique]. c2004-2008. Version 5.10.2. Bourgas (Bulgarie) : Prof. Assen Zlatarov University, Laboratory of Mathematical Chemistry. CATALOGIC.
[CCRIS] Chemical Carcinogenesis Research Information System. 2009. P-Nitroaniline: CASRN: 100-01-6 [consulté en mars 2010].
ChemCAN [modèle de fugacité de niveau III pour 24 régions du Canada]. 2003. Version 6.00. Peterborough (Ont.) : Trent University, Le centre canadien de modélisation et de chimie environnementales [consulté en janvier 2010].
Chen, H. 2006. Recent advances in azo dye degrading enzyme research. Curr. Prot. Pept. Sci. 7:101-111.
[CII] Color Index International [base de données sur Internet]. 2002- . 4e éd. Research Triangle Park (NC) : American Association of Textile Chemists and Colorists. Indice de couleur international [consulté le 3 février 2009].
[CIRC] Centre International de Recherche sur le Cancer. 2001. IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 79: Some Thyrotropic Agents. Résumé des données publiées et les évaluations.
Clariant. 1996. Ensemble de données IUCLID pour le C.I. Disperse Blue 79 (N° CAS 12239-34-8) [base de données sur Internet] [consulté le 28 octobre 2008].
Cliet, I., Fournier, E., Melcion, C., Cordier, A. 1989. In vivo micronucleus test using mouse hepatocytes. Mut Res216:321-326.
Cohle, P., Mihalik, R. 1991. Early life stage toxicity of C.I. Disperse Blue 79:1 purified presscake to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a flow-through system. Rapport final. Columbia (MO) : ABC Laboratories Inc.
Commission européenne. 2006. Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Commission européenne. 2008. Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Commission européenne. 2010. European Commission "Cosmetics Directive" 76/768/EEC (Cosmetics Directive) Base de données des ingrédients et substances.
[ConsExpo] Consumer Exposure Model [en ligne]. 2006. Version 4.1. Bilthoven (Pays-Bas) : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut national néérlandais de la santé publique et de l’environnement). ConsExpo 4.1.
[CPOP] Canadian POPs Model. 2008. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes; Bourgas (Bulgarie) : Prof. Assen Zlatarov University, Laboratory of Mathematical Chemistry. [Modèle élaboré à partir de celui de Mekenyan et al., 2005]. Disponible sur demande.
[CSPC] Comité scientifique des produits de consommation. 2005, SCCP. Opinion sur p-Aminophenol. COLIPA No. A16.
[EPA du Danemark] Danish Environmental Protection Agency. 1999.Enquête sur les colorants azoïques au Danemark. Consumption, use, health and environmental aspects. MiljØprojekt No. 509. Henriette, Danish Technological Institute, Environment, Ministry of Environment and Energy, Denmark, Danish Environmental Protection Agency, 1999. Rapport préparé par Øllgaard, H., Frost L, Galster J, Hansen OC.
Datyner, A. 1978. The solubilisation of disperse dyes by dispersing agents at 127ºC. JSDC June 256-260.
Degawa, M., Shoji, Y., Masuko, K., Hashimoto, Y. 1979. Mutagenicity of metabolites of carcinogenic aminoazo dyes.Cancer Lett. 8(1):71-6.
[DEREK] Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge [module de prévision sur CD-ROM]. 2008. Version 10.0.2. Cambridge (MA) : Harvard University, LHASA Group.. Prédiction de toxicologie [réserve de consultation].
Dimitrov, S, Dimitrova, N., Walker, J., Veith, G., Mekenyan, O. 2002. Predicting bioconcentration potential of highly hydrophobic chemicals. Effect of molecular size. Pure Appl. Chem. 74(10):1823-1830.
Dimitrov, S., Dimitrova, N., Parkerton, T., Comber, M., Bonnell, M., Mekenyan, O. 2005. Base-line model for identifying the bioaccumulation potential of chemicals. SAR QSAR Environ. Res. 16(6):531-554.
Environnement Canada. 1988. Données de la Liste intérieure des substances (LIS), 1984-1986, recueillies en vertu du paragraphe 25(1) de la LCPE (1988), et conformément à la Liste intérieure des substances : guide du déclarant. Données préparées par : Environnement Canada.
Environnement Canada. 1995. NSN submission. Données présentées à la Division des substances nouvelles d’Environnement Canada dans le cadre du Programme de renseignements concernant les substances nouvelles.
Environnement Canada. 2000. Environmental Categorization for Persistence Bioaccumulation and Inherent Toxicity of Substances on the Domestic Substances List Using QSARs. Rapport final. Division de l’évaluation des produits chimiques, Environnement Canada, juillet.
Environnement Canada. 2006. Données pour certaines substances recueillies en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), article 71 : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Données préparées par Environnement Canada, Santé Canada, Programme des substances existantes.
Environnement Canada. 2008a. Données sur les substances du lot 6 recueillies en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le deuxième lot du Défi. Données préparées par Environnement Canada, Programme des substances existantes
Environnement Canada. 2008b. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: Mass Flow Tool. Document de travail préliminaire. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2008c. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: Mega Flush consumer release scenario. Document de travail préliminaire. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2009. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: the Industrial Generic Exposure Tool - Aquatic (IGETA). Document de travail. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2010a. Assumptions, limitations and uncertainties of the Mass Flow Tool for Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1. [consulté le 27 juillet 2010]. Document provisoire interne. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. Document disponible sur demande.
Environnement Canada. 2010b. Rapport IGETA : Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1, version [consulté le 27 juillet 2010]. Rapport inédit. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2010c. Rapport MegaFlush : Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1 [consulté le 27 juillet 2010]. Rapport inédit. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
[EPIsuite] Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows [modèle d’estimation]. 2008. Version 4.0 Washington (DC) : US Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics; Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation. Outils d'évaluation de l'exposition et des modèles.
Esancy, J.F., Freeman, H.S., Claxton, L.D. 1990. The effect of alkoxy substituents on the mutagenicity of some aminoazobenzene dyes and their reductive-cleavage products. Mut. Res. 238:1-22.
[ESIS] European Chemical Substances Information System [base de données sur Internet]. 2008. Version 5. Bureau Européen des Substances Chimiques (BESC). [consultée le 13 février 2009].Système d'information des substances chimiques européenne.
[ESIS] European Chemical Substances Information System [base de données sur Internet]. 2010. Bureau Européen des Substances Chimiques (BESC). CLP/GHS Search of Annex VI [consultée en juin 2010].
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Canadian Affiliates, Dayan, J., Trebitz, H., consultants. 1995. Health and environmental information on dyes used in Canada. Rapport inédit présenté à Environnement Canada, Division des substances nouvelles. En page couverture : An overview to assist in the implementation of the New Substances Notification Regulations under the Canadian Environmental Protection Act.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 1992. Draft Guidelines for the Assessment of Environmental Exposure to Dyestuffs.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 1997. Extractability of dyestuff from textiles over a normal lifetime of use. Mars 1997.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Information received in support of DSL categorization for 12 disperse dyes. Courriel daté du 27 octobre 2005.
Farbchemie Braun, K.G. 2008. Fantagen Disperse Dyes pour polyester [en ligne].
Golka, K., Kopps, S., Myslak, Z.W. 2004. Carcinogenicity of azo colorants: influence of solubility and bioavailabilty. Toxicol. Lett. 151(1):203-210.
Haag, W.R., Mill, T. 1987. Direct and indirect photolysis of water-soluble azodyes: kinetic measurements and structure-activity relationships. Environ. Toxicol. Chem. 6:359-369.
Harada, T., Kimura, E., Hirata-Koizumi, M., Hirose, A., Kamata, E., Ema, M. 2008. Reproductive and developmental toxicity screening study of 4-aminophenol in rats. Drug Chem. Toxicol. 31:473-486.
Hunger, K. (éd). 2003. Industrial dyes; chemistry, properties, applications. Weinheim (Allemagne) : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
Inde. 1997. Ministry of Environment and Forests Notification, Prohibition on the Handling of Azodyes. The Gazette of India Extraordinary. Part II- Sec. 3(ii). Annexure 10. REGD. NO. D.L.-33004/97.
Industrie Canada. 2008a. Réseau des entreprises canadiennes.
Industrie Canada. 2008b. Finissage de textiles et de tissus [SCIAN 31331] : 2004-2007 et Revêtement de tissus [SCIAN 31332] : 2004-2007. Préparé par la Direction de l’habillement et des textiles, Direction générale des industries de services et des produits de consommation (DGISPC), Industrie Canada. Demandes de renseignements : B. John (Jazz) Szabo, 613-957-1242 ou szabo.john@ic.gc.ca.
[IUCLID] International Uniform Chemical Information Database. 2000. IUCLID Dataset: Substance ID: 123-30-8, 4-aminophenol.
Koovi, D.G., Mamane, R., Callais, F., Festy, B., Lich, N.P. 1987. Study on the genotoxicity of 2-amino-5-nitroanisole (ANA) and its metabolites. Ann. Falsif. Expert. Chim. Toxicol. 80(854):25-39.
Kraetke, R.M., Platzek, T. 2005. Exposure to chemicals in clothing textiles: Methods and models. Occupational and Environmental Exposure of Skin to Chemicals.
Lock, E.A., Cross, T.J., Schnellmann, R.G. 1993. Studeis on the mechanisms of 4-aminophenol-induced toxicity to renal proximal tubules. Hum. Exp. Toxicol. 12(5):383-388.
Majeska, J.B., Holden, H.E. 1995. Genotoxic effects of p-aminophenol in Chinese hamster ovary and mouse lymphoma cells: Results of a multiple endpoint test. Environ. Mol. Mutagen. 26:163-170.
Meinke, M., Abdollahnia, M., Gähr, F., Platzek, T., Sterry, W., Lademann, J. 2009. Migration and penetration of a fluorescent textile dye into the skin--in vivo versus in vitro methods. Experimental Dermatology18(9):789-792.
Mekenyan, G., Dimitrov, S.D., Pavlov, T.S., Veith, G.D. 2005. POPs: A QSAR system for creating PBT profiles of chemicals and their metabolites. SAR QSAR Environ. Res.16(1-2):103−133.
[MITI] Ministry of International Trade & Industry (Japon). 1992. Biodegradation and bioaccumulation data of existing chemicals based on the CSCL Japan, Basic Industries Bureau, Chemical Products Safety Division. Japan Chemical Industry Ecology-Toxicology & Information Centre,Tokyo (Japon).
Nair, R.S., Auletta, C.S., Schroeder, R.E., Johannsen, F.R. 1990. Chronic toxicity, oncogenic potential, and reproductive toxicity of p-nitroaniline in rats. Fund Appl Toxicol 15:507-621.
[NCI] National Chemical Inventories [base de données sur cédérom]. 2006. Columbus (OH) : American Chemical Society. [consultée le 11 décembre 2006]. Inventaire nationale des produits chimiques sur CD.
Nishida, K., Ando, Y., Ohwada, K., Mori, T., Koide, M., Koukitsu, A. 1989. Vapour pressures and heats of sublimation of some azo disperse dyes. JSDC 105:112-114.
Nordenskjold, M., Andersson, B., Rahimtula, A., Moldeus, P. 1984. Prostaglandin synthase-catalyzed metabolic activation of some aromatic amines to genotoxic products. Mut. Res.127:107-112.
Norris, B., Smith, S. 2002. Les recherches des enfants jusqu'à 5 ans sur le comportement de mettre des objects dans leur bouche. Rapport commandé par Consumer and Competition Policy Directorate, UK Department of Trade and Industry, Londres (Royaume-Uni).
[NTP] United States National Toxicology Program. 1978. Rapport de toxicologie TR-84 : Essais biologiques du sulfate de 2,4-diaminoanisole pour cancérogénicité possible (CASRN 615-05-4).
[NTP] United States National Toxicology Program. 2005. 11th Report on Carcinogens (RoC): 2,4-Diaminoanisole Sulfate (CAS RN 615-05-4).
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 1996. Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, n° 305B. Bioconcentration : Essai semi-statique chez le poisson. Paris : OCDE, adoptée en juin 1996.
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 2004. Draft emission scenario on textile manufacturing wool mills [en ligne]. Paris (France) : Direction de l’environnement de l’OCDE. Rapport n° : ENV/JM/EEA(2004)8/1/REV, JT00175156. [consulté le 16 février 2009].
Odabasoglu, M., Çakmak, S., Turgut, G., Içbudak, H. 2003. Preparation and characterization of chromophor group containing cyclotriphosphazenes: III bis-azo chromophor carrying some cyclotriphosphazenes. Phosphorus, Sulfur and Silicon178:549-558.
Pagga, U., Brown, D. 1986. The degradation of dyestuffs: Part II Behaviour of dyestuffs in aerobic biodegradation tests. Chemosphere. 15, 4, 479-491.
Palmer, K.A., Denunzio, A., Green, S. 1978. The mutagenic assay of some hair dye components, using the thymidine kinase locus of L5178Y mouse lymphoma cells. J. Environ. Pathol. Toxicol. 1(1):87-91.
[PhysProp] Interactive PhysProp Database [base de données sur Internet]. 2006. Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation.Démo de la base de données intéractives PhysProp [consulté le 16 février 2009].
Prikryl, J., Rusicka, Burgert, L. 1979. A new method of determining the solubility of disperse dyes. JSDC octobre: 349-351.
Platzek, T., Lang, C., Grohmann, G., Gi, U.S., Baltes, W. 1999. Formation of a carcinogenic aromatic amine from an azo dye by human skin bacteria in vitro. Hum. Exp. Toxicol. 18(9):552-559.
Présentation de projet. 2008a. Projet non publié et confidentiel présenté à la Division des substances existantes d’Environnement Canada dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Sommaire de rigueur d’étude, n° 11887Challenge006.
Présentation de projet. 2008b. Projet non publié et confidentiel présenté à la Division des substances existantes d’Environnement Canada, selon le Plan de gestion des produits chimiques. Sommaire de rigueur d’étude, n° 12890Challenge006.
[QPC] Qianjiang Printing & Chemical Co., Ltd. 2004. Products: Disperse Orange 29 [en ligne].
Razo-Flores, E., Luijten, M., Donlon, B., Lettinga, G., Field, J. 1997. Biodegradation of selected azo dyes under methanogenic conditions. Wat. Sci. Technol. 36(6-7):65-72.
Robertson, I.C.G., Sivarajah, K., Eling, T.E., Zeiger, E. 1983. Activation of Some Aromatic Amines to Mutagenic Products by Prostaglandin Endoperoxide Synthetase. Cancer Res. 43:476-480.
Sakuratani, Y., Noguchi, Y., Kobayashi, K., Yamada, J., Nishihara, T. 2008. Molecular size as a limiting characterisitic for bioaccumulation in fish. J. Environ. Biol.29(1):89-92.
Santé Canada. 1995. Exposure factors for assessing total daily intake of priority substances by the general population of Canada. Rapport inédit. Ottawa (Ont.) : Santé Canada. Direction de l’hygiène du milieu.
Santé Canada 2007. Règlement sur les aliments et drogues, partie B − aliments.
Santé Canada. 2009. Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques.
Sarkar, F.H., Radcliff, G., Callewaert, D.M. 1992. Purified prostaglandin synthase activates aromatic amines to derivatives that are mutagenic to Salmonella typhimurium. 282:273-281.
Shen, G., Hu, S. 2008. Bioconcentration Test of C.I. Disperse Orange 30 in Fish. Préparé par Environmental Testing Laboratory, Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai (Chine) pour Dystar au nom de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD), Bâle (Suisse). Rapport n° S-070-2007. Présenté à Environnement Canada en avril 2008. N° de déclaration dans le cadre du Défi : 8351.
Sheu, C.J.W., Green, S. 1979. Dominant lethal assay of some hair-dye components in random-bred male rats. Mutat. Res. 68:85-98.
Sijm, D.T.H.M., Schuurmann, G., deVries, P.J., Opperhuizen, A. 1999. Aqueous solubility, octanol solubility, and octanol/water partition coefficient of nine hydrophobic dyes. Environ. Toxicol. Chem. 18(6):1109-1117.
[SPIN] Substances in Products in Nordic Countries [base de données sur Internet]. 2008. Projet financé par le Conseil des ministres des pays nordiques, Groupe chimique. Substances dans les produits dans les pays nordiques [consulté en décembre 2008].
Stingley, R.L., Zou, W., Heinze, T.M., Chen, H., Cerniglia, C.E. 2010. Metabolism of azo dyes by human skin microbiota. J. Med. Microbiol. 59(Pt.1):108-114.
[TOPKAT] TOxicity Prediction by Komputer Assisted Technology [en ligne]. 2004. Version 6.2. San Diego (CA) : Accelrys Software Inc. [consulté le 7 janvier 2009].
[USEPA] United States Environmental Protection Agency. 1986−2002. Toxic Substances Control Act: Inventory Update Reporting (TSCA−IUR). Non-confidential Production Volume Information for 1986, 1990, 1994, 1998 and 2002 reporting cycles [CD-ROM]. Washington (DC) : USEPA.
White, T.J., Goodman, D., Sulgin, A.T., Castagnolli, N., Lee, R., Petrakis, N.L. 1977. Mutagenic activity of some centrally active aromatic amines in Salonella typhimurium. Mutation Research 56:199-202.
Wild, D., King, M.T., Eckhardt, K., Gocke, E. 1981 Mutagenic activity of aminophenols and diphenols, and relations with chemical structure. Mut Res 85:456.
Yen, C.C., Perenich, T.A., Baughman, G.L. 1989. Fate of dyes in aquatic systems II. Solubility and octanol/water partition coefficients of disperse dyes. Environ. Toxicol. Chem.8(11):981-986.
Yen, C.C., Perenich, T.A., Baughman, G.L. 1991. Fate of commercial disperse dyes in sediments. Environ. Toxicol. Chem. 10:1009-1017.
Zeiger, E., Anderson, B., Haworth, S., lawlor, T., Mortelmans, K. 1988. Salmonella mutagenicity tests: IV. Results from the testing of 300 chemicals. Environ. Mol. Mutagen. 11(Suppl 12):1-157.
Zhang, X., Wang, G. 2009. Four-week oral toxicity study of p-nitrophenol, paminophenol and p-nitroaniline in rats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 32 (SUPPL. 1), p. 122-123.
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Persistance dans l’eau, les sédiments et le sol
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Bio-elimination study for CAS# 6250-23-3 (Disperse Yellow 23) Clariant dyestuff product = Foron Yellow E RGFL (Présentation de projet, 2008a) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 6250-23-3 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Yellow 23 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 54 % Disperse Yellow 23 |
| Méthode | ||||
| 6 | Référence | 1 | Non | |
| 7 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 8 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 9 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1976) | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 10 | Type d’essai (c.-à-d. hydrolyse, biodégradation) | s.o. | Oui | Biodégradation |
| 11 | Conditions d’essai (aérobie ou anaérobie) | s.o. | Non | Non indiqué |
| 12 | Milieu d’essai (eau, sédiments ou sol) | s.o. | Oui | Eau (par déduction d’après la concentration d’essai exprimée en mg/L) |
| 13 | Durée de l’essai | s.o. | Oui | 14 jours |
| 14 | Témoins négatifs ou positifs? | 1 | Non | |
| 15 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 16 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 17 | Méthode ou instrument analytique | 1 | Non | |
| Détails sur la biodégradation | ||||
| 18 | Type de biodégradation (immédiate ou intrinsèque) indiqué? | 2 | Non | Non indiqué |
| 19 | Lorsque le type de biodégradation (immédiate ou intrinsèque) n’est pas signalé, une information indirecte permet-elle l’identification du type de biodégradation? | 1 | Non | |
| 20 | Source de l’inoculum | 1 | Non | |
| 21 | Concentration dans l’inoculum ou nombre de microorganismes | 1 | Non | |
| 22 | Un préconditionnement et une préadaptation de l’inoculum ont-ils été signalés? | 1 | Non | |
| 23 | Le préconditionnement et la préadaptation de l’inoculum étaient-ils appropriés dans le cadre de la méthode utilisée? | s.o. | Non | |
| 24 | Température | 1 | Non | Non indiqué |
| 25 | Le pourcentage de dégradation du composé de référence a-t-il atteint les niveaux requis avant le 14ejour? | s.o. | Non | Pas de composé de référence testé |
| 26 | Sol : humidité du sol signalée? | 1 | ||
| 27 | Sol et sédiments : contenu en matière organique du sol (MOS) de base signalé? | 1 | ||
| 28 | Sol et sédiments : teneur en argile signalée? | 1 | ||
| 29 | Sol et sédiments : CEC (capacité d’échange cationique) signalée? | 1 | ||
| Détails sur l’hydrolyse | ||||
| 30 | Valeurs du pH signalées? | 1 | ||
| 31 | Température | 1 | ||
| 32 | Les concentrations appropriées de la substance ont-elles été utilisées? | |||
| 33 | Si un solvant a été utilisé, l’a-t-il été de manière appropriée? | |||
| Détails sur la photo-dégradation | ||||
| 34 | Température | 1 | ||
| 35 | Source lumineuse | 1 | ||
| 36 | Spectre lumineux (nm) | 1 | ||
| 37 | Intensité relative en fonction de l’intensité lumineuse du soleil | 1 | ||
| 38 | Spectre d’une substance | 1 | ||
| 39 | Photolyse indirecte : Sensibilisateur (type) | 1 | ||
| 40 | Photolyse indirecte : concentration du sensibilisateur | 1 | ||
| Résultats | ||||
| 41 | Paramètre et valeur | s.o. | s.o. | Biodégradation moyenne en 14 jours = 51 % |
| 42 | Produits de dégradation | s.o. | Non | |
| 43 | Note : ... % | 4,5 | ||
| 44 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 45 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 46 | Remarques | |||
Formulaire pour sommaire de rigueur d’étude : organismes aquatiques B
| N° | Élément | Pondé-ration | Oui/non | Précisions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : SHEN, G., HU, S. 2008. Bioconcentration Test of C.I. Disperse Orange 30 in Fish. Préparé par Environmental Testing Laboratory, Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai (Chine) pour Dystar au nom de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD), Bâle (Suisse). Rapport n° S-070-2007. Présenté à Environnement Canada en avril 2008. N° de déclaration dans le cadre du Défi 8351. |
||||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 5261-31-4 | |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | ||
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | ||
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | ||
| 7 | Si le matériel d’essai est radiomarqué, est-ce que la ou les positions précises du ou des atomes marqués ainsi que le pourcentage de radioactivité associé aux impuretés ont été rapportés? | 2 | Non | ||
| Méthode | |||||
| 8 | Référence | 1 | Oui | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 305B-1996 | |
| 9 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE | |
| 10 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | ||
| 11 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Non | ||
| Organisme d’essai | |||||
| 12 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Poisson zèbre, Brachydanio rerio | |
| 13 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | Les deux | |
| 14 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | ||
| 15 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Longueur moyenne du corps 3,91 +/- 0,18 cm et poids moyen du corps 0,32 +/- 0,06 g | |
| 16 | Sexe | 1 | Non | ||
| 17 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 7 | |
| 18 | Charge en organismes | 1 | Oui | 20 mg/L | |
| 19 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | Mise au régime avec un poisson du commerce jusqu’à un jour avant le début du test | |
| Conception et conditions des essais | |||||
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | Laboratoire | |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau | |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 28 jours | |
| 23 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | ||
| 24 | Concentrations | 1 | Oui | 20 mg/L | |
| 25 | Type/composition de la nourriture et périodes d’alimentation (pendant l’essai) | 1 | Oui | Les poissons étaient nourris deux heures avant le renouvellement de l’eau | |
| 26 | Si le ratio FBC/FBA dérivait de la concentration chimique dans l’organisme et dans l’eau, la durée de l’expérience était-elle égale à ou supérieure au temps nécessaire pour que les concentrations chimiques atteignent un état stable? | 3 | Oui | 28 jours | |
| 27 | Si le rapport FBC/FBA a été déterminé comme correspondant au rapport de la concentration du produit chimique dans l’organisme sur sa concentration dans l’eau, est-ce que les concentrations mesurées dans l’organisme et dans l’eau étaient mentionnées? | 3 | Oui | ||
| 28 | Les concentrations dans les eaux d’essai ont-elles été mesurées périodiquement? | 1 | Oui | Sur trois jours distincts | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | Oui, tous les deux jours | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | 12:12 | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | ||
| 32 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | Tous les deux jours pour l’oxygène dissous, le pH et la température | |
| 33 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | ||
| 34 | Le solubilisant/émulsifiant a-t-il été utilisé si le produit chimique était faiblement soluble ou instable? | s.o. | Non | ||
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | |||||
| 35 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | ||
| 36 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | ||
| 37 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | Semi-statique | |
| 38 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | 7,22 à 7,84 | |
| 39 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | 22 à 23 | |
| 40 | Le contenu lipidique (ou FBA/FBC lipidiquement normalisé) a-t-il été signalé? | 2 | Oui | ||
| 41 | Les concentrations mesurées d’un produit chimique dans l’eau du test étaient-elles inférieures à la solubilité dans l’eau du produit chimique? | 3 | Non | ||
| 42 | Si une substance radiomarquée a été utilisée, est-ce que le FBC a été déterminé d’après le composé d’origine (et non d’après les résidus radiomarqués)? | 3 | Non | ||
| Résultats | |||||
| 43 | Les paramètres déterminés (FBA, FBC) et leurs valeurs | s.o. | s.o. | FBC | |
| 44 | FBA ou FBC déterminés comme : 1) le rapport de la concentration en produit chimique produit dans l’organisme, ou 2) le rapport entre les constantes d’incorporation de produit chimique et du taux d’élimination | s.o. | s.o. | 1 | |
| 45 | Le FBA/FBC était-il issu d’un 1) échantillon de tissu ou 2) organisme entier? | s.o. | s.o. | 2 | |
| 46 | Le FBA/FBC 1) moyen ou 2) maximum at-il été utilisé? |
s.o. | s.o. | 1 | |
| 47 | Note : ... % | 67,9 | |||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 2 | |||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance satisfaisante | |||
| 50 | Remarques | La présente procédure est basée sur des conditions semi-statiques (renouvellement des solutions du test tous les deux jours). Par conséquent, les substances d’essai très peu solubles dans l’eau, comme les colorants diazoïques, peuvent aussi être caractérisées selon leur potentiel de bioconcentration sans l’ajout de solvants ou d’autres substances auxiliaires qui pourraient modifier les résultats. | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Fish toxicity study for CAS# 6250-23-3 (Disperse Yellow 23) Clariant dyestuff product=Foron Yellow E RGFL (Prrésentation de projet, 2008b) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 6250-23-3 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Yellow 23 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 54 % DY23 |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1974) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Truite arc-en-ciel |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Non | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Longueur : 11 cm; poids : 15 g |
| 15 | Sexe | 1 | Non | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | (48 heures) |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé est-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est > 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non | Seule la température est indiquée (typique pour l’organisme d’essai) |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | 20 °C |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Non | La CL50 indiquée est supérieure de 8 ordres de grandeur à la solubilité dans l’eau mesurée par Baughman et Perenich (1989). |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 à 48 heures = 1 000 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : % | 17,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 203 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Poisson-zèbre (Brachydanio rerio) |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Non | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | (48 heures) |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Non | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Oui | La différence entre les valeurs de la CE50 et de la solubilité dans l’eau ne dépasse pas 1 ordre de grandeur. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 à 96 heures > 480 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note : % | 28,6 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 201 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Scenedesmus subspicatus |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Sans objet | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 72 heures |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Oui | La différence entre la CL50 indiquée et la solubilité dans l’eau ne dépasse pas 1 ordre de grandeur. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CE50 après 72 h pour la biomasse = 6 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Oui | CE50 pour la croissance = 86 mg/L; CE10 pour la biomasse et la croissance = 1,7 et 5,4 mg/L; |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : % | 38,2 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence: [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 202 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Daphnia magna |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Sans objet | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 24 et 48 heures |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé est-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est > 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Non | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Non | La CL50 indiquée est supérieure à la valeur fournie de la solubilité dans l’eau. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 après 48 heures > 70 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Oui | CE50 après 24 h > 100 mg/L |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : | 29,4 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire pour sommaires de rigueur d’études : toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : BASF 1990. Bericht uber die Prufung der akuten Toxizitit an der Goldorfe (Leuciscus idus L., Goldvariante). Présenté à Environnement Canada par l’ETAD en août 2008. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | ||
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | ||
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | ||
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Ide dorée |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Non | |
| 15 | Sexe | 1 | Non | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Non | |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Non | |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 96 h |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | Non | |
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | Non | |
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Non | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Non | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Non | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | ||
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | CL50 = > 100 mg/L < 220 mg/L | |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | CSEO = 100 mg/L | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | ||
| 47 | Note globale : % | 9,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | Les données soumises ne sont pas suffisantes pour évaluer correctement la fiabilité de cette étude. | ||
Formulaire pour sommaires de rigueur d’études : toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Environnement Canada, 1995. NSN submission. Données présentées à la Division des substances nouvelles d’Environnement Canada dans le cadre du Programme de renseignements concernant les substances nouvelles. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Non | |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Oui | OCDE 203 |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Oui | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Truite arc-en-ciel |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | longueur moyenne : 51 mm; poids moyen : 1,54 |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Voir ci-dessus |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 10 |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Oui | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 96 h |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Oui | 3 |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | 2 |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Oui | 320-3 200 mg/L |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé était-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est supérieure à 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Solubilité dans l’eau inconnue | |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 après 96 h |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : | 77,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 2 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Cohle, P. et R. MIihalik. 1991. Early life stage toxicity of C.I. Disperse Blue 79:1 purified preecake to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a flow-through system. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | ||
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Disperse Blue 79:1 | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 96,61 |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Oui | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | ASTM, 1983 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Oui | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Truite arc-en-ciel | |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 20 |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Oui | 0,36 à 4,8 µg/L |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Toxicité chronique |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 122 jours |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Oui | Témoin et porteur non indiqués |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | 2 |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Oui | 5 |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Oui | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Oui | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Oui | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Oui | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | Oui | |
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | Oui | Pas de valeur pour la toxicité, mais l’agent a été utilisé comme témoin |
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | Renouvellement continu |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Impossible à évaluer. Il y a lieu de croire que la plus forte dose d’essai correspond à la limite de solubilité. | |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CSEO > 0,005 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | ||
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | ||
| 47 | Note globale : | 97,7 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 1 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance élevée | ||
| 50 | Remarques | |||
Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité Disperse Orange 29 (19800-42-1)
| Paramètre | Propriétés physico-chimiques et devenir | Profils de persistance, bioaccumulation et toxicité | Écotoxicité |
|---|---|---|---|
| Paramètres d’entrée des modèles | Suite EPIWIN (tous les modèles, notamment AOPWIN, KOCWIN, BCFWIN, BIOWIN et ECOSAR) |
Canadian POP Model (incluant : CATABOL, modèle de facteurs d’atténuation du FBC, modèle de toxicité OASIS) |
Artificial Intelligence Expert System (AIES)/TOPKAT/ASTER |
| Code SMILES [1] | x | x | x |
Annexe 3 : Absorption estimée de la limite supérieure d’absorption de Disperse Orange 29 à partir des textiles par divers groupes d’âge (µg/kg p.c. par jour) (Limite inférieure : exposition maximale estimée par les textiles grand teint. Limite supérieure : exposition maximale prudente)[1]
| Produit de consommation | 0 à 6 mois[2] | 0,5 à 4 ans[3] | 5 à 11 ans[4] | 12 à 19 ans[5] | 20 ans et + [6] |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutanée : port de textiles | 0,2 à 4 | 0,2 à 3 | 0,2 à 3 | 0,1 à 2 | 0,1 à 2 |
| Voie orale : mâchonnement | 0,1 | 0,1 | s.o.[7] | s.o. | s.o. |
[2] En supposant que le nourrisson pèse 7,5 kg, que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,28 m2 (Santé Canada, 1995) et qu’il passe 23 minutes par jour à mâchonner le tissu (Norris et Smith, 2002).
[3] En supposant que l’enfant pèse 15,5 kg, que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,46 m2 (Santé Canada, 1998) et qu’il passe 29 minutes par jour à mâchonner le tissu (Norris et Smith, 2002).
[4] En supposant que l’enfant pèse 31 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,80 m2 (Santé Canada, 1995).
[5] En supposant que l’adolescent pèse 59,4 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 1,4 m2 (Santé Canada, 1995).
[6] En supposant que la personne pèse 70,9 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 1,6 m2 (Santé Canada, 1995).
[7] Sans objet.
| Scénario basé sur des produits de consommation | Hypothèses | Estimation de l’exposition |
|---|---|---|
| Port d’un vêtement teint confectionné à partir de tissu synthétique | Scénario d’exposition pour les nourrissons : ConsExpo 4.0, contact cutané direct avec le produit – migration (RIVM, 2005). Concentration : 1 % en poids (Kraetke et Platzek, 2005) Densité du tissu : 100 g/m2 (Kraetke et Platzek, 2005) Hypothèses générales
Poids du corps du nourrisson : 7,5 kg (Santé Canada, 1998)
Voie cutanée : contact cutané direct avec le produit – migration (RIVM, 2005).
|
Dose chronique par voie cutanée = 4 µg/kg p.c. par jour |
| Mâchonnement de textiles teints | L’exposition est estimée ci-dessous pour des nourrissons âgés de 0 à 6 mois. Valeur d’absorption journalière estimée pour l’ingestion résultant du mâchonnement :
où :
= (42,8 mg/L × 0,22 mL/min × 0,001 L/mL × 0,005 × 1 × 23 min/jour)/7,5 kg = 0,0001 mg/kg p.c. par jour |
Dose chronique par voie orale = 0,1 µg/kg p.c. par jour |
[2] Quantité de produit = densité du tissu ´ quantité de tissus ´ concentration = 100g/m2, 1,60 m2, 1 % poids = 1,60 g
Annexe 5 : Sommaire des résultats de RQSA pour le Disperse Orange 29 et les produits potentiels de rupture des liaisons azoïques
Cancérogénicité
| N° CAS | DEREK (2008) | CASETOX (2008) | TOPKAT (2008) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancer | m-rat | f-rat | m-souris | f-souris | Rongeurs du NTP | NTP m-rat |
NTP f-rat |
NTP m-souris |
NTP f-souris |
|
| 19800-42-1 (parent) | P | NC | N | NC | NC | NC | P | HC | P | NC |
| 100-01-6 | P | NC | NC | NC | NC | N | P | NC | P | N |
| 123-30-8 | HC | NC | NC | N | NC | NC | P | N | N | N |
| 5307-02-8 | P | N | N | N | N | NC | P | NC | N | P |
Génotoxicité
| N° CAS | Ames | ChrAb | Induction de micronoyaux | Mutation du lymphome chez les souris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek | CT | TK | Derek | CT | CT | CT | |
| 19800-42-1 (origine) | P | N | NC | NC | P | N | NC |
| 100-01-6 | P | NC | N | NC | P | N | NC |
| 123-30-8 | HC | N | N | P | P | N | P |
| 5307-02-8 | P | P | P | HC | P | N | P |
Notes de bas de page
[2] Mutagène 2 au tableau 3.1 de l'annexe VI du Règlement CLP, mutagène de catégorie 3 au tableau 3.2 de l'annexe VI du Règlement CLP (Commission européenne, 2008; ESIS, 2010).
Cette page Web a été archivée dans le Web
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Archivée
4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol
Disperse Orange 29
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
19800-42-1
Environnement Canada
Santé Canada
Septembre 2011
Table des Matières
- Sommaire
- Introduction
- Identité de la substance
- Propriétés physiques et chimiques
- Sources
- Utilisations
- Rejets dans l'environnement
- Devenir dans l'environnement
- Persistance et potentiel de bioaccumulation
- Potentiel d'effets nocifs sur l'environnement
- Potentiel d'effets nocifs sur la santé humaine
- Conclusion
- Références
- Annexe 1 : Sommaires de rigueur d'étude pour les études clés
- Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité
- Annexe 3 : Absorption estimée de la limite supérieure d’absorption de Disperse Orange 29 à partir des textiles par divers groupes d’âge (µg/kg p.c. par jour) (Limite inférieure : exposition maximale estimée par les textiles grand teint. Limite supérieure : exposition maximale prudente)
- Annexe 4 : Estimation de l'exposition par la migration des colorants à partir des vêtements
- Annexe 5 : Sommaire des résultats de RQSA pour le Disperse Orange 29 et les produits potentiels de rupture des liaisons azoïques
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 19800-42-1.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances.
Le Disperse Orange 29 est une substance organique principalement utilisée au Canada comme teinture à textile. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements fournis par l’industrie en réponse à l’enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999) au Canada, le Disperse Orange 29 n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 ou en 2005. Une entreprise a importé 2 000 kg de cette substance au pays en 2006. En 2005, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Disperse Orange 29 au Canada : une entreprise a importé entre 100 et 1 000 kg de cette substance, tandis qu’une autre en a importé entre 1 001 et 100 000 kg, soit dans des produits ou soit pour la fabrication de divers produits colorés.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la majorité des quantités de Disperse Orange 29 utilisées au Canada se retrouvent en grande partie dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouve dans les égouts. On croit que cette substance n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatile, mais qu’elle est adsorbée sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, le Disperse Orange 29 se retrouvera sans doute dans les sédiments s’il est rejeté directement dans l’eau, et peut-être dans une moindre mesure dans les sols agricoles amendés avec des biosolides provenant de stations de traitement des eaux usées, après leur rejet dans l’eau. On est d’avis que le Disperse Orange 29 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation de deux analogues à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans leRèglement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Disperse Orange 29 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Pour la présente version finale de l’évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition de l’environnement prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette la quantité maximum de Disperse Orange 29 selon les sondages les plus récents. De plus, étant donné que le Disperse Orange 29 peut être utilisé dans des produits de consommation, un scénario prudent de rejet provenant de l’utilisation par les consommateurs a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant dans les produits commerciaux au Canada. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.
À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au Disperse Orange 29 dans les milieux environnementaux soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 en raison de son utilisation comme colorant pour les textiles et les tissus, cependant on s’attend à ce que l’exposition cutanée et orale soit faible. Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’était disponible pour le Disperse Orange 29 ou pour des analogues fiables. Les dangers potentiels du Disperse Orange 29 sont reconnus à cause de sa possibilité de former de composés aromatiques aminés à partir de clivages azoïques. Toutefois, lorsque que considère que l’exposition prévue à la population est faible, les risques potentiels à la santé humaine sont considérés faibles aux présents niveaux d’exposition. On conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) exige que les ministres de l’Environnement et de la Santé procèdent à une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si elles présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.
En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (Ti), et que l’on pense être commercialisées au Canada;
- celles qui répondent aux critères de catégorisation pour le plus fort risque d’exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.
Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada(Canada, 2006a), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances d’importance prioritaire.
L’évaluation des risques écologiques présentés par la substance 4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- (qui sera appelée Disperse Orange 29 aux fins du présent document) a été jugée hautement prioritaire, car cette substance répond aux critères environnementaux de catégorisation pour la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et elle semble être commercialisée au Canada. Le volet du Défi portant sur cette substance a été publié dans la Gazette du Canada le 31 mai 2008 (Canada, 2008a, 2008b). En même temps a été publié le profil de cette substance qui présentait l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé sa catégorisation. Dans le cadre du Défi, des renseignements ont été fournis relativement aux propriétés, à la persistance, aux dangers et aux utilisations du Disperse Orange 29 et de certains de ses produits de formulation.
Même si l’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour l’environnement est jugée hautement prioritaire, cette substance ne répond pas aux critères de catégorisation pour le PFRE ou le REI ni aux critères définissant un grave risque pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d’autres organismes nationaux ou internationaux quant à sa cancérogénicité, à sa génotoxicité ou à sa toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.
Les évaluations préalables mettent l’accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Les évaluations préalables visent à examiner des renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence[1].
La présente évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers, les utilisations et l’exposition, y compris ceux fournis dans le cadre du Défi. Les données pertinentes pour l’évaluation préalable de cette substance sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d’évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d’autres documents consultés lors de recherches documentaires menées récemment, jusqu’en juillet 2010. Les études importantes ont fait l’objet d’une évaluation critique; les résultats de la modélisation ont pu être utilisés dans la formulation des conclusions. Les informations disponibles et pertinentes présentées dans des évaluations des risques effectuées par d’autres instances ont été prises en compte. L’évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Il s’agit plutôt d’un sommaire des renseignements essentiels qui appuient la conclusion.
La présente évaluation préalable finale a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada et elle intègre les résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. La section de la présente évaluation portant sur l’écologie a fait l’objet d’une étude consignée par des pairs ou d’une consultation de ces derniers. Des commentaires sur les portions techniques concernant la santé humaine ont été reçus de la part d’experts scientifiques désignés et dirigés par la Toxicology Excellence for Risk Assessment (TERA), notamment M. Larry Claxton, M. Bernard Gadagbui, M. Pertti Hakkinen, M. Glenn Talaska et Mme Pam Williams. De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable a fait l’objet d’une période de commentaires de 60 jours par le public. Bien que les commentaires venus de l’extérieur aient été pris en considération, Santé Canada et Environnement Canada sont seuls responsables du contenu final et des résultats de l’évaluation préalable. Les approches suivies lors des évaluations préalables dans le cadre du Défi ont été examinées par un groupe indépendant, soit le Groupe consultatif du Défi.
Les considérations et renseignements importants qui sous-tendent la présente évaluation sont présentés ci-après.
Nom de la substance
Aux fins du présent document, la substance phénol,
4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- sera appelée Disperse Orange 29, conformément à son nom dans le Colour Index (numéro dans le Colour Index : 26077; CII 2002-). Les renseignements sur l’identité de cette substance sont indiqués dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Identité de la substance pour le Disperse Orange 29
| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) | 19800-42-1 |
| Nom dans la LIS | 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol |
| Noms dans les inventaires[1] | Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (TSCA, AICS, PICCS, ASIA-PAC) 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol(EINECS) Disperse Orange 29 (ENCS) C.I. disperse orange 029 (ECL) C.I. Disperse Orange 29, (4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo)]phenol)(PICCS) |
| Autres noms | 4-[[4-[(p-nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azo]phenol; C.I. Disperse Orange 29; Dianix Yellow Brown SE-R; Foron Yellow Brown SE-RL; Hisperse Orange C-GS; Intrasil Orange L 2R; Intrasil Orange L 2R200; Palanil Orange GL; phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phe-nyl]azo]-; Resolin Yellow Brown 3GL; Samaron Yellow Brown HRSL; Sumikaron Orange SE-RBL; Synten Orange P-GRL; 4-({2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl}azo)phenol |
| Catégorie de la substance | Substances organiques définies |
| Classe chimique | Composés azoïques |
| Groupechimique | Composés diazoïques |
| Formule chimique | C19H15N5O4 |
| Structure chimique | 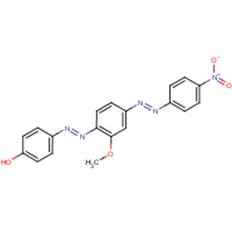 |
| SMILES[2] | N(=O)(=O)c(ccc(N=Nc(ccc(N=NC(ccc(O)c1)c1)c2OC)c2)c3)c3 |
| Poids moléculaire | 377,36 g/mol |
[2] Simplified Molecular Input Line Entry System
La substance Disperse Orange 29 est un colorant diazoïque dispersé. Les deux liaisons azoïques (-N=N-) de cette molécule sont des groupes fonctionnels qui produisent de la couleur (EPA du Danemark, 1999). Les colorants peuvent être classés selon leur structure chimique, mais aussi selon leurs applications industrielles et les méthodes de teinture du substrat considéré (ETAD, 1995). Leur classification, qui inclut les colorants acides et directs, tend à refléter les regroupements basés sur les propriétés physiques et chimiques des substances. Un bref exposé des usages de ce colorant est consultable à la partie « Utilisations » du présent document.
On dispose de peu de données expérimentales sur les propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29. À l’occasion de l’atelier sur les relations quantitatives structure-activité (RQSA) organisé par Environnement Canada en 1999 (Environnement Canada, 2000), des experts en modélisation ont déterminé que de nombreuses classes structurelles de pigments et de teintures sont « difficiles à modéliser » à l’aide de modèles RQSA. Les propriétés physiques ou chimiques de nombreuses classes structurelles de teintures et de pigments se prêtent mal à la prévision par modélisation, car on considère qu’elles « ne font pas partie du domaine d’applicabilité » (p. ex. domaines de la structure ou des paramètres des propriétés). Par conséquent, pour déterminer leur utilité potentielle, les domaines d’applicabilité des modèles RQSA aux teintures et aux pigments sont évalués au cas par cas.
Pour la présente évaluation, on considère que les modèles des RQSA utilisés pour prévoir les propriétés physiques et chimiques pour lesquels on manque de substances analogues au Disperse Orange 29 dans leur domaine d’applicabilité peuvent produire des résultats ayant un degré d’incertitude élevé. Par conséquent, une méthode par analogie a été employée pour déterminer les propriétés physiques et chimiques approximatives au tableau 2. Par la suite, ces propriétés ont été considérées dans l’évaluation de différentes sources de données. Le tableau 2 présente certaines propriétés physiques et chimiques (valeurs calculées et extrapolées) du Disperse Orange 29.
Un analogue est un produit chimique dont la structure est similaire à celle de la substance évaluée; il devrait donc avoir des propriétés physiques et chimiques, un comportement dans l’environnement et une toxicité semblables. Lorsque ce sont des données expérimentales pour un paramètre donné d’une substance analogue, celles-ci peuvent être directement utilisées ou avec un ajustement, comme estimation de cette valeur de paramètre pour la substance en cours d’évaluation.
Pour trouver des analogues acceptables, une revue des données pour plusieurs colorants azoïques dispersés a été effectuée (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988; ETAD, 1995; Brown, 1992; Yen et al. 1989; Sijm et al., 1999). En plus de leurs similitudes structurelles avec le Disperse Orange 29, ces composés partagent d’autres caractéristiques importantes avec la substance, qui renforcent leur pertinence en tant qu’analogues. Cela comprend les propriétés influant sur leur devenir dans l’environnement comme des masses moléculaires élevées (généralement supérieures à 300 g/mol), un diamètre transversal similaire (entre 1,3 et 2,2 nm), des structures particulaires solides, un point de décomposition supérieur à 120 ºC et une « dispersabilité » dans l’eau (c’est-à-dire que ces composés ne sont pas entièrement « solubles »). De plus, leur pression de vapeur à température ambiante est négligeable, et ils sont stables dans des conditions environnementales, car ils ont été conçus pour l’être. D’autres analogues ont été sélectionnés aux fins de l’évaluation des effets sur la santé humaine, lorsque des données pertinentes existaient (voir la section du présent rapport consacrée au potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine pour des précisions à cet égard).
Comme certains des colorants diazoïques ont été étudiés dans des conditions environnementales non pertinentes (à des températures élevées, par exemple) ou qu’ils ont été testés sous forme de composés purs, ou encore comme peu de renseignements permettaient d’évaluer la fiabilité de certaines études, des données confirmatoires sur les colorants dispersés azoïques, en général, sont incluses dans le tableau 2.
Tableau 2. Propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29 et des analogues pertinents
| Propriété | Type[1] | Valeur | Température (°C) | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État physique | Disperse Orange 29 | Poudre | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Point de décomposition[2] (ºC) |
Disperse Orange 29 | 223 à 223,8 | ETAD, 2005 | ||||||
| Analogue : Solvent Red 23 |
195 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) | 185 | MITI, 1992 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 | 158 178 | Odabasoglu et al., 2003; Datyner, 1978 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 153 à 156,5 | Nishida et al., 1989 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 126,9 à 128,5 | ETAD, 2005 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 157 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 132 153 |
Sijm et al., 1999; Yen et al., 1989 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 117 à 175 74 à 236 |
Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| Point d’ébullition[3] (ºC) |
Sans objet | ||||||||
| Masse volumique (kg/m3) |
Non disponible | ||||||||
| Pression de vapeur (Pa) |
Analogue : Disperse Blue 79 | 4,53 x 10-7 | Clariant, 1996 | ||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 5,3 x 10-12 à 5,3 x 10-5) (4 x 10-14 à 4 x 10-7 mm Hg) |
25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,18 à 0,42[4] | 191,5 à 211[4] | Nishida et al., 1989 | ||||||
| Constante de la loi de Henry (Pa·m3/mol) | Données déduites à partir d’analogues des colorants azoïques | 10-8 à 10-1 (10-13 à 10-6atm·m3/mol)[5] |
Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Log Koe (coefficient de partage octanol-eau) (sans dimension) |
Disperse Orange 29 | 4,6[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 4,1; 4,3[7] | Clariant, 1996; Brown, 1992 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 4,4; 4,8 | Sijm et al., 1999; Yen et al.,1989 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 4,2[8] | Brown, 1992 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 1,8 à 5,1 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| > 2 à 5,1 | Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987 | ||||||||
| Log Kco (coefficient de partage carbone organique-eau) (sans dimension) |
Données déduites à partir d’analogues, calculées | 3,4 à 4,2[9] | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| Solubilité dans l’eau (mg/L) |
Analogue : Disperse Orange 29 | 42,9[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||
| Substance d’essai peu soluble dans l’eau | Présentation de projet, 2008a | ||||||||
| 0,0037 | 25 | Baughman et al., 1996 (estimé) | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,345 | PhysProp, 2006 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 | 0,00006 | 25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||
| 0,00052 | Baughman et al., 1996 (estimé) | ||||||||
| 15,7 à 34,8[4] | 130 | Braun, 1991 | |||||||
| Analogue : Disperse Yellow 68 | 16,6[4] | 125 | Prikryl et al., 1979 | ||||||
| Analogue : Disperse Blue 79 | 0,0054 | 25 | Clariant, 1996 | ||||||
| 0,02[7] | Brown, 1992 | ||||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 0,02 | Sijm et al., 1999 | |||||||
| 0,0052 | Yen et al., 1989 | ||||||||
| 0,00063[4] | 100 à 125 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 0,07[8] | Brown, 1992 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | < 0,01 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||
| Très peu soluble dans l’eau | ETAD, 1995 | ||||||||
| 1,2 x 10-5 à 35,5 (4 x 10-11à 1,8 x 10-4 mol/L) |
Baughman et Perenich, 1988 | ||||||||
| Solubilité dans le n-octanol (mg/L) | Analogue : Disperse Orange 29 | 5 086 | ETAD, 2005 | ||||||
| Analogue : Disperse Orange 30 | 576 | ETAD, 2005 | |||||||
| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 14 | Sijm et al., 1999 | |||||||
| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 81 à 2 100 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||
| pKa (constante de dissociation) (sans dimension) |
Analogue : isperse Orange 29 |
9,03 | ACD/pKa DB, 2005 | ||||||
| Analogue : Disperse Yellow 23 |
8,1 | Haag et Mill, 1987 | |||||||
[2] On utilise l’expression « point de décomposition », plutôt que le point de fusion car il est du domaine connu qu’à des températures élevées (supérieures à 200 °C), les colorants dispersés ne fondent pas, mais se carbonisent (ETAD, 1995).
[3] En général, la notion de point d’ébullition ne s’applique pas aux colorants dispersés. Dans le cas des colorants en poudre, on observe, à température élevée, une carbonisation ou une décomposition de la substance plutôt qu’une ébullition. Pour ce qui est des liquides et des pâtes colorantes, on observe l’ébullition du solvant seulement, alors que le composant solide qui ne s’est pas évaporé se décompose ou se carbonise (ETAD, 1995).
[4] Il est à noter que les essais de solubilité dans l’eau, dans ces études, ont été effectués à température très élevée et, par conséquent, les valeurs sont supérieures à celles auxquelles on peut s’attendre à température ambiante.
[5] Les valeurs de solubilité de cinq colorants azoïques dispersés (Disperse Orange 3, Disperse Red 1, Solvent Yellow 2, Dis. A. 5, Dis. A. 7) à 25 et 80 °C ont été utilisées par Baughman et Perenich (1988) pour calculer les constantes de la loi de Henry de ces colorants. Une plage de valeurs est utilisée pour signifier que la constante de la loi de Henry prévue, en ce qui concerne les colorants azoïques, se situe dans cette gamme.
[6] L’étude indique que le Disperse Orange 29 utilisé dans l’essai avait une dispersion de 20 % du colorant testé (70 % d’eau et 10 % de Reax).
[7] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 76 % et une dispersion à 20 % du colorant.
[8] L’étude indique que le Disperse Orange 30 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 73 % et une dispersion à 20 % du colorant.
[9] Les valeurs du log Kcosont fondées sur les calculs que Baughman et Perenich (1988) ont réalisés en utilisant une solubilité mesurée pour des colorants commerciaux, à un point de fusion supposé de 200 ºC.
En raison du peu de données empiriques sur le Disperse Orange 29 et de l’erreur associée aux prédictions de la modélisation portant sur les colorants dispersés, certaines données empiriques sur les propriétés physiques et chimiques (tableau 2), des données sur la bioaccumulation (tableaux 6a et 6b) et des données sur la toxicité provenant d’analogues (tableau 7b) ont été utilisées pour étayer la preuve et les conclusions proposées dans cette évaluation préalable. Plus précisément, des données ont été obtenues sur quatre colorants diazoïques ayant une structure similaire : Disperse Yellow 23, Disperse Yellow 68, Disperse Orange 13, Solvent Red 23 et Solvent Sudan IV/Solvent Red 24) et six colorants monoazoïques ayant une structure similaire (Disperse Blue 79, Disperse Blue 79:1, Disperse Orange 30, Disperse Red 73, Disperse Orange 25 et Disperse Red 17). Les renseignements sur les substances, de même que les données empiriques sur les analogues utilisés dans le présent rapport, sont présentés dans le tableau 3a, alors que les poids moléculaires et les diamètres transversaux sont présentés dans le tableau 3b.
Tableau 3a. Analogues structuraux du Disperse Orange 29 pris en compte dans l’évaluation environnementale
| Nom commun (n° CAS) |
Nom dans la LIS | Structure | Similarités et différences de structure majeures avec le Disperse Orange 29 | Données empiriques disponibles[1] |
|---|---|---|---|---|
| Disperse Orange 29 (19800-42-1) |
4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)] phénol |  |
Sans objet. Même substance. | État physique, point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, solubilité dans le n-octanol |
| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |
p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol |  |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 23 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers |
Point de fusion, solubilité dans l’eau, pKa et toxicité aquatique |
| Disperse Yellow 68 (21811-64-3) |
p,p’-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol | 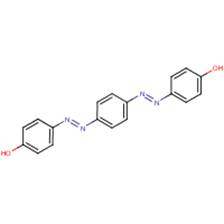 |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 68 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers, et comporte un groupement hydroxyle additionnel |
Solubilité dans l’eau |
| Disperse Orange 13 (6253-10-7) |
p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol | 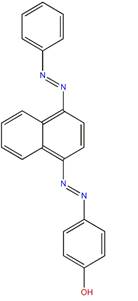 |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Orange 13 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal |
Point de fusion, hydrosolubilité, pression de vapeur |
| Solvent Red 23 (85-86-9) |
1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol | 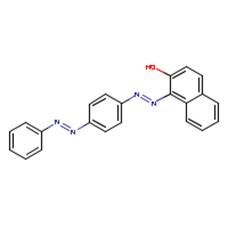 |
Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle Différences : Solvent Red 23 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal ou d’éthers |
Point de fusion |
| Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) (85-83-6) |
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol | 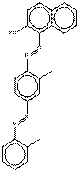 |
Similarité : Composé diazoïque aromatique possédant un anneau naphtalène avec un substituant hydroxyle. Même nombre d’anneaux. Différences : Deux groupements méthyle de plus – un sur chacun des anneaux simples. |
Point de fusion, toxicité, FBC |
| Disperse Orange 25 (31482-56-1) |
3-[Éthyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl] amino]propionitrile |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 25 contient un groupe fonctionnel nitrile et un groupe d’amines |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
| Disperse Orange 30 (5261-31-4) |
Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle | 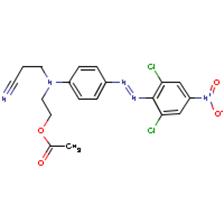 |
Similarité : Composé azoïque aromatique avec un groupement nitro terminal. Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 30 contient des groupes fonctionnels nitriles et carboxyliques et deux chlores. |
Bioaccumula-tion, toxicité pour les organismes aquatiques, log Koe |
| Disperse Blue 79 (12239-34-8) |
Diacétate de 2,2’-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle |  |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et d’un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro additionnel, un aniline avec deux chaînes carbonées et un groupement de brome |
Point de fusion, pression de vapeur, log Koe, solubilité dans l’eau et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |
| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |
Diacétate de 2,2’-{[5-acétamido-4-(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino} diéthyle |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79:1 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, bioaccumulation et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |
| Disperse Red 17 (3179-89-3) |
2,2'-{[3-Méthyl-4-(4-nitrophénylazo)phényl]imino}diéthanol |  |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : pas de second groupe azoïque, Disperse Red 17 contient un groupement hydroxyle additionnel et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
| Disperse Red 73 (16889-10-4) |
2-({4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl} azo)-5-nitrobenzonitrile |
 |
Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Red 73 contient deux groupements fonctionnels nitriles et aucun groupe d’éthers, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
Tableau 3b. Comparaison de la masse moléculaire et du diamètre transversal des colorants dispersés monoazoïques et diazoïques considérés comme des analogues structuraux
| Substance | N° CAS | Nom commun | Masse moléculaire (g/mol) | Minimum-maximum Dmax(nm)[1] |
|---|---|---|---|---|
| Colorants diazoïques | 19800-42-1 | Disperse Orange 29 | 377 | 1,56-2,19 |
| 6250-23-3 | Disperse Yellow 23 | 302 | 1,50-2,07 | |
| 6253-10-7 | Disperse Orange 13 | 352 | 1,56-2,07 | |
| 85-86-9 | Solvent Red 23 | 352 | 1,50-2,03 | |
| 85-83-6 | Sudan IV | 380 | 1,50-2,03 | |
| 21811-64-3 | Disperse Yellow 68 | 318 | 2,09-2,14 | |
| Colorants monoazoïques analogues | 12239-34-8 | Disperse Blue 79 | 639 | 1,69-2,05 |
| 3618-72-2 | Disperse Blue 79:1 | 625 | 1,43-2,03 | |
| 5261-31-4 | Disperse Orange 30 | 450 | 1,75-1,98 | |
| 16889-10-4 | Disperse Red 73 | 348 | 1,31-1,93 | |
| 31482-56-1 | Disperse Orange 25 | 323 | 1,37-1,95 | |
| 3179-89-3 | Disperse Red 17 | 344 | 1,41-1,86 |
Il faut noter qu’il existe plusieurs incertitudes associées à l’utilisation des données physiques, chimiques, toxicologiques et de bioaccumulation disponibles pour les substances. Toutes ces substances appartiennent à la même classe chimique, à savoir les composés azoïques (un sous-ensemble comporte deux liaisons azoïques et un autre comporte une liaison azoïque) et sont utilisées à des fins industrielles similaires (colorants dispersés et teintures avec deux solvants). Toutefois, ces substances présentent des différences liées à leur groupement fonctionnel propre (voir le tableau 3a ci-après) et à leur taille moléculaire. En dépit du fait que les colorants monoazoïques comportent des masses moléculaires plus élevées que les colorants diazoïques, leur état physique, leur point de fusion, leur solubilité dans l’eau, leur log Koe et leurs diamètres transversaux comparables (tableau 3b) offrent un fondement raisonnable permettant de conclure que les colorants monoazoïques auront un comportement semblable à celui des colorants diazoïques dans l’environnement, et présenteront une biodisponibilité à peu près égale, et que leur utilisation comme analogues du Disperse Orange 29 était donc acceptable.
Le Disperse Orange 29 n’est pas produit naturellement dans l’environnement.
Des enquêtes menées récemment auprès de l’industrie en 2005 et 2006 par le truchement d’avis publiés dans laGazette du Canada conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), ont permis de recueillir des renseignements récents (Canada, 2006b et 2008b). Ces avis nécessitaient la fourniture de données sur la fabrication, l’importation et l’utilisation du Disperse Orange 29 au Canada. Dans l’avis de 2006, on demandait aussi des données sur les quantités de ce colorant utilisées. Dans le contexte des avis émis en vertu de l’article 71 de 2005 et 2006, les entreprises qui n’étaient pas tenues de fournir des données selon les critères établis, mais qui avaient un intérêt commercial se rapportant au Disperse Orange 29, ont été invitées à s’identifier en tant que parties intéressées.
En 2006, une entreprise a déclaré avoir importé 2 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2008a). En 2005, moins de quatre entreprises ont déclaré avoir importé de 100 à 100 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2006). Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué du Disperse Orange 29 à des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/année durant l’une ou l’autre année.
En 2006, un importateur de Disperse Orange 29 a déclaré en avoir vendu à 13 entreprises, la quantité maximale vendue étant de 261 kg au cours de cette année. Au total, trois entreprises se sont identifiées en tant que partie intéressée pour le Disperse Orange 29 en 2005 et 2006 (Environnement Canada, 2006, 2008a).
Au cours de l’élaboration de la Liste intérieure des substances (LIS), la quantité de Disperse Orange 29 déclarée avoir été fabriquée, importée ou commercialisée en 1986 était de 42 000 kg par huit entreprises (Environnement Canada, 1988).
Le Disperse Orange 29 a été reconnu comme substance chimique produite en faible quantité dans l’Union européenne (UE). Sa production au sein de l’Union européenne a été estimée entre 10 et 1 000 tonnes par an, environ (ESIS, 2008). Aux États-Unis, la production nationale de Disperse Orange 29 se situait dans l’intervalle de 10 000 à 500 000 livres pour les cycles de déclaration de 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002 du programme Inventory Update Reporting de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA, 1986-2002). Le Disperse Orange 29 a également été utilisé en Suède de 1999 à 2006, et au Danemark de 2003 à 2006 (SPIN, 2008).
Les produits contenant du Disperse Orange 29 peuvent entrer au Canada même s’ils n’ont pas été recensés en tant que tels dans l’enquête menée en vertu de l’article 71, en raison de leur importation involontaire dans les articles manufacturés ou de leurs quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg établi pour l’enquête.
Des renseignements relatifs aux utilisations pour les années civiles 2005 et 2006 ont été recueillis en réponse aux avis publiés en application de l’article 71 de la LCPE (1999) (Canada, 2006b, 2008b). Les entreprises qui ont importé du Disperse Orange 29 en 2005 et en 2006 ont déclaré que leurs activités commerciales étaient liées au finissage de textiles et de tissus, et à la préparation de produits chimiques. L’importateur de Disperse Orange 29 en 2006 a indiqué avoir vendu la substance à 13 autres entreprises (Environnement Canada, 2008a). D’après des recherches additionnelles, ces entreprises font partie de l’industrie du textile et produisent des tissus d’intérieur, des vêtements de travail, des tissus techniques, des vêtements pour enfants, des sangles pour ceintures de sécurité et autres usages, des fermetures à glissière et d’autres produits textiles. Ces entreprises utilisent des textiles tels que le coton, le jersey, le molleton, le polyester et le tissu éponge (Industrie Canada, 2008a).
Au cours du processus d’inscription des substances dans la LIS (1984-1986), les codes d’utilisation « colorant - pigments/colorants/teintures/encre », « pigments, teintures et encres d’imprimerie », « secteur textile, fabrication primaire » et « produits textiles » ont été attribués au Disperse Orange 29.
Une analyse de l’information scientifique et technique révèle que le Disperse Orange 29 est surtout utilisé dans l’industrie du textile (SPIN, 2008) pour teindre le polyester, l’acétate et le nylon (CII, 2002). Les méthodes employées pour son application comprennent le thermosolage et l’impression (QPC, 2004), et les textiles colorés au Disperse Orange 29 peuvent servir à teindre des vêtements de travail et de sport ainsi que des tissus d’ameublement et pour automobile (Farbchemie Braun KG, 2008).
Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas dans la liste des additifs alimentaires autorisés du Règlement sur les aliments et drogues et n’est pas utilisé dans l’emballage alimentaire (Santé Canada, 2007)
Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas à l’article C.01.040.2 du Règlement sur les aliments et drogues parmi les colorants autorisés dans les médicaments (Canada, 1978). De plus, le Disperse Orange 29 n’est inscrit ni dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP), ni dans la base de données sur les ingrédients non médicinaux interne de la Direction des produits thérapeutiques, ni dans la Base de données sur les ingrédients de produits de santé naturels (BDIPSN), ni dans la Base de données des produits de santé naturels homologués (BDPSNH) en tant qu’ingrédient médicinal ou non médicinal dans les produits pharmaceutiques finaux, les produits de santé naturels ou les médicaments vétérinaires (BDPP, 2010; BDIPSN, 2010; BDPSNH, 2010; courriel de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada adressé au Bureau de gestion du risque de Santé Canada en avril 2010, source non citée).
Débit massique
Environnement Canada a développé une méthode pour estimer les pertes d’une substance pendant différentes étapes de son cycle de vie, y compris son devenir dans un produit ou un article fini (Environnement Canada, 2008). Cette méthode comprend une analyse du cycle de vie et un tableur (outil de débit massique) qui intègrent les renseignements sur la fabrication, l’importation et l’utilisation de la substance. En commençant par une masse définie de la substance, chaque étape du cycle de vie est par la suite évaluée jusqu'à ce que toute la masse ait été comptabilisée. Les facteurs pertinents sont étudiés, les incertitudes sont déterminées et des hypothèses peuvent être faites pendant chaque étape, selon les renseignements disponibles. Les pertes estimées représentent le bilan massique complet de la substance au cours de son cycle de vie et elles comprennent les rejets dans les eaux usées et dans d’autres milieux récepteurs (sol, air), la transformation chimique, le transfert vers les activités de recyclage et le transfert vers les sites d’élimination des déchets (sites d’enfouissement, incinération). Toutefois, à moins de disposer de données précises sur le taux ou le potentiel de rejet de cette substance provenant des sites d’enfouissement et des incinérateurs, la méthode ne permet pas de quantifier les rejets dans l’environnement à partir de ces sources. En fin de compte, les pertes estimées fournissent le premier volet de l’analyse de l’exposition à une substance et aident à estimer les rejets dans l’environnement et à mettre l’accent sur la caractérisation de l’exposition plus tard dans l’évaluation.
En général, les rejets d’une substance dans l’environnement peuvent découler de différentes pertes de la substance lors de sa fabrication, de son utilisation industrielle, de son utilisation commerciale et de son utilisation par les consommateurs. Ces pertes peuvent être regroupées en sept types : 1) déversements dans les eaux usées; 2) émissions atmosphériques; 3) perte dans le sol; 4) transformation chimique; 5) élimination sur les sites d’enfouissement; 6) perte par incinération; 7) élimination par recyclage (p. ex. le recyclage est jugé comme une perte et n’est plus pris davantage en compte). Ces pertes sont estimées à partir de données d’enquêtes réglementaires, de données de l’industrie, et de données publiées par différents organismes. Les rejets dans les eaux usées font référence aux eaux usées brutes avant tout traitement par des systèmes d'assainissement publics ou privés. De la même manière, les pertes par transformation chimique font référence aux modifications de l'identité de la substance qui peuvent avoir lieu au cours des étapes de fabrication, d'utilisation industrielle ou d'utilisation commerciale ou par les consommateurs, mais elles excluent celles qui ont lieu pendant les opérations de gestion des déchets telles que l'incinération et le traitement des eaux usées. La perte dans le sol inclut le transfert accidentel ou les fuites dans le sol ou sur les surfaces pavées ou non pavées pendant l'utilisation de la substance et sa durée de vie utile (p. ex. lors de l'utilisation de machinerie agricole ou d'automobiles). La perte dans le sol n'inclut toutefois pas les transferts après l'utilisation de la substance ou sa vie utile (p. ex. application sur le sol des biosolides et dépôts atmosphériques).
Les pertes estimées pour le Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie (fondées sur des hypothèses prudentes) sont présentées au tableau 4 (Environnement Canada, 2010a). Le Disperse Orange 29 n’est pas fabriqué au Canada au-delà des seuils de déclaration, par conséquent, les pertes estimées sont fondées sur les quantités importées déclarées en 2006.
Tableau 4. Estimation des pertes de Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie
| Type de perte | Proportion (%) | Étapes pertinentes du cycle de vie |
|---|---|---|
| Eaux usées | 14,8 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Émissions atmosphériques | 0 | |
| Sol | 0 | |
| Transformation chimique | 0 | |
| Sites d’enfouissement | 82,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Incinération | 2,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |
| Recyclage | 0 | |
| Total | 100 |
Comme le Disperse Orange 29 est principalement utilisé dans l’industrie textile, l’outil du débit massique a été alimenté en données concernant spécifiquement les colorants textiles pour la présente évaluation.
Selon les estimations, le Disperse Orange 29 est rejeté dans les eaux usées à 14,8 % durant son utilisation à des fins industrielles et aux étapes d’utilisation par les commerces et les consommateurs. Les hypothèses émises pendant cette étape comprennent les pertes pendant la manutention des contenants et les activités de coloration. On estime que la majorité du Disperse Orange 29 dans les textiles se perd dans l’élimination des déchets provenant d’article manufacturés (incinération 2,6 % et décharges 82,6 %). On suppose que les pertes dans le recyclage des textiles sont négligeables.
Les pertes estimées ci-dessus indiquent que le Disperse Orange 29 utilisé dans les textiles présente un potentiel de rejets dans l’environnement. En général, les eaux usées constituent un point d’entrée commun des substances dans l’eau, cela par l’intermédiaire des installations de traitement des eaux usées, et un point d’entrée dans le sol par l’intermédiaire de la gestion subséquente des boues résiduelles. Les émissions atmosphériques peuvent donner lieu à des dépôts atmosphériques dans le sol et l’eau. Lorsqu’une substance est transférée accidentellement vers les terres, elle peut pénétrer dans les égouts ou être transférée par le vent ou la pluie vers le sol proche. Lors d’activités de recyclage, la substance peut être acheminée dans l’eau ou le sol, selon les caractéristiques opérationnelles des installations. Enfin, les décharges ont le potentiel de lessiver des substances dans l’eau souterraine ou d’en rejeter dans l’atmosphère.
Selon les données de Statistique Canada et une analyse réalisée par Industrie Canada (2008b), on propose que les colorants textiles tels que le Disperse Orange 29 évalué dans le présent rapport pourraient être importés dans des articles manufacturés. À la suite de cette hypothèse, le rapport de textiles fabriqués au Canada et importés de 30/70 a été utilisé pour estimer la quantité de teinture importée dans les textiles (Industrie Canada, 2008b; Environnement Canada, 2008c). Cette quantité importée a été prise en compte dans les calculs de l’outil de débit massique pour le Disperse Orange 29 utilisé dans le secteur des textiles.
Les calculs présument qu’il n’y a aucun rejet de cette substance à partir des sites d’enfouissement, bien que des rejets à long terme soient possibles. Une petite fraction des déchets solides est incinérée, ce qui peut engendrer la transformation chimique de la substance. D’après les renseignements contenus dans les documents sur les scénarios d’émission de l’OCDE concernant la transformation et les utilisations associées à ce type de substance (OCDE, 2004), on estime que 14,8 % du Disperse Orange 29 utilisé dans les colorants textiles peuvent être rejetés dans les égouts (5,4 % découlant du traitement industriel et 9,4 % provenant des utilisations par les consommateurs).
D’après ce qui précède, les effluents d’eaux usées constituent le milieu qui reçoit la plus grande proportion de Disperse Orange 29 rejeté pendant l’utilisation du produit. On prévoit que la plus grande partie de la substance, qu’elle soit fixée aux textiles manufacturés ou aux boues des installations de traitement des eaux usées à la suite de rejets aux égouts, sera envoyée sous une forme solide (textiles) ou entraînée dans les boues vers des sites d’enfouissement (décharges). En plus d’être mis en décharge, une partie des biosolides produits par les installations de traitement des eaux usées peuvent être épandus sur des terres comme engrais ou comme amendement des sols destinés à des utilisations agricoles ou forestières ou encore devant être mis en valeur, et un petit pourcentage peut être incinéré.
Selon les résultats obtenus à l’aide de l’outil de débit massique (tableau 4), la substance Disperse Orange 29 est susceptible d’être rejetée dans les effluents d’eaux usées issus de sa transformation industrielle et de ses utilisations associées à des rejets dans les égouts. Les valeurs élevées de log Koe (4,6) et les valeurs élevées de log Kco déterminées par analogie (3,4 à 4,2) [voir le tableau 2] indiquent que cette substance pourrait avoir une affinité pour les solides. Toutefois, les log Kco sont des valeurs calculées, et non strictement expérimentales (voir la note 8 du tableau 2), et le potentiel d’adsorption des structures particulaires solides des colorants n’est généralement pas bien compris; par conséquent, l’importance de ce comportement particulier est incertaine.
Selon les modèles de biodégradation aérobie, il est attendu que la biodégradation du Disperse Orange 29 soit lente (voir le tableau 5 ci-dessous). Cette substance peut être épandue sur des sols au Canada involontairement du fait de sa présence dans les biosolides souvent utilisés pour enrichir le sol. De plus, la substance pourrait être libérée des textiles teints qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement.
Étant donné les valeurs du pKa de 8,1 pour l’analogue Disperse Yellow 23 et une valeur pKaestimée à 9,03 pour le Disperse Orange 29 (tableau 2), on peut s’attendre à ce que cette substance chimique se comporte comme un acide faible et soit partiellement ionisée dans l’eau aux valeurs élevées de la gamme normale du pH dans l’environnement (8 à 9). Toutefois, en raison de la faible solubilité dans l’eau attendue du Disperse Orange 29 (tableau 2) et de son état particulaire, il est peu probable que l’ionisation à un pH élevé influe significativement sur la répartition de ces substances dans l’environnement ou sur leur solubilité dans l’eau. De ce fait, lorsqu’elle est rejetée dans l’eau, cette substance devrait se retrouver principalement sous forme solide ou être adsorbée aux particules en suspension pour enfin se déposer sur les matériaux du lit où elle devrait demeurer sous une forme qui n’est relativement pas biodisponible. Il a été indiqué que, vu le caractère récalcitrant des colorants azoïques en milieu aérobie, ces produits finissent par se retrouver dans des sédiments anaérobies, dans des aquifères peu profonds et dans l’eau souterraine (Razo-Flores et al., 1997). Cependant, comme le Solvent Red 23 est faiblement soluble dans l’eau et possède un Kco relativement élevé, il est peu susceptible d’être lessivé à partir des sédiments et des sols.
La vitesse de volatilisation à partir de la surface de l’eau est proportionnelle à la constante de la loi de Henry (Baughman et Perenich, 1988). Baughman et Perenich (1988) mentionnent également que la volatilisation à partir de systèmes aquatiques devrait être un processus de perte peu important pour les colorants dont la valeur de la constante de la loi de Henry pour les analogues est faible à négligeable
(10-8 à 10-1 Pa·m3/mol, tableau 2). Le transport dans l’air qui résulte de la perte de cette substance des sols superficiels humides et secs n’est pas très important pour cette substance comme l’indique sa très faible pression de vapeur (5,33 x (10-12 à 10-5) Pa; tableau 2). Ces données sont compatibles avec l’état physique (particule solide) des colorants diazoïques qui les rend peu sujets à la volatilisation. La valeur expérimentale de la pression de vapeur du Disperse Orange 13 n’est pas un indicateur utile de la volatilisation du Disperse Orange 29 étant donné qu’elle a été obtenue à une température élevée.
Persistance dans l’environnement
Les colorants doivent être très stables, d’un point de vue chimique, et résister à la photolyse pour être utiles. Ils sont donc pour la plupart considérés comme non biodégradables dans les conditions aérobies ambiantes (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995). Des études dans lesquelles les épreuves généralement reconnues (p. ex., les lignes directrices de l’OCDE) de biodégradabilité immédiate et intrinsèque ont été appliquées ont permis de confirmer ce point (ETAD, 1992; Pagga et Brown, 1986). La dégradation abiotique, dont la photolyse et l’hydrolyse, ne devrait pas jouer un rôle important dans le devenir des colorants azoïques dans l’environnement (EPA du Danemark, 1999), même si une étude a montré une photodécomposition fortement accélérée de tels colorants en présence de matières humiques naturelles (Brown et Anliker, 1988).
La dégradation biotique des colorants azoïques peut se produire relativement rapidement dans des conditions anaérobies ou réductrices (Baughman et Weber, 1994; EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995; Isik et Sponza, 2004; Yen et al., 1991). Il a été déterminé que la perméabilité de la paroi cellulaire des bactéries constitue l’étape limitante du processus de réduction (EPA du Danemark, 1999). On observe chez les colorants azoïques une forte tendance à la rupture de la liaison azoïque avec formation d’amines aromatiques (EPA du Danemark, 1999; Hunger, 2005). Le potentiel de cancérogénicité des amines aromatiques varie considérablement en fonction de la structure moléculaire, des produits de décomposition cancérogènes étant associés avec des groupements fonctionnels de la benzidine, de l’aniline, du toluène et du naphtalène. Cependant, la formation de tels métabolites dans les sédiments anoxiques profonds n’entraînera habituellement pas d’exposition des organismes aquatiques. La minéralisation totale ou la dégradation subséquente de ces métabolites est une possibilité si ceux-ci sont déplacés (p. ex., par remise en suspension des sédiments) dans un milieu aérobie (EPA du Danemark, 1999; Isik et Sponza, 2004). Des amines aromatiques peuvent également être présentes comme impuretés dans les colorants azoïques offerts sur le marché, mais la rupture de la liaison de ces colorants lors du métabolisme demeure la principale source de telles amines (EPA du Danemark, 1999).
D’après une étude présentée sur la bioélimination du Disperse Yellow 23, cette substance est dégradée à 51 % en 14 jours (présentation de projet, 2008b). Toutefois, cette valeur expérimentale n’a pas pu être utilisée pour l’évaluation de la persistance du Disperse Orange 29, car l’étude a été considérée peu fiable en raison de renseignements insuffisants sur les conditions expérimentales (voir le sommaire de rigueur d’étude à l’annexe 1). Outre cette étude, aucune autre donnée expérimentale ou de comparaison sur la dégradation du Disperse Orange 29 n’a été relevée. Aucune donnée de surveillance environnementale n’ayant trait à la présence de ces colorants dans l’environnement canadien (air, eau, sol et sédiments) n’a été relevée.
Comme on s’attend à ce que le Disperse Orange 29 soit rejeté dans les eaux usées, sa persistance a surtout été examinée à l’aide de modèles de prévision RQSA sur la biodégradation aérobie dans l’eau. L’utilisation de ces modèles est jugé acceptable dans cette situation puisqu’ils sont fondés sur la structure chimique et que la structure diazoïque est représentée dans les ensembles d’étalonnage de tous les modèles BIOWIN utilisés, ce qui augmente la fiabilité des prédictions (Environnement Canada, 2007). L’analyse suivante concerne principalement la partie de cette substance actuellement dissoute dans l’environnement, tout en tenant compte du fait qu’il est probable qu’une grande partie de cette substance soit dispersée sous la forme de particules solides. Le Disperse Orange 29 et ses analogues ne contiennent pas de groupements fonctionnels susceptibles d’entreprendre une hydrolyse dans un milieu anaérobie (les colorants sont connus pour être stables dans les milieux aqueux). Le tableau 5 résume les résultats des modèles RQSA disponibles sur la biodégradation aérobie dans l’eau.
Tableau 5. Données modélisées sur la biodégradation du Disperse Orange 29
| Processus du devenir | Modèle et base du modèle |
Résultat et prévision du modèle | Demi-vie extrapolée (jours) |
|---|---|---|---|
| Biodégradation primaire | |||
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 4 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |
3,2[2] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation ultime | |||
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 3 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |
1,6[2] « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 5 : Probabilité linéaire, MITI |
-0,34[3] « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 6 : Probabilité non linéaire, MITI |
0[3] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | TOPKAT, 2004 Probabilité |
0[3] n.d.[4] « se biodégrade lentement » |
≥ 182 |
| Biodégradation (aérobie) | CATABOL, C2004-2008 % DBO[5] (demande biochimique en oxygène) |
% DBO = 0 « se biodégrade très lentement » |
≥ 182 |
[2] Le résultat s’exprime par une valeur numérique de 0 à 5.
[3] Le résultat s’exprime par un taux de probabilité.
[4] n.d. : non disponible (hors du domaine du modèle).
[5] DBO : demande biochimique en oxygène.
Comme le montre le tableau 5, tous les modèles de biodégradation ultime (BIOWIN 3, 5, 6, CATABOL et TOPKAT) portent à croire que la biodégradation du Disperse Orange 29 se fait lentement en conditions aérobies dans l’eau. Toutefois, le résultat du modèle TOPKAT a été étiqueté non fiable pour ce type de structure. En fait, les résultats de probabilité des modèles BIOWIN 5 et 6 sont bien inférieurs à 0,3, ce qui est la limite suggérée par Aronson et al. (2006) pour trouver les substances qui ont une demi-vie de plus de 60 jours (selon les modèles de probabilité du MITI). En outre, les deux autres modèles de dégradation ultime, à savoir BIOWIN 3 et CATABOL, indiquent que le Disperse Orange 29 sera persistant dans l’eau.
Lorsque les résultats de probabilité et les modèles de dégradation ultime sont pris en compte, il y a un important consensus qui suggère que la demi-vie de la biodégradation ultime dans l’eau est supérieure ou égale à 182 jours. Ce résultat correspond à ce qu’on s’attend de ces structures chimiques (c.-à-d., peu de groupements fonctionnels dégradables, particules solides peu solubles).
Selon un ratio d’extrapolation de 1:1:4 pour la demi-vie associée à la biodégradation dans l’eau, le sol, les sédiments (Boethling et al., 1995), la demi-vie de dégradation ultime dans le sol aérobie est également supérieure ou égale à 182 jours, et la demi-vie dans les sédiments est supérieure ou égale à 365 jours. Cela indique que le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans le sol et les sédiments.
D’après les données modélisées pour la dégradation ultime (voir tableau 5 ci-dessus) et l’avis d’expert (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995), le Disperse Orange 29 répond aux critères de persistance dans l’eau, le sol (demi-vies en conditions aérobies dans le sol et dans l’eau ≥ 182 jours), les sédiments (demi-vie dans les sédiments aérobies de ≥ 365 jours) énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Potentiel de bioaccumulation
On ne dispose pas de données expérimentales sur la bioaccumulation du Disperse Orange 29. Comme il est connu que les modèles de la bioaccumulation s’appliquent mal aux pigments et aux colorants, leurs prévisions ne sont pas considérées comme fiables pour les colorants diazoïques. La modélisation de la bioaccumulation n’a donc pas été employée pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de ces substances.
Vu l’absence de données expérimentales et modélisées, les facteurs de bioconcentration (FBC) et de bioaccumulation (FBA) d’analogues structuraux ont été utilisés pour estimer le potentiel de bioaccumulation du Disperse Orange 29. D’après des études sur la bioconcentration d’analogues structuraux relativement proches, le Sudan IV (MITI, 1992) et le Disperse Orange 30 (Shen et Hu, 2008), l’accumulation du Solvent Red 23 dans les poissons serait peu probable (Sten et Hu, 2008). L’essai sur le Solvent Red 23 (tableau 6a) effectué par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI) à l’aide de carpes a généré une série de facteurs de bioconcentration faibles (inférieurs à 11 L/kg).
Tableau 6a. Données empiriques sur la bioaccumulation et la bioconcentration du Sudan IV, analogue du Solvent Red 23
| Organisme d’essai | Concentrations expérimentale (mg/L) et/ou source d’exposition | Paramètre (FBC, L/kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| Carpe (Cyprinus carpio) |
0,35 | < 0,29 à 2,9 | MITI, 1992 |
| Carpe (Cyprinus carpio) |
0,035 | < 2,9 à 11 | MITI, 1992 |
L’essai de bioconcentration effectué par Shen et Hu (2008) a été réalisé selon les lignes directrices de l’OCDE (OCDE, 1996). La bioconcentration du Disperse Orange 30 chez le poisson zèbre (Brachydanio rerio) a été déterminée par un test semi-statique sur 28 jours, avec renouvellement du milieu de test tous les deux jours. Afin de vérifier le potentiel de bioconcentration de la substance d’essai, un essai en phase d’exposition à une concentration nominale de 20 mg/L (concentration moyenne mesurée entre 0,028 et 0,28 mg/L approximativement) a été mené en tenant compte du résultat obtenu lors de l’essai de toxicité aiguë pour le poisson. Des échantillons des deux solutions de test et des organismes d’essai ont été pris du 26e jour au 28ejour de la période de test d’exposition sur 28 jours. Les échantillons ont été préparés en extrayant le composant lipidique des poissons testés. La concentration mesurée de la substance d’essai, la teneur en lipides et le facteur de bioconcentration (FBC) figurent au tableau 6b.
Tableau 6b. Concentrations mesurées, teneur en lipides et calcul du FBC d’une substance analogue du Disperse Orange 30, d’après Shen et Hu (2008)
| Traitements (20 mg/L) | Durée d’échantillonnage | ||
|---|---|---|---|
| 26e jour | 27e jour | 28e jour | |
| Concentration mesurée de la substance d’essai dans les solutions extraites (mg/L) | < 0,028 | < 0,028 | < 0,028 |
| Contenu de la substance test dans les lipides du poisson (mg) | < 1,68 | < 1,68 | < 1,68 |
| Poids total des poissons (g) | 2,07 | 2,13 | 2,53 |
| Concentration de la substance d’essai dans les poissons Cp (mg/kg) | < 0,81 | < 0,79 | < 0,66 |
| Concentration mesurée de la substance test dans le Ce de l’eau (mg/L) | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 |
| Contenu lipidique du poisson (%) | 0,81 | 0,57 | 1,25 |
| FBC | < 100 | < 100 | < 100 |
| FBC moyen | < 100 | ||
L’étude de Shen et Hu (2008) a été révisée et considérée comme acceptable (voir l’annexe 1). Le très faible niveau de détection dans les extraits de poisson (< 0,028 mg/L) indiquerait une solubilité limitée dans les lipides ou un potentiel limité de répartition dans les tissus des poissons des systèmes aqueux. Toutefois, il existe une incertitude associée aux valeurs limites dans toute étude, car la « vraie » valeur n’est pas connue. Par contre, étant donné la structure et le comportement probable des colorants dispersés dans les systèmes aqueux, le faible résultat obtenu pour le FBC n’est pas inattendu. La plupart des colorants dispersés, ainsi que leur nom le laisse entendre, se présentent sous la forme de fines particules dispersibles avec des fractions réellement solubles limitées. Leur solubilité peut, toutefois, être augmentée en ajoutant à la molécule des groupements fonctionnels polarisés. Or, même si le Disperse Orange 29 comprend certains groupements fonctionnels solubilisants (groupements phénols), les valeurs expérimentales disponibles pour leur solubilité (qui varient de 0,000 06 à 0,345 mg/L) sont relativement faibles, soit inférieures ou comparables, par moins d’un ordre de grandeur, à la solubilité dans l’eau du Disperse Orange 30 (c.-à-d. 0.07 mg/L). Par conséquent, le Disperse Orange 29 devrait avoir une biodisponibilité et un potentiel de bioconcentration similaires ou inférieurs à ceux du Disperse Orange 30.
L’étude susmentionnée constitue un élément de preuve de première importance permettant de croire que le Disperse Orange 29 ne serait pas bioaccumulable, et d’autres recherches viennent appuyer également cette conclusion. Anlikeret al., (1981) présentent des valeurs expérimentales sur la bioaccumulation dans les poissons pour 18 colorants monoazoïques dispersés, valeurs obtenues suivant les méthodes prescrites par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI). Le log des facteurs de bioaccumulation (FBC) variait entre 0,00 et 1,76 et est exprimé en fonction du poids humide total des poissons (Anliker et al., 1981). L’absence d’information sur le numéro de registre et la structure chimique précise limite toutefois l’utilité de cette étude pour des déductions par analogie au sujet du Disperse Orange 29. Néanmoins, des études complémentaires fournissant des précisions sur la structure chimique des colorants dispersés testés ont confirmé le faible potentiel de bioaccumulation de dix colorants azoïques nitrosubstitués pour lesquels les valeurs déterminées du log du facteur de bioaccumulation varient de 0,3 à 1,76 (Anliker et Moser, 1987; Anliker et al., 1988). Des études du MITI viennent également appuyer le faible potentiel de bioaccumulation des colorants azoïques dispersés. Les FBC déclarés de trois colorants azoïques dispersés (nos CAS 40690-89-9, 61968-52-3 et 71767-67-4) testés à une concentration de 0,01 mg/L variaient de moins de 0,3 à 47 L/kg (MITI, 1992). Une étude sur l’accumulation d’une durée de huit semaines réalisée par Brown (1987) montre également qu’aucun des douze colorants dispersés ayant été testés ne s’accumulait chez la carpe.
Les seules données qui indiqueraient que la substance pourrait avoir un potentiel élevé de bioaccumulation sont une valeur élevée du log Koe pour le Disperse Orange 29 et des valeurs se rapportant à des analogues azoïques apparentés (tableau 2). Malgré les valeurs élevées du log Koedéduites du Disperse Orange 29 et d’analogues structurels azoïques, la preuve de la bioaccumulation des colorants azoïques dispersés est insuffisante (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Ankiler et al.,. 1988; MITI, 1992). Selon les auteurs qui ont mesuré des valeurs élevées du log Koe et de faibles facteurs de bioaccumulation concomitants pour les colorants azoïques dispersés, les facteurs d’accumulation faibles pourraient s’expliquer, dans certains cas, par leur faible liposolubilité absolue (Brown, 1987) ou leur poids moléculaire relativement élevé, ce qui pourrait rendre difficile le transport de ces substances à travers les membranes des poissons (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987). Il se peut aussi que le manque de biodisponibilité et le comportement de répartition limité imposés par les conditions d’essai sur le FBC restreignent l’accumulation dans les tissus lipidiques des poissons.
De récentes études liées aux données sur le FBC chez les poissons et aux paramètres de la taille moléculaire (Dimitrovet al. (2002, 2005) laissent entendre que la probabilité qu’une molécule traverse des membranes cellulaires à la suite d’une diffusion passive diminue de façon importante avec l’augmentation du diamètre maximal (Dmax). La probabilité qu’une diffusion passive se produise diminue de façon notable lorsque le diamètre maximal est supérieur à environ 1,5 nm et diminue de façon encore plus significative dans le cas des molécules ayant un diamètre maximal supérieur à 1,7 nm. Sakuratani et al., (2008) ont également étudié l’effet du diamètre transversal sur la diffusion passive à l’aide d’un ensemble d’essais du FBC comptant environ 1 200 substances chimiques nouvelles et existantes. Ils ont observé que les substances qui n’ont pas un potentiel de bioconcentration très élevé (FBC < 5 000 ont souvent un Dmax > 2,0 nm et un diamètre effectif (Deff) > 1,1 nm.
Le Disperse Orange 29 et ses analogues les plus proches (les colorants diazoïques) ont des poids moléculaires variant de 302 à 377 g/mol (voir le tableau 3b) et des structures moléculaires relativement peu compliquées; ces deux caractéristiques indiquent une capacité de bioaccumulation si le poids moléculaire est le seul indicateur utilisé. En revanche, Arnot et al., (2010) indiquent qu’il n’y a pas de rapports nets qui permettraient de fixer une valeur limite de la taille moléculaire de démarcation pour l’évaluation du potentiel de bioaccumulation. Ce rapport ne met toutefois pas en cause la notion selon laquelle la réduction du taux d’absorption pourrait être associée à l’augmentation du diamètre transversal, comme cela a été démontré par Dimitrov et al. (2002, 2005). Le diamètre maximal du Disperse Orange 29, de ses analogues les plus proches et de ses conformères varie de 1,5 à 2,2 nm (BBM, 2008), ce qui indiquerait une possibilité de réduction significative de l’absorption à partir de l’eau et de la biodisponibilité in vivo pour ces colorants.
Cependant, comme l’ont évoqué Arnot et al. (2010), il existe des incertitudes quant aux seuils proposés par Dimitrovet al., (2002, 2005) et Sakuratani et al. (2008), étant donné que les études sur le FBC utilisées pour calculer ces seuils n’ont pas fait l’objet d’évaluations critiques. Selon Arnot et al. (2010), la taille moléculaire a un effet sur la solubilité et la capacité de diffusion dans l’eau et dans les phases organiques (membranes), et les plus grosses molécules peuvent avoir un taux d’absorption plus lent. Toutefois, ces mêmes contraintes liées aux facteurs cinétiques s’appliquent aux voies de diffusion de l’élimination chimique (c.-à-d., absorption lente = élimination lente). Un potentiel de bioaccumulation important peut donc s’appliquer aux substances qui sont soumises à un processus d’absorption lent, si elles sont biotransformées ou éliminées lentement par d’autres processus. Par conséquent, lorsqu’on évalue le potentiel de bioaccumulation, les données sur la taille moléculaire doivent être utilisées avec discernement et de pair avec des éléments de preuve pertinents dans le cadre d’une méthode du poids de la preuve.
Étant donné l’absence d’accumulation observée dans les études sur la bioconcentration du Sudan IV, du Disperse Orange 30 et d’autres colorants azoïques dispersés apparentés ayant donné des résultats similaires, et compte tenu du grand diamètre transversal du Disperse Orange 29 et de ses analogues, qui restreint vraisemblablement leur comportement de partage, le Disperse Orange 29 devrait présenter un faible potentiel de bioaccumulation. Par conséquent, en considérant les données disponibles, le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères de bioaccumulation (FBC ou FBA ≥ 5 000) du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Évaluation des effets écologiques
A – Dans le milieu aquatique
Des études de la toxicité du Disperse Orange 29 et du Disperse Yellow 23 analogue (présentation de projet, 2008a, b) ont été présentées pour étayer l’évaluation des dangers que posent ces substances. Selon ces études, le Disperse Orange 29 a une CE50 après 72 h de 6 mg/L pour l’algueScenedesmus subspicatus et une CE50 après 48 h de 70 mg/L pour Daphnia magna (tableau 7a). Elles indiquent également dans le cas du Disperse Yellow 23 une CL50 après 48 h supérieure à 1 000 mg/L pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et dans le cas du Disperse Orange 29 une CL50 après 96 h de 480 mg/L pour le poisson zèbre (Brachydanio rerio) [tableau 10b]. La fiabilité de ces études est toutefois considérée comme incertaine en raison de l’absence de certains détails sur leur réalisation (voir l’annexe 1). Néanmoins, il a été jugé que leurs données pouvaient être utilisées dans cette évaluation préalable aux fins de l’établissement du poids de la preuve.
Tableau 7a. Données empiriques sur la toxicité du Disperse Orange 29 pour les organismes aquatiques
| Substance | Organisme d’essai | Type d’essai | Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Disperse Orange 29 | Scenedesmus subspicatus | Toxicité chronique (72 heures) |
CE50[1] | 6 | Présentation de projet, 2008a[3] |
| Daphnia magna | Toxicité aiguë (48 heures) |
CE50 | 70 | ||
| Brachydanio rerio | Toxicité aiguë (96 heures) |
CL50[2] | 480 |
[2] CL50 – La concentration d’une substance estimée létale pour 50 % des organismes d’essai.
[3] Il est indiqué dans l’étude qu’une dispersion à 20 % du colorant a été utilisée pour ces essais de toxicité.
Des données écotoxicologiques additionnelles ont été recensées pour plusieurs analogues du Disperse Orange 29. Une étude présentée au nom de l’ETAD fournit des données sur la toxicité aiguë chez les poissons, les invertébrés, les algues et les bactéries pour cinq colorants azoïques dispersés nitro-substitués (Brown, 1992). La toxicité aiguë chez les poissons-zèbres, Daphnia magna et Scenedesmus subspicatus, pour les cinq analogues variait de 17 à 710 mg/L, 4,5 à 110 mg/L et 6,7 à 54 mg/L, respectivement (tableau 7b). De plus, tous les essais à l’aide de bactéries avaient une CI50 dépassant 100 mg/L. Le protocole expérimental détaillé de l’étude portant sur les colorants testés n’a pas été fourni, ce qui restreint grandement l’évaluation de ces études (Brown, 1992). Toutefois, on a jugé que ces données pouvaient être utilisées et elles sont comprises dans cette ébauche d’évaluation préalable en tant qu’élément du poids de la preuve.
Une autre étude de la toxicité aiguë d’un poisson a été présentée pour l’analogue Disperse Blue 79 (BASF, 1990). Elle a indiqué une CL50 après 96 h entre 100 et 220 mg/L pour l’ide dorée (tableau 7b). Toutefois, sa fiabilité est aussi considérée comme incertaine en raison de l’absence de détails (annexe 1). Une étude sur la toxicité de l’analogue Sudan IV en concentration supérieure à 100 mg/L (MITI, 1992) a également été intégrée au tableau 7b comme contribution aux éléments probants, mais elle n’a pas été retenue dans le choix des valeurs critiques parce que le paramètre n’est pas une valeur finie.
Des données écotoxicologiques sur un autre colorant azoïque dispersé ont été reçues en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(Environnement Canada, 1995). Une étude de la toxicité aiguë d’un poisson soumise afin de satisfaire les exigences en matière de déclaration a révélé que cette substance à une CL50 de 505 mg/L dans la truite arc-en-ciel après 96 heures (tableau 7b). Cet essai a été mené en conformité avec les Lignes directrices de l’OCDE n° 203. La fiche signalétique fournie avec cette déclaration contient également des renseignements sur les effets toxiques chez les bactéries. Les résultats indiquent une CE50 supérieure à 1 000 mg/L pour l’inhibition de la respiration de boues activées. À la lumière des données disponibles sur l’écotoxicité, les effets toxiques de la nouvelle substance pour les organismes aquatiques ont été considérés comme peu préoccupants. La fiabilité de cet essai a été évaluée à l’aide d’un sommaire de rigueur d’études et elle est jugée satisfaisante (annexe 1).
Enfin, une étude présentée sur la toxicité chronique de l’analogue Disperse Blue 79:1 a indiqué une concentration sans effet observé (CSEO) de 122 jours supérieure à 0,0048 mg/L chez la truite arc-en-ciel (tableau 7b). Cette étude a été évaluée et jugée très fiable (annexe 1). Toutefois, comme la valeur susmentionnée est un résultat non lié (seuil d’effet incertain), elle n’a pas été utilisée pour calculer la concentration estimée sans effet. À la lumière de toute l’information sur la toxicité des analogues structuraux et compte tenu des données sur la toxicité du Disperse Yellow 23 et du Disperse Orange 29, il y a lieu de croire que le Disperse Orange 29 n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (valeurs de la CL50 aiguë supérieures à 1 mg/L).
Tableau 7b. Données empiriques sur la toxicité pour les analogues du Disperse Orange 29
| Nom usuel ou n° CAS |
Organisme d’essai | Gravité (durée) |
Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |
Oncorynchus mykiss | Aiguë (48 heures) |
CL50[1] | > 1 000 | Présentation de projet, 2008b |
| Sudan IV (85-83-6) |
Oryzias latipes | Aiguë (48 heures) |
CL50[1] | > 100 | MITI, 1992 |
| Disperse Blue 79[2] (12239-34-8) |
Ide dorée | Aiguë (96 heures) |
CL50[1] | 100 < CL50 < 220 | BASF, 1990 |
| Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 340 | Brown, 1992 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50[3] | 4,5[*] | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | 9,5 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50[4] | > 100 | ||
| Disperse Red 73[5] (16889-10-4) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 17 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50 | 23 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | > 10 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Disperse Orange 30[6] (5261-31-4) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 710 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50[2] | 5,8 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |
CE50 | 6,7 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Disperse Orange 25[7] (31482-56-1) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CI50 | 268 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CL50 | 110 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |
CE50 | 54 | ||
| Bactérie | Non disponible | CE50 | > 100 | ||
| Disperse Red 17[8] (3179-89-3) |
Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 103 | |
| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |
CE50 | 98 | ||
| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |
CE50 | 7 | ||
| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||
| Colorant azoïque dispersé analogue (n° CAS confidentiel) |
Truite arc-en-ciel | Aiguë (96 heures) |
CL50 | 505 | Environnement Canada, 1995 |
| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |
Truite arc-en-ciel | Chronique 122 jours |
CSEO[9] | > 0,0048 | Cohle et Mihalik, 1991 |
[2] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans le test (en tant que matière organique) avait une pureté de 76 % et une dispersion du colorant à 20 %.
[3] CE50 - La concentration d’une substance qui est jugée causer un effet sublétal toxique chez 50 % des organismes d’essai.
[4] CI50 - Concentration inhibitrice pour un pourcentage donné d’un effet. Estimation ponctuelle de la concentration d’une substance d’essai causant une réduction de 50 % d’une mesure biologique quantitative comme le taux de croissance.
[5] L’étude indique que la pureté du Disperse Red 73 utilisé dans le test était de 96 6 %.
[6] L’étude indique que le Disperse Orange 30 utilisé dans le test (en tant que matière organique) avait une pureté de 73 % et une dispersion du colorant à 20 %.
[7] L’étude indique que la pureté du Disperse Orange 25 utilisé dans le test était de 94 %.
[8] L’étude indique que la pureté du Disperse Red 17 utilisé dans le test était de 98,8 %.
[9] CSEO - La concentration sans effet observé est la concentration la plus élevée, au cours d’un essai sur la toxicité, à laquelle on n’obtient pas d’effet statistiquement significatif, par comparaison aux témoins.
[*] La valeur critique de toxicité utilisée pour calculer une concentration estimée sans effet.
En général, en raison de leur faible solubilité (c’est-à-dire < 1 mg/L), les colorants dispersés sont supposés avoir un impact écologique faiblement aigu (Hunger, 2003). Les résultats des études empiriques sur la toxicité portant sur le Disperse Orange 29 et ses analogues concordent avec ces prévisions, indiquant pour le poisson des valeurs CL50 comprises entre 17 et 505 mg/L, laDaphnia étant l’organisme testé le plus sensible (CE50/CL50 allant de 4,5 à 110 mg/L). La valeur critique sélectionnée pour calculer une concentration estimée sans effet était la CE50 chez Daphnia magna, soit 4,5 mg/L (Brown, 1992).
L’interprétation des résultats de ces essais est compliquée par le fait que certaines des valeurs obtenues (c.-à-d. CE50 et CL50) sont supérieures à la solubilité indiquée pour les substances d’essai. En effet, certaines des concentrations figurant aux tableaux 7a et 7b pourraient représenter la charge de la substance d’essai. Ainsi, le sous-ensemble des valeurs de CE50 et CL50réelles pourrait être inférieur aux concentrations indiquées, car la concentration réellement dissoute dans l’eau pouvant entraîner un effet est inconnue. Dans d’autres cas (voir les notes au bas du tableau 7b), les substances d’essai se trouvaient sous forme de préparations et n’étaient donc pas pures à 100 %. Par conséquent, d’autres produits chimiques dans la préparation pourraient avoir accru la solubilité dans l’eau et la pureté de certains analogues. Les données expérimentales et sur les analogues disponibles indiquent vraiment que la toxicité du Disperse Orange 29 est sans doute faible.
Des prévisions de la toxicité du Disperse Orange 29 pour les organismes aquatiques ont aussi été obtenues à l’aide de modèles RQSA. Toutefois, tout comme pour la bioaccumulation, les estimations de l’écotoxicité fondées sur des RQSA de ces substances ne sont pas jugées fiables à cause de l’erreur pouvant être associée aux paramètres d’entrée des modèles et de la nature particulière des colorants dispersés − état physique, caractéristiques structurales et/ou propriétés physiques et chimiques hors du domaine d’applicabilité des modèles.
Les données empiriques disponibles sur l’écotoxicité du Disperse Orange 29 et de ses analogues permettent de croire que cette substance n’est probablement pas très dangereuse pour les organismes aquatiques.
B – Dans d’autres milieux naturels
On n’a trouvé aucune étude concernant les effets du Disperse Orange 29 sur l’environnement dans d’autres milieux que l’eau. Cette substance pourrait cependant se retrouver dans le sol ou les sédiments après son rejet dans le milieu aquatique l’élimination dans un site d’enfouissement de boues usées provenant d’usines de traitement des eaux usées, l’élimination de produits contenant cette substance ou l’application de biosolides sur les sols. Il serait donc souhaitable d’obtenir des données sur sa toxicité pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments.
Ceci étant dit, le potentiel de toxicité de cette substance est probablement faible pour les espèces vivant des le sol ou les sédiments, étant donné son faible potentiel de bioaccumulation et ses propriétés physiques et chimiques. Toutefois, cette hypothèse ne peut être confirmée en raison du manque de données pertinentes sur la toxicité de cette substance chez des organismes entiers.
Évaluation de l’exposition écologique
Aucune donnée sur les concentrations de Disperse Orange 29 dans l’eau au Canada n’a été retracée. Les concentrations dans l’environnement sont donc estimées à partir des renseignements disponibles, comme les quantités de la substance, les estimations des rejets dans l’environnement et les caractéristiques des plans d’eau récepteurs.
L’outil de débit massique a été utilisé pour prévoir des rejets vers les eaux (égouts) en se basant sur l’utilisation de produits de formulation et l’utilisation par les consommateurs de produits contenant cette substance.
A – Rejets industriels
On s’attend à une exposition aquatique au Disperse Orange 29 si cette substance est rejetée après une utilisation industrielle vers une usine de traitement des eaux usées et que les effluents de cette usine sont envoyés vers des eaux réceptrices. La concentration de cette substance dans les eaux réceptrices près du point de rejet de l’usine de traitement des eaux usées est utilisée comme la concentration environnementale estimée (CEE) dans l’évaluation du risque présenté par cette substance en milieu aquatique. On peut la calculer à l’aide de l’équation
Ceau-ind = [1000 × Q × L × (1 - R)] / [N × F × D]
où
Ceau-ind : concentration en milieu aquatique due aux rejets industriels, en mg/L
Q : quantité de substance totale utilisée chaque année sur un site industriel, en kg/an
L : pertes dans les eaux usées, fraction
R : taux d’élimination de l’usine de traitement des eaux usées, fraction
N : nombre de jours de rejets annuels, en jour/an
F : débit de l’effluent de l’usine de traitement des eaux usées, en m3/jour
D : facteur de dilution dans l’eau réceptrice, sans dimension
Un scénario prudent concernant les rejets industriels est utilisé pour évaluer la concentration du Disperse Orange 29 dans l’eau comme colorant dans la fabrication de produits textiles, à l’aide du modèle Industrial Generic Exposure Tool − Aquatic (IGETA) d’Environnement Canada (2009). Le scénario est rendu prudent en assumant que la quantité totale de cette substance utilisée par l’industrie au Canada est utilisée par une seule installation industrielle sur un petit site hypothétique. Un tel petit site est retenu afin d’avoir un débit d’effluent au 10e centile (3 456 m3/jour) des taux de rejet des usines de traitement des eaux usées au Canada. Ce scénario suppose également que le rejet a lieu 150 jours par année, car les colorants textiles sont utilisés en très faibles quantités et appliqués en fonction de la spécialité. De plus, on suppose que 16 % (c.-à-d. une perte de 14 % du colorant non fixé et une perte de 2 % du transfert et du nettoyage des bassins) est perdu pendant les activités industrielles, dont un taux d’élimination primaire de 60 % à l’usine de traitement des eaux usées, dans un cours d’eau récepteur relativement petit ayant une capacité de dilution de 10.
Pour les hypothèses susmentionnées, le modèle IGETA a indiqué une concentration dans l’eau de 0,0247mg/L (Environnement Canada, 2010b). Ces valeurs des CEE représentent le niveau d’exposition dans les eaux réceptrices près du point de rejet de l’usine de traitement des eaux usées sur chaque site.
B – Rejets par les consommateurs
L’outil Mega Flush d’Environnement Canada qui sert à estimer les rejets à l’égout issus d’utilisations par les consommateurs a été utilisé pour estimer la concentration possible de la substance dans différents cours d’eau récepteurs d’effluents issus des usines de traitement des eaux usées dans lesquelles ont été rejetés par les consommateurs des produits contenant cette substance (Environnement Canada, 2008c). Le tableur fournit ces estimations pour environ 1 000 sites de rejet dans tout le Canada, et ce, d’après des hypothèses prudentes.
Ces dernières incluent :
- pertes dans les égouts à 100 %;
- taux d’élimination des usines de traitement des eaux usées de 0,0 %;
- nombre de jours de rejets annuels de 365 jours/an;
- facteur de dilution dans l’eau réceptrice sur une échelle de 1 à 10.
Le scénario des rejets des consommateurs était fondé sur des quantités maximales importées de 2 000 kg de Disperse Orange 29 d’après le plus récent sondage (c.-à-d., 2 000 kg). Seule la quantité restant après la fabrication des articles au Canada (c.-à-d. après la prise en compte de la perte de 16 % à l’étape du traitement industriel) a été considérée. Ont également été comptabilisées les quantités potentiellement présentes dans les textiles au Canada d’après le rapport 30/70 entre les textiles fabriqués au Canada et les textiles importés (Industrie Canada, 2008b). La quantité totale considérée dans le scénario des utilisations des consommateurs de Disperse Orange 29 pour les colorants textiles était donc de 5 628 kg. Une perte potentielle donnant lieu à des rejets annuels dans l’eau (perte dans les égouts lors du lavage des articles fabriqués contenant ces colorants) de 10 % des colorants textiles a été prévue (EPA du Danemark, 1999). Le modèle Mega Flush a indiqué une CEE maximale de 8,6 x 10-4 mg/L (Environnement Canada, 2010c), en considérant le 10e centile du débit pour tous les cours d’eau.
Caractérisation du risque écologique
La démarche utilisée pour cette évaluation écologique préalable examinait les renseignements scientifiques disponibles et dégageait des conclusions en appliquant la méthode du poids de la preuve et une approche préventive conformément à la LCPE (1999).
Si l’on se fonde sur les propriétés physiques et chimiques de substances analogues, le Disperse Orange 29 devrait se dégrader lentement en milieu aérobie et devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance devrait présenter un faible potentiel de bioaccumulation. Bien que la proportion de Disperse Orange 29 qui devrait être rejetée dans les égouts soit assez élevée (14,8 %), les faibles quantités importées de ce colorant au Canada ainsi que les données sur leurs propriétés physiques et chimiques et ses utilisations indiquent, dans l’ensemble, un faible potentiel de rejet dans l’environnement canadien. Si elle est rejetée dans l’environnement, on s’attend à ce que cette substance soit principalement déversée dans les eaux de surface où elle devrait finir par se déposer dans les sédiments. L’utilisation de données expérimentales et déduites à partir d’analogues a permis de démontrer que le Disperse Orange 29 présente seulement un potentiel moyen de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.
La concentration estimée sans effet (CESE) a été évaluée en se fondant sur la CE50 de 48 h de 4,5 mg/L chez laDaphnia magna pour un analogue du Disperse Blue 79 (tableau 7b). On a ensuite appliqué un facteur de 100 pour tenir compte de la toxicité aiguë à la toxicité chronique et des extrapolations au terrain des résultats en laboratoire et de l’utilisation d’une substance de remplacement. La CESE ainsi obtenue est de 0,045 mg/L.
Une analyse du quotient de risque, mettant en relation une CEE prudente avec une estimation prudente du potentiel d’effets nocifs ou une CESE, a été effectuée pour le milieu aquatique. Le quotient de risque (CEE/CESE) qui en découle est un élément de preuve important à considérer dans l’évaluation du risque pour l’environnement.
Quand on le compare à la CEE calculée ci-dessus pour les rejets industriels dans l’eau passant par une installation de traitement des eaux usées (0,0147 mg/L), le quotient de risque résultant (CEE/CESE) est de 0,0247/0,045 = 0,55. Par conséquent, il est estimé que la concentration de Disperse Orange 29 dans les eaux de surface au Canada qui résulteraient des rejets industriels passant par une installation de traitement primaire des eaux usées ne devrait pas être nocive pour les organismes aquatiques.
Concernant l’exposition attribuable aux rejets à l’égout issus d’utilisations par les consommateurs (scénario prudent), il est estimé d’après les résultats de Mega Flush que la CEE pour le Disperse Orange 29 ne dépassera pas la CESE quel que soit le site (c.-à-d. que tous les quotients de risque sont < 1). Le quotient de risque maximal calculé à partir de la CEE la plus élevée (8,6 x 10-4 mg/L) divisé par la CESE (0,045 mg/L) est de 0,019. Cela montre que les rejets des consommateurs dans le réseau d’égouts de Disperse Orange 29 ne devraient pas être nocifs pour les organismes aquatiques.
Par conséquent, il est peu probable que le Disperse Orange 29 soit nocif pour des populations d’organismes aquatiques au Canada.
Incertitudes dans l’évaluation des risques pour l’environnement
L’évaluation de la persistance est limitée par le manque de données sur la biodégradation, ce qui a nécessité la production de prévisions modélisées. Bien que toutes les prévisions modélisées comportent un certain degré d’erreur, les résultats du modèle de biodégradation aérobie ont confirmé la persistance attendue du Disperse Orange 29, compte tenu de ses utilisations et de ses caractéristiques structurales. De plus, l’évaluation de la persistance est limitée par les incertitudes quant à la vitesse de dégradation et à la mesure dans laquelle cette dégradation se produit dans des sédiments anaérobies ainsi qu’à la détermination de la biodisponibilité des produits de dégradation (p. ex. amines). On prévoit que les produits de dégradation seront peu biodisponibles étant donné qu’ils se forment seulement dans des sédiments anoxiques relativement profonds, mais la possibilité de perturbation de ces sédiments demeure. Ce point constitue donc une source d’incertitude dans l’évaluation de la toxicité du Disperse Orange 29.
L’évaluation de la bioaccumulation de cette substance a été limitée par le manque de données empiriques sur le Disperse Orange 29 et l’incapacité des modèles disponibles à estimer de façon fiable la bioaccumulation de colorants azoïques. L’évaluation était plutôt fondée sur l’utilisation de données sur la bioaccumulation pour un analogue structural (Disperse Orange 30).
Il existe également des incertitudes en raison de l’absence de données sur les concentrations de Disperse Orange 29 dans l’environnement au Canada. Cependant, l’absence de rapports sur la fabrication au Canada, les faibles quantités importées, le degré de fixation relativement élevé de ces colorants sur les textiles et le taux d’élimination prévu dans les effluents permettent de croire à un faible potentiel de rejet de ces substances dans les milieux aquatiques au Canada.
La fraction de la substance qui est rejetée et celle qui est éliminée dans les stations d’épuration des eaux usées constituent une autre source d’incertitude. Ces incertitudes ont été étudiées par l’utilisation d’hypothèses prudentes dans la modélisation de l’exposition.
Les concentrations expérimentales, associées à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, peuvent constituer une source additionnelle d’incertitude lorsqu’elles dépassent la solubilité du produit chimique dans l’eau (expérimentale ou prédite). Il existe également des incertitudes relativement à la pureté des substances utilisées dans les tests de solubilité et de toxicité. En raison de leur faible solubilité, les colorants sont souvent mélangés avec de l’eau et un agent solubilisant afin d’effectuer le test. Cette convention peut produire des valeurs de solubilité qui sont artificiellement élevées et qui peuvent également influer sur les résultats des tests de toxicité sur les organismes aquatiques. Toutefois, des mesures visant à rendre les colorants plus solubles peuvent augmenter artificiellement la biodisponibilité plutôt que de la diminuer. Par conséquent, malgré ces incertitudes, les données disponibles indiquent que le Disperse Orange 29 et ses analogues ne sont pas très dangereux pour les organismes aquatiques dans la colonne d’eau.
De plus, en ce qui concerne l’écotoxicité, le comportement de répartition prévu du Disperse Orange 29 et de ses analogues montre que les données disponibles sur les effets ne permettent pas d’évaluer comme il se doit l’importance du sol et des sédiments comme milieu d’exposition. En effet, les seules données sur les effets qui ont été trouvées s’appliquent principalement aux expositions aquatiques pélagiques, même si la colonne d’eau peut ne pas être le moyen le plus préoccupant à long terme d’après les estimations sur la répartition et les modèles de rejets.
Étant donné que la substance est utilisée dans d’autres pays, il est possible qu’elle entre sur le marché canadien comme composant d’articles manufacturés ou de produits de consommation. Les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête menée en vertu de l’article 71 et d’autres sources de renseignements indiquent qu’elle est peut-être présente dans un certain nombre de ces produits au Canada. Les renseignements disponibles ne sont actuellement pas suffisants pour donner une estimation quantitative permettant de définir l’importance de cette source dans l’évaluation écologique. Cependant, on prévoit que les volumes de rejets de Disperse Orange 29 dans les divers milieux naturels ne différeraient pas énormément des quantités estimées ici, bien que les quantités transférées vers le recyclage ou l’élimination des déchets puissent être supérieures. On reconnaît également la possibilité que des rejets proviennent des sites d’enfouissement, bien qu’ils soient difficiles à quantifier en raison du manque de données, et qu’ils contribuent à des concentrations environnementales globales.
Évaluation de l’exposition
Aucune donnée n’a été relevée sur le Disperse Orange 29 dans les milieux naturels. Les concentrations estimées dans l’environnement produites à l’aide de la version 6 du logiciel ChemCAN (ChemCAN, 2003) étaient fondées sur les pourcentages de pertes prévus par l’outil de débit massique tels qu’ils figurent au tableau 4 (Environnement Canada, 2010a). Les pourcentages ont été appliqués à la quantité totale de 2 000 kg de Disperse Orange 29 dans le commerce au Canada en 2006 (Environnement Canada, 2008a). Les quantités de pertes sont estimées à 296 kg pour les pertes dans l’eau à partir des eaux usées, à 0 kg pour les pertes dans l’air à partir des émissions atmosphériques, et à 0 kg dans le sol à partir des pertes vers les terres. La tranche supérieure des estimations de l’absorption de Disperse Orange qui en résulte pour chaque groupe d’âge de la population générale au Canada devrait être négligeable pour tous les milieux naturels.
Le Disperse Orange 29 est principalement utilisé dans le secteur du textile et du tissage pour teindre ou imprimer des tissus, des textiles et des vêtements comme les polyesters et les polyamides. Les colorants dispersés tirent leur nom du processus de teinture utilisé (EPA du Danemark, 1999). En raison de leur faible solubilité dans l’eau, les composés de colorant sont traditionnellement moulus en vue d’obtenir une fine poudre qui est ensuite dispersée dans de l’eau.
Les vêtements fabriqués à partir de tissu teint au Disperse Orange 29 sont une source d’exposition potentielle de la population générale. Les nourrissons et les tout-petits pourraient aussi être exposés par la voie orale en mâchonnant du tissu contenant ce colorant. La tranche supérieure des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée est présentée à l’annexe 3. Les détails des hypothèses utilisées dans ces estimations de l’exposition sont indiqués à l’annexe 4. L’exposition cutanée a été évaluée entre 0,1 et 2 µg/kg p.c. par jour pour les adultes et entre 0,2 et 4 µg/kg p.c. par jour pour les nourrissons de 0 à 6 mois à un taux de lessivage évalué entre 0,03 % et 0,5 % (ETAD, 2004; Kraetke et Platzek, 2005). La plage du taux de lessivage représente un nouveau vêtement non lavé qui possède des propriétés de solidité de la couleur de bonnes à faibles (ETAD, 1997). L’exposition des nourrissons et des tout-petits (âgés de 6 mois à 4 ans) au Disperse Orange 29 devrait en outre avoir une composante orale, attribuable au mâchonnement; elle est estimée à 0,1 µg/kg p.c. par jour. Ces estimations représentent les expositions aux limites supérieures, car les colorants devraient être lessivés du tissu principalement pendant le lavage. De plus, une récente étude a comparé la migration d’un colorant dispersé d’un vêtement vers la peau de volontaires humains avec sa migration d’un vêtement vers un produit simulant de la sueur. Une étude récente a déterminé que la quantité de colorant dispersé migrant sur la peau de volontaires humains était jusqu’à 600 fois plus faible que celle émise par les stimulants sudorifiques (Meinke et al., 2009). Dans l’ensemble, cela confirme la nature prudente de la tranche supérieure des estimations de l’exposition.
Évaluation des effets sur la santé
Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’a été relevée pour le Disperse Orange 29 et aucun colorant azoïque dispersé analogue apparenté sur lequel on aurait disposé de données concernant la santé n’a été relevé. Par conséquent, le profil toxicologique du Disperse Orange 29 est principalement fondé sur les données relatives aux produits potentiels de rupture des liaisons azoïques et la prise en compte des résultats de modèles de relations quantitatives structure-activité (RQSA).
Étant donné que le Disperse Orange 29 est un membre de la famille des colorants azoïques, les données sur la classe azoïque des substances ont été considérées dans la présente évaluation. Il a été démontré que les colorants azoïques peuvent subir une rupture réductrice par des enzymes azoréductase présents dans les tissus mammaires et dans les bactéries de l’intestin et de la peau (p. ex., Golka et al., 2004; Platzek, 1999; Chen, 2006; Stingley et al., 2010). Même s’il est reconnu que le degré de réduction azoïque est susceptible d’être influencé par divers facteurs (p. ex. la solubilité du composé d’origine, présence ou position des substituants moléculaires), les données relatives aux effets sur la santé sur des produits potentiels de rupture des liaisons azoïques sont considérées comme pertinentes pour la caractérisation des effets sur la santé du composé d’origine, car l’exposition au colorant azoïque peut entraîner une exposition à ses produits apparentés de rupture des liaisons azoïques, habituellement des amines aromatiques. D’après le potentiel du Disperse Orange 29 à subir une rupture de ses liaisons azoïques, des données utiles sur les produits potentiels issus de cette rupture sont aussi considérées dans la présente évaluation : 4-aminophénol (n° CAS 123-30-8), 2,5-diaminoanisole (n° CAS 5307-02-8), et 4-nitroaniline (n° CAS 100-01-6) (voir le tableau 8 pour connaître leurs structures et le type de données disponibles). Des évaluations et des profils de toxicité internationaux des produits potentiels susmentionnés résultant de la rupture des liaisons azoïques ont été pris en compte dans l’établissement de la base de données concernant les effets du Disperse Orange 29 sur la santé. Un sommaire de ces données est présenté ci-dessous.
Tableau 8. Structure chimique du Disperse Orange 29 et possibles produits de rupture des liaisons azoïques pris en compte dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
| Identification de la substance | Structure | Données considérées/disponibles |
|---|---|---|
| Disperse Orange 29 | ||
| Disperse Orange 29 CI 26077 N° CAS 19800-42-1 |
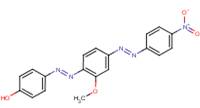 |
RQSA |
| Possibles produits de rupture des liaisons azoïques | ||
| 4-nitroaniline N° CAS 100-01-6 |
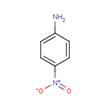 |
RQSA Bioessais de deux ans chez les rats et les souris Étude de la reproduction et du développement des rats et des souris Test d’Ames |
| 4-aminophénol N° CAS 123-30-8 |
RQSA Ensemble de données IUCLID (IUCLID, 2000) Essai sur des lymphomes de souris Essai du micronoyau in vivo Tests d’Ames Étude orale de six mois chez les rats Étude de la reproduction et du développement chez les rats |
|
| 2,5-diaminoanisole N° CAS 5307-02-8 |
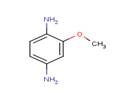 |
RQSA Test d’Ames Essai létal dominant chez les rats Données d’analogues sur l’isomère (2,5-diaminoanisole) |
La Commission européenne a classé le 4-aminophénol (n° CAS 123-30-8) parmi les mutagènes conformément à la directive du CLP[2] (Commission européenne, 2008; ESIS, 2010). L’analyse de mutation du lymphome de la souris a donné des résultats positifs (Majeska et Holden, 1995). Le 4-aminophénol a induit un accroissement du nombre d’hépatocytes micronucléés lorsqu’il a été administré par voie intrapéritonéale (IP) à des souris (Cliet et al., 1989). De plus, l’administration par voie IP à des souris a entraîné la formation de micronoyaux dans la moelle osseuse (Wildet al., 1981). Cependant, le 4-aminophénol n’a pas induit d’augmentation de la formation de micronoyaux dans la moelle osseusse lorsqu’il a été administré par voie orale à des souris (Wild et al., 1981). Des tests in vitro de mutagénicité dans les bactéries étaient principalement négatifs (Zeiger et al., 1988). Le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) a conclu que la substance 4-aminophénol était génotoxique in vivo etin vitro (CSPC, 2005). On ne dispose d’aucune donnée empirique permettant d’évaluer la cancérogénicité du 4-aminophénol. La substance 4-aminophénol a eu des effets sur des tubes contournés proximaux rénaux dans un modèle in vitro (Lock et al., 1993) et a eu des effets sur les reins (néphropathie) chez les rats ayant reçu une dose élevée de 0,07, 0,2 ou 0,7 % dans leur alimentation pendant six mois (Burnett et al., 1989). Une récente étude portrait sur la toxicité du 4-aminophénol sur la reproduction et le développement dans des groupes de 12 rats à qui l’on administrait 0, 20, 100 ou 500 mg/kg p.c. par jour par gavage. Chez les femelles, l’exposition débutait 14 jours avant l’accouplement et se poursuivait jusqu’au troisième jour de lactation. Les mâles recevaient des doses pendant une période de 49 jours qui débutait 14 jours avant l’accouplement. Parmi ceux qui ont reçu une dose élevée, quatre mâles et deux femelles sont décédés et ceux qui ont survécu avaient une urine brune à 100 mg/kg p.c. par jour et plus. Le gain de poids et la consommation de nourriture ont diminué à 500 mg/kg p.c. par jour. À dose élevée, les effets sur l’appareil reproducteur des mâles et sur les fœtus en développement étaient évidents. Dans cette étude, les auteurs ont constaté une dose sans effet nocif observé (DSENO) sur la reproduction ou le développement de 100 mg/kg p.c. par jour (Harada et al., 2008).
Un test de mutagénicité inverse de la substance 2,5-diaminoanisole (n° CAS 5307-02-8) a été positif dans des tests d’Ames standards sur des souches de Salmonella typhimurium TA98 et TA100 avec et sans activation S9 (Degawaet al., 1979; Koovi et al., 1987; Esancy et al., 1990), dans TA1538 avec activation S9 (Ames et al., 1975; White et al., 1977; Robertson et al., 1983), et dans TA100 avec un système d’activation modifié dans lequel était utilisée une cyclo-oxygénase H purifiée (Sarkar et al., 1992). Cette substance a également causé des fractions de l’ADN en simple brin dans des lymphocytes de peau humaine cultivée sans activation métabolique, ce qui indique une interaction directe avec l’ADN (Nordenskjoldet al., 1984), et a induit une synthèse imprévue de l’ADN dans les hépatocytes primaires de rats (Bradlaw et al., 1981). Toutefois, la mutagénicité du 2,5-diaminoanisole était négative au locus TK des cellules de lymphomes de souris (L5781Y) avec et sans activation S9 (Palmer et al., 1978). Elle était également négative dans le test létal dominant chez les rats (Sheu et Green, 1979). Il n’existe aucune donnée empirique permettant d’évaluer la cancérogénicité du 2,5-diaminoanisole. Dans une étude de l’administration périodique, l’isomère structural du 2,5-diaminoanisole et du 2,4-diaminoanisole (n° CAS 615-05-4) était positif pour la cancérogénicité chez les souris et les rats des deux sexes (NTP, 1978) et pour le National Toxicology Program, il est « raisonnablement considéré comme un agent cancérogène pour les humains » (NTP, 2005). De plus, la Commission européenne a classé l’isomère 2,4- comme cancérogène et mutagène dans son règlement CLP (Commission européenne, 2008), comme agent cancérogène 2B du CIRC (CIRC, 2001) et il est réglementé en Europe dans le cadre du programme REACH parmi les 22 amines aromatiques libérés des colorants diazoïques qui pourraient ne pas se trouver dans certains articles textiles ou de cuir (Commission européenne, 2006). L’utilisation du diaminoanisole 2,5- et 2,4-, ainsi que de leurs sels, a été interdite dans les cosmétiques en vertu de la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques (Santé Canada, 2009) et de l’Annexe II de la Directive européenne sur les cosmétiques (Commission européenne, 2010).
Le test de mutagénicité de la substance 4-nitroaniline (n° CAS 100-01-6) a été positif dans certains essais bactériologiques in vitro, mais pas dans les autres (ACGIH, 1991). Un activateur S9 dérivé du foie de hamster rendait la 4-nitroaniline plus mutagène que celui dérivé du foie de rat dans les essais de mutation inverse sur bactéries (ACGIH, 1991). La cancérogénicité et la toxicité sur le plan de la reproduction se sont également révélées nulles pour la 4-nitroaniline d’après une étude sur l’exposition des rats par voie orale (Nair et al., 1990. Chez les souris, des hémangiosarcomes ont été observés, et étaient considérés comme une preuve équivoque de cancérogénicité (CCRIS, 2009). La 4-nitroaniline induit de la méthémoglobine chez les humains, ce qui peut mener à l’anoxie et à l’hémolyse si l’exposition est suffisamment élevée ou prolongée. Des effets nocifs sur le foie ont également été constatés chez les humains (ACGIH, 1991).
Dans une récente étude, un mélange renfermant du 4-aminophénol, de la 4-nitroaniline et un autre composé (du 4-nitrophénol) a été administré par voie gastrique à des rats mâles et femelles, cela en doses de 5, 25 ou 50 mg/kg p.c. par jour pendant 4 semaines. Des différences significatives ont été observées entre les témoins et les animaux ayant reçu des doses de 25 ou 50 mg/kg p.c. par jour au plan de la prise de poids corporel (p < 0,05 pour les femelles). Les paramètres biochimiques (SGPT, SGOT, GTP, urée, cholestérol total, protéines totales, albumine et créatinine) avaient tous connu une hausse significative chez les animaux traités à 50 mg/kg p.c. par jour. Le nombre d’érythrocytes, de leucocytes et de réticulocytes ainsi que la teneur en hémoglobine étaient significativement accrus chez le groupe traité à la plus forte dose, comparativement aux témoins. Les concentrations de méthémoglobine avaient subi une hausse importante au bout de 3 semaines de traitement chez les sujets exposés à 50 mg/kg p.c. par jour, et au bout de 4 semaines chez les animaux exposés à 25 ou à 50 mg/kg p.c. par jour. On a observé des lésions au niveau du foie, des reins, de la rate, du cervelet et du système hématopoïétique (Zhang et Wang, 2009).
Les prévisions tirées des modèles de relation quantitative structure-activité (RQSA) (CASETOX, DEREK, TOPKAT) sur la génotoxicité et la cancérogénicité du Disperse Orange 29 ont également été considérées dans la présente évaluation. Les prévisions relatives au cancer d’après le modèle DEREK étaient positives. Toutefois, les prévisions tirées du modèle CASETOX étaient en grande partie non concluantes. Les résultats du modèle TOPKAT étaient équivoques. Pour les modèles de génotoxicité, le modèle DEREK prédisait que le Disperse Orange 29 serait positif dans le test d’Ames et était non concluant dans un modèle d’aberration chromosomique. CASETOX a prédit un résultat négatif dans le test d’Ames, un résultat positif dans le test d’aberration chromosomique, était négatif pour l’induction du micronoyau, et non concluant dans un modèle d’étude de la mutation du lymphome chez les souris. TOPKAT a été non concluant pour la mutagénicité in vitro. Les résultats des prévisions des modèles pour le Disperse Orange 29 et ses produits potentiels de rupture des liaisons azoïques sont présentés à l’annexe 6.
Caractérisation du risque pour la santé humaine
On ne dispose d’aucune donnée empirique sur la santé pour le Disperse Orange 29.
Cette substance appartient au groupe des substances azoïques qui peuvent rejeter des amines aromatiques par rupture réductrice de la liaison azoïque. Bien qu’aucune donnée chimique sur la réduction des liaisons azoïques du Disperse Orange 29 n’ait été relevée, une hypothèse prudente a été de supposer le rejet potentiel d’amines aromatiques après une exposition de cette substance. Comme une cancérogénicité et une génotoxicité sont souvent associées aux amines aromatiques, on a considéré ces paramètres comme étant les effets critiques qui pourraient découler de l’exposition au Disperse Orange 29. Par conséquent, les données relatives aux effets sur la santé des amines aromatique pouvant être libérées du Disperse Orange 29 ont été prises en compte. L’Union européenne a classé la substance 4-aminophénol comme mutagène (ESIS, 2010). De plus, des tests de mutagénicité de la substance 2,5-diaminoanisole ont été positifs, elle comporte une structure similaire à celle du 2,4’-diaminoanisole, ce qui a démontré un potentiel génotoxique et cancérogène (CIRC, 2001; NTP, 2005). Les résultats des tests de mutagénicité de la substance 4-Nitroaniline étaient mixtes. D’après les renseignements sur ces produits potentiels de rupture des liaisons azoïques, on estime que le Disperse Orange 29 peut présenter un danger potentiel.
On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au Disperse Orange 29 provenant des milieux naturels soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 dans ses utilisations comme colorant dans les textiles et les tissus; toutefois, l’exposition cutanée et orale estimée devrait être faible.
Bien qu’on reconnaisse les dangers potentiels du Disperse Orange 29 en raison de la formation possible d’amines aromatiques provenant de la rupture des liaisons azoïques, compte tenu de la faible exposition prévue de la population générale, le risque pour la santé humaine est jugé faible aux niveaux d’exposition actuels.
Incertitudes de l’évaluation des risques pour la santé humaine
La confiance dans la base de données concernant les effets du Disperse Orange 29 sur la santé est considérée comme faible puisqu’on n’a trouvé aucune donnée empirique à ce sujet pour le Disperse Orange 29 ou des colorants azoïques structurels analogues. De plus, comme il n’y a aucune donnée empirique indiquant le potentiel de cette substance de subir une rupture réductrice de ses liaisons azoïques, les données examinées sur les métabolites potentiels ne sont peut-être pas nécessairement associées à l’exposition au Disperse Orange 29.
Des incertitudes existent quant à l’évaluation de l’exposition. Les sources d’exposition au Disperse Orange 29 ont été caractérisées principalement comme étant les tissus synthétiques, et des estimations de l’exposition ont été dérivées pour des scénarios prudents comprenant les vêtements, étant donné l’absence de données plus précises sur le profil d’utilisation de la substance. Toutefois, on a confiance que les valeurs d’exposition modélisées présentées dans la présente évaluation surestiment la véritable exposition en raison de la nature prudente des hypothèses émises.
D’après les renseignements contenus dans la présente version finale de l’évaluation préalable, le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, cette substance répond aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Même si le danger potentiel du Disperse Orange 29 est reconnu, d’après un examen global des données disponibles sur les effets sur la santé et la faible exposition prévue de la population générale, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Il est donc conclu que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Par conséquent, il est conclu que le Disperse Orange 29 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Considérations dans le cadre d’un suivi
Le Disperse Orange 29 appartient à un groupe des substances azoïques qui peuvent être métabolisées en amines aromatiques, une classe de composés chimiques connus pour présenter des propriétés dangereuses, notamment une cancérogénicité. Par conséquent, des activités supplémentaires (p. ex., recherche, évaluation, contrôle et surveillance) peuvent être entreprises afin de caractériser le risque présenté par ce vaste groupe de substances azoïques pour la santé humaine au Canada. Un avis d’intention décrivant la façon dont Santé Canada et Environnement Canada étudieront ce groupe de substances se trouve à l’adresse Internet des Substances chimiques.
ACD/pKaDB [module de prévision]. 2005. Version 9.04. Toronto (Ont.) : Advanced Chemistry Development. [réserve de consultation].
[ACGIH] American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. 1991. Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. 6th ed. Volumes I, II, III. Cincinnati (OH) : ACGIH, p. 1094.
Ames, B.N., Kammen, H.O., Yamasaki, E. 1975. Hair Dyes Are Mutagenic: Identification of a Variety of Mutagenic Ingredients.Proc. Nat. Acad. Sci. 72(6):2423-2427.
Anliker, R., Clarke, E.A., Moser, P. 1981. Use of the partition coefficient as an indicator of bioaccumulation tendency of dyestuffs in fish. Chemosphere 10(3):263-274.
Anliker, R., Moser, P. 1987. The limits of bioaccumulation of organic pigments in fish: their relation to the partition coefficient and the solubility in water and octanol.Ecotoxicol. and Environ. Safety 13:43-52.
Anliker, R., Moser, P., Poppinger, D. 1988. Bioaccumulation of dyestuffs and organic pigments in fish. Relationships to hydrophobicity and steric factors. Chemosphere17(8):1631-1644.
Arnot, J.A., Arnot, M., Mackay, D., Couillard, Y., MacDonald, D., Bonnell, M., Doyle, P. 2010. Molecular size cut-off criteria for screening bioaccumulation potential: Fact or fiction?Integrated Environmental Assessment and Management6(2):210-224.
Aronson, D., Boethling, B., Howard, P., Stiteler, W. 2006. Estimating biodegradation half-lives for use in chemical screening.Chemosphere 63:1953-1960.
BASF. 1990. Bericht uber die Prufung der akuten Toxizitit an der Goldorfe (Leuciscus idus L.,. Goldvariante). Présenté par ETAD à Environnement Canada le 13 août 2008 par courriel.
Baughman, G.L., Perenich, T.A. 1988. Fate of dyes in aquatic systems: I. Solubility and partitioning of some hydrophobic dyes and related compounds. Environ. Toxicol. Chem.7(3):183-199.
Baughman, G.L., Weber, E.J. 1994. Transformation of dyes and related compounds in anoxic sediment: kinetics and products.Environ. Sci. Technol. 28(2):267-276.
Baughman, G.L., Bannerjee, S., Perenich, T.A. 1996. Dye Solubility. In: Physico-chemical Principles of Color Chemistry. Peters, A.T., Freeman, H.S. (éditeurs). Advances in Color Chemistry Series, Vol. 4. Glasgow (Écosse) : Blackie Academic and Professional Publishers. p. 145-195.
[BBM] Baseline Bioaccumulation Model. 2008. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. [modèle basé sur celui de Dimitrov et al., 2005]. Document disponible sur demande.
[BIOWIN] Biodegradation Probability Program for Windows [modèle d’estimation]. 2008. Version 4.02. Washington (DC) : US Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics; Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation. Outils d'évaluation de l'exposition et des modèles.
Boethling, R.S., Howard, P.H., Beauman, J.A., Larosche, M.E. 1995. Factors for intermedia extrapolations in biodegradability assessment. Chemosphere 30(4):741-752.
Bradlaw, J.A., Hauswirth, J.W., Thomas, C.A. 1981. Induction of unscheduled DNA synthesis (UDS) in primary rat hepatocytes by some hair dye components. Environ. Mut. 3:398 (extrait de la rencontre).
Braun, H. 1991. A new method for the determination of the solubility of disperse dyes. JSDC 107:77-83.
Brown, D. (ICI Group Environmental Laboratory, Brixham, Royaume-Uni). Environmental assessment of dyestuffs. Rédigé pour le compte de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers, Bâle (Suisse), ETAD ecological sub-committee project E3020, 1992. Présenté à Environnement Canada le 9 mai 2008.
Brown, D. 1987. Effects of colorants in the aquatic environment.Ecotox Environ. Safe 13:139-147.
Burnett, C.M., Ta, R.E., Rodiguez, S., Loehr, R.F., Dressler, W.E. 1989. The toxicity of p-aminophenol in the Sprague-Dawley rat: effects on growth, reproduction and foetal development. Fd. Chem. Toxic. 27(10):691-698.
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C., 1999, ch. 33.
Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107.Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, n° 7.
Canada, Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 49.
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorité pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 9.
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2008a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis de sixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi. Canada Gazette. Partie I, vol. 142, n° 22.
Canada. Ministère de l’Environnement. 2008b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le sixième lot du Défi. Canada Gazette. Partie I, vol. 142, n° 22.
CASETOX [module de prévision]. 2008. Version 2.0. Beachwood (OH) : MultiCASE Inc. CASETOX [réserve de consultation].
[CATABOL] Probabilistic assessment of biodegradability and metabolic pathways [modèle informatique]. c2004-2008. Version 5.10.2. Bourgas (Bulgarie) : Prof. Assen Zlatarov University, Laboratory of Mathematical Chemistry. CATALOGIC.
[CCRIS] Chemical Carcinogenesis Research Information System. 2009. P-Nitroaniline: CASRN: 100-01-6 [consulté en mars 2010].
ChemCAN [modèle de fugacité de niveau III pour 24 régions du Canada]. 2003. Version 6.00. Peterborough (Ont.) : Trent University, Le centre canadien de modélisation et de chimie environnementales [consulté en janvier 2010].
Chen, H. 2006. Recent advances in azo dye degrading enzyme research. Curr. Prot. Pept. Sci. 7:101-111.
[CII] Color Index International [base de données sur Internet]. 2002- . 4e éd. Research Triangle Park (NC) : American Association of Textile Chemists and Colorists. Indice de couleur international [consulté le 3 février 2009].
[CIRC] Centre International de Recherche sur le Cancer. 2001. IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 79: Some Thyrotropic Agents. Résumé des données publiées et les évaluations.
Clariant. 1996. Ensemble de données IUCLID pour le C.I. Disperse Blue 79 (N° CAS 12239-34-8) [base de données sur Internet] [consulté le 28 octobre 2008].
Cliet, I., Fournier, E., Melcion, C., Cordier, A. 1989. In vivo micronucleus test using mouse hepatocytes. Mut Res216:321-326.
Cohle, P., Mihalik, R. 1991. Early life stage toxicity of C.I. Disperse Blue 79:1 purified presscake to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a flow-through system. Rapport final. Columbia (MO) : ABC Laboratories Inc.
Commission européenne. 2006. Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Commission européenne. 2008. Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Commission européenne. 2010. European Commission "Cosmetics Directive" 76/768/EEC (Cosmetics Directive) Base de données des ingrédients et substances.
[ConsExpo] Consumer Exposure Model [en ligne]. 2006. Version 4.1. Bilthoven (Pays-Bas) : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut national néérlandais de la santé publique et de l’environnement). ConsExpo 4.1.
[CPOP] Canadian POPs Model. 2008. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes; Bourgas (Bulgarie) : Prof. Assen Zlatarov University, Laboratory of Mathematical Chemistry. [Modèle élaboré à partir de celui de Mekenyan et al., 2005]. Disponible sur demande.
[CSPC] Comité scientifique des produits de consommation. 2005, SCCP. Opinion sur p-Aminophenol. COLIPA No. A16.
[EPA du Danemark] Danish Environmental Protection Agency. 1999.Enquête sur les colorants azoïques au Danemark. Consumption, use, health and environmental aspects. MiljØprojekt No. 509. Henriette, Danish Technological Institute, Environment, Ministry of Environment and Energy, Denmark, Danish Environmental Protection Agency, 1999. Rapport préparé par Øllgaard, H., Frost L, Galster J, Hansen OC.
Datyner, A. 1978. The solubilisation of disperse dyes by dispersing agents at 127ºC. JSDC June 256-260.
Degawa, M., Shoji, Y., Masuko, K., Hashimoto, Y. 1979. Mutagenicity of metabolites of carcinogenic aminoazo dyes.Cancer Lett. 8(1):71-6.
[DEREK] Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge [module de prévision sur CD-ROM]. 2008. Version 10.0.2. Cambridge (MA) : Harvard University, LHASA Group.. Prédiction de toxicologie [réserve de consultation].
Dimitrov, S, Dimitrova, N., Walker, J., Veith, G., Mekenyan, O. 2002. Predicting bioconcentration potential of highly hydrophobic chemicals. Effect of molecular size. Pure Appl. Chem. 74(10):1823-1830.
Dimitrov, S., Dimitrova, N., Parkerton, T., Comber, M., Bonnell, M., Mekenyan, O. 2005. Base-line model for identifying the bioaccumulation potential of chemicals. SAR QSAR Environ. Res. 16(6):531-554.
Environnement Canada. 1988. Données de la Liste intérieure des substances (LIS), 1984-1986, recueillies en vertu du paragraphe 25(1) de la LCPE (1988), et conformément à la Liste intérieure des substances : guide du déclarant. Données préparées par : Environnement Canada.
Environnement Canada. 1995. NSN submission. Données présentées à la Division des substances nouvelles d’Environnement Canada dans le cadre du Programme de renseignements concernant les substances nouvelles.
Environnement Canada. 2000. Environmental Categorization for Persistence Bioaccumulation and Inherent Toxicity of Substances on the Domestic Substances List Using QSARs. Rapport final. Division de l’évaluation des produits chimiques, Environnement Canada, juillet.
Environnement Canada. 2006. Données pour certaines substances recueillies en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), article 71 : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Données préparées par Environnement Canada, Santé Canada, Programme des substances existantes.
Environnement Canada. 2008a. Données sur les substances du lot 6 recueillies en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le deuxième lot du Défi. Données préparées par Environnement Canada, Programme des substances existantes
Environnement Canada. 2008b. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: Mass Flow Tool. Document de travail préliminaire. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2008c. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: Mega Flush consumer release scenario. Document de travail préliminaire. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2009. Guidance for conducting ecological assessments under CEPA, 1999: science resource technical series, technical guidance module: the Industrial Generic Exposure Tool - Aquatic (IGETA). Document de travail. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2010a. Assumptions, limitations and uncertainties of the Mass Flow Tool for Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1. [consulté le 27 juillet 2010]. Document provisoire interne. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. Document disponible sur demande.
Environnement Canada. 2010b. Rapport IGETA : Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1, version [consulté le 27 juillet 2010]. Rapport inédit. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
Environnement Canada. 2010c. Rapport MegaFlush : Disperse Orange 29, CAS RN 19800-42-1 [consulté le 27 juillet 2010]. Rapport inédit. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes.
[EPIsuite] Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows [modèle d’estimation]. 2008. Version 4.0 Washington (DC) : US Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics; Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation. Outils d'évaluation de l'exposition et des modèles.
Esancy, J.F., Freeman, H.S., Claxton, L.D. 1990. The effect of alkoxy substituents on the mutagenicity of some aminoazobenzene dyes and their reductive-cleavage products. Mut. Res. 238:1-22.
[ESIS] European Chemical Substances Information System [base de données sur Internet]. 2008. Version 5. Bureau Européen des Substances Chimiques (BESC). [consultée le 13 février 2009].Système d'information des substances chimiques européenne.
[ESIS] European Chemical Substances Information System [base de données sur Internet]. 2010. Bureau Européen des Substances Chimiques (BESC). CLP/GHS Search of Annex VI [consultée en juin 2010].
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Canadian Affiliates, Dayan, J., Trebitz, H., consultants. 1995. Health and environmental information on dyes used in Canada. Rapport inédit présenté à Environnement Canada, Division des substances nouvelles. En page couverture : An overview to assist in the implementation of the New Substances Notification Regulations under the Canadian Environmental Protection Act.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 1992. Draft Guidelines for the Assessment of Environmental Exposure to Dyestuffs.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 1997. Extractability of dyestuff from textiles over a normal lifetime of use. Mars 1997.
[ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Information received in support of DSL categorization for 12 disperse dyes. Courriel daté du 27 octobre 2005.
Farbchemie Braun, K.G. 2008. Fantagen Disperse Dyes pour polyester [en ligne].
Golka, K., Kopps, S., Myslak, Z.W. 2004. Carcinogenicity of azo colorants: influence of solubility and bioavailabilty. Toxicol. Lett. 151(1):203-210.
Haag, W.R., Mill, T. 1987. Direct and indirect photolysis of water-soluble azodyes: kinetic measurements and structure-activity relationships. Environ. Toxicol. Chem. 6:359-369.
Harada, T., Kimura, E., Hirata-Koizumi, M., Hirose, A., Kamata, E., Ema, M. 2008. Reproductive and developmental toxicity screening study of 4-aminophenol in rats. Drug Chem. Toxicol. 31:473-486.
Hunger, K. (éd). 2003. Industrial dyes; chemistry, properties, applications. Weinheim (Allemagne) : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
Inde. 1997. Ministry of Environment and Forests Notification, Prohibition on the Handling of Azodyes. The Gazette of India Extraordinary. Part II- Sec. 3(ii). Annexure 10. REGD. NO. D.L.-33004/97.
Industrie Canada. 2008a. Réseau des entreprises canadiennes.
Industrie Canada. 2008b. Finissage de textiles et de tissus [SCIAN 31331] : 2004-2007 et Revêtement de tissus [SCIAN 31332] : 2004-2007. Préparé par la Direction de l’habillement et des textiles, Direction générale des industries de services et des produits de consommation (DGISPC), Industrie Canada. Demandes de renseignements : B. John (Jazz) Szabo, 613-957-1242 ou szabo.john@ic.gc.ca.
[IUCLID] International Uniform Chemical Information Database. 2000. IUCLID Dataset: Substance ID: 123-30-8, 4-aminophenol.
Koovi, D.G., Mamane, R., Callais, F., Festy, B., Lich, N.P. 1987. Study on the genotoxicity of 2-amino-5-nitroanisole (ANA) and its metabolites. Ann. Falsif. Expert. Chim. Toxicol. 80(854):25-39.
Kraetke, R.M., Platzek, T. 2005. Exposure to chemicals in clothing textiles: Methods and models. Occupational and Environmental Exposure of Skin to Chemicals.
Lock, E.A., Cross, T.J., Schnellmann, R.G. 1993. Studeis on the mechanisms of 4-aminophenol-induced toxicity to renal proximal tubules. Hum. Exp. Toxicol. 12(5):383-388.
Majeska, J.B., Holden, H.E. 1995. Genotoxic effects of p-aminophenol in Chinese hamster ovary and mouse lymphoma cells: Results of a multiple endpoint test. Environ. Mol. Mutagen. 26:163-170.
Meinke, M., Abdollahnia, M., Gähr, F., Platzek, T., Sterry, W., Lademann, J. 2009. Migration and penetration of a fluorescent textile dye into the skin--in vivo versus in vitro methods. Experimental Dermatology18(9):789-792.
Mekenyan, G., Dimitrov, S.D., Pavlov, T.S., Veith, G.D. 2005. POPs: A QSAR system for creating PBT profiles of chemicals and their metabolites. SAR QSAR Environ. Res.16(1-2):103−133.
[MITI] Ministry of International Trade & Industry (Japon). 1992. Biodegradation and bioaccumulation data of existing chemicals based on the CSCL Japan, Basic Industries Bureau, Chemical Products Safety Division. Japan Chemical Industry Ecology-Toxicology & Information Centre,Tokyo (Japon).
Nair, R.S., Auletta, C.S., Schroeder, R.E., Johannsen, F.R. 1990. Chronic toxicity, oncogenic potential, and reproductive toxicity of p-nitroaniline in rats. Fund Appl Toxicol 15:507-621.
[NCI] National Chemical Inventories [base de données sur cédérom]. 2006. Columbus (OH) : American Chemical Society. [consultée le 11 décembre 2006]. Inventaire nationale des produits chimiques sur CD.
Nishida, K., Ando, Y., Ohwada, K., Mori, T., Koide, M., Koukitsu, A. 1989. Vapour pressures and heats of sublimation of some azo disperse dyes. JSDC 105:112-114.
Nordenskjold, M., Andersson, B., Rahimtula, A., Moldeus, P. 1984. Prostaglandin synthase-catalyzed metabolic activation of some aromatic amines to genotoxic products. Mut. Res.127:107-112.
Norris, B., Smith, S. 2002. Les recherches des enfants jusqu'à 5 ans sur le comportement de mettre des objects dans leur bouche. Rapport commandé par Consumer and Competition Policy Directorate, UK Department of Trade and Industry, Londres (Royaume-Uni).
[NTP] United States National Toxicology Program. 1978. Rapport de toxicologie TR-84 : Essais biologiques du sulfate de 2,4-diaminoanisole pour cancérogénicité possible (CASRN 615-05-4).
[NTP] United States National Toxicology Program. 2005. 11th Report on Carcinogens (RoC): 2,4-Diaminoanisole Sulfate (CAS RN 615-05-4).
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 1996. Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, n° 305B. Bioconcentration : Essai semi-statique chez le poisson. Paris : OCDE, adoptée en juin 1996.
[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 2004. Draft emission scenario on textile manufacturing wool mills [en ligne]. Paris (France) : Direction de l’environnement de l’OCDE. Rapport n° : ENV/JM/EEA(2004)8/1/REV, JT00175156. [consulté le 16 février 2009].
Odabasoglu, M., Çakmak, S., Turgut, G., Içbudak, H. 2003. Preparation and characterization of chromophor group containing cyclotriphosphazenes: III bis-azo chromophor carrying some cyclotriphosphazenes. Phosphorus, Sulfur and Silicon178:549-558.
Pagga, U., Brown, D. 1986. The degradation of dyestuffs: Part II Behaviour of dyestuffs in aerobic biodegradation tests. Chemosphere. 15, 4, 479-491.
Palmer, K.A., Denunzio, A., Green, S. 1978. The mutagenic assay of some hair dye components, using the thymidine kinase locus of L5178Y mouse lymphoma cells. J. Environ. Pathol. Toxicol. 1(1):87-91.
[PhysProp] Interactive PhysProp Database [base de données sur Internet]. 2006. Syracuse (NY) : Syracuse Research Corporation.Démo de la base de données intéractives PhysProp [consulté le 16 février 2009].
Prikryl, J., Rusicka, Burgert, L. 1979. A new method of determining the solubility of disperse dyes. JSDC octobre: 349-351.
Platzek, T., Lang, C., Grohmann, G., Gi, U.S., Baltes, W. 1999. Formation of a carcinogenic aromatic amine from an azo dye by human skin bacteria in vitro. Hum. Exp. Toxicol. 18(9):552-559.
Présentation de projet. 2008a. Projet non publié et confidentiel présenté à la Division des substances existantes d’Environnement Canada dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Sommaire de rigueur d’étude, n° 11887Challenge006.
Présentation de projet. 2008b. Projet non publié et confidentiel présenté à la Division des substances existantes d’Environnement Canada, selon le Plan de gestion des produits chimiques. Sommaire de rigueur d’étude, n° 12890Challenge006.
[QPC] Qianjiang Printing & Chemical Co., Ltd. 2004. Products: Disperse Orange 29 [en ligne].
Razo-Flores, E., Luijten, M., Donlon, B., Lettinga, G., Field, J. 1997. Biodegradation of selected azo dyes under methanogenic conditions. Wat. Sci. Technol. 36(6-7):65-72.
Robertson, I.C.G., Sivarajah, K., Eling, T.E., Zeiger, E. 1983. Activation of Some Aromatic Amines to Mutagenic Products by Prostaglandin Endoperoxide Synthetase. Cancer Res. 43:476-480.
Sakuratani, Y., Noguchi, Y., Kobayashi, K., Yamada, J., Nishihara, T. 2008. Molecular size as a limiting characterisitic for bioaccumulation in fish. J. Environ. Biol.29(1):89-92.
Santé Canada. 1995. Exposure factors for assessing total daily intake of priority substances by the general population of Canada. Rapport inédit. Ottawa (Ont.) : Santé Canada. Direction de l’hygiène du milieu.
Santé Canada 2007. Règlement sur les aliments et drogues, partie B − aliments.
Santé Canada. 2009. Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques.
Sarkar, F.H., Radcliff, G., Callewaert, D.M. 1992. Purified prostaglandin synthase activates aromatic amines to derivatives that are mutagenic to Salmonella typhimurium. 282:273-281.
Shen, G., Hu, S. 2008. Bioconcentration Test of C.I. Disperse Orange 30 in Fish. Préparé par Environmental Testing Laboratory, Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai (Chine) pour Dystar au nom de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD), Bâle (Suisse). Rapport n° S-070-2007. Présenté à Environnement Canada en avril 2008. N° de déclaration dans le cadre du Défi : 8351.
Sheu, C.J.W., Green, S. 1979. Dominant lethal assay of some hair-dye components in random-bred male rats. Mutat. Res. 68:85-98.
Sijm, D.T.H.M., Schuurmann, G., deVries, P.J., Opperhuizen, A. 1999. Aqueous solubility, octanol solubility, and octanol/water partition coefficient of nine hydrophobic dyes. Environ. Toxicol. Chem. 18(6):1109-1117.
[SPIN] Substances in Products in Nordic Countries [base de données sur Internet]. 2008. Projet financé par le Conseil des ministres des pays nordiques, Groupe chimique. Substances dans les produits dans les pays nordiques [consulté en décembre 2008].
Stingley, R.L., Zou, W., Heinze, T.M., Chen, H., Cerniglia, C.E. 2010. Metabolism of azo dyes by human skin microbiota. J. Med. Microbiol. 59(Pt.1):108-114.
[TOPKAT] TOxicity Prediction by Komputer Assisted Technology [en ligne]. 2004. Version 6.2. San Diego (CA) : Accelrys Software Inc. [consulté le 7 janvier 2009].
[USEPA] United States Environmental Protection Agency. 1986−2002. Toxic Substances Control Act: Inventory Update Reporting (TSCA−IUR). Non-confidential Production Volume Information for 1986, 1990, 1994, 1998 and 2002 reporting cycles [CD-ROM]. Washington (DC) : USEPA.
White, T.J., Goodman, D., Sulgin, A.T., Castagnolli, N., Lee, R., Petrakis, N.L. 1977. Mutagenic activity of some centrally active aromatic amines in Salonella typhimurium. Mutation Research 56:199-202.
Wild, D., King, M.T., Eckhardt, K., Gocke, E. 1981 Mutagenic activity of aminophenols and diphenols, and relations with chemical structure. Mut Res 85:456.
Yen, C.C., Perenich, T.A., Baughman, G.L. 1989. Fate of dyes in aquatic systems II. Solubility and octanol/water partition coefficients of disperse dyes. Environ. Toxicol. Chem.8(11):981-986.
Yen, C.C., Perenich, T.A., Baughman, G.L. 1991. Fate of commercial disperse dyes in sediments. Environ. Toxicol. Chem. 10:1009-1017.
Zeiger, E., Anderson, B., Haworth, S., lawlor, T., Mortelmans, K. 1988. Salmonella mutagenicity tests: IV. Results from the testing of 300 chemicals. Environ. Mol. Mutagen. 11(Suppl 12):1-157.
Zhang, X., Wang, G. 2009. Four-week oral toxicity study of p-nitrophenol, paminophenol and p-nitroaniline in rats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 32 (SUPPL. 1), p. 122-123.
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Persistance dans l’eau, les sédiments et le sol
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Bio-elimination study for CAS# 6250-23-3 (Disperse Yellow 23) Clariant dyestuff product = Foron Yellow E RGFL (Présentation de projet, 2008a) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 6250-23-3 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Yellow 23 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 54 % Disperse Yellow 23 |
| Méthode | ||||
| 6 | Référence | 1 | Non | |
| 7 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 8 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 9 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1976) | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 10 | Type d’essai (c.-à-d. hydrolyse, biodégradation) | s.o. | Oui | Biodégradation |
| 11 | Conditions d’essai (aérobie ou anaérobie) | s.o. | Non | Non indiqué |
| 12 | Milieu d’essai (eau, sédiments ou sol) | s.o. | Oui | Eau (par déduction d’après la concentration d’essai exprimée en mg/L) |
| 13 | Durée de l’essai | s.o. | Oui | 14 jours |
| 14 | Témoins négatifs ou positifs? | 1 | Non | |
| 15 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 16 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 17 | Méthode ou instrument analytique | 1 | Non | |
| Détails sur la biodégradation | ||||
| 18 | Type de biodégradation (immédiate ou intrinsèque) indiqué? | 2 | Non | Non indiqué |
| 19 | Lorsque le type de biodégradation (immédiate ou intrinsèque) n’est pas signalé, une information indirecte permet-elle l’identification du type de biodégradation? | 1 | Non | |
| 20 | Source de l’inoculum | 1 | Non | |
| 21 | Concentration dans l’inoculum ou nombre de microorganismes | 1 | Non | |
| 22 | Un préconditionnement et une préadaptation de l’inoculum ont-ils été signalés? | 1 | Non | |
| 23 | Le préconditionnement et la préadaptation de l’inoculum étaient-ils appropriés dans le cadre de la méthode utilisée? | s.o. | Non | |
| 24 | Température | 1 | Non | Non indiqué |
| 25 | Le pourcentage de dégradation du composé de référence a-t-il atteint les niveaux requis avant le 14ejour? | s.o. | Non | Pas de composé de référence testé |
| 26 | Sol : humidité du sol signalée? | 1 | ||
| 27 | Sol et sédiments : contenu en matière organique du sol (MOS) de base signalé? | 1 | ||
| 28 | Sol et sédiments : teneur en argile signalée? | 1 | ||
| 29 | Sol et sédiments : CEC (capacité d’échange cationique) signalée? | 1 | ||
| Détails sur l’hydrolyse | ||||
| 30 | Valeurs du pH signalées? | 1 | ||
| 31 | Température | 1 | ||
| 32 | Les concentrations appropriées de la substance ont-elles été utilisées? | |||
| 33 | Si un solvant a été utilisé, l’a-t-il été de manière appropriée? | |||
| Détails sur la photo-dégradation | ||||
| 34 | Température | 1 | ||
| 35 | Source lumineuse | 1 | ||
| 36 | Spectre lumineux (nm) | 1 | ||
| 37 | Intensité relative en fonction de l’intensité lumineuse du soleil | 1 | ||
| 38 | Spectre d’une substance | 1 | ||
| 39 | Photolyse indirecte : Sensibilisateur (type) | 1 | ||
| 40 | Photolyse indirecte : concentration du sensibilisateur | 1 | ||
| Résultats | ||||
| 41 | Paramètre et valeur | s.o. | s.o. | Biodégradation moyenne en 14 jours = 51 % |
| 42 | Produits de dégradation | s.o. | Non | |
| 43 | Note : ... % | 4,5 | ||
| 44 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 45 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 46 | Remarques | |||
Formulaire pour sommaire de rigueur d’étude : organismes aquatiques B
| N° | Élément | Pondé-ration | Oui/non | Précisions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : SHEN, G., HU, S. 2008. Bioconcentration Test of C.I. Disperse Orange 30 in Fish. Préparé par Environmental Testing Laboratory, Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai (Chine) pour Dystar au nom de l’Ecological and Toxicological Association of the Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD), Bâle (Suisse). Rapport n° S-070-2007. Présenté à Environnement Canada en avril 2008. N° de déclaration dans le cadre du Défi 8351. |
||||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 5261-31-4 | |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | ||
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | ||
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | ||
| 7 | Si le matériel d’essai est radiomarqué, est-ce que la ou les positions précises du ou des atomes marqués ainsi que le pourcentage de radioactivité associé aux impuretés ont été rapportés? | 2 | Non | ||
| Méthode | |||||
| 8 | Référence | 1 | Oui | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 305B-1996 | |
| 9 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE | |
| 10 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | ||
| 11 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Non | ||
| Organisme d’essai | |||||
| 12 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Poisson zèbre, Brachydanio rerio | |
| 13 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | Les deux | |
| 14 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | ||
| 15 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Longueur moyenne du corps 3,91 +/- 0,18 cm et poids moyen du corps 0,32 +/- 0,06 g | |
| 16 | Sexe | 1 | Non | ||
| 17 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 7 | |
| 18 | Charge en organismes | 1 | Oui | 20 mg/L | |
| 19 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | Mise au régime avec un poisson du commerce jusqu’à un jour avant le début du test | |
| Conception et conditions des essais | |||||
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | Laboratoire | |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau | |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 28 jours | |
| 23 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | ||
| 24 | Concentrations | 1 | Oui | 20 mg/L | |
| 25 | Type/composition de la nourriture et périodes d’alimentation (pendant l’essai) | 1 | Oui | Les poissons étaient nourris deux heures avant le renouvellement de l’eau | |
| 26 | Si le ratio FBC/FBA dérivait de la concentration chimique dans l’organisme et dans l’eau, la durée de l’expérience était-elle égale à ou supérieure au temps nécessaire pour que les concentrations chimiques atteignent un état stable? | 3 | Oui | 28 jours | |
| 27 | Si le rapport FBC/FBA a été déterminé comme correspondant au rapport de la concentration du produit chimique dans l’organisme sur sa concentration dans l’eau, est-ce que les concentrations mesurées dans l’organisme et dans l’eau étaient mentionnées? | 3 | Oui | ||
| 28 | Les concentrations dans les eaux d’essai ont-elles été mesurées périodiquement? | 1 | Oui | Sur trois jours distincts | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | Oui, tous les deux jours | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | 12:12 | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | ||
| 32 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | Tous les deux jours pour l’oxygène dissous, le pH et la température | |
| 33 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | ||
| 34 | Le solubilisant/émulsifiant a-t-il été utilisé si le produit chimique était faiblement soluble ou instable? | s.o. | Non | ||
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | |||||
| 35 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | ||
| 36 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | ||
| 37 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | Semi-statique | |
| 38 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | 7,22 à 7,84 | |
| 39 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | 22 à 23 | |
| 40 | Le contenu lipidique (ou FBA/FBC lipidiquement normalisé) a-t-il été signalé? | 2 | Oui | ||
| 41 | Les concentrations mesurées d’un produit chimique dans l’eau du test étaient-elles inférieures à la solubilité dans l’eau du produit chimique? | 3 | Non | ||
| 42 | Si une substance radiomarquée a été utilisée, est-ce que le FBC a été déterminé d’après le composé d’origine (et non d’après les résidus radiomarqués)? | 3 | Non | ||
| Résultats | |||||
| 43 | Les paramètres déterminés (FBA, FBC) et leurs valeurs | s.o. | s.o. | FBC | |
| 44 | FBA ou FBC déterminés comme : 1) le rapport de la concentration en produit chimique produit dans l’organisme, ou 2) le rapport entre les constantes d’incorporation de produit chimique et du taux d’élimination | s.o. | s.o. | 1 | |
| 45 | Le FBA/FBC était-il issu d’un 1) échantillon de tissu ou 2) organisme entier? | s.o. | s.o. | 2 | |
| 46 | Le FBA/FBC 1) moyen ou 2) maximum at-il été utilisé? |
s.o. | s.o. | 1 | |
| 47 | Note : ... % | 67,9 | |||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 2 | |||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance satisfaisante | |||
| 50 | Remarques | La présente procédure est basée sur des conditions semi-statiques (renouvellement des solutions du test tous les deux jours). Par conséquent, les substances d’essai très peu solubles dans l’eau, comme les colorants diazoïques, peuvent aussi être caractérisées selon leur potentiel de bioconcentration sans l’ajout de solvants ou d’autres substances auxiliaires qui pourraient modifier les résultats. | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Fish toxicity study for CAS# 6250-23-3 (Disperse Yellow 23) Clariant dyestuff product=Foron Yellow E RGFL (Prrésentation de projet, 2008b) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 6250-23-3 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Yellow 23 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 54 % DY23 |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1974) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Truite arc-en-ciel |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Non | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Longueur : 11 cm; poids : 15 g |
| 15 | Sexe | 1 | Non | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | (48 heures) |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé est-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est > 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non | Seule la température est indiquée (typique pour l’organisme d’essai) |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | 20 °C |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Non | La CL50 indiquée est supérieure de 8 ordres de grandeur à la solubilité dans l’eau mesurée par Baughman et Perenich (1989). |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 à 48 heures = 1 000 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : % | 17,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 203 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Poisson-zèbre (Brachydanio rerio) |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Non | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | (48 heures) |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Non | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Oui | La différence entre les valeurs de la CE50 et de la solubilité dans l’eau ne dépasse pas 1 ordre de grandeur. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 à 96 heures > 480 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note : % | 28,6 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 201 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Scenedesmus subspicatus |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Sans objet | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 72 heures |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Oui | La différence entre la CL50 indiquée et la solubilité dans l’eau ne dépasse pas 1 ordre de grandeur. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CE50 après 72 h pour la biomasse = 6 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Oui | CE50 pour la croissance = 86 mg/L; CE10 pour la biomasse et la croissance = 1,7 et 5,4 mg/L; |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : % | 38,2 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence: [ETAD] Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers. 2005. Projet E 3020 : Information reçue à l’appui de la catégorisation de 12 colorants dispersés dans la LIS. (Courriel daté du 27 octobre 2005) | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Oui | 19800-42-1 |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | Disperse Orange 29 |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | Colorant : 20 %; Reax 85A : 10 %; Eau : 70 %. |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | Dispersion à 20 % du colorant |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | OCDE 202 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | s.o. (étude réalisée en 1990) | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Daphnia magna |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Sans objet | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 24 et 48 heures |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé est-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est > 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Non | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non indiqué | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Impossible à évaluer | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | pH non précisé | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non précisé | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Non | La CL50 indiquée est supérieure à la valeur fournie de la solubilité dans l’eau. |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 après 48 heures > 70 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Oui | CE50 après 24 h > 100 mg/L |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : | 29,4 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire pour sommaires de rigueur d’études : toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : BASF 1990. Bericht uber die Prufung der akuten Toxizitit an der Goldorfe (Leuciscus idus L., Goldvariante). Présenté à Environnement Canada par l’ETAD en août 2008. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | ||
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | ||
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Non | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Non | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Non | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | ||
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Ide dorée |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Non | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Non | |
| 15 | Sexe | 1 | Non | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Non | |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Non | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Non | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Non | |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Non | |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 96 h |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Non | |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Non | |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Non | |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Non | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Non | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Non | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | Non | |
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | Non | |
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Non | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Non | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Non | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Non | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Non | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Non | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Non | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | ||
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | CL50 = > 100 mg/L < 220 mg/L | |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | CSEO = 100 mg/L | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | ||
| 47 | Note globale : % | 9,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 4 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Non satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | Les données soumises ne sont pas suffisantes pour évaluer correctement la fiabilité de cette étude. | ||
Formulaire pour sommaires de rigueur d’études : toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Environnement Canada, 1995. NSN submission. Données présentées à la Division des substances nouvelles d’Environnement Canada dans le cadre du Programme de renseignements concernant les substances nouvelles. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | Non | |
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Oui | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Non | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Non | |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Oui | OCDE 203 |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Oui | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Oui | Truite arc-en-ciel |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | longueur moyenne : 51 mm; poids moyen : 1,54 |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | Voir ci-dessus |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 10 |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Oui | |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Aiguë |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 96 h |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Oui | 3 |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | 2 |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Oui | 320-3 200 mg/L |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Non | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Sans objet | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Non | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Non | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | ||
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | ||
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le paramètre déterminé était-il directement attribuable à la toxicité de la substance, non à l’état de santé des organismes (p. ex., lorsque la mortalité des témoins est supérieure à 10 %) ou à des facteurs physiques (p. ex., « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Solubilité dans l’eau inconnue | |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CL50 après 96 h |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | Non | |
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | Non | |
| 47 | Note globale : | 77,5 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 2 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance satisfaisante | ||
| 50 | Remarques | |||
Formulaire et instructions pour sommaire de rigueur d’étude : Ti aquatique
| N° | Élément | Pondération | Oui/non | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Référence : Cohle, P. et R. MIihalik. 1991. Early life stage toxicity of C.I. Disperse Blue 79:1 purified preecake to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a flow-through system. | |||
| 2 | Identité de la substance : n° CAS | s.o.[1] | ||
| 3 | Identité de la substance : nom(s) chimique(s) | s.o. | Disperse Blue 79:1 | |
| 4 | Composition chimique de la substance | 2 | Oui | |
| 5 | Pureté chimique | 1 | Oui | 96,61 |
| 6 | Indication de la persistance/stabilité de la substance en milieu aqueux? | 1 | Non | |
| Méthode | ||||
| 7 | Référence | 1 | Oui | |
| 8 | Méthode normalisée (OCDE, UE, nationale, ou autre)? | 3 | Oui | ASTM, 1983 |
| 9 | Justification de la méthode ou du protocole si une méthode non normalisée a été utilisée | 2 | Sans objet | |
| 10 | BPL (bonne pratique de laboratoire) | 3 | Oui | |
| Organisme d’essai | ||||
| 11 | Identité de l’organisme : nom | s.o. | Truite arc-en-ciel | |
| 12 | Indication du nom latin ou des deux noms (latin et commun)? | 1 | Oui | |
| 13 | Âge ou stade biologique de l’organisme d’essai | 1 | Oui | |
| 14 | Longueur et/ou poids | 1 | Oui | |
| 15 | Sexe | 1 | Sans objet | |
| 16 | Nombre d’organismes par répétition | 1 | Oui | 20 |
| 17 | Charge en organismes | 1 | Oui | 0,36 à 4,8 µg/L |
| 18 | Type de nourriture et périodes d’alimentation pendant la période d’acclimatation | 1 | Oui | |
| Conception et conditions des essais | ||||
| 19 | Type d’essai (toxicité aiguë ou chronique) | s.o. | Oui | Toxicité chronique |
| 20 | Type d’expérience (en laboratoire ou sur le terrain) | s.o. | Oui | En laboratoire |
| 21 | Voies d’exposition (nourriture, eau, les deux) | s.o. | Oui | Eau |
| 22 | Durée de l’exposition | s.o. | Oui | 122 jours |
| 23 | Témoins négatifs ou positifs (préciser) | 1 | Oui | Témoin et porteur non indiqués |
| 24 | Nombre de répétitions (y compris les témoins) | 1 | Oui | 2 |
| 25 | Des concentrations nominales sont-elles indiquées? | 1 | Oui | 5 |
| 26 | Des concentrations mesurées sont-elles indiquées? | 3 | Oui | |
| 27 | Type de nourriture et périodes d’alimentation durant les essais à long terme | 1 | Oui | |
| 28 | Les concentrations ont-elles été mesurées périodiquement (spécialement dans les essais de toxicité chronique)? | 1 | Oui | |
| 29 | Les conditions du milieu d’exposition correspondaient-elles au produit chimique particulier signalé? (par exemple, pour la toxicité du métal : pH, DOC/TOC, dureté de l’eau, température) | 3 | Oui | |
| 30 | Photopériode et intensité de l’éclairage | 1 | Oui | |
| 31 | Préparation de solutions mères et de solutions d’essai | 1 | Oui | |
| 32 | Un agent émulsionnant ou stabilisant a-t-il été employé si la substance était peu soluble ou instable? | 1 | Oui | |
| 33 | Si un agent émulsionnant ou stabilisant a été employé, sa concentration est-elle indiquée? | 1 | Oui | |
| 34 | Si un solubilisant/émulsifiant a été utilisé, son écotoxicité a-t-elle été signalée? | 1 | Oui | Pas de valeur pour la toxicité, mais l’agent a été utilisé comme témoin |
| 35 | Intervalles des contrôles analytiques | 1 | Oui | |
| 36 | Méthodes statistiques utilisées | 1 | Oui | |
| Renseignements d’intérêt pour la qualité des données | ||||
| 37 | Le critère d’évaluation a-t-il été directement causé par la toxicité du produit chimique et non par l’état de santé de l’organisme (par exemple, lorsque la mortalité lors du contrôle est > 10 %) ou des effets physiques (par exemple, « effet d’ombrage »)? | s.o. | Oui | |
| 38 | L’organisme d’essai correspondait-il à l’environnement canadien? | 3 | Oui | |
| 39 | Les conditions d’essai (pH, température, OD, etc.) sont-elles typiques pour l’organisme d’essai? | 1 | Oui | |
| 40 | Le type et la conception du système (statique, semi-statique, dynamique; ouvert ou fermé; etc.) correspondent-ils aux propriétés de la substance et à la nature ou aux habitudes de l’organisme? | 2 | Oui | Renouvellement continu |
| 41 | Le pH de l’eau du test se situait-il dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (6 à 9)? | 1 | Oui | |
| 42 | La température de l’eau du test se situait-elle dans la plage habituelle pour l’environnement canadien (5 à 27 °C)? | 1 | Oui | |
| 43 | La valeur de la toxicité était-elle inférieure à celle de la solubilité de la substance dans l’eau? | 3 | Impossible à évaluer. Il y a lieu de croire que la plus forte dose d’essai correspond à la limite de solubilité. | |
| Résultats | ||||
| 44 | Valeurs de la toxicité (fournir paramètres et valeurs) | s.o. | s.o. | CSEO > 0,005 mg/L |
| 45 | Autres paramètres indiqués - p. ex., FBC/FBA, CMEO/CSEO (préciser)? | s.o. | ||
| 46 | Autres effets indésirables (par exemple, cancérogénicité, mutagénicité) signalés? | s.o. | ||
| 47 | Note globale : | 97,7 | ||
| 48 | Code de fiabilité d’Environnement Canada : | 1 | ||
| 49 | Catégorie de fiabilité (élevée, satisfaisante, basse) : | Confiance élevée | ||
| 50 | Remarques | |||
Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité Disperse Orange 29 (19800-42-1)
| Paramètre | Propriétés physico-chimiques et devenir | Profils de persistance, bioaccumulation et toxicité | Écotoxicité |
|---|---|---|---|
| Paramètres d’entrée des modèles | Suite EPIWIN (tous les modèles, notamment AOPWIN, KOCWIN, BCFWIN, BIOWIN et ECOSAR) |
Canadian POP Model (incluant : CATABOL, modèle de facteurs d’atténuation du FBC, modèle de toxicité OASIS) |
Artificial Intelligence Expert System (AIES)/TOPKAT/ASTER |
| Code SMILES [1] | x | x | x |
Annexe 3 : Absorption estimée de la limite supérieure d’absorption de Disperse Orange 29 à partir des textiles par divers groupes d’âge (µg/kg p.c. par jour) (Limite inférieure : exposition maximale estimée par les textiles grand teint. Limite supérieure : exposition maximale prudente)[1]
| Produit de consommation | 0 à 6 mois[2] | 0,5 à 4 ans[3] | 5 à 11 ans[4] | 12 à 19 ans[5] | 20 ans et + [6] |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutanée : port de textiles | 0,2 à 4 | 0,2 à 3 | 0,2 à 3 | 0,1 à 2 | 0,1 à 2 |
| Voie orale : mâchonnement | 0,1 | 0,1 | s.o.[7] | s.o. | s.o. |
[2] En supposant que le nourrisson pèse 7,5 kg, que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,28 m2 (Santé Canada, 1995) et qu’il passe 23 minutes par jour à mâchonner le tissu (Norris et Smith, 2002).
[3] En supposant que l’enfant pèse 15,5 kg, que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,46 m2 (Santé Canada, 1998) et qu’il passe 29 minutes par jour à mâchonner le tissu (Norris et Smith, 2002).
[4] En supposant que l’enfant pèse 31 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 0,80 m2 (Santé Canada, 1995).
[5] En supposant que l’adolescent pèse 59,4 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 1,4 m2 (Santé Canada, 1995).
[6] En supposant que la personne pèse 70,9 kg et que sa surface corporelle (sans les mains et la tête) représente 1,6 m2 (Santé Canada, 1995).
[7] Sans objet.
| Scénario basé sur des produits de consommation | Hypothèses | Estimation de l’exposition |
|---|---|---|
| Port d’un vêtement teint confectionné à partir de tissu synthétique | Scénario d’exposition pour les nourrissons : ConsExpo 4.0, contact cutané direct avec le produit – migration (RIVM, 2005). Concentration : 1 % en poids (Kraetke et Platzek, 2005) Densité du tissu : 100 g/m2 (Kraetke et Platzek, 2005) Hypothèses générales
Poids du corps du nourrisson : 7,5 kg (Santé Canada, 1998)
Voie cutanée : contact cutané direct avec le produit – migration (RIVM, 2005).
|
Dose chronique par voie cutanée = 4 µg/kg p.c. par jour |
| Mâchonnement de textiles teints | L’exposition est estimée ci-dessous pour des nourrissons âgés de 0 à 6 mois. Valeur d’absorption journalière estimée pour l’ingestion résultant du mâchonnement :
où :
= (42,8 mg/L × 0,22 mL/min × 0,001 L/mL × 0,005 × 1 × 23 min/jour)/7,5 kg = 0,0001 mg/kg p.c. par jour |
Dose chronique par voie orale = 0,1 µg/kg p.c. par jour |
[2] Quantité de produit = densité du tissu ´ quantité de tissus ´ concentration = 100g/m2, 1,60 m2, 1 % poids = 1,60 g
Annexe 5 : Sommaire des résultats de RQSA pour le Disperse Orange 29 et les produits potentiels de rupture des liaisons azoïques
Cancérogénicité
| N° CAS | DEREK (2008) | CASETOX (2008) | TOPKAT (2008) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancer | m-rat | f-rat | m-souris | f-souris | Rongeurs du NTP | NTP m-rat |
NTP f-rat |
NTP m-souris |
NTP f-souris |
|
| 19800-42-1 (parent) | P | NC | N | NC | NC | NC | P | HC | P | NC |
| 100-01-6 | P | NC | NC | NC | NC | N | P | NC | P | N |
| 123-30-8 | HC | NC | NC | N | NC | NC | P | N | N | N |
| 5307-02-8 | P | N | N | N | N | NC | P | NC | N | P |
Génotoxicité
| N° CAS | Ames | ChrAb | Induction de micronoyaux | Mutation du lymphome chez les souris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek | CT | TK | Derek | CT | CT | CT | |
| 19800-42-1 (origine) | P | N | NC | NC | P | N | NC |
| 100-01-6 | P | NC | N | NC | P | N | NC |
| 123-30-8 | HC | N | N | P | P | N | P |
| 5307-02-8 | P | P | P | HC | P | N | P |
Notes de bas de page
[2] Mutagène 2 au tableau 3.1 de l'annexe VI du Règlement CLP, mutagène de catégorie 3 au tableau 3.2 de l'annexe VI du Règlement CLP (Commission européenne, 2008; ESIS, 2010).