Évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés
Division de l’évaluation
Direction générale de la vérification et de l’évaluation
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Août 2024
Table des matières
- Résumé
- Plan d’action de réponse de la direction
- Liste des acronymes
- Liste des figures
- Aperçu du Programme de réinstallation des réfugiés
- Contexte de l’évaluation
- Méthodologie
- Limites et stratégies d’atténuation
- Profil des réfugiés réinstallés
- Profil des réfugiés réinstallés : données sociodémographiques
- Constatations de l’évaluation
- Conclusions et recommandations
- Annexe A : Modèle logique du Programme de réinstallation des réfugiés
- Notes de bas de page
Résumé
Contexte
Le présent rapport présente les constatations de l’évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’évaluation a été menée conformément aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et portait sur la pertinence, le rendement et la gouvernance du programme, de janvier 2016 à décembre 2021.
L’objectif de cette évaluation consistait à déterminer si le programme avait permis d’obtenir les résultats escomptés. L’évaluation portait également sur les points forts et les limites de conception du programme, ainsi que sur l’intégrité et la gestion du programme, y compris la clarté et la pertinence des rôles et des responsabilités des partenaires.
Résumé des principales constatations
L’évaluation a permis de constater que le programme repose sur une justification claire et solide et qu’il cadre bien avec les objectifs du gouvernement du Canada (GdC), notamment pour ce qui est de sauver des vies et d’offrir une protection. Le programme a été mis à profit pour gérer des crises humanitaires, même si cela a parfois eu pour effet de réduire l’attention portée aux objectifs habituels de réinstallation. En outre, le fait de donner la priorité à certains groupes contribue à un accès potentiellement inéquitable à une protection opportune, de même qu’à des préoccupations concernant le recours à des politiques d’intérêt public. La gouvernance du programme demeure un défi, au regard des répercussions négatives sur la coordination et la communication internes, ainsi que sur les relations avec les intervenants externes.
Le programme répond aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés, mais les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) éprouvent des difficultés à voir leurs besoins satisfaits par rapport aux réfugiés parrainés, en particulier lors des périodes d’arrivées massives. Les difficultés rencontrées pour trouver un logement permanent ont eu des répercussions sur l’aide au revenu et la prestation de services, et l’aide au revenu demeure insuffisante pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés. Enfin, le résultat ultime des réfugiés vivant de manière indépendante et la manière dont le programme contribue à ce résultat ne sont pas claires.
Recommandations
À la lumière de ces résultats, l’évaluation propose les recommandations ci-dessous.
- IRCC devrait revoir les objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés pour clarifier et actualiser son cadre de mesure du rendement, afin de s’assurer que les résultats attendus, les indicateurs et les cibles sont clairs et adaptés au rôle du programme.
- IRCC devrait clarifier et communiquer les rôles et responsabilités internes en matière de réinstallation, et améliorer la communication et la coordination sur le plan opérationnel et avec les intervenants externes.
- IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour traiter les conséquences des séjours prolongés dans des hébergements temporaires, qui garantirait une prestation opportune et cohérente des services du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) aux RPG.
- IRCC devrait intégrer au Cadre de réponse aux crises une stratégie visant à garantir des services efficaces et équitables pendant les périodes d’arrivées massives.
- IRCC devrait examiner plus régulièrement les mécanismes de soutien du revenu pour s’assurer que les taux sont harmonisés avec l’aide sociale provinciale/territoriale et qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des RPG.
- En tenant compte des préoccupations des répondants concernant les exigences du Programme de parrainage privé de réfugiés, IRCC devrait :
- élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence de la migration secondaire sur les répondants;
- collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme afin d’aider à relever les défis rencontrés pour répondre aux exigences du programme et prendre des mesures appropriées à cette fin.
Plan d’action de réponse de la direction
Recommandation 1
L’évaluation a montré que le résultat ultime du Programme de réinstallation des réfugiés, à savoir une vie autonome, n’est pas clairement défini ou convenu en ce qui concerne des mesures telles que l’aide sociale et l’utilisation des services d’établissement. De plus, les attentes du programme en matière d’emploi ne sont pas claires, y compris en ce qui concerne les réfugiés qui devraient se trouver un emploi et les délais à respecter à cet égard.
Par ailleurs, il a été constaté que le Programme de réinstallation des réfugiés s’appuie sur le Programme d’établissement pour atteindre ce résultat ultime. Les personnes interrogées ont exprimé des doutes sur le fait que le Programme de réinstallation des réfugiés dispose des mécanismes appropriés pour influencer les résultats à long terme, et cette dépendance à l’égard du Programme d’établissement a créé une certaine confusion quant aux résultats attendus, soulignant la nécessité de reconfirmer les objectifs respectifs de ces deux programmes.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) devrait revoir les objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés pour clarifier et actualiser son cadre de mesure du rendement, afin de s’assurer que les résultats attendus, les indicateurs et les cibles sont clairs et adaptés au rôle du programme.
Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.
Au moment où les besoins de protection des réfugiés atteignent des niveaux sans précédent et où de nouvelles crises humanitaires surviennent partout dans le monde, le Programme de réinstallation des réfugiés continuera d’être un moyen essentiel pour offrir une protection aux personnes déplacées qui ont besoin d’une solution durable.
Compte tenu de l’évolution constante du paysage mondial de la protection des populations et des sollicitations de plus en plus fréquentes afin de tirer parti du Programme de réinstallation des réfugiés pour faire face aux crises émergentes et pour venir au secours des populations cibles qui se trouvent en situation de crise, il serait opportun d’évaluer le Programme et ses objectifs afin de s’assurer de leur clarté et de leur adaptation au but visé.
De plus, les objectifs politiques déclarés du programme se concentrent sur sa capacité à offrir une protection efficace, tandis que la majorité des résultats sont axés sur l’intégration des clients individuels.
En 2024, IRCC a élaboré un nouveau modèle logique combiné pour le Programme d’aide à la réinstallation (PAR) et le Programme d’établissement afin d’harmoniser leurs objectifs en ce qui concerne les aides fournies aux réfugiés réinstallés après leur arrivée au Canada. Ce modèle logique actualisé a été élaboré pour soutenir le récent appel à propositions du PAR et du Programme d’établissement. Ce travail contribuera à distinguer les résultats liés aux activités préalables à l’arrivée et aux aides au Canada, et à élaborer des indicateurs de rendement appropriés.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
Mesure 1A: En tenant compte de la révision récente du Modèle logique du PAR et de l’établissement, entreprendre un examen complet du modèle logique du Programme de réinstallation des réfugiés, y compris la validation des objectifs fondamentaux du programme. |
Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Direction générale des politiques de l’établissement et de l’intégration, Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Politiques sur les réponses migratoires |
T1 2025-26 |
| Mesure 1B: Mettre à jour le profil d’information sur le rendement et demander l’approbation de la table de gestion des programmes (TGP) et du Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation (CMRE). | Identique à la mesure 1A. | T2 2025-26 |
Recommandation 2
L’évaluation a montré que la gouvernance interne demeure un défi pour le Programme de réinstallation des réfugiés. La gouvernance du programme est complexe et fragmentée entre de multiples directions générales et secteurs, ce qui contribue à un manque de clarté sur les rôles et responsabilités internes et à des problèmes de communication et de coordination internes, en particulier au niveau opérationnel. De plus, les problèmes de gouvernance ont été ressentis comme ayant des répercussions négatives sur les relations d’IRCC avec les intervenants externes.
Il convient de reconnaître qu’une importante restructuration du ministère a eu lieu en 2023, ce qui a commencé à résoudre les problèmes de gouvernance et de coordination.
IRCC devrait clarifier et communiquer les rôles et responsabilités internes en matière de réinstallation, et améliorer la communication et la coordination sur le plan opérationnel et avec les intervenants externes.
Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.
Les résultats de l’évaluation concernant la gouvernance du programme reflètent une période antérieure à une réorganisation majeure du Ministère, qui visait à résoudre ces problèmes. Les changements et initiatives décrits ci-dessous ont déjà eu lieu et répondent à cette recommandation.
Dans le cadre de la réorganisation d’IRCC annoncée en septembre 2023, un certain nombre de changements ont été opérés dans l’ensemble du Ministère, avec des répercussions directes sur la gestion du Programme de réinstallation. Les principaux points sont les suivants:
- Création du nouveau Secteur des affaires internationales et de l’intervention en cas de crise.
- Les fonctions opérationnelles et politiques liées à la sélection et aux préparatifs avant l’arrivée dans le cadre du Programme de réinstallation sont regroupées sous la responsabilité d’un sous ministre adjoint (SMA) dans le nouveau Secteur d’octroi de l’asile et de réinstallation des réfugiés.
Une restructuration ultérieure a permis de regrouper ces mêmes fonctions opérationnelles et politiques au sein d’une nouvelle Direction générale du Programme de réinstallation. La somme de ces changements a permis de consolider les responsabilités des cadres supérieurs, tout en rassemblant les équipes de travail pour une meilleure coordination.
En mai 2021, le Réseau de l’établissement (RE) a regroupé ses activités de réinstallation sous la responsabilité de la Division des opérations de réinstallation (DOR-RE). En septembre 2023, les fonctions politiques au Canada liées à la réinstallation et à l’intervention en cas de crises ont été regroupées au sein de la Direction générale pour l’établissement des arrivées massives. En février 2022, un comité des DG sur la réinstallation a été mis en place et des réunions des SMA sont également convoquées en cas de besoin.
En ce qui concerne les intervenants externes, en juin 2023, un rôle de liaison avec les signataires d’entente de parrainage (SEP) a été créé pour mieux répondre à leurs demandes de renseignements, leur prêter assistance dans les cas complexes et leur offrir d’autres aides utiles.
Afin de répondre pleinement à la recommandation, IRCC pourrait, comme prochaine étape, communiquer plus systématiquement les informations relatives à ces changements organisationnels aux principaux groupes d’intervenants en matière de réinstallation.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
Mesure 2A : Les points focaux d’IRCC pour ses relations avec les principaux intervenants externes fourniront une vue détaillée des changements organisationnels, des rôles et responsabilités et des correspondants clés lors des prochaines réunions de chaque groupe (par exemple, réunion ONG– gouvernement avec le conseil des SEP, Appartenir au-delà des frontières, groupe de travail sur les réfugiés pris en charge par le gouvernement [RPG]-PAR). |
Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Réseau d’établissement |
T3 2024-25 |
Recommandation 3
L’évaluation a révélé que les séjours prolongés dans des logements temporaires sont une préoccupation croissante et peuvent avoir des conséquences négatives sur l’aide et les services offerts aux réfugiés. Alors que les documents internes indiquent que les réfugiés sont censés passer d’une à trois semaines dans des logements temporaires, les preuves ont laissé penser que la plupart des RPG y passent au moins un mois.
L’évaluation a révélé que les séjours prolongés peuvent limiter l’aide financière globale que les RPG reçoivent et peuvent entraîner des retards, des doublons ou une perte d’efficacité des services essentiels. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les séjours prolongés peuvent retarder l’indépendance des réfugiés ou rendre plus difficile l’adaptation des réfugiés à leur logement permanent.
IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour traiter les conséquences des séjours prolongés dans des hébergements temporaires, qui garantirait une prestation opportune et cohérente des services du PAR aux RPG.
Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.
Les admissions de RPG ont considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 10 800 en 2021 à plus de 23 900 en 2023, principalement dans le contexte de l’initiative de réinstallation des Afghans, ce qui exerce une pression importante sur les organisations de fournisseurs de services (FS). Cette situation a entraîné une pression sur les séjours dans des logements temporaires; depuis la pandémie de COVID-19 et dans le contexte des arrivées massives, la durée des séjours dans des logements temporaires a encore augmenté. Toutefois, les admissions de RPG devraient diminuer de manière considérable au cours des prochaines années en fonction du plan pluriannuel des niveaux d’immigration.
Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour soutenir et gérer les arrivées et les capacités avec les FS, à savoir:
- Volumétrie : Le ministère ajuste chaque année les objectifs communautaires et cherche à améliorer en permanence la correspondance entre les arrivées, les FS et les capacités communautaires.
- Capacité : Depuis 2022, IRCC a encouragé les FS à désigner des coordinateurs spécifiques en matière de logement et a apporté son soutien aux liaisons avec les propriétaires dans les grands centres urbains où les FS estiment que cela serait bénéfique. De plus, IRCC a organisé un événement national à l’intention des propriétaires de logements, en collaboration avec le secrétariat des FS du PAR. IRCC a augmenté le financement du développement professionnel du personnel des FS du PAR, et il y a maintenant une réunion virtuelle trimestrielle avec le personnel consacré à la recherche de logement pour assurer une intégration efficace du nouveau personnel et une mise en commun rapide des meilleures pratiques.
- Soutien du revenu : Le soutien du revenu mis à la disposition des clients du PAR dans un marché du logement difficile détermine également la rapidité avec laquelle les FS du PAR peuvent aider les clients à obtenir un logement permanent. Depuis la période d’évaluation, IRCC a procédé à deux révisions de taux qui ont permis d’actualiser les indemnités fédérales et de s’aligner sur les modifications des taux d’aide sociale provinciaux, et se tourne vers un révision de taux régulière pour se tenir au courant autant que possible.
- IRCC a également lancé l’Initiative de supplément au loyer (ISL) en tant que programme pilote limité dans le temps ayant pour but de combler l’écart entre les coûts réels de location et l’aide financière fournie aux RPG pour leur permettre de trouver un logement, et évalue actuellement les résultats de cette initiative.
- Gestion des cas complexes : IRCC a reconnu une typologie de clients qui séjournent pendant des périodes prolongées dans des hébergements au delà du volume des arrivées. En conséquence, en 2022, IRCC a créé une équipe nationale chargée des cas complexes et a financé des postes pour les cas complexes dans les FS du PAR qui en avaient un besoin avéré.
- Enfin, IRCC a publié des orientations fonctionnelles et a travaillé avec les FS du PAR pour s’assurer que les paramètres du programme sont respectés en ce qui concerne le nombre d’options d’hébergement permanent présentées aux clients pendant qu’ils sont dans des hébergements temporaires financés par IRCC.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
Mesure 3A: Affiner la stratégie pour suivre avec précision le rythme et les arrivées afin d’aider au mieux les clients dès leur arrivée et d’assurer leur départ des logements et leur accès aux services en temps voulu. |
Responsable: Réseau de l’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Direction générale de la migration et de la santé, Direction générale du Programme de réinstallation |
T4 2024-25 |
| Mesure 3B: Entreprendre l’analyse des études sur les capacités communautaires. Fournir des ressources aux FS afin de les aider à assurer la libération des logements dans les meilleurs délais. | Identique à la mesure 3A. | T3 2024-25 |
| Mesure 3C: Élaborer un tableau de bord des normes de service nationales pour le suivi du soutien du revenu du PAR. | Identique à la mesure 3A. | T3 2024-25 |
| Mesure 3D: Inciter les partenaires internes à établir une stratégie/un cadre pour répondre aux besoins complexes, y compris l’élaboration d’une définition normalisée des cas complexes. | Identique à la mesure 3A. | T4 2024-25 |
Recommandation 4
Bien que les données d’IRCC ne fassent pas de distinction entre les arrivées massives et les arrivées régulières, les données portent à croire que les RPG arrivant lors des années d’arrivées massives sont moins susceptibles de recevoir des services durant leurs premières semaines au Canada, ou de déclarer que les services qu’ils ont reçus ont répondu à leurs besoins. Il a été constaté que les arrivées massives augmentent le temps passé dans des logements temporaires, ce qui a des répercussions sur la rapidité et la qualité des services immédiats offerts aux RPG. De plus, l’évaluation a fait état de préoccupations liées à l’équité de la prestation de services pendant les périodes d’arrivées massives, ainsi que d’incidences sur les effectifs et les capacités des FS du PAR. Par ailleurs, il a été noté que le personnel des FS peut être trop occupé pour fournir un soutien personnalisé aux réfugiés pendant ces périodes.
IRCC devrait intégrer au Cadre de réponse aux crises une stratégie visant à garantir des services efficaces et équitables pendant les périodes d’arrivées massives.
Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.
Les admissions de RPG ont considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 10 800 en 2021 à plus de 23 900 en 2023, principalement dans le contexte de l’initiative de réinstallation des Afghans. Cette augmentation du nombre de clients a mis à rude épreuve les FS qui assurent des services immédiats et essentiels dans le cadre du PAR. L’élaboration d’une stratégie de prestation de services lors d’éventuelles périodes d’arrivées massives permettra d’améliorer l’efficacité et l’équité des services du PAR. Cette stratégie pourrait être un outil relevant du nouveau Cadre de réponse aux crises d’IRCC, destiné à soutenir les arrivants en temps de crise.
IRCC s’est engagé à élaborer ce Cadre de réponse aux crises dans son rapport d’octobre 2023 intitulé Un système d’immigration pour l’avenir du Canada, à améliorer la prise de décision et à promouvoir l’équité en ce qui concerne les crises, notamment en mettant en œuvre un processus plus prévisible et des critères cohérents pour évaluer les situations émergentes, ainsi que des outils pour guider l’analyse politique, la conception et la mise en œuvre des programmes, l’évaluation et l’engagement continu avec les provinces/territoires (PT), les partenaires et les intervenants.
Dans le contexte des travaux en cours sur le Cadre, IRCC étudie également l’élaboration de nouveaux outils pour fournir des mesures de soutien et des services aux personnes arrivant au Canada par les parcours de résidence temporaire (RT) et de résidence permanente (RP) de crise, qui se situent en dehors des parcours existants de réinstallation des réfugiés du Canada, dans le but d’aider à réduire les pressions exercées sur les FS dans le contexte de la crise, ce qui pourrait à son tour améliorer les services fournis aux clients, y compris les immigrants arrivés en situation de crise et les RPG.
IRCC a travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs du PAR pendant cette période d’arrivées massives, avec l’aide d’un secrétariat des FS du PAR financé par IRCC. IRCC a l’intention de continuer à appuyer ce secrétariat afin que les FS du PAR puissent conserver les enseignements tirés de cette période et la capacité de monter en puissance, le cas échéant, pour atteindre les objectifs fixés en matière de RPG.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
Mesure 4A: Élaborer une stratégie visant à garantir la prestation efficace et équitable des services du PAR aux RPG pendant les périodes d’arrivées massives. |
Responsable: Réseau d’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives |
T4 2024-25 |
Mesure 4B: Continuer à soutenir le secrétariat national des FS du PAR afin d’assurer une coordination solide entre IRCC et les FS lors des périodes d’arrivées massives par l’entremise de l’appel de propositions 2024. |
Responsable: Réseau d’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives |
T1 2025-26 |
Mesure 4C: Dans le contexte du nouveau Cadre d’intervention de crise, élaborer de nouveaux outils pour fournir un soutien et des services aux personnes arrivant au Canada en raison d’une réponse migratoire à une crise. |
Responsable: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives Soutien: Direction générale des politiques sur les réponses migratoires, Réseau d’établissement |
T2 2025-26 |
Recommandation 5
L’évaluation a révélé que les taux de soutien du revenu du PAR restent insuffisants pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés. Même si les taux de soutien au revenu se veulent en adéquation avec les taux d’aide sociale provinciaux ou territoriaux, ils sont inférieurs à la mesure officielle de la pauvreté au Canada et n’ont pas suivi l’évolution du coût de la vie ou de l’inflation, en particulier en ce qui concerne les coûts du logement. La grande majorité des réfugiés interrogés ont déclaré avoir dû travailler parce que le soutien au revenu était insuffisant pour couvrir leurs besoins de base. L’évaluation a également révélé un recours important aux banques alimentaires parmi les réfugiés, en particulier les RPG qui comptent uniquement sur le soutien du revenu du PAR.
En mars 2023, IRCC a mis en place l’Initiative de supplément au loyer (ISL) afin de contribuer à combler le déficit d’accessibilité au logement et d’aider les réfugiés à obtenir un logement permanent. L’ISL offre une allocation complémentaire aux réfugiés pour répondre à leurs besoins en matière de logement. En partant d’initiatives aussi novatrices que celle-ci:
IRCC devrait examiner plus régulièrement les mécanismes de soutien du revenu pour s’assurer que les taux sont harmonisés avec l’aide sociale provinciale/territoriale et qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des RPG.
Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.
Compte tenu des conclusions de l’évaluation selon lesquelles le soutien du revenu du PAR est insuffisant pour permettre aux RPG de satisfaire leurs besoins fondamentaux, il est nécessaire d’étudier les possibilités de mieux répondre à ces besoins.
Le soutien du revenu du PAR comprend des allocations mensuelles pour le logement, la nourriture et les frais accessoires. Ces allocations doivent être harmonisées avec les taux d’aide sociale de la province où vit le RPG, comme indiqué dans les conditions générales du PAR. Les RPG bénéficient ainsi d’un niveau de soutien financier semblable à celui dont jouissent les Canadiens dans le besoin, et d’une transition en douceur vers l’aide sociale provinciale (pour les RPG qui en ont besoin), une fois que la période du PAR prend fin. Lorsque les provinces actualisent leurs taux d’aide sociale, par exemple en raison de l’augmentation du coût de la vie, IRCC suit le mouvement pour maintenir la parité.
Le soutien du revenu du PAR comprend également des allocations nationales, dont une allocation unique de démarrage pour l’achat de meubles et d’articles ménagers de première nécessité, et un supplément mensuel pour le logement. IRCC fixe ces taux indépendamment des taux provinciaux d’aide sociale, en fonction d’une évaluation des coûts réels.
IRCC a récemment achevé la révision des taux de soutien du revenu du PAR. À la lumière de cet examen, les taux pour la plupart des clients ont été relevés le 1er juin 2024, par rapport aux taux provinciaux en vigueur en décembre 2022. Les changements varient selon la province et la composition de la famille. Les taux de soutien du revenu du PAR ont été actualisés pour la dernière fois à l’automne 2021. Pour mieux faire face à l’augmentation du coût de la vie, IRCC a l’intention d’entreprendre des révisions régulières des taux de soutien du revenu du PAR, la prochaine révision des taux étant prévue à l’automne 2024, les taux actualisés entrant en vigueur au milieu ou à la fin de l’année 2025.
Compte tenu de la crise actuelle du logement, et pour aider les RPG à faire face à la hausse rapide des coûts de logement, IRCC a mis en œuvre un programme pilote en mars 2022, appelé Initiative de supplément au loyer (ISL), visant à fournir aux RPG une allocation exceptionnelle de soutien du revenu supplémentaire pour couvrir les coûts réels du logement. Ce projet pilote doit prendre fin en décembre 2024. IRCC procède actuellement à l’analyse de ce projet pilote, afin d’éclairer les options permettant de mieux répondre aux besoins des RPG en matière de logement une fois que le projet sera arrivé à son terme.
IRCC procède également à une analyse de la mesure d’incitation à l’emploi du PAR, afin de s’assurer qu’elle encourage les RPG à accéder au marché du travail et non qu’elle ne les en dissuade.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
Mesure 5A: Procéder régulièrement à un examen des taux de soutien du revenu dans le cadre du PAR, afin de s’assurer que la parité avec les taux d’aide sociale provinciaux est maintenue en temps opportun. |
Responsable: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives Soutien: Réseau d’établissement |
T4 2024-25, en cours |
Mesure 5B: Achever l’analyse de l’efficacité et des effets de l’ISL afin d’éclairer la décision relative à l’avenir du projet pilote. |
Identique à la mesure 5A. | T4 2024-25 |
| Mesure 5C: Achever l’analyse de la mesure d’incitation à l’emploi de 50 %, afin de déterminer les éventuelles adaptations à y apporter. | Identique à la mesure 5A. | T4 2024-25 |
Recommandation 6
L’évaluation a révélé que si le parrainage privé des réfugiés fonctionnait bien dans l’ensemble, les répondants font face à certains défis. La migration secondaire des réfugiés parrainés présente des difficultés pour les répondants, qui sont confrontés à des charges administratives ou financières et à des pénalités potentielles de parrainage.
De plus, bien que le programme ait amélioré la surveillance, l’évaluation a révélé que les répondants qui parrainent des membres de leur famille peuvent éprouver des difficultés à satisfaire aux exigences du programme et à démontrer qu’ils bénéficient d’un soutien adéquat.
En tenant compte des préoccupations des répondants concernant les exigences du Programme de parrainage privé de réfugiés, IRCC devrait:
- a) élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence de la migration secondaire sur les répondants;
- b) collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme afin d’aider à relever les défis rencontrés pour répondre aux exigences du programme et prendre des mesures appropriées à cette fin.
6.a) Les politiques et pratiques actuelles d’IRCC dans ce domaine visent à réduire le plus possible les conséquences de la migration secondaire pour les répondants. Lorsque la migration secondaire a lieu et que les répondants ne peuvent pas satisfaire à de nouvelles exigences, une rupture de parrainage non punitive est déclarée et il n’y a pas d’évaluation de la faute si le répondant peut prouver qu’il a tenté de satisfaire à ces exigences.
Des travaux sont en cours pour répondre aux préoccupations des répondants concernant la migration secondaire, notamment en améliorant les informations que les réfugiés reçoivent à ce sujet avant et après leur arrivée au Canada, et en finançant un fournisseur tiers, le Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPR), pour offrir aux groupes de répondants un soutien et des conseils sur la manière de réduire la probabilité de migration secondaire (par exemple, en fixant des attentes réalistes en matière d’établissement avant et après l’arrivée, et en facilitant l’intégration au sein de la communauté locale).
Le Ministère examinera s’il existe d’autres moyens d’atténuer les conséquences financières de la migration secondaire pour les répondants.
6.b) La procédure d’examen des cas offre déjà une grande souplesse pour démontrer que les exigences du programme ont été respectées. Toutefois, IRCC comprend que les exigences en matière de suivi des cas concernant les preuves de soutien constituent un domaine de préoccupation particulier pour les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme. Les mesures visant à répondre aux préoccupations des répondants devront être conciliées avec les objectifs du Programme de parrainage des réfugiés par le secteur privé. IRCC travaillera avec les partenaires de parrainage pour mieux comprendre ces préoccupations dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du cadre d’intégrité des programmes et des mesures connexes.
| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |
|---|---|---|
| Mesure 6A(1): Mettre à jour les documents de communication et de sensibilisation afin de mieux informer les réfugiés des conséquences de choisir eux-mêmes leur destination et celles de la migration secondaire. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Réseau d’établissement |
T1 2025-26 |
| Mesure 6A(2): Procéder à une analyse plus approfondie des effets et des mesures d’atténuation de la migration secondaire et mettre en œuvre toute modification des politiques applicables. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Réseau d’établissement |
T1 2025-26 |
| Mesure 6B(1): En consultation avec les partenaires externes chargés de la mise en œuvre du programme, mettre à jour les lignes directrices pour répondre aux exigences du programme dans le cadre du suivi des cas. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation |
T1 2025-26 |
| Mesure 6B(2): En collaboration avec les SEP et à partir des résultats de l’évaluation, examiner les difficultés liées aux exigences du programme, notamment en ce qui concerne les preuves de soutien, et prendre des mesures appropriées dans le cadre des autorisations du programme. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation |
T1 2025-26 |
Liste des acronymes
- ACE
- Allocation canadienne pour enfants
- ACS Plus
- Analyse comparative entre les sexes Plus
- BDCDEE
- Base de données sur la dynamique canadienne entre employeurs et employés
- BDIM
- Banque de données longitudinales sur les immigrants
- CIP
- Cadre pour l’intégrité des programmes
- CMRE
- Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation
- DSR
- détermination du statut de réfugié
- EASR
- Équipe de l’assurance des services de réinstallation
- FS
- du PAR fournisseur de services du Programme d’aide à la réinstallation
- FS
- fournisseur de services
- G5
- groupe de cinq répondants
- GdC
- Gouvernement du Canada
- GC
- groupe constitutif (de parrainage)
- HCR
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- iEDEC
- Immigration Environnement de déclarations d’ententes de contribution
- IRCC
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- ISL
- Initiative de supplément au loyer
- LGBTQ2
- lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel et autres
- LIPR
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- OIM
- Organisation internationale pour les migrations
- ORS
- Opération Réfugiés syriens
- PAR
- Programme d’aide à la réinstallation
- PDE
- point d’entrée
- PFPR
- Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés
- PFSI
- Programme fédéral de santé intérimaire
- PPI
- Programme des prêts aux immigrants
- RC
- répondant communautaire
- RDBV
- réfugié désigné par un bureau des visas
- RM
- Réseau mondial
- RPAD
- Réponse et plan d’action de la direction
- RPG
- réfugié pris en charge par le gouvernement
- RPSP
- réfugié parrainé par le secteur privé
- SEP
- signataire d’entente de parrainage
- SMGC
- Système mondial de gestion des cas
- TPA
- Transmission-préavis d’arrivée
Liste des figures
- Figure 1 : Réfugiés admis par volet, 2016-2022 (SMGC)
- Figure 2 : Pays de naissance des réfugiés admis (SMGC)
- Figure 3 : Profil sociodémographique des réfugiés admis, 2016-2022 (SMGC)
- Figure 4 : Réfugiés réinstallés par rapport au besoin mondial de réinstallation (SMGC, HCR)
- Figure 5 : Admissions de réfugiés par volet, 2016-2022 (SMGC)
- Figure 6 : Délai de traitement des demandes de statut de réfugié par volet, 80e centile de la période de décision (SMGC)
- Figure 7 : Délai de traitement des demandes de statut de réfugié par pays de résidence en 2021, 80e centile de la période de décision (SMGC)
- Figure 8 : Réfugiés interrogés ayant déclaré avoir bénéficié d’une aide de démarrage
- Figure 9 : Réfugiés interrogés ayant déclaré que « tous » leurs besoins initiaux ou « la plupart » d’entre eux avaient été satisfaits
- Figure 10 : Part des réfugiés interrogés dans les groupes ACS Plus qui ont déclaré avoir rencontré des obstacles dans l’accès aux mesures de soutien
- Figure 11 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir reçu les informations dont ils avaient besoin en matière de logement
- Figure 12 : Part des RPG recevant des services déclarés (iEDEC)
- Figure 13 : Proportion de réfugiés vivant dans un logement temporaire depuis plus de six semaines (iEDEC)
- Figure 14 : Migration sortante interprovinciale au cours de l’année suivant l’admission, 2009-2019 (BDIM)
- Figure 15 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir eu recours à une banque alimentaire au cours de leur première année de séjour
- Figure 16 : Recours à l’aide sociale selon le nombre d’années après l’admission (BDIM)
- Figure 17 : Revenu familial médian, années après l’admission (BDIM)
- Figure 18 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir noué des liens sociaux au cours de leur première année de séjour
Aperçu du Programme de réinstallation des réfugiés
Contexte
Le Programme de réinstallation des réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à offrir de la protection. Ce programme contribue à maintenir les traditions et les obligations humanitaires du Canada en offrant la résidence permanente aux réfugiés et à d’autres personnes ayant besoin de protection lorsqu’il n’existe aucune solution durable.
Conformément au Plan des niveaux d’immigration du Canada, IRCC facilite l’admission d’un nombre ciblé de réfugiés en tant que résident permanent par la voie du Programme de réinstallation des réfugiés. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) prévoient la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.
L’appartenance à ces deux catégories repose sur des craintes fondées de persécution en raison de l’origine ethnique, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques ou de l’appartenance à un groupe, ou sur le fait d’avoir été et de continuer à être gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou des violations massives des droits de la personne. Les réfugiés doivent également se trouver hors de leur pays d’origine ou du pays où ils vivent habituellement.
De 2016 à 2022, le Canada a admis 207 060 réfugiés, dont 110 147 étaient parrainés par le secteur privé, 88 838 étaient pris en charge par le gouvernement et 8 075 provenaient du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas.
Volets du programme
Les réfugiés sélectionnés pour la réinstallation au Canada se voient remettre des visas pour se rendre au Canada au titre de l’un des volets suivants du Programme de réinstallation des réfugiés :
Réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG)
Les RPG sont recommandés par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou d’autres organisations de recommandation en fonction de la vulnérabilité. Les RPG reçoivent jusqu’à un an de soutien du revenu de la part du gouvernement du Canada (GdC), ainsi que des services immédiats et essentiels fournis par des organismes non gouvernementaux appuyés par IRCC, appelés fournisseurs de services (FS).
Réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP)
Les RPSP sont identifiés et parrainés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents, notamment des signataires d’une entente de parrainage (SEP), des groupes constitutifs (GC), des groupes de cinq (G5) et des répondants communautaires (RC). Les répondants apportent un soutien financier, émotionnel et autre pendant une période pouvant aller jusqu’à un an.
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV)
Les RDBV sont recommandés par le HCR ou d’autres organisations de recommandation et identifiés à l’interne comme des cas à mettre en relation avec des répondants privés. Les répondants partagent les responsabilités financières avec le GdC, chacun d’entre eux fournissant une aide au revenu pendant six mois. Les répondants couvrent également les coûts initiaux et les mesures de soutien immédiat et essentiel.
Programmes de services de soutien
Programme d’aide à la réinstallation (PAR)
Le PAR apporte un soutien aux RPG et aux autres bénéficiaires admissibles à leur arrivée au Canada. Ce programme se compose de deux volets :
- une aide financière directe pour les réfugiés admissibles, y compris un versement initial unique et un soutien du revenu mensuel pendant un maximum d’un an (dans des circonstances exceptionnelles, jusqu’à 24 mois);
- un financement des FS du PAR pour qu’ils fournissent des services immédiats et essentiels pendant 4 à 6 semaines, dont : hébergement temporaire et aide à la recherche d’un logement permanent, orientation sur la vie au Canada et aiguillage vers des services.
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
Le PFSI offre des services médicaux avant le départ, une couverture temporaire des soins de santé au Canada jusqu’à ce que les personnes puissent bénéficier d’une assurance maladie provinciale/territoriale, ainsi qu’une couverture complémentaire des soins de santé pour une durée maximale d’un an.
Programme de prêts aux immigrants (PPI)
Le PPI offre aux clients des prêts pour couvrir les frais de transport vers le Canada et pour les aider à satisfaire à leurs besoins de base au Canada.
Contexte de l’évaluation
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés. Menée par la Division de l’évaluation d’IRCC entre juillet 2022 et décembre 2023, l’évaluation a permis d’analyser le rendement du programme et de fournir des preuves et des résultats en temps opportun qui serviront à orienter l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de programmes.
Cette évaluation répond aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Portée de l’évaluation
L’évaluation couvre la période allant de janvier 2016 à décembre 2021; les données administratives ont toutefois été actualisées pour inclure l’année 2022.
La portée de l’évaluation exclut les programmes spéciaux en cours visant la réinstallation des ressortissants afghans, ainsi que les objectifs spéciaux liés au PPI, au PFSI ou aux services d’établissement avant l’arrivée, étant donné que ces domaines ont fait l’objet d’évaluations distinctes dernièrement ou seront évalués dans l’avenir. Toutefois, les contributions générales de ces secteurs aux objectifs globaux du Programme de réinstallation des réfugiés sont incluses dans la portée.
L’évaluation est guidée par un mandat élaboré avec l’aide des représentants du programme et approuvé par le Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation (CMRE) d’IRCC.
Objet de l’évaluation
L’évaluation porte principalement sur le rendement du programme par rapport aux résultats attendus, ainsi que sur les résultats socioéconomiques des réfugiés réinstallés dans le cadre du programme.
Résultats du Programme de réinstallation des réfugiés
- Immédiats : Protection opportune des réfugiés réinstallés et satisfaction de leurs besoins immédiats et essentiels.
- Intermédiaire: Les réfugiés réinstallés disposent des outils nécessaires pour vivre de manière autonome dans la société canadienne.
- Ultime: Les réfugiés réinstallés mènent une vie autonome dans la société canadienne.
L’évaluation a également examiné les points forts et les limites de conception du programme, y compris les différences entre les RPG, les RPSP et les RDBV, la nécessité et la complémentarité des volets du programme, et les interactions du programme avec les organismes de recommandation.
Dans une moindre mesure, l’évaluation a examiné l’intégrité du programme en ce qui a trait au volet RPSP et la gestion du programme, notamment sur la clarté et la pertinence des rôles et des responsabilités des partenaires.
Questions d’évaluation
- Dans quelle mesure les différents volets du programme sont-ils harmonisés avec les objectifs du programme?
- Dans quelle mesure le programme est-il conçu d’une manière efficace et la coordination entre les partenaires du programme est-elle assurée?
- Dans quelle mesure les répondants des RPSP fournissent-ils un niveau de soutien adéquat aux réfugiés qu’ils parrainent?
- Dans quelle mesure le programme offre-t-il une protection opportune aux réfugiés réinstallés?
- Dans quelle mesure le programme répond-il aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés?
- Dans quelle mesure le programme contribue-t-il à la capacité des réfugiés à vivre de manière autonome dans la société canadienne?
Méthodologie
L’évaluation a fait appel à plusieurs méthodes, décrites ci-dessous.
Examen des documents
L’examen des documents portait sur des documents internes et externes relatifs au Programme de réinstallation des réfugiés, notamment les suivants : documents du GdC et du ministère; littérature universitaire; documents des intervenants; textes législatifs et réglementaires; documents relatifs aux programmes, aux politiques et au suivi; orientation fonctionnelle.
Entrevues avec des informateurs clés
Des entrevues virtuelles ont été menées avec 57 personnes à l’aide de Microsoft Teams, y compris :
- 42 représentants de programme d’IRCC;
- 7 représentants des FS du PAR;
- 4 représentants du conseil des SEP et de l’Unité de navigation des SEP;
- 2 représentants du Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPR);
- 1 représentant du HCR;
- 1 représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Analyse des données administratives
On a procédé à une analyse des données issues du Système mondial de gestion des cas (SMGC) d’IRCC afin de dresser un profil sociodémographique des réfugiés admis de 2016 à 2022. Des informations sur les délais de traitement et le nombre de demandes en cours ont également été examinées.
Les données du SMGC ont été combinées aux données de l’Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) d’IRCC pour établir un profil des services offerts aux réfugiés aux points d’entrée (PDE) et dans le cadre du PAR.
Les données de la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) ont été utilisées pour obtenir les chiffres relatifs à l’incidence de l’emploi, au revenu d’emploi médian et à la migration secondaire au fil du temps. Les dossiers fiscaux de 2009 à 2020 ont été examinés globalement, y compris les données du fichier T1 sur les familles et les données supplémentaires du feuillet T4 pour les réfugiés admis au cours de la même période.
Tous les ensembles de données ont également été utilisés pour contextualiser les tendances du programme.
Sondage à l’intention des réfugiés
Réalisé en ligne, le sondage a été adressé à tous les réfugiés réinstallés, admis au Canada de 2016 à 2022, âgés de 18 à 75 ans et dont les coordonnées étaient disponibles (N = 94 325). Le sondage comprenait des questions sur leurs premières semaines et leur première année au Canada. Le questionnaire était disponible en anglais, en français, en arabe, en dari, en tigrinya et en pachto, et 6 391 personnes y ont répondu, ce qui représente un taux de réponse de 7 %.
Sondage à l’intention des répondants
Le sondage a été réalisé en ligne et adressé à toutes les personnes ayant parrainé des RPSP et/ou des RDBV de 2016 à 2022 et dont les coordonnées étaient disponibles (N = 27 751)Note de bas de page 1. Il a permis de recueillir des avis sur la formation et les ressources, la coordination avec IRCC, les relations avec les réfugiés et les résultats obtenus. Au total, 2 156 réponses ont été reçues, soit un taux de réponse de 8 %.
Sondage à l’intention des FS du PAR
L’évaluation a tiré profit d’un sondage en ligne, réalisé dans le cadre de l’Évaluation du Programme de santé des migrants d’IRCC pour recueillir les points de vue des FS du PAR sur le soutien apporté aux RPG. Le sondage comprenait des questions sur la coordination avant l’arrivée et sur la prestation de services immédiats ou essentiels au cours des cinq dernières années. Trente-cinq FS du PAR identifiés par les intervenants internes ont été inclus dans la liste de distribution de ce sondage, et 19 ont répondu.
Limites et stratégies d’atténuation
L’approche d’évaluation a fait appel à des méthodes complémentaires et a permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives.
Disponibilité et qualité des données
Transmission des données à l’iEDEC
Les intervenants ont fait remarquer que les données n’étaient pas toujours transmises à l’iEDEC avec toute l’assiduité voulue, en raison de la priorité ou de l’urgence des services à fournir, en particulier pendant les périodes d’arrivées massives. Par ailleurs, les intervenants ont reconnu des retards dans les rapports des FS du PAR sur les services fournis. Pour atténuer les conséquences des retards de déclaration, l’évaluation a prévu un décalage de près d’un an avant l’extraction des données (c’est-à-dire que les données sur les services fournis jusqu’au 31 décembre 2022 ont été extraites en décembre 2023). De plus, les résultats de l’analyse des données ont été triangulés avec les résultats d’autres sources de données, comme les réponses des réfugiés, des répondants et des FS du PAR au sondage relatives à la prestation de services, ainsi que les entrevues et l’examen des documents.
Arrivées massives
L’impact des arrivées massives a été un thème récurrent soulevé par les intervenants. Toutefois, au moment de l’évaluation, IRCC ne recueillait pas de données systématiques permettant de savoir si les réfugiés admis étaient arrivés au Canada dans le contexte de ces arrivées massives. En l’absence d’un indicateur clairement défini des arrivées massives, l’évaluation a employé une variable de substitution en utilisant les données disponibles sur le pays de résidence (p. ex. Syrie, Afghanistan) et l’année d’admission (p. ex. 2016, 2021‑2022). Il convient de noter que cette variable ne tient pas compte des effets potentiels sur la prestation des services pour d’autres réfugiés arrivant à un rythme régulier, parallèlement aux arrivées massives.
Codage des réfugiés dans le SMGC
Une erreur de codage des admissions de RDBV dans le SMGC a été constatée après l’extraction des données pour l’évaluation. Cette erreur a entraîné une déclaration excédentaire de RDBV en 2022. Pour atténuer ce problème, le nombre de réfugiés a été ajusté sur la base des outils de déclaration internes pour l’année d’admission 2022.
Caractère représentatif des sondages
Sondage à l’intention des réfugiés
Par rapport à la population de réfugiés admis dans la période visée par l’évaluation, le sondage a surreprésenté les réfugiés admis au Canada en 2022 (+9,8 %), les hommes (+8,9 %), les réfugiés ayant une connaissance de l’anglais (+7,2 %) et les réfugiés titulaires d’un baccalauréat (+8,0 %). Les résultats du sondage ont été triangulés avec d’autres sources de données, notamment une analyse documentaire ayant permis de recueillir des informations sur les groupes sous-représentés et leurs points de vue. De plus, les entrevues comprenaient des questions portant précisément sur la mesure dans laquelle les différents facteurs sociodémographiques ont influencé les résultats du programme.
Sondage à l’intention des répondants
Étant donné le peu d’information qu’IRCC recueille sur les caractéristiques des répondants, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les résultats du sondage sont représentatifs de cette population. Pour atténuer ce problème, les résultats du sondage ont été triangulés avec d’autres sources de données dans la mesure du possible, notamment des entrevues avec des représentants des SEP.
Sondage à l’intention des FS du PAR
La population de FS du PAR est peu nombreuse et évolue au fil du temps. Même si plus de la moitié des FS du PAR contactés pour le sondage ont répondu, la petite taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble de la population des FS du PAR. Pour renforcer la confiance dans les conclusions relatives aux FS du PAR, des entrevues avec des représentants des FS du PAR ont été menées dans le cadre de l’évaluation. Les conclusions sont basées sur la triangulation des résultats entre plusieurs sources de données.
Profil des réfugiés réinstallés
De 2016 à 2022, 207 060 réfugiés ont été admis au Canada : 110 147 RPSP (53 %); 88 838 RPG (43 %) et 8 075 RDBV (4 %). Le nombre de réfugiés admis au Canada a varié d’une année à l’autre. Les admissions ont été plus élevées pendant les années d’arrivées massives spécifiques à certains pays (notamment dans le cadre de l’Opération Réfugiés syriens et de l’engagement envers les réfugiés afghans), et plus faibles pendant les années de pandémie de COVID-19 et de restrictions de voyage correspondantes. En ce qui concerne les admissions par volet :
- Les admissions de RPSP sont restées relativement stables dans le temps, à l’exception des années marquées par les restrictions dues à la COVID-19.
- De 2017 à 2019, le nombre de RPG admis est resté inférieur à la moitié des niveaux de 2016.
- Le nombre de RDBV admis a diminué au fil du temps, avec plus d’arrivées en 2016 (4 420) que toutes les années suivantes (3 655).
Figure 1 : Réfugiés admis par volet, 2016-2022 (SMGC)

Figure 1
La figure illustre un graphique linéaire montrant le nombre de réfugiés admis par volet et par année, entre 2016 et 2022. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) : 2016 : 4 420; 2017 : 1 285; 2018 : 1 149; 2019 : 993; 2020 : 52; 2021 : 76; 2022 : 100. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) : 2016 : 23 560; 2017 : 8 638; 2018 : 8 093; 2019 : 9 952; 2020 : 3 871; 2021 : 10 812; 2022 : 23 912. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) : 2016 : 18 361; 2017 : 16 698; 2018 : 18 568; 2019 : 19 143; 2020 : 5 313 2021 : 9 543; 2022 : 22 521.
Tendances du pays de naissance
Dans l’ensemble, près de la moitié des réfugiés admis entre 2016 et 2022 sont nés en Syrie (33 %) ou en Afghanistan (15 %). La ventilation par pays de naissance varie d’une année à l’autre; par exemple, les Syriens représentaient 66 % des admissions en 2016, mais 13 % en 2022. Les Afghans représentaient 2 % des admissions en 2016, mais 41 % en 2022.
Figure 2 : Pays de naissance des réfugiés admis (SMGC)

Figure 2
La figure illustre un diagramme circulaire montrant les principaux pays de naissance des réfugiés admis au Canada entre 2016 et 2022. La figure montre les points de données suivants : Syrie : 33 %; Afghanistan : 15 %; Érythrée : 11 %; Irak : 9 %; Tous les autres pays : 33 %.
La prépondérance de certains pays de naissance reflète les engagements publics pris par le GdC en réponse aux crises humanitaires mondiales:
Opération Réfugiés syriens (ORS)
Fin 2015 et début 2016, le GdC s’est engagé à plusieurs reprises à réinstaller des réfugiés syriens au Canada, dont au moins 25 000 en 2016Note de bas de page 2 .
Engagement envers les ressortissants afghans
En août 2021, le GdC s’est engagé à réinstaller 40 000 Afghans. Les personnes arrivant dans le cadre du volet humanitaire de cet engagement relèvent des volets RPG et RPSPNote de bas de page 3.
Profil des réfugiés réinstallés : données sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques
Les données administratives établissent le profil des réfugiés réinstallés au moment de l’admission, notamment le sexe, l’âge, la destination prévue, le niveau scolaritéNote de bas de page 4 et la connaissance des langues officielles déclarée au moment de l’admission au CanadaNote de bas de page 5.
Figure 3 : Profil sociodémographique des réfugiés admis, 2016-2022 (SMGC)

Figure 3
La figure 3 présente cinq diagrammes circulaires portant sur le profil sociodémographique des réfugiés qui ont été admis entre 2016 et 2022, notamment la répartition selon le sexe, l’âge, la province ou le territoire, la scolarité et la connaissance des langues officielles. Le graphique relatif au sexe présente les points de données suivants : Hommes : 52 %; Femmes : 48 %. Le graphique relatif à l’âge présente les points de données suivants : 17 ans et moins : 41 %; de 18 à 29 ans : 22 %; de 30 à 39 ans : 19 %; de 40 à 49 ans : 10 %; 50 ans et plus : 8 %. Le graphique relatif aux provinces et aux territoires présente les points de données suivants : Ontario : 42 %; Alberta : 18 %; Québec : 15 %; Toutes les autres provinces et tous les territoires : 25 %. Le graphique relatif à la scolarité présente les points de données suivants : Secondaire ou moins : 63 %; Études postsecondaires partielles : 29 %; Aucune scolarité : 7 %. Le graphique relatif aux langues officielles présente les points de données suivants : Ne parlent ni l’anglais ni le français : 63 %; Parlent seulement l’anglais : 33 %; Parlent seulement le français : 2 %; Parlent le français et l’anglais : 2 %.
Différences par volet de programme
L’évaluation a mis en évidence certaines différences dans les caractéristiques des réfugiés admis selon les volets du Programme de réinstallation des réfugiés. De manière générale:
- Une plus grande proportion de RPSP (54 %) possédait au moins une certaine compétence dans les langues officielles à l’admission (comparativement à 17 % des RPG et à 20 % des RDBV).
- Une plus grande proportion de RPSP (36 %) avait fait au moins certaines études postsecondaires (comparativement à 19 % des RPG et à 14 % des RDBV).
- Les RDBV et les RPG avaient tendance à être plus jeunes; 71 % des RDBV et 70 % des RPG avaient moins de 30 ans au moment de l’admission, comparativement à 57 % des RPSP.
Constatations de l’évaluation
Besoin et justification
Constatation 1 : Le Programme de réinstallation des réfugiés repose sur une justification claire et solide, car il offre une protection immédiate et une solution durable aux réfugiés et aide le Canada à respecter ses obligations internationales.
Protection des réfugiés
Le HCR définit les réfugiés comme des personnes qui ont fui leur pays pour échapper à un conflit, à la violence ou à la persécution et qui ont cherché à se mettre en sécurité dans un autre paysNote de bas de page 6. Les obligations internationales en matière de protection des réfugiés sont fondées sur la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que sur le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018. Les pays signataires, dont le Canada, ont la responsabilité de fournir une protection et des solutions durables en offrant l’une des trois solutions suivantes:
- Le rapatriement volontaire (les réfugiés retournent volontairement dans leur pays d’origine une fois que les conditions sont sûres);
- Intégration locale (intégration dans le pays où les réfugiés ont demandé l’asile);
- Réinstallation dans un pays tiers (les réfugiés sont sélectionnés dans leur pays d’asile pour être transférés dans un pays tiers). La réinstallation est souvent utilisée comme solution de dernier recours.
Selon le HCR, la réinstallation des réfugiés est un outil de protection destiné à répondre aux besoins des réfugiés, à offrir une solution à long terme aux réfugiés et à constituer un mécanisme de partage des responsabilités entre les pays qui accueillent les réfugiés.
Obligations internationales du Canada
L’examen des documents et les entrevues ont permis de constater que le Programme de réinstallation des réfugiés repose sur une justification claire et solide pour répondre aux obligations internationales du Canada, car le Canada s'acquitte de ses obligations en matière de protection des réfugiés et de partage du fardeau, principalement par l’intermédiaire du Programme de réinstallation des réfugiés.
Certaines personnes interrogées ont fait remarquer que le Canada est un chef de file mondial en matière de réinstallation. De 2016 à 2022, le Canada a accueilli chaque année le plus grand ou le deuxième plus grand nombre de réfugiés réinstallés de tous les pays, soit entre 25 % et 42 % de tous les réfugiés réinstallés dans le monde chaque année. Il a également été souligné que le Canada accueille un grand nombre de réfugiés dont les besoins sont importants et qu’il entretient des relations fortes avec le HCR.
Besoin mondial de réinstallation
L’examen des documents et les entrevues ont montré que le Programme de réinstallation des réfugiés est nécessaire pour répondre à un besoin mondial croissant en matière de réinstallation. Le HCR a estimé qu’en 2022, il y a eu 35,3 millions de réfugiés dans le monde, dont 1,5 million ont eu besoin d’être réinstallés, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 1,1 million de réfugiés ayant eu besoin d’être réinstallés en 2016Note de bas de page 7. Malgré les besoins croissants, on estime que seulement 5 % des personnes ayant besoin d’être réinstallées le sont chaque année.
Figure 4 : Réfugiés réinstallés par rapport au besoin mondial de réinstallation (SMGC, HCR)

Figure 4
La figure présente un graphique linéaire illustrant trois tendances, entre 2016 et 2022, en nombre absolu : les besoins mondiaux en matière de réinstallation, le nombre de réfugiés réinstallés dans le monde et le nombre de réfugiés réinstallés au Canada. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne les besoins mondiaux en matière de réinstallation : 2016 : 1 100 000; 2017 : 1 200 000; 2018 : 1 400 000; 2019 : 1 400 000; 2020 : 1 400 000; 2021 : 1 400 000; 2022 : 1 500 000. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne le nombre de réfugiés réinstallés dans le monde : 2016 : 189 300; 2017 : 102 800; 2018 : 92 400; 2019 : 107 800; 2020 : 34 400; 2021 : 57 500; 2022 : 114 300. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne le nombre de réfugiés réinstallés au Canada : 2016 : 46 700; 2017 : 26 600; 2018 : 28 100; 2019 : 30 100; 2020 : 9 200; 2021 : 20 400; 2022 : 47 600.
Justification pour les volets du programme
Les personnes interrogées ont estimé que tous les volets du programme (RPG, RPSP et RDBV) étaient utiles et contribuaient aux objectifs généraux du Programme de réinstallation des réfugiés, certains décrivant les volets comme ayant des priorités différentes, mais complémentaires.
Volet des RPG
L’examen des documents et les entrevues ont mis en évidence le fait que le volet des RPG donnait la priorité aux réfugiés les plus vulnérables, identifiés comme tels par le HCR ou d’autres organisations de recommandation. Les personnes interrogées ont décrit le volet des RPG comme le volet de réinstallation « classique » du Canada et ont estimé que ce volet était fortement aligné sur les objectifs émanant du HCR et de la LIPR.
Volet des RPSP
L’examen des documents et les entrevues ont souligné qu’en plus de fournir une protection, le volet des RPSP contribuait à de meilleurs résultats en matière d’établissement et de regroupement familial, étant donné que le parrainage est souvent lié à la famille, ce qui permet l’établissement d’un réseau de soutien plus large pour les réfugiés. L’examen des documents et les entrevues ont également montré que le parrainage privé permet aux Canadiens de s’investir directement dans la réinstallation des réfugiés et d’augmenter le nombre de places de protection.
Certaines personnes interrogées ont souligné que le modèle canadien de RPSP faisait des émules dans d’autres pays et que le Canada jouait un rôle important dans le renforcement des capacités mondiales en matière de parrainage privé par le biais de l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR). Les personnes interrogées estimaient que le volet des RPSP était utile à la promotion et au renforcement de la protection des réfugiés dans le monde, ainsi qu’au Canada.
Volet des RDBV
Le volet des RDBV a été instauré en 2013 dans le cadre d’une initiative d’économie visant à conserver des places de protection tout en diminuant le coût du soutien aux RPG pour le GdC. Conformément aux conclusions de l’évaluation des RDBV (2021), on a constaté que les objectifs du volet des RDBV ont évolué au fil du temps pour permettre aux réfugiés les plus vulnérables de bénéficier d’un soutien au parrainage sur mesure, et aux répondants de répondre plus facilement aux crises mondiales des réfugiésNote de bas de page 8.
Même si certaines personnes interrogées étaient d’avis que le volet des RDBV combine bien les avantages des volets des RPG et des RPSP, l’examen des documents et certaines entrevues ont mis en évidence des difficultés – par exemple, le volet des RDBV a été peu utilisé, et certains estimaient qu’il ne permet plus de réduire les coûts comme prévu. IRCC a mis en œuvre de nombreuses initiatives pour encourager l’utilisation du RDBV, avec un succès mitigé.
Le recours au volet des RDBV est resté faible en 2022, et certaines personnes interrogées ont estimé qu’il faudrait revoir les objectifs du volet afin d’augmenter le nombre de places de protection utilisées.
Figure 5 : Admissions de réfugiés par volet, 2016-2022 (SMGC)

Figure 5
La figure présente un diagramme circulaire montrant la répartition des admissions de réfugiés par volet, pour la période de 2016 à 2022. La figure présente les points de données suivants : RPSP : 53 %; RPG : 43 %; RDBV : 4 %.
Objectifs du programme
Constatation 2: Le Programme de réinstallation des réfugiés est utilisé pour répondre à des objectifs d’ordre humanitaire en constante évolution. Même si les politiques d’intérêt public soutiennent la capacité d’IRCC à répondre à des crises, cela se fait au détriment des objectifs habituels de réinstallation.
Réinstallation traditionnelle des réfugiés
Pour être réinstallée au Canada en tant que réfugié, une personne doit être recommandée par un organisme de recommandation (p. ex. le HCR) ou un groupe de parrainage privé, et appartenir à l’une des deux catégories de réfugiés du Canada:
Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières
- Se trouvent à l’extérieur de leur pays d’origine.
- Ne peuvent y retourner en raison d’une crainte fondée de persécution reposant sur l’origine ethnique, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l’appartenance à un groupe social particulier.
Catégorie de personnes de pays d’accueil
- Se trouvent en dehors de leur pays d’origine ou du pays où ils vivent habituellement.
- Ont été gravement touchés par une guerre civile ou un conflit armé, ou par des violations massives et permanentes des droits de la personne.
Évolution des objectifs d’ordre humanitaire
Toutefois, le paragraphe 25.2(1) de la LIPR autorise le ministre à accorder le statut de résident permanent ou des dispenses aux critères d’admissibilité, par exemple en renonçant aux critères habituels de réinstallation par voie de politiques d’intérêt publicNote de bas de page 9.
L’examen des documents et les entrevues ont révélé qu’on a plus fréquemment eu recours à des politiques d’intérêt public ces dernières années pour cibler des populations qui ne répondent pas aux exigences du Canada en matière de réinstallation, par exemple en les dispensant de l’exigence de se trouver en dehors du pays d’origine. Cette dispense a permis au gouvernement du Canada d’accorder une protection aux populations qui n’ont pas pu quitter leur pays d’origine en raison de crises humanitaires, comme dans le cadre de l’initiative sur les survivants de Daesh. En outre, le programme a contribué à la réinstallation de plus de 40 000 Afghans de 2021 à 2023, honorant ainsi un engagement humanitaire du gouvernement du Canada.
Les personnes interrogées ont estimé que, même si les politiques d’intérêt public permettent au Canada de répondre aux crises humanitaires émergentes et aux objectifs en matière de politique étrangère, leur utilisation se fait au détriment des objectifs habituels de réinstallation.
Défis relatifs aux politiques d’intérêt public
Défis et objectifs
Certaines personnes interrogées ont estimé que le Programme de réinstallation des réfugiés était utilisé pour atteindre des objectifs pour lesquels il n’a pas été conçu, ce qui crée une certaine confusion quant aux personnes admissibles à la réinstallation des réfugiés et aux services qui leur sont destinés. Les personnes interrogées ont aussi fait remarquer que le recours à des politiques d’intérêt public pour la réinstallation de réfugiés consomme beaucoup de ressources.
Certains ont estimé que le recours aux politiques d’intérêt public révèle un décalage entre la définition de « réfugié » au sens de la LIPR et les engagements publics du Canada en matière de crises humanitaires, ce qui indiquerait soit que les critères relatifs aux réfugiés énoncés dans la LIPR sont trop restrictifs pour tenir compte de l’évolution des objectifs, soit que les engagements publics ne sont pas harmonisés avec la réglementation.
Les personnes interrogées ont indiqué qu’il était nécessaire de répondre à l’évolution des crises humanitaires tout en protégeant les programmes de réinstallation habituels et les demandes en attente de traitement. En 2024, un cadre de réponse aux crises était en cours d’élaboration à IRCCNote de bas de page 10.
Défis en matière d’équité
L’examen des documents et les entrevues ont fait état de l’inégalité perçue dans la dérogation aux critères pour certaines populations seulement et du fait que ces populations bénéficient d’un traitement et d’une protection plus opportuns au détriment des demandes de réinstallation déjà en attente de traitement.
Cette inégalité a eu un effet négatif sur l’engagement des intervenants externes, qui se sont inquiétés du fait que certaines populations puissent bénéficier d’un traitement préférentiel par l’intermédiaire des politiques d’intérêt public.
Gouvernance
Constatation 3: La complexité de la structure de gouvernance et le manque de clarté des rôles et responsabilités internes ont compliqué la coordination du Programme de réinstallation des réfugiés et ont eu des répercussions négatives sur les relations avec les intervenants externes.
Gouvernance complexe
Au fil des ans, les évaluations internes, vérifications, bilans et notes de service ont tous mis en évidence les défis liés à la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés. Malgré les efforts d’amélioration déployés en 2021, comme la création de nouvelles directions générales et d’un conseil de gouvernance interne, la moitié des personnes interrogées ont estimé que la gouvernance restait une difficulté majeure.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés est fragmentée entre plusieurs secteurs et de nombreuses directions générales d’IRCC, ce qui crée un manque de coordination entre les intervenants internes. Plus particulièrement, les documents examinés et les personnes interrogées ont fait ressortir les difficultés suivantes:
- Certaines personnes interrogées ont estimé qu’il y avait un manque de coordination entre les directions politiques et opérationnelles.
- La création du Secteur de l’Afghanistan et des directions générales correspondantes a encore plus fragmenté la gouvernance en matière de réinstallation.
- Certaines personnes interrogées ont déclaré que la réorganisation ministérielle de 2021 n’avait fait qu’accroître la complexité.
- Certaines personnes interrogées ont estimé qu’il y avait un manque de cohésion et de coordination entre les directions générales de réinstallation et d’établissement.
Rôles et responsabilités internes
Les personnes interrogées ont évoqué le manque de clarté des rôles découlant de la complexité de la gouvernance et ont fait part de leur confusion quant à la répartition des responsabilités relatives à l’orientation fonctionnelle, à la mise en œuvre des politiques, aux relations avec les intervenants et au PAR.
Les documents examinés ont aussi révélé un manque de clarté. En effet, les documents internes présentent souvent de l’information inexacte, obsolète ou contradictoire sur les rôles et responsabilités. En raison de la complexité de la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés et des changements fréquents qui y sont apportés, l’évaluation n’a pas permis d’établir une chronologie complète des changements survenus à l’égard des rôles et des responsabilités. Par exemple, la responsabilité du PAR a été transférée d’une direction à une autre à plusieurs reprises au cours de la période d’évaluation, et les documents examinés ainsi que les entrevues ont fait ressortir des points de vue contradictoires quant à l’entité responsable du PAR au moment de l’évaluation.
Les personnes interrogées ont décrit les problèmes de coordination interne résultant d’une gouvernance complexe et de rôles peu clairs, mentionnant notamment:
- un manque de communication à l’échelle fonctionnelle, entre les directions générales, malgré une meilleure coordination à l’échelle de la haute direction;
- une communication tardive ou erronée entre les intervenants, notamment en ce qui concerne les Transmission‑préavis d’arrivée (TPA), les documents relatifs aux réfugiés et les demandes de renseignements internes;
- des problèmes de communication de données, notamment en ce qui concerne l’attribution des cas de parrainage.
En particulier, des problèmes de coordination avec les bureaux de migration du Réseau mondial (RM) ont été relevés.
Participants externes
Selon les personnes interrogées, en plus d’avoir une incidence négative sur la coordination interne, les problèmes de gouvernance nuisent aux relations d’IRCC avec les intervenants externes, plus précisément les répondants. Des problèmes de coordination interne ont entravé la capacité d’IRCC à communiquer aux SEP le nombre de places disponibles pour l’attribution de cas de parrainage, et créé un risque que le Ministère propose trop ou trop peu de cas, ce qui pourrait pénaliser les SEP et faire perdre des places de réinstallation.
Les personnes interrogées ont également fait remarquer que le programme dépendait fortement de partenaires extérieurs, mais que les changements fréquents dans la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés rendaient plus difficiles les contacts et la coordination entre les partenaires extérieurs et IRCC, par exemple lorsqu’un point de contact est déplacé.
Rapidité de la protection
Constatation 4: Le Programme de réinstallation des réfugiés offre de la protection dans un temps opportun aux réfugiés lorsque les dossiers sont traités en priorité. Toutefois, la priorité accordée à certains groupes contribue à un accès globalement inéquitable.
Efficacité du traitement
Les personnes interrogées ont estimé que le traitement était efficace et que les objectifs étaient systématiquement atteints, suivant les niveaux planifiés. Les données administratives ont montré que les objectifs ont été atteints, à l’exception des années affectées par les restrictions de voyage liées à la COVID-19. Toutefois, l’examen des documents et les personnes interrogées ont mis en évidence certains problèmes de traitement, notamment:
- l’absence de gestion de réception pour des demandes de RPSP pour les répondants des catégories RC et G5, les demandes reçues dépassant les niveaux annuels de places, ce qui se traduit par une augmentation des demandes qui sont en attente de traitement et des temps d’attente;
- l’absence d’investissement dans le matériel informatique pour la réception numérique des recommandations des demandes et la dépendance à l’égard des dossiers papier et du courrier électronique, qui est plus chronophage et pose des problèmes de confidentialité pour les renseignements relatifs aux demandes;
- le mode de traitement particulier de chaque mission – les demandes traitées dans une mission manquant de ressources étaient assujetties à des délais de traitement beaucoup plus longs;
- erreurs de traitement de certaines demandes de RPSP, notamment des demandes de parrainage reçues sans qu’un numéro de dossier d’IRCC ne leur soit attribué.
Au moment de l’évaluation, des travaux étaient en cours pour améliorer l’efficacité du traitement, y compris la mise en œuvre de la réception numérique.
Rapidité du traitement
À ce jour, il n’existe pas de normes de service pour le traitement des demandes de réfugié. Or, près de la moitié des personnes interrogées ont estimé que, dans l’ensemble, le programme n’offre pas de protection suffisamment opportune.
IRCC applique une « période de décision du 80e centile » pour rendre compte du délai de traitement des demandes de réfugié, soit le temps nécessaire pour que 80 % des demandes soient traitées, de la réception à la décision finale, exprimé en mois. De 2016 à 2021, la période de décision du 80e centile a oscillé entre 18 et 32 mois.
Au 22 juillet 2022, on comptait 103 968 demandes de réfugié en attente de traitement, dont les deux tiers étaient des RPSP (69 %). Seuls 3 % d’entre elles avaient été reçues avant 2018, ce qui indique que les délais d’attente supérieurs à cinq ans sont rares.
Figure 6 : Délai de traitement des demandes de réfugié par volet, 80e centile de la période de décision (SMGC)
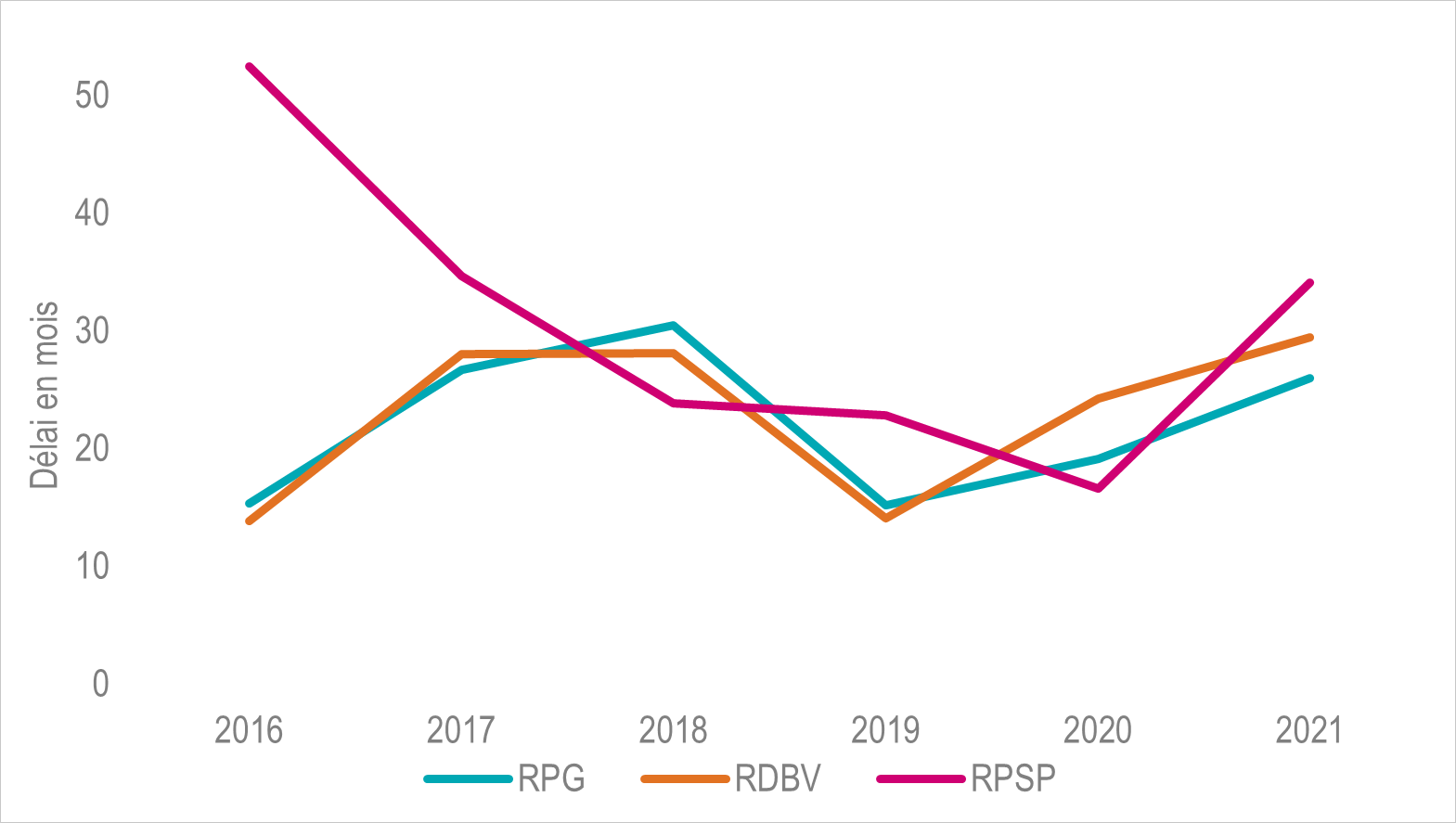
Figure 6
La figure illustre un graphique linéaire montrant le délai de traitement des demandes de réfugié par volet au 80e centile de la période de décision, par catégorie et par année, de 2016 à 2021. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : 2016 : 15 mois; 2017 : 27 mois; 2018 : 30 mois; 2019 : 15 mois; 2020 : 19 mois; 2021 : 26 mois. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : 2016 : 52 mois; 2017 : 35 mois; 2018 : 24 mois; 2019 : 23 mois; 2020 : 17 mois; 2021 : 34 mois. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : 2016 : 14 mois; 2017 : 28 mois; 2018 : 28 mois; 2019 : 14 mois; 2020 : 24 mois; 2021 : 29 mois.
Traitement inéquitable
Les demandes de réinstallation doivent être traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », en suivant le plan des niveaux d’immigration. Cependant, le traitement des demandes de certains groupes peut être priorisé en fonction des engagements ministériels (p. ex. politiques d’intérêt public), de la vulnérabilité déterminée par les bureaux des migrations (p. ex. femmes à risque) ou des recommandations des partenaires (p. ex. recommandations d’urgence du HCR).
L’examen des documents et les données du SMGC ont montré que le traitement par ordre de priorité permet au GdC d’offrir la protection dans un temps opportun et d’atteindre les objectifs d’ordre humanitaire. Par exemple, le traitement prioritaire dans le cadre de l’ORS et du programme humanitaire pour les ressortissants afghans a permis aux réfugiés syriens et afghans de bénéficier d’une protection plus opportune :Note de bas de page 11
- les réfugiés syriens devaient patienter 16 mois en 2016 pendant l’ORS, comparativement à plus de cinq ans en 2021;
- en 2021, le délai de traitement des dossiers des réfugiés afghans a été ramené à un mois, alors qu’il était de cinq à sept ans de 2016 à 2019.
À l’inverse, les groupes non prioritaires attendent souvent beaucoup plus longtemps. Dans certains pays, la période de décision au 80e centile dépassait neuf ans au cours de la période d’évaluation.
On a relevé dans la littérature universitaire qu’un déplacement prolongé a des répercussions négatives sur la santé mentale des réfugiés et sur leur capacité à s’adapter ou à se remettre d’événements stressants et traumatisants, ce qui laisse à penser que la longueur des délais de traitement aura des répercussions négatives sur les objectifs d’indépendance et d’intégration à plus long terme du Programme de réinstallation des réfugiés. Il convient de noter que les délais de traitement d’IRCC n’incluent pas le temps que les réfugiés passent à se rendre dans leur pays d’asile ou à attendre la détermination du statut de réfugié (DSR) ou leur recommandation.
Figure 7 : Délai de traitement des demandes de réfugié par pays de résidence en 2021, 80e centile de la période de décision (SMGC)Note de bas de page 12

Figure 7
La figure présente le temps de traitement en mois pour 2021, par pays de résidence, au moyen du 80e centile. La figure présente les données suivantes : Afghanistan : 1 mois; Algérie : 23 mois; Angola : 0 mois; Arménie : 0 mois; Botswana : 0 mois; Burundi : 42 mois; Cameroun : 36 mois; Tchad : 49 mois; Chypre : 0 mois; Djibouti : 39 mois; Équateur : 0 mois; Égypte : 36 mois; Érythrée : 0 mois; Éthiopie : 35 mois; Allemagne : 33 mois; Ghana : 28 mois; Grèce : 0 mois; Guinée : 0 mois; Inde : 40 mois; Indonésie : 32 mois; Iran : 73 mois; Irak : 29 mois; Israël : 35 mois; Côte d’Ivoire : 0 mois; Jordanie : 27 mois; Kenya : 31 mois; Koweït : 42 mois; Liban : 44 mois; Libye : 26 mois; Malawi : 24 mois; Malaisie : 31 mois; Mexique : 5 mois; Maroc : 32 mois; Mozambique : 0 mois; Namibie : 0 mois; Népal : 0 mois; Niger : 18 mois; Oman : 0 mois; Pakistan : 18 mois; Qatar : 49 mois; République du Congo : 50 mois; Russie : 0 mois; Rwanda : 16 mois; Arabie saoudite : 38 mois; Somalie : 27 mois; Afrique du Sud : 27 mois; Sri Lanka : 29 mois; Soudan : 29 mois; Suède : 0 mois; Syrie : 69 mois; Tadjikistan : 30 mois; Tanzanie : 32 mois; Thaïlande : 33 mois; Turquie : 25 mois; Ouganda : 35 mois; Émirats arabes unis : 40 mois; États‑Unis : 3 mois; Yémen : 0 mois; Zambie : 6 mois; Zimbabwe : 0 mois.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que les politiques d’intérêt public et les arrivées massives de réfugiés ont un impact négatif sur le traitement des demandes et les demandes en attente de traitement, car elles détournent les ressources des réfugiés habituels. Par exemple, l’examen des documents a révélé qu’on s’attendait à ce que l’engagement en faveur de l’Afghanistan en 2021 retarde l’équivalent d’une année de demandes régulières, soit environ 13 500 cas de réfugiés, sur une période de trois ans.
Certains informateurs clés ont estimé que ce détournement de ressources nuit à l’engagement d’IRCC auprès des répondants, des réfugiés et du grand public.
Soutien et réponse aux besoins
Constatation 5: Dans l’ensemble, le Programme de réinstallation des réfugiés répond aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés; toutefois, les RPG, les réfugiés LGBTQ2 et les personnes vivant avec un handicap ont de la difficulté à obtenir satisfaction à leurs besoins.
Transmission-préavis d’arrivée (TPA)
Une fois la demande de réfugié approuvée, le RM envoie une TPA au FS du point d’entrée et au bureau local d’IRCC. La TPA comprend des informations sur l’arrivée prévue du réfugié et sur les besoins particuliers qui pourraient nécessiter une attention supplémentaire à l’arrivée. Les TPA doivent être envoyées au moins 10 jours ouvrables avant l’arrivée prévue.
Les personnes interrogées ont souligné les défis liés à l’exhaustivité et à la rapidité des TPA. En particulier, il a été noté qu’en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée, les TPA ne contiennent souvent pas d’informations médicales sur les réfugiés, ce qui fait que certains d’entre eux arrivent au Canada avec des problèmes médicaux graves et inconnus. Certaines personnes interrogées ont estimé que le fait de ne pas fournir ces informations à l’avance empêchait les FS du PAR et les répondants de satisfaire les besoins immédiats et essentiels des réfugiés.
Tout en reconnaissant que l’état de préparation au voyage des réfugiés peut être imprévisible en raison de facteurs externes, certaines personnes interrogées ont indiqué que la norme de service de 10 jours ouvrables pour les TPA ne donne pas suffisamment de temps aux répondants pour se préparer. L’examen des documents et les entrevues ont montré que pendant la pandémie de COVID-19, un « pré-TPA » était envoyé aux répondants plusieurs mois avant leur arrivée, mais que ce processus n’était plus utilisé.
Soutien aux points d’entrée
Lorsqu’un réfugié arrive au Canada, le FS du PDE doit l’accueillir à l’aéroport, l’aider avec les formalités d’immigration et de douane, et veiller à ce qu’il soit transporté jusqu’à sa destination finale ou accueilli par un FS du PAR ou un répondant à l’aéroport. Du 15 octobre au 15 avril, les FS des PDE doivent également fournir aux RPG des vêtements d’hiver.
De 2016 à 2022, 147 498 services uniques au PDE ont été fournis. Les résultats du sondage ont suggéré que presque tous les réfugiés ont été accueillis à l’aéroport (95 %) par une personne capable de communiquer avec eux (93 %) et ont été transportés vers des logements temporaires (89 %). Certains réfugiés ont estimé avoir besoin de vêtements d’hiver au point d’entrée et n’en ont pas reçu (30 %), mais des politiques internes prévoient qu’une allocation vestimentaire puisse être offerte, plutôt que des vêtements.
Aide de démarrage
Après leur arrivée au Canada, une fois installés dans un logement permanent, les réfugiés reçoivent de l’aide en nature ou financière pour couvrir les besoins initiaux tels que le linge de maison, les vêtements, les meubles et les services publics. Les FS du PAR sont chargés d’informer les réfugiés sur l’aide de démarrage à leur disposition et de veiller à ce qu’ils reçoivent les divers services d’aide immédiats et essentiels. Les répondants doivent veiller à ce que les besoins des RDBV et des RPSP soient satisfaits.
La majorité des réfugiés interrogés ont déclaré avoir reçu de l’aide au cours des premières semaines et que cette aide avait répondu à leurs besoins, dans différentes catégories. Une proportion plus faible de RPG a déclaré avoir bénéficié d’une aide de démarrage, par rapport aux réfugiés parrainés. Les intervenants ont fait remarquer que, comme les RPG ne reçoivent certains services d’aide de démarrage qu’après avoir trouvé un logement permanent, la disparité entre les réfugiés pris en charge par le gouvernement et les réfugiés parrainés par le secteur privé peut révéler des retards dans l’obtention de l’aide par les RPG.
Figure 8 : Réfugiés interrogés ayant déclaré avoir bénéficié d’une aide de démarrage

Figure 8
La figure présente un graphique en suçons illustrant la proportion de réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir reçu un soutien au démarrage, par type de soutien et par type de réfugié. En général, la figure montre un écart entre la proportion de RPG ayant déclaré avoir reçu des soutiens, par rapport aux RDBV et aux RPSP. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : Téléphone/Internet : 47 %; Alimentation et produits de base: 66 %; Services publics : 60 %; Transports : 59 %; Linge de maison; 70 %; Besoins essentiels des ménages: 56 %; Vêtements : 49 %; Mobilier : 76 %. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : Téléphone/Internet : 83 %; Alimentation et produits de base: 88 %; Services publics : 90 %; Transports : 80 %; Linge de maison; 89 %; Besoins essentiels des ménages : 88 %; Vêtements : 82 %; Mobilier : 87 %. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : Téléphone/Internet : 83 %; Alimentation et produits de base: 89 %; Services publics : 86 %; Transports : 84 %; Linge de maison; 87 %; Besoins essentiels des ménages: 85 %; Vêtements : 78 %; Mobilier : 86 %.
Parmi les réfugiés qui ont déclaré avoir reçu une aide au démarrage au cours des premières semaines, les RPG avaient une opinion moins positive de la façon dont cette aide répondait à leurs besoins que les RPSP et les RDBV, ce qui laisse supposer qu’une proportion plus faible de RPG voit ses besoins satisfaits au cours des premières semaines, même en tenant compte des retards dans la prestation des services.
Figure 9 : Réfugiés interrogés ayant déclaré que « tous » leurs besoins initiaux ou « la plupart » d’entre eux avaient été satisfaits

Figure 9
La figure présente un graphique en suçons illustrant la proportion de réfugiés sondés qui ont déclaré que leurs besoins en matière de démarrage ont été « en tout » ou « en partie » satisfaits, par type de soutien et par type de réfugié. En général, la figure montre un écart entre la proportion de RPG ayant déclaré que leurs besoins ont été satisfaits « en tout » ou « en partie » par rapport aux RDBV et aux RPSP. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : Téléphone/Internet : 78 %; Alimentation et produits de base: 76 %; Services publics : 75 %; Transports : 74 % Linge de maison : 67 %; Besoins essentiels des ménages: 65 %; Vêtements : 62 %; Mobilier : 60 %. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : Téléphone/Internet : 92 %; Alimentation et produits de base: 92 %; Services publics : 91 %; Transports : 92 %; Linge de maison : 91 %; Besoins essentiels des ménages: 91 %; Vêtements : 86 %; Mobilier : 92 %. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : Téléphone/Internet : 95 %; Alimentation et produits de base: 95 %; Services publics : 95 %; Transports : 94 %; Linge de maison : 94 %; Besoins essentiels des ménages: 93 %; Vêtements : 93 %; Mobilier : 92 %.
Rapidité et réactivité
Presque tous les réfugiés ont estimé que les services qu’ils ont reçus au cours des premières semaines, que ce soit de la part d’un FS ou d’un répondant, étaient opportuns et adaptés à leurs besoins et à leur situation, et qu’ils ont été offerts aussi longtemps que nécessaire. De même, la plupart des FS du PAR et des répondants interrogés n’ont signalé aucune difficulté majeure pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés. Par exemple, peu de FS du PAR ont fait état de difficultés à évaluer les besoins, à fournir des services d’aiguillage (p. ex. vers la formation linguistique, le gestion de cas), à offrir des services d’orientation ou à établir des liens avec des programmes fédéraux ou provinciaux.
Besoins et aide en matière d’information
Les FS du PAR et les répondants fournissent des informations pour aider les réfugiés à comprendre ce qu’ils doivent savoir au cours de leurs premières semaines au Canada, notamment sur des sujets tels que leur communauté ou ville, les finances, l’emploi, les écoles et les soins de santé.
La plupart des réfugiés interrogés ont déclaré avoir besoin d’aide sur ces sujets, et le besoin de soutien était plus élevé chez les RPG (63 %) et les RDBV (62 %), par rapport aux RPSP (53 %)Note de bas de page 13. La plupart des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir besoin de cette aide l’ont reçue et ont estimé qu’elle avait répondu à leurs besoins. Toutefois, la proportion de RPG ayant déclaré que les services répondaient à leurs besoins était inférieure à celle des réfugiés parrainés.
Dans le cadre de l’orientation immédiate et essentielle, il est demandé aux FS du PAR d’enseigner aux clients différentes notions sociales et culturelles, telles que la dualité linguistique, les droits de la personne et le multiculturalisme. Dans ces matières, une plus faible proportion de RPSP (qui ne bénéficient pas des services du PAR) a déclaré avoir appris ces notions.
Services d’établissement
En plus de répondre aux besoins immédiats, les FS du PAR et les répondants doivent également aider les réfugiés à se renseigner sur les services d’établissement, tels que la formation linguistique, les services d’aide aux clients et d’autres formes de soutien à plus long terme, et à en bénéficier.
Le sondage réalisé auprès des réfugiés a révélé que même si les cours de langue étaient bien connus, les autres services d’établissement l’étaient relativement peu. Les RPG (51 %) et les RDBV (57 %) étaient plus nombreux à connaître ces services que les RPSP (43 %)Note de bas de page 14. L’examen des documents et les entrevues ont également mis en évidence le fait que les RPSP sont peut‑être moins au courant des mesures d’aide à l’établissement.
Bien que tous les réfugiés ne soient pas conscients de l’étendue des services disponibles, la majorité d’entre eux ont déclaré avoir reçu les services dont ils avaient besoin. Les services les plus fréquemment demandés, mais non reçus, étaient l’aide à la recherche d’emploi (57 %) et la mise en relation avec d’autres services communautaires (53 %). Les obstacles les plus fréquents à l’accès aux services étaient le fait de ne pas savoir où et comment obtenir des services (33 %), la nécessité de travailler (25 %) et le manque de moyens de transport (22 %). Ces obstacles ont également été relevés dans la littérature universitaire.
Défis et groupes ACS Plus
L’évaluation a révélé que certains groupes de réfugiés, notamment les réfugiés lesbiens, gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels (LGBTQ2), les réfugiés vivant avec un handicap et, dans une moindre mesure, les femmes, éprouvent des difficultés à satisfaire leurs besoins immédiats.
L’examen des documents et les entrevues ont montré que les femmes peuvent être confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder aux services d’établissement et à l’emploi en raison des responsabilités liées à la garde des enfants et des normes liées au sexe. Le sondage à l’intention des réfugiés n’a pas révélé de différences majeures entre les femmes et les hommes se déclarant comme tels, tous besoins confondus. Toutefois, les réfugiés qui se sont identifiés à plus d’un sexe avaient davantage besoin de services, avaient moins accès aux services et avaient moins de besoins satisfaits dans l’ensemble.
L’analyse documentaire a suggéré que les réfugiés LGBTQ2 sont confrontés à des obstacles fondés sur la discrimination, notamment des difficultés d’accès aux informations relatives aux services et aux communautés LGBTQ2 au Canada, ainsi qu’à l’isolement social. Les personnes interrogées ont fait remarquer que les réfugiés LGBTQ2 peuvent être victimes de discrimination dans l’accès aux services et peuvent rencontrer des obstacles dans la mise en place de réseaux de soutien plus larges.
L’examen des documents et les entrevues ont également mis en évidence des obstacles à la prise en compte des besoins des réfugiés vivant avec un handicap. Par exemple, les FS et les répondants peuvent ne pas être en mesure de répondre aux besoins d’informations spécialisées ou d’aiguiller les réfugiés vers des services spécialisés (p. ex. les soins de santé). L’absence de transports accessibles a également été soulignée comme un obstacle majeur pour les personnes vivant avec un handicap, ce qui a encore entravé l’accès à d’autres services.
De manière générale, le sondage auprès des réfugiés a révélé que, bien que l’accès aux services soit globalement similaire, une plus grande proportion de réfugiés LGBTQ2 et de réfugiés vivant avec un handicap ont déclaré avoir rencontré des difficultés d’accès aux services au cours de leurs premières semaines au Canada.
Figure 10 : Part des réfugiés interrogés dans les groupes ACS Plus qui ont déclaré avoir rencontré des obstacles dans l’accès aux mesures de soutien

Figure 10
La figure présente un graphique en suçons illustrant la proportion de réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir fait face à des obstacles pour obtenir du soutien, par type de soutien, ventilée par l’ensemble des réfugiés, par réfugiés LGBTQ2 et par réfugiés ayant déclaré vivre avec un handicap. En général, le graphique montre un écart entre les réfugiés LGBTQ2 et les réfugiés ayant déclaré vivre avec un handicap, par rapport à l’ensemble des réfugiés. La figure présente les points de données suivants pour l’ensemble des réfugiés : Non mis au courant: 33 %; Liste d’attente : 23 %; Transports : 22 %; Services non adaptables: 6 %. La figure présente les points de données suivants pour les réfugiés LGBTQ2 : Non mis au courant: 41 %; Liste d’attente : 27 %; Transports : 25 %; Services non adaptables: 12 %. La figure présente les points de données suivants pour les réfugiés ayant déclaré vivre avec un handicap : Non mis au courant: 41 %; Liste d’attente : 30 %; Transports : 28 %; Services non adaptables: 27 %.
Logement
Constatation 6 : Le manque de logements permanents disponibles et les séjours prolongés dans des logements temporaires sont les principaux défis pour la prestation cohérente et opportune des services et des soutiens du PAR.
Logement temporaire
Lorsqu’un réfugié arrive au Canada, le FS du PAR ou le répondant est chargé de lui fournir un logement temporaire jusqu’à ce qu’il obtienne un logement permanent. Les logements temporaires peuvent être une maison d’accueil, un hôtel, un logement loué ou autre, et doivent être situés dans un emplacement central (par exemple, accès facile aux transports publics, aux locaux du FS, aux magasins d’alimentation). En outre, le FS du PAR ou le répondant doit fournir au réfugié des informations sur le logement, notamment sur la location, le bail et le paiement des services publics.
En général, les réfugiés interrogés étaient satisfaits de leur logement temporaire sur de nombreux points, tels que la sécurité, l’état et la proximité des transports en commun. La plupart des réfugiés ont déclaré avoir reçu les aides au logement dont ils avaient besoin, par exemple des informations sur la location et les responsabilités des propriétaires et des locataires. Toutefois, une proportion plus faible de RPG a déclaré avoir bénéficié de ces aides par rapport aux RPSP et aux RDBV.
Figure 11 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir reçu les informations dont ils avaient besoin en matière de logement

Figure 11
La figure présente un graphique en suçons illustrant la proportion de réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir reçu les renseignements dont ils avaient besoin en matière de logement, par catégorie de renseignements sur le logement et par type de réfugié. En général, le graphique montre un écart entre les RPG et les RDBV et les RPSP. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : Responsabilités du locataire : 84 %; Responsabilités du propriétaire : 78 %; Types de logements locatifs : 78 %; Règles de la communauté: 75 %; Baux : 75 %; Règlements en matière de logement: 74 %; Assurance du locataire: 68 %. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : Responsabilités du locataire : 92 %; Responsabilités du propriétaire : 87 %; Types de logements locatifs : 90 %; Règles de la communauté: 87 %; Baux : 84 %; Règlements en matière de logement: 82 %; Assurance du locataire: 82 %. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : Responsabilités du locataire : 92 %; Responsabilités du propriétaire : 87 %; Types de logements locatifs : 88 %; Règles de la communauté: 87 %; Baux : 84 %; Règlements en matière de logement: 84 %; Assurance du locataire: 80 %.
Dépassements de durée de séjour
Les logements temporaires sont destinés à permettre aux réfugiés de bénéficier d’un soutien et d’une orientation adéquats pour s’adapter pendant leurs premiers jours au Canada avant de vivre seuls dans la communauté. Le guide du FS du PAR indique que le séjour moyen dans un logement temporaire devrait être d’une à trois semaines, mais qu’il peut y avoir des dépassements de durée de séjour.
Des preuves de plusieurs sources de données ont suggéré que le temps passé dans des logements temporaires dépasse souvent la norme d’une à trois semaines. Un tableau de bord interne de 2023 a montré que la durée moyenne nationale de séjour dans un logement temporaire était de 60 jours, et 54 % des réfugiés interrogés ont déclaré être restés plus d’un mois, y compris 64 % des RPG.
Effets du dépassement de la durée de séjour
Les personnes interrogées ont estimé que le temps passé dans des logements temporaires était de plus en plus préoccupant. En particulier, les personnes interrogées ont fait remarquer que les séjours prolongés sont coûteux, qu’ils limitent la disponibilité des places pour les réfugiés nouvellement arrivés et qu’ils créent une charge administrative pour les FS qui doivent trouver de nouvelles places (par exemple, dans de nouveaux hôtels).
L’examen des documents et les entrevues ont également révélé que le soutien du revenu accordé dans le cadre du PAR prend fin un an après l’arrivée au Canada, mais que les réfugiés ne reçoivent ce soutien qu’une fois qu’ils ont trouvé un logement permanent. Par conséquent, les personnes interrogées ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les séjours prolongés dans des logements temporaires limitent le soutien du revenu global que les réfugiés reçoivent au cours de leur première année. Bien que les réfugiés reçoivent d’autres aides dans les logements temporaires au lieu du soutien du revenu, certaines personnes interrogées ont estimé que cela retardait l’indépendance du réfugié.
Les séjours prolongés dans des logements temporaires ont également un effet négatif sur la prestation des services du PAR, car certains services ne sont fournis qu’une fois le logement permanent obtenu (par exemple, l’orientation sur les transports publics), ou doivent être fournis à nouveau. Les personnes interrogées ont fait remarquer que pour certaines administrations, les enfants ne peuvent pas être inscrits à l’école sans adresse permanente et que les séjours prolongés dans un logement temporaire empêchent les enfants d’aller à l’école.
Logement permanent
Les FS du PAR et les répondants sont tenus d’aider les réfugiés à trouver un logement permanent et à s’y installer. Ils doivent tenir compte de facteurs tels que la sécurité, l’abordabilité, l’accessibilité des services, la taille et tout besoin particulier lorsqu’ils présentent des options de logement aux réfugiés.
La recherche d’un logement permanent a été signalée comme un défi par plusieurs sources de données. Parmi les réfugiés interrogés qui sont arrivés de 2016 à 2022, 14 % ont déclaré ne pas disposer d’un logement permanent au moment du sondage, au printemps 2023. La recherche d’un logement permanent était le deuxième défi le plus fréquemment signalé par les répondants, qui ont relevé des lacunes dans la disponibilité des logements au sein de leur communauté, ainsi que des problèmes d’abordabilité et de taille des logements. Les FS du PAR ont également indiqué qu’il était difficile d’aider les réfugiés à trouver un logement.
La majorité des réfugiés interrogés (91 %) qui ont trouvé un logement permanent étaient au moins un peu satisfaits de ce logement, la plupart d’entre eux déclarant qu’il était sûr, accessible et abordable. Dans l’ensemble, la plupart des réfugiés ont fait part d’opinions positives concernant leur premier logement permanent, bien qu’une proportion plus faible de RPG se soit déclarée satisfaite, par rapport aux RPSP et de RDBV.
Abordabilité des logements
L’abordabilité du logement a ajouté à la difficulté de trouver un logement permanent. La moitié des personnes interrogées et de nombreux FS du PAR ont fait savoir qu’ils rencontraient de graves difficultés pour trouver des logements abordables, en particulier pour:
- les célibataires et les couples (par exemple, ceux qui ne disposaient pas de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) pour subventionner le logement, ou ceux qui ne voulaient pas de colocataires);
- les familles nombreuses (c’est-à-dire manque de logements de taille convenable);
- les réfugiés vivant avec un handicap (manque d’accessibilité);
- les réfugiés LGBTQ2 (en raison de la discrimination de la part des propriétaires et des colocataires).
Plus de la moitié des réfugiés estimaient que les logements qu’ils avaient trouvés pourraient être plus abordables (54 %). Même si les intervenants ont souligné que la question du logement abordable est un défi pour tous les Canadiens et pas seulement pour les réfugiés, le statut de logement des RPG a une incidence sur la façon dont ils reçoivent les services du PAR et le soutien du revenu, ainsi que sur leur intégration à plus long terme.
Initiative de supplément au loyer
En réponse aux difficultés croissantes liées aux dépassements de séjour en logement temporaire et à l’abordabilité du logement, IRCC a mis en place l’Initiative de supplément au loyer (ISL) en mars 2022 sous la forme d’un projet pilote à durée limitée. L’initiative visait à réduire le temps passé par les RPG dans des logements temporaires et les coûts associés, à remédier aux goulets d’étranglement dans la prestation de services, à réduire les séjours prolongés et à combler les lacunes en matière d’abordabilité du logement.
L’ISL offre aux réfugiés admissibles une allocation exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 500 dollars par mois, qui vient s’ajouter à l’aide au revenu du PAR.Note de bas de page 15
Bien que le taux d’approbation de l’initiative ait atteint 94 % au cours de la première année, l’utilisation du programme a été faible, seuls 7 % des clients cibles ayant déposé une demande. Le complément moyen pour les clients approuvés s’est élevé à 330 $.
Les premières analyses d’incidence de l’ISL semblent indiquer qu’elle permet de réduire le temps passé dans des logements temporaires, de réduire les coûts associés à ces logements et d’aider les réfugiés confrontés à des obstacles supplémentaires (par exemple, en raison de l’accessibilité, de la taille du ménage ou de barrières fondées sur le sexe) à trouver un logement.
Gestion du rythme des arrivées
Constatation 7 : Les arrivées massives posent des défis en matière de prestation, de qualité et d’équité des services, ainsi que d’effectif et de capacités chez les FS du PAR.
Gestion du rythme et arrivées massives
La « gestion du rythme » consiste à gérer le taux d’arrivées de réfugiés au Canada afin de garantir que la communauté d’accueil puisse répondre aux besoins des clients. L’examen des documents et les entrevues ont permis d’établir une distinction entre les arrivées régulières (c’est-à-dire les réfugiés qui arrivent progressivement tout au long de l’année, conformément au plan des niveaux) et les arrivées massives (par exemple, ceux qui arrivent par des vols affrétés ou dans le cadre d’une politique publique).
L’examen des documents et les entrevues ont mis en évidence des préoccupations concernant les arrivées imprévisibles et incohérentes tout au long de l’année, par exemple lorsque quelques réfugiés arrivent un mois et des centaines le mois suivant. Même si les personnes interrogées ont indiqué que de nombreux facteurs externes influent sur le rythme des arrivées, certaines ont souligné que le rythme imprévisible et les arrivées massives ont un impact sur la prestation de services, sur les effectifs et sur les capacités des FS du PAR.
Les personnes interrogées ont également fait remarquer que les frais de transport pouvaient être moins élevés pour les réfugiés qui arrivaient sur des vols affrétés que pour ceux qui arrivaient par des vols réguliers, ce qui créait une inégalité pour les réfugiés et ajoutait des difficultés pour les FS dans la gestion des attentes. Certains ont estimé que cela avait engendré des frustrations, certains réfugiés étant contrariés par le fait d’avoir à contracter un plus gros prêt que les autres.
Impact du rythme des arrivées sur les services
Bien qu’IRCC ne dispose pas d’une méthode systématique pour différencier les arrivées massives des arrivées régulières, les données issues des sondages et les données administratives semblent indiquer que les arrivées massives peuvent avoir des répercussions sur la prestation de services.
Même si les réfugiés interrogés avaient des besoins similaires quelle que soit l’année d’admission, une plus petite proportion de RPG arrivés en 2021 ou 2022 ont déclaré avoir reçu des services au cours de leurs premières semaines au Canada, ou ont déclaré que les services reçus répondaient à leurs besoins. Les mêmes différences n’ont pas été observées chez les réfugiés parrainés.
Les données administratives montrent qu’une proportion moindre de RPG est enregistrée comme ayant bénéficié des services du PAR au cours des années d’arrivées massives (c’est-à-dire 2016, 2021-2022). Les intervenants ont estimé que ces écarts pouvaient révéler des lacunes dans les déclarations – par exemple, qui portaient à croire que les FS du PAR fournissent des services, mais n’ont peut-être pas le temps de les déclarer dans l’iEDEC.
Les personnes interrogées ont également estimé que les arrivées massives peuvent avoir des répercussions sur la prestation de services aux réfugiés qui arrivent à des moments coïncidant avec les arrivées massives. Même si les personnes interrogées ont fait remarquer que les arrivées massives pouvaient entraîner des économies d’échelle bénéfiques (par exemple, lorsqu’une banque aide de nombreux réfugiés à ouvrir des comptes en même temps), certaines se sont inquiétées du fait que cette approche donne la priorité à des services « universels » plutôt qu’à des aides personnalisées.
Figure 12 : Part des RPG recevant des services déclarés (iEDEC)



Figure 12
La figure présente trois graphiques à barres horizontales montrant la proportion de RPG qui ont été inscrits dans le système Immigration — Environnement de déclaration d’ententes de contribution (iEDEC) comme ayant reçu des services, par année, de 2016 à 2022. Trois graphiques sont présentés : Services d’orientation dans le cadre du Programme d’aide à la réinstallation (PAR), services d’évaluation dans le cadre du PAR et services de mise en relation dans le cadre du PAR. Dans tous les graphiques, les années qui comprenaient des arrivées massives (2016, 2021 et 2022) sont mises en évidence, car, en général, les graphiques montrent une tendance selon laquelle un nombre plus faible de RPG ont reçu des services au cours de ces années. La figure présente les points de données suivants pour les services d’orientation dans le cadre du PAR : 2016 : 80 %; 2017 : 84 %; 2018 : 84 %; 2019 : 91 %; 2020 : 91 %; 2021 : 85 %; 2022 : 78 %. La figure présente les points de données suivants pour les services d’évaluation dans le cadre du PAR : 2016 : 76 %; 2017 : 80 %; 2018 : 75 %; 2019 : 77 %; 2020 : 80 %; 2021 : 78 %; 2022 : 62 %. La figure présente les points de données suivants pour les services de mise en relation dans le cadre du PAR : 2016 : 83 %; 2017 : 85 %; 2018 : 83 %; 2019 : 87 %; 2020 : 89 %; 2021 : 84 %; 2022 : 75 %.
Impact du rythme sur la capacité des FS de RAP
L’examen des documents et les entrevues ont montré que les rythmes imprévisibles et les arrivées massives peuvent mettre à rude épreuve la capacité des FS du PAR. Les personnes interrogées ont fait remarquer que les FS du PAR sont tenus d’intensifier et de réduire leurs activités avant et après les arrivées massives, soulignant que l’intensification à court terme posait des problèmes pour trouver du nouveau personnel et entraînait de longues heures de travail et un épuisement professionnel, tandis que les baisses d’activité à la suite d’arrivées massives pouvaient accroître le risque de perdre des travailleurs qualifiés, d’alourdir les charges administratives liées à l’embauche et réduire les connaissances institutionnelles globales.
En outre, des documents internes et des personnes interrogées ont indiqué que les FS du PAR ont besoin de fonds supplémentaires pour répondre aux besoins des arrivées massives, ce qui entraîne souvent des retards de financement ou la réaffectation des fonds existants jusqu’à la réception des fonds supplémentaires.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que les arrivées massives peuvent mettre à rude épreuve les capacités du personnel du FS et limiter le soutien personnalisé qu’il peut offrir aux réfugiés. Par exemple, il se peut que des entrevues ne soient pas menées avec chaque réfugié pendant les périodes d’arrivées massives, ce qui fait que certains problèmes ne sont pas pris en compte et qu’il n’y a pas d’aide adaptée. Des documents internes ont indiqué que certains RPG se sont inquiétés du fait que le personnel du FS du PAR était trop occupé pour répondre à leurs besoins lors des arrivées massives.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que les FS du PAR doivent adapter leurs services pour répondre aux besoins des arrivées massives. Par exemple, comme le principal pays de naissance et la langue maternelle des réfugiés changent en cas d’arrivées massives, les FS du PAR doivent embaucher de nouveaux interprètes et modifier leurs services de traduction et d’interprétation pour répondre aux besoins des réfugiés.
Impact du rythme sur le logement temporaire
Les entrevues, l’examen des documents et les données administratives ont porté à croire que le temps passé dans les logements temporaires est plus élevé pendant les périodes d’arrivées massives en raison des difficultés à trouver un logement permanent pour de nombreux réfugiés dans un bref délai.
Les données administratives ont montré que, les années d’arrivées massives, la proportion de réfugiés hébergés dans des logements temporaires pendant plus de six semaines est plus importante.
Figure 13 : Proportion de réfugiés vivant dans un logement temporaire depuis plus de six semaines (iEDEC)

Figure 13
La figure présente un graphique à barres horizontales montrant la proportion de réfugiés habitant un logement temporaire pendant plus de six semaines, selon les données de l’iEDEC, par année, de 2016 à 2022. Les années où les nombres d’arrivées massives sont plus élevés (2016, 2021 et 2022) sont mises en évidence dans la figure. La figure présente les points de données suivants : 2016 : 15 %; 2017 : 6 %; 2018 : 7 %; 2019 : 9 %; 2020 : 6 %; 2021 : 15 %; 2022 : 27 %.
Les FS du PAR ont indiqué que le fait de devoir trouver des hébergements complémentaires pour absorber le surplus de personnes (par exemple, utiliser les hôtels lorsque les hébergements habituels sont complets) en cas d’arrivées massives nécessitait des ressources administratives plus importantes, par exemple, pour prendre le temps d’établir des relations et de fixer des attentes avec les nouveaux hôtels, ou parce que le personnel doit être réparti entre plusieurs sites.
Les personnes interrogées ont également fait remarquer que les séjours prolongés dans des logements temporaires avaient obligé certains FS du PAR à enseigner les compétences essentielles à la vie quotidienne alors que les réfugiés étaient encore à l’hôtel, ce qui, selon eux, peut retarder l’intégration et l’indépendance des réfugiés; par exemple, les réfugiés peuvent avoir besoin de services en double et d’une réorientation après avoir déménagé, ou avoir plus de difficultés à s’adapter à un logement permanent.
Les personnes interrogées et les données financières ont également mis en évidence l’augmentation des coûts du logement temporaire. En particulier, le coût de l’hébergement temporaire par client a considérablement augmenté ces dernières années. Les personnes interrogées ont également fait remarquer que les logements servant à compenser le débordement sont plus chers, et certaines se sont demandées par quelle logique les frais d’hôtel pouvaient être approuvés alors que les demandes d’augmentation des allocations de logement étaient refusées.
Migration secondaire
Constatation 8 : La migration secondaire pose de sérieux problèmes aux répondants et aux fournisseurs de services.
Raisons de la migration secondaire
La migration secondaire se produit lorsque le client change de destination (ville ou province) après s’être rendu au lieu d’hébergement temporaire, et avant la fin de sa première année au Canada, pendant la période de soutien du revenu et de parrainage.
La migration secondaire est déconseillée aux réfugiés au cours de leur première année. Par exemple, les FS du PAR informent les réfugiés des difficultés potentielles liées à la migration secondaire, notamment le fait que les réfugiés sont responsables des coûts de leur réinstallation et que leur nouvelle destination peut ne pas disposer des mêmes services spécialisés ou des mêmes logements que leur destination initiale. Malgré les difficultés potentielles, la « Liberté de circulation et d’établissement » est un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés et les réfugiés ont le droit de décider où ils vivront au Canada.
L’analyse documentaire a montré que les réfugiés se déplacent pour diverses raisons, notamment les possibilités d’emploi et d’éducation, le regroupement familial et les liens socioculturels. Parmi les réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir déménagé au cours de leur première année, les raisons les plus fréquemment invoquées étaient l’emploi (49 %), suivi de l’accessibilité du logement (25 %) et de la proximité d’amis (24 %). L’emploi était également la raison la plus fréquente parmi les réfugiés qui ont déménagé pour plus d’une raison.
Prévalence et impacts de la migration secondaire
29 % des réfugiés interrogés ont déclaré avoir déménagé au cours de leur première année au Canada, la proportion étant légèrement plus élevée chez les RPG (32 %) que chez les réfugiés parrainés (26 %).
Les données de la BDIM ont suggéré que, la première année, plus d’un tiers des réfugiés admis au Manitoba partent pour d’autres provinces. L’Alberta (21 %) et l’Ontario (9 %) affichaient des taux relativement élevés de migration entrante au cours de la première année. Certaines personnes interrogées ont suggéré qu’un grand nombre de réfugiés s’installent à Toronto au cours de leur première année, à tel point qu’un financement supplémentaire est nécessaire pour les FS basés à Toronto.
Après leur déménagement, une légère majorité de réfugiés ont déclaré avoir reçu des services d’établissement ou de réinstallation d’un nouveau FS (68 %), et les réfugiés parrainés ont déclaré continuer à recevoir un soutien financier (61 %) et autre (67 %) de la part de leurs répondants. En général, les réfugiés ont estimé que la qualité (78 %) et la disponibilité des services (72 %) étaient aussi bonnes ou meilleures après leur déménagement.
Figure 14 : Migration sortante interprovinciale au cours de l’année suivant l’admission, 2009-2019 (BDIM)

Figure 14
La figure présente un graphique à barres horizontales montrant le taux de migration interprovinciale au cours de l’année suivant l’admission, d’après les fonds de données de la base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) provenant des déclarations de revenus de 2009 à 2019. La figure présente les points de données suivants : Manitoba : 34 %; Saskatchewan : 17 %; Provinces de l’Atlantique : 14 %; Colombie‑Britannique : 7 %; Alberta : 7 %; Ontario : 4 %.
Défis pour les répondants et les FS du PAR
L’examen des documents et les entrevues ont permis de constater que les FS du PAR et les répondants sont confrontés à des difficultés lorsque les réfugiés déménagent au cours de la première année. L’examen des documents et les personnes interrogées ont indiqué que les FS d’IRCC et du PAR subissent des charges administratives et financières en raison de la migration secondaire des RPG, car la vérification des allocations et des services précédemment reçus est nécessaire pour éviter les doubles emplois.
Les répondants ont exprimé des préoccupations similaires concernant les RPSP et les RDBV, et ont également fait remarquer qu’ils doivent faire face à des coûts supplémentaires si le réfugié qu’ils parrainent déménage dans une région où le coût de la vie est plus élevé, ce qui oblige les répondants à fournir des niveaux de soutien du revenu plus élevés que ce qui avait été prévu et approuvé dans la demande de parrainage. Les répondants peuvent être confrontés à une rupture de parrainage s’ils ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins du réfugié dans sa nouvelle destination, ou s’ils ne parviennent pas à trouver des répondants pour les réfugiés après leur déménagement.
Soutien du revenu
Constatation 9 : Le soutien du revenu accordé aux réfugiés réinstallés est insuffisant pour répondre à leurs besoins de base.
Le soutien du revenu et la première année au Canada
Les réfugiés reçoivent une aide financière mensuelle, soit au titre du soutien du revenu du PAR, soit de la part de répondants, pour répondre à leurs besoins fondamentaux pendant leur première année au Canada ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes, selon ce qui se produit en premier. Les taux d’aide au revenu sont guidés par les taux d’aide sociale provinciaux ou territoriaux et varient en fonction de la composition de la famille et du lieu de résidence. Le soutien du revenu est destiné à couvrir les besoins de base, notamment le logement, la nourriture, les frais accessoires, le transport et les coûts de communication. Des allocations exceptionnelles peuvent également être accordées pour les frais de maternité, les frais liés aux nouveau-nés et les frais liés aux besoins alimentaires.
Les documents du programme, les évaluations antérieures et la littérature universitaire ont souligné que l’aide au revenu du PAR reste insuffisante pour répondre aux besoins essentiels des réfugiés. Des documents internes ont suggéré qu’à partir de 2019, les taux de soutien du revenu du PAR pour les RPG se situaient entre 40 % et 60 % de la mesure du panier de consommation (mesure officielle de la pauvreté au Canada) et n’ont pas suivi la progression de l’inflation et du coût de la vie.Note de bas de page 16 Près de la moitié des personnes interrogées ont reconnu que le soutien du revenu était insuffisant pour répondre aux besoins de base.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que la gestion des attentes en matière de soutien du revenu est un défi croissant. Certaines ont fourni des exemples de réfugiés exprimant que les niveaux de soutien du revenu étaient inférieurs à leurs attentes ou qu’ils n’avaient pas les moyens de couvrir les besoins de base. De même, parmi les répondants interrogés qui ont déclaré avoir eu des différends avec des réfugiés parrainés, 31 % ont fait état de différends liés au soutien du revenu. En outre, une forte majorité des réfugiés qui ont occupé un emploi au cours de leur première année au Canada ont déclaré l’avoir fait parce que le soutien du revenu était insuffisant pour couvrir leurs besoins de base.
Les répondants interrogés ont également fait état de fausses attentes concernant le coût du soutien d’un réfugié, la moitié d’entre eux déclarant que les frais de démarrage (50 %) et le soutien du revenu (49 %) étaient plus élevés qu’ils ne l’avaient estimé au départ. Les personnes interrogées ont également fait remarquer que les réfugiés parrainés arrivent souvent des années après l’élaboration des plans d’établissement en raison des délais de traitement, ce qui induit un décalage entre les coûts prévus et les coûts réels du parrainage, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie.
Insécurité alimentaire
L’examen des documents, les entrevues, ainsi que les sondages menés auprès des répondants et des réfugiés ont mis en évidence un recours important aux banques alimentaires. En particulier, le sondage auprès des réfugiés a révélé qu’au cours de leur première année au Canada, près d’un tiers de ceux-ci ont « toujours » ou « souvent » eu recours aux banques alimentaires (31 %). Le recours aux banques alimentaires était particulièrement répandu chez les RPG, dont 80 % ont déclaré avoir eu besoin d’y recourir au moins une fois au cours de leur première année au Canada, comparativement à 65 % des RDBV et à 40 % des RPSP.
Figure 15 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir eu recours à une banque alimentaire au cours de leur première année
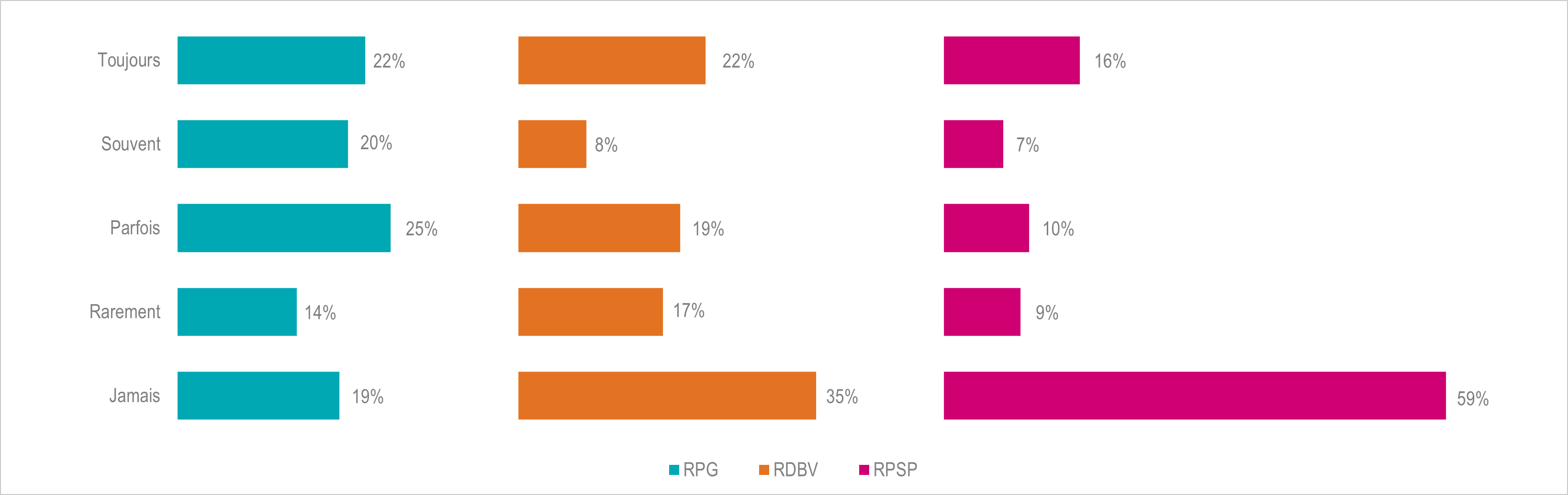
Figure 15
La figure présente un graphique à barres horizontales montrant la proportion de réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir eu recours à une banque alimentaire au cours de leur première année au Canada, par type de réfugié. En général, la figure montre une incidence plus élevée du recours aux banques alimentaires chez les RPG que chez les RDBV ou les RPSP. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : Jamais : 19 %; Rarement : 14 %; Parfois : 25 %; Souvent : 20 %; Toujours : 22 %. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : Jamais : 35 %; Rarement : 17 %; Parfois : 19 %; Souvent : 8 %; Toujours : 22 %. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : Jamais : 59 %; Rarement : 9 %; Parfois : 10 %; Souvent : 7 %; Toujours : 16 %.
En outre, certains réfugiés ont estimé qu’ils n’avaient « jamais », « rarement » ou « parfois » :
- eu suffisamment à manger (c’est-à-dire ne pas avoir dû sauter de repas) (15 %);
- eu accès à des aliments qui répondaient à leurs préférences culturelles (19 %);
- eu accès à des aliments qui correspondaient à leurs préférences alimentaires (18 %);
- eu accès à des aliments frais et nutritifs (15 %).
Vie autonome
Constatation 10 : Les attentes en matière de vie autonome et le temps nécessaire pour l’atteindre, ainsi que la manière dont le Programme de réinstallation des réfugiés contribue à ce résultat, ne sont pas clairs.
Manque de clarté de la notion de vie autonome
Le Programme de réinstallation des réfugiés a pour objectif final que les réfugiés « vivent de manière autonome dans la société canadienne » (annexe A). Toutefois, les documents internes ont suggéré que la notion de vie autonome n’est pas clairement définie et que les intervenants ont des points de vue différents sur le sens à lui donner pour l’atteindre.
Les documents de mesure du rendement fournissent deux indicateurs pour la vie autonome :
- Pourcentage de réfugiés bénéficiant d’une aide sociale;
- Nombre et pourcentage de réfugiés qui accèdent aux services d’établissement d’IRCC.
Toutefois, le programme ne définit pas le pourcentage de réfugiés censés utiliser l’aide sociale ou les services d’établissement, ni après combien d’années.
Malgré l’absence d’objectif précis, les données d’iEDEC ont montré que presque tous les réfugiés ont bénéficié d’au moins un service d’établissement, les RPG (96 %) en bénéficiant à un taux plus élevé que les réfugiés parrainés (86 %).
Les données de la BDIM ont montré que le recours à I’aide sociale est initialement élevé chez les RPG et les RDBV, mais qu’il diminue au fil du temps. En revanche, le taux de référence de l’aide sociale est d’environ 30 % pour les RPSP à partir de la première année.
En outre, il n’est pas certain que les RPG, les RDBV et les RPSP soient censés atteindre les mêmes taux d’utilisation de l’aide sociale et des services d’établissement. L’examen des documents et les personnes interrogées ont mis en doute le fait que l’on doive s’attendre à ce que tous les réfugiés atteignent l’objectif final d’une vie autonome.
Figure 16 : Recours à l’aide sociale selon le nombre d’années après l’admission (BDIM)
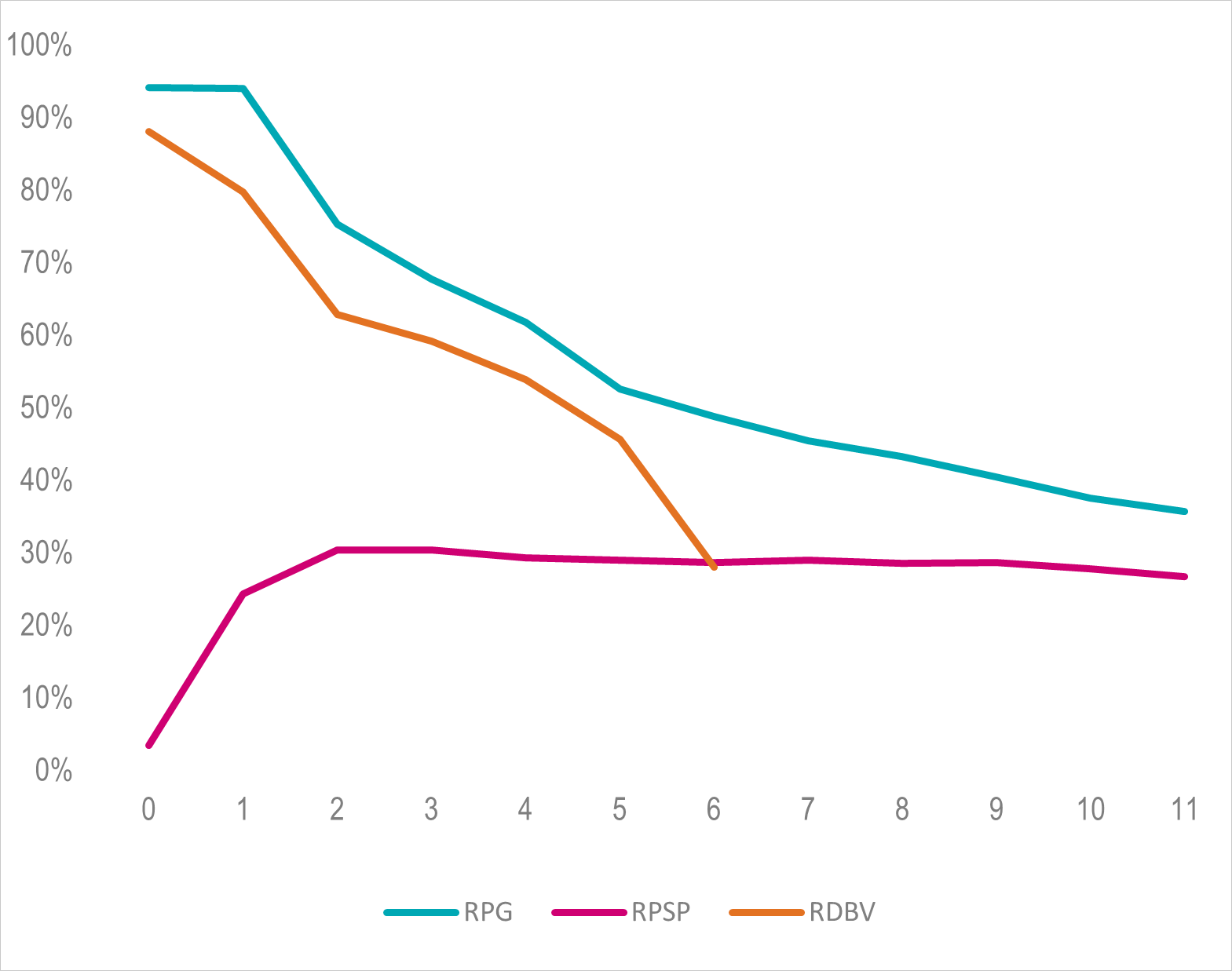
Figure 16
La figure présente un graphique linéaire illustrant l’incidence du recours à l’aide sociale par nombre d’années suivant l’admission, ventilé selon le type de réfugié. La figure montre les points de données suivants pour les RPG : 0 année depuis l’admission : 94 %; une année depuis l’admission : 94 %; deux années depuis l’admission : 75 %; trois années depuis l’admission : 68 %; quatre années depuis l’admission : 62 %; cinq années depuis l’admission : 53 %; six années depuis l’admission : 49 %; sept années depuis l’admission : 45 %; huit années depuis l’admission : 43 %; neuf années depuis l’admission : 40 %; dix années depuis l’admission : 38 %; onze années depuis l’admission : 36 %. La figure montre les points de données suivants pour les RPSP : 0 année depuis l’admission : 3 %; une année depuis l’admission : 24 %; deux années depuis l’admission : 30 %; trois années depuis l’admission : 30 %; quatre années depuis l’admission : 29 %; cinq années depuis l’admission : 29 %; six années depuis l’admission : 29 %; sept années depuis l’admission : 29 %; huit années depuis l’admission : 28 %; neuf années depuis l’admission : 29 %; dix années depuis l’admission : 28 %; onze années depuis l’admission : 27 %. Comme le Programme mixte des RDBV n’existait pas il y a onze ans, soit au moment de l’évaluation, seuls les six ans suivant l’admission ont été présentés, selon les points de données suivants : 0 année depuis l’admission : 88 %; une année depuis l’admission : 80 %; deux années depuis l’admission : 63 %; trois années depuis l’admission : 59 %; quatre années depuis l’admission : 54 %; cinq années depuis l’admission : 46 %; six années depuis l’admission : 28 %.
Résultats de la réinstallation et de l’établissement
Les personnes interrogées ont souligné que les programmes de réinstallation et d’établissement s’inscrivaient dans un continuum de soutien aux réfugiés et que le Programme d’établissement était essentiel pour atteindre les objectifs en matière de réinstallation. L’examen des documents a permis de constater que, bien que l’intégration des réfugiés relève du Programme d’établissement, le Programme de réinstallation des réfugiés est censé contribuer à ce résultat.
Toutefois, les personnes interrogées se sont demandées si le Programme de réinstallation des réfugiés disposait des mécanismes adéquats pour influencer les résultats à long terme. Les personnes interrogées ont exprimé des points de vue différents sur la durée de la période de réinstallation. Certaines personnes interrogées se sont demandées si la période de réinstallation était suffisamment longue pour aider les réfugiés à mener une vie autonome, en particulier pour les RPG qui dépendent des services d’établissement après la période de 4 à 6 semaines du PAR.
En outre, certaines personnes interrogées ont estimé que le fait de s’appuyer sur le Programme d’établissement créait une certaine confusion quant aux objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés, et se sont demandées si le programme était conçu pour une intégration à long terme ou pour une protection par le simple fait de faire venir les réfugiés au Canada. Certaines personnes interrogées se sont demandées si la transition des réfugiés vers le Programme d’établissement était suffisante pour atteindre le résultat final du Programme de réinstallation des réfugiés, certains soulignant que les réfugiés ont souvent besoin d’un soutien plus important que les clients types du Programme d’établissement, comme en témoigne la nécessité d’une gestion de cas. Certaines se sont demandées si le Programme d’établissement pouvait fournir un soutien adapté aux réfugiés ayant des besoins importants et si tous les réfugiés devaient atteindre les objectifs du programme.
Manque de clarté sur les résultats en matière d’emploi
Bien que le modèle logique et les indicateurs clés du rendement du programme ne fassent aucune référence à l’emploi, certaines personnes interrogées ont considéré l’emploi comme une mesure de la vie autonome. En outre, la plupart des réfugiés qui ont travaillé ont déclaré l’avoir fait pour devenir autonomes (87 %). Toutefois, les attentes du Programme de réinstallation des réfugiés en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne les personnes qui doivent trouver un emploi et les délais à respecter, ne sont pas claires.
L’examen des documents et les entrevues ont mis en évidence des préoccupations concernant le fait que le travail effectué peu après l’admission peut être en décalage avec l’objectif d’intégration. Parmi les réfugiés interrogés, 34 % ont déclaré que le fait de travailler les empêchait d’accéder aux services linguistiques, et plus d’un cinquième ont estimé que le fait de travailler les empêchait d’accéder aux services de familiarisation avec leur communauté. Les personnes interrogées ont également fait remarquer un décalage entre le fait de souhaiter que les réfugiés trouvent un emploi et celui de récupérer le soutien du revenu du PAR si les revenus dépassent 50 % du soutien du revenu mensuel d’un client.
Résultats en matière d’emploi des réfugiés
Parmi les réfugiés interrogés, 47 % ont travaillé au cours de leur première année au pays. Sur ceux qui ont travaillé, 56 % ont trouvé un emploi dans les trois mois. Ils étaient 34 % à déclarer avoir plus d’un emploi, et 36 % de ce groupe à cumuler plusieurs emplois simultanément. En général, les réfugiés étaient satisfaits de l’adéquation de leur emploi avec leur formation et leur expérience. Ils étaient 81 % à déclarer avoir gagné moins de 30 000 dollars au cours de la première année et 66 % à avoir travaillé à temps plein.
Les données de la BDIM ont montré que le revenu médian de l’emploi familial était faible la première année, et plus faible chez les RPG et les RDBV que chez les RPSP. En outre, un an après l’admission, les revenus d’emploi ont légèrement augmenté, mais sont restés inférieurs pour les RPG et les RDBV. Les données de la BDIM ont également suggéré que l’incidence des revenus d’emploi est moins fréquente chez les personnes âgées de 55 à 64 ans au moment de l’admission, et très rare chez les personnes âgées de 65 ans ou plus.
Résultats à plus long terme en matière d’emploi
Les données de la BDIM ont également révélé une série de tendances à plus long terme :
- L’incidence d’un revenu d’emploi est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, même si ce phénomène s’est atténué au fil du temps.
- L’incidence d’un revenu d’emploi dans la région atlantique était faible au départ, mais elle s’est stabilisée au fil du temps. L’incidence d’un revenu d’emploi en Ontario et en Colombie-Britannique était plus faible que dans les autres régions après la sixième année.
- L’incidence du revenu d’emploi était systématiquement la plus faible chez les réfugiés n’ayant aucune compétence dans les langues officielles. Le fait de connaître au moins un peu le français au moment de l’admission était associé à une plus grande incidence d’un revenu d’emploi au fil du temps, malgré un déficit initial.
Le revenu familial moyen était plus élevé chez les RPSP que chez les RPG et les RDBV, bien que l’écart se soit réduit au fil du temps.
Figure 17 : Revenu familial médian, années après l’admission (BDIM)
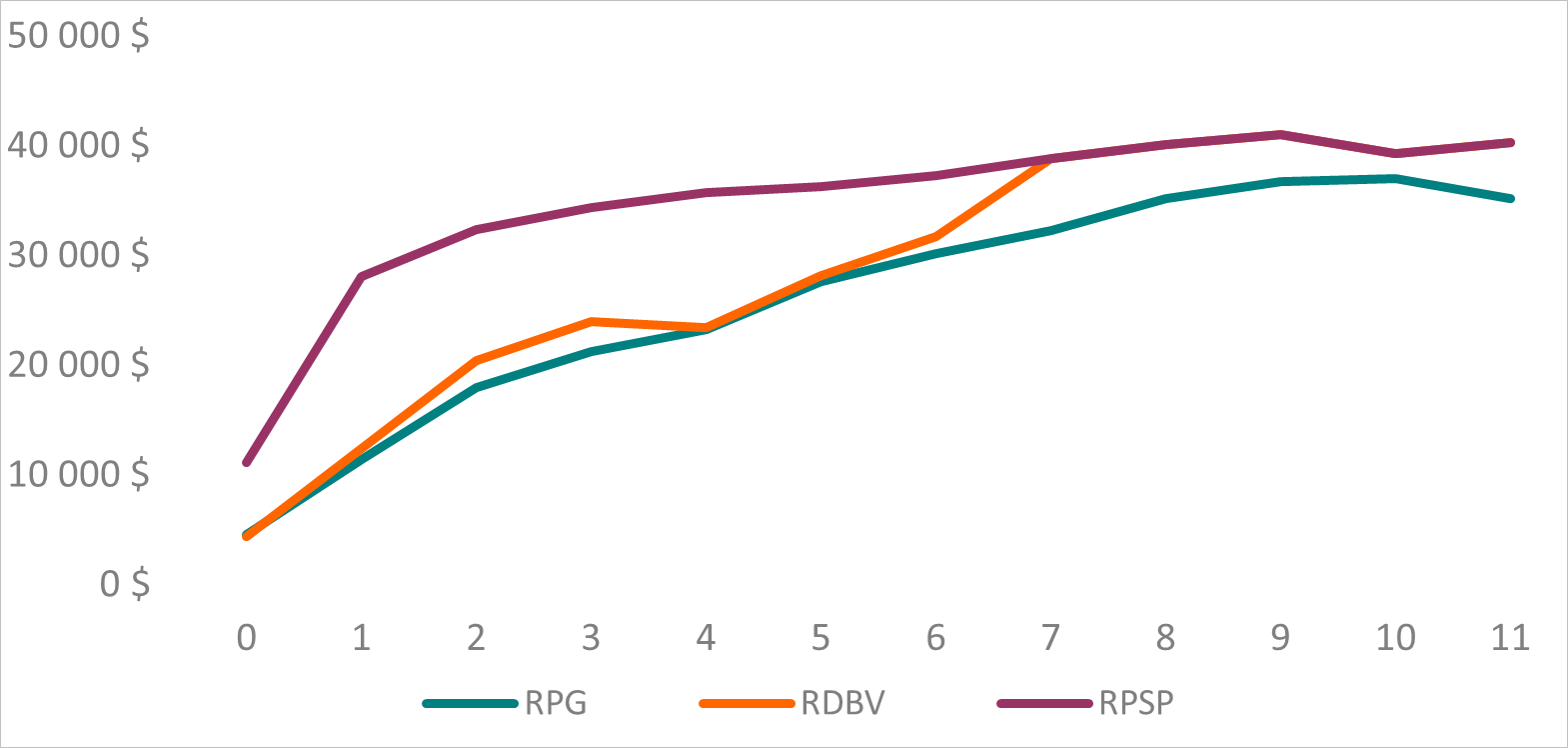
Figure 17
La figure présente un graphique linéaire illustrant le revenu familial médian, par nombre d’années suivant l’admission, ventilé par type de réfugié. La figure montre les points de données suivants pour les RPG : 0 année depuis l’admission : 4 600 $; une année depuis l’admission : 11 400 $; deux années depuis l’admission : 18 000 $; trois années depuis l’admission : 21 200 $; quatre années depuis l’admission : 23 200 $; cinq années depuis l’admission : 27 600 $; six années depuis l’admission : 30 200 $; sept années depuis l’admission : 32 300 $; huit années depuis l’admission : 35 200 $; neuf années depuis l’admission : 36 700 $; dix années depuis l’admission : 37 000 $; onze années depuis l’admission : 35 200 $. La figure montre les points de données suivants pour les RPSP : 0 année depuis l’admission : 11 100 $; une année depuis l’admission : 28 100 $; deux années depuis l’admission : 32 400 $; trois années depuis l’admission : 34 400 $; quatre années depuis l’admission : 35 700 $; cinq années depuis l’admission : 36 300 $; six années depuis l’admission : 37 300 $; sept années depuis l’admission : 38 800 $; huit années depuis l’admission : 40 100 $; neuf années depuis l’admission : 41 100 $; dix années depuis l’admission : 39 300 $; onze années depuis l’admission : 40 300 $. Comme le Programme mixte des RDBV n’existait pas il y a onze ans, soit au moment de l’évaluation, seuls les six ans suivant l’admission ont été présentés, selon les points de données suivants : 0 année depuis l’admission : 4 400 $; une année depuis l’admission : 12 400 $; deux années depuis l’admission : 20 400 $; trois années depuis l’admission : 24 000 $; quatre années depuis l’admission : 23 400 $; cinq années depuis l’admission : 28 200 $; six années depuis l’admission : 31 700 $.
Prêts
Le PPI accorde aux réfugiés des prêts d’un montant maximal de 15 000 dollars par famille pour couvrir les frais de leur voyage au Canada. Les réfugiés doivent commencer à le rembourser un an après leur arrivée, et le remboursement prend généralement entre trois et huit ans, selon des documents internes.
Les personnes interrogées ont estimé que ces prêts n’avaient pas un effet positif sur la capacité des réfugiés à vivre de manière autonome et certaines ont exprimé la crainte que les prêts n’entraînent des difficultés financières et ne créent une pression pour travailler trop tôt. Plusieurs ont estimé que les prêts devraient être renoncés.
Le sondage auprès des réfugiés a révélé que le remboursement des prêts :
- a rendu plus difficile pour des réfugiés de payer les produits de première nécessité (57 %) et les produits autres que les produits de première nécessité (60 %);
- a contraint les réfugiés à accepter des emplois plus tôt qu’ils ne se sentaient à l’aise de le faire (50 %) ou qui ne correspondaient pas à leurs études/compétences (42 %);
- a empêché les réfugiés de poursuivre leurs études (33 %) ou de bénéficier de services d’installation (34 %).
Connaissances et compétences pour vivre de manière autonome
L’évaluation a également permis de recueillir le point de vue des FS du PAR et des répondants sur la question de savoir si les réfugiés possédaient les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre de façon autonome au Canada après la première année.
La plupart des FS du PAR interrogés ont estimé que les RPG de leur communauté ont acquis les connaissances, les compétences et les relations nécessaires pour vivre de façon autonome à la fin de leur première année au Canada.
De même, la quasi-totalité (87 %) des répondants interrogés ont estimé que les réfugiés parrainés avaient acquis les compétences nécessaires pour mener une vie autonome à la fin de la période de parrainage. Toutefois, les répondants interrogés ont relevé certaines lacunes chez les réfugiés parrainés à la fin de la première année :
- connaissance des langues officielles (52 %);
- connaissances et compétences en matière de recherche d’emploi (46 %); et
- connaissance des lois, des droits et des responsabilités au Canada (44 %).
Liens sociaux
La majorité des réfugiés interrogés ont déclaré avoir noué des liens sociaux au cours de leur première année au Canada, mais les RPG dans une moindre mesure que les RDBV ou les RPSP. Par ailleurs, une plus grande proportion de RPG se sentait isolée de sa communauté (47 %) par rapport aux réfugiés parrainés (32 %).
Figure 18 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir noué des liens sociaux au cours de leur première année
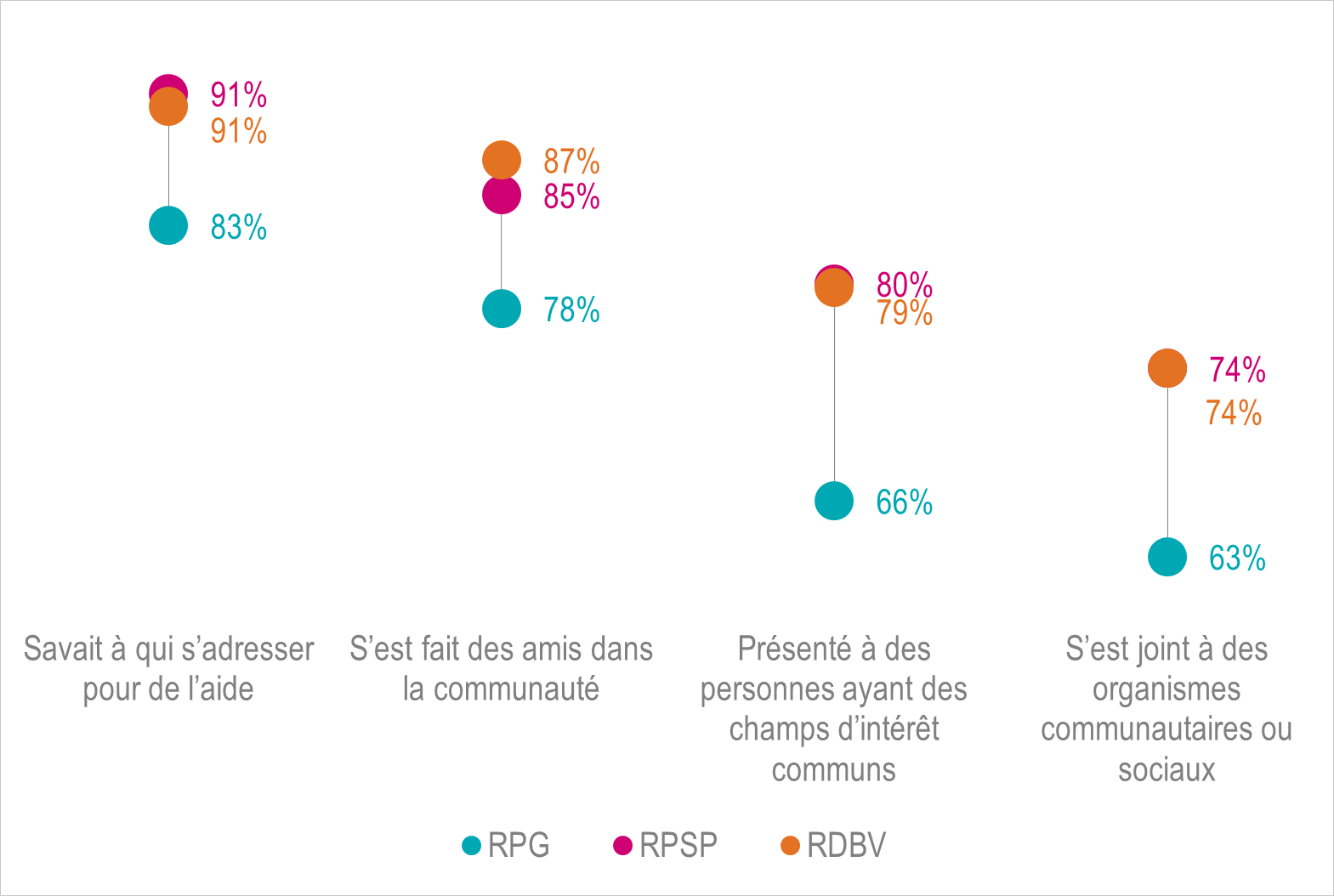
Figure 18
La figure présente un graphique en suçons illustrant la proportion de réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir établi des liens sociaux au cours de leur première année, selon le type de lien social et le type de réfugié. En général, la figure montre un écart entre la proportion de RPG ayant déclaré avoir établi des liens sociaux, par rapport aux RPSP et aux RDBV. La figure montre les points de données suivants pour les RPG : Savait à qui s’adresser pour de l’aide: 83 %; S’est fait des amis dans la communauté: 78 %; Présenté à des personnes ayant des champs d’intérêt communs: 66 %; Se sont joints à des organismes sociaux ou communautaires : 63 %. La figure montre les points de données suivants pour les RPSP : Savait à qui s’adresser pour de l’aide: 91 %; S’est fait des amis dans la communauté: 85 %; Présenté à des personnes ayant des champs d’intérêt communs: 80 %; Se sont joints à des organismes sociaux ou communautaires : 74 %. La figure montre les points de données suivants pour les RDBV : Savait à qui s’adresser pour de l’aide: 91 %; S’est fait des amis dans la communauté: 87 %; Présenté à des personnes ayant des champs d’intérêt communs: 79 %; Se sont joints à des organismes sociaux ou communautaires : 74 %.
Relation avec les parrains
Constatation 11 : Les répondants entretiennent de bonnes relations avec les réfugiés et leur apportent un niveau de soutien important. Même si les répondants comprennent généralement leur rôle et ont accès à la formation, la formation n’est pas promue en dehors de la communauté des SEP.
Relation avec les parrains
Presque tous les réfugiés parrainés ont déclaré avoir une relation saine avec leur répondant (96 %), être restés en contact pendant la première année (96 %) et être satisfaits de leur répondant dans l’ensemble (96 %). La plupart des répondants ont également déclaré maintenir des liens sociaux dans une mesure modérée ou importante (85 %). La plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient prêts à parrainer à de nouveau (82 %).
Différends dans la relation de parrainage
Un différend peut survenir en raison de désaccords ou de malentendus entre le répondant et le réfugié. Les différends peuvent être résolus entre le répondant et le réfugié ou nécessiter l’intervention de l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) d’IRCC. Si un différend n’est pas résolu ou si l’une des parties manque irrémédiablement à son obligation de respecter l’accord de parrainage, il peut y avoir rupture du parrainage.
Parmi les répondants interrogés, 9 % ont déclaré avoir été confrontés à un différend avec leur répondant à un moment ou à un autre, et 75 % d’entre eux ont indiqué que le différend avait été résolu. Selon les répondants, les raisons les plus courantes des différends sont des attentes peu claires de la part du réfugié (40 %) et des personnalités ou des intérêts différents (39 %). L’EASR a dû intervenir dans 28 % des différends.
Soutien au-delà de la période de parrainage
La majorité des répondants interrogés ont déclaré avoir gardé le contact avec le réfugié qu’ils avaient parrainé au-delà de la période de parrainage (86 %). De plus, certains répondants ont déclaré qu’ils apportaient « souvent » ou « toujours » un soutien financier (27 %) et non financier (30 %) après la fin de la période de parrainage.
Par ailleurs, certains répondants interrogés ont déclaré passer du temps avec le réfugié (55 %), répondre à ses questions (46 %) et lui fournir un logement (13 %) au-delà de la période de parrainage. Les principales raisons invoquées pour justifier la poursuite du soutien sont le fait que le répondant et le réfugié font partie de la même famille (54 %) ou qu’ils ont tissé des liens étroits ou des liens d’amitié (53 %).
Rôles, responsabilités et formation
Les répondants assument diverses responsabilités, notamment présenter la demande, accueillir le réfugié à l’aéroport, lui fournir une aide au démarrage et l’aider à accéder aux aides communautaires et d’établissement. Dans l’ensemble, la plupart des répondants interrogés ont estimé qu’ils comprenaient leurs responsabilités dans une mesure modérée ou importante (87 %).
Les principales ressources utilisées par les répondants étaient les sites Web d’IRCC (67 %) et du PFPR (32 %), ainsi que les renseignements fournis par un autre répondant (14 %). Une plus petite proportion de répondants du G5 (26 %) a déclaré avoir utilisé le site Web du PFPR par rapport aux autres types de répondants (43 %). Seuls 3 % des répondants interrogés ont déclaré n’avoir utilisé aucune ressource et les répondants ont généralement estimé que les ressources disponibles étaient utiles.
Formation au parrainage
Malgré les formations disponibles, 67 % des répondants interrogés n’avaient pas participé à une formation avant de parrainer, dont 77 % des G5.
La formation est obligatoire pour les SEP, mais pas pour les répondants RC et G5. Les personnes interrogées ont souligné que les répondants des catégories RC et G5 doivent chercher à se former sur une base volontaire et sont moins susceptibles de connaître le PFPR ou d’avoir des liens avec lui. Par exemple, le PFPR n’était pas en mesure de communiquer de manière proactive avec les répondants G5 et les RC, car leurs coordonnées n’ont pas été communiquées. Seuls 30 % des répondants interrogés ont déclaré avoir reçu un soutien du PFPR; toutefois, ceux qui en ont bénéficié en sont généralement satisfaits (88 %).
Bien que la formation du PFPR soit disponible pour les répondants G5 et les RC, elle est promue principalement comme une ressource pour les SEP et ne figure pas en bonne place dans les documents d’information des répondants G5 et des RC. Parmi les répondants interrogés qui n’ont pas participé à la formation, 58 % ont indiqué qu’ils ne savaient pas que la formation était disponible. La majorité d’entre eux (89 %) ont déclaré que la formation qu’ils ont reçue leur a été utile dans une mesure modérée ou importante.
Intégrité du programme
Constatation 12 : L’approche normalisée du suivi des cas n’est pas bien adaptée à la nature familiale et communautaire du parrainage privé, et la prise inopportune de décision sur les problèmes liés à l’intégrité du parrainage s’est révélé un défi.
Mesures d’intégrité du programme
L’examen des documents et les entrevues ont montré qu’avant 2018, IRCC gérait les risques liés aux problèmes d’intégrité en réagissant aux préoccupations signalées, mais n’affectait pas assez de ressources pour assurer un suivi systématique. En réponse à la croissance et aux préoccupations croissantes en matière d’intégrité du volet RPSP, IRCC a institué un bon nombre de mesures pour assurer l’intégrité du programme, notamment le suivi systématique des cas et la création de deux équipes d’assurance (à savoir l’EASR et l’unité de soutien opérationnel).
Les cas de parrainage font l’objet d’une évaluation avant l’arrivée (par exemple, en fournissant un plan d’installation et une preuve de soutien financier) et d’un suivi après l’arrivée. Si un cas de parrainage est sélectionné pour faire l’objet d’un suivi après l’arrivée, le répondant peut être tenu de démontrer qu’il apporte un soutien adéquat au réfugié et qu’il satisfait aux exigences du programme.
Le suivi des cas a révélé des failles dans l’intégrité du programme, notamment des documents frauduleux, des aides inadéquates et de l’exploitation financière. En raison de ces problèmes d’intégrité, l’intégrité du Programme de réinstallation des réfugiés a continué d’être renforcée au moyen d’une série de mesures et de modifications réglementaires, y compris la mise à jour des lignes directrices et des documents relatifs à la recevabilité des répondants et aux exigences du parrainage.
Cadre pour l’intégrité des programmes (CIP)
En 2023, le CIP a été mis en œuvre pour clarifier et normaliser les activités d’intégrité des programmes pour les SEP dans le cadre des volets RPSP et RDBV. Le CIP établit :
- les conditions à remplir pour devenir SEP;
- l’évaluation organisationnelle que les SEP doivent réaliser;
- les activités d’assurance du programme, y compris les obligations de suivi et de déclaration auxquelles le SEP est astreint;
- les mesures à prendre pour corriger les lacunes en matière de parrainage ou y remédier.
Certaines personnes interrogées ont estimé que le CIP, et en particulier l’évaluation organisationnelle et l’audit financier, créait une charge administrative et financière excessive pour les SEP.
Nature du parrainage par le secteur privé
Même si l’examen des documents et les personnes interrogées s’accordaient sur la nécessité de mener des activités de suivi, on a noté que l’approche normalisée du suivi des cas pose des défis pour des SEP, qui sont souvent basés dans la communauté, gérés par des bénévoles et dotés d’une structure très diversifiée.
Les personnes interrogées ont attiré l’attention sur la prévalence des cas de RPSP liés à la famille, soulignant les difficultés que rencontrent ces répondants pour se conformer aux exigences du programme et démontrer leur soutien (par exemple, en fournissant des reçus pour les repas familiaux ou les articles ménagers). Bien qu’IRCC ne recueille pas de données sur le parrainage avec liens familiaux, 58 % des RPSP et 47 % des répondants interrogés ont fait état de liens familiaux.
L’examen des documents et les entrevues ont indiqué que la plupart des manquements à l’obligation d’intégrité des répondants sont dus au fait que ceux-ci ne comprennent pas leurs responsabilités, qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences du programme malgré le soutien apporté, qu’ils sont débordés, et qu’ils prennent de mauvaises habitudes au fil du temps. Certaines personnes interrogées ont indiqué qu’il était plus difficile de mener à bien les activités de suivi dans les cas d’arrivées massives.
Prise inopportune de décision sur les violations des obligations de parrainage
L’examen des documents et les entrevues ont noté des défis avec la réponse apportée aux violations des ententes de parrainage. Au moment de l’évaluation, les SEP faisant l’objet de signalements de manquements pouvaient voir leur entente mise à l’épreuve, suspendue ou annulée, selon la décision du ministre ou de son délégué.
Les personnes interrogées ont estimé que ces décisions n’étaient pas opportunes, ce qui avait pour effet de maintenir la possibilité, pour les répondants dont l’intégrité était mise en cause, de présenter des dossiers et d’accueillir des réfugiés. Le CIP a été mis en place en 2023 afin de clarifier le processus de prise de décision et les échéances attendues.
Conclusions et recommandations
Conclusions
Ce rapport présente les conclusions de l’évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés, réalisée par IRCC. Cette évaluation répond aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et de la Loi sur la gestion des finances publiques, et évalue la pertinence, le rendement et la gouvernance du programme entre janvier 2016 et décembre 2021.
L’évaluation a montré qu’il existe une justification claire et solide pour l’existence de ce programme, car il permet au Canada de respecter ses engagements en matière de protection des réfugiés; tous les volets du programme contribuent à la réalisation de ces objectifs. Même si le programme est utilisé pour répondre à des objectifs d’ordre humanitaire du GdC, cela pourrait se faire au détriment des objectifs habituels en matière de réinstallation. Le fait de donner la priorité à certains groupes contribue en outre à accorder un accès inéquitable à une protection opportune et donne lieu à des préoccupations concernant le recours aux politiques publiques.
La gouvernance du programme demeure un défi, malgré les évaluations, les vérifications et les examens antérieurs qui avaient mis en évidence des problèmes dans ce domaine. L’évaluation a montré que la structure de gouvernance est complexe, ce qui a eu des conséquences négatives sur la coordination et la communication internes, ainsi que sur les relations avec les intervenants externes.
Dans l’ensemble, le programme répond aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés. Toutefois, les RPG éprouvent plus de difficultés à voir leurs besoins satisfaits que les réfugiés parrainés, en particulier pendant les périodes d’arrivées massives. Les défis rencontrés pour trouver un logement permanent augmentent le temps que les réfugiés passent dans des hébergements temporaires, ce qui retarde ou réduit le soutien du revenu et a un impact négatif sur la prestation des services. Comme l’ont montré les évaluations et examens antérieurs, les taux de soutien du revenu restent insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux.
Le résultat ultime du programme, à savoir la vie autonome des réfugiés, ainsi que la façon dont le programme contribue à ce résultat ne sont pas clairs, et les intervenants avaient des points de vue différents sur le sens à lui donner pour l’atteindre. De plus, le programme s’appuie sur le Programme d’établissement pour atteindre cet objectif, ce qui crée une certaine confusion quant au rôle de chaque programme dans la réinstallation des réfugiés.
Recommandations
Recommandation 1 :
L’évaluation a montré que le résultat ultime du Programme de réinstallation des réfugiés, à savoir une vie autonome, n’est pas clairement défini ou convenu en ce qui concerne des mesures telles que l’aide sociale et l’utilisation des services d’établissement. De plus, les attentes du programme en matière d’emploi ne sont pas claires, notamment les règles qui servent à déterminer quels réfugiés devraient se trouver un emploi et les délais à respecter à cet égard.
De plus, il a été constaté que le Programme de réinstallation des réfugiés s’appuie sur le Programme d’établissement pour atteindre ce résultat ultime. Les personnes interrogées ont exprimé des doutes sur le fait que le Programme de réinstallation des réfugiés dispose des bons mécanismes pour influencer les résultats à long terme, et que le Programme d’établissement fournisse une aide suffisante aux réfugiés. De plus, le fait de s’appuyer sur le Programme d’établissement a créé une certaine confusion quant aux objectifs du Programme de réinstallation.
- IRCC devrait revoir les objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés pour clarifier et actualiser son cadre de mesure du rendement, afin de s’assurer que les résultats attendus, les indicateurs et les cibles sont clairs et adaptés au rôle du programme.
Recommandation 2 :
L’évaluation a montré que la gouvernance interne demeure un défi pour le Programme de réinstallation des réfugiés. La gouvernance du programme est complexe et fragmentée entre de multiples directions générales et secteurs, ce qui contribue à un manque de clarté sur les rôles et responsabilités internes et à des problèmes de communication et de coordination internes, en particulier au niveau opérationnel. En outre, les problèmes de gouvernance ont été ressentis comme ayant des répercussions négatives sur les relations d’IRCC avec les intervenants externes.
En tenant compte du fait qu’IRCC a fait l’objet d’une restructuration interne en 2023, et en s’appuyant sur le travail réalisé avec le Conseil sur la réinstallation :
- IRCC devrait clarifier et communiquer les rôles et responsabilités internes en matière de réinstallation, et améliorer la communication et la coordination sur le plan opérationnel et avec les intervenants externes.
Recommandation 3 :
L’évaluation a montré que les séjours prolongés dans des logements temporaires sont une préoccupation croissante et peuvent avoir des conséquences négatives sur l’aide et les services offerts aux réfugiés. Alors que les documents internes indiquent que les réfugiés sont censés passer d’une à trois semaines dans des logements temporaires, les preuves ont laissé penser que la plupart des RPG y passent au moins un mois.
L’évaluation a montré que les séjours prolongés peuvent limiter l’aide financière globale que les RPG reçoivent et peuvent entraîner des retards, des doublons ou une perte d’efficacité des services essentiels. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les séjours prolongés peuvent retarder l’indépendance des réfugiés ou rendre plus difficile l’adaptation des réfugiés à leur logement permanent.
- IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour traiter les conséquences des séjours prolongés dans des hébergements temporaires, qui garantirait une prestation opportune et cohérente des services du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) aux RPG.
Recommandation 4 :
Bien que les données d’IRCC ne fassent pas de distinction entre les arrivées massives et les arrivées régulières, les preuves ont donné à croire que les RPG arrivant lors des années d’arrivées massives sont moins susceptibles de recevoir des services durant leurs premières semaines au Canada, ou de déclarer que les services qu’ils ont reçus ont répondu à leurs besoins. Il a été constaté que les arrivées massives augmentent le temps passé dans des logements temporaires, ce qui a des répercussions sur la rapidité et la qualité des services immédiats offerts aux RPG. De plus, l’évaluation a fait état de préoccupations liées à l’équité de la prestation de services pendant les périodes d’arrivées massives, ainsi que d’incidences sur les effectifs et les capacités des FS du PAR. Par ailleurs, il a été noté que le personnel des FS peut être trop occupé pour fournir un soutien personnalisé aux réfugiés pendant ces périodes.
- IRCC devrait intégrer au Cadre de réponse aux crises une stratégie visant à garantir des services efficaces et équitables pendant les périodes d’arrivées massives.
Recommandation 5 :
L’évaluation a montré que les taux de soutien du revenu du PAR restent insuffisants pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés. Même si les taux de soutien du revenu se veulent en adéquation avec les taux d’aide sociale provinciaux ou territoriaux, ils sont inférieurs à la mesure officielle de la pauvreté au Canada et n’ont pas suivi l’évolution du coût de la vie ou de l’inflation, en particulier en ce qui concerne les coûts du logement. La grande majorité des réfugiés interrogés ont déclaré avoir dû travailler parce que le soutien du revenu était insuffisant pour couvrir leurs besoins de base. L’évaluation a également révélé un recours important aux banques alimentaires parmi les réfugiés, en particulier les RPG qui comptent uniquement sur le soutien du revenu du PAR.
En mars 2022, IRCC a mis en place l’Initiative de supplément au loyer (ISL) en tant que programme pilote limité dans le temps, afin de contribuer à combler le déficit d’accessibilité au logement et d’aider les réfugiés à obtenir un logement permanent. L’ISL offrait une allocation exceptionnelle aux réfugiés pour répondre à leurs besoins en matière de logement. En partant d’initiatives aussi novatrices que celle-ci :
- IRCC devrait examiner plus régulièrement les mécanismes de soutien du revenu pour s’assurer que les taux sont harmonisés avec l’aide sociale provinciale/territoriale et qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des RPG.
Recommandation 6 :
L’évaluation a révélé que si le parrainage privé des réfugiés fonctionnait bien dans l’ensemble, les répondants font face à certains défis. La migration secondaire des réfugiés parrainés présente des difficultés pour les répondants, qui sont confrontés à des charges administratives ou financières et à des ruptures potentielles de parrainage.
De plus, bien que le programme ait amélioré la surveillance, l’évaluation a révélé que les répondants qui parrainent des membres de leur famille peuvent éprouver des difficultés à satisfaire aux exigences du programme et à démontrer qu’ils bénéficient d’un soutien adéquat.
- En tenant compte des préoccupations des répondants concernant les exigences du Programme de parrainage privé de réfugiés, IRCC devrait :
- a) élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence de la migration secondaire sur les répondants;
- b) collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme afin d’aider à relever les défis rencontrés pour répondre aux exigences du programme et prendre des mesures appropriées à cette fin.
Annexe A : Modèle logique du Programme de réinstallation des réfugiés
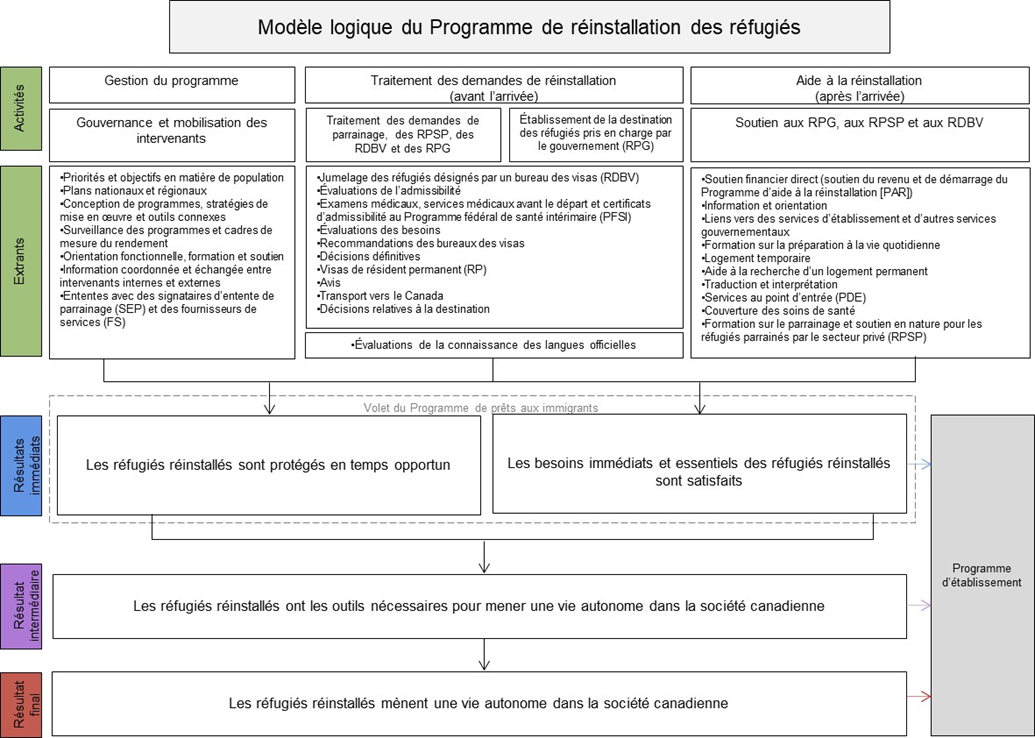
Annexe A : Modèle logique
L’annexe A présente un modèle logique illustrant les activités, les extrants et les résultats qui composent le Programme de réinstallation des réfugiés. Le modèle logique s’étend des activités du programme aux extrants créés par ces activités et aux résultats obtenus grâce à ces extrants. Les activités comprennent la gestion du programme, notamment la gouvernance et la mobilisation des intervenants; le traitement des demandes de réinstallation (avant l’arrivée), y compris le parrainage, le traitement des demandes des RPSP, des RDBV et des RPG, ainsi que l’établissement de la destination des RPG; et le soutien à la réinstallation (après l’arrivée), y compris le soutien aux RPG, aux RPSP et aux RDBV. En ce qui concerne les extrants de la gestion du programme, le modèle logique fait référence à ce qui suit : Les priorités et cibles en matière de population; les plans nationaux et régionaux; la conception des programmes, les stratégies de mise en œuvre et les outils connexes; la surveillance et les cadres de mesure du rendement des programmes; l’orientation fonctionnelle, le soutien et la formation; l’information coordonnée et échangée entre les intervenants internes et externes; les ententes conclues avec les signataires d’ententes de parrainage et avec les fournisseurs de services. En ce qui concerne les extrants dans le cadre du traitement des demandes de réinstallation (avant l’arrivée), le modèle logique fait référence à ce qui suit : Le jumelage des RDBV; les évaluations relatives à l’admissibilité; les examens médicaux, les services médicaux avant le départ et les certificats d’admissibilité au Programme fédéral de santé intérimaire; les évaluations des besoins; les recommandations des bureaux des visas; les décisions définitives; les visas de résident permanent; les avis; le moyen de transport utilisé pour venir au Canada; les décisions relatives à la destination; les évaluations des langues officielles. En ce qui concerne les extrants dans le cadre du soutien à la réinstallation (après l’arrivée), le modèle logique fait référence aux extrants suivants : Le soutien financier direct (soutien du revenu et de démarrage du PAR); l’information et l’orientation; les liens vers les services d’établissement et d’autres services gouvernementaux; la formation sur la préparation à la vie quotidienne; le logement temporaire; l’aide à la recherche d’un logement permanent; la traduction et l’interprétation; les services au point d’entrée; la couverture des soins de santé; la formation sur le parrainage et le soutien en nature pour les RPSP. Collectivement, tous ces extrants, en coordination avec le volet du Programme des prêts aux immigrants, entraînent les résultats immédiats suivants : Protection en temps opportun des réfugiés réinstallés; les besoins immédiats et essentiels des réfugiés réinstallés sont satisfaits. Ces résultats immédiats sont intégrés au résultat intermédiaire du programme : Les réfugiés réinstallés ont les outils nécessaires pour mener une vie autonome dans la société canadienne. Ce résultat intermédiaire est intégré au résultat ultime : Les réfugiés réinstallés mènent une vie autonome dans la société canadienne. De plus, à toutes les étapes du résultat (c.‑à‑d. immédiat, intermédiaire et ultime), le modèle logique montre que ces résultats sont également intégrés au Programme d’établissement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.