Document technique sur la conseils proposée pour les pathogènes d'origine hydrique
Table des matières
- Objectif de la consultation
- Sommaire
- Partie A
- Partie B. Renseignements techniques
- B.1 Bactéries entériques
- B.2 Agents pathogènes présents dans la nature
- Partie C. Bibliographie
- Annexe A : Liste d'abréviations
- Annexe B : Tableau B1 - Présentation sommaire des agents pathogènes entériques d'origine hydrique
- Annexe C : Tableau C1 - Présentation sommaire des agents pathogènes présents dans la nature
- Annexe D : Figure D1 - Valeurs relatives de CT pour divers agents pathogènes d'origine hydrique et pour le chlore libre (inactivation de 2 log, 5 à 25 °C, pH de 6 à 9)
- Annexe E : Figure E1 - Exigences en matière de dose relative d'UV pour divers agents pathogènes (inactivation de 4 log)
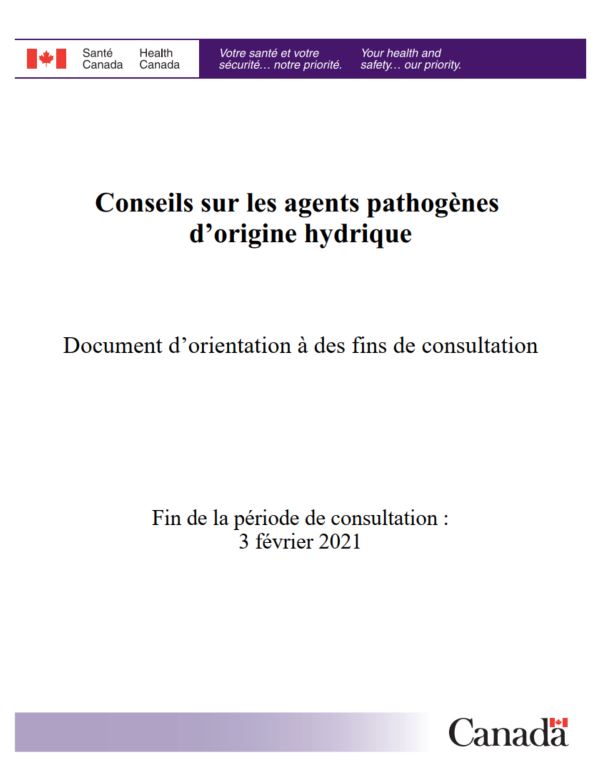
Télécharger le format de rechange
(Format PDF, 1.61 Mo, 91 pages)
Organization : Santé Canada
Date Publié : 3 février 2021
Objectif de la consultation
Le présent document a été élaboré dans but de fournir aux organismes de règlementation et aux décideurs des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique ne figurant pas dans d'autres documents techniques.
Ce document est mis à la disposition du public pour une période de consultation de 60 jours. Veuillez faire parvenir vos commentaires, accompagnés d'une justification, au besoin, à Santé Canada par courriel à :
Tous les commentaires doivent reçus avant le 3 février 2021. Les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation seront transmis aux membres du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (CEP), accompagnés du nom et de l'affiliation de leurs auteurs. Les personnes ne souhaitant pas que leur nom et leur affiliation soient communiqués aux membres du CEP doivent joindre à leurs commentaires une déclaration à cet égard.
Il convient de noter que le présent document d'orientation pourrait être révisé après évaluation des commentaires reçus et que des recommandations en matière de qualité de l'eau potable seront formulées, le cas échéant. Le présent document doit donc doit donc être considéré uniquement comme une ébauche à des fins de consultation.
Sommaire
De nombreux types de microorganismes pathogènes peuvent se propager par l'eau potable contaminée ou inadéquatement traitée et causer des maladies chez l'humain. Certains d'entre eux sont présents dans les matières fécales humaines ou animales et peuvent entrainer des maladies gastro-intestinales quand de l'eau contaminée par ces matières est consommée. D'autres microorganismes pathogènes sont naturellement présents dans les milieux aquatiques et peuvent causer des infections opportunistes surtout chez les personnes sensibles aux infections, quand les conditions dans les systèmes d’eau artificiels et industriels, permettent leur prolifération. Les effets sur la santé provoqués par ces agents pathogènes opportunistes sont variés et peuvent se manifester par des maladies respiratoires ou des infections des yeux, de la peau, du système nerveux central ou du tube digestif.
Il est nécessaire d'avoir des connaissances de base sur les différents types d'agents pathogènes d'origine hydrique - leurs origines, les mesures importantes à effectuer pour réduire leur nombre et les personnes les plus à risque de tomber malade -, pour pouvoir gérer efficacement la distribution de l'eau potable et prévenir les éclosions de maladies d'origine hydrique. Santé Canada a terminé de passer en revue les agents pathogènes d'origine hydrique pouvant présenter des risques pour la santé humaine. Le présent document d'orientation a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (CEP) et décrit ces organismes, leurs effets sur la santé, leur mode de transmission et les pratiques exemplaires à adopter pour garantir la salubrité de l'eau potable.
Évaluation
La détermination de concentrations maximales acceptables pour les agents pathogènes décrits dans ce document n'est pas pratique et nécessaire, car elle n'aide pas les responsables de systèmes d’approvisionnements en eau potable à gérer adéquatement les risques. La mise en œuvre d'une approche « de la source au robinet » est une stratégie universellement recommandée pour réduire la concentration d'agents pathogènes d'origine hydrique dans l'eau potable et limiter les risques possibles auxquels ils sont associés. Les principaux éléments de cette stratégie sont : la protection de la source d'eau, les exigences de traitement et de désinfection qui s'appuient sur les objectifs sanitaires de traitement pour les protozoaires (Giardia et Cryptosporidium) et virus entériques; et le contrôle de la survie et du développement des microorganismes dans les réseaux de distribution d'eau potable. Le maintien d'une lutte antimicrobienne dans les réseaux de distribution des édifices et des maisons est également un élément essentiel de l'approvisionnement des consommateurs d'eau potable salubre. Le présent document vise à fournir aux intervenants, notamment les organismes de règlementation provinciaux et territoriaux, les décideurs, les propriétaires et exploitants de systèmes d’approvisionnement en eau et les consultants, des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique qui ne sont pas mentionnés dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé publique associés aux systèmes d’approvisionnement en eau réseaux de distribution canadiens.
Considérations internationales
Les recommandations, les normes et les conseils en matière d'eau potable émanant d'autres organisations nationales et internationales peuvent varier en raison de la date des évaluations et des différences de politiques et d'approches.
Les organisations internationales n'ont pas établi de limites chiffrées quant à la présence de ces agents pathogènes d'origine hydrique dans l'eau potable. L'Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Union européenne (UE) et l'Australian National Health and Medical Research Council recommande tous d'adopter une stratégie de gestion des risques basée sur une approche à barrières multiples pour prévenir l'apparition et la transmission de ces agents pathogènes d'origine hydrique. L'OMS et l'Australie ont créé des feuillets d’information qui fournissent des renseignements sur les agents pathogènes d'origine hydrique susceptibles de contaminer le réseau d'approvisionnement en eau.
Partie A
A.1 Objectif et portée
Le présent document a pour objectif de fournir aux provinces, territoires, autres ministères et intervenants des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique potentiellement nuisibles à la santé humaine et ne figurant pas dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.
Un grand nombre de travaux de recherche majeurs ont permis de mieux comprendre l'enjeu de santé publique que représentent ces agents pathogènes d'origine hydrique présents dans les réseaux d'eau potable. Les stratégies de gestion de l'eau potable sont principalement axées sur les stations de traitement et les réseaux de distribution. Cependant, certains conseils visent les installations de plomberie des bâtiments et maisons. L’autorité responsable en matière d’eau potable devrait être consultée, notamment en matière de conseils et d'exigences concernant les installations de plomberie.
A.2 Introduction
Les microorganismes décrits dans le présent document sont énumérés dans le tableau 1. Ce document traite des bactéries pathogènes d'origine hydrique et entérique, lesquelles sont réputées responsables de maladies gastro-intestinales lorsque de l'eau potable inadéquatement traitée est contaminée par des matières fécales. En outre, le document décrit les agents pathogènes naturellement présents dans l'eau. Ces derniers étant souvent associés à des infections chez les personnes vulnérables (telles que les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées), ils sont qualifiés d'agents pathogènes opportunistes. Les systèmes d’eau artificiels et industriels constituent des milieux favorables au développement d'agents pathogènes naturellement présents dans l'eau. Nombre de ces réseaux présentent des caractéristiques qui posent problème aux responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable, comme une importante résistance à la désinfection, un développement de ces organismes malgré la faible disponibilité de nutriments et d'oxygène et la formation de biofilms. Pour gérer efficacement des réseaux de distribution d'eau potable, il est nécessaire de limiter la prolifération de ces organismes dans ces derniers et dans les installations de plomberie de bâtiments, lesquelles ne sont généralement pas sous la responsabilité des responsables de systèmes d’approvisionnements. Pour mieux comprendre les pratiques exemplaires de gestion, il faudrait mieux connaitre l'écologie de ces organismes dans les biofilms et l'efficacité des procédés de traitement.
Les stratégies globales de gestion sont résumées dans la partie A.3. Dans la partie B figurent des renseignements techniques succincts sur chaque agent pathogène (voir tableau 1) et leurs effets sur la santé humaine ainsi que sur les sources de ces organismes et l'exposition à ces derniers. Un résumé des traitements et analyses effectuées est également fourni.
Tableau 1 - Microorganismes décrits dans le présent document d'orientation.
Agents pathogènes entériques d'origine hydrique
- Campylobacter spp.
- Escherichia coli (E. coli) pathogènes entériques et Shigella spp.
- Helicobacter pylori
- Salmonella spp.
- Yersinia spp.
Agents pathogènes naturellement présents dans l'eau
Bactéries :
- Aeromonas spp.
- Legionella spp.
- Mycobacterium spp.
- Pseudomonas spp.
Protozoaires :
- Naegleria fowleri
- Acanthamoeba spp.
A.3 Stratégies de gestion des risques
La fixation de concentrations maximales acceptables pour ces microorganismes n'est pas pratique et nécessaire, car elle n'aide pas les fournisseurs d'eau potable à gérer adéquatement les risques. La stratégie recommandée de gestion des risques possibles pour les fournisseurs d'eau consiste plutôt à mettre l'accent en priorité sur la gestion des procédés de traitement de l'eau potable, par la mise en œuvre d'une approche « de la source au robinet » et d'un plan de salubrité de l'eau. Les éléments importants de cette stratégie sont :
- la protection de la source d'eau (dans la mesure du possible);
- l'optimisation des performances de traitement en ce qui concerne la réduction de la turbidité et des matières organiques naturelles;
- l'utilisation correcte des techniques de désinfection;
- des analyses de rendement et de vérification utilisant plusieurs paramètres d'exploitation et indicateurs de la qualité de l'eau;
- un réseau de distribution bien conçu et entretenu;
- le maintien d'une concentration efficace de désinfectant résiduel.
A.3.1 Installation de traitement de l'eau
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination et de désinfection couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable détruisent et inactivent très efficacement les agents pathogènes d'origine hydriques décrits dans le présent document. Les exigences actuelles en matière de traitement s'appuient sur les objectifs sanitaires de traitement pour les protozoaires (Giardia et Cryptosporidium) et virus entériques. En effet, ces microorganismes sont d'importants agents de maladies d'origine hydrique, présentent une infectivité élevée, sont difficiles à éliminer par traitement de l'eau et ont une forte résistance aux désinfectants. Les exigences en matière d'élimination physique et de désinfection pour les agents pathogènes d'origine hydrique décrites ici sont inférieures ou équivalentes à celles des protozoaires et virus entériques. Par conséquent, les réseaux d'eau de surface et d'eau souterraine sous influence directe d'eaux de surface qui sont conformes aux recommandations associées aux protozoaires et virus entériques (soit respectivement, une élimination ou inactivation minimale de 3 log et de 4 log) ont la capacité de limiter la prolifération de ces agents pathogènes. Les réseaux d'eau souterraine qui satisfont aux recommandations liées aux virus entériques (soit une élimination ou inactivation minimale de 4 log) ont la capacité de limiter la prolifération de ces agents pathogènes. Les documents techniques de Santé Canada intitulés Virus entériques et Protozoaires entériques : décrivent plus en détail les exigences en matière de traitement et désinfection de l'eau potable.
A.3.2 Réseau de distribution d'eau potable
Même si des technologies de traitement sont utilisées, des microorganismes peuvent pénétrer dans les réseaux de distribution d'eau potable en raison d'un traitement inadéquat ou d'une contamination par intrusion après traitement, dans les interconnexions ou durant des travaux de construction ou de réparation. Les biofilms et les dépôts non fixés présents dans les réseaux de distribution d'eau potable offrent des milieux favorables à la survie, au développement et à la dissémination de microorganismes pathogènes, notamment ceux qui sont opportunistes (p. ex. Legionella).
Des renseignements sur la gestion de la survie et du développement des microorganismes dans les systèmes de distribution d'eau potable figurent dans les publications de Santé Canada intitulées Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l'eau potable dans les réseaux de distribution et Document de conseils sur la matière organique naturelle dans l'eau potable. Les pratiques clés d'exploitation et de maintenance des réseaux de distribution sont :
- l'emploi de matériaux de construction appropriés;
- l'optimisation du traitement, pour réduire au minimum la quantité de nutriments disponible, l'entartrage et la corrosion dans les réseaux;
- le contrôle de la durée de séjour de l'eau et des effets de la température, lorsque cela est possible;
- le maintien d'une concentration efficace de désinfectant résiduel;
- la prévention des contaminations externes (p. ex. le maintien d'une pression minimale dans les réseaux, la prévention des contaminations croisées et des retours d'eau et l'adoption de pratiques hygiéniques durant la construction ou la réparation des conduites d'eau principales);
- le maintien de la propreté des réseaux de distribution (p. ex. par l'utilisation de techniques appropriées de rinçage et de nettoyage).
A.3.3 Plomberie des bâtiments
Le maintien d'une lutte antimicrobienne dans les réseaux de distribution des bâtiments, notamment dans les grands édifices, est un élément essentiel de l'approvisionnement des clients en eau potable sure. Les stratégies de lutte antimicrobienne des réseaux de distribution consistent principalement à :
- limiter la quantité de nutriments disponibles, en portant une attention particulière à la conception des réseaux et aux matériaux utilisés pour les construire;
- réduire au minimum le nombre de zones de faible débit ou de stagnation de l'eau;
- maintenir les températures des réseaux d'eau chaude et d'eau froide en dehors des intervalles optimaux pour le développement de microorganismes (p. ex. température de l'eau froide inférieure à 20 °C et température dans les réservoirs d'eau chaude supérieure à 60 °C);
- limiter la formation et la transmission d'aérosols contaminés provenant de dispositifs distaux.
Il est également important de souligner que dans les stratégies de gestion des réseaux de distribution complexes, beaucoup de mesures de lutte sont interreliées. Les changements de matériaux utilisés et des procédures d'exploitation peuvent s'accompagner de variations de la diversité microbiologique des réseaux de distribution d'eau potable. Il est nécessaire de comprendre les effets des changements apportés aux opérations de gestion de l'eau sur l'écologie de l'eau potable, afin de réduire au minimum les conséquences non souhaitées, telles que des conditions favorisant le développement (c.-à-d. l'enrichissement) de certains groupes de microorganismes.
Partie B. Renseignements techniques
B.1 Bactéries entériques
B.1.1 Campylobacter spp.
B.1.1.1 Description
Campylobacter (classe : Epsilonproteobacteria) est un genre de bactéries qui rassemble plus de 30 espèces identifiées, dont seules quelques-unes présentent un danger pour la santé humaine (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017; LPSN, 2019). Campylobacter jejuni (C. jejuni) et Escherichia coli (E. coli) sont les espèces primaires et secondaires qui ont le plus d'intérêt comme agents de maladies gastro-intestinales humaines, car elles sont responsables de 90 % des cas de campylobactériose humaine dans le monde (Huang et coll., 2015; Wagenaar et coll., 2015). D'autres espèces sont également identifiées comme agents de maladies gastro-intestinales, mais leur fréquence est faible ou associée à certains groupes à risque (p. ex. les personnes immunodéprimées) ou à des zones géographiques particulières (Wagenaar et coll., 2015). Certaines espèces de Campylobacter (spp.) ont été associées à des infections prénatales et néonatales et à des parodontites humaines (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015).
Campylobacter spp. sont des bactéries à Gram négatif motiles, en forme de bâtonnets incurvés ou spiralés (Percival et Williams, 2014b). Ce sont des bactéries exigeantes et microaérophiles (faibles besoins en oxygène), qui se développent à des températures comprises entre 30 et 45 °C (températures optimales de 40 à 42 °C) (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015; Zautner et Masanta, 2016).
B.1.1.2 Effets sur la santé
La gastroentérite causée par Campylobacter spp. se traduit par une diarrhée aqueuse et abondante, parfois mêlée de sang, et s'accompagnant parfois de fièvre et de douleurs abdominales (Backert et coll., 2017; Percival et Williams, 2014b). Certaines infections graves peuvent nécessiter une hospitalisation et être létales, bien que les cas de décès s'observent habituellement chez les patients très jeunes, très vieux, atteints d'une maladie sous-jacente ou immunodéprimés (Kvalsvig et coll., 2014). Les symptômes se déclarent généralement entre un et cinq jours après l'infection et la maladie dure moins de sept à dix jours (Backert et coll., 2017). L'élimination de la bactérie par les selles cesse au bout de quelques semaines, mais elle peut aussi durer trois mois ou plus. Des infections asymptomatiques par Campylobacter spp. sont également possibles (Percival et Williams, 2014b). Bien que les Campylobacter spp. puissent causer la maladie chez des personnes saines de tout âge, dans les pays développés, les infections touchent davantage les jeunes enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées (Kaakoush et coll., 2015; ASPC, 2018c). La dose infectante estimée de Campylobacter spp. varie considérablement. Cependant, des données indiquent que l'ingestion de quelques centaines de bactéries suffit à provoquer une infection (Kothary et Babu, 2001; Percival et Williams, 2014b; Backert et coll., 2017).
Des complications post-infectieuses causées par les Campylobacter spp. peuvent se produire, telles que le syndrome de Guillain-Barré et de l'arthrite réactionnelle, bien que celles-ci soient relativement rares (Backert et coll., 2017; Percival et Williams, 2014b). Une infection par des Campylobacter spp. peut être associée à l'apparition de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et le syndrome du côlon irritable (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015). Une méta-analyse a montré que les patients infectés par des Campylobacter spp. présentaient des complications à long terme dans les proportions suivantes : Syndrome de Guillain-Barré, 0,07 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,03 à 0,15 %); arthrite réactionnelle, 2,86 % (IC à 95 % : 1,40 à 5,61 %); et syndrome du colon irritable, 4,01 % (IC à 95 % : 1,41 à 10,88 %) (Keithlin et coll., 2014b).Les Campylobacter spp. sont la principale cause de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada et dans d'autres pays développés du monde (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015). Les cas de campylobactériose au Canada et dans le monde sont essentiellement sporadiques, la plupart des maladies étant provoquées par la consommation d'aliments contaminés (Huang et coll., 2015; Wagenaar et coll., 2015). Au Canada, les taux d'incidence annuels observés (toutes causes confondues) sur la période 2013-2017 variaient entre 25,4 et 29,2 (taux médian de 28,4) cas pour 100 000 habitants (ASPC, 2019). Les infections (toutes sources confondues) sont plus courantes durant les mois d'été (Fleury et coll., 2006; Lal et coll., 2012; Kaakoush et coll., 2015).
La maladie causée par les Campylobacter spp. est habituellement autolimitée. Des antibiotiques ne sont prescrits que dans les cas graves (Wagenaar et coll., 2015). Aucun vaccin contre Campylobacter n'est actuellement disponible (Wagenaar et coll., 2015). Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention ou CDC) ont attribué un niveau de menace élevé aux Campylobacter spp. résistantes à la ciprofloxacine et à l'azithromycine (CDC 2013a). L'OMS et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) considèrent comme moyennement à très prioritaires la surveillance, l'étude et l'évaluation des risques pour la santé publique de ces organismes (Garner et coll., 2015; OMS, 2017, ASPC, 2018a).
B.1.1.3 Sources et exposition
Les Campylobacter spp. sont des agents pathogènes zoonotiques (c.-à-d. transmis des animaux à l'humain), qui sont naturellement présents dans le tube digestif d'un grand nombre d'oiseaux et de mammifères sauvages et domestiques (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). La volaille est considérée comme le principal réservoir de ces organismes (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). Les bovins, les ovins et les animaux de compagnie en sont aussi d'importants réservoirs (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). Les Campylobacter spp. se transmettent par voie oro-fécale, les principales voies d'exposition étant la nourriture ou l'eau contaminée et le contact direct avec des animaux (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015). La transmission entre personnes est rare (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015). L'eau de ruissèlement contaminée par des déchets d'élevage et les eaux usées municipales (p. ex. le rejet d'eaux usées et des fuites sur le réseau séparatif) sont d'importantes sources de contamination fécale qui peuvent avoir des répercussions sur les sources d'eau potable (Whiley et coll., 2013). L'introduction de matières fécales animales dans l'eau à la suite de fortes pluies ou de la fonte des neiges est une cause particulièrement importante de contamination des puits d'eau souterraine vulnérables (Moreira et Bondelind, 2017).
Bien que les Campylobacter spp. soient rarement responsables de maladies d'origine alimentaire ou hydrique (Huang et coll., 2015; Moreira et Bondelind, 2017), il a été déterminé qu'elles étaient les agents pathogènes bactériens d'origine hydrique les plus souvent à l'origine d'éclosions liées à l'eau potable dans les pays industrialisés (Moreira et Bondelind, 2017). Des données publiées aux États-Unis (US) montrent que les Campylobacter spp. sont partiellement ou entièrement responsables de 11 % des éclosions liées à l'eau potable dénombrées entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes). Ces éclosions surviennent tous les mois de l'année, les plus graves durant les mois de printemps et d'été (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d). Les périodes à risque élevé d'éclosion d'origine hydrique coïncident avec les périodes de pics de lessivage agricole provoqué par les précipitations (p. ex. pluie ou la fonte des neiges) (Sterk et coll., 2013, Galanis et coll., 2014).
Citons les exemples suivants de grandes éclosions liés à la contamination de l'eau potable par des Campylobacter spp. survenues dans le monde : Nouvelle-Zélande (2016 : plus de 1000 cas), Danemark (2010 : 409 cas), Ohio, US (2004 : 1450 cas), Finlande (2001 : 1000 cas), Walkerton, Ontario (2000 : plus de 2300 cas) et France (2000 : 781 cas, deux décès) (Hrudey et Hrudey, 2004, Government Inquiry into Havelock North Drinking Water, 2017; Moreira et Bondelind, 2017). Les éclosions liées à l'eau potable ont été très souvent associées à de petites sources d'approvisionnement en eau potable (c.-à-d. des puits privés ou de petites sources locales), la contamination ayant été causée la plupart du temps par l'infiltration de matières fécales animales ou d'eaux usées dans la source ou par une désinfection inadéquate (Moreira et Bondelind, 2017). Les réseaux de distribution d'eau privés ou appartenant à de petites communautés sont considérés comme plus susceptibles de favoriser les maladies entériques humaines que les réseaux municipaux (Hrudey et Hrudey, 2004; Murphy et coll., 2016; Butler et coll., 2016). À l'aide d'une évaluation quantitative du risque microbien (EQRM), Murphy et ses collaborateurs (2016) ont estimé qu'environ 5 % du nombre total annuel de cas canadiens de contamination par des Campylobacter spp. pourraient être attribuables à la consommation d'eau provenant de petits réseaux de distribution d'eau potable contaminés. Dans les réseaux municipaux, une désinfection inadéquate et une contamination après traitement par intrusion ou dans les interconnexions sont les causes les plus fréquentes d'éclosions liées à des Campylobacter spp. (Moreira et Bondelind, 2017).
B.1.2 Escherichia coli et Shigella spp. (souches pathogènes)
B.1.2.1 Description
Les Escherichia coli (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) sont des bactéries à Gram négatif, qui font partie de la flore microbienne intestinale naturelle des humains et des animaux. Ces bactéries sont anaérobies facultatives, motiles ou non, et en forme de bâtonnets et peuvent se développer dans un grand intervalle de températures (entre 7 et 45 °C), la température optimale de croissance étant de 37 °C (Ishii et Sadowsky, 2008, Percival et Williams, 2014c). La plupart des souches (c.-à-d. des variantes) d'E. coli sont inoffensives, mais certaines d'entre elles deviennent virulentes par gain ou perte de matériel génétique (Croxen et coll., 2013). Ces E. coli pathogènes peuvent causer de nombreuses maladies humaines, dont de graves infections du tube digestif, des voies urinaires et du sang et des méningites néonatales (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c).
Les E. coli pathogènes sont très souvent classés en groupes fonctionnels, selon les mécanismes par lesquels elles interagissent avec leurs cellules cibles et provoquent des symptômes. Différents types d'E. Coli peuvent se fixer aux cellules, y pénétrer ou modifier leur structure et produire certains types de toxines. Il existe six grands groupes d'E. Coli pathogènes responsables d'infections gastro-intestinales : les E. coli entérohémorragiques (ECEH), les E. coli entérotoxinogènes (ECET), les E. coli entéroinvasives (ECEI), les E. coli entéropathogènes (ECEP), les E. coli entéroagrégatives (ECEA) et les E. coli à adhésion diffuse (ECAD) (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c). La catégorisation des souches pathogènes d'E. coli a déjà été réalisée par sérogroupage, à partir du système de classification classique de Kauffmann et White basé sur les antigènes de surface O et H (Croxen et coll., 2013; Robins-Browne et coll., 2016). Des méthodes moléculaires ont été mises au point, qui permettent une détection et une identification rapides des différentes souches pathogènes (Croxen et coll., 2013; Robins-Browne et coll., 2016). Les données issues du sérogroupage s'avèrent néanmoins utiles en épidémiologie et en surveillance des maladies (Robins-Browne et coll., 2016). D'autres groupes d'E. coli pathogènes ont été proposés, mais ils n'ont pas été complètement caractérisés. Des études génomiques comparatives ont montré que ces groupes n'étaient pas clairement distincts les uns des autres et qu'ils se chevauchaient énormément en ce qui a trait aux mécanismes de virulence mis en œuvre par les différentes souches d'E. coli (Croxen et coll., 2013). Les Shigella spp. sont très proches des E. coli, mais ont été autrefois considérées comme des espèces distinctes en raison de leurs caractéristiques biochimiques et des tableaux cliniques des maladies qu'elles causent. Des analyses poussées par typage et séquençage moléculaire ont mis en évidence que les Shigella spp. faisaient clairement partie des espèces d'E. coli et formaient un groupe unique avec les ECEI (Croxen et coll., 2013, Robins-Browne et coll., 2016). Une réévaluation de la classification des Shigella spp. pourrait être nécessaire pour tenir compte de son lien génétique avec le genre Escherichia. Le genre Shigella et la shigellose (soit la maladie causée par les Shigella spp.) sont encore nommés ainsi pour des raisons historiques (Croxen et coll., 2013). Par convention, il est admis qu'il existe quatre grandes espèces de Shigella spp. (S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii et S. sonnei), Shigella sonnei et Shigella flexneri étant les plus courantes dans les pays développés (Percival et Williams, 2014h).
Parmi les E. coli pathogènes, les ECEH (synonymes : Escherichia coli productrices de shigatoxines, et Escherichia coli vérotoxinogènes, ou ECVT) préoccupent beaucoup le secteur de l'approvisionnement en eau potable (Percival et Williams, 2014c; Saxena et coll., 2015). Les ECEH sont un sous-type
d'E. coli pouvant produire une ou plusieurs des puissantes shigatoxines et sont considérées comme très pathogènes pour l'humain. E. coli O157:H7 est le sérotype d'EHEC le plus fréquent. Cependant, d'autres sérotypes, soit O26, O45, O103, O111, O121 et O145 sont d'importantes causes de maladies humaines (Croxen et coll., 2013, Saxena et coll., 2015; ASPC, 2018c).
B.1.2.2 Effets sur la santé
Dans les pays développés, la plupart des maladies liées à E. coli surviennent sous la forme de cas ou d'éclosions sporadiques, causés par des aliments ou de l'eau contaminés ou associés à des voyages (Croxen et coll., 2013; Saxena et coll., 2015). Dans les pays en voie de développement, les E. coli pathogènes entériques représentent une cause importante de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants.
Les E. coli et Shigella spp. pathogènes entériques provoquent des maladies diarrhéiques moyennement graves et autolimitées à très graves et potentiellement mortelles, selon le groupe et la souche incriminés. Le premier symptôme est une diarrhée aqueuse. Elle peut être suivie d'une diarrhée mêlée de sang dans le cas d'infections à ECEH, et parfois lors d'infections à ECEI et Shigella spp. ou à ECEA (Croxen et coll., 2013, Percival et Williams 2014c; 2014h). D'autres symptômes peuvent consister en des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Les symptômes apparaissent habituellement un à trois jours après l'infection. Les diarrhées durent généralement une à deux semaines, mais peuvent persister pour certaines souches (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c, 2014h). Les personnes infectées peuvent être des porteurs asymptomatiques capables d'éliminer les organismes dans leurs matières fécales durant des semaines, voire des mois, après l'infection (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c, 2014h). Les doses causant une infection sont estimées à moins de 100 à 1000 organismes pour les ECEH et les ECEI et Shigella spp. et à plus d'un million à dix milliards pour les autres groupes (Kothary et Babu, 2001; Croxen et coll., 2013, Percival et Williams, 2014c; 2014h).
Les maladies causées par les ECEH sont particulièrement préoccupantes, car elles peuvent mener au grave syndrome hémolytique et urémique (SHU), potentiellement mortel, qui se traduit par une diminution des numérations globulaire et plaquettaire et une insuffisance rénale aigüe. Une méta-analyse a montré que le SHU était la complication à long terme la plus fréquente après des infections par E. coli O157 et que sa prévalence était comprise entre 4 et 17 % (Keithlin et coll., 2014a). Le SHU peut aussi entrainer des effets à long terme sur le pancréas, l'appareil digestif et le système nerveux central
(Spinale et coll., 2013). Les complications résultant d'infections non liées aux ECEH sont rares (Croxen et coll., 2013). Il a été suggéré qu'il existait un lien entre les infections par certains types d'E. coli pathogènes (soit des ECAD et certaines E. coli invasives) et des troubles digestifs chroniques, tels que le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn (Croxen et coll., 2013). Dans les pays développés, les E. coli entéropathogènes peuvent causer des infections gastro-intestinales chez les personnes saines de tous les âges. Les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risques de contracter une maladie et de présenter des complications à la suite d'une infection (Percival et Williams, 2014c, 2014h; Gargano et coll., 2017).
Les ECEH et les Shigella spp. figurent parmi les principales causes des maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada et en Europe (Scallan et coll., 2011; CDC, 2018; ECCDC, 2018a; ASPC, 2019). Les cas dénombrés et les éclosions de maladies diarrhéiques liées à E. coli et de shigellose en Amérique du Nord ont été en grande partie attribués à des contaminations par la nourriture ou par des voyageurs, bien que l'exposition à de l'eau contaminée demeure une importante cause d'infections (Croxen et coll., 2013; ASPC, 2018c). Les taux d'incidence annuels des infections à ECEH (ECVT) observées au Canada (toutes causes confondues) sur la période 2013-2017 étaient : pour les infections à ECEH, compris entre 1,78 et 2,24 (taux médian : 1,82) cas pour 100 000 personnes; et pour les infections à Shigella, compris entre 1,94 et 2,53 (taux médian : 2,28) cas pour 100 000 personnes (ASPC, 2019). Des variations saisonnières des infections à ECHC et à Shigella spp. (toutes sources confondues) ont été généralement observées dans le monde, un plus grand nombre de cas survenant en été et au début de l'automne (Fleury et coll., 2006; ASPC, 2010; Lal, 2012).
Dans la plupart des cas, les maladies diarrhéiques causées par E. coli sont autolimitées. Le traitement consiste habituellement en une réhydratation par voie orale, pour préserver l'équilibre des liquides et des électrolytes. Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves d'infections par certaines souches d'E. coli. Ils ne sont normalement pas recommandés pour les infections par des ECEH, car ils peuvent stimuler la production de shigatoxines, ce qui augmente le risque de SHU (Croxen et coll., 2013).
Les CDC, l'OMS et l'ASPC ont déterminé que les E. coli résistantes aux carbapénèmes et les E. coli productrices de β-lactamases à spectre élargi (BLSE) constituaient des menaces graves à très graves pour la santé publique (CDC 2013a; OMS, 2017, ASPC, 2018a). Les E. coli productrices de β-lactamases à spectre élargi sont habituellement résistantes à de nombreux médicaments antibactériens. Pour les personnes gravement infectées par ces souches, les carbapénèmes sont l'un des principaux traitements possibles. La résistance aux carbapénèmes implique une résistance à l'un des derniers traitements disponibles (CDC 2013a, OMS, 2017). Des souches d'E. coli pathogènes résistantes aux antibiotiques à large spectre et aux carbapénèmes ont été découvertes chez l'humain et les animaux (Mir et Kudva, 2018). De plus, les CDC ont déterminé que les Shigella spp. résistantes à la ciprofloxacine et à l'azithromycine représentaient des menaces graves et l'ASPC et l'OMS ont considéré comme faiblement à moyennement prioritaire leur étude et leur surveillance (CDC, 2013a, Garner et coll., 2015; OMS, 2017). Vu l'augmentation de la résistance des Shigella spp. aux médicaments de première ligne, le traitement des infections résistantes repose désormais sur les antibiotiques à large spectre et les carbapénèmes (CDC, 2013a; OMS, 2017). Un vaccin à base de toxine cholérique (dont la structure est similaire à la toxine thermolabile des ECET) a été homologué pour être utilisé comme traitement contre la diarrhée du voyageur associée aux ECET (Croxen et coll., 2013; O'Ryan et coll. 2015). Il est nécessaire d'obtenir davantage de données pour déterminer l'efficacité de ce vaccin et d'autres vaccins candidats contre les ECET (O'Ryan et coll. 2015). Aucun vaccin n'est actuellement disponible pour les autres groupes d'E. Coli (Croxen et coll., 2013).
B.1.2.3 Sources et exposition
Les humains constituent le principal réservoir des groupes ECEP, ECET et ECEA et le seul réservoir d'ECEI et de Shigella spp. (Croxen et coll., 2013). Les ECEH sont d'importants agents pathogènes zoonotiques. Les ruminants, en particulier les bovins, sont le premier réservoir des ECEH. Les humains constituent un réservoir secondaire de ce groupe (Croxen et coll., 2013, Percival et Williams, 2014c). Les animaux (p. ex. les bovins, les chiens, les ovins et les lapins) constituent aussi le réservoir de certaines souches d'ECEP (Croxen et coll., 2013). Les E. coli pathogènes se transmettent par voie oro-fécale et les principaux vecteurs d'infection sont la nourriture ou l'eau contaminée, la transmission entre personnes et le contact direct avec les animaux. D'importantes sources de contamination fécale de sources d'eau potable sont sensiblement les mêmes que celles décrites dans le cas des Campylobacter spp. (voir B.1.1) (Hrudey et Hrudey, 2004; Moreira et Bondelind, 2017).
Il a été déterminé que des températures élevées et des pluies torrentielles constituaient des facteurs favorisant les éclosions de maladies d'origine hydrique au Canada (Thomas et coll., 2006). De fortes pluies ayant entrainé des inondations ont ainsi contribué à l'éclosion d'infections par E. coli O157:H7 et des Campylobacter spp., à Walkerton (Ontario) en 2000 (O'Connor, 2002). Aux US, des E. Coli pathogènes (essentiellement E. coli O157:H7) ont été reconnues comme étant les agents responsables ou coresponsables de 4 % des éclosions liées à l'eau potable dénombrées entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes) (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d). La plupart des éclosions dues à la contamination de l'eau potable par E. coli ont été associées à de petites sources d'approvisionnement (c.-à-d. des puits privés ou de petites sources locales) (Craun et coll., 2010; CDC, 2011, 2013c, 2015, 2017d). Les résultats de l'EQRM semblent indiquer que la consommation d'eau non traitée ou inadéquatement traitée provenant de petites sources d'eau potable pourrait être responsable de 4 % des tous les cas de maladies causées par E. coli O157 au Canada (Murphy et coll., 2016). De graves éclosions liées à la contamination de l'eau potable par des E. coli pathogènes ont touché les endroits suivants : Corée (2015 : 188 cas, zéro décès), Missouri, US (2010 : 28 cas, zéro décès); Walkerton, Ontario (2000 : plus de 2300 cas, sept décès); et New York, US (1999 : 781 cas, deux décès) (Hrudey et Hrudey, 2004; Missouri Department of Health and Senior Services, 2011; Park et coll., 2018). Les Shigella spp. sont rarement associées à des éclosions liées à l'eau potable (Hrudey et Hrudey, 2004; Craun et coll., 2010). Trois éclosions dues à la contamination de l'eau potable par des Shigella spp. ont été dénombrées aux US entre 2001 et 2014, toutes associées à des sources d’approvisionnement en eau potable non conformes aux règlementations (eau d'étang ou de lac et eau embouteillée) (CDC, 2006, 2011, 2015).
B.1.3 Helicobacter pylori
B.1.3.1 Description
Helicobacter pylori (H. Pylori; classe : Epsilonproteobacteria) est une bactérie pathogène qui peut coloniser l'estomac humain et causer des maladies gastro-intestinales, comme la gastrite, les ulcères gastroduodénaux et le cancer de l'estomac (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Les Helicobacter sont étroitement apparentées au genre Campylobacter (Percival et Williams, 2014d). Plus de 20 espèces différentes d'Helicobacter ont été identifiées par séquençage génétique (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). H. pylori est l'espèce pathogène prédominante du genre Helicobacter, responsable de la vaste majorité des infections humaines. D'autres espèces d'Helicobacter ont parfois été associées à des maladies gastro-intestinales humaines (Percival et Williams, 2014d).
H. pylori sont des bactéries à Gram négatif, motiles, exigeantes et microaérophiles (faibles besoins en oxygène), qui se développent à des températures comprises entre 30 et 42 °C (températures optimales de 37 °C) (Mégraud et Lehours, 2007; Posteraro et coll., 2015). Elles ne sont pas acidophiles (qui aiment les milieux acides), mais mettent en œuvre des mécanismes qui leur permettent de tolérer les conditions acides de l'estomac humain. H. pylori présentent deux morphologies différentes : une forme en bâtonnet spiralé (décrivant un S) et une forme sphérique, viable mais non cultivable (VNC), adoptée lorsque la bactérie subit un stress environnemental. La forme VNC constitue un élément clé de la stratégie de survie de l'organisme. Toutefois, son rôle dans la pathogenèse demeure inconnu (Percival et Williams, 2014d).
B.1.3.2 Effets sur la santé
L'immense majorité des infections causées par H. pylori sont asymptomatiques (Percival et Williams, 2014d). Une infection par H. pylori peut provoquer une gastrite chronique et superficielle et certaines infections évoluent en ulcères duodénaux ou gastriques (Posteraro et coll., 2015). Les symptômes de la gastrite et des ulcères sont des nausées, des douleurs abdominales, des brulures d'estomac et des saignements (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Pour une petite proportion de la population infectée, les infections peuvent évoluer en cancer de l'estomac. H. pylori a été classifiée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme cancérogène pour l'humain (CIRC, 2014) et est considérée comme la cause la plus fréquente de cancer de l'estomac dans le monde (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). La dose infectante d'H. pylori reste inconnue. Des études contradictoires laissent croire qu'elle est inférieure à 10 000 cellules (Solnick et coll., 2001; Graham et coll., 2004). Cependant, des données tirées de déclarations de cas montrent que la dose infectante pourrait être plusieurs ordres de grandeur en dessous de cette valeur (Langenberg et coll., 1990; Matysiak-Budnik et coll., 1995).
Les effets variables sur la santé des infections par H. pylori semblent s'expliquer par la variabilité de la génétique humaine, des facteurs environnementaux et diététiques et des différences de virulence entre souches (Brown, 2000; Posteraro et coll., 2015). Vu que la majorité des personnes infectées ne contractent pas de maladie clinique, il peut s'avérer difficile de déterminer quand l'infection survient (Brown, 2000). Les personnes de statut socioéconomique peu élevé ou vivant dans des conditions hygiéniques et sanitaires médiocres et dans des zones densément peuplées sont plus largement infectées par H. pylori (Brown, 2000). Les taux d'infection sont plus élevés dans les pays en voie de développement et dans les populations à risque, la plupart des infections étant contractées durant l'enfance dans ces zones (Brown, 2000, Posteraro et coll., 2015). Les taux d'infection durant l'enfance dans les pays développés sont faibles et peuvent diminuer lorsque les pratiques sanitaires s'améliorent (Brown, 2000). H. pylori est considérée comme l'agent pathogène le plus fréquent chez l'humain (Posteraro et coll., 2015). Environ la moitié de la population mondiale est infectée par H. pylori (Percival et Williams, 2014d). Les taux d'infection asymptomatique par H. pylori varient beaucoup selon les zones géographiques. Cependant, il est estimé qu'ils diminuent pour se situer entre 20 et 50 % dans les régions développées et entre 50 à plus de 70 % dans les pays en voie de développement (Brown, 2000; Hooi et coll., 2017; Zamani et coll. 2018). Les taux d'infections par H. pylori au Canada ne sont pas bien connus, car ce ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire. Des études portant sur les infections par H. pylori chez des adultes de l'Ontario âgés de 50 à 80 ans et des enfants canadiens présentant des symptômes dans la partie supérieure de l'appareil digestif ont mis en évidence des taux d'infection respectifs de 23,1 % et 7,1 % dans ces deux groupes d'individus (Naja et coll., 2007; Segal et coll., 2008). Des taux plus élevés (> 40 %) ont été observés au sein des populations autochtones du Canada (Bernstein et coll., 1999; Sethi et coll., 2013; Fagan-Garcia et coll., 2019).
Une fois que les personnes ont été contaminées par H. pylori, les infections peuvent durer toute une vie à moins que des thérapies antimicrobiennes intensives ne soient entreprises (Percival et Williams, 2014d). Il a été montré que l'éradication d'H. Pylori permettait une guérison complète des ulcères duodénaux et de la plupart des ulcères gastriques (Percival et Williams, 2014d). L'ASPC et l'OMS ont considéré comme moyennement à hautement prioritaires l'étude des Helicobacter résistants à la clarithromycine et multirésistants et la mise au point de nouveaux traitements antibiotiques contre ces organismes (Garner et coll., 2015; OMS, 2017). Aucun vaccin efficace contre les infections par H. pylori n'a été encore été conçu (Posteraro et coll., 2015).
B.1.3.3 Sources et exposition
H. pylori est présente chez l'humain, le chat domestique et les primates non humains (c.-à-d. les Catarrhiniens) (Percival et Williams, 2014d). L'estomac humain est considéré comme un réservoir important de cet organisme (Percival et Williams, 2014d). Les chats domestiques sont suspectés d'être des vecteurs probables d'infection de l'humain (Percival et Williams, 2014d).
Le processus d'infection par H. pylori est mal connu. Une transmission entre personnes, par voie oro-fécale, oro-gastrique ou oro-orale, est censée être le mode de contamination le plus probable (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Les contacts directs entre chats domestiques sont également suspectés d'être des modes d'infection. Cependant, il n'existe aucune donnée probante sur la transmission des animaux aux humains (Brown, 2000). La consommation d'eau potable contaminée est présumée être une possible source d'infection. Des infections survenant par l'intermédiaire de multiples voies de transmission sont envisageables (Percival et Williams, 2014d). Des tentatives de culture d'H. Pylori à partir d'échantillons environnementaux ont échoué pour la plupart et l'absence de données sur la culture de cet organisme a limité les études épidémiologiques et les évaluations des risques (Percival et Williams, 2014d). La preuve d'une transmission par l'eau provient en grande partie d'études épidémiologiques menées dans des pays en voie de développement (Percival et Williams, 2014d). D'autres preuves de ce mode de transmission ont été apportées grâce à la culture H. pylori dans des matières fécales de personnes infectées, à la détection d'H. Pylori par des méthodes moléculaires dans des sources d'eau potable et à la découverte d'un lien entre la présence d'H. Pylori dans des sources d'eau souterraine non traitée et l'infection clinique de personnes ayant bu cette eau (Baker et Hagerty, 2001). Dans les pays disposant de moyens de traitement de l'eau potable adéquats, celle-ci risque peu de constituer un vecteur d'infection important (Percival et Williams, 2014d). Néanmoins, il est nécessaire d'approfondir les travaux de recherche menés sur le rôle de l'eau dans la propagation des infections par H. pylori. Les études sur la détection d'H. pylori dans les sources d'eau potable municipales sont peu nombreuses. Des inspections effectuées sur des installations publiques et des robinets domestiques ont permis de détecter H. pylori, par réaction en chaine de la polymérase (PCR), dans des échantillons d'eau et de biofilm sur 7 à 66 % des sites d'échantillonnage (Watson et coll., 2004; Santiago et coll., 2015; Richards et coll., 2018). H. pylori n'est pas considérée comme une cause d'éclosions liées à la contamination de l'eau (Percival et Williams, 2014d).
B.1.4 Salmonella spp.
B.1.4.1 Description
Salmonella (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) est un grand groupe de bactéries variées pouvant causer des infections gastro-intestinales chez les animaux et l'humain. Des méthodes moléculaires ont montré que le genre Salmonella comporte seulement deux espèces, Salmonella enterica et Salmonella bongori (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). Salmonella enterica se divise à son tour en six sous-espèces et regroupe la majorité des 2500 sérotypes et plus qui ont été identifiés (Grimont et Weill, 2007; Percival et Williams, 2014g). Lors des premières identifications des Salmonella, les sérotypes étaient traités comme des espèces et des noms leur étaient donnés, qui reflétaient l'organisme infecté ou la maladie auxquels ils étaient associés ou, plus tard, les localisations géographiques où ils étaient découverts (Grimont et Weill, 2007). Lorsque la taxonomie actuelle des Salmonella a été mise en place, ces noms étaient devenus tellement familiers qu'ils ont été conservés, remplaçant la nomenclature basée sur les antigènes de surface O et H plus couramment utilisée pour les autres espèces bactériennes (Grimont et Weill, 2007).
Les Salmonella présentant un risque pour l'humain sont généralement réparties en deux groupes principaux selon le type de maladie qu'elles causent. Les Salmonella typhoïdiques (sérotypes Typhi et Paratyphi) sont les agents responsables de la fièvre entérique, une maladie grave et potentiellement mortelle (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les Salmonella non typhoïdiques sont un grand groupe qui comporte tous les autres sérotypes pouvant entrainer des maladies gastro-intestinales de gravité variable (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Dans les pays industrialisés, les Salmonella non typhoïdiques sont les agents pathogènes d'origine alimentaire et hydrique les plus fréquents (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Percival et Williams, 2014g). Les sérotypes S. Enteritidis et S. Typhimurium sont ceux qui causent des infections humaines les plus couramment rencontrés (Sanchez-Vargas et coll., 2011).
Les Salmonella sont des bactéries à Gram négatif, anaérobies facultatives et la plupart du temps motiles et en forme de bâtonnets qui peuvent se développer à des températures comprises entre 5 et 47 °C, et optimalement entre 35 et 37 °C (Graziani et coll., 2017).
B.1.4.2 Effets sur la santé
Les infections par les Salmonella évoluent en différentes maladies, selon que leur sérotype est typhoïdique ou non (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les Salmonella non typhoïdiques causent une gastroentérite caractérisée par de la diarrhée, de la fièvre et des douleurs abdominales (Percival et Williams, 2014g, Graziani et coll., 2017). Les symptômes apparaissent 12 à 72 heures après l'infection et la maladie peut durer quatre à sept jours. Dans les cas graves, l'infection peut se répandre à d'autres parties du corps (p. ex. le sang, l'urine, les articulations et le cerveau) et s'avérer mortelle (Percival et Williams, 2014g; Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les enfants présentent le taux d'incidence le plus élevé d'infections à Salmonella (Christenson, 2013; ASPC, 2018c). Les infections graves et mortelles sont rares et sont plus fréquemment observées chez les très jeunes enfants, les personnes très âgées et les sujets immunodéprimés ou atteints d'une maladie sous-jacente (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Dekker et Frank, 2015). Une méta-analyse des cas d'infections à Salmonella non typhoïdiques suivies de complications à long terme a produit les estimations suivantes : 5,8 % ont été suivies d'une arthrite réactionnelle (IC à 95 % : 3,2 à 10,3 %) et 3,3 % (IC à 95 % : 1,6 à 6,6 %) d'un syndrome du côlon irritable (Keithlin et coll., 2015). Il a été impossible d'évaluer d'autres types de complications (p. ex. SHU et syndrome de Guillain-Barré) en raison du manque de données disponibles (Keithlin et coll., 2015). Les Salmonella typhoïdiques provoquent la fièvre entérique, une maladie invasive et générale qui se manifeste par de fortes fièvres, des vomissements, des maux de tête et de nombreuses complications potentiellement mortelles (Sanchez-Vargas et coll., 2011). La fièvre entérique s'observe surtout dans les pays à faible revenu. Dans les pays industrialisés, cette maladie est peu fréquente et essentiellement rencontrée chez les voyageurs (Sanchez-Vargas et coll., 2011). La dose infectante varie selon le sérotype incriminé et la sensibilité du sujet contaminé. Des données laissent croire que cette dose (dans le cas des Salmonella non typhoïdiques) peut varier entre moins de 100 organismes et un maximum de 100 000 à 10 milliards d'organismes (Kothary et Babu, 2001).
Les Salmonella sont la deuxième cause de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada, aux US et en Europe (Scallan et coll., 2011; CDC, 2018; ECCDC, 2019; ASPC, 2019). Au Canada, les taux d'incidence annuels observés (toutes sources confondues) sur la période 2013-2017 variaient entre 17,6 et 21,7 (taux médian de 21,38) cas pour 100 000 habitants (ASPC, 2019). Les cas de maladies sont essentiellement sporadiques, la plupart étant associés à la consommation d'aliments contaminés. Le pic d'incidence de la maladie (toutes sources confondues) survient en été et en automne (Fleury et coll., 2006; Lal et coll., 2012).
Les infections à Salmonella non typhoïdiques sont généralement autolimitées et le traitement consiste à remplacer les liquides et électrolytes perdus (Percival et Williams, 2014g). Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves, lorsque le risque de propagation de l'infection est élevé (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Percival et Williams, 2014g). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible contre les infections à Salmonella non typhoïdiques (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les CDC, l'OMS et l'ASPC ont catégorisé les Salmonella non typhoïdiques résistantes à la ciprofloxacine, à la ceftriaxone ou à plusieurs classes (soit plus de trois) de médicaments comme des menaces prioritaires à élevées (CDC 2013a; OMS, 2017, ASPC, 2018a). Dans les pays développés, l'évolution de la résistance aux antibiotiques a suivi celle de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux destinés à la consommation humaine et du taux accru de résistance aux anciennes générations d'antimicrobiens ont été observés (McDermott et coll., 2018). Une diminution des taux de résistance aux médicaments essentiels pour les animaux et les humains (bêta-lactamines et ciprofloxacine de troisième génération) a été observée aux US et au Canada et coïncide avec les politiques limitant leur usage en agriculture (McDermott et coll., 2018; ASPC, 2018a).
B.1.4.3 Sources et exposition
Les Salmonella non typhoïdiques sont des agents pathogènes zoonotiques. Les poules, les cochons, les dindes et les bovins sont considérés comme les réservoirs les plus importants de Salmonella (Graziani et coll., 2017). D'autres animaux (les chiens, les oiseaux, les rongeurs et les reptiles) et les humains (personnes infectées et porteurs asymptomatiques) sont aussi connus comme étant des sources de Salmonella (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). Les humains constituent le seul réservoir connu de sérotypes de Salmonella typhoïdiques (Percival et Williams, 2014g).
Ces organismes se transmettent par voie oro-fécale. Dans le cas des sérotypes non typhoïdiques, la nourriture contaminée est le vecteur d'infection le plus fréquent. Les contacts entre personnes et le contact direct avec des animaux sont d'importantes voies d'exposition (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). L'ingestion d'eau contaminée est aussi un mode d'infection connu (Graziani et coll., 2017). La section consacrée aux Campylobacter spp. (voir B.1.1) contient des renseignements sur les principales sources de contamination de l'eau potable. Les Salmonella non typhoïdiques sont très rarement associées à des éclosions liées à l'eau potable (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d; Hrudey et Hrudey, 2004).
B.1.5 Yersinia spp.
B.1.5.1 Description
Le genre Yersinia (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) regroupe environ 20 espèces bactériennes, dont seulement trois sont connues comme étant des agents pathogènes humains. Deux espèces (Yersinia enterocolitica et Yersinia paratuberculosis) sont considérées comme des entéropathogènes d'origine alimentaire ou hydrique, pouvant causer des gastroentérites aigües de gravité légère à élevée (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Yersinia pestis est la bactérie responsable de la peste, qui se transmet des animaux aux humains par les puces et dans les aérosols (Fredriksson-Ahomaa, 2015). Yersinia enterocolitica peut se diviser en six biotypes différentiables par des analyses physiochimiques et biochimiques et en plus de 30 sérotypes, selon la variation de leurs antigènes de surface O (Sabina et coll., 2011; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les infections humaines ont traditionnellement été attribuées à certaines combinaisons de biotypes et sérotypes. Les types 1b:O8, 2:O5,27, 2:O9, 3:O3 et 4:O3 sont le plus souvent associés à des maladies humaines observées dans le monde entier (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015, 2017). Y. paratuberculosis, plus étroitement apparentée à la bactérie responsable de la peste (Yersinia pestis) qu'Y. Enterocolitica, cause moins fréquemment des infections chez l'humain (Todd, 2014). Concernant Y. paratuberculosis, il existe plus de 20 sérotypes basés sur les variations des antigènes O, tous pathogènes (Percival et Williams, 2014i).
Les membres du genre Yersinia sont des cellules à Gram négatif, motiles, anaérobies facultatives et en forme de bâtonnets ou de coccobacilles, capables de se développer à des températures comprises entre 4 et 43 °C (températures optimales : entre 28 et 30 °C) (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).
B.1.5.2 Effets sur la santé
Les Yersinia entéropathogènes sont des organismes entéroinvasifs qui colonisent et envahissent les cellules épithéliales du colon, provoquant des diarrhées et des réactions inflammatoires (Percival et Williams, 2014i; Todd, 2014). Les symptômes des infections par Yersinia peuvent varier en fonction de l'âge et de l'immunité de la personne contaminée, de la souche incriminée et de la dose infectante (Todd, 2014). Les symptômes fréquents chez l'enfant sont des diarrhées (souvent mêlées de sang), de la fièvre et des douleurs abdominales (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les diarrhées sont moins souvent observées dans le cas d'infections par Y. paratuberculosis (Todd, 2014). Chez les enfants plus âgés et les adultes, les symptômes les plus fréquents sont la fièvre et les douleurs abdominales et rappellent ceux de l'appendicite (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les symptômes se déclarent un à 11 jours après la contamination et peuvent persister durant un à trois jours, voire plus longtemps (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Des infections asymptomatiques par Y. enterocolitica et Y. paratuberculosis ont été observées et ces agents pathogènes peuvent continuer à être éliminés par les matières fécales pendant des semaines après que les symptômes aient disparu (Todd, 2014). Parfois, dans les cas graves, les bactéries peuvent pénétrer dans les ganglions lymphatiques et l'infection peut se répandre davantage par la circulation sanguine (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les complications à la suite d'infections sont rares et peuvent consister en des douleurs articulaires (arthrite réactionnelle) et des éruptions cutanées (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). D'autres symptômes moins fréquents peuvent être associés à une infection par des Yersinia entéropathogènes, comme des réactions inflammatoires variées résultant d'une propagation de l'infection à d'autres parties du corps (p. ex. le foie, la rate, les poumons, le cœur, le cerveau et les os) (Percival et Williams, 2014i, Todd, 2014). Les jeunes enfants risquent davantage de tomber malades s'ils sont infectés par des Yersinia entéropathogènes (Todd, 2014; ASPC, 2018c). Les infections graves ou mortelles sont rares et habituellement observées chez les personnes âgées ou immunodéprimées (Todd, 2014). La dose infectante d'Y. enterocolitica et d'Y. paratuberculosis est estimée à 10 000 à un milliard d'organismes (Todd, 2014). Cependant, elle est susceptible de diminuer dans le cas de personnes immunodéprimées (Fredriksson-Ahomaa, 2017).
Les Yersinia sont une cause majeure de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada, aux US et en Europe (ASPC 2018c; CDC 2018; ASPC, 2018b). Aucune donnée sur l'incidence des infections par les Yersinia n'est disponible au Canada, car la yersiniose n'y est pas une maladie à déclaration obligatoire. La majorité des cas de maladies liées aux Yersinia sont causées par Y. enterocolitica et sont associées à la consommation d'aliments contaminés (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015; ASPC, 2018c). En général, les infections à Yersinia sont plus fréquemment observées durant les mois d'hiver (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).
Comme les infections par Y. enterocolitica ou Y. paratuberculosis sont normalement autolimitées, un traitement est administré uniquement dans les cas graves s'accompagnant d'une infection généralisée ou une bactériémie (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible.
B.1.5.3 Sources et exposition
Les Yersinia spp. pathogènes ou non peuvent être présents dans le tube digestif de nombreux animaux sauvages et domestiques (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les cochons constituent le plus gros réservoir de souches pathogènes d'Y. enterocolitica. Les ruminants (p. ex. les bovins, les moutons et les chèvres), les chiens et les chats sont aussi d'importantes sources de ce pathogène (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les rongeurs et les oiseaux sont considérés comme d'importants réservoirs d'Y. paratuberculosis (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les Yersinia spp. pathogènes sont zoonotiques et peuvent donc se transmettre des animaux à l'humain par voie oro-fécale (Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les sources de nourriture contaminées sont les vecteurs d'infection les plus courants (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). La consommation d'eau contaminée ou le contact direct avec des animaux sont également d'importantes voies d'infection (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). La transmission entre personnes est possible, mais rare (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).
Dans la plupart des études, ce sont les espèces ou souches non pathogènes qui sont les plus fréquemment isolées (Brennhovd et coll., 1992; Cheyne et coll., 2009; Schaffter et Parriaux, 2002). La faible fréquence d'isolement dans les échantillons environnementaux peut s'expliquer par la sensibilité limitée des méthodes d'isolement par culture (Fredriksson-Ahomaa et Korkeala, 2003). Cheyne et ses collègues (2010) ont pu détecter, à l'aide de méthodes PCR, des gènes de virulence d'Yersinia dans 21 à 38 % des échantillons prélevés dans un bassin hydrologique fortement contaminé, qui était utilisé comme source alimentant un système d'approvisionnement en eau potable.
Les Yersinia spp. ont rarement été associées à des éclosions liées à la contamination de l'eau potable. Selon des données publiées aux US entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes), les Yersinia enterocolitica, apparaissant de façon concomitante avec des Campylobacter jejuni, ont entrainé une seule éclosion liée à la contamination de l'eau potable (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c 2015, 2017d). Il a été déterminé que la cause de cette éclosion était une source d'eau souterraine non communautaire, contaminée et non traitée (CDC, 2004).
B.1.6 Méthodes d'analyse
Des méthodes standards permettent de détecter les Campylobacter spp., les E. coli et Shigella spp. pathogènes, les Salmonella spp. et les Yersinia spp. dans l'eau potable (APHA et coll., 2017; ISO, 2019). Les protocoles d'isolement et d'identification de ces bactéries procèdent habituellement en étapes, par exemple l'enrichissement ou la séparation, l'étalement sur plaque, le tri des colonies et l'identification à l'aide d'analyses biochimiques, de techniques sérologiques, de méthodes moléculaires ou de trousses d'analyse commerciales (p. ex. pour identifier les toxines) (APHA et coll., 2017).
Aucune méthode standard de détection d'Helicobacter spp. viables dans l'eau n'a encore été mise au point (Percival et Williams, 2014d, APHA et coll., 2017). Les méthodes de détection d'H. pylori dans les environnements aqueux consistent en l'utilisation de techniques moléculaires indépendantes de la culture, telles que la PCR ou l'hybridation in situ en fluorescence. Vous pouvez consulter lLes publications scientifiques peuvent être consultées pour obtenir davantage de renseignements sur certaines méthodes (Watson et coll., 2004; Percival et Williams, 2014d; Santiago et coll., 2015; Richards et coll., 2018).
B.1.7 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - et les méthodes de désinfection - basées sur l'utilisation de chlore, de chloramines ou de monochloramine, de dioxyde de chlore, d'ozone ou de lumière ultraviolette (UV) - couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable s'avèrent très efficaces pour réduire ou inactiver les bactéries entériques décrites dans les sections précédentes (LeChevallier et Au., 2004). Les exigences en matière de CT (concentration x temps) pour l'inactivation de ces bactéries à l'aide de désinfectants chimiques sont comparables à celles applicables à E. coli et inférieures à celles fixées pour les protozoaires et virus entériques (Sobsey, 1989; Lund, 1996; Johnson et coll., 1997; Rice et coll., 1999; Baker et coll., 2002; LeChevallier et Au, 2004; Rose et coll., 2007; Wojcicka et coll., 2007; Chauret et coll., 2008; Rasheed et coll., 2016; Jamil et coll., 2017; Santé Canada, 2019c, 2019d, 2019e). Les exigences en matière de dose pour l'inactivation par UV de ces organismes sont similaires à celles applicables à E. coli et aux protozoaires entériques et inférieures à celles requises pour de nombreux virus entériques (Sommer et coll., 2000; Zimmer et Slawson, 2002; Smeets et coll., 2006; Hayes et coll., 2006; Zimmer-Thomas et coll., 2007; Hijnen et coll., 2011; Santé Canada, 2019c, 2019e).
Les pratiques d'exploitation et de maintenance visant à réduire le développement et la survie des bactéries généralement appliquées aux réseaux de distribution d'eau potable et aux installations de plomberie sont décrites dans la partie A (LeChevallier et Au, 2004; Friedman et coll., 2017). Ces pratiques permettent de lutter contre les biofilms, lesquels offrent un milieu favorable à la survie des agents pathogènes fécaux, qui peuvent avoir franchi les différentes barrières de traitement de l'eau potable ou s'être directement infiltrés dans le réseau de distribution en raison de défaillances touchant l'intégrité des procédés (Leclerc, 2003).
Pour les systèmes résidentiels et les puits privés, il est important d'effectuer régulièrement des inspections physiques, pour repérer les défaillances éventuelles, et des analyses sur le systèmes d’approvisionnement en eau (p. ex. des mesures des concentrations d'E. Coli et des coliformes totaux), afin de valider la bonne qualité microbiologique de l'eau. Les autorités provinciales et territoriales fournissent habituellement des conseils généraux sur la construction, l'entretien et la protection des puits et l'analyse de l'eau qu'ils contiennent. Les propriétaires de puits peuvent aussi consulter la série de documents intitulée Parlons d'eau pour en savoir davantage (Santé Canada, 2019a). Lorsqu'un traitement s'impose, Santé Canada recommande aux consommateurs d'utiliser des appareils certifiés conformes, par un organisme de certification accrédité, aux normes appropriées de NSF International (NSF) et de l'American National Standards Institute (ANSI) en matière de procédés de traitement de l'eau potable (NSF/ANSI, 2018, 2019a, 2019b). Les organismes de certification garantissent qu'un produit est conforme aux normes applicables et doivent être accrédités par le Conseil canadien des normes (CCN). Une liste à jour des organismes de certification accrédités peut être obtenue auprès du CCN (2020).
B.1.8 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence des bactéries pathogènes entériques suivantes dans l'eau potable : Campylobacter spp., E. coli et Shigella pathogènes entériques, Helicobacter pylori, Salmonella spp. et Yersinia spp. Tout comme les documents d'orientation publiés par Santé Canada, les recommandations en matière d'eau potable de l'OMS et de l'Australie comportent des feuillets d’information qui fournissent des renseignements sur les agents pathogènes d'origine hydrique préoccupants.
B.2 Agents pathogènes présents dans la nature
B.2.1 Bactéries
B.2.1.1 Aeromonas spp.
B.2.1.1.1 Description
Le genre bactérien Aeromonas (classe : Gammaproteobacteria) présente une structure taxonomique complexe. Environ 30 espèces ont été associées à ce genre et de nouvelles espèces potentielles continuent d'être décrites, bien qu'elles n'aient pas toutes été universellement acceptées (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a; LPSN, 2019). Les difficultés que pose l'identification des Aeromonas viennent du manque de caractéristiques phénotypiques clairement distinctes et de l'absence d'un profil de typage cohérent permettant de distinguer différentes espèces. Par conséquent, il est nécessaire de recourir à des méthodes biochimiques et moléculaires pour effectuer une classification précise. Les Aeromonas spp. ayant une pertinence d'un point de vue clinique sont des agents pathogènes opportunistes qui ont été associés à des maladies et syndromes intestinaux et extra-intestinaux variés (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). Quatorze espèces ont causé des maladies chez l'humain, mais la majorité des infections humaines (85 %) sont provoquées par les souches de quatre espèces : A. hydrophila, A. caviae, A. veronii (biotype A. sobria) et A. trota (Percival et Williams, 2014a; Liu, 2015; Bhowmick et Battacharjee, 2018).
Les aéromonades sont des bactéries à Gram négatif, anaérobies facultatives en forme de bâtonnets et ne formant pas de spores (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a). Les souches associées à des infections humaines se développent optimalement à des températures comprises entre 35 et 37 °C, bien que de nombreuses souches puissent croitre entre 4 et 42 °C (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a; Liu, 2015).
B.2.1.1.2 Effets sur la santé
La gastroentérite est la maladie la plus fréquente causée par une infection à Aeromonas (Janda et Abbott, 2010). Les formes de la maladie vont d'une entérite caractérisée par des diarrhées aqueuses, accompagnées de fièvre légère, de vomissements et de douleurs abdominales (le plus souvent), à une maladie semblable au choléra (très rare), en passant par une forme dysentérique s'accompagnant de selles sanglantes (rare) (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). Les Aeromonas spp. sont très rarement responsables de la diarrhée du voyageur. En outre, ils peuvent être associés à une infection intestinale subaigüe ou chronique (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015).
Le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes est d'un ou deux jours dans le cas de la diarrhée du voyageur causée par des Aeromonas (Janda et Abbott, 2010). Par définition, les cas subaigus de diarrhée durent deux semaines à deux mois, tandis que les cas chroniques persistent plus longtemps (Janda et Abbot, 2010). Les complications qui ont été associées à des cas plus graves de gastroentérite causée par des Aeromonas sont la colite ulcéreuse, le syndrome hémolytique et urémique et des maladies inflammatoires de l'intestin (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). La dose d'Aeromonas spp. minimale causant une infection gastro-intestinale n'est pas clairement définie. Deux souches sur 5 provoquaient une infection (14 sujets sur 57) et des diarrhées (2 personnes sur 57) à des concentrations bactériennes élevées (dix milles à dix-milliards d'unités formant des colonies ou UFC) (Morgan et coll., 1985). Des données provenant de l'observation d'éclosions d'origine alimentaire indiquent que la concentration minimale causant une infection pourrait être plusieurs ordres de grandeur en dessous de ces valeurs pour certaines souches d'Aeromonas (Teunis et Figueras, 2016).
Les infections de la peau et des tissus mous sont les secondes formes les plus fréquentes de maladies liées aux Aeromonas. Les Aeromonas spp. peuvent être associées à des infections variées, allant d'irritations bénignes (p. ex. des lésions purulentes) à des infections graves ou mortelles, comme la cellulite ou la fasciite nécrosante (Janda et Abbott, 2010; Bhowmick et Battacharjee, 2018). Les aéromonades ont souvent été la cause d'infections transmissibles par le sang, lesquelles surviennent la plupart du temps par transfert de bactéries issues du tube digestif ou de plaies infectées. Les symptômes associés à ces infections sont la fièvre, la jaunisse, des douleurs abdominales et un choc septique (Janda et Abbott, 2010). Plus rarement, les Aeromonas entrainent des maladies caractérisées par des infections des voies respiratoires, de l'appareil urogénital ou des yeux (Janda et Abbott, 2010). Des taux de mortalité élevés ont été observés chez des sujets très vulnérables atteints de sepsis et d'infections de plaies graves causées par des Aeromonas (Janda et Abbot, 2010; Liu, 2015).
Des diarrhées provoquées par des Aeromonas ont été observées chez des personnes saines de tous groupes d'âge (Janda et Abbot, 2010; Percival et Williams, 2014a; Teunis et Figueras, 2016). Cependant, bien que les Aeromonas spp. soient très présentes dans la nourriture et l'eau, relativement peu de cas de maladie ont été dénombrés chez les personnes exposées à ces bactéries (Janda et Abbott, 2010). Les infections gastro-intestinales sont plus fréquentes dans les pays en voie de développement (Ghenghesh et coll., 2008). Les groupes à risque sont les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou atteintes d'une maladie sous-jacente, comme une hépatopathie ou des maladies malignes (Ghenghesh et coll., 2008; Liu, 2015). Les infections de la peau et des tissus mous sont souvent le résultat d'un trauma ou d'une blessure pénétrante et surviennent habituellement plus souvent chez les adultes que chez les enfants (Janda et Abbot, 2010). En ce qui concerne les bactériémies causées par des Aeromonas, la vaste majorité des cas s'observent chez les sujets immunodéprimés (Janda et Abbot, 2010). Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves, lorsque le risque de propagation de l'infection est élevé (Percival et Williams, 2014a; Liu et coll., 2015). L'ASPC a catégorisé l'étude et la surveillance des Aeromonas spp. résistants aux médicaments comme une faible priorité par rapport aux autres agents pathogènes résistants aux antimicrobiens (Garner et coll., 2015). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible contre les infections à Aeromonas (Liu et coll., 2015).
Ces infections ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire en Amérique du Nord et dans la plupart des pays du monde. Les cas observés et les éclosions de maladies ont pour la plupart été associés à de la nourriture, à des expositions à l'hôpital, à des voyageurs, à des milieux non aqueux ou à des causes inconnues (Teunis et Figueras, 2016). Les infections sont le plus souvent observées durant les saisons chaudes (Janda et Abbot, 2010; Bhowmick et Battacharjee, 2018).
B.2.1.1.3 Sources et exposition
Les Aeromonas spp. peuvent vivre dans presque toutes les niches écologiques, dont les habitats aquatiques, le sol, les espèces animales vertébrées et invertébrées, les insectes et la nourriture (Janda et Abbot, 2010; Percival et Williams, 2014a). Elles sont présentes dans les milieux aqueux et aquatiques (p. ex. les lacs, les rivières, les eaux souterraines, l'eau de mer, les sources d'eau potable, les eaux usées et les égouts) et supportent toutes les conditions de pH, de température et de salinité, sauf les plus extrêmes (Janda et Abbot, 2010). Les membres du genre Aeromonas sont présents dans le tube digestif des animaux à sang froid et à sang chaud, dont les poissons, les oiseaux, les reptiles et le bétail. Les Aeromonas spp. peuvent être isolées à partir des matières fécales de personnes saines ayant consommé des aliments ou de l'eau contenant ces organismes (Percival et Williams, 2014a). Elles peuvent aussi être présentes en fortes concentrations dans les eaux usées (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a). Les aéromonades se développent optimalement à des températures élevées, leur concentration dans l'eau étant donc maximale durant les saisons chaudes (LeChevallier et coll., 1982; Gavriel et coll., 2008; Chauret et coll., 2001; Egorov et coll., 2011).
L'ingestion de nourriture ou d'eau contaminée est considérée comme le principal mode de transmission de la gastroentérite causée par des Aeromonas. Le contact corporel direct avec de l'eau contaminée est le premier mode de contamination par les Aeromonas spp. responsables d'infections de la peau et des tissus mous liées à l'eau. Il a été déterminé que les eaux de crue contaminées dans des contextes de catastrophes naturelles étaient d'importants vecteurs de ces types de maladies (Tempark et coll., 2013). La transmission entre personnes n'est pas considérée comme un risque d'infections à Aeromonas.
Les aéromonades ne sont pas fréquemment détectées dans l'eau libre qui circule dans les réseaux de distribution municipaux contenant un désinfectant résiduel (Chauret et coll., 2001; Egorov et coll., 2011). Dans une étude portant sur 293 réseaux publics de distribution d'eau menée aux US, des Aeromonas spp. ont été détectées par des méthodes de culture dans 42 réseaux (14,3 %), à des concentrations comprises entre 0,2 et 880 (valeur médiane égale à 1,6) UFC par 100 ml (Egorov et coll., 2011). Les eaux souterraines sont censées contenir de moins grandes quantités d'aéromonades que les eaux de surface, mais les puits d'eau potable peuvent être colonisés par ces bactéries (Borchardt et coll., 2003; Percival et Williams, 2014a; Katz et coll. 2015). Les aéromonades sont capables de se développer et de subsister dans les biofilms des réseaux de distribution et cela peut contribuer à l'augmentation de leur concentration dans les sources d'eau potable (Gavriel et coll., 1998; Chauret et coll., 2001).
L'importance de l'eau comme vecteur de transmission des maladies gastro-intestinales causées par des Aeromonas n'est pas encore bien comprise. Des espèces d'Aeromonas possédant de multiples gènes de virulence ont été détectées dans des sources d'eau potable en Amérique du Nord et dans d'autres pays (Handfield et coll., 1996; Kühn et coll., 1997; Sen et Rogers, 2004; Robertson et coll., 2014b). Des études tentant de relier des souches découvertes dans des sources d'eau potable et des isolats de patients se sont avérées infructueuses (Havelaar et coll., 1992; Borchardt et coll., 2003). D'autres études ont mis en évidence un lien épidémiologique entre les Aeromonas d'échantillons cliniques et l'eau potable comme source d'infection (Khajanchi et coll., 2010; Katz et coll., 2015). Il est généralement admis que seul un sous-ensemble de souches d'Aeromonas peut provoquer des maladies gastro-intestinales chez l'humain (Teunis et Figueras, 2016). En outre, il semblerait que l'infection soit un processus complexe mettant en jeu la virulence de la souche d'Aeromonas, son interaction avec d'autres microorganismes présents dans le tube digestif (constituant des agents pathogènes co-infectieux ou faisant partie du microbiote intestinal naturel) et l'état de santé du sujet contaminé (Teunis et Figueras, 2016). Par conséquent, la présence seule d'Aeromonas spp. dans l'eau potable ne prouve pas qu'il existe un risque pour la santé (Edberg et coll., 2007). Des travaux plus approfondis sont nécessaires pour déterminer la combinaison spécifique des facteurs liés au sujet contaminé, à l'environnement et aux agents pathogènes, qui entraine l'apparition de maladies gastro-intestinales à la suite d'infections à Aeromonas (Teunis et Figueras, 2016). Aucune éclosion liée à la contamination de l'eau potable par des Aeromonas n'a encore été observée (Janda et Abbot, 2010; Teunis et Figueras, 2016).
B.2.1.1.4 Méthodes d'analyse
Des méthodes standards de détection des Aeromonas dans l'eau potable sont disponibles (US EPA, 2001; APHA et coll., 2017). Cependant, il n'existe aucune méthode d'isolement par culture universellement acceptée permettant de détecter toutes les aéromonades présentes dans des échantillons d'eau (APHA et coll., 2017). Les Aeromonas spp. sont des bactéries hétérotrophes détectées par numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NPBH). Cependant, il n'existe aucune corrélation directe entre les résultats de la NPBH et les concentrations d'Aeromonas.
B.2.1.1.5 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les méthodes d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - et de désinfection - basées sur l'utilisation de chlore, de chloramines ou de monochloramine, de dioxyde de chlore, d'ozone ou d'UV - couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable s'avèrent très efficaces pour réduire ou inactiver les Aeromonas spp. (Chauret et coll., 2001; OMS, 2002; US EPA, 2006a; Yu et coll., 2008). Cependant, l'emploi de charbon actif en granulés (CAG) dans le traitement de l'eau peut fournir des sources de nutriments aux aéromonades, ce qui peut favoriser leur présence et leur survie dans les réseaux de distribution d'eau potable (OMS, 2002; US EPA, 2006a).
Les Aeromonas sont aussi sensibles aux désinfectants chimiques qu'E. coli et d'autres bactéries d'origine hydrique (Knøchel, 1991; Medema et coll., 1991; Sisti et coll., 1998; OMS, 2002; US EPA, 2006a). Les exigences en matière de CT pour l'inactivation des Aeromonas spp. par les désinfectants chimiques sont inférieures à celles applicables à de nombreux virus entériques. Les exigences en matière de dose d'UV sont comparables à celles requises pour d'autres bactéries pathogènes entériques et pour les protozoaires entériques Giardia et Cryptosporidium et sont inférieures à celles applicables à de nombreux virus entériques (Massa et coll., 1999; Gerba et coll., 2003; US EPA, 2006a; Santé Canada, 2019c, 2019d).
Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance visant à limiter la survie et le développement de microbes dans les réseaux de distribution d'eau potable et les installations de plomberie, telles qu'elles sont décrites dans la partie A, sont essentielles pour contrôler la présence d'Aeromonas spp. (Chauret et coll., 2001; OMS, 2002; Percival et Williams, 2014a). Les stratégies de contrôle consistent à maintenir les concentrations de chlore libre et de chloramine résiduels respectivement en dessous de 0,2 mg/l et 0,4 mg/l (Gavriel et coll., 1998; Chauret et coll., 2001; Pablos et coll., 2009).
Pour les systèmes résidentiels et les puits privés, il important d'effectuer régulièrement des inspections physiques, pour repérer les défaillances éventuelles, et des analyses sur le réseau de distribution d'eau (p. ex. des mesures des concentrations d'E. Coli et des coliformes totaux), afin de valider la bonne qualité microbiologique de l'eau. Si des problèmes de qualité microbiologique de l'eau potable sont suspectés, il peut s'avérer utile d'ajouter des paramètres d'analyse (p. ex. une NPBH). L'autorité responsable de la gestion de l'eau potable sur le territoire administratif concerné devrait fournir des conseils précis en matière de construction, d'exploitation et de maintenance des réseaux et d'analyses des eaux qu'ils contiennent.
B.2.1.1.6 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence des Aeromonas spp. dans l'eau potable. Aux Pays-Bas, la règlementation spécifie une exigence de surveillance des Aeromonas, sous la forme d'un paramètre d'exploitation dont la limite cible est inférieure à 1000 UFC/100 ml (Smeets et coll., 2009). Cette limite se base sur les capacités de traitement et non sur des critères de santé publique (OMS, 2002).
B.2.1.2 Legionella spp.
B.2.1.2.1 Description
Le genre bactérien Legionella (classe : Gammaproteobacteria) comporte 61 espèces et trois sous-espèces (LPSN, 2019). Quelque 30 espèces sont connues comme responsables d'infections humaines (Cuhna et coll., 2016; Burillo et coll., 2017). Les Legionella spp. pathogènes sont des agents infectieux opportunistes qui causent des maladies respiratoires sous deux formes principales : la maladie du légionnaire et la fièvre de Pontiac (Percival et Williams, 2014e). Les maladies provoquées par les Legionella spp. sont toutes nommées légionelloses. La Legionella pneumophila (essentiellement le sérogroupe 1), l'agent pathogène le plus commun et le plus virulent du genre Legionella, est responsable de 65 à 90 % de tous les cas de maladie du légionnaire (Fields et coll., 2002; Edelstein et Roy, 2015; Percival et Williams, 2014e, Prussin II et coll., 2017). Les infections causées par d'autres espèces sont bien moins fréquentes et ont été principalement associées à L. micdadei, L. bozmanae, L. dumoffii et L. longbeachae (Edelstein et Roy, 2015; Percival et Williams, 2014e; Cuhna et coll., 2016).
Les Legionella spp. sont des cellules à Gram négatif, aérobies strictes, motiles pour la plupart et en forme de bâtonnets courts et ont besoin de nutriments particuliers (L-cystine et fer) pour se développer (Percival et Williams, 2014e). Durant leur cycle de vie, les Legionella peuvent s'adapter à des conditions changeantes en se différenciant en différents types de cellules dont l’infectivité et la resistance à la désinfectation viarient (Robertson et coll., 2014a; NAS, 2019).
B.2.1.2.2 Effets sur la santé
La maladie du légionnaire est une maladie respiratoire grave qui provoque une pneumonie. Les autres symptômes de la maladie sont la fièvre, la toux, des frissons, des troubles neurologiques (confusion), des douleurs musculaires, des maux de tête et des problèmes gastro-intestinaux (diarrhée, nausées et vomissements) (Castillo et coll., 2016, Cunha et coll., 2016; Edelstein et Roy, 2015). Les symptômes apparaissent généralement deux à 14 jours après l'infection (NAS, 2019) et la maladie peut persister des semaines voire des mois (Palusińska-Szysz et Cendrowska-Pinkosz, 2009). Bien que beaucoup de gens soient exposés aux Legionella, peu contractent la maladie (Castillo et coll., 2016). La maladie du légionnaire présente un taux d'attaque faible et touche moins de 1 à 5 % de la population générale et moins de 1 à 14 % des patients hospitalisés et exposés aux bactéries lors d'éclosions (Hornei et coll., 2007; Edelstein et Roy, 2015; Leoni et coll., 2018). La légionellose survient davantage chez les adultes âgés ou les personnes immunodéprimées. Toutefois, les sujets sains peuvent contracter la maladie s'ils sont exposés à une concentration suffisamment élevée de bactéries (Springston et Yocavitch, 2017). Les cas de maladie du légionnaire chez les enfants sains sont extrêmement rares (McDonough et coll., 2007, Greenberg et coll., 2006). La sensibilité à la légionellose après exposition aux bactéries est plus élevée chez les personnes de sexe masculin, âgées de 40 à 50 ans, fumeuses, atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques, de diabète ou d'insuffisance rénale, immunodéprimées, transplantées ou souffrant de certains types de cancer (Fields et coll., 2002; Edelstein et Roy, 2015, Castillo et coll., 2016; Cuhna et coll., 2016; NAS, 2019). Le taux de mortalité des patients atteints de la maladie du légionnaire dépend de leur état de santé et de la rapidité avec laquelle un traitement leur est administré et varie selon que les cas sont sporadiques, nosocomiaux ou liés à une éclosion (Edelstein et Roy, 2015). La mortalité est estimée à moins de 10 à 15 % des cas d'origine communautaire, mais à plus de 25 % des cas nosocomiaux (Benin et coll., 2002; Howden et coll., 2003; Dominguez et coll., 2009; Soda et coll., 2017; Leoni et coll., 2018).
La fièvre de Pontiac est une maladie plus bénigne, d'allure grippale, autolimitée et non pulmonaire, associée à une exposition à des Legionella. Cette maladie a été principalement diagnostiquée lors d'éclosions où les personnes atteintes présentaient des symptômes d'allure grippale et avaient été exposées à une même source d'aérosols (Lüttichau et coll., 1998). Le mode d'apparition de la fièvre de Pontiac est mal compris et la raison pour laquelle des personnes contractent cette maladie et d'autres la légionellose demeure inconnue (Fields et coll., 2001; Edelstein, 2007). Il a été suggéré que la fièvre de Pontiac pourrait être due à une exposition à certaines combinaisons de microorganismes vivants et morts (soit des espèces de Legionella, soit des microorganismes coexistants) et de leurs produits (notamment des endotoxines) (Edelstein, 2007). La fièvre de Pontiac présente un taux d'attaque élevé et touche 80 à 90 % des personnes exposées durant des éclosions (Leoni et coll., 2018). Les symptômes de la maladie se déclarent cinq heures à trois jours après l'infection et persistent deux à sept jours. Aucune complication à long terme n'a été observée et la maladie n'est pas mortelle (Tossa et coll., 2006; Edelstein et Roy, 2015). Il ne semble y avoir aucun facteur de prédisposition à la maladie chez les personnes infectées (Edelstein et Roy, 2015). Des cas de fièvre de Pontiac ont été observés chez des enfants lors d'éclosions de la maladie (Lüttichau et coll., 1998; Goldberg et coll., 1989, Jones et coll., 2003; Burnsed et coll., 2007).
Des modèles dose-réponse ont été élaborés pour quelques souches particulières de Legionella, à partir d'expériences réalisées sur des animaux (NAS, 2019). Les résultats d'une EQRM visant à estimer le risque d'exposition aux Legionella lors de la prise d'une seule douche indiquent qu'il faudrait plus d'un million de cellules viables par litre d'eau libre pour générer une dose infectante de 1 à 100 UFC (Schoen et Ashbolt, 2011). Aucun consensus entre spécialistes ne permet d'affirmer qu'il existe un seuil détectable de concentration de Legionella en dessous duquel il n'y aurait aucun risque d'infection (NAS, 2019).
Les Legionella sont une cause majeure de maladies d'origine hydrique aux US (Neil et Berkleman, 2008; CDC, 2017d; Friedman et coll., 2017). Les éclosions d'envergure de Legionella sont l'objet de la plus grande attention étant donné leurs importantes répercussions sur la santé. Cependant, il est estimé que moins de 20 % de tous les cas observés de légionellose sont liés à des éclosions (Fields et coll., 2002; Neil et Berkleman, 2008; Burillo et coll., 2017). Cette maladie suit un cycle saisonnier particulier, le plus grand nombre de cas étant observé durant l'été et l'automne (Prussin II et coll., 2017, Cuhna et coll., 2016). Au Canada, le nombre de cas de la légionellose observés sur la période 2006-2016 (année de publication des données les plus récentes) était compris entre 0,37 et 1,39 (taux médian : 0,71) pour 100 000 habitants (ASPC, 2019). Les taux observés aux US se situaient entre 1,0 et 1,89 (taux médian : 1,18) pour 100 000 habitants pendant la même période (Adams et coll., 2016, 2017). Étant donné que la légionellose est sous-diagnostiquée et sous-déclarée, celui-ci devrait être beaucoup plus élevé (Castillo et coll., 2016; ASPC, 2018d). Les taux d'incidence annuelle de légionellose au Canada et aux US sont en augmentation (Adams et coll., 2016, 2017; ASPC, 2019). Les facteurs contribuant à cette augmentation sont un accroissement réel du nombre de cas, la plus grande utilisation des tests de diagnostic et une meilleure déclaration des cas (Burillo et coll., 2017).
Vu que les Legionella sont des agents pathogènes intracellulaires, le traitement de la maladie du légionnaire requiert l'utilisation d'antibiotiques capables d'atteindre des concentrations thérapeutiques à l'intérieur des cellules humaines (Fields et coll., 2002; Edelstein et Roy, 2015, Castillo et coll., 2016; Wilson et coll., 2018). Il n'existe aucun vaccin humain contre la maladie (Edelstein et Roy, 2015). La plupart des sujets atteints de fièvre de Pontiac ne tombent pas suffisamment malades pour nécessiter des soins médicaux et aucun traitement antibiotique n'est habituellement requis (Edelstein et Roy, 2015, Castillo et coll., 2016). Les variations d'antibiorésistance des Legionella spp. ne sont pas bien comprises (Wilson et coll., 2018). Les données sur la résistance d'isolats cliniques aux antibiotiques ne sont pas bien documentées en raison de l'absence de tests faciles à réaliser (Wilson et coll., 2018).
B.2.1.2.3 Sources et exposition
Les Legionella ont deux habitats - un réservoir primaire dans le milieu naturel et un habitat secondaire dans les réseaux de distribution d'eau (NAS, 2019). D'après les connaissances actuelles, le milieu principal où se développent les Legionella dans ces habitats se situe à l'intérieur de protozoaires libres vivant dans les biofilms (Devos et coll., 2005; NAS, 2019). Les Legionella sont naturellement présentes dans le monde entier dans l'eau douce et le sol, en particulier les lacs, les rivières, les sédiments et les eaux souterraines (Fields et coll., 2002; Percival et Williams, 2014e, Burillo et coll., 2017; NAS, 2019). Les matières fécales humaines et animales ne sont pas considérées comme des sources de Legionella, bien que ces bactéries puissent être détectées dans les selles de personnes infectées présentant des symptômes diarrhéiques. Les animaux peuvent être infectés par des Legionella, mais la transmission zoonotique de ces bactéries n'a pas encore été documentée (Surman-Lee et coll., 2007; Edelstein et Roy, 2015).
Les Legionella parasitent et envahissent de nombreuses espèces de protozoaires d'eau douce (p. ex. les amibes et les ciliés) présents dans les biofilms formés dans les eaux naturelles et systèmes d’eau artificiels et industriels. Parmi ces espèces figurent Acanthamoeba (voir B.3.2.1), Hartmanella, Naegleria (voir B.3.2.2), Valkampfia, Vermamoeba (anciennement Hartmanella), Echinamoeba et Tetrahymena (Fields et coll., 2002; Lau et Ashbolt, 2009; Buse et coll., 2012, Percival et Williams, 2014e; NAS, 2019). Les Legionella peuvent survivre dans ces protozoaires, qui leur offrent une source de nutriments, un milieu protecteur contre les désinfectants et d'autres conditions hostiles (comme des températures élevées) ainsi qu’un moyen de transport (Percival et Williams, 2014e, Buse et coll., 2012; NAS, 2019). Les Legionella sont aussi capables de survivre dans les biofilms en l'absence de protozoaires hôtes (NAS, 2019).
Sous des conditions appropriées dans des systèmes d’eau artificiels et industriels, les Legionella peuvent se développer et atteindre des concentrations élevées. Les systèmes d’eau artificiels et industriels constituant des réservoirs de Legionella sont les installations de plomberie d'édifices grands et complexes (comme ceux des hôpitaux, des hôtels, des immeubles d'appartements, des centres communautaires, des bâtiments industriels et des bateaux de croisière), les tours de refroidissement ou les condenseurs évaporatifs commerciaux ou industriels et les réseaux de distribution d'eau potable. Comme les Legionella se transmettent de l'eau à l'air, les composants de ces réseaux favorisant la formation de biofilms et pouvant générer des aérosols s'avèrent très fréquemment être des sources d'exposition à ces bactéries (NAS, 2019). Ces composants font partie de systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation (CVC), tels que des tours de refroidissements ou des climatiseurs, des éléments de plomberie (p. ex. des pommeaux de douche ou des robinets), des baignoires à remous, des humidificateurs et des nébuliseurs. D'autres réseaux de distribution d'eau générant des aérosols à partir de sources d'eau chaude stockée ou stagnante constituent des sources d'exposition aux Legionella, en particulier les lave-autos, les fontaines décoratives et les brumisateurs des étalages de supermarché (NAS, 2019).
Les Legionella se développent à des températures comprises entre 25 et 45 °C (températures optimales : entre 25 et 35 °C). Par conséquent, les sources d'eau dont la température se situe dans cet intervalle sont celles qui favorisent un développement optimal de ces organismes (NAS, 2019). Par ailleurs, les Legionella sont thermotolérantes, c'est-à-dire capables de survivre à des températures comprises entre 55 et 70 °C (Allegra et coll., 2008; Cervero-Aragó, 2015; 2019). Il a été démontré que les Legionella survivaient dans les cystes de protozoaires après avoir été exposées à une température de 80 °C (NAS, 2019). Dans les installations de plomberie, les systèmes d'approvisionnement en eau chaude sont souvent identifiés comme étant à l'origine d'une contamination par des Legionella. En plus d'offrir des températures favorables au développement des Legionella, ces systèmes présentent habituellement des concentrations de désinfectant résiduel inférieures à celles mesurées dans les réseaux de distribution d'eau froide. De plus, les sources d'eau froide maintenues à une température supérieure à 25 °C peuvent présenter un risque élevé de colonisation par des Legionella (Donohue et coll., 2014; Schwake et coll. 2016).
Les données sur la détection des Legionella spp. dans les réseaux de distribution d’eau potable en Amérique du Nord sont rares. Des études ont permis de détecter par PCR des Legionella spp. et des L. pneumophila respectivement dans 57 à 83 % et 6 à 14 % des échantillons d'eau (Wang et coll., 2012a; Lu et coll., 2015a). Lu et ses collègues (2015b) ont détecté par PCR des L. pneumophila dans 38 % (7/18) d'échantillons de sédiments de réservoirs d'eau potable situés partout aux US Cependant, les méthodes employées dans ces études ne sont pas capables de faire la différence entre des organismes vivants et morts. Un faisceau de preuves comportant des données publiées par des autorités internationales montre que des L. pneumophila peuvent être détectées à diverses concentrations dans des échantillons prélevés dans des réseaux de distribution (p. ex. eau, biofilms, dépôts non fixés) appartenant à des responsables de systèmes d’approvisionnement d'eau (Wullings et coll., 2011; Wang et coll., 2012a; Whiley et coll., 2014; Lu et coll., 2015a; 2015b). Des taux de détection de Legionella et de L. pneumophila plus élevés peuvent être observés dans les tours de refroidissement et les installations de plomberie de grands édifices (Stout et coll., 2007, Christina et coll., 2014, Llewellyn et coll., 2017). Stout et ses collègues (2007) ont indiqué que des Legionella pneumophila avaient été détectées dans les installations de plomberie de 70 % (14/20) des hôpitaux visés par leur étude. Llewellyn et ses collègues (2017) ont détecté par PCR des Legionella spp. dans 84 % (164/196) d'échantillons prélevés dans des tours de refroidissement situées dans différentes régions des US Des L. pneumophila ont été détectées par des méthodes de culture dans 32 % (53/164) des échantillons testés positifs par PCR (Llewellyn et coll., 2017). En se basant sur des données existantes sur des études de cas de légionellose, le Comité de gestion de la Legionella dans les réseaux de distribution d'eau de la National Academies of Sciences (NAS) propose qu'une concentration de 5 x 104 UFC/l dans des échantillons prélevés dans des systèmes d’eau artificiels et industriels d'eau soit considérée comme un seuil d'intervention. Ce seuil reflète une concentration suffisamment élevée pour qu'on s'en préoccupe et sert de signal pour la prise de mesures correctives (NAS, 2019). Un seuil d'intervention plus bas peut s'avérer nécessaire pour protéger les personnes les plus à risque de contracter la légionellose, comme les patients hospitalisés (NAS, 2019).
Relativement peu de connaissances sont disponibles sur les sources environnementales des cas sporadiques de légionellose d'origine communautaire. Les réseaux de distribution domestiques peuvent être des sources potentielles de Legionella (Collins et coll., 2017, Mathys et coll., 2008). Dans diverses études menées aux US et en Europe, des Legionella ayant une pertinence clinique ont été isolées, à l'aide de méthodes de culture, aux extrémités (p. ex. des robinets et des pommeaux de douche) de réseaux de distribution domestiques d'eau chaude alimentés par des réservoirs d'eau chaude dans 6 à 21 % des foyers où des échantillons ont été prélevés (Alary et Joly, 1991; Stout et coll., 1992; Bates et coll., 2000; Mathys et coll., 2008; Dilger et coll., 2016; Collins et coll., 2017). Des études ont mis en évidence la forte présence de Legionella spp. dans des échantillons prélevés sur des réseaux de distribution d'eau chaude alimentés par des chauffe-eaux à stratification (c.-à-d. chauffés électriquement) et l'absence de ces mêmes bactéries dans des réseaux d'eau chaude alimentés par des chauffe-eaux à gaz ou à mazout délivrant des températures supérieures à 60 °C aux sorties d'eau et extrémités de ces réseaux (Alary et Joly, 1991, Mathys et coll., 2008). Il n'est pas clair si les réseaux domestiques de distribution d'eau sont des sources importantes d'infection par Legionella chez les personnes vulnérables (Bates et coll., 2000; Prussin II et coll., 2017). En général, le risque de contracter la maladie du légionnaire après une exposition à ces bactéries dans les réseaux de distribution résidentiels est considéré comme bas. Cependant, certaines personnes sont à risque élevé en raison de leur santé fragile (Mathys et coll., 2008; Prussin II et coll., 2017).
Les Legionella se transmettent essentiellement par inhalation d'aérosols (taille des particules comprise entre 2 et 10 µm) contenant les bactéries (Percival et Williams, 2014e; Castillo et coll., 2016). La consommation d'eau potable n'est pas considérée comme un mode de transmission des Legionella (Percival et Williams, 2014e; Prussin II et coll., 2017). Il est supposé que la microaspiration se produisant durant l'ingestion d'eau ou associée à certaines conditions ou procédures cliniques constitue une source d'exposition possible (NAS, 2019). L'inoculation de plaies chirurgicales est une autre voie d'infection moins fréquente (Cuhna et coll., 2016; Burillo et coll., 2017). Les Legionella ne se transmettent habituellement pas entre personnes (Percival et Williams, 2014e; Edelstein et Roy, 2015), bien qu'un cas probable ait été observé (Correia et coll., 2016).
La pluie et un fort taux d'humidité ont été confirmés comme étant des causes de la légionellose (Fisman et coll., 2005; Beauté et coll., 2016). Une éclosion de légionellose d'origine communautaire survenue à Calgary en novembre et décembre 2012 met en évidence que les Legionella peuvent se transmettre à la fin de l'automne et pendant la saison hivernale en Amérique du Nord (Knox et coll., 2017). Les changements climatiques et l'augmentation des températures qui les accompagne pourraient être des facteurs favorables au développement des Legionella (Cuhna et Cuhna, 2017; MacIntyre et coll., 2018).
Citons quelques éclosions remarquables de légionellose en Amérique du Nord : Brooklyn, New York (2015 : 138 cas, 16 décès); comté de Genessee, Michigan (2014-2015 : 87 cas, 12 décès), Québec, Québec (2012 : 182 cas, 13 décès); et Scarborough, Ontario (2005 : 112 cas, 23 décès) (Gilmour et coll., 2007, Levesque et coll., 2014, MDHHS, 2016, Weiss et coll., 2017).
B.2.1.2.4 Méthodes d'analyse
La détection des Legionella est techniquement difficile et ne peut se faire que dans des laboratoires spécialisés. Des méthodes standards de détection des Legionella dans l'eau potable sont disponibles (APHA et coll., 2017; ISO 2019). Le recours à d'autres méthodes pourrait être autorisé dans d'autres circonscriptions administratives (CEAEQ, 2019). La littérature fournit aussi des renseignements détaillés sur certaines méthodes (Mercante et Winchell, 2015; Wang et coll., 2017, Petricek et Hall, 2018). Des codes de pratiques approuvés et des normes, élaborés pour limiter le développement des Legionella dans les réseaux de distribution d'eau de bâtiments, recommandent de procéder à des évaluations des risques propres aux sites, pour que la prise de décisions s'appuie sur les besoins de surveillance environnementale de chaque installation (HSE 2013c; TPSGC, 2016). En général, les programmes de surveillance consistent à contrôler régulièrement la qualité microbiologique globale, indicateur de contrôle du réseau, et à détecter la présence de Legionella à intervalles réguliers, à l'aide de méthodes de culture combinées à des méthodes PCR (HSE 2013a; 2013b; 2019; TPSGC, 2016). Pour les études épidémiologiques, les méthodes de typage par séquençage sont actuellement les épreuves de référence servant à comparer des isolats de Legionella environnementaux et de patients (Gaia et coll., 2005; Mercante et Winchell, 2015; APHA et coll., 2017).
B.2.1.2.5 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - permettent de réduire le nombre de Legionella présentes dans l'eau potable (US EPA, 1989a, 2006b; Hijnen et Medema, 2010). Les valeurs de CT pour l'inactivation des Legionella pneumophila par le chlore, les chloramines (monochloramine), le dioxyde de chlore et l'ozone sont supérieures à celles exigées pour les Giardia, mais inférieures ou égales à celles requises pour les Cryptosporidium (Jacangelo et coll., 2002; Santé Canada, 2019d). Les données de recherche indiquent que les exigences en matière de dose d'UV sont plus élevées que celles applicables aux Giardia et aux Cryptosporidium, mais inférieures à celles requises pour de nombreux virus entériques (Hijnen et coll., 2011; Santé Canada, 2019c, 2019d). Il est également nécessaire de limiter efficacement la quantité de protozoaires libres dans l'eau potable (p. ex. Acanthamoeba, Naegleria - voir B.3.2), afin de réduire les populations de Legionella (Loret et Greub, 2010; Thomas et Ashbolt, 2011; NAS, 2019). Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance visant à limiter la survie et le développement de microbes dans les réseaux distribution d'eau potable et les installations de plomberie, décrites dans la partie A, sont importantes pour réduire la quantité de Legionella spp. dans l'eau (Falkinham et coll., 2015b). Les données d'études de laboratoire laissent penser qu'une concentration de chlore libre supérieure à 0,5 mg/l est nécessaire pour inactiver les Legionella dans l'eau libre et que des concentrations élevées (supérieures à 2mg/l) sont nécessaires pour éliminer efficacement les Legionella présentes dans les biofilms ou les amibes libres (Miyamoto et coll., 2000; Storey et coll., 2004; Cooper et Hanlon, 2010; Dupuy et coll., 2011). Il est prouvé que les monochloramines permettent de réduire plus efficacement les quantités de Legionella dans les réseaux de distribution d'eau des bâtiments que le chlore libre (Pryor et coll., 2004; Flannery et coll., 2006; Weintraub et coll., 2008; NAS, 2019).
Les éclosions de légionellose de 2014-2015 dans le comté de Genesee, dans le Michigan, qui ont coïncidé avec la crise sanitaire de Flint offrent un exemple des conséquences involontaires de changements dans l'exploitation de réseaux de distribution d'eau potable. Lorsque l'usine de traitement de l'eau de Flint a changé sa source d'approvisionnement et s'est alimentée dans la rivière acide Flint et en l'absence de surveillance de la corrosion des installations, des conditions sont apparues (concentration en chlore résiduel instable, températures élevées et concentration en fer élevé), favorisant le développement de Legionella dans les réseaux de distribution d'eau potable (Masten et coll., 2016).
De nombreuses ressources existent qui décrivent les mesures à prendre pour réduire le risque d'exposition aux Legionella dans les réseaux de distribution des bâtiments. Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) (CNRC, 2015a) et le Code national de la plomberie du Canada (CNP) (CNRC, 2015b) énoncent des normes et des dispositions techniques en matière de conception et d'installation respectivement de systèmes de CVC et de circuits de plomberie dans les bâtiments. Tous deux contiennent des dispositions sur la présence des Legionella dans les réseaux et installations des bâtiments. La norme 188 de l'American National Standards Institute et de l'American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI et ASHRAE) (ASHRAE, 2018) fixe des exigences minimales en matière de gestion des risques liés aux Legionella pour les réseaux de distribution d'eau des bâtiments, à l'intention des personnes participant à la conception, à la construction, à l'installation, à la mise en route, à l'exploitation, à la maintenance et à l'entretien de réseaux de distribution d'eau centralisés de bâtiments et de leurs composants. Des documents d'orientation recommandent l'utilisation de plans de gestion de l'eau et de sécurité sanitaire de l'eau pour la gestion des Legionella dans les réseaux de distribution d'eau des bâtiments. Les établissements de soins de santé et de soins de longue durée équipés de tours de refroidissement sont considérés comme des infrastructures nécessitant particulièrement des programmes de gestion de l'eau visant à réduire les risques de développement et de propagation de Legionella (OMS, 2007, HSE 2013a, CDC, 2017a). Des publications destinées à aider les gestionnaires de bâtiments à élaborer des plans de gestion de l'eau et de la sécurité sanitaire de l'eau sont disponibles (OMS, 2007, 2011; HSE, 2013a, 2013b, 2013c; TPSGC, 2016; CDC, 2017a; ASHRAE, 2018). En général, le Comité de gestion de la Legionella dans les réseaux de distribution d'eau de la NAS recommande d'exiger la mise en place de plans de gestion de l'eau dans tous les édifices publics et de créer des registres associés aux tours de refroidissements, deux mesures stratégiques, qui peuvent améliorer la protection de la santé publique contre l'exposition aux Legionella (NAS, 2019).
Le Québec a adopté son Code de sécurité des bâtiments en 2013, lequel comprend des règlements en matière de maintenance et d'exploitation des tours de refroidissement (gouvernement du Québec, 2020). Ces règlements décrivent les exigences imposées aux propriétaires, qui doivent déclarer leur réseau auprès de l'autorité de règlementation, mettre en œuvre un plan de gestion de l'eau et effectuer régulièrement des analyses pour détecter la présence de Legionella pneumophila. Les villes d'Hamilton et de Vancouver ont intégré des exigences similaires en ce qui concerne les tours de refroidissements, les condenseurs évaporatifs ou les pièces d'eau décoratives dans leur règlementation (ville d'Hamilton, 2019; ville de Vancouvert, 2020).
Pour les installations de plomberie, la gestion de la température, c'est-à-dire l'utilisation de mesures de contrôle visant à maintenir les températures des réseaux de distribution d'eau chaude ou froide en dehors de l'intervalle compris entre 25 et 43 °C, favorable au développement bactérien, est un aspect essentiel de la stratégie de lutte contre les Legionella (Bédard et coll., 2016a; Boppe et coll., 2016; NAS, 2019). Le maintien des réservoirs d'eau chaude à une température minimale de 60 °C est un critère essentiel permettant de réduire la détection de Legionella dans les édifices (OMS, 2011; HSE, 2013b; CNRC 2015b, NAS, 2019). Le CNP spécifie que le stockage de l'eau à des températures inférieures à 60 °C dans des réservoirs et des réseaux de distribution d'eau chaude peut entrainer le développement de Legionella. Le CNP précise par ailleurs que les chauffe-eaux électriques de type réservoir devraient être préréglés à une température de 60 °C en raison du phénomène de stratification qui se produit dans ce type de chauffe-eau. Ce genre de problème ne touche pas les autres types de chauffe-eaux de conception différente qui utilisent divers combustibles (CNRC, 2015b). Il a été aussi recommandé d'ajuster les régimes thermiques pour atteindre une température supérieure à 55 °C aux extrémités des réseaux, afin de réduire efficacement la prolifération de Legionella dans ces derniers (OMS, 2011; HSE, 2013b, NAS, 2019). Les températures de l'eau chaude exigées pour empêcher le développement de Legionella sont associées à des risques élevés de brulures (CNRC, 2015b; NAS, 2019). La mise en œuvre de stratégies de gestion de la température de l'eau devrait respecter la règlementation en vigueur en matière de températures maximales acceptables au robinet. Le Code national de la plomberie précise que les robinets d'eau alimentant les pommeaux de douche et les bains à remous devraient être capable de maintenir une température de sortie d'eau ne dépassant pas 49 °C, de manière à limiter les risques de brulures (CNRC, 2015b). L'élévation temporaire de la température de l'eau ou choc thermique (p. ex. un choc thermique intense à 70 °C pendant 30 minutes) a été utilisé comme mesure de contrôle dans les réseaux de distribution d'eau de bâtiments. Toutefois, l'efficacité de cette procédure est controversée et celle-ci est considérée comme une mesure d'assainissement extrême (NAS, 2019). L'utilisation de techniques de désinfection sur place est également considérée comme s'insérant dans les stratégies de lutte contre les Legionella appliquées aux réseaux de distribution d'eau des grands édifices. Diverses techniques de désinfection (chlore libre, monochloramine, dioxyde de chlore, ionisation du cuivre et de l'argent, lumière UV, ozone, techniques de filtration au point d'utilisation [PU] ou au point d'entrée [PE]) se sont montrées relativement efficaces contre les Legionella (Bentham et coll., 2007; Exner et coll., 2007; US EPA, 2016; Springston et Yocavitch, 2017; NAS, 2019). Les recommandations visant les installations de plomberie des bâtiments préconisent le maintien de concentrations de chlore libre et de monochloramine résiduels respectivement supérieures ou égales à 0,2 mg/l et 1,5 mg/l (Moore et Shelton, 2004; OMS, 2007; HSE, 2014). La mise en œuvre de toute autre stratégie de contrôle nécessite une connaissance approfondie de la complexité des réseaux et de la composition de l'eau et des matériaux dont ils sont constitués (Bartram et coll., 2007; US EPA, 2016; NAS, 2019).
Pour les propriétaires de maison, les recommandations en matière de lutte contre les Legionella dans les habitats individuels préconisent de maintenir une température minimale dans les réservoirs d'eau chaude de 60 °C, conformément aux spécifications du CNP (CNRC 2015b; OMS, 2017; NAS, 2019). Il est utile de sensibiliser les personnes immunodéprimées aux risques possibles présentés par les appareils domestiques générant des aérosols et favorisant le développement de Legionella (p. ex. les humidificateurs et les nébuliseurs) pour les aider à gérer les risques domestiques associés à ces bactéries (NAS, 2019).
Les besoins croissants d'économie d'énergie, d'eau et de matériaux peuvent avoir des conséquences imprévues sur les risques microbiologiques. Il s'agit d'un aspect important dans le cas des Legionella, mais aussi pour les autres agents pathogènes opportunistes pouvant poser problème dans les installations de plomberie domestiques. Des changements dans l'exploitation ou les caractéristiques des réseaux de distribution d'eau requérant l'utilisation d'autres sources d'eau (p. ex. récupération d'eau ou collecte d'eau de pluie), une augmentation du temps de séjour de l'eau, une diminution des débits d'eau et des variations de température dans les réseaux d'eau chaude ou froide des bâtiments peuvent accroitre inopinément le risque de développement de ces agents pathogènes (Bédard et coll., 2016; Rhoads et coll., 2016; NAS, 2019). Il est nécessaire d'étudier davantage les solutions techniques qui pourraient permettre d'uniformiser les efforts visant à réaliser des économies d'énergie et à réduire les risques microbiologiques (Rhoads et coll., 2016; NAS, 2019).
B.2.1.2.6 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence des Legionella dans l'eau potable. Des recommandations et normes visant les Legionella spp. ont été élaborées au Canada et aux US en ce qui a trait à la lutte contre ces organismes dans les réseaux de distribution d'eau des bâtiments, hormis les réseaux municipaux.
B.2.1.3 Mycobacterium spp.
B.2.1.3.1 Description
Le genre Mycobacterium (classe : Actinobacteria) comporte plus de 200 espèces connues. Les bactéries appartenant à ce genre sont variées dans leur capacité à causer des maladies humaines. Certaines sont des agents pathogènes stricts, tandis que d'autres sont non pathogènes ou responsables d'infections non opportunistes. La tuberculose et la lèpre sont deux maladies causées par des espèces de Mycobacterium. Cependant, ces espèces ne présentent pas de risques pour l'eau potable. Les mycobactéries qui préoccupent les fournisseurs d'eau potable sont des espèces communément appelées mycobactéries non tuberculeuses (MNT).
Les MNT regroupent plus de 150 espèces distinctes, considérées comme des agents pathogènes humains opportunistes (Falkinham, 2016a, b). Les membres du complexe Mycobacterium avium - qui comporte M. avium et ses sous-espèces, M. intracellulare et M. chimaera - sont des organismes le plus souvent associés à des maladies humaines. D'autres espèces pertinentes sur le plan médical sont M. abscessus, M. chelonae, M. fortuitum, M. gordonae, M. kansasii, M. malmoense et M. xenopi (Nichols et coll., 2004; Hoefsloot et coll., 2013; Falkinham, 2016a).
Les mycobactéries sont des bactéries à Gram négatif, aérobies ou microaérophiles, non motiles, en forme de bâtonnets et ne formant pas de spores. Les espèces sont regroupées en bactéries à croissance rapide et à croissance lente, selon le temps qu'elles mettent à former des colonies en milieu de culture (Cangelosi et coll., 2004; Falkinham et coll., 2015b). La plupart des mycobactéries pathogènes sont des bactéries à croissance lente (Cangelosi et coll., 2004). Les mycobactéries peuvent se développer à des températures comprises entre 20 et 45 °C (Cangelosi et coll., 2004; Kaur, 2014). Les températures de développement optimales de chaque espèce varient entre 30 et 45 °C (De Groote, 2004; Stinear et coll., 2004). Ces bactéries sont relativement résistantes à la chaleur et capables de survivre à des températures supérieures à 50 °C (Schulze-Robbecke et Buchholtz, 1992; Falkinham, 2016a). Les mycobactéries peuvent utiliser de nombreuses substances comme sources de nutriments et peuvent survivre sur des substrats très simples (Kaur, 2014). Toutes les mycobactéries possèdent une paroi cellulaire épaisse et riche en lipides qui les rend relativement imperméables aux composés hydrophiles. Cette paroi confère aussi à ces bactéries une résistance accrue aux milieux acides ou alcalins, aux désinfectants et aux antibiotiques.
B.2.1.3.2 Effets sur la santé
Les espèces de MNT causent un certain nombre de maladies humaines différentes, dont des infections pulmonaires, l'adénopathie cervicale (c.-à-d. une infection des ganglions lymphatiques du cou) et des infections de la peau et des tissus mous, du sang et du tube digestif. Les MNT provoquent rarement des maladies chez les personnes saines. Les infections surviennent chez les sujets immunodéprimés ou atteints d'affections respiratoires sous-jacentes.
Les maladies pulmonaires sont les formes pathologiques les plus courantes associées aux MNT. Elles se manifestent par de la toux, une asthénie et des sueurs nocturnes. Le taux d'attaque et le délai d'apparition des symptômes demeurent inconnus. Au diagnostic, l'infection peut être difficile à distinguer d'une maladie respiratoire générale et les patients peuvent présenter un long historique de symptômes (p. ex. des mois à des années) avant de recevoir un diagnostic positif de maladie causée par des mycobactéries (Falkinham et coll., 2015b). Les groupes les plus à risque d'infections pulmonaires lies aux MNT sont : les humains âgés fumeurs ou alcooliques de longue date ou présentant des lésions pulmonaires associées à une exposition professionnelle à des poussières; les femmes grandes, minces et âgées sans facteurs de risque notables; et les personnes atteintes d'affections pulmonaires chroniques (p. ex. la mucoviscidose, le cancer du poumon et la maladie pulmonaire obstructive chronique) (Falkinham, 2015c; Adjemian et coll., 2018).
L'adénopathie cervicale causée par les MNT se traduit par un gonflement des ganglions lymphatiques de la tête ou du cou, la majorité des cas étant observée chez les enfants de 18 mois à 5 ans (Falkinham, 2015c). Chez les personnes immunodéprimées, les infections liées aux MNT peuvent se propager à d'autres parties du corps, comme les articulations, le foie et le cerveau. La bactériémie associée aux MNT est une infection fréquente et potentiellement mortelle chez les individus infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou atteints du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) (Falkinham, 2015c). Les infections de la peau et des tissus mous provoquées par les MNT vont de simples lésions ou nodules cutanés localisés à des ulcérations ou des nécroses généralisées (Percival et Williams, 2014f). M. paratuberculosis, une sous-espèce de M. Avium appartenant aux MNT, est suspectée comme étant une des causes de la maladie de Crohn, bien qu'aucune donnée concluante ne le prouve (Waddell et coll., 2015; 2016). Parmi les facteurs de risque des maladies non pulmonaires liées aux MNT figurent des comorbidités résultant d'un affaiblissement du système immunitaire, comme des troubles immunologiques sous-jacents et l'infection par le VIH.
Les doses infectantes des espèces de MNT restent inconnues (Stout et coll., 2016; Hamilton et coll., 2017; Adjemian et coll., 2018). Les taux de mortalité associés à des cas de maladies causées par les MNT sont mal connus (Adjemian et coll., 2018). Aux US, le taux de mortalité global associé aux maladies causées par les MNT a été estimé à 2,3 morts pour 1 million d'habitants par an (Vinnard et coll., 2016).
La prévalence des maladies associées aux mycobactéries non tuberculeuses au Canada est inconnue, car ce ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire. En Ontario, le taux annuel de maladies liées aux MNT a été estimé à 9,7 à 10,7 cas pour 100 000 habitants sur la période 2006-2010 (Marras et coll., 2013). Les infections associées aux MNT ne sont des maladies à déclaration obligatoire que dans un petit nombre d'états (Donohue et Wymer, 2016; Adjemian et coll., 2018). Le taux annuel moyen de cas d'infection par les MNT dans cinq états où la maladie est déclarée (Maryland, Mississippi, Missouri, Ohio et Wisconsin) est compris entre 8,7 et 13,9 cas pour 100 000 habitants sur la période 2008-2013 (Donohue et Wymer, 2016). Des données semblent indiquer que la prévalence des maladies liées aux MNT est en constante augmentation en Amérique du Nord et dans d'autres pays du monde (Donohue et Wymer, 2016; Stout et coll., 2016, Adjemian et coll., 2018). Les données sur les maladies non pulmonaires associées aux MNT sont relativement plus limitées. Les taux d'incidence estimés des maladies non pulmonaires aux États-Unis varient entre 1,5 et 1,9 cas pour 100 000 habitants (Henkle et coll., 2017, Adjemian et coll., 2018). Il existe peu de données sur les répercussions des facteurs liés aux saisons ou au climat sur les infections par les MNT (Falkinham, 2004; Adjemian et coll., 2018).
Ces dernières résistent à de nombreux antibiotiques couramment utilisés. Le traitement habituel de ces maladies nécessite une combinaison d'antibiotiques, parmi lesquels la clarithromycine, l'arithromycine et la rifampine (Percival et Williams, 2014f; Falkinham, 2015c, Halstrom et coll., 2015).
B.2.1.3.3 Sources et exposition
Les mycobactéries non tuberculeuses sont naturellement présentes dans le sol et les habitats aquatiques, tels que les eaux marines, les lacs, les rivières, les ruisseaux, les eaux souterraines et les marais. Les sols, en particulier les sols acides et riches en tourbe sont les principaux réservoirs de ces bactéries (Falkinham, 2016b). Les boues d'eaux usées et d'égouts peuvent contenir d'importantes quantités de MNT (Radomski et coll., 2011; Percival et Williams, 2014f). Celles-ci ont comme autres habitats principaux les systèmes d’eau artificiels et industriels (réseaux d'approvisionnement en eau potable et installations de plomberie) et les installations situées en aval de ces derniers ou les dispositifs utilisant de l'eau, lesquels fournissent aux bactéries des nutriments, des températures optimales et des conditions de protection contre les désinfectants leur permettant de se proliférer. Les caractéristiques des mycobactéries qui font qu'elles sont parfaitement adaptées pour vivre dans ces environnements sont leur capacité à se développer en présence de faibles quantités de nutriments et d'oxygène, leur résistance aux désinfectants, leur thermorésistance et leur capacité à survivre et à se développer dans des biofilms et des protozoaires libres (Falkinham, 2015a). À l'instar des Legionella spp., les mycobactéries pathogènes se transmettent de l'eau à l'air (Percival et Williams, 2014f; Falkinham 2015c). Par conséquent, les pièces d'eau ou dispositifs utilisant de l'eau qui génèrent des aérosols constituent des sources potentielles d'exposition de l'humain à ces bactéries par inhalation (Falkinham, 2015c; 2016b). Des MNT ont été isolées dans de nombreuses pièces et réseaux d'eau, dont des installations de plomberie d'hôpitaux ou de maisons (réseaux de distribution d'eau chaude ou froide), des robinets, des pommeaux de douche, des bains à remous, des distributrices de glace, des nébuliseurs chauffés et des piscines (Percival et Williams, 2014f; Nichols et coll., 2004).
L'inhalation d'aérosols contenant des mycobactéries est la principale voie de transmission des maladies pulmonaires à MNT (Percival et Williams, 2014f; Falkinham, 2015c; Halstrom et coll., 2015). L'ingestion d'eau contaminée ou le contact avec celle-ci sont aussi connus comme étant des voies de transmission d'autres maladies à MNT liées à l'eau (Percival et Williams, 2014f; Falkinham, 2015c; Falkinham et coll., 2015a). Bien que les mycobactéries non tuberculeuses proviennent principalement de sources contamination liées à l'environnement, il a été proposé que la transmission entre personnes (par l'intermédiaire d'objets contaminés) pouvait constituer un mode de contamination présentant un risque pour les personnes atteintes de mucoviscidose (Bryant et coll., 2013; Bryant et coll., 2016, Sood et Parrish, 2017). M. avium ssp. paratuberculosis se transmet par voie oro-fécale chez les bovins. Cependant, le rôle pathogène de cet organisme dans les maladies humaines et les sources possibles de contamination font l'objet d'âpres débats (Harris et Barrletta, 2001; Waddell et coll., 2016).
Les eaux souterraines contiennent généralement de plus faibles quantités de mycobactéries non tuberculeuses que les eaux de surface (Falkinham, 2015c). Toutefois, ces organismes peuvent être aussi présents et en concentrations similaires dans les réseaux de distribution municipaux utilisant de l'eau souterraine ou de surface (Covert et coll., 1999; Lu et coll., 2015b). Des études portant sur la présence de mycobactéries non tuberculeuses dans des échantillons d'eau prélevés dans des réseaux de distribution chlorés ou chloraminés ont permis de détecter ces organismes dans 40 à 100 % des sites d'échantillonnage à l'aide de méthodes PCR (Wang et coll., 2012a; Thomson et coll., 2013; Whiley et coll., 2014; Lu et coll., 2015a).
Les mycobactéries non tuberculeuses sont souvent détectées dans les échantillons de biofilm et d'eau du robinet prélevés dans des installations de plomberie domestiques alimentés par des réseaux de distribution d'eau potable municipaux (Feazel et coll., 2009; Holinger et coll., 2014). Les circuits de plomberie domestiques peuvent héberger de plus grandes populations de mycobactéries dans l'eau libre et les biofilms que celles observées dans les réseaux principaux de distribution d'eau (Hilborn et coll., 2006). Des données laissent croire que ces organismes sont moins abondants dans les habitations alimentées en eau par des puits privés (Gebert et coll., 2018). Des études s'intéressant à des maisons alimentées par un réseau municipal ont permis de détecter des Mycobacterium spp. et des M. avium respectivement dans 70 à 85 % et 7 à 57 % d'échantillons de biofilm prélevés sur des robinets et des pommeaux de douche (Feazel et coll., 2009; Wang et coll., 2012a; Lande et coll., 2019). Il est constaté que les taux de contaminations par des mycobactéries non tuberculeuses sont plus élevés dans les bâtiments dotés de boucles de recirculation d'eau chaude (p. ex. les hôpitaux, les condominiums et les immeubles d'appartements) que dans les habitats individuels (Falkinham, 2015b; Li et coll., 2017).
Une grande variété de mycobactéries non tuberculeuses peuvent être isolées à partir des sources d'eau potable. Néanmoins, l'importance de chaque espèce d'un point de vue clinique varie et peut différer selon les endroits du monde. Il est difficile d'établir des liens épidémiologiques avec les réservoirs de ces bactéries dans l'environnement et peu d'études sont parvenues à faire correspondre des isolats de patients avec des souches décelées dans de l'eau potable (Halstrom et coll., 2015; Li et coll., 2017). Lande et ses collègues (2019) ont fait appel à des techniques moléculaires sophistiquées pour faire correspondre des souches de M. avium provenant d'échantillons respiratoires de patients atteints de maladie pulmonaire causée par M. Avium et d'échantillons prélevés sur des circuits de plomberie domestique. Cela a clairement montré que ces derniers pouvaient constituer une source d'infection pour les individus vulnérables. Les MNT sont ubiquitaires dans l'environnement et les risques d'infection humaine dépendent de l'interaction entre plusieurs facteurs environnementaux liés aux microorganismes et aux personnes infectées (Halstrom et coll., 2015). Les données scientifiques actuelles montrent que la présence de mycobactéries non tuberculeuses dans les réseaux de distribution d'eau domestiques ne suffit par à prouver que les usagers de ces réseaux présentent un risque particulier de tomber malade (Halstrom et coll., 2015; Adjemian et coll., 2018).
Les éclosions de maladies non associées aux MNT en Amérique du Nord ont été en grande partie causées par des expositions à de l'eau à usage récréatif et par des soins de santé (Hlavsa et coll., 2018; Sood et Parrish, 2017). Aucune éclosion de maladies liées à la contamination de l'eau potable par des MNT n'a été observée au Canada ou aux États-Unis (CDC, 2013c 2015; 2017d).
B.2.1.3.4 Méthodes d'analyse
Des méthodes d'isolation et de détection basée sur la culture des Mycobacterium spp. prélevés dans l'eau potable ont été décrites. Cependant, mais il n'existe actuellement aucune méthode d'analyse normalisée (APHA et coll., 2017). Les genres et espèces des isolats peuvent être identifiés à l'aide de méthodes PCR ou par séquençage de l'ADN (Stinear et coll., 2004; Falkinham, 2015c). L'identification des sous-espèces et des souches nécessite l'utilisation de techniques moléculaires plus avancées (Stinear et coll., 2004; Falkinham, 2015c). La littérature fournit des renseignements détaillés sur des méthodes spécifiques (Stinear et coll., 2004; Wang et coll., 2017).
B.2.1.3.5 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - permettent de réduire le nombre de mycobactéries présentes dans l'eau potable (LeChevallier et coll., 2001; Le Dantec et coll., 2002; LeChevallier, 2004). Cependant, des caractéristiques spécifiques des mycobactéries, telles que leur hydrophobie et leur charge superficielle, influent de différentes manières sur les procédés de traitement (LeChevallier, 2004; Wong et Shin, 2014). En raison de leur paroi cellulaire très hydrophobe, les mycobactéries ont une forte tendance à se fixer à des particules (LeChevallier, 2004). Des corrélations entre l'abaissement de la turbidité et l'élimination des mycobactéries ont été mises en évidence (Falkinham et coll., 2001; Wong et Shin, 2014). L'utilisation de filtres à CAG peut offrir des conditions (accumulation de nutriments et neutralisation des désinfectants résiduels) favorisant le développement des mycobactéries (Le Dantec et coll., 2002; LeChevallier, 2004).
Ces bactéries sont très résistantes aux désinfectants chimiques couramment utilisés. Pour inactiver les espèces de mycobactéries non tuberculeuses (dont Mycobacterium avium) (Taylor et coll., 2000; Jacangelo et coll., 2002; Le Dantec et coll., 2002), il se peut que :
- les valeurs de CT pour le chlore soient supérieures à celles exigées pour les Giardia, mais inférieures à celles applicables aux Cryptosporidium; et
- les valeurs de CT pour les chloramines (monochloramine), le dioxyde de chlore et l'ozone soient inférieures à celles requises pour les Giardia et Cryptosporidium.
Les différentes espèces et souches présentes des sensibilités aux désinfectantes très variables (Taylor et coll., 2000; OMS, 2004) et les valeurs de CT observées diffèrent selon les chercheurs (OMS, 2004). Jacangelo et se collègues (2002) ont observé que l'inactivation des Mycobacterium fortuitum nécessitait des valeurs de CT pour l'ozone égales ou supérieures à celles requises pour les Cryptosporidium.
Les doses d'UV nécessaires pour inactiver les organismes du complexe Mycobacterium avium peuvent s'avérer supérieures à celles exigées pour les Giardia et Cryptosporidium et comparables à celles applicables à certains virus entériques. Il a été constaté que l'inactivation de certaines souches de M. avium et M. fortuitum nécessitait des doses d'UV comparables à celles requises pour les adénovirus (gerba et coll., 2003; Schiavano et coll., 2018).
Même en présence d'un traitement et d'une désinfection efficaces, les mycobactéries non tuberculeuses présentent une forte tolérance à la désinfection et peuvent s'infiltrer dans les réseaux de distribution et les circuits de plomberie en faibles quantités. Des études à échelle réelle laissent croire que le chlore libre est plus efficace que la monochloramine comme désinfectant secondaire pour réduire la prolifération des mycobactéries dans les installations de plomberie des bâtiments (Pryor et coll., 2004; Wang et coll., 2012a; Rhoads et coll., 2017). La monochloramine peut permettre de limiter davantage la formation de biofilms sur certains matériaux constituant les canalisations, comme les surfaces en fer rouillées (Norton et coll., 2004).
Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance visant à limiter la survie et le développement de microbes dans les réseaux distribution d'eau potable et les installations de plomberie, décrites dans la partie A, sont importantes pour empêcher le développement de Mycobacterium spp. dans l'eau (Falkinham et coll., 2015 a, 2015b). Des documents d'orientation recommandent l'utilisation de plans de gestion de l'eau et de sécurité sanitaire de l'eau pour prévenir le développement de mycobactéries dans les réseaux de distribution d'eau des bâtiments (OMS, 2007). Des ressources offrant des renseignements à l'intention des gestionnaires d'édifices sont disponibles (OMS, 2007; 2011). Dans les établissements de soins de santé, la lutte contre les mycobactéries s'insèrera dans des plans de gestion visant à réduire les risques associés aux Legionella (Ford et coll., 2004). Cependant, il faut reconnaitre que les mycobactéries et les Legionella présentent des sensibilités différentes aux désinfectants utilisés dans l'eau potable (Jacangelo et coll., 2002, Pryor et coll., 2004; Moore et coll., 2006b).
Des stratégies supplémentaires de lutte contre les mycobactéries ont été décrites et ont consisté en des désinfections par surébullition et rinçage à l'eau chaude à des températures supérieures à 50 à 70 °C, en l'application de diverses méthodes de désinfection (hyperchloration au chlore libre et emploi du dioxyde de chlore) et en l'utilisation de techniques de filtration sur membrane au point d'utilisation (LeChevallier, 2004; Sebakova et coll., 2008; Williams et coll., 2011; Hsu et coll., 2016). Entre autres mesures s'inscrivant dans un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, il est aussi recommandé de procéder au nettoyage et à l'entretien réguliers des pièces d'eau et des dispositifs utilisant de l'eau qui génèrent des aérosols (robinets, pommeaux de douche, bains à remous et tours de refroidissement) (Ford et coll., 2004).
Pour les propriétaires de maisons, il a été recommandé de maintenir la température des réservoirs d'eau chaude à des valeurs conformes aux spécifications du CNP en matière de lutte contre les Legionella (c.-à-d. 60 °C minimum) (CNRC, 2015b) dans le cadre d'une stratégie générale visant à réduire au minimum les risques d'exposition à des agents pathogènes opportunistes dans les installations de plomberie domestiques (OMS, 2011; Falkinham et coll., 2015a, 2015b; NAS, 2019).
B.2.1.3.6 Contexte international
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence de Mycobacterium spp. dans l'eau potable.
B.2.1.4 Pseudomonas spp.
B.2.1.4.1 Description
Le genre Pseudomonas (classe : Gammaproteobacteria) comprend plus de 30 espèces (Chakravarty et Anderson, 2015). Pseudomonas aeruginosa, l'espèce la plus pertinente sur le plan clinique est un agent pathogène opportuniste pouvant causer diverses infections chez l'humain (Chakravarty et Anderson, 2015; Daniels et Gregory, 2015). D'autres espèces (P. fluorescens, P. putida et P. stutzeri) ont été rarement observées dans des infections humaines (Chakravarty et Anderson, 2015).
Les Pseudomonas spp. sont des bactéries à Gram négatif, aéorobies strictes, motiles en forme de bâtonnets droits ou légèrement incurvés, qui se développent à des températures comprises entre 4 et 42 °C (températures optimales : 28 à 37 °C) (Moore et coll., 2006a; Chakravarty et Anderson, 2015). Elles possèdent un métabolisme versatile et sont capables d'utiliser de nombreuses substances comme sources de nutriments et de survivre avec peu de nutriments (Chakravarty et Anderson, 2015; Falkinham et coll., 2015a). Les Pseudomonas spp. sont également remarquables par leur capacité à se fixer à des biofilms ou à en former dans les milieux aqueux (Bédard et coll., 2016b).
B.2.1.4.2 Effets sur la santé
P. aeruginosa cause des maladies à la suite de leur prolifération dans l'organisme de patients présentant des facteurs de prédisposition (p. ex. immunodépression, maladie sous-jacente, lésion traumatique ou intervention médicale) les rendant plus vulnérables aux infections (Chakravarty et Anderson, 2015). Les voies respiratoires sont les sites les plus fréquents d'infection humaine. Les symptômes de l'infection à P. aeruginosa sont la fièvre, des frissons, de la toux et une respiration difficile. Leur apparition peut être soudaine et grave (Daniels et Gregory, 2015). Les patients atteints de mucoviscidose sont particulièrement à risque d'infection respiratoire par P. aeruginosa et celles-ci sont une cause majeure de morbidité et de mortalité chez ces individus (Chakravarty et Anderson, 2015). P. aeruginosa est une cause principale d'infections touchant la peau, les yeux, les oreilles et l'appareil urinaire (Chakravarty et Anderson, 2015; Daniels et Gregory, 2015). Les bactériémies résultant d'infections des poumons, de la peau ou de l'appareil urinaire peuvent se traduire par une propagation des bactéries à d'autres parties du corps. Des taux de mortalité élevés ont été observés chez des individus très vulnérables atteints d'une septicémie liée à P. aeruginosa (Chakravarty et Anderson, 2015; Daniels et Gregory, 2015). Les individus à risque élevé d'infections sont les personnes : immunodéprimées (p. ex. les patients atteints de neutropénie ou du VIH ou du SIDA); présentant des maladies sous-jacentes (mucoviscidose, diabète, maladie pulmonaire chronique); recevant des soins utilisant des dispositifs effractifs (cathéters vasculaires et urinaires, respirateur artificiel, tubes endotrachéaux); ou ayant des défenses immunitaires affaiblies à la suite de brulures ou de traumatismes par pénétration (incisions chirurgicales, plaies) (Daniels et Gregory, 2015). Les doses de P. aeruginosa pouvant provoquer une infection par les différentes voies de transmission sont mal connues (Roser et coll., 2014). Les infections par P. aeruginosa chez les personnes saines sont rares.
Les infections par Pseudomonas ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire en Amérique du Nord et dans la plupart des pays du monde. La vaste majorité des cas ou éclosions de maladies liées à P. aeruginosa ont été associés à des hôpitaux ou à un usage récréatif de l'eau dans des installations contenant de l'eau traitée (p. ex. des bains à remous et des piscines) (CDC, 2013b; Falkinham et coll., 2015a; Hlavsa et coll., 2018).
Le traitement des infections par P. aeruginosa est difficile en raison de l'antibiorésistance accrue de ces bactéries (Falkinham et coll., 2015a). Certaines souches se sont avérées résistantes à tous ou presque tous les antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, les fluoroquinolones et les carbapénèmes de dernière génération (CDC, 2013a). P. aeruginosa multirésistante a été classée comme étant des menaces graves par les CDC et comme devant faire l'objet d'une gestion prioritaire des risques par l'ASPC (CDC, 2013a; Garner et coll., 2015). P. aeruginosa résistante aux carbapénèmes en particulier a été considérée par l'OMS comme des cibles prioritaires dans la conception de nouveaux traitements antibiotiques (OMS, 2017).
B.2.1.4.3 Sources et exposition
Les Pseudomonas spp. sont des bactéries ubiquitaires, présentes dans une grande variété d'habitats, notamment le sol, les milieux aquatiques (eau de surface douce ou marine, eaux souterraines, sources d'eau potable) et la végétation (Falkinham et coll., 2015a; Degnan, 2006). Les matières fécales humaines et animales ne sont pas des sources importantes de ces bactéries. Cependant, celles-ci sont présentes en grand nombre dans les eaux d'égout et les eaux usées (Degnan, 2006). Les habitats des P. aeruginosa sont les réseaux de distribution d'eau et les installations ou dispositifs situés en aval de ces derniers qui fournissent aux bactéries des conditions (nutriments, température optimale, protection contre les désinfectants) leur permettant de proliférer (Bédard et coll., 2016b). Les réseaux d'approvisionnement en eau des hôpitaux et d'autres établissements de soins de santé sont des sources importantes de P. aeruginosa (Bédard et coll., 2016b). Des réservoirs confirmés situés dans ces établissements sont les robinets d'eau potable, les conduits d'évacuation des lavabos et douches, les humidificateurs, les bains chauds et les bassins d'hydrothérapie et de baignade (Falkinham, 2015a; Bédard et coll., 2016b). Dans les établissements communautaires, les bains à remous et les piscines peuvent aussi constituer d'importantes sources d'infection (Bédard et coll., 2016b).
P. aeruginosa peut se transmettre par contact entre personnes ou contact direct avec des objets ou de l'eau contaminés (Falkinham, 2015a; Bédard et coll., 2016b). La consommation d'eau potable n'est pas considérée comme un mode d'infection (Bédard et coll., 2016b).
Des études utilisant des méthodes de détection moléculaires et basées sur la culture des bactéries ont permis de découvrir que P. aeruginosa était détectée sporadiquement dans des échantillons d'eau et de sédiments prélevés sur des réseaux de distribution d'eau potable (Wingender et Flemming, 2004; Van der Wielen et Van der Kooij, 2013; Lu et coll., 2015a, 2015b) et pouvaient être plus fréquemment détectée dans des échantillons provenant d'installations de plomberie domestiques (Reuter et coll., 2002; Rogues et coll., 2007; Lavenir et coll., 2008; Van der Wielen et Van der Kooij, 2013; Charron et coll., 2015). Il est suggéré que le développement de populations de P. aeruginosa dans des biofilms se formant dans les circuits de plomberie domestiques ou des dispositifs au PU explique la détection de plus grandes quantités de ces bactéries dans ces échantillons (Bédard et coll., 2016b). L'ingestion d'amibes libres, telles que Acanthamoeba spp. (voir B.3.2.1) peut également contribuer à la survie et au développement de P. aeruginosa dans les réseaux de distribution d'eau potable et les installations de plomberie domestiques (Bédard et coll., 2016b). Aucune éclosion liée à la contamination de l'eau potable par des P. aeruginosa n'a encore été consignée (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d).
B.2.1.4.4 Méthodes d'analyse
Des méthodes standards de détection des Pseudomonas spp. dans l'eau potable sont disponibles (APHA et coll., 2017; ISO, 2019). La littérature fournit aussi des renseignements détaillés sur certaines méthodes (Wang et coll., 2017). Les Pseudomonas spp. sont des bactéries hétérotrophes détectées par NPBH. Cependant, il n'existe aucune corrélation directe entre les résultats de la NPBH et les concentrations de Pseudomonas aeruginosa.
B.2.1.4.5 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les méthodes d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - et de désinfection - basées sur l'utilisation de chlore, de chloramines ou de monochloramine, de dioxyde de chlore, d'ozone ou d'UV - couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable s'avèrent très efficaces pour éliminer ou inactiver P. aeruginosa (LeChevallier et Au., 2004; Clauβ, 2006; Xue et coll., 2013; Behnke et Camper, 2012, Zuma et coll., 2009; Garvey et coll., 2014; Zhang et coll., 2015). Pour l'inactivation de P. aeruginosa, les exigences en matière de CT pour le chlore et la monochloramine (chloramine) sont inférieures à celles requises pour l'inactivation des nombreux virus entériques et les exigences concernant les doses d'UV sont inférieures à celles applicables aux protozoaires entériques Giardia et Cryptosporidium (Clauβ, 2006; Xue et coll., 2013; Santé Canada, 2019c).
Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance visant à limiter la survie et le développement de microbes dans les réseaux de distribution d'eau potable et les installations de plomberie, décrites dans la partie A, sont essentielles pour empêcher le développement des Pseudomonas spp. dans l'eau (Falkinham et coll., 2015a; Bédard et coll., 2016b). La résistance à la chloration varie selon les souches et les effets protecteurs offerts par les biofilms (Bédard et coll., 2016; Mao et coll., 2018). Des études de laboratoire et pilotes semblent indiquer que le maintien de concentrations de chlore libre résiduel au-dessus de 0,3 mg/l est utile pour empêcher le développement de Pseudomonas spp. dans l'eau libre (Wang et coll., 2012b; Mao et coll., 2018). Mao et ses collègues (2018) ont mis en évidence qu'une exposition continue et de longue durée à une concentration efficace de chlore résiduel est importante pour prévenir la réapparition de Pseudomonas et le développement de nouvelles souches résistantes. Il est nécessaire d'étudier davantage les effets des désinfectants à base de chlore sur P. aeruginosa dans l'eau des circuits de plomberie domestiques et les biofilms (Bédard et coll., 2016).
Des plans de gestion de l'eau et de la sécurité sanitaire de l'eau sont recommandés pour limiter l'apparition de Pseudomonas aeruginosa dans les réseaux de distribution d'eau des bâtiments (OMS, 2011). D'autres stratégies reposant sur des mesures de préventions applicables aux hôpitaux et établissements de soins de santé ont été décrites, qui consistent en des désinfections par surébullition et rinçage à l'eau chaude à des températures supérieures à 50 à 70 °C et en l'utilisation de techniques de filtration sur membrane au PU (Falkinham et coll., 2015a; Bédard et coll., 2016b).
Pour les propriétaires de maisons, aucune mesure n'est considérée comme nécessaire pour réduire leurs risques d'être infectés par P. aeruginosa. Toutefois, ces personnes peuvent réduire au minimum leur risque d'exposition aux agents pathogènes opportunistes d'origine hydrique en maintenant la température de leur réservoir d'eau chaude à 60 °C minimum (OMS, 2011; Falkinham et coll., 2015a, 2015b).
B.2.1.5.6 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence de P. aeruginosa dans l'eau potable. Des recommandations et normes visant les Pseudomonas spp. ont été élaborées au Canada et aux US en ce qui a trait à la lutte contre ces organismes dans les systèmes d’approvisionnement en eau des bâtiments, hormis les réseaux de distribution municipaux.
B.2.2 Protozoaires
B.2.2.1 Acanthamoeba spp.
B.2.2.1.1 Description
Les Acanthamoeba spp. sont des amibes libres souvent présentes dans le sol et les milieux aquatiques. Ce sont des agents pathogènes opportunistes qui peuvent provoquer des maladies rares mais graves touchant les yeux, la peau, les poumons, le cerveau et le système nerveux central (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014a). Les espèces d'Acanthamoeba ont été classées à l'origine selon leur morphologie à différents stades du développement (p. ex. les cystes - voir ci-dessous). Néanmoins, le génotypage est fréquemment utilisé pour classer les différents membres du genre (Visvesvara et coll., 2007; Juárez et coll., 2018). Environ 20 génotypes différents d'Acanthamoeba ont été identifiés en fonction des différences de séquence (Juárez et coll., 2018). Le génotype d'Acanthamoeba T4 est le plus fréquent dans les cas de maladie et dans l'environnement. Cependant, d'autres génotypes ont été associés à des maladies (Chalmers, 2014a; Juárez et coll., 2018). Les Acanthamoeba spp. sont pertinentes d'un point de vue microbiologique en raison de leur capacité à héberger certains microorganismes pathogènes dans les réseaux de distribution d'eau potable.
Les Acanthamoeba spp. ont de faibles besoins en nutriments et se développent à des températures comprises entre 12 et 45 °C (température optimale : 30°C) (Chalmers, 2014a). Leur cycle de vie comprend deux étapes : un stade d'alimentation appelé trophozoïte (25 à 40 µm) et un stade de cyste résistant (10 à 30 µm) qui peut supporter des températures comprises entre -20 et 56 °C et résister à la dessiccation et à la désinfection (Chalmers, 2014a; Juárez et coll., 2018).
B.2.2.1.2 Effets sur la santé
Les infections par les Acanthamoeba sont rares dans la population générale (Visvesvara et coll., 2007; Juárez et coll., 2018). La kératite à Acanthamoeba (KA) est la forme pathologique la plus commune (Juárez et coll., 2018) associée à cet organisme. Les premiers symptômes de la KA sont une vision floue, une douleur intense et photosensibilité touchant habituellement un seul œil (Chalmers, 2014a; Juárez et coll., 2018). Dans les cas avancés et graves de la maladie, les symptômes comportent également une ulcération de la cornée, un gonflement de l'œil, une cataracte et la cécité (Juárez et coll., 2018). La KA apparait lentement, prenant des jours voire des semaines à se développer à la suite d'une infection, et évoluant lentement vers une forme plus grave (Köhsler et coll., 2016, Juárez et coll., 2018). Dans les pays industrialisés, la KA touche principalement les individus porteurs de lentilles de contact (Chalmers, 2014a). Les personnes à risque d'exposition élevé sont celles qui conservent, nettoient ou désinfectent leurs lentilles avec de l'eau du robinet non stérile et celles qui nagent et utilisent des bains à remous ou des douches en portant des lentilles de contact (Chalmers, 2014a; Juárez et coll., 2018). Dans une minorité des cas de KA non associés au port de lentilles de contact, les infections sont généralement dues à un traumatisme oculaire ou à une contamination dans l'environnement (Chalmers, 2014a).
D'autres manifestations de maladies associées à l'Acanthamoeba sont les infections disséminées touchant d'abord la peau ou les poumons et pouvant se propager ensuite à d'autres parties du corps, comme les reins et les glandes surrénales et l'encéphalite amibienne granulomateuse (EAG), une maladie mortelle qui survient quand l'infection atteint le cerveau et le système nerveux central (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014a). Il s'agit de formes très rares de maladie, qui touchent principalement les individus immunodéprimés ou atteints de maladies sous-jacentes (p. ex. les personnes atteintes du VIH ou du SIDA, de cancer, de diabète, d'hépatopathie ou subissant une chimiothérapie ou une transplantation d'organe) (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014a; Guimaraes et coll., 2016). La dose d'Aeromonas spp. minimale causant une infection demeure inconnue.
Bien que l'organisme soit très répandu dans les milieux aquatiques, le nombre de cas de maladie liés aux Acanthamoeba spp. est faible. Le taux d'incidence estimé de la KA dans les pays développés est d'un à 33 cas pour un million de personnes porteuses de lentilles de contact (CDC, 2017b). Le traitement de la KA est compliqué, car les cystes sont résistants à la plupart des antimicrobiens aux concentrations tolérées par l'œil humain (Juárez et coll., 2018). Un traitement prolongé combinant plusieurs médicaments est nécessaire (Visvesvara et coll., 2007).
B.2.2.1.3 Sources et exposition
Les Acanthamoeba spp. sont ubiquitaires dans le sol et dans l'eau partout dans le monde. Elles sont l'une des amibes libres les plus communes présentes dans l'environnement (Visvesvara et coll., 2007; Juárez et coll., 2018). Les amibes ont été isolées dans un très grand nombre de milieux naturels et artificiels, dont le sol, la boue, les eaux douces et saumâtres, les piscines, les bains à remous, les tours de refroidissement, les humidificateurs, les appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, l'eau potable et les poussières en suspension dans l'air (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014a).
L'importance relative de l'eau comme mode d'infection n'est pas claire. La présence ubiquitaire d'Acanthamoeba dans l'environnement rend difficile la détermination des sources d'infection. L'ingestion ou l'inhalation d'eau contaminée ne sont pas considérées comme des voies de contamination (Chalmers, 2014a). Aucune éclosion de KA survenue à la suite d'une exposition à de l'eau potable n'a été observée en Amérique du Nord (Kilvington et coll., 2004; Craun et coll., 2010; Yoder et coll., 2012b). Des cas de KA ont été associés à l'utilisation d'eau du robinet non stérile dans la préparation de solutions pour lentilles de contact (Visvesvara et coll., 2007). Il semblerait que les infections disséminées et l'EAG causés par les Acanthamoeba spp. ne soient pas d'origine hydrique (Chalmers, 2014a).
Les Acanthamoeba spp. peuvent être fréquemment détectées dans les réseaux de distribution d'eau potable en Amérique du Nord et dans le monde (Magnet et coll., 2012; Lu et coll., 2015a, 2015b; Qin et coll., 2017). La reprise du développement de Acanthamoeba spp. peut se produire dans les biofilms et les dépôts non fixés dans les réseaux de distribution d'eau potable et les circuits de plomberie domestiques (Thomas et Ashbolt, 2011; Wang et coll., 2012a; Qin et coll., 2017).Aux US, des Acanthamoeba spp. ont été détectées par PCR dans 40 à 63 % d'échantillons de sédiments de réservoirs d'eau municipaux (Lu et coll., 2015b; Qin et coll., 2017).
Les Acanthamoeba spp. peuvent servir d'hôtes à des microorganismes pathogènes résistants aux amibes, en offrant à ces derniers des conditions (nutriments, protection contre les stress environnementaux) essentielles à leur survie, leur prolifération et leur transport (Thomas et Ashbolt, 2011). Il a été suggéré que la virulence des microorganismes résistants aux amibes était améliorée par les protozoaires infectieux (Visvesvara et coll., 2007; Thomas et Ashbolt, 2011; Chalmers, 2014a). Les bactéries pathogènes isolées à partir des Acanthamoeba spp. sont Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Helicobacter pylori, les sérotypes O157 d'Escherichia coli, Listeria monocytogenes, les Pseudomonas spp. et Vibrio cholerae (Visvesvara et coll., 2007; Juárez et coll., 2018). Les Acanthamoeba spp. peuvent aussi héberger des protozoaires, des mycètes et des virus (Köhsler et coll., 2016; Juárez et coll., 2018). Il est nécessaire d'investiguer davantage sur les conséquences des interactions entre les espèces d'amibes libres et les microorganismes pathogènes résistants aux amibes dans l'eau potable (Thomas et Ashbolt, 2011).
B.2.2.1.4 Méthodes d'analyse
Aucune méthode normalisée n'a été mise au point pour détecter et identifier les Acanthamoeba spp. présentes dans l'eau potable. Les procédures d'isolation des Acanthamoeba dans des échantillons d'eau consistent en une concentration par filtration sur membrane ou centrifugation, un tri sur plaque et une identification à l'aide de méthodes moléculaires (Chalmers, 2014a). La littérature fournit des renseignements détaillés sur certaines méthodes (Wang et coll., 2017).
B.2.2.1.5 Traitements
Les cystes d'Acanthamoeba sont plus gros que ceux des Giardia et que les oocystes de Cryptosporidium (Chalmers, 2014a; Santé Canada, 2019d). Les mécanismes d'élimination physique utilisés durant le traitement de l'eau potable sont donc censés éliminer ces cystes. Les cystes sont très résistants aux désinfectants fréquemment utilisés et aux UV (Loret et coll., 2008; Hijnen et coll., 2011). Pour l'inactivation des cystes de Acanthamoeba spp., la valeur de CT pour le chlore libre est supérieure à celle requise pour les Giardia, mais inférieure à celle observée pour les Cryptosporidium et les valeurs de CT pour le dioxyde de chlore et l'ozone sont supérieures à celle observée pour ces deux organismes (Loret et coll., 2008). Les exigences en matière de dose d'UV pour l'inactivation des cystes d'Acanthamoeba spp. sont similaires à celles requises pour les adénovirus (Hijnen et coll., 2011; Santé Canada, 2019c).
Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance essentielles pour limiter la survie et le développement d'agents pathogènes d'origine hydrique, dont les Acanthamoeba spp., dans les réseaux de distribution d'eau potable et les installations de plomberie sont décrites dans la partie A (Chalmers, 2014a; Ashbolt, 2015). Dans le cadre d'un plan général de gestion de l'eau dans les bâtiments généraux, les gestionnaires de réseaux d'eau de bâtiments peuvent mettre en œuvre des opérations de nettoyage et maintenance réguliers des pièces d'eau et dispositifs utilisant de l'eau (p. ex. les robinets, les pommeaux de douche, les bains à remous et les tours de refroidissement). La prévention du développement des Acanthamoeba spp. peut s'avérer particulièrement importante dans certaines utilisations de l'eau comme les douches oculaires d'urgence (Chalmers, 2014a).
Aucune mesure spécifique de la part des propriétaires de maison n'est nécessaire. Toutefois, ces personnes peuvent réduire au minimum les risques d'exposition aux agents pathogènes opportunistes d'origine hydrique en maintenant la température de leur réservoir d'eau chaude à 60 °C minimum (OMS, 2011). Les habitants d'une maison qui portent des lentilles de contact devraient aussi suivre les recommandations des spécialistes en soin des yeux en matière de manipulation, de nettoyage et de port de lentilles de contact (CDC, 2017b).
B.2.2.1.6 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence d'Acanthamoeba spp. dans l'eau potable.
B.2.2.2 Naegleria fowleri
B.2.2.2.1 Description
Les Naegleria fowleri sont des amibes libres pathogènes qui causent la méningoencéphalite amibienne primitive (MAP) chez l'humain, une maladie rare mais presque toujours mortelle. Plus de 40 espèces de Naegleria spp. ont été identifiées. Cependant, il a été prouvé que seule N. fowleri est pathogène pour l'humain (Marciano‐Cabral et Cabral et coll. 2007; Yoder et coll. 2010). Huit génotypes de N. fowleri connus ont été découverts dans le monde et tous sont suspectés d'être pathogènes pour l'humain (Bartrand et coll., 2014; Chalmers, 2014b). Les N. fowleri sont thermophiles, se développent bien à des températures comprises entre 25 et 40 °C (température optimale : 37 °C) et peuvent tolérer des températures supérieures à 50 à 60 °C (Hallenbeck et Brenniman, 1989; Visvesvara et coll., 2007; Zaongo et coll., 2018). Il existe trois stades distincts dans le cycle de vie des N. fowleri : un stade de trophozoïte, un stade intermédiaire flagellé et un stade de cyste résistant (Bartrand et coll., 2014, Chalmers, 2014b). Les cystes sont les formes les plus résistantes de ces bactéries et peuvent survivre à des conditions environnementales hostiles, telles que des températures froides et des milieux offrant peu de nourriture ou de nutriments (Bartrand et coll., 2014; Chalmers, 2014b).
B.2.2.2.2 Effets sur la santé
Les symptômes de la MAP sont cliniquement similaires à ceux d'une méningite bactérienne ou virale et commencent par des maux de tête, de la fièvre, des nausées et des vomissements, pour évoluer ensuite en une raideur de la nuque, une altération des facultés mentales, des hallucinations occasionnelles, des crises d'épilepsie et le coma (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014b). Les symptômes apparaissent un à sept jours après l'exposition et la maladie progresse rapidement, la mort survenant généralement au bout de cinq jours (Visvesvara et coll., 2007; Chalmers, 2014b). La MAP a un taux de mortalité extrêmement élevé (supérieur à 97 %) (De Jonckheere, 2011; Capewell et coll., 2015). Parmi les cas documentés aux États-Unis, seuls cinq patients atteints par la maladie y ont survécu (Capewell et coll., 2015). Les infections surviennent lorsque de l'eau contenant N. fowleri pénètre dans les fosses nasales. Les amibes envahissent ensuite les tissus muqueux et se propagent le long du nerf olfactif jusqu'au cerveau, où elles se nourrissent des cellules nerveuses et sanguines, causant une inflammation et des lésions aux cellules, ce qui entraine la mort (Chalmers, 2014b; Siddiqui et coll., 2016). La dose minimale de N. fowleri causant une infection n'est pas bien connue (Bartrand et coll., 2014).
Malgré la présence fréquente de N. fowleri dans les milieux aqueux, la MAP est rare. À partir de 2011, seulement 235 cas de MAP ont été observés dans le monde, la majorité aux US (De Jonckheere, 2011). Les cas de MAP surviennent principalement durant les saisons chaudes. Des maladies sont plus fréquemment contractée par les enfants et les jeunes adultes, catégories de personnes qui s'adonnent le plus à des activités aquatiques (Visvesvara et coll., 2007).
La MAP est difficile à détecter, la plupart des cas progressant si rapidement que le diagnostic n'est établi qu'après la mort des patients (Chalmers, 2014b). Plusieurs médicaments se sont avérés efficaces contre N. fowleri (Capewell et coll., 2015; Siddiqui et coll., 2016) en laboratoire. Cependant, les traitements efficaces sont mal connus (Capewell et coll., 2015; Siddiqui et coll., 2016). Une persistance de l'infection a été mise en évidence chez deux patients qui s'étaient vus administrer des agents microbiens en association et un traitement énergique de leur œdème cérébral (CDC, 2019). L'essai continu de nouvelles thérapies reste nécessaire (Capewell et coll., 2015; Siddiqui et coll., 2016). Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la MAP (Siddiqui et coll., 2016).
B.2.2.2.3 Sources et exposition
N. fowleri est naturellement présent dans les milieux d'eau douce et les sols chauds partout dans le monde (Chalmers, 2014b). Ces organismes ont été isolés à partir d'une grande variété de sources d'eau chaude naturelles et artificielles, dont les lacs, les rivières, les étangs, les sources thermales, les eaux souterraines géothermiques, les eaux mélangées à des rejets d'eau chaude de centrales électriques ou d'usines et les piscines mal entretenues (Chalmers, 2014b, Bartrand et coll., 2014). Aux US, N. fowleri a souvent été détectée dans des eaux naturelles d'états du sud. Ces agents pathogènes sont moins présents dans les eaux du nord du pays, mais ils ont été détectés dans des lacs d'états de l'extrême nord, comme le Minnesota (Yoder et coll., 2010; 2012a). N. fowleri a été isolée dans des sources d'eau potable et des circuits de plomberie domestiques en Australie et aux États-Unis, en Arizona et en Louisiane (Bartrand et coll., 2014). Une augmentation de la température ambiante résultant des changements climatiques peut étendre l'aire de répartition de N. fowleri (Bartrand et coll., 2014; Chalmers, 2014b).
N. fowleri se transmet par la voie intranasale. La majorité des infections ont été associées à des activités de loisir (p. ex. la natation ou la plongée) dans des eaux récréatives douces et chaudes ou des piscines contaminées. Dans de très rares cas, les infections ont été reliées à des sources d'eau potable contaminées par des facteurs tels que l'irrigation nasale, la baignade ou les usages récréatifs de l'eau (Yoder et coll., 2010, 2012a, Bartrand et coll., 2014). L'eau potable contaminée n'est pas une voie d'infection.
Il existe très peu de données sur la contamination de réseaux de distribution d'eau potable ou de circuits de plomberie domestiques par N. fowleri en Amérique du Nord (Bartrand et coll., 2014). Ces dernières sont répandues dans les réservoirs naturels, mais en faible quantité, à moins que l'environnement offre des conditions propices à leur prolifération, comme des températures optimales de développement, la disponibilité de nutriments et l'absence de désinfectants résiduels (Bartrand et coll., 2014). Les réseaux de distribution d'eau potable vulnérables aux contaminations par N. fowleri sont ceux dans lesquels la température de l'eau dépasse constamment 25 °C et une concentration adéquate en désinfectants résiduels n'est pas maintenue (Bartrand et coll., 2014). La survie à long terme des cystes à des températures inférieures aux valeurs optimales de développement microbien est possible et N. fowleri est capable de survivre à l'hiver dans des lacs situés dans des régions subtropicales et tempérées (Bartrand et coll., 2014). Des études de laboratoire et à échelle réelle ont montré que N. fowleri pouvait persister et se développer dans les biofilms des réseaux de distribution et des installations de plomberie domestiques (Bartrand et coll., 2014).
N. fowleri peut servir de réservoir aux microorganismes résistants aux amibes (Thomas et Ashbolt, 2011; Bartrand et coll., 2014). Les espèces de Naegleria sont considérées comme des hôtes de L. pneumophila et peuvent offrir à ces dernières des conditions leur permettant de se multiplier, de se protéger et de se répandre dans l'environnement (Thomas et Ashbolt, 2011; Bartrand et coll., 2014; Siddiqui et coll., 2016). Il est nécessaire de mener des études approfondies pour comprendre les interactions entre les espèces d'amibes libres et les microorganismes pathogènes résistants aux amibes et pouvoir ainsi mesurer les risques pour la santé humaine (Thomas et Ashbolt, 2011). Seuls six des 132 cas d'infection par N. fowleri recensés aux US entre 1962 et 2013 étaient le résultat d'expositions à de l'eau potable contaminée (Yoder et coll.2010; CDC, 2017c). Trois de ces cas étaient liés à des gestes d'irrigation nasale (Louisiane (2), 2011, iles Vierges, US (1), 2012), deux à des activités de baignade (Arizona, 2002) et un à une exposition à de l'eau du robinet sur une glissade d'eau extérieure (Louisiane, 2013) (Yoder et coll.2010, 2012a; Bartrand et coll., 2014). Dans les deux cas survenus en Louisiane, c'était la première fois que de l'eau du robinet désinfectée était associée à une infection à N. fowleri aux US (Yoder et coll., 2012a). À ce jour, il n'y a eu aucun cas confirmé d'infection au virus MAP au Canada.
B.2.2.2.4 Méthodes d'analyse
La détection et l'identification de N. fowleri dans l'eau potable requièrent des laboratoires hautement spécialisés (Bartrand et coll., 2014, Chalmers, 2014b). Aucune méthode normalisée n'existe. Les procédures d'isolement de N. fowleri consistent en une concentration (par filtration sur membrane ou centrifugation) ou une séparation, un tri sur plaque et une identification à l'aide de l'immunofluorescence ou de méthodes moléculaires (Bartrand et coll., 2014; Chalmers, 2014b, Wang et coll., 2017). La littérature fournit des renseignements détaillés sur certaines méthodes (Bartrand et coll., 2017; Wang et coll., 2017).
B.2.2.2.5 Traitements
Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable sont censées détruire N. fowleri. Les cystes sont très résistants aux désinfectants fréquemment utilisés - chlore, chloramines ou monochloramine et UV. Les cystes de N. fowleri sont très similaires en taille à ceux de Giardia (Chalmers, 2014b, Santé Canada, 2019d). Pour l'inactivation des cystes des Naegleria spp., les exigences en matière de CT pour le chlore libre et la chloramine (monochloramine) sont inférieures à celles requises pour les Giardia et les Cryptosporidium, tandis que les exigences en matière de dose d'UV sont supérieures à celles applicables à ces protozoaires, mais inférieures à celles requises pour les adénovirus (Sarkar et Gerba, 2012; Goudot et coll., 2014; Santé Canada, 2019c, 2019d).
Les pratiques générales d'exploitation et de maintenance essentielles pour limiter la survie et le développement d'agents pathogènes d'origine hydrique, dont les Naegleria spp., dans les réseaux distribution d'eau potable et les installations de plomberie sont décrites dans la partie A (Bartrand et coll., 2014). Le maintien d'une concentration minimale de chlore ou de chloramine résiduels à 0,5 mg/l dans l'ensemble du réseau de distribution est recommandé pour limiter le développement de N. fowleri dans les systèmes d’approvisionnement en eau potable vulnérables (Robinson et Christy, 1984; Trolio et coll., 2008; Bartrand et coll., 2014; NHMRC, NRMMC, 2011).
N. fowleri ne constitue pas un risque immédiat pour les réseaux de distribution d'eau potable au Canada. Cependant, les propriétaires de maison devraient s'assurer de procéder à des rinçages nasaux avec de l'eau préalablement portée à ébullition ou refroidie ou de l'eau distillée.
B.2.2.2.6 Considérations internationales
L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence de N. fowleri dans l'eau potable.
Partie C. Bibliographie
- Adams, D.A., Thomas, K.R., Jajosky, R.A., Foster, L., Sharp, P., Onweh, D.H., Schley, A.W. et Anderson, W.J. (2016). Summary of notifiable infectious diseases and conditions—United States, 2014. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep., 63(54): 1-152.
- Adams, D.A., Thomas, K.R., Jajosky, R.A., Foster, L., Baroi, G., Sharp, P., Onweh, D.H., Schley, A.W. et Anderson, W.J. (2017). Summary of notifiable infectious diseases and conditions—United States, 2015. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep., 64(53): 1-143.
- Adjemian, J., Daniel-Wayman, S., Ricotta, E. et Prevots, D.R. (2018). Epidemiology of nontuberculous mycobacteriosis. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine, 39(3): 325-335.
- Alary, M. et Joly, J.R. (1991). Risk factors for contamination of domestic hot water systems by Legionellae. Appl. Environ. Microbiol., 57(8): 2360-2367.
- Allegra, S., Berger, F., Berthelot, P., Grattard, F., Pozzetto, B. et Riffard, S. (2008). Use of flow cytometry to monitor Legionella viability. Appl. Environ. Microbiol., 74 (24):7813-7816.
- APHA, AWWA et WEF. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater. 23rd edition. American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, Washington, DC.
- Ashbolt, N.J. (2015). Environmental (saprozoic) pathogens of engineered water systems: Understanding their ecology for risk assessment and management. Pathogens, 4(2): 390-405.
- ASHRAE. (2018). ANSI/ASHRAE Standard 188-2018, Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Atlanta, GA. www.ashrae.org.
- Backert, S., Tegtmeyer, N., Cróinín, T.Ó, Boehm, M. et Heimesaat, M.M. (2016). Human campylobacteriosis. In Campylobacter: Features, detection, and prevention of foodborne disease. Klein, G (ed.). Academic Press. Cambridge, USA. pp. 1-25.
- Baker, K.H. et Hegarty, J.P. (2001). Presence of Helicobacter pylori in drinking water is associated with clinical infection (2001) Scand. J. Infect. Dis., 33 (10):744-746.
- Baker, K.H., Hegarty, J.P., Redmond, B., Reed, N.A. et Herson, D.S. (2002). Effect of oxidizing disinfectants (chlorine, monochloramine, and ozone) on Helicobacter pylori. Appl. Environ. Microbiol., 68(2): 981-984.
- Bartram, J., Bentham, R., Briand, E., Callan, P., Crespi, S., Lee, J.V. et Surman-Lee, S. (2007). Chapter 3; Approaches to risk management. In Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. (ed.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 39-56.
- Bartrand, T.A., Causey, J.J. et Clancy, J.L. (2014). Naegleria fowleri: An emerging drinking water pathogen. J. Am. Water Works Assoc., 106(10): E418-E432.
- Bates, M.N., Maas, E., Martin, T., Harte, D., Grubner, M. et Margolin, T. (2000). Investigation of the prevalence of Legionella species in domestic hot water systems. New Zealand Med. J., 113(1111): 218-220.
- Beauté, J., Sandin, S., Uldum, S.A., Rota, M.C., Brandsema, P., Giesecke, J. et Sparén, P. (2016). Short-term effects of atmospheric pressure, temperature, and rainfall on notification rate of community-acquired Legionnaires' disease in four European countries. Epidemiol. Infect., 144(16): 3483-3493.
- Bédard, E., Boppe, I., Kouamé, S., Martin, P., Pinsonneault, L., Valiquette, L., Racine, J. et Prévost, M. (2016a). Combination of heat shock and enhanced thermal regime to control the growth of a persistent Legionella pneumophila strain. Pathogens, 5(2): 35.
- Bédard, E., Prévost, M. et Déziel, E. (2016b). Pseudomonas aeruginosa in premise plumbing of large buildings. MicrobiologyOpen, 5(6): 937-956.
- Behnke, S. et Camper, A.K. (2012). Chlorine dioxide disinfection of single and dual species biofilms, Benin, A.L., Benson, R.F. et Besser, R.E. (2002). Trends in Legionnaires' disease, 1980–1998: Declining mortality and new patterns of diagnosis. Clin. Infect. Dis., 35(9): 1039-1046.
- Bentham, R., Surman-Lee, S., Lee, J.V., Briand, E. et Van de Kooj, D. (2007). Chapter 4: Potable water and in-building distribution systems. In: Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. et coll. (eds.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 57-68.
- Bernstein, C.N., McKeown, I., Embil, J.M., Blanchard, J.F., Dawood, M., Kabani, A., Kliewer, E., Smart, G., Coghlan, G., MacDonald, S., Cook, C., Orr, P. (1999). Seroprevalence of Helicobacter pylori, incidence of gastric cancer, and peptic ulcer-associated hospitalizations in a Canadian Indian population. Digest. Dis. Sci., 44 (4): 668-674.
- Bhowmick, U.D. et Bhattacharjee, S. (2018). Bacteriological, clinical and virulence aspects of Aeromonas-associated diseases in humans. Pol. J. Microbiol., 67(2): 137-149.
- Boppe, I., Bédard, E., Taillandier, C., Lecellier, D., Nantel-Gauvin, M. A., Villion, M., Laferrière, C. et Prevost, M. (2016). Investigative approach to improve hot water system hydraulics through temperature monitoring to reduce building environmental quality hazard associated to Legionella. Build. Environ., 108, 230-239.
- Borchardt, M.A., Stemper, M.E. et Standridge, J.H. (2003). Aeromonas isolates from human diarrheic stool and groundwater compared by pulsed-field gel electrophoresis. Emerg. Infect. Dis., 9(2): 224-228.
- Bragança, S.M., Azevedo, N.F., Simöes, L.C., Keevil, C.W. et Vieira, M.J. (2007). Use of fluorescent in situ hybridisation for the visualisation of Helicobacter pylori in real drinking water biofilms. Water Sci. Technol., 55(8-9):387-393.
- Brennhovd, O., Kapperud, G. et Langeland, G. (1992). Survey of thermotolerant Campylobacter spp. and Yersinia spp. in three surface water sources in Norway. Int. J. Food Microbiol., 15(3-4): 327-338.
- Brown, L.M. (2000). Helicobacter pylori: Epidemiology and routes of transmission. Epidemiol. Rev., 22 (2): 283-297.
- Bryant, J.M. et coll. (2016). Population-level genomics identifies the emergence and global spread of a human transmissible multidrug-resistant nontuberculous Mycobacterium. Science, 354(6313): 751-757.
- Bryant, J.M., Grogono, D.M., Greaves, D., Foweraker, J., Roddick, I., Inns, T., Reacher, M., Haworth, C.S., Curran, M.D., Harris, S.R., Peacock, S.J., Parkhill, J. et Floto, R.A. (2013). Whole-genome sequencing to identify transmission of Mycobacterium abscessus between patients with cystic fibrosis: A retrospective cohort study. Lancet, 381(9877): 1551-1560.
- Burillo, A., Pedro-Botet, M.L. et Bouza, E. (2017). Microbiology and epidemiology of Legionnaires' disease. Infect. Dis. Clin. North Am., 31(1): 7-27.
- Burnsed, L.J., Hicks, L.A., Smithee, L.M.K., Fields, B.S., Bradley, K.K., Pascoe, N., Richards, S.M., Mallonee, S., Littrell, L., Benson, R.F. et Moore, M.R. (2007). A large, travel-associated outbreak of legionellosis among hotel guests: Utility of the urine antigen assay in confirming Pontiac fever. Clin Infect Dis, 44(2): 222-228.
- Buse, H.Y., Schoen, M.E. et Ashbolt, N.J. (2012). Legionellae in engineered systems and use of quantitative microbial risk assessment to predict exposure. Water Res., 46 (4): 921-933.
- Butler, A.J., Pintar, K.D.M. et Thomas, M.K. (2016). Estimating the Relative Role of Various Subcategories of Food, Water, and Animal Contact Transmission of 28 Enteric Diseases in Canada. Foodborne Pathog. Dis., 13 (2): 57-64.
- Cangelosi, G., Clark-Curtiss, J., Behr, M., Bull, T. et Stinear, T. (2004). Biology of waterborne pathogenic mycobacteria. In Pathogenic mycobacteria in water—A guide to public health consequences, monitoring and management. IWA Publishing. Organisation mondiale de la santé. Genève, Suisse. pp. 39-54.
- Capewell, L.G., Harris, A.M., Yoder, J.S., Cope, J.R., Eddy, B.A., Roy, S.L., Visvesvara, G.S., Fox, L.M. et Beach, M.J. (2015). Diagnosis, clinical course, and treatment of primary amoebic meningoencephalitis in the United States, 1937-2013. J. Pediatric Infect. Dis. Soc., 4(4): e68-e75.
- Castillo, N.E., Rajasekaran, A. et Ali, S.K. (2016). Legionnaires' disease: A review. Infect. Dis. Clin. Pract., 24(5): 248-253.
- CDC. (2004). Surveillance for Waterborne-Disease Outbreaks Associated with Recreational Water—United States, 2001–2002 and Surveillance for Waterborne Disease Outbreaks Associated with Drinking Water—United States, 2001–2002. In Surveillance Summaries, October 22, 2004. MMWR 2004:53(no. SS-8).
- CDC. (2006). Surveillance for waterborne disease and outbreaks associated with drinking water and water not intended for drinking--United States, 2003-2004. MMWR Surveill Summ, 55(12): 31-65.
- CDC. (2008). Surveillance for Waterborne Disease and Outbreaks Associated with Recreational Water use and Other Aquatic Facility-Associated Health Events—United States, 2005–2006 and Surveillance for Waterborne Disease and Outbreaks Associated with Drinking Water and Water Not Intended for Drinking—United States, 2005–2006. Surveillance Summaries. MMWR 2008;57(no. SS-9).
- CDC. (2011). Surveillance for waterborne disease outbreaks associated with drinking water---United States, 2007--2008. MMWR Surveill. Summ., 60(12): 38-68.
- CDC. (2013a). Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013.
- CDC. (2013b). Pseudomonas aeruginosa in healthcare settings. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. https://www.cdc.gov/hai/organisms/pseudomonas.html.
- CDC. (2013c). Surveillance for Waterborne Disease Outbreaks Associated with Drinking Water and Other Nonrecreational Water—United States, 2009–2010. Surveillance Summaries. MMWR, 62(no. 35).
- CDC. (2015). Surveillance for Waterborne Disease Outbreaks Associated with
Drinking Water—United States, 2011–2012. Surveillance Summaries. MMWR, 64 (no. 31). - CDC. (2017a). Developing a water management program to reduce Legionella growth & spread in buildings. A practical guide to implementing industry standards. Version 1.1. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. Accédé novembre 2019 à : https://www.cdc.gov/legionella/wmp/toolkit/index.html
- CDC. (2017b). Parasites—Acanthamoeba—Granulomatous Amebic Encephalitis (GAE); Keratitis. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. Accédé juillet 2019 à : https://www.cdc.gov/parasites/acanthamoeba/index.html
- CDC. (2017c). Parasites—Naegleria fowleri—Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM)—Amebic Encephalitis. Naegleria fowleri in Louisiana Public Water Systems. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. Accédé juillet 2019 à : https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/public-water-systems-louisiana.html
- CDC. (2017d). Surveillance for waterborne disease outbreaks associated with drinking water -United States, 2013-2014. MMWR, 66(44): 1216-1221.
- CDC. (2018). Centers for Disease Control and Prevention. National Notifiable Diseases Surveillance System, 2017 Annual Tables of Infectious Disease Data. Atlanta, GA. CDC Division of Health Informatics and Surveillance, 2018. Available at https://wonder.cdc.gov/nndss/nndss_annual_tables_menu.asp
- CDC. (2019). Parasites—Naegleria fowleri—Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM)—Amebic Encephalitis. General Information. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. Accédé juillet 2019 à : https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/general.html
- CEAEQ. (2018). Centre d'Expertise en Analyse Environmentale du Québec. Méthodes d'analyses (analyses biologie, microbiologie et toxicologie). Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Accédé novembre 2019 à : http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/bio_toxico_micro.htm.
- Cervero-Aragó, S., Rodríguez-Martínez, S., Puertas-Bennasar, A. et Araujo, R.M. (2015). Effect of common drinking water disinfectants, chlorine and heat, on free Legionella and amoebae-associated Legionella. PLoS ONE, 10 (8), art. no. e0134726.
- Cervero-Aragó, S., Schrammel, B., Dietersdorfer, E., Sommer, R., Lück, C., Walochnik, J. et Kirschner, A. (2019). Viability and infectivity of viable but nonculturable Legionella pneumophila strains induced at high temperatures. Water Res., 158: 268-279.
- Chakravarty, S. et Anderson, G.G. (2015). The genus Pseudomonas. In Practical handbook of microbiology. Goldman, E. et Green, L.H. (eds.). Third. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 321-343.
- Chalmers, R.M. (2014a). Acanthamoeba. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK pp. 263-276.
- Chalmers, R.M. (2014b). Naegleria. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK pp. 407-416.
- Charron, D., Bédard, E., Lalancette, C., Laferrière, C. et Prévost, M. (2015). Impact of electronic faucets and water quality on the occurrence of Pseudomonas aeruginosa in water: A multi-hospital study. Infect. Control Hosp. Epidemiol., 36(3): 311-319.
- Chauret, C., Volk, C., Creason, R., Jarosh, J., Robinson, J. et Warnes, C. (2001). Detection of Aeromonas hydrophila in a drinking-water distribution system: A field and pilot study. Can. J. Microbiol., 47(8): 782-786.
- Chauret, C., Smith, C. et Baribeau, H. (2008). Inactivation of Nitrosomonas europaea and pathogenic Escherichia coli by chlorine and monochloramine. J. Water Health, 6(3): 315-322.
- Cheyne, B.M., Van Dyke, M.I., Anderson, W.B. et Huck, P.M. (2009). An evaluation of methods for the isolation of Yersinia enterocolitica from surface waters in the Grand River watershed. J. Water Health, 7(3): 392-403.
- Cheyne, B.M., Van Dyke, M.I., Anderson, W.B. et Huck, P.M. (2010). The detection of Yersinia enterocolitica in surface water by quantitative PCR amplification of the ail and yadA genes. J. Water Health, 8(3): 487-499.
- Christenson, J.C. (2013). Salmonella infections. Pediatr Rev, 34(9): 375-383.
- City of Hamilton. (2019). Accédé février, 2020 à : https://www.hamilton.ca/operating-business/health-requirements-inspections/cooling-towers
- City of Vancouver (2020). Vancouver, Canada. Accédé février, 2020 à : https://vancouver.ca/home-property-development/operating-permit.aspx#review-operating-permit
- Cristina, M.L., Spagnolo, A.M., Casini, B., Baggiani, A., Del Giudice, P., Brusaferro, S., Poscia, A., Moscato, U., Perdelli, F. et Orlando, P. (2014). The impact of aerators on water contamination by emerging gram-negative opportunists in at-risk hospital departments. Infect. Cont. Hosp. Epi., 35 (2): 122-129.
- Clauß, M. (2006). Higher effectiveness of photoinactivation of bacterial spores, UV resistant vegetative bacteria and mold spores with 222 nm compared to 254 nm wavelength. Acta Hydrochim. Hydrobiol., 34(6): 525-532.
- Collins, S., Stevenson, D., Bennett, A. et Walker, J. (2017). Occurrence of Legionella in UK household showers. Int. J. Hyg. Environ. Health, 220(2): 401-406.
- Cooper, I.R. et Hanlon, G.W. (2010). Resistance of Legionella pneumophila serotype 1 biofilms to chlorine-based disinfection. J. Hosp. Infect., 74(2): 152-159.
- Correia, A.M., Gonçalves, J. et Gomes, J.P. (2016). Probable person-to-person transmission of legionnaires' disease. New Engl. J. Med., 374(5): 497-498.
- Covert, T.C., Rodgers, M.R., Reyes, A.L. et Stelma Jr., G.N. (1999). Occurrence of nontuberculous mycobacteria in environmental samples. Appl. Environ. Microbiol., 65(6): 2492-2496.
- Craun, G.F., Brunkard, J.M., Yoder, J.S., Roberts, V.A., Carpenter, J., Wade, T., Calderon, R.L., Roberts, J.M., Beach, M.J. et Roy, S.L. (2010). Causes of outbreaks associated with drinking water in the United States from 1971 to 2006. Clin. Microbiol. Rev., 23(3): 507-528.
- Croxen, M.A., Law, R.J., Scholz, R., Keeney, K.M., Wlodarska, M. et Finlay, B.B. (2013). Recent advances in understanding enteric pathogenic Escherichia coli. Clin. Microbiol. Rev., 26(4): 822-880.
- Cunha, B.A., Burillo, A. et Bouza, E. (2016). Legionnaires' disease. Lancet, 387(10016): 376-385.
- Cunha, C.B. et Cunha, B.A. (2017). Legionnaires' disease since Philadelphia: Lessons learned and continued progress. Infect. Dis. Clin. North Am., 31(1): 1-5.
- Daniels, T.L. et Gregory, D.W. (2015). Pseudomonas, Stenotrophomonas and Burkholderia. In Clinical infectious disease. Schlossberg, D. (ed.). Second edition. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 966-974.
- De Groote, M.A. (2004). Disease resulting from contaminated equipment and invasive procedures. In Pathogenic mycobacteria in water—A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp: 131-142.
- De Jonckheere, J.F. (2011). Origin and evolution of the worldwide distributed pathogenic amoeboflagellate Naegleria fowleri. Infect. Genet. Evol., 11(7): 1520-1528.
- Degnan, A.J. (2006). Chapter 16. Pseudomonas. In AWWA manual of water supply practices—M48: Waterborne pathogens. 2nd edition. American Water Works Association, Denver, CO, pp. 131-134.
- Dekker, J.P. et Frank, K.M. (2015). Salmonella, Shigella, and Yersinia. Clin. Lab. Med., 35(2): 225-246.
- Devos, L., Boon, N. et Verstraete, W. (2005). Legionella pneumophila in the environment: The occurrence of a fastidious bacterium in oligotrophic conditions. Rev. Environ. Sci. Bio., 4 (1-2): 61-74.
- Dilger, T., Melzl, H. et Gessner, A. (2016). Legionella contamination in warm water systems in Germany—influence of maximal temperature and temperature during sampling. GWF Wasser Abwasser, 157(3): 262-271.
- Dominguez, A., Alvarez, J., Sabria, M., Carmona, G., Torner, N., Oviedo, M., Cayla, J., Minguell, S., Barrabeig, I., Sala, M., Godoy, P. et Camps, N. (2009). Factors influencing the case-fatality rate of Legionnaires' disease. Int. J. Tuberc. Lung Dis., 13(3): 407-412.
- Donohue, M.J., O'Connell, K., Vesper, S.J., Mistry, J.H., King, D., Kostich, M. et Pfaller, S. (2014). Widespread molecular detection of Legionella pneumophila serogroup 1 in cold water taps across the United States. Environ. Sci. Technol., 48(6): 3145-3152.
- Donohue, M.J., Mistry, J.H., Donohue, J.M., Oconnell, K., King, D., Byran, J., Covert, T. et Pfaller, S. (2015). Increased frequency of nontuberculous mycobacteria detection at potable water taps within the United States. Environ. Sci. Technol., 49(10): 6127-6133.
- Donohue, M.J. et Wymer, L. (2016). Increasing prevalence rate of nontuberculous mycobacteria infections in five states, 2008-2013. Annals of the American Thoracic Society, 13(12): 2143-2150.
- Dupuy, M., Mazoua, S., Berne, F., Bodet, C., Garrec, N., Herbelin, P., Ménard-Szczebara, F., Oberti, S., Rodier, M.H., Soreau, S., Wallet, F. et Héchard, Y. (2011). Efficiency of water disinfectants against Legionella pneumophila and Acanthamoeba. Water Res., 45(3): 1087-1094.
- ECCDC. (2018a). European Centre for Disease Prevention and Control. Shigellosis. In ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.
- ECCDC. (2018b). European Centre for Disease Prevention and Control. Yersiniosis. In ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.
- ECCDC. (2019). European Centre for Disease Prevention and Control. Salmonellosis. In ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2019.
- Edberg, S.C., Browne, F.A. et Allen, M.J. (2007). Issues for microbial regulation: Aeromonas as a model. Crit. Rev. Microbiol., 33(1): 89-100.
- Edelstein, P.H. et Roy, C.R. (2015). Legionnaires' disease and Pontiac fever. In Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. Bennett, J.E. et coll. (eds.). Saunders. Philadelphia, USA. pp. 2633-2644.
- Edelstein, P.H. (2007). Urine antigen tests positive for Pontiac fever: Implications for diagnosis and pathogenesis. Clin Infect Dis, 44(2): 229-231.
- Egorov, A.I., Best, J.M., Frebis, C.P. et Karapondo, M.S. (2011). Occurrence of Aeromonas spp. in a random sample of drinking water distribution systems in the USA. J. Water. Health., 9(4): 785-798.
- Exner, M., Hartemann, P. et Lajoie, L (2007). Chapter 6. Health-care facilities. In Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. et coll. (eds.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 89-102.
- Fagan-Garcia, K., Geary, J., Chang, H.-J., McAlpine, L., Walker, E., Colquhoun, A., Van Zanten, S.V., Girgis, S., Archie, B., Hanley, B., Corriveau, A., Morse, J., Munday, R. et Goodman, K.J. (2019). Burden of disease from Helicobacter pylori infection in western Canadian Arctic communities. BMC Public Health, 19 (1), art. no. 730.
- Falkinham III, J.O., Norton, C.D. et Lechevallier, M.W. (2001). Factors influencing numbers of Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, and other mycobacteria in drinking water distribution systems. Appl. Environ. Microbiol., 67(3): 1225-1231.
- Falkinham, J.O. (2004). Environmental sources of Mycobacterium avium linked to routes of exposure. In Pathogenic mycobacteria in water A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et al (eds.). IWA Publishing. Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 26-38.
- Falkinham, J.O.,3rd (2015a). Common features of opportunistic premise plumbing pathogens. Int. J. Environ. Res. Public. Health., 12(5): 4533-4545.
- Falkinham, J.O., III (2015b). Environmental sources of nontuberculous mycobacteria. Clinics in Chest Medicine, 36(1): 35-41.
- Falkinham, J.O. (2015c). The Mycobacterium avium complex and slowly growing mycobacteria. In Molecular medical microbiology: Second edition. Elsevier Ltd, London, UK. pp. 1669-1678.
- Falkinham, J.O. III, Hilborn, E.D., Arduino, M.J., Pruden, A. et Edwards, M.A. (2015a). Epidemiology and ecology of opportunistic premise plumbing pathogens: Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, and Pseudomonas aeruginosa. Environ. Health Perspect., 123(8): 749-758.
- Falkinham, J.O., Pruden, A. et Edwards, M. (2015b). Opportunistic premise plumbing pathogens: Increasingly important pathogens in drinking water. Pathogens, 4(2): 373-386.
- Falkinham, J.O.,3rd (2016a). Current epidemiologic trends of the nontuberculous mycobacteria (NTM). Curr Environ Health Rep, 3(2): 161-167.
- Falkinham, J.O. (2016b). Nontuberculous mycobacteria: Community and nosocomial waterborne opportunistic pathogens. Clin. Microbiol. Newsl., 38(1): 1-7.
- Feazel, L.M., Baumgartner, L.K., Peterson, K.L., Frank, D.N., Harris, J.K. et Pace, N.R. (2009). Opportunistic pathogens enriched in showerhead biofilms. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38): 16393-16398.
- Fields, B.S., Haupt, T., Davis, J.P., Arduino, M.J., Miller, P.H. et Butler, J.C. (2001). Pontiac fever due to Legionella micdadei from a whirlpool spa: Possible role of bacterial endotoxin. J. Infect. Dis., 184(10): 1289-1292.
- Fields, B.S., Benson, R.F. et Besser, R.E. (2002). Legionella and Legionnaires' disease: 25 years of investigation. Clin. Microbiol. Rev., 15(3): 506-526.
- Fisman, D.N., Lim, S., Wellenius, G.A., Johnson, C., Britz, P., Gaskins, M., Maher, J., Mittleman, M.A., Spain, C.V., Haas, C.N. et Newbern, C. (2005). It's not the heat, it's the humidity: Wet weather increases legionellosis risk in the greater Philadelphia metropolitan area. J. Infect. Dis., 192(12): 2066-2073.
- Flannery, B., Gelling, L.B., Vugia, D.J., Weintraub, J.M., Salerno, J.J., Conroy, M.J., Stevens, V.A., Rose, C.E., Moore, M.R., Fields, B.S. et Besser, R.E. (2006). Reducing Legionella colonization of water systems with monochloramine. Emerg. Infect. Dis., 12(4): 588-596.
- Fleury, M., Charron, D.F., Holt, J.D., Allen, O.B. et Maarouf, A.R. (2006). A time series analysis of the relationship of ambient temperature and common bacterial enteric infections in two Canadian provinces. Int. J. Biometeorol., 50 (6): 385-391.
- Ford, T., Hermon-Taylor, J., Nichols, G., Cangelosi, G. et Bartram, J. (2004). Approaches to risk management in priority setting. In Pathogenic mycobacteria in Water—A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 169-178.
- Fredriksson-Ahomaa, M. et Korkeala, H. (2003). Low occurrence of pathogenic Yersinia enterocolitica in clinical, food, and environmental samples: A methodological problem. Clin. Microbiol. Rev., 16(2): 220-229.
- Fredriksson-Ahomaa, M. (2015). Enteropathogenic Yersinia spp. In Zoonoses-infections affecting humans and animals: Focus on public health aspects. Sing, A. (ed.). Springer. Dordrecht. pp. 213-234.
- Fredriksson-Ahomaa, M. (2017). Yersinia enterocolitica. In Foodborne diseases: Third edition. Yersinia enterocolitica. Dodd, C. et coll. (eds.). Academic Press. Cambridge, USA. pp. 223-233.
- Friedman, M., Ashbolt, J., Hanson, A., Meteer, L. et Ureta, A. (2017). Chapter 3: Understanding and managing biofilm, coliform occurrence, and the microbial community. Manual of water supply practices M68– Water quality in distribution systems. American Water Works Association, Denver, CO., pp. 39-80.
- Gaia, V., Fry, N.K., Afshar, B., Lück, P.C., Meugnier, H., Etienne, J., Peduzzi, R. et Harrison, T.G. (2005). Consensus sequence-based scheme for epidemiological typing of clinical and environmental isolates of Legionella pneumophila. J. Clin. Microbiol., 43 (5):2047-2052.
- Galanis, E., Mak, S., Otterstatter, M., Taylor, M., Zubel, M., Takaro, T.K., Kuo, M. et Michel, P. (2014). The association between campylobacteriosis, agriculture and drinking water: A case-case study in a region of British Columbia, Canada, 2005-2009. Epidemiol. Infect., 142 (10): 2075-2084.
- Gargano, J.W., Adam, E.A., Collier, S.A., Fullerton, K.E., Feinman, S.J. et Beach, M.J. (2017). Mortality from selected diseases that can be transmitted by water—United States, 2003-2009. J. Water Health, 15(3): 438-450.
- Garvey, M., Thokala, N. et Rowan, N. (2014). A comparative study on the pulsed UV and the low-pressure UV inactivation of a range of microbial species in water. Water Environ. Res., 86(12): 2317-2324.
- Gavriel, A.A., Landre, J.P.B. et Lamb, A.J. (1998). Incidence of mesophilic Aeromonas within a public drinking water supply in north-east Scotland. J. Appl. Microbiol., 84(3): 383-392.
- Gebert, M.J., Delgado-Baquerizo, M., Oliverio, A.M., Webster, T.M., Nichols, L.M., Honda, J.R., Chan, E.D., Adjemian, J., Dunn, R.R. et Fierer, N. (2018). Ecological analyses of mycobacteria in showerhead biofilms and their relevance to human health. mBio, 9(5).
- Gerba, C.P., Nwachuku, N. et Riley, K.R. (2003). Disinfection resistance of waterborne pathogens on the United States Environmental Protection Agency's Contaminant candidate list (CCL). J. Water Supply Res. T., 52(2): 81-94.
- Ghenghesh, K.S., Ahmed, S.F., El-Khalek, R.A., Al-Gendy, A. et Klena, J. (2008). Aeromonas-associated infections in developing countries. J. Infect. Dev. Countr., 2(2): 81-98.
- Gilmour, M.W., Bernard, K., Tracz, D.M., Olson, A.B., Corbett, C.R., Burdz, T., Ng, B., Wiebe, D., Broukhanski, G., Boleszczuk, P., Tang, P., Jamieson, F., Van Domselaar, G., Plummer, F.A. et Berry, J.D. (2007). Molecular typing of a Legionella pneumophila outbreak in Ontario, Canada. J. Med. Microbiol., 56(3): 336-341.
- Goldberg, D., Collier, P., Fallon, R., Mckay, T., Markwick, T., Wrench, J., Emslie, J., Forbes, G., Macpherson, A. et Reid, D. (1989). Lochgoilhead fever: Outbreak of non-pneumonic legionellosis due to Legionella micdadei. Lancet, 333(8633): 316-318.
- Goudot, S., Herbelin, P., Mathieu, L., Soreau, S., Banas, S. et Jorand, F.P.A. (2014). Biocidal efficacy of monochloramine against planktonic and biofilm-associated Naegleria fowleri cells. J. Appl. Microbiol., 116(4): 1055-1065.
- Government Inquiry into Havelock North Drinking Water. (2017). Havelock North drinking water inquiry: Stage 2. May 2017, Auckland, New Zealand. ISBN: 978-0-473-39743-2. Available at https://www.dia.govt.nz/stage-1-of-the-water-inquiry.
- Gouvernement du Québec. (2020). Régie du Bâtiment Québec. Quebec, Canada. Accédé février, 2020 à : https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/batiment/interpretation-directives-techniques-et-administratives/chapitre-batiment-du-code-de-securite/tours-de-refroidissement-a-leau-obligations-du-proprietaire.html
- Graham, D.Y., Opekun, A.R., Osato, M.S., El-Zimaity, H.M.T., Lee, C.K., Yamaoka, Y., Qureshi, W.A., Cadoz, M. et Monath, T.P. (2004). Challenge model for Helicobacter pylori infection in human volunteers. Gut, 53(9): 1235-1243.
- Graziani, C., Losasso, C., Luzzi, I., Ricci, A., Scavia, G. et Pasquali, P. (2017). Salmonella. In Foodborne diseases: Third edition. Dodd, C. et coll. (eds.). Academic Press. Cambridge, USA. pp. 133-169.
- Greenberg, D., Chiou, C.C., Famigilleti, R., Lee, T.C. et Yu, V.L. (2006). Problem pathogens: Paediatric legionellosis-implications for improved diagnosis. Lancet Infect. Dis., 6(8): 529-535.
- Grimont, P.A.D. et Weill, F-X. (2007). Antigenic formulae of the Salmonella serovars. 9th edition. WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella. Institut Pasteur, Paris, France. Accédé janvier 2020 à : https://www.pasteur.fr/sites/default/files/veng_0.pdf
- Guimaraes, A.J., Gomes, K.X., Cortines, J.R., Peralta, J.M. et Peralta, R.H.S. (2016). Acanthamoeba spp. as a universal host for pathogenic microorganisms: One bridge from environment to host virulence. Microbiol. Res., 193: 30-38.
- Hallenbeck, W.H. et Brenniman, G.R. (1989). Risk of fatal amebic meningoencephalitis from waterborne Naegleria fowleri. Environ. Manage., 13(2): 227-232.
- Halstrom, S., Price, P. et Thomson, R. (2015). Review: Environmental mycobacteria as a cause of human infection. Int. J. Mycobacteriology, 4(2): 81-91.
- Hamilton, K.A., Weir, M.H. et Haas, C.N. (2017). Dose response models and a quantitative microbial risk assessment framework for the Mycobacterium avium complex that account for recent developments in molecular biology, taxonomy, and epidemiology. Water Res., 109: 310-326.
- Handfield, M., Simard, P., Couillard, M. et Letarte, R. (1996). Aeromonas hydrophila isolated from food and drinking water: Hemagglutination, hemolysis, and cytotoxicity for a human intestinal cell line (HT-29). Appl. Environ. Microbiol., 62(9): 3459-3461.
- Harris, N.B. et Barletta, R.G. (2001). Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Veterinary Medicine. Clin. Microbiol. Rev., 14 (3):489-512
- Havelaar, A.H., Schets, F.M., van Silfhout, A., Jansen, W.H., Wieten, G. et van der Kooij, D. (1992). Typing of Aeromonas strains from patients with diarrhoea and from drinking water. J. Appl. Bacteriol., 72(5): 435-444.
- Hayes, S.L., White, K.M. et Rodgers, M.R. (2006). Assessment of the effectiveness of low-pressure UV light for inactivation of Helicobacter pylori. Appl. Environ. Microbiol., 72(5): 3763-3765.
- Hayes, S.L., Sivaganesan, M., White, K.M. et Pfaller, S.L. (2008). Assessing the effectiveness of low-pressure ultraviolet light for inactivating Mycobacterium avium complex (MAC) micro-organisms. Lett. Appl. Microbiol., 47(5): 386-392.
- Henkle, E., Hedberg, K., Schafer, S.D. et Winthrop, K.L. (2017). Surveillance of extrapulmonary nontuberculous mycobacteria infections, Oregon, USA, 2007–2012. Emerg. Infect. Dis., 23(10): 1627-1630.
- Hermon-Taylor., J. et El-Zaatari, F.A.K. (2004). The Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis problem and its relation to the causation of Crohn's disease. In: Pathogenic mycobacteria in Water—A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp: 74-94.
- Hijnen, W.A.M. et Medema, G.J. (2010). Elimination of micro-organisms by drinking water treatment processes. KWR Watercycle Research Institute. IWA Publishing, London, United Kingdom. Pp. 1-102.
- Hijnen, W.A.M., Beerendonk, E.F. et Medema, G.J. (2011). Inactivation credit of UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review.). In Quantitative methods to assess capacity of water treatment to eliminate microorganisms. Hijnen, W.A.M ed.; KWR Watercycle Research Institute. IWA Publishing., London, United Kingdom.
- Hilborn, E.D., Covert, T.C., Yakrus, M.A., Harris, S.I., Donnelly, S.F., Rice, E.W., Toney, S., Bailey, S.A. et Stelma Jr., G.N. (2006). Persistence of nontuberculous mycobacteria in a drinking water system after addition of filtration treatment. Appl. Environ. Microbiol., 72(9): 5864-5869.
- Hlavsa, M.C., Cikesh, B.L., Roberts, V.A., Kahler, A.M., Vigar, M., Hilborn, E.D., Wade, T.J., Roellig, D.M., Murphy, J.L., Xiao, L., Yates, K.M., Kunz, J.M., Arduino, M.J., Reddy, S.C., Fullerton, K.E., Cooley, L.A., Beach, M.J., Hill, V.R. et Yoder, J.S. (2018). Outbreaks associated with treated recreational water—United States, 2000–2014. Am. J. Transplant., 18(7): 1815-1819.
- Hoefsloot, W. et coll. (2013). The geographic diversity of nontuberculous mycobacteria isolated from pulmonary samples: An NTM-NET collaborative study. European Respiratory Journal, 42(6): 1604-1613.
- Holinger, E.P., Ross, K.A., Robertson, C.E., Stevens, M.J., Harris, J.K. et Pace, N.R. (2014). Molecular analysis of point-of-use municipal drinking water microbiology. Water Res., 49: 225-235.
- Hooi, J.K.Y., Lai, W.Y., Ng, W.K., Suen, M.M.Y., Underwood, F.E., Tanyingoh, D., Malfertheiner, P., Graham, D.Y., Wong, V.W.S., Wu, J.C.Y., Chan, F.K.L., Sung, J.J.Y., Kaplan, G.G. et Ng, S.C. (2017). Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology, 153 (2): 420-429.
- Hornei, B., Ewig, S., Exner, M., Tartakovsky, I., Lajoie, L., Dangendorf, F., Surman-Lee, S. et Fields, B. (2007). Chapter 1: Legionellosis. In: Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. et coll. (eds.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 1-27.
- Howden, B.P., Stuart, R.L., Tallis, G., Bailey, M. et Johnson, P.D.R. (2003). Treatment and outcome of 104 hospitalized patients with legionnaires' disease. Internal Medicine Journal, 33(11): 484-488.
- Hrudey, S. E. et Hrudey, E. (2004). Safe drinking water: Lessons from recent outbreaks in affluent nations. Safe drinking water: Lessons from recent outbreaks in affluent nations. IWA Publishing, London.
- HSE. (2013a). Legionnaires' Disease: Technical Guidance. HSG274 Part 1: The Control of Legionella Bacteria in Evaporative Cooling Systems. Health and Safety Executive, Gouvernement du Royame-Uni. London, UK. Pp. 1-57. Accédé décembre 2018 à : http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg274.htm
- HSE. (2013b). Legionnaires' Disease: Technical Guidance. HSG274 Part 2: The Control of Legionella Bacteria in Hot and Cold Water Systems. Health and Safety Executive, Government of the United Kingdom. London, UK. Pp. 1-65. Accédé décembre 2018 à : http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg274.htm
- HSE. (2013c). Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems—Approved Code of Practice and Guidance. L8 (Fourth Edition). Health and Safety Executive, Government of the United Kingdom. London, UK. Pp. 1-28. Accédé novembre 2018 à : http://www.hse.gov.uk/pubns/books/l8.htm
- HSE. (2019). Legionella and Legionnaires' Disease – Frequently asked questions. Health and Safety Executive, Government of the United Kingdom. London, UK. Accédé novembre 2018 à : http://www.hse.gov.uk/legionnaires/faqs.htm#Testing-monitoring
- Hsu, M.-S., Wu, M.-Y., Huang, Y.-T. et Liao, C.-H. (2016). Efficacy of chlorine dioxide disinfection to non-fermentative gram-negative bacilli and non-tuberculous mycobacteria in a hospital water system. Journal of Hospital Infection, 93(1): 22-28.
- Huang, H., Brooks, B.W., Lowman, R. et Carrillo, C.D. (2015). Campylobacter species in animal, food, and environmental sources, and relevant testing programs in Canada. Can. J. Microbiol., 61(10): 701-721.
- IARC Helicobacter pylori Working Group. (2014). Helicobacter pylori eradication as a strategy for preventing gastric cancer. International Agency for Research on Cancer, IARC Working Group Reports, No. 8, Lyon, France.
- Ishii, S. et Sadowsky, M.J. (2008). Escherichia coli in the environment: Implications for water quality and human health. Microbes Environ., 23(2): 101-108.
- ISO. (2019). ISO ICS 07.100.20 – Microbiology of Water. International Organization for Standardization. Genève, Suisse. Accédé à : www.iso.org/Ics/07.100.20/X/.
- Jacangelo, J.G., Patania, N.L., Trussell, R.R., Haas, C.N. et Gerba, C. (2002). Inactivation of waterborne emerging pathogens by selected disinfectants. AWWA Research Foundation and American Water Works Association, Denver, CO.
- Jamil, A., Farooq, S. et Hashmi, I. (2017). Ozone disinfection efficiency for indicator microorganisms at different pH values and temperatures. Ozone Sci. Eng., 39(6): 407-416.
- Janda, J.M. et Abbott, S.L. (2010). The genus Aeromonas: Taxonomy, pathogenicity, and infection. Clinical Microbiology Reviews, 23(1): 35-73.
- Johnson, C.H., Rice, E.W. et Reasoner, D.J. (1997). Inactivation of Helicobacter pylori by chlorination. Appl. Environ. Microbiol., 63(12): 4969-4970.
- Jones, T.F., Benson, R.F., Brown, E.W., Rowland, J.R., Crosier, S.C. et Schaffner, W. (2003). Epidemiologic investigation of a restaurant-associated outbreak of pontiac fever. Clin Infect Dis, 37(10): 1292-1297.
- Juárez, M.M., Tártara, L.I., Cid, A.G., Real, J.P., Bermúdez, J.M., Rajal, V.B. et Palma, S.D. (2018). Acanthamoeba in the eye, can the parasite hide even more? Latest developments on the disease. Contact Lens and Anterior Eye, 41(3): 245-251.
- Kaakoush, N.O., Castaño-Rodríguez, N., Mitchell, H.M. et Man, S.M. (2015). Global epidemiology of Campylobacter infection. Clinical Microbiology Reviews, 28(3): 687-720.
- Katz, M.J., Parrish, N.M., Belani, A. et Shah, M. (2015). Recurrent Aeromonas bacteremia due to contaminated well water. Open Forum Infectious Diseases, 2(4).
- Kaur, S. (2014). Chapter 9: Pathogenic mycobacteria and water. In Water and health. Singh, P.P. et Sharma, V. (eds.) Springer. India. pp. 137-153.
- Keithlin, J., Sargeant, J., Thomas, M.K. et Fazil, A. (2014a). Chronic sequelae of E. coli O157: Systematic review and meta-analysis of the proportion of E. coli O157 cases that develop chronic sequelae. Foodborne Pathog. Dis., 11 (2): 79-95.
- Keithlin, J., Sargeant, J., Thomas, M.K. et Fazil, A. (2014b). Systematic review and meta-analysis of the proportion of Campylobacter cases that develop chronic sequelae. BMC Public Health, 14 (1), art. no. 1203: 1-19.
- Keithlin, J., Sargeant, J.M., Thomas, M.K. et Fazil, A. (2015). Systematic review and meta-analysis of the proportion of non-typhoidal Salmonella cases that develop chronic sequelae. Epidemiol. Infect., 143: 1333–1351.
- Khajanchi, B.K., Fadl, A.A., Borchardt, M.A., Berg, R.L., Horneman, A.J., Stemper, M.E., Joseph, S.W., Moyer, N.P., Sha, J. et Chopra, A.K. (2010). Distribution of virulence factors and molecular fingerprinting of Aeromonas species isolates from water and clinical samples: Suggestive evidence of water-to-human transmission. Appl. Environ. Microbiol., 76(7): 2313-2325.
- Kilvington, S., Gray, T., Dart, J., Morlet, N., Beeching, J.R., Frazer, D.G. et Matheson, M. (2004). Acanthamoeba keratitis: The role of domestic tap water contamination in the United Kingdom. Invest. Ophth. Vis. Sci., 45(1): 165-169.
- Knøchel, S. (1991). Chlorine resistance of motile Aeromonas spp. Water Sci. Technol., 24(2): 327-330.
- Knox, N.C., Weedmark, K.A., Conly, J., Ensminger, A.W., Hosein, F.S. et Drews, S.J. (2017). Unusual Legionnaires' outbreak in cool, dry western Canada: An investigation using genomic epidemiology. Epidemiol. Infect., 145(2): 254-265.
- Köhsler, M., Mrva, M. et Walochnik, J. (2016). Acanthamoeba. In Molecular parasitology: Protozoan parasites and their molecules. Walochnik, J. et Duchêne, M. (eds.). Springer. Vienna. pp. 285-324.
- Kothary, M.H. et Babu, US (2001). Infective dose of foodborne pathogens in volunteers: A review. J. Food Safety, 21(1): 49-73.
- Kühn, I., Allestam, G., Huys, G., Janssen, P., Kersters, K., Krovacek, K. et Stenström, T.-. (1997). Diversity, persistence, and virulence of Aeromonas strains isolated from drinking water distribution systems in Sweden. Appl. Environ. Microbiol., 63(7): 2708-2715.
- Kvalsvig, A., Baker, M.G., Sears, A. et French, N. (2013). Bacteria: Campylobacter. In Encyclopedia of food safety. Motarjemi, Y., Moy, G. et Todd, E. (eds.). Academic Press. Cambridge, USA. pp. 369-380.
- Lal, A., Hales, S., French, N., et Baker, M.G. (2012). Seasonality in human zoonotic enteric diseases: A systematic review. PLoS ONE, 7 (4), art. no. e31883.
- Lande, L., Alexander, D.C., Wallace, R.J., Jr., Kwait, R., Iakhiaeva, E., Williams, M., Cameron, A.D.S., Olshefsky, S., Devon, R., Vasireddy, R., Peterson, D.D. et Falkinham, J.O., III (2019). Mycobacterium avium in community and household water, suburban Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2010-2012. Emerg. Infect. Dis., 25(3): 473-481.
- Langenberg, W., Rauws, E.A.J., Oudbier, J.H. et Tytgat, G.N.J. (1990). Patient-to-patient transmission of Campylobacter pylori infection by fiber optic gastroduodenoscopy and biopsy. J. Infect. Dis., 161(3): 507-511.
- Lau, H.Y. et Ashbolt, N.J. (2009). The role of biofilms and protozoa in Legionella pathogenesis: Implications for drinking water. J. Appl. Microbiol., 107 (2): 368-378.
- Lavenir, R., Sanroma, M., Gibert, S., Crouzet, O., Laurent, F., Kravtsoff, J., Mazoyer, M.A. et Cournoyer, B. (2008). Spatio-temporal analysis of infra-specific genetic variations among a Pseudomonas aeruginosa water network hospital population: Invasion and selection of clonal complexes. J. Appl. Microbiol., 105(5):1491-1501.
- Le Dantec, C., Duguet, J.P., Montiel, A., Dumoutier, N., Dubrou, S. et Vincent, V. (2002). Occurrence of mycobacteria in water treatment lines and in water distribution systems. Appl. Environ. Microbiol., 68(11): 5318-5325.
- LeChevallier, M.W. (2004). Control, treatment and disinfection of Mycobacterium avium complex in drinking water. In Pathogenic mycobacteria in water—A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp: 143-168.
- LeChevallier, M.W., Evans, T.M., Seidler, R.J., Daily, O.P., Merrell, B.R., Rollins, D.M. et Joseph, S.W. (1982). Aeromonas sobria in chlorinated drinking water supplies. Microb. Ecol., 8(4): 325-333.
- LeChevallier, M.W. et Au, K.K. (2004). Water treatment and pathogen control: Process efficiency in achieving safe drinking water. IWA Publishing, London, UK, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.
- LeChevallier, M.W., Norton, C.D., Falkinham, III, J.O., Williams, M.D., Taylor, R.H. et Cowan, H.E. (2001). Occurrence and control of Mycobacterium avium complex. AWWA Research Foundation and American Water Works Association., Denver. CO.
- Leclerc, H. (2003). Relationships between common water bacteria and pathogens in drinking-water. In Heterotrophic plate counts and drinking-water safety. The significance of HPCs for water quality and human health. Bartram, J., Cotruvo, J., Exner, M., Fricker, C. et Glasmacher, A. (eds.). IWA Publishing, London, UK. pp. 80–118.
- Leoni, E., Catalani, F., Marini, S. et Dallolio, L. (2018). Legionellosis associated with recreational waters: A systematic review of cases and outbreaks in swimming pools, spa pools, and similar environments. Int. J. Env. Res. Pub. He., 15 (8), art. no. 1612.
- Lévesque, S., Plante, P.-L., Mendis, N., Cantin, P., Marchand, G., Charest, H., Raymond, F., Huot, C., Goupil-Sormany, I., Desbiens, F., Faucher, S.P., Corbeil, J. et Tremblay, C. (2014). Genomic characterization of a large outbreak of Legionella pneumophila serogroup 1 strains in Quebec City, 2012. PLoS ONE, 9(8).
- Li, T., Abebe, L.S., Cronk, R. et Bartram, J. (2017). A systematic review of waterborne infections from nontuberculous mycobacteria in health care facility water systems. Int. J. Hyg. Envir. Heal., 220(3): 611-620.
- Liu, D. (2014). Aeromonas. In Molecular medical microbiology: Second edition. Tang, Y-W. et coll., eds. Elsevier Ltd. London, UK. pp. 1099-1110.
- Llewellyn, A.C., Lucas, C.E., Roberts, S.E., Brown, E.W., Nayak, B.S., Raphael, B.H. et Winchell, J.M. (2017). Distribution of Legionella and bacterial community composition among regionally diverse US cooling towers. PLoS ONE, 12 (12).
- Loret, J.F. et Greub, G. (2010). Free-living amoebae: Biological by-passes in water treatment. Int. J. Hyg. Envir. Heal., 213(3): 167-175.
- Loret, J.F., Jousset, M., Robert, S., Anselme, C., Saucedo, G., Ribas, F., Martinez, L. et Catalan, V. (2008). Elimination of free-living amoebae by drinking water treatment processes. Journal Europeen D'Hydrologie, 39(1): 37-50.
- LPSN. (2019). List of prokaryote names with standing in nomenclature. Retrieved juin 2019 à www.bacterio.net.
- Lu, J., Struewing, I., Vereen, E., Kirby, A.E., Levy, K., Moe, C. et Ashbolt, N. (2015a). Molecular detection of Legionella spp. and their associations with Mycobacterium spp., Pseudomonas aeruginosa and amoeba hosts in a drinking water distribution system. J. Appl. Microbiol., 120(2): 509-521.
- Lu, J., Struewing, I., Yelton, S. et Ashbolt, N. (2015b). Molecular survey of occurrence and quantity of Legionella spp., Mycobacterium spp., Pseudomonas aeruginosa and amoeba hosts in municipal drinking water storage tank sediments. J. Appl. Microbiol., 119(1): 278-288.
- Lund, V. (1996). Evaluation of E. coli as an indicator for the presence of Campylobacter jejuni and Yersinia enterocolitica in chlorinated and untreated oligotrophic lake water. Water Res., 30(6): 1528-1534.
- Lüttichau, H.R., Vinther, C., Uldum, S.A., Møller, J., Faber, M. et Jensen, J.S. (1998). An outbreak of Pontiac fever among children following use of a whirlpool. Clin. Infect. Dis., 26(6): 1374-1378.
- MacIntyre, C.R., Dyda, A., Bui, C.M. et Chughtai, A.A. (2018). Rolling epidemic of Legionnaires' disease outbreaks in small geographic areas. Emerg. Microbes Infect., 7(1): 36.
- Magnet, A., Galván, A.L., Fenoy, S., Izquierdo, F., Rueda, C., Fernandez Vadillo, C., Pérez-Irezábal, J., Bandyopadhyay, K., Visvesvara, G.S., Da Silva, A.J. et Del Aguila, C. (2012). Molecular characterization of Acanthamoeba isolated in water treatment plants and comparison with clinical isolates. Parasitol. Res., 111(1): 383-392.
- Mao, G., Song, Y., Bartlam, M. et Wang, Y. (2018). Long-term effects of residual chlorine on Pseudomonas aeruginosa in simulated drinking water fed with low AOC medium. Front. Microbiol., 9(MAY).
- Marciano-Cabral, F. et Cabral, G.A. (2007). The immune response to Naegleria fowleri amebae and pathogenesis of infection. FEMS Immunol. Med. Mic., 51(2): 243-259.
- Marras, T.K., Mendelson, D., Marchand-Austin, A., May, K. et Jamieson, F.B. (2013). Pulmonary nontuberculous mycobacterial disease, Ontario, Canada, 1998-2010. Emerg. Infect. Dis., 19(11): 1889-1891.
- Massa, S., Armuzzi, R., Tosques, M., Canganella, F. et Trovatelli, L.D. (1999). Note: Susceptibility to chlorine of Aeromonas hydrophila strains. J. Appl. Microbiol. 86 (1):169-173.
- Masten, S.J., Davies, S.H. et McElmurry, S.P. (2016). Flint water crisis: What happened and why? J. Am. Water Works Assoc., 108(12): 22-34.
- Mathys, W., Stanke, J., Harmuth, M. et Junge-Mathys, E. (2008). Occurrence of Legionella in hot water systems of single-family residences in suburbs of two German cities with special reference to solar and district heating. Int. J. Hyg. Environ. Heal., 211 (1-2): 179-185.
- Matysiak-Budnik, T., Briet, F., Heyman, M. et Mégraud, F. (1995). Laboratory-acquired Helicobacter pylori infection. Lancet, 346(8988): 1489-1490.
- McDermott, P.F., Zhao, S. et Tate, H. (2018). Antimicrobial Resistance in Nontyphoidal Salmonella. Microbiology spectrum, American Society for Microbiology. 6(4):1-26.
- McDonough, E.A., Metzgar, D., Hansen, C.J., Myers, C.A. et Russell, K.L. (2007). A cluster of Legionella-associated pneumonia cases in a population of military recruits. J. Clin. Microbiol., 45(6): 2075-2077.
- MDHHS. (2016). Legionellosis outbreak-Genesee County, June, 2014 – March, 2015. Full analysis. Michigan Department of Health and Human Services, MI. Accédé novembre 2018 à www.michigan.gov.
- Medema, G.J., Wondergem, E., Van Dijk-Looyaard, A.M. et Havelaar, A.H. (1991). Effectivity of chlorine dioxide to control Aeromonas in drinking water distribution systems. Water Sci. Technol., 24(2): 325-326.
- Mégraud, F. et Lehours, P. (2007). Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing. Clin. Microbiol. Rev., 20 (2): 280-322.
- Mercante, J.W. et Winchell, J.M. (2015). Current and emerging Legionella diagnostics for laboratory and outbreak investigations. Clin. Microbiol. Rev., 28(1): 95-133.
- Mir, R.A. et Kudva, I.T. (2019). Antibiotic-resistant Shiga toxin-producing Escherichia coli: An overview of prevalence and intervention strategies. Zoonoses Public Hlth., 66 (1): 1-13.
- Missouri Department of Health and Senior Services (2010). Communicable Disease Surveillance 2010 Annual Report.
- Miyamoto, M., Yamaguchi, Y., et Sastsu, M. (2000). Disinfectant effects of hot water, ultraviolet light, silver ions and chlorine on stains of Legionella and nontuberculous mycobacteria. Microbios. 101(398):7-13.
- Moore, E.R.B., Tindall, B.J., Martins Dos Santos, V.A.P., Pieper, D.H., Ramos, J-L. et Palleroni, N.J. (2006a). Nonmedical: Pseudomonas. In The Prokaryotes—A handbook on the biology of bacteria. Third edition. Volume 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria. Dworkin, M. et coll., eds. Springer, Singapore. pp. 646-703.
- Moore, M.R., Pryor, M., Fields, B., Lucas, C., Phelan, M. et Besser, R.E. (2006b). Introduction of monochloramine into a municipal water system: Impact on colonization of buildings by Legionella spp. Appl. Env. Microbiol. 72 (1):378-383.
- Moreira, N.A. et Bondelind, M. (2017). Safe drinking water and waterborne outbreaks. J. Water. Health., 15(1): 83-96.
- Moreno, Y., Piqueres, P., Alonso, J.L., Jiménez, A., González, A. et Ferrús, M.A. (2007). Survival and viability of Helicobacter pylori after inoculation into chlorinated drinking water. Water Res., 41(15): 3490-3496.
- Morgan, D.R., Johnson, P.C., DuPont, H.L., Satterwhite, T.K. et Wood, L.V. (1985). Lack of correlation between known virulence properties of Aeromonas hydrophila and enteropathogenicity for humans. Infect. Immun., 50(1): 62-65.
- Mraz, A.L. et Weir, M.H. (2018). Knowledge to predict pathogens: Legionella pneumophila lifecycle critical review Part I Uptake into host cells. Water (Suisse), 10(2), 132.
- Murphy, H.M., Thomas, M.K., Schmidt, P.J., Medeiros, D.T., McFadyen, S. et Pintar, K.D.M. (2016). Estimating the burden of acute gastrointestinal illness due to Giardia, Cryptosporidium, Campylobacter, E. coli O157 and norovirus associated with private wells and small water systems in Canada. Epidemiol. Infect., 144 (7): 1355-1370.
- Naja, F., Kreiger, N. et Sullivan, T. (2007). Helicobacter pylori infection in Ontario: Prevalence and risk factors. Can. J. Gastroenterol., 21 (8):501-506.
- NAS. (2019). Management of Legionella in Water Systems. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington, DC. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25474.
- Neil, K. et Berkelman, R. (2008). Increasing incidence of legionellosis in the United States, 1990-2005: Changing epidemiologic trends. Clin. Infect. Dis., 47(5): 591-599.
- NHMRC, NRMMC. (2011). Australian drinking water guidelines 6—national water quality management strategy. National Health and Medical Research Council, National Resource Management Ministerial Council, Commonwealth of Australia, Canberra.
- Nichols, G., Ford, T., Bartram, J., Dufour, A. et Portaels, F. (2004). Introduction. In Pathogenic mycobacteria in water—A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 1-14.
- Norton, C.D., LeChevallier, M.W. et Falkinham III, J.O. (2004). Survival of Mycobacterium avium in a model distribution system. Water Res., 38(6): 1457-1466.
- NRCC. (2015a). National building code. National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario. Available at https://nrc.canada.ca/en/certifications-evaluations-standards/codes-canada/codes-canada-publications/national-building-code-canada-2015
- NRCC. (2015b). National plumbing code of Canada. National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario. Available at https://nrc.canada.ca/en/certifications-evaluations-standards/codes-canada/codes-canada-publications/national-plumbing-code-canada-2015
- NSF/ANSI. (2018). Standard 244—Drinking Water Treatment Units-Supplemental Microbiological Water Treatment Systems-Filtration. NSF International, Ann Arbor, Michigan
- NSF/ANSI. (2019a). Standard 55—Ultraviolet microbiological water treatment systems. NSF International, Ann Arbor, Michigan.
- NSF/ANSI. (2019b). Standard 60- Drinking water treatment chemicals: Health effects. NSF International, Ann Arbor, Michigan.
- O'Connor, D.R. (2002). Report of the Walkerton inquiry, Part one: The events of May 2000 and related issues. Ontario Ministry of the Attorney General (ISBN: 0-7794-2559-6).
- OMS. (2002). Guidelines for drinking-water quality Second Edition. Addendum: Microbiological agents in drinking water. Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.
- OMS. (2004). Pathogenic Mycobacteria in Water—A Guide to Public Health Consequences, Monitoring and Management. Pedley, S. et coll., (eds). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.
- OMS. (2007). Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. (ed.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.
- OMS. (2011). Water safety in buildings. Organisation mondiale de la santé. Genève, Suisse.
- OMS. (2017). Prioritization of pathogens to guide discovery, research and development of new antibiotics for drug-resistant bacterial infections, including tuberculosis. Organisation mondiale de la santé. Genève, Suisse. Accédé octobre 2019 à https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/prioritization-of-pathogens/en/
- Orta de Velásquez, M. T., Yáñez Noguez, I., Casasola Rodríguez, B. et Román Román, P.I. (2017). Effects of ozone and chlorine disinfection on VBNC Helicobacter pylori by molecular techniques and FESEM images. Environ. Technol., 38(6): 744-753.
- O'Ryan, M., Vidal, R., Del Canto, F., Salazar, J.C. et Montero, D. (2015). Vaccines for viral and bacterial pathogens causing acute gastroenteritis: Part II: Vaccines for Shigella, Salmonella, enterotoxigenic E. coli (ETEC) enterohemorragic E. coli (EHEC) and Campylobacter jejuni. Hum. Vacc. and Immunother., 11(3): 601-619.
- Pablos, M., Rodríguez-Calleja, J.M., Santos, J.A., Otero, A. et García-López, M.L. (2009). Occurrence of motile Aeromonas in municipal drinking water and distribution of genes encoding virulence factors. Int. J. Food Microbiol., 135(2): 158-164.
- Palusińska-Szysz, M. et Cendrowska-Pinkosz, M. (2009). Pathogenicity of the family Legionellaceae. Arch. Immunol. Ther. Ex., 57(4): 279-290.
- Park, J., Kim, J.S., Kim, S., Shin, E., Oh, K.-H., Kim, Y., Kim, C.H., Hwang, M.A., Jin, C.M., Na, K., Lee, J., Cho, E., Kang, B.-H., Kwak, H.-S., Seong, W.K. et Kim, J. (2018). A waterborne outbreak of multiple diarrhoeagenic Escherichia coli infections associated with drinking water at a school camp. Int. J. Infect. Dis., 66: 45-50.
- Park, S.R., Mackay, W.G. et Reid, D.C. (2001). Helicobacter sp. recovered from drinking water biofilm sampled from a water distribution system. Water Res., 35(6): 1624-1626.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014a). Aeromonas. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 49-64.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014b). Campylobacter. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 65-78.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014c). Escherichia coli. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 89-117.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014d). Helicobacter pylori. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd., Oxford, UK. pp. 119-154.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014e). Legionella. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 155-175.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014f). Mycobacterium. In Microbiology of waterborne diseases. Second edition. Elsevier Ltd., Oxford, UK, pp. 177-207.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014g). Salmonella. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 209-222.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014h). Shigella. In Microbiology of waterborne diseases: Microbiological aspects and risks: Second edition. Elsevier Ltd. Oxford, UK. pp. 223-236.
- Percival, S.L. et Williams, D.W. (2014i). Yersinia. In Microbiology of waterborne diseases. Second edition. Elsevier Ltd., Oxford, UK, pp. 249-259.
- Petrisek, R. et Hall, J. (2018). Evaluation of a most probable number method for the enumeration of Legionella pneumophila from North American potable and nonpotable water samples. J. Water Health, 16 (1), pp. 57-69.
- ASPC. (2010). Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes – Shigella spp.. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada. Accédé septembre 2019 : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques/shigella.html
- ASPC. (2011). Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes – Salmonella enterica spp.. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada. Accédé septembre 2019: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques/salmonella-enterica.html
- ASPC. (2018a). Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens - Mise à jour 2018. . Agence de la santé publique du Canada. Ottawa, Canada. Accédé octobre 2019 : https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/medicaments-et-produits-sante.html
- ASPC. (2018b). FoodNet Canada rapport annuel 2016. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada.
- ASPC. (2018c). FoodNet Canada rapport annuel 2017. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada.
- ASPC. (2018d). Legionella. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada. Accédé juin 2019 à : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/legionella.html.
- ASPC. (2019). Graphiques de maladies à déclaration obligatoire. Cas déclarés de 1924 à 2016 au Canada. Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Canada. Accédé septembre 2019 à : https://maladies.canada.ca/declaration-obligatoire/liste-graphiques.
- Posteraro, B., Posteraro, P. et Sanguinetti, M. (2015). Helicobacter pylori. In: Molecular medical microbiology: Second edition. Elsevier Ltd, London, UK. pp. 1237-1258.
- Prussin, A.J., II, Schwake, D.O. et Marr, L.C. (2017). Ten questions concerning the aerosolization and transmission of Legionella in the built environment. Build. Environ., 123: 684-695.
- Pryor, M., Springthorpe, S., Riffard, S., Brooks, T., Huo, Y., Davis, G. et Sattar, S.A. (2004). Investigation of opportunistic pathogens in municipal drinking water under different supply and treatment regimes. Water Sci. Technol., 50(1): 83-90.
- PWGSC. (2016). MD 15161 – 2013 Control of Legionella in Mechanical Systems. Standard for Building Owners, Design Professionals, and Maintenance Personnel. Public Works and Government Services Canada. Gatineau, Quebec. Accédé juin 2019 à : https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/legionella/index-eng.html
- Qin, W., Li, W.G., Gong, X.J., Huang, X.F., Fan, W.B., Zhang, D., Yao, P., Wang, X.J. et Song, Y. (2017). Seasonal-related effects on ammonium removal in activated carbon filter biologically enhanced by heterotrophic nitrifying bacteria for drinking water treatment. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 6(4):54.
- Radomski, N., Betelli, L., Moilleron, R., Haenn, S., Moulin, L., Cambau, E., Rocher, V., Gonçalves, A. et Lucas, F.S. (2011). Mycobacterium behavior in wastewater treatment plant, a bacterial model distinct from Escherichia coli and enterococci. Environ. Sci. Technol., 45(12): 5380-5386.
- Rasheed, S., Hashmi, I. et Campos, L. (2016). Inactivation of Escherichia coli and Salmonella with chlorine in drinking waters at various pH and temperature levels. Proc. Pak. Acad. Sci., 53(2B): 83-92.
- Reuter, S., Sigge, A., Wiedeck, H. et Trautmann, M. (2002). Analysis of transmission pathways of Pseudomonas aeruginosa between patients and tap water outlets. Crit. Care Med., 30(10): 2222-2228.
- Rhoads, W.J., Pruden, A. et Edwards, M.A. (2016). Survey of green building water systems reveals elevated water age and water quality concerns. Environ. Sci.: Wat. Res., 2 (1): 164-173.
- Rhoads, W.J., Garner, E., Ji, P., Zhu, N., Parks, J., Schwake, D.O., Pruden, A. et Edwards, M.A. (2017). Distribution system operational deficiencies coincide with reported Legionnaires' disease clusters in Flint, Michigan. Environ. Sci. Technol., 51(20): 11986-11995.
- Rice, E.W., Clark, R.M. et Johnson, C.H. (1999). Chlorine inactivation of Escherichia coli O157:H7. Emerg. Infect. Dis., 5(3): 461-463.
- Richards, C.L., Broadaway, S.C., Eggers, M.J., Doyle, J., Pyle, B.H., Camper, A.K. et Ford, T.E. (2018). Detection of pathogenic and non-pathogenic bacteria in drinking water and associated biofilms on the Crow Reservation, Montana, USA. Microb. Ecol., 76(1): 52-63.
- Robertson, P., Abdelhady, H. et Garduño, R.A. (2014a). The many forms of a pleomorphic bacterial pathogen-the developmental network of Legionella pneumophila. Front. Microbiol. 5, art. no. 670: 1-20.
- Robertson, B.K., Harden, C., Selvaraju, S.B., Pradhan, S. et Yadav, J.S. (2014b). Molecular detection, quantification, and toxigenicity profiling of Aeromonas spp. in source- and drinking-water. Open Microbiol. J., 8(1): 32-39.
- Robins-Browne, R.M., Holt, K.E., Ingle, D.J., Hocking, D.M., Yang, J. et Tauschek, M. (2016). Are Escherichia coli pathotypes still relevant in the era of whole-genome sequencing? Front. Cell. Infect. Mi., 6 (NOV), art. no. 141.
- Robinson, B.S. et Christy, P.E. (1984). Disinfection of water for control of amoebae. Water, (11): 21-24.
- Rogues, A.M., Boulestreau, H., Lashéras, A., Boyer, A., Gruson, D., Merle, C., Castaing, Y., Bébear, C.M. et Gachie, J.-. (2007). Contribution of tap water to patient colonisation with Pseudomonas aeruginosa in a medical intensive care unit. J. Hosp. Infect., 67(1): 72-78.
- Rohr, U., Weber, S., Michel, R., Selenka, F. et Wilhelm, M. (1998). Comparison of free-living amoebae in hot water systems of hospitals with isolates from moist sanitary areas by identifying genera and determining temperature tolerance. Appl. Environ. Microbiol., 64 (5), pp. 1822-1824.
- Rose, L.J., Rice, E.W., Hodges, L., Peterson, A. et Arduino, M.J. (2007). Monochloramine inactivation of bacterial select agents. Appl. Environ. Microbiol., 73(10): 3437-3439.
- Roser, D.J., Van Den Akker, B., Boase, S., Haas, C.N., Ashbolt, N.J. et Rice, S.A. (2014). Pseudomonas aeruginosa dose response and bathing water infection. Epidemiol. Infect., 142(3): 449-462.
- Sabina, Y., Rahman, A., Ray, R.C. et Montet D. (2011). Yersinia enterocolitica: Mode of transmission, molecular insights of virulence, and pathogenesis of infection. J. Pathog. 2011. Article ID 429069.
- Sanchez-Vargas, F.M., Abu-El-Haija, M.A. et Gomez-Duarte, O.G. (2011). Salmonella infections: An update on epidemiology, management, and prevention. Travel Med. Infect. Dis., 9(6): 263-277.
- Santé Canada. (2018). Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – chloramines – en préparation. Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Canada.
- Santé Canada. (2019a). Parlons d’eau - Et puis, votre puits? Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada. Ottawa, Ontario. Accédé en février 2020 : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/parlons-eau-puits.html
- Santé Canada. (2019b). Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l’eau potable dans les réseaux de distribution —en préparation. Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada. Ottawa, Ontario.
- Santé Canada. (2019c). Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — virus entériques. Bureau de l’eau, de l’air et des changements climatiques, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario.
- Santé Canada. (2019d). Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Protozoaires entériques : Giardia et Cryptosporidium. Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario.
- Santé Canada. (2019e). Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada — Documents technique —Escherichia coli– en préparation. Bureau de l’eau, de l’air et des changements climatiques, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario.
- Santiago, P., Moreno, Y. et Ferrús, M.A. (2015). Identification of viable Helicobacter pylori in drinking water supplies by cultural and molecular techniques. Helicobacter, 20(4): 252-259.
- Sarkar, P. et Gerba, C.P. (2012). Inactivation of Naegleria fowleri by chlorine and ultraviolet light. J. Am. Water Works Assoc., 104(3): 51-52.
- Saxena, G., Bharagava, R.N., Kaithwas, G. et Raj, A. (2015). Microbial indicators, pathogens and methods for their monitoring in water environment. J. Water Health, 13(2): 319-339.
- Scallan, E., Hoekstra, R. M., Angulo, F. J., Tauxe, R. V., Widdowson, M., Roy, S. L. et Griffin, P. M. (2011). Foodborne Illness Acquired in the United States—Major Pathogens. Emerg. Infect. Dis., 17(1), 7-15. https://dx.doi.org/10.3201/eid1701.p11101.
- SCC. (2019). Directory of Accredited Product, Process and Service Certification Bodies. Standards Council of Canada, Ottawa, Ontario. Available at https://www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and-service-certification/directory-of-accredited-clients
- Schaffter, N. et Parriaux, A. (2002). Pathogenic-bacterial water contamination in mountainous catchments. Water Res., 36(1): 131-139.
- Schiavano, G.F., De Santi, M., Sisti, M., Amagliani, G. et Brandi, G. (2018). Disinfection of Mycobacterium avium subspecies hominissuis in drinking tap water using ultraviolet germicidal irradiation. Environ.Technol. (United Kingdom), 39(24): 3221-3227.
- Schoen, M.E. et Ashbolt, N.J. (2011). An in-premise model for Legionella exposure during showering events. Water Res., 45(18): 5826-5836.
- Schulze-Robbecke, R. et Buchholtz, K. (1992). Heat susceptibility of aquatic mycobacteria. Appl. Environ. Microbiol., 58(6): 1869-1873.
- Schwake, D.O., Garner, E., Strom, O.R., Pruden, A. et Edwards, M.A. (2016). Legionella DNA markers in tap water coincident with a spike in Legionnaires' disease in Flint, MI. Environ. Sci. Technol. Let., 3(9): 311-315.
- Sebakova, H., Kozisek, F., Mudra, R., Kaustova, J., Fiedorova, M., Hanslikova, D., Nachtmannova, H., Kubina, J., Vraspir, P. et Sasek, J. (2008). Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of disinfection. Can. J. Microbiol., 54(11): 891-898.
- Segal, I., Otley, A., Issenman, R., Armstrong, D., Espinosa, V., Cawdron, R., Morshed, M.G. et Jacobson, K. (2008). Low prevalence of Helicobacter pylori infection in Canadian children: A cross-sectional analysis. Can. J. Gastroenterol., 22 (5):485-489.
- Sen, K. et Rodgers, M. (2004). Distribution of six virulence factors in Aeromonas species isolated from US drinking water utilities: A PCR identification. J. Appl. Microbiol., 97(5): 1077-1086.
- Sethi, A., Chaudhuri, M., Kelly, L. et Hopman, W. (2013). Prevalence of Helicobacter pylori in a First Nations population in northwestern Ontario. Can. Fam. Physician, 59 (4): e182-e187.
- Siddiqui, R., Ali, I.K.M., Cope, J.R. et Khan, N.A. (2016). Biology and pathogenesis of Naegleria fowleri. Acta Trop., 164: 375-394.
- Sisti, M., Albano, A. et Brandi, G. (1998). Bactericidal effect of chlorine on motile Aeromonas spp. in drinking water supplies and influence of temperature on disinfection efficacy. Lett. Appl. Microbiol., 26(5): 347-351.
- Smeets, P., Rietveld, L., Hijnen, W., Medema, G. et Stenstrom, T. (2006). Efficacy of water treatment processes. In MicroRisk—microbiological risk assessment: A scientific basis for managing drinking water safety from source to tap. April 2006. Accédé juin 2019 à : www.kwrwater.nl
- Smeets, P. W. M. H., Medema, G.J. et Van Dijk, J.C. (2009). The Dutch secret: How to provide safe drinking water without chlorine in the Netherlands. Drink. Water Eng. Sci., 2(1): 1-14.
- Sobsey, M.D. (1989). Inactivation of health-related microorganisms in water by disinfection processes. Water Sci. Technol., 21(3): 179-195.
- Soda, E.A. (2017). Vital signs: Health Care–Associated Legionnaires' disease surveillance data from 20 states and a large metropolitan area—United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 66.
- Solnick, J.V., Hansen, L.M., Canfield, D.R. et Parsonnet, J. (2001). Determination of the infectious dose of Helicobacter pylori during primary and secondary infection in rhesus monkeys (Macaca mulatta). Infect. Immun., 69(11): 6887-6892.
- Sommer, R., Lhotsky, M., Haider, T. et Cabaj, A. (2000). UV inactivation, liquid-holding recovery, and photoreactivation of Escherichia coli O157 and other pathogenic Escherichia coli strains in water. J. Food Prot., 63(8): 1015-1020.
- Sood, G. et Parrish, N. (2017). Outbreaks of nontuberculous mycobacteria. Curr. Opin. Infect. Dis., 30(4): 404-409.
- Spinale, J.M., Ruebner, R.L., Copelovitch, L. et Kaplan, B.S. (2013). Long-term outcomes of Shiga toxin hemolytic uremic syndrome. Pediatr. Nephrol., 28 (11):2097-2105.
- Springston, J.P. et Yocavitch, L. (2017). Existence and control of Legionella bacteria in building water systems: A review. J. Occup. Environ. Hyg., 14(2): 124-134.
- Sterk, A., Schijven, J., De Nijs, T. et De Roda Husman, A.M. (2013). Direct and indirect effects of climate change on the risk of infection by water-transmitted pathogens. Environ. Sci. Technol., 47 (22):12648-12660.
- Stinear, T., Ford, T. et Vincent, V. (2004). Analytical methods for the detection of waterborne and environmental pathogenic mycobacteria. In Pathogenic mycobacteria in water. A guide to public health consequences, monitoring and management. Pedley, S. (ed.). IWA Publishing. Organisation mondiale de la santé., Genève, Suisse. pp. 55-73.
- Storey, M.V., Winiecka-Krusnell, J., Ashbolt, N.J. et Stenström, T.-A. (2004). The efficacy of heat and chlorine treatment against thermotolerant acanthamoebae and legionellae. Scand. J. Infect. Dis., 36(9): 656-662.
- Stout, J.E., YU, V.L., Yee, Y.C., Vaccarello, S., Diven, W. et Lee, T.C. (1992). Legionella pneumophila in residential water supplies: Environmental surveillance with clinical assessment for Legionnaires' disease. Epidemiol. Infect., 109(1): 49-57.
- Stout, J.E., et coll., (2007). Role of environmental surveillance in determining the risk of hospital-acquired legionellosis: A national surveillance study with clinical correlations. Infect. Cont. Hosp. Ep., 28 (7): 818-824.
- Stout, J.E., Koh, W.-J. et Yew, W.W. (2016). Update on pulmonary disease due to non-tuberculous mycobacteria. Int. J. Infect. Dis., 45: 123-134.
- Surman-Lee, S., Fields, B., Hornei, B., Ewig, S., Exner, M., Tartakovsky, I., Lajoie, L., Dangendorf, F., Bentham, R., Cabanes, P.A., Fourrier, P., Trouvet, T. et France Wallet, F. (2007). Chapter 2: Ecology and environmental sources of Legionella. In Legionella and the prevention of legionellosis. Bartram, J. et. coll. (eds.). Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. pp. 29-38.
- Taylor, R.H., Falkinham III, J.O., Norton, C.D. et LeChevallier, M.W. (2000). Chlorine, chloramine, chlorine dioxide, and ozone susceptibility of Mycobacterium avium. Appl. Environ. Microbiol., 66(4): 1702-1705.
- Tempark, T., Lueangarun, S., Chatproedprai, S. et Wananukul, S. (2013). Flood-related skin diseases: A literature review. Int. J. Dermatol., 52(10): 1168-1176.
- Teunis, P. et Figueras, M.J. (2016). Reassessment of the enteropathogenicity of mesophilic Aeromonas species. Front. Microbiol., 7(Article 1395):1-12.
- Thomas, M.K., Charron, D.F., Waltner-Toews, D., Schuster, C., Maarouf, A.R. et Holt, J.D. (2006). A role of high impact weather events in waterborne disease outbreaks in Canada, 1975-2001. Int. J. Environ. Heal. R., 16 (3): 167-180.
- Thomas, J.M. et Ashbolt, N.J. (2011). Do free-living amoebae in treated drinking water systems present an emerging health risk? Environ. Sci. Technol., 45(3): 860-869.
- Thomson, R.M., Carter, R., Tolson, C., Coulter, C., Huygens, F. et Hargreaves, M. (2013). Factors associated with the isolation of nontuberculous mycobacteria (NTM) from a large municipal water system in Brisbane, Australia. BMC Microbiol., 13(1).
- Todd, E.C.D. (2014). Bacteria: Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis. In: Encyclopedia of food safety. Volume 1. Academic Press, Cambridge, USA, pp. 574-580.
- Tossa, P., Deloge-Abarkan, M., Zmirou-Navier, D., Hartemann, P. et Mathieu, L. (2006). Pontiac fever: An operational definition for epidemiological studies. BMC Public Health, 6(1): 112.
- Trolio, R., Bath, A., Gordon, C., Walker, R. et Wyber, A. (2008). Operational management of Naegleria spp. in drinking water supplies in Western Australia. Water Sci. Technol.—W. Supp., 8(2): 207-215.
- US EPA. (1989). National Primary Drinking Water Regulations; Filtration, Disinfection; Turbidity, Giardia lamblia, Viruses, Legionella, and Heterotrophic Bacteria; Final Rule. Part III. Federal Register, 54:124:27486.
- US EPA. (2001). Method 1605: Aeromonas in Finished Water by Membrane Filtration using Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V). United States Environmental Protection Agency, Office of Water. Washington, DC. EPA-821-R-01-034.
- US EPA. (2006a). Aeromonas: Human Health Criteria Document. United States Environmental Protection Agency, Office of Water. Washington, D.C. March 2006.
- US EPA. (2006b). National primary drinking water regulations: Long term 2 enhanced surface water treatment rule. Final rule. Fed. regist., 71(3): 653–702.
- US EPA. (2016). Technologies for Legionella control in premise plumbing systems: Scientific literature review. United States Environmental Protection Agency, Office of Water. Washington, DC. EPA 810-R-16-001. September 2016.
- van der Wielen, P. W. J. J. et van der Kooij, D. (2013). Nontuberculous mycobacteria, fungi, and opportunistic pathogens in unchlorinated drinking water in the Netherlands. Appl. Environ. Microbiol., 79(3): 825-834.
- Vicuña-Reyes, J.P., Luh, J. et Mariñas, B.J. (2008). Inactivation of Mycobacterium avium with chlorine dioxide. Water Res., 42(6-7): 1531-1538.
- Vinnard, C., Longworth, S., Mezochow, A., Patrawalla, A., Kreiswirth, B.N. et Hamilton, K. (2016). Deaths related to nontuberculous mycobacterial infections in the United States, 1999-2014. Annals of the American Thoracic Society, 13(11): 1951-1955.
- Visvesvara, G.S., Moura, H. et Schuster, F.L. (2007). Pathogenic and opportunistic free-living amoebae: Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, and Sappinia diploidea. FEMS Immunol. Med. Mic., 50(1): 1-26.
- Waddell, L.A., Rajic, A., Stärk, K.D.C. et McEwen, S.A. (2015). The zoonotic potential of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis: A systematic review and meta-analyses of the evidence. Epidemiol. Infect., 143 (15):3135-3157.
- Waddell, L., Rajić, A., Stärk, K. et McEwen, S.A. (2016). Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis detection in animals, food, water and other sources or vehicles of human exposure: A scoping review of the existing evidence. Prev. Vet. Med., 132:32-48.
- Wagenaar, J.A., Newell, D.G., Kalupahana, R.S. et Lapo Mughini-Gras, L. (2015). Campylobacter: Animal reservoirs, human infections, and options for control. In Zoonoses-infections affecting humans and animals: Focus on public health aspects. Sing, A. (ed.). Springer. Dordrecht, Netherlands. pp. 159-177.
- Wang, H., Edwards, M., Falkinham, J.O. et Pruden, A. (2012a). Molecular survey of the occurrence of Legionella spp., Mycobacterium spp., Pseudomonas aeruginosa, and amoeba hosts in two chloraminated drinking water distribution systems. Appl. Environ. Microbiol., 78(17): 6285-6294.
- Wang, H., Masters, S., Hong, Y., Stallings, J., Falkinham, J.O.,3rd, Edwards, M.A. et Pruden, A. (2012b). Effect of disinfectant, water age, and pipe material on occurrence and persistence of Legionella, mycobacteria, Pseudomonas aeruginosa, and two amoebas. Environ. Sci. Technol., 46(21): 11566-11574.
- Wang, H., Bédard, E., Prévost, M., Camper, A.K., Hill, V.R. et Pruden, A. (2017). Methodological approaches for monitoring opportunistic pathogens in premise plumbing: A review. Water Res., 117: 68-86.
- Watson, C.L., Owen, R.J., Said, B., Lai, S., Lee, J.V., Surman-Lee, S. et Nichols, G. (2004). Detection of Helicobacter pylori by PCR but not culture in water and biofilm samples from drinking water distribution systems in England. J. Appl. Microbiol., 97(4): 690-698.
- Weigel, K.M., Nguyen, F.K., Kearney, M.R., Meschke, J.S. et Cangelosi, G.A. (2017). Molecular viability testing of UV-inactivated bacteria. Appl. Environ. Microbiol., 83(10).
- Weintraub, J.M., Flannery, B., Vugia, D.J., Gelling, L.B., Salerno, J.J., Conroy, M.J., Stevens, V.A., Rose, C.E., Besser, R.E., Fields, B.S. et Moore, M.R. (2008). Legionella reduction after conversion to monochloramine for residual disinfection. J. Am. Water Works Assoc., 100(4): 129-139.
- Weiss, D., Boyd, C., Rakeman, J.L., et coll. (2017). A large community outbreak of Legionnaires' disease associated with a cooling tower in New York City, 2015. Public Health Rep., 132(2): 241-250.
- Whiley, H., van den Akker, B., Giglio, S. et Bentham, R. (2013). The role of environmental reservoirs in human campylobacteriosis. Int. J. Environ. Res. Public Health, 10(11): 5886-5907.
- Whiley, H., Keegan, A., Fallowfield, H. et Bentham, R. (2014). Detection of Legionella, L. pneumophila and Mycobacterium avium complex (MAC) along potable water distribution pipelines. Int. J. Env. Res. Pub. He., 11(7): 7393-7405.
- Williams, M.M., Chen, T., Keane, T., Toney, N., Toney, S., Armbruster, C.R., Ray Butler, R. et Arduino, M.J. (2011). Point-of-use membrane filtration and hyperchlorination to prevent patient exposure to rapidly growing mycobacteria in the potable water supply of a skilled nursing facility. Infect. Con. Hosp. Ep., 32(9): 837-844.
- Wilson, R.E., Hill, R.L.R., Chalker, V.J., Mentasti, M., et Ready, D. (2018). Antibiotic susceptibility of Legionella pneumophila strains isolated in England and Wales 2007–17. J. Antimicrob. Chemoth., 73 (10): 2757-2761.
- Wingender, J. et Flemming, H.-C. (2004). Contamination potential of drinking water distribution network biofilms. Water Sci. Technol., 49(11-12): 277-286.
- Winiecka-Krusnell, J., Wreiber, K., Von Euler, A., Engstrand, L. et Linder, E. (2002). Free-living amoebae promote growth and survival of Helicobacter pylori. Scand. J. Infect. Dis., 34(4): 253-256.
- Wojcicka, L., Hofmann, R., Baxter, C., Andrews, R.C., Auvray, I., Lière, J., Miller, T., Chauret, C. et Baribeau, H. (2007). Inactivation of environmental and reference strains of heterotrophic bacteria and Escherichia coli O157:H7 by free chlorine and monochloramine. J. Water Supply Res. Technol. Aqua, 56(2): 137-150.
- Wong, E.A. et Shin, G.-A. (2015). Removal of Mycobacterium avium subspecies hominissuis (MAH) from drinking water by coagulation, flocculation and sedimentation processes. Lett. Appl. Microbiol., 60(3): 273-278.
- Wullings, B.A., Bakker, G. et Van, D.K. (2011). Concentration and diversity of uncultured Legionella spp. in two unchlorinated drinking water supplies with different concentrations of natural organic matter. Appl. Environ. Microbiol., 77(2): 634-641.
- Xue, Z., Hessler, C.M., Panmanee, W., Hassett, D.J. et Seo, Y. (2013). Pseudomonas aeruginosa inactivation mechanism is affected by capsular extracellular polymeric substances reactivity with chlorine and monochloramine. FEMS Microbiol. Ecol., 83(1): 101-111.
- Yoder, J., Roberts, V., Craun, G.F., Hill, V., Hicks, L.A., Alexander, N.T., Radke, V., Calderon, R.L., Hlavsa, M.C., Beach, M.J. et Roy, S.L. (2008). Surveillance for waterborne disease and outbreaks associated with drinking water and water not intended for drinking—United States, 2005-2006. MMWR Surveill. Summ., 57(9): 39-62.
- Yoder, J.S., Eddy, B.A., Visvesvara, G.S., Capewell, L. et Beach, M.J. (2010). The epidemiology of primary amoebic meningoencephalitis in the USA, 1962-2008. Epidemiol. Infect., 138(7): 968-975.
- Yoder, J.S., Straif-Bourgeois, S., Roy, S.L., Moore, T.A., Visvesvara, G.S., Ratard, R.C., Hill, V.R., Wilson, J.D., Linscott, A.J., Crager, R., Kozak, N.A., Sriram, R., Narayanan, J., Mull, B., Kahler, A.M., Schneeberger, C., Da Silva, A.J., Poudel, M., Baumgarten, K.L., Xiao, L. et Beach, M.J. (2012a). Primary amebic meningoencephalitis deaths associated with sinus irrigation using contaminated tap water. Clin. Infect. Dis., 55(9): e7-e85.
- Yoder, J.S., Verani, J., Heidman, N., Hoppe-Bauer, J., Alfonso, E.C., Miller, D., Jones, D.B., Bruckner, D., Langston, R., Jeng, B.H., Joslin, C.E., Tu, E., Colby, K., Vetter, E., Ritterband, D., Mathers, W., Kowalski, R.P., Acharya, N.R., Limaye, A.P., Leiter, C., Roy, S., Lorick, S., Roberts, J. et Beach, M.J. (2012b). Acanthamoeba keratitis: The persistence of cases following a multistate outbreak. Ophthalmic Epidemiology, 19(4): 221-225.
- Yu, C.-P., Farrell, S.K., Robinson, B. et Chu, K.-H. (2008). Development and application of real-time PCR assays for quantifying total and aerolysin gene-containing Aeromonas in source, intermediate, and finished drinking water. Environ. Sci. Technol., 42(4): 1191-1200.
- Zahran, S., McElmurry, S.P., Kilgore, P.E., Mushinski, D., Press, J., Love, N.G., Sadler, R.C. et Swanson, M.S. (2018). Assessment of the Legionnaires' disease outbreak in Flint, Michigan. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(8): E173-E1739.
- Zamani, M., Ebrahimtabar, F., Zamani, V., Miller, W.H., Alizadeh-Navaei, R., Shokri-Shirvani, J. et Derakhshan, M.H. (2018). Systematic review with meta-analysis: the worldwide prevalence of Helicobacter pylori infection. Aliment. Pharm. Therap., 47 (7):868-876.
- Zaongo, S.D., Shaio, M.-F. et Ji, D.-D. (2018). Effects of culture media on Naegleria fowleri growth at different temperatures. J. Parasitol., 104 (5):451-456.
- Zautner, A.E. et Masanta, W.O. (2016). Campylobacter: Health Effects and Toxicity. In Encyclopedia of Food and Health. Caballero, B. et coll. (eds.). Academic Press, Cambridge, USA. pp. 596-601.
- Zhang, Y.Q., Wu, Q.P., Zhang, J.M. et Yang, X.H. (2015). Effects of ozone on the cytomembrane and ultrastructure of Pseudomonas aeruginosa. Food Sci. Biotechnol., 24(3): 987-993.
- Zimmer, J.L. et Slawson, R.M. (2002). Potential repair of Escherichia coli DNA following exposure to UV radiation from both medium- and low-pressure UV sources used in drinking water treatment. Appl. Environ. Microbiol., 68 (7): 3293-3299.
- Zimmer-Thomas, J.L., Slawson, R.M. et Huck, P.M. (2007). A comparison of DNA repair and survival of Escherichia coli O157:H7 following exposure to both low- and medium- pressure UV irradiation. J. Water Health, 5(3): 407-415.
- Zuma, F.N., Lin, J. et Jonnalagadda, S.B. (2009). Kinetics of inactivation of Pseudomonas aeruginosa in aqueous solutions by ozone aeration. J. Environ. Sci. Health Part A Toxic Hazard. Subst. Environ. Eng., 44(10): 929-935.
Annexe A : Listes d'abréviations
- ADN
- acide désoxyribonucléique
- ANSI
- American National Standards Institute
- ASHRAE
- American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers
- ASPC
- Agence de la santé publique du Canada
- BLSE
- β-lactamases à spectre élargi
- CAG
- charbon actif en granulés
- CCN
- Conseil canadien des normes
- CDC
- Centers for Disease Control and Prevention
- CEP
- Comité (fédéral-provincial-territorial) sur l'eau potable
- CIRC
- Centre international de recherche sur le cancer
- CNP
- Code national de la plomberie (Canada)
- CT
- concentration (C) x temps (T)
- CVC
- chauffage, ventilation et climatisation
- US
- États-Unis
- EAG
- encéphalite amibienne granulomateuse
- ECAD
- E. coli à adhésion diffuse
- ECEA
- E. coli entéroagrégative
- ECEH
- E. coli entérohémorragique
- ECEI
- E. coli entéroinvasive
- ECEP
- E. coli entéropathogène
- ECET
- E. coli entérotoxinogène
- ECST
- Escherichia coli productrice de shigatoxines
- ECVT
- Escherichia coli vérotoxinogène
- EQMR
- Évaluation quantitative du risque microbien
- ISO
- Organisation internationale de normalisation
- KA
- kératite à Acanthamoeba
- MAP
- méningoencéphalite amibienne primitive
- MNT
- mycobactérie non tuberculeuse
- NAS
- National Academies of Sciences
- NPBH
- numération sur plaque des bactéries hétérotrophes
- NSF
- NSF International
- OMS
- Organisation mondiale de la santé
- PCR
- réaction en chaine de la polymérase
- PE
- point d'entrée
- PU
- point d'utilisation
- SHU
- syndrome hémolytique et urémique
- SIDA
- syndrome d'immunodéficience acquise
- Spp.
- espèces
- UE
- Union européenne
- UFC
- unité formant des colonies
- US EPA
- Environmental Protection Agency des États-Unis
- UV
- ultraviolet
- VIH
- virus de l'immunodéficience humaine
- VNC
- viable mais non cultivable
| Agent pathogène | Espèces les plus fréquemment associées à une maladie humaine | Effets sur la santé | Groupes à risque élevé de maladie | Principaux réservoirs | Principal mode de transmission hydrique | Importance en tant qu'agent pathogène présent dans l'eau potable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campylobacter spp. | C. jejuni et C. coli | Gastroentérite (symptômes : diarrhée aqueuse, abondante et parfois mêlée de sang; fièvre et douleurs abdominales). | Jeunes enfants, jeunes adultes et personnes âgées | Volaille, bovins, ovins et animaux de compagnie | Ingestion d'eau contaminée par des matières fécales | Bien documenté comme cause d'éclosions liées à de l'eau potable contaminée. |
| Escherichia coli et Shigella spp. pathogènes | Groupe des E. coli entérohémorragiques (ECEH) Le sérotype O157:H7 d'E. Coli est prédominant. | Gastroentérite (symptômes : diarrhée aqueuse qui peut s'accompagner de pertes de sang, de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et de fièvre). Les maladies causées par les ECEH peuvent évoluer en syndrome hémolytique et urémique (SHU), potentiellement mortel, qui se traduit par une diminution des numérations globulaire et plaquettaire et une insuffisance rénale aigüe. |
Jeunes enfants et personnes âgées | Bovins et autres ruminants et humains | Ingestion d'eau potable contaminée par des matières fécales | Bien documenté comme cause d'éclosions liées à de l'eau potable contaminée. |
| Shigella spp. : S. sonnei et S. flexneri | Gastroentérite (symptômes : diarrhée aqueuse qui peut s'accompagner de pertes de sang, de douleurs abdominales et de fièvre). | Jeunes enfants | Humains | Ingestion d'eau contaminée par des matières fécales | Rarement associés à des éclosions liées à la contamination de l'eau potable. | |
| Helicobacter pylori | H. pylori | Gastrite superficielle asymptomatique Certaines infections évoluent en ulcères gastriques ou duodénaux. | Personnes vivant dans des zones densément peuplées ou dans des conditions d'hygiène médiocres | Humains | L'ingestion d'eau contaminée par des matières fécales est suspectée comme étant un mode de transmission possible | Il est nécessaire d'investiguer davantage sur l'importance de l'eau potable comme source d'infection. |
| Salmonella spp. | Les groupes de Salmonella non typhoïdiques, notamment : les sérotypes S. Enteritidis et S. Typhimurium | Gastroentérite (diarrhée, fièvre et douleurs abdominales). Cas graves chez les personnes immunodéprimées : l'Infection peut se répandre à d'autres parties du corps (p. ex. le sang, l'urine, les articulations et le cerveau). |
Jeunes enfants, personnes âgées et individus immunodéprimés | Poules, cochons, dinde et bovins | Ingestion d'eau contaminée par des matières fécales | Rarement associés à des éclosions liées à la contamination de l'eau potable. |
| Yersinia spp. | Y. enterocolitica et Y. paratuberculosis | Gastroentérite de gravité variable selon la souche incriminée (symptômes : diarrhée qui peut s'accompagner de pertes de sang, de fièvre et de douleurs abdominales chez les enfants; symptômes similaires à ceux de l'appendicite chez les adultes). | Jeunes enfants, personnes âgées et individus immunodéprimés | Y. enterocolitica : Cochons, ruminants, chiens et chats Y. paratuberculosis : rongeurs et oiseaux | Ingestion d'eau contaminée par des matières fécales | Rarement associés à des éclosions liées à la contamination de l'eau potable. |
| Agent pathogène | Espèces les plus fréquemment associées à une maladie humaine | Effets sur la santé | Groupes à risque élevé de maladie | Principaux réservoirs | Principal mode de transmission hydrique | Importance en tant qu'agent pathogène présent dans l'eau potable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromonas spp. | A. hydrophila, A. caviae, A. veronii (biotype sobria) et A. trota | Associées à des maladies et syndromes intestinaux et extra-intestinaux variés. La gastroentérite est la maladie la plus commune (symptômes : diarrhée aqueuse accompagnée de fièvre légère, de vomissements et de douleurs abdominales). |
Jeunes enfants, personnes âgées et individus immunodéprimés | Bactéries ubiquitaires, présentes dans des habitats très variés, dont les milieux aquatiques, les sols, les espèces animales vertébrées et invertébrées, les insectes et la nourriture. |
Ingestion d'eau contaminée | Il est nécessaire d'investiguer davantage sur l'importance de l'eau potable comme source d'infection. |
| Legionella spp. | L. pneumophila (principalement le sérogroupe 1) | La maladie du légionnaire : maladie respiratoire grave provoquant une pneumonie. Fièvre de Pontiac : maladie bénigne, similaire à la grippe, autolimitée et non pulmonaire. |
Personnes âgées, fumeurs, sujets immunodéprimées ou atteintes de maladies sous-jacentes | Protozoaire libre potentiellement présent dans les biofilms dans la nature et dans les réseaux d'eau de distribution d'eau (grandes installations de plomberie, tours de refroidissement, réseaux de distribution d'eau potable) |
Inhalation d'aérosols contaminés générés par des appareils associés à des systèmes de CVC, des installations de plomberie et des dispositifs d'humidification | Bien documenté comme une cause d'éclosions liées à des réseaux de distribution d'eau (tours de refroidissement, installations de plomberie) de grands édifices (le plus souvent des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des hôtels et des complexes touristiques). |
| Mycobacterium spp. | Groupe des mycobactéries non tuberculeuses (MNT), en particulier : le complexe M. avium (CMA) : M. avium et ses sous-espèces, M. intracellulare et M. chimaera |
Maladie pulmonaire Symptômes : toux persistante, asthénie et sueurs nocturnes. Dans les cas graves, chez les personnes immunodéprimées, l'infection peut se répandre à d'autres parties du corps (p. ex. les articulations, le foie et le cerveau). Autres maladies : adénopathie cervicale et infections de la peau et des tissus mous. |
Individus immunodéprimés ou atteints de troubles respiratoires sous-jacents | Sols, habitats aquatiques, biofilms se formant dans les réseaux de distribution d'eau (installations de plomberie, réseaux de distribution d'eau potable) |
Inhalation d'aérosols contaminés générés par des appareils associés à des installations de plomberie et des dispositifs d'humidification | Aucune éclosion rapportée en lien avec la contamination de l'eau potable L'eau contaminée peut constituer une importante source d'infection dans des conditions spécifiques (p. ex. des établissements de soins de santé) pour les groupes de personnes à risque. |
| Pseudomonas spp. | P. aeruginosa | Infections respiratoires (symptômes : fièvre, frissons, toux et respiration difficile); infections touchant la peau, les yeux, les oreilles et l'appareil urinaire. |
Personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies sous-jacentes (en particulier la mucoviscidose), patients qui reçoivent des soins utilisant des dispositifs invasifs ou qui présentent des brulures ou des traumatismes pénétrants (incisions chirurgicales, plaies) | Bactérie ubiquitaire présente dans des habitats très variés, dont le sol, les milieux aquatiques, la végétation et les biofilms qui se forment dans les réseaux de distribution d'eau (circuits de plomberie) |
Contact corporel direct avec de l'eau contaminée ou des appareils en contact avec de l'eau provenant de réseaux de distribution contaminés |
Aucune éclosion rapportée en lien avec la contamination de l'eau potable. L'eau contaminée peut constituer une importante source d'infection dans des conditions spécifiques (p. ex. des établissements de soins de santé) pour les groupes de personnes à risque. |
| Acanthamoeba spp. | Génotype T4 d'Acanthamoeba | Kératite à Acanthamoeba (KA), une maladie menaçant la vision (symptômes : vision floue, fortes douleurs et photosensibilité élevée; évolution en cas graves : ulcération de la cornée, gonflement de l'œil, glaucome, cataractes et cécité). |
Porteurs de lentilles de contact | Ubiquitaires dans le sol et l'eau; présent également dans les biofilms se formant dans les réseaux de distribution d'eau (circuits de plomberie, réseaux de distribution d'eau potable, tours de refroidissement) et dans les poussières en suspension dans l'air |
Contact des yeux avec des lentilles exposées à de l'eau contenant des bactéries durant le nettoyage, l'entreposage ou le port de ces lentilles | L'incidence de la maladie est très faible Peuvent servir d'hôtes à des bactéries pathogènes, comme les Legionella et les mycobactéries non tuberculeuses. |
| Naegleria spp. | N. fowleri | Méningoencéphalite amibienne primitive (symptômes similaires à ceux d'une méningite virale ou bactérienne : maux de tête, fièvre, nausées et vomissements; évolution : raideur de la nuque, altération des facultés mentales, hallucinations occasionnelles, coma); infections presque toujours mortelles. |
Enfants et jeunes adultes participant à des activités de loisir aquatiques, lors desquelles les bactéries sont présentes; personnes procédant à des irrigations nasales avec de l'eau non stérile | Milieux d'eau douce chaude (lacs, rivières, sources thermales) et sols Peuvent s'adapter pour croitre dans des biofilms se formant dans les réseaux de distribution d'eau et les installations de plomberie, si les conditions sont favorables (température |
Contact intranasal avec de l'eau contaminée durant des activités de plongée, de natation, de baignade ou de pataugeage ou lors d'irrigations nasales | L'incidence de la maladie est très faible Les bactéries ont causé des infections et ont été isolés à partir de réseaux de canalisations d'eau essentiellement dans des zones climatiques subtropicales. Peuvent servir d'hôtes à des bactéries pathogènes, comme les Legionella et les mycobactéries non tuberculeuses. |
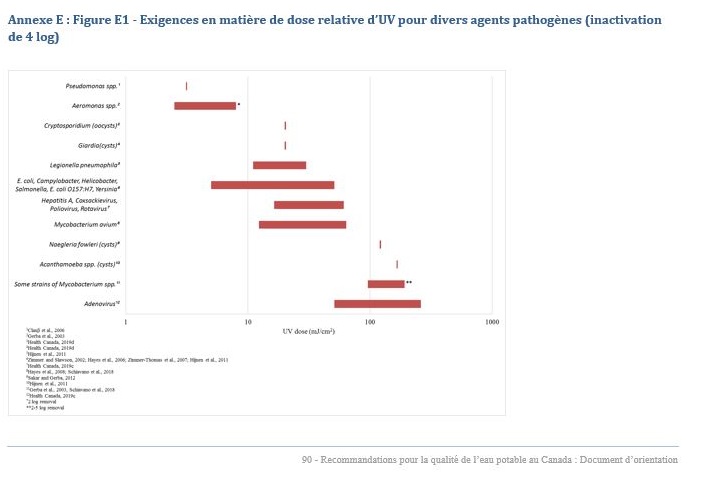
Figure D1 - Équivalent textuel
Un graphique qui montre les valeurs CT requises pour une inactivation de 2 log de divers agents pathogènes d’origine hydrique utilisant le chlore libre. L’axe des X du graphique représente les valeurs CT exprimées en milligramme minutes par litre. Il est présenté sur une échelle logarithmique et les valeurs de l’axe vont de 0,001 à 10 000. L’axe des ordonnées du graphique affiche différents agents pathogènes ou des groupes d’agents pathogènes. Chaque agent pathogène ou groupe d’agents est marqué avec une note de bas de page qui correspond aux références utilisées. Dans le graphique, les valeurs CT sont affichées sous forme de barres qui s’étendent de la valeur la plus basse à la valeur la plus élevée. Les valeurs CT affichées sont les suivantes : 1. Aeromonas spp. : 0,2 à 1,4; 2. Pseudomonas spp. : 0,0073 à 4,3; 3. Le groupe d’E. coli, Campylobacter, Helicobacter, Salmonella, E. coli O157:H7 et Yersinia : 0,034 à 5,1; 4. Les virus entériques : 0,01 à 12; 5. Les kystes de Naegleria fowleri : 31 à 37; 6. Les kystes de Giardia : 25 à 99; 7. Legionella pneumophila : 25 à 1 000; 8. Mycobacterium avium : 51 à 1 552; 9. Les kystes d’Acanthamoeba spp. : 1 300; 10. Les oocystes de Cryptosporidium : 7 200.. Le graphique a deux autres marqueurs de note de bas de page – un (*) à côté de la barre pour les kystes de Naegleria fowleri pour indiquer que ces valeurs sont pour une inactivation de 4 log, et un (**) à côté de la barre pour Mycobacterium avium pour indiquer que ces valeurs sont pour une inactivation de 3 log. La liste des notes de bas de page est affichée sous le graphique et inclue : 1. Massa et coll., 1999; Gerba et coll., 2003; 2. Perez-Recuerda et coll., 1998; Xue et coll., 2013; 3. Hoff, 1986; Lund et coll., 1996; Johnson et coll., 1997; Perez-Recuerda et coll., 1998; Rice et coll., 1999; Baker et coll., 2002; Wojcicka et coll., 2007; Rasheed et coll., 2016; 4. Santé Canada, 2019c; 5. Sakar and Gerba, 2012; 6. Santé Canada, 2019d; 7. Jacangelo et coll., 2002; 8. Taylor et coll., 2000; 9. Loret et coll., 2008; 10. Santé Canada, 2019d; (*) inactivation de 4 log; (**) inactivation de 3 log.
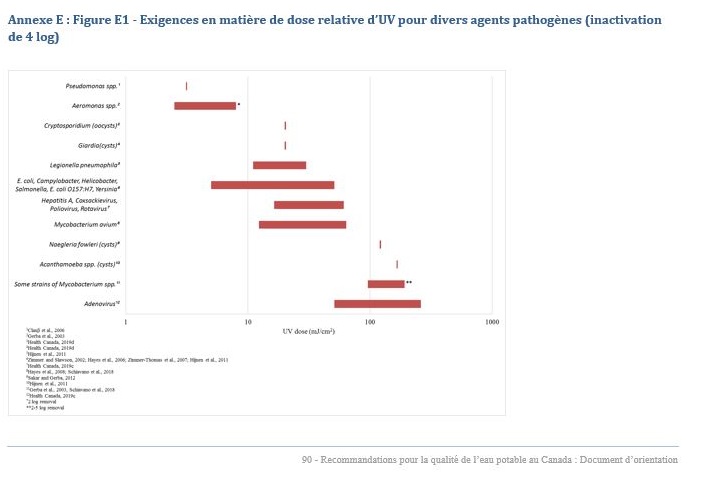
Figure E - Équivalent textuel
Un graphique qui montre les doses d’UV requissent pour une inactivation de 4 log de divers agents pathogènes d’origine hydrique. L’axe des X du graphique représente la dose d’UV exprimées en millijoules par centimètre carré. Il est présenté sur une échelle logarithmique et les valeurs de l’axe vont de 1 à 1 000. L’axe des ordonnées du graphique affiche différents agents pathogènes ou des groupes d’agents pathogènes. Chaque agent pathogène ou groupe d’agents est marqué avec une note de bas de page qui correspond aux références utilisées. Dans le graphique, les doses d’UV sont affichées sous forme de barres qui s’étendent de la valeur la plus basse à la valeur la plus élevée. Les doses d’UV affichées pour les agents pathogènes ou des groupes d’agents pathogènes sont les suivantes : 1. Pseudomonas spp. : 3,1; 2. Aeromonas spp. : 2,5 à 8; 3. Les oocystes de Cryptosporidium : 22; 4. Les kystes de Giardia : 22; 5. Legionella pneumophila : 11 à 30; 6. Le groupe de : E. coli, Campylobacter, Helicobacter, Salmonella, E. coli O157:H7 et Yersinia : 5 à 51; 7. Le groupe de : le virus de l’hépatite A, le virus Coxsackie, le poliovirus et le rotavirus 16,4 à 61; 8. Mycobacterium avium : 12,3 à 64; 9. Les kystes de Naegleria fowleri : 121; 10. Les kystes d’Acanthamoeba spp. : 167; 11. Certaines souches de Mycobacterium spp. : 96 à 192; 12. L’ Adenovirus : 51 à 261. Le graphique a deux autres marqueurs de notes de bas de page – un (*) à côté de la barre pour Aeromonas spp. : pour montrer que ces valeurs sont pour une inactivation de 2 log, et un (**) à côté de la barre pour certaines souches de Mycobacterium spp. : pour montrer que ces valeurs sont pour une inactivation de 2 à 5 log. La liste des notes de bas de page est affichée sous le graphique et inclue : 1. Clauβ et coll., 2006; 2. Gerba et coll., 2003; 3. Santé Canada, 2019d; 4. Santé Canada, 2019d; 5. Hijnen et coll., 2011; 6. Zimmer and Slawson, 2002; Hayes et coll., 2006; Zimmer-Thomas et coll., 2007; Hijnen et coll., 2011; 7. Santé Canada, 2019c; 8. Hayes et coll., 2008; Schiavano et coll., 2018; 9. Sakar and Gerba, 2012; 10. Hijnen et coll., 2011; 11; Gerba et coll., 2003, Schiavano et coll., 2018; 12. Santé Canada, 2019c; (*) inactivation de 2 log; (**) inactivation de 2 to 5 log.