Rapport complet : Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada
Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2021
Télécharger en format PDF
(3,26 Mo, 140 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : 2021-12-13
Cat. : HP2-10E-PDF
ISBN : 1924-7087
Pub. : 210338
Table des matières
- Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada
- À propos du présent rapport
- Partie 1. La COVID 19 au Canada et dans le monde
- Partie 2. La santé publique au Canada : possibilités de transformation
- Partie 3. Une vision pour transformer la santé publique au Canada
- La voie à suivre
- Annexe A : Méthodologie
- Remerciements
- Références
- Notes de bas de page
Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada
La pandémie de la COVID-19 représente la plus grande crise de santé publique à laquelle notre pays a été confronté depuis un siècle.
Il ne fait aucun doute que cela a mis à rude épreuve nos systèmes de santé publique. Bien qu'il y ait eu des défis, il y a aussi eu des réalisations remarquables, comme la prise en charge par les peuples autochtones de la réponse à la pandémie dans les communautés autochtones. C'est avec une grande fierté que je souligne que plus de 28 millions de Canadiennes et Canadiens de 12 ans et plus ont été entièrement vaccinés jusqu'à présent. Compte tenu de l'approbation récente de la première formulation de vaccin contre la COVID-19 du Canada destinée aux enfants de 5 à 11 ans, nous continuerons de voir nos taux de couverture vaccinale augmenter partout au pays.
Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 demeurera une priorité clé en santé publique au Canada dans un avenir prévisible. Au moment de la publication du présent rapport, le Canada est aux prises avec une quatrième vague alimentée par le variant Delta hautement transmissible, et un nouveau variant préoccupant, Omicron, a récemment été identifié par l'Organisation mondiale de la santé. Il est encore trop tôt pour savoir comment ce nouveau variant influera sur les mesures d'intervention du Canada quant à la pandémie, mais son apparition nous rappelle que nous devons demeurer vigilants et adapter nos mesures, au besoin. Simultanément, nous faisons face à d'autres problèmes pressants de santé publique qui requièrent également une action urgente. Cela comprend l'aggravation de la crise liée aux surdoses d'opioïdes, l'augmentation des problèmes de santé mentale, les répercussions des changements climatiques sur la santé et la menace continue de la résistance aux antimicrobiens.
Bien que notre système de santé publique se soit élargi pour répondre aux demandes accrues liées à la COVID-19, il est dangereusement à bout de souffle. La pandémie a mis en lumière les forces de notre système, mais elle a aussi révélé des fissures de longue date dans ses fondations. Le système de santé publique ne dispose pas des ressources et des outils nécessaires pour mener à bien son travail essentiel et il est soumis à des cycles de financement fluctuants qui nous laissent mal préparés face aux nouvelles menaces.
À l'avenir, nous devons nous assurer que notre système de santé publique est mieux équipé pour protéger toutes les personnes qui vivent au Canada et les aider à atteindre une santé optimale.
Autrement dit, nous devons agir maintenant pour faire en sorte que notre avenir post-pandémique soit différent de notre passé pré-pandémique.
Dans mon rapport annuel de 2020, j'ai examiné les conséquences plus vastes de la pandémie et la façon dont les inégalités sociales de santé persistantes ont entraîné des répercussions disproportionnées de la COVID-19 sur certaines populations. Le rapport a souligné la nécessité d'un système de santé publique renforcé, axé sur l'équité en santé et visant à assurer une bonne santé et un bien-être pour tous.
Mon rapport annuel de 2021 se base sur ces conclusions. Il fait appel à divers avis de dirigeants de la santé publique, de chercheurs, d'experts communautaires, de collaborateurs intersectoriels et de dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En se basant sur les fondements des systèmes de santé publique au Canada, mon rapport décrit les opportunités stratégiques et les actions clés pour parvenir à un système de santé publique transformé qui nous protège tous contre les défis actuels et émergents en matière de santé publique.
Bien que la pandémie ne soit pas encore terminée, nous en sommes à un moment crucial où nous pouvons nous réunir pour réfléchir à ce que nous avons appris et, collectivement, définir une nouvelle voie à suivre. En unissant nos forces à travers les communautés et les secteurs, nous pouvons entamer le dialogue visant à définir le système de santé publique dont nous avons tous besoin et auquel nous nous attendons, dans la poursuite d'une société prospère et en santé que nous voulons tous. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons être sûrs d'y parvenir.
À propos du présent rapport
Le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) de cette année porte sur l'état de la santé publique au Canada. Il décrit les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et présente une vision prospective pour transformer le système de santé publique du Canada afin qu'il excelle et soit mieux préparé à la prochaine crise de santé publique.
Tout comme le SRAS et la grippe H1N1 dans le passé, la COVID-19 a été un test de résistance pour nos systèmes de santé, sociaux et économiques. La pandémie a souligné l'importance cruciale du système de santé publique pour nous protéger des effets potentiellement dévastateurs des nouveaux virus. Cela comprend le rôle vital que joue la santé publique pour aider à atténuer la pression excessive exercée sur les ressources de soins de santé.
Alors que nous continuons d'être exposés à des menaces changeantes et croissantes pour la santé humaine, comme les changements climatiques, la résistance aux antimicrobiens ou la charge des maladies non contagieuses, nous devons nous assurer que nos systèmes de santé publique sont mieux équipés pour relever ces défis complexes.
Le présent rapport est basé sur le rapport annuel de l'ACSP de l'an dernier intitulé Du risque à la résilience : Une approche axée sur l'équité concernant la COVID-19, qui confirme les répercussions inégales de la COVID-19 sur la santé des Canadiennes et des Canadiens. Ce document souligne la nécessité de renforcer les systèmes de santé publique pour garder les personnes en bonne santé, tout en contribuant à une société florissante.
Le rapport de cette année, Une vision pour transformer la santé publique au Canada, est divisé en 3 grandes parties.
La partie 1 établit le contexte en donnant un aperçu des principaux événements épidémiologiques de la COVID-19 au Canada entre août 2020 et août 2021. En illustrant les inégalités, les vastes répercussions de la pandémie et les leçons apprises, cette partie fournit d'autres données probantes convaincantes sur la nécessité de renforcer le système de santé publique au Canada.
La partie 2 décrit le rôle unique et l'incidence de la santé publique sur la santé des populations. Elle présente les éléments de base des systèmes de santé publique au Canada et souligne les possibilités d'amélioration à l'échelle systémique.
La partie 3 prend appui sur ces possibilités pour offrir une vision d'un système de santé publique de calibre mondial. Elle présente ensuite les éléments nécessaires pour réaliser cette vision et faire en sorte que les conditions soient réunies pour que le Canada soit prêt à relever les défis actuels et futurs en matière de santé publique.
Avis aux lecteurs : Ce rapport a été rédigé en sachant que la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions continuent d'évoluer. Compte tenu de la nécessité de finaliser le rapport bien avant sa publication, il ne couvre pas les changements épidémiologiques, les événements émergents ou la mise en œuvre de mesures de santé publique supplémentaires au-delà de la fin août 2021. De plus amples détails sur les méthodes et les limites figurent à l'annexe A.
Ce rapport est le fruit du leadership et de l'expertise de nombreux collaborateurs. En particulier, 4 rapports indépendants commissionnés ont été préparés pour éclairer son contenu, qui sera disponible sur le site web des Centres de collaboration nationale en santé publique :
- Les expériences, les visions et les voix des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur l'avenir de la santé publique au Canada sont présentées dans un rapport d'accompagnement intitulé Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui a été élaboré et dirigé par des dirigeants autochtones en santé publique, en collaboration avec des universitaires autochtones et des organisations autochtones nationales.
- Les composantes, les approches et les facteurs fondamentaux au soutien d'un système pancanadien de données sur la santé publique sont résumés dans un rapport d'accompagnement intitulé Une vision éclairée par des données probantes pour un système de données en santé publique au Canada, qui a été élaboré par le Dr David Buckeridge.
- Les possibilités de renforcer, d'améliorer ou de transformer la gouvernance actuelle de la santé publique font l'objet d'un rapport d'accompagnement intitulé Gouverner pour la santé du public: options de gouvernance pour un système de santé publique renforcé et renouvelé au Canada, dont la rédaction a été dirigée par Erica Di Ruggerio, Ph. D.
- Les principales mesures proposées pour mieux intégrer et renforcer les capacités des collectivités après la pandémie de COVID-19 sont présentées dans un rapport d'accompagnement intitulé Renforcer les liens communautaires : l'avenir de la santé publique se joue à l'échelle des quartiers, élaboré par Kate Mulligan, Ph. D.
Enfin, un rapport sur « Ce que nous avons entendu » intitulé Renouvellement et renforcement du système de santé publique au Canada, qui présente un résumé des groupes de discussion et des entrevues menées auprès d'informateurs clés pour éclairer l'élaboration et la rédaction du présent rapport.
Nous soulignons respectueusement que les terres sur lesquelles nous avons élaboré le présent rapport se trouvent sur le territoire traditionnel des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et nous reconnaissons leurs histoires et leurs cultures diversifiées. Nous tenons à mettre en place des partenariats respectueux avec les Autochtones dans le but de paver la voie vers une guérison collective et une réconciliation véritable. Plus précisément, le présent rapport a été préparé à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnabe; à Halifax, sur le territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq; à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation mohawk; et à Toronto, sur le territoire traditionnel des Wendat, des Anishnaabeg, des Haudenosaunee, des Métis et de la Première Nation des Mississaugas de New Credit.
Partie 1. La COVID-19 au Canada et dans le monde
Pandémie de COVID-19 au Canada
Aperçu de l'épidémiologie de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 est une des pires crises de santé publique que l'on ait connue depuis longtemps. En date du 31 août 2021, il y avait eu 1 500 000 cas déclarés de COVID-19 et 27 000 décès liés à la COVID-19 au CanadaNote de bas de page 1. En 2020, on a estimé que la COVID-19 était la troisième cause de décès, après le cancer et les maladies cardiaquesNote de bas de page i Note de bas de page 2. Il s'agissait de la première fois depuis le milieu du 20e siècle qu'une maladie infectieuse se classait parmi les 3 principales causes de décès au CanadaNote de bas de page 3 Note de bas de page 4. Le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) de 2020 décrit en détail le début épidémiologie de la crise de la COVID-19 jusqu'à la fin de la première vague en août 2020Note de bas de page 5. Depuis, le Canada a connu d'autres vagues, dont une à l'hiver 2020‑2021 et une autre au printemps 2021Note de bas de page ii. En août 2021, au moment de la rédaction du présent rapport, l'augmentation de l'incidence a marqué le début d'une quatrième vagueNote de bas de page 6. La figure 1 donne un aperçu des cas de COVID-19 déclarés à l'échelle nationale et des résultats connexes, comme le nombre quotidien de patients hospitalisés, le nombre quotidien de patients aux soins intensifs et le nombre de décès au Canada pour la période de mars 2020 à août 2021Note de bas de page 1.
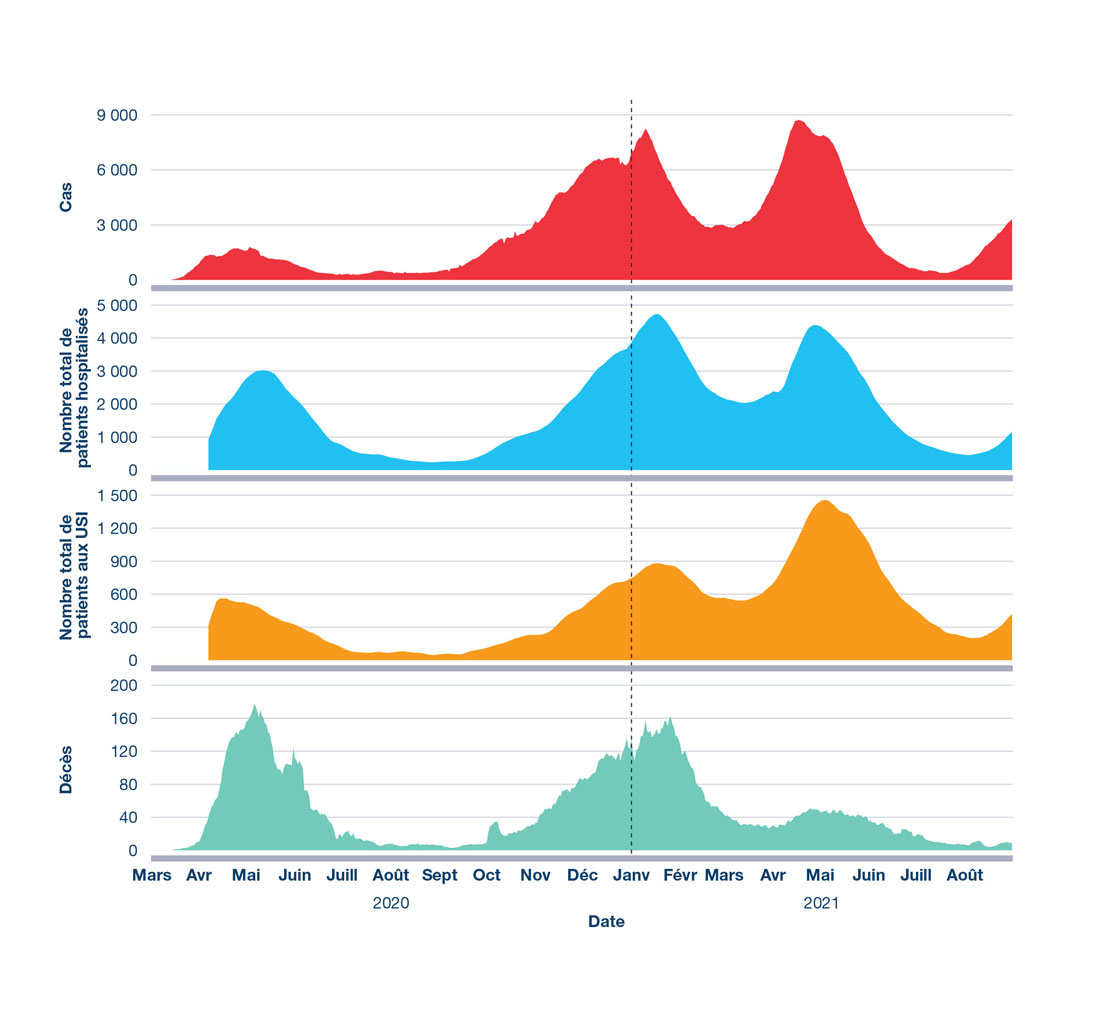
Figure 1 : Texte descriptif
La figure donne un aperçu de la pandémie de la COVID-19 au Canada de mars 2020 à août 2021. Les axes verticaux affichent 4 indicateurs différents comme la moyenne pondérée sur 7 jours des données quotidiennes selon la date déclarée dans des panneaux distincts, de haut en bas, c'est-à-dire les cas, le nombre total de patients hospitalisés, le nombre total de patients aux USI et les décès. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois.
| Date (période précise) | Cas | Décès | Nombre total de patients hospitalisés | Nombre total de patients aux USI |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 327,7 | 3,6 | Non disponible | Non disponible |
| 2020-04-30 | 1 427,1 | 88,9 | 1 939,0 | 514,0 |
| 2020-05-31 | 1 287,8 | 134,3 | 2 788,1 | 420,0 |
| 2020-06-30 | 491,0 | 55,0 | 1 398,3 | 219,7 |
| 2020-07-31 | 380,2 | 12,5 | 525,5 | 76,1 |
| 2020-08-31 | 398,7 | 6,5 | 287,1 | 65,7 |
| 2020-09-30 | 877,6 | 5,6 | 314,0 | 70,8 |
| 2020-10-31 | 2 329,1 | 24,9 | 890,5 | 177,9 |
| 2020-11-30 | 4 462,1 | 61,8 | 1 730,2 | 337,8 |
| 2020-12-31 | 6 456,4 | 107,9 | 3 234,5 | 637,0 |
| 2021-01-31 | 6 657,2 | 141,5 | 4 376,8 | 841,8 |
| 2021-02-28 | 3 295,6 | 78,6 | 2 836,8 | 655,1 |
| 2021-03-31 | 3 494,9 | 32,8 | 2 131,6 | 578,0 |
| 2021-04-30 | 7 628,2 | 39,8 | 3 423,8 | 1 072,6 |
| 2021-05-31 | 5 747,8 | 44,2 | 3 610,2 | 1 321,0 |
| 2021-06-30 | 1 321,7 | 26,5 | 1 577,6 | 706,3 |
| 2021-07-31 | 496,0 | 10,8 | 638,0 | 306,5 |
| 2021-08-31 | 1 966,8 | 7,7 | 671,3 | 265,0 |
Veuillez noter que les axes verticaux ont été mis à l'échelle différemment pour chaque variable. Toutes les variables sont des moyennes mobiles sur 7 jours des données quotidiennes par date de déclaration. Les données complètes sur les hospitalisations et les unités de soins intensifs avant avril 2020 ne sont pas disponiblesNote de bas de page 1.
Les tendances des principaux indicateurs de gravité de la maladie ont changé au fil du temps. Comparativement à la première vague, et malgré un nombre de cas beaucoup plus élevé, une plus faible proportion du nombre total de personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées, ont été hospitalisées ou admises aux soins intensifs au cours des deuxième et troisième vagues (tableau 1)Note de bas de page 1. Fait important à signaler : l'amélioration de l'infrastructure de dépistage et de surveillance après la première vague a accru la probabilité de détection de cas bénins et asymptomatiquesNote de bas de page 7.Outre la modification des tests, un autre facteur a influé sur cette tendance, soit une meilleure protection des personnes les plus susceptibles de tomber gravement malades comme les résidents des établissements de soins de longue durée, grâce à des interventions améliorées en santé publique et à des programmes de vaccination ciblés (décrits plus en détail ci‑dessous).
Toutefois, en raison de la durée prolongée de l'incidence élevée et, par conséquent, du nombre élevé d'admissions aux soins intensifs (figure 1), la troisième vague a mis à rude épreuve la capacité des unités de soins intensifs, surtout dans les provinces les plus peupléesNote de bas de page 8.Dans certaines provinces, les patients ont dû être transférés dans d'autres régions en raison de l'achalandage trop élevé des milieux de traitement et de nombreuses régions ont réduit ou reporté des interventions médicales et chirurgicales non urgentesNote de bas de page 8.
| Indicateurs de COVID-19 | Nombre total de cas – première vague (janvier à août 2020) |
Nombre total de cas – deuxième vague (août 2020 à février 2021) |
Nombre total de cas – troisième vague (février 2021 à mai 2021) |
|---|---|---|---|
| Cas | 126 707 | 751 158 | 640 293 |
| Hommes | 57 107 (45 %) | 369 989 (49 %) | 327 180 (51 %) |
| Femmes | 69 383 (55 %) | 380 177 (51 %) | 311 806 (49 %) |
| Autre | 14 (<1 %) | 56 (<1 %) | 82 (<1 %) |
| Âge médian des patients admis aux soins intensifs (étendue) | 47 ans (0 à 119) | 37 ans (0 à 115) | 33 ans (0 à 113) |
| Décès | 9 363 (7 %) | 13 573 (2 %) | 4 463 (1 %) |
| Hommes | 4 294 (46 %) | 6 931 (51 %) | 2 627 (59 %) |
| Femmes | 5 054 (54 %) | 6 625 (49 %) | 1 822 (41 %) |
| Autre | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Âge médian des décès (étendue) | 86 ans (0 à 112) | 85 ans (0 à 109) | 75 ans (1 à 105) |
| Hospitalisations | 13 428 (11 %) | 36 251 (5 %) | 29 920 (5 %) |
| Hommes | 6 865 (51 %) | 19 296 (53 %) | 16 401 (55 %) |
| Femmes | 6 554 (49 %) | 16 924 (47 %) | 13 477 (45 %) |
| Autre | 0 (0 %) | 2 (<1 %) | 3 (<1 %) |
| Âge médian des hospitalisations (étendue) | 73 ans (0 à 106) | 71 ans (0 à 108) | 59 ans (0 à 107) |
| Admission aux soins intensifs | 2 733 (2 %) | 5 996 (1 %) | 6 557 (1%) |
| Males | 1 740 (64 %) | 3 798 (63 %) | 4 024 (61 %) |
| Females | 993 (36 %) | 2 191 (37 %) | 2 524 (38 %) |
| Other | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Âge médian des hospitalisations (étendue) | 65 ans (0 à 99) | 66 ans (0 à 104) | 59 ans (0 à 99) |
| Ces données peuvent être influencées par la variation des méthodes de dépistage au fil du temps ainsi qu'entre les régions. De plus, certaines données probantes indiquent que le nombre des décès liés à la COVID-19 a été sous‑estimé au printemps et à l'automne 2020Note de bas de page 9. Le dénominateur des pourcentages de décès, d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs est le nombre total de cas signalés. Pour chaque désagrégation par genre/sexe, le dénominateur est le nombre total pour chaque indicateur respectifNote de bas de page 1. | |||
Chaque vague de la pandémie au Canada a été marquée par des caractéristiques clés (résumées dans le tableau 2). Cette partie décrit certaines des principales caractéristiques épidémiologiques de la pandémie, en mettant l'emphase sur la période d'août 2020 à août 2021.
| Période | Brève description des principales caractéristiques |
|---|---|
Première vague (de janvier 2020 à août 2020) |
|
Deuxième vague (d'août 2020 à février 2021) |
|
Troisième vague (de février 2021 à août 2021) |
|
Quatrième vague (début en août 2021) |
|
| Pour obtenir des références et plus de détails sur ces sujets, veuillez consulter le contenu suivant. Comme la présente partie a été achevée en août 2021, les données incluses ne représentent pas un examen exhaustif de la quatrième vague. | |
Deuxième vague : d'août 2020 à février 2021
L'assouplissement des mesures de santé publique a alimenté la résurgence de l'épidémie
À l'été 2020, à la fin de la première vague, les cas de COVID-19 déclarés à l'échelle nationale avaient considérablement diminué (figure 1)Note de bas de page 1. Bien qu'il y ait eu des variations d'une région sanitaire à l'autre, bon nombre des mesures de santé publique les plus restrictives mises en œuvre dans le cadre de la réponse initiale du Canada à la pandémie, comme les fermetures d'entreprises, de lieux de travail et d'écoles, le confinement, l'annulation d'événements publics et les restrictions sur les rassemblements sociaux, ont été assouplies. Les protocoles liés aux frontières internationales, le dépistage et l'isolement des personnes infectées, la traçabilité des contacts, ainsi que les conseils sur les pratiques de prévention individuelles et les mesures populationnelles pour limiter les contacts, sont demeurés en placeNote de bas de page 10.
Les taux de contact croissants des Canadiens et des Canadiennes ont amplifié la propagation du virus à l'automne 2020Note de bas de page 11. À l'époque, la modélisation mathématique prédisait que si ces taux de contact étaient maintenus, l'épidémie pourrait réapparaître plus rapidement et susciter plus de casNote de bas de page 11. Il s'agissait d'un indicateur d'alerte rapide pour la deuxième grande vague qui a commencé à la fin d'août 2020 et qui a culminé à l'échelle nationale en janvier 2021 (figure 1)Note de bas de page 1. Bien que les établissements de soins de longue durée aient continué d'être le milieu d'éclosion le plus fréquent, les rassemblements sociaux et les éclosions en milieu de travail ont grandement contribué à la propagation au sein de la collectivité au cours de la deuxième vague, surtout à mesure que les taux d'infection augmentaient chez les groupes d'âge plus jeunes, plus actifs sur le plan social, dont les déplacements étaient plus fréquents et les taux de contact plus élevésNote de bas de page 12.
Au cours de l'hiver 2020‑2021, en réponse à l'augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations (figure 1), de nombreuses régions du pays ont dû de nouveau mettre en place des mesures de santé publique plus restrictivesNote de bas de page 10. Cependant, la baisse du nombre de cas à moins de la moitié du pic quotidien observé en janvier 2021 a entrainé l'assouplissement de nombreuses restrictions en mars 2021, avant de les resserrer de nouveau en avril 2021Note de bas de page 8. Cela était conforme aux prévisions de modélisation indiquant fort justement qu'une autre augmentation des cas aurait lieu, amorçant la troisième vagueNote de bas de page 13.
Les mesures de santé publique étaient le principal outil disponible pour limiter la propagation
Au cours de la plus grande partie de la deuxième vague, les mesures de santé publique ont continué d'être le principal moyen pour contrôler l'épidémie au Canada, puisque des interventions pharmaceutiques efficaces (les vaccins, par exemple) n'étaient pas encore disponibles à grande échelle. Les mesures de santé publique mises en œuvre comprenaient un éventail d'interventions visant à réduire la transmission communautaire du SRAS‑CoV‑2 dans le but de « réduire au minimum le risque de maladie grave et de décès en général tout en atténuant les perturbations sociales »Note de bas de page 14. Il s'agissait à la fois de pratiques individuelles (p. ex. masques, distanciation physique, hygiène des mains) et de mesures communautaires (p. ex. gestion des cas et traçabilité des contacts, fermeture d'écoles et d'entreprises, confinement à la maison)Note de bas de page 15. Il était difficile d'atténuer les conséquences sociales, psychologiques et économiques des mesures de santé publique tout en réduisant la transmission communautaire par une diminution des taux de contact. De plus, certaines personnes avaient une capacité limitée de suivre les recommandations en raison de leur état de santé, de leur âge, de leur situation économique ou socialeNote de bas de page 15.
Les autorités de la santé publique à l'échelle fédérale, provinciale, territoriale et locale ont adapté les mesures de santé publique à mesure que de nouvelles données scientifiques, des avis d'experts, de chercheuses et de chercheurs canadiens et internationaux sont devenus disponibles. Par exemple, des enquêtes sur les épidémies et des études scientifiques ont révélé que le SRAS‑CoV‑2 pouvait se propager au moyen de gouttelettes respiratoires de taille variable, allant de grosses gouttelettes qui tombent rapidement au sol près de la personne infectée à de plus petites gouttelettes, appelées aérosols, qui restent dans l'air dans certaines circonstancesNote de bas de page 16. On a laissé entendre que la transmission des aérosols sur de courtes distances était particulièrement pertinente dans les espaces intérieurs surpeuplés mal ventilésNote de bas de page 16. Par conséquent, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis à jour les directives sur la fabrication, l'ajustement et le port approprié des masques faciaux ainsi que sur l'amélioration de la ventilation intérieure pendant la deuxième vagueNote de bas de page 17 Note de bas de page 18 Note de bas de page 19. Les directives nationales sur les mesures de santé publique étaient fondées sur la planification pancanadienne en cas de pandémie que les régions ont adaptée à leur contexte épidémiologique local, comme l'imposition du couvre‑feu ou la désignation de zones régionales plus circonscrites pour adapter les approches propres à la région localeNote de bas de page 10 Note de bas de page 14.
La réponse à la pandémie a exigé l'adoption des mesures de santé publique ainsi que le respect constant et soutenu de ces mesures pendant de longues périodes. Un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes ont déclaré qu'ils approuvaient et appuyaient grandement l'utilisation de mesures pour limiter la propagation du virusNote de bas de page 20 Note de bas de page 21 Note de bas de page 22 Note de bas de page 23. Par exemple, une enquête menée par Impact Canada en mars 2021 a révélé que la grande majorité des répondants respectaient « toujours » ou « presque toujours » aux mesures sanitaires comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physiqueNote de bas de page 24. La modélisation statistique a indiqué que les facteurs les plus déterminants à l'adhésion aux mesures de santé publique comprennaient l'anxiété liée à la santé de la famille et à la confiance dans les sources gouvernementales et les professionnels de la santéNote de bas de page 25.
Diverses sources de données non classiques ont été utilisées pour fournir un aperçu de l'adhésion générale aux mesures de santé publique qui visaient à limiter les déplacements et les contacts avec les autres. Par exemple, les données sur la mobilité recueillies à partir des réseaux cellulaires indiquent une diminution importante de la proportion de temps que les Canadiennes et les Canadiens ont passé à la maison après la première vague, ce qui semble correspondre à l'assouplissement des mesures de santé publiqueNote de bas de page 10. Bien que divers facteurs aient influencé l'adhésion aux mesures de santé publique, il importe de souligner que certaines personnes se sont déplacées davantage et ont eu plus de contacts sociaux, malgré les mesures en place, en raison de facteurs comme le travail essentiel ou les logements à forte densitéNote de bas de page 26.
Troisième vague : de février 2021 à août 2021
Les variants préoccupants très transmissibles ont contribué à la croissance rapide de l'épidémie
Après une diminution du nombre moyen de cas quotidiens au pays, de janvier à février 2021, les taux d'infection ont fortement augmenté en mars 2021 dans la plupart des provinces et territoires (figure 1)Note de bas de page 1. Cela s'explique par l'augmentation des taux de contacts sociaux à la suite de l'assouplissement des restrictions ainsi que par l'émergence et la propagation de variants plus contagieux du virusNote de bas de page 13. Comme pour tous les virus, le SRAS‑CoV‑2 accumule des mutations génétiques au fil du temps; certaines de ces mutations peuvent mener à des variants du virus qui sont considérés comme préoccupants parce qu'ils se propagent plus facilement, causent des maladies plus graves ou réduisent l'efficacité des outils diagnostics, des vaccins, des thérapies ou des mesures de santé publique disponiblesNote de bas de page 27. Au début de 2021, des variants plus contagieux du virus ont commencé à être détectés au Canada et, en août 2021, ces variants incluaient les variants Alpha, Bêta, Gamma et Delta. Ces variants préoccupants s'étaient répandus dans la plupart des provinces et des territoires et étaient responsables d'environ 80 % des cas en août 2021Note de bas de page 28. Alors que le variant Alpha était à l'origine de la majorité des cas de COVID-19 à l'apparition de la troisième vague, au début de juillet 2021, le variant Delta avait remplacé le variant Alpha comme variant le plus fréquemment déclaréNote de bas de page 28.
Les premières données probantes de l'Ontario laissent entendre que, comparativement à la souche originale du SRAS‑CoV‑2, le variant Alpha était associé, chez les personnes infectées, à une augmentation de 62 % des hospitalisations, de 114 % des admissions aux soins intensifs et de 40 % des décèsNote de bas de page 29. Les constatations préliminaires indiquaient que le variant Delta était plus contagieux et plus virulent que le variant AlphaNote de bas de page 30.
Des mesures frontalières internationales ont été déployées et adaptées au fil du temps à mesure que la connaissance du SRAS‑CoV‑2 et des variants préoccupants évoluait. Tout au long de la pandémie, le volume de voyageurs par transports aérien et terrestre est demeuré inférieur à moins de 90 % des niveaux prépandémiquesNote de bas de page 31. Afin de réduire davantage le risque d'importation de virus, en particulier des variants préoccupants, le Canada a mis en œuvre des mesures améliorées de dépistage et de quarantaine aux frontières internationales, en plus de celles déjà en place, dès l'hiver 2020‑2021. Ces mesures comprenaient des tests obligatoires avant le départ et au Canada pour tous les voyageurs non exemptés, ainsi qu'un confinement obligatoire de 3 jours dans un hôtel approuvé par le gouvernement pour les voyageurs non exemptés, arrivant par voie aérienne aux 4 principaux aéroports autorisant les arrivées internationalesNote de bas de page 32.
Au début de 2021, le Canada a rapidement intensifié ses efforts de surveillance et de séquençage génomique pour détecter les variants préoccupants connus et émergentsNote de bas de page 33. L'ASPC a collaboré avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement ainsi qu'avec des chercheurs universitaires pour établir un réseau de surveillance pancanadien qui utilisait de nouveaux essais génétiques pour détecter les variants du SRAS‑CoV‑2 à partir d'échantillons d'eaux uséesNote de bas de page 34. Cette mesure a fait partie d'un système d'indicateurs d'alerte rapide combiné aux prévisions des modèles mathématiques, facilitant l'adaptation de la réponse à la COVID-19 à l'évolution de l'information. Par exemple, dans les Territoires du Nord‑Ouest, la détection de la présence du virus de la COVID-19 dans les eaux usées a permis d'identifier une personne infectée, ce qui a mené à l'exécution de tests à plus grande échelle dans la collectivité. Cette intervention rapide a permis de détecter rapidement d'autres cas de COVID-19, ce qui a interrompu la propagation et peut‑être empêché une éclosion plus importanteNote de bas de page 34.
Les vaccins contre la COVID-19, des outils essentiels de lutte contre le virus
Vers la fin de l'année 2020, moins de 1 an après l'apparition du virus SARS‑CoV‑2, les chercheurs ont mis au point les premiers vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, un exploit sans précédent dans l'histoire scientifique. Cela a marqué un tournant dans la lutte contre la pandémie mondiale. Les vaccins sont le fruit de la collaboration de chercheurs universitaires et du secteur privé du monde entier ainsi que d'un financement accru qui, concurremment, a permis à la science de tirer parti des progrès scientifiques et technologiques réalisés au cours de la dernière décennieNote de bas de page 35. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les vaccins protègent les populations, consulter l'encadré « Les vaccins protègent tout le monde grâce à une meilleure protection des collectivités ».
Le 9 décembre 2020, le premier vaccin contre la COVID-19, reposant sur une nouvelle technologie d'ARN messager (ARNm), a été approuvé pour utilisation chez les adultes au CanadaNote de bas de page 36. Les autorisations subséquentes des vaccins comprenaient un autre vaccin à base d'ARNm ainsi que des vaccins à vecteur viral, la plupart nécessitant alors 2 doses pour la meilleure protection possibleNote de bas de page 37. L'autorisation rapide a été facilitée par la capacité de Santé Canada d'examiner les nouvelles données probantes au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles et par l'affectation de ressources scientifiques accrues au processus d'examen de l'innocuité et de l'efficacité des vaccinsNote de bas de page 38 Note de bas de page 39. L'évaluation et la surveillance de l'innocuité des vaccins sont un processus continu tout au long du cycle de vie d'un vaccin (voir l'encadré « Création du programme de soutien aux victimes d'une vaccination »). En date du 31 août 2021, plus de 53 millions de doses de vaccins sécuritaires et efficaces avaient été administrées au CanadaNote de bas de page 40.
Les vaccins nous protègent tous grâce à une meilleure protection communautaire
Les vaccins sont l'une des interventions de prévention les plus importantes pour de nombreuses maladies infectieuses graves. Ils offrent une protection directe aux personnes vaccinées et une protection indirecte pour tous. Plus la proportion de personnes vaccinées est élevée, moins un agent pathogène n'a d'opportunités de circuler, réduisant du fait le risque d'importantes éclosions. Les taux élevés de vaccination communautaire protègent de plus les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou qui ne sont pas aussi bien protégées par la vaccination, et réduisent les possibilités de mutation des agents pathogènesNote de bas de page 41. Les vaccins offrent donc une meilleure protection communautaire, ce qui est particulièrement important pour les personnes susceptibles de développer des problèmes de santé graves, y compris l'hospitalisation et la mort. La vaccination de masse est l'un des moyens les plus efficaces de protéger la population contre la COVID-19Note de bas de page 42.
La distribution et l'administration des vaccins contre la COVID-19 ont été le programme de vaccination le plus vaste et le plus complexe jamais mis en œuvre par le Canada. Le gouvernement fédéral a assumé la responsabilité d'acheter les vaccins, de superviser la logistique et de coordonner la surveillance, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les partenaires en santé publique, pour assurer un déploiement rapide, équitable et bien coordonnéNote de bas de page 43.
Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada a fourni des conseils d'experts indépendants pour aider les provinces et les territoires à établir l'ordre de priorité étant donné l'approvisionnement initial limité des vaccins contre la COVID-19. Le CCNI tient compte du contexte plus vaste, réel et des meilleures données probantes disponibles au moment de formuler des recommandationsNote de bas de page 44. Dans son document intitulé Orientations sur l'administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19, le CCNI a énoncé que les principales populations à immuniser en priorité à l'étape 1 étaient les résidents et le personnel des milieux de vie collectifs qui fournissent des soins aux personnes âgées, les adultes de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé et les adultes vivant dans les communautés autochtonesNote de bas de page 45. Ces populations étaient généralement considérées comme susceptibles de contracter une maladie grave et celles qui avaient le plus besoin de protection. Avant d'offrir des vaccins à la population générale à mesure que l'approvisionnement en vaccins augmentait, le CCNI a recommandé qu'à l'étape 2 du déploiement du programme de vaccination, les vaccins soient proposés aux travailleurs de la santé non compris à l'étape 1, aux résidents et au personnel de tous les autres milieux collectifs, ainsi qu'aux travailleurs essentielsNote de bas de page 45. En mars 2021, compte tenu des nouvelles données probantes sur le degré de protection fourni par une dose, le CCNI recommande que les autorités prolongent l'intervalle entre l'administration de la première et de la seconde dose des vaccins afin de maximiser le nombre de personnes ayant d'une certaine protection contre le virus et de réduire la transmission dans le contexte d'un approvisionnement initial limité en vaccinsNote de bas de page 46. Les instances provinciales et territoriales, qui étaient responsables de l'administration et de la distribution des vaccins, ont adopté en grande partie les recommandations du CCNI.
Création du programme de soutien aux victimes d'une vaccination
Les vaccins autorisés pour utilisation au Canada respectent les normes les plus élevées en matière d'innocuité et d'efficacitéNote de bas de page 47. Comme pour tout médicament, les vaccins peuvent causer des réactions et des effets secondaires. Les événements indésirables graves sont rares, mais cela peut arriverNote de bas de page 47. L'ASPC a créé le programme de soutien aux victimes d'une vaccination pour offrir une indemnisation juste et rapide aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont subi un préjudice corporel après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada administré au Canada le 8 décembre 2020 ou aprèsNote de bas de page 47 Note de bas de page 48. Ce programme d'indemnisations sans égard à la responsabilité est fondé sur un programme qui existe au Québec depuis plus de 30 ans et qui place le Canada sur le même plan que les autres pays du G7Note de bas de page 47. L'indemnisation pour préjudices causés par la vaccination peut également soutenir l'innovation et l'approvisionnement en vaccins en réduisant les risques juridiques pour les fabricantsNote de bas de page 49.
Une fois que les défis initiaux en matière d'approvisionnement en vaccins ont été surmontées, il y a eu une accélération rapide dans la livraison de vaccins à partir du printemps 2021. Les bénéfices des vaccins se sont immédiatement manifestés dans les populations prioritaires, comme les résidents des établissements de soins de longue durée et les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé, ce qui a entraîné une diminution importante des cas de COVID-19 à mesure que la couverture vaccinale augmentaitNote de bas de page 50. Les premières données probantes ont montré que les vaccins contre la COVID-19 offrent une bonne protection, surtout pour prévenir des problèmes de santé. Les données de 11 provinces et territoires révèlent qu'entre le 18 juillet 2021 et le 14 août 2021 le taux moyen de nouveaux cas de COVID-19 était 12 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées, et le taux des hospitalisations associées à la COVID-19 était 36 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinéesNote de bas de page 51. Le renforcement des mesures de santé publique, conjugué à l'augmentation de la couverture vaccinale, ont ramené l'activité de la COVID-19 à de faibles niveaux dans la plupart des régions du Canada en juillet 2021 (figure 1)Note de bas de page 52. Cela a également permis au Canada d'adopter une approche progressive afin d'assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinésNote de bas de page 53.
Effets disproportionnés de la deuxième et troisième vague de la pandémie
La deuxième et troisième vague de la pandémie étaient différentes de la première. Certaines régions et populations ont dû faire face à des difficultés persistantes ou à de nouveaux défis. L'évolution de la science et les leçons apprises ont amené les juridictions à adapter leur intervention en santé publique, ce qui a changé la dynamique des vagues subséquentes. Dans cette section, nous examinerons certaines des principales observations relatives à ces dernières vagues, y compris l'effet disproportionné continu sur les Canadiens dont l'état de santé et les conditions sociales et économiques étaient moins bonnes avant la pandémie en raison d'iniquités préexistantesNote de bas de page 14.
La COVID-19 s'est répandue différemment selon les régions au pays
Contrairement à la première vague, les vagues suivantes de la pandémie ont été ressenties partout au pays. Cependant, les régions n'ont pas toutes connu de deuxième et troisième vagues distinctes au même moment ou avec la même intensité (figure 2).

Figure 2 : Texte descriptif
La figure est une carte thermique décrivant le taux de cas de COVID-19 par 100 000 habitants dans chaque province et territoire au fil du temps, de mars 2020 à août 2021. Les 2 axes verticaux affichent le nombre de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants et par province ou territoire, respectivement. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois. Un dégradé de couleurs utilisant des tons clairs (c.-à-d. faible) à foncés (c.-à-d. élevé) indique des changements de taux au fil du temps.
| Date (période précise) | NU | NT | YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 6,2 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,7 |
| 2020-04-30 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 5,3 | 21,7 | 4,6 | 3,5 | 21,6 | 61,0 | 2,0 | 2,1 | 18,9 | 6,4 |
| 2020-05-31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 11,6 | 5,3 | 0,4 | 18,4 | 64,9 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |
| 2020-06-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,3 | 2,6 | 0,5 | 12,1 | 15,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2020-07-31 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,8 | 12,8 | 8,8 | 1,3 | 6,7 | 9,8 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 |
| 2020-08-31 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,5 | 15,1 | 7,2 | 11,6 | 4,7 | 8,6 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
| 2020-09-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 21,9 | 5,2 | 12,8 | 12,7 | 26,6 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2020-10-31 | 0,0 | 2,2 | 3,8 | 22,0 | 45,8 | 20,1 | 48,6 | 35,2 | 81,7 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
| 2020-11-30 | 96,1 | 2,9 | 11,1 | 77,2 | 142,6 | 93,9 | 183,6 | 60,7 | 96,1 | 4,1 | 1,0 | 3,9 | 1,8 |
| 2020-12-31 | 59,3 | 4,5 | 9,6 | 86,1 | 229,7 | 138,7 | 139,0 | 96,1 | 148,9 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 2,5 |
| 2021-01-31 | 10,7 | 3,5 | 5,4 | 69,2 | 124,2 | 157,1 | 81,6 | 135,5 | 168,2 | 17,5 | 2,2 | 2,3 | 0,7 |
| 2021-02-28 | 44,2 | 6,1 | 1,2 | 61,3 | 54,1 | 108,0 | 45,4 | 59,3 | 77,7 | 7,3 | 1,6 | 1,3 | 27,0 |
| 2021-03-31 | 23,6 | 0,0 | 0,5 | 81,3 | 70,9 | 91,8 | 36,9 | 69,8 | 60,4 | 4,4 | 5,0 | 1,9 | 2,1 |
| 2021-04-30 | 46,0 | 4,2 | 4,3 | 134,5 | 205,3 | 146,5 | 69,4 | 173,1 | 104,7 | 8,9 | 3,1 | 11,9 | 2,1 |
| 2021-05-31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 11,6 | 5,3 | 0,4 | 18,4 | 64,9 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |
| 2021-06-30 | 6,2 | 0,4 | 110,0 | 18,1 | 28,8 | 48,1 | 99,2 | 25,1 | 14,3 | 4,3 | 0,7 | 8,0 | 4,2 |
| 2021-07-31 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | 8,7 | 10,8 | 21,1 | 25,8 | 8,7 | 6,6 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 2,3 |
| 2021-08-31 | 0,0 | 134,7 | 57,9 | 64,3 | 81,8 | 71,7 | 17,3 | 21,0 | 28,2 | 10,9 | 3,0 | 2,8 | 1,4 |
| Les provinces et territoires énumérés dans le tableau sont abrégés au moyen du code alphabétique. | |||||||||||||
Les données quotidiennes sont présentées par province et territoire et par date de déclarationNote de bas de page 54.
Le taux d'incidence observé à l'échelle nationale était principalement attribuable aux provinces à l'ouest de la région de l'Atlantique, en partie en raison de la taille et de la densité de leur populationNote de bas de page 54. Depuis la première vague, les provinces de l'Atlantique ont pu mettre en place des mesures suffisantes (p. ex. les restrictions sur les déplacements internationaux) pour gérer et limiter les importations de cas, arrêter la propagation et freiner l'épidémie de COVID-19 (figure 2)Note de bas de page 55 Note de bas de page 56 Note de bas de page 57. Cependant, il y a eu des augmentations soudaines que les gouvernements provinciaux ont rapidement interrompues en mettant rapidement en œuvre des mesures de santé publique rigoureuses afin de prévenir une plus grande propagation. Ces mesures étaient particulièrement importantes compte tenu de la capacité limitée du système de santé dans certaines provinces.
Par ailleurs, dans les régions où le taux de COVID-19 était relativement faibles au cours de la première vague, l'activité de la maladie a augmenté après l'été 2020. Par exemple, alors que les territoires ne comptaient au départ que très peu de cas, à la fin de 2020, certaines collectivités ont connu une augmentation rapide du nombre de cas de transmission communautaire à la suite de l'importation du virus (figure 2)Note de bas de page 54. Il a donc fallu mettre en œuvre rapidement des mesures rigoureuses de santé publique à l'échelle locale et territoriale pour empêcher la propagation. Dans les territoires, dont les collectivités ont été priorisées lors du premier déploiement de la vaccination, le taux d'adoption du vaccin était élevé et, en date du 20 juillet 2021, 84 % des adultes de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 76 % avaient été entièrement vaccinésNote de bas de page 40. Les succès remportés initialement par les territoires dans l'élargissement de la couverture vaccinale ont été soutenus par l'attribution prioritaire de vaccins, qui étaient plus faciles à transporter et à entreposer dans les collectivités du Nord, ainsi que par un programme de sensibilisation et un leadership à l'échelle communautaireNote de bas de page 58 Note de bas de page 59 Note de bas de page 60.
Tendance de la propagation chez les jeunes canadiens et canadiennes
Étant donné que la population canadienne plus âgée était mieux protégée grâce aux mesures de santé publique, et grâce à l'adaptation des interventions contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et, enfin, aux taux élevés de vaccination, l'âge médian des cas de COVID-19 a diminué (tableau 1)Note de bas de page 1. Jusqu'à la fin de la deuxième vague, la population canadienne âgée de 80 ans et plus avaient le taux d'incidence national le plus élevé. Toutefois, à partir du début de 2021, le taux d'incidence dans ce groupe d'âge a chuté. Au moment de la rédaction du présent rapport, en août 2021, le taux d'incidence parmi les Canadiens et les Canadiennes de 80 ans plus était le plus faible de tous les groupes d'âge depuis mars 2021 (figure 3), en grande partie en raison de la couverture vaccinale élevée au sein de cette populationNote de bas de page 1. En date du 28 août 2021, 93 % des adultes de 80 ans et plus étaient entièrement vaccinés contre la COVID-19Note de bas de page 40.
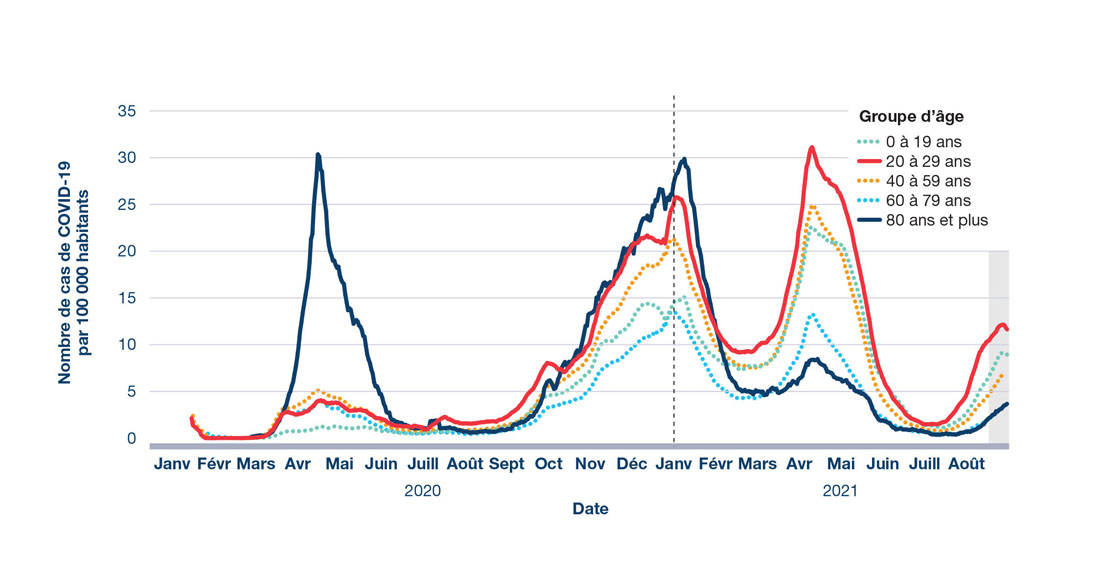
Figure 3 : Texte descriptif
La figure est un graphique linéaire affichant le nombre de cas de COVID-19 selon la date d'apparition de la maladie et le groupe d'âge au Canada de janvier 2020 à septembre 2021. L'axe vertical affiche le nombre de cas (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants. L'axe horizontal affiche la date d'apparition de la maladie en mois. Les groupes d'âge sont représentés par des lignes de tendance de couleurs différentes : vert (0 à 19 ans), rouge (20 à 39 ans), orange (40 à 59 ans), bleu pâle (60 à 79 ans) et bleu foncé (80 ans ou plus). Les groupes d'âge de 20 à 39 ans et de 80 ans et plus sont affichés sous forme de lignes continues, respectivement, afin de mieux indiquer leur changement de tendance au fil du temps, par opposition aux lignes en pointillés pour tous les autres groupes.
| Date (période précise) | 0 à 19 ans | 20 à 39 ans | 40 à 59 ans | 60 à 79 ans | 80 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| 2020-02-29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2020-03-31 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |
| 2020-04-30 | 1,0 | 3,4 | 4,5 | 3,3 | 20,3 |
| 2020-05-31 | 1,1 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 11,4 |
| 2020-06-30 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,9 |
| 2020-07-31 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
| 2020-08-31 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
| 2020-09-30 | 2,8 | 4,8 | 2,9 | 1,6 | 2,5 |
| 2020-10-31 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 4,0 | 8,4 |
| 2020-11-30 | 10,6 | 16,1 | 13,0 | 7,8 | 17,1 |
| 2020-12-31 | 13,8 | 21,6 | 18,7 | 11,3 | 24,2 |
| 2021-01-31 | 11,6 | 19,0 | 15,6 | 9,9 | 22,3 |
| 2021-02-28 | 7,8 | 9,7 | 8,3 | 4,7 | 6,6 |
| 2021-03-31 | 10,4 | 13,1 | 10,3 | 5,8 | 2,2 |
| 2021-04-30 | 20,9 | 27,7 | 22,0 | 11,1 | 7,4 |
| 2021-05-31 | 13,7 | 17,3 | 12,3 | 5,5 | 4,6 |
| 2021-06-30 | 3,4 | 3,4 | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| 2021-07-31 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 2021-08-31 | 6,2 | 9,5 | 4,5 | 2,0 | 1,9 |
Toutes les variables sont des moyennes mobiles sur 7 jours des données quotidiennes selon la date d'apparition de la maladie. La zone ombrée indique l'incertitude des données en raison des retards de déclarationNote de bas de page 1.
L'âge est l'un des facteurs de risque le plus important associé aux formes graves de la COVID-19Note de bas de page 61 Note de bas de page 62. Malgré la diminution du nombre global de cas, à la fin d'août 2021, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 pour 100 000 habitants était toujours le plus élevé au sein de la population canadienne âgée de 80 ans et plus. Toutefois, ce taux a diminué considérablement après la deuxième vagueNote de bas de page 1. Par ailleurs, 89 % des 15 300 personnes qui sont décédées de la COVID-19 en 2020 avaient au moins un autre problème de santé inscrit sur leur certificat de décès. La démence et la maladie d'Alzheimer étaient les affections les plus courantes, suivies de l'hypertension, du diabète et des cardiopathies ischémiquesNote de bas de page 63.
De nouvelles données probantes ont également révélé une augmentation du taux des naissances prématurées et des bébés mort-nés chez les personnes enceintes atteintes de la COVID-19Note de bas de page 64. Comparativement aux personnes non enceintes, les personnes enceintes qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 étaient 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisées et 11 fois plus susceptibles d'être admises aux soins intensifsNote de bas de page 64.
L'une des principales différences entre la première vague de la pandémie et les vagues subséquentes a été l'adoption d'une campagne de dépistage de la transmission communautaire plus étendue chez les jeunes adultes. Les personnes âgées de 20 à 39 ans, dont les taux de contacts sociaux sont généralement plus élevés et qui courent donc un risque accru d'exposition au virus, affichent le taux d'incidence le plus élevé depuis février 2021 (figure 3)Note de bas de page 1. Bien que les maladies graves soient moins courantes chez les personnes plus jeunes, au printemps 2021, le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 a augmenté chez les personnes âgées de 40 à 59 ansNote de bas de page 57. Cette augmentation est probablement attribuable à une combinaison des changements de la répartition des cas selon l'âge compte tenu d'une meilleure protection des personnes plus âgées, de la gravité accrue de certains variants préoccupants et de l'assouplissement des mesures de santé publique.
Incidence différentielle de la COVID-19 selon le sexe et le genre
Depuis l'été 2020, les femmes et les hommes représentent une proportion égale des cas de COVID-19 (tableau 1)Note de bas de page 1. Cette distribution égale contraste avec la première vague, au cours de laquelle les femmes représentaient 55 % des cas, peut‑être en raison de leur surreprésentation parmi les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée, et ainsi d'une probabilité accrue d'être exposées au virus et de subir des tests de dépistageNote de bas de page 5. Cela pourrait également expliquer le pourcentage plus élevé de décès chez les femmes lors de la première vague. Au cours de la deuxième et de la troisième vague, ces groupes ont peut‑être été mieux protégés par un meilleur accès à l'équipement de protection individuelle et aux vaccinsNote de bas de page 65.
Toutefois, poursuivant la tendance de la première vague, les hommes représentaient un pourcentage plus élevé des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs (tableau 1)Note de bas de page 1. Les chercheurs ont avancé que les différences biologiques fondamentales principalement liées à l'immunologie, ainsi que les différences de comportement comme la probabilité de fumer ou de demander des soins de santé, sont probablement des facteurs de risque accru d'effets graves de la COVID-19 chez les hommesNote de bas de page 66 Note de bas de page 67 Note de bas de page 68 Note de bas de page 69.
Variation des répercussions dans différents milieux d'éclosion
Établissement de soins de longue durée
Les établissements de soins de longue durée ont continué d'être un milieu à risque élevé dans bon nombre de provinces et de territoiresNote de bas de page 8. Toutefois, la proportion du total des décès liés à la COVID-19 associés aux établissements de soins de longue durée a diminué de 79 % au cours de la première vague à 50 % au cours de la deuxième et de la troisième vagueNote de bas de page 1. Depuis janvier 2021, le nombre et l'ampleur des éclosions dans les établissements de soins de longue durée ont diminué de façon constante, en grande partie en raison de l'effet de la vaccinationNote de bas de page 8.
Milieux de soins de santé
En avril 2020, 25 % de tous les cas de COVID-19 concernaient les personnes travaillant dans des milieux de soins de santéNote de bas de page 1. En raison de l'amélioration des mesures de contrôle des infections, de la priorisation des vaccins et du dépistage plus étendu des cas dans les collectivités à l'extérieur des milieux de soins de santé, cette proportion a nettement diminué pour s'établir à 3 % en mars 2021Note de bas de page 1. Les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé représentent un large éventail d'individus, notamment des professionnels de la santé et des travailleurs de soutien, qui sont exposés à des risques variables de contracter le SRAS‑CoV‑2 en milieu de travail. Ainsi, selon les données de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie‑Britannique, le risque de contracter la COVID-19 était 1,8 fois plus élevé parmi les préposés aux bénéficiaires que chez le personnel infirmier et 3,3 fois plus élevé que chez les médecinsNote de bas de page 70.
Conditions de vie et de travail collectif
Les prisons fédérales ont signalé une augmentation importante des cas de COVID-19 au cours de l'hiver 2020‑2021. Bien que 13 des 43 établissements aient connu des éclosions au cours de la deuxième vague, 70 % des 880 cas au total se sont produits dans les 2 plus grands pénitenciers du pays, un au Manitoba et un en SaskatchewanNote de bas de page 71. Les Autochtones ont été touchés de façon disproportionnée en raison de leur surreprésentation dans le système carcéral canadienNote de bas de page 71. La vaccination a été accélérée pour les personnes incarcérées dans les établissements fédéraux et, en date du 8 août 2021, 78 % de cette population avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19Note de bas de page 72.
Les médecins hygiénistes régionaux ont signalé que les éclosions en milieu de travail étaient devenues l'un des facteurs de transmission les plus courants dans certaines provinces et certains territoires au cours de la deuxième et de la troisième vagueNote de bas de page 73 Note de bas de page 74 Note de bas de page 75. De nombreuses régions sanitaires ont connu des éclosions dans de vastes lieux de travail où les travailleurs pouvaient difficilement maintenir une distance physique. Bon nombre de ces éclosions ont nécessité des efforts supplémentaires pour les contenir. Par exemple, la Croix‑Rouge canadienne a effectué la recherche des contacts en réponse à une éclosion d'un variant préoccupant de COVID-19 dans une mine accessible uniquement par avion au Nunavut pour les employés qui avaient quitté le lieu de travail et étaient retournés à leur domicile dans diverses régions du paysNote de bas de page 76. Comme lors de la première vague, diverses autorités de santé publique ont signalé d'importantes éclosions dans les usines de transformation de la viande au cours des vagues suivantes, dont certaines ont nécessité la fermeture temporaire des installationsNote de bas de page 77 Note de bas de page 78. En conséquence, plusieurs régions sanitaires ont accordé la priorité à la vaccination des travailleurs du secteur de la transformation des alimentsNote de bas de page 79 Note de bas de page 80.
Le suivi des éclosions en milieu de travail à l'échelle provinciale, territoriale et nationale était limité, mais il est nécessaire pour l'adoption de mesures stratégiques ciblant des industries et des milieux particuliers afin de freiner la propagation futureNote de bas de page 81. Certaines autorités locales ont lancé des initiatives pendant la pandémie pour recueillir ce type de données. Par exemple, le Bureau de santé publique de Toronto a commencé à afficher publiquement le nom des lieux de travail touchés par des éclosions actives qui emploient 20 personnes ou plus et, à Ottawa, les employeurs étaient tenus d'aviser Santé publique Ottawa si 2 personnes ou plus dans leur lieu de travail avaient obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19Note de bas de page 82 Note de bas de page 83.
La COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur certaines collectivités
Au cours de la première vague, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 en fonction de l'âge était 2 fois plus élevé dans les quartiers du Canada où la concentration de la composition ethnoculturelle était la plus élevée (quintile supérieur) que dans ceux des quintiles inférieursNote de bas de page 69 Note de bas de page 84 Note de bas de page 85. De même, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 selon l'âge était 2 fois plus élevé chez les Canadiens et les Canadiennes vivant dans un quartier du quintile de revenu le plus bas que chez ceux des quartiers du quintile supérieurNote de bas de page 69 Note de bas de page 84. Dans les 2 analyses, les hommes affichaient des taux de mortalité beaucoup plus élevés que les femmesNote de bas de page 69 Note de bas de page 84.
Bien que ces populations aient été exposées de façon différente au SRAS‑CoV‑2 en raison de facteurs tels que la nature essentielle du travail et les conditions de vie, les raisons des écarts dans les taux de mortalité tiennent aux différences socioéconomiques de longue date dans la répartition des facteurs de risque sous‑jacents et l'accès aux services de soins de santéNote de bas de page 5 Note de bas de page 86. Même si des données nationales semblables pour la deuxième et la troisième vague n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport, il a été établi que les communautés racisées et les groupes à faible revenu étaient susceptibles de continuer d'afficher des taux plus élevés de COVID-19 et de préjudices graves lors des vagues suivantes. Cela est attribuable aux iniquités fondamentales qui existaient avant la pandémie et au risque disproportionné continu d'exposition au SRAS‑CoV‑2.
Les données sur la séroprévalence recueillies auprès de donneurs de sang en mai 2021 indiquaient que les donneurs racisés étaient plus de 2 fois plus susceptibles d'avoir des anticorps acquis à la suite d'une infection antérieure au virus de la COVID-19Note de bas de page 87. De plus, le Bureau de santé publique de Toronto a signalé que 73 % de toutes les personnes qui avaient obtenu un résultat positif au test de dépistage du SRAS‑CoV‑2 entre le 20 mai 2020 et le 31 mai 2021 ont dit appartenir à un groupe racisé. Soulignons que ces groupes représentent habituellement 52 % de la population de Toronto. De même, 45 % des cas déclarés concernaient des personnes vivant dans des ménages à faible revenu, lesquels représentent 30 % de la population de TorontoNote de bas de page 88.
Reconnaissant qu'une répartition inéquitable possible des vaccins menaçait d'exacerber les iniquités sociales et de santé déjà intensifiées par la pandémie, le CCNI a mis à jour, en février 2021, ses lignes directrices initiales sur la priorisation de la vaccination contre la COVID-19 au Canada pour inclure les adultes des communautés racisées touchées de façon disproportionnée par la COVID-19Note de bas de page 89. Comme pour d'autres directives nationales, les régions ont adapté ces recommandations en fonction de leur propre contexte local.
Une analyse a mis en lumière l'inégalité de la couverture vaccinale en Ontario, probablement en raison de facteurs institutionnels et sociaux complexes, la province a détourné 50 % de son approvisionnement en vaccins vers les quartiers affichant la plus forte incidence d'infection pendant 2 semaines en mai 2021Note de bas de page 90. Ces quartiers présentaient souvent des concentrations plus élevées de populations racisées et à faible revenu et la plus forte proportion de travailleurs essentiels.
Le ciblage sur place des besoins en matière de vaccination (p. ex. les zones à haut risque) doit aussi être accompagné d'initiatives visant directement à lutter contre les iniquités socialesNote de bas de page 91. Par exemple, la Health Association of African Canadians (Association pour la santé des Afro‑Canadiens), l'Association of Black Social Workers (association des travailleurs sociaux noirs) et l'Office des affaires afro‑néo‑écossaises, ainsi que des dirigeants communautaires, ont mis sur pied des cliniques de vaccination à l'intention des membres des communautés afro‑néo‑écossaisesNote de bas de page 92. De plus, de nombreux centres urbains, dont Montréal et Vancouver, ont accordé la priorité à la vaccination des personnes sans abri en janvier 2021 et ont eu recours à des stratégies ciblées pour accroître le taux de vaccination dans cette populationNote de bas de page 93 Note de bas de page 94.
La COVID-19 et les communautés autochtones
Au cours des premiers mois de la pandémie, les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont rapidement pris les commandes de l'intervention et, en travaillant en collaboration, elles ont réussi à limiter la propagation de la COVID-19Note de bas de page 5. Comme dans de nombreuses régions du Canada, le nombre de cas a augmenté rapidement dans de nombreuses communautés autochtones au cours de la deuxième vagueNote de bas de page 95. Compte tenu de l'intersection des défis sociaux et économiques et des répercussions durables et continues des traumatismes intergénérationnels et de l'oppression systémique, l'ensemble des communautés autochtones présentaient un risque élevé de propagation rapide de la COVID-19 et de conséquences potentiellement plus graves comparativement à la population canadienne en général. Parmi les difficultés figuraient les questions de logements inadéquats et surpeuplés, de l'isolement géographique et de l'accès réduit aux services de santé et de soins intensifsNote de bas de page 5.
Au plus fort de la deuxième vague en janvier 2021, le taux d'incidence de COVID-19 chez les Premières Nations vivant dans les communautés autochtones était 3 fois plus élevé que celui de la population canadienne en général (figure 4)Note de bas de page 95. Les statistiques sur les membres des Premières Nations qui ne vivent pas dans les communautés n'étaient pas disponibles à l'échelle nationale. Toutefois, les données régionales indiquaient que le fardeau de la COVID-19 était potentiellement plus lourd pour les personnes vivant hors communauté que pour celles vivant dans les communautés. Par exemple, en date du 14 août 2021, les personnes vivant hors communauté représentaient 56 % des cas de COVID-19 chez les Premières Nations en Colombie‑BritanniqueNote de bas de page 96.
Après avoir réussi à prévenir toute importation de cas au cours de la première vague, le Nunavut, dont la population est composée à 85 % d'Inuits, a déclaré son premier cas de COVID-19 en novembre 2020 (figure 2)Note de bas de page 54 Note de bas de page 97. Le territoire a rapidement freiné d'autres éclosions et empêché leur réapparition grâce à des mesures de santé publique ciblées, y compris des tests proactifs de surveillance des eaux usées et la restriction des déplacements territoriauxNote de bas de page 98 Note de bas de page 99 Note de bas de page 100. En date du 31 août 2021, le dernier cas de COVID-19 signalé au Nunavut remontait à juin 2021 et le territoire avait administré au moins une dose de vaccin à 80 % de la population admissibleNote de bas de page 54 Note de bas de page 60.
Les vaccins ont été proposés en priorité aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui ont joué un rôle de premier plan dans l'exécution des programmes de vaccination. Les groupes communautaires ainsi que les gouvernements et les dirigeants autochtones ont réagi rapidement pour mettre sur pied des cliniques et fournir du matériel éducatif adapté à la cultureNote de bas de page 101 Note de bas de page 102 Note de bas de page 103. Des initiatives visant à administrer des vaccins de façon sécuritaire et efficace ont également été mises en œuvre, comme l'opération Immunité dans les collectivités éloignées, dirigée par le service d'ambulance aérienne et de transport médical de l'Ontario (ORNGE), en partenariat avec la Nation Nishnawbe Aski, qui a fourni des vaccins à 31 collectivités éloignées des Premières Nations de la provinceNote de bas de page 104.
Compte tenu des expériences antérieures de stigmatisation et de racisme, les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada ont exprimé le désir de connaître et de comprendre les risques et les avantages de la vaccination, expliqués par des sources fiables, et ils ont réclamé des interventions spécialement adaptées aux besoins et aux pratiques culturelles des communautésNote de bas de page 105 Note de bas de page 106. À titre d'exemple, citons le partenariat entre le Conseil autochtone des soins de santé primaires et le Programme national de réconciliation Save the Children pour diriger un programme de promotion de la vaccination chez les jeunes Autochtones. Les jeunes ont élaboré des stratégies dans les médias sociaux pour dire pourquoi ils se sont fait vacciner en utilisant les mots‑clics #IndigenousYouth4Vaccine et #SmudgeCOVIDNote de bas de page 107. En date du 10 août 2021, plus de 86 % des personnes de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires avaient reçu au moins une dose de vaccinNote de bas de page 95 Note de bas de page 108.
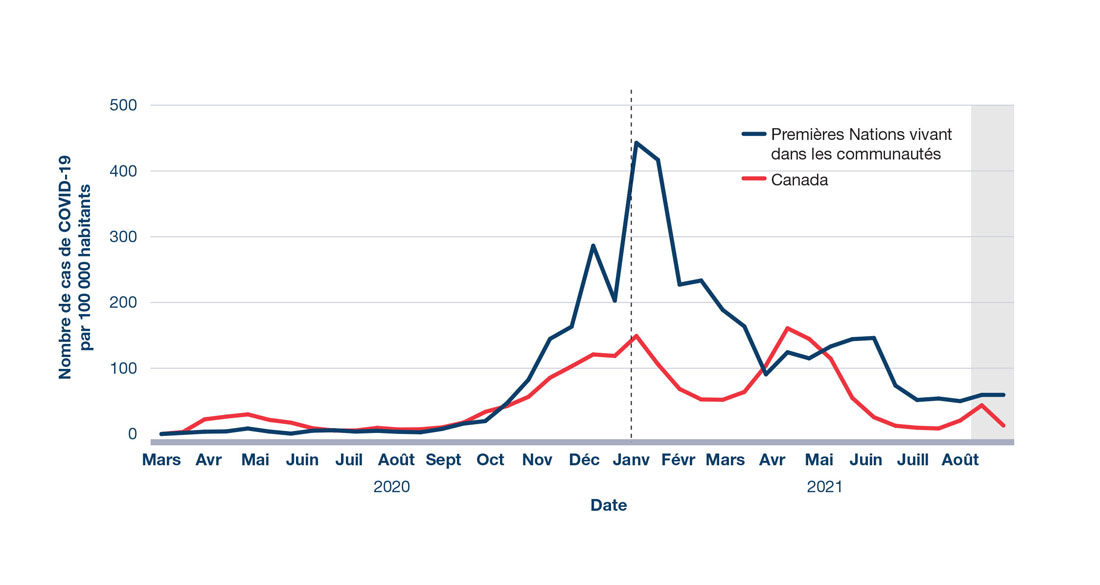
Figure 4 : Texte descriptif
La figure est un graphique linéaire affichant le taux de cas déclarés de COVID-19 chez les membres des Premières Nations vivant dans les communautés autochtones comparativement à la population canadienne en général, de mars 2020 à août 2021. La ligne bleue affiche le nombre de cas des Premières Nations dans les communautés autochtones et la ligne rouge affiche le nombre de cas pour l'ensemble du Canada. L'axe vertical montre le nombre de cas pour 100 000 habitants. L'axe horizontal affiche la date d'apparition de la maladie en mois.
| Date (période précise) | Premières Nations vivant dans les communautés autochtones | Canada |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 1,8 | 8,5 |
| 2020-04-30 | 6,2 | 28,1 |
| 2020-05-31 | 2,2 | 19,4 |
| 2020-06-30 | 5,4 | 7,1 |
| 2020-07-31 | 4,3 | 7,4 |
| 2020-08-31 | 4,6 | 8,1 |
| 2020-09-30 | 17,8 | 25,6 |
| 2020-10-31 | 64,6 | 49,5 |
| 2020-11-30 | 154,0 | 94,3 |
| 2020-12-31 | 244,6 | 119,9 |
| 2021-01-31 | 362,2 | 107,8 |
| 2021-02-28 | 211,1 | 52,3 |
| 2021-03-31 | 127,2 | 84,1 |
| 2021-04-30 | 119,7 | 152,7 |
| 2021-05-31 | 138,7 | 84,8 |
| 2021-06-30 | 109,8 | 19,0 |
| 2021-07-31 | 52,9 | 9,0 |
| 2021-08-31 | 56,3 | 25,7 |
Toutes les variables sont des données hebdomadaires selon la date d'apparition de la maladie. La zone ombrée indique l'incertitude des données en raison des retards de déclarationNote de bas de page 95.
Effet attendu de la vaccination sur la quatrième vague
Au moment de la rédaction du rapport, en août 2021, l'augmentation de l'incidence indiquait le début d'une quatrième vague (figure 1). En juillet 2021, la modélisation à long terme fondée principalement sur le variant préoccupant Delta plus contagieux a prédit qu'à l'automne 2021, le nombre de cas quotidiens pourrait dépasser les pics des vagues précédentes, car de nombreuses régions prévoyaient de passer aux étapes finales de leurs plans de déconfinementNote de bas de page 30 Note de bas de page 109.
En date du 28 août 2021, 83 % de la population admissible au Canada avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 76 % avaient été entièrement vaccinésNote de bas de page 40. Compte tenu de l'accélération de la vaccination de la population générale, il était attendu que l'épidémiologie et les interventions en santé publique pour cette vague soient très différentes de ce qu'elles avaient été auparavant. Les spécialistes de la santé publique prévoyaient que la transmission serait concentrée dans les régions où la couverture vaccinale était plus faible et chez les enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination, alors que les écoles rouvraient à l'apprentissage en présentielNote de bas de page 109.
On escomptait que l'atteinte d'une couverture vaccinale élevée parmi les populations admissibles ait un effet important sur la réduction de la gravité de la maladie à l'avenir. Cependant, la mise à jour de la modélisation en août 2021 a révélé qu'il y avait encore un risque que les capacités du système de santé soient dépassées si au moins 80 % de la population admissible n'était pas entièrement vaccinée, en particulier les Canadiennes et les Canadiens de 18 à 39 ans, et si l'assouplissement accru des mesures de santé publique donnait lieu à l'augmentation des taux de contact. Cela s'explique en partie par le risque élevé d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs associé au variant Delta, en particulier chez les personnes non vaccinéesNote de bas de page 51.
À l'été 2021, de nombreuses régions ont lancé des campagnes plus ciblées pour favoriser l'adhésion à la vaccination (voir l'encadré « Renforcer la confiance dans les vaccins au Canada »). Plusieurs régions ont également exigé des preuves de vaccination pour certains groupes ou pour la participation à certaines activitésNote de bas de page 109. Par exemple, en août 2021, le Québec est devenu la première province à annoncer que les gens doivent être adéquatement vaccinés (ou avoir reçu une exemption pour des raisons médicales) pour accéder à certains services non essentielsNote de bas de page 110. Les Services de santé de l'Alberta ont également annoncé des plans visant à imposer la vaccination complète obligatoire à tous les employés et fournisseurs de soins de santé contractuelsNote de bas de page 111.
Renforcer la confiance dans les vaccins au Canada
Les résultats d'une enquête nationale menée de septembre à décembre 2020 révèlent que 77 % des Canadiens et des Canadiennes de 12 ans et plus ont déclaré être « plutôt disposés » ou « très disposés » à se faire vacciner contre la COVID-19Note de bas de page 112. En février 2021, après le début de l'administration des vaccins, ce pourcentage a augmenté pour atteindre 82 %Note de bas de page 113. Les raisons invoquées pour l'hésitation à se faire vacciner sont multiples, notamment les préoccupations au sujet de l'innocuité et de l'efficacité du vaccin, l'accessibilité des services de vaccination et la méfiance à l'égard du processus d'approbation du vaccinNote de bas de page 105 Note de bas de page 114 Note de bas de page 115 Note de bas de page 116. Il est essentiel de lutter contre la réticence à l'égard de la vaccination pour assurer la gestion continue de la COVID-19, car une vaste couverture vaccinale est nécessaire pour limiter les éclosions futures. En reconnaissance de cette nécessité, de nombreuses collectivités et entreprises, ainsi que tous les paliers gouvernementaux, ont étudié les possibilités de favoriser l'adoption de la vaccination. Le Défi de l'innovation communautaire pour la vaccination est un exemple d'initiative visant à encourager la vaccination et à renforcer la confiance envers les vaccins. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada a sélectionné jusqu'à 140 projets créatifs qui permettront d'élaborer et de réaliser des campagnes d'information afin de donner aux dirigeants communautaires les moyens nécessaires pour accroître la confiance des gens envers les vaccins contre la COVID-19 et renforcer les mesures de santé publique ciblant les populations les plus durement touchées par la pandémieNote de bas de page 117. Cette initiative est l'un des nombreux programmes soutenus par le Fonds de partenariat d'immunisation qui visent à accroître la confiance dans les vaccins et à contrer la mésinformation et la désinformation en donnant la parole à des intervenants communautaires dignes de confianceNote de bas de page 117.
Étant donné l'ampleur de la couverture vaccinale, les régions sanitaires ont prévu de concentrer davantage les interventions en santé publique sur les éclosions localisées, et de surveiller les indicateurs de gravité plutôt que d'appliquer des mesures de santé publique restrictives à grande échelle. Il était particulièrement important de doter le système de santé publique de capacités suffisantes, car d'autres priorités pressantes en matière de santé et le retour à une saison de grippe et de virus respiratoire plus typique exerceraient une pression supplémentaire sur un effectif de santé publique déjà épuiséNote de bas de page 118. Les mesures de protection personnelle comme rester à la maison lorsqu'on est malade et l'hygiène des mains sont demeurées importantes même après la levée des mesures de santé publique restrictives par les diverses instances. Toutefois, il était impératif de demeurer réceptif aux signaux de l'augmentation de l'activité du SRAS‑CoV‑2, de maintenir la vigilance et la préparation pour les variants préoccupants existants et émergents, et de surveiller l'efficacité des vaccins partout au pays et à l'échelle internationale.
La situation de la COVID-19 au Canada dans un contexte mondial
En date du 31 août 2021, à l'échelle mondiale, plus de 215 millions de cas de COVID-19 et près de 4,5 millions de décès liés à la COVID-19 avaient été signalésNote de bas de page 119. Comme le Canada, de nombreux autres pays repères de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont connu des éclosions et une recrudescence des cas de COVID-19 après l'été 2020, même ceux qui avaient réussi à prévenir ou à limiter une première vagueNote de bas de page 119. Une multitude de facteurs influent sur la tendance épidémiologique dans chaque pays, d'où la nécessité d'interpréter avec prudence leurs données respectives.
En 2021, de nombreux pays de l'OCDE ont modifié leurs interventions en santé publique pour mettre leurs efforts à acquérir une couverture vaccinale élevée. Comparativement à des pays comme les États‑Unis, le Royaume‑Uni et Israël, la vaccination de masse au Canada a commencé un peu plus tard (figure 5)Note de bas de page 119. Néanmoins, en raison de l'accélération de l'offre de vaccination, de l'expansion des campagnes de vaccination dans les provinces et les territoires et d'une stratégie d'intervalles prolongés entre les doses, le 31 août 2021, le Canada avait administré au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 à 73 % de la population totaleNote de bas de page 40. Ces efforts combinés ont contribué à placer le Canada au septième rang des pays de l'OCDE pour la couverture vaccinale de la première dose la plus élevée à l'époqueNote de bas de page 119.
Le Canada s'est penché sur les expériences d'autres pays qui ont connu une résurgence alimentée par des variants plus contagieux. Par exemple, Israël, l'Islande et le Royaume‑Uni ont tous connu une augmentation rapide du nombre de cas à l'été 2021, même avec une couverture vaccinale relativement élevée (figure 5), attribuable au variant Delta. Toutefois, en août 2021, le nombre d'hospitalisations ou de décès liés à la COVID-19 dans les 3 pays était de loin inférieur à celui déclaré au cours des vagues précédentesNote de bas de page 119. Les expériences de ces pays, ainsi que les nouvelles données probantes selon lesquelles l'immunité acquise par le vaccin pourrait diminuer au fil du temps, ont mis en lumière la nécessité de continuer à faire preuve de prudence à mesure que la couverture vaccinale augmenteNote de bas de page 120. L'assouplissement des mesures de santé publique doit être contrôlé, graduel et adapté au contexte épidémiologique local, même lorsque les taux d'infection atteignent de faibles niveaux.
En date du 31 août 2021, seulement 40 % de la population mondiale et 2 % de la population des pays à faible revenu avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19Note de bas de page 119 Note de bas de page 121. À l'échelle mondiale, le manque d'approvisionnement en vaccins et d'accès à la vaccination contre la COVID-19 signifie que, dans un avenir prévisible, la phase aiguë de la pandémie persistera dans de nombreux endroits. Le Canada demeure déterminé à travailler avec ses partenaires pour atteindre des cibles de vaccination équitables à l'échelle mondiale, par exemple par le don de vaccins et de fonds au Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (COVAX)Note de bas de page 122. Le soutien offert par le Canada à l'échelle internationale profite également à la population canadienne, car l'avenir de la COVID-19 au Canada dépend de la collaboration avec tous les pays pour mettre fin à la pandémie.
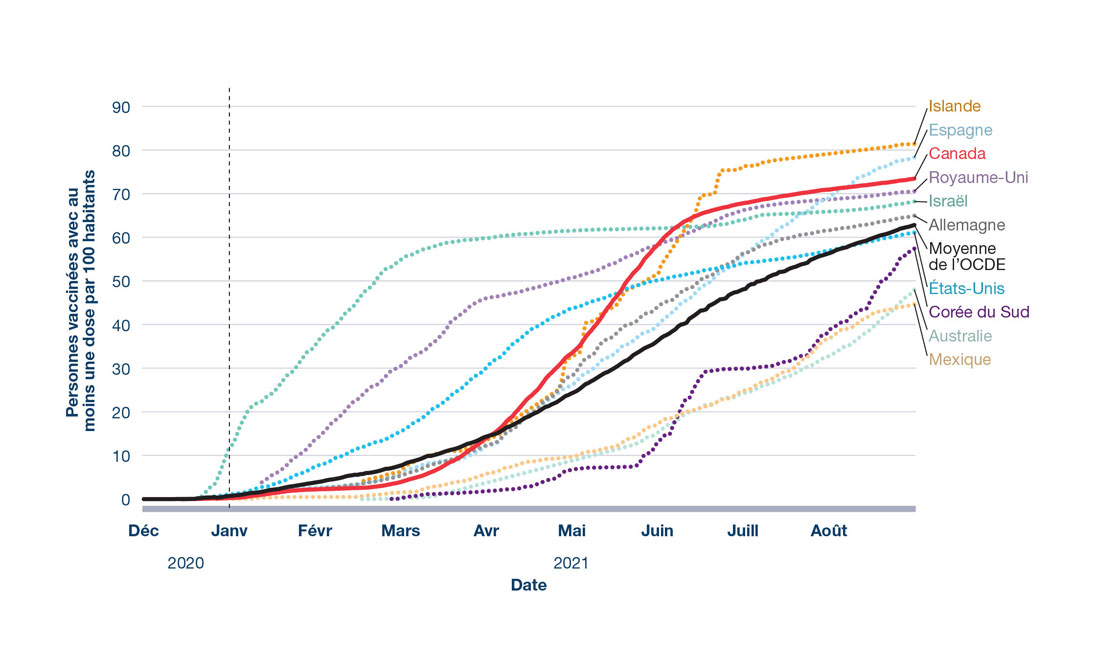
Figure 5 : Texte descriptif
La figure est un graphique linéaire affichant le nombre cumulatif de personnes qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada et dans certains pays de l'OCDE de décembre 2020 à août 2021. L'axe vertical affiche le nombre de personnes vaccinées avec au moins une dose par 100. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois. Les pays sont représentés par des lignes de tendance de couleurs différentes : Islande (orange), Espagne (bleu pâle), Royaume-Uni (violet pâle), Israël (vert), Allemagne (gris), Brésil (violet foncé), États-Unis (bleu pâle), Australie (vert pâle) et Afrique du Sud (orange pâle). Le Canada et la moyenne de l'OCDE sont représentés par des lignes continues rouge et noire, respectivement, pour faciliter la comparaison par rapport aux lignes pointillées pour tous les autres pays.
| Date (période précise) | Personnes vaccinées avec au moins une dose par 100 habitants |
|---|---|
| Australie | |
| 2021-02-28 | 0,1 |
| 2021-03-31 | 2,6 |
| 2021-04-30 | 7,7 |
| 2021-05-31 | 14,5 |
| 2021-06-30 | 23,8 |
| 2021-07-31 | 32,5 |
| 2021-08-31 | 47,3 |
| Brésil | |
| 2021-01-31 | 0,3 |
| 2021-02-28 | 2,2 |
| 2021-03-31 | 3,6 |
| 2021-04-30 | 13,2 |
| 2021-05-31 | 32,4 |
| 2021-06-30 | 57,2 |
| 2021-07-31 | 67,6 |
| 2021-08-31 | 70,9 |
| Canada | |
| 2020-12-31 | 73,4 |
| 2021-01-31 | 0,3 |
| 2021-02-28 | 2,3 |
| 2021-03-31 | 4,9 |
| 2021-04-30 | 11,9 |
| 2021-05-31 | 27,7 |
| 2021-06-30 | 43,0 |
| 2021-07-31 | 55,3 |
| 2021-08-31 | 61,5 |
| Allemagne | |
| 2020-12-31 | 64,8 |
| 2021-01-31 | 1,4 |
| 2021-02-28 | 3,1 |
| 2021-03-31 | 5,7 |
| 2021-04-30 | 14,4 |
| 2021-05-31 | 31,9 |
| 2021-06-30 | 49,9 |
| 2021-07-31 | 75,5 |
| 2021-08-31 | 78,4 |
| Islande | |
| 2020-12-31 | 81,4 |
| 2021-01-31 | 11,3 |
| 2021-02-28 | 35,3 |
| 2021-03-31 | 53,7 |
| 2021-04-30 | 59,7 |
| 2021-05-31 | 61,5 |
| 2021-06-30 | 62,1 |
| 2021-07-31 | 63,7 |
| 2021-08-31 | 65,9 |
| Israël | |
| 2020-12-31 | 68,1 |
| 2021-01-31 | 0,0 |
| 2021-02-28 | 0,5 |
| 2021-03-31 | 1,5 |
| 2021-04-30 | 5,3 |
| 2021-05-31 | 9,6 |
| 2021-06-30 | 16,7 |
| 2021-07-31 | 24,2 |
| 2021-08-31 | 36,4 |
| Mexique | |
| 2020-12-31 | 44,5 |
| 2021-01-31 | 0,0 |
| 2021-02-28 | 1,7 |
| 2021-03-31 | 6,6 |
| 2021-04-30 | 11,3 |
| 2021-05-31 | 29,9 |
| 2021-06-30 | 37,9 |
| 2021-07-31 | 57,1 |
| 2021-08-31 | 2,7 |
| Corée du Sud | |
| 2021-02-28 | 5,5 |
| 2021-03-31 | 11,4 |
| 2021-04-30 | 25,2 |
| 2021-05-31 | 38,9 |
| 2021-06-30 | 54,8 |
| 2021-07-31 | 68,1 |
| 2021-08-31 | 78,2 |
| Afrique du Sud | |
| 2021-02-28 | 1,5 |
| 2021-03-31 | 13,6 |
| 2021-04-30 | 29,7 |
| 2021-05-31 | 45,7 |
| 2021-06-30 | 50,4 |
| 2021-07-31 | 57,9 |
| 2021-08-31 | 65,8 |
| Espagne | |
| 2021-01-31 | 68,6 |
| 2021-02-28 | 70,5 |
| 2021-03-31 | 0,8 |
| 2021-04-30 | 7,5 |
| 2021-05-31 | 14,8 |
| 2021-06-30 | 29,0 |
| 2021-07-31 | 43,1 |
| 2021-08-31 | 49,9 |
| Royaume-Uni | |
| 2020-12-31 | 53,7 |
| 2021-01-31 | 56,8 |
| 2021-02-28 | 61,0 |
| 2021-03-31 | 0,7 |
| 2021-04-30 | 3,8 |
| 2021-05-31 | 7,3 |
| 2021-06-30 | 13,9 |
| 2021-07-31 | 23,6 |
| 2021-08-31 | 35,5 |
| États-Unis | |
| 2020-12-31 | 47,5 |
| 2021-01-31 | 56,0 |
| 2021-02-28 | 62,6 |
| 2021-03-31 | 0,1 |
| 2021-04-30 | 2,6 |
| 2021-05-31 | 7,7 |
| 2021-06-30 | 14,5 |
| 2021-07-31 | 23,8 |
| 2021-08-31 | 32,5 |
| Moyenne de l'OCDE | |
| 2020-12-31 | 47,3 |
| 2021-01-31 | 0,3 |
| 2021-02-28 | 2,2 |
| 2021-03-31 | 3,6 |
| 2021-04-30 | 13,2 |
| 2021-05-31 | 32,4 |
| 2021-06-30 | 57,2 |
| 2021-07-31 | 67,6 |
| 2021-08-31 | 70,9 |
La déclaration peut être fondée sur des normes et des fréquences différentes selon le pays. Par conséquent, ces données doivent être interprétées avec prudence. La couverture vaccinale peut inclure des non‑résidentsNote de bas de page 119.
Conséquences sanitaires et sociales générales de la COVID-19 au Canada
Bien que l'influence de la pandémie de COVID-19 sur la santé puisse être décelée au moyen de nombreux indicateurs de la santé de la population au Canada, comme on l'a vu lors la première vague, les conséquences de la pandémie ne se limitent pas au domaine de la santé.
Comme pour les répercussions directes sur la santé de la COVID-19 dont il a été question plus tôt, les conséquences sanitaires et sociales sont ressenties de façon disproportionnée parmi certaines populations clés au Canada. Les répercussions différentes sont souvent liées à des iniquités préexistantes en matière de santé et d'économie, ainsi qu'à l'accès aux ressources et aux soutiens. Par conséquent, la pandémie a aggravé bon nombre des facteurs structurels et systémiques qui contribuent à la répartition inéquitable du pouvoir et des ressourcesNote de bas de page 5 Note de bas de page 14. La présente section met en lumière une série d'exemples qui illustrent les répercussions économiques, sociales et sanitaires plus vastes, complexes et interreliées de la COVID-19 et de certaines actions gouvernementales, communautaires et du secteur privé visant à les atténuer.
L'espérance de vie générale a probablement diminué pendant la pandémie
L'examen de l'espérance de vie peut donner une vue d'ensemble des répercussions les plus graves de la pandémie sur la santé de l'ensemble de la population au Canada. L'espérance de vie représente le nombre d'années de vie auxquelles une personne d'un âge donné peut s'attendre, compte tenu des taux de mortalité observés. En 2020, on a estimé que l'espérance de vie à la naissance avait diminué de près de 5 mois pour les 2 sexes à l'échelle nationale en raison des décès attribuables à la COVID-19 seulementNote de bas de page 123. En règle générale, l'espérance de vie au Canada a augmenté d'environ 2,5 mois par année au cours des 4 dernières décenniesNote de bas de page 124. L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance a commencé à stagner au début de la crise des opioïdes en 2016Note de bas de page 124 Note de bas de page 125. Bien que l'espérance de vie n'ait pas encore été calculée pour 2020 au moment de la rédaction du rapport, il est clair que la COVID-19 aura un impact importantNote de bas de page 123 Note de bas de page 126.
Même si la surmortalité peut, dans une large mesure, être directement attribuée à la COVID-19, la pandémie a également eu des conséquences indirectes sur la mortalité. C'est ce qui ressort le plus clairement dans le cas des populations plus jeunes. Bien que 1 600 décès liés à la COVID-19 aient été signalés chez des Canadiennes et des Canadiens de moins de 65 ans entre mars 2020 et mai 2021, il y a eu 7 150 décès de plus que prévu dans ce groupe d'âge au cours de la même périodeNote de bas de page 127. L'aggravation de la crise des surdoses d'opioïdes est probablement une cause importante de cette surmortalitéNote de bas de page 128.
Problèmes de santé prévisibles à l'horizon
La COVID-19 a exercé d'énormes pressions sur le système de soins de santé canadien et les répercussions négatives à long terme seront probablement considérables.
Pendant la pandémie, le recours à certains services de santé a diminué de façon notable. Cela peut être attribuable à la fois à la diminution du nombre de personnes qui demandent des soins et à la réduction du nombre et des types de services disponiblesNote de bas de page 129. Au cours des 10 premiers mois de la pandémie, le nombre de visites à l'urgence et d'hospitalisations a diminué au pays. Les conseils de rester à la maison peuvent avoir entraîné une diminution des préjudices non intentionnels et de la transmission d'autres maladies contagieusesNote de bas de page 129 Note de bas de page 130. De plus, les fournisseurs de soins de santé au Canada qui offrent des services de prévention, de dépistage et de traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ont signalé une baisse de 66 % de la demande pour leurs servicesNote de bas de page 131. Cela pourrait être attribuable à la difficulté pour la population d'accéder aux services en raison de la réduction des heures d'ouverture ou de la fermeture dans le cadre des mesures de santé publique.
Le fardeau imposé au système de soins de santé par la pandémie et les répercussions des mesures de santé publique ont eu pour effet de réduire l'accessibilité à certains services. De nombreuses instances ont reporté des chirurgies non urgentes et d'autres interventions chirurgicales afin de s'assurer qu'il y avait suffisamment de ressources disponibles pour les patients atteints de la COVID-19Note de bas de page 129. Ainsi, en Ontario, le Bureau de la responsabilité financière a estimé qu'à la fin de septembre 2021, il faudrait plus de 3 ans pour éliminer l'arriéré accumulé en chirurgie et en diagnostic pendant la pandémieNote de bas de page 132. Les chercheurs prévoient également une augmentation des cas de cancer une fois que le dépistage et les interventions chirurgicales auront repris après les interruptions liées à la COVID-19Note de bas de page 133. Cependant, contrairement à ce qui s'est produit pour les adultes, le taux d'incidence du cancer chez les enfants et le dépistage précoce semblent être demeurés stables tout au long de la pandémieNote de bas de page 134. La pandémie a aussi détourné des ressources et d'autres programmes de santé publique, limitant ainsi la capacité de les affecter à d'autres priorités de santé publiqueNote de bas de page 7. Les encadrés intitulés « Syndrome post‑COVID-19 » et « Les mesures de santé publique ont eu une incidence sur la propagation et la prise en charge d'autres maladies contagieuses » présentent d'autres exemples des effets de la pandémie sur la santé.
Syndrome post‑COVID-19
Le syndrome post‑COVID-19 (aussi appelé la COVID-19 de longue durée) se caractérise par des symptômes qui persistent ou réapparaissent après une infection aiguë à la COVID-19, soit à court terme (de 4 à 12 semaines après le diagnostic) ou à long terme (plus de 12 semaines après le diagnostic)Note de bas de page 135. Les résultats préliminaires d'une revue systématique indiquent que 56 % des personnes qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ont fait état de la persistance ou de la présence d'un ou de plusieurs symptômes à long termeNote de bas de page 135. Bien que plus d'une centaine de résultats aient été signalés (c.‑à‑d. symptômes, séquelles et difficultés à mener les activités habituelles), les symptômes les plus courants comprennent la fatigue, la douleur ou l'inconfort général, les troubles du sommeil, l'essoufflement et l'anxiété ou la dépressionNote de bas de page 135. La prise en charge de ces patients, qui pourraient être aux prises avec des symptômes de la maladie à long terme, pose des défis qui exerceront des pressions supplémentaires sur le système de santé. Le Canada compte de nombreuses cliniques spécialisées qui ont été créées pour gérer le syndrome post‑COVID-19Note de bas de page 136.
En partenariat avec Statistique Canada, les établissements d'enseignement, les provinces et les territoires, l'ASPC évalue un certain nombre de sources de données qui pourraient être utilisées pour faire le suivi des cas de syndrome post‑COVID-19 et des symptômes connexes. Le gouvernement du Canada continue de surveiller les données probantes nationales et internationales et d'appuyer les revues systématiques portant sur l'éventail des complications associées à cette maladieNote de bas de page 137. De plus, les Instituts de recherche en santé du Canada ont financé des études prospectives qui nous permettront de mieux comprendre les facteurs de risque et les résultats à long terme de la COVID-19Note de bas de page 138.
Transition rapide vers les soins virtuels
Afin de réduire au minimum le risque d'exposition au SRAS‑CoV‑2, un grand nombre de fournisseurs de soins de santé ont rapidement opté pour des rendez‑vous de soins virtuels. Dans 5 provinces pour lesquelles des données étaient disponibles, en février 2020, 48 % des médecins avaient fourni au moins un service de soins virtuels. Ce pourcentage a augmenté pour atteindre 83 % en septembre 2020Note de bas de page 139. Les adultes plus âgés, qui sont susceptibles de subir les effets néfastes de la COVID-19, étaient les principaux utilisateurs des soins virtuelsNote de bas de page 140. Toutefois, le recours aux soins virtuels a posé des difficultés aux personnes qui manquaient de compétences numériques ou n'avaient pas un accès fiable à Internet ou au téléphoneNote de bas de page 141. Des études sont nécessaires pour déterminer les problèmes de santé et les circonstances les plus propices à l'utilisation des soins virtuels qui n'exacerbent pas les iniquités en matière d'accès aux services de santéNote de bas de page 142.
Les mesures de santé publique ont eu une incidence sur la propagation et la prise en charge d'autres maladies contagieuses
L'adoption des mesures de santé publique visant à gérer la transmission de la COVID-19 pourrait aussi avoir freiner la propagation d'autres maladies infectieuses. Malgré l'augmentation des tests, le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire entre septembre 2020 et août 2021 était inférieur à 0,2 % du nombre de cas déclarés au cours de la même période en 2018‑2019. De même, aucun décès lié à la grippe n'a été enregistré en 2020‑2021 dans les 8 provinces et territoires déclarants, comparativement à 223 décès liés à la grippe enregistrés en 2018‑2019Note de bas de page 143 Note de bas de page 144.
Les taux d'autres maladies infectieuses pourraient aussi avoir été inférieurs à ceux des années précédentes, bien que dans certains cas, cela pourrait être attribuable à une diminution des tests en raison des conséquences plus vastes de la COVID-19, plutôt qu'à une diminution de l'incidence de la maladie. En 2020, l'Alberta et l'Ontario ont tous deux signalé une baisse des taux d'incidence de la chlamydia, du VIH et de l'hépatite CNote de bas de page 145 Note de bas de page 146. Toutefois, les maladies infectieuses n'ont pas toutes affiché une tendance à la baisse. Par exemple, le taux de syphilis infectieuse a augmenté de 8 % en AlbertaNote de bas de page 145. Cette tendance à la hausse, qui s'est amorcée avant la pandémie, demeure préoccupante, surtout chez les jeunes canadiens et canadiennes et les populations mal desserviesNote de bas de page 147. En outre, de nouvelles données probantes révèlent que l'utilisation d'antimicrobiens dans la collectivité a diminué considérablement. De mars à octobre 2020, le taux national moyen de distribution d'antibiotiques a diminué de 27 % par rapport à la période antérieure à la COVID-19. Cela peut être lié à une diminution des consultations médicales pendant la pandémieNote de bas de page 148.
La santé mentale de la population canadienne s'est détériorée pendant la pandémie
Pour nombre de Canadiens et de Canadiennes, l'expérience de la pandémie s'est accompagnée du stress lié à la perte d'emploi, à l'isolement des êtres chers, aux restrictions sur les activités communautaires et récréatives ou à la nécessité de trouver un équilibre entre les responsabilités professionnelles et de prestation de soins. Tout porte à croire que l'étendue de ces défis ont eu une incidence négative sur les sentiments et les perceptions d'un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes quant à leur santé mentale et à leur bien‑être, en particulier les femmes, les jeunes et les travailleurs de première ligne.
Selon les données recueillies en mars et en avril 2021 dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 42 % des personnes interrogées ont déclaré que leur santé mentale perçue était « un peu moins bonne » ou « bien moins bonne » comparativement à avant la pandémieNote de bas de page 149. La détérioration perçue de la santé mentale était plus fréquente chez les femmes (44 %) que chez les hommes (39 %) et elle était aussi plus fréquente au sein de la population âgée de 18 à 34 ans (45 %), de 35 à 49 ans (48 %) et de 50 à 64 ans (40 %) que chez les personnes âgées de 65 ans et plus (33 %)Note de bas de page 149.
Environ 70 % des travailleurs de la santé qui ont participé à une enquête par approche participative menée par Statistique Canada de novembre à décembre 2020 ont déclaré avoir l'impression que leur santé mentale s'était détériorée pendant la pandémie de COVID-19. Les gens qui ont eu des contacts avec des personnes dont l'infection à la COVID-19 a été confirmée ou était soupçonnée étaient plus nombreux à déclarer éprouver le sentiment que leur santé mentale s'était détériorée (77 %) comparativement à ceux qui n'ont pas déclaré avoir eu de contact direct avec d'autres personnes (62 %)Note de bas de page 150. Bien qu'aucune comparaison directe avec la situation d'avant la pandémie n'était disponible, selon l'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM), les travailleurs canadiens de première ligne étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir un résultat positif au dépistage pour le trouble de stress post‑traumatique et 1,5 fois plus susceptibles d'avoir un résultat positif pour le trouble d'anxiété généralisée ou le trouble dépressif majeur que les personnes qui ne travaillaient pas en première ligneNote de bas de page 151 Note de bas de page 152.
Même si les personnes âgées de 12 à 17 ans faisaient partie d'un des groupes d'âge les moins susceptibles de déclarer une détérioration de leur santé mentale en janvier et en février 2021, la proportion de ces personnes ayant fait état d'une mauvaise santé mentale a doublé depuis septembre 2020Note de bas de page 149. Bien que peu de données probantes à l'échelle nationale étaient disponibles au moment de la rédaction du rapport, une étude menée dans la région du Grand Toronto d'avril à juin 2020 laisse entendre que la santé mentale pendant la pandémie s'est détériorée davantage chez les enfants et les adolescents ayant un diagnostic psychiatrique préexistantNote de bas de page 153. Selon Jeunesse, J'écoute, un service de santé mentale en ligne offrant un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes Canadiennes et Canadiens, le nombre d'appels, de messages textes et de clics sur leurs ressources en ligne a plus que doublé en 2020 par rapport à 2019Note de bas de page 154. Le gouvernement du Canada a réagi en offrant un financement supplémentaire de 7,5 millions de dollars pour la ligne d'écoute téléphonique afin d'offrir aux jeunes du soutien en santé mentale pendant la pandémieNote de bas de page 155.
Les parents de jeunes enfants ont également déclaré avoir le sentiment que leur santé mentale s'était détériorée. Selon une enquête menée en mai 2020, 44 % des parents ayant des enfants vivant à la maison ont rapporté une détérioration de leur santé mentale. Dans la même enquête, 36 % des répondants sans enfants vivant à la maison ont déclaré que leur santé mentale s'était détérioréeNote de bas de page 156. La perception d'une détérioration de l'état de santé mentale semblait la plus élevée chez les parents d'un enfant de moins de 4 ans (55 %)Note de bas de page 156.
Bien que les sentiments de stress et d'anxiété signalés aient augmenté au cours de la pandémie, les données préliminaires indiquent qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale des troubles mentaux diagnostiquésNote de bas de page 157. Au fur et à mesure que les données sur la pandémie continuent d'être recueillies et analysées, les changements sur l'état de la santé mentale des Canadiens devront être examinés de manière approfondis.
Malgré les rapports faisant état d'une détérioration de la santé mentale, les résultats de l'ECSM menée de septembre à décembre 2020 n'indiquent pas d'augmentation du pourcentage de répondants ayant sérieusement envisagé le suicide par rapport à 2019Note de bas de page 158. Des recherches préliminaires laissent entendre que cette situation pourrait être attribuable à diverses raisons, notamment l'accès accru aux services de santé mentale et aux soutiens financiers, ainsi que le bienfait potentiel de passer plus de temps avec les membres du ménageNote de bas de page 159 Note de bas de page 160. Certains groupes de population touchés de façon disproportionnée par la pandémie (p. ex. les personnes qui ont déclaré avoir perdu leur emploi ou des revenus et celles qui éprouvaient un sentiment de solitude ou d'isolement en raison de la pandémie) étaient plus susceptibles que d'autres d'envisager sérieusement le suicideNote de bas de page 158. Comme le taux de suicide peut être influencé par des perturbations durables associées à la vie sociale et à l'économie, il faudra du temps pour mieux comprendre les effets à long terme de la pandémie sur ce taux, d'autant plus que la déclaration des causes de décès peut être retardéeNote de bas de page 9 Note de bas de page 161.
Effets de la COVID-19 sur la consommation de substances
Le stress et l'incertitude liés à la pandémie, y compris les bouleversements sociaux et économiques qui y sont associés, ont modifié le profil de consommation de substances de bon nombre de Canadiennes et de Canadiens.
Double épidémie : l'aggravation de la crise des surdoses d'opioïdes et la COVID-19
La crise des surdoses d'opioïdes, qui constitue une priorité nationale de santé publique depuis de nombreuses années, fait peser un lourd fardeau sur la santé, l'économie et la société au sein des collectivités, des groupes d'âge et des groupes socioéconomiques au CanadaNote de bas de page 162 Note de bas de page 163. Malgré les efforts déployés pour lutter contre la crise des opioïdes et les signes d'une diminution des décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes avant la pandémie, le nombre de décès en 2020 (6 214) dépassait les niveaux atteints en 2018 (4 389) au sommet de la criseNote de bas de page 128. D'avril à décembre 2020, les décès reliés à une intoxication aux opioïdes ont augmenté de 89 %par rapport à la même période en 2019Note de bas de page 128. En 2020, semblable en cela aux tendances observées avant la pandémie, la plupart des décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ont été dénombrés chez les hommes (77 %) et les personnes âgées de 20 à 49 ans (69 %)Note de bas de page 128. L'Ouest canadien et l'Ontario ont continué d'être les régions les plus touchés, mais de nombreuses régions ont constaté une augmentation des méfaits liés aux opioïdes pendant la pandémieNote de bas de page 128.
Même si les données mises à jour n'étaient pas encore disponibles à l'échelle nationale au moment de la rédaction du rapport, les données de certaines provinces ont laissé entendre que cette tendance se poursuit. Par exemple, il y a eu une augmentation de 46 % des décès reliés à une intoxication suspectée aux drogues illicites en mars 2021 en Colombie‑Britannique comparativement à mars 2020Note de bas de page 164. De plus, un scénario de décès liés aux opioïdes pendant la pandémie prédisait que le nombre de décès demeurerait élevé ou même augmenterait jusqu'à la fin de 2021Note de bas de page 165.
La stigmatisation et la discrimination, les séquelles des déplacements forcés, des mauvais traitements et de la perturbation de la culture traditionnelle dans les pensionnats, de même que le traumatisme intergénérationnel qui en découle, ont continué de nuire à la santé et au bien‑être des peuples autochtones du CanadaNote de bas de page 166. Bien que les membres des Premières Nations ne représentaient que 3 % de la population de la Colombie‑Britannique, en 2020, 15 % de tous les décès liés à des substances toxiques ont eu lieu chez les membres des Premières Nations, comparativement à 12 % en 2019. De même, en Alberta, les membres des Premières Nations représentent 6 % de la population, mais 22 % de tous les décès liés à une intoxication aux opioïdes de janvier à juin 2020Note de bas de page 167 Note de bas de page 168. Pour relever certains de ces défis, la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie‑Britannique a élargi l'accès à des stratégies de réduction des méfaits et de guérison respectueuses de leur culture, comme le lancement du service virtuel de traitement de la toxicomanie et de psychiatrie des Premières NationsNote de bas de page 168.
Le fentanyl non pharmaceutique a continué d'être un facteur important des augmentations subites observées des hospitalisations et des décès liés aux opioïdes pendant la COVID-19Note de bas de page 128. Les sentiments croissants d'isolement, de stress et d'anxiété, ainsi que la disponibilité ou l'accessibilité limitée des services de santé publique comme les services de réduction des méfaits pour les personnes qui consomment des substances, pourraient aussi y avoir contribuéNote de bas de page 128 Note de bas de page 169. Les mesures de santé publique mises en œuvre pour gérer la COVID-19 ont également perturbé les chaînes d'approvisionnement en substances, ce qui pourrait avoir créé des risques supplémentaires pour les personnes qui ont dû modifier en conséquence leur consommation habituelle de substancesNote de bas de page 169.
Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour permettre au système de santé de mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment des substances. Santé Canada a créé et étendu une exemption temporaire à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, laquelle permet notamment aux pharmaciens de rédiger des ordonnances et aux médecins de prescrire verbalement des substances contrôlées afin d'aider les patients à respecter les mesures de santé publiqueNote de bas de page 170. De même, en septembre 2020, la Colombie‑Britannique a rendu une ordonnance de santé publique afin que le personnel infirmier autorisé puisse prescrire des solutions de rechange pharmaceutiques pour empêcher les gens de se procurer des drogues illicites potentiellement toxiques et offrir plus de possibilités de soins, de traitements et de soutien continusNote de bas de page 171. Le projet novateur de distributrices automatiques MySafe installées à Victoria, à London, à Dartmouth et à Vancouver est un autre exemple d'approvisionnement sécuritaire. Après avoir vérifié l'identité d'une personne au moyen d'un balayage de la paume, les machines donnent accès à des médicaments aux patients qui ont déjà une ordonnanceNote de bas de page 172.
Augmentation des hospitalisations liées à l'alcool pendant la pandémie
Certaines Canadiennes et certains Canadiens semblent avoir augmenté leur consommation d'alcool pendant la pandémie. De septembre à décembre 2020, 16 % des répondants à l'ECSM ont déclaré que leur consommation avait augmenté, surtout parmi ceux qui percevaient que leur santé mentale s'était détérioréNote de bas de page 173. Comparativement à 2019, de mars à septembre 2020, le nombre total d'hospitalisations en raison de méfaits causés par l'alcool a augmenté de 5 %Note de bas de page 169. En plus de l'augmentation de la consommation et de la disponibilité de l'alcool, cet état de fait peut aussi refléter une tendance générale à retarder la recherche des soins nécessaires, ce qui entraîne des résultats plus gravesNote de bas de page 169. La plus forte augmentation du taux des hospitalisations liées à l'alcool (14 %) a été observée dans les régions à faible revenu pendant la pandémie, alors qu'il n'y a eu aucun changement dans les régions à revenu élevéNote de bas de page 169. Cette situation pourrait être attribuable au fait que la population canadienne à faible revenu a été plus affectée par la pandémie et a tendance à souffrir davantage de maladies chroniques multiplesNote de bas de page 5 Note de bas de page 174.
Déterminants sociaux de la santé
La santé de la population canadienne dépend d'un ensemble de déterminants sociaux fondamentaux. Le rapport annuel de 2020 de l'ACSP a notamment porté sur la manière dont les déterminants sociaux de la santé, comme le revenu, l'emploi et le racisme, ont une influence sur les iniquités sociales et les risques associés à COVID-19Note de bas de page 5. Conformément aux constatations tirées de la première vague, les nouvelles données probantes de la deuxième et de la troisième vague indiquent que les répercussions sociales et économiques plus vastes de la pandémie ont également été ressenties de façon disproportionnée par les groupes qui sont historiquement moins bien, comme les populations racisées, les populations à faible revenu et les femmes.
La sécurité financière a été mise à l'épreuve pendant la pandémie
En raison des répercussions économiques de la COVID-19, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont perdu leur emploi, ont eu un horaire de travail réduit ou se sont trouvés dans une situation financière précaireNote de bas de page 175. Les pertes d'emplois les plus importantes ont été observées dans les industries les plus touchées par les conséquences imprévues des mesures de santé publique, comme le commerce de détail, l'hébergement et les services alimentairesNote de bas de page 176. Après avoir atteint un sommet de 14 % en mai 2020, le taux de chômage a généralement suivi une tendance à la baisse (8 % en juillet 2021), mais se situait toujours au‑dessus des niveaux pré pandémiques au moment de la rédaction du rapportNote de bas de page 177.
Certaines populations racisées ont connu des taux de chômage disproportionnellement élevés. En juin 2021, le taux de chômage chez les groupes de la population canadienne désignés comme minorités visibles était de 10 %, comparativement à 6 % chez les Canadiennes et les Canadiens qui n'étaient ni Autochtones ni membres d'une minorité visibleNote de bas de page 178. Comparativement à février 2020, en février 2021, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans avait augmenté de près de 7 points de pourcentage et les pertes d'emploi chez les femmes de ce groupe d'âge étaient près du double de celles observées chez les hommesNote de bas de page 179.
Le chômage de longue durée est associé à des effets négatifs sur la santé, à la difficulté de retourner au travail et aux retards dans l'acquisition d'expérience de travailNote de bas de page 176. En juillet 2021, 28 % des sans‑emploi étaient au chômage de longue durée, une augmentation d'environ 12 points de pourcentage comparativement à la période avant la pandémieNote de bas de page 180. La COVID-19 a aussi amplifié les conséquences des conditions d'emploi précaires (p. ex. travail peu rémunéré, travail à temps partiel, horaires irréguliers) auxquelles font face de nombreux travailleurs au Canada, qui sont de façon disproportionnée des femmes, des personnes racisées, des immigrants et des personnes vivant avec un handicap. Ce facteur est de plus en plus reconnu comme un déterminant social important de la santé et a été lié à un certain nombre de résultats indésirables pour les travailleurs, la famille et la santé communautaireNote de bas de page 181 Note de bas de page 182 Note de bas de page 183.
Les travailleurs à faible revenu et les ménages dont le principal soutien économique a moins de 35 ans ont subi les pertes de salaire les plus prononcées en 2020Note de bas de page 184. Toutefois, en raison des transferts du soutien au revenu liés à la COVID-19 qui ont été effectués par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour compenser les pertes financières, ces 2 groupes ont connu les plus fortes augmentations du revenu en 2020 comparativement à 2019Note de bas de page 184. En particulier, les ménages dont le revenu est le plus faible au Canada ont vu leur revenu augmenter de 18 % en 2020, soit plus que celui des autres types de ménagesNote de bas de page 184. De plus, l'écart entre les personnes ayant le revenu le plus faible et celles dont le revenu est le plus élevé a diminué de 2 % en 2020 par rapport à 2019Note de bas de page 184. Il importe de souligner que certains groupes n'étaient pas admissibles à ces programmes de soutien au revenu. Néanmoins, les leçons tirées de ces programmes peuvent être utilisées pour faciliter le débat sur un revenu de base à l'échelle du pays, ce qui pourrait réduire les répercussions des difficultés financières sur la santé, surtout en cas d'urgence sanitaireNote de bas de page 185.
Autres répercussions sur les déterminants sociaux de la santé
Les changements dans la sécurité financière de la population canadienne n'étaient qu'un des effets de la pandémie sur les déterminants sociaux de la santé. Dans beaucoup d'autres cas, comme le montrent les exemples fournis dans le tableau 3, il faudra continuer à recueillir des données et comprendre les effets à long terme de la COVID-19.
| Déterminants sociaux de la santé | Incidence potentielle de la COVID-19 |
|---|---|
| Insécurité alimentaire |
|
| Violence familiale et fondée sur le genre |
|
| Stigmatisation et discrimination |
|
| Éducation |
|
| Développement des enfants |
|
De nombreuses conséquences de la COVID-19 restent sans doute encore à venir
Cette section décrit en détail certaines des conséquences plus vastes de la pandémie sur les déterminants sociaux de la santé, la consommation de substances et les résultats en matière de santé qui ne sont pas liés à la COVID-19. Dans certaines sphères, les interventions pour atténuer les difficultés étaient axées sur le court terme et les répercussions à plus long terme étaient inconnues. Ces effets à long terme sur la santé de la population canadienne ne feront surface que dans les années à venir. Par exemple, on sait très peu est connu sur les répercussions à long terme de la pandémie sur les enfants. Il reste donc important de continuer comprendre les vastes conséquences de la COVID-19 et de surveiller les indicateurs de bien‑être qui englobent les multiples dimensions de la qualité de vie de la population canadienneNote de bas de page 204 Note de bas de page 205.
En raison de la pandémie, la santé publique est une priorité pour un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. L'examen de certaines des conséquences plus vastes de la pandémie met en évidence le fait que la santé publique est beaucoup plus que de la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, cela démontre que des efforts ciblés et coordonnés par la santé publique et les partenaires des secteurs connexes sont nécessaires pour faire face aux conséquences futures. La section qui suit porte sur la façon dont le système de santé publique s'est adapté à la pandémie, y compris les défis et les innovations, et la manière dont le travail doit se poursuivre dans tous les secteurs pour protéger la santé et le bien‑être de la population en cas d'urgence de santé publique.
Principaux défis et solutions du système de santé publique pendant la pandémie de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les domaines prioritaires pour le renforcement des systèmes de santé publique au Canada. Elle a aussi fourni une occasion unique de combler les lacunes de longue date grâce à des efforts d'innovation et de collaboration. Le regroupement des forces de tous les ordres de gouvernement, du secteur privé, des organismes non gouvernementaux et des collectivités a été sans précédent, bien qu'il y ait encore des domaines clés qui nécessitent une attention accrue.
Assurer l'accès aux données et à l'information pertinentes pour appuyer la prise de décisions complexes
Tout au long de la pandémie, la collecte et l'échange de données, de connaissances et d'information sur la santé à l'appui d'une intervention efficace ont posé un défi constant. Il a été difficile d'obtenir des données nationales uniformes, opportunes et complètes sur les cas de COVID-19, car les provinces et les territoires ne recueillent pas et ne déclarent pas toujours l'information de façon uniformeNote de bas de page 7 Note de bas de page 206. De plus, l'information sur l'emplacement géographique, la situation des hospitalisations, les maladies préexistantes et les décès n'était pas toujours disponible, ce qui met en évidence les défis de longue date liés à l'infrastructure des données, aux capacités limitées de l'effectif et aux accords d'échange de donnéesNote de bas de page 7 Note de bas de page 206 Note de bas de page 207. Ces retards dans l'accès à des ensembles de données nationales complets ont réduit la qualité des analyses des caractéristiques telles que les symptômes de la maladie et les contacts étroits, ainsi que la capacité des modèles à prédire la propagation du virusNote de bas de page 7.
De même, les instances nationales n'étaient pas en mesure de recueillir des données sur la santé et de les coupler avec des renseignements sociodémographiques, comme le statut d'Autochtone, la race, le revenu et la professionNote de bas de page 7 Note de bas de page 208. Cela s'explique principalement par les lacunes dans la collecte de ces données à l'échelle locale ainsi que par l'absence d'un écosystème de données interopérables sur la santé qui pourrait combiner différents types de données tout en assurant une protection adéquate des renseignements personnelsNote de bas de page 207.
L'effet disproportionné de la COVID-19 sur certaines populations souligne le besoin d'information sociodémographique en temps opportun lors des urgences en santé publique afin de comprendre les iniquités qui existent en matière de santé et de mettre en œuvre les approches ciblées les plus appropriéesNote de bas de page 5. Afin de relever ces défis à l'échelle locale, plusieurs bureaux de santé publique ont commencé à publier au printemps 2020 des données sur la COVID-19 désagrégées par race et par revenuNote de bas de page 209. Ces données ont permis de mettre au point des stratégies ciblées pour freiner la propagation de la COVID-19 et d'accroître l'adoption du vaccin dans les collectivités où la réticence face à la vaccination est élevéeNote de bas de page 210. Cette démarche a également incité un nouveau groupe de travail des scientifiques noirs sur l'équité en matière de vaccins (Black Scientists' Task Force on Vaccine Equity) à élaborer des recommandations en matière de santé publique pour répondre aux préoccupations de la communauté noireNote de bas de page 211.
Des solutions temporaires ou locales comme celle décrite ci‑dessus ont souvent été mises en place pour régler les problèmes de disponibilité et d'accès aux données. Le fait de reconnaître que bon nombre de ces stratégies n'étaient ni tout à fait viables ni évolutives a suscité un intérêt renouvelé à l'échelle nationale pour combler les lacunes de longue date dans l'écosystème des données sur la santé du Canada.
En octobre 2020, l'ASPC a pris l'initiative au nom du gouvernement du Canada de travailler directement avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones et les intervenants clés pour élaborer une stratégie pancanadienne relative aux données sur la santéNote de bas de page 207. Cette stratégie a soutenu la réponse du Canada à la COVID-19 en répondant aux besoins immédiats en données mis au jour par la pandémieNote de bas de page 212. La stratégie fera progresser les efforts à long terme visant à améliorer considérablement la collecte, l'échange et l'utilisation des données sur la santé en permettant de mieux comprendre les causes profondes des problèmes, en déterminant les possibilités d'amélioration et en élaborant un ensemble de principes directeursNote de bas de page 207. Elle constituera le fondement d'une base de données cohérentes, durables, efficaces et adéquatement communiquées sur la santé qui respecte la protection des données et permet l'utilisation collective des données individuelles et agrégées sur la santé afin d'améliorer les résultats pour les personnes, les collectivités et la sociétéNote de bas de page 207.
Naviguer à travers l'information sur la pandémie
La pandémie a fait ressortir la nécessité d'une communication cohérente et transparente des messages et des risques. La prestation de renseignements exacts, fiables et opportuns est essentielle à la prise de décisions éclairées en vue de protéger la santé de la population, de renforcer la confiance du public et de réduire au minimum les perturbations sociales et économiques, et c'est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernementNote de bas de page 213. Les connaissances sur la COVID-19 évoluent constamment à mesure que de nouvelles données scientifiques deviennent disponibles. Les décideurs en santé publique ont dû déployer des efforts considérables pour intégrer les conseils d'experts, les tendances épidémiologiques et les résultats de recherche les plus récents, ainsi que d'autres données contextuelles.
Il s'agit de la première pandémie à survenir à une époque où l'on compte grandement sur la technologie numérique et les plateformes virtuelles de transmission de l'information pour assurer la sécurité des gens, les informer et faire en sorte qu'ils restent en contactNote de bas de page 214. De plus, l'utilisation intensive des médias sociaux pendant la pandémie a créé de multiples façons de propager des points de vue divergents, de faux renseignements, de la mésinformation, de la désinformation et des messages officiels contradictoiresNote de bas de page 215 Note de bas de page 216. Cela a entraîné une infodémie, une surabondance d'information, tant en ligne que hors ligne, qui a pu contribuer au non‑respect des mesures de santé publique et ainsi nuire à la capacité de maîtriser l'épidémieNote de bas de page 215. Par exemple, le fait de fournir trop d'information peut engendrer une hésitation à l'égard de la vaccination, alors qu'une bonne communication peut donner confiance dans l'efficacité et l'innocuité des vaccinsNote de bas de page 217.
Les professionnels de la santé publique ont dû trouver des approches et des mécanismes différents pour contrer les faux renseignements, la mésinformation et la désinformation et renforcer la confiance du public dans le système de santé publique. Les chefs de file en santé publique de tout le pays ont donc investi beaucoup de temps et d'efforts pour communiquer directement avec le public de manière inédite, notamment en tenant fréquemment des points de presse, des séances d'information technique, des mêlées journalistiques, des entrevues et des campagnes de sensibilisation du public dans divers médiasNote de bas de page 218 Note de bas de page 219.
ScienceUpFirst, une collaboration entre l'Association canadienne des centres de sciences, COVID-19 Resources Canada et le Health Law Institute de l'Université de l'Alberta, est un exemple d'initiative novatrice dans les médias sociaux pour lutter contre la mésinformationNote de bas de page 220 Note de bas de page 221. Ce mouvement national des médias sociaux établit des liens entre les scientifiques, les fournisseurs de soins de santé et les communicateurs scientifiques en fournissant de l'information scientifique crédible de façon créative pour contrer la propagation de la mésinformation et aider la population canadienne à s'y retrouver dans l'infodémieNote de bas de page 220 Note de bas de page 221. L'encadré « L'évolution rapide des données probantes conduit à des partenariats novateurs entre universitaires et praticiens » présente d'autres exemples de collaboration universitaire.
Il était également important d'adapter les communications aux collectivités pour veiller à ce que l'information soit accessible et pertinente pour les publics cibles. Ainsi, le Centre for Wise Practices in Indigenous Health a mis au point, en partenariat avec d'autres organismes communautaires et de santé autochtones, un outil d'adaptation de la communication aux communautés autochtones appelé Maad'ookiing Mshkiki ‑ Sharing Medicine qui vise à favoriser l'adoption du vaccin. Cette ressource axée sur les communautés autochtones a été conçue pour favoriser le consentement éclairé des peuples autochtonesNote de bas de page 222. Elle fournit de l'information culturellement pertinente au sujet des vaccins contre la COVID-19, qui tient compte des traumatismes subis par les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Par exemple, on a créé une infographie qui explique efficacement les diverses composantes des vaccins contre la COVID-19 à base d'ARN messager tout en intégrant les connaissances et les pratiques de guérison traditionnellesNote de bas de page 222.
Il était essentiel de cibler l'information en fonction du contexte épidémiologique régional. Toutefois, pendant la pandémie, il y a eu des moments marqués par les divergences des gouvernements en matière de compétences ou d'organisation dans les principales stratégies de communication, ce qui a mis en exergue la nécessité d'une communication cohérente et uniformeNote de bas de page 10 Note de bas de page 223. Parfois, le désir d'information a créé des possibilités de communication pour les professionnels de la santé et les scientifiques dont l'expertise en santé publique n'est pas exhaustive, ce qui a peut‑être semé la confusion et réduit la confiance dans la santé publiqueNote de bas de page 219 Note de bas de page 223. Au cours de la pandémie, les membres du Conseil des médecins hygiénistes en chef, composé des médecins hygiénistes en chef de chaque administration fédérale, provinciale et territoriale, ont publié des déclarations communes pour unifier leur voix en tant qu'experts de la santé publique de confiance auprès de la population canadienneNote de bas de page 224. Ces déclarations contenaient des conseils et des recommandations relatives à la COVID-19 au Canada, depuis les efforts de vaccination jusqu'à la gestion de la COVID-19 sur les plans individuel, organisationnel et communautaireNote de bas de page 225 Note de bas de page 226.
L'évolution rapide des données probantes conduit à des partenariats novateurs entre universitaires et praticiens
Dans le contexte de l'évolution rapide des données probantes sur la COVID-19, plusieurs initiatives ont été mises en place pour aider les organisations de santé publique à trouver et à utiliser rapidement les données probantes. COVID‑END, CanCOVID et CoVaRR‑Net sont 3 exemples de partenariats misant sur l'expertise du milieu universitaire.
Le COVID-19 Evidence Network to support Decision‑making (réseau de données probantes en soutien à la prise de décisions sur la COVID-19, ou COVID‑END), établi au McMaster Health Forum, réunissait des experts en synthèse des connaissances et en évaluation. Ce réseau a utilisé des méthodes systématiques pour produire des synthèses de données probantes et des analyses prospectives sur un éventail de sujets, y compris les interventions lors de pandémies, les mesures de santé publique, les réponses économiques et sociales et la gestion cliniqueNote de bas de page 227.
En avril 2020, la conseillère scientifique en chef du Canada a créé CanCOVID pour offrir « une réponse fondée sur des données probantes à la pandémie de COVID-19 »Note de bas de page 228. Ce réseau était composé de « chercheurs actifs, d'universitaires, de partenaires patients, de décideurs et de partenaires industriels » du CanadaNote de bas de page 228. Pendant la pandémie, CanCOVID a soutenu l'ASPC en facilitant la sollicitation rapide d'experts pour aider à apporter de nouvelles recherches et de nouvelles idées à des fins de discussion.
Le Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus (Coronavirus Variants Rapid Response Network – CoVaRR‑Net) a été créé en tant que réseau de chercheurs interdisciplinaires de toutes les régions du Canada pour travailler avec le gouvernement du Canada à une stratégie visant à faire face à la menace que représentent de nouveaux variants du SRAS‑CoV‑2. L'objectif de CoVaRR‑Net était de répondre rapidement aux questions urgentes sur les caractéristiques des variants, comme leur transmissibilité accrue, la gravité de la maladie et la résistance aux vaccinsNote de bas de page 229.
Renforcer la collaboration
La portée et les répercussions de la pandémie ont créé un besoin sans précédent de collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les collectivités, ainsi qu'entre les secteurs de la santé et d'autres secteurs connexes. Il est particulièrement important de mobiliser les collectivités tout au long d'une intervention en cas de pandémie pour atteindre les populations prioritaires et appuyer des interventions fondées sur l'équitéNote de bas de page 230.
Une approche collaborative face à la pandémie a nécessité l'élargissement des partenariats existants et la création de nouveaux partenariats, rôles, responsabilités et processus décisionnels. Dans l'ensemble des administrations, le Comité consultatif spécial sur la COVID-19 (CCS) a été reconnu comme un exemple réussi de leadership fédéral, provincial et territorialNote de bas de page 206 Note de bas de page 218 Note de bas de page 231. Tous les médecins hygiénistes en chef et les hauts fonctionnaires de la santé publique se sont réunis jusqu'à plusieurs fois par semaine depuis janvier 2020 pour discuter de la coordination dans l'ensemble des systèmes de santé du Canada. Le CCS a également publié des recommandations et des directives nationales sur un large éventail de sujets liés à la pandémieNote de bas de page 231.
À l'échelle fédéral, l'ASPC a fait équipe avec d'autres ministères pour veiller à ce que la réponse du Canada à la pandémie soit coordonnée et appuyée à l'échelle nationale. Par exemple, Santé Canada a accéléré l'accès aux fournitures médicales; l'Agence des services frontaliers du Canada a mis en œuvre et appliqué des restrictions aux frontières ainsi que des mesures de quarantaine obligatoires; Innovation, Sciences et Développement économique Canada a mis en place des mesures visant à soutenir directement les entreprises qui mettent au point des produits pour contribuer aux efforts de lutte contre la COVID-19; et Services aux Autochtones Canada (SAC) a travaillé avec des partenaires autochtones pour donner aux communautés les moyens de mettre en œuvre leurs propres plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence de santé publiqueNote de bas de page 206 Note de bas de page 232. Le gouvernement du Canada a également soutenu plusieurs programmes régionaux ou locaux, p. ex. en octroyant 4,2 millions de dollars à des bureaux de santé publique locaux pour leur permettre d'exploiter des sites sûrs d'isolement volontaire en Nouvelle‑Écosse pour les personnes vivant dans des logements surpeuplésNote de bas de page 233.
Les collaborations pangouvernementales ancrées dans les principes de l'autonomie gouvernementale ont revêtu une importance particulière. Les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont travaillé avec de nombreux ordres de gouvernement pour appuyer des programmes d'immunisation communautaires exemplaires et qui respectent leurs valeurs culturellesNote de bas de page 234. Ainsi, les dirigeants autochtones ont dirigé le déploiement rapide et généralisé des vaccins contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations et encouragé les Aînés et les gardiens du savoir à prodiguer leurs conseilsNote de bas de page 234. Dans le cadre d'une campagne de santé publique appelée Vaccinated Métis Strong, l'organisme Métis Nation Saskatchewan a ouvert une clinique de vaccination facilement accessible et respectueuse de la culture métisse en SaskatchewanNote de bas de page 235. La Manitoba Inuit Association a également organisé des séances de vaccination dans l'ensemble du Manitoba, où des cliniques respectueuses de la culture ont mis en valeur l'art inuit et affiché des pancartes rédigées en inuktitutNote de bas de page 236.
En outre, de nombreuses communautés autochtones ont entrepris l'élaboration de tests de dépistage communautaire rapide de la COVID-19 aux points de service avec l'appui du Laboratoire national de microbiologie (LNM) et de SAC. Depuis le 28 juillet 2021, dans le cadre de l'initiative pour les régions éloignées et isolées du Nord du Canada, 302 sites ont été en mesure de fournir des résultats de tests diagnostiques en quelques minutes. Ces communautés ont travaillé directement avec le LNM pour acquérir des appareils de test diagnostique et accéder à une formation de soutien, en renforçant la capacité de concevoir et d'effectuer leurs propres tests pour éclairer la mise en œuvre de mesures de santé publique locales et limiter les éclosionsNote de bas de page 237.
Intégrer les leçons apprises pour se préparer aux éventuelles urgences en santé publique
La pandémie de COVID-19 a été la plus grande crise de santé des dernières décennies. Elle a mis à l'épreuve les limites et les capacités de préparation du pays et mis en lumière la nécessité et la possibilité d'accroître la préparation du Canada à de futures crises de santé publique.
Mise à jour des plans de lutte contre les pandémies et des systèmes de surveillance
Les organisations fédérales qui jouent un rôle important en santé publique au Canada, comme l'ASPC et SAC, ont adapté rapidement les plans existants pour répondre à la pandémieNote de bas de page 206 Note de bas de page 238. À mesure que la pandémie progressait, les connaissances scientifiques sur la COVID-19 ont augmenté considérablement et rapidement. De plus, il est devenu évident que les mesures de santé publique devaient permettre d'établir un meilleur équilibre entre la réduction de la morbidité et de la mortalité et les effets des perturbations de la vie socialeNote de bas de page 14. En s'appuyant sur ces expériences, l'ASPC a travaillé avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec des partenaires de secteurs connexes à l'élaboration et à la mise à jour régulière du Plan d'intervention fédéral‑provincial‑territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVID-19Note de bas de page 14. Ce document évolutif a été essentiel pour assurer une approche commune de planification prospective. L'ASPC s'est engagée à travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour intégrer les leçons tirées de la COVID-19 dans la mise à jour et la mise à l'essai des plans de lutte contre des pandémies futuresNote de bas de page 206. La pandémie a également fait ressortir la nécessité de systèmes de surveillance fondés sur les événements qui émettent des avertissements précoces et sont bien intégrés aux structures de gouvernance et aux processus d'évaluation des risques qui favorisent la coordination entre les fonctions de surveillanceNote de bas de page 206 Note de bas de page 239.
Équité en matière de préparation et d'intervention en cas de pandémie
Les effets disproportionnés directs (p. ex. exposition au SRAS‑CoV‑2 et mortalité attribuable à la COVID-19) et indirects (p. ex. santé mentale et consommation de substances) de la COVID-19 sur les populations les plus exposées ont souligné la nécessité d'une approche équitable en matière de préparation en cas de pandémie. Pendant la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs programmes portant expressément sur les déterminants sociaux de la santé. Par exemple, la Prestation canadienne d'urgence (PCU) temporaire et l'assurance‑emploi ont aidé plus de 8,9 millions de personnes qui ont perdu leur emploi ou éprouvé des difficultés financières en raison de la pandémieNote de bas de page 240. De plus, afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens vivant dans des logements précaires et qui ont dû faire face à des défis liés aux mesures d'éloignement physique et à l'accès à des produits d'hygiène, l'Initiative pour la création rapide de logements a été créée pour répondre aux besoins urgents en matière de logement grâce à la construction de 4 500 logements abordablesNote de bas de page 241. Les plans d'intervention futurs doivent reposer sur une approche d'équité et tenir compte de la façon dont les répercussions d'une urgence de santé publique pourraient être liées aux déterminants sociaux de la santé et aggraver les iniquités préexistantesNote de bas de page 5. Cela souligne également l'importance d'améliorer les déterminants sociaux de la santé et les programmes de soutien avant la prochaine urgence de santé publique, en utilisant les leçons tirées de la pandémie.
Capacité de mobilisation
La pandémie a exercé une pression sans précédent sur les ressources en santé disponibles. Il est difficile de répondre à une urgence de santé d'une telle ampleur et aussi persistante, car elle exige une expansion rapide des services de santé pour satisfaire à la demande accrue d'espace, de personnel et de fournitures (voir l'encadré « Effort multi‑organisationnel pour renforcer la capacité de mobilisation au Canada »)Note de bas de page 242. Par exemple, de nombreuses administrations ne disposaient pas de laboratoires ayant les capacités nécessaires pour traiter de grands volumes de tests de dépistage de la COVID-19 dans un court délaiNote de bas de page 243. Particulièrement au début de la pandémie, il a aussi été difficile de répondre à la demande extraordinaire de fournitures comme l'équipement de protection individuelle et les appareils médicaux. Des défis ont fait ressortir l'importance d'une stratégie pour le maintien d'un inventaire des articles essentiels en cas de menaces futures à la santé publiqueNote de bas de page 244.
Effort multi‑organisationnel pour renforcer la capacité de mobilisation au Canada
Pour soutenir une intervention d'urgence aussi complexe et continue, une mobilisation sans précédent de ressources humaines spécialisées a été nécessaireNote de bas de page 218. Ce besoin de ressources accrues a nécessité d'importantes contributions de la part de partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé.
Par exemple, la Croix‑Rouge canadienne a contribué à renforcer la capacité de mobilisation grâce à l'apport d'un grand nombre de membres du personnel médical et non médical bien formés, et a dirigé des initiatives à plus de 400 endroits au paysNote de bas de page 245. Elle a notamment fourni de l'aide dans des cliniques de vaccination d'au moins 6 provinces et territoires et a déployé des hôpitaux de campagne et du matériel médical en Alberta, en Colombie‑Britannique, en Ontario et au QuébecNote de bas de page 246. La Croix‑Rouge canadienne a également soutenu des sites d'isolement volontaire pour les travailleurs agricoles saisonniers en Ontario en plus d'aider à la logistique et à l'établissement de sites de prélèvement autocontrôlés à 19 postes frontaliers terrestres canadiensNote de bas de page 245. Pendant la troisième vague de la pandémie, elle a fourni du matériel et un soutien logistique sur place à 14 villages nordiques au NunavikNote de bas de page 247.
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont également fourni un soutien considérable. Au cours de la première vague, les FAC ont déployé du personnel médical et de soutien dans 54 établissements de soins de longue durée en Ontario et au Québec afin de contribuer aux activités quotidiennes, au contrôle et à la prévention des infections, ainsi qu'au soutien général au besoin. Entre octobre 2020 et août 2021, les Rangers canadiens ont été mobilisés dans plus de 10 communautés des Premières Nations pour fournir de l'aide humanitaire et répondre aux besoins immédiats dans le cadre des efforts d'atténuation de la COVID-19 et des mesures de secours. Au cours de la troisième vague, les FAC ont fourni des ressources médicales militaires à l'Ontario et au Manitoba afin d'augmenter le nombre de fournisseurs de soins de santé dans les établissements de santé et ont joué un rôle essentiel en contribuant à la logistique complexe de la distribution de vaccins contre la COVID-19 partout au Canada dans le cadre de l'opération VECTOR, en particulier dans les régions éloignéesNote de bas de page 248 Note de bas de page 249.
Un système de santé publique bien préparé doit avoir des capacités de mobilisation évolutives, souples et résilientes, non seulement pour répondre aux besoins immédiats en cas d'urgence de santé publique, mais aussi afin de disposer de suffisamment de ressources pour répondre à d'autres priorités existantes ou émergentes en matière de santé (p. ex. la crise des surdoses d'opioïdes, les changements climatiques) sans risquer d'épuiser la main‑d'œuvre. Au cours de la pandémie de la COVID-19, de nombreux intervenants ont été poussés à la limite de leurs capacités alors qu'ils ont dû faire face à de multiples crises en même temps. Par exemple, les conséquences émotionnelles et physiques de la pandémie sur les ambulanciers paramédicaux ont été exacerbées par la canicule de juillet 2021, qui a entraîné une augmentation considérable des morts subites dans l'Ouest canadienNote de bas de page 250 Note de bas de page 251. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence le besoin de longue date d'améliorer les capacités de mobilisation non seulement dans le domaine de la santé publique, mais aussi dans les secteurs connexesNote de bas de page 252.
Les éventuelles urgences en santé publique nécessiteront une intervention de l'ensemble de la société, et notamment un système de santé publique plus robuste
Les conséquences directes et indirectes de la COVID-19 ont continué d'avoir un impact sur les systèmes de santé et les systèmes sociaux. La pandémie a mis au jour de nombreuses lacunes dans les systèmes de santé publique, et les répercussions de la COVID-19 n'ont pas fini de se faire sentir.
Bon nombre des solutions novatrices aux défis mis en lumière par la COVID-19 ont été conçues comme des interventions immédiates et à court terme en cas de crise. Il importe d'élaborer des stratégies durables pour bâtir un système de santé publique plus résilient fondé sur le renforcement des partenariats et qui servent à répondre aux besoins de toutes les personnes vivant au Canada. Cela commence par une réflexion sur la façon dont les systèmes de santé publique du Canada sont gouvernés, organisés et outillés afin que nous puissions aller de l'avant et trouver les bonnes solutions.
Partie 2. La santé publique au Canada : possibilités de transformation
La pandémie de COVID-19 a attiré l'attention du monde entier sur la santé publique, révélant son rôle essentiel au bien‑être d'une nation. Comme les pandémies précédentes, elle a mis en évidence une fonction essentielle de la santé publique : la préparation et l'intervention en cas d'urgence. Toutefois, cette fonction n'est qu'une des nombreuses façons dont les systèmes de santé publique protègent et soutiennent la santé des populations.
La COVID-19 a mis à l'épreuve les systèmes de santé publique au Canada et dans le monde. Les difficultés de longues haleines et les réussites en cours de pandémie ont amplifié des faiblesses déjà connues des systèmes de santé publique, ont révélé de nouveaux défis et souligné la nécessité de systèmes de santé publique résilients qui peuvent mieux soutenir la santé et le bien‑être de la population du Canada. La pandémie a également démontré qu'il est nécessaire d'innover et de trouver de nouvelles façons de travailler ensemble. De nombreux appels ont été lancés en faveur d'une réforme du système de santé publique, tant dans le passé que dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, mais il y a des signes supplémentaires qui montrent qu'il est de plus en plus urgent d'agir maintenantNote de bas de page 7 Note de bas de page 253 Note de bas de page 254 Note de bas de page 255 Note de bas de page 256 Note de bas de page 257 Note de bas de page 258 Note de bas de page 259.
Déjà fortement sollicités avant la pandémie, les effectifs en santé publique sont débordés et n'auront peut‑être pas la capacité de répondre à la prochaine urgence. Il y a encore des retards inacceptables dans l'obtention des données requises pour éclairer la prise de décisions en matière de santé publique. Les iniquités d'ampleur sociétale persistent et les politiques sociales et économiques clés mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19 ne soient pas maintenues. Ces vulnérabilités pourraient affaiblir la résilience du Canada face à d'éventuelles menaces à la santé.
Alors que le Canada se prépare à un rétablissement post pandémie, le fardeau imposé jusqu'ici au système de soins de santé menace d'éclipser le besoin tout aussi crucial de renforcer le système de santé publique. Comme la pandémie de la COVID-19 l'a montré, les 2 systèmes doivent être suffisamment soutenus pour que le Canada ait un système de santé fiable et agile qui est susceptible de répondre aux besoins de sa population.
Avant de pouvoir discuter des possibilités de renforcer le système de santé publique, il faut avoir une compréhension commune de la portée réelle de la santé publique et de son incidence sur la vie quotidienne des gens.
Ce qu'est la santé publique
La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière un aspect important du travail des systèmes de santé publique et ce, pour de nombreuses personnes au Canada. Toutefois, la santé publique travaille depuis longtemps à garder les gens en santé, à prévenir les blessures, les maladies et les décès prématurés, et à contribuer à l'équité en santéNote de bas de page 260. Pour tout cela, les professionnels de la santé publique assument des rôles multiples, en tant que leaders, coordonnateurs, promoteurs et alliés pour relever les défis exigeants en matière de santé.
La pandémie de la COVID-19 est l'une des nombreuses urgences sanitaires auxquelles font face les systèmes de santé publique. Les autres défis actuels comprennent la résistance aux antimicrobiens, la crise des surdoses d'opioïdes, les maladies non transmissibles (p. ex. les maladies cardiovasculaires), la santé mentale et les impacts croissants des changements climatiques sur la santéNote de bas de page 261 Note de bas de page 262 Note de bas de page 263. S'attaquer à ces problèmes complexes de santé publique, requiert une compréhension approfondie de ce qui rend les populations en bonne santéNote de bas de page 264 Note de bas de page 265 Note de bas de page 266 Note de bas de page 267.
Les organismes de santé publique considèrent la population comme le « patient », comparativement aux établissements de soins de santé qui eux, fournissent des services individuels aux particuliers. Ces populations sont organisées en différents groupes, tels que des quartiers, des communautés spéciales, des provinces ou territoires ou, comme il a été démontré avec la pandémie de COVID-19, le monde entier.
Par sa nature même, le travail de santé publique est souvent invisible et se fait en coulisse. Pourtant, son impact sur la santé collective des populations est majeur.
Citation : « Si vous prolongez la vie d'une personne pendant 2 heures, vous savez ce que vous avez fait. Si vous avez évité le décès de 4 millions de personnes en lien avec la COVID, personne ne le saura, parce que ces décès ne se sont pas produits. C'est la nature de ce que nous faisons (en santé publique); lorsque nous réussissons, nous sommes invisibles. »
Durant le 20e siècle, on estime que les progrès en santé publique ont augmenté de 25 ans l'espérance de vie moyenne à la naissance au Canada (voir encadré « Moments déterminants dans l'histoire de la santé publique au Canada »)Note de bas de page 268. Ces acquis sont liés à des réalisations clés en santé publiqueNote de bas de page 269 notamment :
- l'amélioration de la santé maternelle et infantile grâce à des progrès en matière d'hygiène, de nutrition, d'éducation, de prévention des décès périnataux, d'accès aux soins et de contraception;
- l'amélioration des installations sanitaires et la réduction des toxines environnementales, y compris les égouts et les systèmes de traitement de l'eau et la réduction de la pollution atmosphérique provenant des véhicules motorisés;
- la fluoration de l'eau potable pour prévenir la carie dentaire et les maladies dentaires;
- la lutte contre le tabagisme, y compris la reconnaissance du tabac comme étant un produit dangereux pour la santé, la réglementation de la publicité et les limites sa vente, les campagnes antitabac et les environnements sans fumée;
- la sécurité au travail, y compris la réduction des blessures en milieu de travail et une augmentation de la promotion de la santé au travail;
- la sécurité des véhicules automobiles, y compris la prévention des blessures et des décès grâce à l'utilisation de la ceinture de sécurité, et des sièges de sécurité pour enfants et la diminution des collisions liées à l'alcool;
- la baisse du nombre de décès attribuables aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux en raison d'une combinaison de progrès en matière de prévention, de détection et de traitement, y compris des changements dans les habitudes de vie dont l'activité physique, l'alimentation, le tabagisme et la modification des facteurs de risque;
- le contrôle et la prévention des maladies infectieuses par des interventions comme la vaccination, l'éducation et les campagnes publiques, les mesures de santé publique et les traitements antimicrobiens;
- des aliments plus sûrs et plus sains, notamment grâce à la pasteurisation, l'inspection des aliments, l'iodation du sel et une meilleure nutrition.
Les vaccins sont l'une des interventions de santé publique les plus connues et les plus importantes. L'introduction d'initiatives de vaccination de masse a entraîné une baisse spectaculaire des maladies infectieuses (figure 6), de leurs maladies connexes et de la mortalité qui leur est associéeNote de bas de page 268 Note de bas de page 270. Le succès de la vaccination a notamment mené à l'éradication mondiale de la variole en 1980 et à la certification du Canada comme pays exempt de poliomyélite en 1994Note de bas de page 271 Note de bas de page 272. Aujourd'hui, les gens reçoivent régulièrement des vaccins pour se protéger contre diverses maladies, dont la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le tétanos, l'hépatite B, le virus du papillome humain (VPH) et la grippeNote de bas de page 273.
Sans un effort concerté continu pour contrôler les maladies évitables par la vaccination, les maladies infectieuses auparavant maîtrisées reviendrontNote de bas de page 272 Note de bas de page 274. Cela représente un défi constant pour la santé publique. Notamment dû à l'énorme efficacité des programmes de vaccination pour enfants, les gens sous-estiment maintenant les risques de ces mêmes maladiesNote de bas de page 273.
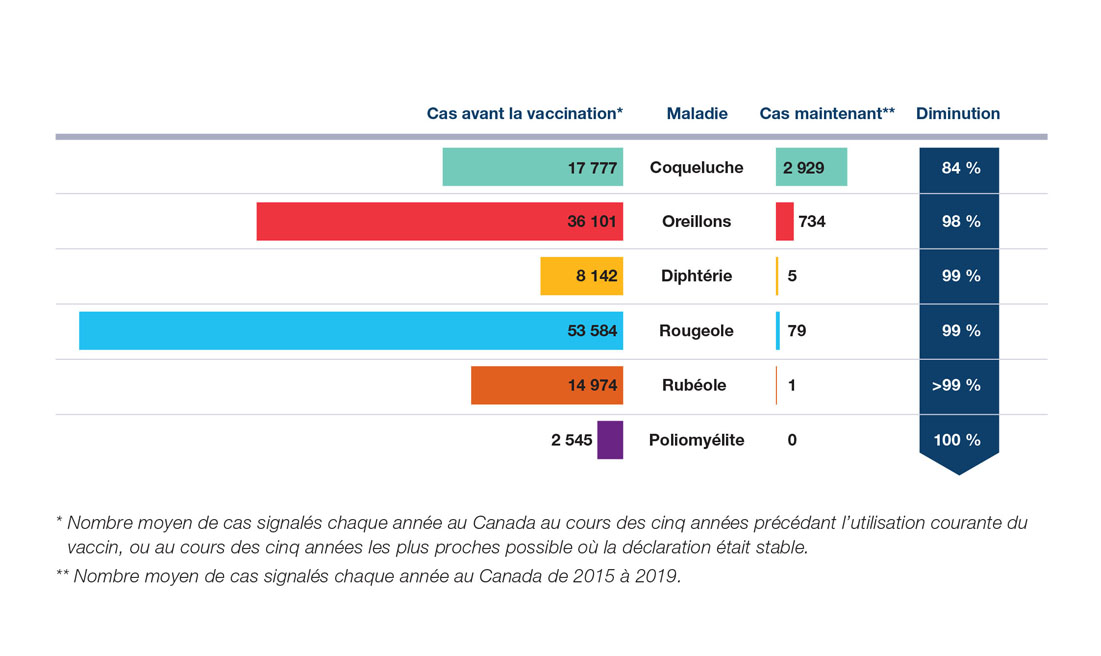
Figure 6 : Texte descriptif
La figure montre l'impact de la vaccination des enfants sur les principaux cas de maladies infectieuses au Canada. Elle est représentée à l'aide de barres horizontales qui comparent le nombre de cas de maladies évitables par la vaccination avant la vaccination au nombre de cas actuels. Les cas diminués, en pourcentage, sont affichés à droite.
Les cas avant la vaccination renvoient au nombre moyen de cas signalés chaque année au Canada au cours des 5 années précédant l'utilisation courante du vaccin, ou au cours des 5 années les plus proches possible où la déclaration était stable. Les cas actuels renvoient au nombre moyen de cas signalés chaque année au Canada de 2015 à 2019.
| Maladie | Cas avant la vaccinationNote de bas de page * | Cas maintenantNote de bas de page ** | Diminution |
|---|---|---|---|
| Coqueluche | 17 777 | 2 929 | 84 % |
| Oreillons | 36 101 | 734 | 98 % |
| Diphtérie | 8 142 | 5 | 99 % |
| Rougeole | 53 584 | 79 | 99 % |
| Rubéole | 14 974 | 1 | >99 % |
| Poliomyélite | 2 545 | 0 | 100 % |
|
|||
Sources : Les données sur la rougeole et la rubéole proviennent du Système canadien de surveillance de la rougeole et de la rubéole, tandis que les données des autres maladies proviennent du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoireNote de bas de page 275 Note de bas de page 276.
Moments déterminants dans l'histoire de la santé publique au Canada
Les systèmes actuels de santé publique au Canada relèvent d'initiatives historiques déployées pour contrôler les maladies infectieuses, en particulier les lois sur la quarantaine élaborées au 18e siècle (figure 7)Note de bas de page 277. Cet historique est étroitement liée aux mouvements de réforme sociale et à un intérêt accru quant à comment les conditions sociales influencent sur la propagation des maladiesNote de bas de page 278 Note de bas de page 279. Ainsi les iniquités en santé sont au cœur de la science et de la pratique de la santé publique depuis des siècles.
Au début du 20e siècle, la portée de la santé publique s'est élargie pour inclure la santé maternelle et infantile, la nutrition et la salubrité des aliments, la prévention des blessures, la contamination de l'environnement, les maladies chroniques et d'autres problèmesNote de bas de page 253 Note de bas de page 259 Note de bas de page 277. Ce changements 'est produit en même temps qu'un intérêt accru pour les soins de santé au Canada au milieu du 20e siècle, y compris des investissements rapides dans les hôpitaux et dans des politiques visant à améliorer l'accès aux soins de santéNote de bas de page 280. L'assurance‑maladie a été mise en œuvre en Saskatchewan en 1962, puis s'est étendue à l'ensemble du pays avec l'adoption de la Loi canadienne sur la santé en 1984Note de bas de page 281. Ce jalon important de la politique sur la santé de la population permis à tous les résidents du Canada d'avoir droit à des services de santé universels, accessibles, complets, transférables et administrés publiquement dans tout le paysNote de bas de page 281.
À la fin du 20e siècle, le Canada s'est attiré une attention internationale en raison de sa reconnaissance officielle des déterminants sociaux de la santé, à commencer par le rapport Lalonde de 1974, intitulé Nouvelle perspective de la santé des CanadiensNote de bas de page 282 Note de bas de page 283. En 1986, les participants à la première conférence internationale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la promotion de la santé ont élaboré la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui constitue un engagement à l'égard de la mise en œuvre d'une stratégie axée sur la santé pour tous au plus tard en l'an 2000. La Charte a été un document fondamental pour la santé publique à l'échelle mondiale. Elle représente un changement visant à définir la santé comme le résultant des conditions dans lesquelles les gens vivent, et pas seulement de leurs comportements ou de l'accès aux soins de santéNote de bas de page 277 Note de bas de page 284. La Charte est encore citée à l'échelle internationale aujourd'hui.
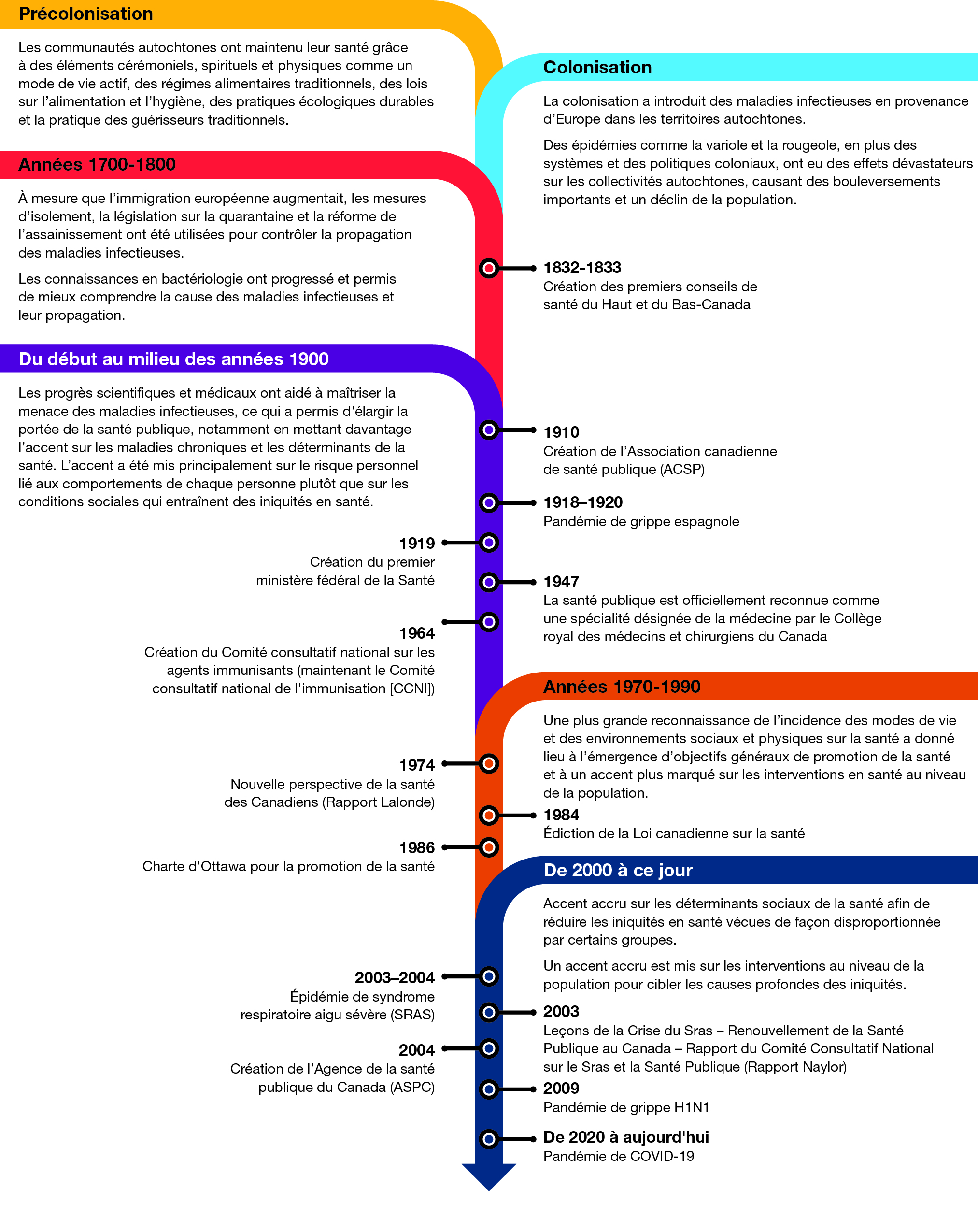
Figure 7 : Texte descriptif
La figure montre un calendrier vertical décrivant les principaux étapes et les changements en santé publique au Canada. De haut en bas, la figure décrit les composants suivants :
Précolonisation : les communautés autochtones ont maintenu leur santé grâce à des éléments cérémoniels, spirituels et physiques comme un mode de vie actif, des régimes alimentaires traditionnels, des lois sur l'alimentation et l'hygiène, des pratiques écologiques durables et la pratique des guérisseurs traditionnels.
Colonisation : la colonisation a introduit des maladies infectieuses en provenance d'Europe dans les territoires autochtones. Des épidémies comme la variole et la rougeole, en plus des systèmes et des politiques oppressifs, ont eu des effets dévastateurs sur les collectivités autochtones, causant des bouleversements importants, des maladies et des décès.
Années 1700 et 1800 : à mesure que l'immigration européenne augmentait, les mesures d'isolement, la législation sur la quarantaine et les réformes sanitaires ont été utilisées pour contrôler la propagation des maladies infectieuses.Les connaissances en bactériologie ont progressé et permis de mieux comprendre la cause des maladies infectieuses et leur propagation.
- 1832-1833 : création des premiers conseils de santé du Haut et du Bas-Canada
Du début au milieu des années 1900 : les progrès scientifiques et médicaux ont aidé à maîtriser la menace des maladies infectieuses, ce qui a permis d'élargir la portée de la santé publique, notamment en mettant l'emphase sur les maladies chroniques et les déterminants de la santé. L'accent a été mis principalement sur le risque personnel lié aux comportements de chaque personne plutôt que sur les conditions sociales qui entraînent des iniquités en santé.
- 1910 : création de l'Association canadienne de santé publique (ACSP)
- 1918-1920 : pandémie de grippe espagnole
- 1919 : création du premier ministère fédéral de la Santé
- 1947 : la santé publique est officiellement reconnue comme une spécialité désignée de la médecine par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
- 1964 : création du Comité consultatif national sur les agents immunisants (maintenant le Comité consultatif national de l'immunisation [CCNI])
Années 1970-1990 : la reconnaissance de l'impact des modes de vie et de l'environnement social et physique sur la santé a donné lieu à l'émergence d'objectifs généraux de promotion de la santé et à une attention sur les interventions en santé au niveau de la population.
- 1974 : Une nouvelle perspective de la santé des Canadiens (Rapport Lalonde)
- 1984 : création de la Loi canadienne sur la santé
- 1986 : charte d'Ottawa pour la promotion de la santé
De 2000 à ce jour : accent accru sur les déterminants sociaux de la santé afin de réduire les iniquités en santé vécues de façon disproportionnée par certains groupes. L'emphase est mise sur les interventions au niveau populationnel pour cibler les causes profondes des iniquités.
- 2003-2004 : épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
- 2003 : Leçons de la Crise du Sras – Renouvellement de la Santé Publique au Canada – Rapport du Comité Consultatif National sur le Sras et la Santé Publique (Rapport Naylor)
- 2004 : création de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
- 2009 : pandémie de grippe H1N1
- De 2020 à ce jour : pandémie de COVID-19
Sources : adaptée de l'Association canadienne de santé publique. Chronologie de l'immunisation et La santé publique : une histoire canadienneNote de bas de page 271 Note de bas de page 277.
Reconnaître les répercussions du colonialisme sur la santé publique
L'histoire de la santé publique au Canada ne peut être dissociée de son histoire coloniale. La colonisation a perturbé les approches et les systèmes autochtones en matière de santé, de médecine et de bien‑être. Les politiques coloniales ont démantelé le savoir traditionnel, coupé les liens ancestraux et brisé les structures familiales et socialesNote de bas de page 285 Note de bas de page 286 Note de bas de page 287 Note de bas de page 288. Les effets intergénérationnels du colonialisme continuent d'avoir une incidence sur la santé et le bien‑être des peuples autochtones, incluant les expériences de racisme systémique, les défis continus liés à l'autodétermination, et les obstacles à l'obtention de services de santé de haute qualité, accessibles et pertinentsNote de bas de page 285 Note de bas de page 286 Note de bas de page 289 Note de bas de page 290 Note de bas de page 291.
Aujourd'hui, la santé publique continue d'être dominée par les connaissances et les pratiques occidentales qui ne répondent pas adéquatement aux réalités sociales et sanitaires des peuples autochtonesNote de bas de page 292. Les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis sont diversifiés et ont de riches histoires, cultures, langues et approches en matière de santé et de guérison. Toutefois, ils partagent aussi une compréhension holistique et relationnelle commune de la santé et du bien‑êtreNote de bas de page 292 Note de bas de page 293 Note de bas de page 294. Les connaissances traditionnelles et les pratiques culturelles jouent un rôle crucial dans le maintien du bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis.Pendant la pandémie de la COVID-19, l'autodétermination, le leadership autochtone et les connaissances locales ont contribué aux efforts de protection des communautés autochtonesNote de bas de page 292.
Ces approches sont essentielles à la réconciliation, un processus continu de guérison des relationsNote de bas de page 295. La réconciliation exige, parallèlement à l'autodétermination et au leadership autochtone, une compréhension de l'histoire et un engagement envers la vérité et la justiceNote de bas de page 295. Elle requiert également de prendre des mesures pour changer les politiques, les systèmes et les structures qui contribuent aux iniquités sociales, économiques et sanitaires entre les Autochtones et les non‑Autochtones au CanadaNote de bas de page 295.
Le Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a souligné le besoin urgent de travailler à éliminer les iniquités en santé dont sont victimes les peuples autochtones. De nombreux rapports réalisés par des Autochtones avaient déjà mentionné ces observations et de nombreux autres s'en sont fait l'échoNote de bas de page 285 Note de bas de page 286 Note de bas de page 289 Note de bas de page 292 Note de bas de page 296.
L'interaction entre la santé publique, la société, l'économie et l'environnement
Les avenues actuelles en santé publique sont axées sur la nature interdépendante des défis sanitaires. Cette interdépendance comprend les liens entre les maladies infectieuses humaines et animales, les risques pour la santé découlant des changements climatiques et l'interaction entre les iniquités sociales, économiques, environnementales et sanitaires. Les 2 approches suivantes tiennent compte ces facteurs interdépendants et sont alignées, dans leur priorisation continue, sur les déterminants sociaux de la santé.
Une seule santé
L'approche Une seule santé explore des façons de concevoir et de mettre en œuvre des recherches et des mesures intersectorielles pour promouvoir simultanément la santé des humains, des animaux et des écosystèmesNote de bas de page 297 Note de bas de page 298. Des enjeux comme la pandémie de la COVID-19 et les changements climatiques ont fait ressortir l'importance d'agir sur les interconnexions complexes entre la santé humaine et l'environnement, ainsi que la valeur potentielle de l'approche Une seule santéNote de bas de page 299. La menace croissante de la résistance aux antimicrobiens (RAM) souligne également la nécessité d'aborder ces liens complexes au moyen d'une approche multisectorielle à plusieurs niveauxNote de bas de page 297 Note de bas de page 300 Note de bas de page 301. À l'heure actuelle, le cadre d'action pancanadien sur la RAM et l'utilisation d'antimicrobiens repose sur une approche « Une seule santé », qui nécessite une collaboration entre les ordres de gouvernement, le milieu universitaire, l'industrie et les organismes non gouvernementaux, y compris la participation d'experts en santé humaine, en santé animale et en agricultureNote de bas de page 302 Note de bas de page 303.
Équité et inclusion en santé et déterminants sociaux de la santé
Comme on l'a vu au Canada et ailleurs dans le monde, les conditions sociales, politiques et environnementales desquels ont découlé des risques différentiels face à la COVID-19 sont aussi au nombre des facteurs à l'origine des iniquités en matière de maladies non transmissiblesNote de bas de page 5 Note de bas de page 304 Note de bas de page 305. La pandémie n'a laissé aucun doute sur l'importance cruciale de s'agir sur ces iniquitésNote de bas de page 5 Note de bas de page 86 Note de bas de page 306 Note de bas de page 307 Note de bas de page 308. À l'échelle mondiale, de nombreuses maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales chroniques ont été associées à un risque plus élevé de développer une forme grave de la COVID-19 ou de mourir de la maladieNote de bas de page 309. La prévalence de ces maladies varie au sein de la population canadienne en fonction de facteurs comme le revenu, la scolarité, la race et le statut d'AutochtoneNote de bas de page 304 Note de bas de page 305 Note de bas de page 309 Note de bas de page 310 Note de bas de page 311 Note de bas de page 312 Note de bas de page 313 Note de bas de page 314 Note de bas de page 315 Note de bas de page 316 Note de bas de page 317 Note de bas de page 318 Note de bas de page 319 Note de bas de page 320 Note de bas de page 321 Note de bas de page 322.
Pourtant, les maladies infectieuses et les maladies non contagieuses sont souvent abordées séparément dans les politiques, les interventions et les pratiques de santé publique. Une meilleure compréhension des liens entre les déterminants sociaux de la santé et les divers résultats en matière de santé permettra d'éclairer les mesures de santé publique et ainsi d'améliorer la santé globale des populations et réduire les vulnérabilités de la société face aux urgences sanitaires futuresNote de bas de page 323 Note de bas de page 324. Il faudra notamment prêter attention au racisme systémique et à d'autres formes de stigmatisation qui continuent d'avoir un impact sur la santé des communautés autochtones et racisées, des communautés LGBTQ2+, des personnes vivant avec un handicap et d'autres personnes marginaliséesNote de bas de page 324 Note de bas de page 325 Note de bas de page 326 Note de bas de page 327 Note de bas de page 328 Note de bas de page 329 Note de bas de page 330 Note de bas de page 331.
Bien que la santé publique ait toujours fait état des déterminants sociaux de la santé qui entraînent des iniquités en santé, l'action concertée et l'application des concepts d'équité en santé ne sont pas encore pleinement institutionnaliséesNote de bas de page 259 Note de bas de page 332 Note de bas de page 333 Note de bas de page 334 Note de bas de page 335. La lutte contre les iniquités en santé renforcera la capacité collective de la société de résister aux crises sanitaires futures.
Fonctionnement des systèmes de santé publique au Canada
Le système des systèmes de santé publique
De nombreux organismes, groupes, collectivités et secteurs contribuent à améliorer la santé et le bien‑être des populations (figure 8). Les établissements de santé publique forment le noyau des systèmes de santé publique.
Afin de servir toutes les collectivités et les populations, les mandats de santé publique sont répartis entre les systèmes de santé publique des différentes juridictions. Celles-ci incluent le système de santé publique du Canada, lequel fait partie d'un système encore plus vaste, fédéré et universel, au paysNote de bas de page 336.

Figure 8 : Texte descriptif
La figure décrit les organisations du système de santé publique.
Un cercle au centre de l'image décrit les établissements de santé publique, qui ont des rôles et des responsabilités en matière de santé publique et qui sont en mesure d'adopter des politiques de santé publique. Ces organisations sont :
- organismes de santé autochtones;
- autorités de la santé régionales et locales;
- ministères de la Santé provinciaux ou territoriaux;
- organismes et établissements nationaux et provinciaux de santé publique;
- organismes et ministères fédéraux.
Autour de ce cercle se trouvent les institutions et les organismes qui n'ont pas de mandat de santé publique, mais qui travaillent en étroite collaboration avec le système de santé publique. Ces organisations sont :
- associations professionnelles;
- systèmes de prestation des soins de santé;
- ONG et organismes communautaires;
- universités, laboratoires et établissements de recherche;
- médias;
- secteur privé et industrie;
- autres ministères (p. ex., logement, économie, services sociaux, emploi, défense).
La santé publique est organisée différemment dans chacune et chacun des 13 provinces et territoires du CanadaNote de bas de page 253. Dépendamment des structures en place dans les provinces et territoires, on dénote au Canada, 80 services régionaux ou selon le cas, municipaux ou locaux, de santé publique. C'est à ce niveau que les services de santé publique sont offerts directement aux populations localesNote de bas de page 253. Les gouvernements provinciaux sont chargés de coordonner ces régies ou unités et, entre autres rôles, de soutenir la planification globale, d'administrer les budgets et de fournir une aide techniqueNote de bas de page 253.
À l'échelle fédérale, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) joue un rôle de chef de file national en matière de santé publique au sein du portefeuille de la Santé qui comprend Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetésNote de bas de page 337. Il y a aussi 6 centres de collaboration nationale en santé publique financés par le gouvernement fédéral qui servent de carrefours de connaissances pour la recherche scientifique et d'autres connaissances afin d'éclairer les mesures de santé publique.
Les services de santé publique destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont répartis entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriauxNote de bas de page 338. À l'échelon fédéral, les rôles et les responsabilités sont partagés entre Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada et l'ASPCNote de bas de page 339. Services aux Autochtones Canada finance ou fournit directement des services, comme les programmes de soins de santé primaires et de promotion de la santé, destinés aux Premières Nations et aux Inuits, et offre aussi du financement et des services aux communautés métissesNote de bas de page 257 Note de bas de page 340. L'ASPC appuie également des initiatives de santé qui s'adressent aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant hors réserveNote de bas de page 339. Le travail des gouvernements provinciaux et territoriaux vient s'ajouter à ces efforts de diverses façons. Par exemple, l'Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie‑Britannique travaille avec les Premières Nations, des partenaires gouvernementaux et d'autres intervenants pour améliorer les résultats en matière de santé des Premières Nations de la Colombie‑BritanniqueNote de bas de page 341. De plus, il y a des organisations autochtones nationales qui représentent et défendent les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada.
Le pourquoi et le comment du système de santé publique au Canada
Le but primordial du système de santé publique implique d'œuvrer à l'atteinte d'une santé et d'un bien-être optimaux pour tous les Canadiens (figure 9). Trois objectifs soutiennent ce but, et tous visent à protéger et améliorer la santé des populations tout en atteignant des résultats de santé équitables.
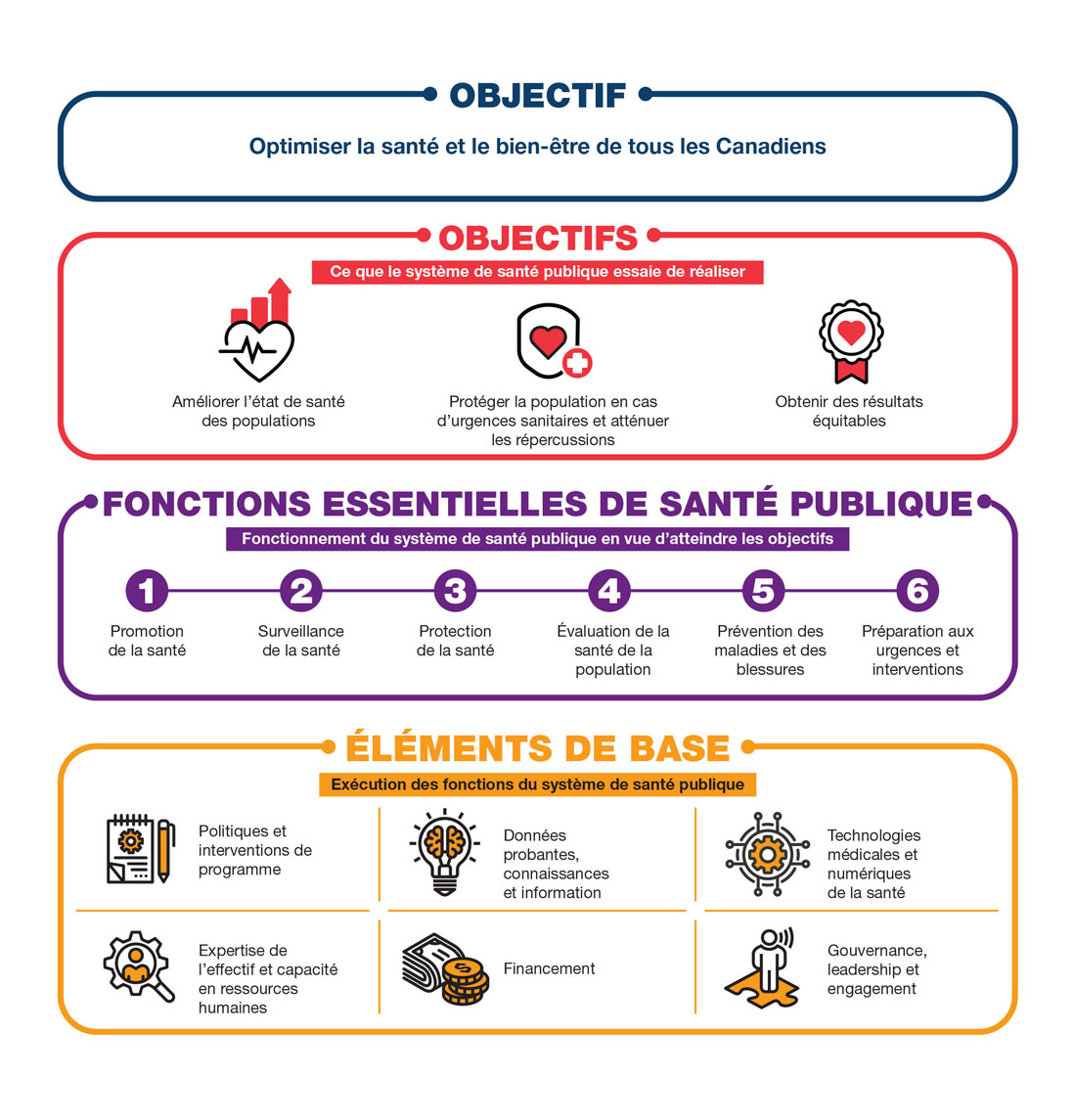
Figure 9 : Texte descriptif
Cette figure décrit la raison d'être, les objectifs, les fonctions et les éléments constitutifs des systèmes de santé publique au Canada. La figure fonctionne de haut en bas et décrit les composants suivants :
Raison d'être : optimiser la santé et le bien-être de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes.
Objectifs (ce que le système de santé publique essaie de réaliser) : 1) améliorer l'état de santé des populations; 2) protéger contre les urgences sanitaires et atténuer les répercussions; et 3) obtenir des résultats équitables.
Fonctions essentielles de la santé publique (fonctionnement du système de santé publique en vue d'atteindre les objectifs) : (1) promotion de la santé; (2) surveillance de la santé; (3) protection de la santé; (4) évaluation de la santé de la population; (5) prévention des maladies et des blessures; et (6) préparation et intervention en cas d'urgence.
Éléments constitutifs (exécution des fonctions du système de santé publique) : (1) interventions en matière de politiques et de programmes; (2) données probantes, connaissances et information; (3) technologies médicales et numériques de la santé; (4) expertise de la main-d'œuvre et capacité en matière de ressources humaines; (5) financement; et (6) gouvernance, leadership et engagement.
Pour atteindre ces objectifs, les systèmes de santé publique du Canada exercent 6 fonctions essentielles qui aident à organiser et à unifier les activités entre les systèmes (tableau 4).
Au cours des 3 dernières décennies, des efforts importants ont été déployés pour définir et redéfinir les fonctions de la santé publique au sein du système de santé en général, tant au Canada qu'à l'étrangerNote de bas de page 253 Note de bas de page 342 Note de bas de page 343. Ces fonctions ont été élaborées pour la première fois pour le Canada en 2003 par le Comité consultatif national sur la santé de la population en réponse au SRASNote de bas de page 344. Comme la portée et la complexité de la pratique de la santé publique ont considérablement augmenté au cours du 20e siècle, la description des fonctions de la santé publique est devenue une priorité.
La pratique de la santé publique continue d'évoluer. Compte tenu de la propagation mondiale des maladies émergentes, de l'importance croissante de travailler en collaboration pour obtenir la confiance du public et de l'impératif urgent d'agir sur les iniquités systémiques en santé, des efforts ont été déployés à l'échelle mondiale pour revoir les fonctions essentielles de la santé publiqueNote de bas de page 342 Note de bas de page 345 Note de bas de page 346.
| Fonction | Description |
|---|---|
| 1. Promotion de la santé | Travailler en collaboration avec les collectivités et d'autres secteurs pour comprendre et améliorer la santé au moyen de politiques publiques saines, d'interventions communautaires, de la participation du public et de plaidoyers ou d'actions sur les déterminants de santé. |
| 2. Surveillance de la santé | Recueillir des données de santé pour faire le suivi des maladies, de l'état de santé des populations et des déterminants de la santé, afin de promouvoir la santé, de prévenir et de réduire les impacts des maladies, et de monitorer les iniquités en santé |
| 3. Protection de la santé | Protéger la population contre les maladies infectieuses, les menaces environnementales et l'insalubrité de l'eau, de l'air et des aliments |
| 4. Évaluation de la santé de la population | Comprendre la santé des collectivités ou de populations précises et les déterminants de la santé afin d'améliorer les services, les politiques et la recherche visant à déterminer les interventions les plus efficaces |
| 5. Prévention des maladies et des blessures | Promouvoir des modes de vie sains et sécuritaires pour prévenir les maladies et les blessures et réduire le risque d'éclosion de maladies infectieuses grâce à des enquêtes et à des mesures de prévention |
| 6. Prévision, préparation et réponse aux situations d'urgence | Préparer le pays en cas de catastrophe naturelle ou de désastre d'origine humaine afin de réduire au minimum les maladies graves et les décès, et répondre aux urgences en minimisant les perturbations sociales. |
| Le Comité consultatif national sur la santé de la population a initialement élaboré la liste des fonctions essentielles de santé publique à la suite du SRAS. Des rapports ultérieurs, y compris Naylor et al. (2003) et le premier rapport de l'ACSP (2008) ont réitéré ces fonctions. | |
Dans certains cas, les fonctions de la santé publique sont exercées dans une clinique ou dans un autre contexte de prestation de soins de santé. Par exemple, les réseaux d'hôpitaux recueillent des données cruciales pour la surveillance de la santé, de nombreux réseaux de soins primaires offrent des services de protection et de promotion de la santé et, dans l'ensemble du système de prestation des soins de santé, une éducation en matière de santé est offerte à l'appui de la prévention des maladies et des blessures. La réussite de ces efforts repose sur une collaboration étroite entre l'État, les autorités locales de santé publique et les collectivités.
Pendant la pandémie de la COVID-19, les systèmes de santé publique ont activé ces fonctions simultanément. Par exemple :
- préparation et intervention en cas d'urgence afin de coordonner les activités à l'échelle du pays, d'assurer l'approvisionnement en vaccins et de créer des outils d'orientation et de communication en matière de santé publique;
- surveillance de la santé par la mise au point des premières technologies pour détecter le SRAS‑CoV‑2, puis des systèmes de données pour suivre la propagation du virus;
- protection de la santé par la mise en œuvre de mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus;
- promotion de la santé pour éclairer et élaborer des politiques, des programmes et d'autres interventions avec les collectivités et d'autres secteurs en matière de santé mentale, de sécurité alimentaire, de soutien économique, etc.;
- prévention des maladies par la vaccination et d'autres interventions visant à réduire l'incidence d'autres maladies et facteurs de risque qui exacerbent l'incidence de la COVID-19 (p. ex. santé mentale, méfaits de la consommation de substances);
- évaluation continue de la santé de la population au fil de l'évolution des forces, des vulnérabilités et des besoins des collectivités associée à la pandémie de laCOVID-19 et des mesures de santé publique, et synthèse rapide de la recherche sur les moyens de prévenir l'infection et de réduire la propagation.
Éléments de base du système de santé publique au Canada
Si les fonctions essentielles de santé publique illustrent la façon dont les systèmes de santé publique font leur travail, les éléments de base représentent la façon dont les systèmes sont organisés pour appuyer ces fonctions (figure 9)Note de bas de page iiiNote de bas de page 347. Ces éléments de base sont fondamentaux et intrinsèquement interdépendants.
Par exemple, le premier élément de base, Données probantes, connaissances et information, repose sur des systèmes de surveillance efficaces. Pour que ces systèmes soient interopérables et adaptés aux urgences sanitaires, des éléments et des actions provenant de tous les autres éléments de base sont requis, notamment : des accords d'échange de données (Gouvernance, leadership et mobilisation); des outils et des infrastructures numériques innovants et prédictifs (Technologies médicales et numériques); des ressources durables pour maintenir l'infrastructure technologique (Financement); l'expertise nécessaire pour analyser les données (Expertise de l'effectif et capacité en ressources humaines), et la contribution des collectivités pour comprendre le contexte des données et la manière dont elles pourraient être utilisées pour éclairer les interventions (Interventions en matière de politiques et de programmes).
Élément de base 1 : Interventions en matière de politiques et de programmes
Les interventions en santé de la population sont des politiques, des programmes, des services et des stratégies élaborés pour améliorer la santé mentale et physique et l'équité en santé à l'échelle de la populationNote de bas de page 348. Les professionnels de la santé publique, les organismes communautaires, les chercheurs et d'autres secteurs conçoivent des interventions pour des populations entières (p. ex. tous les enfants de toutes les écoles) ou pour des sous‑groupes prioritaires (p. ex. les enfants qui fréquentent des écoles dans des régions économiquement défavorisées). Les interventions sont fondées sur des données probantes et peuvent être des approches universelles ou axées sur un groupe, une collectivité ou une population en particulierNote de bas de page 349 Note de bas de page 350 Note de bas de page 351 Note de bas de page 352.
Comme il n'y a pas de solution universelle pour régler les problèmes complexes de santé publique, la mise en œuvre simultanée d'une gamme d'interventions est plus efficace. Les systèmes de santé publique font des interventions auprès des populations directement (p. ex. sensibilisation, vaccination, programmes d'aide aux communautés marginalisées) ou indirectement, en aidant les partenaires communautaires et sectoriels à prendre des mesures. Pour mettre en œuvre la bonne combinaison d'interventions, les professionnels de la santé publique ont besoin des meilleures données probantes disponibles, des bonnes ressources, de solides partenariats avec les collectivités et des mécanismes nécessaires pour apprendre et corriger les multiples mesures en temps réel.
Élément de base 2 : Données probantes, connaissances et information
La prise de décisions en santé publique est éclairée par des données probantes provenant de diverses sources, y compris la recherche, l'expérience des praticiens et les connaissances communautairesNote de bas de page 353 Note de bas de page 354 Note de bas de page 355 Note de bas de page 356 Note de bas de page 357. Les données probantes peuvent comprendre des résultats de recherche de différentes disciplines, des rapports sur l'état de santé des collectivités, des données provenant des systèmes de surveillance et d'information sur la santé, des observations des collectivités sur leur expérience vécue, des recherches sur l'évaluation et l'intervention, l'analyse de l'environnement politique, et l'examen des contextes politique, social et économique.
Ces données probantes sont évaluées et synthétisées par des chercheurs, des professionnels de la santé publique et des carrefours de connaissances, comme les CCN en santé publiqueNote de bas de page 358. Les méthodes utilisées pour obtenir des données probantes et les analyser peuvent être quantitatives (p. ex. surveillance, recherche épidémiologique), qualitatives (p. ex. entrevues, consultations) ou une combinaison des deux (p. ex. méthodes mixtes utilisées dans les évaluations et la recherche interventionnelle).
Lorsqu'ils dressent un portrait de la question à l'étude, les experts en santé publique évaluent de façon critique différents éléments d'informationNote de bas de page 354 Note de bas de page 359 Note de bas de page 360 Note de bas de page 361 :
- Qui est affecté et où?
- Quelles sont les répercussions?
- Quel est le contexte?
- Quels sont les déterminants, les causes et les risques?
- Quelles interventions pourraient être les plus efficaces?
D'autres groupes à l'extérieur des systèmes de santé publique se fient également aux données probantes de la santé publique. Par exemple, les professionnels du secteur des soins de santé, les experts des secteurs des politiques sociales et environnementales, les intervenants clés (p. ex. les organismes communautaires et le public) et les chercheurs en santé de la population peuvent tous utiliser ces données probantes et ces analyses pour éclairer leur travail ou leurs actionsNote de bas de page 362.
Élément de base 3 : Technologies médicales et numériques en santé
Les professionnels de la santé publique s'appuient sur du matériel et des technologies médicales et sanitaires efficaces ainsi que sur une infrastructure de laboratoire stable et réactive et des technologies numériques novatrices pour cerner les problèmes de santé et y répondre. Les laboratoires de santé publique du Canada sont un élément essentiel de l'écosystème des technologies médicales du pays. Ils fournissent un soutien de base pour détecter, comprendre et contrer les menaces à la santé publique. Par exemple, le Laboratoire national de microbiologie se spécialise dans sur la surveillance, les diagnostics, la recherche appliquée (p. ex. la modélisation mathématique, la cartographie du Système d'information géographique) et les services d'intervention en cas d'urgenceNote de bas de page 363.
Partout au Canada, les gouvernements ont aussi mis en place des systèmes pour maintenir des réserves de Matériel médical, de technologies et d'équipement (p. ex. équipement de protection individuelle, respirateurs, centres de triage et cliniques de traitement mineur)Note de bas de page 364. À titre d'exemple, la Réserve nationale stratégique d'urgence peut être consultée en tout temps pour appuyer les interventions provinciales et territoriales en cas d'urgence ou être prépositionnée pour assurer la préparation à d'autres événements de santé publiqueNote de bas de page 364.
Les systèmes de santé publique tirent parti de l'infrastructure d'information numérique et des technologies émergentes, comme les systèmes de surveillance de pointe, l'informatique et l'intelligence artificielleNote de bas de page 239. Le Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP), le système de surveillance fondé sur les événements du Canada, utilise les technologies numériques pour déterminer les risques pour la santé publique en parcourant des rapports, des reportages, des rumeurs et d'autres sources d'informationNote de bas de page 239. De plus, le Canada contribue à et utilise l'information de l'initiative Epidemic Intelligence from Open Sources (Renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes), un effort de collaboration international dirigé par l'OMSNote de bas de page 239 Note de bas de page 365.
Les leaders en santé publique comptent de plus en plus sur les innovations numériques pour appuyer la prise de décisions en temps réel. Cela comprend l'utilisation de données de source ouverte et d'un code de source ouverte, l'échange de données, ainsi que de nouvelles approches de modélisation, de visualisation et de communication avec le publicNote de bas de page 366.
Élément de base 4 : Expertise de l'effectif et capacité en ressources humaines
La main‑d'œuvre en santé publique est diversifiée et répartie entre différentes professions, travaillant dans tous les ordres de gouvernement, le système de santé, les collectivités, les laboratoires et les milieux universitaires. Ces professions comprennent, sans toutefois s'y limiter :
- Médecins et infirmières en santé publique
- Chercheurs en sciences de la santé et en sciences naturelles
- Modélisateurs mathématiques
- Microbiologistes et experts en maladies infectieuses
- Analystes de politiques
- Vétérinaires
- Spécialistes en sciences sociales et comportementales
- Inspecteurs en santé publique
- Diététistes de la santé publique
- Épidémiologistes et biostatisticiens
- Spécialistes de la promotion de la santé
- Agents de développement communautaire
- Experts en communications
- Aînés, guérisseurs traditionnels et gardiens du savoir culturel
Une diversité d'ensembles de compétences et d'expertise disciplinaire est essentielle pour veiller à ce que l'effectif en santé publique puisse relever les défis variés et complexes de la santé publique.
Depuis la crise du SRAS, on a mis l'accent sur la structuration et le renforcement des éléments essentiels de la main‑d'œuvre en santé publique du Canada. Par exemple, le Groupe de travail mixte sur les ressources humaines en santé publique a présenté le Cadre pancanadien de planification des ressources humaines en santé publique (2005), préparant le terrain pour l'élaboration des compétences essentielles en santé publique au Canada (2007)Note de bas de page 367 Note de bas de page 368. Ces initiatives ont également contribué à l'accroissement du nombre de programmes d'études supérieures dans les écoles de santé publique partout au CanadaNote de bas de page 369.
Élément de base 5 : Financement
Au Canada, les systèmes de santé publique sont financés par les impôts fédéraux, provinciaux et territoriaux et, dans certains cas, municipauxNote de bas de page 281 Note de bas de page 370 Note de bas de page 371. L'ASPC reçoit des fonds directement du budget fédéral de la santé. Les conditions du financement fédéral de la santé destiné aux provinces et aux territoires sont établies par la Loi canadienne sur la santé, qui met l'accent sur les soins de santé et ne traite pas précisément du financement de la santé publiqueNote de bas de page 372. Les provinces et les territoires sont responsables de décider où et comment investir dans leur système de santé publique. Il peut aussi y avoir des ententes de financement ponctuelles avec des ministères fédéraux, des provinces ou des territoires ou des organismes non gouvernementaux pour régler des problèmes de santé émergents ou urgents comme la pandémie de la COVID-19Note de bas de page 373 Note de bas de page 374.
Le financement des services de santé destinés aux peuples autochtones est un domaine de compétence partagée. L'ambiguïté des compétences a mené à la fragmentation du financement et de la gouvernance des systèmes de santé publique au service des peuples autochtones au CanadaNote de bas de page 339.
Il est difficile d'estimer le financement de la santé publique et les estimations varient, mais une approximation suggère que les dépenses de santé publique représentent un peu moins de 6 % des dépenses totales en santé au CanadaNote de bas de page 375. En revanche, les hôpitaux reçoivent environ 26 % du total des dépenses en santé, et les coûts des médicaments représentent 15 % de ces dépensesNote de bas de page 375.
L'argument économique souligne l'importance des affectations financières pour la santé publique. Par exemple, la recherche démontre que l'investissement dans la santé publique peut avoir un rendement élevé sur le capital investi (voir encadré « L'investissement dans la santé publique génère d'importants avantages financiers à long terme »)Note de bas de page 376 Note de bas de page 377. En outre, certains ont fait valoir qu'investir dans des stratégies pour atteindre une santé optimale soit impératif pour la justice socialeNote de bas de page iv, un élément qui soutient un engagement face au bien-être de tous les citoyensNote de bas de page 378.
L'investissement dans la santé publique génère d'importants avantages financiers à long terme
Il existe de plusieurs approches différentes pour calculer l'incidence des interventions en santé publique. Lors d'un examen systématique du rendement du capital investi (RCI) des interventions en santé publique dans les pays industrialisés dotés d'un régime universel de soins de santé, les chercheurs ont constaté que, même lorsqu'on tient compte de toutes les réserves, les interventions locales et nationales en santé publique permettent de réaliser des économies substantiellesNote de bas de page 376 :
- Le RCI médian de toutes les interventions évaluées était de 14,3, ce qui signifie que chaque dollar investi en santé publique a généré plus de 14 $ en économies de coûts. Ces économies découlent de l'élimination des coûts supplémentaires en aval pour le secteur de la santé et de l'économie. Il est important de noter que les mesures de santé publique qui peuvent cibler efficacement une grande partie de la population, comme les interventions législatives, de protection de la santé ou à l'échelle nationale, produisent les RCI les plus importants (de27.20 $ à 46,50 $ en économie de coût par dollar investi).
- Contrairement aux investissements typiques dans les soins de santé ou les services sociaux, il peut s'écouler beaucoup de temps avant que les effets positifs des interventions en santé publique soient perceptibles. Par conséquent, ces interventions nécessitent un engagement et une planification à long terme, plutôt que des considérations politiques et économiques à court terme.
Élément de base 6 : Gouvernance, leadership et mobilisation
La gouvernance de la santé publique désigne la façon dont les organismes et les secteurs publics, non gouvernementaux ou privés travaillent ensemble pour aider les collectivités à prévenir les maladies et à optimiser la santé, le bien‑être et l'équité en santéNote de bas de page 379. Les fonctions et les mesures de gouvernance comprennent l'élaboration de politiques et de stratégies, la législation, l'intendance des ressources, la mobilisation des partenaires et des collectivités et la facilitation de l'amélioration continue. Tous ces éléments peuvent être officiellement intégrés dans les institutions ou faire l'objet d'ententes mutuelles informelles.
Tous les ordres de gouvernement ont des rôles et des responsabilités en matière de santé publique et sont en mesure de légiférer ou d'adopter des politiques qui améliorent la santé des populationsNote de bas de page 254 Note de bas de page 255. Cette gouvernance partagée entre les divers secteurs de compétence nécessite de tirer parti des réseaux pour faciliter la collaboration entre les divers paliers de gouvernement et la coordination en santé publique. Au Canada, le plus influent d'entre eux est le Réseau pancanadien de santé publique, qui a été établi dans la foulée de la crise du SRAS afin de renforcer et d'améliorer les politiques et les pratiques en matière de santé publique au CanadaNote de bas de page 224 Note de bas de page 253. Le Comité consultatif spécial sur la COVID-19 a été mis sur pied sous l'égide de ce réseau en 2020 pour diriger la réponse pancanadienne à la pandémie.
Défis et possibilités liés au système de santé publique du Canada
Dans chacun des éléments de base s'inscrivent des opportunités clés de renforcer les systèmes de santé publique du Canada. Ces occasions découlent d'ébauches d'idées qui ont continué de progresser au cours de la pandémie de COVID-19 Note de bas de page 7 Note de bas de page 253 Note de bas de page 258 Note de bas de page 259. Bien qu'elles ne soient pas exhaustives, ces possibilités représentent des points de départ importants pour des conversations portant sur la transformation de la santé publique à l'échelle du système global. La section 3 énonce les conditions requises pour que ces opportunités se concrétisent et appuient un système de santé publique de calibre mondial pour le Canada.
Élément de base 1 : Interventions en matière de politiques et de programmes
Des discussions avec des experts en santé publique ont fait ressortir la nécessité d'adopter une approche plus globale, coordonnée et cohérente face aux interventions de santé publiqueNote de bas de page 380. La complexité des problèmes de santé publique, ainsi que les variations entre les populations et les contextes, exige une planification ciblée des interventions susceptibles d'avoir l'incidence la plus large possible sur les déterminants de la santé. L'adoption d'une approche sociétale pour relever les défis de la santé publique contribuerait à la réalisation de cet objectifNote de bas de page 323 Note de bas de page 381 Note de bas de page 382 Note de bas de page 383. La communauté et la société civile ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, à la fois comme partenaires et comme initiateurs d'actions locales visant à remédier aux iniquitésNote de bas de page 323. Pour être efficace dans ce rôle, les collectivités et les organismes qui les desservent ont besoin de ressources adéquates et établir des contacts avec les chercheurs, la santé publique et le système de santé au sens largeNote de bas de page 384 Note de bas de page 385.
Amplifier l'action en amont pour traiter les problèmes complexes de santé publique
Le fardeau et les résultats inéquitables et disproportionnés associés aux cas de COVID-19, ont été un rappel brutal de la nécessité constante pour les systèmes de santé publique de catalyser l'action sur les déterminants sociaux de la santé. En fait, la pandémie a montré que l'action collective dans tous les secteurs est essentielle à l'optimisation de la santé de tous les Canadiens et de toutes les CanadiennesNote de bas de page 5. Pour ce faire, il faut une approche globale de la santé publique qui se concentre sur les « causes des causes », en ciblant les facteurs structurels à la base de la santé et les circonstances de la vie quotidienne (voir encadré « L'amélioration de la santé des populations exige une combinaison d'efforts en amont et en aval »)Note de bas de page 386. Cette approche aiderait aussi à orienter l'action autour des déterminants de la santé plutôt que de se limiter à des approches cloisonnées axées sur les différentes maladiesNote de bas de page 386.
L'amélioration de la santé des populations exige une combinaison d'efforts en amont et en aval
La santé des populations est façonnée par les déterminants sociaux, qui façonnent ensuite les conditions dans lesquelles les gens viventNote de bas de page 378. Les professionnels de la santé publique utilisent souvent l'analogie d'une rivière et les concepts relatifs « en amont » et « en aval » pour décrire comment ces déterminants de la santé influencent les comportements à risque et la santé (figure 10).
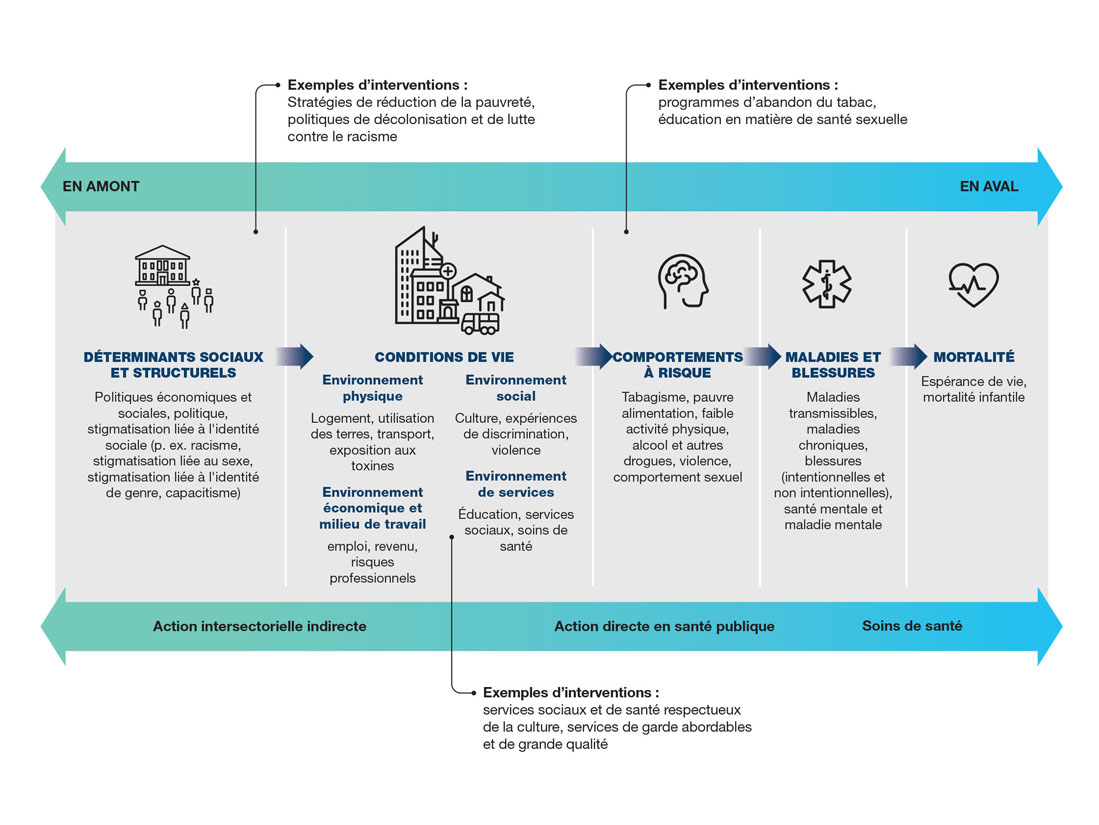
Figure 10 : Texte descriptif
Cette figure illustre un continuum d'interventions visant les déterminants de la santé.
La figure montre les facteurs en amont et en aval qui ont un impact sur la santé, ainsi que des exemples d'interventions en amont, intermédiaires et en aval. De gauche à droite, la figure illustre aussi l'action intersectorielle indirecte, l'action directe en santé publique et les soins de santé. De gauche à droite, la figure décrit les composants suivants :
- Déterminants sociaux et structurels : politiques économiques et sociales, politique, stigmatisation liée à l'identité sociale (p. ex. racisme, stigmatisation liée au sexe, stigmatisation liée à l'identité de genre, capacitisme).
- Conditions de vie :
- Environnement physique : logement, utilisation des terres, transport, exposition aux toxines.
- Environnement social : culture, expériences de discrimination, violence.
- Environnement économique et milieu de travail : emploi, revenu, risques professionnels.
- Environnement de services : éducation, services sociaux, soins de santé.
- Comportements à risque : tabagisme, moins bonne alimentation, faible activité physique, alcool et autres drogues, violence, comportement sexuel.
- Maladies et blessures : maladies transmissibles, maladies chroniques, blessures (intentionnelles et non intentionnelles), santé mentale et maladie mentale.
- Mortalité : espérance de vie, mortalité infantile.
Exemples d'interventions en amont : stratégies de réduction de la pauvreté, politiques de décolonisation et de lutte contre le racisme.
Exemples d'interventions intermédiaires : services sociaux et de santé adaptés sur le plan culturel, services de garde d'enfants abordables et de grande qualité.
Exemples d'interventions en aval : programmes d'abandon du tabac, éducation en matière de santé sexuelle.
Figure adapté de A Public Health Framework for Reducing Health Inequities : Bay Area Regional Health Inequities InitiativeNote de bas de page 387.
Cette analogie vient d'une parabole qui raconte qu'« une personne est témoin de l'affolement d'un homme pris dans le courant d'une rivière. Après avoir porté secours à l'homme, le témoin réalise qu'il doit sauver d'autres personnes qui affluent avec le courant. Après en avoir sorti un grand nombre de l'eau, le témoin marche en amont pour voir pourquoi autant de personnes étaient tombées dans la rivière »Note de bas de page 388.
Les interventions en amont ciblent les déterminants sociaux et structurels de la santé (c.‑à‑d. qu'elles ont pour but d'empêcher les gens de tomber à l'eau en premier lieu). Ces interventions ciblent les politiques et les iniquités sous‑jacentes qui façonnent à la fois les conditions de vie et les comportements des gens. Puisque ces facteurs influencent de nombreux autres facteurs de risque, le fait de les aborder peut avoir une incidence sur un certain nombre de paramètres de santé en même temps. Pour ce faire, la santé publique doit fournir des données, des analyses et du transfert de connaissances pour guider et soutenir des interventions en amont.
Les interventions intermédiaires visent à réduire les vulnérabilités d'un groupe et à atténuer les iniquités existantes le concernant. Ces vulnérabilités se manifestent principalement dans l'environnement où vivent les gens et dans Leurs conditions de vie. Encore une fois, le fait d'agir sur ces vulnérabilités et iniquités peut avoir une incidence sur un certain nombre de paramètres ou indicateurs de santé, pour les groupes en question. Les systèmes de santé publique agissent directement et indirectement sur ces vulnérabilités.
Les interventions en aval soutiennent les personnes qui subissent déjà les effets sur leur santé (c.‑à‑d. qu'elles visent à aider les personnes après qu'elles se sont retrouvées prises dans le courant de la rivière). Ces interventions sont axées sur la modification des facteurs de risque comportementaux individuels, le renforcement des compétences ou le traitement du problème de santé qui en résulte. Les systèmes de santé publique sont en mesure de prendre des mesures directes dans ces domaines, bien qu'ils soient généralement les moins influents pour ce qui est des grands changements à l'échelle de la populationNote de bas de page 349 Note de bas de page 389.
À mesure que les systèmes de santé publique continuent de promouvoir et de faire progresser les solutions en amont, il convient d'articuler clairement leurs rôles dans les actions intersectoriellesNote de bas de page 349 Note de bas de page 390 Note de bas de page 391. Par exemple, les systèmes de santé publique possèdent souvent une expertise et des connaissances techniques qui peuvent aider d'autres secteurs à agir sur les déterminants sociaux, structurels et environnementaux de la santéNote de bas de page 390 Note de bas de page 392 Note de bas de page 393. Cependant, cela nécessite l'adhésion des secteurs ayant le mandat d'agir sur ces déterminants(p. ex. logement, emploi et éducation)Note de bas de page 349 Note de bas de page 390 Note de bas de page 391 Note de bas de page 394.
Les discussions avec les parties-prenantes durant l'élaboration du présent rapport ont rappelé l'importance de veiller à ce que les systèmes de santé publique soutiennent les autres secteurs et la nécessité de renforcer les mécanismes susceptibles d'encourager la collaboration intersectorielleNote de bas de page 380. Plusieurs exemples bénéficient d'un élan à l'échelle internationale et au Canada. Premièrement, les évaluations des incidences sur la santé (EIS) ou de l'équité en matière de santé sont des outils que d'autres secteurs peuvent utiliser pour déterminer les conséquences de projets, de programmes ou de politiques en matière de santé et d'équité et en tenir compteNote de bas de page 395 Note de bas de page 396 Note de bas de page 397 Note de bas de page 398. Deuxièmement, l'approche axée sur les répercussions collectives reconnaît que les problèmes sociaux et de santé publique complexes exigent des efforts coordonnés avec des objectifs communs et des actions se renforçant mutuellement entre les secteursNote de bas de page 399 Note de bas de page 400. Cette approche offre des moyens concrets de promouvoir et de mettre en œuvre la responsabilisation partagée entre les organismes participantsNote de bas de page 399.
La bonne combinaison d'interventions peut cibler efficacement les déterminants de la santé en amont, ceux dits intermédiaires et ceux en aval. Pourtant, il subsiste de de nombreux défis à relever pour déterminer les actions qui ont le plus d'impact et qui sont modifiables en vue d'être transposées à grande échelle pour certaines maladies, populations et contextesNote de bas de page 267 Note de bas de page 401 Note de bas de page 402 Note de bas de page 403 Note de bas de page 404. La recherche appliquée en santé publique offre des perspectives importantes sur la durabilité, l'équité et l'efficacité des interventions de santé publiqueNote de bas de page 405. Le travail dans ce domaine pourrait être renforcé en priorisant la recherche pertinente aux politiques et en travaillant avec les praticiens pour convertir de façon pratique les connaissances générées par la recherche portant sur des interventions, en action de santé publiqueNote de bas de page 405.
Mobiliser la participation communautaire à la prise de décisions en santé publique
La participation communautaire est essentielle à la fois à l'équité en santé et à l'établissement d'un système de santé publique résilientNote de bas de page 385. Les organismes communautaires améliorent la santé des populations qu'ils desservent de multiples façons, en mobilisant les communautés locales et en les habilitant à agir ainsi qu'en leur offrant des services de santé et des services sociaux pour répondre à leurs besoins immédiatsNote de bas de page 385 Note de bas de page 406. Les organismes communautaires sont également bien placés pour orienter les interventions en santé publique, étant donné leur lien étroit avec les membres de la collectivité, les structures de gouvernance communautaire et les réseaux agilesNote de bas de page 324. En travaillant avec le système de santé publique, les collectivités peuvent être des partenaires dans les décisions en matière de santé publique, améliorer l'accès aux services et la pertinence de ceux‑ci, et agir comme des agents de mobilisation importants sur le terrain pour les interventions en santé publique pendant les urgences sanitairesNote de bas de page 230 Note de bas de page 407 Note de bas de page 408 Note de bas de page 409 Note de bas de page 410 Note de bas de page 411.
Il existe de nombreux exemples de partenariats forts et efficaces entre les communautés et les organismes de santé publique au Canada, ceci a particulièrement été mis en évidence lors de la pandémie de la COVID-19Note de bas de page 385. Sur ce plan s'offrent à nous des possibilités immédiates de mieux intégrer la participation et l'action communautaires de façon équitable dans les interventions en santé publique. L'encadré « Leadership communautaire et COVID 19 à Toronto » en donne un exemple. Parmi les partenariats observés pendant la pandémie, comptent les nombreuses coalitions et les nombreux organismes bénévoles qui ont travaillé en étroite collaboration avec les systèmes de santé publique, comme le South Asian Health NetworkNote de bas de page 412 (réseau pour la santé des communautés sud‑asiatiques), le Black Scientists Task Force on Vaccine EquityNote de bas de page 413 (groupe de travail des scientifiques noirs sur l'équité en matière de vaccins) et Inclusion Nova Scotia (Inclusion Nouvelle‑Écosse)Note de bas de page 414.
Les principaux moyens de soutenir les efforts des collectivités en matière de santé de la population comprennent la prestation de ressources stables et continues, le soutien à l'autodétermination des communautés autochtones, l'accent sur la participation équitable et le partage équitable des pouvoirs, le renforcement de la confiance, l'élaboration conjointe de processus et d'initiatives, et l'évaluation de la nature et des impacts de l'engagementNote de bas de page 408 Note de bas de page 415 Note de bas de page 416.
Il est également possible de tirer parti de la relation synergique entre les collectivités, les systèmes de santé publique locaux et les services de soins primaires, bien qu'il y ait des différences appréciables entre les systèmes de santé provinciaux et territoriaux. Les modèles complets de soins de santé primaires globaux mettent l'accent sur cette synergie et offrent un moyen d'envisager la coordination de la pratique de la santé publique à l'échelon communautaireNote de bas de page 385. Les systèmes locaux de santé publique ont un rôle important à jouer pour faire le pont entre l'expertise de cette triade et les tables fédérales, provinciales et territoriales plus vastes sur la conception de programmes et de politiques.
Leadership communautaire et COVID-19 à Toronto
Les mesures communautaires sont apparues tôt dans la réponse à la pandémie de la COVID-19. Au fil du temps, la ville de Toronto et la province d'Ontario ont toutes deux appris des approches communautaires et ont fourni des ressources directement aux organismes communautaires pour appuyer leur rôle de leadership dans la prestation de conseils et l'exécution d'interventions fiablesNote de bas de page 417. Des ambassadeurs communautaires de la réponse à la pandémie de la COVID-19, c.‑à‑d. des leaders multilingues, locaux et de confiance, ont été recrutés et formés pour interagir avec la communauté, fournir de l'information et mettre les membres en contact avec les sites de vaccinationNote de bas de page 418. Les ressources étaient axées sur le soutien des populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie, y compris les populations noires, latino‑canadiennes et hispaniques de Toronto, les communautés LGBTQ2+, les personnes sans abri, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les Sud‑Asiatiques, les Asiatiques du Sud‑Est et les Asiatiques de l'Ouest, les personnes sans papiers et les jeunes. Des approches dirigées par des Autochtones ont permis d'offrir des services de vaccination et de dépistage respectueux de la culture et accessibles aux communautés de toute la villeNote de bas de page 419.
Pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la participation efficace aux interventions est fondée sur l'autodétermination et le respect de la culture. Dans le but de maximiser l'efficacité des interventions en santé publique, un leadership en santé publique autochtone, un engagement fort, la création conjointe d'interventions et des évaluations culturellement pertinentes sont requisNote de bas de page 420. Les processus de mobilisation respectueux de la culture qui reconnaissent et abordent la dynamique du pouvoir dans le système de santé sont particulièrement importantsNote de bas de page 147 Note de bas de page 285 Note de bas de page 421 Note de bas de page 422 Note de bas de page 423. La mise en œuvre de ces processus exige une confiance mutuelle, l'élimination de préjugés et de discrimination, la validation systémique du savoir des Autochtones, l'autoréflexion pour les partenaires non autochtones et l'humilité culturelleNote de bas de page 147 Note de bas de page 285 Note de bas de page 421 Note de bas de page 422 Note de bas de page 423 Note de bas de page 424. Grâce à cette approche, les relations et les environnements de santé publique peuvent être sécuritaires sur les plans spirituel, social et émotionnel pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des MétisNote de bas de page 425.
Élément de base 2 : Données probantes, connaissances et information
Les systèmes de santé publique ont besoin de données probantes de grande qualité, accessibles et soutenues par des écosystèmes et des processus d'information adaptables. Lorsque ces systèmes sont en place, il est possible de prendre des décisions en temps réel et d'apporter des améliorations continues aux interventions (voir l'encadré « Une culture d'apprentissage »).
Toutefois, les connaissances nécessaires pour guider les interventions du système de santé publique ne peuvent pas provenir uniquement de la santé publique. Pour être à la fois efficace et équitable, la prise de décisions fondées sur des données probantes nécessite une plus grande attention aux expériences et au point de vue de diverses populations et une utilisation accrue de diverses approches méthodologiques. Cela comprend les communautés qui ont été traditionnellement exclues au Canada, comme les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les groupes racisés, les personnes LGBTQ2+, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap.
Une culture d'apprentissage
Un système de santé axé sur l'apprentissage utilise les données pour cerner les problèmes de santé et y répondre de façon continue, dans le but d'améliorer les soins et de réduire les coûts. Pour ce faire, il combine les données et la recherche pour favoriser l'apprentissage, l'amélioration et l'innovation Note de bas de page 426 Note de bas de page 427. Axés à l'origine sur les soins de santé, les systèmes de santé peuvent être adaptés en fonction des considérations de santé publique dans la poursuite des résultats en matière de santé de la populationNote de bas de page 426. Cela nécessiterait d'établir des liens plus étroits entre la santé publique, le système de santé, la recherche et les données probantes en constante évolution et les collectivités, conjugués à des efforts permanents et conscients pour intégrer une orientation axée sur l'équité Note de bas de page 426 Note de bas de page 428.
Créer un écosystème de données et d'information interopérable pour appuyer la prise de décisions
Citation : « La surveillance et le suivi constituent l'une des fonctions essentielles de la santé publique. C'est notre test de laboratoire, notre examen physique, notre façon de prendre le pouls de la collectivité. »
La première étape pour comprendre tout problème de santé publique, et une condition préalable à la prise de décisions en santé publique, est la collecte d'information sur l'état de santé, les risques pour la santé et les déterminants de la santé pour la population d'intérêt et les sous‑groupes clésNote de bas de page 362. Le Canada utilise toute une gamme de systèmes de surveillance fondés sur des indicateurs et des événements pour saisir et analyser de façon systématique des données sur un éventail de problèmes de santé publique, comme les maladies infectieuses et chroniques, la crise des surdoses d'opioïdes et les problème de santé mentaleNote de bas de page 429.
Ces systèmes d'information sont d'une importance cruciale pour orienter les décisions et éclairer la pratique fondée sur des données probantes. Toutefois, le panorama national des données est fragmenté entre les administrations, les organismes gouvernementaux et les propriétaires de données à l'échelle communautaire. De nombreux systèmes et cadres de données indépendants ont évolué au fil du temps, mais leurs capacités à une collecte de données normalisées, l'échange de données entre les systèmes et une synthèse plus large de l'information sont limitéesNote de bas de page 207. Ces problèmes restreignent l'utilité des systèmes de données existants pour appuyer la prise de décisions en santé publiqueNote de bas de page 7.
Cette fragmentation, conjuguée à une technologie désuète, a des conséquences particulièrement prononcées en cas d'urgence sanitaire lorsque l'accès aux données en temps réel est primordial pour la prise de décisionsNote de bas de page 206 Note de bas de page 207 Note de bas de page 253. Les retards dans l'obtention des bons renseignements peuvent nuire à d'importants objectifs de surveillance de la santé publique au début d'une pandémie, comme la détection du virus et la compréhension de son mode de propagationNote de bas de page 206.
En raison de ces défis historiques et continus, il y a eu de nombreux examens et appels à des réformesNote de bas de page 206 Note de bas de page 334 Note de bas de page 430 Note de bas de page 431. Les leçons tirées des tentatives antérieures de réforme des systèmes nationaux de données sur la santé ont permis de cerner des obstacles systémiques comme le manque de confiance et de responsabilités claires entre les propriétaires de données et les utilisateurs, une participation ou un intérêt public limité, des objectifs stratégiques différents et l'incapacité de « diffuser l'excellence »Note de bas de page 207 Note de bas de page 432.
Citation : « Il y a des données que nous ne recueillons pas, des données que nous recueillons et ne partageons pas, des données que nous partageons et utilisons mal, des données que nous utilisons pour opprimer et stigmatiser et autres problèmes, et des données que nous avons, mais n'utilisons pas pour régler les problèmes. »
La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence le besoin quant à des processus efficaces de couplage de données épidémiologiques, biomédicales et cliniques. Des données, des systèmes d'information et des processus, tous interopérables appuieraient ainsi le flux et l'analyse des données entre les systèmes. Il est important de reconnaître que par « interopérabilité », nous n'entendons pas un système centralisé, mais plutôt un écosystème coopératif qui respecte la propriété des donnéesNote de bas de page 207. Dans un tel système tous les doivent avoir des objectifs communs et une compréhension commune des besoins en données et des rôles de chacunNote de bas de page 207. Ce système doit également inclure des processus appropriés pour veiller à ce que les données soient recueillies, conservées, traitées et utilisées d'une manière qui respecte la culture, ainsi que des mécanismes qui protègent les renseignements personnelsNote de bas de page 433 Note de bas de page 434 Note de bas de page 435.
Les technologies novatrices et la capacité d'analyse sont toutes deux nécessaires à ce travail. Les données interconnectées, les grands ensembles de données et les bases de données complexes doivent être traités par des professionnels de la santé publique spécialisés en analyse de données et en informatique de la santéNote de bas de page 7 Note de bas de page 430 Note de bas de page 436 Note de bas de page 437. L'infrastructure technique idéale serait adaptée aux besoins de collecte et de gestion des données et comprendrait des mécanismes de réseautage entre les systèmesNote de bas de page 438. L'échange de données ouvertes sous forme de plateformes de données novatrices peut aider à combler les lacunes des systèmes de surveillance actuels en ce qui a trait à la prise de décisions en temps réelNote de bas de page 366. Cependant, bon nombre des systèmes de données utilisés par les intervenants en santé publique au Canada sont actuellement désuets ou offrent des fonctionnalités limitéesNote de bas de page 436.
Élargir la base de connaissances des systèmes de santé publique
Les approches de recherche qualitatives et mixtes, incluant les données probantes qui en sont issues ont été sous‑utilisées en santé publiqueNote de bas de page 440. La recherche qualitative peut aider les chercheurs à explorer les aspects sociaux de la santé et de la maladie, comme par exemple, les raisons pour lesquelles les gens se comportent de certaines façons ce qu' ils comprennent ou donnent un sens à leurs expériencesNote de bas de page 440 Note de bas de page 441 Note de bas de page 442. Ces questions qualitatives ajoutent de la profondeur et du contexte aux modèles épidémiologiques et elles fournissent des renseignements qui aident à éclairer l'élaboration d'interventionsNote de bas de page 440 Note de bas de page 441 Note de bas de page 442. Par exemple, les méthodes qualitatives peuvent fournir des renseignements importants sur les aspects sociaux, culturels et politiques d'une pandémie en aidant les professionnels de la santé publique à comprendre quels sont les facteurs de risque, quels éléments influencent l'adoption de mesures de santé publique, quelles sont les conséquences inattendues découlant des actions de santé publique et quelles façons s'y prendre pour mieux susciter l'adhésion des collectivités aux initiatives de santé publiqueNote de bas de page 442 Note de bas de page 443. De plus, bien que les approches fondées sur des données probantes en santé publique aient toujours été guidées par les principes de la science moderne, ceux‑ci ne tiennent pas suffisamment compte des connaissances et des réalités de toutes les personnes vivant au CanadaNote de bas de page 433 Note de bas de page 444 Note de bas de page 445. Par exemple, le savoir autochtone, comme les histoires orales et les récits, est souvent non reconnu ou sous‑évaluéNote de bas de page 420.
Pour ce qui est des données quantitatives, le manque de données désagrégées selon des caractéristiques comme la race, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, le revenu, l'éducation et l'identité de genre est un défi constant pour les professionnels de la santé publique et les collectivitésNote de bas de page 210 Note de bas de page 306 Note de bas de page 334 Note de bas de page 446. Sans ces données, il est impossible de mesurer les impacts différentiels entre les populations, et les iniquités risquent de ne pas être corrigéesNote de bas de page 210 Note de bas de page 306 Note de bas de page 334. Au Canada, il y a eu des défis liés au couplage ou à la mise en commun de données individuelles, ce qui a nui à la recherche dans ces domainesNote de bas de page 436. De même, les approches utilisées pour la détermination du statut d'Autochtone dans les sources principales de données sur la santé de la population varient d'une administration à l'autre, et certaines provinces ne recueillent pas du tout ce type de donnéesNote de bas de page 447 Note de bas de page 448 Note de bas de page 449.
Ces écarts ne constituent pas seulement un problème technique, mais aussi un problème d'équité. Depuis des décennies, les communautés préconisent des approches de gouvernance des données qui tiennent compte des intérêts de la communauté et corrigent les déséquilibres de pouvoir entourant la propriété des donnéesNote de bas de page 450. Quelques exemples de principes de souveraineté des données déterminés par les communautés sont proposés dans l'encadré « Principes de souveraineté des données autochtones : principes PCAP des Premières Nations, principes Inuit Quaujimajayuquangit et principes (PCAP) des Métis. » Le Groupe de travail sur l'équité en santé pour les Noirs de l'Ontario, par exemple, a publié un cadre de mobilisation, de gouvernance, d'accès et de protection pour la collecte, l'utilisation et la gouvernance des donnéesNote de bas de page 433. La demande générale de données axées sur l'équité fait écho à l'importance de la participation de la communauté à ces processus et à l'action subséquente en santé publiqueNote de bas de page 208 Note de bas de page 446.
Principes de souveraineté des données autochtones : principes PCAP des Premières Nations, principes Inuit Quaujimajayuquangit et principes (PCAG) des Métis
Principes PCAP des Premières Nations
Les Premières Nations ont une longue tradition de collecte, d'utilisation et de gouvernance de l'information nécessaire pour prendre des décisions liées à la santé et au bien‑être. Les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession PCAP des Premières Nations constituent l'approche standard de la gouvernance des données des Premières Nations et appuient la souveraineté des donnéesNote de bas de page 434 Note de bas de page 451. Compte tenu de la diversité au sein des nations et entre elles, l'expression des principes peut être affirmée différemment d'une nation à l'autre, conformément à leur vision du monde, à leurs connaissances traditionnelles et à leurs protocolesNote de bas de page 434.
Inuit Quaujimajayuquangit
L'Inuit Quaujimajayuquangit (IQ) (expression inuite qui signifie « connaissances traditionnelles des Inuits ») est un cadre qui représente le savoir autochtone des Inuits. L'Inuit Quaujimajayuquangit repose sur 4 éléments, soit travailler pour le bien commun, respecter tous les êtres vivants, maintenir l'harmonie et l'équilibre, et planifier et préparer continuellement l'avenirNote de bas de page 452. Cette approche constitue le fondement du bien‑être des communautés inuites, tout comme la valorisation, la préservation et la promotion du savoir traditionnelNote de bas de page 452.
Les principes PCAG des Métis du Manitoba
Les renseignements sur la santé des Métis devraient être recueillis conformément aux principes de propriété, de contrôle, d'accès et de gouvernance (PCAG), et sous la propriété et le contrôle de la nation métisseNote de bas de page 420. Le Ralliement national des Métis appuie les ententes d'application des connaissances conclues avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui mènent à des interventions fondées sur des données probantes qui profitent à la santé et au bien‑être des MétisNote de bas de page 420.
Améliorer l'interface entre la recherche et la pratique
La recherche est essentielle à une pratique efficace en santé publiqueNote de bas de page 453. Cependant, il y a des lacunes dans l'interface, entre le contexte dans lequel la recherche est effectuée et les besoins et ressources du milieu dans lequel elle est appliquée. Par conséquent, il se peut que les données probantes ne soient pas utilisées dans les contextes où elles pourraient être les plus utilesNote de bas de page 453 Note de bas de page 454.
La pandémie de la COVID-19 a illustré la nécessité de générer et synthétiser rapidement les connaissances émergentes. Des relations plus étroites et plus souples entre les organismes de santé publique, les instituts et les établissements universitaires pourraient mener à des résultats de recherche davantage axés sur les solutions afin d'éclairer directement les décisions en santé publiqueNote de bas de page 455. Des initiatives comme les réseaux de recherche COVID‑END et CanCOVID ont été créés pour synthétiser l'évolution des données probantes pendant la pandémie dela COVID-19 (pour plus d'information, voir l'encadré de la section 1 « L'évolution rapide des données probantes en évolution rapide mènent à des partenariats novateurs entre universitaires et praticiens »)Note de bas de page 227 Note de bas de page 228. Ces initiatives pourraient servir de modèles pour des réseaux futurs de recherche et de pratique. La recherche appliquée en santé publique est également essentielle pour soutenir les liens entre la recherche et la pratique en santé publique. Par exemple, le programme des chaires en santé publique appliquée – une collaboration entre les IRSC et l'ASPC – établit des liens entre les chercheurs et les décideurs afin d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes qui améliorent la santé et l'équité en santéNote de bas de page 456. Le maintien de ce modèle aidera à faire en sorte que la recherche appliquée en santé publique demeure adaptée à la pratique en santé publique au Canada.
Parmi les autres domaines d'intérêt, mentionnons les dispositions relatives à la capacité de pointe pendant les crises, la collaboration en matière de recherche sur les systèmes de santé publique et les partenariats entre la santé publique et le milieu universitaire pour l'éducation et la formationNote de bas de page 455 Note de bas de page 457 Note de bas de page 458. Dans ce dernier cas, le perfectionnement des étudiants et le perfectionnement professionnel pourraient être harmonisés avec les domaines de compétence prioritaires, notamment l'équité, la santé des Autochtones, les déterminants écologiques de la santé et le leadershipNote de bas de page 455.
Si le Canada veut bénéficier d'une base de données probantes exceptionnelle en santé publique, il doit donner priorité à l'échange continu de connaissances et aux ententes établies entre les organismes de santé publique et un éventail de disciplines (p. ex. sciences sociales, géographie, économie). Les collaborations interdisciplinaires sont particulièrement importantes pour comprendre les déterminants de la santé complexes, multidimensionnels et interreliés et y réagirNote de bas de page 459 Note de bas de page 460 Note de bas de page 461 Note de bas de page 462 Note de bas de page 463. Par exemple, récemment, des spécialistes des sciences sociales ont examiné les facteurs sociaux, politiques et économiques qui ont influencé la crise de la COVID-19 et l'intervention en santé publiqueNote de bas de page 464.
Élément de base 3 : Technologies médicales et numériques de pointe en santé
Un système de santé efficace est en mesure d'utiliser une gamme d'outils pour appuyer l'accès équitable aux produits médicaux, aux vaccins et aux technologies, de même que leur distribution équitableNote de bas de page 465. Cela comprend la fabrication, l'approvisionnement et l'entreposage des médicaments, des fournitures médicales et d'autres ressources essentielsNote de bas de page 465. Cela comprend également l'infrastructure, comme les laboratoires de santé publique, qui fournissent un soutien essentiel pour détecter et comprendre les menaces à la santé publique, et pour y réagir. À mesure que le système de santé publique tire des leçons des défis passés et actuels, les outils et les processus novateurs évoluent pour répondre aux besoins des populations.
Comme la société s'habitue de plus en plus aux solutions numériques, le fait d'aligner les objectifs et d'évaluer les innovations sera important pour exploiter avec succès les opportunités numériques et les avancées technologiques dans toutes les juridictionsNote de bas de page 366 Note de bas de page 466.
Renforcer les systèmes d'alerte précoce
Les systèmes d'alerte précoce permettent d'identifier les signes de menace potentiels pour la santé publique afin de soutenir une intervention rapide et d'atténuer les répercussions sur la santé publiqueNote de bas de page 239 Note de bas de page 467. Ces systèmes sont un élément clé des systèmes de surveillance plus vastes, qui s'appuient sur un certain nombre de sources, comme les médias, les réseaux sociaux et l'information sur la santé animale et les catastrophes environnementalesNote de bas de page 467. Leur fonctionnement exige une expertise adéquate, des structures et de la technologie. Un examen indépendant du système de surveillance fondé sur des événements du Canada (c.‑à‑d. le RMISP) en 2021 suggère de renforcer ces composantesNote de bas de page 239. L'expertise et les structures pourraient être améliorées en clarifiant le rôle de la surveillance fondée sur les cas, dans un cadre plus large de surveillance et d'évaluation des risques, et en améliorant la consultation ainsi que la coordination avec des experts de contenu, incluant les spécialistes de la modélisation des donnéesNote de bas de page 239. Les partenaires du milieu universitaire et du secteur privé ont également un rôle à jouer, notamment en fournissant un soutien supplémentaire pour améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle utilisés dans la surveillance fondée sur les événementsNote de bas de page 239.
Compte tenu de la nature internationale de la santé publique, aucun pays ne peut entreprendre ce travail seul. Les efforts déployés à l'échelle mondiale pour améliorer la surveillance fondée sur les événements se poursuivent, et le Canada peut continuer d'y contribuer et d'apprendre grâce à un alignement et de la collaborationNote de bas de page 239.
Soutenir l'innovation dans l'infrastructure des technologies et des approvisionnements en santé
La pandémie de la COVID-19 a réitéré le rôle crucial du dépistage dans le contrôle des éclosions de maladies infectieuses et dans l'orientation des décisions de santé publique. Par conséquent, des efforts sont nécessaires pour renforcer les capacités des laboratoires de santé publique au CanadaNote de bas de page 468. Pendant la pandémie, les laboratoires se sont rapidement adaptés pour soutenir la réponse à la COVID-19 en implantant de nouveaux protocoles de tests pour le SRAS‑CoV‑2, en augmentant leur capacité en ressources humaines et en achetant de l'équipement supplémentaire, tout cela dans le contexte d'une forte demande mondiale vis-à-vis du matériel de tests importantNote de bas de page 468 Note de bas de page 469.
Le Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO) est l'un des partenariats novateurs créés pendant la pandémie pour renforcer les capacités de séquençage un virus-hôte en soutien à la prise de décision urgente qu'implique une pandémie. Par l'entremise du RCanGéCO, le Laboratoire national de microbiologie du gouvernement du Canada, Génome Canada, des laboratoires régionaux de santé publique, des partenaires du secteur des soins de santé et des chercheurs universitaires ont travaillé ensemble pour coordonner à grande échelle le séquençage du virus et la collecte de données épidémiologiques d' échantillons de SRAS‑CoV‑2Note de bas de page 470 Note de bas de page 471. Ces efforts soutiennent un apprentissage rapide et un meilleur suivi quant à comment le virus mute et se propage, offrant ainsi des informations clés sur les tendances de transmission susceptible d'influencer la détection du virus ou l'efficacité des traitements et vaccinsNote de bas de page 471.
De plus, des chercheurs du laboratoire de santé publique du centre de contrôle des maladies de la Colombie‑Britannique, en partenariat avec des laboratoires publics et privés de la province, ont combiné le séquençage du génome à grande échelle et l'analyse épidémiologique afin de surveiller avec succès la propagation et l'évolution des variants préoccupants du virus dans les populations vaccinées et non vaccinées à l'échelle communautaireNote de bas de page 472. Cette étude a démontré la valeur d'approches novatrices, interdisciplinaires et intégrées en fournissant rapidement des données locales précises pour aider à éclairer les interventions en santé publiqueNote de bas de page 473 Note de bas de page 474. Cet exemple souligne en outre l'importance de de créer la capacité et l'infrastructure nécessaire aux analyses complexes.
La pandémie a également mis en lumière une occasion d'améliorer l'efficacité des systèmes de distribution des vaccins. Malgré un départ relativement plus lent par rapport aux pays de référence, le Canada a rapidement atteint des taux de vaccination élevés lorsque les livraisons de vaccins se sont accéléréesNote de bas de page 475 Note de bas de page 476. À l'avenir, les processus généraux d'approvisionnement en vaccins pourraient être renforcés en améliorant la coordination et la collaboration, ainsi qu'en encourageant une innovation accrue dans l'infrastructure numérique de soutien et l'intégration de la main‑d'œuvre. Les progrès numériques qui appuient le suivi de l'approvisionnement et de l'utilisation de vaccins en temps réel pourraient améliorer la précision dans la distribution et réduire au minimum le gaspillage de produitsNote de bas de page 477.
Au cours de la pandémie de la COVID-19, de nombreux pays, dont le Canada, n'étaient pas préparés adéquatement à la demande soudaine et élevée d'équipement de protection individuelle et d'appareils médicaux, y compris des écouvillons d'essai et des respirateursNote de bas de page 244. Pour déterminer les fournitures nécessaires, en autoriser l'achat et s'en approvisionner, le gouvernement du Canada a dû réviser ses méthodes d'approvisionnement existantes. Il a notamment modifié les politiques et processus d'assurance de la qualité, changé de fournisseurs et mobilisé rapidement des ressources pour les achatsNote de bas de page 244. Grâce à ces adaptations, à l'investissement national, au rééquipement et à l'achat en vrac, le Canada a pu accroître son approvisionnement en équipement de protection individuelle dans la réserve nationale et renforcer les stocks provinciaux et territoriaux de matériel médicalNote de bas de page 244. Des stratégies visant à mieux surveiller et gérer les stocks d'urgence, avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour l'ensemble des administrations, amélioreraient l'état de préparation et assureraient la pertinence et la fiabilité des approvisionnementsNote de bas de page 244.
Tirer parti des technologies numériques en santé
Un certain nombre de technologies numériques en santé ont été utilisées au Canada et à l'échelle mondiale en réponse à la pandémie de la COVID-19 (voir l'encadré « Vaccine Hunters Canada : l'innovation numérique de A à Z »). Certaines étaient des extensions d'approches existantes, comme des solutions technologiques pour contrer l'« infodémie » en ligne. Par exemple, l'alerte SOS de Google a donné la priorité à l'OMS et à d'autres sources de santé publique fiables dans les résultats de recherche, et le robot conversationnel reposant sur l'apprentissage automatique de l'OMS a été lancé sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook pour lutter contre les informations erronées et la désinformation autour de la COVID-19Note de bas de page 366Note de bas de page 478 Note de bas de page 479. D'autres étaient plus novatrices, Comme l'utilisation des données anonymes de téléphonie mobile pour comprendre l'adhésion aux mesures de santé publique locales ainsi que l'exposition aux notifications numériques (par exemple, l'application Alerte COVID)Note de bas de page 366 Note de bas de page 480 Note de bas de page 481 Note de bas de page 482. Ces progrès sont notables, car la santé publique a généralement été lente à tirer parti des innovations numériquesNote de bas de page 366. L'évaluation de ces applications, ainsi que d'autres mesures de santé publique, pourrait fournir des informations importantes susceptibles de soutenir une plus grande utilisation de ces outils. Particulièrement en soutien aux innovations technologiques liées aux changements climatiques qui sont nouvellement créées pour soutenir la santé publique, incluant Donneesclimatiques.ca et ADAPTATIONSantéNote de bas de page 483 Note de bas de page 484.
Ces initiatives numériques, mises en œuvre rapidement, requièrent une évaluation et une prise en compte adéquate des préoccupations des domaines juridique, éthique et de la confidentialitéNote de bas de page 366 Note de bas de page 481 Note de bas de page 485 Note de bas de page 486. Il importe également de porter une attention aux iniquités induites par l'utilisation des technologies, comme l'intelligence artificielle en santé publique, potentiellement problématique en raison de biais algorithmiques et manque de diversitéNote de bas de page 487 Note de bas de page 488 Note de bas de page 489. À l'avenir, il faudra également tenir compte des préoccupations relatives à l'accès inéquitable aux technologies pour que ces innovations soient significatives en santé publiqueNote de bas de page 366 Note de bas de page 466.
S'il y a lieu, les initiatives ayant bien fonctionné pourraient être intégrées aux systèmes et à l'infrastructure de santé publique en généralNote de bas de page 366 Note de bas de page 466 , comme ConnexionVaccin, qui restera un outil essentiel pour la gestion d'autres programmes de vaccination. Parmi les autres exemples, mentionnons les progrès technologiques comme les mégadonnées, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, qui pourraient appuyer le développement de systèmes d'apprentissage en santé publiqueNote de bas de page 366 Note de bas de page 426 Note de bas de page 490 Note de bas de page 491. Cette intégration aiderait à faire en sorte que les technologies demeurent un outil pour la santé publique, plutôt qu'une priorité en soiNote de bas de page 366.
Vaccine Hunters Canada : l'innovation numérique de A à Z
En mars 2021, des bénévoles engagés à aider la population canadienne à se faire vacciner contre la COVID-19 ont formé Vaccine Hunters Canada. L'organisme compte plus de 40 000 membres et des dizaines de bénévoles actifs sur de multiples plateformes de médias sociauxNote de bas de page 492.
En tirant parti d'outils numériques fondés sur l'approche participative pour connaître la disponibilité des vaccins, d'un soutien personnalisé offert par des bénévoles et des comptes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et Discord, Vaccine Hunters Canada a aidé les Canadiens et les Canadiennes partout au pays à comprendre l'admissibilité au vaccin et à trouver des rendez‑vous de vaccinationNote de bas de page 492.
En juin 2021, Vaccine Hunters Canada a lancé Trouvez votre vaccination, un nouveau site Web qui permet aux utilisateurs de trouver des rendez‑vous, en fonction de leur code postal et de leur admissibilité au vaccin, dans divers sites de vaccination. Le service était offert en 22 langues et, au moment de la rédaction du rapport, il comptait plus de 2 millions d'utilisateurs uniquesNote de bas de page 493.
Avant de passer à un soutien entièrement automatisé en août 2021, Vaccine Hunters Canada a annoncé que la plateforme de source ouverte Trouvez votre vaccination serait offerte gratuitement à tout pays, pour un usage personnalisable et multilingueNote de bas de page 494.
Élément de base 4 : Expertise de l'effectif et capacité en ressources humaines
Le système de santé publique exige un effectif en santé publique bien formé, interdisciplinaire et durable pour relever les défis et les menaces de plus en plus complexes qui affectent sur la santé des populations. La main‑d'œuvre doit posséder les compétences pour exercer les fonctions essentielles, en plus d'avoir les aptitudes qui se révèlent de plus en plus importantes pour travailler dans tous les secteurs et pour influencer les politiques publiques qui traitent des déterminants de la santéNote de bas de page 367 Note de bas de page 455 Note de bas de page 495.
Après la crise du SRAS, de nombreuses initiatives ont été élaborées pour renforcer les effectifs en santé publique et accroître l'expertise en santé publique dans toutes les organisationsNote de bas de page 253 Note de bas de page 368 Note de bas de page 369 Note de bas de page 371. Certaines initiatives se sont poursuivies, comme les programmes d'études supérieures universitaires en santé publique, tandis que d'autres ont stagné ou ont été suspenduesNote de bas de page 258 Note de bas de page 455. La pandémie de la COVID-19 a révélé le besoin continu et critique de mieux soutenir les personnes qui protègent la santé du public.
Accroître et soutenir l'effectif en santé publique
En cas d'urgence sanitaire, les systèmes de santé publique ont besoin de travailleurs ayant la formation, l'expérience et l'expertise adéquates. La pandémie de COVID-19 a amplifié l'effectif en santé publique, y compris des lacunes systémiques en matière de santé publique et d'expertise médicale, de gestion des urgences, de communication des risques, de politiques et de planification, et d'opérationsNote de bas de page 218.
La pandémie de la COVID-19 a exercé une pression supplémentaire sur les professionnels de la santé publique ayant une expertise recherchéeNote de bas de page 218 Note de bas de page 469. Par exemple, les experts en santé publique ont dit que les gestionnaires de cas, qui sont souvent des infirmières ou des infirmiers, pouvaient être retirés de leur travail en santé publique pour aider à traiter les patients lorsque le nombre de cas de la COVID-19 augmentait. De tels problèmes de capacité peuvent avoir un certain nombre de conséquences pour les systèmes de santé publique, notamment des retards dans l'analyse et la communication des résultats des tests de dépistage, des difficultés à mener la recherche des contacts, une incidence sur la qualité des produits de communication, des défis opérationnels et des difficultés à mobiliser des interventions à long termeNote de bas de page 218 Note de bas de page 243 Note de bas de page 496. Pour répondre à ces demandes concurrentes, l'effectif de la santé publique doit être soutenu par des ressources humaines suffisantes pour assurer la relève et l'interopérabilitéNote de bas de page 497.
La diversité de l'effectif est également essentielle au bon fonctionnement du système de santé publique et appuie une plus grande innovation en santé publiqueNote de bas de page 446 Note de bas de page 498 Note de bas de page 499 Note de bas de page 500. La diversité et l'inclusion peuvent être favorisées par des initiatives comme des campagnes de recrutement axées sur le personnel sous‑représenté, des programmes de mentorat professionnel, des projets visant à améliorer l'équité en milieu de travail et des processus efficaces pour signaler la discriminationNote de bas de page 498 Note de bas de page 501.
Comme on l'a constaté chez les travailleurs de la santé et dans les recherches internationales, la pandémie a eu des répercussions sur la santé mentale et le bien‑être du personnel de la santé publiqueNote de bas de page 502 Note de bas de page 503. Bien qu'il y ait des lacunes dans les recherches sur cette question au Canada, les examens gouvernementaux ont mis en évidence les longues heures de travail et le stress vécu par le personnel de la santé publique et de la gestion des urgences, ainsi que les nombreux rapports médiatiques de harcèlement et de menaces contre les responsables et les travailleurs de la santé publiqueNote de bas de page 218 Note de bas de page 504. Le roulement du personnel et l'épuisement professionnel chez les travailleurs et les experts constituent une menace très réelle à la stabilité des systèmes de santé publique et à leur capacité de répondre aux urgences sanitairesNote de bas de page 505.
Comme il a été mentionné dans les discussions avec les intervenants, ces problèmes ont été aggravés par le manque de données sur le nombre, la structure, les compétences et l'identité de personnes racisées ou autochtones chez les travailleurs dans les systèmes de santé publique, y compris l'endroit où trouver du personnel qualifié pour effectuer des tâches comme les tests de dépistage et la recherche des contactsNote de bas de page 380. En raison des différences dans l'organisation des structures de santé publique au Canada, ainsi que de l'étendue et de la profondeur de la pratique en santé publique, il est difficile de suivre et d'évaluer la nature et l'étendue de l'effectifNote de bas de page 252 Note de bas de page 258. Ces lacunes en matière d'infrastructure et de données nuisent aux efforts de planification et de préparation de la main‑d'œuvre dans les systèmes de santé publique fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipauxNote de bas de page 380 Note de bas de page 506. L'absence de données démographiques nuit également au suivi de l'effectif en santé publique par rapport aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux engagements sur le plan de l'équité en matière d'emploiNote de bas de page 380.
La capacité de l'effectif en santé publique est un domaine d'intérêt urgent compte tenu du fardeau continu de la COVID-19 sur l'effectif en santé publique et du risque toujours présent de crises simultanées en santé publique.
Renforcer les compétences essentielles et l'expertise scientifique
La santé publique est un domaine de pratique particulier, et le nombre et la variété des compétences requises soulignent l'importance d'une formation complète et d'un effectif préparé en conséquenceNote de bas de page 367. Les compétences de base englobent les connaissances, les habiletés et les attitudes interdisciplinaires essentielles à la pratique en santé publique. Les domaines de compétence actuels comprennent la science de la santé publique, l'évaluation et l'analyse des données, la planification de politiques et de programmes, la mise en œuvre et l'évaluation d'interventions, la collaboration et les partenariats, la représentation, la diversité et l'inclusivité, la communication et le leadershipNote de bas de page 367.
Les appels continus visant à clarifier et, possiblement, à élargir les compétences ou l'expertise en santé publique reflètent l'évolution de la pratique de la santé publique et les leçons tirées des urgences en santé. Par exemple, les compétences supplémentaires ou améliorées pourraient comprendre l'expérience de travail dans des systèmes gouvernementaux complexes, la collaboration pour l'action intersectorielle, l'élaboration de politiques publiques saines, l'équité sociale et raciale, les déterminants écologiques liés aux changements climatiques, la mobilisation des communautés et la santé des AutochtonesNote de bas de page 252 Note de bas de page 408 Note de bas de page 455 Note de bas de page 495 Note de bas de page 507 Note de bas de page 508 Note de bas de page 509 Note de bas de page 510 Note de bas de page 511 Note de bas de page 512 Note de bas de page 513 Note de bas de page 514 Note de bas de page 515 Note de bas de page 516 Note de bas de page 517.
Depuis le début de la pandémie, d'autres priorités ont émergé. Elles comprennent la navigation de l'information et la communication dans le contexte d'une infodémie, la lutte contre la désinformation, la communication en cas de crise, le travail dans un contexte d'incertitude, la compréhension et l'utilisation avancées des technologies de données et d'analyse, l'évaluation et la gestion des risques, l'établissement des priorités et l'affectation des ressourcesNote de bas de page 239 Note de bas de page 518 Note de bas de page 519. L'exercice d'un leadership dans toutes les disciplines et dans la sphère politique, la capacité d'adapter les communications au public cible, la connaissance de la situation et l'esprit de décision flexible sont des exemples de compétences importantes en leadershipNote de bas de page 510 Note de bas de page 520. Les compétences en gestion du risque et en prise de décisions dans des environnements complexes sont également importantes pour la pratique avancée et le leadershipNote de bas de page 455.
Élément de base 5 : Financement
Pour maintenir et améliorer la santé et le bien‑être de la population, les systèmes de santé doivent faire l'objet d'un financement suffisant Note de bas de page 465 Note de bas de page 515. Les systèmes de santé publique ont besoin de ressources non seulement pour remplir leurs fonctions essentielles, mais aussi pour travailler efficacement avec d'autres secteurs afin d'aborder les déterminants de la santé. Les ressources doivent être en nombre adéquat pour permettre aux systèmes de santé publique d'être agiles lorsque requisNote de bas de page 253. Cela est particulièrement important étant donné que les crises sanitaires émergentes et concomitantes risque d'augmenter en raison de facteurs d'influence, comme les changements climatiques et la destruction de l'habitat naturelNote de bas de page 521.
Compte tenu de l'ampleur du travail et du besoin pressant de développer une capacité de pointe dynamique, les systèmes de santé publique ont besoin de ressources stables qui leur sont entièrement dédiéesNote de bas de page 520. Cependant, : on ne sait pas exactement à quoi devrait ressembler un système financé de façon appropriée pour le Canada. Cela requiert de connaître le montant des fonds qui sont consacrés à la santé publique, ainsi que les activités et les fins auxquelles ils sont consacrés.
Investir dans le système de santé publique en fonction du mandat
Au fil des ans, malgré son vaste mandat, les dépenses du système de santé publique n'ont représenté qu'une petite portion des dépenses totales en santé. L'estimation du financement de la santé publique est ardue et plusieurs méthodes permettent de le faire. Selon une évaluation de l'Institut canadien d'information sur la santé, un peu moins de 6 % de toutes les dépenses annuelles en santé étaient affectées aux systèmes de santé publique avant la pandémie (figure 11)Note de bas de page 375. Les variations dans la façon dont ces pourcentages sont calculés rendent difficiles les comparaisons entre les juridictions. Néanmoins, on estime que le financement des activités de santé publique ne représente que 1 % de certains budgets provinciaux de la santéNote de bas de page 522 Note de bas de page 523.
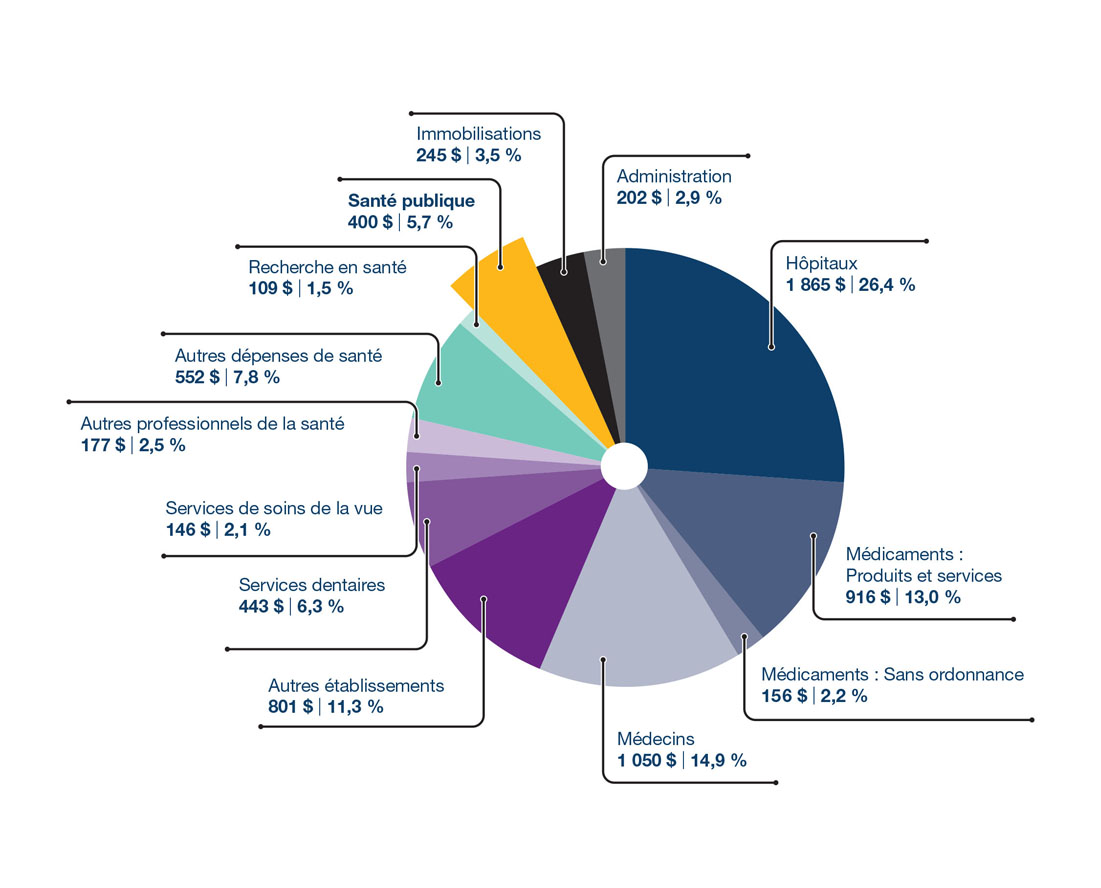
Figure 11 : Texte descriptif
La figure est un diagramme circulaire qui montre la répartition des dépenses de santé totales par habitant au Canada en 2019.
| Catégorie | Part en dollars | Pourcentage |
|---|---|---|
| Santé publique | 400 $ | 5,70 % |
| Immobilisations | 245 $ | 3,50 % |
| Administration | 202 $ | 2,90 % |
| Hôpitaux | 1 865 $ | 26,40 % |
| Médicaments : Produits et services | 916 $ | 13,00 % |
| Médicaments : Sans ordonnance | 156 $ | 2,20 % |
| Médecins | 1 050 $ | 14,90 % |
| Autres établissements | 801 $ | 11,30 % |
| Services dentaires | 443 $ | 6,30 % |
| Services de soins de la vue | 146 $ | 2,10 % |
| Autres professionnels de la santé | 177 $ | 2,50 % |
| Autres dépenses de santé | 552 $ | 7,80 % |
| Recherche en santé | 109 $ | 1,50 % |
Source : Institut canadien d'information sur la santé. Tendances des dépenses nationales de santéNote de bas de page 375.
Ces estimations présentent plusieurs problèmes méthodologiques. La diversité et l'éventail des activités menées par les systèmes de santé publique font en sorte qu'il est difficile de séparer le travail de santé publique d'autres activités des secteurs des services sociaux et des soins de santé. De plus, il n'y a pas de définition standard des activités de santé publique au paysNote de bas de page 372. Les incohérences qui en résultent entraînent des variations d'une juridiction à l'autre quant à la façon dont les dépenses de santé publique sont calculéesNote de bas de page 522. Donc, des limites claires existent dans la façon de rapporter et mesurer l'efficacité des investissements en santé publique au CanadaNote de bas de page 372 Note de bas de page 522. Ces lacunes doivent être comblées de toute urgence, mais les défis méthodologiques ne doivent pas entraver les efforts visant à doter les systèmes de santé publique du Canada des ressources financières nécessaires pour exécuter le travail essentiel de protection des populations.
Bien qu'il soit difficile de recueillir des estimations fiables, les données probantes indiquent que le financement de la santé publique au Canada pourrait être insuffisant et vulnérable aux compressions budgétaires, y compris les réductions de plusieurs budgets provinciaux de santé publique antérieursNote de bas de page 258 Note de bas de page 372 Note de bas de page 458 Note de bas de page 522 Note de bas de page 523. Ces réductions de financement se font particulièrement sentir à l'échelle localeNote de bas de page 252. Si ces tendances se maintiennent, il pourrait y avoir des coûts supplémentaires considérables en aval pour le système de santé et l'économie en généralNote de bas de page 376.
Citation : « Le danger est que nous ayons un intérêt actuel pour la santé publique, en raison de la pandémie, mais nous avons traversé plusieurs cycles. C'est la panique, puis les gens oublient la santé publique. Dès que la COVID-19 sera chose du passé, de nouvelles priorités politiques et l'arriéré de chirurgies prendront le dessus. Nous repasserons au mode “investissement dans le curatif”, mais la prévention sera de nouveau mise de côté. »
Un autre défi est que le financement a tendance à fluctuer en fonction des crises sanitaires et des cycles électoraux, alors que les objectifs et les mandats de la santé publique vont bien au‑delà de ces événementsNote de bas de page 253 Note de bas de page 458 Note de bas de page 524. Pour déterminer la meilleure façon de financer les systèmes de santé publique en fonction de sa portée et de son mandat à long terme, il faut un engagement commun à l'égard des fonctions de base de la santé publique, ainsi qu'une base de données probantes renforcée et une compréhension commune de la mise en œuvre efficace de ces fonctionsNote de bas de page 372 Note de bas de page 522.
Il est également important d'avoir des modèles de financement flexibles et des actions durables à long terme pour renforcer le système de santé publique d'une manière qui appuie l'autodétermination des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela réduirait au minimum la fragmentation des compétences et augmenterait le contrôle de la communauté sur la conception des programmes de santé et leur prestationNote de bas de page 339 Note de bas de page 525 Note de bas de page 526. En allant dans cette direction, le système de santé publique s'aligne également sur l'appel à la justice no 3.2 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinéesNote de bas de page 286.
Élément de base 6 : Gouvernance, leadership et mobilisation
Une gouvernance efficace repose sur une vision claire ainsi que sur la clarté quant aux autorités, au mandat, au rôle et aux fonctions essentielles de la santé publique. Pour que la gouvernance de la santé publique soit équitable, l'engagement envers les valeurs fondamentales que sont l'anticolonialisme, la diversité et l'inclusion, la transparence et la responsabilisation sera nécessaireNote de bas de page 379.
Une gouvernance efficace est résiliente, capable de s'adapter et fondée sur un leadership compétentNote de bas de page 379. Elle repose également sur l'action coordonnée et collective du gouvernement et d'autres acteurs, notamment sur la collaboration entre les juridictions au sein du système de santé publique, la mise en commun de l'expertise à l'échelle internationale, le soutien aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis en matière d'autodétermination et d'autonomie, les partenariats avec d'autres secteurs et le leadership communautaire aux tables de gouvernance de la santé publiqueNote de bas de page 383 Note de bas de page 393 Note de bas de page 527 Note de bas de page 528 Note de bas de page 529 Note de bas de page 530.
Renforcer la cohérence entre les systèmes de santé publique
La structure de gouvernance décentralisée du système de santé au Canada permet d'orienter les interventions en santé publique en fonction des contextes et des besoins régionaux et locaux. Cependant, la coordination, la collaboration et l'obligation de rendre compte régulièrement dans l'ensemble du système et envers les décideurs, y compris les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones, sont essentielles à l'efficacité, au caractère stratégique et à la cohérence du système de santé publique. C'est ce qu'on a constaté pendant la réponse à la COVID-19, alors que les approches pancanadiennes ont été conjuguées à des mesures souples et personnalisées aux échelons provincial et territorialNote de bas de page 14. La gouvernance complexe de la santé publique dans plusieurs administrations au Canada peut rendre difficile la compréhension des rôles et des responsabilités à différents échelons, ce qui entraîne parfois de la confusion, des incohérences et des lacunesNote de bas de page 258 Note de bas de page 372 Note de bas de page 379. La gouvernance de la santé publique et le leadership en matière d'interventions intersectorielles nécessaires pour relever des défis particuliers en santé publique (p. ex. la RAM) ajoutent à la complexitéNote de bas de page 379.
Les mécanismes de gouvernance visant à améliorer la collaboration entre les systèmes de santé publique comprennent des cadres, des stratégies ou des lois pancanadiennes. La Loi canadienne sur la santé énonce les principes, les critères et les conditions que les provinces et les territoires doivent respecter pour recevoir des fonds fédéraux pour les services de santé. La Loi assure la responsabilité de veiller à ce que les résidents admissibles du Canada aient accès à des services de santé financés par l'ÉtatNote de bas de page 531. En revanche, dans le cas de la santé publique, il n'existe pas de structure juridique officielle énonçant les responsabilités en matière de santé publique pour les résidents du Canada.
Certains ont soutenu que le fait que le système de santé publique n'ait pas de base législative nuit à l'adoption d'une approche cohérente et coordonnée de la santé publique au CanadaNote de bas de page 7. D'autres experts en santé publique ont fait remarquer que les discussions intergouvernementales sur les rôles, les objectifs et les valeurs partagées prennent des années, sans pour autant aboutir à des décisions ou à des engagements définitifsNote de bas de page 380. Par exemple, après la crise du SRAS, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé se sont entendus sur un ensemble d'objectifs de santé publique pour améliorer la santé de la population canadienne, mais cela ne s'est pas traduit par des responsabilités définiesNote de bas de page 532.
Citation : « Nous avons besoin d'un engagement soutenu, à long terme vis-à-vis l'agenda de la santé publique, et qui ne soit pas trop fluctuant. »
Sur la scène internationale, le Canada collabore depuis longtemps avec d'autres pays et des organisations multilatérales pour relever les défis mondiaux en matière de santé (voir l'encadré « Solutions mondiales aux défis mondiaux en matière de santé publique »). Les efforts de collaboration se sont intensifiés pendant la pandémie de la COVID-19, car le virus a rapidement traversé les frontières internationalesNote de bas de page 533. Cette propagation mondiale reflète la réalité des risques pour la santé publique dans le monde d'aujourd'hui et a donné à la communauté internationale un aperçu des défis à venir en matière de sécurité sanitaire mondiale. Elle a également réaffirmé la nécessité de renforcer ces efforts de collaboration et de regarder au‑delà des frontières lors de la planification et de l'intervention en cas d'urgence mondialeNote de bas de page 534. L'échange d'information sur la recherche, les connaissances et les expériences aide également le système de santé mondial à apprendre plus rapidement et à réagir plus intelligemmentNote de bas de page 535.
Solutions mondiales aux défis mondiaux en matière de santé publique
Règlement sanitaire international
Après la crise du SRAS, la communauté mondiale de la santé s'est réunie pour renforcer les systèmes de coopération. En 2005, l'OMS et ses États membres ont adopté un nouveau Règlement sanitaire international qui décrit en détail les responsabilités de chaque pays vis‑à‑vis la loi lors d'événements majeurs de santé publique, ainsi que les systèmes de responsabilisationNote de bas de page 536. En 2007, le Règlement sanitaire international est entré en vigueur, exigeant des pays signataires qu'ils renforcent et maintiennent leur capacité de détecter, d'évaluer et de signaler les événements de santé publique, et d'intervenir en cas de tels événementsNote de bas de page 536. Le Règlement met l'accent sur la surveillance, les dispositions à ce sujet étant en partie éclairées par l'utilisation du RMISP pendant l'éclosion du SRAS en 2003Note de bas de page 239. La structure et les résultats du RMISP ont été utilisés par plusieurs pays pour orienter l'expansion de leurs propres systèmes de surveillance fondés sur les événementsNote de bas de page 537. L'examen de ces processus et leur adaptation pour intégrer les leçons tirées de la pandémie de la COVID-19 aideront à assurer une meilleure préparation à l'échelle nationale et internationaleNote de bas de page 534.
Centre de l'OMS pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies
En 2021, l'OMS a lancé une initiative fondée sur une approche visionnaire dans le but de favoriser la coopération mondiale et les solutions communes pour faire face aux risques de pandémie. Cette initiative, le Centre de l'OMS pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies, tire parti du rôle unique de rassembleur de l'OMS pour réunir l'expertise et les ressources de près de 200 États membresNote de bas de page 538. Financé par le gouvernement de l'Allemagne, le Centre utilisera une approche de collecte de renseignements axée sur la collaboration pour améliorer les données et les analyses et appuyer la prise de décisions liées aux pandémies. Le Centre mettra en place une structure de confiance pour soutenir l'échange des données et des connaissances à l'échelle internationale et favoriser les liens entre les intervenants des milieux de la politique, de la politique publique, de la science et de la société civile. Les chercheurs, le gouvernement et les partenaires privés seront encouragés à créer des bases de données partagées, en utilisant des données sur la santé publique, la société, les comportements, les médias, la mobilité, les voyages et l'environnement. Cette approche innovante rassemblera des chercheurs pour mener des recherches intensives sur des questions précises, en utilisant une technologie de pointe et des collaborations multidisciplinaires pour aider les pays du monde entier à détecter, à évaluer et à réagir aux épidémiesNote de bas de page 538 Note de bas de page 539 Note de bas de page 540.
Honorer l'autodétermination et la gouvernance des Autochtones dans le système de santé publique
La gouvernance de la santé publique doit mettre l'accent sur l'autodétermination des Autochtones et la réconciliation. La réconciliation est le processus continu d'établissement de relations mutuellement respectueuses entre les populations autochtones et non autochtones du Canada, fondées sur la vérité, la justice et la guérisonNote de bas de page 287. Pour ce faire, il faut prendre conscience du passé et le reconnaître, réparer les torts causés par la colonisation, prendre des mesures concrètes pour changer la société et se réconcilier avec le monde naturelNote de bas de page 287. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu que l'autodétermination est une condition préalable à la réconciliation (voir l'encadré « Le droit à l'autodétermination »)Note de bas de page 288.
Le droit à l'autodétermination
Le droit à l'autodétermination est clairement reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), laquelle énonce ce qui suitNote de bas de page 541 : « Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions »Note de bas de page 541. Toutefois, ces principes n'ont pas toujours été appliqués au CanadaNote de bas de page 339.
Les décisions judiciaires rendues au cours des dernières décennies, y compris le principe de Jordan et l'arrêt Daniels, visent à combler ces lacunesNote de bas de page 541. De plus, le projet de loi C‑15 (juin 2021) vise à amorcer le processus d'harmonisation du droit canadien avec la DNUDPANote de bas de page 542. Cette loi fournit au gouvernement fédéral et aux peuples autochtones une feuille de route pour travailler ensemble à la mise en œuvre de la Déclaration, y compris l'autodétermination.
L'autodétermination est un déterminant important de la santé et du bien‑être des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et elle est essentielle pour combler les écarts en matière de santé entre les populations autochtones et non autochtonesNote de bas de page 288. Les modèles d'autodétermination en matière de santé peuvent varier d'un bout à l'autre du Canada, en fonction de la diversité des besoins, des expériences et des intérêts exprimés par différentes nations et communautésNote de bas de page 339.
L'autodétermination liée à la santé consiste à veiller à ce que les populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis puissent concevoir, offrir et gérer leurs propres programmes et services de santé grâce à l'autonomie gouvernementale des Autochtones et à des ententes de soutien financierNote de bas de page 339. Elle exige également l'inclusion égale des populations autochtones dans l'élaboration de politiques et la prise de décisions en matière de santé afin de veiller à ce que les politiques des organismes et des gouvernements non autochtones ne minent pas l'autodéterminationNote de bas de page 329.
Aucun modèle de gouvernance unique ne fonctionnera dans toutes les communautés autochtones, et les gouvernements à tous les ordres ont la responsabilité d'appuyer les processus d'autodéterminationNote de bas de page 339. La Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie‑Britannique, dirigée et gérée par les Autochtones, est un exemple de réforme qui accorde la priorité à l'autodétermination (voir l'encadré « Cadre d'intervention COVID-19 des communautés rurales et éloignées et des Premières nations du nord de la Colombie-Britannique »)Note de bas de page 543 Note de bas de page 544.
Cadre d'intervention contre la COVID-19 des communautés rurales et éloignées du Nord de la Colombie‑Britannique et des Premières Nations
Le cadre d'intervention contre la COVID-19 des communautés rurales et éloignées du Nord de la Colombie-Britannique et des Premières Nations (juin 2020) répond à une demande du ministre de la Santé de la Colombie-Britannique d'élaborer les processus nécessaires à la planification et à la prestation des services de dépistage, des protocoles cliniques, du transport des patients, et d'autres outils en réponse à la pandémie de la COVID-19.
Le cadre a été élaboré conjointement par des dirigeants et des représentants de la Régie de la santé du Nord, de la Régie de la santé des Premières Nations (province et région du Nord), des communautés des Premières Nations, des communautés locales rurales et éloignées et de la Régie provinciale des services de santé. Le cadre respecte les réalités uniques des communautés nordiques, rurales, éloignées, des Premières Nations et des Métis et de leurs citoyens et fait aussi appel à la flexibilité et au partenariat dans la mise en œuvre du travail.
Cette initiative a commencé sous la forme d'un groupe de dirigeants engagés, de professionnels et de membres des communautés, qui se sont réunis virtuellement et en personne, pour travailler ensemble à la production du cadre qui servira plus tard à éclairer le cadre d'intervention contre la COVID-19 des communautés rurales, éloignées, autochtones et des Premières Nations de la Colombie‑Britannique.Mais, il est également devenu un lieu de transformation. L'approfondissement des liens entre les partenaires grâce à des objectifs communs et au travail collectif pour le Nord a redéfini leurs façons de travailler ensemble. Un tel changement relationnel permet un changement de système et un avenir meilleur pour tous.
Nous remercions les auteurs de leur contribution :
Margo Greenwood, Ph. D., responsable universitaire, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, chef universitaire, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; vice‑présidente, Santé autochtone, régie de la santé du Nord, et professeure, Études des Premières Nations, Université du Nord de la Colombie‑Britannique
Dre Shannon McDonald, médecin hygiéniste en chef par intérim, Régie de la santé des Premières Nations, Colombie‑Britannique
Nicole Cross, directrice générale, Santé des Autochtones, ministère de la Santé, Colombie‑Britannique
Assurer l'action et la collaboration multisectorielles
La pandémie de la COVID-19 a donné lieu à des appels renouvelés à une action pangouvernementale et intersectorielle sur les conditions sociales, structurelles et environnementales qui mènent à une mauvaise santé. Cette action nécessite des modèles de gouvernance audacieux et exhaustifs. L'approche la plus connue qui peut répondre à ce besoin est celle de la Santé dans toutes les politiques (voir l'encadré « Adopter une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques au Canada : Deux exemples » ). En tant que mécanisme de systématisation de la gouvernance intersectorielle, cette approche a pour objet la prise en considération de la santé et du bien‑être les décisions stratégiques, et ce, dans tous les secteurs qui influencent les déterminants sociaux de la santéNote de bas de page 394 Note de bas de page 545. Elle peut également comprendre la mobilisation des intervenants ou de l'industrie.
Un exemple international digne de mention est l'approche axée sur la Santé dans toutes les politiques adoptée par le gouvernement de l'Australie‑Méridionale en 2007, qui établit des liens intersectoriels dans l'ensemble du gouvernement au profit des secteurs de la santé et des partenariatsNote de bas de page 546. Une évaluation quinquennale de cette approche a révélé que le fait d'accorder la priorité aux mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé a mené à des mesures et à des processus qui peuvent contribuer à l'amélioration globale de la santé de la population dans l'ensemble des secteursNote de bas de page 394.
Adopter une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques au Canada : Deux exemples
La Santé dans toutes les politiques est « une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en matière de santé »Note de bas de page 547.
Terre‑Neuve‑et‑Labrador
Le plan stratégique « The Way Forward (en anglais seulement) » du gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador comprend des mesures stratégiques visant à atteindre 4 objectifs, soit un secteur public plus efficace, des assises économiques plus solides, de meilleurs services et de meilleurs résultats en matière de santéNote de bas de page 548. La Protection and Promotion of Public Health Act (loi sur la protection et la promotion de la santé publique) (2018) a été présentée dans le cadre de ce plan pour aider le gouvernement provincial à réagir plus efficacement aux défis émergents et aux urgences en matière de santé publique.
Cette loi repose sur une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques. Elle permet au gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador de tenir compte des répercussions sur la santé dans ses décisions stratégiques et de prendre des décisions axées sur des améliorations mesurables de l'état de santé. Cela vise à améliorer les déterminants de la santé de la population (c.‑à‑d. l'emploi, l'éducation, la prévention du crime) et à réduire les coûts des soins de santé à long terme.
Québec
Le Québec a élaboré une série de programmes, de lois, de plans d'action, de politiques et d'autres outils servant de leviers pour une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques. Bien que cette approche ne soit pas explicitement énoncée comme stratégie dans la législation québécoise, la Loi sur la santé publique est assortie d'un mandat juridique et de ressources pour appuyer les évaluations des incidences sur la santé (EIS). Elle fait également du ministre de la Santé et des Services sociaux un « conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique » et stipule que chaque ministère doit évaluer l'impact de ses actions sur la santé. Si cet impact est jugé important, le ministère doit consulter les services de santé et les services sociauxNote de bas de page 398 Note de bas de page 549.
La décision de la région de la Montérégie d'inclure l'obligation d'effectuer une EIS dans le Plan d'action régional en matière de santé publique de 2011 pour appuyer les décideurs municipaux est un exemple de cette approche en action. La responsabilité de mener une EIS a été assumée par un professionnel à temps plein de la Direction de la santé publique qui a collaboré avec de nombreux organismes gouvernementaux.
Dans l'élaboration d'une approche axée sur la Santé dans toutes les politiques, des mesures de l'équité en santé peuvent être utilisées pour soutenir la gouvernance entre les secteurs, représenter les déterminants prioritaires de la santé et mettre en évidence les lacunes à combler en matière d'équité en santé. Avant la pandémie, des initiatives canadiennes visant à mesurer et à analyser l'équité en santé étaient en cours. L'Initiative pancanadienne sur les iniquités en santé est la première tentative pancanadienne visant à documenter les principales iniquités en santéNote de bas de page 550. Cet effort de collaboration produit le rapport sur Les principales inégalités en santé au Canada et l'Outil de données sur les iniquités en santé comportant 70 indicateurs des résultats en matière de santé et des déterminants sociaux de la santéNote de bas de page 84 Note de bas de page 551.
D'autres administrations dans le monde ont intégré des mesures de l'équité en santé dans leurs structures décisionnelles. Reconnaissant que le Grand Manchester avait des taux de mortalité plus élevés que d'autres régions de l'Angleterre avant la pandémie, la région a placé l'équité en santé au cœur de ses décisions à l'aide des indicateurs de MarmotNote de bas de page 552. Publiés à l'origine en 2011, les indicateurs de Marmot ont été révisés en 2014 par l'Institute of Health Equity du University College of London, en collaboration avec Public Health England, afin d'aider les autorités locales à mesurer et à comprendre les iniquités sociales et en matière de santé ainsi que les déterminants sociaux de la santéNote de bas de page 553. La région a ensuite utilisé ces indicateurs pour élaborer une feuille de route pour « se reconstruire de façon plus équitable (PDF, en anglais seulement) » après la pandémie, afin de réduire les iniquités sur les plans sanitaire, économique, social, environnemental et culturelNote de bas de page 554. Les indicateurs sont axés sur 6 thèmes, à savoir la petite enfance, les enfants et les jeunes; le travail et l'emploi; le revenu, la pauvreté et l'endettement; le logement, les transports et l'environnement; les communautés et le lieu; et la santé publiqueNote de bas de page 552 Note de bas de page 555 Note de bas de page 556.
Partie 3. Une vision pour transformer la santé publique au Canada
Il est clair que, maintenant plus que jamais, une transformation du système de santé publique du Canada s'impose pour aider les Canadiens et les Canadiennes à atteindre une santé optimale et à se protéger contre les crises actuelles et futures en matière de santé.
La présente section décrit une vision pour ce système transformé, une vision qui se repose sur des données probantes et des connaissances tirées de documents examinés par des pairs, d'examens fondamentaux et de discussions entre les professionnels de la santé publique, les dirigeants communautaires et d'autres experts qui veillent au bon fonctionnement des systèmes de santé publique du Canada.
Le travail nécessaire à la réalisation de cette vision ne peut être accompli par une seule personne ou un seul organisme; il nécessite plutôt un apprentissage collectif et une culture de l'excellence entre les systèmes.
Concrétiser la raison d'être du système de santé publique
Tel qu'il est décrit dans la section 2, le système de santé publique a pour objectif d'optimiser la santé et le bien-être de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Il s'agit également là de la vision qui sous-tend la transformation du système. La figure 12 illustre les éléments vers un système de santé publique qui est équipé et soutenu pour atteindre son objectif et réaliser les objectifs.
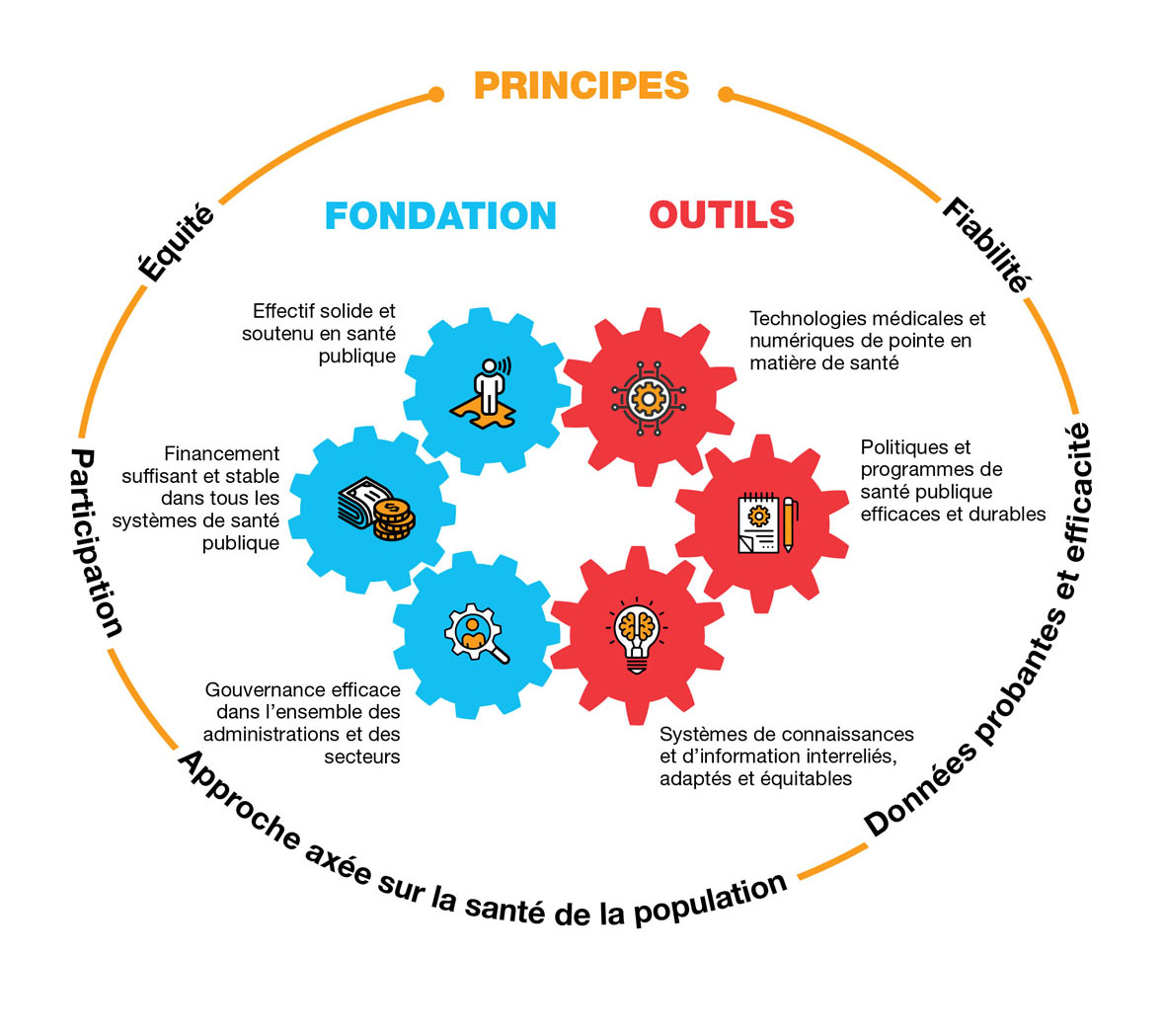
Figure 12 : Texte descriptif
La figure décrit les éléments requis pour un système de santé publique de calibre mondial afin d'optimiser la santé et le bien-être de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes.
Les éléments d'un système de santé publique de calibre mondial sont présentés en 3 catégories.
- Fondements du système de santé publique, présenté comme des mécanismes interconnectés :
- effectif solide et soutenu en santé publique;
- stabilité financière favorisant la santé de la population;
- gouvernance efficace dans l'ensemble des administrations et des secteurs.
- Outils du système de santé publique, présentés sous forme d'éléments interconnectés :
- technologies médicales et numériques de pointe en matière de santé;
- politiques et programmes de santé publique efficaces et durables;
- systèmes de connaissances et d'information interreliés, adaptés et équitables.
- Principes :
- les principes du système de santé publique entourent les fondements et les outils. Ils sont : fiables, fondés sur des données probantes et efficaces, approche axée sur la santé de la population, participatifs et axés sur l'équité.
Principes directeurs
Les principes directeurs mettent en lumière les valeurs générales qui orientent le travail des systèmes de santé publique. Ils peuvent aider à orienter les efforts collectifs des personnes, des organisations et des institutions qui composent les systèmes de santé publique au Canada au fil de la transformation (tableau 5).
| Principe | Objectif | En pratique |
|---|---|---|
| Fiabilité | Gagner la confiance des citoyens par la réflexion continue et la transparence | Un système de santé publique crédible et digne de confiance se traduit par de meilleurs résultats pour la santé. Les mesures qui favorisent la confiance exigent une communication ouverte et claire, des partenariats équitables, la responsabilisation et la transparence. Un système de santé publique digne de confiance permet d'éviter les conséquences imprévues qui pourraient compromettre la confiance. L'importance de la confiance a été soulignée dans les réponses nationales à la COVID-19Note de bas de page 557. |
| Données probantes et efficacité | Valoriser des systèmes de connaissances et de données probantes inclusifs, diversifiés et de grande qualité afin de prendre les meilleures décisions pour la santé des populations | L'efficacité fait référence aux politiques et aux programmes qui atteignent leur impact potentiel dans des conditions réellesNote de bas de page 558. C'est la capacité de la santé publique d'apporter des changements positifs pour améliorer la santé de la population, dans un large éventail de contextes, tout en favorisant des résultats équitablesNote de bas de page 559. L'efficacité en santé publique comprend l'innovation, le partenariat, la mobilisation et la prise de décisions fondées sur des données probantes, la traduction des données scientifiques en action, la surveillance et l'évaluation, et le soutien de la rechercheNote de bas de page 559 Note de bas de page 560. |
| Approche axée sur la santé de la population | Stimuler l'action intersectorielle afin d'améliorer la santé de toutes les populations et de réduire les iniquités entre les collectivités | Les interventions se situent au niveau de la population, plutôt qu'au niveau individuelNote de bas de page 561. L'emphase est mise sur l'amélioration de la santé et la réduction des iniquités en santé entre les populations. Cette approche exige une action intersectorielle et la reconnaissance du fait qu'une bonne santé est un objectif et une responsabilité partagés entre de nombreux secteurs, organisations et acteursNote de bas de page 253. |
| Participation | Intégrer harmonieusement la participation communautaire et citoyenne et la co-création dans la pratique et les interventions en matière de santé publique | La participation du public éclaire les mesures de santé publique et mobilise les personnes et les collectivités autour des enjeux qui sont importants pour leurs expériences. Le renforcement de la participation communautaire au sein des systèmes de santé publique à travers les réseaux et les différentes échelles peut être réalisé par une collaboration cohérente, en assurant des responsabilités claires, et en plaçant l'autodétermination de la communauté au centre des processus d'engagement, de coproduction et de gouvernanceNote de bas de page 385. |
| Équité | Accorder la priorité à l'inclusion et à la diversité des voix aux tables de décision tout en s'efforçant d'assurer la réconciliation | Les mesures sont conçues et mises en œuvre pour remédier aux iniquités souvent de longue date qui ont un impact sur la santé des populations. Cela nécessite un programme ambitieux qui comprend des investissements sociaux, des actions intersectorielles et intergouvernementales et un leadership accru au sein du secteur de la santé et au-delàNote de bas de page 290. Il faut accorder une attention particulière à la décolonisation de la santé publique. |
Les fondements et les outils pour un système de santé publique plus fort
Conjugués avec les principes comme guides, les éléments de base décrits dans la partie 2 offrent un cadre pour articuler les éléments qui constituent les fondements et les outils d'un système plus fort et plus résilient (tableau 6). Bien que bon nombre de ces idées ne soient pas nouvelles, lorsqu'elles sont avancées ensemble, elles peuvent conduire à un véritable changement de culture, qui met la santé de la population au premier plan et élève le bien-être au rang de priorité fondamentale.
Ces éléments ambitieux mais nécessaires ne sont pas les seuls aspects auxquels il faut prêter attention. Cette liste est destinée à servir de point de départ à des discussions, des réflexions et des actions plus générales.
| Outils |
|---|
| Élément de base 1 : Politiques et programmes de santé publique efficaces et durables |
|
| Élément de base 2 : Systèmes de connaissances et d'information reliés, adaptés et équitables |
|
| Élément de base 3 : Technologies médicales et numériques de pointe en matière de santé |
|
| Fondements |
| Élément de base 4 : Effectif solide et soutenu en santé publique |
|
| Élément de base 5 : Stabilité financière pour assurer la santé de la population |
|
| Élément de base 6 : Gouvernance efficace dans l'ensemble des administrations et des secteurs |
|
La voie à suivre
La COVID-19 a mis à l'épreuve les systèmes de santé publique au Canada et dans le monde entier. Elle a amplifié les faiblesses connues, révélé de nouveaux défis et mis en évidence la nécessité de faire preuve de résilience. Alors que nous continuons d'être exposés à des menaces changeantes et croissantes pour la santé humaine, comme les changements climatiques, la crise de la surdose des opioïdes, la résistance aux antimicrobiens ou le fardeau des maladies non contagieuses, nous devons nous assurer que nos systèmes de santé publique sont mieux équipés pour relever ces défis complexes. Autrement dit, nous n'étions pas adéquatement préparés à faire face à une urgence de l'ampleur de la COVID-19. Nous devons faire mieux à l'avenir.
La pandémie a révélé l'importance du rôle de la santé publique pour la prévention des maladies, la promotion de bonnes habitudes de vie et le travail en amont dans tous les secteurs pour s'agir sur les facteurs d'une moins bonne santé. Elle a démontré comment la santé publique peut assurer la stabilité au sein du système de santé en empêchant les personnes de tomber malades et les hôpitaux d'être débordés. Elle a également démontré que lorsque nous travaillons à améliorer les conditions de vie et le bien-être des personnes en contexte de vulnérabilité, nous sommes collectivement plus en sécurité et en meilleure santé. Lorsque les enfants sont en santé, ils apprennent mieux. Lorsque les employés sont en bonne santé, ils sont plus susceptibles d'obtenir et de conserver un emploi. Les investissements dans la santé publique sont donc des investissements pour une société plus en santé.
De nombreux appels ont été lancés en faveur d'une réforme du système de santé publique, tant dans le passé que dans le cadre de la réponse à la COVID-19, mais il y a des signes pressants qui indiquent qu'il faut agir maintenant. Alors que le Canada se rétablit graduellement de la pandémie, les lourdes exigences imposées au système de soins de santé menacent d'éclipser le besoin tout aussi crucial de renforcer le système de santé publique. Comme la pandémie de la COVID-19 l'a montré, les 2 systèmes doivent être suffisamment soutenus pour que le Canada ait un système de santé fiable et adapté pour répondre aux besoins de sa population.
Nous avons maintenant une occasion importante de commencer notre parcours de transformation. Un parcours qui vise à mettre en place un système de santé plus durable et une société plus équitable.
Domaines d'action prioritaires pour le renouvellement du système de santé publique
La pandémie a démontré la nécessité d'un système de santé publique fort et agile, capable d'innover et de s'adapter aux enjeux et aux défis actuels et émergents. À mesure que l'urgence de la pandémie s'atténuera, il y aura des possibilités de transformation dans les systèmes de santé, les systèmes sociaux et les systèmes économiques. Garantir un système de santé publique de calibre mondial axé sur l'équité, digne de confiance, participatif et efficace est la meilleure manière pour le Canada de contrer les menaces futures à la santé publique.
En se basant sur les éléments énoncés à la section 3, ce plan d'action propose 4 domaines d'action prioritaires, ainsi qu'une série d'« idées réalisables » pour stimuler la transformation du système. La transformation exigera un engagement et des investissements soutenus. Il faudra aussi que la santé publique adopte une culture d'apprentissage continu, qu'elle soit à la fine pointe de l'innovation et qu'elle établisse des liens solides entre les communautés et les secteurs, tant au niveau local qu'avec nos partenaires mondiaux.
En résumé, la transformation nécessitera de :
- favoriser l'excellence de la main-d'œuvre en santé publique;
- améliorer nos outils;
- moderniser nos modèles de gouvernance;
- assurer un financement stable et constant.
Favoriser l'excellence de la main-d'œuvre en santé publique
La pandémie a imposé des exigences sans précédent aux travailleurs de la santé du Canada, y compris ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique. Bon nombre d'entre eux travaillent jour et nuit depuis près de 2 ans. Nos professionnels de la santé publique sont très bien formés pour garder les populations en santé et les protéger contre les blessures et les menaces de maladie, mais les signalements d'épuisement professionnel augmentent et les ressources sont à bout de souffle.
Investir dans la main-d'œuvre en santé publique exige une attention urgente, compte tenu du fardeau continu de la COVID-19 sur les praticiens de la santé publique et du risque présent de crises en santé publique. L'objectif est de recruter et de maintenir en poste un effectif qui possède une expertise approfondie en santé publique et la capacité de travailler dans de nombreuses disciplines connexes, y compris dans les domaines de la science des données, de la science du comportement, de l'économie, de la sociologie et même de l'ingénierie, afin d'élaborer et de mettre à la portée des solutions novatrices.
Pour commencer, nous devons mettre à jour nos compétences en santé publique pour nous assurer que notre effectif possède la diversité des compétences dont il a besoin pour relever les défis complexes de santé publique actuels. Il est essentiel, mais insuffisant, de veiller à ce que le personnel ait une base solide dans les fonctions essentielles de la santé publique (c.‑à‑d. la surveillance, l'évaluation de la santé, la promotion et la protection de la santé, la préparation et l'intervention en cas d'urgence, ainsi que la prévention des maladies et des blessures). Les praticiens de la santé publique doivent également avoir la capacité de travailler dans l'ensemble des secteurs et des collectivités, d'interpréter efficacement les données et de communiquer des données scientifiques en évolution rapide à l'ère de l'information.
Il est important de souligner que l'effectif de la santé publique doit donner l'exemple et démontrer le pouvoir de ce qu'un effectif inclusif et diversifié peut faire. Lorsque tous les niveaux de dotation d'une organisation représentent les collectivités qu'ils servent, ils sont mieux en mesure de répondre à leurs besoins et de réduire la stigmatisation dans les politiques et les services. Cela est particulièrement important dans le domaine de la santé publique, qui vise à réduire les iniquités qui mènent à une moins bonne santé.
Enfin, la planification de la main-d'œuvre doit être axée sur l'avenir. Cela comprend le développement des générations actuelles et futures de professionnels de la santé publique, grâce à des partenariats avec des établissements d'enseignement et des organisations non gouvernementales, comme la Croix-Rouge canadienne, afin de mobiliser rapidement des ressources supplémentaires en cas d'urgence. La transition et la planification de la continuité sont également importantes. Le succès de la santé publique repose sur l'établissement de liens solides à l'intérieur et à l'extérieur du secteur. Le taux élevé de roulement et d'attrition des employés entraîne non seulement une perte de connaissances et d'expérience, mais signifie également que les organisations doivent recommencer à établir ces liens. En accordant la priorité à l'apprentissage et au perfectionnement, en favorisant l'excellence au sein du personnel et en améliorant la planification des ressources humaines, les établissements de santé publique peuvent attirer de nouveaux talents pour mieux répondre aux demandes futures.
Idées réalisables pour favoriser l'excellence de la main-d'œuvre en santé publique
- Moderniser les compétences en santé publique pour qu'elles correspondent aux exigences actuelles de la pratique en santé publique. Cela comprend la capacité de concevoir conjointement des initiatives dans les collectivités, les disciplines et les secteurs; d'assurer la communication des risques pour lutter contre la mésinformation et la désinformation; de traduire la science en options stratégiques; et d'intégrer la sécurité culturelle et l'humilité culturelle dans les politiques et les pratiques de santé publique.
- Renforcer la capacité de pointe pour accroître la réactivité et la souplesse du système. Cela comprend les ententes permanentes avec les universités et les organisations non gouvernementales, le maintien de listes d'experts en santé publique et les réseaux communautaires qui peuvent mobiliser les capacités locales.
- Soutenir la formation et l'apprentissage dynamiques en cours d'emploi pour les étudiants et les professionnels en santé publique. Cela comprend des nominations et des échanges conjoints entre les établissements d'enseignement et de santé publique, l'examen des programmes d'études universitaires et l'expansion de programmes de formation efficaces, comme le programme canadien d'épidémiologie de terrain et le programme des agents de santé publique, et le soutien à l'élaboration d'un programme de formation autochtone en épidémiologie de terrain.
Améliorer nos outils
Plus de données et de meilleures données
De bonnes données et de bons renseignements sont essentiels pour comprendre les tendances des maladies, des blessures et des préjudices, et la meilleure façon de cibler les interventions en santé publique. Au cours d'une pandémie, il est essentiel d'avoir la bonne information au bon moment pour comprendre comment les maladies se propagent, pour identifier les personnes vulnérables et pour prévoir les scénarios futurs afin d'orienter les mesures de santé publique.
Il ne fait aucun doute que notre réponse à la pandémie était limitée, en partie, en raison de lacunes importantes dans nos systèmes de données et de surveillance de la santé publique. Cela comprend un manque de données sur la race et l'origine ethnique, un manque de données comparables entre les provinces et les territoires et des lacunes d'information au niveau local. Ces lacunes de notre système ne sont pas nouvelles. Au cours des 40 dernières années, les examens de la santé publique ont fait ressortir la nécessité de renforcer nos systèmes de surveillance. De nos jours, il est inacceptable que la santé publique ne dispose pas de l'information dont elle a besoin à tous les niveaux pour surveiller les problèmes de santé publique et cibler efficacement les efforts d'intervention.
Un écosystème de données pancanadien interopérable, équitable et éthique
Au Canada, nous travaillons encore avec de multiples systèmes de données indépendants qui ne sont pas interreliés. Par conséquent, les données sont fragmentées entre les juridictions, les organisations gouvernementales et les collectivités. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour améliorer le partage et la comparabilité des données, afin de fournir aux décideurs les renseignements dont ils ont besoin pour éclairer les politiques et les programmes, et d'assurer une plus grande transparence pour les Canadiens et Canadiennes sur la santé de leurs collectivités.
Une étape clé consistera à établir un système interopérable qui facilite le couplage et la mise en commun de données provenant de diverses sources, y compris des données épidémiologiques, cliniques et administratives. Cela pourrait fonctionner comme un réseau coopératif, avec des normes claires pour s'assurer que les données sont traitées de façon sécuritaire et culturellement sécuritaire. Au cœur de ce système, nous devons établir des priorités et intégrer l'équité, y compris un engagement à recueillir des données désagrégées, à favoriser la collaboration communautaire et à assurer l'accès aux données d'une manière respectueuse de la confidentialité. Un tel système doit respecter les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour que les collectivités puissent posséder, partager et contrôler leurs propres données.
De meilleurs renseignements
Afin de transformer les données en renseignements exploitables, la santé publique a besoin de bons outils d'analyse. Cela comprend la modélisation prédictive de pointe pour prévoir les tendances des maladies et de tirer profit de la technologie, comme l'intelligence artificielle, pour détecter les signaux d'alerte précoce d'une nouvelle menace pour la santé publique.
Pour être efficace, l'alerte rapide, la prévision et la surveillance des urgences sanitaires exigent une collaboration plus étroite avec les experts universitaires et du secteur privé, ainsi qu'avec nos partenaires internationaux, afin de renforcer et de combiner l'analyse humaine et l'apprentissage informatique au sujet des menaces émergentes. Comme nous l'avons appris lors de la pandémie, nos systèmes d'alerte rapide doivent être bien intégrés aux structures décisionnelles du gouvernement et comprendre des processus d'évaluation des risques renforcés qui sont coordonnés entre les juridictions.
Accélérer l'application des connaissances
Nous devons poursuivre notre travail pour trouver des moyens novateurs de combler l'écart entre la production de connaissances, les politiques et la pratique. La pandémie a mis en évidence la nécessité de produire et de synthétiser rapidement les nouvelles recherches sur la COVID-19 afin d'éclairer les mesures de santé publique. Des initiatives novatrices, comme les réseaux COVID-END et CanCOVID, créés pour examiner et synthétiser les recherches en cours, ainsi que le réseau de modélisation de la COVID-19 et le réseau canadien de génomique COVID-19, peuvent servir de modèles pour l'avenir en reliant les dirigeants de la santé publique, les scientifiques universitaires et les gouvernements de tout le pays. Les Centres de collaboration nationale en santé publique servent de centre de connaissances pour les politiques et les pratiques à l'échelle du Canada. À l'avenir, nous devons trouver des moyens plus efficaces de mobiliser le travail des centres d'application des connaissances, tant au sein de la communauté de la santé publique qu'avec les partenaires et les intervenants d'autres secteurs qui ont une influence sur la santé de la population.
Lorsque les données probantes évoluent rapidement, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de services ont besoin de conseils clairs, opportuns et culturellement sûrs sur la meilleure façon de prévenir la propagation de l'infection et de traiter les patients infectés le plus efficacement possible. Bien qu'il existe des comités d'experts indépendants bien établis, comme le Comité consultatif national de l'immunisation, qui ont fourni des conseils aux responsables de la santé publique avant et pendant la pandémie de COVID-19, il n'y a pas de mécanisme pour mettre à jour régulièrement les lignes directrices sur la gestion clinique à l'échelle nationale. À l'avenir, nous devons veiller à ce que les bons organismes consultatifs soient en place, y compris les capacités pour élaborer rapidement une gamme de directives techniques pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies infectieuses émergentes.
Un programme de recherche en santé publique plus solide
La santé publique est un domaine scientifique qui est fier de travailler à partir des meilleures données probantes disponibles, mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les politiques et les pratiques en matière de santé publique au Canada et dans le monde entier. Par exemple, il faut effectuer plus de recherches sur la gouvernance de la santé publique, les modèles d'organisation et les normes afin de tirer parti de notre compréhension des modèles qui fonctionnent le mieux pour améliorer la santé et réduire les iniquités.
Nous avons également besoin de plus de recherches interdisciplinaires pour mesurer l'impact des mesures en amont sur les résultats en matière de santé. On dit souvent que le Canada est un pays de projets pilotes, et que différentes interventions sont mises à l'essai dans différentes régions du pays pour agir sur les problèmes de santé publique ou les facteurs sociaux qui ont un impact sur la santé, comme la précarité d'emploi, les méfaits liés à la consommation d'opioïdes. En collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada et d'autres partenaires, nous avons besoin d'un programme de recherche pour évaluer de façon plus systématique l'efficacité et la durabilité des interventions locales afin de déterminer, mettre à place et diffuser les pratiques exemplaires en partenariat avec les collectivités.
Une base de connaissances plus inclusive
Enfin, nous devons revoir notre base de connaissances en santé publique et en élargir la portée. Par exemple, les concepts traditionnels autochtones de santé et de bien-être sont de nature holistique et relationnelle, établissant un lien entre la santé individuelle, la santé collectivité et la richesse de la culture. Historiquement, le savoir autochtone, comme les histoires orales, les récits et la participation de la collectivité, est souvent ignoré ou sous-évalué. Les collaborations qui comprennent et valorisent le savoir des Premières Nations, des Inuits et des Métis peuvent enrichir la science et la pratique de la santé publique au Canada et mener à des services novateurs qui répondent mieux aux besoins des collectivités.
Améliorer notre réserve de solutions biomédicales
La COVID-19 a souligné la nécessité de travailler avec des partenaires nationaux et mondiaux pour entreprendre des recherches, accroître la production et éliminer les obstacles à un accès équitable aux vaccins, aux diagnostics et aux produits thérapeutiques de pointe. La pandémie a marqué le début d'une nouvelle ère d'innovation en santé et de partenariats entre les établissements de santé publique, le milieu universitaire et l'industrie. À l'avenir, cette collaboration devrait être soutenue et améliorée. Pour veiller à ce que le Canada soit en mesure d'agir efficacement aux menaces émergentes pour la santé, les acteurs dans le domaine de la recherche, du développement et de la production doivent collaborer afin de définir les besoins en technologies de la santé et de trouver des solutions qui protègent la santé du public. Grâce à la coopération et à la collaboration internationales dans ce domaine, nous contribuons non seulement à la sécurité sanitaire à l'échelle mondiale, mais aussi à assurer la protection des Canadiens.
La Stratégie du gouvernement du Canada sur la biofabrication et les sciences de la vie est un pas important dans cette direction. Les gouvernements doivent continuer de travailler en étroite collaboration avec les scientifiques et l'industrie pour développer le bassin de talents du Canada, la capacité de fabrication et de distribution afin de produire des tests d'urgence, de l'équipement, des vaccins et des traitements qui peuvent être déployés rapidement. Dans le cadre de ce travail, les établissements de santé publique doivent être systématiquement mobilisés pour définir les priorités en matière de santé publique et les traduire en lignes directrices pour les politiques économiques et industrielles et, en fin de compte, en produits et technologies qui sauvent des vies.
Idées réalisables pour améliorer les outils de santé publique
- Accélérer la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne en matière de données sur la santé en établissant des jalons clairs. Cela comprend la priorisation des systèmes pour une utilisation interopérable, comme un réseau national de registres de vaccins qui comprend des données sociodémographiques ainsi que des liens entre les données épidémiologiques, biomédicales, cliniques et administratives sur la santé.
- Revigorer les systèmes nationaux et intergouvernementaux de détection des menaces et de prévision, y compris l'évaluation des risques, la modélisation, la planification de scénarios et la connaissance de la situation.
- Prioriser la mise en œuvre des principes de propriété et de contrôle pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans l'ensemble des systèmes de données.
- Améliorer la recherche d'intervention rapide et continue en santé de la population pour les initiatives de prévention et de bien-être, et renforcer les modèles interdisciplinaires de synthèse des connaissances, comme les Centres de collaboration nationale en santé publique.
- Tirer parti de la Stratégie du Canada sur la biofabrication et les sciences de la vie pour mobiliser systématiquement les secteurs de la santé publique et de la recherche et du développement afin de déterminer les technologies de santé stratégiques et essentielles et les contre-mesures pour éclairer la politique industrielle et la prise de décisions.
Moderniser nos modèles de gouvernance
Renforcement du mandat et de la responsabilisation en matière de santé publique au sein des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
La santé publique est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et les autorités locales de santé publique. Bien que la COVID-19 ait démontré les forces de notre intervention collective, elle a également mis en évidence les lacunes de nos plans de préparation à la pandémie et la nécessité de revoir nos modèles de gouvernance afin d'être mieux préparés pour l'avenir. Cela commence par renforcer le mandat de la santé publique au sein des systèmes de santé FPT et rendre les gouvernements plus responsables des objectifs et des résultats en matière de santé publique.
Comme première étape essentielle de ce processus de transformation, nous devons clarifier le rôle de la santé publique dans l'ensemble des administrations et veiller à ce que les fonctions essentielles soient conformes aux définitions mondiales en évolution pour répondre aux défis transfrontaliers complexes d'aujourd'hui, de la résistance aux antimicrobiens jusqu'aux changements climatiques. Les gouvernements doivent ensuite travailler ensemble pour déterminer des objectifs et des résultats communs en matière de santé publique liés aux engagements de financement, qui peuvent être mesurés et rapportés aux Canadiens dans un bulletin annuel. Pour ce faire, il faudra élaborer des indicateurs de rendement comparables pour mesurer l'efficacité et les résultats des politiques de santé publique. Ce niveau de responsabilisation aidera à cerner les secteurs à améliorer et à faire en sorte que la santé publique soit mieux équipée pour réduire les iniquités en santé et mieux préparée pour la prochaine urgence.
Enfin, il est important que les mécanismes de gouvernance de la santé publique comprennent une expertise et des perspectives en santé publique autochtone pour permettre l'autodétermination des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela signifie qu'il faut veiller à ce que les collectivités et les partenaires autochtones reçoivent un soutien adéquat pour élaborer et mettre en œuvre leurs propres plans et priorités en matière de santé publique, y compris des solutions locales holistiques et communautaires en partenariat avec les autorités de la santé publique.
Une voix plus forte pour la santé publique aux tables de décision
Les leaders en santé publique ont fourni de précieux conseils scientifiques aux décideurs tout au long de la pandémie de COVID-19. Il sera important que les dirigeants en santé publique continuent d'avoir un accès régulier aux décideurs à l'avenir, afin de s'assurer que le Canada est prêt à faire face à la prochaine crise de santé publique, que le système de santé est axé sur l'amélioration du mieux-être, et afin de poursuivre le travail essentiel visant à réduire les iniquités de santé. Dans le domaine de la santé FPT, il s'agit notamment de veiller à ce que la santé publique continue d'occuper une place plus importante dans le programme de santé FPT et d'appuyer continuellement la participation des médecins hygiénistes en chef aux discussions sur la gouvernance. Il faut également encourager la participation à d'autres tables de gouvernance que la santé.
Renforcer les liens intersectoriels
La pandémie a mis en évidence l'interaction complexe des déterminants sociaux de la santé, des facteurs comme l'éducation, la stabilité économique, la sécurité d'emploi et le logement stable dans l'élaboration des résultats en matière de santé et dans l'apparition d'iniquités. Le lien vital entre la santé et les conditions sociales, environnementales et économiques est devenu évident tant pour les décideurs que pour le public.
Il est maintenant bien connu qu'une bonne partie de ce qui nous rend en santé ne relève pas du système de santé. Les personnes vulnérables à la COVID-19 sont également les plus touchées par les iniquités structurelles et les maladies chroniques. Bien que les solutions biomédicales, comme les vaccins, aient été des outils importants pour lutter contre la COVID-19, les solutions sociales, y compris le soutien du revenu, les congés de maladie payés et d'autres mesures de soutien au logement et à l'emploi, ont également été essentielles.
De nouvelles façons de travailler sont nécessaires pour améliorer les conditions sociales qui déterminent les résultats en matière de santé. La pandémie a révélé l'importance de rassembler tous les secteurs de la société dans la lutte contre la COVID-19, y compris les entreprises, la société civile et d'autres ministères. Nous devons maintenant utiliser la même énergie de collaboration pour créer des alliances stratégiques en amont afin de réduire les iniquités en santé, où l'action collective est fondée sur des indicateurs clairs et mesurables. « L'impact collectif » est une approche encourageante dans le domaine de l'innovation sociale. Cela fournit un cadre pour répondre aux priorités en matière de santé et de services sociaux en élaborant des objectifs communs et en coordonnant des mesures qui se renforcent mutuellement entre les secteurs, le tout motivé par une responsabilité partagée.
Exploiter le pouvoir des collectivités
Le patient de la santé publique est la population. Pour protéger efficacement la santé des populations, il faut une bonne collaboration et une prise de décisions entre les secteurs et les juridictions, y compris avec les collectivités de tout le pays. Qu'il s'agisse d'organiser des campagnes de vaccination ou de livrer de la nourriture aux personnes dans le besoin, les dirigeants communautaires ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de solutions adaptées qui tiennent compte de l'expérience vécue, des défis uniques et des besoins particuliers de leurs membres.
Le leadership des collectivités autochtones dans l'élaboration d'un bien-être holistique et d'une planification adaptée en cas de pandémie offre un aperçu de ce qui peut être fait lorsque les dirigeants et les organisations de santé publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont soutenus pour assurer leur propre gouvernance de la santé autochtone. De même, le leadership des Canadiens d'origine afro-caribéenne dans l'amélioration de la mise à jour du vaccin a démontré que la détermination communautaire a un rôle important à jouer dans l'atteinte de résultats positifs en matière de santé.
Les initiatives axées sur la collectivité exigent de nouveaux modèles novateurs de gouvernance et de collaboration partagées qui permettent l'expertise locale. Plus nous travaillerons à rapprocher les réalités locales des données mondiales et à exploiter notre expertise collective, mieux nous serons outillés pour nous organiser rapidement et intervenir efficacement en cas d'urgence.
Idées réalisables pour la modernisation de la gouvernance
- Moderniser les fonctions essentielles en santé publique (ou les rôles en santé publique à l'échelle du pays) afin de réagir aux changements dans le paysage actuel de la santé publique et de les harmoniser avec les réflexions mondiales.
- Élaborer un mandat pancanadien sur la santé publique avec des priorités, des objectifs, des fonctions essentielles et des rôles clairs pour orienter la prise de décisions et les investissements FPT. Cela comprendrait des rapports annuels sur les progrès réalisés vers l'atteinte d'objectifs communs. Veiller également à ce que la planification et les priorités en matière de santé publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient appuyées afin de répondre aux besoins d'une manière proactive et souple qui appuie l'autodétermination et les solutions locales holistiques.
- Élaborer une stratégie de recherche sur les systèmes de santé publique pour éclairer les indicateurs de rendement normalisés et les rapports annuels sur les politiques et les services de santé publique au Canada.
- Remanier les plans de lutte contre la pandémie pour y inclure les secteurs de la santé, des services sociaux et de l'économie, et assurer la préparation à la pandémie grâce à un financement durable, à des tests et à des rapports publics annuels sur l'état de préparation.
- Créer un système de surveillance et de déclaration de l'équité en santé avec les dirigeants intersectoriels afin d'améliorer et de suivre les facteurs sociaux qui peuvent protéger les populations contre de futures pandémies et d'autres problèmes de santé.
- Intégrer la collectivité et l'équité dans les processus de prise de décisions en santé publique en intégrant des responsabilités en matière d'engagement communautaire, de conception conjointe et de mise en œuvre au niveau communautaire.
Assurer un financement stable et constant
Pour assurer l'avenir de notre système de santé publique, il faut investir adéquatement dans notre personnel, nos outils et nos structures de gouvernance. Il faut aussi un financement plus constant et plus stable pour faire face aux crises complexes d'aujourd'hui et mieux se préparer pour l'avenir.
Les ressources en santé publique sont souvent réduites après les urgences en santé publique à mesure que les gouvernements s'attaquent à d'autres priorités. C'est ce qu'on appelle l'alternance des cycles de financement en santé publique. Cela désavantage le système de santé publique au début de chaque crise parce qu'il n'a pas la capacité ou les réseaux nécessaires pour intervenir rapidement.
Investir dans la santé publique est un investissement intelligent qui a des répercussions directes et indirectes sur le bien-être social et économique. La santé publique, c'est l'éclosion qui n'a pas eu lieu, le traumatisme qui n'a pas eu lieu et la surdose qui a été évitée. La santé publique protège la durabilité de notre système de santé en réduisant la demande de traitements médicaux coûteux et en aidant les gens à rester en bonne santé. Comme la pandémie l'a clairement démontré, lorsque nous n'accordons pas la priorité à la santé publique, les gens tombent malades, le système de santé peut être débordé et l'économie en souffre.
Bien qu'il soit difficile de le mesurer avec précision, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) estime qu'en 2019, un peu moins de 6 % de toutes les dépenses de santé ont été affectées à la santé publique au Canada. Nous devons nous demander si cet investissement est suffisant compte tenu du rôle essentiel que joue la santé publique dans le maintien de la santé et de la sécurité des Canadiens.
Les dépenses en santé publique doivent être plus transparentes dans les budgets du gouvernement et liées à des objectifs de rendement et à des résultats clairs afin de les rendre plus visibles et responsables envers le public. Des modèles de financement souples sont également nécessaires pour appuyer l'autodétermination des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et pour veiller à ce que les collectivités autochtones soient soutenues dans l'élaboration d'approches et d'interventions adaptées à leurs besoins.
Idées de financement réalisables
- Augmenter le financement pour atteindre des niveaux budgétaires permanents qui correspondent au mandat de santé publique.
- Collaborer avec les gouvernements FPT pour veiller à ce que les budgets établissent clairement les priorités et le financement des politiques et des services de santé publique, à mesure que les investissements en santé publique réduisent les coûts des soins de santé et les possibilités économiques perdues.
- Soutenir la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis grâce à un financement ciblé pour les programmes de santé publique dirigés par les Autochtones.
- Utiliser les fonds fédéraux pour réaliser des priorités et des objectifs communs en matière de santé publique et élaborer des indicateurs pour rendre compte des résultats au niveau FPT.
Appels à l'action
Nous sommes à un moment décisif. La santé publique au Canada a relevé le défi de la pandémie de la COVID-19, mais ses ressources sont limitées.
En nous basant sur notre expérience de la pandémie, nous pouvons décider du type de système de santé publique que nous voulons avoir à l'avenir. Un système de santé publique de calibre mondial, résilient et protégeant chacun d'entre nous, sera notre meilleure police d'assurance contre les futures crises de santé publique. Cela nous permettra également d'être bien équipés pour affronter les menaces de plus en plus complexes qui se présentent à l'horizon.
À l'heure actuelle, plusieurs pays commencent à entreprendre des réflexions critiques similaires. Les leçons apprises et les pratiques exemplaires émergentes peuvent être partagées au-delà des frontières et éclairer notre marche à suivre pour transformer notre système de santé publique et atteindre une santé optimale pour toute la population du Canada.
La pandémie a sensibilisé beaucoup de personnes au fait que notre système de santé ne se limite pas à la gestion des maladies au moyen de médicaments et d'interventions à l'hôpital, notre système doit prévenir ces maladies dès que possible.
En travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres et en collaborant avec d'autres acteurs à travers le monde entier, nous pourrons bâtir un système de santé publique de calibre mondial et une société plus saine et plus forte.
Annexe A : Méthodologie
Processus
Le rapport annuel de 2021 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada (ACSP) a été rédigé à la suite d'une revue des meilleures données probantes disponibles, y compris des données probantes provenant de la recherche, de l'expertise universitaire, de l'expertise pratique et appliquée en santé publique, de l'expertise communautaire et des modes de savoirs traditionnels. Au lieu de procéder à des revues rapides fondées sur une recherche ponctuelle, les nouvelles connaissances ont été relevées et synthétisées tout au long du processus de rédaction afin de tenir compte de l'évolution constante des données probantes et de l'expérience cumulative. Compte tenu des priorités en matière de contenu, une partie de l'information présentée dans le rapport a été synthétisée à partir de revues de données probantes indépendantes commandées et de thèmes pertinents qui ont émergé des consultations d'experts. En ce qui concerne la recherche, des sources autres que les revues systémiques ont été nécessaires, y compris des études primaires sous forme de publications à comité de lecture, de prépublications, de littérature grise et de consultations d'experts. Dans la mesure du possible, les études et les données représentatives canadiennes ont été priorisées, et les données épidémiologiques ont été tirées de sources gouvernementales fédérales, provinciales, territoriales ou municipales.
Puisque le rapport a été préparé au cours de la pandémie de COVID-19 actuelle, les renseignements sur la COVID-19 qu'il comporte reflètent le caractère évolutif de la science et notre compréhension du virus et de ses répercussions.
Les données probantes ont été recueillies par les moyens suivants :
Revues de recherches
- Recherches documentaires fréquentes et continues, effectuées par sous-sujet à l'aide de bases de données en ligne comme Medline et Scopus, ainsi qu'un repérage des études nouvelles et existantes tenues par divers éditeurs universitaires, comme BMJ, The Lancet et Elsevier
- Initiatives de revue rapide à l'échelle du Canada, comme le réseau de données sur la COVID-19 pour soutenir la prise de décisions (COVID‑END), CanCOVID et la plateforme de données du Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
Mises à jour sur la surveillance, rapports sur la santé publique et autre littérature grise
- Revue des publications municipales, provinciales, territoriales et nationales en santé publique, en particulier les rapports épidémiologiques et les rapports d'enquêtes publiques
- Revues de la littérature grise et de politiques de sources fiables, comme les publications d'organismes de santé publique (p. ex., Organisation mondiale de la Santé) et les publications gouvernementales (p. ex., Santé publique Ontario)
- Renseignements épidémiologiques, selon l'ordre de priorité suivant : renseignements des rapports sur les cas de COVID-19 communiqués à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) par les gouvernements provinciaux et territoriaux et les réseaux nationaux de recherche, données publiques provenant des sites Web provinciaux et territoriaux, points de presse par les autorités sanitaires et reportages dans les médias
- Information publiée ou transmise par d'autres ministères fédéraux, comme Statistique Canada et Services aux Autochtones Canada
Revues de données probantes commandées
- Rapports commissionnés auprès d'experts indépendants en santé publique :
- Une vision éclairée par des données probantes pour un système de données en santé publique au Canada, rédigé par le Dr David Buckeridge
- Gouverner pour la santé du public: options de gouvernance pour un système de santé publique renforcé et renouvelé au Canada, rédigé par Erica Di Ruggerio, Ph. D.
- Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, rédigé par Margo Greenwood, Ph. D. (rédactrice), le Dr. Evan Adams (rédacteur), la Dre Marcia Anderson, Donna Atkinson, la Dre Danièle Behn Smith, la Dre Sarah Funnell, Theresa Koonoo (avec les contributions de Rebecca Lonsdale, Sarah MacRury, Igah Sangoya, Meeka Kiguktak, Janice Panimera et Jeanie Aulaqiaq), la Dre Shannon McDonald, Clara Morin Dal Col, le Dr Christopher Mushquash, la Dre Janet Smylie, la Dre Shannon Waters, le Dr Eduardo Vides et les organisations autochtones nationales suivantes : Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et Ralliement national des Métis
- Renforcer les liens communautaires : l'avenir de la santé publique se joue à l'échelle des quartiers, rédigé par Kate Mulligan, Ph. D.
Groupes de discussion et entrevues avec des informateurs clés
- Collaboration avec des intervenants experts internes et externes, des responsables de programmes et de la surveillance de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)
- Processus de consultation ciblé, mobilisation de divers groupes comprenant des intervenants d'organismes de santé publique, du milieu universitaire, d'organismes communautaires et du gouvernement. Le résumé des principaux thèmes de ces discussions a été publié dans un rapport sur « Ce que nous avons entendu » intitulé Renouvellement et renforcement du système de santé publique au Canada. Ce processus de consultation des intervenants comprenait :
- Une rencontre virtuelle « Échange des Meilleurs Cerveaux », organisée conjointement par l'ASPC et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
- 5 groupes de discussion, chacun axé sur un groupe différent de participants :
- Chercheurs et leaders d'opinion touchés par la pensée systémique et l'innovation sociale
- Bénéficiaires de subventions des IRSC du secteur de la recherche sur le système de santé publique et l'innovation en matière d'infrastructure
- Membres du Forum des professionnels de la santé de l'ACSP
- Membres du Comité consultatif spécial sur la COVID-19
- Médecins hygiénistes locaux
- 6 rencontres avec des experts et des dirigeants en santé publique
- Éclairé par le processus de consultation national, le « Dialogue communautaire sur l'avenir des systèmes de santé publique canadiens », dirigé par l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC
Limites
Portée et recherche documentaire
Le rapport annuel de l'ACSP de 2021 explore les vastes répercussions de la COVID-19 et une vision pour l'avenir du système de santé publique au Canada. Étant donné que ce rapport a pour but de fournir une vue d'ensemble des sujets et des concepts présentés, le niveau de détail fourni dans chaque partie est nécessairement limité. Compte tenu des données probantes disponibles au moment de la rédaction du présent rapport et des courts délais de production, le présent document ne constitue pas un examen exhaustif des données probantes ni des consultations approfondies auprès des intervenants de tous les systèmes de santé publique au Canada. Seuls les documents publiés en anglais et en français ont fait l'objet d'une revue. Une évaluation détaillée de la qualité de l'étude et du risque de biais n'a pas été effectuée dans le cadre de cette revue, ce qui peut avoir des conséquences importantes compte tenu du statut préliminaire de certaines ressources et constatations.
Langage
Dans la mesure du possible, nous avons tenté d'utiliser un langage normalisé, inclusif et adapté sur le plan culturel pour décrire les réalités des différentes communautés et leurs expériences en matière de santé selon les données probantes sous-jacentes. Cependant, nous nous sommes fiés à la terminologie incluse dans les documents sources (p. ex., minorités visibles) lorsque nous n'avons pas été en mesure de trouver une terminologie plus appropriée.
Remerciements
De nombreuses personnes et organisations ont fourni des idées et des conseils précieux pour l'élaboration du présent rapport.
Je tiens à exprimer ma gratitude envers les conseillers experts qui ont fourni une orientation et des conseils stratégiques pour la rédaction de ce rapport et qui ont lu de nombreuses ébauches :
- Dr M. Mustafa Hirji, médecin hygiéniste intérimaire, région de Niagara, Ontario
- Dr David Mowat, consultant en santé publique; ex-médecin hygiéniste, Santé publique de Peel
- Dr Cory Neudorf, professeur, Département de santé communautaire et d'épidémiologie, Collège de médecine, Université de la Saskatchewan, et médecin hygiéniste en chef intérimaire, Régie de la santé de la Saskatchewan
- Duncan Selbie, professeur, président de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique et ex-directeur général de Public Health England
- Dre Gaynor Watson-Creed, doyenne adjointe, Serving and Engaging Society, et professeure adjointe, Département de santé communautaire et d'épidémiologie, Faculté de médecine, Université Dalhousie
De plus, j'aimerais remercier mes collègues qui ont dirigé l'élaboration de rapports indépendants qui éclairent mon rapport annuel et qui ont fourni une expertise supplémentaire en la matière :
- Dr Evan Adams, médecin hygiéniste en chef adjoint de la santé publique, Services aux Autochtones Canada
- Dr David Buckeridge, professeur, Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, Université McGill
- Erica Di Ruggiero, Ph. D., professeure associée, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto
- Margo Greenwood, Ph. D., responsable universitaire, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone
- Kate Mulligan, Ph. D., professeure adjointe, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto
J'aimerais également remercier sincèrement les nombreux membres du personnel de l'Agence de la santé publique du Canada qui ont fourni des idées et des conseils importants tout au long de l'élaboration du rapport.
Je tiens à souligner le travail de l'Institut canadien d'information sur la santé et de Santé Canada, qui ont contribué aux données et à l'information citées dans ce rapport. De plus, j'aimerais remercier nos partenaires d'Emploi et développement social Canada, de Statistique Canada et de Services aux Autochtones Canada de nous avoir transmis de l'information ou d'avoir examiné de façon critique le contenu du rapport. Un grand merci également à nos collègues des Instituts de recherche en santé du Canada d'avoir organisé conjointement l'Échange des Meilleurs Cerveaux, d'avoir participé aux consultations et d'avoir fourni de précieux conseils et données probantes.
Je remercie sincèrement les quelque 150 dirigeants de l'ensemble du Canada, notamment des médecins hygiénistes, des praticiens et des dirigeants de la santé publique, des chercheurs, des décideurs et d'autres fournisseurs de services, qui ont participé aux rencontres et aux groupes de discussion, y compris les membres du Forum des professionnels de l'administratrice en chef de la santé publique et du Comité consultatif spécial du Réseau pancanadien de santé publique sur la COVID-19 et les médecins hygiénistes locaux. Vos idées et vos commentaires ont aidé à éclairer mon rapport sur les facteurs nécessaires pour transformer la santé publique et améliorer la santé des gens au Canada.
Enfin, je remercie les équipes du Bureau de l'administratrice en chef de la santé publique de s'être réunies pour soutenir l'élaboration de mon rapport. Des remerciements particuliers à l'équipe des rapports pour son engagement et son dévouement à l'égard de ce rapport, de sa conception à sa publication : Tammy Bell, Fabienne Boursiquot, Marie Chia, Ph. D., Charlene Cook, Ph. D., Sarah Drohan, Ph. D., Elyse Fortier, Rhonda Fraser, Kimberly Gray, Ph. D., David Grote, Ph. D., Bonnie Hostrawser, Jessica Lepage, Danielle Noble, Kelly Kavanagh Salmond, Kelsey Seal et Inès Zombré.
Références
- Note de bas de page 1
-
Public Health Agency of Canada. COVID-19 Epidemiology Internal Data. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 2
-
Statistique Canada. Nombre Proviso Ire de Décès et Surmortalité, Janvier 2020 à Mars 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 3
-
Statistique Canada. Les Changements Survenus Dans Les Causes de Décès de 1950 à 2012. Gouvernement du Canada; 2016.
- Note de bas de page 4
-
Bourbeau, R, Ouellette, N. Trends, Patterns, and Differentials in Canadian Mortality over Nearly a Century, 1921-2011. Canadian Studies in Population. 2016; 43(1-2):48–77.
- Note de bas de page 5
-
Tam, T. Du Risque à la Résilience : Une Approche Axée sur L'équité Concernant la COVID-19. Ottawa, ON: Agence de santé publique du Canada; 2020.
- Note de bas de page 6
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration de L'administratrice En Chef de la Santé Publique du Canada, le 27 Août 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 7
-
Association canadienne de santé publique. Examen de la Riposte Initiale du Canada à la Pandémie de COVID-19. Association canadienne de santé publique; 2021.
- Note de bas de page 8
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending May 7, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 9
-
Moriarty, T, Boczula, AE, Thind, EK, Loreto, N, McElhaney, JE. Surmortalité Toutes Causes Confondues Pendant L'épidémie de COVID-19 au Canada. Société royale du Canada; 2021.
- Note de bas de page 10
-
Cameron-Blake, E, Breton, C, Sim, P, Tatlow, H, Hale, T, Wood, A, et al. Variation in the Canadian Provincial and Territorial Responses to COVID-19. Blavatnik School of Government Working Paper. 2021.
- Note de bas de page 11
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – Le 22 Septembre 2020. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 12
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – Le 30 Octobre 2020. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 13
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – Le 23 Avril 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 14
-
Agence de la santé publique du Canada. Plan D'intervention Fédéral-Provincial-Territorial En Matière de Santé Publique pour la Gestion Continue de la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 15
-
Gouvernement du Canada. Mesures Individuelles et Communautaires pour Atténuer la Propagation de la Maladie à COVID-19 au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 16
-
Gouvernement du Canada. COVID-19: Principaux Modes de Transmission. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 17
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration de L'administratrice En Chef de la Santé Publique du Canada, le 10 Février 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 18
-
Gouvernement du Canada. Masques Non Médicaux : À Propos. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 19
-
Agence de la santé publique du Canada. COVID-19 : Guide de Ventilation des Espaces Intérieurs Pendant la Pandémie. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 20
-
Parkin, A. Tous Ensemble? Opinion des Canadiens sur le Port Dur Masque, Les Vaccins et le Confinement Durant la Pandémie de COVID-19. La confédération de demain. 2021.
- Note de bas de page 21
-
Desveaux, L, Mosher, R, Buchan, JL, Burns, R, Corace, KM, Evans, GA, et al. Behavioural Science Principles for Enhancing Adherence to Public Health Measures. Science Briefs of the Ontario COVID-19 Science Advisory Table. 2021.
- Note de bas de page 22
-
Impact Canada. Surveillance Instantanée COVID-19 (SICO Canada). Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 23
-
Dionne, M, Dubé, E, Pelletier, C. COVID-19 - Pandémie et Impacts sur la Vie Personnelle. Institut national de santé publique du Québec:2021.
- Note de bas de page 24
-
Impact Canada. Surveillance Instantanée COVID-19 (SICO Canada) Vague 12. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 25
-
Impact Canada. Surveillance Instantanée COVID-19 (SICO Canada) Vague 11. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 26
-
Brankston, G, Merkley, E, Fisman, DN, Tuite, AR, Poljak, Z, Loewen, PJ, et al. Socio-Demographic Disparities in Knowledge, Practices, and Ability to Comply with COVID-19 Public Health Measures in Canada. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(3):363-75.
- Note de bas de page 27
-
Gouvernement du Canada. Variants du Sras-Cov-2 : Définitions, Classification et Santé Publique Nationales. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 28
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending July 30, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 29
-
Tuite, AR, Fisman, DN, Odutayo, A, Bobos, P, Allen, V, Bogoch, II, et al. COVID-19 Hospitalizations, ICU Admissions and Deaths Associated with the New Variants of Concern. Ontario COVID-19 Science Advisory Table. 2021.
- Note de bas de page 30
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – 30 Juillet 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 31
-
Public Health Agency of Canada. COVID-19 Border Response Provides Case Study for Assessing Canada's Future Approach to Border and Travel Health. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 32
-
Transports Canada. Le Gouvernement du Canada Adopte des Restrictions Supplémentaires S'appliquant Aux Voyages Internationaux. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 33
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Gouvernement du Canada Investit 53 Millions de Dollars Dans la Lutte Contre Les Variants Préoccupants du Virus de la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 34
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration de L'administratrice En Chef de la Santé Publique du Canada, le 7 Juin 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 35
-
Agence de la santé publique du Canada. L'ACSP Émet Une Série de Déclarations sur la COVID-19 : Vaccins à ARNm. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 36
-
Santé Canada. Santé Canada Autorise le Premier Vaccin Contre la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 37
-
Gouvernement du Canada. Autorisations de Médicament et de Vaccine Contre la COVID-19 : Liste des Drogues et Vaccins Autorisés et des Drogues à Indication Supplémentaire. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 38
-
Gouvernement du Canada. Vaccins et Traitements pour la COVID-19 : Progrès. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 39
-
Agence de la santé publique du Canada. Édition du Dimanche de la Déclaration de l'ACSP : La Sécurité des Vaccins au Canada – Ce Que Vous Devez Savoir. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 40
-
Gouvernement du Canada. Vaccination Contre la COVID-19 au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 41
-
Canadian Public Health Association. The Value of Immunization in the Future of Canada's Health System. Commission on the Future of Health Care in Canada; 2001.
- Note de bas de page 42
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – 28 Mai 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 43
-
Agence de la santé publique du Canada. Plan de Vaccination du Canada Contre la COVID-19 : Sauver des Vies et Protéger Les Moyens de Subsistance. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 44
-
Agence de la santé publique du Canada. Édition du Dimanche de L'ACSP : Les Deux Nouveaux Vaccins Contre la COVID-19 du Canada : Ce Que Vous Devez Savoir. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 45
-
Comité consultative national de l'immunisation. Orientations sur L'administration Prioritaire des Premières Doses du Vaccin Contre la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 46
-
Comité consultative national de l'immunisation. Réponse Rapide du CCNI : Allongement des Intervalles Entre Les Doses des Vaccins Contre la COVID-19 pour Optimiser Les Campagne de Vaccination Précoces et la Protection des Population au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 47
-
Immunisation Canada. Programme Pancanadien de Soutien Aux Victimes D'une Vaccination. Immunisation Canada; 2021.
- Note de bas de page 48
-
Agence de la santé publique du Canada. Programme de Soutien Aux Victimes D'une Vaccination (PSVV). Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 49
-
Murray, T. Canada's Long Road to a Vaccine Injury Compensation Program. Canadian Medical Association Journal. 2021; 193(8):E294-E5.
- Note de bas de page 50
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending June 15, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 51
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Point sur la COVID-19 au Canada : Épidémiologie et Modélisation – 3 Septembre 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 52
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending July 23, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 53
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Gouvernement du Canada Annonce Un Assouplissement des Mesures Frontalières pour Les Voyageurs Entièrement Vaccinés. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 54
-
Agence de la santé publique du Canada. Mise à Jour Quotidienne sur L'épidémiologie de la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 55
-
Province of Nova Scotia. Border and Other Restrictions to Reduce Spread of COVID-19. Province of Nova Scotia; 2021.
- Note de bas de page 56
-
Province of Nova Scotia. New Brunswick Border Restrictions Reinstated. Province of Nova Scotia; 2021.
- Note de bas de page 57
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending May 14, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 58
-
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Dévoile Les Premiers Détails sur Sa Future Campagne de Vaccination Contre la COVID-19. Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; 2020.
- Note de bas de page 59
-
Government of Yukon. Statement from Minister of Health and Social Services Pauline Frost on the Arrival of Moderna's COVID-19 Vaccine in Yukon. Government of Yukon; 2020.
- Note de bas de page 60
-
Gouvernement du Nunavut. Vaccination Contre la COVID-19. Gouvernement du Nunavut; 2021.
- Note de bas de page 61
-
Levin, AT, Hanage, WP, Owusu-Boaitey, N, Cochran, KB, Walsh, SP, Meyerowitz-Katz, G. Assessing the Age Specificity of Infection Fatality Rates for COVID-19: Systematic Review, Meta-Analysis, and Public Policy Implications. European Journal of Epidemiology. 2020; 35(12):1123-38.
- Note de bas de page 62
-
Booth, A, Reed, AB, Ponzo, S, Yassaee, A, Aral, M, Plans, D, et al. Population Risk Factors for Severe Disease and Mortality in COVID-19: A Global Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2021; 16(3):e0247461.
- Note de bas de page 63
-
Statistique Canada. Nombre Provisoire de Décès et Surmortalité, Janvier 2020 à Février 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 64
-
Public Health Agency of Canada. Canadian Surveillance of Covid-19 in Pregnancy: Epidemiology, Maternal and Infant Outcomes - Report #4. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 65
-
Statistique Canada. Répercussions de la COVID-19 sur Les Travailleurs de la Santé : Prévention et Contrôle des Infections, Fichier de Microdonnées à Grande Diffusion. Statistique Canada; 2021.
- Note de bas de page 66
-
Peckham, H, de Gruijter, NM, Raine, C, Radziszewska, A, Ciurtin, C, Wedderburn, LR, et al. Male Sex Identified by Global COVID-19 Meta-Analysis as a Risk Factor for Death and ITU Admission. Nature Communications. 2020; 11(1):6317.
- Note de bas de page 67
-
Okpechi, SC, Fong, JT, Gill, SS, Harman, JC, Nguyen, TH, Chukwurah, QC, et al. Global Sex Disparity of COVID-19: A Descriptive Review of Sex Hormones and Consideration for the Potential Therapeutic Use of Hormone Replacement Therapy in Older Adults. Aging and Disease. 2021; 12(2):671-83.
- Note de bas de page 68
-
Shastri, MD, Shukla, SD, Chong, WC, Kc, R, Dua, K, Patel, RP, et al. Smoking and COVID-19: What We Know So Far. Respiratory Medicine. 2021; 176.
- Note de bas de page 69
-
Agence de la santé publique du Canada. Inégalités Sociales des Décès Liés à la COVID-19 au Canada, Par Caractéristiques Individuelles et Locales, de Janvier à Juillet/Août 2020. Ottawa, ON: Agence de la santé publique du Canda; 2021.
- Note de bas de page 70
-
Institut canadien d'information sur la santé. Nombre de Cas et de Décès Liés à la COVID-19 Chez Les Travailleurs de la Santé au Canada. Institut canadien d'information sur la santé; 2021.
- Note de bas de page 71
-
Office of the Correctional Investigator. Third COVID-19 Status Update. Office of the Correctional Investigator; 2021.
- Note de bas de page 72
-
Services correctionnel du Canada. Vaccination Dans Les Établissements Correctionnels Fédéraux. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 73
-
Henry, B. COVID-19 Press Conference on February 5, 2021. Press Conference; 2021.
- Note de bas de page 74
-
The Conversation Piece. E27: Dr Deena Hinshaw on the Network of Humanity in the Face of a Virus: The Walrus; 2020.
- Note de bas de page 75
-
Henry, B. COVID-19 Press Conference on April 8, 2021. Press Conference; 2021.
- Note de bas de page 76
-
Canadian Red Cross. How Red Cross Is Responding to COVID-19 in Nunavut. Canadian Red Cross; 2021.
- Note de bas de page 77
-
City of Toronto. Two COVID-19 Cases in Toronto Appear Linked to the B.1.1.7 Variant. City of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 78
-
Alberta Health Services. Meat Processing Plant COVID-19 Outbreaks. Alberta Health Services; 2021.
- Note de bas de page 79
-
Ministère de la Santé d'Ontario. Document D'orientation sur la Priorisation des Groupes à Vacciner au Cours de la Phase 2 du Programme de Vaccination Contre la COVID-19. Gouvernement d'Ontario; 2021.
- Note de bas de page 80
-
Hinshaw, D. COVID-19 Press Conference on March 15, 2021. Press Conference; 2021.
- Note de bas de page 81
-
Ontario Health Coalition. Tracking of COVID-19 Outbreaks in Non-Health Care Settings – Data Updated to October 13. Ontario Health Coalition; 2020.
- Note de bas de page 82
-
City of Toronto. Toronto Public Health Releases COVID-19 Workplace Outbreak Data. City of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 83
-
Santé publique Ottawa. Éclosions Aux Lieux de Travail. Santé publique Ottawa; 2021.
- Note de bas de page 84
-
Agence de la santé publique du Canada. Outil de Données sur Les Décès Attribuables à la COVID-19. Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé; 2021.
- Note de bas de page 85
-
Subedi, R, Greenberg, L, Trucotte, M. Taux de Mortalité Attribuable à la COVID-19 Dans Les Quartiers Ethnoculturels du Canada. Statistiques Canada; 2020.
- Note de bas de page 86
-
Statistiques Canada. Répercussions sur Les Immigrants et Les Personnes Désignées Comme Minorités Visibles. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 87
-
Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Les Quartiers Défavorisés et Les Communautés Racisées Toujours à la Traîne Dans la Couverture Vaccinale : Les Plus Récents Résultats de la Société Canadienne du Sang. Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19; 2021.
- Note de bas de page 88
-
City of Toronto. COVID 19: Ethno-Racial Identity and Income. City of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 89
-
Comité consultative national de l'immunisation. Orientations sur L'établissement de L'ordre de Priorité des Principales Populations à Immuniser Contre la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 90
-
Gouvernement d'Ontario. L'ontario Étend la Prise de Rendez-Vous pour la Vaccination Contre la COVID-19 à Un Plus Grand Nombre de Personnes. Gouvernement d'Ontario; 2021.
- Note de bas de page 91
-
Iveniuk, J, Leon, S. An Uneven Recovery: Measuring COVID-19 Vaccine Equity in Ontario. Wellesley Institute; 2021.
- Note de bas de page 92
-
Angus, M. “Champions for Immunization against COVID-19” African Nova Scotian Communities and Partners Work Together to Create Positive Vaccine Experience. Nova Scotia Health; 2021.
- Note de bas de page 93
-
Plante, V. City of Montreal COVID-19 Press Conference on January 13. Press Conference; 2021.
- Note de bas de page 94
-
CBC News. Vancouver Health Authority Rolls out COVID-19 Vaccine on Downtown Eastside. CBC News. 2021.
- Note de bas de page 95
-
Indigenous Services Canada. COVID-19 Epidemiology Internal Data. Indigenous Services Canada; 2021.
- Note de bas de page 96
-
First Nations Health Authority. Community Situation Report August 14, 2021. First Nations Health Authority; 2021.
- Note de bas de page 97
-
Statistiques Canada. Série Perspective Géographique, Recensement de 2016 – Nunavut. Ottawa, ON: Statistiques Canada; 2017.
- Note de bas de page 98
-
Gouvernement du Nunavut. Déplacements et Séjours D'isolement. Gouvernement du Nunavut; 2021.
- Note de bas de page 99
-
Gouvernement du Nunavut. Assouplissement des Restrictions Sanitaires à Iqaluit et Début de L'analyse des Eaux Usées. Gouvernement du Nunavut; 2021.
- Note de bas de page 100
-
Gouvernement du Nunavut. Signaux Positifs de COVID-19 Détectés Dans Les Eaux D'égout de Rankin Inlet. Gouvernement du Nunavut; 2021.
- Note de bas de page 101
-
Assembly of Manitoba Chiefs, Southern Chiefs' Organization Inc., Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc., Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc., First Nations Health, Social Secretariat of Manitoba. Protect Yourself. Protect Our People. 2021; disponible : https://protectourpeoplemb.ca/.
- Note de bas de page 102
-
Services aux Autochtones Canada. Les Peoples Autochtones et Les Vaccins Contre la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 103
-
Anishnabek News. Connecting Indigenous Communities with Culturally-Relevant COVID-19 Vaccine Information. Anishnabek News. 2021.
- Note de bas de page 104
-
Northern Policy Institute. Taking to the Skies: Vaccination Delivery in the Far North. Northern Policy Institute; 2021; disponible : https://www.northernpolicy.ca/article/taking-to-the-skies-vaccination-delivery-in-the-far-north--41534.asp.
- Note de bas de page 105
-
National Collaborating Centre for Methods and Tools. Rapid Review: What Is Known About Reasons for Vaccine Confidence and Uptake in Populations Experiencing Inequities? National Collaborating Centre for Methods and Tools; 2021.
- Note de bas de page 106
-
MacDonald, N, Comeau, J, Dubé, È, Graham, J, Greenwood, M, Harmon, S, et al.Promouvoir L'acceptation des Vaccins Contre la COVID-19 au Canada. Société royale du Canada; 2021.
- Note de bas de page 107
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration de L'administratrice En Chef de la Santé Publique du Canada, le 22 Mai 2021. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 108
-
Services aux Autochtones Canada. Le Gouvernement du Canada Fait le Point sur la COVID-19 Chez Les Autochtones et Dans Leurs Communautés, Semaine du 9 Août. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 109
-
Public Health Agency of Canada. Weekly COVID Surveillance Indicator Report - Week Ending August 13, 2021. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 110
-
Gouvernement du Québec. Passeport Vaccinal COVID-19. Gouvernement du Québec; 2021.
- Note de bas de page 111
-
Alberta Health Services. Alberta Health Services Implementing Immunization Policy for Physicians, Staff and Contracted Providers. Alberta Health Services; 2021.
- Note de bas de page 112
-
Statistique Canada. Volonté de Se Faire Vaccine Contre la COVID-19 Parmi Les Groupes de Population au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 113
-
Statistique Canada. La Plupart des Canadiens Sont Prêts à Se Faire Vacciner et Un Plus Grand Nombre D'entre Eux Sont Restés à la Maison au Début de 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 114
-
Statistique Canada. Enquête sur la Couverture Vaccinale Contre la COVID-19. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 115
-
Office of the Chief Public Health Officer, Privy Council Office/Impact & Innovation Unit. Augmenting Vaccination Data among Priority Populations. Government of Canada; 2021.
- Note de bas de page 116
-
Dionne, M, Dubé, E, Hamel, D, Rochette, L, Tessier, M. Pandémie et Vaccination Contre la COVID-19 - 24 Août 2021. Institut national de santé publique du Québec; 2021.
- Note de bas de page 117
-
Agence de la santé publique du Canada. Défi de L'innovation Communautaire des Vaccins : Objectifs et Principes. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 118
-
Public Health Agency of Canada. COVID-19 Internal Transition Briefing. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 119
-
Ritchie, H, Mathieu, E, Rodés-Guirao, L, Appel, C, Giattino, C, Ortiz-Ospina, E, et al. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World in Data; 2020.
- Note de bas de page 120
-
Callaway, E. COVID Vaccine Boosters: The Most Important Questions. Nature. 2021; 596:178-80.
- Note de bas de page 121
-
Mathieu, E, Ritchie, H, Ortiz-Ospina, E, Roser, M, Hasell, J, Appel, C, et al. A Global Database of COVID-19 Vaccinations. Nature Human Behaviour. 2021.
- Note de bas de page 122
-
Affaires mondiales Canada. Le Canada Annonce Une Nouvelle Contribution Aux Efforts de Vaccination à L'échelle Mondiale. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 123
-
Statistique Canada. Réductions de L'espérance de Vie Associées Directement à la COVID-19, 2020. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 124
-
Statistique Canada. Tableau 12-10-0114001 Espérance de Vie et Autres Éléments de la Table de Mortalité, Canada, Toutes Les Provinces Excepté L'île-du-Prince-Édouard. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 125
-
Statistique Canada. Tables de Mortalité, 2016-2018. Le Quotidien; 2020.
- Note de bas de page 126
-
Dion, P. Réductions de L'espérance de Vie Associées Directement à la COVID-19 En 2020. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 127
-
Statistique Canada. Nombre Provisoire de Décès et Surmortalité, Janvier 2020 à Mai 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 128
-
Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes. Méfaits Associés Aux Opioïdes et Aux Stimulants au Canada. Ottawa, ON: Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 129
-
Institut canadien d'information sur la santé. L'incidence de la COVID-19 sur Les Systèmes de Santé du Canada. Institut canadien d'information sur la santé; 2021.
- Note de bas de page 130
-
Institut canadien d'information sur la santé. Incidence de la COVID-19 sur Les Services D'urgence. Institut canadien d'information sur la santé; 2020.
- Note de bas de page 131
-
Agence de la santé publique du Canada. Enquête Concernant L'incidence de la COVID-19 sur la Capacité à Fournir des Services de Prévention, de Dépistage Ou de Traitement des Itss, Y Compris des Services de Réduction des Méfaits au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 132
-
Devakos, T, Gordon, M, Gurnham, M, Kim, J, Stephenson, M. Ministère de la Santé : Examen du Plan de Dépenses. Toronto, ON: Bureau de la responsabilité financière; 2021.
- Note de bas de page 133
-
Yong, JH, Mainprize, JG, Yaffe, MJ, Ruan, Y, Poirier, AE, Coldman, A, et al. The Impact of Episodic Screening Interruption: COVID-19 and Population-Based Cancer Screening in Canada. Journal of Medical Screening. 2020; 28(2):100-7.
- Note de bas de page 134
-
Pelland-Marcotte, MC, Xie, L, Barber, R, Elkhalifa, S, Frechette, M, Kaur, J, et al. Incidence of Childhood Cancer in Canada during the COVID-19 Pandemic. Canadian Medical Association Journal. 2021.
- Note de bas de page 135
-
Domingo, FR, Waddell, LA, Cheung, AM, Cooper, CL, Belcourt, VJ, Zuckermann, AME, et al. Prevalence of Long-Term Effects in Individuals Diagnosed with COVID-19: A Living Systematic Review. medRxiv. 2021.
- Note de bas de page 136
-
Survivor Corps. Post COVID Care Centers. Survivor Corps; 2021; disponible : https://www.survivorcorps.com/pccc-canada.
- Note de bas de page 137
-
Gouvernement du Canada. Syndrome Post-COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 138
-
CANCOV. The Canadian COVID-19 Prospective Cohort Study (CANCOV). CANCOV; 2020; disponible : https://cancov.net/.
- Note de bas de page 139
-
Institut canadien d'information sur la santé. La Main-D'œuvre de la Santé au Canada : Points Saillants de L'incidence de la COVID-19. Institut canadien d'information sur la santé; 2021.
- Note de bas de page 140
-
Bhatia, RS, Chu, C, Pang, A, Tadrous, M, Stamenova, V, Cram, P. Virtual Care Use before and during the COVID-19 Pandemic: A Repeated Cross-Sectional Study. Canadian Medical Association Open Access Journal. 2021; 9(1):E107-E14.
- Note de bas de page 141
-
Audy, E, Gamache, L, Gauthier, A, Lemétayer, F, Lessard, S, Melançon, A. Inégalités D'accès et D'usage des Technologies Numériques : Un Déterminant Préoccupant pour la Santé de la Population? Institut national de santé publique du Québec; 2021.
- Note de bas de page 142
-
Équipe spéciale sur l'accès equitable aux soins virtuels. Recommandations Fondées sur des Principes En Matière D'équité. Ottawa, ON: Santé Canada; 2021.
- Note de bas de page 143
-
Agence de la santé publique du Canada. Surveillance de L'influenza : Du 21 Juillet au 24 Août 2019 (Semaine de Déclaration 30-34). Gouvernement du Canada; 2019.
- Note de bas de page 144
-
Agence de la santé publique du Canada. Surveillance de L'influenza : Du 24 Juillet au 28 Août 2021 (Semaine de Déclaration 30-34). Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 145
-
Alberta Health. Alberta Sexually Transmitted Infections and HIV. Edmonton, AB: Government of Alberta; 2020.
- Note de bas de page 146
-
Ontario Agency for Health Protection and Promotion (Public Health Ontario). Monthly Infectious Diseases Surveillance Report: Diseases of Public Health Significance Cases for January to December 2020. Toronto, ON: Queen's Printer for Ontario; 2021.
- Note de bas de page 147
-
Tam, T. Lutte Contre la Stigmatisation : Vers Un Système de Santé Plus Inclusif. Ottawa, ON: Agence de la santé publique du Canada; 2019.
- Note de bas de page 148
-
Shurgold, J, Avery, B, Rank, C, Volling, C, Béïque, L, Gravel-Tropper, D, et al. Système Canadien de Surveillance de la Résistance Aux Antimicrobiens. Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 149
-
Statistique Canada. Tableau 13-10-0809-01 Santé des Canadiens et COVID-19, Selon L'âge et le Genre de la Personne. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 150
-
Statistique Canada. La COVID-19 au Canada: le Point sur Les Répercussions Sociales et Économiques Après Un An. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 151
-
Agence de la santé publique du Canada. Symptômes du Trouble de Stress Post-Traumatique Durant la Pandémie de COVID-19. Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 152
-
Agence de la santé publique du Canada. Symptômes D'anxiété et de Dépression Durant la Pandémie de COVID-19. Agence de la santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 153
-
Cost, KT, Crosbie, J, Anagnostou, E, Birken, CS, Charach, A, Monga, S, et al. Mostly Worse, Occasionally Better: Impact of COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Canadian Children and Adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry. 2021:1-14.
- Note de bas de page 154
-
Yousif, N. 4 Million Cries for Help: Calls to Kids Help Phone Soar Amid Pandemic. Toronto Star. 2020.
- Note de bas de page 155
-
Cabinet du Premier minister. Le Premier Ministre Annonce du Soutien pour Les Canadiens Vulnérables Qui Sont Touchés Par la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 156
-
Gadermann, AC, Thomson, KC, Richardson, CG, Gagné, M, McAuliffe, C, Hirani, S, et al. Examining the Impacts of the COVID-19 Pandemic on Family Mental Health in Canada: Findings from a National Cross-Sectional Study. British Medical Journal Open. 2021; 11(1).
- Note de bas de page 157
-
Sun, Y, Wu, Y, Bonardi, O, Krishnan, A, He, C, Boruff, JT, et al. Comparison of Mental Health Symptoms Prior to and during COVID-19: Evidence from a Living Systematic Review and Meta-Analysis. medRxiv. 2021.
- Note de bas de page 158
-
Liu, L, Capaldi, CA, Dopko, RL. Recherche Quantitative Originale – Idées Suicidaires au Canada Pendant la Pandémie de COVID-19. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2021.
- Note de bas de page 159
-
Mise à Jour Annuelle des Suicides au Québec. Association québécoise de prévention du suicide; 2021; disponible : https://www.aqps.info/semaine/communique-presse-mise-jour-annuelle-des-675.html.
- Note de bas de page 160
-
Pirkis, J, John, A, Shin, S, DelPozo-Banos, M, Arya, V, Analuisa-Aguilar, P, et al. Suicide Trends in the Early Months of the COVID-19 Pandemic: An Interrupted Time-Series Analysis of Preliminary Data from 21 Countries. The Lancet Psychiatry. 2021; 8(7):579-88.
- Note de bas de page 161
-
Botchway, S, Fazel, S. Remaining Vigilant About COVID-19 and Suicide. The Lancet Psychiatry. 2021; 8(7):552-3.
- Note de bas de page 162
-
Belzak, L, Halverson, J. The Opioid Crisis in Canada: A National Perspective. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada. 2018; 38(6):224-33.
- Note de bas de page 163
-
Morin, KA, Eibl, JK, Franklyn, AM, Marsh, DC. The Opioid Crisis: Past, Present and Future Policy Climate in Ontario, Canada. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2017; 12(1).
- Note de bas de page 164
-
British Columbia Coroners Service. Illicit Drug Toxicity Deaths in Bc January 1, 2011 – June 30, 2021. Government of British Columbia; 2021.
- Note de bas de page 165
-
Gouvernement du Canada. Modélisation des Décès Par Surdose D'opioïdes Pendant L'éclosion de COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 166
-
Adelson, N. The Embodiment of Inequity: Health Disparities in Aboriginal Canada. Canadian Journal of Public Health. 2005; 96(2):S45-S61.
- Note de bas de page 167
-
Government of Alberta. Alberta Opioid Response Surveillance Report: First Nations People in Alberta. Government of Alberta; 2021.
- Note de bas de page 168
-
First Nations Health Authority. First Nations Toxic Drug Deaths Doubled During the Pandemic in 2020. First Nations Health Authority; 2021.
- Note de bas de page 169
-
Institut canadien d'information sur la santé. Conséquences Inattendues de la Pandémie de COVID-19 : Méfaits Causés Par L'utilisation de Substances. Ottawa, ON: Institut canadien d'information sur la santé; 2021.
- Note de bas de page 170
-
Santé Canada. Exemption de Catégorie de Personnes En Vertu du Paragraphe 56(1) Visant Les Patients, Les Pharmaciens et Les Praticiens pour la Prescription et la Fourniture de Substances Désignées au Canada. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 171
-
Henry, B. Order of the Provincial Health Officer: Registered Nurse and Registered Psychiatric Nurse Public Health Pharmacotherapy. Government of British Columbia; 2021.
- Note de bas de page 172
-
Santé Canada. Le Gouvernement du Canada Appuie L'expansion D'un Projet Novateur D'approvisionnement Plus Sécuritaire pour Qu'il Soit Offert Dans Quatre Villes au Pays. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 173
-
Varin, M, Hill MacEachern, K, Hussain, N, Baker, MM. Aperçu – Mesurer Les Changements Autodéclarés Relatifs à la Consommation D'alcool et de Cannabis au Cours de la Deuxième Vague de la Pandémie de COVID-19 au Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2021.
- Note de bas de page 174
-
Statistique Canada. Consommation D'alcool et de Cannabis Pendant la Pandémie: Série D'enquêtes sur Les Perspectives Canadiennes 6. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 175
-
Statistique Canada. Enquête sur la Population Active, Décembre 2020. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 176
-
Statistique Canada. Enquête sur la Population Active, Avril 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 177
-
Statistique Canada. Enquête sur la Population Active, Juillet 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 178
-
Statistique Canada. Enquête sur la Population Active, Juin 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 179
-
Statistique Canada. Enquête sur la Population Active, Février 2021. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 180
-
Statistique Canada. Tableau 14-10-0342-01 Durée du Chômage, Données Mensuelles Désaisonnalisées. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 181
-
Muntaner, C, Solar, O, Vanroelen, C, Martínez, JM, Vergara, M, Santana, V, et al. Unemployment, Informal Work, Precarious Employment, Child Labor, Slavery, and Health Inequalities: Pathways and Mechanisms. International Journal of Health Services. 2010; 40(2):281-95.
- Note de bas de page 182
-
Benach, J, Vives, A, Amable, M, Vanroelen, C, Tarafa, G, Muntaner, C. Precarious Employment: Understanding an Emerging Social Determinant of Health. Annual Review of Public Health. 2014; 35(1):229-53.
- Note de bas de page 183
-
Tran, M, Sokas, RK. The Gig Economy and Contingent Work: An Occupational Health Assessment. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2017; 59(4):e63-e6.
- Note de bas de page 184
-
Statistique Canada. Le Bien-Être Économique des Ménages Durant la Pandémie de COVID-19, Estimations Expérimentales, Premier Trimestre au Troisième Trimestre de 2020. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 185
-
Segal, H, Forget, E, Banting, K. Un Revenue de Base Fédéral Dans le Plan D'action pour la Relance Économique de L'après-COVID-19. Société royale du Canada; 2020.
- Note de bas de page 186
-
Men, F, Tarasuk, V. Food Insecurity Amid the COVID-19 Pandemic: Food Charity, Government Assistance, and Employment. Canadian Public Policy. 2021.
- Note de bas de page 187
-
Polsky, JY, Gilmour, H. Food Insecurity and Mental Health during the COVID-19 Pandemic. Health Reports. 2020.
- Note de bas de page 188
-
Statistique Canada. L'insécurité Alimentaire Pendant la Pandémie COVID-19, Mai 2020. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 189
-
Gionet, L, Roshanafshar, S. Certains Indicateurs de la Santé des Membres des Premières Nations Vivant Hors Réserve, des Métis et des Inuits. Statistique Canada; 2015.
- Note de bas de page 190
-
Statistique Canada. Série D'enquêtes sur Les Perspectives Canadiennes 1 : Répercussions de la COVID-19. Le Quotidien; 2020.
- Note de bas de page 191
-
Shields, M, Tonmyr, L, Gonzalez, A, Weeks, M, Park, S, Robert, A, et al. Symptômes du Trouble Dépressif Majeur Pendant la Pandémie de COVID-19: Résultats Obtenus à Partir D'un Échantillon Représentatif de la Population Canadienne. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2021.
- Note de bas de page 192
-
Prokopenko, E, Kevins, C. Vulnérabilités Liées à la COVID-19 Chez Les Canadiens et Les Canadiennes LGBTQ2+. Statistique Canada; 2020.
- Note de bas de page 193
-
Thompson, N. Reports of Domestic, Intimate Partner Violence Continue to Rise during Pandemic. CBC News. 2021.
- Note de bas de page 194
-
Statistique Canada. Expérience de la Discrimination Pendant la Pandémie de COVID-19. Le Quotidien; 2020.
- Note de bas de page 195
-
Manojlovic, D. Year-End 2020 Year-to-Date Key Performance Indicators Report. Vancouver Police Board; 2021.
- Note de bas de page 196
-
Ville d'Ottawa. Ottawa Assiste à Une Hausse D'actes de Racisme Envers Les Asiatiques. Ottawa, ON: Ville d'Ottawa; 2021.
- Note de bas de page 197
-
Statistique Canada. Fermetures D'écoles et COVID-19 : Outil Interactif. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 198
-
Gallagher-Mackay, K, Srivastava, P, Underwood, K, Dhuey, E, McCready, L, Born, KB, et al. COVID-19 and Education Disruption in Ontario: Emerging Evidence on Impacts. Ontario COVID-19 Science Advisory Table; 2021. disponible : https://doi.org/10.47326/ocsat.2021.02.34.1.0.
- Note de bas de page 199
-
Melançon, A. COVID-19 : Impacts de la Pandémie sur le Développement des Enfants de 2 à 12 Ans. Institut national de santé publique du Québec; 2021.
- Note de bas de page 200
-
Representative for Children and Youth. Left Out: Children and Youth with Special Needs in the Pandemic. Representative for Children and Youth; 2020.
- Note de bas de page 201
-
Zwaigenbaum, L, Brian, JA, Ip, A. Le Dépistage Précoce du Trouble du Spectre de L'autisme Chez Les Jeunes Enfants. Paediatrics & Child Health. 2019; 24(7):424-32.
- Note de bas de page 202
-
Shaw, M, Hodgkins, P, Caci, H, Young, S, Kahle, J, Woods, AG, et al. A Systematic Review and Analysis of Long-Term Outcomes in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effects of Treatment and Non-Treatment. BioMed Central Medicine. 2012; 10.
- Note de bas de page 203
-
Chudley, AE, Conry, J, Cook, JL, Loock, C, Rosales, T, LeBlanc, N, et al. Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Canadian Guidelines for Diagnosis. Canadian Medical Association Journal. 2005; 172(5 Suppl):S1-S21.
- Note de bas de page 204
-
Charnock, S, Heisz, A, Kaddatz, J, Spinks, N, Mann, R. Le Bien-Être des Canadiens au Cours de la Première Année de la Pandémie de COVID-19. Statistique Canada; 2021.
- Note de bas de page 205
-
Ministère des Finances Canada. Budget 2021 : Une Relance Axée sur Les Emplois, la Croissance et la Résilience. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 206
-
Bureau du vérificateur général du Canada. Rapport 8 — Préparation En Cas de Pandémie, Surveillance et Mesures de Contrôle Aux Frontières. Bureau du vérificateur général du Canada; 2021.
- Note de bas de page 207
-
Agence de la santé publique du Canada. La Stratégie Pancanadienne de Données sur la Santé : Rapports et Sommaires des Comité Consultatif D'experts. Agence de santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 208
-
McKenzie, K. Race and Ethnicity Data Collection during COVID-19 in Canada: If You Are Not Counted You Cannot Count on the Pandemic Response. Ottawa, ON: Royal Society of Canada; 2020.
- Note de bas de page 209
-
City of Toronto. Toronto Public Health Releases New Socio-Demographic COVID-19 Data. City of Toronto; 2020.
- Note de bas de page 210
-
McKenzie, K. Socio-Demographic Data Collection and Equity in Covid-19 in Toronto. EClinicalMedicine. 2021; 34.
- Note de bas de page 211
-
City of Toronto. Black Scientists' Task Force on Vaccine Equity to Deliver Final Report and Recommendations to the Board of Health Today. City of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 212
-
Agence de la santé publique du Canada. La Stratégie Pancanadienne de Données sur la Santé : Aperçu du Comité Consultatif D'experts. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 213
-
Henry, B. Canadian Pandemic Influenza Preparedness: Communications Strategy. Canada Communicable Disease Report. 2018; 44(5):106-9.
- Note de bas de page 214
-
Agence de la santé publique du Canada. Édition du Dimanche de la Déclaration de L'ACSP : Se Préparer à Faire Face Aux Informations Erronées et à la Désinformation Pendant la Pandémie de COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 215
-
Organisation mondiale de la santé, Nations Unies, UNICEF, PNUD, UNESCO, ONUSIDA, et al. Gestion de L'infodémie sur la COVID-19 : Promouvoir des Comportements Sains et Atténuer Les Effets Néfastes de la Diffusion D'informations Fausses et Trompeuses. Organisation mondiale de la santé; 2020.
- Note de bas de page 216
-
Zarocostas, J. How to Fight an Infodemic. The Lancet. 2020; 395(10225):676.
- Note de bas de page 217
-
Dubé, E, Gagnon, D, Vivion, M. Pratiques Exemplaires Face à la Réticence à la Vaccination. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2020; 46(2/3):48-52.
- Note de bas de page 218
-
Office of Audit and Evaluation (Health Canada, Public Health Agency of Canada). Lessons Learned from the Public Health Agency of Canada's COVID-19 Response (Phase One). Government of Canada; 2020.
- Note de bas de page 219
-
MacDonald, NE. COVID-19, Public Health and Constructive Journalism in Canada. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(2):179-82.
- Note de bas de page 220
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Gouvernement du Canada Finance Deux Nouveaux Projets pour Inciter la Population Canadienne à Se Faire Vacciner. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 221
-
Ensemble Contre la Désinformation. LaSciencedAbord; 2021; disponible : https://www.scienceupfirst.com/?lang=fr.
- Note de bas de page 222
-
Maad'ookiing Mshkiki — Sharing Medicine: Connecting Indigenous Communities with Culturally Relevant COVID-19 Vaccine Information. University Health Network; 2021; disponible : https://www.uhn.ca/corporate/News/Pages/Sharing_Medicine_connecting_Indigenous_communities_with_culturally_relevant_COVID19_vaccine_information.aspx.
- Note de bas de page 223
-
Greenberg, J, Gauthier, B. Canada Needs a Fresh Strategy for Pandemic Communications. Policy Options. 2021.
- Note de bas de page 224
-
À Propos du Réseau Pancanadien de Santé Publique. Réseau pancanadien de santé publique; 2020; disponible : http://www.phn-rsp.ca/network-fra.php.
- Note de bas de page 225
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration du Conseil des Médecins Hygiénistes En Chef : Travailler En Collaboration Avec Les Canadiens sur la Gestion Continue de la COVID-19 au Cours des Prochains Mois. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 226
-
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration du Conseil des Médecins Hygiénistes En Chef : Mise En Œuvre de la Vaccination Contre la COVID-19 au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 227
-
COVID-END. COVID-END; 2021; disponible : https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end.
- Note de bas de page 228
-
CanCOVID. À Propos CanCOVID. CanCOVID; 2021; disponible : https://cancovid.ca/fr/a-propos/.
- Note de bas de page 229
-
CoVaRR-Net. CoVaRR-Net; 2021; disponible : https://covarrnet.ca/fr/accueil/.
- Note de bas de page 230
-
Gilmore, B, Ndejjo, R, Tchetchia, A, de Claro, V, Mago, E, Diallo, AA, et al. Community Engagement for COVID-19 Prevention and Control: A Rapid Evidence Synthesis. British Medical Journal Global Health. 2020; 5(10).
- Note de bas de page 231
-
Comité Consultatif Spécial sur la COVID-19. Réseau pancanadien de santé publique; 2021; disponible : http://www.phn-rsp.ca/sac-covid-ccs/index-fra.php.
- Note de bas de page 232
-
Service publique et approvisionnement Canada. Appuyer L'intervention du Canada Face à la COVID-19 : Comité Permanent des Opérations Gouvernementales et des Prévisions Budgétaires – Juillet 23 2020. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 233
-
Agence de la santé publique du Canada. Le Gouvernement du Canada Annoncera du Financement pour des Sites Sûrs D'isolement Volontaire Lié à la COVID-19 En Nouvelle-Écosse. Gouvernement du Canada 2021.
- Note de bas de page 234
-
Services aux Autochtones Canada. Le Gouvernement du Canada Fait le Point sur la COVID-19 Chez Les Autochtones et Dans Leurs Communautés, Semaine du 14 Juin. Gouvernement du Canada 2021.
- Note de bas de page 235
-
Vaccinated Métis Strong. Saskatoon, SK: Métis Nation Saskatchewan; 2021; disponible : https://metisnationsk.com/vaccine/.
- Note de bas de page 236
-
Connecting Culture Services & Community. Winnipeg, MB: Manitoba Inuit Association; 2021; disponible : https://www.manitobainuit.ca/.
- Note de bas de page 237
-
Gouvernement du Canada. Le Dépistage Aux Points de Service Permet Aux Collectivités Mal Desservies D'avoir Accès au Test de Dépistage Rapide de la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 238
-
Bureau du vérificateur général du Canada. Rapport 11 — Ressources En Santé pour Les Collectivités Autochtones — Services Aux Autochtones Canada. Bureau du vérificateur général du Canada; 2021.
- Note de bas de page 239
-
Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP). Rapport Final pour L'examen du Réseau Mondial D'information En Santé Publique (RMISP). Agence de santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 240
-
Gouvernement du Canada. Statistiques sur la Prestation Canadienne D'urgence et le Programme D'assurance-Emploi. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 241
-
Bureau du premier ministre du Canada. Création de 4 500 Logements pour Les Canadiens. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 242
-
Agence de la santé publique du Canada. Préparation du Canada En Cas de Grippe Pandémique : Guide de Planification pour le Secteur de la Santé. Gouvernement du Canada; 2018.
- Note de bas de page 243
-
Bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario. Préparation et Gestion En Lien Avec la COVID-19. Rapport Spécial sur Les Tests En Laboratoire, Gestion des Cas et Recherche des Contacts. Toronto, ON: Bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario; 2020.
- Note de bas de page 244
-
Bureau du vérificateur général du Canada. Rapport 10 — L'obtention D'équipement de Protection Individuelle et D'instruments Médicaux. Bureau du vérificateur général du Canada; 2021.
- Note de bas de page 245
-
Canadian Red Cross. Operations Report on September 7. Canadian Red Cross; 2021.
- Note de bas de page 246
-
Croix-Rouge Canadienne. Ce Que Fait la Croix-Rouge au Canada. Croix-Rouge Canadienne; 2021.
- Note de bas de page 247
-
Croix-Rouge Canadienne. Ligne Chronologique de Notre Réponse à la COVID-19. Croix-Rouge Canadienne; 2020.
- Note de bas de page 248
-
Defense Nationale. Opération LASER. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 249
-
Defense Nationale. Opération VECTOR. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 250
-
Hager, M, Lee, C. B.C. Vows to Improve Ambulance System after Heat Wave Overwhelms Emergency Services. The Globe and Mail. 2021.
- Note de bas de page 251
-
Roffel, B. B.C.'s Heat Wave Likely Contributed to 719 Sudden Deaths in a Week, Coroner Says — Triple the Usual Number. CBC News. 2021.
- Note de bas de page 252
-
Association canadienne de santé publique. La Santé Publique Dans le Contexte du Renouvellement du Système de Santé au Canada. Association canadienne de santé publique; 2019.
- Note de bas de page 253
-
Naylor, D, Basrur, S, Bergeron, MG, Brunham, RC, Butler-Jones, D, Dafoe, G, et al. Leçons de la Crise du Sras – Renouvellement de la Santé Publique au Canada – Rapport du Comité Consultatif National sur le Sras et la Santé Publique. Ottawa, ON: Comité consultatif national sur le SRAS et la Santé publique; 2003.
- Note de bas de page 254
-
Eggleton, A, Ogilvie, KK, Standing Senate Committee on Social Affairs Science and Technology. Canada's Response to the 2009 H1N1 Influenza Pandemic. Ottawa, ON: Senate, Government of Canada; 2010.
- Note de bas de page 255
-
Agence de la santé publique du Canada. Leçons à Retenir : Réponse de L'agence de la Santé Publique du Canada et de Santé Canada à la Pandémie de Grippe H1N1 de 2009. Ottawa, ON: Agence de santé publique du Canada; 2010.
- Note de bas de page 256
-
Frank, J, Di Ruggiero, E, Moloughney, B. The Future of Public Health in Canada: Developing a Public Health System for the 21st Century. Ottawa, ON: Canadian Institutes for Health Research; 2003.
- Note de bas de page 257
-
McMahon, M, Nadigel, J, Thompson, E, Glazier, RH. Informing Canada's Health System Response to COVID-19: Priorities for Health Services and Policy Research. Healthcare Policy. 2020; 16(1):112-24.
- Note de bas de page 258
-
Instituts de recherche en santé du Canada. Des Systèmes de Santé Publique Conçus pour L'avenir : Institut de la Santé Publique et des Populations des Irsc Document D'information sur le Contexte du Dialogue. Instituts de recherche en santé du Canada; 2021.
- Note de bas de page 259
-
Jones, E, MacDougall, H, Monnais, L, Hanley, J, Carstairs, C. Au-Delà de la Crise de la COVID-19 : Tirer des Leçons du Passé et des Occasions Manquées En Santé Publique. Société Royale du Canada; 2021.
- Note de bas de page 260
-
Association canadienne de santé publique. L'histoire de la Santé Publique au Canada. Association canadienne de santé publique; 2010.
- Note de bas de page 261
-
Santé Canada, Agence de santé publique du Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments. Résistance Aux Antibiotiques (Antimicrobiens). Gouvernement du Canada; 2018.
- Note de bas de page 262
-
Association canadienne de santé publique. Énoncé de Position : Les Changements Climatiques et la Santé Humaine. Ottawa, ON: Association canadienne de santé publique; 2019.
- Note de bas de page 263
-
Gouvernement du Canada. Faire Face à la Crise des Opioïdes au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 264
-
Rutter, H, Savona, N, Glonti, K, Bibby, J, Cummins, S, Finegood, DT, et al. The Need for a Complex Systems Model of Evidence for Public Health. The Lancet. 2017; 390(10112):2602-4.
- Note de bas de page 265
-
Zukowski, N, Davidson, S, Yates, MJ. Systems Approaches to Population Health in Canada: How Have They Been Applied, and What Are the Insights and Future Implications for Practice? Canadian Journal of Public Health. 2019; 110(6):741-51.
- Note de bas de page 266
-
Riley, BL, Robinson, KL, Gamble, J, Finegood, DT, Sheppard, D, Penney, TL, et al. Knowledge to Action for Solving Complex Problems: Insights from a Review of Nine International Cases. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada. 2015; 35(3):47-53.
- Note de bas de page 267
-
McGill, E, Er, V, Penney, T, Egan, M, White, M, Meier, P, et al. Evaluation of Public Health Interventions from a Complex Systems Perspective: A Research Methods Review. Social Science & Medicine. 2021; 272:113697.
- Note de bas de page 268
-
Decady, Y, Greenberg, L. Quatre-Vingt-Dix Ans de Changements Dans L'espérance de Vie. Statistique Canada; 2014.
- Note de bas de page 269
-
Association Canadienne de santé publique. 12 Grandes Réalisations. Association Canadienne de santé publique.
- Note de bas de page 270
-
Ehreth, J. The Value of Vaccination: A Global Perspective. Vaccine. 2003; 21(27):4105-17.
- Note de bas de page 271
-
Association Canadienne de santé publique. Chronologie de L'immunisation. Association Canadienne de santé publique.
- Note de bas de page 272
-
Agence de la santé publique du Canada. Maladies Évitables Par la Vaccination : Rapport de Surveillance En Date du 31 Décembre 2017. Ottawa, ON: Agence de la santé publique du Canada; 2020.
- Note de bas de page 273
-
Gouvernement du Canada. Guide Canadien D'immunisation : Introduction. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 274
-
Pless, R. Doing Well Still Needs to Sell: Bringing Vaccine-Preventable Diseases under Further Control in Canada Requires a Shift in Thinking. Paediatrics & Child Health. 1999; 4(1):16-8.
- Note de bas de page 275
-
Public Health Agency of Canada. Canadian Measles/Rubella Surveillance System. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 276
-
Public Health Agency of Canada. Canadian Notifiable Disease Surveillance System. Public Health Agency of Canada; 2021.
- Note de bas de page 277
-
Rutty, C, Sullivan, SC. This Is Public Health: A Canadian History. Ottawa, ON: Canadian Public Health Association; 2010.
- Note de bas de page 278
-
Jackson, BE. Situating Epidemiology. In: Texler Segal M, Demos V, Kronenfeld JJ, editors. Gender Perspectives on Health and Medicine: Emerald Group Publishing Limited; 2003. p. 11-58.
- Note de bas de page 279
-
Belshaw, JD. 7.2 - Social Reform. In: Canadian History: Post-Confederation. Victoria, BC: BCcampus; 2016.
- Note de bas de page 280
-
Bryant, T. Health Policy in Canada. Second Edition. Toronto, ON: Canadian Scholars' Press Inc.; 2016.
- Note de bas de page 281
-
Santé Canada. Le Système des Soins de Santé du Canada. Gouvernement du Canada; 2019.
- Note de bas de page 282
-
Public Health Agency of Canada. Canadian Reference Group on Social Determinants of Health. World Health Organization; 2011.
- Note de bas de page 283
-
Lalonde, M. Nouvelle Perspective de la Santé des Canadiens : Un Document de Travail. Ottawa, ON: Ministre de la Santé national et du bien-être social; 1974.
- Note de bas de page 284
-
Potvin, L, Jones, CM. Twenty-Five Years after the Ottawa Charter: The Critical Role of Health Promotion for Public Health. Canadian Journal of Public Health. 2011; 102(4):244-8.
- Note de bas de page 285
-
Allan, B, Smylie, J. First Peoples, Second Class Treatment: The Role of Racism in the Health and Well-Being of Indigenous Peoples in Canada. Toronto, ON: Wellesley Institute; 2015.
- Note de bas de page 286
-
Enquêtes nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Réclamer Notre Pouvoir et Notre Place : le Rapport Final de L'enquête Nationale sur Les Femmes et Les Filles Autochtones Disparues et Assassinées. Enquêtes nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; 2019.
- Note de bas de page 287
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Rapports de la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada. Centre national pour la vérité et la réconciliation; 2015; disponible : https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr.
- Note de bas de page 288
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Honorer la Vérité, Réconcilier pour L'avenir : Sommaire du Rapport Final de la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada. Commission de vérité et réconciliation du Canada; 2015.
- Note de bas de page 289
-
Turpel-Lafond, ME. In Plain Sight: Addressing Indigenous-Specific Racism and Discrimination in B.C. Health Care. Office of the British Columbia Minister of Health; 2020.
- Note de bas de page 290
-
Commission de l'Organisation panaméricaine de la Santé sur l'équité et les inégalités en santé dans les Amériques. Sociétés Justes: Équité En Santé et Vie Digne. Washington, D.C.: Organisation Panaméricain de la santé; 2019.
- Note de bas de page 291
-
Allen, L, Hatala, A, Ijaz, S, Courchene, ED, Bushie, EB. Indigenous-Led Health Care Partnerships in Canada. Canadian Medical Association Journal. 2020; 192(9):E208.
- Note de bas de page 292
-
Richmond, C, Ambtman-Smith, V, Bourassa, C, Cassidy-Mathews, C, Duhamel, K, Keewatin, M, et al.La COVID-19 et la Santé et le Bien-Être des Autochtones: Nos Histoires Sont Notre Atout et Témoignent de Notre Resilience. Société royale du Canada; 2020.
- Note de bas de page 293
-
Santé Canada, l'Assemblée des Premières Nations. Cadre du Continuum du Mieux-Être Mental des Premières Nations - Rapport Sommaire. Ottawa, ON: Santé Canada; 2015.
- Note de bas de page 294
-
Health Canada, Assembly of First Nations, National Native Addictions Partnership Foundation Inc. Honouring Our Strengths: A Renewed Framework to Address Substance Use Issues among First Nations People in Canada. Ottawa, ON: Health Canada; 2011.
- Note de bas de page 295
-
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Ce Que Nous Avons Retenu : Les Principes de la Vérité et de la Réconciliation. Commission de vérité et réconciliation du Canada; 2015.
- Note de bas de page 296
-
Commission royale sur les peuples autochtones. Sur le Chemin de la Guérison : Rapport de la Table Ronde Nationale sur la Santé et Les Questions Sociales. Vancouver, BC: Commission royale sur les peuples autochtones; 1993.
- Note de bas de page 297
-
Organisation mondiale de la santé. L'approche Multisectorielle de L'OMS «Un Monde, Une Santé». Organisation mondiale de la santé; 2017.
- Note de bas de page 298
-
Mackenzie, JS, Jeggo, M. The One Health Approach-Why Is It So Important? Tropical Medicine and Infectious Disease. 2019; 4(2):88.
- Note de bas de page 299
-
Ruckert, A, Zinszer, K, Zarowsky, C, Labonté, R, Carabin, H. What Role for One Health in the COVID-19 Pandemic? Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(5):641-4.
- Note de bas de page 300
-
Kahn, LH. Antimicrobial Resistance: A One Health Perspective. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2017; 111(6):255-60.
- Note de bas de page 301
-
University of Calgary. Antimicrobial Resistance - One Health Consortium. University of Calgary; 2021; disponible : https://research.ucalgary.ca/amr.
- Note de bas de page 302
-
Mehrotra, M, Li, XZ, Ireland, MJ. Amélioration de la Gestion des Antimicrobiens Par le Renforcement du Cadre de Réglementation des Médicaments Vétérinaires. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2017; 43(11):220-3.
- Note de bas de page 303
-
Agence de la santé publique du Canada. Lutter Contre la Résistance Aux Antimicrobiens et Optimiser Leur Utilisation : Un Cadre D'action Pancanadien. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2017; 43(11):217-9.
- Note de bas de page 304
-
Upshaw, TL, Brown, C, Smith, R, Perri, M, Ziegler, C, Pinto, AD. Social Determinants of COVID-19 Incidence and Outcomes: A Rapid Review. PloS one. 2021; 16(3):e0248336.
- Note de bas de page 305
-
Etowa, J, Hyman, I. Unpacking the Health and Social Consequences of COVID-19 through a Race, Migration and Gender Lens. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(1):8-11.
- Note de bas de page 306
-
Thompson, E, Edjoc, R, Atchessi, N, Striha, M, Gabrani-Juma, I, Dawson, T. COVID-19 : Un Argument En Faveur de la Collecte de Données sur Les Populations Racialisées au Canada et à L'étranger. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2021; 47(7-8):300-4.
- Note de bas de page 307
-
Government of Manitoba. COVID-19 Infections in Manitoba: Race, Ethnicity, and Indigeneity. Government of Manitoba; 2021.
- Note de bas de page 308
-
Wellesley Insititute, Ontario Health. Tracking COVID-19 through Race-Based Data. Ontario Health; 2021.
- Note de bas de page 309
-
Thakur, B, Dubey, P, Benitez, J, Torres, JP, Reddy, S, Shokar, N, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Geographic Differences in Comorbidities and Associated Severity and Mortality among Individuals with COVID-19. Scientific Reports. 2021; 11(1):8562.
- Note de bas de page 310
-
Réseau pancanadien de santé publique. Les Principales Inégalités En Santé au Canada : Un Portrait National. Réseau pancanadien de santé publique; 2018.
- Note de bas de page 311
-
Gagné, T, Veenstra, G. Inequalities in Hypertension and Diabetes in Canada: Intersections between Racial Identity, Gender, and Income. Ethnicity & Disease. 2017; 27(4):371-8.
- Note de bas de page 312
-
Chu, M, Truscott, R, Young, S, Harrington, D, Keller-Olaman, S, Manson, H, et al. The Burden of Chronic Diseases in Ontario: Key Estimates to Support Efforts in Prevention. Cancer Care Ontario, Public Health Ontario; 2019.
- Note de bas de page 313
-
Dai, H, Younis, A, Kong, JD, Bragazzi, NL, Wu, J. Trends and Regional Variation in Prevalence of Cardiovascular Risk Factors and Association with Socioeconomic Status in Canada, 2005-2016. Journal of the American Medical Association Network Open. 2021; 4(8):e2121443.
- Note de bas de page 314
-
Anand, SS, Abonyi, S, Arbour, L, Balasubramanian, K, Brook, J, Castleden, H, et al. Explaining the Variability in Cardiovascular Risk Factors among First Nations Communities in Canada: A Population-Based Study. The Lancet Planetary Health. 2019; 3(12):e511-e20.
- Note de bas de page 315
-
Vanasse, A, Courteau, J, Asghari, S, Leroux, D, Cloutier, L. Health Inequalities Associated with Neighbourhood Deprivation in the Quebec Population with Hypertension in Primary Prevention of Cardiovascular Disease. Chronis Diseases and Injuries in Canada. 2014; 34(4):181-94.
- Note de bas de page 316
-
Nash, DM, Dirk, JS, McArthur, E, Green, ME, Shah, BR, Walker, JD, et al. Kidney Disease and Care among First Nations People with Diabetes in Ontario: A Population-Based Cohort Study. Canadian Medical Association Journal Open. 2019; 7(4):E706.
- Note de bas de page 317
-
Thomas, DA, Huang, A, McCarron, MCE, Kappel, JE, Holden, RM, Yeates, KE, et al. A Retrospective Study of Chronic Kidney Disease Burden in Saskatchewan's First Nations People. Canadian Journal of Kidney Health and Disease. 2018; 5.
- Note de bas de page 318
-
Choi, KH, Denice, P, Haan, M, Zajacova, A. Studying the Social Determinants of COVID-19 in a Data Vacuum. Canadian Review of Sociology. 2021; 58(2):146-64.
- Note de bas de page 319
-
Sundaram, ME, Calzavara, A, Mishra, S, Kustra, R, Chan, AK, Hamilton, MA, et al. Individual and Social Determinants of SARS-Cov-2 Testing and Positivity in Ontario, Canada: A Population-Wide Study. Canadian Medical Association Journal. 2021; 193(20):E723.
- Note de bas de page 320
-
Yeates, K, Tonelli, M. Chronic Kidney Disease among Aboriginal People Living in Canada. Clinical Nephrology. 2010; 74(1):57-60.
- Note de bas de page 321
-
Garcia-Garcia, G, Jha, V, on behalf of the World Kidney Day Steering Committee. CKD in Disadvantaged Populations. Canadian Journal of Kidney Health and Disease. 2015; 2(1):3-6.
- Note de bas de page 322
-
Public Health Ontario. Enhanced Epidemiological Summary: COVID-19 in Ontario – a Focus on Material Deprivation. Public Health Ontario; 2020.
- Note de bas de page 323
-
Solar, O, Irwin, A. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. Social Determinants of Health Discussion Paper 2 (Policy and Practice). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007.
- Note de bas de page 324
-
Ndumbe-Eyoh, S, Muzumdar, P, Betker, C, Oickle, D. 'Back to Better': Amplifying Health Equity, and Determinants of Health Perspectives during the COVID-19 Pandemic. Global Health Promotion. 2021; 28(2):7-16.
- Note de bas de page 325
-
Knaak, S, Livingston, J, Stuart, H, Ungar, T. Lutter Contre la Stigmatisation Structurelle Entourant Les Problèmes de Santé Mentale et de Consommation de Substances Dans Les Établissements de Soins de Santé – Cadre D'action. Ottawa, ON: Comission de la santé mentale du Canada; 2020.
- Note de bas de page 326
-
Johnson-Agbakwu, CE, Ali, NS, Oxford, CM, Wingo, S, Manin, E, Coonrod, DV. Racism, COVID-19, and Health Inequity in the USA: A Call to Action. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities. 2020:1-7.
- Note de bas de page 327
-
Kunins, HV. Structural Racism and the Opioid Overdose Epidemic: The Need for Antiracist Public Health Practice. Journal of Public Health Management and Practice. 2020; 26(3):201-5.
- Note de bas de page 328
-
Dryden, O, Nnorom, O. Time to Dismantle Systemic Anti-Black Racism in Medicine in Canada. Canadian Medical Association Journal. 2021; 193(2):E55-E7.
- Note de bas de page 329
-
Richardson, L, Crawford, A. COVID-19 and the Decolonization of Indigenous Public Health. Canadian Medical Association Journal. 2020; 192(38):E1098-E100.
- Note de bas de page 330
-
Annals of Family Medicine. A Shared Bibliography on Systemic Racism and Health Disparities. Annals of Family Medicine; 2020; disponible : https://www.annfammed.org/content/shared-bibliography-systemic-racism-and-health-disparities.
- Note de bas de page 331
-
Krieger, N. Enough: COVID-19, Structural Racism, Police Brutality, Plutocracy, Climate Change—and Time for Health Justice, Democratic Governance, and an Equitable, Sustainable Future. American Journal of Public Health. 2020; 110(11):1620-3.
- Note de bas de page 332
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. L'intégration des Déterminants Sociaux de la Santé et de L'équité En Santé Dans Les Pratiques de Santé Publique au Canada : Analyse du Contexte En 2010. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2010.
- Note de bas de page 333
-
Jensen, N, Kelly, AH, Avendano, M. The COVID-19 Pandemic Underscores the Need for an Equity-Focused Global Health Agenda. Humanities and Social Sciences Communications. 2021; 8(1):15.
- Note de bas de page 334
-
Blair, A, Warsame, K, Naik, H, Byrne, W, Parnia, A, Siddiqi, A. Identifying Gaps in COVID-19 Health Equity Data Reporting in Canada Using a Scorecard Approach. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(3):352-62.
- Note de bas de page 335
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Instaurer Une Culture D'équité Dans le Secteur de la Santé Publique au Canada : Une Analyse du Contexte. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2018.
- Note de bas de page 336
-
Marchildon, GP, Allin, S, Merkur, S. Canada: Health System Review. Third Edition. Copenhagen, Denmark: North American Observatory on Health Systems and Policies & European Observatory on Health Systems and Policies, WHO Regional Office for Europe; 2020.
- Note de bas de page 337
-
Santé Canada. Portefeuille de la Santé. Gouvernement du Canada; 2017.
- Note de bas de page 338
-
Services aux Autochtones Canada. Soins de Santé pour Les Autochtones au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 339
-
Halseth, R, Murdock, L. Appuyer L'autodétermination des Peuples Autochtones En Matière de Santé : Leçons Tirées D'un Examen des Pratiques Exemplaires En Matière de Gouvernance de la Santé au Canada et Dans le Monde. Prince George, BC: Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2020.
- Note de bas de page 340
-
Services aux Autochtones Canada. Santé des Autochtones. Services aux Autochtones Canada; 2021.
- Note de bas de page 341
-
First Nations Health Authority. FNHA Mandate. First Nations Health Authority.
- Note de bas de page 342
-
World Health Organization. Essential Public Health Functions, Health Systems, and Health Security: Developing Conceptual Clarity and a WHO Roadmap for Action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018.
- Note de bas de page 343
-
Bettcher, DW, Sapirie, S, Goon, EH. Essential Public Health Functions: Results of the International Delphi Study. World Health Statistics Quarterly. 1998; 51(1):44-54.
- Note de bas de page 344
-
Report of the National Advisory Committee on Population Health (ACPH). In: Naylor D, Basrur S, Bergeron MG, Brunham RC, Butler-Jones D, Dafoe G, et al., editors. Learning from SARS: Renewal of Public Health in Canada. Ottawa, ON: National Advisory Committee on SARS and Public Health; 2003.
- Note de bas de page 345
-
Centres for Disease Control and Prevention. 10 Essential Public Health Services. Centres for Disease Control and Prevention; 2020.
- Note de bas de page 346
-
Pan American Health Organization. The Essential Public Health Functions in the Americas: A Renewal for the 21st Century - Conceptual Framework and Description. Washington, D.C.: Pan American Health Organization; 2020.
- Note de bas de page 347
-
World Health Organization. Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes - WHO's Framework for Action. World Health Organization; 2007.
- Note de bas de page 348
-
Hawe, P, Potvin, L. What Is Population Health Intervention Research? Canadian Journal of Public Health. 2009; 100(1):I8-I14.
- Note de bas de page 349
-
Frieden, TR. A Framework for Public Health Action: The Health Impact Pyramid. American Journal of Public Health. 2010; 100(4):590-5.
- Note de bas de page 350
-
Carey, G, Crammond, B, De Leeuw, E. Towards Health Equity: A Framework for the Application of Proportionate Universalism. International Journal for Equity in Health. 2015; 14(1):81.
- Note de bas de page 351
-
Rideout, K, Oickle, D. Glossary of Health Equity in the Context of Environmental Public Health Practice. Journal of Epidemiology and Community Health. 2019; 73(9):806.
- Note de bas de page 352
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Les Démarches Ciblées et Universelles En Matière D'équité En Santé : Parlons-En. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2013.
- Note de bas de page 353
-
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils. La Prise de Décision Éclairée Par des Données Probantes En Santé Publique. Centre de collaboration nationale des méthodes et outils; 2021.
- Note de bas de page 354
-
Brownson, RC, Fielding, JE, Maylahn, CM. Evidence-Based Public Health: A Fundamental Concept for Public Health Practice. Annual Review of Public Health. 2009; 30(1):175-201.
- Note de bas de page 355
-
Dubois, A, Lévesque, M. Les Centres de Collaboration Nationale du Canada : Faciliter la Prise de Décisions Informées Par des Données Probantes En Santé Publique. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2020; 46(2-3):31-5.
- Note de bas de page 356
-
Husson, H, Howarth, C, Neil-Sztramko, S, Dobbins, M. Le Centre de Collaboration Nationale des Méthodes et Outils (Ccnmo) : Soutenir la Prise de Décisions Fondée sur des Données Probantes En Santé Publique au Canada. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2021; 47(5-6):292-6.
- Note de bas de page 357
-
Peters, DH, Tran, NT, Adam, T. Implementation Research in Health: A Practical Guide. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization; 2013.
- Note de bas de page 358
-
Centres de Collaboration Nationale En Santé Publique. Centres de collaboration nationale en santé publique; disponible : https://ccnsp.ca/.
- Note de bas de page 359
-
Mackintosh, J, Ciliska, D, Tulloch, K. Evidence-Informed Decision Making in Public Health in Action. Environmental Health Review. 2015; 58(1):15-9.
- Note de bas de page 360
-
Ciliska, D, Thomas, H, Buffett, C. An Introduction to Evidence-Informed Public Health and a Compendium of Critical Appraisal Tools for Public Health Practice. National Collaborating Centre for Methods and Tools; 2008.
- Note de bas de page 361
-
Jacobs, JA, Jones, E, Gabella, BA, Spring, B, Brownson, RC. Tools for Implementing an Evidence-Based Approach in Public Health Practice. Preventing chronic disease. 2012; 9:E116-E.
- Note de bas de page 362
-
Brownson, RC, Baker, EA, Deshpande, AD, Gillespie, KN. Evidence-Based Public Health. 3rd. Oxford University Press; 2017.
- Note de bas de page 363
-
Agence de la santé publique du Canada. Laboratoire National de Microbiologie. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 364
-
Public Health Agency of Canada. National Emergency Strategic Stockpile. Government of Canada; 2019.
- Note de bas de page 365
-
World Health Organization. Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) - Zero Impact from Health Threats. World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 366
-
Budd, J, Miller, BS, Manning, EM, Lampos, V, Zhuang, M, Edelstein, M, et al. Digital Technologies in the Public-Health Response to COVID-19. Nature Medicine. 2020; 26(8):1183-92.
- Note de bas de page 367
-
Agence de la santé publique du Canada. Compétences Essentielles En Santé Publique au Canada. Ottawa, ON: Gouvernement du Canada; 2007.
- Note de bas de page 368
-
Groupe de travail conjoint sur les ressources humaines en santé publique. Édifier Une Main-D'œuvre En Santé Publique pour le 21ième Siècle : Un Cadre Pancanadien pour la Planification des Ressources Humaines En Santé Publique. Gouvernement du Canada; 2005.
- Note de bas de page 369
-
Massé, R, Moloughney, B. New Era for Schools of Public Health in Canada. Public Health Reviews. 2011; 33:277-88.
- Note de bas de page 370
-
Tikkanen, R, Osborn, R, Mossialos, E, Djordjevic, A, Wharton, GA. International Health Care System Profiles - Canada. The Commonwealth Fund; 2020.
- Note de bas de page 371
-
Mowat, DL, Butler-Jones, D. Public Health in Canada: A Difficult History. Healthcare Papers. 2007; 7(3):31-6.
- Note de bas de page 372
-
Association Canadienne de santé publique. La Santé Publique Dans le Contexte du Renouvellement du Système de Santé au Canada : Document D'information. Association Canadienne de santé publique; 2019.
- Note de bas de page 373
-
Norris, S. Le Financement Fédéral des Soins de Santé : Étude Général. Ottawa, ON: Bibliothèque du Parlement; 2020.
- Note de bas de page 374
-
Gouvernement du Canada. COVID-19 : Soutien Aux Provinces et Aux Territoires. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 375
-
Institut canadien d'information sur la santé. Tendances des Dépenses Nationales de Santé. Ottawa, ON: Institut canadien d'information sur la santé; 2020.
- Note de bas de page 376
-
Masters, R, Anwar, E, Collins, B, Cookson, R, Capewell, S. Return on Investment of Public Health Interventions: A Systematic Review. Journal of Epidemiology and Community Health. 2017; 71(8):827-34.
- Note de bas de page 377
-
Nurse, J, Dorey, S, Yao, L, Sigfrid, L, Yfantopolous, P, McDaid, D, et al. The Case for Investing in Public Health: A Public Health Summary Report for EPHO 8. World Health Organization; 2014.
- Note de bas de page 378
-
World Health Organization. Commission on Social Determinants of Health, 2005-2008. World Health Organization; 2008.
- Note de bas de page 379
-
Di Ruggiero, E, Bhatia, D, Umar, I, Arpin, E, Champagne, C, Clavier, C, et al.Gouverner pour la Santé du Public: Options de Gouvernance pour Un Système de Santé Publique Renforcé et Renouvelé au Canada. Centre de collaboration nationale en santé publique; [dans la presse].
- Note de bas de page 380
-
Dyke, E. Ce Que Nous Avons Entendu : Renouvellement et Renforcement du Système de Santé Publique au Canada. Agence de santé publique du Canada; [dans la presse].
- Note de bas de page 381
-
Ndumbe-Eyoh, S, Moffatt, H. Intersectoral Action for Health Equity: A Rapid Systematic Review. BioMed Central Public Health. 2013; 13(1):1056.
- Note de bas de page 382
-
Lucyk, K. Commentaire – Action Intersectorielle sur Les Déterminants Sociaux de la Santé et L'équité En Santé au Canada : Examen des Lettres de Mandat du Gouvernement Fédéral de Décembre 2019. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2020; 40(10):10.
- Note de bas de page 383
-
Diallo, T. Cinq Exemples D'actions Intersectorielles En Faveur de la Santé à L'échelle Locale et Régionale au Canada. Montréal, QC: Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2020.
- Note de bas de page 384
-
National Academies of Sciences Engineering and Medicine. 7 - Partners in Promoting Health Equity in Communities. In: Baciu A, Negussie Y, Geller A, et al., editors. Communities in Action: Pathways to Health Equity. Washington, DC: National Academies Press; 2017. p. 383-446.
- Note de bas de page 385
-
Mulligan, K. Renforcer Les Liens Communautaires : L'avenir de la Santé Publique Se Joue à L'échelle des Quartiers. Centre de collaboration nationale en santé publique; [dans la presse].
- Note de bas de page 386
-
Commission des déterminants sociaux de la santé. Combler le Fossé En Une Génération : Instaurer L'équité En Santé En Agissant sur Les déterminants Sociaux de la Santé. Organisation mondiale de la Santé; 2009.
- Note de bas de page 387
-
Bay Area Regional Health Inequities Initiative. A Public Health Framework for Reducing Health Inequities: Bay Area Regional Health Inequities Initiative; 2020. disponible : https://www.barhii.org/barhii-framework.
- Note de bas de page 388
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Se Diriger Vers L'amont : Parlons-En. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2014.
- Note de bas de page 389
-
Lorenc, T, Petticrew, M, Welch, V, Tugwell, P. What Types of Interventions Generate Inequalities? Evidence from Systematic Reviews. Journal of Epidemiology and Community Health. 2013; 67(2):190.
- Note de bas de page 390
-
Litvak, E, Dufour, R, Leblanc, É, Kaiser, D, Mercure, S-A, Nguyen, CT, et al. Making Sense of What Exactly Public Health Does: A Typology of Public Health Interventions. Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(1):65-71.
- Note de bas de page 391
-
Jarvis, T, Scott, F, El-Jardali, F, Alvarez, E. Defining and Classifying Public Health Systems: A Critical Interpretive Synthesis. Health Research Policy and Systems. 2020; 18(1):68.
- Note de bas de page 392
-
Liburd, LC, Hall, JE, Mpofu, JJ, Williams, SM, Bouye, K, Penman-Aguilar, A. Addressing Health Equity in Public Health Practice: Frameworks, Promising Strategies, and Measurement Considerations. Annual Review of Public Health. 2020; 41(1):417-32.
- Note de bas de page 393
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Évaluation de L'incidence et de L'efficacité de L'action Intersectorielle Exercée sur Les Déterminants Sociaux de la Santé et L'équité En Santé : Une Revue Systématique Accélérée. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2012.
- Note de bas de page 394
-
Tonelli, M, Tang, K-C, Forest, P-G. Canada Needs a “Health in All Policies” Action Plan Now. Canadian Medical Association Journal. 2020; 192(3):E61.
- Note de bas de page 395
-
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Évaluation D'impact sur la Santé. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2010.
- Note de bas de page 396
-
Freeman, S. Survol des Besoins et des Connaissances En Matière D'évaluation des Impacts sur la Santé (EIS) du CCNSE. Vancouver, BC: Centre de collaboration nationale en santé environnementale; 2019.
- Note de bas de page 397
-
McCallum, LC, Ollson, CA, Stefanovic, IL. Advancing the Practice of Health Impact Assessment in Canada: Obstacles and Opportunities. Environmental Impact Assessment Review. 2015; 55:98-109.
- Note de bas de page 398
-
Diallo, T, Freeman, S. Health Impact Assessment—Insights from the Experience of Québec. Environmental Health Review. 2020; 63(1):6-13.
- Note de bas de page 399
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Impact Collectif et Santé Publique : Une Ancienne et Une Nouvelle Démarche — Récit de Deux Initiatives Canadiennes. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2017.
- Note de bas de page 400
-
Kania, J, Kramer, M. Collective Impact. Stanford Social Innovation Review. 2011; 9(1):36-41.
- Note de bas de page 401
-
Evans, RE, Moore, G, Movsisyan, A, Rehfuess, E. How Can We Adapt Complex Population Health Interventions for New Contexts? Progressing Debates and Research Priorities. Journal of Epidemiology and Community Health. 2021; 75(1):40.
- Note de bas de page 402
-
Minary, L, Alla, F, Cambon, L, Kivits, J, Potvin, L. Addressing Complexity in Population Health Intervention Research: The Context/Intervention Interface. Journal of Epidemiology and Community Health. 2018; 72(4):319.
- Note de bas de page 403
-
McGill, E, Marks, D, Er, V, Penney, T, Petticrew, M, Egan, M. Qualitative Process Evaluation from a Complex Systems Perspective: A Systematic Review and Framework for Public Health Evaluators. PLOS Medicine. 2020; 17(11):e1003368.
- Note de bas de page 404
-
Rychetnik, L, Frommer, M, Hawe, P, Shiell, A. Criteria for Evaluating Evidence on Public Health Interventions. Journal of Epidemiology and Community Health. 2002; 56(2):119-27.
- Note de bas de page 405
-
McLaren, L, Braitstein, P, Buckeridge, D, Contandriopoulos, D, Creatore, MI, Faulkner, G, et al. Why Public Health Matters Today and Tomorrow: The Role of Applied Public Health Research. Canadian Journal of Public Health. 2019; 110(3):317-22.
- Note de bas de page 406
-
Nickel, S, von dem Knesebeck, O. Do Multiple Community-Based Interventions on Health Promotion Tackle Health Inequalities? International Journal for Equity in Health. 2020; 19(1):157.
- Note de bas de page 407
-
Jewett, RL, Mah, SM, Howell, N, Larsen, MM. Social Cohesion and Community Resilience During COVID-19 and Pandemics: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for COVID-19 Recovery. International Journal of Health Services. 2021; 51(3):325-36.
- Note de bas de page 408
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. L'engagement Communautaire Axé sur L'équité En Santé : Parlons-En. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2021.
- Note de bas de page 409
-
National Academies of Sciences Engineering and Medicine. 4 - The Role of Communities in Promoting Health Equity. In: Baciu A, Negussie Y, Geller A, et al., editors. Communities in Action: Pathways to Health Equity. Washington, DC: National Academies Press; 2017. p. 185-210.
- Note de bas de page 410
-
O'Mara-Eves, A, Brunton, G, Oliver, S, Kavanagh, J, Jamal, F, Thomas, J. The Effectiveness of Community Engagement in Public Health Interventions for Disadvantaged Groups: A Meta-Analysis. BioMed Central Public Health. 2015; 15(1):129.
- Note de bas de page 411
-
James, W. 4 - The Community. In: Institute of Medicine (US) Committee on Assuring the Health of the Public in the 21st Century, editor. The Future of the Public's Health in the 21st Century. Washington, DC: National Academies Press; 2002.
- Note de bas de page 412
-
South Asian Health Network. South Asian Health Network; disponible : https://southasianhealthnetwork.ca/.
- Note de bas de page 413
-
Black Scientists' Task Force on Vaccine Equity. Black Scientists' Task Force on Vaccine Equity; 2021; disponible : http://www.torontoblackcovid.com/.
- Note de bas de page 414
-
InclusionNS. InclusionNS; disponible : https://www.inclusionns.ca/.
- Note de bas de page 415
-
South, J, Phillips, G. Evaluating Community Engagement as Part of the Public Health System. Journal of Epidemiology and Community Health. 2014; 68(7):692.
- Note de bas de page 416
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Sommaire de la Revue : Engagement Communautaire pour Atténuer Les Inégalités de Santé. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2015.
- Note de bas de page 417
-
Gouvernement de l'Ontario. L'ontario Soutient L'intervention Liée à la COVID-19 Dans Les Collectivités Prioritaires. Gouvernement de l'Ontario; 2021.
- Note de bas de page 418
-
City of Toronto. City of Toronto Awards $5.5 Million in COVID-19 Vaccine Engagement Teams Grants to Local Agencies for Vaccine Outreach in Vulnerable Communities. City of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 419
-
Ireland, N. Here's How Community Groups Are Getting COVID-19 Vaccinations to Indigenous People in Canada's Largest City. CBC News. 2021.
- Note de bas de page 420
-
Assembly of First Nations, Métis National Council, Inuit Tapiriit Kanatami, Greenwood, M, Adams, E, Anderson, M, et al.Vers Un Avenir Meilleur : Santé Publique et Populationnelle Chez Les Premières Nations, Les Inuits et Les Métis. Greenwood M, Adams E, editors. Centre de collaboration nationale en santé publique; [dans la presse].
- Note de bas de page 421
-
Baba, L. Sécurité Culturelle En Santé Publique Chez Les Premières Nations, Les Inuits et Les Métis : État des Lieux sur la Compétence et la Sécurité Culturelles En Éduction, En Formaion et Dans Les Services de Santé. Prince George, BC: Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2013.
- Note de bas de page 422
-
Greenwood, M, Lindsay, N, King, J, Loewen, D. Ethical Spaces and Places: Indigenous Cultural Safety in British Columbia Health Care. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples. 2017; 13(3):179-89.
- Note de bas de page 423
-
Churchill, M, Parent-Bergeron, M, Smylie, J, Ward, C, Fridkin, A, Smylie, D, et al. Evidence Brief: Wise Practices for Indigenous-Specific Cultural Safety Training. Well Living House Action Research Centre for Indigenous Infant, Child and Family Health and Wellbeing, Centre for Urban Health Solutions, St. Michael's Hospital; 2017.
- Note de bas de page 424
-
First Nations Health Authority, First Nations Health Council, First Nations Health Director's Association. Anti-Racism, Cultural Safety & Humility Framework. First Nations Health Authority; 2021.
- Note de bas de page 425
-
Williams, R. Culturally Safe - What Does It Mean for Our Work Practice? Australian and New Zealand Journal of Public Health. 1999; 23(2):213-4.
- Note de bas de page 426
-
Feng, P, Di Ruggiero, E, Reid, R, Pinto, A, Upshur, R. Public Health and Learning Health Systems White Paper. Toronto, ON: Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto; 2021.
- Note de bas de page 427
-
Institute of Medicine (US) Committee on the Learning Health Care System in America. Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in America. Smith M, Saunders R, Stuckhardt L, McGinnis JM, editors. Washington, DC: National Academies Press (US); 2013.
- Note de bas de page 428
-
Glazier, R. The Lessons of COVID-19 for Canadian Learning Health Systems. Longwoods Breakfast Series: Canadian Institute of Health Research; 2020
- Note de bas de page 429
-
Agence de la santé publique du Canada. Surveillance de la Santé Publique au Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 430
-
Huston, P, Edge, VL, Bernier, E. Reaping the Benefits of Open Data in Public Health. Canada Communicable Disease Report. 2019; 45(11):252-6.
- Note de bas de page 431
-
Mishra, S, Kwong, JC, Chan, AK, Baral, SD. Understanding Heterogeneity to Inform the Public Health Response to COVID-19 in Canada. Canadian Medical Association Journal. 2020; 192(25):E684.
- Note de bas de page 432
-
van Panhuis, WG, Paul, P, Emerson, C, Grefenstette, J, Wilder, R, Herbst, AJ, et al. A Systematic Review of Barriers to Data Sharing in Public Health. BioMed Central Public Health. 2014; 14(1):1144.
- Note de bas de page 433
-
Groupe de travail sur l'équité en santé pour les Noirs. Engagement, Gouvernance, Accès et Protection (EGAP): Cadre de Gouvernance des Données sur la Santé Recueillies Auprès des Communautés de L'ontario. Alliance pour des communautés en santé; 2021.
- Note de bas de page 434
-
Centre de Gouvernance de l'information des Premières Nations. Les Principes de PCAP® des Premières Nations. Centre de Gouvernance de l'information des Premières Nations; 2021; disponible : https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/.
- Note de bas de page 435
-
Wolfe, S, Hill, M. Sécurité Culturelle : la Criticité des Savoirs Autochtones et la Gouvernance des Données. Canadian Science Policy Centre. Centre canadien de la politique scientifique; 2020.
- Note de bas de page 436
-
Conseil des académies canadiennes. L'accès Aux Données sur la Santé et Aux Données Connexes au Canada. Ottawa, ON: Conseil des académies canadiennes; 2015.
- Note de bas de page 437
-
Buckeridge, DL, Goel, V. Health Informatics Education: An Opportunity for Public Health in Canada. Canadian Journal of Public Health. 2001; 92(3):233-6.
- Note de bas de page 438
-
Buckeridge, D. Une Vision Éclairée Par des Données Probantes pour Un Système de Données En Santé Publique au Canada. Centre de collaboration nationale en santé publique; [dans la presse].
- Note de bas de page 439
-
Agence de la santé publique du Canada. ConnexionVaccin : Système Informatique pour la Gestion du Déploiement des Vaccins. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 440
-
Padgett, DK. Qualitative and Mixed Methods in Public Health. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.; 2012.
- Note de bas de page 441
-
Baum, F. Researching Public Health: Behind the Qualitative-Quantitative Methodological Debate. Social Science & Medicine. 1995; 40(4):459-68.
- Note de bas de page 442
-
Teti, M, Schatz, E, Liebenberg, L. Methods in the Time of COVID-19: The Vital Role of Qualitative Inquiries. International Journal of Qualitative Methods. 2020; 19(1):1-5.
- Note de bas de page 443
-
Tremblay, S, Castiglione, S, Audet, L-A, Desmarais, M, Horace, M, Peláez, S. Conducting Qualitative Research to Respond to COVID-19 Challenges: Reflections for the Present and Beyond. International Journal of Qualitative Methods. 2021; 20(1):1-8.
- Note de bas de page 444
-
Rogers, BJ, Swift, K, van der Woerd, K, Auger, M, Halseth, R, Atkinson, D, et al. At the Interface: Indigenous Health Practitioners and Evidence-Based Practice. Prince George, BC: National Collaborating Centre for Aboriginal Health; 2019.
- Note de bas de page 445
-
Smylie, J, Olding, M, Ziegler, C. Sharing What We Know About Living a Good Life: Indigenous Approaches to Knowledge Translation. Journal of the Canadian Health Libraries Association. 2014; 35:16-23.
- Note de bas de page 446
-
Haworth-Brockman, M, Betker, C. Mesurer Ce Qui Compte En Plein Coeur de la Pandémie de COVID-19 Indicateurs D'équité pour la Santé Publique. Centre de collaboration nationale des maladies infectieuse; 2020.
- Note de bas de page 447
-
First Nation Advisory Council. Katop Wasis Sesomiw Nokalawin Mo Nagelameg Neoteetjit Mitjoaatjitj: No Child Left Behind. First Nation Advisory Council; 2021.
- Note de bas de page 448
-
Smylie, J, Firestone, M. Back to the Basics: Identifying and Addressing Underlying Challenges in Achieving High Quality and Relevant Health Statistics for Indigenous Populations in Canada. Statistical Journal of the IAOS. 2015; 31(1):67-87.
- Note de bas de page 449
-
Pollock, NJ, Healey, GK, Jong, M, Valcour, JE, Mulay, S. Tracking Progress in Suicide Prevention in Indigenous Communities: A Challenge for Public Health Surveillance in Canada. BMC Public Health. 2018; 18(1):1320.
- Note de bas de page 450
-
Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Stratégie de Gouvernance des Données des Premières Nations - Une Réponse Aux Directives Reçues des Dirigeants des Premières Nations, Financées Dans le Cadre du Budget Fédéral de 2018 à L'appui de la Nouvelle Relation Financière. Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations; 2020.
- Note de bas de page 451
-
Nickerson, M. First Nations' Data Governance: Measuring the Nation-to-Nation Relationship. British Columbia First Nations' Data Governance Initiative; 2017.
- Note de bas de page 452
-
Tagalik, S. Inuit Qaujimajatuqangit : le Rôle du Savoir Autochtone pour Favoriser le Bien-Être des Communautés Inuites du Nunavut. Prince George, BC: Centre de collaboration nationale de la santé autochtone; 2012.
- Note de bas de page 453
-
Brownson, RC, Kreuter, MW, Arrington, BA, True, WR. Translating Scientific Discoveries into Public Health Action: How Can Schools of Public Health Move Us Forward? Public health reports (Washington, DC : 1974). 2006; 121(1):97-103.
- Note de bas de page 454
-
Nutbeam, D. Achieving ‘Best Practice' in Health Promotion: Improving the Fit between Research and Practice. Health Education Research. 1996; 11(3):317-26.
- Note de bas de page 455
-
Di Ruggiero, E, Papadopoulos, A, Steinberg, M, Blais, R, Frandsen, N, Valcour, J, et al. Strengthening Collaborations at the Public Health System–Academic Interface: A Call to Action. Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(6):921-5.
- Note de bas de page 456
-
Instituts de recherche en santé du Canada. Lancement de Chaires de Recherche Appliquée En Santé Publique. Instituts de recherche en santé du Canada; 2021.
- Note de bas de page 457
-
Paradis, G, Hamelin, A-M, Malowany, M, Levy, J, Rossignol, M, Bergeron, P, et al. The University–Public Health Partnership for Public Health Research Training in Quebec, Canada. American Journal of Public Health. 2016; 107(1):100-4.
- Note de bas de page 458
-
Graham, JR, Sibbald, SL. Rebuilding Public Health on More Than Thoughts and Prayers. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(4):548-51.
- Note de bas de page 459
-
Transdisciplinary Public Health: Research, Education, and Practice. Haire-Joshu D, McBride TD, editors. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.; 2013.
- Note de bas de page 460
-
Dankwa-Mullan, I, Rhee, KB, Stoff, DM, Pohlhaus, JR, Sy, FS, Stinson, N, et al. Moving toward Paradigm-Shifting Research in Health Disparities through Translational, Transformational, and Transdisciplinary Approaches. American Journal of Public Health. 2010; 100(S1):S19-S24.
- Note de bas de page 461
-
Johnson, MT, Johnson, EA, Nettle, D, Pickett, KE. Designing Trials of Universal Basic Income for Health Impact: Identifying Interdisciplinary Questions to Address. Journal of Public Health. 2021:1-9.
- Note de bas de page 462
-
Holmes, EA, O'Connor, RC, Perry, VH, Tracey, I, Wessely, S, Arseneault, L, et al. Multidisciplinary Research Priorities for the COVID-19 Pandemic: A Call for Action for Mental Health Science. The Lancet Psychiatry. 2020; 7(6):547-60.
- Note de bas de page 463
-
Kivits, J, Ricci, L, Minary, L. Interdisciplinary Research in Public Health: The ‘Why' and the ‘How'. Journal of Epidemiology and Community Health. 2019; 73(12):1061.
- Note de bas de page 464
-
Leslie, M, Fadaak, R, Davies, J, Blaak, J, Forest, PG, Green, L, et al. Integrating the Social Sciences into the COVID-19 Response in Alberta, Canada. British Medical Journal Global Health. 2020; 5(7):e002672.
- Note de bas de page 465
-
World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies. World Health Organization; 2010.
- Note de bas de page 466
-
World Health Organization. Global Strategy on Digital Health 2020-2025. Geneva, CH: World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 467
-
Organisation mondiale de la Santé. Détection Précoce, Évaluation et Réponse Lors D'une Urgence de Santé Publique : Mise En Oeuvre de L'alerte Précoce et Réponse Notamment la Surveillance Fondée sur Les Évènements: Version Provisoire. Geneva, CH: Organisation mondiale de la Santé; 2014.
- Note de bas de page 468
-
Santé Canada. Stratégies Prioritaires pour Optimiser Les Tests et le Dépistage de la COVID-19 au Canada : Rapport. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 469
-
Pabbaraju, K, Wong Anita, A, Douesnard, M, Ma, R, Gill, K, Dieu, P, et al. A Public Health Laboratory Response to the Pandemic. Journal of Clinical Microbiology. 2020; 58(8):e01110-20.
- Note de bas de page 470
-
Gouvernement du Canada. Déchiffrer le Code du Virus de la COVID-19. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 471
-
Génome Canada. Rcangeco. Génome Canada; 2020.
- Note de bas de page 472
-
Hogan, C, Jassem, A, Sbihi, H, Joffres, Y, Tyson, J, Noftall, K, et al. Rapid Increase in SARS-Cov-2 P.1 Lineage Leading to Codominance with B.1.1.7 Lineage, British Columbia, Canada, January–April 2021. Emerging Infectious Disease Journal. 2021; 27(11).
- Note de bas de page 473
-
Cyranoski, D. Alarming COVID Variants Show Vital Role of Genomic Surveillance. 2021;Sect. 337-8.
- Note de bas de page 474
-
World Health Organization. Tracking SARS-Cov-2 Variants. World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 475
-
Detsky, AS, Bogoch, II. COVID-19 in Canada: Experience and Response to Waves 2 and 3. Journal of the American Medical Association. 2021; 326(12):1145-6.
- Note de bas de page 476
-
Organisation for Economic Co-Operation and Development. Access to COVID-19 Vaccines: Global Approaches in a Global Crisis. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD); 2021.
- Note de bas de page 477
-
Snowdon, AW, Wright, A, Saunders, M. An Evidence-Based Strategy to Scale Vaccination in Canada. Healthcare Quarterly. 2021; 24(1):28-35.
- Note de bas de page 478
-
World Health Organization. WHO Launches a Chatbot on Facebook Messenger to Combat COVID-19 Misinformation. World Health Organization; 2020.
- Note de bas de page 479
-
Organisation mondiale de la santé. Le Service D'alerte Sanitaire Whatsapp de L'OMS Désormais Disponible En Français. Organisation mondiale de la santé; 2021.
- Note de bas de page 480
-
Brown, KA, Soucy, J-PR, Buchan, SA, Sturrock, SL, Berry, I, Stall, NM, et al. The Mobility Gap: Estimating Mobility Thresholds Required to Control SARS-Cov-2 in Canada. Canadian Medical Association Journal. 2021; 193(17):E592.
- Note de bas de page 481
-
Sun, S, Shaw, M, Moodie, E, Ruths, D. COVID Alert Application Effectiveness. McGill University; 2021.
- Note de bas de page 482
-
Gouvernement du Canada. Téléchargez Alerte COVID Dès Maintenant. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 483
-
Santé Canada. ADAPTATIONSanté. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 484
-
Donneesclimatiques.ca. Zone D'apprentissage. Donneesclimatiques.ca; 2021; disponible : https://donneesclimatiques.ca/apprendre/.
- Note de bas de page 485
-
Seto, E, Challa, P, Ware, P. Adoption of COVID-19 Contact Tracing Apps: A Balance between Privacy and Effectiveness. Journal of Medical Internet Research. 2021; 23(3):e25726.
- Note de bas de page 486
-
Colizza, V, Grill, E, Mikolajczyk, R, Cattuto, C, Kucharski, A, Riley, S, et al. Time to Evaluate COVID-19 Contact-Tracing Apps. Nature Medicine. 2021; 27(3):361-2.
- Note de bas de page 487
-
Panch, T, Pearson-Stuttard, J, Greaves, F, Atun, R. Artificial Intelligence: Opportunities and Risks for Public Health. The Lancet Digital Health. 2019; 1(1):e13-e4.
- Note de bas de page 488
-
Dankwa-Mullan, I, Scheufele, EL, Matheny, ME, Quintana, Y, Chapman, WW, Jackson, G, et al. A Proposed Framework on Integrating Health Equity and Racial Justice into the Artificial Intelligence Development Lifecycle. Journal of Health Care for the Poor and Underserved. 2021; 32(2):300-17.
- Note de bas de page 489
-
Smith, MJ, Axler, R, Bean, S, Rudzicz, F, Shaw, J. Four Equity Considerations for the Use of Artificial Intelligence in Public Health. Bulletin of the World Health Organization. 2020; 98(4):290-2.
- Note de bas de page 490
-
Canadian Institute for Advanced Research. Building a Learning Health System for Canadians: Report of the Cifar Task Force on Artificial Intelligence for Health Task Force. Canadian Institute for Advanced Research; 2020.
- Note de bas de page 491
-
Dixon, BE, Rahurkar, S, Apathy, NC. Interoperability and Health Information Exchange for Public Health. In: Magnuson JA, Dixon BE, editors. Public Health Informatics and Information Systems. Cham: Springer International Publishing; 2020. p. 307-24.
- Note de bas de page 492
-
Vaccine Hunters. À Propos de Nous. Vaccine Hunters; 2021; disponible : https://vaccinehunters.ca/about.
- Note de bas de page 493
-
Vaccine Hunters. Vaccine Hunters Canada to Pivot Operations. Vaccine Hunters; 2021; disponible : https://vaccinehunters.ca/pivot.
- Note de bas de page 494
-
VaxHuntersCan. We've Developed a Free, Customizable, Multilingual, Open-Source Platform to Find Vaccine Appointments.: https://twitter.com/VaxHuntersCan/status/1430300283532419082?s=20 Aug 24, 2021[Tweet]. disponible : @VaxHuntersCan.
- Note de bas de page 495
-
Kamwa Ngne, A, Morrison, V. Compétences En Politiques Publiques pour la Santé Publique : Une Revue de la Littérature. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; 2021.
- Note de bas de page 496
-
Bhatia, D, Vaga, K, Roerig, M, Pawa, J, Allin, S, Marchildon, G. COVID-19 Case and Contact Management Strategies in Canada. Toronto, ON: North American Observatory on Health Systems and Policies; 2020.
- Note de bas de page 497
-
Khan, Y, O'Sullivan, T, Brown, A, Tracey, S, Gibson, J, Généreux, M, et al. Public Health Emergency Preparedness: A Framework to Promote Resilience. BioMed Central Public Health. 2018; 18(1):1344.
- Note de bas de page 498
-
Coronado, F, Beck, AJ, Shah, G, Young, JL, Sellers, K, Leider, JP. Understanding the Dynamics of Diversity in the Public Health Workforce. Journal of Public Health Management and Practice. 2020; 26(4).
- Note de bas de page 499
-
Sellers, K, Leider, JP, Gould, E, Castrucci, BC, Beck, A, Bogaert, K, et al. The State of the US Governmental Public Health Workforce, 2014–2017. American Journal of Public Health. 2019; 109(5):674-80.
- Note de bas de page 500
-
Shahi, A, Karachiwalla, F, Grewal, N. Walking the Walk: The Case for Internal Equity, Diversity, and Inclusion Work within the Canadian Public Health Sector. Health Equity. 2019; 3(1):183-5.
- Note de bas de page 501
-
Khan, MS, Lakha, F, Tan, MMJ, Singh, SR, Quek, RYC, Han, E, et al. More Talk Than Action: Gender and Ethnic Diversity in Leading Public Health Universities. The Lancet. 2019; 393(10171):594-600.
- Note de bas de page 502
-
Statistique Canada. La Santé Mentale Chez Les Travailleurs de la Santé au Canada Pendant la Pandémie de COVID-19. Le Quotidien; 2021.
- Note de bas de page 503
-
Bryant-Genevier, J, Rao, CY, Lopes-Cardozo, B, Kone, A, Rose, C, Thomas, I, et al. Symptoms of Depression, Anxiety, Post-Traumatic Stress Disorder, and Suicidal Ideation among State, Tribal, Local, and Territorial Public Health Workers During the COVID-19 Pandemic — United States, March–April 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2021; 70:947-52.
- Note de bas de page 504
-
Office of the Auditor General of Ontario. COVID-19 Preparedness and Management: Special Report on Emergency Management in Ontario—Pandemic Response. Toronto, ON: Office of the Auditor General of Ontario; 2020.
- Note de bas de page 505
-
Santé public Ontario. Stratégies du Secteur des Soins de Santé Pouvant Être Adaptées au Secteur de la Santé Publique pour Favoriser la Santé Mentale et la Résilience du Personnel Pendant le Rétablissement Postpandémie de COVID-19. Santé public Ontario; 2021.
- Note de bas de page 506
-
Glynn, MK, Jenkins, ML, Jr., Ramsey, C, Simone, PM. Public Health Workforce 3.0: Recent Progress and What's on the Horizon to Achieve the 21st-Century Workforce. Journal of Public Health Management and Practice. 2019; 25(1):S6-S9.
- Note de bas de page 507
-
Edwards, NC, MacLean Davison, C. Social Justice and Core Competencies for Public Health: Improving the Fit. Canadian Journal of Public Health. 2008; 99(2):130-2.
- Note de bas de page 508
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Compétences Essentielles En Santé Publique au Canada : Analyse et Comparaison du Contenu Relatif Aux Déterminants Sociaux de la Santé. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2012.
- Note de bas de page 509
-
Cabaj, JL, Musto, R, Ghali, WA. Public Health: Who, What, and Why? Canadian Journal of Public Health. 2019; 110(3):340-3.
- Note de bas de page 510
-
Brownson, RC, Burke, TA, Colditz, GA, Samet, JM. Reimagining Public Health in the Aftermath of a Pandemic. American Journal of Public Health. 2020; 110(11):1605-10.
- Note de bas de page 511
-
Bowes, C, Cote-Meek, S, Cutler, H, Labre, S, Lemieux, S. Talking Together to Improve Health: Gathering and Sharing Learning. Sudbury, ON: Locally Driven Collaborative Projects; 2020.
- Note de bas de page 512
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Le Racisme et L'équité En Santé : Parlons-En. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2018.
- Note de bas de page 513
-
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. La Communication pour Accroître la Capacité Organisationnelle D'agir sur L'équité En Santé. Antigonish, NS: Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé; 2021.
- Note de bas de page 514
-
Machado, S, Goldenberg, S. Sharpening Our Public Health Lens: Advancing Im/Migrant Health Equity during COVID-19 and Beyond. International Journal for Equity in Health. 2021; 20:57.
- Note de bas de page 515
-
DeSalvo, KB, Wang, YC, Harris, A, Auerbach, J, Koo, D, O'Carroll, P. Public Health 3.0: A Call to Action for Public Health to Meet the Challenges of the 21st Century. Preventing Chronic Disease. 2017; 14:170017.
- Note de bas de page 516
-
Jagals, P, Ebi, K. Core Competencies for Health Workers to Deal with Climate and Environmental Change. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(8):3849.
- Note de bas de page 517
-
Lemery, J, Balbus, J, Sorensen, C, Rublee, C, Dresser, C, Balsari, S, et al. Training Clinical and Public Health Leaders in Climate and Health. Health Affairs. 2020; 39(12):2189-96.
- Note de bas de page 518
-
Ghaffar, A, Rashid, SF, Wanyenze, RK, Hyder, AA. Public Health Education Post-COVID-19: A Proposal for Critical Revisions. British Medical Journal Global Health. 2021; 6(4):e005669.
- Note de bas de page 519
-
Czabanowska, K, Kuhlmann, E. Public Health Competences through the Lens of the COVID-19 Pandemic: What Matters for Health Workforce Preparedness for Global Health Emergencies. International Journal of Health Planning and Management. 2021; 36(1):14-9.
- Note de bas de page 520
-
Denis, J-L, Potvin, L, Rochon, J, Fournier, P, Gauvin, L. On Redesigning Public Health in Québec: Lessons Learned from the Pandemic. Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(6):912-20.
- Note de bas de page 521
-
Austin, SE, Ford, JD, Berrang-Ford, L, Araos, M, Parker, S, Fleury, MD. Public Health Adaptation to Climate Change in Canadian Jurisdictions. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015; 12(1):623-51.
- Note de bas de page 522
-
Fiset-Laniel, J, Guyon, A, Perreault, R, Strumpf, EC. Public Health Investments: Neglect or Wilful Omission? Historical Trends in Quebec and Implications for Canada. Canadian Journal of Public Health. 2020; 111(3):383-8.
- Note de bas de page 523
-
Caldwell, HAT, Scruton, S, Fierlbeck, K, Hajizadeh, M, Dave, S, Sim, SM, et al. Fare Well to Nova Scotia? Public Health Investments Remain Chronically Underfunded. Canadian Journal of Public Health. 2021; 112(2):186-90.
- Note de bas de page 524
-
Hoffman, SJ, Creatore, MI, Klassen, A, Lay, AM, Fafard, P. Building the Political Case for Investing in Public Health and Public Health Research. Canadian Journal of Public Health. 2019; 110(3):270-4.
- Note de bas de page 525
-
Bratina, B. La COVID-19 et Les Peuples Autochtones : de la Crise à Un Véritable Changement. Comité permanent des affaires autochtones et du Nord; 2021.
- Note de bas de page 526
-
Waakebiness-Bryce Institute for Indigenous Health. Ce Que Nous Avons Entendu : Peuples Autochtones & COVID-19 : Rapport Complémentaire de L'agence de la Santé Publique du Canada. Agence de santé publique du Canada; 2021.
- Note de bas de page 527
-
Baum, F, Delany-Crowe, T, MacDougall, C, Lawless, A, van Eyk, H, Williams, C. Ideas, Actors and Institutions: Lessons from South Australian Health in All Policies on What Encourages Other Sectors' Involvement. BioMed Central Public Health. 2017; 17(1):811.
- Note de bas de page 528
-
Commission on Social Determinants of Health. Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health - Executive Summary. World Health Organization; 2008.
- Note de bas de page 529
-
Delany, T, Lawless, A, Baum, F, Popay, J, Jones, L, McDermott, D, et al. Health in All Policies in South Australia: What Has Supported Early Implementation? Health Promotion International. 2016; 31(4):888-98.
- Note de bas de page 530
-
Kickbusch, I, Gleicher, D. Governance for Health in the 21st Century. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2013.
- Note de bas de page 531
-
Gouvernement du Canada. Loi Canadienne sur la Santé. Gouvernement du Canada; 2020.
- Note de bas de page 532
-
Kermode-Scott, B. Canada Tries Once More to Set Public Health Goals. British Medical Journal. 2005; 331(7514):422-.
- Note de bas de page 533
-
Gouvernement du Canada. Maladie à Coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 534
-
Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations. WHO's Work in Health Emergencies - Strengthening Preparedness for Health Emergencies: Implementation of the International Health Regulations (2005). World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 535
-
Bump, JB, Friberg, P, Harper, DR. International Collaboration and COVID-19: What Are We Doing and Where Are We Going? British Medical Journal. 2021; 372:n180.
- Note de bas de page 536
-
World Health Organization. International Health Regulations. World Health Organization; 2005.
- Note de bas de page 537
-
Dion, M, AbdelMalik, P, Mawudeku, A. Big Data and the Global Public Health Intelligence Network (GPHIN). Canada Communicable Disease Report. 2015; 41(9):209-14.
- Note de bas de page 538
-
World Health Organization. WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 539
-
Maxmen, A. Leader of WHO's New Pandemic Hub: Improve Data Flow to Extinguish Outbreaks. Nature. 2021.
- Note de bas de page 540
-
World Health Organization. WHO, Germany Open Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin. World Health Organization; 2021.
- Note de bas de page 541
-
Assemblée générale des Nations Unies. Déclaration des Nations Unies sur Les Droits des Peuples Autochtones. Assemblée générale des Nations Unies; 2007.
- Note de bas de page 542
-
Ministère de la Justice. Document D'information : Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur Les Droits des Peuples Autochtones. Gouvernement du Canada; 2021.
- Note de bas de page 543
-
First Nations Health Authority. First Nations Health Authority; 2021; disponible : https://www.fnha.ca/.
- Note de bas de page 544
-
Northern Inter-Tribal Health Authority (NITHA). Northern Inter-Tribal Health Authority; 2021; disponible : https://www.nitha.com/.
- Note de bas de page 545
-
McQueen, DV, Wismar, M, Lin, V, Jones, CM, Davies, M, ed. Intersectoral Governance for Health in All Policies: Structures, Actions and Experiences. World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies; 2012.
- Note de bas de page 546
-
South Australia's HiAP Approach. Government of South Australia; 2018.
- Note de bas de page 547
-
World Health Organization. Health in All Policies (HiAP) Framework for Country Action. World Health Organization; 2014.
- Note de bas de page 548
-
Government of Newfoundland and Labrador. Take a Health-in-All-Policies Approach. Government of Newfoundland and Labrador.
- Note de bas de page 549
-
Gagnon, F, Turgeon, J, Dallaire, C. L'évaluation D'impact sur la Santé au Québec: Lorsque la Loi Devient Levier D'action. Télescope. 2008; 14(2):79-94.
- Note de bas de page 550
-
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Initiative Pancanadienne sur Les Inégalités En Santé. Prince George, BC: Centre de collaboration nationale de la santé autochtone.
- Note de bas de page 551
-
Réseau pancanadien de santé publique. Les Principales Inégalités En Santé au Canada – Sommaire Exécutif. Réseau pancanadien de santé publique; 2018.
- Note de bas de page 552
-
Marmot, M, Allen, J, Boyce, T, Goldblatt, P, Morrison, J. Build Back Fairer in Greater Manchester: Health Equity and Dignified Lives. London, UK: Institute of Health Equity; 2021.
- Note de bas de page 553
-
Marmot Indicators. Public Health England; 2015; disponible : https://fingertips.phe.org.uk/profile-group/marmot.
- Note de bas de page 554
-
Marmot, M, Allen, J, Boyce, T, Goldblatt, P, Morrison, J. Build Back Fairer in Greater Manchester: Health Equity and Dignified Lives - Executive Summary. London, UK: Institute of Health Equity; 2021.
- Note de bas de page 555
-
Health Equity in Greater Manchester: The Marmot Review 2020. Institute of Health Equity; 2020.
- Note de bas de page 556
-
Michael Marmot and Jessica Allen: Building Back Fairer in Greater Manchester. The BMJ Opinion; 2021.
- Note de bas de page 557
-
Bargain, O, Aminjonov, U. Trust and Compliance to Public Health Policies in Times of COVID-19. Journal of Public Economics. 2020; 192:104316.
- Note de bas de page 558
-
Waters, E, Doyle, J, Jackson, N, Howes, F, Brunton, G, Oakley, A, et al. Evaluating the Effectiveness of Public Health Interventions: The Role and Activities of the Cochrane Collaboration. Journal of Epidemiology and Community Health. 2006; 60(4):285-9.
- Note de bas de page 559
-
Frieden, TR. Six Components Necessary for Effective Public Health Program Implementation. American Journal of Public Health. 2013; 104(1):17-22.
- Note de bas de page 560
-
Hyland-Wood, B, Gardner, J, Leask, J, Ecker, UKH. Toward Effective Government Communication Strategies in the Era of COVID-19. Humanities and Social Sciences Communications. 2021; 8(1):30.
- Note de bas de page 561
-
Santé Canada. Qu'est-Ce Que L'approche Axée sur la Santé de la Population? Governement of Canada; 2013.
Notes de bas de page
- Note de bas de page i
-
Selon 93 % de l'information provisoire complète disponible, la COVID-19 était la troisième cause de décès la plus fréquente (5 %), après le cancer (26 %) et les maladies cardiaques (17 %).
- Note de bas de page ii
-
Le terme « vague » est utilisé dans ce rapport pour désigner une résurgence importante du virus.
- Note de bas de page iii
-
Ces éléments de base ont été adaptés pour les systèmes de santé publique du Canada à partir des éléments essentiels des systèmes de santé de l'OMS, qui sont utilisés pour surveiller les systèmes de santé dans de nombreux pays (PDF, en anglais seulement).
- Note de bas de page iv
-
La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986) énonce les conditions et les ressources fondamentales pour la santé. Elles sont la paix, le logement, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité. Ces conditions préalables de base sont fondamentales pour améliorer la santé.

