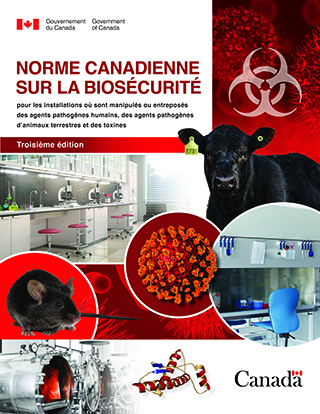Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition
Télécharger en format PDF
(9.22 Mo, 198 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : 2022-11
N° de cat. : HP45-7/2022F-PDF
ISBN : 978-0-660-45740-6
Numéro de la publication : 220464
Liens connexes
Accéder à l’Addenda de biosûreté apporté à la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition
Table des matières
- Préface
- Abréviations et sigles
- Glossaire
- 1. Introduction
- 2. Comment utiliser la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition
- 3. Exigences physiques en matière de confinement
- 4. Exigences opérationnelles
- 4.1 Gestion du programme de biosécurité
- 4.2 Programme de formation
- 4.3 Équipement de protection individuel
- 4.4 Entrée et sortie
- 4.5 Pratiques de travail
- 4.6 Considérations pour le travail avec les animaux
- 4.7 Décontamination et gestion des déchets
- 4.8 Intervention d'urgence
- 4.9 Registres et documents
- 5. Exigences relatives aux essais de vérification et de performance
- 5.1 Essais de vérification et de performance pour toutes les zones de confinement
- 5.2 Essais supplémentaires de vérification et de performance pour les zones de confinement sélectionnées
- 5.3 Essais de vérification et de performance à effectuer au cours de la mise en service et à des intervalles énoncés pour toutes les zones de confinement
- Références
- Annexe A : Principales exigences législatives et réglementaires
Préface
Au Canada, la manipulation ou l'entreposage des agents pathogènes humains et des toxines de groupe de risque 2 (GR2), GR3 et GR4 est réglementé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT). En vertu de la Loi sur la santé des animaux (LSA) et du Règlement sur la santé des animaux (RSA), l'ASPC et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglementent l'importation d'agents zoopathogènes ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), d'animaux exposés de manière naturelle ou expérimentale à un agent zoopathogène ou à une partie de celui-ci (p. ex. une toxine), ainsi que des produits ou sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum) ou d'autres organismes porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).
La Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB), 2022, du gouvernement du Canada, est la norme nationale pour les installations où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines réglementés. La première édition des Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité (NLDCB), publiée en 2013, a été élaborée pour mettre à jour et harmoniser trois documents de normes et lignes directrices canadiennes en matière de biosécurité pour la conception, la construction et l'exploitation des installations où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées :
- Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, 3e édition, 2004
- Normes sur le confinement des installations vétérinaires, 1re édition, 1996
- Normes de confinement pour les laboratoires, les installations vétérinaires et les salles de nécropsie qui manipulent des prions, 1re édition, 2005
La troisième édition de la NCB s'appuie sur l'approche fondée sur les risques, les éléments probants et les résultats de la deuxième édition. Les exigences ont été révisées afin de clarifier l'intention sous-jacente en matière de biosécurité et/ou de biosûreté et d'éliminer les redondances dans la mesure du possible.
La figure suivante illustre la hiérarchie des documents qu'utilisent l'ASPC et l'ACIA pour surveiller les activités de biosécurité et de biosûreté. Chaque niveau de la pyramide correspond à un type de document. Les documents sont placés en ordre de priorité du haut de la pyramide vers le bas. Les lois et les règlements se trouvent au sommet de la pyramide, car ce sont ces documents qui confèrent à l'ASPC et à l'ACIA leur autorité légale. Le matériel d'orientation et les éléments techniques se trouvent au bas de la pyramide, car ils sont uniquement destinés à résumer les recommandations et les connaissances scientifiques.
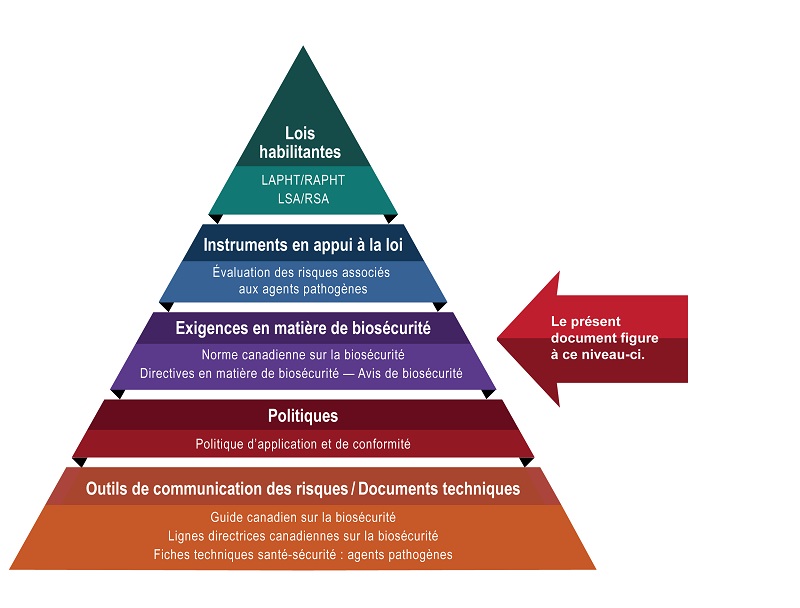
Figure 1 - Texte descriptif
Figure sous la forme d'une pyramide représentant la hiérarchie des documents utilisés par l'ASPC pour superviser les opérations de biosécurité et de biosûreté. Chacun des cinq niveaux de la pyramide correspond à un type de document, dont l'ordre de préséance augmente du bas vers le haut.
Au sommet se trouve la législation habilitante, c'est-à-dire la LAPHT, le RAPHT, la LSA et le RSA, qui transmet les autorités légales à l'ASPC. Au-dessous des lois et des règlements figurent les Instruments à l'appui de la législation, et ceux-ci sont les évaluations des risques associés aux agents pathogènes. La prochaine étape est intitulée les Exigences en matière de biosécurité, notamment la Norme canadienne sur la biosécurité, les Directives en matière de biosécurité et les Avis de biosécurité. Le deuxième niveau du bas est Documents de politique, soit la Politique de conformité et d'application de la loi. Le matériel d'orientation et les pièces techniques trouvés au bas de la pyramide, sous l'en-tête des Outils de communication des risques et documents techniques, visent seulement à résumer les recommandations et les informations scientifiques. Il s'agit notamment du Guide canadien sur la biosécurité, des Lignes directrices canadiennes sur la biosécurité et des Fiches techniques santé-sécurité : agents pathogènes.
Abréviations et sigles
- Ag
- Agriculture (c.-à-d. NC2-Ag, NC3-Ag)
- ABCSE
- Agent biologique à cote de sécurité élevée
- ACIA
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- ASB
- Agent de la sécurité biologique
- ASPC
- Agence de la santé publique du Canada
- CVAC
- Chauffage, ventilation et air climatisé
- ELR
- Évaluation locale des risques
- EPI
- Équipement de protection individuel
- ESB
- Enceinte de sécurité biologique
- FTSSP
- Fiche technique santé-sécurité : agents pathogènes
- GCB
- Guide canadien sur la biosécurité
- GR
- Groupe de risque (c.-à-d. GR1, GR2, GR3, GR4)
- HEPA
- Haute efficacité pour les particules de l'air
- LAPHT
- Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
- LSA
- Loi sur la santé des animaux
- MAE
- Maladie animale exotique
- MAÉ
- Maladie animale émergente
- NC
- Niveau de confinement (c.-à-d. NC1, NC2, NC3, NC4)
- NCB
- Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition
- PIU
- Plan d'intervention d'urgence
- PON
- Procédure opératoire normalisée
- RAPHT
- Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
- RSA
- Règlement sur la santé des animaux
- UPS
- Source d'alimentation continue
- Zone GA
- Zone de confinement de gros animaux
- Zone PA
- Zone de confinement de petits animaux
Glossaire
Bien que certaines des définitions fournies dans le glossaire soient universellement reconnues, beaucoup d'entre elles sont propres à la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB); par conséquent, certaines définitions pourraient ne pas s'appliquer aux installations non visées par la NCB.
- Accès limité
- Permission d'accès accordée uniquement aux membres du personnel et aux visiteurs autorisés en ayant recours à un moyen opérationnel (p. ex. la surveillance et le contrôle de toutes les personnes qui accèdent à un espace désigné par les membres du personnel autorisés) ou à une barrière physique (p. ex. un système de contrôle d'accès tel que des serrures à clé ou des cartes d'accès électroniques).
- Accès restreint
- Permission d'accès strictement contrôlée et accordée exclusivement aux membres du personnel autorisés en ayant recours à une barrière physique (c.-à-d. un dispositif ou un système de contrôle d'accès tels que des cartes d'accès électroniques, des codes d'accès ou des clés à serrure).
- Accident
- Événement imprévu ayant causé des blessures, un préjudice ou des dommages.
- Activité réglementée
- Activité visée par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, à savoir : posséder, manipuler ou utiliser des agents pathogènes humains ou des toxines; les produire; les entreposer; permettre à quiconque d'y avoir accès; les transférer; les importer ou les exporter; les rejeter ou les abandonner de toute autre manière; les éliminer.
- Aérosol
- Fines particules solides ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux (p. ex. l'air); les aérosols peuvent se former lorsqu'une activité provoque un transfert d'énergie dans une matière liquide ou semi-liquide.
- Agent de la sécurité biologique (ASB)
- Personne désignée pour superviser les pratiques en matière de biosécurité et de biosûreté dans une installation.
- Agent pathogène
- Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez l'humain ou l'animal. Les agents pathogènes humains et les agents zoopathogènes classés peuvent être trouvés à l'aide de la base de données sur les groupes de risque ePATHogène offerte par l'Agence de la santé publique du Canada.
- Agent pathogène aéroporté
- Agent pathogène ayant la capacité de se déplacer dans l'air ou d'y être transporté.
- Agent pathogène d'animaux aquatiques
- Agent pathogène, y compris ceux issus de la biotechnologie, ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez les animaux aquatiques qui, selon le Règlement sur la santé des animaux, sont les poissons à nageoires, les mollusques et les crustacés ou toute partie de ceux-ci à toute étape de leur cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les animaux aquatiques comprennent les mammifères aquatiques qui passent leur vie dans l'eau (p. ex. les phoques, les dauphins).
- Agent pathogène d'animaux terrestres
- Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez les animaux terrestres; y compris ceux dérivés de la biotechnologie. Ceux-ci comprennent les agents pathogènes ayant la capacité de causer une maladie chez les oiseaux et les amphibiens, mais ce terme ne s'applique pas aux agents pathogènes qui causent des maladies seulement chez les animaux aquatiques ou les invertébrés. Ceci comprend également les agents pathogènes d'animaux terrestres ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine) présents sur ou dans des produits ou des sous-produits animaux, ou d'autres organismes.
- Agent pathogène non indigène d'animaux terrestres
- Agent pathogène qui provoque une maladie animale figurant sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, et qui est considéré comme allogène au Canada, ou toute autre maladie animale considérée comme allogène au Canada ayant une conséquence importante sur la santé des animaux, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (c.-à-d. un agent causant une maladie animale exotique qui ne se retrouve pas au pays). Ces agents pathogènes peuvent avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne.
- Agent pathogène zoonotique
- Agent pathogène qui cause une maladie chez l'humain et l'animal (c.-à-d. une zoonose) et qui peut être transmis des animaux aux humains et vice-versa. Ces agents sont considérés à la fois comme des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes.
- Agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE)
- Sous-ensemble d'agents pathogènes humains et de toxines qui présentent un risque accru en matière de biosûreté en raison de la possibilité qu'ils soient utilisés comme arme biologique. Au paragraphe 10 du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT), les ABCSE sont identifiés comme des agents pathogènes et des toxines « précisés ». Les ABCSE comprennent donc tous les agents pathogènes de groupe de risque 3 (GR3) et de GR4 qui se retrouvent sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation, publiée par le Groupe d'Australie et modifiée de temps à autre, à l'exception du virus Duvenhage, du virus rabique et de tous les autres du genre Lyssavirus, du virus de la stomatite vésiculaire, ainsi que du virus de la chorioméningite lymphocytaire. Les ABCSE comprennent aussi toutes les toxines qui se trouvent à la fois à l'annexe 1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation et qui sont présentes en quantités supérieures aux quantités seuils énoncées au paragraphe 10(2) du RAPHT.
- Aire administrative
- Salle ou pièces voisines qui sont réservées pour des activités qui ne comportent pas de matières réglementées. Les aires administratives n'exigent pas d'équipement ou de systèmes de confinement, et il n'est pas nécessaire d'y mettre en œuvre des pratiques opérationnelles en matière de confinement. Les bureaux, les aires de photocopie, les salles de réunion et les salles de conférence sont des exemples d'aires administratives.
- Animal réglementé
- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les animaux réglementés comprennent :
- les animaux infectés ou intoxiqués de manière expérimentale avec un agent pathogène humain ou une toxine (en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines);
- les animaux infectés ou intoxiqués de manière naturelle ou expérimentale avec un agent pathogène d'animaux terrestres ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), y compris ceux connus ou soupçonnés d'être infectés ou intoxiqués (en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux).
- Barrière de confinement
- Structures physiques ou barrières qui créent une limite entre les espaces « propres » et les espaces « sales » ou entre les zones à plus faible risque de contamination et celles à risque plus élevé (p. ex. entre les espaces de travail en laboratoire, les aires de production à grande échelle, les salles animalières, les box et les salles de nécropsie, et l'extérieur de cette aire de confinement). La barrière de confinement est elle-même créée par les murs, les portes, les planchers et les plafonds qui entourent physiquement les espaces à l'intérieur du confinement, ainsi que par le courant d'air vers l'intérieur aux portes critiques (là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé).
- Besoin de savoir
- Principe fondamental de la sécurité qui restreint l’accès à des espaces précis, des matières réglementées et des ressources connexes (p. ex. des renseignements sensibles, de l’équipement, des systèmes de soutien essentiels) aux personnes qui en ont besoin pour assumer les responsabilités relatives à leurs postes. Seules les personnes qui ont une raison ou une autorisation légitime selon les responsabilités relatives à leurs postes peuvent avoir accès à des espaces précis et aux ressources connexes.
- Bioconfinement
- Voir « Confinement ».
- Biosécurité
- Ensemble des principes, des technologies et des pratiques liés au confinement mis en œuvre pour empêcher l'exposition involontaire à des matières réglementées, ou leur rejet accidentel.
- Biosûreté
- Ensemble des mesures de sûreté visant à prévenir la perte, le vol, le mésusage, le détournement ou le rejet volontaire de matières réglementées ou d'autres ressources connexes (p. ex. les membres du personnel, l'équipement, les matières non infectieuses, les animaux, les renseignements sensibles).
- Bonnes pratiques microbiologiques
- Code de déontologie fondamental régissant toutes les activités de laboratoire comportant des matières biologiques. Ce code sert à protéger les membres du personnel de laboratoire et à prévenir la contamination de leur milieu de travail et des échantillons utilisés.
- Box
- Salle ou espace conçu pour héberger un ou plusieurs animaux où la salle elle-même sert de confinement primaire. Ces espaces servent à héberger des gros animaux (p. ex. du bétail, des cerfs) ou des petits animaux qui sont hébergés dans des cages ouvertes (c.-à-d. pas des cages de confinement primaire).
- Cage de confinement primaire
- Cage pour animaux qui sert de dispositif de confinement primaire et qui empêche le rejet de matières réglementées. Ce type de cage comprend les cages ventilées à couvercle filtrant et les étagères à cages de micro-isolation ventilées, avec ou sans filtre à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA).
- Cage ouverte
- Cage destinée à contenir des animaux à un endroit donné (p. ex. un enclos). Ce type de cage n'empêche pas le rejet de matières réglementées et ne répond donc pas aux exigences visant les cages de confinement primaire.
- Certification de l'installation
- Processus par lequel l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) reconnaît officiellement qu'une zone de confinement ou une installation satisfait aux exigences relatives au confinement physique, aux pratiques opérationnelles et aux essais de vérification et de performance décrites dans la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition. Le renouvellement de la certification de l'installation est accordé par l'ACIA à la suite d'un processus d'examen simplifié.
- Charge représentative
- Contenu d'une charge simulée qui comprend des matières de nature particulière (p. ex. des matières plastiques, des déchets, des liquides, des carcasses), y compris des charges mixtes (p. ex. contenant des embouts de pipette, des géloses et des gants), qui permet de valider une méthode de décontamination utilisée pour traiter les charges régulières. La quantité qui serait décontaminée dans une seule charge peut être un nombre (p. ex. 6 sarraus), une taille (p. ex. un sac à autoclave rempli au 2/3) ou un poids (p. ex. 5 kg) définis.
- Communauté
- Comprend à la fois la communauté humaine (c.-à-d. le public) et la population animale.
- Confinement
- Ensemble de paramètres de conception physique et de pratiques opérationnelles visant à protéger les membres du personnel, le milieu de travail immédiat et la communauté contre toute exposition à des matières biologiques. Dans le même contexte, le terme « bioconfinement » est aussi employé.
- Confinement primaire
- Premier niveau de barrière physique conçu de façon à confiner des matières réglementées, et à prévenir leur rejet. On obtient le confinement primaire en se servant d'un dispositif, d'un équipement, ou d'une autre structure physique qui crée une barrière entre les matières réglementées et l'individu, le milieu de travail ou d'autres espaces à l'intérieur de la zone de confinement. Des exemples de ce type de confinement comprennent les enceintes de sécurité biologique, les boîtes à gants et les cages de micro-isolation. Dans les box, la salle elle-même sert de confinement primaire; l'équipement de protection individuel sert donc de protection primaire contre l'exposition.
- Contamination
- Présence non désirée de matières réglementées sur une surface (p. ex. la paillasse, les mains, les gants) ou dans d'autres matières (p. ex. les échantillons de laboratoire, les cultures cellulaires).
- Contamination évidente
- Accumulation de matières organiques (p. ex. de la litière, de la nourriture, des excréments, du sang, des tissus) sur une surface qui peuvent être éliminées par des moyens physiques (p. ex. en grattant, en brossant, en essuyant avec un linge).
- Contenant primaire
- Réceptacle étanche conçu pour contenir différents types d'échantillons, y compris des matières réglementées (p. ex. une éprouvette, un flacon)
- Contenant secondaire
- Contenant étanche renfermant des contenants primaires (p. ex. un sac à autoclave à l'intérieur d'un contenant solide résistant aux impacts).
- Contrôle des clés
- Mécanisme pour empêcher la reproduction non autorisée ou l’accès non autorisé aux clés ou aux cartes d’accès et pour documenter dans un registre les personnes autorisées qui ont reçu une clé ou une carte d’accès. Le contrôle des clés peut comprendre l’utilisation de clés ou de cartes d’accès qui ne peuvent pas être reproduites ou qui ne sont pas facilement accessibles sur le marché, ou des procédures pour empêcher les clés ou les cartes d’accès de sortir de l’édifice (p. ex. échangées contre un effet personnel [p. ex. une carte d’identité, un dispositif], un système de suivi électronique qui enregistre la date à laquelle une clé ou une carte d’accès a été remise et retournée, ainsi que le nom de la personne à laquelle elle a été remise).
- Corridor « propre »
- Dans les espaces de travail en laboratoire et les zones de confinement de gros animaux, un corridor qui est considéré exempt de contamination. Les sas séparant le corridor « propre » de chaque box et salle de nécropsie, ainsi que l'adhésion rigoureuse aux pratiques opérationnelles (p. ex. pour l'entrée et la sortie), sont critiques pour prévenir la propagation de la contamination à l'intérieur de la zone de confinement.
- Corridor « sale »
- Dans les espaces de travail en laboratoire et les zones de confinement de gros animaux, un corridor qui est considéré comme étant contaminé. Le corridor « sale » permet le déplacement des membres du personnel, des échantillons, des animaux réglementés et des matières réglementées entre les box et les salles de nécropsie.
- Courant d'air vers l'intérieur
- Courant d'air qui s'écoule constamment des zones dont le niveau de confinement ou le risque de contamination est plus bas vers les zones dont le niveau de confinement ou le risque de contamination est plus élevé, et ce, en raison d'une pression différentielle de l'air négative à l'intérieur de la zone de confinement, créée par un système de ventilation. Le courant d'air vers l'intérieur protège les espaces « propres » contre le rejet d'agents pathogènes aéroportés, d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées.
- Culture
- Multiplication in vitro de microorganismes, de tissus, de cellules ou d'autres matières vivantes dans des conditions contrôlées (p. ex. la température, l'humidité, les nutriments) afin d'augmenter le nombre ou la concentration de ces organismes ou de ces cellules. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, le terme « culture cellulaire » réfère à une culture de cellules d'origine humaine ou animale.
- Cuve d'immersion
- Récipient situé à même la barrière de confinement et rempli de désinfectant pour permettre aux membres du personnel de retirer de façon sécuritaire du matériel et des échantillons des zones de confinement en les immergeant pour décontaminer leur surface.
- Danger
- Source possible de dommage, de tort, ou d'effets indésirables. Dans le contexte de la biosécurité, des objets (p. ex. des objets pointus ou tranchants, des aiguilles), des matières (p. ex. des agents pathogènes, des toxines), des animaux (p. ex. des morsures, des égratignures) et des situations (p. ex. une défaillance du système de confinement) en sont des exemples.
- Déchet
- Matière solide ou liquide produite par une installation et destinée à être éliminée.
- Décontamination
- Procédé qui consiste à traiter des matières et des surfaces pour que leur manipulation soit sécuritaire et qu'elles soient relativement exemptes de microorganismes, de toxines ou de prions. La décontamination s'effectue par désinfection, inactivation ou stérilisation.
- Déplacement
- Fait de déplacer (p. ex. amener, apporter, conduire, relocaliser) des personnes, des matières (y compris des matières réglementées) ou des animaux entre deux emplacements du même édifice. Le déplacement peut se faire de différentes manières : à l'intérieur d'une même zone de confinement, vers une autre zone de confinement et vers un autre emplacement dans le même édifice.
- Désinfectant
- Agent chimique ayant la capacité d'éliminer le matériel biologique viable sur les surfaces ou dans les déchets liquides. L'efficacité peut varier selon les propriétés de l'agent chimique, la concentration, la durée de conservation et le temps de contact.
- Désinfection
- Procédé qui élimine la plupart des formes de microorganismes vivants présents sur des surfaces ou des objets inanimés.
- Dispositif antirefoulement d'eau
- Système qui protège l'eau acheminée à la zone de confinement contre la contamination en cas de refoulement de l'eau. Plusieurs types de dispositifs antirefoulement d'eau sont dotés de prises d'essai qui permettent de confirmer qu'ils fonctionnent correctement.
- Dispositif de confinement primaire
- Appareil ou équipement conçu pour empêcher le rejet de matières réglementées et assurer le confinement primaire (c.-à-d. former une barrière physique entre les matières réglementées et la personne et/ou le milieu de travail). Les enceintes de sécurité biologique, les isolateurs, les centrifugeuses munies de godets ou de rotors étanches, l'équipement de procédé, les fermenteurs, les bioréacteurs, les cages de micro-isolation et les étagères à cages ventilées en sont des exemples.
- Document législatif
- Les documents législatifs délivrés par l'Agence de la santé publique du Canada comprennent les suivants :
- Permis visant des agents pathogènes et des toxines pour conduire une ou plusieurs activités réglementées avec des agents pathogènes ou des toxines;
- Permis d'agents pathogènes d'animaux terrestres pour l'importation ou le transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres en culture pure ou dans des échantillons ne provenant pas d'animaux (p. ex. un échantillon humain ou environnemental), à l'exception des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.
- Les documents législatifs délivrés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'appliquent aux agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, aux agents pathogènes d'animaux terrestres présents dans des animaux, des produits ou des sous-produits animaux, ou dans d'autres organismes, et aux animaux infectés ou intoxiqués de manière naturelle ou expérimentale avec un agent pathogène d'animaux terrestres. Ces documents comprennent les suivants :
-
- Permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres;
- Permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres;
- Certification de l'installation et vérification de conformité.
- Enceinte de sécurité biologique (ESB)
- Dispositif de confinement primaire qui offre une protection aux membres du personnel, à l'environnement et aux produits (selon la catégorie d'ESB) lors de travaux avec des matières biologiques.
- Entreposage à long terme
- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, le fait de posséder des matières réglementées plus de 30 jours après leur réception ou leur création.
- Équipement de procédé
- Équipement particulier servant à l'exécution d'un procédé de fabrication comportant des matières biologiques. Le terme « équipement de procédé » est généralement employé pour décrire l'équipement utilisé pour exécuter des procédés à grande échelle (p. ex. l'équipement de fermentation industrielle, les bioréacteurs).
- Équipement de protection individuel (EPI)
- Équipement ou vêtement porté par les membres du personnel à titre de barrière afin de réduire le risque d'exposition aux matières réglementées. Des exemples d'EPI comprennent les sarraus, les blouses, les vêtements de protection couvrant toutes les parties du corps, les gants, les chaussures de sécurité, les lunettes de sécurité, les masques et les appareils de protection respiratoire.
- Espace de travail en laboratoire
- Espace à l'intérieur d'une zone de confinement conçu et équipé de façon à pouvoir y mener des activités in vitro (p. ex. à des fins de diagnostic, d'enseignement et de recherche).
- Étalonnage
- Processus permettant de déterminer, normaliser, ajuster ou rectifier les paramètres ou les graduations d'un instrument de mesure ou d'une pièce d'équipement.
- Évaluation des besoins en matière de formation
- Évaluation qui vise à cerner les besoins actuels et futurs en ce qui concerne la formation des membres du personnel de l'installation (c.-à-d. de l'organisation, de la zone de confinement), y compris la formation, la formation de perfectionnement et la requalification, et les lacunes du programme de formation existant.
- Évaluation des risques associés à l'agent pathogène
- Évaluation des caractéristiques inhérentes à un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique en comportant des parties) qui détermine la classification du groupe de risque. Une évaluation des risques associés à l'agent pathogène comporte l'analyse de quatre facteurs de risque clés, y compris la pathogénicité (c.-à-d. l'infectivité et la virulence), les mesures pré- et post-exposition, la transmissibilité et l'impact sur la population animale (c.-à-d. la gamme d'hôtes, la distribution naturelle et l'impact économique).
- Évaluation des risques de biosûreté
- Évaluation des risques qui consiste à définir et à classer par ordre de priorité les matières réglementées et les autres ressources connexes (p. ex. l'équipement, les animaux, les renseignements sensibles, les membres du personnel, le matériel non infectieux), à évaluer la probabilité des menaces, les vulnérabilités et les conséquences associées, ainsi qu'à recommander des stratégies d'atténuation appropriées afin de protéger ces ressources contre des événements de biosûreté.
- Évaluation globale des risques
- Évaluation générale qui appuie le programme de biosécurité dans son ensemble et qui peut comprendre plusieurs zones de confinement au sein d'une organisation. L'évaluation globale des risques détermine quels sont les dangers, les risques et quelles sont les stratégies d'atténuation pour les activités proposées comportant des matières réglementées. Les stratégies d'atténuation et de gestion des risques tiennent compte du type de programme de biosécurité nécessaire pour prévenir l'exposition des membres du personnel aux matières réglementées ainsi que le rejet de celles-ci.
- Évaluation locale des risques (ELR)
- Évaluation propre à un endroit en particulier réalisée pour repérer les dangers associés aux activités menées ainsi qu'aux matières réglementées utilisées. Cette évaluation permet d'élaborer des stratégies d'atténuation des risques et des stratégies de gestion des risques, qui doivent être intégrées aux paramètres de conception relatifs au confinement physique et aux pratiques opérationnelles de l'installation.
- Exigences opérationnelles
- Procédures et contrôles administratifs respectés dans une zone de confinement pour protéger les membres du personnel, l'environnement et, ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé à la section 4.
- Exigences physiques en matière de confinement
- Mesures d'ingénierie et exigences relatives à la conception de l'installation visant à créer une barrière physique pour protéger les membres du personnel, l'environnement et ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé à la section 3.
- Exigences relatives aux essais de vérification et de performance
- Essais de vérification et de performance nécessaires pour démontrer qu'une installation répond aux exigences physiques en matière de confinement énoncées à la section 3 et, dans certains cas, aux exigences opérationnelles énoncées à la section 4. Les exigences relatives aux essais de vérification et de performance figurent à la section 5.
- Exportation
- Activité qui consiste à expédier (p. ex. transférer, transporter) des matières réglementées du Canada vers un autre pays ou juridiction. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, ce terme ne s'applique pas aux activités auxquelles la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses s'applique, ou à l'exportation d'agents pathogènes humains ou de toxines autorisée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
- Exposition
- Contact ou proximité étroite avec des agents pathogènes ou des toxines pouvant respectivement causer une infection ou une intoxication. Les voies d'exposition comprennent l'inhalation, l'ingestion, l'inoculation et l'absorption.
- Filtre à haute efficacité
- Dispositif offrant une efficacité de filtration comparable à celle des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA). Lorsque les filtres sont exposés à de la chaleur ou de l'humidité, les filtres à haute efficacité sont considérés comme étant des solutions de rechange acceptables aux filtres HEPA. Les filtres à membrane situés sur les évents de plomberie et les conduites destinées à la surveillance des pressions différentielles de l'air en sont des exemples.
- Filtre à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA)
- Filtre à air mécanique plissé permettant de retenir plus de 99,97 % des particules aéroportées de 0,3 µm de diamètre, soit les particules les plus pénétrantes en raison de leur taille. Les phénomènes d'impaction, de diffusion et d'interception rehaussent la capacité des filtres HEPA à piéger et à retenir efficacement les particules dont le diamètre est inférieur ou supérieur à 0,3 µm.
- Fonction du programme
- Description des travaux qui seront effectués dans une zone de confinement. Cette description comprend, entre autres, la portée des travaux (p. ex. des activités de diagnostic, d'enseignement, de recherche, de production à grande échelle, de travail in vitro ou in vivo), la liste des matières réglementées qui seront manipulées ou entreposées, la liste des espèces animales qu'implique le travail in vivo avec des matières réglementées dans la zone, ainsi que la liste des procédures qui peuvent générer des aérosols.
- Forte concentration
- Concentration de matières réglementées qui augmente les risques associés à la manipulation de la matière (c.-à-d. la probabilité ou les conséquences d'une exposition sont plus importantes).
- Groupe de risque (GR)
- Groupe dans lequel un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique contenant des parties de ceux-ci) est classé en fonction de ses caractéristiques inhérentes, comme la pathogénicité, la virulence, la transmissibilité et l'existence d'un traitement prophylactique ou thérapeutique efficace. Le groupe de risque indique quel est le risque pour la santé des personnes et du public ainsi que pour la santé des animaux et des populations animales.
- Habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT)
- Autorisation délivrée par l'Agence de la santé publique du Canada, en vertu de l'article 34 de la LAPHT, à la suite d'une vérification des antécédents et de la cote de fiabilité d'une personne.
- Importation
- Activité qui consiste à introduire au Canada (p. ex. transférer, transporter) des matières réglementées en provenance d'un autre pays ou juridiction. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, ce terme ne s'applique pas aux activités auxquelles la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses s'applique.
- In situ
- Du latin « en place »; se rapporte à un endroit fixe où une expérience ou une procédure se déroule.
- In vitro
- Du latin « dans le verre »; se rapporte à une expérience menée en milieu artificiel avec des composantes d'un organisme vivant (p. ex. manipuler des cellules dans une boîte de Pétri), y compris les activités comportant des lignées cellulaires ou des œufs.
- In vivo
- Du latin « dans le vivant »; se rapporte à une expérience menée dans un organisme vivant (p. ex. une étude des effets d'un traitement antibiotique sur des modèles animaux).
- Inactivation
- Processus qui détruit l'activité des agents pathogènes et des toxines.
- Incident
- Événement ou situation pouvant causer une blessure, du mal, une infection, une intoxication, une maladie ou un dommage. Les accidents et ceux évités de justesse sont considérés comme des incidents.
- Inspection
- Mesures prises dans le but de vérifier si une organisation se conforme ou non à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, à la Loi sur la santé des animaux et/ou au Règlement sur la santé des animaux, ou afin de prévenir la non-conformité.
- Installation
- Structure, édifice ou espace défini à l'intérieur d'une structure ou d'un édifice dans lesquels sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. Il peut s'agir d'un unique laboratoire de recherche ou de diagnostic, d'une aire de production à grande échelle ou d'une zone où des animaux sont hébergés. Ce terme peut également désigner un ensemble de salles de ce type ou un édifice où se trouvent plusieurs espaces de ce type.
- Intoxication
- Trouble ou maladie causé par une substance qui peut être symptomatique ou asymptomatique et entraîner un dérèglement physiologique. L'intoxication fait suite à l'exposition (c.-à-d. l'ingestion, l'inhalation, l'inoculation, l'absorption) à une toxine produite par un microorganisme ou dérivée de celui-ci. Une intoxication peut aussi être le résultat d'une exposition à une toxine microbienne produite de manière synthétique.
- Inventaire
- Liste des ressources biologiques d'une zone de confinement répertoriant les matières réglementées pour leur entreposage à long terme (c.-à-d. plus de 30 jours) à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone de confinement.
- Laboratoire
- Espace à l'intérieur d'une installation ou l'installation elle-même où des matières biologiques sont manipulées.
- Lacune
- Observation de non-conformité avec les exigences applicables de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, d'une directive en matière de biosécurité, de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, de la Loi sur la santé des animaux ou du Règlement sur la santé des animaux.
- Maladie
- Trouble structural ou fonctionnel touchant un humain ou un animal vivant, ou une partie du corps de ceux-ci. Les maladies sont causées par une infection ou une intoxication et se manifestent généralement par des signes et des symptômes caractéristiques.
- Maladie animale émergente (MAÉ)
- Nouvelle maladie infectieuse qui résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant; maladie infectieuse connue se propageant à une nouvelle population ou zone géographique; ou maladie diagnostiquée pour la toute première fois ou causée par un agent pathogène auparavant inconnu qui pourrait avoir un effet important sur la santé animale, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Maladie animale exotique (MAE)
- Maladie qui apparait sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, qui n'est pas considérée indigène au Canada, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); ou toute maladie à déclaration obligatoire réglementée par l'ACIA qui n'est pas présente au Canada et pour laquelle l'ACIA a une stratégie de réponse établie; ou toute autre maladie qui, après avoir été dûment examinée, est désignée comme telle par le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Les agents pathogènes causant une MAE peuvent également avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne.
- Manipulation ou entreposage
- « Manipulation ou entreposage » comprend la possession, la manipulation, l'utilisation, la production, l'entreposage, le transfert, l'importation, l'exportation, le rejet, l'élimination ou l'abandon de matières réglementées, ainsi que le fait de permettre l'accès à de telles substances. Cela comprend donc toutes les activités réglementées comportant des agents pathogènes humains ou des toxines énoncées au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. Tous les temps de verbe et toutes les variations de « manipulation ou entreposage » sont également utilisés dans ce contexte.
- Manuel de biosécurité
- Ensemble de documents propres à une installation dans lesquels sont décrits les éléments fondamentaux d'un programme de biosécurité (p. ex. le plan de biosûreté, la formation, l'équipement de protection individuel) qui s'appliquent à la zone de confinement. Les renseignements peuvent être présentés sous la forme d'un seul document papier ou électronique ou d'un ensemble de documents.
- Matière biologique
- Microorganismes, protéines ou acides nucléiques pathogènes ou non pathogènes, ou toute autre matière biologique pouvant contenir un de ces éléments, en partie ou en entier, ou d'autres agents infectieux. Les bactéries, les virus, les champignons, les prions, les toxines, les organismes génétiquement modifiés, les acides nucléiques, les échantillons de tissus, les échantillons de diagnostic, les échantillons environnementaux, les vaccins vivants et les isolats d'un agent pathogène ou d'une toxine (p. ex. les cultures pures, les suspensions, les spores purifiées) sont tous des exemples de microorganismes.
- Matière infectieuse
- Tout isolat d'un agent pathogène ou toute matière biologique qui contient des agents pathogènes humains ou des agents zoopathogènes, et qui présente donc un risque pour la santé humaine ou animale.
- Matière réglementée
- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les matières réglementées comprennent :
- les agents pathogènes humains et les toxines (en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines);
- les agents pathogènes d'animaux terrestres (en vertu de la Loi sur la santé des animaux [LSA] et du Règlement sur la santé des animaux [RSA]);
- les agents pathogènes d'animaux terrestres dans des animaux, des produits ou des sous-produits animaux, ou d'autres organismes (en vertu de la LSA et du RSA).
- Mécanisme
- Dispositif physique ou mesure opérationnelle.
- Mécanisme d'interverrouillage
- Mécanisme qui coordonne le fonctionnement de plusieurs composantes (p. ex. pour prévenir l'ouverture simultanée de deux portes, pour que le ventilateur d'approvisionnement s'éteigne en cas de défaillance du ventilateur d'évacuation).
- Membre du personnel autorisé
- Personne ayant reçu un droit d’accès sans escorte au-delà des barrières de biosûreté ou à une zone de confinement par l’autorité interne responsable (p. ex. le directeur de la zone de confinement, l’agent de la sécurité biologique, une autre personne à laquelle cette responsabilité a été confiée). Pour obtenir accès à ces espaces et aux ressources connexes (p. ex. des renseignements sensibles, des systèmes de soutien essentiels), il faut satisfaire à diverses exigences en matière de formation et faire preuve de compétence envers les procédures opératoires normalisées, tel que déterminé par l’évaluation des besoins en matière de formation. Des critères supplémentaires relatifs à l’accès comprennent le fait d’avoir une habilitation de sécurité (p. ex. une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines) ou un contrôle de sécurité de base approprié et d’avoir le besoin de savoir, tel que déterminé par l’évaluation des risques de biosûreté pour les espaces et les ressources connexes.
- Microorganisme
- Entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ne pouvant pas raisonnablement être décelable à l'œil nu et ayant la capacité de se répliquer ou de transférer son matériel génétique. Les microorganismes comprennent les bactéries, les champignons, les virus et les parasites, qu'ils soient pathogènes ou non.
- Mise en service
- Processus consistant à soumettre une zone de confinement nouvellement construite, modifiée ou rénovée à une série d'essais de vérification et de performance pour confirmer que la zone, y compris l'équipement et les systèmes de confinement, fonctionnera conformément aux spécifications et aux objectifs liés à la conception physique et qu'elle est prête à être exploitée ou à reprendre les activités, respectivement.
- Niveau de confinement (NC)
- Exigences minimales liées au confinement physique et aux pratiques opérationnelles visant la manipulation sécuritaire des matières réglementées dans les laboratoires, les aires de production à grande échelle et les environnements de travail avec des animaux. Il existe quatre niveaux de confinement, allant du niveau de base (c.-à-d. NC1) au niveau le plus élevé (c.-à-d. NC4).
- Non-conformité
- État de non-conformité aux exigences législatives (p. ex. la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, la Loi sur la santé des animaux, le Règlement sur la santé des animaux, les conditions du permis visant des agents pathogènes et des toxines et du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres).
- Pathogénicité
- Capacité d'un agent pathogène de causer une maladie chez un hôte humain ou animal.
- Permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres
- Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu des alinéas 51a) et 51b) du Règlement sur la santé des animaux, l'importation au Canada d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).
- Permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres
- Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu de l'alinéa 51.1a) du Règlement sur la santé des animaux, le transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).
- Permis visant des agents pathogènes et des toxines
- Autorisation délivrée par l'Agence de la santé publique du Canada :
- en vertu de l'article 18 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, permettant de mener une ou plusieurs activités réglementées comportant des agents pathogènes humains ou des toxines;
- en vertu de l'alinéa 51a) du Règlement sur la santé des animaux, permettant d'importer au Canada des agents pathogènes d'animaux terrestres (à l'exception des agents pathogènes associés à des maladies animales émergentes et des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres).
- Plan d'intervention d'urgence (PIU)
- Document énonçant les mesures à prendre et les parties responsables en cas d'urgence, par exemple en cas : de déversement, d'exposition, ou de rejet de matières réglementées; de fuite d'un animal; de blessure ou de maladie chez un membre du personnel; de panne de courant; ou de toute autre situation d'urgence.
- Plan de gestion des risques
- Plan qui propose les dispositions organisationnelles et les bases de la gestion des risques qui permettent de concevoir, de mettre en pratique, de surveiller, de réviser et d'améliorer continuellement les procédures de gestion des risques, et ce, dans toute l'organisation.
- Porte critique
- Toute porte d'une zone de confinement, d'un box ou d'une salle de nécropsie où le maintien d'un courant d'air vers l'intérieur est exigé.
- Portes hermétiques
- Portes conçues pour ne permettre aucune fuite d'air (0 %) dans des conditions de fonctionnement normales et qui demeurent hermétiques lors de la décontamination gazeuse et la vérification du taux de décroissement de pression. Les portes peuvent être rendues hermétiques à l'aide de joints pneumatiques ou de jonctions à compression.
- Possibilité de double usage
- Propriétés d'un agent pathogène ou d'une toxine, d'une méthode scientifique, de la propriété intellectuelle, ou d'une autre ressource connexe qui leur permettent d'être utilisés autant pour mener des activités scientifiques légitimes (p. ex. à des fins commerciales, médicales ou de recherche) que d'être volontairement mal utilisés pour causer du tort ou une maladie. Les agents pathogènes et les toxines qui pourraient être utilisés comme arme biologique (p. ex. pour du bioterrorisme), une méthode qui facilite la propagation de tels agents pathogènes dans un contexte de laboratoire non traditionnel, ou la découverte qu'une certaine mutation confère une résistance à tous les traitements disponibles sont des exemples de ressources à possibilité de double usage.
- Poste ventilé pour le changement de cages
- Équipement spécialement conçu pour changer la litière ou toute autre substance placée à l'intérieur des cages des animaux. Cet équipement agit de deux façons :
- il dirige l'air à l'opposé de l'utilisateur, vers l'intérieur de l'unité, avec une vélocité suffisante pour protéger l'utilisateur contre une exposition aux matières réglementées;
- il filtre l'air évacué avant son rejet hors de l'unité, ce qui permet de prévenir le rejet de matières réglementées dans l'environnement.
- Prion
- Petite particule protéique infectieuse généralement reconnue comme étant impliquée dans le développement d'un certain groupe de maladies neurodégénératives chez l'humain et l'animal, à savoir les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
- Procédure opératoire normalisée (PON)
- Document qui normalise, en fonction d'une évaluation locale des risques, les procédures et les pratiques de travail sécuritaires utilisées dans le cadre d'activités réalisées avec des matières réglementées dans une zone de confinement. Les protocoles expérimentaux, les procédures d'entrée et de sortie, les protocoles de décontamination et les procédures d'intervention en cas d'urgence sont des exemples de PON.
- Production à grande échelle
- Activités de production ou de pré-production, y compris des cultures in vitro, qui impliquent des volumes importants de matières réglementées. Les activités à grande échelle diffèrent des activités à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essai selon l'équipement utilisé, puisqu'elles sont généralement effectuées dans des fermenteurs, des bioréacteurs et d'autres systèmes fermés.
- Programme de biosécurité
- Programme qui décrit les politiques et les plans institutionnels qui facilitent la manipulation et l'entreposage sécuritaire des matières réglementées, et qui préviennent leur rejet hors de la zone de confinement. Les éléments fondamentaux d'un programme de biosécurité comprennent un manuel de biosécurité, un programme de formation exhaustif, un programme de surveillance médicale, un plan d'intervention d'urgence, des procédures opératoires normalisées et un plan de biosûreté.
- Programme de surveillance médicale
- Programme conçu pour prévenir et déceler les maladies liées à une exposition à des matières réglementées chez les membres du personnel. L'accent est principalement mis sur la prévention, mais le programme prévoit un mécanisme d'intervention par lequel une infection ou une intoxication possible est décelée et traitée avant qu'il n'en résulte une atteinte ou une maladie grave et pour réduire la possibilité de propagation de la maladie dans la communauté.
- Protection antirefoulement d'air
- Système qui, en cas de refoulement d'air, empêche l'air contaminé ou possiblement contaminé de s'échapper de la barrière de confinement par des conduits d'approvisionnement et d'évacuation d'air. Des volets de confinement automatisés (c.-à-d. qui se ferment automatiquement en cas de défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé [CVAC]) ou des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) sont couramment utilisés à cette fin.
- Quantité seuil
- Quantité minimale au-dessus de laquelle une toxine réglementée en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est qualifiée de « toxine précisée » et, donc, considérée comme un agent biologique à cote de sécurité élevée, tel que décrit au paragraphe 10(2) du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines.
- Rapport de notification
- Outil utilisé pour aviser l'Agence de la santé publique du Canada et pour documenter les renseignements préliminaires associés à un incident (p. ex. une exposition; une possession, production ou rejet involontaire; un agent pathogène manquant, volé ou perdu).
- Rapport de suivi de l'exposition
- Outil utilisé pour déclarer et documenter des renseignements liés à un incident survenu et à l'enquête pour un incident d'exposition ayant fait l'objet d'une notification préalable à l'Agence de la santé publique du Canada.
- Recherche scientifique
- Selon la définition de l'article 1 du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, il s'agit d'une enquête ou d'une recherche systématique menée dans un domaine de la science ou de la technologie au moyen d'activités réglementées, telles que :
- la recherche fondamentale, qui consiste en la pratique d'activités réglementées dans le but de faire avancer les connaissances scientifiques, sans toutefois viser une application pratique précise (p. ex. des études génomiques pour améliorer les connaissances sur la résistance à la maladie);
- la recherche appliquée, qui consiste en la pratique d'activités réglementées dans le but de faire avancer les connaissances scientifiques pour une application pratique précise (p. ex. le développement de souches de vaccin pour prévenir une maladie);
- le développement expérimental, qui consiste en la pratique d'activités réglementées pour faire avancer la science ou la technologie dans le but de créer, ou d'améliorer, des matériaux, des produits, des procédés ou des dispositifs (p. ex. la modification des voies dans diverses souches de microorganismes pour améliorer la production d'éthanol).
- Rejet
- Libération de matières réglementées hors d'un système de confinement ou d'une zone de confinement (p. ex. découlant d'une fuite, d'une pulvérisation, d'un dépôt, d'une décharge, d'une vaporisation).
- Renseignements sensibles
- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, documents et tout autre renseignement relatifs aux matières réglementées ou aux ressources connexes, pour lesquels il pourrait être raisonnablement attendu que la divulgation, l’accès, l’utilisation, la modification ou la destruction non autorisés :
- compromette la biosûreté; ou
- risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité de la communauté.
- Retour d'air
- Refoulement d'air à partir de l'avant d'une enceinte de sécurité biologique (ESB) de catégorie II, type B2, causé par une panne de courant, ou une défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) ou du ventilateur d'évacuation desservant l'ESB.
- Risque
- Probabilité qu'un événement indésirable (p. ex. un accident, un incident, un bris de confinement) survienne et les conséquences de cet événement.
- Salle animalière
- Salle conçue pour héberger des animaux dans des cages de confinement primaire. Ces espaces servent seulement pour les petits animaux (p. ex. des souris, des rats, des lapins).
- Salle de nécropsie
- Salle située à l'intérieur de la zone de confinement, où sont menées des nécropsies et des dissections d'animaux à l'extérieur d'un dispositif de confinement primaire.
- Sas
- Salle ou ensemble de salles situées à l'intérieur de la zone de confinement permettant de séparer les espaces « propres » des espaces « sales » (c.-à-d. séparer les zones à plus faible risque de contamination de celles à plus haut risque). Les sas sont utilisés pour franchir la barrière de confinement (entrée et sortie du personnel, du matériel et des animaux), pour entrer dans les salles animalières, les box ou les salles de nécropsie, et en ressortir. La présence d'un sas facilite le maintien des pressions différentielles de l'air négatives dans les zones de confinement où un courant d'air vers l'intérieur est exigé. Le sas peut également fournir un espace approprié aux points d'entrée ou de sortie pour enfiler, retirer et ranger l'équipement de protection individuel dédié et supplémentaire, lorsqu'exigé.
- Siphon à garde d'eau profonde
- Siphon de drainage dont la profondeur est suffisante pour maintenir de manière efficace une garde d'eau, en fonction des pressions différentielles de l'air qui peuvent exister (c.-à-d. de façon à ce que l'eau ne soit ni siphonnée dans la pièce, ni poussée dans le siphon). Habituellement, dans ce type de siphon, la profondeur de la garde d'eau est de 127 mm à 152 mm (5 à 6 po).
- Stérilisation
- Procédé qui élimine tous les microorganismes vivants, y compris les spores bactériennes.
- Surface de travail
- Surface dans la zone de confinement sur laquelle du travail est effectué. Les paillasses, les tables et les surfaces à l'intérieur des enceintes de sécurité biologique en sont des exemples.
- Système de confinement
- Équipement destiné à créer et à maintenir un certain niveau de confinement pour les matières réglementées. Les dispositifs de confinement primaire (p. ex. les enceintes de sécurité biologique), les systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC), les systèmes de contrôle et les systèmes de décontamination (p. ex. les autoclaves, les systèmes de décontamination des effluents) sont des exemples de systèmes de confinement.
- Système de contrôle d'accès
- Système physique ou électronique conçu pour restreindre l'accès aux membres du personnel autorisés seulement (p. ex. des serrures à clé, des cartes d'accès électroniques).
- Système de décontamination
- Équipement dont la capacité à permettre la manipulation sécuritaire de matières en les rendant relativement exemptes de microorganismes, de toxines ou de prions a été validée. Les autoclaves, les incinérateurs, les digesteurs et les systèmes de décontamination des effluents sont des exemples de systèmes de décontamination.
- Système de décontamination des effluents
- Équipement raccordé à la plomberie qui utilise la chaleur ou des procédés chimiques pour décontaminer les déchets liquides (c.-à-d. les effluents) produits dans la zone de confinement avant leur rejet dans les égouts sanitaires.
- Système de décontamination primaire
- Premier équipement validé utilisé pour décontaminer les déchets de la zone de confinement avant de les éliminer, de les incinérer ou de les rejeter dans les égouts sanitaires. Ceci permet d'éliminer ou d'inactiver les matières réglementées par des procédés de désinfection, de stérilisation ou d'inactivation. Ceci peut être suivi d'une décontamination secondaire.
- Système de détection d'intrusion (SDI)
- Technologie qui permet de surveiller et analyser les dispositifs d’alarme afin de déceler des signes d’accès non autorisé et d’activités malveillantes. Un SDI avertit les membres du personnel de sécurité lorsqu’il détecte des tendances ou des comportements suspects aux barrières de biosûreté physiques et logiques et à l’intérieur de celles-ci.
- Système de sécurité
- Gamme de technologies de sécurité à l’intérieur d’un espace défini conçues pour surveiller les signes d’accès non autorisé et d’activités malveillantes à l’encontre des ressources, des personnes et des renseignements d’une organisation.
- Système fermé
- Équipement, appareil, ou système de traitement conçu pour contenir des matières biologiques et prévenir leur rejet dans le milieu ambiant (p. ex. la zone de confinement).
- Système passe-plats
- Équipement doté de compartiments à deux portes qui est situé à même la barrière de confinement. Cet équipement permet d'introduire des matières à l'intérieur d'une barrière de confinement et de les retirer de celle-ci en toute sécurité. Les passe-plats, les cuves d'immersion, les chutes d'alimentation ainsi que les lave-cages et les autoclaves à deux portes qui traversent la barrière de confinement sont des exemples de systèmes passe-plats.
- Toxine (microbienne)
- Substance toxique produite par un microorganisme, ou dérivée de celui-ci, qui peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou animale. Les toxines humaines sont énumérées à l'annexe 1 et à la partie 1 de l'annexe 5 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
- Transfert
- Changement de possession (c.-à-d. de propriété) de matières réglementées entre des personnes qui travaillent dans une même installation ou dans des installations différentes (c.-à-d. le déplacement hors du ou des endroits énoncés dans le permis visant des agents pathogènes et des toxines ou le permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres vers tout autre endroit).
- Transport
- Fait de transporter (p. ex. envoyer, acheminer) des matières réglementées vers un édifice ou un emplacement différent du sien (c.-à-d. dont l'adresse n'est pas la même), au Canada ou à l'étranger, conformément à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
- Validation
- Fait de confirmer qu'une méthode permet d'atteindre l'objectif souhaité et convient à l'usage auquel elle est destinée grâce à des données probantes objectives. La validation peut être l'observation que des conditions particulières ont été respectées (p. ex. confirmer à l'aide d'indicateurs biologiques, d'indicateurs chimiques ou de dispositifs de surveillance paramétriques situés à des endroits difficiles à décontaminer qu'un cycle précis d'autoclavage peut décontaminer une charge représentative de déchets).
- Vérification
- Surveillance régulière de l'équipement et des procédés visant à confirmer leur efficacité continue entre les validations (p. ex. une mise à l'essai de la performance d'un autoclave en utilisant des indicateurs biologiques, la visualisation des jauges de courant d'air pour confirmer la fonction du ventilateur d'une enceinte de sécurité biologique). La comparaison de l'exactitude d'une pièce d'équipement avec celle prévue par une norme ou une procédure opératoire normalisée applicable est un exemple de vérification.
- Vérification du taux de décroissement de pression
- Méthode utilisée pour quantifier le taux de fuite dans un environnement hermétique.
- Vestiaire « propre »
- Espace désigné où les membres du personnel enfilent l'équipement de protection individuel dédié avant de pénétrer dans une zone de confinement, une barrière de confinement, une salle animalière, un box ou une salle de nécropsie. Le vestiaire « propre » est considéré comme étant exempt de contamination lorsque les procédures d'entrée et de sortie sont suivies. Dans les zones de confinement élevé, le vestiaire « propre » est situé à l'extérieur de la barrière de confinement.
- Vestiaire « sale »
- Espace désigné à l'intérieur de la barrière de confinement où l'équipement de protection individuel contaminé est retiré, y compris les chaussures dédiées, avant de sortir d'une zone de confinement, d'une barrière de confinement, d'une salle animalière, d'un box ou d'une salle de nécropsie. Lorsque tout fonctionne normalement, le vestiaire « sale » est considéré comme étant contaminé ou possiblement contaminé.
- Virulence
- Gravité ou sévérité d'une maladie causée par un agent pathogène.
- Volet de confinement
- Robinet d'arrêt qui permet la décontamination des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) en obturant les évents de plomberie et les conduits du système d'approvisionnement et d'évacuation de l'air de la zone de confinement. Les volets de confinement automatisés fournissent aussi une protection antirefoulement d'air en cas de défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) ou d'un refoulement du courant d'air.
- Volume important
- Volume de matières réglementées pour lequel les risques associés à la manipulation de cette matière sont accrus en comparaison avec des volumes à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essai (c.-à-d. le volume augmente la probabilité d'une exposition ou d'un rejet ou aggrave les conséquences de ceux-ci).
- Zone d'agent biologique à cote de sécurité élevée (ABCSE)
- Locaux de l'installation où des activités réglementées avec des ABCSE sont autorisées, tel que défini dans la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT). Cette zone peut être une pièce, un ensemble de pièces ou des équipements dans lesquels des ABCSE sont manipulés ou entreposés et dont l'accès est restreint aux membres du personnel autorisés titulaires d'une habilitation de sécurité valide en vertu de la LAPHT qui est émise par l'Agence de la santé publique du Canada.
- Zone de confinement
- Espace physique qui répond aux exigences liées à un niveau de confinement donné. Il peut s'agir d'une salle unique (p. ex. un laboratoire de niveau de confinement 2 [NC2]), d'une série de salles situées dans un même endroit (p. ex. plusieurs espaces de travail en laboratoire de NC2 non adjacents, mais verrouillables) ou d'une série de salles adjacentes (p. ex. des salles de NC3 comprenant des espaces de laboratoire réservés à certaines activités et des salles animalières ou des box séparés). Les espaces réservés au soutien de la zone, y compris les sas équipés de douches, les vestiaires « propres » et les vestiaires « sales », là où ils sont exigés, font partie de la zone de confinement.
- Zone de confinement de gros animaux (Zone GA)
- Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des box (c.-à-d. que la salle elle-même sert de confinement primaire). Une zone GA peut comprendre des box qui hébergent de gros animaux, comme du bétail ou des cervidés, ou des box qui hébergent de petits animaux, comme des souris ou des ratons laveurs, dans des cages ouvertes et non des cages de confinement primaire. Les salles de nécropsie, lorsqu'elles sont présentes, sont considérées comme faisant partie d'une zone GA.
- Zone de confinement de petits animaux (Zone PA)
- Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des cages de confinement primaire (p. ex. des micro-isolateurs) situées dans des salles animalières. Une zone PA peut contenir des souris, des rats ou des lapins, pourvu qu'ils soient hébergés dans des cages de confinement primaire.
- Zone de confinement élevé
- Zone de confinement (c.-à-d. un espace de travail en laboratoire, une aire de production à grande échelle, une salle animalière, un box, une salle de nécropsie), y compris tout espace réservé au soutien d'une zone de confinement, de niveau de confinement 3 (NC3), NC3-Agriculture et NC4.
- Zoonose
- Maladie transmissible entre des humains et des animaux vivants. Les zoonoses comprennent les anthropozoonoses (c.-à-d. les maladies transmises des animaux aux humains) et les zooanthroponoses, aussi appelés zoonoses inversées (c.-à-d. les maladies transmises des humains aux animaux).
1. Introduction
Au Canada et ailleurs, la pandémie de la COVID-19 a transformé le paysage de la biosécurité et de la biosûreté. La conception, la structure et l'exploitation des zones de confinement sont essentielles pour atténuer les risques relatifs à la biosécurité et à la biosûreté présentés par les matières réglementées, prévenir l'exposition des membres du personnel et protéger la santé publique contre un rejet de laboratoire. La NCB énonce les exigences en matière de biosécurité et de biosûreté qui protègent ultimement les membres du personnel de laboratoire et la communauté. La NCB énonce les exigences physiques en matière de confinement, les exigences opérationnelles, et les exigences relatives aux essais de vérification et de performance minimales qui s'appliquent aux installations où sont manipulés et entreposés des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines de GR2, GR3 et GR4. La troisième édition de la NCB remplace la Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, 2015.
1.1 Portée
Les installations qui détiennent un permis visant des agents pathogènes et des toxines (ci-après, un permis) en vertu de la LAPHT et du RAPHT, ainsi que les installations qui détiennent un permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou un permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres en vertu de la LSA et du RSA doivent se conformer à la NCB.
Les installations au Canada où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes d'animaux aquatiques importés doivent se conformer aux Normes relatives au confinement des installations manipulant des agents pathogènes d'animaux aquatiques de l'ACIA, première édition, 2010. De même, les installations canadiennes où sont manipulés ou entreposés des agents phytoravageurs qui ont été importés doivent se conformer aux Normes sur le confinement des installations manipulant des phytoravageurs, première édition, 2007, de l'ACIA. La NCB s'applique également aux agents pathogènes d'animaux aquatiques et aux agents phytoravageurs capables de causer des maladies chez les humains ou les animaux terrestres.
1.1.1 Agents pathogènes humains et toxines exclus de la LAPHT
La LAPHT ne s'applique pas à un agent pathogène humain ou une toxine qui est dans son milieu naturel, pourvu qu'il n'ait été ni cultivé (p. ex. mis en culture) ni intentionnellement recueilli ou extrait (p. ex. par centrifugation, chromatographie), ou à une drogue sous forme posologique dont la vente est permise ou autrement autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou à un agent pathogène humain ou une toxine contenu dans une telle drogue [LAPHT 4]. Les agents pathogènes humains et les toxines sont considérés comme étant dans leur milieu naturel dans les échantillons primaires (p. ex. le sang, le plasma, les écouvillons, l'urine, les fèces, le liquide céphalorachidien, les tissus, le lait) prélevés chez des patients qui sont infectés par un agent pathogène humain ou ont été exposés à une toxine, dans des échantillons environnementaux (p. ex. le sol, l'écorce d'arbre, le filtre à air) et dans des échantillons primaires prélevés chez des animaux exposés de manière naturelle. Les activités avec un agent pathogène ou une toxine dans son milieu naturel qui n'augmentent pas la quantité ou la concentration de l'agent pathogène, comme celles conçues pour détecter des protéines, des anticorps ou des acides nucléiques, sont également exclues de la LAPHT. Par conséquent, il n'y a aucune obligation légale en vertu de la LAPHT pour les installations où uniquement ces activités sont menées. Néanmoins, la NCB peut être utilisée comme référence pour les meilleures pratiques en matière de biosécurité afin de protéger la santé et la sécurité des membres du personnel et de la communauté.
1.1.2 Exemption de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la LAPHT
Les installations exemptées de l'exigence relative à la délivrance de permis sont tout de même réglementées en vertu de la LAPHT et, à ce titre, doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité du public contre les risques que présentent les activités impliquant des agents pathogènes humains et des toxines [LAPHT 6]. Ces installations peuvent faire l'objet d'une inspection par l'ASPC pour vérifier si toutes les précautions raisonnables ont été prises. À titre de pratique exemplaire, le fait de suivre les exigences physiques en matière de confinement et les exigences opérationnelles applicables énoncées dans la NCB peut aider à démontrer cela. Des lignes directrices supplémentaires de l'ASPC sur la biosécurité sont également disponibles pour appuyer davantage les installations exemptées.
1.1.2.1 Activités de diagnostic avec un agent pathogène humain
En vertu du paragraphe 27(1) du RAPHT, toute personne qui effectue des tests diagnostiques ou des analyses de laboratoire avec un agent pathogène humain qui n'est pas un prion ni un agent pathogène humain précisé (c.-à-d. un agent biologique à cote de sécurité élevée [ABCSE]) est exemptée de l'obligation d'obtenir un permis. Toutefois, cette exemption ne s'applique que si elle ne cultive pas (p. ex. la mise en culture) d'agent pathogène humain ou n'en produit pas d'une autre manière, ou, lorsqu'il y a une production, celle-ci est effectuée dans un contenant scellé qui empêche le rejet de l'agent pathogène et qui est décontaminé avant son élimination ou sa réutilisation (c.-à-d. le contenant demeure scellé jusqu'à ce que la décontamination ait été effectuée). L'exemption de l'obligation d'obtenir un permis s'applique également aux personnes qui manipulent des échantillons de contrôle de la qualité ou des épreuves de compétence contenant des agents pathogènes humains du GR2 ou du GR3 qui imitent des échantillons primaires et servent à confirmer l'exactitude continue des analyses diagnostiques (p. ex. pour étalonner un instrument, pour déterminer la performance des tests ou des mesures en laboratoire, pour surveiller la compétence continue du laboratoire), pourvu que ces échantillons ne contiennent ni prion ni ABCSE.
1.1.2.2 Soins vétérinaires avec un agent pathogène humain
En vertu du paragraphe 27(2) du RAPHT, les analyses de laboratoire ou les tests diagnostiques pour un agent pathogène humain du GR2 effectués par un vétérinaire agréé en vertu des lois d'une province, ou toute personne sous la supervision d'un vétérinaire agréé, sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis à condition que toute activité réglementée avec l'agent pathogène du GR2 soit menée dans le cadre de la médecine vétérinaire dans un établissement clinique de cette province. Cela comprend les tests diagnostiques tels que l'isolement, la culture, la mise en culture ou la concentration de l'agent pathogène afin d'identifier une infection par un agent pathogène du GR2 qui peut également infecter l'humain (c.-à-d. les agents pathogènes humains ou zoonotiques). L'exemption ne s'applique pas aux laboratoires vétérinaires de diagnostic qui offrent des services de tests diagnostiques auprès des vétérinaires (c.-à-d. qu'ils reçoivent des échantillons de cliniques et d'installations externes), ni aux tests diagnostiques d'échantillons provenant d'animaux exposés de manière intentionnelle ou expérimentale à un agent pathogène humain du GR2 (c.-à-d. la recherche vétérinaire ou les études in vivo impliquant des agents pathogènes humains ou des toxines).
1.2 Autorités de réglementation
Au Canada, les installations où des agents pathogènes humains ou des toxines sont manipulés ou entreposés sont réglementées en vertu de la LAPHT et du RAPHT. Les laboratoires de santé publique, les laboratoires d'enseignement et de recherche, les laboratoires de diagnostic et les usines de production de vaccins en sont des exemples. À moins d'être expressément exclues de la LAPHT, ou exemptées de l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la LAPHT ou du RAPHT, ces installations doivent obtenir un permis pour mener sciemment des activités réglementées avec un agent pathogène humain ou une toxine. Les installations canadiennes qui importent des agents zoopathogènes ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), ou des animaux, des produits ou sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine) sont réglementées en vertu de la LSA et du RSA. Les agents pathogènes zoonotiques (c.-à-d. capables de causer des maladies chez les humains et les animaux) qui sont importés au Canada sont réglementés en vertu de la LAPHT, du RAPHT, de la LSA et du RSA.
1.2.1 Agence de la santé publique du Canada
L'ASPC est l'autorité nationale en matière de biosécurité et de biosûreté pour les agents pathogènes humains et les toxines. L'ASPC est responsable de la réglementation des agents pathogènes humains et des toxines en vertu de la LAPHT et du RAPHT. En vertu de la LSA et du RSA, l'ASPC est aussi responsable de l'importation ou du transfert de cultures pures d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), à l'exception des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et des agents pathogènes causant des maladies animales émergentes (MAÉ). Les personnes qui effectuent des activités réglementées (c.-à-d. la manipulation ou l'entreposage) avec des agents pathogènes humains ou des toxines doivent se référer à la LAPHT et au RAPHT pour bien comprendre les exigences applicables (se référer aux tableaux A-1 et A-2 de l'annexe A pour les principales exigences de la LAPHT et du RAPHT). Il demeure la responsabilité du titulaire de permis de comprendre ses obligations en vertu de la LAPHT et du RAPHT, en plus des conditions de son permis, qui comprennent le respect des exigences applicables indiquées dans la NCB.
1.2.2 Agence canadienne d'inspection des aliments
L'ACIA est responsable de la réglementation de l'importation ou du transfert d'agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et d'agents pathogènes causant des MAÉ, ainsi que d'animaux, de produits animaux et de sous-produits animaux (p. ex. les tissus, le sérum) qui sont porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine), en vertu de la LSA et du RSA. L'ACIA est également responsable de la réglementation de l'importation ou du transfert d'agents pathogènes d'animaux aquatiques et de phytoravageurs. Les personnes qui demandent un permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres doivent consulter la LSA ou le RSA pour bien comprendre les exigences (se référer au tableau A-3 de l'annexe A pour les principales exigences en vertu de la LSA et du RSA). Il demeure la responsabilité du titulaire du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres de comprendre ses obligations en vertu de la LSA et du RSA, en plus des conditions de son permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres, qui comprennent le respect des exigences applicables indiquées dans la NCB.
1.2.3 Surveillance et vérification de la conformité
L'ASPC et l'ACIA se réfèrent à la LAPHT, au RAPHT, à la LSA, au RSA et à la NCB pour surveiller et vérifier la conformité continue des installations réglementées aux exigences applicables. Les installations réglementées doivent se conformer aux exigences réglementaires afin de maintenir ou de renouveler leurs permis, leurs permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres et leurs autorisations de transfert, et, le cas échéant, la certification (et le renouvellement de la certification) des zones de confinement des installations. La conformité aux exigences physiques en matière de confinement, aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives aux essais de vérification et de performance, respectivement énoncées aux sections 3, 4 et 5 de la NCB, contribue à prévenir l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières réglementées, qui pourraient présenter des risques importants pour la santé humaine ou animale, l'environnement ou l'économie.
Dans certains cas, les installations où les matières réglementées sont manipulées ou entreposées peuvent devoir être modifiées ou rénovées pour satisfaire aux exigences physiques en matière de confinement énoncées à la section 3 de la NCB. Conformément aux programmes actuels de conformité et d'application de la loi de l'ASPC et de l'ACIA et au Cadre de conformité et d'application des règlements de l'ASPC, les plans de mesures correctives pour les non-conformités sont examinés par l'ASPC et l'ACIA au cas par cas. Il est recommandé que les éléments de non-conformité soient discutés avec l'agence (ou les agences) concernée(s) afin de déterminer un délai raisonnable pour se conformer aux exigences, en fonction du niveau de risque et des stratégies provisoires d'atténuation des risques en place, ou de déterminer si d'autres stratégies d'atténuation peuvent être mises en œuvre pour ces éléments.
1.2.4 Harmonisation internationale
En tant que chefs de file reconnus à l'échelle internationale en matière de biosécurité humaine et animale, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) favorisent une approche fondée sur les risques pour la manipulation et l'entreposage sécuritaires des agents pathogènes humains, des agents zoopathogènes et des toxines. Le Laboratory Biosafety Manual (en anglais seulement) de l'OMS, quatrième édition, 2020, met l'accent sur une approche fondée sur les risques en matière de biosécurité, en mettant les évaluations des risques de l'avant. Par ailleurs, l'OMS s'est éloignée des concepts de groupes de risque et de niveaux de biosécurité (c.-à-d. les niveaux de confinement) dans sa mise en œuvre de cette approche. Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA souligne également l'importance de l'évaluation des risques et de la gestion des risques pour l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux à l'échelle mondiale grâce à un commerce international sécuritaire.
L'approche graduelle adoptée dans la NCB, selon laquelle les exigences au niveau de confinement 2 (NC2) constituent le fondement des niveaux de confinement plus élevés, s'harmonise avec la quatrième édition du Laboratory Biosafety Manual (en anglais seulement), qui présente trois niveaux d'exigences : « exigences de base », « mesures de contrôle renforcées » et « mesures de confinement maximales ». Cela est en accord avec l'objectif du Canada de présenter dans la NCB des exigences fondées sur les risques, les données probantes et les résultats. L'approche en matière de biosûreté (c.-à-d. les exigences relatives à la sûreté) adoptée dans la NCB permet aussi de s'assurer que les politiques du Canada s'harmonisent et soutiennent les accords internationaux concernant les agents pathogènes et les toxines sur les listes de contrôle des exportations ou dans les conventions sur les armes biologiques.
1.3 Travail avec des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines
1.3.1 Agents pathogènes
Un agent pathogène est un microorganisme, un acide nucléique, une protéine ou un autre agent infectieux qui est transmissible et capable de causer une maladie chez les humains ou les animaux. Il peut s'agir d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon, d'un parasite, d'un prion, d'ADN recombiné, d'un microorganisme génétiquement modifié, d'un vecteur viral ou d'un produit biologique synthétique. Les agents pathogènes humains causent des maladies chez l'humain, et les agents zoopathogènes, chez les animaux. Dans le contexte de la NCB, l'expression « agents pathogènes d'animaux terrestres » désigne uniquement les agents pathogènes qui causent des maladies chez les animaux terrestres, y compris les animaux aviaires et amphibiens. Les agents pathogènes zoonotiques sont des agents pathogènes qui causent des maladies chez les humains et les animaux et peuvent être transmis des animaux aux humains ou vice versa (c.-à-d. des zoonoses); ils sont donc considérés comme étant à la fois des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes. Des exemples d'agents pathogènes humains sont fournis dans les listes non exhaustives des annexes 2 à 4 et dans la partie 2 de l'annexe 5 de la LAPHT. Des exemples d'agents pathogènes humains et d'agents zoopathogènes classés sont également disponibles dans ePATHogène, la base de données sur les groupes de risque de l'ASPC.
1.3.2 Toxines
Les toxines biologiques sont des substances toxiques naturellement produites par l'activité métabolique de certains microorganismes, plantes et espèces animales. Contrairement aux agents pathogènes, les toxines ne sont pas infectieuses et ne peuvent pas se multiplier lorsqu'elles sont isolées de l'organisme qui les produit. Dans le contexte de la NCB, le terme « toxine » désigne seulement les toxines microbiennes réglementées par l'ASPC et l'ACIA en vertu de la LAPHT et de la LSA. Une liste exhaustive (modifiée de temps à autre) des toxines réglementées par la LAPHT est fournie aux annexes 1 et 5 de la LAPHT, tandis que toute toxine microbienne importée provenant d'un agent zoopathogène est également réglementée par la LSA. En général, les toxines capables de causer des maladies, appelées intoxications, chez l'humain ou l'animal peuvent être manipulées en toute sécurité dans une zone de NC2, au minimum. Des exigences physiques en matière de confinement et des exigences opérationnelles supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires, selon les évaluations des risques.
1.3.3 Prions
Les prions sont de petites particules infectieuses de nature protéique généralement considérées comme étant à l'origine d'un certain nombre de maladies neurodégénératives évolutives fatales touchant les humains et les animaux, à savoir les encéphalopathies spongiformes transmissibles. La voie de transmission la plus probable associée aux prions infectieux est l'inoculation ou l'ingestion. Les prions résistent aux procédés de décontamination généralement efficaces avec d'autres agents pathogènes. De façon générale, les activités comportant la manipulation de prions infectieux peuvent être menées en toute sécurité dans une zone de NC2 avec des exigences physiques en matière de confinement et des exigences opérationnelles supplémentaires. Par conséquent, la lettre « P » est utilisée dans les matrices des sections 3, 4 et 5 pour indiquer que des exigences accrues ou uniques s'appliquent aux activités comportant la manipulation de prions.
1.3.4 Agents biologiques à cote de sécurité élevée
Les ABCSE sont des agents pathogènes humains et des toxines qui présentent un risque accru sur le plan de la biosûreté en raison de leur inhérente possibilité de double usage (c.-à-d. des propriétés qui leur permettent d'être utilisés à des fins scientifiques légitimes ou intentionnellement utilisés comme armes biologiques). Dans le contexte de la NCB, les ABCSE sont les agents pathogènes humains et les toxines qui sont décrits comme étant des « agents pathogènes humains ou toxines précisés » dans la LAPHT et le RAPHT. Les agents pathogènes humains précisés sont tous les agents pathogènes humains du GR3 et du GR4 qui figurent aussi dans la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation, publiée par le Groupe d'Australie (liste modifiée de temps à autre), à l'exception du virus Duvenhage, du virus de la rage et des autres membres du genre Lyssavirus, du virus de la stomatite vésiculaire, ainsi que du virus de la chorioméningite lymphocytaire.
Les toxines précisées (c.-à-d. les toxines ABCSE) sont toutes les toxines énumérées à l'annexe 1 de la LAPHT qui figurent aussi dans la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation, publiée par le Groupe d'Australie (liste modifiée de temps à autre), lorsque les quantités sont supérieures à celles énoncées au paragraphe 10(2) du RAPHT dans une zone ABCSE. Par conséquent, certaines exigences des sections 3, 4 et 5 s'appliquent uniquement aux ABCSE à tout niveau de confinement et des exigences accrues s'appliquent aux activités comportant des toxines ABCSE dans les zones de NC2 ou NC2-Agriculture (NC2-Ag), tel qu'indiqué par la lettre « S » dans les colonnes NC2 ou NC2-Ag de la matrice. Une toxine présente dans une installation en quantité inférieure à la quantité seuil n'est pas un ABCSE; toutefois, elle demeure une toxine réglementée et est assujettie aux exigences de la NCB (c.-à-d. NC2 est le niveau de confinement minimal pour manipuler une toxine réglementée). Aux fins de référence, l'ASPC maintient une liste exhaustive (liste modifiée de temps à autre) de toutes les toxines ABCSE, y compris les quantités seuils relatives aux toxines, sur le site Web du gouvernement du Canada.
1.3.5 Agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et agents pathogènes causant des maladies animales émergentes
Les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont des agents pathogènes qui sont considérés comme étant exotiques au Canada (c.-à-d. les agents pathogènes causant des maladies animales exotiques [MAE] qui ne sont pas présents au Canada). Dans le contexte de la NCB, les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont des agents pathogènes qui figurent sur la liste des maladies répertoriées de l'Organisation mondiale de la santé animale (liste modifiée de temps à autre) et qui sont également considérés comme exotiques au Canada. En raison du risque d'effets délétères importants sur la santé de la population animale canadienne et des répercussions économiques qui en découleraient, des exigences plus rigoureuses concernant le confinement physique et les pratiques opérationnelles sont appliquées dans les zones de confinement où des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont importés et manipulés. Par conséquent, afin de prévenir leur rejet dans l'environnement, les activités comportant la manipulation d'agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont associées à des exigences uniques dans les sections 3, 4 et 5, tel qu'indiqué dans la description même des exigences. Afin de prévenir la propagation d'une maladie transmissible, une installation dans laquelle un agent pathogène non indigène d'animaux terrestres est importé ou manipulé peut être assujettie à la certification de l'installation par l'ACIA avant la délivrance du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres. Cette certification est conforme à la Politique sur l'importation au Canada d'agents pathogènes causant des maladies animales exotiques ou émergentes chez les animaux terrestres par des établissements externes de l'ACIA.
Une MAÉ est une nouvelle maladie infectieuse résultant de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant, une maladie infectieuse connue se propageant à une nouvelle zone géographique ou à une nouvelle population, ou une maladie diagnostiquée pour la toute première fois ou causée par un agent pathogène auparavant inconnu qui pourrait avoir d'importants effets sur la santé des animaux. En raison du risque de graves répercussions associé avec ces agents pathogènes, les agents pathogènes causant des MAÉ sont traités par l'ACIA de la même façon que les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.
1.3.6 Groupes de risque
Les groupes de risque permettent de classer un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique ou une matière biologique contenant des parties de ceux-ci) selon ses caractéristiques inhérentes, notamment la pathogénicité, la virulence, la transmissibilité et la disponibilité de traitements prophylactiques ou thérapeutiques efficaces. Les définitions suivantes précisent la catégorie de groupe de risque dans laquelle les agents pathogènes humains et les agents zoopathogènes devraient être classés selon le risque qu'ils présentent pour la personne ou l'animal, ainsi que pour la communauté ou la population animale. Le risque pour la personne et la communauté pour chaque groupe de risque est décrit au tableau 1-1. Des exemples d'agents pathogènes humains et d'agents zoopathogènes, ainsi que leur classification de groupe de risque correspondante, sont disponibles en ligne dans ePATHogène, la base de données sur les groupes de risque.
| Type de risque | Groupe de risque 1 | Groupe de risque 2 | Groupe de risque 3 | Groupe de risque 4 |
|---|---|---|---|---|
| Risque pour la personne | Faible | Modéré | Élevé | Élevé |
| Risque pour la communauté | Faible | Faible | Faible | Élevé |
1.3.6.1 Groupe de risque 1 (GR1; risque faible pour la personne, faible pour la communauté)
Un microorganisme, un acide nucléique ou une protéine qui est soit :
- a) incapable de causer une maladie chez l'humain ou l'animal;
- b) capable de causer une maladie chez l'humain ou l'animal, mais est peu susceptible de le faire.
Les organismes de GR1 qui sont capables de causer des maladies sont considérés comme des agents pathogènes qui présentent un faible risque pour la santé des personnes ou des animaux, et un faible risque pour la santé publique et pour la population animale. Les agents pathogènes du GR1 peuvent être opportunistes et menacer la santé des personnes immunodéprimées. En raison du faible risque qu'ils présentent pour la santé publique et la population animale, la NCB n'énonce pas d'exigences relatives à la manipulation des matières biologiques de GR1. Il demeure néanmoins important de prendre les précautions nécessaires et de suivre des pratiques de travail sécuritaires (p. ex. les bonnes pratiques microbiologiques) lors de la manipulation de matières biologiques de GR1.
1.3.6.2 Groupe de risque 2 (GR2; risque modéré pour la personne, faible pour la communauté)
Un agent pathogène ou une toxine qui présente un risque modéré pour la santé des personnes ou des animaux et un faible risque pour la santé publique et pour la population animale. Ces agents pathogènes peuvent causer des maladies graves chez les humains ou les animaux, mais sont peu susceptibles de le faire. Des mesures prophylactiques et des traitements efficaces sont disponibles et le risque de propagation des maladies causées par ces agents pathogènes est faible. L'annexe 2 de la LAPHT fournit des exemples d'agents pathogènes humains du GR2.
1.3.6.3 Groupe de risque 3 (GR3; risque élevé pour la personne, faible pour la communauté)
Un agent pathogène qui présente un risque élevé pour la santé des personnes ou des animaux et un faible risque pour la santé publique. Ces agents pathogènes sont susceptibles de causer des maladies graves chez les humains ou les animaux. Des mesures prophylactiques et des traitements efficaces sont généralement disponibles et le risque de propagation des maladies causées par ces agents pathogènes est faible pour la communauté. Le risque de propagation dans la population animale, quant à lui, peut varier de faible à élevé en fonction de l'agent pathogène. L'annexe 3 de la LAPHT fournit des exemples d'agents pathogènes humains du GR3.
1.3.6.4 Groupe de risque 4 (GR4; risque élevé pour la personne, élevé pour la communauté)
Un agent pathogène qui présente un risque élevé pour la santé des personnes ou des animaux et un risque élevé pour la santé publique. Ces agents pathogènes sont susceptibles de causer des maladies graves chez les humains ou les animaux et, dans bien des cas, d'entraîner la mort. Des mesures prophylactiques et des traitements efficaces ne sont généralement pas disponibles et le risque de propagation des maladies causées par ces agents pathogènes est élevé pour la communauté. Le risque de propagation de la maladie dans la population animale, quant à lui, peut varier de faible à élevé en fonction de l'agent pathogène. L'annexe 4 de la LAPHT fournit des exemples d'agents pathogènes humains du GR4.
1.3.7 Niveaux de confinement et zones de confinement
Les niveaux de confinement font référence aux exigences physiques en matière de confinement et aux exigences opérationnelles minimales requises pour les zones de confinement (c.-à-d. une zone physique déterminée qui répond aux exigences d'un niveau de confinement donné) où on peut manipuler ou entreposer en toute sécurité des matières réglementées. La NCB décrit les trois niveaux de confinement reconnus par l'ASPC et l'ACIA, lesquels vont du niveau le plus faible auquel il est permis de travailler avec des matières réglementées (c.-à-d. NC2) au niveau de confinement le plus élevé (c.-à-d. NC4). Une zone de confinement peut être une salle unique (p. ex. un laboratoire), une série de salles situées dans un même endroit (p. ex. plusieurs espaces de travail en laboratoire de NC2 non adjacents, mais verrouillables), ou une série de salles adjacentes d'un même niveau de confinement (p. ex. une aire de travail de NC3 comprenant des laboratoires dédiés et des zones de soutien dédiées, comme des sas, des vestiaires, des salles d'entreposage, des aires de préparation et des salles d'autoclave centralisées). Une zone de confinement peut comprendre un ou plusieurs espaces de travail de nature différente (c.-à-d. un espace de travail en laboratoire, une aire de production à grande échelle et des espaces de travail avec les animaux), pourvu que ces espaces soient du même niveau de confinement.
1.3.8 Évaluations des risques associés aux agents pathogènes et évaluations des niveaux de confinement
Les agents pathogènes bien caractérisés qui ont fait l'objet d'une évaluation des risques associés à l'agent pathogène effectuée par l'ASPC ou l'ACIA ont été attribués à un groupe de risque et un niveau de confinement. La classification par groupe de risque de milliers d'agents pathogènes et de toxines est disponible en ligne dans ePATHogène, la base de données sur les groupes de risque et dans les documents techniques appelés Fiches techniques santé-sécurité : agents pathogènes (FTSSP) qui sont facilement accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada. En plus de présenter la classification par groupe de risque, les FTSSP énoncent les mesures de précaution à prendre pour manipuler et éliminer en toute sécurité les agents pathogènes.
Des fiches d'information sur les maladies à déclaration obligatoire pour les animaux terrestres au Canada ont été élaborées par l'ACIA et sont facilement accessibles sur le site Web de l'ACIA. Le niveau de confinement approprié et les exigences supplémentaires pour travailler avec certains agents pathogènes d'animaux terrestres (p. ex. les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et les agents pathogènes causant des MAÉ) sont déterminés par l'ACIA à l'aide d'une évaluation des risques associés à l'agent pathogène et à une évaluation du niveau de confinement.
En général, le niveau de confinement et le groupe de risque d'un agent pathogène sont les mêmes (p. ex. les agents pathogènes du GR2 sont manipulés au NC2); il y a toutefois des exceptions. Dans certains cas, il existe un niveau de risque plus élevé ou unique associé à la manipulation de certains agents pathogènes (p. ex. les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, les prions) ou à certains types de travail (p. ex. du travail in vivo, de la production à grande échelle). Une évaluation locale des risques (ELR) propre à un site est essentielle pour évaluer et déterminer les pratiques opérationnelles et les stratégies d'atténuation liées au travail qui sont nécessaires pour atteindre le niveau de protection approprié.
1.3.9 Évaluations locales des risques
Les ELR sont des évaluations des risques propres à un endroit particulier et portant sur des activités impliquant des matières réglementées qui servent à :
- déterminer et caractériser les dangers associés aux matières réglementées utilisées ainsi qu'aux activités menées;
- évaluer les risques pour chaque danger et déterminer la probabilité d'incidents pouvant possiblement causer une exposition, un rejet ou une perte de matières réglementées, ainsi que les conséquences de ces incidents;
- élaborer et mettre en œuvre des mesures d'atténuation.
Les ELR déterminent quelles stratégies d'atténuation des risques doivent être intégrées dans les procédures du programme et dans la conception de l'installation, selon les activités planifiées, pour la manipulation et l'entreposage sécuritaires des matières réglementées. La NCB énonce les exigences minimales pour une zone de confinement en fonction du niveau de confinement. Étant donné que la majorité des exigences sont fondées sur le risque et les résultats, les ELR sont utilisées pour déterminer la manière dont ces exigences peuvent être mises en œuvre. Par exemple, la NCB exige que l'équipement de protection individuel (EPI) dédié spécifique à chaque zone de confinement soit enfilé conformément aux procédures d'entrée; cependant, l'EPI utilisé et l'endroit où il est enfilé et retiré ainsi que la manière de le faire sont déterminés par une ELR.
1.3.10 Exemptions fondées sur le risque relatives aux exigences physiques en matière de confinement ou aux exigences opérationnelles
Dans le cadre des évaluations continues des risques associés aux agents pathogènes et des niveaux de confinement menées par l'ASPC et l'ACIA, le niveau de confinement exigé pour la manipulation d'un agent pathogène peut changer au fil du temps, et des exigences physiques spécifiques en matière de confinement ou des exigences opérationnelles spécifiques peuvent être réduites en conjonction avec la mise en œuvre de stratégies d'atténuation des risques supplémentaires spécifiques à l'agent pathogène. Par exemple, beaucoup d'exigences physiques en matière de confinement et d'exigences opérationnelles au NC3 visent à réduire les risques associés aux agents pathogènes aéroportés ou transmissibles par l'air. Dans certains cas, les travaux avec des agents pathogènes du GR3 qui ne sont pas connus comme étant transmissibles par inhalation et qui comportent des activités moins susceptibles de produire des aérosols infectieux peuvent être menés en toute sécurité au NC2 avec des exigences supplémentaires en matière de biosécurité. L'ASPC élabore des directives en matière de biosécurité qui fournissent une vue d'ensemble des exigences en matière de niveau de confinement adaptées aux activités avec des agents pathogènes spécifiques ou des groupes d'agents pathogènes lorsque le niveau de confinement diffère du groupe de risque (p. ex. un agent pathogène du GR3 manipulé au NC2). Les exigences de niveau de confinement adaptées approuvées par l'ASPC ou l'ACIA seront stipulées sur le permis visant des agents pathogènes et des toxines ou sur le permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres.
Les exemptions relatives à des exigences physiques en matière de confinement ou à des exigences opérationnelles particulières seront considérées au cas par cas par l'ASPC et l'ACIA, s'il peut être démontré qu'un autre mécanisme permet d'atteindre le but de l'exigence en question, tel que déterminé par une ELR.
1.4 Activités de travail
1.4.1 Production à grande échelle
La production à grande échelle comprend des activités comportant des volumes de production de toxines ou de cultures in vitro de matières réglementées, au contraire des activités à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essai qui comportent généralement des volumes beaucoup plus petits et qui sont menées dans de la verrerie ou du matériel en plastique. Les cultures et les purifications à l'échelle de la production sont généralement menées dans des fermenteurs, des bioréacteurs et d'autres systèmes fermés. Les installations de production à grande échelle, qui comprennent les usines spécialisées en fermentation industrielle et en production de vaccins, présentent un risque accru pour les membres du personnel et l'environnement en raison des grandes quantités de matières réglementées manipulées et des risques inhérents associés à l'équipement utilisé (p. ex. l'aérosolisation de matières réglementées lorsqu'elles sont rejetées d'un système sous pression). Ainsi, il y a parfois des exigences plus strictes et des considérations supplémentaires pour les aires de production à grande échelle par rapport à un espace de travail en laboratoire d'un même niveau de confinement. Les sections 3, 4 et 5 énoncent les exigences supplémentaires s'appliquant aux zones de confinement où sont menées des activités de production à grande échelle avec des matières réglementées, tel qu'indiqué dans la description même des exigences.
En cas d'incertitude, la nécessité que des activités particulières menées dans une zone de confinement soient conformes aux exigences accrues ou uniques pour les aires de production à grande échelle sera déterminée en consultation avec l'ASPC et l'ACIA au cas par cas.
1.4.2 Travail avec des animaux
Le travail avec des matières réglementées comportant des animaux vivants (c.-à-d. in vivo) s'effectue dans une zone de confinement d'animaux. Une zone de confinement d'animaux fait référence à un ensemble de salles animalières ou de box situés au même endroit, ainsi que les corridors et les salles de soutien connexes (p. ex. les aires d'entreposage et de préparation) d'un même niveau de confinement. Une zone où les animaux sont hébergés dans des cages de confinement primaire (c.-à-d. des cages de confinement munies de filtres pour prévenir le rejet de matières réglementées) est qualifiée de « zone de confinement de petits animaux » (zone PA). Les « salles animalières » désignent les pièces à l'intérieur d'une zone PA où les animaux sont hébergés dans des cages de confinement primaire. Lorsqu'une pièce sert elle-même de confinement primaire, on parle d'une « zone de confinement de gros animaux » (zone GA). Les « box » désignent les pièces ou les espaces dans une zone GA où les animaux sont hébergés. Les zones GA peuvent également comprendre des salles de nécropsie. Dans le contexte de la NCB, le terme « salle de nécropsie » désigne les salles situées dans les zones GA où sont effectuées la nécropsie et la dissection des cadavres d'animaux.
Il est important de noter que la désignation de zone PA ou de zone GA dépend de la façon dont les animaux sont hébergés (c.-à-d. dans une cage de confinement primaire ou dans une salle assurant elle-même le confinement primaire) plutôt que de la taille physique des animaux. De manière générale, les animaux de grande taille sont hébergés dans des zones GA, et les animaux de petite taille, dans des zones PA. Cependant, dans certains cas, de petits animaux peuvent être hébergés dans une zone GA. Par exemple, lorsque de petits animaux sont hébergés dans des cages ouvertes prévues seulement pour confiner des animaux à l'intérieur d'une salle (c.-à-d. qu'il n'y a pas de filtre pour prévenir le rejet de matières réglementées), cette salle est considérée comme un box situé dans une zone GA, et ce, quelle que soit la taille des animaux. Les box et les salles de nécropsie situées dans des zones GA font l'objet d'exigences supplémentaires et parfois uniques concernant le confinement physique et les pratiques opérationnelles afin de prévenir le rejet des matières réglementées et de protéger les membres du personnel qui doivent entrer dans ces espaces contre une exposition. Ces exigences sont indiquées dans la colonne Agriculture (c.-à-d. Ag).
2. Comment utiliser la Norme Canadienne sur la biosécurité, troisième édition
La NCB énonce, selon le niveau de confinement, les exigences physiques en matière de confinement, les exigences opérationnelles et les exigences relatives aux essais de vérification et de performance minimales qui s'appliquent aux installations où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. Dans le contexte de la NCB, « la manipulation ou l'entreposage » des matières réglementées comprend la possession, la manipulation, l'utilisation, la production, l'entreposage, le transfert, l'importation, l'exportation, le rejet, l'élimination ou l'abandon de telles matières, ou le fait de permettre l'accès à celles-ci.
2.1 Abréviations, définitions et références
Une liste détaillée de l'ensemble des abréviations et des sigles utilisés dans la NCB se trouve au début du présent document.
Un glossaire exhaustif pour les termes techniques se trouve au début du présent document. La terminologie utilisée dans la NCB doit être interprétée en fonction de la définition correspondante fournie dans le glossaire.
Une liste complète des normes externes et des autres documents cités dans la NCB (y compris les hyperliens) se trouve à la fin du document. Sauf lorsque les renseignements contenus dans une norme externe sont directement intégrés dans la NCB, les normes externes sont citées par numéro seulement; les utilisateurs doivent se reporter à la version la plus récente des normes.
2.2 Disposition des matrices : Sections 3, 4 et 5
Les exigences qui s'appliquent aux installations où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées sont fournies dans les sections 3, 4 et 5. Les exigences sont fondées sur les risques et les données probantes et, lorsque cela est possible, elles sont davantage axées sur les résultats plutôt que d'être explicitement normatives. La section 3 énonce les exigences physiques en matière de confinement (c.-à-d. les mesures d'ingénierie et la conception de l'installation) à respecter avant la manipulation ou l'entreposage des matières réglementées. La section 4 énonce les exigences opérationnelles (c.-à-d. les procédures et les contrôles administratifs) à mettre en œuvre pour atténuer les risques et protéger le personnel, la communauté et l'environnement lors de la manipulation ou l'entreposage des matières réglementées. La section 5 fournit les exigences relatives aux essais de vérification et de performance nécessaires pour satisfaire aux exigences physiques en matière de confinement, lesquelles sont énoncées dans la section 3 et, dans certains cas, aux exigences opérationnelles, lesquelles sont énoncées dans la section 4.
Les exigences des sections 3, 4 et 5 sont présentées dans des matrices (ou tableaux) où est indiquée l'applicabilité de chaque exigence à des niveaux de confinement spécifiques et, dans certains cas, à des espaces de travail en particulier. Ces exigences sont regroupées par sujet dans des matrices qui renferment des colonnes distinctes pour le NC2, NC3 et NC4. Plutôt que de regrouper les exigences par niveau de confinement dans une matrice en particulier, elles sont disposées de manière à montrer comment une exigence donnée s'applique à différents niveaux de confinement. Cette disposition aide à démontrer comment les exigences pour les hauts niveaux de confinement sont fondées sur les exigences pour les niveaux de confinement plus faibles. Différents types d'espaces de travail pouvant être présents dans une zone de confinement sont compris dans chaque colonne des matrices, tel que résumé dans le tableau 2-1. En raison des risques uniques présents dans ces zones, des exigences physiques en matière de confinement et des exigences opérationnelles s'appliquent aux zones GA, où la salle elle-même sert de confinement primaire. Dans chaque matrice, les zones GA possèdent des colonnes distinctes au NC2 et NC3, lesquelles sont intitulées zones « NC2-Ag » et « NC3-Ag », respectivement. Les autres espaces de travail (c.-à-d. les espaces de travail en laboratoire, les aires de production à grande échelle et les zones PA) sont tous compris dans les colonnes NC2 et NC3. Les exigences figurant dans la colonne NC4 s'appliquent à tous les espaces de travail.
| Type d'espace de travail | Colonne des matrices | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NC2Note de bas de page a | NC2-AgNote de bas de page a | NC3 | NC3-Ag | NC4 | |
| Espaces de travail en laboratoire | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Aires de production à grande échelle | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Zones PANote de bas de page b (y compris les salles animalières) | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Zones GANote de bas de page c (y compris les box et les salles de nécropsie, le cas échéant) | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
|
|||||
En général, les exigences qui s'appliquent à tous les espaces de travail représentés dans une colonne des matrices sont les mêmes (p. ex. un espace de travail en laboratoire de NC2, une aire de production à grande échelle, une zone PA) et une case noire apparaît dans les colonnes (■). Dans certains cas, l'exigence elle-même fait référence à un type d'espace de travail en particulier (p. ex. « à grande échelle », « travail avec les animaux », « zone PA », « salles animalières », « box », « salles de nécropsie ») auquel elle s'applique. Lorsqu'une exigence s'applique aux zones PA de NC2 et aux aires de production à grande échelle de NC2, et non aux espaces de travail en laboratoire de NC2, une case vide (□) apparaît dans la colonne de NC2.
Lorsque les exigences ne sont pas les mêmes pour certains espaces de travail, les exceptions sont énumérées entre crochets sous l'exigence (p. ex. [Non exigé pour les zones PA de NC2.], [Dans les zones de NC3, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.]). La description des symboles ainsi qu'un exemple de matrice sont fournis à la figure 2-1.
Les symboles et combinaisons qui suivent sont utilisés dans les sections 3, 4 et 5 :
- ■
- Exigé dans toutes les zones de confinement, y compris les espaces de travail où les activités comportent des prions ou des ABCSE
Pour les zones de NC2 et de NC2-Ag, les symboles suivants sont utilisés pour faciliter le repérage des exigences applicables :
- □
- Exigé dans toutes les zones PA de NC2 et les aires de production à grande échelle de NC2, y compris les zones PA de NC2 et les aires de production à grande échelle de NC2 où les activités comportent des prions ou des ABCSE; non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC2
- P
- Exigé dans tous les espaces de travail où des activités avec des prions sont menées
- S
- Exigé dans tous les espaces de travail où des activités avec des ABCSE sont menées
- PS
- Exigé dans tous les espaces de travail où des activités avec des prions ou des ABCSE sont menées
- □ P
- Exigé dans les zones PA de NC2 et les aires de production à grande échelle de NC2, ainsi que les espaces de travail en laboratoire de NC2 où des activités avec des prions sont menées
- □ PS
- Exigé dans les zones PA de NC2 et les aires de production à grande échelle de NC2, ainsi que les espaces de travail en laboratoire de NC2 où des activités avec des prions ou des ABCSE sont menées
L'absence de symbole dans une colonne indique que l'élément n'est pas exigé pour ce niveau de confinement.
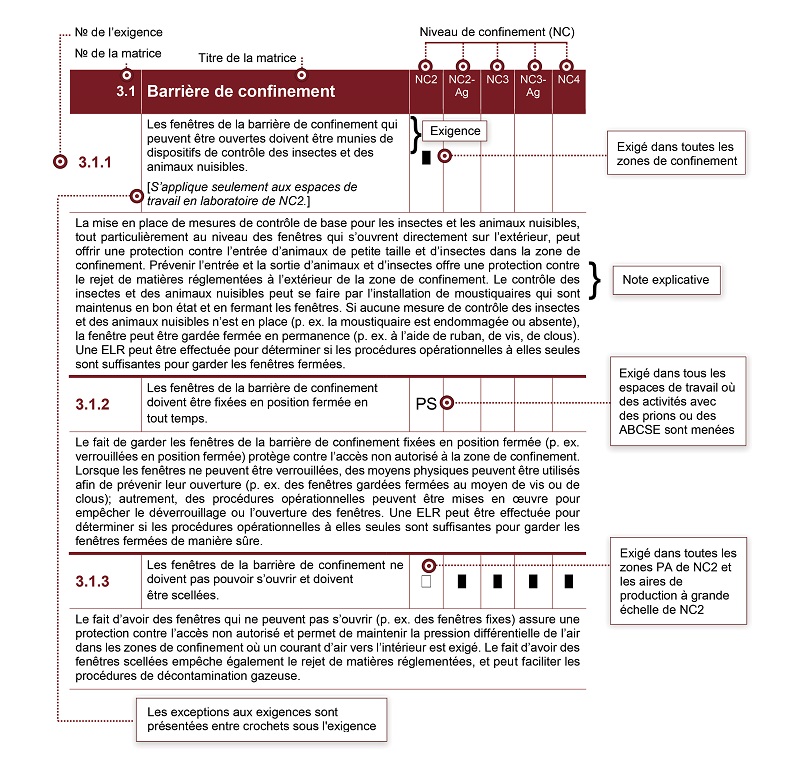
Figure 2-1 - Texte descriptif
L'image fournit une représentation visuelle d'une partie de la matrice 3.1, ce qui comprend les exigences 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3, annotées pour indiquer où trouver les éléments suivants :
- Le numéro de la matrice apparait dans la première colonne de la ligne titre.
- Le titre de la matrice apparait dans la deuxième colonne de la ligne titre.
- Les niveaux de confinement NC2, NC2-Ag, NC3, NC3-Ag et NC4 apparaissent dans la troisième à la septième colonne.
- Le numéro de l'exigence apparait dans la première colonne.
- L'exigence apparait dans la deuxième colonne.
- Les exceptions aux exigences, indiquées en italique entre crochets, apparaissent dans la deuxième colonne sous l'exigence.
- Le symbole d'une case noire apparait dans la colonne de NC2 de l'exigence 3.1.1, ce qui indique qu'elle s'applique à toutes les zones de confinement.
- Le symbole PS apparait dans la colonne de NC2 de l'exigence 3.1.2, ce qui indique qu'elle s'applique seulement aux espaces de NC2 où des activités avec des prions ou des ABCSE sont menées.
- Le symbole d'une case vide apparait dans la colonne de NC2 de l'exigence 3.1.3, ce qui indique qu'elle s'applique à toutes les zones PA de NC2 et les aires de production à grande échelle de NC2.
- Une note explicative apparait sous chaque exigence et traverse les sept colonnes du tableau.
2.3 Notes explicatives
Les notes explicatives se trouvant sous les exigences fournissent des renseignements supplémentaires sur le but de l'exigence, plus précisément sur la façon dont les risques sont atténués par les exigences énumérées aux sections 3, 4 et 5. Les notes explicatives comprennent également des exemples sur la façon de satisfaire aux exigences. Il est à noter que les exemples fournis dans les notes explicatives ne constituent pas des exigences ou des recommandations précises; ils servent plutôt à donner des précisions et représentent des moyens habituels employés pour satisfaire à une exigence. Les notes explicatives associées aux exigences de la section 5 offrent de plus amples renseignements sur les essais qui doivent être menés.
2.4 Guide canadien sur la biosécurité
Le Guide canadien sur la biosécurité (GCB) est un document qui accompagne la NCB et qui offre des renseignements de base et des recommandations sur les moyens de satisfaire aux exigences en matière de biosécurité et de biosûreté énoncées dans la NCB. Le GCB est structuré de façon à aborder tous les concepts qui sont requis pour l'élaboration et le maintien d'un programme de gestion de la biosécurité exhaustif et axé sur les risques. Dans certains cas, des pratiques exemplaires ou des mesures d'atténuation des risques autres que celles présentées dans le GCB peuvent également être acceptables pour satisfaire aux exigences de la NCB.
3. Exigences physiques en matière de confinement
La présente section énonce les exigences physiques en matière de confinement (c.-à-d. les mesures d'ingénierie et la conception de l'installation) visant à atténuer les risques associés à la manipulation ou à l'entreposage de matières réglementées, et à la manipulation ou à l'hébergement d'animaux réglementés.
3.1 Barrière de confinement
Le terme « barrière de confinement » fait référence aux structures physiques (p. ex. les murs, les portes, les planchers, les plafonds) ou aux barrières (p. ex. le courant d'air vers l'intérieur dans les espaces où il est fourni) tenant lieu de frontière entre les espaces « propres » et « sales » d'une zone de confinement ou entre des espaces de niveau de confinement inférieur et ceux de niveau de confinement plus élevé. Les points d'accès permettant de traverser la barrière de confinement comprennent les portes et les sas. L'équipement tel que les cuves d'immersion, les passe-plats et les autoclaves à deux portes qui traversent la barrière de confinement sont des exemples de pénétrations de la barrière de confinement pouvant servir à transférer des matières vers l'intérieur ou l'extérieur de la barrière de confinement.
| Matrice 3.1 | Barrière de confinement | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Les fenêtres de la barrière de confinement qui peuvent être ouvertes doivent être munies de dispositifs de contrôle des insectes et des animaux nuisibles. |
■ | ||||
| La mise en place de mesures de contrôle de base pour les insectes et les animaux nuisibles, tout particulièrement au niveau des fenêtres qui s'ouvrent directement sur l'extérieur, peut offrir une protection contre l'entrée d'animaux de petite taille et d'insectes dans la zone de confinement. Prévenir l'entrée et la sortie d'animaux et d'insectes offre une protection contre le rejet de matières réglementées à l'extérieur de la zone de confinement. Le contrôle des insectes et des animaux nuisibles peut se faire par l'installation de moustiquaires qui sont maintenus en bon état et en fermant les fenêtres. Si aucune mesure de contrôle des insectes et des animaux nuisibles n'est en place (p. ex. la moustiquaire est endommagée ou absente), la fenêtre peut être gardée fermée en permanence (p. ex. à l'aide de ruban, de vis, de clous). Une ELR peut être effectuée pour déterminer si les procédures opérationnelles à elles seules sont suffisantes pour garder les fenêtres fermées. | ||||||
| 3.1.2 | Les fenêtres de la barrière de confinement doivent être fixées en position fermée en tout temps. | PS | ||||
| Le fait de garder les fenêtres de la barrière de confinement fixées en position fermée (p. ex. verrouillées en position fermée) protège contre l'accès non autorisé à la zone de confinement. Lorsque les fenêtres ne peuvent être verrouillées, des moyens physiques peuvent être utilisés afin de prévenir leur ouverture (p. ex. des fenêtres gardées fermées au moyen de vis ou de clous); autrement, des procédures opérationnelles peuvent être mises en œuvre pour empêcher le déverrouillage ou l'ouverture des fenêtres. Une ELR peut être effectuée pour déterminer si les procédures opérationnelles à elles seules sont suffisantes pour garder les fenêtres fermées de manière sûre. | ||||||
| 3.1.3 | Les fenêtres de la barrière de confinement ne doivent pas pouvoir s'ouvrir et doivent être scellées. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait d'avoir des fenêtres qui ne peuvent pas s'ouvrir (p. ex. des fenêtres fixes) assure une protection contre l'accès non autorisé et permet de maintenir la pression différentielle de l'air dans les zones de confinement où un courant d'air vers l'intérieur est exigé. Le fait d'avoir des fenêtres scellées empêche également le rejet de matières réglementées, et peut faciliter les procédures de décontamination gazeuse. | ||||||
| 3.1.4 | Les fenêtres doivent contribuer à garder les lieux sûrs tel que déterminé par l'évaluation des risques de biosûreté. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les fenêtres qui comprennent des dispositifs de protection peuvent offrir différents degrés de protection contre les bris et les menaces de biosûreté (p. ex. les menaces externes, les membres du personnel non autorisés). Lorsque les fenêtres peuvent être ouvertes (p. ex. dans les espaces de travail en laboratoire de NC2), l'évaluation des risques de biosûreté peut déterminer si les procédures opérationnelles pour la fermeture et le verrouillage des fenêtres atténuent suffisamment les risques de biosûreté ou si des dispositifs de protection supplémentaires sont nécessaires. Des éléments de conception et des matériaux simples (p. ex. des stores, des pellicules anti-regard) peuvent être utilisés pour empêcher de voir à l'intérieur de la zone de confinement. Selon l'évaluation des risques de biosûreté, les dispositifs de protection utilisés pour renforcer la sûreté des fenêtres peuvent comprendre le double-vitrage, le verre trempé, le verre chauffé ou traité chimiquement, le verre de sécurité feuilleté, le vitrage à l'acrylique ou au polycarbonate, les pellicules adhésives anti-intrusion, les barres de métal, les grilles ou les lattes en métal déployé. Des détecteurs de bris de verre ou des détecteurs de vibrations peuvent également faire partie des systèmes de détection d'intrusion pour renforcer davantage la sûreté des fenêtres. Il est important que ces dispositifs n'interfèrent pas avec la sécurité des personnes se trouvant dans la zone de confinement. | ||||||
| 3.1.5 | Les systèmes passe-plats à même la barrière de confinement doivent être munis d'un mécanisme qui empêche l'ouverture simultanée des deux portes. | ■ | ||||
| Le fait d'empêcher l'ouverture simultanée des portes situées de chaque côté des systèmes passe-plats aide à prévenir un bris de confinement et un rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. D'un point de vue opérationnel, cela peut se faire au moyen d'indicateurs visuels ou sonores qui émettent un signal lorsque les portes sont ouvertes ou fermées, ou d'autres mécanismes acceptables. Les mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques qui empêchent l'ouverture simultanée des portes sont plus fiables, car ils ne dépendent pas du respect des procédures opérationnelles par les membres du personnel. | ||||||
| 3.1.6 | Les portes des systèmes passe-plats à même la barrière de confinement doivent être munies de mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques qui empêchent l'ouverture simultanée des deux portes. | ■ | ||||
| Les systèmes passe-plats à même la barrière de confinement dotés de mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques empêchent les membres du personnel d'ouvrir simultanément les deux portes (p. ex. dans le cas d'un autoclave à deux portes qui traverse la barrière de confinement). L'ouverture simultanée de ces portes nuit au maintien du courant d'air vers l'intérieur et pourrait entraîner un bris de confinement. Le fait de garder fermée au moins une porte des systèmes passe-plats qui traversent la barrière de confinement protège l'intégrité du confinement et empêche le rejet de matières réglementées. | ||||||
| 3.1.7 | Les portes des systèmes passe-plats à même la barrière de confinement doivent être munies de mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques et d'avertisseurs visuels ou sonores. | ■ | ||||
| Les systèmes passe-plats à même la barrière de confinement dotés de mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques et d'un indicateur visuel ou sonore empêchent les membres du personnel d'ouvrir simultanément les deux portes (p. ex. dans le cas d'un autoclave à deux portes qui traverse la barrière de confinement). L'ouverture simultanée de ces portes nuit au maintien du courant d'air vers l'intérieur et pourrait entraîner un bris de confinement. Le fait de garder fermée au moins une porte des systèmes passe-plats qui traversent la barrière de confinement protège l'intégrité du confinement et empêche le rejet de matières réglementées. Un mécanisme de rechange (p. ex. des procédures opérationnelles) ajoute une protection supplémentaire. | ||||||
| 3.1.8 | Toutes les pénétrations de la barrière de confinement doivent être scellées afin de maintenir l'intégrité de la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ||
| L'intégrité de la barrière de confinement de la zone de confinement, du box et de la salle de nécropsie peut être maintenue au moyen d'un joint d'étanchéité continu (p. ex. un produit de calfeutrage qui ne se contracte pas comme le calfeutrage au silicone, au polyuréthane ou au polyéther) autour des pénétrations afin de fermer tous les espaces libres possibles avec le mur adjacent, le plafond et le plancher de la barrière de confinement. Les pénétrations dans la barrière de confinement comprennent l'équipement (p. ex. l'autoclave à deux portes qui traverse la barrière de confinement, les cuves d'immersion, les systèmes passe-plats), les conduits, la tuyauterie, le câblage et tous les autres éléments qui traversent la barrière. Un joint d'étanchéité approprié permet aux personnes d'effectuer les essais applicables (p. ex. la vérification du taux de décroissement de pression), contribue au maintien du courant d'air vers l'intérieur et est compatible avec les produits chimiques utilisés pour la décontamination de surface et la décontamination gazeuse de la salle dans l'éventualité où celle-ci serait exigée (p. ex. les procédures de décontamination régulières, à la suite d'un incident, lors de la mise hors service). Selon l'application, différents matériaux peuvent être utilisés pour créer un joint d'étanchéité hermétique afin de maintenir une barrière continue (p. ex. une bride de fermeture biologique, un joint d'étanchéité fait d'un matériau souple). L'équipement qui est conçu et installé de manière à réduire au minimum l'espace libre entre l'équipement et la surface de la barrière de confinement réduit le recours aux produits d'étanchéité. | ||||||
|
||||||
3.2 Accès
Les barrières physiques (p. ex. les portes, les verrous, les sas, les mécanismes d'interverrouillage) situées aux points d'entrée et de sortie de la zone de confinement sont essentielles pour maintenir l'intégrité du confinement et permettre que seules des personnes autorisées (c.-à-d. les membres du personnel autorisés et les visiteurs autorisés) accèdent à la zone. Dans les zones de confinement élevé, les barrières physiques aident à maintenir le courant d'air vers l'intérieur et offrent des espaces pour retirer et entreposer l'EPI contaminé ou possiblement contaminé à l'intérieur de la barrière de confinement.
| Matrice 3.2 | Accès | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Un panneau d'avertissement de danger biologique doit être apposé aux points d'entrée de la zone de confinement, de la salle animalière, du box, de la salle de nécropsie et des espaces où des dangers uniques sont présents. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le panneau d'avertissement de danger biologique apposé aux points d'entrée de la zone de confinement, de la salle animalière, du box, de la salle de nécropsie et à l'entrée des espaces où des dangers uniques sont présents est un outil de communication essentiel. Un tel panneau d'avertissement est conçu pour informer les personnes à l'extérieur de l'endroit désigné des dangers qui sont présents à l'intérieur. | ||||||
| 3.2.2 | Le panneau d'avertissement de danger biologique doit comprendre :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les renseignements fournis sur le panneau d'avertissement de danger biologique peuvent s'appliquer à toute une zone de confinement ou être propres à une pièce ou un espace spécifique à l'intérieur de la zone de confinement. Le symbole international du danger biologique est un logo universellement accepté indiquant la présence de matières biologiques qui présentent un risque pour la santé. Le fait d'inclure le niveau de confinement, l'EPI exigé et les exigences relatives à l'accès sur le panneau d'avertissement de danger biologique communique également le niveau de risque associé aux matières biologiques présentes. Les coordonnées à utiliser en cas d'urgence (p. ex. des numéros de téléphone) sur le panneau d'avertissement de danger biologique sont essentielles pour faciliter les procédures d'intervention en cas d'urgence et de notification des incidents. | ||||||
| 3.2.3 | Aux endroits où des matières réglementées sont entreposées à l'extérieur de la zone de confinement, le panneau d'avertissement de danger biologique doit :
|
■ | ■ | ■ | ■ | |
| Le panneau d'avertissement de danger biologique informe les membres du personnel des risques associés aux matières réglementées qui sont entreposées et des exigences relatives à leur manipulation (p. ex. le port d'EPI, le niveau de confinement auquel elles peuvent être manipulées). Le panneau d'avertissement de danger biologique peut également aider à identifier l'emplacement spécifique du matériel en inventaire. Le symbole international du danger biologique est un logo universellement accepté indiquant la présence de matières biologiques qui présentent un risque pour la santé. Il est essentiel de fournir les coordonnées à utiliser en cas d'urgence (p. ex. des numéros de téléphone) sur le panneau afin de faciliter les procédures d'intervention en cas d'urgence et de notification des incidents. Les réfrigérateurs, les chambres froides, les congélateurs, les armoires et les boîtiers de verrouillage constituent des exemples de l'équipement utilisé pour entreposer des matières réglementées à l'extérieur de la zone de confinement. | ||||||
| 3.2.4 | Les zones de confinement doivent être séparées des endroits publics et des aires administratives par une porte verrouillable. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une porte est une barrière physique qui sert à protéger contre le rejet de matières réglementées en séparant la zone de confinement (c.-à-d. l'espace « sale » ou contaminé) des aires publiques ou administratives (c.-à-d. les zones « propres » ou non contaminées). L'installation de portes verrouillables fournit une barrière physique de base pour empêcher l'accès non autorisé à la zone de confinement et garder en lieu sûr les matières réglementées entreposées à l'intérieur de celle-ci. Les considérations relatives à l'installation et à la conception (p. ex. placer les charnières de porte de façon à empêcher toute ouverture possible depuis l'extérieur) sont prises en considération dans l'évaluation des risques de biosûreté. Si une porte sert de barrière physique à un endroit qui comprend un espace « sale » et un espace « propre », des pratiques opérationnelles peuvent être mises en œuvre afin de limiter la propagation de la contamination. Lorsque de grandes ouvertures donnent accès à la zone de confinement (p. ex. un comptoir de réception des échantillons), des solutions de rechange pour les fermer (p. ex. une porte à enroulement, des volets situés au-dessus du comptoir) peuvent aider à limiter l'accès et à contenir tout rejet de matières réglementées dans l'espace de travail en cas de déversement. | ||||||
| 3.2.5 | Un système de contrôle d'accès doit permettre un accès restreint à la zone de confinement. | □ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes de contrôle d'accès sont utilisés pour que l'accès à la zone de confinement soit restreint aux personnes autorisées seulement. Ces systèmes permettent à la zone de confinement de demeurer un lieu sûr (c.-à-d. en demeurant verrouillés) en tout temps (p. ex. lorsqu'elle est occupée, lorsqu'elle est vacante, dans les situations d'évacuation d'urgence). Les lecteurs biométriques, les systèmes utilisant des cartes d'accès électroniques, les claviers numériques, les systèmes utilisant un code d'accès, les mécanismes de contrôle des clés (c.-à-d. qui empêchent la reproduction des clés ou des cartes d'accès) ou les systèmes équivalents sont des exemples de systèmes de contrôle d'accès. | ||||||
| 3.2.6 | Un système de contrôle d'accès doit permettre un accès restreint à la zone ABCSE. | S | S | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes de contrôle d'accès sont utilisés pour que l'accès aux locaux dans l'installation où des ABCSE sont présents soit restreint aux personnes autorisées seulement. Ces systèmes permettent aux locaux dans l'installation de demeurer des lieux sûrs (c.-à-d. en demeurant verrouillés) en tout temps (p. ex. lorsqu'ils sont occupés, lorsqu'ils sont vacants, dans les situations d'évacuation d'urgence) lorsque des ABCSE sont présents et accessibles. Les lecteurs biométriques, les systèmes utilisant des cartes d'accès électroniques, les claviers numériques, les systèmes utilisant un code d'accès, les mécanismes de contrôle des clés (c.-à-d. qui empêchent la reproduction des clés ou des cartes d'accès) ou les systèmes équivalents sont des exemples de systèmes de contrôle d'accès. | ||||||
| 3.2.7 | Un système de contrôle d'accès ou un autre mécanisme acceptable doit permettre un accès limité à chaque salle animalière, chaque box et chaque salle de nécropsie où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les systèmes de contrôle d'accès sont utilisés pour que l'accès aux salles animalières, aux box et aux salles de nécropsie où des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont présents soit limité aux personnes autorisées seulement. Ces systèmes permettent à ces endroits dans l'installation de demeurer des lieux sûrs (c.-à-d. en demeurant verrouillés) en tout temps (p. ex. lorsqu'ils sont occupés, lorsqu'ils sont vacants, dans les situations d'évacuation d'urgence). Les lecteurs biométriques, les systèmes utilisant des cartes d'accès électroniques, les claviers numériques, les systèmes utilisant un code d'accès, les mécanismes de contrôle des clés (c.-à-d. qui empêchent la reproduction des clés ou des cartes d'accès) ou les systèmes équivalents sont des exemples de systèmes de contrôle d'accès. | ||||||
| 3.2.8 | Là où un système de contrôle d'accès électronique à la zone de confinement a été installé, celui-ci doit être soutenu par un système de contrôle d'accès de rechange ou un autre mécanisme acceptable. | ■ | ■ | ■ | ||
| Avoir un système de rechange pour appuyer le système de contrôle d'accès permet de garder la zone de confinement sûre en cas de panne de courant ou de déverrouillage d'urgence des systèmes électroniques. Des exemples de systèmes de contrôle d'accès de rechange comprennent les systèmes utilisant un code d'accès physique, un verrou à clé redondant, un mécanisme de contrôle des clés (c.-à-d. qui empêche la reproduction des clés ou des cartes d'accès) redondant, un agent de sûreté placé à l'entrée de la zone de confinement (p. ex. à la porte extérieure) ou à un emplacement à l'intérieur de l'installation qui lui permet d'empêcher l'accès non autorisé. | ||||||
| 3.2.9 | Un espace doit être prévu dans la zone de confinement pour le rangement de l'EPI dédié qui a été porté et qui peut être réutilisé. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des espaces réservés au rangement à l'intérieur de la zone de confinement (ou à l'intérieur de la barrière de confinement, le cas échéant) sont nécessaires pour ranger l'EPI dédié (p. ex. les sarraus, les combinaisons, les écrans faciaux, les appareils de protection respiratoire) qui a été porté et qui peut être réutilisé. Un espace réservé à l'EPI qui a été porté et qui peut être réutilisé permet de séparer physiquement cet EPI des vêtements personnels (p. ex. les manteaux, les chapeaux, les bottes) et de l'EPI inutilisé, ce qui empêche la propagation de la contamination et le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. Il est préférable que l'espace réservé pour l'EPI qui a été porté et qui peut être réutilisé soit situé près du point où cet EPI est enfilé (p. ex. près d'une ESB). Les crochets, les casiers, les étagères ou les espaces à l'intérieur des vestiaires réservés sont des exemples d'espaces réservés au rangement pour l'EPI qui a été porté et qui peut être réutilisé. Une ELR permettra de déterminer la quantité d'espace réservé qui est requis pour ranger l'EPI qui a été porté et qui peut être réutilisé, empêcher une contamination croisée et permettre aux membres du personnel d'exécuter les procédures de sortie de manière sécuritaire (p. ex. un nombre suffisant de crochets pour empêcher l'empilement de sarraus les uns par-dessus les autres). | ||||||
| 3.2.10 | Des vestiaires facilitant l'exécution des procédures d'entrée et de sortie et permettant de séparer les vêtements personnels de l'EPI dédié qui a été porté (c.-à-d. un vestiaire « propre » séparé d'un vestiaire « sale ») doivent être installés et réservés à cette fin. | □ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des vestiaires réservés aux points d'entrée et de sortie de la zone de confinement, à même la barrière de confinement (le cas échéant) ou à un autre emplacement déterminé (p. ex. dans certains endroits de NC2 selon une ELR) permettent de plus facilement enfiler et retirer l'EPI dédié. Ces vestiaires facilitent également la séparation physique des vêtements personnels de l'EPI qui a été porté, ce qui empêche la contamination des vêtements personnels. Les vestiaires réservés sont souvent des sas ou correspondent à une partie d'un sas. Dans les zones de confinement de niveau supérieur, l'espace « propre » est situé à l'extérieur de la barrière de confinement, tandis que l'espace « sale » est situé à l'intérieur de celle-ci. Dans certains cas (p. ex. dans une zone PA de NC2), un espace désigné aux points d'entrée et de sortie de la zone de confinement peut servir de vestiaire. Dans de telles situations, une démarcation distinguant l'espace « propre » de l'espace « sale » (p. ex. la limite de l'espace peut être marquée d'un ruban adhésif apposé sur le plancher, d'un rideau de plastique séparant l'espace ou d'un revêtement de plancher d'une couleur différente) peut être utilisée. | ||||||
| 3.2.11 | Là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé, des sas doivent être installés pour prévenir la contamination du corridor « propre » et des espaces situés hors de la zone de confinement. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | |||
| La présence de sas aux points d'entrée et de sortie d'une zone de confinement, ou d'un box ou d'une salle de nécropsie lorsque la sortie donne sur un corridor « propre », crée un espace tampon qui contribue à maintenir la pression différentielle de l'air nécessaire pour créer un courant d'air vers l'intérieur. Cet espace tampon empêche également la propagation de l'air possiblement contaminé vers des zones de niveau de contamination ou de confinement inférieur (p. ex. à l'extérieur de la zone de confinement, dans le corridor « propre » à l'extérieur d'un box). Cet espace tampon peut être créé par un sas unique ou plusieurs sas réservés à l'entrée et à la sortie des membres du personnel, des animaux ou de l'équipement à travers la barrière de confinement. L'emplacement et le nombre de sas nécessaires sont déterminés par la fonction de la zone de confinement et les activités qui y sont menées. | ||||||
| 3.2.12 | Un ou des sas dotés d'une douche corporelle doivent être installés à même la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ||
| La présence de sas dotés d'une douche corporelle aux points d'entrée et de sortie d'une barrière de confinement aide à prévenir la propagation de la contamination vers des zones de niveau de contamination ou de confinement inférieurs. Le fait de disposer de sas dotés d'une douche corporelle située entre le vestiaire « propre » et le vestiaire « sale » des sas permet aux membres du personnel de se laver les cheveux et le corps pour éliminer toute trace de contamination possible avant de sortir. Dans une zone GA, une douche corporelle aux portes critiques des box ou des salles de nécropsie dont la sortie mène à un corridor « propre » permet aux membres du personnel d'éliminer toute trace de contamination avant de sortir dans le corridor « propre », le vestiaire « propre » ou les espaces à l'extérieur de la zone de confinement. Au NC4, la douche corporelle assure une redondance essentielle afin d'empêcher le rejet de matières réglementées. La douche corporelle constitue une extension du vestiaire « sale » et, par conséquent, celle-ci est située dans l'espace délimité par la barrière de confinement. L'emplacement et le nombre de sas comportant une douche corporelle sont déterminés par la fonction de la zone de confinement et les activités qui y sont menées. | ||||||
| 3.2.13 | Les sas aux points de sortie de la zone de confinement doivent comprendre une douche de décontamination chimique et un vestiaire pour retirer la combinaison à pression positive dans les zones de confinement où des combinaisons à pression positive sont portées. |
■ | ||||
| Dans les zones de NC4 où des combinaisons à pression positive sont portées, une douche de décontamination chimique (ou douche de décontamination des combinaisons) est un élément essentiel pour la sécurité qui doit faire partie du vestiaire « sale » d'un sas pour permettre aux membres du personnel de décontaminer leur combinaison à pression positive (au moyen d'une méthode validée) avant de la retirer. L'emplacement de la douche de décontamination chimique dans la séquence de sortie est crucial pour empêcher une exposition des membres du personnel. La douche de décontamination chimique est située à la sortie immédiate de l'espace contaminé et est suivie par le vestiaire désigné pour les combinaisons (c.-à-d. là où la combinaison décontaminée est retirée) avant la douche corporelle. Le vestiaire désigné pour les combinaisons peut être une salle ou un endroit réservé à cette fin, ou un espace désigné à l'intérieur du vestiaire « sale » du sas. Dans les deux cas, la douche de décontamination chimique et le vestiaire pour les combinaisons sont situés à l'intérieur de la barrière de confinement, car ils sont considérés comme des extensions de l'espace « sale » à l'intérieur du sas. | ||||||
| 3.2.14 | Là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé, les portes critiques des sas doivent être munies d'un mécanisme qui empêche leur ouverture simultanée. |
□ | ■ | ■ | ||
| La prévention de l'ouverture simultanée des portes critiques d'un sas avec des portes critiques adjacentes et séquentielles maintient la pression différentielle de l'air nécessaire pour créer un courant d'air vers l'intérieur. Ce mécanisme aide également à limiter la propagation d'air possiblement contaminé vers les espaces « propres » et les espaces où le niveau de contamination ou le niveau de confinement est inférieur (p. ex. un vestiaire « propre », un corridor « propre », des espaces à l'extérieur de la zone de confinement). Des exemples de mécanismes convenables comprennent des moyens physiques tels que des mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques des portes (p. ex. des mécanismes d'interverrouillage munis de commandes manuelles pour les contourner de façon à permettre l'ouverture des portes en cas d'urgence) et des avertisseurs visuels ou sonores. Les mécanismes convenables comprennent également les méthodes opérationnelles telles que les PON accompagnées d'affiches pour empêcher les membres du personnel d'ouvrir les portes simultanément. | ||||||
| 3.2.15 | Les portes critiques des sas doivent être munies d'un mécanisme d'interverrouillage physique ou électronique qui empêche leur ouverture simultanée. | ■ | ■ | |||
| La prévention de l'ouverture simultanée des portes critiques d'un sas avec des portes critiques adjacentes et séquentielles au moyen de mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques des portes maintient la pression différentielle de l'air nécessaire pour créer un courant d'air vers l'intérieur. De tels mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques des portes limitent également la propagation d'air possiblement contaminé vers les espaces où le niveau de contamination ou le niveau de confinement est inférieur (p. ex. un vestiaire « propre », un corridor « propre », des espaces à l'extérieur de la zone de confinement). Les commandes manuelles pour contourner les mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques permettent l'ouverture des portes en cas d'urgence. | ||||||
| 3.2.16 | Les portes de la douche de décontamination chimique doivent être munies d'un mécanisme d'interverrouillage physique ou électronique empêchant l'ouverture simultanée des portes. | ■ | ||||
| La prévention de l'ouverture simultanée des portes de la douche de décontamination chimique maintient la pression différentielle de l'air et limite la propagation d'air possiblement contaminé dans les vestiaires « sales » (p. ex. le vestiaire pour les combinaisons, la douche corporelle) des sas. Des commandes manuelles pour contourner les mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques permettent d'ouvrir les portes équipées de ces mécanismes en cas d'urgence. | ||||||
| 3.2.17 | Des portes hermétiques doivent être installées aux points d'entrée, y compris :
[Dans les zones de NC3-Ag, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] |
■ | ■ | |||
| Les portes hermétiques (p. ex. les joints pneumatiques résistants à la pression de l'air, les joints à compression) sont conçues de façon à prévenir toute fuite d'air dans des conditions de fonctionnement normales afin de maintenir l'intégrité de la barrière de confinement et de résister à la vérification du taux de décroissement de pression et à la décontamination gazeuse. | ||||||
|
||||||
3.3 Revêtements de surfaces et cabinets de laboratoire
Il est nécessaire de choisir des revêtements de surfaces et des cabinets appropriés pour les zones de confinement afin de faciliter l'entretien, le nettoyage et la décontamination des surfaces dans la zone. Les surfaces de la barrière de confinement (c.-à-d. les murs, les plafonds, les planchers) sont essentielles au maintien du confinement. Les revêtements de surfaces assurent également une protection contre les contraintes physiques associées aux activités menées régulièrement dans la zone de confinement, telles que la décontamination répétée et le nettoyage à haute pression fréquent dans les zones de confinement d'animaux.
| Matrice 3.3 | Revêtements de surfaces et cabinets de laboratoire | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Selon la fonction de la zone, les surfaces et les revêtements, y compris les planchers, les plafonds, les murs, les portes, les cadres, les cabinets, les paillasses et le mobilier, doivent être :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'utilisation de matériaux et de revêtements de surfaces nettoyables et résistants (p. ex. de la peinture, de l'époxy) qui sont compatibles avec un produit d'étanchéité résistant au rétrécissement offre une protection contre les contraintes physiques associées aux activités menées dans la zone de confinement. Cela peut comprendre des décontaminations répétées (p. ex. chimique, gazeuse), le lavage à haute pression fréquent dans les zones de confinement d'animaux, des contraintes physiques (p. ex. les impacts, la chaleur, un équipement déposé sur les surfaces, les cages d'animaux) et des égratignures (p. ex. le déplacement de gros animaux sur le plancher). Des exemples de surfaces qui pourraient exiger une décontamination comprennent les planchers, les plafonds, les murs, les portes, les cadres, les cabinets, les paillasses, le mobilier, les cages et les enclos d'animaux, et les étagères. Le niveau de protection de surface nécessaire est déterminé par la fonction de la zone de confinement et les activités qui y sont menées. Par exemple, les planchers dans un espace de travail en laboratoire pourraient n'exiger des procédures de décontamination qu'à la suite d'incidents, alors que les planchers dans une zone GA pourraient nécessiter une protection additionnelle puisqu'ils sont régulièrement décontaminés. Des exemples de matériaux non absorbants comprennent l'acier inoxydable, les revêtements à base de résine époxy ou les stratifiés de plastique résistants aux produits chimiques pour les paillasses ainsi que l'uréthane ou le vinyle pour les tabourets et les chaises. | ||||||
| 3.3.2 | Les surfaces qui pourraient entrer en contact avec des matières réglementées doivent être continues avec les matériaux adjacents et les matériaux qui se chevauchent. | ■ | ||||
| La continuité des surfaces (p. ex. les surfaces de travail avec les prises électriques, l'alimentation en gaz et les autres services installés sur la surface) assure une barrière continue conçue pour empêcher le dépôt des liquides et des aérosols contaminés sur des surfaces qui sont difficiles à accéder et à décontaminer. Cela facilite également les procédures de décontamination chimique après un déversement, une éclaboussure ou tout autre type d'événement qui entraîne la contamination des surfaces. | ||||||
| 3.3.3 | Selon la fonction de la zone, les surfaces doivent être continues et scellées avec les matériaux adjacents et les matériaux qui se chevauchent. | □ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La continuité du joint d'étanchéité entre les surfaces adjacentes (p. ex. les murs, les planchers, les plafonds, les paillasses) et les matériaux qui se chevauchent (p. ex. les planchers, les plinthes, les voussures, les dosserets) assure une barrière continue conçue pour empêcher les liquides et les aérosols contaminés de se déposer sur des surfaces qui sont difficiles à accéder et à décontaminer. Cela facilite également la décontamination après un déversement (p. ex. dans un espace de travail en laboratoire) ainsi que le nettoyage et la décontamination réguliers de la zone de confinement, de la salle animalière, du box et de la salle de nécropsie. Selon la fonction de la zone, les surfaces qui doivent être continues et scellées avec les matériaux adjacents et les matériaux qui se chevauchent comprennent les surfaces de travail, les dosserets qui sont situés très près du mur, les joints entre les planchers et les murs et les joints entre les murs et le plafond. Au NC2, la nécessité de maintenir la continuité du joint d'étanchéité entre le mur et le plafond peut être déterminée au moyen d'une ELR, selon les activités qui y sont menées, la probabilité de contamination et conformément à la fonction de la zone de confinement. Pour créer une surface continue, il est possible d'utiliser le thermosoudage ou un cordon continu d'un produit de calfeutrage, comme le calfeutrage au silicone. | ||||||
|
||||||
3.4 Traitement de l'air
Les systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) peuvent être conçus de façon à créer une barrière de confinement définie (p. ex. au moyen d'un courant d'air vers l'intérieur) pour réduire au minimum la dissémination d'aérosols infectieux ou de toxines aérosolisées. Dans les zones de confinement élevé, ces systèmes peuvent comprendre des composantes supplémentaires, par exemple des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) pour l'air évacué et des mécanismes d'interverrouillage automatisés.
| Matrice 3.4 | Traitement de l'air | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | Un courant d'air vers l'intérieur doit être présent et maintenu à la barrière de confinement là où :
[Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | |||
| Les pressions différentielles de l'air établies par la conception du système CVAC créent et maintiennent un courant d'air vers l'intérieur lors du fonctionnement normal. Ce courant d'air fait en sorte que l'air circule des espaces où le niveau de confinement est inférieur ou le risque que l'air soit contaminé est plus faible (p. ex. dans le corridor « propre ») vers des espaces où le niveau de confinement est plus élevé ou le risque que l'air soit contaminé est plus élevé (p. ex. les espaces de travail en laboratoire, les salles animalières, les box, les salles de nécropsie). Ce courant d'air empêche le rejet d'une contamination aéroportée ou aérosolisée hors des espaces où l'air peut être contaminé. Ce courant d'air établit également une barrière d'air qui empêche l'air possiblement contaminé de franchir la barrière de confinement. Par exemple, le courant d'air vers l'intérieur force l'air à circuler de l'extérieur de la zone de confinement vers le sas, et vers les corridors ou les espaces de travail « sales » (p. ex. les espaces de travail en laboratoire, les salles animalières, les box). Le courant d'air vers l'intérieur prévient non seulement la propagation des aérosols générés durant les procédures vers d'autres espaces, il aide également à prévenir la propagation d'air contaminé suite à un incident où des aérosols seraient produits hors d'un dispositif de confinement primaire (p. ex. un déversement, l'ouverture accidentelle d'une cage). | ||||||
| 3.4.2 | Un courant d'air vers l'intérieur doit être présent et maintenu à la barrière de confinement et aux portes critiques des box et des salles de nécropsie. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les pressions différentielles de l'air établies par le système CVAC créent et maintiennent un courant d'air vers l'intérieur lors du fonctionnement normal. Ce courant d'air fait en sorte que l'air circule des espaces où le niveau de confinement est inférieur ou le risque que l'air soit contaminé est plus faible (p. ex. le corridor « propre », le vestiaire « propre » des sas) vers des espaces où le niveau de confinement est plus élevé ou le risque que l'air soit contaminé est plus élevé (p. ex. le vestiaire « sale » des sas, les espaces de travail en laboratoire, les salles animalières, les box, les salles de nécropsie). Ce courant d'air empêche le rejet d'une contamination aéroportée ou aérosolisée hors des espaces où l'air peut être contaminé. Ce courant d'air établit également une barrière d'air qui empêche l'air possiblement contaminé de franchir la barrière de confinement. Par exemple, le courant d'air vers l'intérieur force l'air à circuler de l'extérieur de la zone de confinement ou du corridor « propre » vers le vestiaire « propre » du sas, du vestiaire « propre » vers la douche corporelle (le cas échéant) ou le vestiaire « sale », et du vestiaire « sale » vers les corridors ou les espaces de travail « sales » (p. ex. les espaces de travail en laboratoire, les salles animalières, les box). | ||||||
| 3.4.3 | Là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé, des dispositifs de surveillance offrant une représentation visuelle du courant d'air vers l'intérieur doivent être installés à un endroit où ils peuvent être consultés par les membres du personnel immédiatement avant l'entrée. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les dispositifs de surveillance (p. ex. un manomètre de pression différentielle, une sonde de pression différentielle étalonnée, un flotteur, des indicateurs visuels) qui offrent une indication visuelle des paramètres de fonctionnement des systèmes CVAC permettent aux membres du personnel de vérifier que le système fonctionne correctement et que le courant d'air vers l'intérieur est effectivement maintenu. Le fait de placer de tels dispositifs aux points d'entrée de la zone de confinement, de la barrière de confinement, ou à l'entrée des box ou des salles de nécropsie, permet aux membres du personnel de vérifier que le courant d'air vers l'intérieur est maintenu avant d'y entrer. | ||||||
| 3.4.4 | Les conduites destinées à la surveillance des pressions différentielles de l'air qui traversent la barrière de confinement doivent être munies de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité. |
■ | ■ | ■ | ||
| Les conduites destinées à la surveillance des pressions différentielles de l'air et qui traversent la barrière de confinement sont conçues de manière à empêcher le rejet d'air possiblement contaminé (p. ex. des agents pathogènes aéroportés, des aérosols infectieux, des toxines aérosolisées) en cas d'une pressurisation positive causée par une défaillance du système CVAC. Des conduites munies de filtres HEPA, de filtres à haute efficacité ou de petits filtres de conduite à l'intérieur de la barrière de confinement, ou des conduites pleinement étanches sont des exemples de telles considérations relatives à la conception. | ||||||
| 3.4.5 | Des avertisseurs visuels ou sonores signalant toute défaillance des systèmes CVAC doivent être installés à des endroits permettant aux membres du personnel à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement d'en être informés. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les avertisseurs (p. ex. les avertisseurs visuels stroboscopiques, les avertisseurs sonores) qui signalent toute défaillance du système CVAC dans le maintien des paramètres de fonctionnement normaux (c.-à-d. pour maintenir le courant d'air vers l'intérieur) permettent aux membres du personnel, à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement, de rapidement prendre connaissance de la défaillance, entamer des mesures d'urgence et effectuer des réparations (au besoin) pour empêcher un bris de confinement. | ||||||
| 3.4.6 | Les systèmes partagés d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air doivent être munis d'un moyen efficace de prévenir la contamination des espaces où le niveau de confinement est inférieur et de l'environnement extérieur. [Dans les zones de NC4, s'applique seulement aux espaces de NC4 se trouvant entre la douche de décontamination chimique et le vestiaire « propre ».] |
■ | ■ | ■ | ||
| La protection antirefoulement d'air dans les systèmes d'air raccordés directement à l'environnement extérieur ou à des conduits partagés (p. ex. qui sont raccordés à des conduits alimentant des espaces à l'extérieur du confinement, des zones de confinement de niveau inférieur, des espaces à l'intérieur de la zone de confinement où le risque de contamination est plus faible) empêche la contamination des espaces à l'extérieur de la zone de confinement et des espaces à l'intérieur de la zone de confinement où le risque de contamination est plus faible en cas de refoulement du courant d'air ou de défaillance du système CVAC. Les volets de confinement automatisés (p. ex. les volets étanches au gaz, les volets à étanchéité absolue) qui bloquent le courant d'air en cas de défaillance du système CVAC et les filtres HEPA qui purifient tout l'air qui est rejeté sont des exemples de protection antirefoulement d'air efficace pour les systèmes d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air. La protection antirefoulement d'air pour les conduits d'approvisionnement est située en aval (c.-à-d. selon le courant d'air normal) de tout raccord avec les conduits approvisionnant d'autres espaces (p. ex. la ventilation générale, les espaces de niveau de confinement inférieur), et en amont de tout raccord pour les conduits d'évacuation de l'air, à moins que les conduits de raccordement desservent d'autres zones de confinement d'un niveau de confinement équivalent. | ||||||
| 3.4.7 | Le système d'approvisionnement en air doit être muni d'une protection antirefoulement d'air au moyen de filtres HEPA. [Non exigé pour les espaces de NC4 situés entre la douche de décontamination chimique et le vestiaire « propre ».] |
■ | ||||
| Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, les filtres HEPA constituent la seule protection antirefoulement d'air appropriée pour le système d'approvisionnement en air au NC4, car ce mécanisme passif empêche le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement, même en cas de défaillance du système CVAC ou de refoulement du courant d'air. | ||||||
| 3.4.8 | Les systèmes d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air doivent être munis d'un mécanisme d'interverrouillage physique ou électronique automatique afin de prévenir la pressurisation positive de la zone de confinement et l'inversion soutenue du courant d'air au niveau de la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les mécanismes d'interverrouillage du système CVAC entraînent automatiquement (c.-à-d. sans dépendre d'une intervention d'un membre du personnel) la fermeture ou la déviation du système d'approvisionnement en air en cas d'interruption du système d'évacuation de l'air, afin de prévenir une pressurisation soutenue de la zone de confinement qui pourrait possiblement entraîner un refoulement du courant d'air, une fuite d'air hors de la barrière de confinement (p. ex. à travers les pénétrations, sous les portes) et le rejet de matières réglementées. Des exemples de mécanismes d'interverrouillage du système CVAC comprennent des commandes logiques intégrées dans le système de contrôle automatique de l'édifice qui dessert la zone de confinement et le câblage de raccordement entre les ventilateurs d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air. | ||||||
| 3.4.9 | Lorsqu'un courant d'air vers l'intérieur est exigé, l'air évacué doit être :
[Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | |||
| L'évacuation de l'air directement vers l'extérieur empêche la recirculation (et la concentration possible) d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées dans la zone de confinement ou d'autres espaces dans l'édifice. Lorsque l'air n'est pas évacué directement à l'extérieur (c.-à-d. qu'il est recirculé dans l'édifice), il est filtré ou exposé à la chaleur, la radiation ou des traitements chimiques pour éliminer ou inactiver les matières réglementées possiblement présentes. Une ELR peut déterminer l'approche appropriée, qui peut comprendre un filtre HEPA ou un filtre à haute efficacité. De manière semblable, l'emplacement des évents d'évacuation à l'extérieur de l'édifice peut être pris en considération afin de permettre à l'air évacué d'être dilué de manière appropriée avant toute exposition humaine ou animale, et avant d'entrer à nouveau dans l'édifice (p. ex. par l'intermédiaire d'une prise d'air extérieure adjacente). Par exemple, les évents d'évacuation peuvent être situés loin des prises d'air extérieures, des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, des portes et des trottoirs. Les protocoles au charbon ou aux rayons ultraviolets sont des exemples de traitements qui peuvent être utilisés pour prévenir le rejet de matières réglementées. | ||||||
| 3.4.10 | L'air évacué doit passer par une étape de filtration HEPA. | ■ | ■ | |||
| La filtration HEPA de l'air évacué offre une protection contre le rejet d'agents pathogènes aéroportés, d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de la zone de confinement ou la remise en circulation de telles matières à l'intérieur de l'édifice. | ||||||
| 3.4.11 | L'air évacué doit passer par deux étapes de filtration HEPA. [Seule une étape de filtration HEPA est exigée pour les espaces de NC4 situés entre la douche de décontamination chimique et le vestiaire « propre ».] |
■ | ||||
| La filtration HEPA de l'air évacué offre une protection contre le rejet d'agents pathogènes aéroportés, d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de la zone de confinement ou la remise en circulation de telles matières à l'intérieur de l'édifice. Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, deux étapes de filtration HEPA sont nécessaires pour assurer un niveau de protection approprié contre leur rejet. | ||||||
| 3.4.12 | Les filtres HEPA et les filtres à haute efficacité doivent être conformes à la norme IEST-RP-CC001. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les filtres HEPA et les filtres à haute efficacité certifiés sont fabriqués et mis à l'essai conformément à la norme applicable de l'IEST pour démontrer qu'ils fonctionnent selon leurs objectifs de conception. | ||||||
| 3.4.13 | Les boîtiers des filtres HEPA doivent être capables de résister aux changements structuraux à une pression 25% plus élevée que la pression maximale de service, conformément aux exigences de la norme ASME N511. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les boîtiers des filtres HEPA sont conçus pour résister aux pressions associées au fonctionnement normal, à la décontamination gazeuse et aux pressions appliquées dans le cadre d'une mise à l'essai régulière de l'intégrité des conduits de la zone de confinement (c.-à-d. la vérification du taux de décroissement de pression). Une telle conception réduit la possibilité d'une rupture ou d'une fuite (c.-à-d. dans le boîtier ou autour du filtre HEPA) pendant ces procédures pouvant entraîner un rejet de matières réglementées. | ||||||
| 3.4.14 | Les boîtiers des filtres HEPA ou des filtres à haute efficacité doivent permettre l'isolement, la décontamination et la mise à l'essai des filtres in situ. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Compte tenu des risques associés aux matières réglementées manipulées, un mécanisme d'isolement des filtres HEPA ou des filtres à haute efficacité (c.-à-d. des volets de confinement tels que des volets étanches au gaz ou des volets à étanchéité absolue) est essentiel pour empêcher le rejet d'air contaminé lors de la décontamination ou de la mise à l'essai (p. ex. un essai par balayage in situ) des filtres. | ||||||
| 3.4.15 | Les conduits du système d'approvisionnement en air situés entre la barrière de confinement et la protection antirefoulement d'air, et les conduits d'évacuation de l'air situés entre la barrière de confinement et les filtres HEPA ou les volets de confinement doivent être scellés hermétiquement conformément à la classe A du SMACNA. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le scellement hermétique de tous les conduits d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air entre la zone de confinement et la protection antirefoulement d'air empêche la fuite d'air contaminé, et ainsi le rejet de matières réglementées. Le scellement hermétique de tous les conduits d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air permet également d'effectuer la décontamination gazeuse et la vérification régulière du taux de décroissement de pression. Une construction utilisant de l'acier inoxydable soudé maximise la sécurité et la durabilité des conduits au fil du temps. Il est important de prendre en considération qu'une installation de NC2 visant à devenir une installation de NC3 pourrait nécessiter des travaux de scellement de conduits extensifs si la construction initiale a été effectuée conformément à une norme moins stricte. | ||||||
| 3.4.16 | Les sections des systèmes d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air situées à l'extérieur de la barrière de confinement doivent être accessibles aux fins d'entretien et de réparation. | ■ | ||||
| Les sections des systèmes d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air, y compris les conduits et les ventilateurs, à l'extérieur de la barrière de confinement doivent être régulièrement réparées, entretenues, nettoyées et inspectées afin de confirmer que le système CVAC continue à fonctionner comme prévu. La meilleure façon d'y parvenir est de placer ces sections des systèmes d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air pour qu'elles soient facilement accessibles aux membres du personnel chargés de l'entretien ou d'autres tâches. | ||||||
|
||||||
3.5 Installations et services
Les services d'une installation comprennent tous les systèmes de plomberie et d'électricité ainsi que tous les autres services qui servent aux activités de la zone de confinement. Il est important de prendre en considération les risques, notamment les répercussions d'un rejet possible de matières réglementées, au début de l'étape de la planification et de la conception et avant le début de la construction. La conception de la zone de confinement dépend du niveau de confinement et des types d'activités qui seront menées dans l'installation. Les considérations peuvent comprendre la conception des systèmes de confinement (p. ex. les systèmes CVAC, les systèmes de contrôle, les systèmes de décontamination), l'emplacement de l'équipement de grande taille et la charge électrique maximale anticipée, ainsi que la centralisation des services (p. ex. les conduits, les fils électriques, la plomberie) afin de réduire le nombre de pénétrations dans la barrière de confinement.
| Matrice 3.5 | Installations et services | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 | S'ils sont exposés, les conduits, les tuyaux et les autres dispositifs liés aux services doivent être installés de manière à permettre la décontamination de toutes les surfaces. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les conduits, les tuyaux et les autres dispositifs liés aux services dans la zone de confinement sont installés de façon à faciliter les procédures de nettoyage et de décontamination. Les considérations peuvent comprendre l'utilisation de supports d'espacement et de supports de montage en surface qui empêchent l'accumulation de matières contaminées (p. ex. de la litière, des liquides contaminés) dans les endroits difficiles à atteindre et assurent l'accessibilité aux fins d'entretien, de nettoyage et de décontamination. Lorsque les conduits sont fixés près du mur, ceux-ci peuvent être calfeutrés afin de créer une surface continue avec le mur. | ||||||
| 3.5.2 | S'ils sont exposés, les conduits, les tuyaux et les autres dispositifs liés aux services sur ou sous la surface de travail, ainsi que toute autre surface qui pourrait devenir contaminée, doivent être installés de manière à permettre la décontamination de toutes les surfaces. | P | ||||
| Les conduits, les tuyaux et les autres dispositifs liés aux services sur ou sous la surface de travail, s'ils sont exposés, ainsi que toute autre surface qui pourrait devenir contaminée, sont installés de manière à faciliter les procédures de nettoyage et de décontamination. Les considérations peuvent comprendre l'utilisation de supports d'espacement et de supports de montage en surface qui empêchent l'accumulation de contamination (p. ex. des liquides contaminés) dans des endroits difficiles à atteindre et assurent l'accessibilité aux fins d'entretien, de nettoyage et de décontamination. Lorsque les conduits sont fixés près du mur, ceux-ci peuvent être calfeutrés afin de créer une surface continue avec le mur. | ||||||
| 3.5.3 | Le système d'approvisionnement en eau doit être muni d'un robinet d'isolement et de dispositifs antirefoulement d'eau à réduction de pression conformément à la norme CAN/CSA B64.10/B64.10.1. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les dispositifs antirefoulement d'eau (p. ex. les systèmes à réduction de pression) et les robinets d'isolement (p. ex. les robinets-vannes) installés sur la tuyauterie d'approvisionnement en eau de la zone de confinement empêchent la contamination de l'approvisionnement en eau potable à l'extérieur de la zone de confinement. Les robinets d'isolement permettent aux membres du personnel de contrôler l'approvisionnement en eau, ce qui facilite l'arrêt d'urgence au besoin. Les prises d'essai permettent aux personnes de confirmer le fonctionnement du dispositif antirefoulement d'eau tel qu'il a été conçu. | ||||||
| 3.5.4 | Des lavabos doivent être installés pour faciliter le lavage des mains. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le lavage des mains empêche la propagation de la contamination à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement. Les lavabos qui sont situés à proximité des points de sortie de la zone de confinement ou de la barrière de confinement facilitent le lavage des mains par les membres du personnel à leur sortie et réduisent la possibilité que les mains soient contaminées entre le lavage des mains et la sortie. Les lavabos munis d'un dispositif mains libres (p. ex. un œil électronique ou un détecteur à infrarouge, une pédale ou une pompe à actionner avec le pied, un robinet que l'on ouvre à l'aide du coude ou du genou) permettent de réduire le risque de contamination de l'espace autour du lavabo, ce qui réduit davantage la possibilité de contamination des mains lavées avant la sortie. Lorsque l'emplacement des lavabos ne facilite pas le lavage des mains, des PON fondées sur une ELR peuvent décrire les procédures appropriées pour éliminer la contamination des mains et empêcher le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. | ||||||
| 3.5.5 | Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être munis d'un dispositif mains libres. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les lavabos munis d'un dispositif mains libres (p. ex. un œil électronique ou un détecteur à infrarouge, une pédale ou une pompe à actionner avec le pied, un robinet que l'on ouvre à l'aide du coude ou du genou) permettent de réduire le risque de contamination de l'espace autour du lavabo, ce qui réduit davantage la possibilité que les mains lavées soient à nouveau contaminées avant la sortie. | ||||||
| 3.5.6 | Les salles abritant de l'équipement de procédé et d'autres services doivent être capables de contenir le volume total d'un rejet de liquides de production à grande échelle n'ayant pas été décontaminés. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ||
| Des caractéristiques de conception des zones de confinement, comme des siphons de sol surélevés ou munis d'un bouchon, peuvent être incorporées dans les aires de production à grande échelle afin de prévenir un rejet de matières réglementées dans les égouts sanitaires ou dans les espaces situés à l'extérieur de la zone de confinement en cas de fuite ou de déversement. Les caractéristiques de conception peuvent également comprendre des digues, des barrages, des bermes et des puits pour contenir le plus grand volume d'une fuite ou d'un déversement de liquides de production à grande échelle pouvant survenir de manière réaliste selon une ELR. | ||||||
| 3.5.7 | Les tuyaux d'évacuation doivent être munis de siphons à garde d'eau profonde d'une profondeur suffisante pour maintenir la garde d'eau des siphons. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les siphons à garde d'eau profonde créent une garde d'eau qui empêche l'air contaminé provenant de la zone de confinement d'être rejeté dans la tuyauterie, les égouts et les systèmes de décontamination des effluents et dans les espaces de niveau de confinement inférieur (p. ex. à l'extérieur de la zone de confinement). Un siphon en « P » à garde d'eau profonde est un exemple courant d'un siphon utilisé dans les zones de confinement où des pressions différentielles de l'air sont maintenues ou où un refoulement du courant d'air peut survenir. La profondeur du siphon peut être déterminée en fonction des pressions maximales maintenues par le système CVAC. Dans la plupart des installations, une profondeur de siphon de 125 mm ou plus assure une protection adéquate. | ||||||
| 3.5.8 | La tuyauterie d'évacuation des espaces à l'intérieur de la barrière de confinement doit être reliée à un système de décontamination des effluents et être installée de manière à prévenir la contamination des niveaux de confinement inférieurs. [Dans les zones de NC3, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] |
P | ■ | ■ | ■ | |
| Lorsque la tuyauterie d'évacuation de différents niveaux de confinement converge, celle-ci peut être conçue d'une façon visant à prévenir l'écoulement de l'effluent d'un niveau de confinement supérieur vers un niveau de confinement inférieur (p. ex. en raison d'un drain débordant à la suite d'un blocage). Idéalement, la tuyauterie d'évacuation provenant de multiples zones de confinement convergera à proximité du système de décontamination des effluents pour empêcher que cela se produise. | ||||||
| 3.5.9 | Les drains des condensats d'autoclave situés à l'extérieur de la barrière de confinement doivent être installés de manière à empêcher le rejet de matières réglementées. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les drains pour les condensats d'autoclave sont installés de façon à empêcher le rejet de liquides et de vapeur possiblement contaminés hors de l'autoclave et de la zone de confinement. Par exemple, le condensat d'autoclave peut être recueilli et décontaminé avant son rejet dans le réseau d'égouts sanitaires en étant redirigé, par un raccordement fermé, vers un système de décontamination des effluents. Bien qu'un raccordement fermé soit préférable pour empêcher un rejet du condensat et de la vapeur contaminés, un raccordement ouvert peut être acceptable lorsqu'un drain est situé à l'intérieur de la barrière de confinement ou lorsque l'autoclave est doté d'une fonction d'auto-décontamination (c.-à-d. le condensat et la vapeur sont décontaminés avant leur rejet hors de l'autoclave). | ||||||
| 3.5.10 | Les évents de plomberie doivent être indépendants de ceux desservant des espaces de niveau de confinement inférieur, à moins qu'ils ne soient munis de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité installés à des emplacements qui préviennent la contamination des espaces de niveau de confinement inférieur. | ■ | ||||
| Les évents de plomberie pour la plomberie de la zone de confinement sont gardés séparés des évents de plomberie pour les espaces à l'extérieur de la zone de confinement afin d'empêcher le rejet de matières réglementées dans la tuyauterie qui dessert ces espaces. Lorsque les évents de plomberie pour la zone de confinement convergent avec ceux situés à l'extérieur de la zone de confinement, des filtres HEPA ou des filtres à haute efficacité peuvent être installés afin d'empêcher l'air contaminé d'entrer dans les évents de plomberie de la tuyauterie desservant les espaces situés à l'extérieur de la zone de confinement. | ||||||
| 3.5.11 | Les évents de plomberie doivent être munis de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité installés à des emplacements qui préviennent la contamination des espaces de niveau de confinement inférieur et de l'environnement extérieur. [Dans les zones de NC3, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] |
■ | ■ | |||
| Les évents de plomberie qui sont dotés de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité situés entre la tuyauterie desservant des espaces à l'intérieur de la barrière de confinement et le raccord aux évents de plomberie qui sont évacués à l'extérieur ou raccordés à la tuyauterie desservant des espaces de niveau de confinement inférieur empêchent le rejet de matières réglementées dans la tuyauterie qui dessert des espaces situés à l'extérieur de la barrière de confinement ou l'environnement. Pour permettre la décontamination gazeuse et le remplacement ou la mise à l'essai des filtres de façon sécuritaire, les filtres peuvent être pleinement isolés par des volets de confinement (c.-à-d. des volets à étanchéité absolue ou des volets étanches au gaz) ou par d'autres moyens d'isolement. | ||||||
| 3.5.12 | Les évents de plomberie doivent être munis de deux étapes de filtration HEPA ou de filtration à haute efficacité installées à des emplacements qui préviennent la contamination des autres zones de confinement et de l'environnement extérieur. | ■ | ||||
| Les évents de plomberie qui sont dotés de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité situés entre la tuyauterie desservant des espaces à l'intérieur de la barrière de confinement et le raccord aux évents de plomberie qui sont évacués à l'extérieur ou raccordés à la tuyauterie desservant d'autres zones empêchent le rejet de matières réglementées dans la tuyauterie qui dessert des espaces situés à l'extérieur de la barrière de confinement ou l'environnement. Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, deux étapes de filtration HEPA ou de filtration à haute efficacité sont nécessaires dans les évents de plomberie afin d'assurer le niveau de protection approprié contre leur rejet. Pour permettre la décontamination gazeuse et le remplacement ou la mise à l'essai des filtres de façon sécuritaire, les filtres peuvent être pleinement isolés par des volets de confinement (c.-à-d. des volets à étanchéité absolue ou des volets étanches au gaz) ou par d'autres moyens d'isolement. | ||||||
| 3.5.13 | Un système d'approvisionnement en air respirable de secours doit être installé pour les espaces où les membres du personnel portent une combinaison à pression positive, conformément à la norme CAN/CSA Z180.1. | ■ | ||||
| Advenant une défaillance du système d'approvisionnement en air respirable, les systèmes d'approvisionnement en air respirable de secours (p. ex. les bouteilles d'air de secours, le réservoir d'air de réserve) fournissent une quantité d'air suffisante (conformément à la norme CAN/CSA Z180.1) pour tous les membres du personnel dans les zones de NC4 où les membres du personnel portent une combinaison à pression positive. La quantité d'air de secours pouvant être nécessaire dans une situation d'urgence peut être fondée sur le nombre maximal de combinaisons à pression positive portées en tout temps et la distance la plus grande que les membres du personnel pourraient avoir à traverser pour sortir de la zone de confinement en cas d'urgence. | ||||||
| 3.5.14 | L'équipement et les services essentiels au confinement, y compris la biosûreté, doivent être branchés à une source d'alimentation de secours, ou être conçus pour s'éteindre de manière à prévenir un bris de confinement ou une brèche de biosûreté. | □ PS | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fonctionnement continu de l'équipement essentiel au confinement des matières réglementées et pour les garder en lieu sûr (p. ex. les ESB, les étagères à cages ventilées, les systèmes de contrôle d'accès électroniques) pendant une panne de courant est crucial pour maintenir l'intégrité du confinement et garder la zone de confinement sûre. Dans les zones de confinement élevé, un tel équipement comprend les systèmes CVAC et leurs commandes (p. ex. les contrôles d'accès, les systèmes de surveillance et d'acquisition de données [SCADA], les avertisseurs, les mécanismes d'interverrouillage), ainsi que l'équipement essentiel à la sécurité des membres du personnel (p. ex. l'approvisionnement en air). L'alimentation de secours peut être fournie par une génératrice de l'édifice ou un système UPS. Lorsqu'aucune alimentation de secours n'est disponible, il est essentiel que les systèmes de sécurité s'éteignent en gardant la zone sûre (c.-à-d. verrouillée) et que les systèmes CVAC s'éteignent de manière neutre (c.-à-d. aucun courant d'air) pour maintenir le confinement. | ||||||
| 3.5.15 | Les systèmes de sécurité des personnes, les systèmes de contrôle automatique de l'édifice et les autres systèmes de sécurité doivent être branchés à l'UPS. | ■ | ||||
| Un système UPS assure le fonctionnement continu des systèmes de sécurité des personnes (p. ex. l'approvisionnement en air respirable des combinaisons à pression positive), des systèmes de contrôle automatique de l'édifice et des autres systèmes de sécurité (p. ex. les systèmes de contrôle d'accès électroniques), ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des membres du personnel, maintenir le confinement des matières et garder la zone sûre. | ||||||
|
||||||
3.6 Équipement essentiel à la biosécurité
L'équipement de biosécurité offre un confinement efficace des matières réglementées. Cet équipement comprend tous les dispositifs de confinement primaire (p. ex. les ESB, les isolateurs, les centrifugeuses munies de godets étanches, l'équipement de procédé, les fermenteurs, les bioréacteurs, les cages de confinement primaire, les étagères à cages ventilées) et les systèmes de décontamination (p. ex. les autoclaves).
| Matrice 3.6 | Équipement essentiel à la biosécurité | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1 | Des ESB ou d'autres dispositifs de confinement primaire doivent être fournis, selon une ELR. |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés dans le respect des bonnes pratiques microbiologiques et des PON, les dispositifs de confinement primaire offrent une protection efficace des membres du personnel et de l'environnement lors des activités qui impliquent la manipulation de récipients ouverts de matières réglementées, ou d'animaux réglementés. Les ESB, les équipements de procédé, les fermenteurs, les bioréacteurs, les systèmes fermés, les cages de confinement primaire (p. ex. les cages de micro-isolation), les étagères à cages ventilées et les centrifugeuses munies de godets de sécurité ou de rotors étanches sont tous des exemples de dispositifs de confinement primaire. Dans les pièces qui servent de confinement primaire (p. ex. les box, les salles de nécropsie), l'EPI sert de protection primaire contre une exposition. | ||||||
| 3.6.2 | Là où la pièce ne sert pas de confinement primaire, l'équipement de procédé, les systèmes fermés et les autres dispositifs de confinement primaire doivent empêcher le rejet de matières réglementées lors du fonctionnement normal ou avoir des mécanismes en place pour contenir un rejet possible. |
□ | ■ | ■ | ||
| Le fait d'avoir un mécanisme en place afin de prévenir un rejet de matières réglementées hors de l'équipement de procédé, des systèmes fermés et d'autres dispositifs de confinement primaire utilisés pour les activités de production à grande échelle de matières réglementées protège les membres du personnel contre une exposition et prévient la propagation de la contamination. L'installation de filtres HEPA aux points de prélèvement et sur les évents, et l'utilisation d'un boîtier ventilé dont l'air est évacué par un système de filtration HEPA pour renfermer un dispositif de confinement primaire (p. ex. une chambre de confinement primaire) sont des exemples de mécanismes qui peuvent prévenir le rejet de matières réglementées. Le fait d'avoir des mécanismes supplémentaires (p. ex. des vannes de secours, des PON) pour les dispositifs de confinement primaire, l'équipement de procédé et les systèmes fermés utilisés pour les activités de production à grande échelle assure une protection redondante contre un rejet de matières réglementées non traitées dans la zone de confinement ou dans le réseau d'égouts sanitaires. Là où un rejet pourrait se produire (p. ex. lorsque de l'équipement de procédé relâche la pression accumulée dans le système), un mécanisme peut être mis en place pour s'assurer que ce rejet est complètement contenu et prévenir l'exposition des membres du personnel. | ||||||
| 3.6.3 | Des cages de confinement primaire doivent être fournies pour héberger les animaux réglementés. [Non exigé pour les aires de production à grande échelle.] |
□ | ||||
| Les systèmes de cages de confinement primaire sont conçus de façon à empêcher le rejet de matières réglementées provenant d'animaux réglementés. Le choix de la cage de confinement primaire, y compris le type de filtre (p. ex. un filtre HEPA, un filtre antipoussière), peut être fondé sur une ELR qui prend en considération la matière réglementée pouvant être présente, les animaux manipulés et le type de travail qui est effectué. Les cages de micro-isolation ventilées sont un exemple de systèmes de cages de confinement primaire qui pourraient être utilisés dans une zone PA. | ||||||
| 3.6.4 | Des systèmes de cages de confinement primaire munis de filtres HEPA doivent être fournis pour héberger les animaux réglementés. | ■ | ■ | |||
| Les systèmes de cages de confinement primaire munis de filtres HEPA à même les cages (p. ex. une cage à couvercle filtrant) sont conçus de façon à prévenir l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières réglementées provenant d'animaux réglementés. Le choix de la cage de confinement primaire peut être fondé sur une ELR qui prend en considération la matière réglementée pouvant être présente, les animaux manipulés et le type de travail qui est effectué. | ||||||
| 3.6.5 | Des systèmes de décontamination doivent être installés à l'intérieur de la zone de confinement, ou des procédures doivent être en place pour le transport et le déplacement sécuritaires et sûrs des déchets pour leur décontamination à l'extérieur de la zone de confinement. | ■ | ■ | |||
| La décontamination des déchets ou du matériel contaminé à l'intérieur de la zone de confinement, ou les procédures pour leur déplacement ou leur transport sécuritaire et sûr vers un espace de décontamination situé à l'extérieur de la zone de confinement (p. ex. l'endroit de décontamination centralisé de l'installation, le service d'élimination des déchets hors site) empêchent le rejet de matières réglementées. Les autoclaves et les incinérateurs sont des exemples de systèmes de décontamination. Lorsqu'aucun système de décontamination n'est disponible à l'intérieur de la zone de confinement, des procédures peuvent être mises en œuvre, en fonction des ELR, pour le déplacement ou le transport sécuritaire et sûr des déchets ou du matériel contaminé vers l'extérieur de la zone de confinement. Les considérations pour l'ELR comprennent le volume de déchets produits (p. ex. les zones de confinement pour animaux produisent des volumes importants de déchets contaminés) et le type de déchets (p. ex. des déchets solides, des déchets mixtes, des volumes importants de liquides contaminés). | ||||||
| 3.6.6 | Des systèmes de décontamination doivent être installés à même la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les systèmes de décontamination passe-plats (p. ex. les autoclaves à deux portes qui traversent la barrière de confinement, les cuves d'immersion, les chambres de fumigation) qui traversent la barrière de confinement permettent de décontaminer les matières à l'intérieur de la barrière de confinement et de retirer les matières décontaminées des systèmes de décontamination de l'extérieur de la barrière de confinement. Ceci élimine la possibilité que les matières soient de nouveau contaminées avant de franchir la barrière de confinement. | ||||||
| 3.6.7 | Les systèmes de décontamination doivent être munis de dispositifs de surveillance et de mécanismes d'enregistrement qui saisissent les paramètres opérationnels. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les dispositifs de surveillance sur les systèmes de décontamination offrent une indication visuelle des paramètres de fonctionnement, ce qui permet aux membres du personnel de vérifier que les systèmes de décontamination fonctionnent correctement (c.-à-d. que les paramètres opérationnels atteignent les paramètres validés aux fins de décontamination). La date, le numéro du cycle, la durée, la température, la concentration des produits chimiques et la pression sont des exemples de paramètres de fonctionnement pouvant être indiqués sur les dispositifs de surveillance. Il est également nécessaire d'avoir en place un mécanisme d'enregistrement pour saisir les paramètres opérationnels (p. ex. un système de décontamination avec une fonction d'enregistrement intégrée, une PON spécifiant quels paramètres opérationnels sont saisis par les membres du personnel lors de la procédure de décontamination), puisque cela sert de preuve que les paramètres nécessaires à la décontamination ont été atteints. | ||||||
| 3.6.8 | Les systèmes à vide doivent être munis de mécanismes empêchant leur contamination et le rejet de matières réglementées. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes à vide sont utilisés pour aspirer le liquide d'un contenant ou d'un récipient, ou pour créer un vide dans des unités de filtration. Étant donné que les pompes à vide peuvent créer des aérosols contenant des matières réglementées, des mécanismes sont exigés pour empêcher que de tels aérosols contaminent les pompes à vide et leurs conduites, ou pour éviter que ceux-ci soient rejetés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de confinement. Ces mécanismes comprennent les filtres HEPA, les filtres à haute efficacité, les petits filtres de conduite (p. ex. un filtre de 0,2 µm) et les siphons désinfectants. Des PON peuvent également être élaborées et mises en œuvre pour prévenir la contamination des systèmes à vide et le rejet de matières réglementées. | ||||||
|
||||||
3.7 Systèmes de décontamination des effluents
Les systèmes de décontamination des effluents empêchent le rejet de liquides contaminés dans les égouts sanitaires, et ainsi un rejet éventuel dans l'environnement. Il est essentiel de disposer d'un système de décontamination des effluents pour décontaminer tous les déchets liquides produits dans les zones de NC2-Ag où sont manipulés des prions, dans les zones de NC3 où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et dans toutes les zones de NC3-Ag et de NC4.
| Matrice 3.7 | Systèmes de décontamination des effluents | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.1 | Un système de décontamination des effluents doit être installé. [Dans les zones de NC3, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] |
P | ■ | ■ | ■ | |
| Un système de décontamination des effluents permet de décontaminer par la chaleur ou par des moyens chimiques tous les déchets liquides qui quittent la zone de confinement avant qu'ils soient rejetés dans les égouts sanitaires. Un système approprié sera en mesure de décontaminer le volume d'effluents produits. Les conceptions des systèmes de décontamination des effluents peuvent comprendre des réservoirs de rétention dotés d'une ou de plusieurs cuves de décontamination conçues pour décontaminer les effluents de manière continue ou par quantités fixes (c.-à-d. par lots). Les considérations relatives à la conception de l'équipement comprennent des mécanismes qui préviennent les blocages (p. ex. un broyeur, de la tuyauterie d'une taille adéquate) et la capacité de résister à la chaleur et aux produits chimiques conformément à l'utilisation. | ||||||
| 3.7.2 | Les salles abritant un système de décontamination des effluents servant de système de décontamination primaire doivent disposer des éléments suivants :
|
P | ■ | ■ | ■ | |
| Dans l'éventualité d'une défaillance du système de décontamination des effluents (p. ex. la fuite d'un réservoir de rétention ou d'une cuve de décontamination), la salle dans laquelle est installé un système de décontamination des effluents est conçue pour contenir le volume maximal des effluents pouvant être rejetés (c.-à-d. selon une ELR) de façon à empêcher leur rejet hors de la zone de confinement. Pour ce faire, les surfaces de plancher peuvent être scellées et on peut avoir recours à des gorges, à des bermes ou à des digues, ou dans le cas de surfaces de plancher scellées, à des joints étanches entre le plancher et les murs; les murs doivent être scellés jusqu'à la hauteur maximale pouvant être atteinte par les effluents déversés (c.-à-d. les surfaces doivent être continues avec les matériaux adjacents et les matériaux qui se chevauchent). Les salles abritant un système de décontamination des effluents servant de système de décontamination primaire sont également conçues pour offrir un niveau de sûreté approprié (p. ex. des portes verrouillables) et appuyer les procédures d'entrée sécuritaire (c.-à-d. tel qu'il est décrit sur le panneau d'avertissement de danger biologique) pour empêcher l'accès non autorisé. | ||||||
| 3.7.3 | Les salles abritant un système de décontamination des effluents doivent :
|
■ | ||||
| Compte tenu des risques accrus associés aux matières réglementées de GR4, les salles abritant un système de décontamination des effluents qui dessert une zone de confinement de NC4 sont conçues de façon à assurer une protection supplémentaire contre une défaillance du système de décontamination des effluents. Ces exigences physiques en matière de confinement supplémentaires comprennent la filtration HEPA de l'air évacué pour empêcher le rejet d'air contaminé et la mise en place d'un sas pour soutenir le courant d'air vers l'intérieur et permettre les procédures d'entrée et de sortie sécuritaires des membres du personnel. | ||||||
| 3.7.4 | Des avertisseurs visuels ou sonores pour indiquer toute mise en garde ou défaillance du système de décontamination des effluents doivent être fournis à des emplacements qui permettent aux membres du personnel d'être informés de telles mises en garde ou défaillances. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les systèmes d'avertissement (p. ex. un avertisseur sonore, une messagerie électronique automatisée) conçus pour signaler toute mise en garde ou défaillance du système de décontamination des effluents permettent aux membres du personnel à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement d'être immédiatement informés de la mise en garde ou de la défaillance, ce qui leur permet d'intervenir rapidement pour corriger le problème ou entreprendre des procédures d'urgence. | ||||||
| 3.7.5 | Des dispositifs de surveillance et des mécanismes d'enregistrement doivent être en place pour saisir les paramètres de décontamination essentiels des systèmes de décontamination des effluents. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Il est essentiel que des dispositifs de surveillance (p. ex. des capteurs de température, des capteurs de pression, des jauges électroniques) qui saisissent et indiquent visuellement les paramètres de fonctionnement (p. ex. la température, la pression, le pH, le débit) soient utilisés, afin de permettre aux membres du personnel de vérifier que le système de décontamination des effluents atteint et maintient les paramètres exigés pour la décontamination des matières réglementées. Il est également nécessaire d'avoir en place un mécanisme d'enregistrement pour saisir les paramètres opérationnels (p. ex. des dispositifs de surveillance avec une fonction d'enregistrement intégrée, une PON spécifiant quels paramètres opérationnels sont saisis par les membres du personnel lors de la procédure de décontamination), puisque cela sert de preuve que les paramètres nécessaires à la décontamination ont été atteints. | ||||||
| 3.7.6 | La tuyauterie d'évacuation reliée au système de décontamination des effluents doit être identifiée au moyen d'étiquettes. | P | ■ | ■ | ■ | |
| L'étiquetage précis de toute la tuyauterie raccordée à un système de décontamination des effluents permet de bien identifier chaque composante et appuie une intervention rapide des membres du personnel formés en cas de défaillance ou de fuite. Des codes de couleurs, des flèches directionnelles, des étiquettes d'identification et des symboles de danger constituent tous des exemples d'étiquetage approprié. | ||||||
| 3.7.7 | Les évents du système de décontamination des effluents doivent être munis de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité installés à des emplacements qui permettent d'empêcher la contamination des espaces de niveau de confinement inférieur et de l'environnement extérieur. | ■ | ■ | |||
| L'installation de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité sur les évents de plomberie du système de décontamination des effluents empêche le rejet de matières réglementées hors du confinement si les filtres sont situés en aval d'où l'air contaminé est évacué à l'extérieur ou vers les évents de plomberie pour la tuyauterie desservant des espaces à l'extérieur de la barrière de confinement. | ||||||
| 3.7.8 | Les évents du système de décontamination des effluents doivent être munis de deux étapes de filtration HEPA ou de filtration à haute efficacité installées à des emplacements qui permettent d'empêcher la contamination des autres zones de confinement et de l'environnement extérieur. | ■ | ||||
| L'installation de filtres HEPA ou de filtres à haute efficacité sur les évents de plomberie du système de décontamination des effluents empêche le rejet de matières réglementées hors du confinement. Pour assurer une protection appropriée contre le rejet, les filtres sont situés en aval d'où l'air contaminé est évacué à l'extérieur ou vers les évents de plomberie pour la tuyauterie desservant des espaces à l'extérieur de la barrière de confinement. Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, deux étapes de filtration HEPA ou de filtration à haute efficacité sont nécessaires pour assurer une protection redondante contre tout rejet. | ||||||
|
||||||
4. Exigences opérationnelles
La présente section décrit les exigences opérationnelles (c.-à-d. les mesures administratives et les procédures) visant à réduire les risques associés à la manipulation ou à l'entreposage de matières réglementées, et à la manipulation ou à l'hébergement d'animaux réglementés. Bien que cette section énonce les exigences pour chaque type de zone de confinement, les organisations peuvent décider de combiner certains éléments du programme de biosécurité (p. ex. le manuel de biosécurité, l'agent de la sécurité biologique [ASB], le plan de biosûreté) pour plusieurs zones de confinement, selon les résultats d'une évaluation globale des risques.
4.1 Gestion du programme de biosécurité
Un programme de biosécurité vise à prévenir les infections, les intoxications et les maladies chez les membres du personnel et la communauté ainsi qu'à protéger l'environnement contre les dangers en empêchant le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. Le niveau de précision et de complexité du programme de biosécurité dépend de la nature de l'organisation (c.-à-d. sa taille, sa structure et sa complexité) et des activités qui y sont menées. Un programme de biosécurité efficace nécessite l'engagement et la participation active de tous les membres de l'organisation, y compris la haute direction, les superviseurs, l'ASB et les membres du personnel. La gestion quotidienne du programme de biosécurité peut être déterminée à l'interne et les responsabilités déléguées en conséquence.
| Matrice 4.1 | Gestion du programme de biosécurité | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Un programme de biosécurité doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, tenu à jour, ainsi qu'évalué et amélioré au besoin. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un programme de biosécurité permet la mise en œuvre efficace et l'application continue de pratiques relatives à la biosécurité conformément aux exigences réglementaires et aux politiques de biosécurité d'une organisation. Le programme de biosécurité est conçu afin de promouvoir une culture de biosécurité, d'atténuer tous les risques identifiés au moyen d'évaluations des risques, et d'élaborer des plans et des programmes pour satisfaire à l'ensemble des exigences réglementaires applicables (p. ex. la formation, l'enquête sur un incident, la validation et la vérification, la création de PON, les documents et les registres). | ||||||
| 4.1.2 | Un représentant de la biosécurité (c.-à-d. un ASB), dont les connaissances sont appropriées pour les niveaux de confinement de l'installation et les matières réglementées qui y sont manipulées, doit être désigné pour surveiller l'application des pratiques relatives à la biosécurité et à la biosûreté, y compris les suivantes :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les responsables de la biosécurité (p. ex. les ASB désignés) ont la responsabilité de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des principaux éléments du programme de biosécurité. Pour qu'un ASB puisse bien prendre ses responsabilités, des connaissances suffisantes des matières réglementées manipulées sont exigées, ainsi qu'une expérience appropriée pour le type d'installation et les niveaux de confinement dans lesquels sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. | ||||||
| 4.1.3 | Là où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, l'ACIA doit être avisée avant d'apporter des changements à la fonction du programme, à la structure physique de l'installation, à l'équipement ou aux PON qui pourraient influer sur le bioconfinement, afin que ces changements soient approuvés. | ■ | ■ | ■ | ||
| Compte tenu des risques pour la population animale, l'approvisionnement alimentaire et l'économie associés aux agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, tout changement apporté à la fonction du programme (qui décrit l'étendue des activités qui sont menées dans une installation, y compris les matières réglementées et les espèces animales manipulées) ou tout changement qui pourrait avoir une répercussion sur le bioconfinement dans les zones de confinement où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont soumis à l'ACIA avant leur mise en œuvre. Cela permet à l'ACIA de confirmer que les changements sont acceptables et que le confinement des matières réglementées sera efficace. Les changements qui pourraient avoir une répercussion sur le bioconfinement comprennent les changements à la structure physique de l'installation (p. ex. modifier l'emplacement des murs, des portes ou des conduits, desceller des drains de plancher), à l'équipement (p. ex. changer le type de filtre utilisé dans une ESB) ou aux PON (p. ex. une nouvelle procédure effectuée à l'extérieur d'une ESB). | ||||||
| 4.1.4 | Une évaluation globale des risques doit être réalisée, documentée et tenue à jour. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'évaluation globale des risques est une vaste évaluation qui tient compte de toutes les activités menées dans l'installation. Une telle évaluation est souvent réalisée au moment de l'élaboration initiale ou de l'examen du programme de biosécurité d'une installation. Elle vise à cerner les dangers et les risques en matière de biosécurité et de biosûreté, et prend en considération toutes les évaluations des risques effectuées afin d'instaurer des stratégies d'atténuation appropriées pour les activités proposées comportant des matières réglementées. | ||||||
| 4.1.5 | Une évaluation des risques de biosûreté doit être réalisée, documentée et tenue à jour. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une évaluation des risques de biosûreté recense les ressources et établit leur ordre de priorité, définit les menaces, les vulnérabilités et les conséquences, évalue les risques et soutient le plan de biosûreté d'une installation. | ||||||
| 4.1.6 | Une ELR doit être réalisée, documentée et tenue à jour pour les activités comportant des matières réglementées. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les ELR sont des évaluations propres à un endroit en particulier, réalisées pour repérer les dangers associés aux matières réglementées présentes ainsi qu'aux activités qui y sont menées. Elles servent à l'élaboration des PON qui décrivent les pratiques de travail sécuritaires pour les activités réalisées. Les risques relevés peuvent être associés aux activités (p. ex. les procédures in vivo, l'équipement qui produit des aérosols), aux instruments (p. ex. les objets pointus ou tranchants), aux matières réglementées (p. ex. la possible transmission par aérosol), à la forme des matières (p. ex. les toxines sous forme de poudre) et à la quantité de matières manipulées (p. ex. les volumes importants, les fortes concentrations). | ||||||
| 4.1.7 | Un manuel de biosécurité doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, suivi, tenu à jour, communiqué et rendu accessible aux membres du personnel autorisés. Un manuel de biosécurité comprend une description des éléments suivants :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le manuel de biosécurité est essentiel afin de promouvoir la biosécurité et la biosûreté chez les membres du personnel qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement. Il peut comprendre des informations sur les politiques de biosécurité et de biosûreté, ainsi que sur la fonction du programme, et peuvent présenter aux membres du personnel un aperçu général des objectifs de biosécurité et de biosûreté de l'organisation. Il peut également comprendre les renseignements propres à une zone de confinement, y compris une description de la conception physique et du fonctionnement de la zone de confinement et des systèmes de confinement pour situer les PON dans leur contexte (p. ex. les procédures d'entrée et de sortie, la vérification du courant d'air vers l'intérieur). Un plan de communication peut être mis en œuvre afin d'informer les membres du personnel au sujet de renseignements nouveaux ou mis à jour, ainsi que l'endroit où l'on puisse trouver ces derniers. Les renseignements peuvent être contenus dans un document unique en format papier ou électronique ou dans une collection de documents distincts. Lorsque des renseignements liés à plusieurs éléments du programme de biosécurité se trouvent dans des documents distincts, un document central (p. ex. une table des matières) peut permettre un accès rapide et facile à tous les renseignements essentiels. Les documents individuels peuvent être conservés ou non à un seul emplacement physique. Par exemple, les renseignements sensibles relatifs aux ABCSE peuvent être conservés séparément afin de demeurer accessibles seulement aux membres du personnel autorisés (p. ex. les membres du personnel ayant une habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT). | ||||||
| 4.1.8 | Un plan de biosûreté doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, suivi, évalué, tenu à jour, communiqué et rendu accessible aux membres du personnel autorisés. Un plan de biosûreté fournit des renseignements sur :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le plan de biosûreté explique de façon détaillée les stratégies d'atténuation pour contrer les événements de biosûreté possibles identifiés dans l'évaluation des risques de biosûreté. Des mesures d'atténuation sont mises en œuvre pour la sécurité du personnel et la prévention de la perte, du vol, du mésusage, du détournement ou du rejet intentionnel non autorisé de ressources biologiques (c.-à-d. des matières réglementées) et de ressources associées à l'installation (p. ex. de l'équipement, du matériel non infectieux, des animaux, des renseignements sensibles). Les mesures d'atténuation pour la sécurité du personnel comprennent toujours des évaluations de la compétence et de la fiabilité continue des membres du personnel. Les mesures d'atténuation pour la sécurité physique comprennent les barrières, les contrôles d'accès, la détection des intrusions, les protocoles pour émettre et révoquer les autorisations d'accès et les protocoles pour le maintien de registres d'entrée et de sortie pour la zone de confinement. Les mesures d'atténuation servent également à prévenir l'accès non autorisé à des renseignements sensibles ou aux zones de confinement et aux espaces où des matières réglementées sont manipulées ou entreposées. Les mesures d'atténuation relatives à la gestion de l'information comprennent souvent la protection et la classification des renseignements, ainsi que des PON pour l'entreposage approprié des renseignements électroniques et des copies papier. La formation et la sensibilisation relatives au plan de biosûreté (p. ex. à l'aide d'ateliers ou d'exercices fonctionnels et pratiques) permettent de s'assurer que les mesures d'atténuation sont suivies. La formation en matière de biosûreté peut également comprendre la formation sur la déclaration des incidents (p. ex. la perte ou le vol de matières réglementées), les politiques de l'installation sur l'utilisation appropriée des appareils électroniques et des médias sociaux, ainsi que la reconnaissance de la fraude psychologique ou des comportements suspects provenant de menaces internes. L'évaluation et l'examen du plan de biosûreté appuient l'amélioration continue du programme de biosécurité global et peuvent être réalisés à la suite d'un incident, après des modifications à la fonction du programme (p. ex. travailler avec un nouvel agent pathogène, la recherche à gain de fonction) ou après toute situation susceptible d'entraîner des modifications au plan de biosûreté (p. ex. les rénovations de l'installation). Le plan de biosûreté peut être élaboré par une équipe multidisciplinaire d'experts (p. ex. des scientifiques, des spécialistes de la cybersécurité, des professionnels de la sûreté, des consultants externes) et approuvé par la haute direction. | ||||||
| 4.1.9 | Un programme de surveillance médicale fondé sur une évaluation globale des risques et des ELR doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, suivi et tenu à jour. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un programme de surveillance médicale aide à la prévention, à la détection et au traitement des maladies associées à l'exposition des membres du personnel de laboratoire à des matières réglementées. Le programme est essentiellement axé sur la prévention, mais il prévoit également un mécanisme d'intervention qui permet de rapidement détecter et traiter une infection ou une intoxication possible. Le besoin de mettre en œuvre un programme de surveillance médicale est fondé sur les matières réglementées manipulées (p. ex. la probabilité d'infection, la gravité de la maladie) et les activités qui se déroulent à l'intérieur de la zone de confinement (p. ex. la production d'aérosol, l'utilisation d'objets pointus ou tranchants, l'exposition des muqueuses). | ||||||
| 4.1.10 | Des PON propres aux pratiques opérationnelles et aux essais de vérification et de performance doivent être élaborées, documentées, mises en œuvre, suivies, tenues à jour, communiquées et rendues accessibles aux membres du personnel autorisés. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les PON constituent la base de l'élaboration des pratiques de travail sécuritaires et décrivent précisément les étapes et les mesures à suivre dans le cadre d'une activité donnée. Les PON qui sont tenues à jour, communiquées aux membres du personnel et facilement accessibles pour être révisées rapidement permettent aux membres du personnel d'accomplir les tâches de façon sécuritaire et conformément aux exigences internes (c.-à-d. de l'organisation) et externes (p. ex. les lois, les règlements, les normes). Les PON permettent également de s'assurer de satisfaire aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives aux essais de vérification et de performance. Les PON pour les pratiques de travail sécuritaires comprennent celles concernant l'utilisation de l'EPI; les procédures d'entrée et de sortie pour les membres du personnel, les animaux et les matières; l'utilisation de dispositifs de confinement primaire; la manipulation sécuritaire des animaux; la décontamination et la gestion des déchets; le déplacement et le transport sécuritaires et sûrs des matières réglementées; et toute procédure ou tâche qui implique des matières réglementées ou des animaux, selon une ELR. Il est important que les PON soient mises en œuvre et suivies telles qu'elles ont été écrites, et tenues à jour lorsque des changements sont apportés aux procédures. | ||||||
|
||||||
4.2 Programme de formation
La formation constitue un élément fondamental de la biosécurité et de la biosûreté; elle est essentielle à la réussite du programme de biosécurité. Il est essentiel d'informer les membres du personnel des dangers présents dans le milieu de travail ainsi que des pratiques, des outils et de l'équipement qui peuvent les protéger contre une exposition à des matières réglementées et prévenir le rejet de celles-ci hors de la zone de confinement. Ce type de programme peut comprendre l'éducation (c.-à-d. les connaissances théoriques), la formation (c.-à-d. le développement de compétences pratiques) et la supervision des membres du personnel jusqu'à ce qu'ils démontrent leurs connaissances sur le sujet et leur capacité d'appliquer correctement les procédures sur lesquelles ils ont suivi une formation.
| Matrice 4.2 | Programme de formation | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Une évaluation des besoins en matière de formation doit être réalisée, documentée, tenue à jour et révisée annuellement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une évaluation des besoins en matière de formation peut être utilisée au moment de l'élaboration initiale du programme de formation pour déterminer les principaux éléments du programme de formation, y compris les objectifs, le contenu, les groupes cibles, la stratégie de mise en œuvre du programme et les cycles de perfectionnement. Elle peut également être utilisée pour évaluer un programme de formation actuel par rapport à ses objectifs établis pour déterminer s'il existe des écarts ou des lacunes dans le programme. Étant donné que les besoins en matière de formation peuvent varier selon les responsabilités et l'expérience des membres du personnel, des évaluations distinctes peuvent être réalisées pour différents groupes cibles (p. ex. les scientifiques, les techniciens, les étudiants, les membres du personnel d'entretien et de nettoyage, les membres du personnel ayant une habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT). Les évaluations permettent également de déterminer tout besoin relatif à une formation supplémentaire et à la fréquence du perfectionnement (p. ex. la formation sur les procédures d'intervention en cas d'urgence, les exercices). Le besoin en matière de perfectionnement peut changer au fil du temps, en fonction du processus d'examen annuel, de la compétence et de l'expérience des membres du personnel, des incidents, ou des changements au programme de biosécurité ou au plan de biosûreté (c.-à-d. de nouvelles mesures d'atténuation des risques). | ||||||
| 4.2.2 | Un programme de formation, fondé sur une évaluation des besoins en matière de formation, doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, tenu à jour, et évalué et amélioré au besoin. Un programme de formation comprend la formation sur :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le programme de formation comprend les principaux éléments du programme de biosécurité. Il fait régulièrement l'objet d'un examen et d'améliorations afin d'assurer son exactitude et sa pertinence, et pour offrir aux membres du personnel une formation appropriée pour le travail à effectuer. Une formation supplémentaire ou de perfectionnement peut être élaborée au fil du temps, en fonction du processus d'examen, de la compétence et de l'expérience des membres du personnel, des incidents ou des changements apportés au programme de biosécurité. | ||||||
| 4.2.3 | Les visiteurs, les membres du personnel de nettoyage et d'entretien, les entrepreneurs et les autres personnes qui nécessitent un accès temporaire à la zone de confinement doivent suivre une formation et/ou être accompagnés par un membre du personnel autorisé selon les activités qu'ils prévoient mener dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les personnes nécessitant un accès temporaire à la zone de confinement reçoivent une formation sur des éléments spécifiques du manuel de biosécurité (c.-à-d. fondée sur une évaluation des besoins en matière de formation pour leurs activités spécifiques) et/ou sont accompagnées par des membres du personnel autorisés pendant leurs activités dans la zone de confinement de façon à prévenir les incidents (p. ex. une exposition, un rejet). Une formation de base sur la biosécurité permet aux personnes d'être informées des dangers qui se trouvent à l'intérieur de la zone de confinement (c.-à-d. ce qu'ils doivent savoir pour travailler en toute sécurité) et de comprendre les procédures de biosécurité (p. ex. l'EPI exigé pour entrer). La supervision directe des personnes nécessitant un accès temporaire à la zone de confinement favorise la bonne application des techniques apprises (p. ex. le lavage des mains, le retrait sécuritaire de l'EPI à la sortie) et réduit les risques qu'un événement de biosûreté se produise. | ||||||
| 4.2.4 | Les membres du personnel doivent pouvoir démontrer leurs connaissances des éléments pertinents du manuel de biosécurité et appliquer correctement les procédures sur lesquelles ils ont suivi une formation avant d'effectuer des activités non supervisées avec des matières réglementées et des animaux réglementés. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait que les membres du personnel connaissent les PON qui sont utilisées dans la zone de confinement et leur bonne application permet de réduire la possibilité d'exposition ou de rejet lorsque des matières réglementées ou des animaux réglementés sont manipulés. La supervision directe des stagiaires par des membres du personnel autorisés, jusqu'à ce que ceux-ci puissent faire preuve de leur compétence, renforce l'utilisation des bonnes procédures pendant les activités de travail ou lors d'une intervention en réponse à un accident ou à un incident de biosécurité ou de biosûreté. Selon une évaluation des besoins en matière de formation, la démonstration des compétences peut être limitée à certaines tâches qui seront effectuées par les membres du personnel; il pourrait ne pas être nécessaire d'évaluer les compétences relatives à toutes les procédures pour lesquelles une formation est disponible. | ||||||
|
||||||
4.3 Équipement de protection individuel
L'EPI comprend l'équipement et les vêtements de protection conçus pour réduire au minimum le risque d'exposition à des matières réglementées. Le choix de l'EPI est déterminé par une ELR et est propre à la zone de confinement et aux activités de travail à effectuer. Les considérations comprennent également le degré de protection requis et la convenance de l'équipement pour la situation (p. ex. la dextérité, l'ajustement).
| Matrice 4.3 | Équipement de protection individuel | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Le choix de l'EPI doit être déterminé par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'utilisation ou le port d'EPI dédié, d'EPI propre à l'activité, ou d'une couche additionnelle d'EPI protège les personnes contre une exposition et empêche le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. La sélection d'un EPI approprié pour une tâche, un espace de travail ou une zone de confinement donnée est déterminée par une ELR. Des exemples d'EPI utilisés pour le travail avec des matières réglementées comprennent les sarraus, les tabliers, les manchettes jetables, les blouses ne s'ouvrant pas à l'avant, les combinaisons, les ensembles de protection lorsqu'une protection corporelle complète est nécessaire (p. ex. à l'intérieur de la barrière de confinement de zones GA), une protection des yeux ou du visage (p. ex. des lunettes de sécurité, un écran facial) lorsqu'il y a un risque d'exposition à des éclaboussures ou à des objets projetés, et les chaussures dédiées (p. ex. des bottes, des chaussures) ou les chaussures de protection supplémentaires (p. ex. des couvre-chaussures, des surchaussures) lorsque les planchers peuvent être contaminés (p. ex. dans les box, les salles de nécropsie). Dans certains cas, une couche d'EPI supplémentaire peut être justifiée selon une ELR (p. ex. le port d'un tablier par-dessus un sarrau, le port d'une deuxième paire de gants dans le cadre de tâches particulières). | ||||||
| 4.3.2 | Des gants doivent être portés lors de la manipulation de matières réglementées ou d'animaux réglementés, tel que déterminé par une ELR. | ■ | ||||
| Le port de gants appropriés (p. ex. en latex, en nitrile, en vinyle) protège les membres du personnel contre toute exposition et empêche la propagation de la contamination en protégeant les mains de la contamination. Les ELR peuvent déterminer si le port de gants doit être obligatoire au NC2, selon les risques associés aux matières réglementées ou aux animaux réglementés et aux activités menées (p. ex. le risque de blessure lorsque des gants sont portés à proximité d'une flamme nue peut l'emporter sur les risques présentés par les matières réglementées). Les ELR peuvent également tenir compte de la compétence des membres du personnel quant aux procédures ainsi que le respect des procédures de lavage des mains afin de prévenir une exposition et la propagation de la contamination. Lorsque les tâches comprennent l'utilisation d'objets pointus ou tranchants, les ELR pourraient déterminer que des gants résistants aux perforations devraient être portés. | ||||||
| 4.3.3 | Des gants doivent être portés lors de la manipulation de matières réglementées ou d'animaux réglementés. | □ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des gants appropriés (p. ex. en latex, en nitrile, en vinyle) qui protègent les mains contre toute contamination sont toujours portés lorsque des matières réglementées et des animaux réglementés sont manipulés afin de protéger les membres du personnel contre toute exposition et de prévenir la propagation de la contamination. Lorsque les tâches comprennent l'utilisation d'objets pointus ou tranchants, ou des prions, les ELR pourraient déterminer que des gants résistants aux perforations devraient être portés. | ||||||
| 4.3.4 | Des appareils de protection respiratoire doivent être portés là où il existe un risque d'exposition à des aérosols infectieux pouvant être transmis par inhalation ou à des toxines aérosolisées, tel que déterminé par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le port d'un appareil de protection respiratoire ajusté et approprié protège les membres du personnel contre une exposition par inhalation lorsqu'une ELR détermine qu'il existe un risque d'agents pathogènes aéroportés, d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées qui ne sont pas contenus dans un dispositif de confinement primaire (p. ex. une ESB, une cage munie de filtres HEPA). Le type d'appareil de protection respiratoire (p. ex. un N95, un N100, un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé) doit convenir à son utilisation, selon une ELR. Lorsque des appareils de protection respiratoire sont portés, les règlements en matière de santé et de sécurité au travail exigent la mise en place d'un programme d'essais d'ajustement. | ||||||
| 4.3.5 | Des combinaisons à pression positive doivent être portées. [Non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC4 où les matières réglementées sont exclusivement manipulées dans une chaîne d'ESB de catégorie III.] |
■ | ||||
| Dans les zones de NC4 où les matières réglementées ne sont pas manipulées exclusivement dans une ESB de catégorie III, une combinaison à pression positive qui fonctionne correctement permet de protéger les membres du personnel contre une exposition en offrant une barrière de protection complète (c.-à-d. la combinaison procurant une couverture complète et la pression d'air dans l'éventualité d'une rupture de la combinaison) entre les membres du personnel et les matières réglementées, en plus de fournir de l'air propre qui peut être respiré. | ||||||
| 4.3.6 | L'entrée d'air des combinaisons à pression positive doit comprendre un filtre HEPA ou un filtre à haute efficacité lorsque les raccords d'approvisionnement en air respirable sont situés dans la zone de confinement. | ■ | ||||
| Des filtres HEPA ou des filtres à haute efficacité sont fournis sur l'entrée d'air des combinaisons à pression positive pour empêcher la contamination qui peut être présente sur les raccords situés à l'intérieur de la zone de confinement d'entrer dans la combinaison avec la circulation d'air. | ||||||
|
||||||
4.4 Entrée et sortie
Les pratiques opérationnelles d'entrée et de sortie sont essentielles au maintien de l'intégrité du confinement et doivent permettre l'accès à la zone de confinement aux personnes autorisées seulement (c.-à-d. les membres du personnel autorisés et les visiteurs autorisés). La conformité aux procédures opérationnelles permet de maintenir un courant d'air vers l'intérieur, le cas échéant, et de conserver l'EPI contaminé ou possiblement contaminé à l'intérieur de la zone de confinement ou de la barrière de confinement, ce qui empêche le rejet de matières réglementées qui pourraient se trouver sur des vêtements et de l'EPI contaminés.
| Matrice 4.4 | Entrée et sortie | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1 | Les portes et les autres ouvertures de la zone de confinement, des salles animalières, des box et des salles de nécropsie doivent être gardées fermées. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les portes et les autres ouvertures (p. ex. les fenêtres de réception des échantillons) sont gardées fermées pour préserver l'intégrité de la barrière de confinement, empêcher le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de salles hautement contaminées (p. ex. un box) ou dans l'éventualité d'un incident (p. ex. un déversement), et empêcher la fuite d'un animal. Le fait de garder les portes et les autres ouvertures fermées est également essentiel pour maintenir le courant d'air vers l'intérieur lorsque celui-ci est exigé. | ||||||
| 4.4.2 | L'accès à la zone de confinement, à la salle animalière, au box, à la salle de nécropsie, à la salle abritant un système de décontamination des effluents et aux espaces où des services de soutien à la zone de confinement sont situés est accordé seulement aux personnes autorisées. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait de limiter ou restreindre l'accès à la zone de confinement, à la salle animalière, au box, à la salle de nécropsie, à la salle abritant un système de décontamination des effluents et aux endroits où sont situés les services mécaniques et électriques qui soutiennent la zone de confinement (p. ex. les panneaux électriques, la cabine de machinerie, les aires de commande du système CVAC) aux personnes autorisées permet de protéger la sécurité des personnes qui entrent dans ces endroits et de garder les matières réglementées et les ressources en lieu sûr. L'autorisation d'accès offre un mécanisme permettant de vérifier que toutes les personnes qui entrent dans une zone de confinement (p. ex. les membres du personnel, les visiteurs, les membres du personnel d'entretien et de nettoyage) satisfont aux exigences relatives à l'accès, y compris le fait d'avoir réussi la formation exigée (c.-à-d. le niveau de formation approprié selon l'évaluation des besoins en matière de formation pour les tâches qu'elles effectuent) et, le cas échéant, l'obtention d'une habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT avant qu'on leur accorde un accès non supervisé à la zone de confinement, ou qu'elles soient supervisées jusqu'à ce qu'elles satisfassent aux exigences. Afin d'aider à prévenir des défaillances des systèmes, l'accès aux commandes d'opération peut être restreint aux personnes autorisées sur place et, le cas échéant, inclure des mesures de sûreté appropriées afin de prévenir l'accès à distance par des personnes non autorisées. | ||||||
| 4.4.3 | Un mécanisme de contrôle des clés doit être en place lorsque les systèmes de contrôle d'accès comprennent des serrures ou des lecteurs de cartes. | □ PS | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un mécanisme de contrôle des clés est essentiel lorsque les systèmes de contrôle d'accès comprennent des clés et des serrures, ou des cartes d'accès et des lecteurs de cartes, car celui-ci empêche l'utilisation et la reproduction non autorisées des clés et des cartes d'accès. Un mécanisme de contrôle des clés peut impliquer l'utilisation de clés ou de cartes d'accès qui ne peuvent pas être reproduites ou qui ne sont pas facilement accessibles sur le marché ou des procédures restreignant l'accès aux clés ou aux cartes d'accès pour empêcher leur reproduction. De telles procédures peuvent comprendre un registre de signatures, ou l'échange d'une clé ou d'une carte d'accès contre un effet personnel (p. ex. une carte d'identité, un appareil personnel) pour empêcher la sortie des clés ou des cartes d'accès de l'édifice, ou l'utilisation d'un système de suivi électronique qui prend note de quand une clé ou une carte d'accès a été remise et retournée, de la personne qui l'a remise et à qui. | ||||||
| 4.4.4 | Les portes des espaces abritant des services mécaniques et électriques de soutien à la zone de confinement doivent être verrouillées en tout temps. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le fait de garder les portes et les panneaux verrouillés empêche l'accès non autorisé aux services mécaniques et électriques qui soutiennent la zone de confinement (p. ex. les aires de commande du système CVAC, les robinets d'arrêt et les commandes pour l'approvisionnement en eau, la cabine de machinerie, les panneaux électriques). Cela permet d'assurer la sécurité des personnes qui se trouvent dans la zone de confinement, d'empêcher le rejet de matières réglementées (p. ex. en maintenant le courant d'air vers l'intérieur) et de garder les matières réglementées et les ressources connexes en lieu sûr (p. ex. le système de contrôle d'accès électronique). Cela permet également d'empêcher l'exposition involontaire à des dangers (p. ex. l'ouverture d'un conduit ou du boîtier d'un filtre HEPA). Si les services mécaniques ou électriques sont situés dans des endroits qui sont accessibles au public (p. ex. le panneau électrique ou le robinet d'arrêt pour l'eau se trouve dans un corridor public), un mécanisme est nécessaire pour garder les lieux sûrs (p. ex. les garder verrouillés). Si les commandes d'opération pour les services mécaniques ou électriques sont accessibles à distance, des mesures de sûreté supplémentaires pourraient être nécessaires afin de restreindre l'accès aux personnes autorisées. | ||||||
| 4.4.5 | Les portes des espaces abritant un système de décontamination des effluents doivent être verrouillées en tout temps. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer dans les salles abritant un système de décontamination des effluents lorsque les portes sont verrouillées en tout temps. Cela assure une protection contre l'exposition et le rejet volontaire ou involontaire d'effluents contaminés (p. ex. en causant une défaillance du système de décontamination des effluents). Si les commandes d'opération pour le système de décontamination des effluents sont accessibles à distance, des mesures de sûreté supplémentaires pourraient être nécessaires afin de restreindre l'accès aux personnes autorisées. | ||||||
| 4.4.6 | Des procédures doivent être en place pour prévenir la contamination du corridor « propre » là où les portes critiques donnent un accès direct entre le corridor « propre » et un box ou une salle de nécropsie. | ■ | ■ | ■ | ||
| Lorsque la porte d'un box ou d'une salle de nécropsie donne directement sur un corridor « propre » (c.-à-d. qu'il n'y a aucun sas), il y a un risque que le corridor devienne contaminé et que la contamination se propage aux espaces hors de la zone de confinement lors de l'ouverture de la porte. La mise en œuvre de procédures prévient la contamination du corridor « propre » et la propagation de la contamination hors de la zone de confinement. | ||||||
| 4.4.7 | Les membres du personnel doivent vérifier les dispositifs offrant une indication visuelle du courant d'air vers l'intérieur immédiatement avant d'entrer dans une zone où un courant d'air vers l'intérieur est exigé. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La confirmation visuelle de l'exactitude des mesures indiquées sur les dispositifs qui surveillent les paramètres de fonctionnement du système CVAC (p. ex. un manomètre de pression différentielle, un flotteur, des indicateurs visuels) avant d'entrer dans une zone où un courant d'air vers l'intérieur est exigé permet aux membres du personnel de confirmer que le courant d'air vers l'intérieur est maintenu et qu'il est sécuritaire d'entrer dans la zone de confinement. Dans l'éventualité d'une défaillance du système, cette procédure permet également de prévenir le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement découlant de l'ouverture de portes critiques par les membres du personnel. | ||||||
| 4.4.8 | Les vêtements et les effets personnels doivent être rangés dans un endroit différent de celui où sera rangé l'EPI dédié qui a été porté dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait d'entreposer les vêtements personnels (p. ex. les vêtements d'extérieur, les tenues de ville, les sous-vêtements), les effets personnels et l'EPI propre à l'écart de l'EPI dédié qui a été porté dans la zone de confinement (c.-à-d. qui est possiblement contaminé) empêche la contamination de ces articles. Cela protège les individus contre une exposition, en plus d'empêcher la propagation de la contamination à l'extérieur de la zone de confinement. Les vêtements personnels, les effets personnels et l'EPI propre peuvent être entreposés à l'extérieur de la zone de confinement ou à l'intérieur de la zone de confinement dans les vestiaires réservés à cet effet. Lorsque les vêtements personnels, les effets personnels, l'EPI propre et l'EPI utilisé sont entreposés à l'intérieur de la zone de confinement (p. ex. dans un espace de travail en laboratoire de NC2, selon une ELR) ou à l'intérieur du même sas, ils peuvent être physiquement ou spatialement séparés pour prévenir la contamination. Par exemple, l'installation de crochets ou de casiers sur des murs opposés, ou de chaque côté de l'entrée peut être appropriée si les PON permettent de maintenir la séparation (p. ex. un côté est réservé aux vêtements et aux effets personnels tandis que l'autre est réservé à l'EPI utilisé) et de prévenir la contamination croisée à la sortie. | ||||||
| 4.4.9 | Les effets personnels et les articles destinés à un usage personnel qui ne sont pas nécessaires au travail doivent être rangés dans des espaces distincts de ceux où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. | ■ | ||||
| Les effets personnels et autres articles destinés à un usage personnel (p. ex. les sacs à dos, les carnets, les sacs à main, les téléphones cellulaires) sont tenus à l'écart des zones où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées pour empêcher la contamination de ces objets, ce qui protège les individus contre l'exposition et empêche la propagation de la contamination à l'extérieur de la zone de confinement. Cette mesure permet aussi d'éviter que ces effets soient contaminés et qu'ils soient soumis à des procédures de décontamination avant d'être retirés du confinement. Au NC2, les effets peuvent être tenus séparés par de l'espace (p. ex. ils peuvent être entreposés dans un espace « propre ») ou une barrière physique (p. ex. sur une surface propre derrière un écran, dans un sac scellé dont la surface peut être décontaminée). La méthode appropriée sera fondée sur une ELR qui tient compte de la possibilité que la surface soit contaminée (p. ex. des déversements, des éclaboussures, des aérosols) et des matières réglementées qui sont manipulées. | ||||||
| 4.4.10 | Les effets personnels et les articles destinés à un usage personnel qui ne sont pas nécessaires au travail doivent être laissés à l'extérieur de la zone de confinement ou dans les vestiaires situés à l'extérieur de la barrière de confinement. | □ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les effets personnels et les autres articles destinés à un usage personnel (p. ex. les sacs à dos, les carnets, les sacs à main, les téléphones cellulaires) sont laissés à l'extérieur de la zone de confinement ou dans les vestiaires à l'extérieur de la barrière de confinement pour prévenir la contamination de ces objets, ce qui protège les personnes contre l'exposition et empêche la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. Cette mesure permet aussi d'éviter que les objets personnels soient soumis à des procédures de décontamination avant d'être retirés de la barrière de confinement. | ||||||
| 4.4.11 | Les lésions ouvertes, les coupures et les égratignures doivent être couvertes de manière à prévenir une exposition avant d'entrer dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une peau intacte offre une protection contre l'infection et l'intoxication. Toute rupture de l'intégrité de la peau (p. ex. une lésion, une coupure, une égratignure, une éraflure, une éruption cutanée) peut servir de porte d'entrée pour les agents pathogènes et les toxines et doit donc être protégée à l'aide d'un bandage ou de tout autre pansement ou couverture convenable avant d'entrer dans la zone de confinement. Les lésions, les coupures et les égratignures qui surviennent à l'intérieur de la zone de confinement constituent des incidents qui doivent être déclarés à l'autorité interne appropriée. | ||||||
| 4.4.12 | Les bijoux qui pourraient devenir contaminés ou qui pourraient compromettre l'EPI doivent être retirés ou couverts avant d'entrer dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les bijoux peuvent être contaminés ou nuire à la décontamination des matières réglementées qui sont logées entre les bijoux et la peau (p. ex. pendant le lavage des mains ou la douche). Les bijoux peuvent également endommager l'EPI (p. ex. les bagues et les montres peuvent déchirer les gants ou les combinaisons à pression positive). Le fait de retirer les bijoux et de les laisser à l'extérieur de la zone de confinement permet aussi d'éviter que les bijoux aient à être soumis à des procédures de décontamination (p. ex. un javellisant, un autoclave) avant leur retrait de la zone de confinement. Selon une ELR, certains bijoux (p. ex. un anneau à bande plate, des petites boucles d'oreille) peuvent être portés à l'intérieur de la zone de confinement si le risque est minime qu'ils endommagent l'EPI, qu'ils deviennent contaminés (p. ex. si ceux-ci sont couverts par l'EPI), ou s'ils sont peu susceptibles d'être exposés à des matières contaminées ou à des aérosols (p. ex. les bijoux se trouvent dans le nez ou la bouche). | ||||||
| 4.4.13 | Les membres du personnel doivent enfiler l'EPI dédié avant d'entrer dans la zone de confinement, conformément aux procédures d'entrée. | ■ | ■ | |||
| Le fait d'enfiler l'EPI dédié avant l'entrée dans la zone de confinement protège les personnes contre l'exposition à des matières réglementées en empêchant la contamination de la personne et des vêtements personnels, ce qui empêche à son tour la propagation de la contamination à l'extérieur de la zone de confinement. | ||||||
| 4.4.14 | Les membres du personnel doivent retirer leurs vêtements personnels et leurs chaussures et enfiler de l'EPI dédié avant de franchir la barrière de confinement. Là où les vêtements personnels et les chaussures peuvent être portés dans les zones de NC2-Ag ou de NC3, les vêtements personnels et les chaussures doivent être entièrement couverts par l'EPI. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Le fait de retirer les vêtements personnels et les chaussures pour enfiler de l'EPI dédié, y compris des chaussures dédiées, protège les personnes contre une exposition et empêche la contamination des vêtements personnels et des chaussures ainsi que la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. Dans les zones de NC2-Ag où sont manipulés des prions, de même qu'au NC3, une ELR peut déterminer qu'il est acceptable de porter des vêtements personnels (c.-à-d. une tenue de ville) sous un EPI procurant une couverture complète; cependant, les vêtements personnels et les chaussures pourraient devoir être retirés à l'intérieur de la zone de confinement et être décontaminés s'il y a un risque que ceux-ci puissent être contaminés. Le fait de retirer ou de couvrir les vêtements personnels qui peuvent traîner (p. ex. les cravates, les foulards, les cordons de capuchons) réduit le risque que ces articles deviennent contaminés. | ||||||
| 4.4.15 | Là où des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont manipulés, les membres du personnel doivent retirer leurs vêtements personnels et leurs chaussures et enfiler de l'EPI dédié avant de franchir la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le fait de retirer les vêtements personnels et les chaussures pour enfiler de l'EPI dédié, y compris des chaussures dédiées, protège les personnes contre une exposition et empêche la contamination des vêtements personnels et des chaussures ainsi que la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. | ||||||
| 4.4.16 | L'EPI propre à l'activité ou une couche supplémentaire d'EPI doit être enfilé avant de commencer l'activité dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des activités particulières réalisées avec des matières réglementées peuvent mener à des risques spécifiques. Les ELR déterminent quel EPI est exigé pour protéger les membres du personnel contre une exposition à des matières réglementées au moment de réaliser des activités particulières. Cet EPI peut être différent ou supplémentaire à l'EPI exigé pour entrer dans la zone de confinement. Par exemple, les activités comprenant un risque plus élevé (p. ex. la création d'aérosols infectieux, la possibilité d'éclaboussures, le travail avec des animaux) peuvent exiger l'utilisation d'un EPI supplémentaire (p. ex. un appareil de protection respiratoire, une blouse ne s'ouvrant pas à l'avant, un tablier), alors que les activités comprenant un risque moins élevé peuvent permettre une protection d'un niveau moindre. L'EPI porté au moment de procéder à l'entretien des appareils, de l'équipement ou des systèmes possiblement contaminés dépendra de l'équipement et du risque d'exposition (p. ex. l'entretien du panneau de commande d'une ESB, le remplacement d'un filtre HEPA, l'entretien de l'équipement décontaminé). | ||||||
| 4.4.17 | Les combinaisons à pression positive doivent être enfilées avant d'entrer dans la douche de décontamination chimique. [Non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC4 où les matières réglementées sont exclusivement manipulées dans une chaîne d'ESB de catégorie III.] |
■ | ||||
| Dans les zones de NC4 où des matières réglementées ne sont pas exclusivement manipulées dans une ESB de catégorie III, une combinaison à pression positive qui fonctionne correctement permet de protéger les membres du personnel contre une exposition à des matières réglementées et prévient la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. | ||||||
| 4.4.18 | L'EPI dédié et l'EPI propre à l'activité doit être retiré de manière à réduire au minimum la contamination de la peau, des cheveux et des vêtements personnels (le cas échéant) et entreposé ou jeté à l'intérieur de la zone de confinement ou de la barrière de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le retrait de l'EPI dédié et de l'EPI propre à l'activité dans un ordre particulier et de manière à prévenir la contamination de la peau, des cheveux et des vêtements personnels (comme il est décrit dans les PON) réduit la possibilité de créer des aérosols et que l'EPI contaminé entre en contact avec la peau, les cheveux, ou les vêtements personnels non protégés. Le fait de réduire ces risques protège les membres du personnel contre l'exposition. Une fois retiré, l'EPI est entreposé ou jeté à l'intérieur de la zone confinement (ou à l'intérieur de la barrière de confinement, le cas échéant). | ||||||
| 4.4.19 | Les membres du personnel doivent se laver les mains en quittant une zone de confinement, une barrière de confinement, une salle animalière, un box ou une salle de nécropsie. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Le lavage des mains est effectué conformément aux PON immédiatement avant de quitter la zone de confinement, la barrière de confinement, la salle animalière, le box ou la salle de nécropsie afin d'empêcher que les mains soient contaminées en sortant. Cela comprend le lavage de toutes les surfaces de la peau qui pourraient avoir été exposées à des matières réglementées (p. ex. les avant-bras qui ne sont pas couverts par de l'EPI). Selon la conception de l'installation, une ELR peut déterminer qu'il est sécuritaire de retirer les gants à l'intérieur d'une salle ou d'un endroit à l'intérieur de la zone de confinement et de se laver les mains à un lavabo situé à proximité de la sortie de la zone de confinement. De manière semblable, il peut être acceptable de permettre le lavage des mains à un poste de travail éloigné de la sortie. Si les lavabos ne sont pas facilement accessibles, une ELR peut déterminer que les mains peuvent être décontaminées à l'aide d'un désinfectant pour les mains (dont l'efficacité contre les matières réglementées utilisées est confirmée) et lavées à un lavabo qui est accessible à l'extérieur de la zone de confinement. | ||||||
| 4.4.20 | Les membres du personnel doivent se laver les mains à la barrière de confinement en quittant. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le lavage des mains est effectué conformément aux PON (après avoir retiré les gants) à la barrière de confinement, tout juste avant de quitter pour empêcher que les mains soient contaminées en sortant. Cela comprend le lavage de toutes les surfaces de la peau qui pourraient avoir été exposées (p. ex. les avant-bras qui ne sont pas couverts par de l'EPI). Lorsqu'une douche corporelle complète est exigée à la sortie, il peut s'agir d'une solution de rechange acceptable au lavage des mains. | ||||||
| 4.4.21 | L'EPI dédié ou l'EPI propre à l'activité doit être retiré en quittant la zone de confinement, la barrière de confinement, la salle animalière, le box ou la salle de nécropsie. [Non exigé pour les zones de NC4 dans lesquelles des combinaisons à pression positive sont portées.] |
P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le retrait de l'EPI dédié ou de l'EPI propre à l'activité (p. ex. les blouses chirurgicales, les bottes, les combinaisons, les sarraus, les tabliers, les blouses, les vêtements de protection couvrant toutes les parties du corps, les couvre-chaussures, l'équipement de protection pour la tête et le visage) lors de la sortie de la zone de confinement, la barrière de confinement, la salle animalière, le box ou la salle de nécropsie protège les personnes contre l'exposition en empêchant la propagation de la contamination à l'extérieur de ces espaces. En fonction de l'ELR, l'EPI porté à l'intérieur des box ou des salles de nécropsie peut être porté dans des corridors « sales » et être retiré à la sortie de la zone de confinement ou de la barrière de confinement lorsque des PON appuient cette mesure. | ||||||
| 4.4.22 | Les lunettes et les effets personnels nécessaires au travail doivent être décontaminés à la barrière de confinement avant de quitter, sauf s'ils sont protégés contre la contamination par de l'EPI. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Les lunettes correctives portées et les effets personnels nécessaires au travail amenés à l'intérieur de la barrière de confinement qui ne sont pas protégés par une couche supplémentaire d'EPI peuvent être contaminés. Lorsqu'il existe un risque de contamination pendant les activités régulières (p. ex. dans un box) ou en raison d'un incident, les PON peuvent comprendre la décontamination des lunettes correctives à la barrière de confinement pour empêcher la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. | ||||||
| 4.4.23 | Les membres du personnel doivent retirer tous leurs vêtements et prendre une douche lorsqu'ils franchissent la barrière de confinement pour quitter. [Dans les zones de NC3, exigé seulement là où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] | ■ | ■ | |||
| Le fait de retirer tous les vêtements portés à l'intérieur de la barrière de confinement, y compris les sous-vêtements, et de prendre une douche à la sortie prévient la propagation de la contamination à l'extérieur de la barrière de confinement et protège la communauté en empêchant le rejet de matières réglementées. | ||||||
| 4.4.24 | Les membres du personnel qui portent une combinaison à pression positive doivent procéder à une décontamination chimique lorsqu'ils quittent le box, la salle de nécropsie ou l'espace de travail en laboratoire. | ■ | ||||
| Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, les procédures de sortie des zones de NC4 comprennent une douche de décontamination chimique en portant la combinaison à pression positive. Une douche de décontamination chimique permet de retirer toute contamination possiblement présente sur les combinaisons à pression positive, ce qui protège les membres du personnel contre une exposition pendant leur retrait. | ||||||
| 4.4.25 | Les membres du personnel doivent retirer l'EPI dédié et tous leurs vêtements, puis prendre une douche lorsqu'ils franchissent la barrière de confinement en quittant. | ■ | ||||
| Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, la douche corporelle est une redondance essentielle afin de prévenir la propagation possible de contamination à l'extérieur de la barrière de confinement. Une douche est exigée pour toute personne qui sort par la barrière de confinement, située à l'entrée de la douche corporelle, même si elle n'est pas entrée dans un espace de travail (p. ex. un laboratoire) à l'intérieur de la zone de confinement. Lorsque des combinaisons à pression positive sont portées, cette douche corporelle prend place après la douche de décontamination chimique. | ||||||
|
||||||
4.5 Pratiques de travail
L'utilisation de pratiques de travail sécuritaires lors de la manipulation de matières réglementées aide à protéger les membres du personnel contre l'exposition à des matières réglementées et aide à prévenir leur rejet hors de la zone de confinement. Les éléments des bonnes pratiques microbiologiques constituent le fondement de toutes les pratiques de travail sécuritaires avec des matières biologiques. Dans les zones de confinement où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées, les pratiques de travail sécuritaires comprennent l'utilisation et l'entretien appropriés des systèmes de confinement, de l'équipement de biosécurité (p. ex. des ESB, des centrifugeuses), ainsi que les aspects d'entretien général de la zone de confinement (p. ex. la propreté, le fait de réduire au minimum le désordre).
| Matrice 4.5 | Pratiques de travail | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1 | Des procédures doivent être suivies pour prévenir l'exposition des membres du personnel à des matières réglementées et la propagation de contamination durant les tâches. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le respect des PON pour empêcher la propagation de la contamination à l'intérieur de la zone de confinement protège les membres du personnel contre une exposition et empêche le rejet de matières réglementées hors du confinement. Les PON comprennent celles sur les bonnes pratiques microbiologiques, la décontamination des surfaces et des articles qui peuvent être contaminés, et le retrait de l'EPI lorsqu'il est possiblement contaminé. | ||||||
| 4.5.2 | Des itinéraires pour circuler et travailler doivent être établis et respectés afin de prévenir la propagation de contamination. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'identification claire des espaces ou des surfaces d'un niveau de contamination inférieur (c.-à-d. « propres ») et des espaces d'un niveau de contamination supérieur (c.-à-d. « sales ») et la mise en œuvre de procédures pour faciliter les déplacements pendant le travail et la circulation des membres du personnel, de l'équipement, des échantillons et des animaux des espaces « propres » vers des espaces « sales » servent à limiter la propagation de la contamination. Cela peut comprendre la séparation des espaces « propres » réservés à la rédaction de rapports et autre paperasse des espaces ou des surfaces où sont manipulées des matières réglementées au moyen d'une cloison physique (p. ex. un écran antiéclaboussures, une salle distincte) ou en les plaçant à une distance sécuritaire afin de réduire au minimum le risque de contaminer les fournitures de bureau (p. ex., les documents, les carnets) et l'équipement (p. ex. les ordinateurs) qui ne peuvent pas être facilement décontaminés et qui pourraient mener à l'exposition des membres du personnel. Les procédures mises en œuvre pour faciliter les déplacements pendant le travail peuvent comprendre le fait de disposer tout le matériel propre (p. ex. les pipettes, les milieux de culture, les flacons) d'un côté du poste de travail, et les cultures et les déchets de l'autre. | ||||||
| 4.5.3 | La zone de confinement doit être propre en tout temps et la présence des éléments suivants doit être réduite au minimum :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un environnement de travail propre et dégagé, avec peu d'encombrement, permet la décontamination appropriée de la zone de confinement. Cela réduit également le risque de glisser, de trébucher ou de tomber, ainsi que les risques de collision, qui pourraient possiblement mener à des incidents d'exposition ou à la propagation de la contamination. L'entreposage du matériel supplémentaire à l'extérieur de la zone de confinement protège également celui-ci contre la contamination et le besoin de subir des procédures de décontamination. | ||||||
| 4.5.4 | Tout contact du visage ou des muqueuses avec des articles contaminés ou possiblement contaminés par des matières réglementées doit être évité. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des activités telles que pipetter avec la bouche, mâcher l'extrémité d'un crayon, manger, boire, se maquiller, insérer des écouteurs dans les oreilles, insérer ou retirer des lentilles cornéennes, et toute autre activité impliquant le contact possible entre un article quelconque à l'intérieur de la zone de confinement (y compris les mains) et les muqueuses des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche sont évitées afin de réduire le risque d'exposer les muqueuses à des articles qui sont contaminés ou possiblement contaminés par une matière réglementée. | ||||||
| 4.5.5 | Les cheveux qui pourraient être contaminés lors du travail dans la zone de confinement doivent être retenus ou recouverts. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait d'attacher ou de recouvrir les cheveux (y compris la barbe) réduit la possibilité que ceux-ci soient contaminés par un contact accidentel avec des mains gantées, des échantillons, des contenants, de l'équipement ou des surfaces, ainsi que durant les activités dans les pièces qui servent de confinement primaire, tel que déterminé par une ELR. | ||||||
| 4.5.6 | L'utilisation d'objets pointus ou tranchants et d'objets de verre doit être strictement limitée et évitée lorsque des solutions de rechange convenables peuvent être utilisées. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Certains objets pointus ou tranchants (p. ex. des ciseaux) ou des objets de verre (c.-à-d. qui peuvent se briser) peuvent causer une perforation ou une blessure, et possiblement mener à l'inoculation d'un membre du personnel avec une matière réglementée. Le fait de limiter leur utilisation dans la zone de confinement et d'encourager l'utilisation de solutions de rechange convenables (p. ex. des ciseaux de plastique, des matières plastiques) réduit le risque de blessure et d'exposition. | ||||||
| 4.5.7 | L'utilisation d'aiguilles et de seringues doit être strictement limitée. Les actions de plier et de couper des aiguilles, de les retirer des seringues ou de remettre le capuchon sur celles-ci doivent être évitées; si elles sont nécessaires, elles doivent être effectuées conformément aux PON. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les aiguilles et les seringues peuvent causer une perforation ou une blessure, et possiblement mener à l'injection ou à l'inoculation d'un membre du personnel avec une matière réglementée. Le fait de limiter leur utilisation dans la zone de confinement et d'encourager l'utilisation de solutions de rechange convenables (p. ex. des aiguilles de conception sécuritaire, des matières plastiques) réduit le risque de blessure et d'exposition. Les activités comme plier ou couper les aiguilles, les retirer des seringues ou remettre le capuchon sur celles-ci comportent un risque de blessure encore plus élevé et doivent être complètement évitées. Lorsque cela n'est pas possible, le respect rigoureux des PON (p. ex. se servir de forceps pour plier l'aiguille ou remettre le capuchon) protégera les membres du personnel contre les blessures et l'exposition. | ||||||
| 4.5.8 | La vérification des assemblages de petits filtres de conduite associés avec des pompes à vide doit être effectuée à une fréquence basée sur leur utilisation. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une procédure pour la vérification régulière des assemblages de petits filtres de conduite associés avec des pompes à vide est élaborée et suivie afin de confirmer que les filtres fonctionnent toujours comme prévu pour empêcher un bris de confinement. La vérification des assemblages de petits filtres de conduite peut comprendre une confirmation visuelle de leur intégrité et l'absence de contamination visible. | ||||||
| 4.5.9 | La fréquence de la vérification des dispositifs de confinement primaire doit être fondée sur leur utilisation. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lorsqu'ils fonctionnent comme prévu et qu'ils sont utilisés correctement, les dispositifs de confinement primaire confinent tous les aérosols produits à l'intérieur de ceux-ci. À ce titre, une vérification régulière des dispositifs de confinement primaire, conformément aux PON, prévient l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières réglementées hors du confinement découlant d'une défaillance de l'équipement. La vérification des ESB peut comprendre le fait de regarder les jauges du courant d'air pour confirmer que le ventilateur fonctionne, ou de tenir un mouchoir au châssis afin de confirmer que l'air est attiré vers l'intérieur de l'ESB. La vérification est effectuée dans des conditions de fonctionnement normales, avec tout l'équipement ou les appareils (y compris les flammes nues, les mélangeurs, les pompes à vide et les microcentrifugeuses) qui seront utilisés dans l'ESB en place et en fonction. Cela permet de confirmer que ceux-ci n'interrompent pas le rideau d'air essentiel pour le confinement. La vérification comprend également la confirmation de l'intégrité des anneaux d'étanchéité sur les godets de sécurité et les rotors scellés de la centrifugeuse. Les joints toriques et les joints d'étanchéité qui semblent asséchés peuvent être graissés et ceux qui sont fissurés ou endommagés peuvent être remplacés. | ||||||
| 4.5.10 | Le fonctionnement des systèmes de confinement et de sécurité des personnes doit être vérifié quotidiennement. | ■ | ||||
| La vérification quotidienne des systèmes de confinement et de sécurité des personnes, comme le courant d'air vers l'intérieur, l'approvisionnement en air respirable, les systèmes de décontamination des effluents et le niveau de désinfectant dans la douche de décontamination chimique, est essentielle afin de maintenir le confinement, empêcher un rejet et protéger les membres du personnel qui travaillent dans la zone de confinement. | ||||||
| 4.5.11 | L'intégrité des combinaisons à pression positive doit être vérifiée à une fréquence déterminée par une ELR. | ■ | ||||
| La vérification régulière de l'intégrité des combinaisons à pression positive confirme qu'elles fonctionnent comme prévu (c.-à-d. qu'elles empêchent l'exposition des membres du personnel et peuvent fournir de l'air propre qui peut être respiré). La fréquence de la vérification est déterminée par les spécifications du fabricant et une ELR. Selon la condition de la combinaison (p. ex. une combinaison neuve ou utilisée), une ELR peut déterminer qu'une vérification visuelle est suffisante avant chaque utilisation, ou qu'un essai de décroissement de pression doit être effectué avant chaque utilisation ou à chaque semaine (p. ex. selon la fréquence d'utilisation). Les essais d'intégrité peuvent également être concentrés sur certaines sections de la combinaison qui représentent un risque de fuite plus élevé (p. ex. les fermetures éclair, les poignets et les chevilles). | ||||||
| 4.5.12 | Les membres du personnel doivent retirer l'EPI propre à l'activité de manière à réduire au minimum la contamination de la peau, des cheveux et des vêtements personnels (le cas échéant) lorsqu'ils ont terminé leurs activités de travail et lorsque l'EPI est possiblement contaminé. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Après avoir terminé les tâches exigeant un EPI particulier, ou à la suite d'un incident pouvant avoir entraîné la contamination de l'EPI, le retrait de l'EPI conformément aux PON protège les personnes contre l'exposition à des matières réglementées, et empêche la propagation de la contamination à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement. | ||||||
| 4.5.13 | Les contenants primaires renfermant des matières réglementées doivent être ouverts uniquement au niveau de confinement attribué à la matière et aux activités en question par l'ASPC et l'ACIA. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'ouverture des contenants primaires renfermant des matières réglementées uniquement dans les zones de confinement qui répondent aux exigences minimales pour le niveau de confinement qui a été attribué aux matières réglementées et aux activités prévient une exposition des membres du personnel et un rejet hors du confinement. Seuls les agents pathogènes rendus non infectieux et les toxines inactivées (c.-à-d. qui ont été soumis à un processus validé) peuvent être manipulés dans d'autres espaces. | ||||||
| 4.5.14 | Les contenants primaires de matières réglementées retirés de la zone de confinement doivent être entreposés dans des contenants secondaires étiquetés, étanches, résistants aux chocs et conservés dans un équipement d'entreposage verrouillé ou dans un espace auquel l'accès est limité. | ■ | ■ | |||
| L'entreposage sécuritaire et sûr des matières réglementées est essentiel pour empêcher l'accès non autorisé et leur rejet hors du confinement. Des précautions supplémentaires (p. ex. l'entreposage dans un équipement verrouillé) sont nécessaires pour entreposer les matières réglementées en lieu sûr à l'extérieur de la zone de confinement. Cela peut comprendre, par exemple, l'entreposage des échantillons dans un congélateur verrouillé ou dans une salle gardée verrouillée. | ||||||
| 4.5.15 | Les contenants primaires de matières réglementées retirés de la zone de confinement doivent être entreposés dans des contenants secondaires étiquetés, étanches, résistants aux chocs et conservés dans un équipement d'entreposage verrouillé et dans un espace auquel l'accès est limité. | P | P | ■ | ■ | |
| L'entreposage sécuritaire et sûr des matières réglementées est essentiel pour empêcher l'accès non autorisé et leur rejet hors du confinement. Des précautions supplémentaires (p. ex. l'entreposage dans un équipement verrouillé à l'intérieur d'un endroit où l'accès est limité) sont nécessaires pour entreposer les matières réglementées en lieu sûr à l'extérieur de la zone de confinement. Cela peut comprendre, par exemple, l'entreposage des échantillons dans un congélateur verrouillé qui est situé dans une salle qui est gardée verrouillée. | ||||||
| 4.5.16 | Les contenants primaires d'ABCSE qui sont retirés de la zone ABCSE doivent être entreposés dans un contenant secondaire étiqueté, étanche, résistant aux chocs et conservé dans un équipement d'entreposage verrouillé qui ne peut pas être déplacé. | S | S | ■ | ■ | |
| L'entreposage sécuritaire et sûr des matières réglementées est essentiel pour empêcher l'accès non autorisé et leur rejet volontaire hors du confinement. Compte tenu de la possibilité de double usage qu'ils présentent, les ABCSE exigent des mesures de sûreté plus strictes, notamment lorsqu'ils sont entreposés à l'extérieur de la zone de confinement. Les méthodes appropriées pour restreindre l'accès et garder les ABCSE en lieu sûr à l'extérieur de la zone ABCSE peuvent comprendre leur entreposage dans un équipement verrouillé à l'aide d'un cadenas de haute sûreté, d'un cadenas à combinaison ou d'autres moyens, combinés à des charnières qui ne sont pas faciles à enlever. Dans de tels cas, l'équipement d'entreposage des ABCSE doit être non mobile, soit en raison de sa taille (p. ex. trop lourd ou trop grand pour être déplacé facilement) ou parce qu'il est fixé sur place (p. ex. boulonné au mur ou au plancher). En général, les cadenas qui sont intégrés aux réfrigérateurs et aux congélateurs n'assurent pas un niveau de sûreté suffisant, à moins d'avoir été conçus à cette fin. | ||||||
| 4.5.17 | Les matières réglementées de GR4 doivent être entreposées à l'intérieur de la zone de confinement. | ■ | ||||
| L'entreposage sécuritaire et sûr des matières réglementées est essentiel pour prévenir l'accès non autorisé et leur rejet hors du confinement. Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR4, leur entreposage exige des mesures strictes de confinement et de sûreté (p. ex. un accès restreint) qui peuvent uniquement être satisfaites à l'intérieur de la zone de NC4. Par conséquent, ils ne peuvent jamais être entreposés à l'extérieur de la zone de NC4. | ||||||
| 4.5.18 | Les matières réglementées doivent être inactivées avec une méthode validée et vérifiée régulièrement avant leur retrait de la zone de confinement pour leur utilisation à un niveau de confinement inférieur. | ■ | ■ | ■ | ||
| L'inactivation au moyen d'une méthode validée rend les matières non infectieuses et non toxiques, ce qui est essentiel avant leur transfert vers un niveau de confinement inférieur. Des exemples de méthodes d'inactivation comprennent la fixation des tissus, l'extraction des acides nucléiques ou des protéines et la lyse des échantillons avant un immunoessai ou un test d'antigènes, si l'efficacité de la méthode a été validée contre les matières réglementées utilisées. La méthode d'inactivation est vérifiée à une fréquence déterminée par une ELR. | ||||||
| 4.5.19 | Des procédures doivent être mises en œuvre pour l'entreposage et le déplacement de matières réglementées pour qu'elles ne soient pas échappées et pour prévenir une fuite, un déversement, ou un incident semblable. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les procédures pour empêcher les fuites, les déversements ou que des matières soient échappées, ou pour contenir les matières réglementées lorsque ces événements surviennent, protègent les membres du personnel contre les incidents d'exposition et empêchent un rejet de matières réglementées. Ceci comprend les procédures pour l'entreposage des matières (y compris les déchets) et le déplacement des matières à l'intérieur d'une zone de confinement ou entre les zones de confinement à l'intérieur d'un édifice. Les procédures sont fondées sur des ELR qui prennent en considération le type de matières déplacées ou entreposées, les risques associés aux matières (p. ex. des volumes importants de matières, qu'elles soient contenues dans un seul ou plusieurs récipients, peuvent impliquer plus de risques) et les endroits dans l'édifice où les incidents (p. ex. des collisions, des accrochages) sont plus susceptibles de se produire. | ||||||
| 4.5.20 | Une ESB ou d'autres dispositifs de confinement primaire doivent être utilisés pour les activités comportant des récipients ouverts, en fonction des risques associés :
[Non exigé pour l'inoculation d'animaux réglementés hébergés dans des box ou pour le prélèvement d'échantillons chez ces animaux.] |
■ | ■ | |||
| Les ESB et les autres dispositifs de confinement primaire (p. ex. les enceintes personnalisées) assurent un confinement primaire efficace afin de protéger les membres du personnel contre l'exposition à des aérosols infectieux et des toxines aérosolisées, et empêcher leur rejet. La nécessité d'utiliser un dispositif de confinement primaire au NC2 et dans les zones de NC2-Ag est fondée sur des ELR qui prennent en considération les activités réalisées (p. ex. la probabilité de produire un aérosol infectieux), les quantités de matières manipulées (c.-à-d. des volumes importants ou de fortes concentrations), les antécédents d'infections ou intoxications contractées en laboratoire avec l'agent pathogène ou la toxine et les caractéristiques inhérentes à la matière réglementée manipulée. Les considérations comprennent la gravité de la maladie causée par la matière réglementée manipulée et la possibilité de transmission aéroportée d'un agent pathogène dans le contexte des activités en laboratoire qui peut différer de son mode de transmission normal. Le matériel hautement volatile (p. ex. des toxines sous forme de poudre, des spores fongiques) peut nécessiter d'être manipulé dans l'air immobile afin de prévenir la propagation de la contamination. | ||||||
| 4.5.21 | Toutes les activités comportant la manipulation de récipients ouverts qui contiennent des matières réglementées doivent être menées dans une ESB ou dans tout autre dispositif de confinement primaire. [Non exigé pour l'inoculation d'animaux réglementés hébergés dans des box ou pour le prélèvement d'échantillons chez ces animaux.] |
■ | ■ | ■ | ||
| Les ESB et les autres dispositifs de confinement primaire assurent un confinement primaire efficace afin de protéger les membres du personnel contre l'exposition à des aérosols infectieux, et empêcher leur rejet. Compte tenu des risques associés aux matières réglementées de GR3 et de GR4, une ESB ou un autre dispositif de confinement primaire est utilisé pour l'ensemble des activités comportant des récipients ouverts contenant ces matières réglementées. | ||||||
| 4.5.22 | Les ESB et les autres dispositifs de confinement primaire doivent être situés et utilisés de manière à réduire au minimum les perturbations du courant d'air des dispositifs. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le rideau d'air protège les membres du personnel contre l'exposition et empêche le rejet de matières réglementées. Il peut facilement être perturbé par des courants d'air créés par la circulation, l'ouverture et la fermeture des portes (p. ex. un incubateur ou un réfrigérateur à proximité), les autres ESB à proximité et les évents du système CVAC. Pour maintenir le rideau d'air, les ESB et les dispositifs de confinement primaire sont situés dans un espace où ils sont protégés contre les courants d'air. Lorsque l'emplacement de l'ESB ou du dispositif de confinement primaire n'est pas idéal, une mesure de rechange (p. ex. poser des déflecteurs sur les diffuseurs d'air, dessiner une ligne sur le plancher pour maintenir la circulation à une distance raisonnable) peut être efficace. Un essai à l'aide d'une poire à fumée peut être effectué afin de vérifier que les activités menées près des ESB et des autres dispositifs de confinement primaire (p. ex. une porte qui s'ouvre, la circulation des personnes) ne perturbent pas le courant d'air. | ||||||
| 4.5.23 | La centrifugation de matières réglementées qui sont principalement infectieuses ou transmises par inhalation doit être effectuée dans des godets de sécurité ou des rotors scellés qui sont déchargés à l'aide d'un mécanisme qui prévient leur rejet. | ■ | ■ | |||
| Étant donné que la centrifugation peut produire des aérosols, certains mécanismes (p. ex. des PON, de l'équipement, des dispositifs) sont exigés pour protéger les personnes contre l'exposition et empêcher la propagation de la contamination. Lors de la centrifugation de matières réglementées principalement infectieuses ou transmises par inhalation, des dispositifs comme des godets de sécurité et des rotors scellés qui sont déchargés dans une ESB peuvent contenir tous les aérosols possiblement produits. La mise en œuvre de PON pour l'utilisation de godets de sécurité et de rotors scellés avec des matières réglementées est fondée sur les caractéristiques inhérentes à la matière réglementée. Les considérations comprennent la gravité de la maladie causée par la matière réglementée manipulée et la possibilité de transmission aéroportée d'un agent pathogène dans le contexte des activités en laboratoire qui peut différer de son mode de transmission normal. Selon une ELR, des PON qui prévoient un délai suffisant pour permettre aux aérosols de se déposer avant d'ouvrir les godets de sécurité et les rotors scellés à l'extérieur d'une ESB peuvent également être acceptables. | ||||||
| 4.5.24 | La centrifugation de matières réglementées doit être effectuée dans des godets de sécurité ou des rotors scellés qui sont déchargés dans une ESB ou un autre dispositif de confinement primaire à l'aide d'un mécanisme qui prévient leur rejet. | P | P | ■ | ■ | ■ |
| Les godets de sécurité et les rotors scellés utilisés pour la centrifugation empêchent le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées pouvant être créés pendant la centrifugation. Pour protéger les personnes contre l'exposition à toute matière aérosolisée et empêcher la propagation de la contamination, les godets de sécurité et les rotors scellés sont aussi déchargés dans une ESB ou un autre dispositif de confinement primaire à l'aide de mécanismes particuliers (p. ex. des PON, de l'équipement, des dispositifs). | ||||||
| 4.5.25 | La production à grande échelle et le traitement de matières réglementées doivent être effectués dans un équipement de procédé, un système fermé ou dans tout autre dispositif de confinement primaire. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ||
| Les cultures à grande échelle de matières réglementées (p. ex. pour la production à grande échelle) sont gardées dans des systèmes fermés ou d'autres dispositifs de confinement primaire (p. ex. des fermenteurs, des bioréacteurs, des récipients de traitement) qui assurent un confinement primaire efficace et protègent les membres du personnel et l'environnement contre les matières réglementées. Cet équipement est conçu pour résister à des volumes importants, à des pressions et des températures internes variables et à d'autres types de stress sur les soupapes ou les autres ouvertures contrôlées. | ||||||
| 4.5.26 | Le prélèvement d'échantillons, l'ajout de matières ou le déplacement de liquides au cours des activités à grande échelle doit s'effectuer de manière à empêcher le rejet de matières réglementées. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ||
| Selon une ELR, des PON sont élaborées pour la collecte d'échantillons, l'ajout de matières et le transfert de liquides de culture au cours des activités à grande échelle pour empêcher l'exposition des membres du personnel aux matières réglementées (p. ex. dans les liquides, les aérosols) et le rejet de celles-ci, ainsi que la contamination des surfaces exposées. De telles procédures peuvent décrire de façon détaillée comment travailler à partir des points d'échantillonnage appropriés et les dispositifs exigés pour assurer un transfert sécuritaire. | ||||||
| 4.5.27 | Un mécanisme doit être mis en œuvre pour prévenir, détecter et intervenir en cas de problème de contrôle des insectes et des animaux nuisibles. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'entrée et la sortie des insectes et des animaux nuisibles peuvent entraîner le transfert et la propagation involontaires de matières réglementées à l'extérieur de la zone de confinement. Un mécanisme (p. ex. une PON, un dispositif) pour détecter la présence d'insectes et d'animaux nuisibles permet une intervention rapide afin d'empêcher leur entrée et leur sortie de la zone de confinement. Lorsque les insectes et les animaux nuisibles peuvent constituer un problème, des mesures de contrôle de base pour les insectes et les animaux nuisibles comprennent des moustiquaires en bon état qui sont bien installés dans les fenêtres, des pièges à des endroits stratégiques et des plinthes brosses aux bas des portes. | ||||||
| 4.5.28 | Un mécanisme doit être mis en œuvre pour maintenir la garde d'eau dans les siphons de drainage. | ■ | ■ | ■ | ||
| L'entretien des gardes d'eau dans les siphons de drainage des lavabos, des douches et des siphons de sol s'effectue par leur utilisation normale ou leur remplissage régulier qui permet d'empêcher le passage d'air possiblement contaminé. Les gardes d'eau font partie de la barrière de confinement là où un courant d'air vers l'intérieur est maintenu. Lorsque le niveau d'eau est insuffisant, une défaillance du système CVAC pourrait entraîner le passage d'air contaminé dans le drain (p. ex. le passage d'air contaminé provenant d'une salle de nécropsie de NC3 vers un laboratoire de NC2). Les mécanismes pour s'assurer que le niveau d'eau est suffisant peuvent être automatiques (p. ex. un amorceur de garde d'eau) ou effectués conformément aux PON (p. ex. de l'eau ajoutée manuellement). Lorsque des drains ne sont pas nécessaires, d'autres mécanismes comme l'installation de bouchons peuvent constituer une solution de rechange convenable. | ||||||
|
||||||
4.6 Considérations pour le travail avec les animaux
En raison du caractère imprévisible des animaux, en particulier lorsqu'ils sont malades, le travail in vivo (c.-à-d. impliquant des animaux vivants) avec des matières réglementées augmente les risques associés à n'importe quelle procédure. Des techniques de manipulation et des considérations particulières en ce qui a trait au travail avec des animaux permettent de prévenir la transmission de maladie dans la communauté résultant de l'exposition d'un membre du personnel ou d'un rejet de matières réglementées. Les animaux peuvent être infectés de manière naturelle ou expérimentale par des agents pathogènes zoonotiques, et peuvent également être des porteurs asymptomatiques d'agents pathogènes humains.
| Matrice 4.6 | Considérations pour le travail avec les animaux | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.1 | L'observation des animaux par les fenêtres sur la barrière de confinement ne doit pas être possible pour les personnes non autorisées. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Le fait que des personnes non autorisées puissent regarder à l'intérieur d'un espace de travail avec des animaux (c.-à-d. une salle animalière, un box, une salle de nécropsie) présente un risque de biosûreté. Un emplacement adéquat des fenêtres ou l'utilisation de mécanismes qui obstruent la vue à travers les fenêtres (p. ex. des pellicules anti-regard, des miroirs sans tain, des rideaux) peuvent permettre d'empêcher les personnes non autorisées de regarder à l'intérieur des zones de confinement. |
||||||
| 4.6.2 | Des procédures doivent être utilisées pour réduire au minimum les risques de blessure pour les membres du personnel, y compris les griffures, les morsures, les ruades, les lésions par écrasement et l'auto-inoculation accidentelle. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
En raison du comportement imprévisible des animaux et de la variation des risques propres à chaque espèce, l'utilisation de techniques de contention et de manipulation appropriées aux espèces ou à l'animal (c.-à-d. en fonction d'une ELR) permet de garder les membres du personnel et les animaux en sécurité, surtout lorsque l'animal est malade ou qu'il a été exposé à une matière réglementée. |
||||||
| 4.6.3 | Les animaux réglementés doivent être manipulés au niveau de confinement attribué à la matière réglementée ou aux activités in vivo par l'ASPC et l'ACIA. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
La manipulation des animaux réglementés au niveau de confinement auquel les matières réglementées ou les activités in vivo ont été attribuées protège les membres du personnel contre les incidents d'exposition et prévient un rejet. |
||||||
| 4.6.4 | Les animaux réglementés dans des zones PA doivent être gardés en tout temps à l'intérieur d'un dispositif de confinement primaire. |
□ | ■ | ■ | ||
Tous les animaux réglementés dans une zone PA sont gardés à l'intérieur d'un dispositif de confinement primaire en tout temps, y compris lorsqu'ils sont transférés d'une cage à une ESB et pendant l'hébergement, l'élevage, l'inoculation, la collecte des échantillons, les chirurgies, les nécropsies et toutes les autres procédures, afin de protéger les membres du personnel contre une exposition et empêcher le rejet de matières réglementées. Le confinement primaire dans une zone PA peut être assuré par une ESB, une cage ou un système de cages de confinement primaire ou un poste ventilé pour le changement des cages. |
||||||
| 4.6.5 | Les inoculations, les interventions chirurgicales et les nécropsies réalisées sur des animaux dans des zones PA doivent être effectuées dans une ESB ou dans un autre dispositif de confinement primaire approprié. |
□ | ■ | ■ | ||
Le fait d'effectuer les procédures d'inoculation, de chirurgie et de nécropsie sur de petits animaux dans une ESB ou dans un autre dispositif de confinement primaire approprié, tel qu'un poste de chirurgie pour animal ventilé, ou un poste ventilé par aspiration descendante ou par l'arrière, assure un confinement primaire efficace et protège les membres du personnel et l'environnement contre les aérosols infectieux et les toxines aérosolisées. |
||||||
| 4.6.6 | Les animaux réglementés doivent être maintenus dans une cage de confinement primaire ou un autre dispositif de confinement primaire approprié durant le déplacement vers, ou les activités à, un niveau de confinement inférieur. |
□ | ■ | ■ | ■ | |
Le fait de manipuler les animaux réglementés au niveau de confinement auquel les matières réglementées ou les activités in vivo ont été attribuées protège les membres du personnel contre les incidents d'exposition et prévient un rejet. Lorsque les activités doivent être effectuées à un niveau de confinement inférieur, le fait de maintenir les animaux réglementés dans une cage de confinement primaire ou dans un autre dispositif de confinement primaire approprié en tout temps prévient l'exposition à des matières réglementées ou le rejet de celles-ci. Le déplacement d'un animal vers une installation d'imagerie à un niveau de confinement inférieur et le fait d'effectuer des techniques d'imagerie sur un animal sont des exemples de telles activités. |
||||||
| 4.6.7 | Des étiquettes identifiant la matière réglementée utilisée doivent être apposées sur les cages de confinement primaire ou les box où sont hébergés des animaux réglementés. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Le fait d'identifier les matières réglementées auxquelles un animal a été exposé sur l'étiquette de la cage de confinement primaire ou du box où il est hébergé est essentiel pour que les membres du personnel soient informés des risques associés à l'animal et pour contenir correctement la matière réglementée concernée pendant les procédures impliquant l'animal. Cette identification s'avère particulièrement importante dans les zones PA où plus d'une matière réglementée peut avoir été utilisée. |
||||||
| 4.6.8 | Les procédures avec des animaux qui comportent des matières réglementées doivent être conçues et effectuées de manière à réduire au minimum la production d'aérosols et prévenir la dissémination de poussières et d'autres particules à partir des cages, des déchets et des animaux réglementés. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Certaines procédures utilisées pour exposer des animaux à des matières réglementées (p. ex. l'inoculation) ou comportant des animaux qui ont été exposés à des matières réglementées (p. ex. les techniques de collecte d'échantillons, de chirurgie et de nécropsie) pourraient possiblement produire des aérosols. Les procédures qui servent à prévenir la production d'aérosols et la dissémination de poussières et d'autres particules qui contiennent des matières réglementées protègent les membres du personnel contre une exposition et empêchent la propagation de la contamination. Par exemple, il peut être préférable d'utiliser un jet d'eau diffusé à basse pression ou une autre méthode similaire pendant les procédures de nettoyage initiales pour les box ou les salles de nécropsie plutôt qu'un nettoyeur haute pression qui est plus susceptible de produire des aérosols contenant des matières réglementées. Les procédures peuvent également comprendre d'éviter les techniques d'inoculation, de chirurgie et de nécropsie qui pourraient possiblement produire des aérosols ou de mettre en œuvre des procédures pour atténuer les risques associés à ces techniques (p. ex. l'utilisation d'un poste ventilé par aspiration descendante ou par aspiration à l'arrière). |
||||||
| 4.6.9 | Des procédures d'entrée et de sortie du personnel doivent être mises en œuvre pour prévenir le rejet de matières réglementées aérosolisées ou aéroportées hors des box et des salles de nécropsie. |
■ | ■ | ■ | ||
Dans les cas où les procédures comportent des agents pathogènes aéroportés ou peuvent entraîner la production de matières réglementées aérosolisées (p. ex. une inoculation, une chirurgie, une nécropsie), des procédures appropriées relatives à l'entrée et à la sortie du box ou de la salle de nécropsie protègent les personnes contre une exposition et empêchent la propagation de la contamination à l'extérieur du box ou de la salle de nécropsie. Des exemples de telles procédures comprennent la prévention de l'ouverture simultanée des portes adjacentes ou séquentielles (p. ex. les portes du sas) menant à un box ou à une salle de nécropsie, et le fait d'accorder un délai suffisant pour permettre aux aérosols de se déposer avant d'ouvrir la porte pour entrer ou sortir. |
||||||
| 4.6.10 | Les animaux doivent être déplacés dans, à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement de manière à prévenir leur fuite. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Le déplacement des animaux vivants dans, à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement est effectué de manière sécuritaire et sûre (p. ex. en utilisant des techniques de contention) afin d'empêcher la fuite des animaux et la propagation de la contamination à l'intérieur (p. ex. dans un corridor « propre ») ou à l'extérieur de la zone de confinement. De telles procédures peuvent comprendre l'utilisation d'une cage de confinement primaire munie de filtres dans une zone PA, ou l'utilisation de barrières et d'appareils de contention dans une zone GA. |
||||||
| 4.6.11 | Les carcasses d'animaux doivent être retirées de manière à empêcher la propagation de la contamination. |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Le retrait des carcasses animales de manière à empêcher la propagation de la contamination aide à prévenir l'exposition à des matières réglementées ou le rejet de celles-ci. Le fait d'emballer les carcasses animales dans des contenants étiquetés, étanches et résistants aux chocs dont la surface a été décontaminée en est un exemple. Les carcasses de gros animaux peuvent également être divisées en plus petites parties avant l'emballage afin d'en faciliter le déplacement. |
||||||
|
||||||
4.7 Décontamination et gestion des déchets
La décontamination efficace des déchets est essentielle dans toutes les zones de confinement. Une défaillance du processus de décontamination pourrait entraîner l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières contaminées. Les principes de désinfection, d'inactivation et de stérilisation pour traiter les matières, les surfaces et les espaces contaminés sont essentiels pour réduire le risque d'exposition à des matières réglementées dans les zones de confinement, ou leur rejet hors du confinement.
| Matrice 4.7 | Décontamination et gestion des déchets | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.1 | La contamination évidente doit être retirée des surfaces et de l'équipement avant leur décontamination. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les matières organiques (p. ex. les fèces, le sang, la litière, la nourriture) peuvent inactiver ou limiter l'efficacité de certaines méthodes de décontamination de surface (p. ex. les désinfectants chimiques, les rayons ultraviolets). L'élimination de la contamination évidente sur les surfaces, l'équipement et les autres articles permet de les décontaminer de manière efficace. Ceci est particulièrement important dans les zones GA où le risque de contamination est élevé (p. ex. les box, les salles de nécropsie, le corridor « sale »). Une fois retirée, la contamination évidente est décontaminée au moyen d'une méthode appropriée (p. ex. stérilisée à l'autoclave, incinérée) avant d'être éliminée. | ||||||
| 4.7.2 | Les surfaces qui pourraient devenir contaminées doivent être nettoyées et décontaminées à une fréquence déterminée par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait de retirer la contamination évidente, de nettoyer avec de l'eau et du savon et de décontaminer les surfaces (p. ex. les surfaces de travail, les planchers, les murs) à l'aide de désinfectants ou de produits chimiques neutralisants efficaces contre les matières réglementées utilisées réduit les risques d'exposition lorsque ces actions sont effectuées à une fréquence appropriée en fonction d'une ELR. Une ELR peut déterminer que certaines surfaces nécessitent une décontamination plus fréquente en fonction de certaines activités effectuées (c.-à-d. le risque de contamination). Par exemple, dans les zones GA, le fait de décontaminer les box, les salles de nécropsie et le corridor « sale » lorsqu'ils sont contaminés de manière évidente et à la fin de chaque expérience empêche la propagation de la contamination, ce qui protège les membres du personnel contre une exposition. Des PON peuvent être élaborées afin d'établir la fréquence de décontamination de surfaces spécifiques. | ||||||
| 4.7.3 | Des désinfectants et des produits chimiques neutralisants efficaces contre les matières réglementées manipulées ou entreposées doivent être accessibles et utilisés dans la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Le fait d'avoir des désinfectants et des produits chimiques neutralisants disponibles dans la zone de confinement permet de décontaminer les surfaces (p. ex. les paillasses, les contenants) et de réagir rapidement aux déversements biologiques. Les produits chimiques neutralisants utilisés pour une toxine particulière peuvent s'avérer inefficaces contre d'autres. De même, un désinfectant qui est efficace contre un agent pathogène peut s'avérer inefficace contre d'autres. De plus, d'autres facteurs qui peuvent influer sur leur efficacité comprennent le type d'agent pathogène à décontaminer (p. ex. un virus, une bactérie, un prion), son état (p. ex. sous une forme végétative, une spore), la charge organique (c.-à-d. la quantité de matière organique comme la terre, la litière, la nourriture ou le fumier présent sur une surface ou dans une suspension), la matière qui doit être décontaminée et la durée de conservation du désinfectant. Ainsi, il est de bonne pratique d'indiquer la date d'expiration ou la date de préparation des désinfectants sur une étiquette. | ||||||
| 4.7.4 | Les objets pointus ou tranchants doivent être jetés dans des contenants étanches, résistants aux perforations et munis de couvercles, ou dans des contenants conçus pour l'élimination des déchets pointus ou tranchants. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les contenants à déchets pour les objets pointus ou tranchants qui sont étanches, résistants aux perforations et munis de couvercles empêchent les objets pointus ou tranchants de perforer le contenant, ce qui pourrait causer une fuite ou une blessure d'un membre du personnel de la zone de confinement ou des personnes qui manipulent les déchets, entraînant ainsi une exposition. Si les déchets pointus ou tranchants doivent être stérilisés à l'autoclave, les contenants doivent être résistants aux températures auxquelles ils seront exposés. | ||||||
| 4.7.5 | Les filtres HEPA et les filtres à haute efficacité doivent être :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La décontamination des filtres HEPA et des filtres à haute efficacité par fumigation in situ au moyen d'un produit chimique efficace (p. ex. du formaldéhyde, du peroxyde d'hydrogène vaporisé) permet de décontaminer les filtres avant leur retrait (p. ex. du boîtier, de l'ESB). Lorsqu'un filtre HEPA ou un filtre à haute efficacité est installé à la barrière de confinement ou à proximité de celle-ci (c.-à-d. à l'approvisionnement en air, au diffuseur d'évacuation), la décontamination complète de la salle peut également décontaminer efficacement le filtre. Des exemples de solutions de rechange convenables à la décontamination in situ comprennent l'utilisation de filtres HEPA et de filtres à haute efficacité munis de caissons de filtration de type « bag-in/bag-out » ou l'utilisation de procédures permettant de contenir les filtres pendant leur retrait et leur décontamination ultérieure. Dans les zones de confinement où sont manipulés des prions, un tel mécanisme de rechange est exigé pour le retrait sécuritaire des filtres HEPA et des filtres à haute efficacité, puisque les prions ne sont pas complètement inactivés lors de l'utilisation des méthodes de décontamination les plus courantes (p. ex. la fumigation). | ||||||
| 4.7.6 | Les liquides contaminés doivent être décontaminés avant leur rejet dans les égouts sanitaires. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La décontamination des liquides contaminés (p. ex. les liquides de culture produits dans un espace de travail en laboratoire de NC2, l'eau provenant d'une douche corporelle de NC3, les liquides provenant d'une production à grande échelle) au moyen d'une méthode validée et vérifiée régulièrement avant leur déversement dans les égouts sanitaires empêche le rejet de matières réglementées. Il est de bonne pratique de décontaminer les liquides possiblement contaminés qui quittent la zone de confinement avant leur rejet dans les égouts sanitaires puisque les liquides manipulés à l'intérieur de la zone de confinement sont à risque de devenir contaminés au cours des procédures expérimentales. | ||||||
| 4.7.7 | Les matières réglementées, les articles contaminés et les déchets doivent être :
|
■ | ■ | |||
| La décontamination des matières réglementées et des articles contaminés tels que de l'EPI contaminé, des déchets (p. ex. de la litière contaminée), des vêtements contaminés (p. ex. des vêtements de protection, des vêtements personnels à la suite d'un incident), de l'équipement et d'autres matériels avant leur élimination ou leur retrait de la zone de confinement, ou avant la mise à l'essai ou la réparation de l'équipement, est importante afin d'empêcher le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. Si des matières contaminées sont retirées de la zone de confinement à l'intérieur d'un contenant secondaire fermé et étiqueté pour une décontamination ultérieure à un emplacement se trouvant à l'extérieur de la zone de confinement, la surface du contenant doit être décontaminée afin de protéger la sécurité des personnes qui manipulent, nettoient et éliminent ces matières. Une ELR visant à déterminer le besoin de décontaminer les surfaces dans un espace de travail en laboratoire de NC2 peut tenir compte de la probabilité que la surface soit contaminée. Un sac à autoclave à l'intérieur d'un contenant solide résistant aux impacts qui est étiqueté et gardé fermé est un exemple d'un contenant secondaire étanche pour les déchets. | ||||||
| 4.7.8 | Les matières réglementées, ainsi que tous les articles et les déchets doivent être décontaminés à la barrière de confinement avant leur retrait de la zone de confinement, de la salle animalière, du box ou de la salle de nécropsie. | ■ | ■ | ■ | ||
| La décontamination des matières réglementées et des articles tels que de l'EPI, des vêtements de protection, de l'équipement, du matériel et des déchets (p. ex. de la litière contaminée) à la barrière de confinement empêche le rejet des matières réglementées hors des zones de niveau de confinement élevé (p. ex. les salles animalières, les box, les salles de nécropsie). La décontamination de l'EPI avant l'élimination ou le blanchissage (c.-à-d. avant d'être retirés de la zone de confinement) protège les personnes qui manipulent l'EPI (p. ex. les membres du personnel du service de blanchisserie) à l'extérieur de la zone de confinement. Lorsque des procédures de blanchissage sont utilisées comme méthode de décontamination, leur efficacité contre les matières réglementées utilisées doit être validée et vérifiée régulièrement. | ||||||
| 4.7.9 | Les contenants primaires de matières réglementées qui sont retirés d'une zone de confinement pour être acheminés à une autre zone de confinement ou entreposés à l'extérieur de la zone de confinement doivent être placés dans des contenants secondaires fermés, étiquetés et étanches, dont la surface a été décontaminée avant leur retrait de la zone de confinement. [L'entreposage des matières réglementées de GR4 à l'extérieur d'une zone de NC4 est interdit.] |
■ | ■ | ■ | ||
| Le fait de bien emballer, étiqueter et décontaminer les surfaces des contenants secondaires de matières réglementées permet de les maintenir en confinement et d'empêcher les expositions et le rejet de matières réglementées (c.-à-d. sur la surface de l'emballage) à l'extérieur de la zone de confinement. Le choix du contenant secondaire est déterminé par des ELR qui prennent en considération le type de matière à déplacer ou entreposer et les risques associés avec cette dernière (p. ex. d'importants volumes de matières). | ||||||
| 4.7.10 | La performance des systèmes de décontamination doit être vérifiée régulièrement à une fréquence déterminée par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La vérification des systèmes de décontamination (p. ex. la vérification de la performance de l'équipement en utilisant des indicateurs biologiques, des indicateurs chimiques ou des dispositifs de surveillance paramétriques) est effectuée régulièrement afin de confirmer que les matières soumises aux procédures de décontamination sont décontaminées efficacement. Une ELR aide à déterminer les procédures relatives à la surveillance régulière (p. ex. la fréquence, les éléments à vérifier) qui seront intégrées dans les PON selon le système de décontamination, l'équipement utilisé et la fréquence d'utilisation de l'équipement (p. ex. utilisé mensuellement plutôt que quotidiennement). Des exemples de vérification comprennent la confirmation de la durée pendant laquelle un cycle de l'autoclave demeure à la température et à la pression requises pour la décontamination et la surveillance régulière du niveau de produits chimiques dans les réservoirs d'approvisionnement pour les méthodes de décontamination chimique (p. ex. les douches de décontamination chimique) afin de confirmer que les quantités sont suffisantes pour qu'une décontamination efficace puisse avoir lieu. | ||||||
| 4.7.11 | Les portes d'un même système passe-plats ne doivent pas être ouvertes simultanément. | ■ | ■ | ■ | ||
| L'ouverture simultanée des deux portes d'un autoclave à deux portes qui traverse la barrière de confinement ou d'un autre système passe-plats perturbe le courant d'air vers l'intérieur, ce qui peut entraîner un bris de confinement. Le fait de disposer de mécanismes afin d'assurer qu'au moins une porte demeure fermée en tout temps (p. ex. l'interverrouillage des portes de l'autoclave appuyé par des procédures opérationnelles) permet de maintenir le confinement et empêche le rejet de matières réglementées. | ||||||
| 4.7.12 | La litière contaminée doit être :
|
■ | ■ | ■ | ||
| La litière des animaux exposés à une matière réglementée est considérée comme étant contaminée, à moins que l'absence d'excrétion ait été confirmée. Pour empêcher la propagation et le rejet de matières réglementées, la litière peut être décontaminée tandis qu'elle est toujours à l'intérieur de la cage de confinement fermée ou après avoir été retirée de la cage à l'intérieur d'un dispositif de confinement primaire (p. ex. une ESB) ou d'un poste ventilé pour le changement des cages afin de protéger les personnes contre une exposition. | ||||||
| 4.7.13 | Des procédures pour la décontamination complète d'une salle doivent être élaborées, mises en œuvre et suivies, selon une ELR. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lorsque la décontamination complète d'une salle pourrait être exigée (p. ex. conformément aux procédures régulières, à la suite d'un incident, à la mise hors service, pour l'introduction ou le retrait d'équipement de grande taille), des procédures sont élaborées pour la décontamination efficace de toutes les matières réglementées manipulées, ainsi que pour tous les scénarios où une telle décontamination pourrait être exigée. Les scénarios possibles comprennent une décontamination après un déversement ou la production d'aérosols qui peuvent avoir contaminé la salle, à la fin d'un projet, ou pour faciliter l'entretien préventif régulier et les essais de vérification et de performance. La décontamination gazeuse, la brume sèche et la décontamination des surfaces au moyen d'un désinfectant sont des exemples de procédures de décontamination complète d'une salle. Selon une ELR, la décontamination complète d'une salle suivant un incident dans les zones de NC2 peut être atteinte en décontaminant toutes les surfaces possiblement contaminées. | ||||||
| 4.7.14 | La décontamination complète de la salle doit être vérifiée lors de chaque utilisation. | ■ | ■ | ■ | ||
| Plusieurs facteurs peuvent avoir une influence sur l'efficacité d'un processus de décontamination pour de grands espaces, y compris des fluctuations de température, d'humidité relative et la variation entre les lots de désinfectants. La vérification de la décontamination complète de la salle lors de chaque utilisation confirme que le processus a été efficace. | ||||||
|
||||||
4.8 Intervention d'urgence
Des plans qui sont élaborés et mis en œuvre en cas de problème de biosécurité et de biosûreté survenant à la suite d'une situation d'urgence permettent d'intervenir rapidement de manière efficace et appropriée. Les situations d'urgence comprennent toute situation qui pourrait entraîner l'exposition du personnel à des matières réglementées, le rejet de celles-ci hors de la zone de confinement ou une brèche de biosûreté. Les protocoles relatifs à la déclaration d'un incident et aux enquêtes sur les incidents font partie intégrante du PIU, puisqu'un incident peut être révélateur de lacunes dans les systèmes de biosécurité ou de biosûreté qui doivent être reconnues et corrigées.
| Matrice 4.8 | Intervention d'urgence | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.1 | Un PIU, fondé sur une évaluation globale des risques et sur des ELR, doit être élaboré, documenté, mis en œuvre, révisé et tenu à jour. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un PIU complet permet aux membres du personnel de réagir rapidement à des situations d'urgence. Il énonce les procédures que les membres du personnel doivent suivre pour intervenir dans diverses situations d'urgence afin de protéger leur santé et leur sécurité, empêcher le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement et continuer à garder en lieu sûr les matières réglementées et les ressources connexes (p. ex. les renseignements sensibles) qui sont entreposées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement. Le PIU est révisé et mis à jour à une fréquence déterminée par l'organisation (p. ex. au cours d'un examen de routine du programme de biosécurité, suivant des changements au programme de biosécurité). | ||||||
| 4.8.2 | Une relation doit être établie avec les premiers répondants ou les établissements de soins de santé locaux, tel que déterminé par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ||
| Le fait d'établir un lien avec les premiers répondants, l'hôpital local ou les établissements de soins de santé locaux permet de s'assurer que les personnes qui peuvent intervenir en réponse à un incident ou interagir avec des membres du personnel exposés sont conscientes de quelles matières réglementées sont manipulées et entreposées. Le fait de disposer de connaissances préalables sur les matières réglementées auxquelles les personnes peuvent être exposées aide les premiers répondants et les professionnels de la santé à élaborer des procédures appropriées afin d'empêcher les expositions secondaires (p. ex. en portant l'EPI approprié pendant l'intervention, en procédant à la mise en quarantaine des membres du personnel exposés) et d'avoir le matériel nécessaire (p. ex. des fournitures médicales spéciales) disponible pour traiter rapidement les personnes à la suite d'un incident. | ||||||
| 4.8.3 | Une carte de contact en cas d'urgence médicale doit être remise aux membres du personnel de la zone de confinement manipulant des primates non humains ou des matières réglementées qui causent des maladies qui ne sont pas répandues au Canada, tel que déterminé par une ELR. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les cartes de contact en cas d'urgence médicale peuvent comprendre les coordonnées des superviseurs de l'installation et un résumé des renseignements importants concernant les matières réglementées, tels que les voies de transmission, les symptômes et les traitements préventifs et thérapeutiques. Des cartes de contact en cas d'urgence médicale peuvent être remises aux membres du personnel qui manipulent des matières réglementées qui causent des maladies qui ne sont pas répandues au Canada, qui sont peu susceptibles d'être reconnues par le personnel de soins de santé ou difficiles à diagnostiquer, ou qui exigent des traitements atypiques (p. ex. une antitoxine rare, une souche de bactérie multirésistante aux médicaments qui ne répond qu'à un seul traitement). Elles sont également remises aux membres du personnel qui manipulent des primates non humains, lesquels sont souvent des porteurs asymptomatiques du Macacine alphaherpesvirus 1 (aussi appelé Macacine herpesvirus 1 ou Herpès virus B). | ||||||
| 4.8.4 | Le PIU doit décrire les procédures d'urgence qui s'appliquent aux incidents survenant à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement qui peuvent entraîner l'exposition des membres du personnel aux matières réglementées, ou le rejet de celles-ci hors de la zone de confinement. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un PIU complet énonce les procédures que les membres du personnel doivent suivre pour intervenir dans toutes les situations d'urgence et tous les incidents prévisibles (p. ex. des incidents durant des procédures régulières, le déplacement ou l'entreposage). Les incidents pouvant être abordés dans un PIU comprennent toute situation pouvant entraîner l'exposition des membres du personnel ou le rejet de matières réglementées hors du confinement, ainsi que tout accident ou incident, toute urgence médicale, toute évacuation d'urgence, tout déversement biologique, toute panne de courant, toute fuite d'un animal, toute défaillance du dispositif de confinement primaire, tout retour d'air d'une ESB de catégorie II, type B2 (le cas échéant), et toute perte de confinement. Le plan comprend toutes les procédures supplémentaires (p. ex. la recherche des contacts) nécessaires pour réduire au minimum la propagation de la contamination et atténuer les risques d'exposition. Le fait d'avoir un mécanisme pour identifier les personnes présentes durant un incident ou durant la réponse à un incident peut aider à appuyer le processus d'enquête sur un incident. Lorsqu'un incident résulte en un besoin de quitter la zone de confinement ou pour des premiers répondants d'entrer dans l'espace où l'incident s'est produit, il est important que ce mécanisme n'affecte pas les procédures d'entrée et de sortie. Selon l'ELR et le type d'incident, le mécanisme pourrait être une feuille de renseignements (p. ex. les noms, les numéros de téléphone) à un emplacement qui se trouve à une distance sécuritaire de l'endroit où l'incident a eu lieu. | ||||||
| 4.8.5 | Le PIU doit comprendre des procédures pour :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L'adoption de procédures servant à informer rapidement le personnel interne approprié et les autorités réglementaires pertinentes (le cas échéant) des situations d'urgence ou des incidents, à entreprendre une enquête sur un incident et à mettre en œuvre des mesures correctives et préventives permet d'indiquer aux membres du personnel les étapes à suivre et les personnes à aviser en cas d'incident. | ||||||
| 4.8.6 | Le PIU doit comprendre des procédures pour répondre aux dommages causés à une combinaison à pression positive, à la perte d'air respirable et à la défaillance de la douche de décontamination chimique. | ■ | ||||
| Les procédures d'intervention pour les situations d'urgence qui pourraient possiblement mener à un bris de confinement ou une perte d'air respirable à l'intérieur d'une zone de NC4 sont élaborées et décrites dans le PIU afin de protéger les personnes contre une exposition à des matières réglementées. Le fait d'élaborer des procédures d'intervention qui portent sur la défaillance de la douche de décontamination chimique empêche la propagation de la contamination et le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. | ||||||
| 4.8.7 | Le PIU doit comprendre des procédures d'évacuation d'urgence pour les scénarios où il est nécessaire de se doucher avant de sortir de la zone de confinement ou lorsque cette étape est évitée. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les procédures d'intervention pour les situations d'urgence qui exigent que les membres du personnel prennent une douche au moment de sortir de la barrière de confinement (p. ex. un membre du personnel qui s'est fait éclabousser par un agent pathogène à la suite d'un déversement) sont élaborées et décrites dans le PIU afin de prévenir la propagation de la contamination et le rejet de matières réglementées hors de la zone de confinement. Des procédures doivent également être élaborées pour les situations d'urgence où il est possible d'éviter la douche avant la sortie, tel que déterminé par une ELR. | ||||||
| 4.8.8 | L'EPI approprié et le matériel nécessaire pour intervenir en cas de déversement biologique doit être disponible. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une trousse d'intervention en cas de déversement biologique (c.-à-d. l'EPI et le matériel nécessaire pour intervenir en cas de déversement biologique) permet une intervention rapide afin de contenir, de décontaminer et de nettoyer un déversement comportant des matières réglementées. Cela permet d'empêcher l'exposition des membres du personnel, la propagation de la contamination et le rejet de matières réglementées. Le matériel peut être assemblé dans un seul contenant (p. ex. dans une trousse). Il est également acceptable d'avoir tout le matériel (p. ex. du javellisant, des serviettes de papier ou un autre produit absorbant, des pinces, des sacs à déchets, un porte-poussière, un seau) facilement accessible. Le type de matériel se trouvant dans une trousse d'intervention en cas de déversement biologique variera en fonction des matières réglementées (p. ex. un produit chimique de décontamination efficace) et des risques identifiés par une ELR (p. ex. les volumes plus importants peuvent exiger de plus grandes quantités ou du matériel spécialisé, tel que des barrages absorbants). | ||||||
| 4.8.9 | Les incidents de biosécurité et de biosûreté doivent être déclarés immédiatement à l'autorité interne appropriée. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La déclaration immédiate d'incidents de biosécurité et de biosûreté (p. ex. les incidents impliquant des matières réglementées, des animaux, une défaillance des systèmes de confinement ou de commande, des agents pathogènes manquants, un accès non autorisé à des renseignements sensibles) aux autorités internes appropriées selon les PON permet une intervention rapide et appropriée afin de réduire au minimum le risque pour les membres du personnel (p. ex. en fournissant une assistance médicale ou des premiers soins) et les conséquences découlant d'un incident de biosûreté. La déclaration immédiate permet d'entamer rapidement des procédures pour contenir tout rejet possible de matières réglementées, d'effectuer toute réparation ou mesure corrective aux systèmes de confinement, de mettre en lieu sûr les ressources à possibilité de double usage et, le cas échéant, d'aviser les organismes de réglementation appropriés. | ||||||
| 4.8.10 | Des enquêtes sur les incidents de biosécurité et de biosûreté doivent être réalisées et documentées afin d'en déterminer les causes fondamentales et les mesures pour atténuer les risques futurs. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une enquête sur un incident permet d'identifier les causes fondamentales (c.-à-d. les raisons pour lesquelles l'incident a eu lieu) de l'incident de biosécurité ou de biosûreté qui implique des matières réglementées ou des animaux dans la zone de confinement, ou la défaillance des systèmes de confinement ou de commande. L'enquête peut aussi permettre de déterminer si l'incident était un cas isolé et si des mesures supplémentaires visant à atténuer les risques ou empêcher qu'un tel événement se reproduise peuvent être mises en œuvre. Les incidents comprennent les accidents et les accidents évités de justesse (c.-à-d. lorsqu'il était possible qu'un événement cause des dommages ou des préjudices, mais qu'il ne s'est rien produit). Le fait d'avoir un mécanisme pour identifier les personnes présentes durant un incident ou la réponse à un incident peut également appuyer le processus d'enquête sur un incident. En effet, ces personnes pourraient être en mesure de fournir des renseignements importants qui pourraient aider à déterminer les causes fondamentales de l'incident. Les personnes qui pourraient être présentes durant un incident ou une réponse à un incident comprennent les membres du personnel de l'installation (p. ex. les membres du personnel de la zone de confinement, de la sécurité ou de premiers soins), les visiteurs, les employés de la maintenance, les premiers répondants et toute autre personne qui pourrait être entrée dans la zone de confinement durant l'incident ou la réponse à l'incident. L'identification des premiers répondants peut être faite en établissant un lien avec l'unité locale (p. ex. la police, les pompiers, les ambulanciers). | ||||||
| 4.8.11 | L'ASPC doit être informée immédiatement par la soumission d'un rapport de notification de :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La soumission immédiate d'un rapport de notification (c.-à-d. dès qu'il est raisonnablement possible de le faire), même lorsque peu de détails sont disponibles, permet à l'ASPC d'aider le titulaire du permis à intervenir, si une telle aide est demandée ou nécessaire, et permet aussi à l'ASPC d'entamer une intervention de santé publique si elle est exigée. Les principaux renseignements qui sont soumis comprennent une description (si celle-ci est connue) de l'incident (p. ex. une exposition, une possession involontaire, du matériel manquant, un accès non autorisé à des renseignements sensibles), le lieu et l'heure de l'incident, le nom de l'agent pathogène ou de la toxine, la quantité et la concentration, et tout autre renseignement à l'appui connu au moment de la soumission. Dans le cas d'un incident pour lequel un rapport formel pourrait ne pas être nécessaire (c.-à-d. un accident évité de justesse), l'incident devrait tout de même faire l'objet d'une enquête et être documenté. Bien que les agents pathogènes dans leur environnement naturel (p. ex. les échantillons de diagnostic) et les organismes du GR1 soient exclus de la LAPHT (à moins qu'un agent pathogène humain ou une toxine ait été cultivé, ou recueilli ou extrait intentionnellement), il est recommandé que tout incident dans une installation titulaire ou non d'un permis avec de tels échantillons (lorsque l'identité de l'agent pathogène est connue) soit déclaré volontairement à l'ASPC. | ||||||
| 4.8.12 | Un rapport de suivi de l'exposition faisant état de l'enquête effectuée doit être soumis à l'ASPC :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La soumission à l'ASPC d'un rapport de suivi de l'exposition sert de mise à jour sur l'incident d'exposition (ou la maladie reconnue) et permet d'identifier, de surveiller et d'analyser les tendances relatives à l'exposition (ou à la maladie) au fil du temps. Les nouveaux renseignements dans le rapport de suivi de l'exposition peuvent comprendre l'état de l'enquête en cours sur un incident, l'analyse des causes fondamentales, les stratégies d'atténuation des risques mises en œuvre pour empêcher une récurrence et les résultats (s'ils sont connus). | ||||||
| 4.8.13 | Là où des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont manipulés ou entreposés, ou conformément aux conditions du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres, l'ACIA doit être informée sans délai des incidents impliquant :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La déclaration des incidents qui peuvent avoir entraîné l'exposition des membres du personnel à un agent pathogène non indigène d'animaux terrestres, le rejet d'une telle matière réglementée hors du confinement, la défaillance des systèmes de confinement ou de commande, ou la fuite d'un animal permet à l'ACIA d'évaluer la gravité de l'incident et d'aider l'installation à atténuer le risque de préjudice pour la population animale. | ||||||
|
||||||
4.9 Registres et documents
Les registres sont des documents qui reflètent les activités d'un programme de biosécurité (p. ex. la formation, l'accès, la décontamination, les essais de vérification et de performance) et constituent des preuves que les exigences sont satisfaites (p. ex. une activité a été réalisée, un résultat a été atteint, une amélioration a été mise en œuvre).
| Matrice 4.9 | Registres et documents | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.1 | Les registres et les documents doivent être conservés pour un minimum de :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La conservation des registres relatifs aux activités liées aux permis et aux exigences des permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres (p. ex. les transferts, les importations, les exportations) pour une durée minimale permet de documenter toutes les matières réglementées qui sont ou qui ont été manipulées ou entreposées à l'intérieur de la zone de confinement. Ces registres peuvent être examinés par l'ASPC ou l'ACIA, si nécessaire. Les registres sont conservés pour une durée minimale de cinq ans pour rencontrer l'exigence de conservation des documents sous le paragraphe 29(1) du RAPHT et pour une durée minimale de deux ans comme condition du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres sous l'alinéa 91.3(a) du RSA. Les registres relatifs aux essais de vérification et de performance sont conservés pour une durée minimale de cinq ans ou jusqu'à ce que les tests soient répétés (c.-à-d. si les tests sont effectués à des intervalles plus longs que cinq ans) pour s'assurer que les documents pertinents demeurent disponibles. | ||||||
| 4.9.2 | Un registre des incidents de biosécurité et de biosûreté doit être conservé pendant au moins dix ans. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les registres sur les incidents de biosécurité et de biosûreté impliquant des matières réglementées, des animaux réglementés, des brèches de sûreté, ou des défauts de bioconfinement ou des atteintes à son intégrité (c.-à-d. des défauts opérationnels qui auraient pu entraîner une exposition ou un rejet) fournissent des renseignements détaillés concernant l'incident et peuvent servir à prouver qu'une enquête a été menée, que les causes fondamentales ont été déterminées et que des mesures correctives ont été mises en œuvre lorsque nécessaire. Les registres des incidents permettent de surveiller les tendances qui peuvent servir à améliorer les systèmes ou les procédures. Ils constituent de précieuses références pour les enquêtes futures et peuvent également servir d'outils d'apprentissage. | ||||||
| 4.9.3 | L'accès aux registres et aux documents relatifs aux activités effectuées avec des matières réglementées doit être accordé seulement aux personnes autorisées. | S | S | ■ | ■ | ■ |
| Le fait de permettre un accès à des renseignements sensibles aux personnes autorisées seulement permet que les renseignements sensibles, les matières réglementées et les ressources connexes demeurent en lieu sûr. Les renseignements sensibles comprennent les inventaires, les emplacements d'entreposage des matières réglementées (p. ex. le numéro de la pièce ou de l'étage, un plan de l'étage), les listes des membres du personnel autorisés, les méthodes de contrôle d'accès, les codes d'accès et les mots de passe. Selon une évaluation des risques de biosûreté, des renseignements supplémentaires qui pourraient être traités comme des renseignements sensibles comprennent des protocoles et des résultats expérimentaux (p. ex. des méthodes ou des séquences génétiques à possibilité de double usage), des renseignements relatifs à la recherche à gain de fonction, les registres des membres du personnel et les registres d'accès. Les personnes autorisées peuvent comprendre les membres du personnel autorisés, la direction, ou toute autre personne nécessitant d'avoir accès aux registres et aux documents dans le cadre de ses fonctions (c.-à-d. ayant le besoin de savoir), tel que déterminé par une autorité interne (p. ex. le directeur de la zone de confinement, l'ASB, une autre personne à laquelle cette responsabilité a été confiée). Les personnes autorisées sont formées de manière adéquate sur les pratiques de gestion de l'information (p. ex. ont une connaissance des politiques internes) et, lorsque l'information est liée à des ABCSE, ont une habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT. | ||||||
| 4.9.4 | Toutes les activités de formation sur la biosécurité et la biosûreté doivent être documentées; des registres doivent être conservés. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les registres de formation servent à documenter les formations et le perfectionnement qui ont été suivis avec succès par les membres du personnel et qui sont exigés pour certains postes et certaines activités de travail, en fonction de l'évaluation des besoins en matière de formation. La formation constitue l'un des éléments exigés pour se voir accorder un accès non supervisé à la zone de confinement (c.-à-d. les membres du personnel autorisés) et ces registres permettent de démontrer que les membres du personnel satisfont aux exigences. | ||||||
| 4.9.5 | Un inventaire des matières réglementées pour leur entreposage à long terme, y compris les emplacements et les groupes de risque, doit être tenu à jour. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Un inventaire consiste en une liste des ressources biologiques entreposées à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone de confinement. L'inventaire permet aux personnes qui sont responsables des matières réglementées de gérer et de contrôler les matières, et de détecter rapidement si une matière entreposée est disparue ou n'a pas été comptabilisée. À tout le moins, un inventaire décrit la matière d'une manière suffisamment détaillée (c.-à-d. le genre, l'espèce et la souche, au besoin) pour déterminer le niveau de risque pour les humains et pour les animaux (c.-à-d. le groupe de risque) et le ou les emplacements de la matière (p. ex. la salle ou le congélateur, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de confinement). Un inventaire peut également indiquer la forme de la matière (p. ex. sous forme de poudre, cryoconservée, hautement concentrée, une forme pure) et comprendre des renseignements uniques relatifs à l'agent pathogène (p. ex. un agent pathogène non indigène d'animaux terrestres) de façon à pouvoir prendre des décisions éclairées (p. ex. en utilisant des procédures appropriées). Le choix du format de l'inventaire (p. ex. en format électronique ou papier, un journal d'échantillons) est déterminé par l'installation et tient compte de la nécessité de tenir les renseignements à jour et de demeurer facilement accessible pour les membres du personnel autorisés. | ||||||
| 4.9.6 | Pour l'entreposage à long terme des agents pathogènes de GR3 et de GR4 ainsi que des toxines ABCSE, un inventaire doit être tenu à jour et comprendre :
|
S | S | ■ | ■ | ■ |
| Pour permettre aux membres du personnel de remarquer rapidement la disparition d'une matière, il est justifié de garder un inventaire très détaillé en raison du risque accru (p. ex. la possibilité de double usage) associé aux agents pathogènes de GR3 et de GR4, et aux toxines ABCSE. L'inventaire indique l'identité de la matière d'une façon suffisamment détaillée (p. ex. le nom, le genre, l'espèce, la souche) pour déterminer le groupe de risque humain et animal de la matière. Les inventaires des matières réglementées entreposées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement comprennent le ou les emplacements précis de la matière (p. ex. la salle, le congélateur, l'étagère, la boîte) et les renseignements permettant de déterminer si un échantillon a disparu ou a été volé, ce qui peut comprendre le nombre de flacons ou de récipients, et la quantité de matière (p. ex. le volume, la concentration, les unités de toxine) dans chaque contenant primaire. | ||||||
| 4.9.7 | Les plans et les spécifications physiques de l'ensemble des structures et des services relatifs à la zone de confinement, y compris les plans « conformes à l'exécution » mis à jour en cas de modifications, doivent être conservés. [Non exigé pour les zones PA de NC2.] |
□ P | P | ■ | ■ | ■ |
| Des plans et des spécifications physiques qui tiennent compte de la structure actuelle et des services relatifs à la zone de confinement constituent des registres essentiels pour pouvoir identifier correctement la barrière de confinement, effectuer les essais de vérification des systèmes de confinement, et effectuer de manière sécuritaire les réparations et les rénovations, au besoin. Ces documents montrent que la zone de confinement a été construite de façon à respecter les exigences physiques applicables en matière de confinement. Des documents exacts et complets comprendront toutes les modifications apportées à la structure physique de la zone de confinement (p. ex. le retrait d'un mur, le réacheminement de la tuyauterie), y compris celles ayant été apportées pendant les processus de construction, de rénovation ou de modification. | ||||||
| 4.9.8 | Un registre des activités d'entretien et de réparation, des inspections, des lacunes, des mesures correctives, des essais et de la certification (y compris les registres sur les essais de vérification et de performance) de la zone de confinement (y compris les espaces de soutien) et de l'équipement doit être conservé. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les registres d'entretien, de réparation, d'inspections, de lacunes, de mesures correctives, d'essais et de certification (y compris les registres d'essais de vérification et de performance) de la zone de confinement (y compris les espaces de soutien) et de l'équipement montrent qu'ils répondent aux exigences et que les lacunes relevées sont corrigées dans un délai raisonnable. Ces registres peuvent comprendre les documents relatifs aux rapports officiels d'inspection interne, les notes de suivi d'un comité institutionnel (p. ex. biosécurité, santé et sécurité), les notes informelles ou les documents sur les réparations exigées, les essais et la certification des ESB, les essais des filtres HEPA, les essais d'intégrité de l'équipement ainsi que les rapports d'entretien de l'édifice. | ||||||
| 4.9.9 | Un registre du déclenchement des avertisseurs visuels et sonores pour les systèmes de décontamination des effluents et les systèmes CVAC doit être conservé. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les systèmes de décontamination des effluents et les systèmes CVAC sont munis d'avertisseurs visuels ou sonores servant à alerter les utilisateurs de toute lacune ou mauvais fonctionnement. Les avertisseurs pour les alertes (p. ex. une vanne qui fuit, une réduction du débit d'air, un avertisseur indiquant un haut niveau, un avertisseur indiquant un faible niveau) et les défaillances (p. ex. un échec du processus de décontamination à atteindre les paramètres validés, une défaillance d'un ventilateur du CVAC) en sont des exemples. Un registre du déclenchement des avertisseurs visuels et sonores pour les systèmes de décontamination des effluents et les systèmes CVAC montre que les avertisseurs fonctionnent comme prévu et que les utilisateurs ont été informés des alertes et des défaillances. | ||||||
| 4.9.10 | Les documents (p. ex. les certificats) démontrant que l'étalonnage de l'équipement servant aux essais de vérification et de performance était valide au moment de l'essai des systèmes de confinement et de l'équipement essentiel à la biosécurité doivent être conservés. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les certificats d'étalonnage montrent que les instruments utilisés lors des essais de vérification et de performance des systèmes de confinement et de l'équipement de biosécurité essentiel satisfaisaient aux paramètres de précision minimaux au moment de leur étalonnage et que le certificat demeurait valide lors de leur utilisation. Les photomètres d'aérosol, les compteurs de particules et les anémomètres utilisés pour mettre à l'essai les ESB et les filtres HEPA, les manomètres utilisés pour la vérification du taux de décroissement de pression et les essais d'intégrité des combinaisons à pression positive, et les thermocouples pour mesurer la température dans un autoclave constituent tous des exemples d'instruments pour lesquels des certificats d'étalonnage peuvent être exigés. Il est possible d'obtenir sur demande les certificats d'étalonnage des tiers certificateurs, le cas échéant. | ||||||
| 4.9.11 | Un registre de toutes les personnes, y compris les visiteurs, qui entrent dans la zone de confinement et qui en sortent doit être conservé. | S | S | ■ | ■ | ■ |
| Les registres qui tiennent compte de toutes les personnes, y compris les visiteurs, qui entrent dans la zone de confinement avec les heures d'entrée et de sortie (p. ex. un journal en format papier ou électronique) permettent de documenter qui était présent dans la zone de confinement à une heure donnée, ce qui s'avère essentiel lors d'une enquête sur un incident en cas d'exposition ou de rejet connus ou soupçonnés, ainsi que pour les incidents de biosûreté (p. ex. un agent pathogène disparu, une entrée non autorisée). Lorsque le journal des entrées et des sorties est vérifié régulièrement, il peut également être utilisé afin de détecter les entrées non autorisées dans la zone de confinement. Un journal optimal des entrées et des sorties comprendra le nom des personnes indiqué avec suffisamment de détails pour différencier les personnes ayant des noms semblables, la date ainsi que l'heure exacte d'entrée et de sortie. Il peut également être acceptable de saisir (et de conserver) les renseignements d'accès électroniques s'il est exigé que tous les membres du personnel et les visiteurs procèdent par un système de contrôle d'accès électronique qui comprend un dispositif de balayage (scanneur) à l'entrée et à la sortie. Une méthode appropriée pour documenter les entrées et les sorties permet de préparer et de partager une copie (p. ex. la numérisation du journal, un registre extrait du système d'accès) lorsque demandé par l'ASPC, l'ACIA ou d'autres autorités réglementaires. Le niveau de détail présent dans les registres d'entrée et de sortie pour les zones ABCSE où des toxines précisées sont présentes est fondé sur l'évaluation des risques de biosûreté. | ||||||
| 4.9.12 | Les registres de la validation et de la vérification régulière des processus et des systèmes de décontamination doivent être conservés. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les registres de validation et de vérification régulière des processus et des systèmes de décontamination montrent que les méthodes de décontamination continuent d'être efficaces contre les matières réglementées manipulées ou entreposées dans la zone de confinement. Ceci comprend les méthodes d'inactivation utilisées pour rendre le matériel non infectieux et non toxique avant le transfert à un niveau de confinement inférieur. | ||||||
|
||||||
5. Exigences relatives aux essais de vérification et de performance
Cette section énonce les exigences relatives aux essais de vérification et de performance permettant de démontrer que l'installation répond aux exigences physiques en matière de confinement énoncées à la section 3 et, dans certains cas, aux exigences opérationnelles énoncées à la section 4. Les rapports démontrant que les essais sont réussis sont exigés par l'ASPC et l'ACIA afin d'appuyer les demandes de permis visant des agents pathogènes et des toxines pour des activités réglementées réalisées avec des agents pathogènes humains et des toxines, les demandes de permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou la certification de l'installation (ou le renouvellement de la certification) pour les zones de confinement. De plus, les rapports sur les essais pourraient être consultés par l'ASPC et l'ACIA afin de vérifier la continuité de la conformité, y compris durant les inspections et les audits. Les exigences en matière de confinement physique et les exigences opérationnelles correspondantes des sections 3 et 4 sont énoncées dans la note explicative de chacune des exigences des matrices 5.1 à 5.3, le cas échéant. Dans certaines situations, l'ASPC ou l'ACIA pourraient demander, au cas par cas, que des essais supplémentaires soient menés, autres que ceux énoncés dans les matrices ci-dessous, pour démontrer la performance ou la vérification des systèmes de confinement.
5.1 Essais de vérification et de performance pour toutes les zones de confinement
La matrice qui suit décrit les essais de vérification et de performance minimaux qui doivent être effectués pour l'ensemble des types d'espaces de travail à tous les niveaux de confinement (NC2 à NC4).
| Matrice 5.1 | Essais de vérification et de performance pour tous les niveaux de confinement | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Les essais de vérification et de performance décrits dans les exigences 5.1.2 à 5.1.8 doivent être effectués et documentés avant l'utilisation initiale et au moins une fois par année par la suite ou plus fréquemment advenant :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Des essais de vérification et de performance sont réalisés afin de confirmer que la zone de confinement et l'équipement (p. ex. les assemblages de petits filtres de conduite, les systèmes de décontamination, les ESB, les dispositifs ventilés faits sur mesure) fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus, et qu'ils satisfont aux critères minimaux acceptables. Les essais de la matrice 5.1 sont répétés tous les ans, et plus fréquemment pour les situations décrites, afin de confirmer que les critères minimaux sont toujours atteints. La fréquence des essais peut augmenter en fonction des risques associés au mauvais fonctionnement ou à la défaillance de l'équipement, des systèmes et des procédures, et peut aussi être plus élevée pour les niveaux de confinement supérieurs. L'incapacité de satisfaire aux spécifications de manière répétée et le fait d'avoir besoin d'un service pour redevenir conforme peuvent indiquer le besoin d'effectuer des essais plus fréquemment, à moins que la cause fondamentale des défaillances récurrentes soit identifiée et corrigée. | ||||||
| 5.1.2 | La zone de confinement doit faire l'objet d'une inspection (p. ex. les surfaces, l'équipement, les procédures); lorsque des lacunes sont identifiées, la mise en œuvre des mesures correctives doit être vérifiée. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les défauts, les lacunes ou les traces de détérioration à l'intérieur d'une zone de confinement comprennent les éléments physiques (p. ex. un équipement défectueux ou un mauvais éclairage, de la peinture ou des planchers fissurés ou écorchés) et les éléments opérationnels (p. ex. le non-respect des procédures d'entrée). Les défauts, les lacunes et les traces de détérioration peuvent ne pas être remarqués par les membres du personnel lors du fonctionnement normal (c.-à-d. lors des activités quotidiennes); par conséquent, des inspections de la zone de confinement, y compris des surfaces, des planchers, des murs, des plafonds et de l'équipement sont effectuées. Lorsque des lacunes sont identifiées, les mesures correctives sont mises en œuvre dans un délai raisonnable. Le fait de documenter les essais de vérification et de performance, les processus et les résultats sert à prouver que la zone de confinement et l'équipement fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus, que les essais ont été effectués lorsqu'exigés, et que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai raisonnable (c.-à-d. quelles mesures correctives, quand et comment elles ont été mises en œuvre). | ||||||
| 5.1.3 | Les assemblages de petits filtres de conduite doivent faire l'objet d'une inspection visuelle et ils doivent être remplacés ou mis à l'essai conformément aux spécifications du fabricant. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une procédure pour l'inspection et le remplacement ou la mise à l'essai des assemblages de petits filtres de conduite est élaborée et suivie afin de vérifier (c.-à-d. conformément aux spécifications du fabricant) que les filtres fonctionnent toujours comme prévu pour empêcher un bris de confinement. Les filtres sur les conduites destinées à la surveillance des différences de pression et les évents des autoclaves sont des exemples de petits filtres de conduite. Des étiquettes peuvent être apposées sur les filtres, ou à proximité de ceux-ci, afin de confirmer visuellement quand a eu lieu la dernière inspection, le dernier remplacement ou la dernière mise à l'essai. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des filtres conformément aux exigences 3.4.4, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.8 et 4.3.6. | ||||||
| 5.1.4 | La performance des systèmes de décontamination doit être validée en utilisant les paramètres habituels avec des charges représentatives ainsi que des indicateurs biologiques, des indicateurs chimiques, des dispositifs de surveillance paramétriques propres à l'application et compatibles avec le système utilisé, ou plusieurs de ces éléments. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La validation des systèmes de décontamination (p. ex. un autoclave, un système de décontamination des effluents) confirme les paramètres appropriés exigés pour la décontamination efficace des matières avant leur élimination ou leur retrait de la zone de confinement. La validation est effectuée en utilisant les paramètres habituels (p. ex. la durée du cycle, la température, la pression) avec des charges représentatives (p. ex. le type et la quantité de matières). Il est recommandé d'effectuer la validation en utilisant des charges simulées composées de matières non infectieuses. Lorsque les indicateurs biologiques ou chimiques ne sont pas appropriés, des dispositifs de surveillance paramétriques peuvent être utilisés pour surveiller adéquatement l'efficacité de l'équipement de décontamination. Des thermocouples et des jauges qui saisissent la durée du cycle, la température et la pression constituent des exemples de tels dispositifs. Selon une ELR, la vérification régulière des systèmes de décontamination (p. ex. l'autoclave) peut être documentée comme étant une validation annuelle si la charge de déchets est représentative de la charge habituelle (c.-à-d. le type et la quantité de matières) et si elle est effectuée au moyen d'indicateurs biologiques, d'indicateurs chimiques ou de dispositifs de surveillance paramétriques placés à un endroit difficile à décontaminer à l'intérieur de la charge. Cette exigence sert à valider la performance des systèmes de décontamination conformément aux exigences 3.6.5, 3.6.6 et 3.7.1. | ||||||
| 5.1.5 | Les dispositifs de surveillance offrant une représentation visuelle du courant d'air vers l'intérieur doivent être vérifiés pour confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les dispositifs de surveillance offrant une représentation visuelle du courant d'air vers l'intérieur (p. ex. un manomètre de pression différentielle, une jauge de vitesse de l'air, une sonde de pression différentielle étalonnée, un flotteur, des indicateurs visuels) saisissent et affichent les paramètres qui démontrent que le confinement est maintenu. La vérification de ces dispositifs confirme qu'ils fonctionnent comme prévu. Cette exigence sert à permettre la vérification conformément à l'exigence 3.4.3. | ||||||
| 5.1.6 | Les ESB de catégorie II doivent être certifiées dans des conditions d'utilisation habituelles conformément à la norme NSF/ANSI 49, si une telle certification est possible. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les ESB de catégorie II sont mises à l'essai pour confirmer qu'elles fonctionnent comme prévu pour empêcher le rejet de matières réglementées et l'exposition qui pourraient découler d'une défaillance de l'équipement. La norme NSF/ANSI 49 décrit les paramètres et les essais acceptables qui sont exigés pour la certification. L'ESB est installée de la façon dont elle est utilisée habituellement, ce qui comprend la mise en place de tout équipement permanent normalement en marche à l'intérieur ou à proximité de l'ESB pendant que sont effectuées les activités. Il est recommandé que ces essais soient effectués par un technicien certifié. Cette exigence sert à vérifier la performance des ESB de catégorie II conformément à l'exigence 3.6.1. Lorsque la certification d'une ESB de catégorie II conformément à la norme NSF/ANSI 49 n'est pas possible, l'exigence 5.1.7 s'applique. | ||||||
| 5.1.7 | Lorsque la conception d'une ESB ou d'un autre dispositif ventilé ne permet pas la certification conformément à la norme NSF/ANSI 49, les spécifications suivantes du fabricant doivent être vérifiées dans des conditions d'utilisation habituelles :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les dispositifs ventilés (p. ex. les ESB, les dispositifs ventilés faits sur mesure, les postes ventilés par aspiration descendante, les systèmes d'étagères à cages, les postes ventilés pour le changement des cages) sont mis à l'essai pour confirmer qu'ils satisfont aux spécifications du fabricant et qu'ils fonctionnent comme prévu pour empêcher le rejet de matières réglementées et les incidents d'exposition découlant d'une défaillance de l'équipement. Les essais des dispositifs sont effectués lorsqu'ils sont installés de la façon dont ils sont utilisés habituellement, ce qui comprend la mise en place de tout équipement (p. ex. un microincinérateur ou une flamme, une microcentrifugeuse, un agitateur-mélangeur vortex, un ventilateur, une ESB voisine) normalement en marche à l'intérieur ou à proximité du dispositif pendant que sont effectuées les activités. Il est recommandé que les essais soient effectués par un technicien qualifié (p. ex. avec une aptitude démontrée, une formation reconnue). Les renseignements à saisir dans les registres comprennent les essais effectués, la méthode et les spécifications du fabricant pour démontrer l'intégrité des filtres HEPA, le maintien du confinement et le fonctionnement des avertisseurs visuels ou sonores. Lorsque l'ESB est conçue avec un plénum en surpression, l'intégrité du plénum est vérifiée, y compris lorsqu'un des panneaux est retiré. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des dispositifs ventilés conformément à l'exigence 3.6.1. | ||||||
| 5.1.8 | L'intégrité des dispositifs de confinement primaire autres que les ESB et les dispositifs ventilés doit être soumise à des essais conformément aux procédures et aux critères d'acceptation appropriés pour l'équipement et la conception. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les dispositifs de confinement primaire (p. ex. l'équipement de procédé, les systèmes fermés, les cages de confinement primaire, les godets et les rotors scellés des centrifugeuses) sont mis à l'essai pour confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu afin d'empêcher le rejet de matières réglementées et les incidents d'exposition découlant de la défaillance de l'équipement. Cette évaluation comprend des essais pour les filtres HEPA lorsque ceux-ci sont présents. Les filtres HEPA qui ne peuvent pas être soumis aux essais de vérification (p. ex. les petits filtres de conduite, les filtres HEPA inaccessibles) peuvent être remplacés régulièrement selon un calendrier de remplacement pour lequel la fréquence de remplacement est fondée sur les spécifications du fabricant et les ELR). Par exemple, les essais relatifs à l'intégrité de l'équipement de petite taille peuvent être effectués plus régulièrement que les essais relatifs à l'intégrité de l'équipement de plus grande taille (p. ex. l'inspection visuelle des joints toriques dans les godets des centrifugeuses). Cette exigence sert à vérifier la performance des dispositifs de confinement primaire, autres que les ESB et les dispositifs ventilés, conformément aux exigences 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 et 3.6.4. | ||||||
|
||||||
5.2 Essais supplémentaires de vérification et de performance pour les zones de confinement sélectionnées
En plus des essais de vérification et de performance énoncés dans la matrice 5.1, la matrice suivante énonce les essais de vérification et de performance supplémentaires qui doivent être effectués pour les zones de confinement sélectionnées de NC2 et NC2-Ag, ainsi que toutes les zones de confinement de NC3 et NC4.
| Matrice 5.2 | Essais supplémentaires de vérification et de performance pour les zones de confinement sélectionnées | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Les essais de vérification et de performance décrits dans les exigences 5.2.3 à 5.2.15 doivent être effectués et documentés avant l'utilisation initiale et au moins tous les deux ans par la suite, ou plus fréquemment advenant :
[Seulement exigé dans les zones PA de NC2 où sont manipulés des prions.] |
□ P | ■ | |||
| Les essais de vérification et de performance sont effectués pour confirmer que les systèmes de confinement et de sûreté fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus, et qu'ils satisfont aux critères minimaux acceptables pour la manipulation sécuritaire et sûre de matières réglementées. La fréquence des essais peut augmenter en fonction des risques associés au mauvais fonctionnement ou à la défaillance de l'équipement, des systèmes et des procédures. L'incapacité de satisfaire aux spécifications de manière répétée et le fait d'avoir besoin d'un service pour redevenir conforme peuvent indiquer le besoin d'effectuer des essais plus fréquemment, à moins que la cause fondamentale des défaillances récurrentes soit identifiée et corrigée. Le fait de documenter les essais, les processus et les résultats d'essais de vérification et de performance montre que les essais sont réalisés lorsqu'ils sont exigés, que les systèmes de confinement fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus, et que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai raisonnable (c.-à-d. quelles mesures correctives, quand et comment elles ont été mises en œuvre). | ||||||
| 5.2.2 | Les essais de vérification et de performance décrits dans les exigences 5.2.3 à 5.2.19 doivent être effectués et documentés avant l'utilisation initiale et au moins tous les ans par la suite, ou plus fréquemment advenant :
|
S | S | ■ | ■ | ■ |
| Les essais de vérification et de performance sont effectués pour confirmer que les systèmes de confinement et de sûreté fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus, et qu'ils satisfont aux critères minimaux acceptables pour la manipulation sécuritaire et sûre de matières réglementées. La fréquence des essais peut augmenter en fonction des risques associés au mauvais fonctionnement ou à la défaillance de l'équipement, des systèmes et des procédures. L'incapacité de satisfaire aux spécifications de manière répétée et le fait d'avoir besoin d'un service pour redevenir conforme peuvent indiquer le besoin d'effectuer des essais plus fréquemment, à moins que la cause fondamentale des défaillances récurrentes soit identifiée et corrigée. Le fait de documenter les essais, les processus et les résultats d'essais de vérification et de performance montre que les essais sont réalisés lorsqu'ils sont exigés, que les systèmes de confinement fonctionnent comme prévu (et tels qu'ils ont été conçus) et que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai raisonnable (c.-à-d. quelles mesures correctives, quand et comment elles ont été mises en œuvre). | ||||||
| 5.2.3 | Les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de sécurité doivent être vérifiés pour confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu. [Seulement exigé dans les zones PA de NC2 où sont manipulés des prions ou des ABCSE.] |
□ PS | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de sécurité empêchent l'accès non autorisé aux zones de confinement. Une vérification permet de confirmer que les systèmes de contrôle d'accès fonctionnent tels qu'ils ont été conçus afin que les codes, les cartes, ou les traits biométriques valides permettent l'accès et que ceux qui sont invalides ne le permettent pas (c.-à-d. que les portes demeurent verrouillées). Les autres systèmes de sécurité (p. ex. le système de télévision en circuit fermé, l'avertisseur) sont vérifiés régulièrement pour confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu. Si des verrous à clés ou des lecteurs de cartes sont utilisés, la vérification peut comprendre le fait de confirmer que les portes demeurent verrouillées, que les clés et les cartes d'accès ne sont distribuées qu'aux membres du personnel autorisés et que le mécanisme de contrôle des clés empêche la reproduction des clés et des cartes d'accès (p. ex. un suivi électronique ou une inscription au registre lorsqu'une clé ou une carte d'accès a été remise et retournée). Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de sécurité, le cas échéant, conformément aux exigences 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 et 3.2.8. | ||||||
| 5.2.4 | Les systèmes d'alimentation de secours et d'UPS doivent être vérifiés dans des conditions de charges électriques représentatives. [Seulement exigé dans les zones PA de NC2 où sont manipulés des prions ou des ABCSE.] |
□ PS | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes de confinement, les systèmes de sécurité des personnes, les systèmes de contrôle automatique de l'édifice et les autres systèmes de sécurité utilisés dans les zones de confinement élevé (p. ex. les systèmes de contrôle, les ventilateurs, les dispositifs de confinement primaire, les appareils de communication, les systèmes de décontamination des effluents) sont essentiels pour empêcher l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières réglementées. La mise à l'essai des systèmes d'alimentation de secours et d'UPS dans des conditions de charges électriques représentatives confirme que la génératrice ou le système UPS peuvent produire une alimentation électrique suffisante pour permettre aux systèmes de confinement critiques de fonctionner sans interruption durant une panne de courant. S'il n'est pas possible de faire des essais avec une charge réelle, un essai avec une charge simulée est acceptable. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des systèmes d'alimentation de secours et d'UPS, le cas échéant, conformément aux exigences 3.5.14 et 3.5.15. | ||||||
| 5.2.5 | Les joints d'étanchéité, les surfaces et les pénétrations de la barrière de confinement doivent faire l'objet d'une inspection visuelle pour confirmer leur intégrité. [Seulement exigé dans les zones PA de NC2 où sont manipulés des prions.] |
□ P | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les joints d'étanchéité et les surfaces qui composent la barrière de confinement permettent la décontamination efficace des espaces ou des surfaces. La surveillance (c.-à-d. l'inspection visuelle) de l'état des surfaces et des joints d'étanchéité et la correction de toutes les traces de détérioration permettent de maintenir l'intégrité de la barrière et empêchent le rejet de matières réglementées. Une inspection visuelle comprend la vérification des planchers, des murs et des plafonds, ainsi que des joints plancher-mur et mur-plafond (lorsqu'exigé) pour détecter les fissures, les ébréchures ou les signes d'usure. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des joints et des surfaces conformément aux exigences 3.1.8, 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3. | ||||||
| 5.2.6 | Dans les salles abritant un système de décontamination des effluents servant de système de décontamination primaire, les surfaces scellées doivent faire l'objet d'une inspection visuelle pour confirmer leur intégrité. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Dans les salles abritant un système de décontamination des effluents servant de système de décontamination primaire, les surfaces étanches permettent à la salle de contenir le volume total d'un rejet du système de décontamination des effluents dans le cas d'une défaillance. La surveillance (c.-à-d. l'inspection visuelle) de l'état des surfaces étanches et la correction de toutes les traces de détérioration permettent de maintenir l'intégrité de la barrière et empêchent le rejet de matières réglementées. Une inspection visuelle comprend la vérification des planchers et des murs, ainsi que des joints plancher-mur pour détecter les fissures, les ébréchures et les signes d'usure. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des joints et des surfaces conformément à l'exigence 3.7.2. | ||||||
| 5.2.7 | Une inspection visuelle du système de décontamination des effluents et de la tuyauterie d'évacuation menant au système de décontamination des effluents doit être effectuée annuellement afin de détecter les détériorations ou les fuites. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les détériorations ou les fuites du système de décontamination des effluents ou de la tuyauterie d'évacuation menant au système de décontamination des effluents, y compris la détérioration des coudes, des joints, des soudures et des tuyaux, peuvent porter atteinte au confinement. Les inspections visuelles peuvent comprendre des techniques d'examen non destructives telles que les tests par sonde ultrasonique et l'inspection d'indicateurs visuels qui déterminent si une fuite s'est produite. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité du système de décontamination des effluents et de la tuyauterie d'évacuation menant au système de décontamination des effluents installés conformément à l'exigence 3.7.1. | ||||||
| 5.2.8 | Là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé, l'intégrité des joints des pénétrations dans la barrière de confinement de la zone de confinement, du box et de la salle de nécropsie doit être vérifiée au moyen d'une poire à fumée ou d'un autre dispositif qui n'a aucune répercussion sur la direction du courant d'air. [Non exigé dans les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les essais à l'aide d'une poire à fumée pour vérifier l'intégrité des joints permet d'identifier ceux qui ont perdu leur intégrité et qui nécessitent des réparations. Cet essai est exigé pour les joints autour des pénétrations dans la barrière de confinement de la zone de confinement, du box et de la salle de nécropsie, y compris les joints de tous les conduits et tout le câblage, de même que les joints autour des portes, des fenêtres et des systèmes passe-plats tels que les autoclaves et les cuves d'immersion. Des enregistrements vidéo de ces essais peuvent être conservés afin d'appuyer la documentation. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité des joints présents conformément à l'exigence 3.1.8. | ||||||
| 5.2.9 | Là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé, des essais à l'aide d'une poire à fumée ou d'un autre moyen visuel qui n'a aucune répercussion sur la direction du courant d'air doivent être effectués aux portes critiques pour confirmer que le courant d'air vers l'intérieur est maintenu. [Non exigé dans les zones PA de NC2.] |
□ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| La démonstration visuelle à toutes les portes critiques que l'air circule vers les espaces de confinement plus élevé, et jamais dans le sens opposé, selon la conception, confirme que le courant d'air vers l'intérieur est maintenu. L'absence de courant d'air peut également être vérifiée aux portes hermétiques (c.-à-d. au NC4) pour confirmer qu'il n'y a aucun écoulement d'air après le joint d'étanchéité. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des essais pour les portes qui font partie du mur selon la conception de l'installation (p. ex. les portes de secours scellées, les éléments scellés détachables). Des enregistrements vidéo de ces essais et des dessins de vue en plan peuvent également être conservés pour appuyer la documentation. Cette exigence sert à vérifier que le courant d'air vers l'intérieur est maintenu conformément aux exigences 3.4.1, 3.4.2 et 3.7.3. | ||||||
| 5.2.10 | La fermeture étanche des volets de confinement servant de protection antirefoulement d'air primaire sur les conduits du système d'approvisionnement en air doit être vérifiée à l'aide d'une poire à fumée ou d'un autre moyen visuel qui n'a aucune répercussion sur la direction du courant d'air. | ■ | ■ | ■ | ||
| La démonstration visuelle de l'absence de courant d'air lorsque le volet est fermé permet de confirmer que les volets de confinement ferment correctement et que le joint d'étanchéité est hermétique. L'essai peut être effectué en allant vers un diffuseur en aval pour évaluer si un courant d'air est présent en aval à l'aide d'une poire à fumée ou d'un autre moyen visuel qui permet l'observation de fuite d'air avant, durant et après la fermeture du volet. Un rapport du système de gestion d'immeuble démontrant qu'il n'y a pas de courant d'air lorsque le volet est fermé peut fournir des renseignements complémentaires, s'il est disponible. Le fait d'effectuer cet essai de manière à minimiser les interactions des courants d'air environnants peut aider à obtenir des résultats exacts. Il est également acceptable d'effectuer une vérification du taux de décroissement de pression de la pièce. | ||||||
| 5.2.11 | Les filtres HEPA et les filtres à haute efficacité doivent être mis à l'essai in situ pour confirmer leur intégrité par un essai de retenue des particules au moyen de la méthode par balayage, conformément à la norme IEST-RP-CC034.3. S'il n'est pas possible d'effectuer des essais par balayage, les essais par sonde sont acceptables. S'il n'est pas possible d'effectuer les essais conformément à la norme IEST-RP-CC034.3, les essais effectués conformément aux spécifications du fabricant sont acceptables. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les filtres HEPA et les filtres à haute efficacité sont mis à l'essai (c.-à-d. au moyen d'un balayage ou d'une sonde) pour confirmer leur intégrité et empêcher un bris de confinement et le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de la zone de confinement. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des filtres HEPA et des filtres à haute efficacité installés conformément aux exigences 3.4.6, 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12, 3.6.4, 3.7.3, 3.7.7 et 3.7.8. | ||||||
| 5.2.12 | Les boîtiers accessibles des filtres HEPA et des filtres à haute efficacité et les conduits accessibles entre les boîtiers et la barrière de confinement doivent faire l'objet d'une inspection visuelle pour déceler les lacunes. | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Une inspection visuelle des défectuosités, des fissures, des déformations et des lacunes des boîtiers de filtres HEPA et de filtres à haute efficacité et des conduits entre le boîtier et la barrière de confinement permet de confirmer le maintien de leur intégrité. Lorsque le boîtier du filtre ou le conduit est déformé, il peut être nécessaire de procéder à des essais pour déceler les fuites (p. ex. un essai à la fumée, une vérification du taux de décroissement de pression) ou pour confirmer l'intégrité des filtres HEPA ou des filtres à haute efficacité. | ||||||
| 5.2.13 | L'intégrité de la barrière de confinement, y compris les conduits et les boîtiers des filtres, doit être mise à l'essai en faisant la vérification du taux de décroissement de pression de la pièce. Les critères d'acceptation comprennent deux mises à l'essai consécutives avec une perte de pression maximale de 50% de la pression opérationnelle maximale sur une période de 20 minutes. [Seulement exigé dans les zones NC3-Ag où sont manipulés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.] |
■ | ■ | |||
| Le fait de repérer les surfaces qui ont perdu leur intégrité à la barrière de confinement est essentiel pour protéger les membres du personnel contre une exposition et empêcher un bris de confinement, ainsi que pour permettre à la décontamination gazeuse d'être effectuée. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité de la barrière de confinement conçue conformément aux exigences 3.1.8 et 3.2.17. | ||||||
| 5.2.14 | Les mécanismes d'interverrouillage physiques ou électroniques des portes doivent être vérifiés pour déterminer s'ils fonctionnent comme prévu. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Des mécanismes d'interverrouillage qui fonctionnent correctement empêchent l'ouverture simultanée des portes critiques avec des portes adjacentes et séquentielles, ce qui pourrait entraîner un bris de confinement. La vérification des mécanismes d'interverrouillage des portes permet de confirmer que ceux-ci fonctionnent tels qu'ils ont été conçus. Les mécanismes d'interverrouillage des portes peuvent être mis à l'essai en ouvrant la porte critique et en tentant d'ouvrir simultanément les portes à interverrouillage connexes. Les portes interverrouillées sont mises à l'essai une à la fois, et ce, dans les deux directions. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des mécanismes d'interverrouillage des portes et des commandes manuelles pour contourner ces mécanismes installés conformément aux exigences 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.14, 3.2.15 et 3.2.16. | ||||||
| 5.2.15 | Les dispositifs antirefoulement d'eau à pression réduite doivent être vérifiés au moins une fois par année conformément à la norme CAN/CSA B64.10. | P | ■ | ■ | ■ | |
| Les dispositifs antirefoulement d'eau à pression réduite du système d'approvisionnement en eau potable sont mis à l'essai pour confirmer que ceux-ci fonctionnent comme prévu et protègent le système principal d'approvisionnement en eau contre la contamination dans l'éventualité d'un renversement du débit de l'eau provenant de l'installation de confinement. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des dispositifs antirefoulement d'eau à pression réduite installés conformément à l'exigence 3.5.3. | ||||||
| 5.2.16 | L'air comprimé respirable et les systèmes connexes, y compris les systèmes d'approvisionnement en air respirable de secours, doivent être vérifiés conformément à la norme CAN/CSA Z180.1. [Non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC4 où les matières réglementées sont exclusivement manipulées dans une chaîne d'ESB de catégorie III.] |
■ | ||||
| Les systèmes d'approvisionnement en air comprimé respirable et les systèmes connexes, y compris la transition vers les systèmes d'approvisionnement en air respirable de secours et la réponse des avertisseurs, sont mis à l'essai pour confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu et qu'ils fournissent la pression, le volume, le débit et la qualité de l'air exigés pendant leur fonctionnement normal et en situation d'urgence (c.-à-d. une défaillance du système principal), avec le nombre maximal de combinaisons en utilisation. Ces essais (p. ex. le débit d'écoulement sous pression positive) sont réalisés conformément aux spécifications du fabricant et peuvent être effectués plus fréquemment selon la fréquence d'utilisation. Cette exigence sert à vérifier la qualité de l'air comprimé respirable et l'efficacité des systèmes connexes conformément aux exigences 3.5.13 et 4.3.5. | ||||||
| 5.2.17 | La conformité des combinaisons à pression positive aux spécifications du fabricant doit être vérifiée. [Non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC4 où les matières réglementées sont exclusivement manipulées dans une chaîne d'ESB de catégorie III.] |
■ | ||||
| Les combinaisons à pression positive sont mises à l'essai pour confirmer qu'elles fonctionnent comme prévu pour empêcher l'exposition des membres du personnel; cela comprend notamment une inspection visuelle des coutures, des fermetures, des joints d'étanchéité, des filtres HEPA et des joints, ainsi que des essais de pression par le gonflement de la combinaison. Les documents peuvent comprendre les dates des essais, les combinaisons utilisées, les lacunes et toutes les réparations effectuées (c.-à-d. comment et quand ces réparations ont été réalisées). Si les essais sont effectués régulièrement avant l'entrée, les résultats documentés de ces essais peuvent être acceptables. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité des combinaisons à pression positive portées dans les zones de confinement conformément aux exigences 4.3.5, 4.3.6 et 4.4.17. | ||||||
| 5.2.18 | Les systèmes de douches de décontamination chimique, y compris les dispositifs de surveillance paramétriques, doivent être vérifiés pour déterminer s'ils fonctionnent comme prévu. [Non exigé dans les espaces de travail en laboratoire de NC4 où les matières réglementées sont exclusivement manipulées dans une chaîne d'ESB de catégorie III.] |
■ | ||||
| Les systèmes de douches de décontamination chimique dans la zone de confinement sont mis à l'essai (p. ex. avec un essai de porteurs) pour confirmer qu'ils fonctionnent tels qu'ils ont été conçus et que la durée du contact, la concentration et le volume appropriés pour une décontamination efficace ont été atteints. L'essai comprend une vérification que le désinfectant est distribué à une concentration ou un volume approprié, que les compteurs de conductivité et du niveau de produit chimique fonctionnent comme prévu, et que la minuterie atteint le délai minimal prescrit (le cas échéant). Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des systèmes de douches de décontamination chimique et des dispositifs de surveillance paramétriques connexes installés conformément aux exigences 3.2.13 et 3.6.7. | ||||||
| 5.2.19 | L'efficacité des douches de décontamination chimique doit être validée. | ■ | ||||
| La validation des douches de décontamination chimique confirme les paramètres appropriés pour la décontamination efficace des combinaisons à pression positive avant qu'elles soient retirées. La validation peut être effectuée en utilisant une quantité connue d'un agent pathogène de substitution afin de confirmer l'efficacité de la décontamination chimique sur différents types de matériaux. Un agent pathogène de substitution possède une résistance chimique équivalente ou plus importante que celle de l'agent pathogène utilisé. Cette exigence sert à valider l'efficacité des douches de décontamination chimique installées conformément à l'exigence 3.2.13. | ||||||
|
||||||
5.3 Essais de vérification et de performance à effectuer au cours de la mise en service et à des intervalles énoncés pour toutes les zones de confinement
En plus des essais de vérification et de performance énoncés dans les matrices 5.1 et 5.2, la matrice suivante décrit les essais de vérification et de performance qui doivent être effectués au cours du processus de mise en service de la zone de confinement. Étant donné que les édifices et les systèmes peuvent se détériorer au fil du temps, certains essais dans la présente matrice doivent être répétés aux intervalles énoncés.
Les rapports démontrant que les essais sont réussis seront exigés par l'ASPC et l'ACIA pour une zone de confinement nouvellement mise en service, afin d'appuyer une nouvelle demande de permis visant des activités réglementées réalisées avec des agents pathogènes humains et des toxines, une demande de permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres pour une zone de confinement dans laquelle un agent pathogène d'animaux terrestres n'a jamais été importé, ou le processus initial de certification d'une installation pour une zone de confinement où seront réalisées des activités avec des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres. Les essais des systèmes de confinement doivent être répétés lorsque demandé par l'ASPC ou l'ACIA; selon les conditions du permis visant des agents pathogènes humains et des toxines; selon les conditions du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres; ou lorsqu'une réparation est effectuée ou un changement ou une modification est apporté à la zone de confinement, à un dispositif de confinement ou à un système.
| Matrice 5.3 | Essais de vérification et de performance à effectuer au cours de la mise en service et à des intervalles énoncés pour toutes les zones de confinement | NC2 | NC2-Ag | NC3 | NC3-Ag | NC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Les essais de vérification et de performance décrits dans les exigences 5.3.2 à 5.3.9 doivent être effectués et documentés au cours de la mise en service et aux intervalles énoncés, ou plus fréquemment, advenant :
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les essais de vérification et de performance sont réalisés au cours de la mise en service de la zone de confinement pour confirmer que les systèmes de confinement fonctionnent comme prévu et tels qu'ils ont été conçus. Les essais sont répétés aux intervalles énoncés ou à la suite de changements qui pourraient avoir une répercussion sur un système de confinement pour confirmer que les critères minimaux acceptables continuent d'être atteints (c.-à-d. malgré le vieillissement de l'installation ou les changements qui y sont apportés). Lorsque les essais ne peuvent pas être répétés à l'intérieur de l'intervalle énoncé ou lorsque les essais échouent, les installations peuvent communiquer avec l'ASPC ou l'ACIA pour établir un plan d'action pour répéter les essais et satisfaire aux exigences minimales. | ||||||
| 5.3.2 | Au cours de la mise en service, tous les systèmes d'alimentation de secours et d'UPS doivent être vérifiés pour déterminer s'ils fonctionnent comme prévu dans des conditions réelles de commutation et de charges électriques. [Seulement exigé dans les zones PA de NC2 où sont manipulés des prions et des ABCSE.] |
□ PS | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes d'alimentation de secours et d'UPS sont mis à l'essai dans des conditions de charge électrique réelle (c.-à-d. en commutation réelle) pour confirmer que la génératrice peut produire une alimentation suffisante afin de permettre aux systèmes de confinement essentiels de fonctionner sans interruption pendant une panne de courant. Les systèmes de confinement qui sont essentiels pour empêcher l'exposition des membres du personnel et le rejet de matières réglementées comprennent les commandes de l'équipement, les ventilateurs, les dispositifs de confinement essentiels, les appareils de communication et les systèmes de décontamination des effluents. Là où des conditions réelles de commutation ne peuvent pas être utilisées en fonction des autres activités menées dans l'édifice (p. ex. des laboratoires situés dans des hôpitaux), les installations peuvent communiquer avec l'ASPC ou l'ACIA pour établir un plan d'action pour satisfaire aux exigences minimales. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité des systèmes d'alimentation de secours et d'UPS, lorsqu'ils sont installés, conformément aux exigences 3.5.14 et 3.5.15. | ||||||
| 5.3.3 | Au cours de la mise en service, la tuyauterie d'évacuation menant à un système de décontamination des effluents doit être mise à l'essai conformément au Code national de la plomberie du Canada. | P | ■ | ■ | ■ | |
| La tuyauterie d'évacuation est mise à l'essai conformément au Code national de la plomberie du Canada afin de confirmer que le système fonctionne correctement. Les essais portent sur l'ensemble des drains et de la tuyauterie connexe, ainsi que sur les conduites d'évent connexes raccordées au système de décontamination des effluents (c.-à-d. toute tuyauterie entrant ou sortant de la zone de confinement). Cette exigence sert à vérifier l'efficacité de la tuyauterie d'évacuation installée conformément à l'exigence 3.5.8 | ||||||
| 5.3.4 | Au cours de la mise en service, les conduits d'approvisionnement en air situés entre la protection antirefoulement d'air et la barrière de confinement, ainsi que les conduits d'évacuation de l'air situés entre la barrière de confinement et le filtre HEPA ou le volet de confinement, y compris les boîtiers des filtres HEPA, doivent être soumis à une vérification du taux de décroissement de pression in situ conformément à la norme ASME N511. Les critères d'acceptation comprennent un taux de fuite d'air inférieur à 1,0% du volume/minute. | ■ | ||||
| Le fait de tester les conduits d'aération de la zone de confinement et les boîtiers des filtres HEPA permet de confirmer leur intégrité sous des conditions de fonctionnement normales, ce qui empêche un bris de confinement et le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées à l'extérieur de la zone de confinement. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité des conduits d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air, y compris les boîtiers des filtres HEPA installés conformément aux exigences 3.4.6, 3.4.7, 3.4.13 et 3.4.15. | ||||||
| 5.3.5 | Au cours de la mise en service, les conduits d'approvisionnement en air situés entre la protection antirefoulement d'air et la barrière de confinement, ainsi que les conduits d'évacuation de l'air situés entre la barrière de confinement et le filtre HEPA ou le volet de confinement, y compris les boîtiers des filtres HEPA, doivent être soumis à une vérification du taux de décroissement de pression in situ conformément à la norme ASME N511. Les critères d'acceptation comprennent un taux de fuite d'air inférieur à 0,1% du volume/minute. | ■ | ■ | |||
| Le fait de tester les conduits d'aération de la zone de confinement et les boîtiers des filtres HEPA permet de confirmer leur intégrité sous des conditions de fonctionnement normales, ce qui empêche un bris de confinement et le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées à l'extérieur de la zone de confinement. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité des conduits d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air, y compris les boîtiers des filtres HEPA installés conformément aux exigences 3.4.6, 3.4.7, 3.4.13 et 3.4.15. | ||||||
| 5.3.6 | Au cours de la mise en service et tous les 10 ans, le fonctionnement du système CVAC et de ses commandes doit être vérifié durant les simulations de défaillance de ses composantes, y compris des ventilateurs d'évacuation ou d'approvisionnement, et du courant. Les critères d'acceptation comprennent la démonstration que l'inversion du courant d'air vers l'intérieur n'est pas soutenue aux portes critiques et que les avertisseurs et les mécanismes d'interverrouillage du système CVAC fonctionnent comme prévu. | ■ | ■ | ■ | ||
| Les systèmes CVAC et les systèmes de commande sont essentiels pour protéger l'environnement et la sécurité des membres du personnel. Les systèmes CVAC et leurs composantes sont mis à l'essai dans le cadre de plusieurs pannes simulées pour confirmer que ces systèmes peuvent continuer à maintenir les paramètres de fonctionnement minimaux (établis pendant la mise en service) pour empêcher un bris de confinement et le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de la zone de confinement. Les considérations comprennent les facteurs ayant une influence sur les systèmes à différents moments de la journée. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité du système CVAC, de ses composantes et de ses fonctionnalités, conformément aux exigences 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.8, le cas échéant. | ||||||
| 5.3.7 | Au cours de la mise en service et tous les 10 ans, le fonctionnement du système CVAC et de ses commandes doit être vérifié durant les simulations de défaillance de ses composantes liées aux ventilateurs d'évacuation des ESB de catégorie II, type B2 (le cas échéant). Les critères d'acceptation comprennent la démonstration que le retour d'air de l'ESB de catégorie II, type B2, est réduit au minimum et que les avertisseurs et les mécanismes d'interverrouillage qui y sont associés fonctionnent comme prévu. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Les systèmes CVAC et les systèmes de commande sont essentiels pour protéger l'environnement et la sécurité des membres du personnel. Les systèmes CVAC et leurs composantes sont mis à l'essai dans le cadre de plusieurs pannes simulées pour confirmer que ces systèmes peuvent continuer à maintenir les paramètres de fonctionnement minimaux (établis au cours de la mise en service) pour empêcher un bris de confinement et le rejet d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées hors de la zone de confinement ou d'une ESB de catégorie II, type B2. En cas de défaillance du ventilateur d'évacuation, les ESB de catégorie II, type B2, peuvent provoquer un refoulement du courant d'air à partir de l'avant de l'ESB (c.-à-d. un retour d'air) en réponse à un arrêt du système quelques temps après que celui-ci ait eu lieu. Toutes les mesures possibles sont prises pour réduire au minimum les retours d'air de manière mécanique (p. ex. des freins interverrouillés sur le ventilateur d'approvisionnement, un volet de confinement automatisé pour l'entrée d'air de l'ESB). Lorsque les retours d'air ne peuvent pas être éliminés, ils peuvent être réduits au minimum en modifiant les paramètres physiques de l'équipement (c.-à-d. réduire la durée et la vitesse du courant d'air le plus possible) et en mettant en œuvre des mécanismes opérationnels supplémentaires pour répondre aux risques associés aux retours d'air en fonction des matières réglementées et des procédures utilisées. L'utilisation d'EPI supplémentaire (p. ex. un appareil de protection respiratoire, une protection faciale) par tous les membres du personnel dans l'espace de travail immédiat et l'affichage des procédures d'urgence à suivre en cas de retour d'air sont des exemples de mécanismes opérationnels. Cet essai vérifie le scénario dans lequel le ventilateur externe d'évacuation de l'air s'arrête complètement et évalue la réponse de l'ESB durant le délai avant l'arrêt du ventilateur d'approvisionnement interne. Les considérations comprennent les facteurs ayant une influence sur les systèmes à différents moments de la journée. Cette exigence sert à vérifier l'efficacité du système CVAC, de ses composantes et de ses fonctionnalités, ainsi que des ESB de catégorie II, type B2, conformément aux exigences 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.8, le cas échéant. | ||||||
| 5.3.8 | Au cours de la mise en service et tous les 3 ans, l'intégrité de la barrière de confinement des box et des salles de nécropsie, y compris tous les conduits d'aération et les boîtiers des filtres HEPA, doit être mise à l'essai en faisant la vérification du taux de décroissement de pression de la pièce. Les critères d'acceptation comprennent deux mises à l'essai consécutives avec une perte de pression maximale de 50% de la pression opérationnelle maximale sur une période de 20 minutes. | ■ | ||||
| L'intégrité de la barrière de confinement est mise à l'essai par vérification du taux de décroissement de pression de la pièce pour des espaces spécifiques qui servent de confinement primaire. Le fait de repérer les surfaces qui ont perdu leur intégrité à la barrière de confinement, y compris tous les conduits d'aération et les boîtiers des filtres HEPA, est essentiel pour protéger les membres du personnel contre une exposition et empêcher un bris de confinement. Cette exigence sert à vérifier l'intégrité des espaces servant de confinement primaire conçus conformément aux exigences 3.1.8 et 3.2.17. | ||||||
| 5.3.9 | Tous les 3 ans, l'intégrité des joints de transition sur les conduits d'approvisionnement en air et d'évacuation de l'air entre les conduits d'aération vérifiés par taux de décroissement de pression et les diffuseurs d'air doit être vérifiée au moyen d'une poire à fumée ou d'un autre moyen visuel qui n'a aucune répercussion sur la direction du courant d'air. [Non exigé dans les box et les salles de nécropsie.] |
■ | ■ | |||
| Le fait de tester l'intégrité des joints d'étanchéité autour des pénétrations de la barrière de confinement au moyen d'une poire à fumée ou d'un essai à la bulle de savon permet d'identifier les joints d'étanchéité qui ont perdu leur intégrité et qui nécessitent des réparations. Cela inclut la continuité des surfaces entre les diffuseurs d'air des laboratoires et les conduits d'aération, les volets de confinement ou les boîtiers des filtres HEPA qui y sont associés. Ceci est essentiel puisque le fait de maintenir le courant d'air vers l'intérieur protège les membres du personnel contre une exposition et empêche un bris de confinement. Il est également acceptable d'effectuer une vérification du taux de décroissement de pression de la pièce. Cette exigence sert à vérifier les joints d'étanchéité présents conformément à l'exigence 3.1.8. | ||||||
|
||||||
Références
Législation
- Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21).
- Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24).
- Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296).
- Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44).
Documents d'orientation
- Agence canadienne d'inspection des aliments. (2010). Normes relatives au confinement des installations manipulant des agents pathogènes d'animaux aquatiques, 1re éd., Ottawa, ON, Canada : Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Agence canadienne d'inspection des aliments. (2007). Normes sur le confinement des installations manipulant des phytoravageurs, 1re éd., Ottawa, ON, Canada : Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Agence canadienne d'inspection des aliments. (2005). Normes de confinement pour les laboratoires, les installations vétérinaires et les salles de nécropsie qui manipulent des prions, Ottawa, ON, Canada : Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Agence canadienne d'inspection des aliments. (1996). Normes sur le confinement des installations vétérinaires, 1re éd., Ottawa, ON, Canada : Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Agence de la santé publique du Canada. (2004). Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, 3e éd., Ottawa, ON, Canada : Agence de la santé publique du Canada.
- Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et Conseil national de recherches du Canada. (2015). Code national de la plomberie - Canada 2015, 10e éd., Ottawa, ON, Canada : Conseil national de recherches du Canada.
- Gouvernement du Canada. (2016). Guide canadien sur la biosécurité, 2e éd., Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. (2013). Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, 1re éd., Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada.
- Groupe d'Australie. (2020). Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation. Consulté le 19 mai 2022.
- Organisation mondiale de la santé animale. (2022). Maladies animales. Consulté le 5 août 2022.
Ressources générales
- Agence canadienne d'inspection des aliments. (2017). Politique sur l'importation au Canada d'agents pathogènes causant des maladies animales exotiques ou émergentes chez les animaux terrestres par des établissements externes. Consulté le 5 août 2022.
- Agence de la santé publique du Canada. (2018). Cadre de conformité et d'application des règlements de l'ASPC.
- Agence de la santé publique du Canada. (2016). Exemptions de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines. Consulté le 5 août 2022.
- Gouvernement du Canada. ePATHogène - la base de données sur les groupes de risque.
- Gouvernement du Canada. Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes (FTSSP).
- Gouvernement du Canada. Maladies à déclaration obligatoire : Animaux terrestres.
- Gouvernement du Canada. Modèle modifiable d'évaluation des risques associés à l'agent pathogène.
- Organisation mondiale de la Santé. (2020). Laboratory Biosafety Manual, 4e éd, Genève, Suisse : Organisation mondiale de la Santé.
- Organisation mondiale de la santé animale. (2021). Code sanitaire pour les animaux terrestres (29e éd.). Consulté le 5 août 2022.
Normes techniques et codes
- ANSI/SMACNA 016-2012, HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2nd Edition. (2012). Chantilly, VA, États-Unis : Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association, Inc.
- ASME AG-1-2019, Code on Nuclear Air and Gas Treatment. (2019). New York, NY, États-Unis : The American Society of Mechanical Engineers.
- ASME N511-2017, In-Service Testing of Nuclear Air-Treatment, Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems. (2018). New York, NY, États-Unis : The American Society of Mechanical Engineers.
- CSA B64.10:F17/CSA B64.10.1:F17, Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des dispositifs antirefoulement. (C2021). Toronto, ON, Canada : Groupe CSA.
- CSA Z180.1:F19, Air comprimé respirable et systèmes connexes. (2019). Toronto, ON, Canada : Groupe CSA.
- IEST RP-CC001.6, HEPA and ULPA Filters. (2016). Arlington Heights, IL, États-Unis : Institute of Environmental Sciences and Technology.
- IEST RP-CC034.4, HEPA and ULPA Filter Leak Tests. (2016). Arlington Heights, IL, États-Unis : Institute of Environmental Sciences and Technology.
- NSF/ANSI 49-2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. (2021). Ann Arbor, MI, États-Unis : NSF International / American National Standards Institute.
Annexe A : Principales exigences législatives et réglementaires
| Principales exigences pour toutes les installations régies par la LAPHT (c.-à-d. les installations titulaires de permis et celles exemptées) |
Articles correspondants de la LAPHT |
|---|---|
| Toute personne qui, sciemment, effectue toute activité réglementée à l'égard d'agents pathogènes humains ou de toxines doit prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité du public contre les risques présentés par cette activité. | LAPHT 6 |
| Il est interdit d'effectuer toute activité à l'égard d'agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l'annexe 5 de la LAPHT. | LAPHT 8 |
Sauf en cas d'exemption, il faut obtenir un permis de l'ASPC avant d'être autorisé à effectuer l'une ou l'autre des activités réglementées suivantes :
|
LAPHT 7(1) |
| Principales exigences pour les installations titulaires de permis | Articles correspondants de la LAPHT ou du RAPHT |
|---|---|
| Exigences applicables aux permis | |
| Le demandeur de permis qui entend mener des travaux de recherche scientifique doit élaborer un plan décrivant les mesures administratives qui seront prises pour gérer et maîtriser les risques relatifs à la biosécurité et à la biosûreté pendant toute la période de validité du permis (c.-à-d. un plan de gestion des risques), et ce, avant que ledit permis ne puisse être délivré. | RAPHT 3 |
| Les demandeurs de permis sont tenus de désigner un ASB avant qu'un permis ne puisse être délivré. | LAPHT 36(1) |
| Conditions du permis | |
| Le permis est assujetti à des conditions, et le titulaire de permis ainsi que les personnes qui effectuent des activités réglementées autorisées par le permis doivent se conformer à ces conditions. | LAPHT 18(4); LAPHT 18(7) |
| Le titulaire de permis doit informer les personnes qui effectuent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci. | LAPHT 18(6) |
Les conditions suivantes s'appliquent à chaque permis :
|
RAPHT 4(1) |
La condition supplémentaire suivante s'applique aux permis qui autorisent des activités réglementées à l'égard des ABCSE :
|
RAPHT 4(2) |
| Toute condition qui s'applique expressément à un permis donné figure sur le permis même. La conformité avec les exigences applicables de la NCB sera comprise comme condition spécifique du permis. | LAPHT 18(4) |
| Exigences s'appliquant aux ASB | |
Les ASB doivent avoir la qualification minimale suivante :
|
LAPHT 36(3); RAPHT 8 |
L'ASB a les fonctions suivantes :
|
LAPHT 36(5); RAPHT 9(1) |
L'ASB a le pouvoir suivant :
|
LAPHT 36(5); RAPHT 9(2) |
| Exigences relatives aux Habilitations de sécurité en vertu de la LAPHT | |
Nul ne peut pénétrer dans les locaux d'une installation où sont autorisées des activités réglementées avec des ABCSE à moins d'être titulaire d'une Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT valide émise par l'ASPC ou d'être accompagné du titulaire d'une telle habilitation et d'être sous sa surveillance. La présente interdiction ne s'applique pas s'il n'y a aucun ABCSE dans les locaux concernés ou si les ABCSE qui y sont présents sont gardés sous clé et inaccessibles. |
LAPHT 33; RAPHT 28 |
Le titulaire d'une Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT ne peut accompagner et superviser qu'une seule personne ne détenant pas une telle habilitation à la fois (rapport de 1 pour 1); le titulaire doit se trouver dans la même pièce que la personne et surveiller ses activités en tout temps. |
RAPHT 23 |
Les personnes qui n'ont pas d'Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT ne peuvent être accompagnées ni supervisées si leur habilitation de sécurité a été suspendue, si on leur a déjà refusé une habilitation de sécurité ou si leur habilitation de sécurité a été révoquée (et qu'une nouvelle habilitation de sécurité n'a pas encore été émise). |
RAPHT 24 |
Pour obtenir une Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT, les demandeurs devront soumettre une déclaration signée par un titulaire de permis attestant qu'ils doivent obtenir une habilitation de sécurité pour avoir accès à certains locaux d'une installation. |
RAPHT 12(2)(m) |
L'Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT est transférable à d'autres installations, mais le titulaire d'une habilitation de sécurité doit fournir une nouvelle déclaration à l'ASPC, signée par le titulaire du permis, attestant qu'une habilitation de sécurité est nécessaire avant d'avoir accès aux locaux d'une installation non visée par l'habilitation de sécurité existante. |
RAPHT 18 |
| Exigences liées à la déclaration | |
Toute personne menant des activités réglementées autorisées par un permis doit informer le titulaire du permis et l'ASB lorsqu'elle a l'intention d'accroître la virulence, la pathogénicité ou la transmissibilité d'un agent pathogène, sa résistance envers les traitements prophylactiques ou thérapeutiques, ou la toxicité d'une toxine. |
RAPHT 5 |
Toute personne menant des activités réglementées autorisées par un permis doit informer immédiatement le titulaire de permis et l'ASB de tout rejet ou production involontaire d'un agent pathogène humain ou d'une toxine, de tout incident comportant un agent pathogène humain ou une toxine qui a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne, ou de toute situation où un agent pathogène ou une toxine aurait été volé ou aurait autrement disparu. |
LAPHT 15 |
| L'ASPC doit être avisée sans délai dans les situations suivantes : | |
|
LAPHT 12(1) |
|
LAPHT 12(2); RAPHT 9(1)(c)(ii) |
|
LAPHT 13 |
|
LAPHT 14 |
|
LAPHT 32; RAPHT 7 |
|
LAPHT 36(6) |
|
RAPHT 9(1)(c)(iii) |
|
RAPHT 19 |
L'ASPC doit être avisée dans les situations suivantes :
|
RAPHT 6(1) RAPHT 6(2) |
| Exigences relatives aux registres et à la documentation | |
| Le titulaire de permis conserve une liste des personnes autorisées à avoir accès à l'installation visée par le permis, y compris les titulaires d'une Habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT et les visiteurs. | LAPHT 31 |
| Le titulaire de permis doit conserver un registre comprenant le nom complet de chaque personne qui entre, accompagnée et sous surveillance, dans une installation où des ABCSE sont présents, la date, ainsi que le nom complet de la personne qui l'accompagne et la surveille. | RAPHT 25 |
| Principales exigences pour les importateurs régis par la LSA et le RSA | Articles correspondants de la LSA et du RSA |
|---|---|
| L'importation de tout animal ou tout autre organisme au Canada pourrait être interdite et sujette à la réglementation en vertu du RSA pour empêcher qu'une maladie ou qu'une substance toxique soit introduite au Canada ou qu'elle s'y propage. | LSA 14 |
| Il est interdit de posséder ou d'éliminer un animal ou une chose sachant qu'il a été importé en contravention à la LSA ou aux règlements. | LSA 15(1) |
Un permis d'importation d'agents zoopathogènes doit être obtenu auprès de l'ASPC ou de l'ACIA avant l'importation des éléments suivants :
|
RSA 51(a) et (b) |
Un permis d'importation d'agents zoopathogènes peut être délivré par l'ASPC ou l'ACIA, à condition que l'agence responsable soit satisfaite que l'activité visée par le permis n'entraîne pas ou qu'il soit peu probable qu'elle entraîne l'introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques ainsi que l'introduction ou la propagation de ces trois éléments de provenance canadienne dans tout autre pays. |
RSA 160(1.1) |
| Conditions d'importation d'agents zoopathogènes et de toxines | |
Il est interdit d'effectuer les activités suivantes, visées à l'article 51, à l'égard d'un agent zoopathogène ou d'une partie d'un tel agent (p. ex. une toxine) qui sont importés aux termes d'un permis :
|
RSA 51.1 |
| Tout permis d'importation d'agents zoopathogènes délivré en vertu du RSA renferme les conditions que l'ASPC ou l'ACIA jugent appropriées pour empêcher l'introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada. | RSA 160(1.1) et (2) |
| Tout titulaire d'un permis délivré en vertu du RSA doit se conformer aux conditions du permis d'importation d'agents zoopathogènes. | RSA 160.1 |