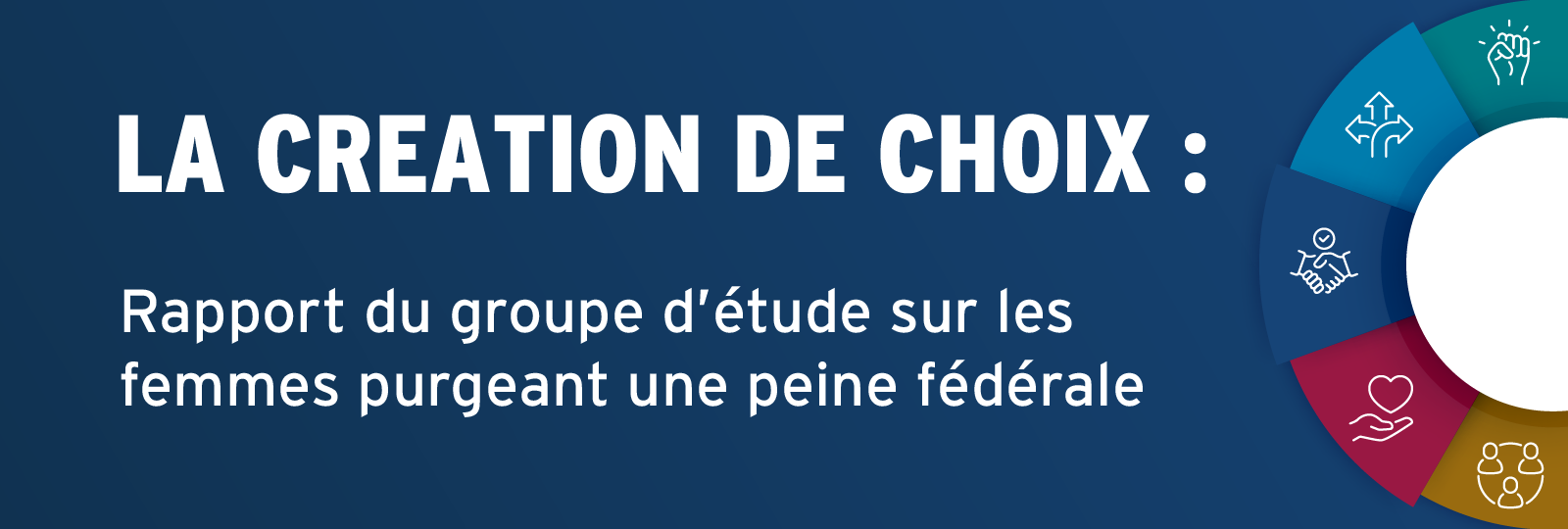Rapport sur la création de choix : le rapport du groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine de ressort fédéral
avril 1990
Coprésident(e)s :
Service correctionnel du Canada
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
Table des matières
- Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale
- Section A : La sagesse de différentes voix
- Section B : Adapter la sagesse aux réalités présentes
- Section C : Construire l’avenir avec sagesse
- Liste de documentation
Format alternatif
Je voudrais profiler de l'occasion pour renouveler l'engagement du gouvernement fédéral de promouvoir l'égalité économique et sociale des Canadiennes. En tant que membres d'une société fortement attachée aux principes de justice sociale, nous devons tous faire en sorte que les Canadiennes puissent participer pleinement et librement à tous les aspects de notre vie nationale.
Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale
Membres du comité de direction
Bonnie Diamond (coprésidente)
Directrice générale, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
James A. Phelps (coprésident)
Sous-commissaire, Programmes et opérations correctionnels, Service correctionnel du Canada
Rob Adlard
Directeur int., Planification opérationnelle et analyse des ressources, Gestion intégrée, Service correctionnel du Canada
Louise Bellefeuille
Directrice, Établissement de la Montée, Saint-François
Louise Biron
Secrétaire du Comité exécutif, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Représentante de la région du Québec
Adrienne Brown
Présidente, Comité consultatif des citoyens, Prison des femmes
Barbara Byers
Membre du Conseil d'administration, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Représentante de la région de l'Atlantique
Hélène Chevalier
Secrétaire exécutif, Commission canadienne des libérations conditionnelles
Don Clark
Sous-commissaire adjoint, Projets pilotes, Administration régionale de l'Ontario, Service correctionnel du Canada
Susan Christie
Analyste principale de la politique, Section de l'élaboration de la politique, Sous-Direction des programmer et de la politique, Ministère de la Justice
John Evans
Directeur général, Recherche correctionnelle et politique stratégique, Direction des affaires correctionnelles Secrétariat du Ministère, Solliciteur général du Canada
Lana Fox
Membre, Assemblée des femmes autochtones
Mona Fox
Agente principale des services sociaux, Direction du développement social, Services aux Indiens, Ministère des Affaires indiennes et du Nord
Betty Hopkins
Membre du Conseil d'administration, Association canadienne des sociétés, Elizabeth Fry, représentante de la région des Prairies
Donna Howell
Coordonnatrice nationale des programmes correctionnels pour les femmes, Armée du Salut
Betty Lee
Présidente, Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada
Ingrid Leonhard
Superviseure de section. Bureau des libérations, Conditionnelles de North Vancouver, Service correctionnel du Canada
Sandra Lyth
Coordonnatrice, Groupe de travail sur les programmes, Administration régionale de l'Atlantique Service correctionnel du Canada
Margaret MacGee
Présidente, Comité spécial sur les femmes et la justice pénale, Conseil national des femmes du Canada
Debbie Meness
Directrice exécutive, Association des femmes autochtones du Canada
Louise Paquin
Directrice int., Section de l'élaboration de la politique, Sous-direction des programmes et de la politique Ministère de la Justice
Karen Paul
Membre, Assemblée des femmes autochtones
Anita Pratt
Membre, Assemblée des femmes autochtones
Janice Russell
Chef, Planification, Administration régionale du Québec, Service correctionnel du Canada
Michelle Simms
Coordonnatrice et directrice générale, Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada
Beth Stacey
Membre du Conseil, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Représentante de la région de l'Ontario
Kay Stanley
Coordonnatrice, Condition féminine Canada
Fran Sugar
Membre, Assemblée des femmes autochtones
Romola Trebilcock
Chargée de projet, Initiatives spéciales, Région des Prairies, Service correctionnel du Canada
Sharon Waddell
Directrice générale, Direction du développement social Services aux Indiens, Ministère des Affaires indiennes et du Nord
Susan Williams
Membre exécutif, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry Représentante de la région de la Colombie- Britannique
Membres du groupe de travail
Jane Miller Ashton (coprésidente)
Directrice, Programmes pour les délinquants autochtones et de sexe féminin, Service correctionnel du Canada
Felicity Hawthorn (coprésidente)
Présidente sortante, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
Mary Cassidy
Directrice, Prison des femmes, Service correctionnel du Canada
Maureen Evans
Vice-présidente, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
Sharon McIvor
Membre Conseil exécutif, Association des femmes autochtones du Canada
Patricia Monture
Professeure, Dalhousie Law School, Membre, Assemblée des femmes autochtones
Rosemary O'Brien
Conseillère spéciale int., Programmes pour les délinquantes, Service Correctionnel du Canada
Hilda Vanneste
Présidente, Groupe du travail sur l'examen des politiques fédérales-provinciales, Service Correctionnel du Canada
Diane Wilkinson
Directrice générale, Société Elizabeth Fry du centre de l'Okanagan
Sally Wills
Directrice générale, Société Elizabeth Fry de Kingston
Remerciements
Les membres du Groupe d'études sur les femmes purgeant une peine fédérale remercient les personnes et les organismes suivants de leur contribution. Nous savons gré à chacun de l'aide, des conseils et du soutien que nous avons reçus.
- Toutes les femmes purgeant une peine fédérale qui ont présenté un exposé oral ou écrit au Groupe d'étude ou qui ont participé aux recherches commandées par le Groupe d'étude;
- toutes les autres personnes ou les organismes qui ont présenté un exposé oral ou écrit au Groupe d'étudeNote de bas de page i ;
- toutes les personnes qui nous ont aidés à planifier, à organiser ou à transcrire les consultations du Groupe d'étude;
- Bob Cormier, directeur de la Recherche et du développement de programmes au Secrétariat du ministère du Solliciteur général qui a parrainé certains des projets de recherche du Groupe d'étude;
- les chercheuses: Lee Axon, Johanne Blanchette, Karen Lee Cannings, Lana Fox, Tina Hattem, Karen Rogers, Lee Seto-Thomas, Margaret Shaw, Fran Sugar, Lada Tamarack;
- le personnel de soutien du Service correctionnel du Canada: Marian Price, Pauline Montreuil, Claire Newton, Sheila Percival, Monique Sabourin, Marg Walsh;
- Stan Fields, directeur des Finances; Vern MacLean, commis à la Comptabilité et aux contrats; le personnel de la Direction des finances du Service correctionnel du Canada; Mista Hiya, shaman; Claire Kearney, int./Superviseur, Imprimerie, Service correctionnel du Canada, et son personnel, Jean-Guy Lamothe, int./Superviseur, Salle de Courrier, Service correctionnel du Canada, et son personnel, Joan Lavalée, Ainée; Linda MacLeod, expert-conseil auprès du Groupe d'étude, rédactrice et réviseure; Jennifer Abbott, réviseure adjointe; Aline Manson, Annik Boutin, Thérèse Dion-Renauld, et personnel, département de traduction, pour la traduction française, et Louise Biron, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Région du Québec, et Anita Pratt, Assemblée des femmes autochtones, pour la révision de la traduction française; Pamela Mayhew, adjointe exécutive, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry; Ted Pender, directeur de la Direction de la gestion du matériel, Service correctionnel du Canada, et son personnel; les responsables provinciaux et territoriaux des services correctionnels et leur personnel qui ont facilité la recherche et les consultations aux installations provinciales et territoriales; Thomas Townsend, directeur général p.i. des Programmes pour les délinquants, Service correctionnel du Canada;
- tous les organismes qui ont permis à leurs membres ou à leurs employés de participer au comité de direction ou au groupe de travail du Groupe d'étude:
- Assemblée des femmes autochtones
- Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
- Comité consultatif de citoyens, Prison des femmes
- Service correctionnel du Canada
- Ministère des Affaires indiennes et du Nord
- Ministère de la Justice du Canada
- Secrétariat du ministère du Solliciteur général du Canada
- Conseil national des femmes du Canada
- Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada
- Commission nationale des libérations conditionnelles
- Association des femmes autochtones du Canada
- Armée du Salut
- Condition féminine Canada;
- les époux, les conjoints et les familles des membres du Groupe d'étude.
Préface
La souffrance est souvent l'antécédent du changement. Tel fut très certainement le cas pour le Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale qui a puisé à même les expériences vécues et les souffrances décrites par ces femmes pour créer sa vision du changement. Les membres du Groupe d'étude ont écouté les femmes purgeant une peine de deux ans ou plus qui leur ont confié les douleurs vécues tant au sein du système de justice pénale qu'à l'extérieur. Nous avons pris connaissance des déchirements vécus par les familles et les amis de ces femmes. Et nous avons songé souvent aux torts soufferts par les victimes de la criminalité.
Chacun d'entre nous, homme ou femme, qui a participé au Groupe d'étude a été touché par cette souffrance. A celle-ci s'est rajoutée notre frustration devant l'ampleur de la tâche à accomplir. Notre mandat consistait à examiner la gestion des femmes purgeant une peine fédérale, depuis le début de la peine, jusqu'à la date d'expiration du mandat et d'élaborer un plan pour orienter ce processus de façon à ce qu'il réponde aux besoins tout à fait particuliers de ce groupe. Cependant, nous avons entrepris notre tâche en sachant très bien que les besoins et la situation des femmes purgeant une peine fédérale avaient été étudiés à maintes reprises déjà sans pour autant que ne changent les problèmes vécus par ces femmes, leurs victimes et les personnes qui ont tenté de leur venir en aide. Que pouvions-nous faire pour apaiser cette souffrance?
Ce sont les femmes condamnées à une peine de deux ans ou plus qui nous ont elles-mêmes donné l'énergie et la volonté nécessaires pour créer une nouvelle vision axée sur la création de choix. En dépit de la douleur de leur situation, de leurs mauvaises expériences antérieures avec les groupes de travail et les recherches, et en dépit de leur sentiment d'impuissance et de méfiance, ce sont ces femmes qui ont fourni leurs idées et leurs espoirs au Groupe d'étude.
Ces femmes nous ont aussi incité à jeter un regard neuf sur leurs besoins et à valoriser la coordination et la sagesse acquises par ce groupe. Les membres du Groupe d'étude étaient fermement engagés à travailler en collaboration et étaient convaincus de pouvoir ensemble trouver des solutions. La co- présidence était assurée par l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et le Service correctionnel du Canada. Des représentants d'un large éventail de groupes communautaires et d'organismes gouvernementaux se sont réunis pour former un comité de direction et un groupe de travail. Les femmes autochtones, malgré leurs réserves au sujet du mandat et de la structure du Groupe d'étude, ont accepté de participer au projet parce qu'elles étaient préoccupées par le sort des nombreux citoyens de nos divers peuples qui souffrent tous les jours au sein du système de justice pénaleNote de bas de page ii .
Le Groupe d'étude a axé toute sa stratégie sur les femmes. Tout au long de son travail, il a donné le pouvoir aux femmes et a par conséquent beaucoup appris de l'expérience de ces dernières. En outre, la plupart des membres et tous les chercheurs du Groupe d'étude étaient des femmes. Des entrevues et les consultations menées auprès d'un grand nombre des femmes purgeant une peine fédérale en prison et à l'extérieur constituent une partie essentielle de notre travail.
Le processus lui-même a été souvent douloureux. Les membres tenaient à fonctionner par consensus, aussi difficile que cela ait pu être. Cette démarche nous a appris que seuls ceux qui sont traités avec respect et jouissent d'un minimum de pouvoir peuvent assumer la responsabilité de leurs gestes et faire des choix valables. Nous avons tenu compte de cette leçon quand nous avons effectué notre travail et créé notre vision du changement. Nous sommes parvenus à comprendre comme il était important pour les femmes purgeant une peine fédérale et pour nous tous d'avoir la possibilité de faire des choix.
Le plan recommandé qui est présenté dans ce rapport s'inscrit dans le contexte d'un objectif à long terme: une situation dans laquelle l'incarcération ne sera pas la solution de choix, dans laquelle le tort fait aux victimes, aux femmes purgeant une peine fédérale, aux collectivités et à la société sera redressé dans la mesure du possible et dans laquelle les peuples autochtones pourront administrer eux-mêmes leur système judiciaire.
L'objectif à long terme est la prévention. Pour apaiser la souffrance qui en porte certains à agir de façon à nuire aux autres, nous devrons supprimer les injustices qui réduisent les choix et prévenir la violence qui engendre la violence. La création de stratégies préventives qui donneront des choix valables aux femmes purgeant une peine fédérale réduira la criminalité et donnera plus de choix à tous les Canadiens. Notre société deviendra par conséquent un milieu plus sûr.
Notre plan recommandé ne constitue qu'une première étape dans une longue série de changements que doit subir notre système de justice ainsi que l'ensemble de notre société. Le processus est déjà amorcé. Au cours des dix dernières années et plus particulièrement au cours des derniers mois, notre système de justice a fait l'objet d'un examen minutieux servant à déterminer si ce système reflète les valeurs et les réalités de notre époque. L'examen exhaustif de notre Code criminel, l'enquête sur l'affaire Marshall, l'enquête sur la justice pour les autochtones du Manitoba, les efforts déployés par les femmes pour jouir de l'égalité prévue par la Charte des droits de la personne et la Commission des droits de la personne et l'autonomie administrative réclamée par les peuples autochtones, voilà autant d'éléments qui témoignent du vif désir des Canadiens de promouvoir l'égalité, l'équité et la justice sociale à grande échelle, volonté qui ne se reflète pas encore malheureusement dans le système pénal.
Ce mouvement de réforme est fortement appuyé par Ole Ingstrup, Commissaire du Service correctionnel du Canada. Sous sa direction, l'énoncé de mission et tous les principes de fonctionnement du Service correctionnel du Canada ont mis l'accent sur le partage des responsabilités, la réinsertion sociale, l'égalité, le traitement humain et le respect. Un des objectifs de cette nouvelle mission consiste à veiller à ce que l'on réponde aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale. Comme l'a affirmé l'ancien Solliciteur général du Canada, Pierre Blais, nous devons commencer à travailler immédiatement pour trouver des solutions à long terme aux problèmes des femmes purgeant une peine de deux ans ou plusNote de bas de page iii .
Désirant, nous aussi, apaiser la souffrance des femmes purgeant une peine fédérale et fournir à ces dernières un éventail complet de choix, nous, les membres du Groupe d'étude, présentons notre recommandation: fermer les portes de la Prison des femmes une fois pour toutes et rapprocher les femmes purgeant une peine fédérale de leur communauté.
Nous avons franchi une première étape dans le processus essentiel du changement. Nous vous invitons maintenant à tirer leçon aussi de la souffrance et à participer au processus afin de nous aider à réaliser notre vision commune.
Section A : La sagesse de différentes voix
Chapter I : La voix des femmes purgeant une peine fédérale
«Nous avons souvent dit que les femmes incarcérées s'entendent pour s'entraider, qu'il leur faut seulement des ressources, un soutien et une aide appropriés. Les sommes que l'on consacre à des études seraient dépensées à bien meilleur escient si elles étaient affectées aux visites des familles, à une aide culturelle appropriée et à la réduction de notre impuissance à nous guérir nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que les conditions carcérales empirent. Nous réclamons à grands cris un processus valable de guérison qui aurait une influence réelle sur nos vies et dont les objectifs et la mise en place répondraient à notre besoin de guérison et d'équilibre» (L. Fox et F. Sugar)Note de bas de page iv .
Ces paroles et celles de toutes les autres femmes incarcérées dans des prisons fédérales qui ont communiqué avec nous en personne ou par écrit ont apporté aux membres du groupe de travail pondération et pierre de touche. Lorsque nous étions tentés de faire passer nos mots et nos idées avant ceux des femmes qui purgent une peine dans une prison fédérale, leurs voix nous ont ramenés à la signification de nos gestes et au besoin urgent de bienveillance.
La présence et la participation importantes de Lana Fox et de Fran Sugar, deux femmes qui ont purgé une peine fédérale et qui ont accepté de se joindre au comité de direction du Groupe d'étude, nous rappelaient constamment la souffrance et la force des femmes qui purgent des peines dans des prisons fédérales.
Cette prise de conscience a été accentuée de façon dramatique par le suicide, pendant les travaux du Groupe d'étude, de deux femmes qui purgeaient une peine fédérale. La mort de Sandy Sayer et de Pat Bear a bouleversé et affecté profondément tous ceux d'entre nous qui veulent la justice et l'équité pour les femmes qui purgent une peine fédérale.
Les expériences et les paroles de ces femmes, leurs vies et leurs morts, ont confirmé tous ceux qui ont collaboré au Groupe d'étude, dans leur engagement à «dire la vérité et de faire en sorte qu'elle soit entendue»Note de bas de page v .
En reconnaissance de la sagesse et de l'équilibre que ces femmes nous ont apportés, les membres du Groupe d'étude dédient ce rapport à toutes les femmes qui purgent une peine fédérale. Leurs paroles, leur souffrance, leur force et leurs espoirs ont guide nos travaux, notre vision et nos recommandations. Leurs paroles sont à l'origine de toutes celles qui vont suivre.
La prison c'est
La prisons c'est «le combat pour survivre à la douleur»
La prison, c'est de la frustration et de la colère si intenses que de m'entailler les artères du bras ne fait que soulager un peu de cette souffrance.
Ça été très dur pour moi de purger une peine à long terme dans un établissement provincial, tout en étant préférable à un éloignement de ma famille. C'était démoralisant d'observer les arrivées et les départs des femmes en brave détention et de me demander quand ce serait mon tour.
Un des meilleurs programmes ici est la thérapie pour les cas d'abus sexuel, mais la liste d'attente est longue. Je me demande si ma souffrance peut attendre.
Si mon petit frère était mort dans une grande ville d'Ontario plutôt que dans une réserve de la Saskatchewan, je sais que j'aurais eu la permission d'aller à ses funérailles.
La prison, c'est être émotionnellement mise à nu pour la première fois de sa vie, sans aucun endroit où se cacher Je construis des murs autour de mes sentiments et je barricade mon coeur du mieux que je peux. Je compte les mois, les jours qui restent jusqu'à la cantine, jusqu'au verrouillage, jusqu'à ma libération. Je me sens parfois angoissée et profondément déprimée quand je consulte le calendrier. Le monde extérieur est toujours plus loin avec chaque nouvelle saison. Ma survie ici, c'est tout ce que j'ai.
La prison, c'est « être à plus de 3000-kilomètres de chez soi »
Il n'y a rien de plus difficile que de faire face à des enfants qui ne te connaissent pas. Faire de la prison n'est rien par comparaison.
Nous devons payer nos appels à la maison ou en virer les frais, ce que ma famille ne peut pas se permettre.
Nous avons besoin qu'on nous donne la chance de gagner la confiance de nos enfants. La distance et l'argent y font sérieusement obstacle.
Je ne pouvais croire qu'on m'envoyait aussi loin de chez moi. Je n'étais même jamais sortie de ma vie de (nom de la province maritime)* uparavant.
Je suis restée là (à la prison provinciale)* seulement parce que je tenais à mes liens avec ma famille. Mais il n'y avait aucun programme pour quelqu'un qui purgeait une longue peine. Je pense qu'on n'aurait pas dû me forcer à choisir entre la vie en prison et ma vie à l'extérieur.
La prison m'a dépouillée de tout, non seulement des biens matériels, mais de toutes les relations de ma vie.
Quand on est plus près de chez soi, on est plus près de la libération.
Même pour moi qui viens du sud de la Saskatchewan, c'est trop loin pour que mes enfants puissent venir me voir. Pour les femmes en prison, une chose qui nous soutient c'est la pensée que nos enfants attendent notre retour à la maison.
L'an dernier, j'ai vu ma mère pour la première fois depuis six ans et je l'ai trouvée vieillie, fragile, presque une étrangère. C'est très mal, cruel et inhumain de nous séparer ainsi de nos familles. Nous avons gravement besoin d'établissements dans nos propres provinces.
La prison, c'est n'avoir « aucune chance de travail véritable »
Ici, ça fait maintenant cinq ans que je suis commis. C'est le poste le moins élevé que j'ai jamais eu de toute ma vie. J'ai perdu tellement d'aptitudes depuis que je suis ici. Je travaillais pour un vice-président auparavant. On a besoin de beaucoup de choses, comme des ordinateurs et des appareils de traitement de texte plus modernes.
Je pense qu'on devrait me permettre de gagner ma libération en travaillant seulement, il n'y a pas de véritable travail ici.
Nous avons besoin de nous engager dans la collectivité pour demeurer saines. J'ai fait du bénévolat toute ma vie Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir plus souvent? Nous y gagnerions et d'autres personnes aussi par le fait même.
Les cours actuels de coiffure et de menuiserie s'avèrent inutiles pour faciliter l'emploi après la libération. Nous avons besoin de programmes et de formation professionnelle pour aider les femmes à devenir autonomes ici et après leur libération.
Il y a beaucoup de femmes intelligentes ici mais pas d'espace pour se développer Ce que je veux dire, c'est que la sécurité et la structure de cet établissement nuisent à une bonne programmation.
One of the biggest work programs here is the laundry - but you don't even get to operate the machines - the program staff do that part.
Un des programmes de travail les plus importants ici, c'est la lessive mais on ne nous permet même pas de faire fonctionner les machines nous-mêmes c'est le personnel affecté aux programmes qui s'en charge.
La prison, c'est « la privation d'identité et de voix »
Il suffit d'une seule gaffe pour ruiner sa réputation. Si vous perdez le contrôle une fois, vous êtes finie pour le reste de votre peine C'est naturel pour les femmes gui purgent une peine de 25 ans d'être en colère, frustrées. On devrait être plus compréhensif au lieu de tout traiter comme une infraction sérieuse On ne fait qu'empirer la situation.
Si je partais d'ici pour retourner chez moi (dans un établissement de ma province), je pense que je perdrais tout mon intimité, mes biens, le droit de porter mes propres vêtements et la chance d'établir des liens étroits.
On entre ici adulte et on en ressort enfant.
J'aimerais savoir pourquoi des personnes comme moi, qui à l'extérieur étaient des gens parfaitement acceptables, réfléchies, respectées et écoutées ne sont pas crues par les autorités de la prison. Pourquoi faut-il que mes paroles soient censurées ou rejetées?
Pourquoi est-ce que j'ai été témoin de plus de 100 coups de couteau, essuyé des litres de sang sur les planchers et les murs et transporté des matelas imbibés de sang jusqu'aux poubelles extérieures tenu dans mes bras des femmes qui saignaient et criaient, pourquoi? Pourquoi croit-on toujours SEULEMENT les gens de la sécurité?
Ma mère devait amener mes enfants me voir. Une couple de jours avant la visite, on m'a dit que je m'en allais à la Prison des femmes. On ne vous avertit jamais à l'avance qu'on va vous transférer, parce que vous pourriez faire un tas d'histoires.
La procédure de règlement des griefs ici est très embourbée. Ça prend des mois juste pour avoir une lettre qui vous informe du retard, sans parler du temps qu'on prend à répondre à votre grief.
La prison, c'est « la vie sous des étiquettes et la violence du racisme »
C'est le racisme, dont le passé est dans nos mémoires et qui est présent dans notre environnement, qui contrecarre les tentatives des non-autochtones de rebâtir nos vies. Les programmes actuels ne peuvent nous atteindre, ne peuvent surmonter les barrières de méfiance élevées par le racisme. Typiquement, les médecins, les psychiatres et les psychologues sont tous des hommes et tous blancs. Comment pouvons-nous être guéries par ceux qui symbolisent les pires expériences de notre passé?
Avant le procès, après notre arrestation, nous avons besoin de soutien. La plupart d'entre nous ont été élevées dans des endroits résidentiels comme des prisons et les juges nous condamnent pour ça. Je crois que nous sommes des victimes soumises à des représailles. Nous obtenons des peines fédérales pour évasion de prison et pourtant c'est tout ce que nous ayons jamais fait, nous enfuir des institutions.
La différence majeure est le racisme. Nous y sommes confrontées en naissant et pendant toute notre vie. Notre expérience de vie en est pétrie. Il engendre la violence, une violence dirigée contre nous, puis la nôtre en retour. La solution est la guérison : guérison par les cérémonies traditionnelles, le soutien, la compréhension et la compassion qui va nous conduire, les femmes autochtones, à améliorer notre sort et celui de nos familles et de nos communautés.
Écoutez-nous
Écoutez-nous... « Il faut qu'il y ait des choix et des occasions favorables si nous devons prendre nos vies en main»
Pourquoi n'y aurait-il pas une garderie à la Prison des femmes?
Il faut offrir des cours de soins aux enfants et de rôle parental à toutes les mères en prison. A leur libération, elles se trouvent handicapées pour ce qui est du soin des enfants.
Je pense que je suis perçue comme mauvaise parce que je ne veux pas voir le psychiatre. J'ai horreur qu'on fouille dans ma vie privée il n'y a pas de services autochtones.
Grâce à la sororité autochtone, j'ai finalement appris le sens de la spiritualité. J'ai appris comment prier en transe et avec de l'herbe sainte. J'ai appris la signification de la plume et des couleurs de l'aigle. Avec ça, j'étais encore plus fière de mon identité.
Quand votre famille vient vous visiter, on ne devrait pas, pour aucun motif, vous refuser la permission de la recevoir.
Après 16 heures, si tu veux une collation, il n'y a que du pain et du beurre d'arachides. Passer de la nourriture en fraude est une infraction. Pourquoi ne peut-on nous offrir des aliments nutritifs?
Les transferts obligatoires des établissements provinciaux à la Prison des femmes doivent cesser. Les autochtones sont particulièrement sujettes à ces pratiques discriminatoires.
La prison ne m'a rien apporté! La sororité m'a tout donné, mais le Bureau des libérations conditionnelles n'a pas compris ce qu'elle avait été pour moi.
Nous devrions avoir les mêmes chances que les hommes. Pourquoi ne pouvons-nous pas être plus près des nôtres et bénéficier quand même des programmes dont nous avons besoin?
Si je n'avais pas pu venir à cette maison de transition, j'aurais été perdue. Qu'arrive-t-il aux femmes qui, à leur libération, n'ont personne pour les accueillir ou aucun endroit où se réfugier? J'imagine qu'elles restent tout simplement en prison.
Une expérience de frustration et de futilité des femmes (membres du Groupe d'étude)charitables et bien intentionnées sont venues nous rendre visite ce matin. Nous voulions parler des améliorations à apporter à ce pénitencier. Elles voulaient parler de la nécessité de bâtir d'autres prisons. Mais tout le monde devrait parler plutôt d'abolir les prisons!
Écoutez-nous... «Nous avons besoin de soutien dans notre projet d'une vie nouvelle»
Les femmes autochtones doivent s'entraider. Vous n'avez pas vécu cette vie-là, alors vous ne pouvez comprendre.
Je pense que la meilleure façon de nous aider est un programme de planification pré libératoire. Nous avons besoin de subventions, d'emplois et de logements. Nous avons besoin d'une initiation graduelle au fait de se retrouver sur la rue. Nous avons besoin d'un programme pré libératoire pour les autochtones.
J'ai grand besoin d'un soutien organisé. Je ne suis pas prête à retourner sur la rue.
Je ne peux jamais voir mon agent de classement ou de gestion des cas. Elle est toujours trop occupée. Je pense que les agents devraient venir nous voir quand nous avons besoin d'elles, et non l'inverse.
Les victimes d'abus ont toutes besoin de compréhension, d'amour aussi. Je pense que l'amour nous donne le sens des responsabilités. Il suffit qu'une seule personne croie en nous et cela nous donne de l'espoir. Si, dans le système carcéral, nous sommes coupées des agents de classement ou de gestion des cas comme la plupart des autochtones le sont, nous avons sûrement besoin du soutien communautaire.
Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas payer pour les visites des enfants à leurs parents en prison? Même une seule fois par année, ça aiderait.
La famille fait partie de l'intégration. Tous ses membres devraient participer à une session de counseling. Il faut maintenir les liens avec la famille. Devant une question de vie ou de mort, qui avons- nous nos familles. La Prison des femmes et le Bureau national des libérations conditionnelles nous séparent, nous interdisent de communiquer avec notre mari, nos soeurs, nos frères, et même les associés, ou comment les appellent-ils? Les criminels notoires s'il vous plaît à ce compte-là, mon grand- père, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes frères, mes soeurs, la nation autochtone au complet seraient des criminels notoires.
Ça fait du bien de parler de mon problème de drogue avec des gens de l'extérieur. Came donne de l'espoir. Je me dis que s'ils sont capables de le faire, je le peux moi aussi.
Écoutez-nous... «Je ne suis pas une menace à la société»
J'étais terrifiée lorsque j'ai vu la Prison des femmes pour la première fois. Ça m'a fait penser à des prisons que j'avais vues à la télévision, et je savais que j’en étais pas comme ça que je n'avais pas besoin d'un endroit comme ça. Mais je n'avais pas le choix. Je me sentais tellement seule.
Tout le monde est traité avec sécurité maximale ici des colis aux programmes.
On parle d'ouvrir un pénitencier à sécurité minimale pour les femmes à Kingston. Il y aura onze places. Mais il y en a tellement qui seraient admissibles. Comment se fera la sélection?
Être une femme et être considérée comme violente, c'est être marquée de façon particulière aux yeux des autorités des prisons où les femmes purgent des peines et aux yeux du personnel surveillant. Dans une prison pour hommes, nos crimes auraient beaucoup moins d'importance. Parmi les femmes, nous (les autochtones) ne correspondons pas aux stéréotypes et sommes automatiquement craintes, et étiquetées comme ayant besoin d'un traitement spécial. L'étiquette "violente" engendre un cycle destructeur perpétuel pour les femmes autochtones à l'intérieur des prisons.
Les femmes n'ont pas besoin d'une discipline plus sévère, mais, comme toujours, des bienfaits de la décence et du bon sens dans leurs vies Des cadres communautaires et le souci de modèles constructifs à imiter aideraient à réparer des vies brisées mieux que des coups de massue assénés aux «moi » déjà fragiles et à des esprits blessés.
Écoutez-nous... «C'est le temps d'agir»
J'ai planté des arbres pour gagner ma vie. Nous redonnions la vie aux arbres. Qui redonne quelque chose aux personnes condamnées à perpétuité dans les prisons du Canada?
Moi et les femmes comme moi, qui contribuons à ce chapitre, sommes la chair qui a nourri la raison d'être de ce Groupe d'étude. Nos plaidoyers montent de nos coeurs et de nos âmes. Nous témoignons de la souffrance humaine, des larmes et du sang versé à l'intérieur des prisons au nom de la justice. AIDEZ A METTRE FIN AUX ABUS.
D'une certaine façon, je n'ai rien en commun avec les femmes qui purgent une peine provinciale ici qu'est-ce que 14 jours comparé à la perpétuité? Qu'est-ce que s'ennuyer un peu de son copain comparé à la privation de la chance d'être une épouse et une mère? Et pourtant, j'ai tout en commun avec elles : la langue, des antécédents d'abus dont nous avons été victimes et de manque d'estime de soi, ainsi que le besoin de reprendre la maîtrise de nos vies. Tout ce qui peut être fait pour m'aider, tout ce que je peux faire pour moi-même, les aidera elles aussi. C'est la même histoire.
Je me sens frustrée, coupable et impuissante comme membre du comité de direction de ce Groupe d'étude. Nous sommes assises ici à traiter de questions bureaucratiques et de plans à long terme tandis que les conditions de vie à la Prison des femmes empirent et que la souffrance humaine continue.
Je suis vraiment consciente des efforts que vous (le Groupe d'étude) consacrez à tout cela. J'ai personnellement un certain espoir qu'on pourra apporter de véritables changements pour les femmes.
Le point de départ de l'action ne se trouve pas dans des discussions abstraites mais dans les expériences des femmes elles-mêmes.
Chapter II : La voix des peuples autochtonesNote de bas de page vi
Les femmes purgeant une peine fédérale constituent l'extrémité du continuum des femmes à risque» quant aux sanctions du droit criminel. Ce schéma a été identifié tôt dans les travaux du Groupe d'étude. Les femmes à risque (et particulièrement les femmes purgeant une peine fédérale) sont les femmes les moins avantagéesNote de bas de page vii de la société canadienne. Les statistiques indiquent que les peuples autochtones constituent la collectivité la plus défavorisée de notre société.Note de bas de page viii Les femmes autochtones sont encore plus démunies. Lorsque la question des services correctionnels se pose ainsi, la réponse doit se trouver dans la création et l'offre de choix valablesNote de bas de page ix . De fait, c'est là un des thèmes et la philosophie même du rapport du Groupe d'étude.
On doit offrir des choix aux femmes. C'est également vrai pour les femmes autochtonesNote de bas de page x que pour toutes les femmesNote de bas de page xi . De tout temps, le manque d'options pour les femmes a clairement caractérisé le système de justice pénale en général, et le système pénitentiaire fédéral en particulier. Le mandat de notre Groupe d'étude était de revoir les politiques fédérales régissant, en tant que femmes, celles condamnées à une peine, tâche à laquelle ne se sont pas attaqués les nombreux rapports antérieurs sur la Prison des femmes. Auparavant, les femmes étaient de simples ajouts au système fédéral d'incarcération des hommes. Dans les années 1980, on a reconnu que cette situation était à la fois irréaliste et paternaliste. C'est l'expérience des femmes elles-mêmes qui doit guider leurs choix et leur avenir. De même, le fait d'inclure les femmes autochtones dans l'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale relève de la même erreur que de placer les femmes à la remorque d'un système conçu par et pour des hommes. Cela ne signifie pas qu'il aurait fallu constituer un groupe d'étude distinct sur les femmes autochtones. Il s'agit simplement de reconnaître que la maîtrise de notre avenir en tant que peuples autochtones et de nos choix en tant que femmes autochtones doit appartenir aux communautés autochtones et aux femmes autochtones.
Notre expérience distincte à titre de femmes autochtones doit être reconnue. Nous ne pouvons pas être uniquement des femmes ni uniquement des autochtones. Notre race et notre sexe sont intimement liés. Nos identités de femmes découlent des enseignements de nos diverses nations autochtones. Il ne faut pas banaliser le fait que nous sommes distinctes.
Être distinctes signifie qu'à l'intérieur de cette nouvelle philosophie correctionnelle axée sur les choix, il faut garantir aux femmes autochtones des choix valables. Les femmes autochtones ont une conception différente de la famille. Nous avons une vue une vue du monde différente, basée sur le lien symbolisé par le cercle et, partant, notre façon de voir rejette les hiérarchies. On appelle souvent cela l'intérêt collectif par opposition à l'intérêt individuel. Les femmes autochtones ont un ordre de valeurs différents, bien que les valeurs considérées importantes sont les mêmes, croyons-nous. Notre compréhension de l'histoire est différente et modèle nos perceptions. Il faut en conclure que, à l'intérieur de la philosophie axée sur les choix, la gamme des choix ne demeurera pas toujours la même.
Non seulement ne pouvons-nous pas séparer l'autochtone de la femme, mais il importe de comprendre que nous partageons avec tous les autochtones un passé commun. Ce passé commun est fait de racisme, d'oppression, de génocide et d'ethnocide. C'est encore une autre façon dont nous nous distinguons. Ce passé collectif a une double incidence sur les femmes autochtones purgeant une peine fédérale. Premièrement, comme le racisme dans les prisons ou dans le système de justice pénale a été grandement laissé pour compte ou a disparu, la situation des femmes autochtones à titre de membres de la société canadienne ne peut pas être comprise par les autorités pénitentiaires ou la bureaucratie correctionnelle, les mêmes qui ont toujours administré la justice pénale. Cela a conduit les femmes autochtones purgeant une peine fédérale à une situation impossible. Elles ne peuvent avoir confiance aux personnes qui détiennent la clé de leur libération. Cette absence de confiance n'est pas attribuable à la seule faute de particuliers (femmes incarcérées ou personnel correctionnel), mais à un refus systématique de prendre conscience du racisme. Il faut reconnaître que le racisme qui infeste la justice pénale n'est pas subi uniquement par les femmes autochtones, mais par d’autres cultures et races aussi.
Deuxièmement, étant donné que L'incarcération d'une femme autochtone ne se rapporte qu’à l'incident ou aux incidents qui sont la cause de ses démêlés avec la justice, elle ne peut guérir, puisque sa souffrance provient des sévices dont elle a été victime toute sa vie. Ce point a été clairement établi dans l'étude de Margaret Shaw, qui se penche sur la difficulté qu'ont de nombreuses prisonnières autochtones soit s’exprimer au personnel, soit à faire reconnaître leurs habiletés personnellesNote de bas de page xii . Cette théorie est corroborée par d'amples témoignages de la violence et des sévices qu'ont eu à subir les femmes dont le Groupe d'étude a étudié le casNote de bas de page xiii . L'affrontement de leur culpabilité criminelle ne leur procure pas une guérison complète.
Pour résumer en des mots plus éloquents que les nôtres, Fran Sugar et Lana Fox expliquent :
"La compréhension que nous avons de la loi, des tribunaux, de la police, du système judiciaire et des prisons est entièrement tributaire de vies entières marquées par le racisme. Le racisme ne se traduit pas seulement en actes manifestes, bien que la plupart d'entre nous avons connu sa haine directe, nous sommes fait traiter de "sales indiennes" à l'école, dans des familles d'accueil, par la police, par des gardiens ou avons vu les différences dans la façon de nous traiter et avons compris que ce n'était aucunement accidentel. Le racisme est beaucoup plus étendu que cela. Culturellement, économiquement et en tant que peuples, nous avons été opprimés et rejetés par les Blancs. On nous a envoyés vivre dans des réserves, nous privant de gagne-pain, nous imposant des règles sans notre assentiment et nous rendant dépendants de services que nous ne pouvions nous offrir nous-mêmesNote de bas de page xiv ."
Le racisme est une barrière systématique qui opère dans les prisons simplement comme un reflet et une extension de la société extérieure dominante. La réalité, c'est que le racisme a engendré une situation telle que les femmes autochtones purgeant des peines fédérales ne peuvent qu'être lésées davantage.
Il faut reconnaître que le racisme qui nous opprime est une violence. Comme les autochtones comprennent qu'oppression égale violence, il est essentiel que le personnel, et plus particulièrement les responsables des programmes et des soins médicaux, soient des autochtones. C'est comme reconnaître qu'il est préférable que certaines fonctions de sécurité et de programmation soient assumées par des femmes plutôt que par des hommes dans les pénitenciers pour femmes. Il faut rendre obligatoire pour tout le personnel, autochtone ou autre, de manifester de la compréhension et du respect pour la culture et les traditions autochtonesNote de bas de page xv .
L'application de ce principe paraît s'imposer à l'endroit des libérations conditionnelles. Les femmes autochtones ont un besoin immédiat de maisons de transition autochtones. Elles ont besoin du soutien de leurs communautés et du droit à une libération conditionnelle dans les réserves. Les femmes autochtones se voient souvent refuser le privilège (d'autres diraient que c'est un droit) de retourner dans leurs réserves au moment de leur élargissement sous prétexte qu'on ne peut leur offrir de logement surveillé ou de surveillance des libertés conditionnels. Une pénurie de ressources, (soit de services soit d'argent) ne peut plus être considérée comme une excuse ou justification valable. Il faut mettre en oeuvre en temps utile la fonction d'assortir de ressources complètes des choix valables pour les femmes autochtones.
Outre le passé commun des femmes autochtones, un autre thème émerge de cette recherche. Les femmes autochtones réclament fortement et uniformément que leurs antécédents culturels et spirituels soient reconnus et acceptés et que tous les aspects de leur traitement à l'intérieur de la prison et après leur mise en liberté dans la communauté reflètent cette reconnaissanceNote de bas de page xvi . Cette doléance ne vient pas seulement de la Prison des femmes, mais aussi des femmes autochtones dans les établissements provinciaux. On ne peut trop insister sur le fait que la programmation (dans certains domaines comme l'éducation des enfants, l'abus sexuel, l'estime de soi et les choix de carrière), l'éducation et la sécurité doivent être offertes d'une manière qui soit constructive pour les femmes autochtones. Cela ne doit pas seulement comprendre la participation effective des autochtones, mais aussi celle des femmes autochtones qui sont passées par là et qui sont en bonne voie de guérison. Ce sont ces dernières qui ont le plus à apporter à celles qui purgent une peine.
La participation des femmes autochtones à ce Groupe d'étude ne doit jamais être considérée comme une reconnaissance de la validité de la juridiction exercée par le gouvernement fédéral du Canada (ou quelque gouvernement provincial ou territorial) sur les affaires de nos nations. Nos peuples, en tant que nations, n'ont jamais consenti à l'application du système juridique euro-canadien et de ses valeurs.
Notre participation au Groupe d'étude doit être vue uniquement comme la manifestation d'un profond intérêt à l'égard des nombreux citoyens de nos diverses nations qui souffrent tous les jours aux mains de la justice pénale. Ces conditions ont été préétablies au départ.
Le mandat de ce Groupe d'étude fut trop étroit pour répondre à nos besoins et refléter nos préoccupations. Parce qu'il vise seulement le processus qui s'étend de la sentence à l'expiration du mandat d'incarcération, toute question de souveraineté et de contrôle échappe à la compétence du Groupe d'étude. C'est pourquoi des négociations valables devront être entreprises avec les gouvernements autochtones qui sont maintenant prêts et aptes à assumer la totalité ou une partie de la juridiction sur la justice pénale. Cela va exiger des engagements sérieux de la part des autorités fédérales, provinciales et territoriales au Canada. Cette recommandation est d'une importance urgente pour les femmes autochtones et ne peut être escamotée sous les nombreuses autres recommandations immédiates et nécessaires qui sont mises de l'avant. De plus, c'est une bonne façon d'assurer que des ressources appropriées finiront par être disponiblesNote de bas de page xvii .
Nous devons travailler ensemble utilement à la recherche non seulement de solutions à court terme ou provisoires, mais de celles offrant un remède et un espoir véritables pour l'avenir. Le rapport de la Révision du droit correctionnel sur les peuples autochtones a déjà reconnu cet important engagement. A titre de femmes autochtones, purgeant une peine ou non, nous reconnaissons qu'une obligation envers les générations à venir commande nos efforts. Dans l'état actuel des choses, une femme autochtone est plus susceptible d'aller en prison qu'à l'universitéNote de bas de page xviii . C'est là une réalité que nous n'accepterons pas pour notre avenir.
Des choix valables signifient aussi que les gouvernements concernés par cette perspective doivent témoigner de leur bonne foi. Trop de rapports de groupes d'étude sur les personnes incarcérées ou sur d'autres questions autochtones n’ont eu d'autre sort que de ramasser de la poussière sur les tablettes. Les communautés autochtones ont manifesté leur bonne foi en demeurant engagées envers cet objectif. Il est essentiel que les recommandations de ce rapport soit mises en oeuvre à la fois en temps utile et avec efficacité.
Notre insatisfaction à l'égard du mandat touche aussi la distinction artificielle (mais peut-être nécessaire) entre les hommes et les femmes. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans le présent chapitre, la culture autochtone enseigne l'union, non la séparation. Nos nations ne séparent pas les hommes des femmes, bien qu'elles reconnaissent les rôles et les responsabilités uniques de chacun. Les enseignements de la création nous apprennent que ce n'est qu'ensemble que les deux sexes pourront instaurer un équilibre philosophique et spirituel complet. Nous sommes des nations et cela exige l'égalité des deux sexes.
Nous n'acceptons pas non plus l'idée que nous obtiendrons un réel changement en concentrant notre attention uniquement sur le sort des femmes autochtones incarcérées. Les personnes inculpées ou à risque ne nous préoccupent pas moins que celles qui purgent déjà une peine fédérale. Il faut donc concentrer les efforts sur l'objectif de «fermer le robinet» afin que les autochtones n'aient plus de comptes à rendre à des justices étrangères, qu'il s'agisse de services sociaux à l'enfance, de tribunaux pour la jeunesse ou de tribunaux fédéraux ou provinciaux. Ce n'est qu'une fois que nous aurons atteint ce point que nous redeviendrons et vivrons en conformité avec nos philosophies traditionnelles telles qu'elles nous ont été données par le Créateur.
La position des femmes autochtones au sein du Groupe d'étude ne doit pas être jugée radicale, militante ou intenable. Elle représente notre rêve, et celui de nombreuses nations autochtones, et nous le réaliserons. Les femmes autochtones qui se sont adressées au Groupe d'étude au cours des consultations l'ont répété maintes fois. «Nous vous disons seulement ce que nous croyons être la vérité.» Cette vérité prend racine dans notre expérience. Cela ne veut pas dire que seuls les autochtones ont accès à la vérité. Bien au contraire, toutes les races (rouge, jaune, noire et blanche) ont reçu des traditions de foi. Chacune de celles-ci peut être considérée comme une vérité spécifique, sur les plans racial et culturel. Ces références à une vérité autochtone sont importantes parce que ce sont le plus souvent nos enseignements qui sont invalidés ou négligés par la société dominante. C'est ce à quoi on réfère dans ce rapport lorsqu'on parle de racisme. De plus, les faiblesses du Groupe d'étude ont été signalées uniquement afin d'établir clairement que nous les reconnaissons. Nous les acceptons uniquement dans le but d'aller de l'avant et ne désirons pas y insister à outrance. Il s'agit, là aussi, de considérations qui ont conditionné au préalable notre participation au Groupe d'étude. Nous devons, aller, de l'avant à partir d'ici.
Nous n'avons pas fait part de ce que nous considérons comme la vérité uniquement pour le bénéfice des femmes autochtones ou du peuple autochtone, mais pour celui de tous les peuples. Comme le préconise la Société John Howard du Manitoba, les peuples autochtones sont ceux que nous devons prendre comme modèles dans le domaine des régimes parallèles de résolution des conflits :
«Nous endossons un modèle de justice réparatrice plutôt que rétributive. La médiation, la réparation et la réconciliation sont les meilleures méthodes. Les solutions doivent venir de la communauté locale. Il faut mettre l'accent sur la résolution de problèmes, le dialogue et la médiation. [...] Nous voulons que ce soit semblable au système de justice tribale [...] un modèle non criminel qui met l'accent sur les personnes qui ont commis des délits au sein de leur culture et de leur communauté. Les victimes aussi doivent retrouver leur pouvoir et le contrevenant doit accepter la responsabilité de ses actes et l'obligation d'en rendre compte. Nous recommandons une approche holistiqueNote de bas de page xix .»
La justice parallèle est maintenant au centre des propositions de réforme du système de justice pénale. Nous prétendons que les régimes parallèles doivent respecter le principe qu'il faut donner aux femmes des choix valables.
Les nations autochtones ont le pouvoir de guérir. Nous avons seulement besoin des ressources et du respect pour y arriver. La récente déclaration de l'Assemblée des femmes autochtones résume bien cette pensée :Note de bas de page xx
«Tous les citoyens autochtones des premières nations sont en conflit avec la loi. Nous sommes des peuples fondateurs et possédons un droit inhérent à établir nos propres systèmes de justice et les valeurs qu'ils représentent. La question des femmes autochtones et du système de justice pénale est simplement le plus flagrant exemple de l'oppression des peuples des premières nations par un système de lois auquel nous n'avons jamais consenti. Cette position est défendue par plusieurs organismes reconnus, y compris l'Association du Barreau canadien. [...]
Nos recommandations ne doivent en aucune manière être considérées comme un produit final ou une liste complète. Il serait plus exact de dire qu'elles devraient être regardées comme les exigences minimales auxquelles le ministère du Solliciteur général doit satisfaire si on souhaite sincèrement mettre fin à la violence et au racisme qui prévalent au sein de l'actuelle justice pénale, telle que présentement infligée aux peuples des premières nations. Ce sont des exigences minimales, car le Solliciteur général et le gouvernement du Canada doivent devenir responsables et comptables de leurs actes, s'ils veulent continuer à enfermer les citoyens des premières nations. Ce qu'il faut, c'est une ACTION IMMÉDIATENote de bas de page xxi .»
Aucun groupe d'étude ni aucune commission royale sur les services correctionnels, que son objet principal ait été les peuples autochtones, les femmes ou les prisons en général, n'a jamais reconnu la position unique des femmes autochtones. La pensée autochtone a été reléguée à quelques pages de ces précédents rapports ou à certaines recommandations dont la philosophie ne cadrait pas avec l'orientation de ces rapports. Cela a eu pour effet d'étouffer notre voix, tout en banalisant notre expérience. Au début des année 1990, nous constatons que le présent rapport a non seulement reconnu notre voix et notre expérience, mais encore qu'il respecte notre position historique de fondateurs a titre de premiers peuples du Canada. C'est notre voix qui aide à promouvoir cette nouvelle vision pour les femmes incarcérées. Les femmes autochtones qui ont participé à ce rapport ont le coeur a la fête parce qu'il s'agit d'une première. C'est cette pensée qui nous donne espoir. Nous espérons que le message des femmes autochtones est désormais clair. Nous réclamons TOUTES une ACTION IMMEDIATE.
Chapitre III : La voix de tiers compatissants
Qui sont ces tiers compatissants
Tout au long du processus de consultation, les membres du Groupe d'étude ont découvert que les personnes compatissantes à notre cause ont aussi disparates et uniques que les femmes purgeant une peine fédérale auxquelles elles s'intéressent. Des politiciens, des membres d'associations féminines, des hauts-fonctionnaires, des membres de la société Elizabeth Fry, des membres de l'Armée du Salut, des membres du personnel correctionnel, des Ainés, des ex-prisonnières, des conseillers, des membres d'associations autochtones, des universitaires, et de nombreuses autres personnes ont exprimé leur intérêt à l'égard de la situation vécue par les femmes purgeant une peine fédérale et fait part de leur espoir pour l'avenir. Au total, plus de 300 personnes et organismes ont présenté des mémoires ou fait une communication au Groupe d'étude. Elles parlaient au nom de beaucoup d'autres personnes compatissantes mais que le Groupe d'étude n'a pu rejoindre. Leur compassion se traduisait par l'ardeur qui animait un grand nombre de ces mémoires et se reflétait dans la préparation soignée de leur communication.
Les tiers compatissants ont parlé d'apprentissage, de compréhension, de responsabilité communautaire, de programmation centrée sur les femmes, de pouvoir des femmes. Et ils ont parlé de changement spectaculaire. La vision du changement partagé par ces personnes était remarquablement cohérente dans son rejet de l'incarcération traditionnelle et dans sa promotion de régimes parallèles s'appuyant sur la communauté, à l'aide de programmes et de politiques préventifs.
Leurs paroles, de même que le travail et l'engagement d'innombrables autres personnes compatissantes, fournissent l'énergie et la créativité nécessaires pour que cette vision du changement devienne réalité. Et maintenant, écoutons les paroles éloquentes de certaines de ces personnes compatissantes.
Les tiers compatissants réclament une meilleure compréhension
«Les racines du problème»
Nous devons reconnaître la signification du fait que la majorité des femmes qui commettent des délits sont celles qui, dans notre société, sont les plus défavorisées.
Il faut rendre obligatoire une formation antiraciste et interculturelle pour le personnel et l'administration. Le racisme règne en maître là-bas.
Le lien entre les conditions de vie des femmes et leur implication subséquente dans le système de justice pénale doit constituer le fondement de toute politique à venir. L'influence des facteurs sociaux comme la pauvreté, le chômage, l'éducation, l'abus sexuel et les mauvais traitements infligés aux enfants est fondamentale pour nous aider à comprendre l'implication des femmes dans le crime et à développer des programmes de réhabilitation appropriés qui soient véritablement "justes".
En comparaison des non-autochtones, les femmes autochtones qui purgent une peine fédérale sont plus susceptibles d'éprouver des problèmes de toxicomanie, moins susceptibles d'avoir complété leur dixième année d'études et d'avoir eu une continuité d'emploi. Elles sont également plus susceptibles d'avoir des enfants et de les élever seules. Le fait que, au moment de leur arrestation, 67 % des autochtones qui avaient commis un délit résidaient dans des communautés urbaines tandis que seulement 20 % d'entre elles y étaient nées suggère que près de la moitié pourraient être dépourvues des aptitudes nécessaires pour survivre dans un environnement urbain.
Les démêlés des femmes avec la justice pénale sont reliés à la condition féminine[...] Toute la programmation et la planification doit tenir compte de ce fait.
Le cycle sans fin de l'incarcération et de la récidive des autochtones ne pourra être rompu qu'une fois qu'on aura identifié les causes de cette situation, qu'on les aura abordées et qu'on y aura remédié d'une manière réaliste et holistique. Autrement, la pauvreté et la sous-scolarisation endémiques ainsi que la frustration qu'elles engendrent continueront de générer des réactions antisociales.
Il est essentiel de tenir compte de la situation sociale des femmes en général dans l'élaboration de programmes pour les femmes en détention : les problèmes de dépendance des femmes en prison ont souvent les mêmes racines que les problèmes de dépendance vécus par les femmes en général.
«Une approche centrée sur les femmes»
Je crois sincèrement que les femmes en prison ont des besoins uniques auxquels nos politiques et nos pratiques de gestion correctionnelle n'ont pas complètement répondu. Il importe que notre réponse à la situation soit stratégique, orientée vers l'action et complète.
Pourquoi ne pas demander aux femmes qui purgent des peines de nous aider à élaborer les programmes qu'elles désirent qu'elles considèrent importants? Il faut donner du pouvoir aux femmes.
Nous devons penser en termes de "refuge pour les femmes". Les femmes qui ont commis un délit ne diffèrent pas des autres femmes dans cette pièce.
La séparation mère-enfant est une tragédie humaine. On punit l'enfant en même temps que la mère.
La plupart des programmes touchant l'alcoolisme et la toxicomanie ont été élaborés par des hommes [...] Nous voyons la nécessité de développer davantage les programmes axés sur les expériences vécues par ces femmes qui les amènent à abuser des drogues et de l'alcool.
En cherchant un moyen d'améliorer les conditions de détention des femmes, nous avons opté pour l'équité plutôt que l'égalité avec les hommes. Nous ne devons pas simplement calquer les modèles féminins de services correctionnels sur les modèles masculins. Une telle approche s'est avérée inappropriée dans la société en général elle l'est encore plus quand on veut l'appliquer aux prisons pour femmes.
Au lieu de chercher quel est le degré de sécurité requis pour la portion carcérale de la peine, nous devons nous demander qui sont, au fond, ces femmes, quels sont leurs besoins, puis concevoir une institution qui tienne compte de ces considérations.
Les tiers compatissants réclament des changements fondamentaux
«Le système ne fonctionne pas»
On remet très peu en question aujourd'hui l'opinion selon laquelle les peines de détention constituent une solution inefficace au comportement criminel.
Si vous ouvrez de nouvelles prisons, vous allez trouver d'autres femmes pour les remplir.
Construire des prisons pour remplacer la Prison des femmes va à l'encontre des efforts en vue d'offrir une programmation préventive.
On a besoin de programmes à long terme portant sur la maîtrise de la colère, l'abus sexuel et l'estime de soi. Il faut répondre d'abord à ces besoins avant de penser aux problèmes de toxicomanie.
Vous (le Groupe d'étude)* vous êtes appuyés sur une prémisse qui suppose (erronément) que l'incarcération en institution est la solution appropriée pour les femmes qui enfreignent le code criminel.
«Des solutions créatives»
Il faut que nous devenions créatifs lorsque nous pensons aux femmes et à leur libération. Peut-être avons-nous besoin d'une autre procédure de libération pour les femmes, il faut certainement songer à une plus grande diversité de procédures communautaires.
Je souhaite une approche plus coopérative à la résolution de problèmes et davantage de collaboration avec les organismes privés du système. Il faut se pencher sur les besoins particuliers des femmes et sur des choix créatifs.
Je crois que le petit nombre de femmes purgeant une peine fédérale et le fait qu'elles ne sont pas considérées comme une menace à la société et n'en sont pas effectivement une nous fournissent une magnifique occasion d'innover d'essayer un nouveau modèle.
De plus, à quelques exceptions près, le niveau de sécurité requis pour la femme qui a commis un délit est faible comparé à son homologue masculin, et le risque qu'elle présente pour la communauté suite à une fugue ou à une évasion est moins élevé. Je crois que ce niveau de tolérance sociétale permettrait une très grande souplesse de la part du SCC si nous avons suffisamment d'imagination pour en saisir l'occasion.
Avec les autochtones, nous devons emprunter le même chemin qu'eux. Nous devons travailler avec leurs communautés lorsqu'ils nous disent qu'ils sont prêts. Nous devons écouter leurs suggestions quant aux moyens de ramener les femmes autochtones incarcérées plus près de chez elles et de leurs coutumes.
Quand nous constatons que 85 % des femmes qui purgent une peine fédérale ont été victimes d'abus sexuel ou d'abus physiques, nous devons comprendre l'importance de s'occuper de la souffrance intérieure avant d'espérer réhabiliter la personne. Une approche holistique est le seul chemin vers une réhabilitation complète.
«Apprendre les uns des autres»
L'éducation est la clé qui ouvre les portes. A mesure qu'augmentent les connaissances, les attitudes et les comportements évoluent, et de la connaissance naît la compassion. Il faut dialoguer. La route est longue mais c'est important de faire le premier pas. Le Groupe d'étude a accompli ce premier pas.
Les coutumes autochtones, ce sont les enseignements de la vie. C'est apprendre aux jeunes à vivre selon notre culture et à devenir quelqu'un. A titre d'Aînés, nous essayons de partager ce que nous savons ce que nous avons appris de nos ancêtres nous invitons les directeurs d'établissement à écouter nos enseignements nous n'essayons pas d'enseigner quoique ce soit de mauvais.
Les gouvernements qui assurent des services correctionnels doivent établir des liens stratégiques avec les groupes communautaires [...] nous partageons des intérêts et des soucis communs.
Nous croyons que la société non autochtone a beaucoup à apprendre des traditions et de la sagesse autochtone. Nous souhaitons que l'avènement de systèmes de justice tribale conduise graduellement, dans notre pays, à un modèle de justice réparatrice, fondée sur la communauté. Ainsi, tous les citoyens victimes des injustices liées aux pratiques courantes, tant autochtones que non autochtones, hommes que femmes, pourraient bénéficier d'une administration plus humaine et plus sensée de la justice.
Les tiers compatissants réclament aussi une action immédiate
«Une approche fondée sur la communauté»
Au Nouveau-Brunswick, nous voulons faire sortir les femmes des établissements correctionnels et les loger dans un établissement résidentiel communautaire. Les femmes ne présentent pas un risque élevé pour la communauté et devraient avoir l'occasion d'être plus près de cette communauté, en faire davantage partie.
Je pense que nous devrions doter les communautés de commissions pénitentiaires qui fonctionneraient sur le modèle des commissions scolaires, hospitalières ou de loisirs et qui seraient composées de citoyens intéressés et de représentants des personnes incarcérées. La commission ne relèverait pas du service correctionnel comme les actuels comités consultatifs de citoyens.
Community agencies provide an important service both in the institutions and in the community. Given that the overriding characteristic of incarcerated women is dependency, it is important to involve community-based program deliverers in the
L'absence d'une "loge spirituelle" est perçue comme une réalité et un problème urgent. Un grand nombre de femmes que j'ai rencontrées en prison ont perdu leurs sens de l'identité et c'est la raison pour laquelle une direction spirituelle est nécessaire.
M2/W2 souhaite une réorientation complète du système de justice pénale. En ce qui a trait aux prisonnières, nous croyons qu'il faut voir les besoins en matière de programmation dans une perspective familiale ou communautaire. Ce serait une façon de reconnaître la valeur réhabilitative des familles.
Les établissements existants, comme les foyers communautaires, pourraient peut-être recevoir des femmes en semi-liberté là où les maisons de transition sont en nombre insuffisant.
«Choix et occasions favorables pour les femmes»
Passer la vadrouille sur les planchers n'y fait pas beaucoup pour l'estime de soi. Les femmes ont besoin de motivation pour faire un bon travail et pour en tirer une certaine fierté. Nous avons besoin d'offrir des occasions de travail qui simulent le monde réel et ne perpétuent pas les stéréotypes de rôles féminins.
Les postes clés dans les pénitenciers pour femmes devraient être confiés à des femmes, afin de fournir des modèles de rôle, des perspectives féministes et le sentiment d'exercer le pouvoir.
Il faudrait prévoir des ressources pour les guérisseurs et les chefs spirituels autochtones afin qu'ils puissent répondre aux besoins des femmes autochtones. Ces personnes devraient jouir du même statut que les médecins et le clergé.
Nous croyons que les femmes et les bébés qui vont vivre ensemble après l'incarcération ne devraient pas être séparés durant l'incarcération. Nous sommes conscients du lien qui s'établit entre les mères et leurs bébés au cours des premières heures et des premiers jours de la vie d'un enfant et recommandons de les garder ensemble si tel est le désir de la mère.
Il faut offrir des programmes de réhabilitation en même temps que des programmes de relation d'aide, autrement les femmes vont récidive.
C'est difficile de se préparer à une mise en liberté quand vous êtes à plus de 1 000 milles de chez vous.
Laissez les femmes en prison apprendre à gérer leur propre vie en leur permettant de fait, de la gérer.
«Des environnements humains»
Les femmes sont soumises à des difficultés excessives et à des perturbations émotives importantes par suite d'une incarcération à une grande distance de chez elles. Les femmes qui purgent une peine fédérale doivent avoir la chance de le faire aussi près que possible de leurs familles ou de la communauté où elles sont libérées.
Alors que la sentence imposée à une femme après avoir été condamnée pour un crime constitue la punition de la société pour ses gestes, nous pouvons commencer à considérer l'incarcération elle-même comme un processus positif de compassion destiné à aider les femmes à réintégrer la société le plus rapidement possible, munies du bagage nécessaire pour éviter les délits à l'avenir.
Les établissements doivent examiner la différence qui existe entre les privilèges et les droits. L'air pur n'est pas un privilège ou une récompense, c'est un droit.
Nous avons toujours privilégié l'engagement d'un personnel exclusivement féminin dans notre établissement de Stephenville. Mais les femmes ont besoin d'une formation particulière aussi, une formation destinée à s'assurer qu'elles possèdent les aptitudes et les attitudes interpersonnelles appropriées à l'emploi qu'elles occupent.
C'est ce que je pense moi aussi. Nous avons besoin de rôles significatifs et de formation pour nous aider à éviter l'ennui et le burnout.
La paperasserie des Blancs nous limite et nous uniformise. Qu'est-il arrivé à la notion de liberté et de société juste?
Notre idée d'un nouveau concept architectural vise à répondre aux principaux buts de la mission. Concrètement, cela se traduit par une architecture de prison qui tente de recréer un environnement résidentiel, qui donne aux prisonniers une occasion de faire l'expérience du sens de la communauté et des responsabilités auquel on doit normalement s'attendre en société. Notre organisme se penche présentement sur le logement des femmes purgeant une peine fédérale (par l'entremise du Groupe d'étude) et le nouveau concept sembleNotre idée d'un nouveau concept architectural vise à répondre aux principaux buts de la mission. Concrètement, cela se traduit par une architecture de prison qui tente de recréer un environnement résidentiel, qui donne aux prisonniers une occasion de faire l'expérience du sens de la communauté et des responsabilités auquel on doit normalement s'attendre en société. Notre organisme se penche présentement sur le logement des femmes purgeant une peine fédérale (par l'entremise du Groupe d'étude) et le nouveau concept semblerait convenir très bien à leur situation.rait convenir très bien à leur situation.
Il importe de se rappeler que c'est difficile de prendre des mesures concernant l'inceste et l'abus sexuel dans la communauté et encore plus difficile dans le cas des personnes incarcérées. Les femmes devraient être logées là où elles peuvent trouver un soutien, se sentir à l'aise pour parler d'abus et d'estime de soi.
«Une action responsable»
Le système de justice fait partie de la communauté et sa responsabilité n'est pas négligeable.
Selon notre expérience, il n'y a jamais eu de programme qui a changé la vie de nos clients de manière aussi spectaculaire que celui de spiritualité autochtone. Presque pour la première fois de leurs vies, ils ont eu à se regarder, à tenir compte de leurs actions et à prendre la responsabilité de leur propre vie.
Il devrait être très clair que ces besoins ne peuvent et ne doivent pas être exclusivement l'apanage des bénévoles et des organismes de services. Il est essentiel que le gouvernement s'engage à fournir des ressources.
Nous devons tous partager la responsabilité des crimes. Les gouvernements doivent compenser par des ressources et des possibilités intéressantes. Les communautés doivent aussi s'amender en prenant conscience des torts faits et en s'efforçant de les réparer. Mais c'est la femme purgeant une peine fédérale qui doit réellement s'amender. Elle doit confronter son passé douloureux, accepter la responsabilité de ses actes et faire des choix pour rebâtir sa vie. Sa tâche est, de loin, la plus onéreuse.
Chapitre IV : Les voix du passé
Introduction
Les voix du passé parlent à l'unisson lorsqu'il s’agit de cerner les problèmes des femmes purgeant une peine fédérale et de recommander des changements. Dès 1914, la Commission royale sur les pénitenciers (rapport Macdonnell) déclarait qu'il y allait de l'intérêt de tous de procéder aux transfèrements de ces quelques détenues et de prendre des mesures afin que le pouvoir provincial assure la garde de toutes les femmes incarcéréesNote de bas de page xxii .
Depuis 1934, huit des neuf principaux groupes d'étude et commissions qui se sont penchés sur les problèmes des femmes purgeant une peine fédérale ont recommandé la fermeture de la Prison des femmes et un recours accru aux installations et services régionaux ou communautaires. En fait, la Commission d'enquête sur le système pénal du Canada (commission Archambault) a été la première à demander la fermeture de la Prison des femmes en 1938, soit seulement quatre ans après son ouverture.
Depuis cinquante ans, les constatations et les recommandations des groupes d'étude ont, dans l'ensemble, donné le ton à bien des idées présentées à ce groupe d'étude. Les rapports des commissions royales et des groupes d'étude canadiens qui se sont intéressés aux femmes purgeant une peine fédérale de même que les mémoires portant sur cette question avaient présenté bon nombre des problèmes et des idées de changement dont nous ont fait part les femmes incarcérées, les travailleurs communautaires, les universitaires, les fonctionnaires du service correctionnel et les décideurs cités dans les chapitres précédents.
Dans ce chapitre, les voix du passé qui se sont faites entendre par l'entremise de groupes d'étude et de commissions au Canada nous permettront de cerner le problème des femmes purgeant une peine fédérale et d'ouvrir la voie à des changements créateurs.
Les problèmes du système actuel
La Prison des femmes est inadéquate
Depuis l'ouverture de la Prison des femmes en 1934, tous les rapports et mémoires officiels ont souligné les défauts de la Prison des femmes. En 1977, le Rapport du sous-comité sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada (rapport MacGuigan) soulignait que la Prison des femmes n'était pas digne de recevoir des ours, encore moins des femmesFootnote xxiii». Les auteurs ajoutaient :
Le système pénal national constitue l'un des seuls secteurs au Canada où les femmes jouissent, bien malgré elles, d'un statut égal à celui des hommes. L'égalité nominale se traduit cependant en injustice. Mais à moins que l'injustice ne devienne absolue, l'égalité cesse et se transforme en discrimination flagrante quand il s'agit d'assurer aux femmes un traitement positif, des loisirs, des programmes, des installations essentielles et de l'espaceFootnote xxiv.
Plus récemment (1988), l'Association du Barreau canadien déclarait dans un rapport sur l'emprisonnement que, dans le cas de la Prison des femmes, il est inutile de faire appel à une autre commission royale ou à un autre comité pour recommander sa fermeture. Le Barreau proposait l'adoption de mesures législatives pour forcer la fermeture en temps opportun de la Prison des femmesFootnote xxv.
Les prisons pour femmes sont sur-sécuritaires
Le rapport OuimetFootnote xxvi, en 1969, et la Commission royale sur la situation de la femme, en 1970Footnote xxvii, s'inquiétaient du milieu à sécurité maximale dans lequel étaient placées toutes les femmes, peu importe leur classification de sécurité. De plus, le rapport MacGuigan présentait le commentaire suivant :
Le caractère et le comportement de la majorité des femmes internées correspondent aux critères établis pour les détenus des établissements à sécurité moyenne ou minimale. D'après la définition officielle, seul un très petit nombre de femmes doit être détenu dans des établissements à sécurité maximaleFootnote xxviii.
En 1988, le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes (comité Daubney) a examiné la détermination de la peine, la mise en liberté sous condition et d'autres aspects du système correctionnel au Canada. Dans son rapport, intitulé Des responsabilités à assumer, le comité déclarait :
Le comité déplore le fait que bon nombre de femmes à l'échelle du pays sont détenues dans des établissements qui maintiennent un niveau de sécurité beaucoup plus élevé qu'il serait nécessaire pour la majorité d'entre elles ou auquel la plupart d'entre elles seraient assujetties si elles étaient des hommesFootnote xxix.
De mauvais programmes
Depuis 1934, chaque rapport, ou presque, a déclaré que les femmes purgeant une peine fédérale faisaient l'objet de «mesures correctionnelles pensées après coupFootnote xxx» en ce qui a trait à la variété et la qualité des programmes. Les programmes de formation et d'évaluation professionnels de même que les programmes pré-libératoires et post-libératoires ont fait l'objet des plus dures critiques. En outre, depuis dix ans, on s'est inquiété de la pénurie de programmes destinés à permettre aux femmes de lutter contre l'alcoolisme et la toxicomanie.
La Commission canadienne des droits de la personne a rendu une décision sur une plainte déposée en 1981 voulant que l'incarcération des femmes purgeant une peine fédérale constitue un cas de discrimination sexuelle.
La principale conclusion de la Commission canadienne des droits de la personne a été que la Prison des femmes étant le seul pénitencier fédéral pour femmes, ces détenues ont accès à des programmes de formation et de réadaptation sociale moins nombreux que ceux qui s'offrent à leurs homologues masculinsFootnote xxxi. La décision de la commission a donné lieu à certains changements à la Prison des femmes, notamment l'accroissement des possibilités d'instruction et de formation professionnelle, et une plus grande interaction entre la collectivité et la prison.
Le gouvernement a, à plusieurs reprises, reconnu le besoin de programmes particuliers pour les femmes en prison. En 1974, le Solliciteur général a créé le Comité consultatif national sur la femme délinquante (auteur du rapport Clark)Footnote xxxii qui a été chargé de présenter des recommandations sur les besoins particuliers des femmes en matière de programmes et de sécurité. En 1982, le Comité consultatif national permanent concernant la détenue sous responsabilité fédérale a vu le jour : y siègent des représentants tant du gouvernement que du secteur privé. Le comité a pour mandat de présenter des conseils aux commissaires au sujet des programmes en cours et de la planification à long terme en ce qui a trait aux femmes dans les établissements correctionnels fédéraux. En 1985, le Service correctionnel du Canada a créé la division des programmes des délinquants autochtones et de sexe féminin.
Les femmes sont isolées de leur famille
Presque tous les rapports présentés depuis 1934 ont souligné l'isolement des femmes de leur famille en raison de l'existence d'un seul établissement central fédéral pour les femmes. Cette situation a été jugée inacceptable, particulièrement dans le cas des femmes ayant de jeunes enfants.
«encore tout récemment l'Association du Barreau canadien recommandait l'adoption d'une loi permettant d'en ordonner la fermeture à un moment choisi. Cette recommandation se fonde principalement sur le fait que l'éloignement géographique des délinquantes, privées du soutien familial et communautaire, rend non seulement leur peine d'emprisonnement plus cruelle qu'il n'est nécessaire, mais encore diminue les chances de réussite de réinsertion dans la sociétéFootnote xxxiii.»
Les besoins des femmes francophones demeurent insatisfaits
Les commissions qui se sont succédées n'ont pas soulevé ce thème aussi souvent que les quatre précédents. Le rapport OuimetFootnote xxxiv a constaté la pénurie de programmes de langue française. Le rapport ChinneryFootnote xxxv, rédigé en 1978 par un comité chargé de préparer un plan d'action pour remplacer la Prison des femmes, s'est aussi penché sur le problème des femmes francophones. La plupart des rapports qui ont recommandé une plus grande responsabilité des provinces à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale ont aussi mentionné, implicitement ou explicitement, ces besoins particuliers.
Les besoins des femmes autochtones demeurent insatisfaits
Il convient de souligner que les groupes d'étude et les commissions qui nous ont précédé n'ont pas vraiment tenu compte des expériences et des besoins particuliers des femmes autochtones. Certains rapports ont évoqué leurs besoins, mais seulement dans le cadre de la situation particulière des femmes purgeant une peine fédérale; on en a traité dans le rapport Ouimet, mais surtout dans le contexte des établissements provinciaux :
Le fait que, dans plusieurs prisons de femmes, surtout dans les provinces de l'Ouest, le grand nombre des détenues sont des Indiennes ou des Métisses exige l'adoption de programmes spéciaux adaptés aux besoins particuliers de ces femmesFootnote xxxvi.
D'autres ont reconnu la discrimination particulière dont étaient victimes les femmes autochtones. Par exemple, le rapport Daubney déclare :
On peut donc voir que les femmes autochtones détenues sont désavantagées sur trois plans : elles endurent non seulement les douleurs de l'incarcération comme tous les détenus, mais aussi les douleurs supplémentaires reliées à l'éloignement culturel ressenties par les détenus autochtones et celles reliées à l'éloignement de la maison et de la famille que vivent les femmes détenuesFootnote xxxvii.
En 1988, le Groupe d'étude sur les autochtones au sein du régime correctionnel fédéral, créé par le Solliciteur général, faisait la recommandation suivante:
Le ministère devrait envisager la possibilité de mettre sur pied une approche holistique permettant de traiter des différents problèmes des détenues autochtones de la Prison des femmes dans le cadre d'un seul programmeFootnote xxxviii.
Il faut élargir le champ de responsabilité à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale
Dès 1938, la Commission royale d'enquête sur le système pénal du Canada recommandait de retourner les femmes dans leurs provinces d'origine et d'en confier la responsabilité aux pouvoirs provinciaux. Le rapport Ouimet a réitéré cette responsabilité provinciale à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale, ce qui a donné lieu à la négociation d'ententes d'échanges de services, qui ont été conclues en 1975.
En 1977, le Rapport du groupe d'étude sur le rôle du secteur privé dans le domaine de la justice pénale (le rapport Sauvé)Footnote xxxix, laissait entendre que le secteur bénévole avait comme rôle primordial la prestation de services. On y mettait l'accent sur un esprit de collaboration entre le gouvernement et le secteur bénévole et l'on déclarait que ce secteur avait un rôle à jouer dans les domaines suivants : mobiliser la participation des citoyens; aider le gouvernement à établir ses priorités et à prévenir le crime; offrir des analyses critiques des initiatives de l'État; et offrir des programmes d'instruction publique et d'éducation populaire. Les systèmes correctionnels reconnaissent dans l'ensemble qu'ils ne peuvent suffire à la tâche : pour réussir, il faut pouvoir compter sur la participation du secteur bénévole.
Dernièrement, l'on insistait à nouveau, dans Des responsabilités à assumerFootnote xl, sur le fait que la collectivité, de même que les femmes purgeant une peine, ont la responsabilité de réparer les torts et de favoriser des changements créateurs qui aideront à prévenir le crime.
Le comité a indiqué qu'il appuyait la réconciliation de la victime et du délinquant et qu'il était particulièrement favorable à ce que les délinquants acceptent ou assument la responsabilité de leur conduite criminelle en réparant les torts causés. Cette responsabilité va de pair avec celle de la collectivité, qui est d'aider les délinquants à apporter dans leur vie des changements constructifs qui réduiront le risque d'avoir de nouveaux démêlés avec la justiceFootnote xli.
L'intégration des femmes à la collectivité
Ce thème est tout d'abord issu de la volonté de réduire l'isolement des femmes par rapport à leurs amis et leur famille. Avec le temps, il a pris de l'ampleur à mesure que l'on constatait l'efficacité de l'intégration à la collectivité comme moyen d'offrir le soutien, la continuité et la variété des services dont les femmes ont besoin pour prendre en charge leur vie.
Le gouvernement fédéral, dans le cadre de son plan d'action sur la situation de la femme, publié en 1979 et intitulé Femmes en voie d'égalité, a souligné le rôle que devait jouer le Solliciteur général pour faciliter la réintégration à la collectivité des femmes incarcérées et pour s'assurer que celles-ci reçoivent les mêmes avantages que leurs homologues masculins.
L'emprisonnement ne favorise pas la réinsertion sociale
Dans le même ordre d'idées, les rapports antérieurs ont convenu que la réinsertion sociale constitue un objectif positif et réalisable pour les femmes purgeant une peine fédérale, tout en reconnaissant que l'emprisonnement n'offre pas le meilleur cadre aux programmes de réinsertion sociale. Par exemple, dans Des responsabilités à assumer, les auteurs écrivaient :
Puisque généralement l'emprisonnement ne permet de protéger la société contre le comportement criminel que pour un temps limité, la réadaptation du délinquant est très importante. Les prisons n'ont pas vraiment réussi à réformer les détenus, comme en témoigne le taux élevé de récidiveFootnote xlii.
Les voix du passé, un point de départ
Depuis 1934, on a déployé bien des efforts et fait appel à bien des compétences pour examiner les problèmes des femmes purgeant une peine fédérale et pour y trouver une solution. Voici, en bref, les principales recommandations de ces commissions et groupes d'étude gouvernementaux.
La plupart ont recommandé la fermeture de la Prison des femmes. En fait, parmi les principales commissions, seul le comité Fauteux (1956)Footnote xliii a recommandé de la conserver, prétendant qu'il était plus facile d'offrir de bons programmes dans un établissement centralisé. Les divers groupes d'étude et commissions ont surtout divergé d'opinion quant à ce qui devait remplacer la Prison des femmes. Les solutions de rechange proposées vont du transfert de la pleine et entière responsabilité aux provinces à la création de nouveaux établissements fédéraux à caractère régional plus ou moins prononcé, en passant par diverses initiatives fédérales-provinciales.
La question centrale du logement est intimement reliée à d'autres telles que les programmes et le personnel. Parmi les multiples recommandations touchant ces questions connexes, mentionnons :
- la création d'une annexe à sécurité minimale;
- la création d'un plus grand éventail de classifications de sécurité fondé sur les risques et les besoins des femmes elles-mêmes et non sur les risques et les besoins de la population masculine;
- une meilleure rémunération des détenues grâce à la création de plus grandes possibilités de travail et de meilleurs programmes;
- des programmes de traitement plus intensifs;
- une amélioration de la formation et des compétences du personnel;
- des services bilingues et des programmes de langue française;
- des programmes conçus pour et par les femmes autochtones;
- des services accrus et améliorés et des programmes pour les femmes au sein de la collectivité;
- le recours généralisé à d'autres solutions que l'emprisonnement pour les femmes;
- la recherche sur une base continue et améliorée, de même que la collecte de statistiques au sujet des femmes relevant du système correctionnel.
Conclusion
Le rapport NeedhamFootnote xliv, présenté par un comité fédéral-provincial créé pour étudier les recommandations du rapport ClarkFootnote xlv, déclarait "qu'il n'y avait aucune solution idéale aux problèmes des femmes incarcérées. Selon ce comité, le pays était trop vaste et le nombre de femmes trop restreint pour permettre autre chose que la solution de compromis qu'il recommandait"Footnote xlvi.
Les voix du passé se sont rarement mises d'accord sur la meilleure «solution de compromis» qui permettrait de résoudre l'énigme capitale que constitue l'hébergement des femmes au sein du système correctionnel fédéral. Toutefois, un solide consensus s'est dégagé au sujet des problèmes prioritaires et des orientations globales à prendre.
Il s'agit maintenant d'appliquer la sagesse du passé aux connaissances et aux objectifs du présent. Comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent, notre optique actuelle et nos espoirs font nettement écho aux voix du passé.
Chapitre V : La voix de la recherche
Introduction
L'objectif de la recherche réalisée pour le Groupe d'étude
Les conclusions du Groupe d'étude sont fondées avant tout sur les voix des femmes et les voix des personnes qui les ont à coeur. Les consultations avec les femmes qui purgent ou qui ont purgé une peine fédérale, avec les travailleurs communautaires, avec les fonctionnaires de l'État et avec d'autres personnes qui travaillent pour et avec ces femmes ont fourni les données de base et l'inspiration de ce rapport.
Toutefois, les membres du Groupe d'étude tenaient à puiser leurs connaissances à autant de sources que possible. Par conséquent, afin d'amplifier ces voix et d'étendre la portée des consultations, le Groupe d'étude a commandé cinq recherches, dont trois par l'entremise du Secrétariat du Ministère du Solliciteur général.
Les recherches commandées par le Groupe d'étude
La première recherche, coordonnée par Margaret ShawFootnote xlvii comportait des entrevues individuelles avec des femmes purgeant une peine fédérale ainsi qu'avec des femmes en liberté conditionnelle ou surveillée. L'étude visait à demander à autant de femmes que possible de nous donner des renseignements sur leurs expériences d'incarcération, de libération conditionnelle et de liberté surveillée; sur leurs besoins de programmes et de services; et sur leurs points de vue au sujet du lieu où elles aimeraient purger leur peine et dans quelles conditions.
La recherche a aussi permis au Groupe d'étude de mieux comprendre les antécédents des femmes qui purgent actuellement une peine fédérale. Les membres du Groupe ont appris, grâce aux entrevues réalisées avec 84 % de l'ensemble des femmes purgeant une peine fédérale, et grâce aussi à 57 entrevues avec des femmes en liberté conditionnelle ou surveillée, le nombre de femmes qui ont été victimes d'abus sexuel et (ou) physique, le nombre de femmes ayant des enfants, les antécédents scolaires et professionnels de ces femmes et une foule d'autres renseignements qui ont sensibilisé davantage les membres du Groupe d'étude aux expériences de ces femmes.
Par la suite, on a réalisé un sondage semblable auprès des femmes autochtones purgeant une peine fédérale au sein de la collectivitéFootnote xlviii. Ce projet a vu le jour lorsque des femmes autochtones siégeant au comité de direction du Groupe d'étude se sont inquiétées que celui-ci n'ait pas fait suffisamment de place aux points de vue des femmes autochtones au sein de la collectivité.
Ce sondage a constitué une tentative unique en son genre de recueillir des renseignements au sujet des femmes autochtones ayant purgé une peine fédérale, renseignements qui ne pouvaient être obtenus qu'auprès de personnes sachant ce que c'est que d'être femme, autochtone, et incarcérée. Des femmes autochtones qui avaient connu le système carcéral canadien ont été chargées d'interviewer 39 femmes autochtones. Les chercheuses se sont adressées aux interviewées à titre de soeurs, à titre de personnes qui partageaient les mêmes antécédents. Elles ont demandé à leurs interlocutrices de leur conter leur vie, elles ont évité de les influencer, afin que leurs récits parlent d'eux-mêmes. Grâce à cette recherche, un Groupe d'étude canadien a pu, pour la première fois, permettre aux voix des femmes autochtones purgeant une peine fédérale d'être entendues.
Le troisième rapport, réalisé par Margaret Shaw, offre un aperçu historique de l'incarcération des femmes, particulièrement au Canada mais aussi dans d'autres paysFootnote xlvix. Cette étude présente aussi un compte rendu à jour des questions entourant l'emprisonnement des femmes au Canada, ainsi qu'une comparaison des réponses données à ces questions dans divers pays.
La quatrième étude, réalisée par Lee AxonFootnote l, visait à obtenir un compte rendu et une analyse à jour des programmes, des services et des possibilités exemplaires visant à répondre aux besoins particuliers des femmes purgeant de longues peines aux États-Unis. Le rapport de madame Axon présente les résultats d'une recension des écrits, d'entrevues téléphoniques et de visites à certains établissements de ce pays. Ces travaux complètent et mettent à jour un récession des programmes à l'échelle internationale réalisé par Lee Axon en 1987Footnote li.
Les troisièmes et quatrièmes rapports examinent en profondeur, en les situant dans leurs contextes, les tentatives actuelles et passées d'améliorer le traitement accordé aux femmes purgeant une peine fédérale au Canada. Ces études offrent aussi un aperçu des initiatives prises par les autres pays dans des domaines analogues à ceux abordés par le Groupe d'étudeFootnote lii.
Le cinquième rapport commandé par le Groupe d'étude a permis d'effectuer un inventaire des programmes offerts par les établissements provinciaux, territoriaux et fédéraux aux femmes purgeant une peine fédérale. Le rapport présente des renseignements sur l'éventail et le type de programmes ainsi que sur les différences et les lacunes dans les programmes offerts par les divers établissements. Les données qui fondent ce rapport ont été recueillies par Price Waterhouse lors d'une enquête sur les établissements correctionnels provinciaux et territoriaux pour les contrevenants adultes, commandée par le Service correctionnel du Canada dans le cadre de l'examen de la politique fédérale-provinciale. Maureen Evans, membre du Groupe de travail, a préparé l'analyse à l'intention du Groupe d'étudeFootnote liii.
Les autres recherches utilisées
Le Groupe d'étude a aussi profité des autres rapports de recherche publiés avant qu'il n'amorce ses travaux ainsi que de deux projets qui se sont terminés ou qui ont été réalisés durant les travaux du Groupe d'étude. L'un d'entre eux portait sur le comportement autodestructeur à la Prison des femmes de Kingston. Dans le cadre de cette étude, on a interviewé 40 femmes purgeant une peine fédérale à la prison, 41 membres du personnel de sécurité ainsi que des employés des services de santé et de traitement des environs au sujet de la nature et des causes de blessures infligées volontairementFootnote liv.
La Direction de la recherche du Service correctionnel du Canada a réalisé une autre étude sur la santé mentale des femmes purgeant une peine fédérale à la Prison des femmes, dans le cadre d'une étude nationale de l'incidence des troubles mentaux et de comportement chez les détenues purgeant une peine fédéraleFootnote lv.
L'optique de la recherche
Les membres du Groupe d'étude, de concert avec les chercheuses, ont tout fait pour que la recherche tienne compte des intérêts et des priorités du Groupe d'étude. On a voulu axer la recherche sur les femmes en mettant l'accent sur les entrevues avec des femmes purgeant une peine fédérale. La recherche s'appuyait sur une conviction voulant que, pour trouver des solutions réalistes et valables aux problèmes des femmes canadiennes purgeant une peine fédérale, les membres du Groupe d'étude, les décideurs en matière de politique, les défenseurs des droits de ces femmes et les travailleurs de première ligne devaient comprendre pleinement les particularités de la situation canadienne, les antécédents criminels et les expériences carcérales de ces femmes, ainsi que leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs besoins. Cela dit, les membres du Groupe d'étude estiment que la recherche, et particulièrement le sondage auprès des femmes purgeant une peine fédérale ou mises en liberté dans la communauté ainsi que le sondage auprès des femmes autochtones mises en liberté dans la communauté constituent une expression supplémentaire de la voix de ces femmes, qui aide à faire connaître les points de vue et les expériences de la majorité des femmes purgeant une peine fédérale.
L'on fera état des constatations de la recherche et l'on s'en inspirera tout au long du rapport. Toutefois, dans le présent chapitre, l'on résumera les principales constatations des chercheuses afin que leurs voix à elles aussi puissent se faire entendre.
Points saillants des entrevues avec les femmes
Entrevues avec les femmes en prison
On a interviewé 170 des 203 femmes purgeant une peine fédérale en prison au moment de l'étudeFootnote lvi. Trente-neuf des femmes interviewées étaient autochtones, 33 étaient canadiennes françaises et 68 purgeaient leurs peines dans des établissements provinciaux. L'âge de ces femmes s'échelonnait de 19 à 75 ans et beaucoup d'entre elles avaient vécu avec au moins un conjoint de fait. Certaines se sont mariées plusieurs fois, certaines ne se sont jamais marines et certaines ont vécu avec des conjoints de fait.
Les renseignements recueillis grâce à ces entrevues tracent le portrait d'un groupe de femmes fort diverses éprouvant un vaste éventail de besoins. Les données révèlent aussi que ces femmes ont tendance à provenir de milieux désavantagés et que les femmes autochtones, en tant que groupe, sont plus désavantagées que l'ensemble de la population des femmes non autochtones purgeant une peine fédérale.
Les entrevues ont aussi révélé que beaucoup de femmes purgeant une peine fédérale ont commis des crimes très graves. Au moment des entrevues, 39 % de la population purgeait une peine pour meurtre ou homicide involontaire, 27 % pour vol et d'autres infractions avec violence de moindre envergure, et 33 % pour des infractions sans violence.
Par ailleurs, les données révèlent aussi que près de la moitié des femmes purgeant une peine fédérale ne sont habituellement pas des récidivistes. Quarante-et-un pour cent de ces femmes sont des délinquantes primaires sans condamnation préalable et 50 % n'ont jamais été emprisonnées auparavantFootnote lvii. Malgré le fait que la moitié n'avaient jamais été emprisonnées auparavant, plus de 50 % des femmes purgeaient des peines de plus de cinq ans, 22 % purgeaient des peines de cinq à neuf ans, et 29 % purgeaient des peines de dix ans ou plus, tandis que 20 % purgeaient des peines d'emprisonnement à perpétuitéFootnote lviii.
Ce bref aperçu de la foule de renseignements recueillis grâce aux entrevues met en relief la difficulté de classer les femmes purgeant des peines fédérales. Malgré leur petit nombre, elles affichent une foule d'antécédents et d'expériences du système de justice pénale. La gravité de leurs crimes et leurs schèmes de comportement criminel ne peuvent être compris de manière constructive que dans le contexte des besoins très variés exposés dans les paragraphes qui suivent.
La maîtrise de leur santé physique et mentale
Les femmes emprisonnées estiment avoir perdu la maîtrise de leur propre corps et ne pas jouir des types de conseils et de médicaments qui leur seraient normalement offerts. Elles affirment avoir grand besoin d'un meilleur accès aux services de santé physique et mentale, à la possibilité d'obtenir une deuxième opinion, et à la chance de choisir un médecin ou un spécialiste des médecines douces. Les femmes ont affirmé que trop de membres du personnel médical les traitent comme des délinquantes et non comme des patientes. Trente des 38 femmes autochtones qui se sont prononcées sur cette question ont affirmé avoir besoin de personnel de soins de santé et de personnel connexe autochtoneFootnote lix.
Les femmes purgeant une peine fédérale veulent que l'on mette davantage l'accent sur la médecine préventive, une meilleure nutrition et de plus grandes possibilités d'exercice physique. Seulement 33 % des femmes interviewées estimaient suffisants les soins de santé offerts dans les prisons.
L'étude réalisée par Jan Heney sur le comportement autodestructeur a mis en relief les besoins pressants en matière de services de santé mentale proactifs. L'auteure a constaté que 59 % des 44 femmes interviewées avaient manifesté ou manifestaient un comportement autodestructeur, comportement qui est souvent symptôme d'une souffrance résultant d'abus sexuelle durant l'enfance. Elle a souligné que le comportement autodestructeur est une question de santé mentale et non de sécurité, et qu'il importe de faire appel aux services de psychologie et de soins de santé dès les premiers signes de détresse émotiveFootnote lx.
Les constatations de l'enquête sur la santé mentale commandée par le Service correctionnel du Canada ont aussi révélé que les types et l'incidence de troubles de santé mentale diffèrent selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes; un bon nombre des problèmes de santé mentale que connaissent les femmes purgeant une peine fédérale peuvent être reliés directement aux expériences antérieures d'abus sexuel, et/ou physique et d'agression sexuelle, en bas âge ou sur une longue période. La recherche souligne l'urgent besoin d'offrir des services de santé mentale pertinents axés sur les besoins propres des femmes purgeant une peine fédéraleFootnote lxi.
Les contacts avec les enfants et la famille
Les contacts avec les enfants sont d'une importance capitale pour la plupart des femmes, peu importe l'âge des enfants. Les deux tiers des femmes interviewées ont des enfants. Environ la moitié ont au moins un enfant de 16 ans ou moins et environ le quart ont au moins un enfant de moins de cinq ansFootnote lxii.
Les femmes sans enfant ressentaient aussi un grand besoin de contacts plus étroits avec leurs familles.
Les femmes de la Prison des femmes veulent recevoir leurs familles. Puisque la plupart des familles habitent très loin de la prison, les contacts doivent souvent prendre une autre forme. Les femmes dans les provinces, qui ont des contacts plus fréquents, désirent de plus longues visites de leurs enfants, l'accès gratuit à un certain nombre d'appels interurbains ainsi que de l'aide financière et autre pour faciliter la visite des enfants qui habitent loin de la prison. Les femmes gui avaient perdu la garde de leurs enfants, ou même l'accès à ceux-ci, suite à leur emprisonnement ont aussi exprimé le besoin de conseils juridiques et de services de défense de leurs droits pour les aider à obtenir à nouveau la garde ou l'accès.
La constatation voulant que, chez les interviewées, 69 des 108 femmes ayant des enfants aient été chefs de famille monoparentale pendant au moins une partie de la vie de ces enfants souligne l'importance du contact entre ces femmes et leurs enfants. Dans certains cas, la femme est la seule personne qui compte dans la vie de son enfantFootnote lxiii.
Les groupes de counseling et de soutien pour les survivantes d'abus physique et sexuel
L'abus physique et (ou) sexuel est le lot de beaucoup de femmes purgeant une peine fédérale, et particulièrement des autochtones. Si l'on tient compte de l'ensemble de la population, 80 % des femmes interviewées ont affirmé avoir été victimes : 68 % ont déclaré avoir été victimes d'abus physiquement et 54 % ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuel, sous une forme ou une autre, au cours de leur vie, par leurs parents, d'autres membres de la famille, des parents nourriciers ou encore par le personnel des établissements et par des compagnons, des maris et des conjoints de fait. L'abus semblait plus élevé chez les femmes de la Prison des femmes que chez les femmes des établissements provinciaux. A la Prison des femmes, on a abusé physiquement ou sexuellement des femmes dans une proportion de 82 % tandis que dans les établissements provinciaux, le pourcentage est de 72.Footnote lxiv
Chez les femmes autochtones, l'abus était encore plus rependu. Quatre-vingt-dix pour cent des femmes autochtones ont affirmé avoir été victimes d'abus physique au cours de leur vie, habituellement régulièrement pendant de longues périodes, comparativement à 61 % des femmes non autochtones. Soixante-et-un pour cent des femmes autochtones ont mentionné avoir été victimes d'abus sexuel, comparativement à 50 % des femmes non autochtonesFootnote lxv.
Environ les deux tiers des femmes qui avaient connu l'abus ont exprimé le désir de counseling individuel pour faire face à ces expériences mais ont insisté pour que le counseling ne devienne jamais une condition de libération. Les femmes ont aussi signalé la pénurie de services pour les survivantes d'abus physique et (ou) sexuel dans les prisons provinciales. L'enquête sur les programmes offerts par les établissements aux femmes purgeant une peine fédérale a révélé que seules deux prisons offraient des programmes aux victimes d'abus sexuel ou d'incesteFootnote lxvi. Les femmes autochtones veulent des programmes autochtones et la participation des aînés pour les aider à devenir de vraies survivantes de l'abus.
Des programmes efficaces de lutte contre la dépendance à l'égard des drogues et de l'alcool
La majorité des femmes interviewées (69 %) ont affirmé que l'abus de substances psychoactives avait été un facteur important dans leurs infractions ou occupait une place importante dans leurs dossiers. Certaines ont affirmé être sous l'emprise de drogues ou d'alcool au moment de leur infraction, d'autres ont affirmé avoir commis une infraction pour payer des drogues et d'autres encore étaient en prison pour trafic ou possession. Chez les 39 autochtones interviewées, l'abus de substances psychoactives était encore plus élevé que dans l'ensemble de la population; les femmes autochtones avaient tendance à être fortement dépendantes depuis 10 à 25 ans.
Bien des femmes ont reconnu avoir participé à des programmes de désintoxication (la plupart des établissements offrent des programmes de traitement), mais elles estimaient que ces programmes étaient mal assortis à leurs expériences. Beaucoup de ces programmes étaient trop élémentaires ou superficiels pour leur offrir le type d'aide dont elles avaient besoin. On a nettement circonscrit le besoin de programmes à l'intention des autochtones. Les femmes veulent aussi de plus longs programmes de groupe ou en résidence pour lutter contre l'abus de substances psychoactives.
La disponibilité de drogues dans les prisons et la forte incidence d'utilisation par les femmes interviewées attestent l'urgence de ces programmesFootnote lxvii.
Abaisser les barrières linguistiques et culturelles
Certaines femmes purgeant une peine fédérale se heurtent à des problèmes de communication et vivent des sentiments de frustration, d'isolement et d'aliénation parce qu'il leur est impossible, ou presque, de s'exprimer dans leur propre langue et leur propre culture dans la prison où elles purgent leur peine. Les femmes purgeant une peine fédérale proviennent de nombreuses cultures différentes et parlent une foule de langues. Près du quart des femmes interviewées purgeant une peine fédérale étaient d'origine autochtone et près d'un autre quart étaient francophones. Environ 40 % des femmes francophones sont emprisonnées à l'extérieur du QuébecFootnote lxviii. Ces femmes ont affirmé éprouver des difficultés à discuter de leurs problèmes ou des symptômes de santé mentale en anglais et demandaient une psychologue francophone. Au Québec, sept femmes anglophones se heurtent aussi à des barrières linguistiques. De plus, on a interviewé dix femmes provenant de l'extérieur du Canada; cinq d'entre elles avaient une langue maternelle autre que l'anglais et éprouvaient par conséquent d'importantes difficultés de communication. Certaines souhaitaient recevoir la visite de chefs de files ou de dirigeants religieux appartenant à des communautés analogues à la leur au CanadaFootnote lxix.»
A peu près aucune femme purgeant une peine fédérale ne semble éprouver de difficulté à communiquer sur un plan pratique, puisque seulement quelques-unes ne parlent ni le français, ni l'anglais. Toutefois, l'absence de possibilités de communication dans leur langue d'origine avec quelqu'un qui partage leur culture peut accroître l'angoisse et les sentiments d'aliénation et de solitude de ces femmes. Les femmes autochtones ont affirmé à maintes reprises qu'elles se sentaient inconfortables en compagnie de personnes non autochtones. Elles ont déclaré avoir besoin de communiquer avec des gens de leur propre culture et de leur propre milieu, et ce à l'égard de toutes les dimensions de leur vie en prison.
Un travail et une formation valables
Les programmes de formation et d'enseignement sont d'une importance capitale pour la plupart des femmes. Les deux tiers de celles-ci n'avaient pas terminé leurs études secondaires ou n'avaient obtenu aucune formation ou instruction après leurs études secondaires. Les femmes autochtones sont encore plus désavantagées. Certaines n'avaient jamais fréquenté l'école et quelques-unes avaient décroché durant les études primairesFootnote lxx. De nombreuses femmes ont affirmé vouloir suivre des cours de niveau post-secondaire ou universitaire. Très peu (habituellement les femmes plus âgées et celles qui achevaient de purger leurs peines) ont affirmé de pas vouloir suivre de cours de formation professionnelle. Les autres femmes demandaient surtout : une formation dans des domaines en demande tels que le travail de bureau, le traitement de texte ou les techniques de laboratoire; une formation dans des domaines tels que l'informatique, l'impression, la photographie et la menuiserie: et la formation à des métiers spécialisés tels que la couture industrielle, la conduite de machinerie lourde et la cuisine. De plus, près du tiers des femmes voulaient étudier le travail social, la sociologie, le développement de l'enfant, l'assistance parajudiciaire aux autochtones, le traitement de la toxicomanie et (ou) le counseling pour leur permettre de travailler auprès des ex-détenues, des jeunes perturbés ou des autochtones, des toxicomanes, des personnes âgées ou des enfants. Les femmes ont fait valoir qu'elles voulaient acquérir des compétences réellement monnayables assorties de qualifications et de diplômes reconnus.
La plupart ont affirmé avoir occupé des emplois non spécialisés et mal rémunérés dans des magasins, des bureaux, des bars et des restaurants, et avoir travaillé comme aides-infirmières, gardiennes d'enfants ou ouvrières non spécialisées. Quinze pour cent n'avaient jamais occupé un emploi rémunéré légalementFootnote lxxi. Ces femmes désirent être mieux préparées au marché du travail en quittant la prison et elles souhaitent disposer des compétences nécessaires pour assurer leur autonomie financière lors de leur mise en liberté. Les femmes de la Prison des femmes estimaient que les cours qu'on leur offrait actuellement étaient très limités et dépassés, sauf ceux qu'elles suivaient dans les prisons des hommes. Quant aux femmes des établissements provinciaux, on ne leur offre pas grand-chose si ce n'est une formation de base.
L'enquête sur les programmes offerts par les établissements aux femmes purgeant une peine fédérale a constaté que seuls sept établissements offraient une formation professionnelle et que, parmi ceux-ci, quatre n'offraient qu'un seul programme. Seulement cinq établissements offraient des cours de formation professionnelle, et certains de ces cours étaient reliés aux besoins d'entretien de l'établissementFootnote lxxii.
Les programmes à l'intention des autochtones
La Prison des femmes offre certains programmes de spiritualité et de culture autochtones, mais les femmes autochtones souhaitent que ces programmes soient offerts de façon plus généralisée. Elles veulent aussi un meilleur accès aux aînés et davantage de programmes de lutte contre l'abus de substances psychoactives et de programmes à l'intention des victimes d'abus physique et sexuel, conçus pour les Autochtones. Certaines prisons provinciales prévoient, à l'occasion, des visites des aînés et la Prison des femmes offre désormais certains programmes à l'intention des Autochtones. Il reste néanmoins que de nombreuses femmes autochtones se sentent inconfortables en présence de personnes non autochtones qui ne comprennent ni leur culture, ni leurs expériences, particulièrement dans le cadre de programmes traitant de l'abus physique ou sexuel et de l'abus de substances psychoactives. Les femmes autochtones aimeraient pouvoir choisir d'avoir affaire à des Autochtones dans toutes les dimensions de leur vie lorsqu'elles purgent une peine fédérale.
L'élimination du racisme
On ne peut comprendre l'importance des programmes à l'intention des Autochtones qui reflètent les cultures, la spiritualité et les expériences des femmes purgeant une peine fédérale que dans le contexte de leur volonté de se libérer du racisme.
Les femmes autochtones purgeant une peine fédérale souffrent tout particulièrement de l'érosion de leur culture et de l'éloignement de leur famille que leur imposent les Canadiens blancs. Beaucoup ont été enlevées à leur foyer et leur famille en bas âge et placées dans des foyers nourriciers ou des résidences. Beaucoup ont quitté ces foyers à l'âge de quatorze ou quinze ans pour vivre sur la rue.
Elles n'ont pas trouvé le système de justice pénale sympathique à leurs souffrances et à leurs besoins. Les femmes déclarent avoir été insultées, n'avoir reçu aucun soutien et avoir été catégorisées injustement par les avocats et les juges.
En prison, certaines se sont senties victimes de racisme et de discrimination et d'autres ont déclaré que très peu de membres du personnel comprenaient vraiment ou acceptaient leur culture et leurs pratiques.
Les femmes autochtones aspirent à des programmes culturellement pertinents afin d'acquérir l'estime de soi et le pouvoir qui leur permettront de faire face à leurs expériences de racisme et de les surmonter.
Les femmes purgeant une peine fédérale appartenant à d'autres groupes minoritaires ont sans doute aussi été victimes du racisme. Toutefois, le Groupe d'étude n'a recueilli aucun renseignement sur cette situation dans le cadre de ses recherches.
Le besoin d'autres programmes
Outre les programmes susmentionnés, on demande surtout des programmes de travail dans la collectivité, des programmes pré libératoires, des conseils et de l'aide juridique, des programmes sur les finances personnelles et les budgets, des programmes à l'intention des personnes purgeant des peines de longue durée et des programmes portant sur les enfants. Ces besoins sont particulièrement prononcés dans le cas des femmes dans les prisons provinciales où l'on offre peu de programmes.
Les besoins des femmes purgeant des peines de longue durée
Plus du tiers des femmes purgeant une peine fédérale qui ont été interviewées purgent des peines de longue durée. Trente-sept pour cent de ces femmes purgent des peines de plus de 10 ans. Vingt pour cent des femmes, ou 37 femmes purgeant une peine fédérale, sont emprisonnées à perpétuité, tandis que huit devront purger au moins 25 ans avant d'être admissibles à la libération conditionnelleFootnote lxxiii. Outre le besoin de programmes portant spécifiquement sur les difficultés de faire face à des peines de longue durée, les femmes ont affirmé que les besoins de ces prisonnières ne diffèrent pas sensiblement de ceux des femmes purgeant des peines plus courtes. Toutes les femmes veulent une amélioration des conditions de travail et de loisir, de meilleurs soins de santé, des contacts plus fréquents et plus personnels avec leur famille, et un meilleur soutien dans leur lutte contre la toxicomanie. Les prisonnières à long terme éprouvent ces besoins, mais de façon plus aiguë.
Les besoins des femmes purgeant leur peine dans des prisons Provinciales
Au moment de la recherche, 68 des 203 femmes purgeant une peine fédérale étaient emprisonnées dans des prisons provinciales en vertu d'entente d'échanges de servicesFootnote lxxiv.
Dans l'ensemble, les femmes dans les établissements provinciaux jouissent d'un bien meilleur accès à leur famille et à leurs enfants. Elles font état de moins de problèmes d'envergure en ce qui a trait à leurs relations avec le personnel et les autres femmes de la prison que les femmes purgeant leurs peines à la Prison des femmes. Toutefois, les femmes des établissements provinciaux reçoivent peu de renseignements sur leurs droits, connaissent mal les programmes auxquels elles pourraient avoir accès et se voient offrir, en règle générale, un choix très limité de programmes.
Le milieu de choix
Lorsqu'on a demandé aux femmes de choisir parmi divers types d'hébergement, seulement 19 sur 170 ont déclaré vouloir rester à la Prison des femmes. L'on préférait, et de loin, une petite résidence communautaire pour femmes à proximité de chez soi; un pourcentage assez important des femmes aurait quand même opté pour une prison régionale.
Cette préférence atteste le fait que, sur les 287 femmes purgeant une peine fédérale figurant sur les registres (c'est-à-dire emprisonnées, en semi-liberté ou illégalement en liberté), seul un petit nombre purgent leur peine à proximité de leur lieu de résidence. Tandis que 5,8 % des femmes purgeant une peine fédérale proviennent des provinces maritimes, aucune ne purge sa peine dans la région de l'Atlantique. Vingt-trois pour cent des femmes proviennent du Québec mais seulement 17,8 % sont emprisonnées dans cette province. Bien que 21,8 % des femmes soient originaires des Prairies, seules 12,5 % sont emprisonnées dans cette région; 16,7 % des femmes viennent de la Colombie-Britannique mais seulement 5 % sont dans des établissements de cette province. Par contre, seulement 22,9 % des femmes purgeant une peine fédérale viennent de l'Ontario, bien que plus de la moitié des femmes purgeant une peine fédérale sont emprisonnées à la Prison des femmes. Même les femmes ontariennes purgeant leurs peines à Kingston peuvent être loin de chez elles, compte tenu de la taille du territoire ontarienFootnote lxxv.
Environ la moitié des femmes aimeraient purger leurs peines dans un milieu mixte afin de jouir d'une atmosphère plus normale et d'avoir accès à davantage de programmes. Ces personnes ont habituellement nuancé leur intérêt en exprimant leur désir d'habiter des locaux distincts. Toutefois, d'autres étaient tout aussi convaincues qu'un établissement mixte ne conviendrait pas aux femmes, particulièrement à celles qui avaient été victimes d'abus par les hommes. L'enquête sur les programmes offerts par les établissementsFootnote lxxvi laisse entendre que les femmes dans les établissements réservés aux femmes semblent avoir accès à davantage de programmes que les femmes dans des établissements mixtes.
Lorsqu'on a demandé aux femmes ce qui leur importait le plus dans leur milieu, la plupart ont choisi la proximité du lieu de résidence; l'accès aux programmes venait en deuxième lieu.
Leur désir d'être traitées avec respect et dignité sous-tendait tous les commentaires et points de vue de ces femmes. Elles ont aussi parlé de leur besoin d'appui, plutôt que de sécurité, et de leur besoin de pouvoir opérer des choix. Beaucoup de femmes voulaient pouvoir choisir ou non de suivre un programme, particulièrement dans les domaines de la désintoxication et des soins de santé mentale; elles désiraient avoir leur mot à dire sur leur participation à ces programmes.
Entrevues avec des femmes non autochtones purgeant une peine fédérale au sein de la collectivité
Dans cette partie de l'étude, on a interviewé 57 femmes non autochtones purgeant une peine fédérale au sein de la collectivité. Près de la moitié de ces femmes étaient en semi-liberté et l'autre moitié, ou presque, jouissaient d'une libération conditionnelle. On n'a interviewé que quelques femmes en liberté surveillée. Dans l'ensemble, les besoins exprimés par les femmes en semi-liberté purgeant une peine fédérale ne différaient pas des besoins exprimés par les femmes jouissant d'une libération conditionnelle ou en liberté surveillée. On n'établira donc aucune distinction entre ces sous-groupes dans le résumé qui suit. Il est important de souligner que les données de cette partie de l'étude n'ont pas encore été soumises à une analyse approfondie. Par conséquent, le résumé suivant ne reflète que les résultats préliminaires et les impressions des chercheuses.
La planification de la mise en liberté
La plupart des femmes estimaient qu'il leur fallait beaucoup plus d'aide en matière de planification de leur mise en liberté qu'elles n'en recevaient actuellement. Elles ont affirmé que de nombreux agents de gestion de cas ne les aidaient que très peu à se préparer à leur mise en liberté. Elles considèrent ces agents comme leur lien avec l'extérieur mais estiment devoir les harceler pour obtenir des renseignements au sujet des maisons de transition ou des services offerts à l'extérieur. La bureaucratie ralentit le processus. Les femmes ont aussi déclaré aux chercheuses que, en plus de consentir beaucoup d'efforts elles-mêmes, elles obtenaient de l'aide surtout des travailleuses de la société Elizabeth Fry, des agents de liberté conditionnelle et, à l'occasion, d'avocats.
La libération conditionnelle
Les femmes au sein de la collectivité provenant des prisons provinciales s'interrogeaient considérablement sur les avantages de renoncer aux droits de libération conditionnelle fédéraux en faveur d'une libération conditionnelle provinciale. Certaines femmes avaient choisi d'aller à la Prison des femmes pour être mises en liberté plus rapidement. Certaines avaient éprouvé des difficultés à obtenir une libération conditionnelle d'une commission provinciale lorsque leurs infractions avaient fait la manchette. Les femmes avec de lourds antécédents de toxicomanie ou de criminalité ont affirmé avoir connu des difficultés particulières à obtenir une libération conditionnelle au fil des ans et avaient eu besoin de beaucoup plus d'appui pour planifier leur mise en liberté.
Joindre les deux bouts
Le manque d'argent pour assurer le nécessaire constitue un problème d'envergure pour les femmes qui ne peuvent trouver un emploi suffisamment rémunérateur au début de leur libération conditionnelle ou qui n'ont aucune expérience professionnelle réelle. Les femmes qui habitent des maisons de transition et qui n'ont pas encore trouvé de travail peuvent se voir refuser certaines prestations d'aide sociale, comme les bons de vêtements car, puisqu'elles purgent encore leur peine, un organisme de l'État assure leur subsistance. D'autres, qui satisfont aux conditions de leur libération conditionnelle, en participant par exemple, à de coûteux programmes de sevrage des drogues, ont de la difficulté à payer ces frais en plus de leur hébergement et de leurs dépenses quotidiennes. Il arrive que les femmes sans emploi soient incapables de verser un acompte pour la location d'un appartement, en vue d'une libération conditionnelle.
Les maisons de transition
La durée du séjour dans une maison de transition varie selon les provinces. Dans certains cas, les femmes sont envoyées dans une maison de transition lorsqu'elles ont purgé le sixième de leur peine; elles y resteront jusqu'au moment de leur libération conditionnelle. Dans d'autres cas, les femmes seront envoyées dans une maison de transition peu de temps avant le moment de leur libération conditionnelle. Dans les premiers cas, puisque la Commission nationale des libérations conditionnelles a comme politique de ne pas accorder de semi-liberté sans condition de résidence avant l'admissibilité à la-libération conditionnelle, les femmes peuvent devoir passer jusqu'à une année à purger leur peine » dans une maison de transition, peu importe la pertinence des autres plans qu'elles auraient pu avoir.
Une ou deux des femmes interviewées avaient passé beaucoup plus de temps dans des maisons de transition.
Compte tenu de la durée du séjour en maison de transition ou en établissement résidentiel communautaire des femmes purgeant une peine fédérale, il importe de signaler non seulement la pénurie de maison de transition au Canada mais les problèmes considérables posés par les conditions imposées aux résidentes, que nous ont communiquées les femmes.
Dans les localités où il n'y a pas de maison de transition, de nombreuses femmes ont été hébergées dans des établissements résidentiels communautaires où habitent divers types de résidents. Pour beaucoup de femmes, ces maisons communautaires ne conviennent pas : elles doivent composer avec un personnel peu habitué à traiter avec des femmes sortant de prison, qui a parfois une attitude trop bourgeoise » et qui n'a ni les connaissances ni le temps de leur fournir l'appui ou l'aide dont elles croient avoir besoin. Lorsqu'on ne réserve qu'un ou deux lits aux femmes qui sortent de prison dans un foyer pour hommes, ces femmes sont mal à l'aise. D'autres maisons communautaires offrent la pension complète mais aucun service de counseling ou de soutien. Dans certaines de ces maisons, les femmes ont affirmé que le personnel fait la police » durant la nuit entêtant un coup d'oeil dans les chambres toutes les heures. Afin d'éviter les problèmes qui affligent tant de maisons communautaires, certaines femmes des provinces sans maison de transition habitent dans des maisons de transition ontariennes.
Mais la majorité de ces femmes préféreraient, et de loin, habiter dans leur propre province.
Beaucoup de femmes ont critiqué l'emplacement des maisons de transition. Celles-ci sont souvent situées dans des villes qui offrent trop de tentations. Les femmes ont affirmé qu'il était alors difficile pour certaines d'entre elles d'éviter d'autres démêlés avec le système judiciaire.
Bien qu'une ou deux maisons de transition aient été louangées par les femmes, ces dernières ont de la difficulté à composer avec leur double rôle : être des citoyennes responsables durant le jour et obéir à des règlements enfantins durant la nuit. Les femmes qui ont leur propre maison ou appartement trouvent futiles les conditions de résidence dans ces maisons. Certaines de ces femmes passent la journée dans leur propre foyer et retournent à la maison de transition ou à la maison communautaire chaque soir.
Les femmes ont aussi déclaré que certaines maisons imposent une foule de règlements mesquins; si les femmes ne les respectent pas, elles peuvent se voir interdites de sortie ou punies. Certaines maisons contrôlent les comptes de banque, vérifient l'haleine pour savoir si les femmes ont bu, approuvent les éventuelles compagnons ou compagnes et surveillent de près les allées et venues ainsi que les comportements des femmes. Certaines limitent l'âge des enfants auxquels on permet des visites.
Malgré le caractère irréaliste et souvent avilissant de ces règlements, les femmes ne doivent jamais oublier que si elles ne satisfont pas à ces conditions, elles peuvent être renvoyées en prison.
Le fait que certaines femmes qui avaient connu de mauvaises expériences dans des maisons de transition aient choisi de demeurer en prison jusqu'au moment de leur libération conditionnelle atteste l'ampleur des problèmes que posent pour les femmes les maisons de transition et les maisons communautaires.
L'hébergement à long terme
La pénurie de logements pour les personnes à faible revenu est particulièrement aiguë dans certaines régions; quelques femmes ont souligné le besoin de coopératives d'habitation pour les ex-détenues qui n'ont pas déjà de foyer. Certaines femmes qui s'apprêtaient à quitter des maisons de transition ou à obtenir leur libération conditionnelle ou une mise en liberté surveillée ont fait valoir l'utilité de tels logements.
Ils faciliteraient la tâche aux femmes gui, en raison de leur âge, de leur dossier judiciaire ou d'une dépendance, ne peuvent trouver un emploi. Aussi, une femme avait déménagé cinq fois depuis sa mise en liberté surveillée, six mois auparavant.
Obtenir un emploi
En règle générale, les femmes qui détenaient un bon emploi rémunérateur avant leur emprisonnement ont réussi à trouver un emploi lors de leur mise en liberté. Mais les femmes sans expérience professionnelle ou qui vivaient sur la rue ont plus de difficulté à faire face à la mise en liberté. Les emplois qu'on leur offre sont souvent mal payés. Certaines femmes les refusent si elles sont habituées à de meilleurs emplois.
Il y aussi beaucoup de femmes qui ne peuvent trouver leur place sur le marché du travail et auxquelles il importe d'offrir une formation. Parfois, dans le cadre de leurs projets de mise en liberté, on leur trouve du travail bénévole; mais il ne s'agit pas là d'une solution à leurs problèmes financiers. Aucune des femmes interviewées n'avait obtenu déformation professionnelle en sortant de prison, bien que certaines étaient en stage d'apprentissage. Quelques-unes ont été victimes de discrimination de la part d'employeurs qui les ont congédiées après avoir découvert qu'elles avaient un dossier judiciaire. Plus d'une fois, cette information a été divulguée à l'employeur de la femme par un agent de liberté conditionnelle.
Les conditions de libération
Les femmes estiment que certaines conditions de libération sont inutilement contraignantes. Ces femmes, qui jouissent d'une libération conditionnelle depuis quelque temps, croient qu'elles pourraient pouvoir téléphoner à leur bureau de libération conditionnelle ou à la police plutôt que d'avoir à se présenter régulièrement en personne. Certaines femmes étaient d'avis que l'obligation de se présenter en raison de problèmes de toxicomanie ou pour d'autres types d'intervention était inutile car elles n'éprouvaient plus ces problèmes. Comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreuses femmes en semi-liberté, qui ont leur propre foyer, aimeraient pouvoir y habiter plutôt que d'habiter dans une maison de transition.
Les femmes aux prises avec des problèmes de toxicomanie sont doublement handicapées. Dans l'ensemble, elles n'ont pas trouvé les programmes offerts par les prisons assez intensifs. On leur refuse souvent la semi-liberté en raison de leur dépendance et on ne les aide pas à trouver un logement ou un emploi en vue de leur libération conditionnelle. Puisqu'elles n'ont pas d'hébergement, on leur refuse la libération conditionnelle. Certaines femmes ont passé des années à alterner entre la prison et la liberté surveillée. Par ailleurs, celles qui souffrent d'une dépendance de longue durée ont de la difficulté à trouver un emploi qui leur procure assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. De plus, les femmes qui désirent surmonter leur dépendance doivent satisfaire à des conditions de libération conditionnelle qui les obligent à participer à des programmes de sevrage par la méthadone, programmes qui sont contraires à leurs buts.
La supervision
On a constaté l'importance d'une relation positive avec les agents de libération conditionnelle. Certaines femmes ont affirmé ne pas bien s'entendre avec leur agent, ne pas lui faire confiance et ne pas obtenir l'aide dont elles avaient besoin. Celles qui avaient trouvé un agent avec lequel elles s'entendaient bien obtenaient énormément de soutien et d'encouragement. Cette situation semble découler en grande partie de la «chimie» entre les personnes ainsi que des approches qui sont prises. Les femmes ont aussi déclaré important l'appui de bons conseillers chez les Alcooliques anonymes ou chez les Narcotiques anonymes ainsi que de bons psychiatres pour améliorer la qualité des relations de surveillance.
Un appui et non un contrôle
La plupart des femmes ont affirmé sans équivoque qu'elles avaient besoin d'appui et non de contrôle.
Les femmes estimaient que le contrôle exercé par les maisons de transition, par les agents de liberté conditionnelle et par les commissions de libération conditionnelle n'a souvent aucun rapport avec leur situation concrète. Elles croient que le niveau de contrôle a davantage trait à leur calendrier de libération qu'à leurs besoins ou à leurs circonstances. Certaines femmes auraient voulu prendre un certain temps de recul au début de leur semi-liberté ou de leur libération conditionnelle totale mais se sentaient tenues de trouver un emploi ou de fréquenter l'école. Lorsqu'on avait permis aux femmes de fonctionner à leur propre rythme, elles avaient beaucoup profité de cette expérience.
Constatations générales
Tout au long de ces entrevues, les femmes ont exprimé avant tout un besoin de respect et de soutien, et demandé qu'on leur offre la chance d'assumer la responsabilité de leurs propres vies. Elles ont aussi souligné un besoin pressant d'établissements résidentiels communautaires qui tiennent compte des besoins particuliers des femmes, qui protègent leur dignité et répondent à leurs besoins d'habiter dans leur propre localité ou à proximité.
Entrevues avec les femmes autochtones au sein de la collectivité
Ce rapport a été préparé par deux femmes autochtones qui ont fait l'expérience du système carcéral canadien. Elles ont recueilli les renseignements nécessaires à l'étude grâce à des entrevues avec 39 femmes autochtones purgeant une peine fédérale au sein de la collectivité.
Les femmes ont fait état de violence et de racisme, et ont parlé de ce que cela signifiait d'être femme, autochtone et en prison. Elles ont parlé de la violence systématique dont elles avaient été victimes tout au long de leurs vies de la part des personnes avec lesquelles elles habitaient, dont elles dépendaient, qu'elles aimaient et en qui elles avaient confiance. Trente-sept des 39 femmes interviewées ont décrit des expériences de violence en bas âge, de viol et d'abus sexuelle continue; certaines avaient été témoin d'un meurtre, avaient vu leur mère se faire battre à maintes reprises et avaient été battues par le personnel et les autres enfants dans des centres de détention juvénile.
Pour beaucoup de ces femmes, la violence de l'enfance est devenue partie intégrante de leurs vies et s'est poursuivie durant l'adolescence et l'âge adulte. Vingt-et-une femmes avaient été violées ou agressées sexuellement durant l'enfance ou l'âge adulte. Vingt-sept des 39 femmes avaient été victimes de violence durant l'adolescence. S'ajoutaient à ces expériences la violence de la prostitution, du viol et de l'agression sur la rue. De plus, 34 des 39 femmes avaient été victimes de violence, certaines aux mains de conjoints (25), certaines aux mains de clients qui les avaient battues ou violées (12 des 39 avaient connu cette expérience et 9 avaient fait preuve de violence à l'égard de clients), d'autres encore aux mains de la police ou de gardiens de prison. Habituellement, ce sont des hommes qui commettent des actes de violence à l'égard de ces femmesFootnote lxxvii.
Les femmes ont aussi parlé de leur expérience du racisme. Le racisme et l'oppression sont les conditions préalables à la violence que connaissent ces femmes tout au long de leurs vies.
Ces expériences de violence ont aussi laissé aux femmes autochtones un lourd fardeau de souvenirs qu'elles essaient d'effacer par un comportement autodestructeur. Les tentatives de suicide sont courantes. Trente-et-une des 39 femmes avaient abusé de l'alcool et dix d'entre elles considéraient leur dépendance comme grave. Vingt-sept se considéraient gravement dépendantes des stupéfiants et beaucoup étaient dépendantes de médicaments d'ordonnance. Vingt-trois ont évoqué une dépendance à l'égard des médicaments d'ordonnance fournis par les psychiatres ou les médecins des établissements où elles étaient incarcérées. Dix des 39 femmes ont mentionné s'être tailladées non pas pour se suicider mais plutôt pour soulager la tension et la colère qui les habitentFootnote lxxviii.
Les femmes ont aussi parlé de leur expérience du racisme. Elles ont parlé d'expériences de racisme flagrant d'avoir été appelées sales indiennes » à l'école, dans des foyers nourriciers et par les policiers et les gardiens. Elles ont déclaré avoir été traitées différemment et savoir que cela était intentionnel.
Les antécédents de la plupart des femmes interviewées les incitent à ne pas faire confiance au pouvoir blanc. Vingt des 39 femmes ont décrit des rapports négatifs avec la police. Beaucoup de ces descriptions font état d'une méfiance «inhérente», conséquences du rôle que la police joue dans la vie des autochtones. D'autres figures d'autorité blanche sont souvent la source d'expériences négatives et sont considérées comme agressives, racistes ou peu enclines à les appuyer. Des 14 femmes qui avaient vécu dans des foyers nourriciers, 12 ont fait état de relations négatives avec leurs parents nourriciers tandis que seulement deux avaient eu des relations positives. Trente-deux des 39 femmes ont déclaré avoir été victimes de racisme à un moment ou l'autre de leur vie. Vingt-trois avaient connu de la discrimination à l'école, 15 dans des maisons de transition, 6 dans des centres de désintoxication. Elles avaient vécu de telles expériences aussi avec des personnes qui auraient dû les aider : des agents de gestion de cas (13 ont déclaré cette relation négative), des agents de libération conditionnelle (20) et des travailleurs sociaux (9). L'on décrit aussi de façon très négative les rapports avec les gardiens de prison : des raclées des viols, du harcèlement sexuel et de l'intimidation verbaleFootnote lxxix.
Outre cette expérience de racisme flagrant, les femmes ont aussi décrit une oppression systématique et un rejet de la part des Blancs. Elles ont appris que les règles imposées par une autorité qu'elles ne respectent pas existent pour être violées. Rejetées par les institutions et victimes de racisme, leurs sentiments à l'égard de l'autorité blanche conjuguaient une méfiance passive à une haine active, et ce même avant leurs démêlés avec le système de justice pénale.
Souvent, les attitudes à l'égard de l'autorité blanche conditionnaient la façon dont ces femmes recevaient des peines fédérales. Les comptes rendus de plusieurs entrevues font état de femmes gui ne croyaient pas qu'un système judiciaire puisse faire preuve de justice à leur égard et qui n'avaient pas confiance en l'avocat qui devait les représenter. Puisqu'elles se sentaient impuissantes et n'avaient pas confiance aux procédures, qu'elles ne comprenaient d'ailleurs pas, certaines se sont soumises. Elles ont accepté des négociations de plaidoyer qui leur portaient préjudice ou sont demeurées silencieuses, refusant de témoigner tant pour s'exonérer que pour impliquer d'autres personnes dans les éléments les plus graves des crimes qu'on leur reprochait. Elles ont accepté sans mot dire d'être emprisonnées, tout comme elles avaient toujours accepté leur rôle de victime.
Pour les femmes autochtones, la prison est une extension de la vie à l'extérieur; par conséquent, il leur est impossible de guérir en prison. Elles ont affirmé que les règlements de la prison revêtent pour elles la même illégitimité que les règles opprimantes qu'elles ont toujours connues. Les prisons sont une autre expression d'une autorité blanche, sexiste, raciste violente, qui diffère de celle du monde extérieur mais qui s'y apparente néanmoins. Les quelques rares services d'aide qu'offre la prison pour permettre à ces femmes de guérir sont offerts d'une façon qui ne convient pas à leur culture en tant que femmes et Autochtones. Les médecins, les psychiatres et les psychologues sont habituellement des hommes blancs. Ils représentent donc les pires expériences des femmes autochtones. Par conséquent, celles-ci ressentent une colère à l'égard de ces personnes, refusent de se prévaloir de leurs services et sont punies encore davantage parce qu'elles refusent de subir un traitement.
Les femmes ont parlé de la rupture des liens avec le monde extérieur; or, ces liens pourraient les aider à guérir. Elles sont souvent placées loin de leurs familles, qui ne peuvent se permettre de leur rendre visite. Vingt-six des femmes qui ont participé à l'étude sont des mères et toutes ont fait état de répercussions néfastes sur les relations avec leurs enfants. Cela n'est pas étonnant, mais la distance, l'impossibilité de voir leurs enfants et les orientations des fonctionnaires de la prison, qui sont habituellement considérés comme insensibles aux relations mère-enfants, exacerbent le problème. Les enfants de ces femmes avaient été placés dans des foyers nourriciers ou des centres de détention juvénile, ou passaient d'un membre de la famille à l'autre. Vingt-cinq des 26 mères ont eu de la difficulté à reprendre leur rôle de mère lors de leur mise en liberté et seulement 17 avaient retrouvé leurs enfantsFootnote lxxx.
Presque toutes les expériences de guérison dont ont fait état les femmes autochtones qui ont été emprisonnées ont eu lieu hors du cadre carcéral. Elles découlent des liens forgés avec d'autres femmes en prison, du soutien de personnes de l'extérieur et des activités de la Native Sisterhood. Il arrive qu'on développe une relation positive avec l'agent chargé du cas, mais il s'agit là d'exceptions. Le refus des femmes autochtones de s'en remettre aux services d’aide de la prison joue contre elles. Beaucoup des femmes interviewées sont perçues comme faisant preuve de manque de coopération. On leur conservait une classification de sécurité élevée et on leur refusait des permissions de sortir. Les femmes autochtones ont déclaré qu'on avait rejeté leurs demandes de libération conditionnelle parce qu'elles avaient refusé de traitements ou s'étaient montrées peu coopératives.
Les femmes croient avoir ce qu'il faut pour s'aider elles-mêmes. Malgré la douleur et la violence passées et présentes, elles espèrent pouvoir, grâce aux ressources, à l'aide et au soutien pertinents, créer les programmes dont elles ont besoin.
Points saillants des autres études.
Une ère de changement
Beaucoup de gens croient que nous traversons actuellement une période de changements créatifs en ce qui a trait à la perception qu'ont les décideurs et les prestataires de services du système judiciaire et de ses rapports avec les femmes purgeant une peine fédérale.
Toutefois, les chercheuses ont constaté que la volonté et les mesures politiques n'attestent que rarement cette nouvelle perception. Lee Axon déclare, par exemple que :
Dans l'ensemble, l'élaboration des programmes dans les établissements correctionnels pour femmes semble traverser une période d'innovation. On a constaté que certaines des innovations dans les services correctionnels féminins pourraient aussi profiter aux détenus masculins, si on leur permettait d'en profiter. Les idées ne semblent pas manquer seulement l'argent et la volonté politique.Footnote lxxxi
Lee Axon et Margaret Shaw, qui ont préparé les études à caractère historique et comparatif, ont cerné un certain nombre de changements survenus au cours des quelques dernières années en ce qui a trait aux approches utilisées à l'égard des femmes emprisonnées dans d'autres pays occidentaux et, dans une certaine mesure, au Canada.
Une reconnaissance du besoin d'approches holistiques
Les fondements holistiques des actuels programmes correctionnels à l'intention des femmes constituent une de leurs dimensions les plus importantes. Les femmes détenues... doivent jouir de programmes qui s'intéressent à l'ensemble de leur personneFootnote lxxxii. Ce sont les hommes et les femmes autochtones qui ont été les grands responsables de ce nouvel intérêt envers les approches holistiques. Les philosophies autochtones sont holistiques. Le mode de vie autochtone est holistique. Et les programmes initiés par les peuples autochtones se fondent sur des principes holistiques.
Un nouvel accent sur le partage des responsabilités
Dans le passé, la réinsertion sociale était surtout quelque chose que l'on «faisait subir» aux femmes détenues; il semble maintenant qu'on mette davantage l'accent sur la responsabilité de la femme à l'égard de sa propre réadaptation. L'établissement ne se charge pas de la réinsertion sociale mais la femme opère des choix pour se créer un avenir plus responsable et autonome, et se réinsère elle- même. Dans cette optique, la responsabilité de l'établissement est d'offrir à la femme les programmes qui lui faciliteront la tâcheFootnote lxxxiii.
Les inquiétudes soulevées par la dépendance des femmes
Tous les programmes (innovateurs)* qui s'adressent aux femmes en prison s'intéressent avant tout à la dépendance... une question encore mal connue mais qui semble toucher la vie de tellement de femmes incarcéréesFootnote lxxxiv. Cette préoccupation ne comprend pas seulement la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues mais aussi une dépendance à l'égard d’autres personnes et des établissements, ainsi que la faible estime de soi qu'entraîne souvent cette dépendance. La dépendance est une question particulièrement pertinente dans le cas des femmes autochtones qu'on a habituellement orientées vers une dépendance à l'égard des institutions non autochtones. La recherche révèle qu'il faut pouvoir compter sur des programmes pertinents pour aider les femmes autochtones à se libérer de leur dépendance, puisque les sources du problème et la signification culturelle des réactions aux problèmes sont souvent très différentes chez ces femmes, comparativement aux femmes non autochtones purgeant une peine fédérale.
Une perte de confiance dans l'emprisonnement
Le recours généralisé à l'emprisonnement a été fortement remis en question par une perte de confiance dans son aptitude à assurer la réinsertion sociale des contrevenants. Il a aussi été remis en question par les observations voulant qu'il crée d'énormes désavantages pour (les femmes)*... puisque celles-ci semblent disposer de moins de ressources que bien des hommes et présenter moins de risques pour la sociétéFootnote lxxxv. Cette perte de confiance a donné lieu à une conviction selon laquelle nous devons disposer de plus d'options et de choix quant à la façon de réagir au mal causé aux personnes par des crimes et par la réaction actuelle de la société à ces crimes.
Il est évident que dans certaines sphères de compétence, l'on cherche des solutions à l'emprisonnement de plus en plus fréquent des femmes, non pas en construisant d'autres prisons mais en tentant d'endiguer l'afflux des femmes dans le système de justice pénale et en offrant diverses solutions de rechange au sein de la collectivité, qui tiennent compte des nombreux problèmes auxquels sont en butte les contrevenantesFootnote lxxxvi.
L'inquiétude grandissante soulevée par les répercussions de l'emprisonnement sur les femmes et leurs enfants
Depuis 1985, au Canada, le gouvernement a commandé quatre études qui ont toutes étudié des dimensions du problème y compris les répercussions de la séparation sur les femmes et leurs familles, les probabilités de conséquences à long terme, les programmes de contacts et de soins, les habiletés parentales et les garderies en établissement, ainsi que les coûts sociaux de l'incarcération des mèresFootnote lxxxvii.
Soulignons l'importante recherche qu'achève Karen Lee Cannings pour le ministère du Solliciteur général. Les questions ont été étudiées et continuent de susciter l'attention, mais cela ne s'est pas traduit par des mesures concrètes.
Une tendance à percevoir l'emprisonnement des femmes à la lumière de leur situation globale au sein de la société
Les personnes qui partagent cette vision remettent constamment en question «la pertinence de l'approche traditionnelle qui est inspirée de l'emprisonnement des hommes» et qui «ne tient pas compte du bien-fondé même de l'incarcération ou des effets destructeurs de l'emprisonnement sur les personnes dont la difficulté à survivre au sein de la collectivité est en grande partie responsable de leur incarcérationFootnote lxxxviii. »
Les types de programmes qui réussissent
Bien que les chercheuses se soient gardées de tenir pour acquis que les programmes qui fonctionnent dans d'autres pays connaîtront du succès au Canada, ou que les programmes puissent être exportés d'une sphère de compétence à l'autre au sein même du Canada, elles ont néanmoins déterminé quelques orientations en matière de programmes et de politiques qui sont susceptibles d'aider à surmonter certains des problèmes énumérés ci-dessus.
Les chercheuses estiment qu'il est essentiel que les femmes acquièrent une meilleure conscience de soi et une plus grande estime de soi grâce à des programmes qui les aident à répondre à d'autres besoins, et ce afin de leur permettre de devenir des citoyennes responsables. Lee Axon mentionne de nombreux programmes américains (y compris des programmes de lutte contre l'abus de substances psychoactives et de formation professionnelle, et des programmes portant sur l'abus physique ou sexuel), dont certains éléments aident les femmes à mieux se connaître et à acquérir confiance en elles.
On a aussi jugé important d'assurer un soutien continu, y compris le suivi des programmes après la mise en liberté.
Dans le même ordre d'idées, on a constaté que les programmes fructueux faisaient tout ce qui était possible pour accroître le soutien de la collectivité et l'intégration de la femme. Pour ce faire, on a recours à une foule de solutions, notamment : la formation professionnelle, qui prépare la femme à l'autonomie au sein de la collectivité; le recours à des services communautaires qui répondent aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale au sein de la collectivité plutôt qu'en établissement; et un recours plus généralisé aux peines purgées au sein de la collectivité.
Les chercheuses ont aussi mis l'accent sur la concertation des divers organismes pour favoriser un réel soutien de la collectivité. Mentionnons entre autres la création d'un conseil communautaire consultatif au Michigan qui a pour mandat : de participer à l'élaboration et à la dotation en personnel de programmes en établissement offerts par des organismes communautaires et des agences de service social; d'offrir des services de suivi et de créer des réseaux à l'intention des détenus mis en libertéFootnote lxxxix. Les consultations menées par le Groupe d'étude soulignent que les programmes et les services devraient viser à créer un milieu sain, favorable à la guérison et à la croissance personnelle. On a aussi signalé l'importance de traiter les femmes avec respect et dignité; il devrait s'agir là d'un principe fondamental de tout programme.
En dernier lieu, le succès des programmes repose sur une volonté politique manifeste:
Les sphères de compétence où les progrès ont été les plus notables sont celles où les assemblées législatives ont offert l'appui politique et financier nécessaire et ont aussi créé un poste de cadre supérieur au sein de leurs services correctionnels, dont le titulaire a été chargé de coordonner et de contrôler les services correctionnels à l'intention des femmesFootnote xc.
Conclusion
Les constatations des chercheuses reflètent les voix des femmes, les voix des personnes qui les ont à coeur et les voix du passé. L'importance du choix, de la dignité, de la responsabilité, de la participation communautaire, du courage et de l'innovation sont reprises par de nombreuses voix.
Les diverses voix soulignent à quel point il est important de susciter la volonté politique et administrative et d'avoir le courage de miser sur le consensus de plus en plus élargi en faveur du changement; il faut s'inspirer des connaissances de plus en plus approfondies sur la façon d'opérer des changements en vue d'offrir des choix valables aux femmes purgeant une peine fédérale.
Qui plus est, toutes ces voix nous rappellent que la création de choix est une entreprise humaine, une entreprise au cours de laquelle il ne faut jamais oublier de respecter la dignité, les droits, les besoins et les espoirs des femmes.
Section B : Adapter la sagesse aux réalités présentes
Chapitre VI : Comprendre le problème
L'ampleur du problème
Au Canada, les groupes d'étude et les commissions parviennent systématiquement aux mêmes conclusions et aux mêmes recommandations en ce qui concerne les femmes purgeant une peine fédérale. Il n'en reste pas moins que les services offerts à ces femmes ne leur conviennent pas ou ne répondent pas vraiment à leurs besoins et que leur expérience de l'emprisonnement est mal comprise.
Dans le passé, les groupes d'étude et commissions abordaient le problème sous un angle très étroit; il était celui des femmes purgeant une peine fédérale au sein du secteur correctionnel. Dans cette optique, le problème était défini de manière encore plus restreinte : il s'agissait tout simplement de la gestion des femmes purgeant une peine fédérale à la Prison des femmes.
Mais l'étude des dilemmes que comporte cette manière d'envisager la question révèle qu'une définition aussi étroite du problème ignore totalement le contexte social de la réalité des femmes. Au Canada et dans d'autres pays occidentaux, les femmes vivent avec des inégalités découlant de traditions et de valeurs qui accentuent leur dépendance envers les hommes et envers les institutions. L'ancienne façon d'aborder le problème ne tient pas compte non plus de la discrimination dans la discrimination que connaissent les femmes autochtones dans le cadre de cette réalité sociale.
Cette définition étroite du problème devient irrecevable dans une conception holistique des expériences et des besoins des femmes ... une conception qui tient compte de leurs besoins physiques, émotifs, psychologiques, spirituels et matériels ainsi que de leur besoin d'avoir des liens et des rapports avec leur famille et la communauté en général. Si ces besoins ne sont pas restitués dans le contexte de leurs expériences de vie passées, présentes et futures, si la femme n'est pas traitée et considérée comme une
« personne à part entière », les programmes et politiques destinés aux femmes purgeant une peine fédérale continueront d'être inadéquats et déshumanisants.
A l'instar de groupes d'étude antérieurs, ce groupe d'étude s'est borné à étudier la situation des femmes purgeant une peine fédérale, c'est-à-dire des femmes condamnées à des peines de deux ans ou plus.
Déjà convaincus de la nécessité de bien circonscrire le problème, les membres de ce groupe d'étude sont parvenus à la conclusion qu'il était également très important de comprendre le problème global et son évolution pour être en mesure d'opérer des changements fondamentaux.
Dilemmes perpétuels
Depuis la première étude majeure sur la situation des femmes purgeant une peine fédérale, réalisée en 1938 par la commission Archambault,Footnote xci les membres des groupes d'étude, les décideurs, les défenseurs de diverses causes, les chercheurs et les travailleurs de première ligne ont dû faire face à un certain nombre de dilemmes connexes. Que pouvons-nous faire pour qu'une population peu nombreuse, diversifiée et constituée de sous-groupes encore plus petits (répartis selon la durée des peines, le type d'infractions, la communauté d'origine, la race ou la langue) soit moins souvent victime de l'éloignement géographique, de conditions de détention in satisfaisantes et d'une insuffisance de programmes?
A l'heure actuelle, deux facteurs rendent ces éternels dilemmes encore plus complexes. Premièrement, les bâtiments abritant les femmes purgeant une peine fédérale sont pour la plupart désuets et vétustes. Deuxièmement, les femmes purgeant une peine fédérale sont largement défavorisées sur le plan des services à cause du nombre croissant de transfèrements non planifiés vers les établissements provinciaux en vertu des ententes d'échanges de services.
En fait, les projets mis en oeuvre afin d'améliorer les conditions d'incarcération et les programmes à la Prison des femmes ne comportaient aucune mesure complémentaire pour les femmes transférées dans leur province d'origine. En vertu d'une entente ratifiée en 1982, la plupart des femmes du Québec purgeant une peine fédérale ont pu, depuis cette époque, purger cette peine dans leur province d'origine. Mais il s'agit là d'une exception à la règle car, dans les autres provinces, les femmes ont été et sont encore si peu nombreuses à bénéficier d'un transfèrement que le Service correctionnel du Canada s'est comporté comme si elles étaient invisibles.
Les installations et les programmes à l'intérieur des prisons sont insuffisants; on retrouve une situation semblable dans la communauté, qu'il s'agisse des services offerts au palier national ou de l'efficacité de la planification en matière de mise en liberté. De plus, le Service correctionnel du Canada a négligé de recueillir des données objectives sur les femmes purgeant une peine fédérale qui ont été placées sous surveillance au sein de la collectivité, et entre autres sur les femmes provenant d'établissements provinciaux: cette négligence peut signifier que le Service correctionnel comprend mal sa responsabilité globale à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale, quel que soit leur lieu d'incarcération, lorsqu'il s'agit de pallier l'insuffisance des installations et l'iniquité des programmes. L'absence de certaines données et l'existence de données qui ne sont ni objectives ni regroupées rendent la planification encore plus difficile.
Un examen plus attentif de ces dilemmes
Au cours du processus de consultation, les membres du groupe d'étude ont eu l'occasion d'examiner de plus près et sous ses différents aspects les responsabilités du Service correctionnel du Canada à l'endroit des femmes purgeant une peine fédérale à la Prison des femmes ainsi que dans les provinces et les territoires. Cette démarche a permis de mieux cerner le problème, comme on pourra en juger dans les sections qui suivent.
Le logement
La construction de la Prison des femmes s'est terminée en 1934. Il s‘agit d'un bâtiment à plusieurs étages construit sur le modèle des établissements à sécurité maximale pour hommes. D'importantes améliorations ont été apportées à la prison (incluant des installations indispensables à la réalisation de certains programmes comme le Centre d'activité aménagé en 1982 et l'Unité des visites familiales privées aménagée en 1983) mais les problèmes découlant de la conception initiale des établissements à sécurité maximale n'ont pas été réglés.
De nombreux rapports et études sont parvenus à la conclusion que la majorité des femmes se voient imposer des mesures de sécurité plus sévères que nécessaires à cause du manque de souplesse dans la conception des lieux d'incarcération. En 1981, on a érigé, autour de la prison, un haut mur solide, au coût approximatif de deux millions de dollars; ce mur lui donne l'aspect d'une forteresse. Il sépare physiquement la prison de la communauté et crée du même coup une barrière psychologique : non seulement les femmes de la prison sont-elles à l'écart de la communauté, elles sont mêmes devenues invisibles.
A l'intérieur des murs, la prison est bruyante, mal ventilée et les espaces disponibles sont soit insuffisants, soit peu propices aux interactions avec la communauté et à l'exécution des programmes. Peu de changements importants ont été apportés à ce milieu de vie; il y a donc lieu de croire que la conclus ion à laquelle était parvenu le Sous-comité sur le régime d'institutions pénitentiaires au CanadaFootnote xcii (dont nous avons déjà parlé) demeure toujours vraie. A savoir, « que la Prison des femmes n'est pas digne de recevoir des ours, encore moins des femmes ». Il est impossible de répondre efficacement aux besoins des femmes autochtones, surtout en ce qui a trait aux espaces consacrés aux célébrations, aux contacts permanents avec les aînés et à l'accès à l'extérieur, d'une part à cause des limites physiques de la prison et d'autre part à cause de la distance séparant ces femmes des communautés autochtones auxquelles elles appartiennent.
L'éloignement géographique
Sur les cent trente femmes présentement emprisonnées, seulement soixante proviennent de communautés de l'Ontario. Les autres sont originaires de diverses régions du pays. Ces femmes sont à Kingston soit parce qu'elles ne peuvent (compte tenu de la durée de leur peine, du type d'infraction ou de conflits de personnalité) demeurer dans leur province d'origine en vertu d'une entente d'échanges de services ou parce qu'elles ont choisi la Prison des femmes pour jouir d'une plus grande diversité de programmes. Ces problèmes d'admissibilité et cette obligation de choisir entre le lieu d'incarcération et les programmes offerts existent depuis 1973, date de la première négociation en vue d'en arriver à des ententes d'échange de services. Les femmes contraintes de faire un choix de cette nature n'ont pour ainsi dire aucun choix.
Des programmes restreints, surtout pour les femmes purgeant des peines de longue durée
Les ententes de 1973 ont été négociées afin de donner suite à la loi habilitante qui stipule qu'un délinquant transféré dans une autre province canadienne est assujetti à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les règles en vigueur dans la province d'accueil. En d'autres mots, le détenu fédéral transféré dans un établissement sous juridiction provinciale devient un «prisonnier provincial».
Les ententes de 1973 acceptaient donc implicitement les normes et les niveaux de services en vigueur dans les provinces. Au cours des premières années, les transfèrements s'effectuaient sur une base volontaire, ils étaient peu nombreux et étaient généralement le fait de détenus fédéraux purgeant des peines de courte durée ou de détenus souhaitant se rapprocher de leur domicile au cours de la période précédant immédiatement leur mise en liberté. Le fait que, dès l'entrée en vigueur de ces ententes, les programmes et services des établissements provinciaux aient été destinés principalement aux prisonniers purgeant des peines de courte durée n'a donc pas causé de problèmes. Ce désintéressement à l'égard des besoins des personnes purgeant des peines d'emprisonnement de longue durée a grandement pénalisé les femmes purgeant des peines fédérales; dans leur cas, le transfèrement représentait et représente toujours la seule solution de rechange valable à la Prison des femmes.
Vers la fin des années 1970, le nombre de transfèrements des femmes purgeant des peines fédérales a augmenté et il est devenu de plus en plus évident que ce choix était injuste pour les femmes. Les ententes tenaient pour acquis que tous les hommes et toutes les femmes purgeant une peine fédérale pouvaient s'adapter à la structure provinciale suite à leur transfèrement. Par conséquent, les paiements fédéraux associés à ces transfèrements étaient essentiellement fonction des frais d'exploitation provinciaux. Ces ententes n'étaient donc pas suffisamment souples pour tenir compte des besoins des femmes purgeant des peines de plus longue durée.
Les ententes prévoyaient également la possibilité de transférer, au régime fédéral, les prisonniers purgeant des peines dans les établissements provinciaux (c'est-à-dire des peines de moins de deux ans). Personne ne s'est demandé si ce mécanisme convenait aux femmes purgeant des peines provinciales, car ces dernières ne pouvaient être transférées qu'à la Prison des femmes alors que les hommes purgeant des peines provinciales pouvaient choisir entre de nombreux établissements.
Parmi ces femmes purgeant des peines provinciales, le nombre de femmes autochtones était anormalement élevé. Leur transfèrement les a éloignées non seulement de leur communauté d'origine mais également de leur culture.
Dans les provinces, la sécurité passe avant les programmes
La première entente consacrée aux femmes purgeant une peine fédérale a été conclue avec la province de Québec en 1982 (l'entente Tanguay). Cette entente garantissait l'incarcération dans leur province à toutes les Québécoises purgeant une peine fédérale mais continuait de prétendre, comme au début, que le mode de fonctionnement des établissements provinciaux était satisfaisant. L'entente Tanguay ne contenait aucune disposition sur les programmes nécessaires; elle traitait cependant du problème de la sécurité. Environ un million de dollars a été consacré à la rénovation de l'établissement afin de le rendre plus sécuritaire.
Entre 1984 et 1986, les ententes de 1973 ont été révisées sans que ne soient relevées les injustices du programme. Il n'a même pas été question de négocier des ententes distinctes, dans chacune des provinces, pour les femmes et les hommes purgeant une peine fédérale. Peut-être a-t-on jugé qu'il ne valait pas la peine de conclure une entente distincte étant donné le petit nombre de femmes transférées à un moment donné?
Le résultat : des injustices de plus en plus grandes en matière de programmes
Au moment même où les transfèrements de femmes purgeant une peine fédérale augmentaient, les programmes et les services de la Prison des femmes étaient améliorés, principalement suite à la cause portée en 1981 devant la Commission canadienne des droits de la personne. Au cours des années 1980, l'écart entre le niveau de services de la Prison des femmes et le niveau de services des établissements provinciaux s'est donc accentué.
Durant cette période, le niveau des transfèrements s'est également stabilisé. La plupart des provinces ont refusé d'accueillir des femmes purgeant des peines de plus de cinq ans (ce fut le cas de la Saskatchewan et du Manitoba) ou de plus de dix ans (ce fut le cas en Alberta et en Colombie- Britannique) ainsi que les femmes jugées difficiles à garder. Ces décisions montraient que les établissements provinciaux n'étaient pas adaptés aux femmes purgeant des peines de longue durée ou ayant des besoins considérables.
Les femmes doivent choisir entre des programmes et un lieu d’incarcération
A l'exception de l'entente Tanguay, aucune autre entente n'oblige une province ou un territoire à accepter le transfèrement proposé; les femmes purgeant une peine fédérale doivent donc, dans un premier temps, être admissibles au transfèrement et, dans un deuxième temps, choisir entre purger leur peine dans leur province d'origine ou avoir accès à des programmes et services plus complets, conçus spécialement pour répondre aux besoins des personnes purgeant des peines de plus longue durée.
Ce choix entre des programmes et un lieu d'incarcération est devenu plus déchirant au cours des dernières années. L'entente Burnaby, une entente conclue avec la Colombie-Britannique pour les femmes purgeant une peine fédérale, et approuvée à la fin de 1988, est la première entente visant à supprimer le dilemme lieu d'incarcération-programme et à garantir la participation du gouvernement fédéral à la gestion des femmes purgeant une peine fédérale, suite à leur transfèrement. L'entente Burnaby est passablement différente de l'entente Tanguay; ce n'est pas que les écarts soient si grands entre les provinces, mais plutôt que l'approche fédérale se soit transformée. L'entente Tanguay, négociée en 1982, avait pour objectif d'offrir un milieu francophone aux prisonnières. Leurs autres besoins n'étaient pas explicitement pris en considération. Les ententes d'échange de services ne témoignent d'aucun souci de la culture et de la spiritualité des autochtones. Par contre, l'entente Burnaby préconise une conception holistique des besoins en matière de programmes et reconnaît formellement le caractère dynamique du processus d'élaboration et d'exécution des programmes.
Les ententes d'échange de services actuellement en vigueur obligent les femmes à choisir entre des programmes et un lieu d'incarcération; le choix est d'autant plus difficile qu'un choisissant sa province d'origine, on choisit également un établissement en particulier, dans la mesure où la plupart des provinces ne compte qu'un seul établissement pour femmes. Dans les provinces qui en comptent deux ou davantage, il existe habituellement un établissement principal, le second servant d'annexe à sécurité minimale. Le type d'installations et le niveau de services offerts aux femmes purgeant une peine fédérale varient sensiblement d'une province à l'autre, ce qui, en soit, inéquitable.
Peu de solutions de rechange au sein de la collectivité
Le rapport du comité DaubneyFootnote xciii faisait ressortir l'insuffisance des activités communautaires pour les femmes au sein du système correctionnel et insistait sur l'urgente nécessité de corriger cette situation. Le nombre de centres résidentiels communautaires est insuffisant et il existe peu de documentation sur les expériences et les besoins des femmes purgeant une peine fédérale au sein de la collectivité; de plus, rien ne prouve qu'il y ait déjà eu des efforts concertés pour analyser la situation et élaborer une stratégie appropriée et efficace pour combler les lacunes. Si les femmes qui purgent une peine fédérale dans les pénitenciers sont invisibles, les femmes qui purgent une peine fédérale au sein de la collectivité le sont encore davantage.
Les femmes héritent de programmes et d'installations conçus pour les hommes
Ces problèmes pratiques découlent des orientations. Les stratégies de gestion correctionnelle sont élaborées pour le genre masculin de race blanche et sont ensuite appliquées indifféremment aux hommes et aux femmes. Dans le meilleur des cas, on tente d'évaluer les répercussions particulières d'une orientation ou d'une initiative sur les femmes. C'est donc à la fin du processus que des rajustements sont apportés, et ils sont habituellement négligeables. La politique du Service correctionnel du Canada à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale constitue un bon exemple de ces orientations philosophiques ou de ces pratiques de gestion. Cette politique stipule qu'en plus d'élaborer des orientations, des programmes et des services généraux s'appliquant à tous les délinquants, on devra également élaborer des stratégies permettant de répondre aux besoins particuliers des femmes. Cette politique révèle que les besoins des femmes sont automatiquement perçus comme exigeant des services supplémentaires plutôt que des services fondamentalement différents de ce qu'offre habituellement le milieu correctionnel. Cependant, des consultations auprès de femmes purgeant une peine fédérale et l'état actuel de la recherche ont incité le groupe d'étude à conclure que les pratiques correctionnelles, tant dans les établissements fédéraux que provinciaux, exacerbent la dépendance des femmes purgeant une peine fédérale et ne les encouragent aucunement à devenir autonomes et responsables.
Les réalités particulières des femmes autochtones ne sont pas reconnues
Si l'on admet que les réalités des femmes n'ont jamais été rien de plus que des prolongements du régime masculin, il devient facile de comprendre que les réalités autochtones ne peuvent être simplement des prolongements du régime des Blancs. Les systèmes correctionnels fédéral et provinciaux ont facilité l'accès à certains aspects de la culture autochtone mais cet accès n'a pas été suffisant. Ainsi, les organismes correctionnels n'accordent pas aux aînés et aux chamans l'importance ou le respect qu'ils accordent aux aumôniers, aux médecins ou aux psychologues, en tant que groupes ou en tant que particuliers.
Les femmes autochtones ont été assimilées à deux univers ...celui des Blancs et celui des hommes. « Culturellement, économiquement et personnellement, nous (femmes et hommes autochtones)* avons été opprimés et mis de côté par les Blancs. On nous a envoyés vivre dans des réserves qui nous privent de moyens d'existence; nous devons obéir à des règles que nous n'avons pas fixées; et nous dépendons maintenant de services que nous ne pouvons-nous offrir nous-mêmesFootnote xciv ».Une recherche commandée par ce groupe d'étude a révélé, hors de tout doute, que la plupart des femmes autochtones avaient été victimes de violence et de viol de la part des hommes. Les femmes autochtones purgeant une peine fédérale ont été assimilées à deux autres univers, celui de toutes les femmes purgeant une peine fédérale et celui de tous les délinquants autochtones purgeant une peine fédérale. Si nous voulons vraiment saisir les réalités particulières des femmes autochtones et répondre efficacement à leurs besoins, nous devons d'abord comprendre les rapports qu'elles entretiennent avec ces différents univers et leurs conséquences en matière de justice.
Une participation insuffisante de la collectivité
Un dernier problème est associé aux femmes purgeant une peine fédérale et c'est celui de la participation de la collectivité. Les consultations menées par le groupe d'étude ont clairement établi qu'il existe des collectivités fortes et engagées auxquelles n'ont pas vraiment et totalement accès les femmes purgeant une peine fédérale. A la Prison des femmes, l'encadrement des bénévoles est une tâche exigeante, compte tenu des ressources en personnel limitées; la situation peut même décourager la collectivité de participer davantage aux activités de l'établissement. D'autres problèmes pratiques d'ordre opérationnel viennent également s'ajouter, telle que l'instabilité découlant de contrats annuels plutôt que pluriannuels. Le caractère barbare des lieux physiques et l'insistance sur la sécurité constituent des barrières psychologiques pour un bon nombre de bénévoles. Chez les bénévoles qui ont déjà surmonté ces obstacles, l'importance accordée à la sécurité et à la punition continue de nuire à l'établissement de relations naturellement équilibrées avec les femmes purgeant une peine fédérale. En fin de compte, les activités s'appuyant sur la participation de la collectivité sont perçues comme étant accessoires au régime et n'en sont pas vraiment partie intégrante.
Conclusion
Cet exposé fait ressortir les dilemmes que soulèvent les interventions actuellement imposés aux femmes purgeant une peine fédérale et la nécessité de changements fondamentaux. Le Service correctionnel du Canada a tenté d'intégrer un petit groupe de femmes, diversifié, présentant des risques relativement limités et des besoins multiples dans un système conçu pour une population nombreuse, plus homogène et à risques plus élevés; en agissant ainsi, il a miné sa capacité de respecter ses engagements à l'égard des femmes purgeant une peine fédérale. Chemin faisant, le régime actuel a créé des inégalités et on a fait fi des besoins des femmes purgeant une peine fédérale, deux conséquences que personne n'avait prévues.
Chapitre VII : Le contexte du problème
Amorcer le changement
Durant l'été 1988, Ole Ingstrup, qui venait d'être nommé commissaire du Service correctionnel du Canada, s'est engagé sans réserve à répondre aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale; il a déclaré souhaiter un examen en profondeur de la situation grâce à la création d'un groupe d'étude.
Cette préoccupation allait dans le sens des recommandations de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, qui prônait depuis longtemps la création d'un groupe d'étude sur les femmes ayant des démêlés avec la loi.
Le milieu pousse à l'action
Divers autres facteurs, relevant du milieu tant externe qu'interne, se conjuguent pour attester le bien- fondé de l'adoption de mesures aptes à régler le problème.
La crédibilité croissante des analyses féministes du problème
Dans le milieu externe, les répercussions du féminisme sur les services correctionnels constituent une influence indirecte. Les critiques des interprétations classiques données par la sociologie et la psychologie à la criminalité des femmes se sont amorcées en 1970 pour culminer, près de dix ans plus tard, par la publication de plusieurs études selon lesquelles les femmes en prison ressemblent davantage aux autres femmes qu'aux détenus masculins, et les programmes et les services devraient chercher à répondre aux besoins et aux circonstances locales, et être conçus de manière ponctuelle et non en fonction de quelque à plan directeurFootnote xcv. Ces études révèlent que, malgré leur caractère peut-être plus dramatique, les besoins des femmes purgeant une peine fédérale sont souvent les mêmes que ceux des femmes en général.
Les représentants des groupes de femmes et les autres personnes qui partagent leurs croyances soulignent que des questions telles que la pauvreté, le racisme, la violence faite aux femmes et l'abus sexuel sont intimement liées à la criminalité des femmes. A leur avis, il faut procéder à une réévaluation fondamentale de l'inégalité des femmes dans notre société, et notamment à une analyse du faible soutien social qu'on leur accorde et des attitudes négatives qu'on entretient à leur endroit, si on espère concevoir des programmes et des politiques efficaces à leur intention.
On a pu remarquer une telle tendance lors du Third National Workshop on Female Offenders à Pittsburgh (Pennsylvanie), en mai 1989. La plupart des intervenantes ont interprété le thème, soit L'évolution des besoins de la contrevenante : un défi à relever, comme un appel à une restructuration fondamentale des services correctionnels à l'intention des femmes plutôt qu'à une multiplication des cataplasmes, si évidente dans de nombreux systèmes correctionnels, qui entrave la poursuite de l'objectif d'autonomie responsable.
Les Autochtones exigent une plus grande maîtrise du système de justice pénale pour leur peuple
L'influence de la lutte des autochtones pour l'autonomie est un élément déterminant du contexte de toute évaluation des femmes autochtones purgeant une peine fédérale. Par exemple, la création récente de l'Assemblée des femmes autochtones, chargée de parler au nom des femmes autochtones ayant des démêlés avec la justice, peut être considérée comme la concrétisation des rapports établis par les femmes autochtones entre l'autonomie et les services correctionnels. On ne peut échapper à la conclusion voulant que si les femmes en général souffrent des stéréotypes sociaux et des disparités économiques, les femmes autochtones souffrent d'une double discrimination en raison des stéréotypes raciaux. Toutefois, l'État n'a pas encore intégré implicitement cette conclusion à ses réflexions.
C'est en mars 1987, avec la création du Groupe d'étude sur les autochtones au sein du régime correctionnel fédéral, qu'on a vu poindre une nouvelle perception du rapport entre les autochtones et le régime correctionnel au sein du ministère du Solliciteur général. Ce groupe d'étude a publié son rapport en 1988. Le caractère interministériel du Groupe d'étude et son souci de consultation attestent la nécessité d'une meilleure compréhension et d'une plus grande reconnaissance de la réalité autochtone. A cette fin, le Groupe d'étude a conclu que l'égalité des autochtones au sein du système correctionnel dépend d'une meilleure participation des autochtones et d'une plus grande mainmise de ceux-ci sur les programmes et les servicesFootnote xcvi. Toutefois, les représentantes autochtones dans le Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale ont signalé que, dans l'optique d'une femme autochtone, le groupe d'étude sur les autochtones n'a pas su forger un partenariat équitable entre le gouvernement et les peuples autochtones. Les femmes autochtones considèrent plutôt son rapport comme un autre rapport du gouvernement.
Les contestations judiciaires en vertu de la Charte soulignent le besoin de changement
Les contestations judiciaires, tant passées qu'actuelles, en vertu notamment des dispositions sur l'égalité de la Charte canadienne des droits et libertés ont mis en relief les inégalités et les injustices dont sont victimes les femmes purgeant une peine fédérale et le besoin de mesures immédiates pour réduire ces iniquités. Les causes révèlent que les failles du système ont donné lieu à une violation des droits des femmes purgeant une peine fédérale dans certains établissements. Le système n'a pas su offrir les mêmes-moyens aux femmes de purger leur peine à une distance raisonnable de chez elles; leur offrir les mêmes possibilités de libération conditionnelle; leur offrir les mêmes programmes; et leur offrir la même qualité et les mêmes normes qu'aux hommes et aux femmes purgeant une peine fédérale dans un autre établissement.
De nouvelles recommandations en faveur de la fermeture de la Prison des femmes
C'est dans ce contexte qu'est paru le Rapport du Comité permanent de la justice et du solliciteur général sur la détermination de la peine, la mise en liberté sous condition et d'autres aspects du système correctionnel (le rapport Daubney). Ce rapport recommandait entre autres que le Solliciteur général crée un groupe d'étude chargé d'examiner la situation des femmes purgeant une peine fédérale et qu'il élabore un plan en vue de la fermeture de la Prison des femmes. Le rapport Daubney est paru à un moment où il n'a pas été nécessaire que le gouvernement y réagisse officiellement; l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry a, pour sa part, continué à prier le Solliciteur général de créer un tel groupe d'étude, suite à la parution du rapport. Il importe toutefois de souligner que le Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale ne constitue pas une réaction du gouvernement au rapport Daubney et qu'il ne tient pas pour acquise la fermeture de la Prison des femmes, même si le plan recommandé l'appui.
L'énoncé de la mission appelle le changement
Dès sa nomination, le commissaire Ingstrup a demandé une refonte de l'énoncé de la mission du Service correctionnel du Canada.
Un des objectifs de la nouvelle mission est de garantir la satisfaction des besoins des femmes purgeant une peine fédérale. La poursuite de cet objectif s'appuie sur les principes directeurs présentés dans l'énoncé de mission, notamment :
- que l'obligation du Service correctionnel du Canada de traiter les délinquants de façon humanitaire ne se limite pas à l'obligation légale d'assurer la satisfaction de leurs besoins physiques;
- qu'il est, par conséquent, essentiel de tout faire pour respecter l'esprit de la Charte des droits et libertés;
- que le Service correctionnel du Canada doit reconnaître sa responsabilité d'assurer les meilleurs services correctionnels possibles;
- que le premier but du Service correctionnel du Canada est la réinsertion sociale des délinquants.
Ces principes généraux, conjugués à l'objectif général de satisfaction des besoins des femmes purgeant une peine fédérale, ont favorisé un engagement interne en faveur du changement, fondé sur les préoccupations soulevées au sein du Service correctionnel du Canada par le fait que les programmes et le logement des femmes purgeant une peine fédérale ne soient pas, dans l à ensemble, actuellement conformes à ces principes. Bien que les groupes communautaires qui interviennent dans le système correctionnel ne soient pas d'accord avec toutes les dimensions de l'énoncé de mission, ils partagent cet engagement envers les femmes purgeant une peine fédérale.
Le Groupe de travail sur les programmes communautaires et institutionnels recommande des mesures immédiates
Un deuxième groupe de travail du Service correctionnel du Canada, le Groupe de travail sur les programmes communautaires et institutionnels, qui a publiés un rapport en 1989, a aussi signalé le besoin d'examiner la situation des femmes purgeant une peine fédérale. L'objectif de ce groupe de travail était d'«élaborer et proposer des améliorations aux programmes pour délinquants afin d'assurer une meilleure protection du public...»Footnote xcvii. Le rapport affirmait sans ambages que «les détenues ne devraient nullement être désavantagées et à cette fin un modèle correctionnel tenant compte de leurs besoins uniques sera établi au cours de la prochaine année». Les auteurs ajoutaient : «Nous sommes arrivés à un stade où il est crucial de formuler une politique claire et précise de gestion des détenues»Footnote xcviii. Le groupe de travail sur les programmes a énoncé des principes de programmes qui découlent des valeurs fondamentales de l'énoncé de mission. Bien qu'il ait pris note du fait que les besoins des femmes purgeant une peine fédérale seraient étudiés séparément, le groupe de travail a laissé entendre que des changements considérables seraient nécessaires si l'on voulait que les principes des programmes aient quelque sens pour ces femmes. Par exemple, comme l'illustre la description de la situation actuelle des femmes purgeant une peine fédérale, il est actuellement impossible pour le Service correctionnel du Canada d'offrir un « environnement correctionnel... qui vise à amener le détenu à amender son comportement criminel», ou de «traiter chaque détenu de façon individuelle» (principes 3 et 4).
Les tragédies à la Prison des femmes appellent des mesures immédiates
Une série de morts et d'incidents à la Prison des femmes ont mis en relief l'insuffisance des actuelles stratégies de gestion et l'incapacité d'intervenir de façon efficace à plusieurs égards. Il est certes probable que de telles tragédies aient leurs sources ailleurs que dans le système de justice pénale, mais les inégalités, l'insensibilité et l'inflexibilité du système correctionnel doivent être éliminées si l'on espère éviter la répétition de telles tragédies.
Les questions que soulèvent ces tragédies ne laissent planer aucun doute quant au caractère inhumain du système actuel. Elles abolissent aussi toute prétention de vouloir créer un milieu plus humanitaire grâce à de simples modifications superficielles du système.
Conclusion
Les tendances et les réalités au sein du régime correctionnel et de la société en général montrent sans l'ombre d'un doute la nécessité d'adopter une approche globale face au changement. Comme le résumé de la situation présenté ci-dessus l'indique, tous s'entendent pour dire qu'il est urgent de procéder à une réforme en profondeur et qu'il est grand temps d'agir.
Chapitre VIII : Le groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale
La création et le mandat du groupe d'étude
Le Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale a été constitué en mars 1989 par le commissaire du Service correctionnel du Canada en collaboration avec l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry.
Le mandat du Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale lui confiait l'étude du régime correctionnel de ces femmes du début de la sentence jusqu'à l'expiration du mandat d'incarcération, et l'élaboration d'une politique et d'un plan destinés à guider et à régir ce processus de manière à ce qu'il réponde aux besoins uniques et particuliers de cette clientèle.
Les principes de travail initiaux
Le travail du groupe d'étude a été initialement guidé par les termes du mandat sur lesquels s'étaient entendus le Service correctionnel du Canada et l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. En outre, les organismes qui co-présidents ont convenu d'un certain nombre de principes de travail, notamment que :
- l'information serait ouvertement partagée;
- le Groupe d'étude ne poserait pas comme prémisse la fermeture de la Prison des femmes;
- pendant la durée des travaux du Groupe d'étude, on n'étendrait pas, sauf peut-être en Alberta, l'application de l'entente fédérale-provinciale d'échange de services pour les contrevenantes. (L'Alberta a été informée qu'aucune négociation ne serait entreprise avant que le rapport du groupe d'étude ne soit déposé et étudié.)
- le Groupe d'étude entreprendrait des recherches centrées sur l'intervention;
- le Groupe d'étude serait suffisamment pourvu de chercheurs et de personnel administratif;
- 1. le Groupe d'étude comprendrait des représentants de groupes de femmes autochtone et d'autres minorités, et l'information serait recueillie et analysée d'une manière culturellement pertinente;
- le Groupe d'étude consulterait les femmes qui purgent une peine fédérale;
- le Groupe d'étude serait composé de deux comités - un comité de direction et un comité de travail, qui seraient coprésidés par des représentants du Service correctionnel du Canada et de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth FryFootnote xcix;
- la représentation du secteur privé aux deux comités du Groupe d'étude serait égale à celle du gouvernement.
Organisation du groupe d'étude
Le Groupe d'étude était composé de deux comités; un comité de direction, comprenant des cadres supérieurs de divers organismes et organisations concernés, et un comité de travail, composé de représentants gouvernementaux et non gouvernementaux possédant une expertise relative aux femmes purgeant une peine fédérale. La composition du Groupe d'étude reflétait une diversité de points de vue et d'expériences. Il comprenait des femmes purgeant une peine fédérale, des représentants du secteur communautaire, des autochtones et des groupes de femmes, de même que divers organismes gouvernementaux.
Le comité de direction était coprésidé par Bonnie Diamond, directrice générale de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, et Jim Phelps, sous-commissaire, Programmes et opérations correctionnels, Service correctionnel du Canada. Ce comité assurait la direction générale, l'orientation et les grandes lignes du contexte de travail du Groupe d'étude.
Le groupe de travail était coprésidé par Jane Miller-Ashton, directrice des programmes pour les délinquants autochtones et de sexe féminin, Service correctionnel du Canada, et Felicity Hawthorn, membre du conseil et ex-présidente de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. Le groupe de travail définissait les buts, planifiait le travail, évaluait les besoins de recherche, dirigeait les chercheurs, menait les consultations, établissait le programme des discussions et rédigeait le rapport.
Lors de la première réunion du comité de direction, l'Association des femmes autochtones du Canada a proposé le renforcement de la représentation des femmes autochtones. En conséquence, avant la première réunion du comité de travail, leur nombre a été porté d'une à quatre au comité de direction et d'une à deux au comité de travail.
Mandat
Par suite d'un examen du Groupe d'étude, on a amendé le mandat original dont avaient convenu le Service correctionnel du Canada et l'Association des sociétés Elizabeth Fry du Canada. Dans sa forme révisée, le mandat, qui a guidé les travaux du Groupe d'étude, fait maintenant ressortir la sur représentation des peuples autochtones dans le système de justice pénale au Canada, de même que l'apport considérable de l'expérience autochtone à la solution des problèmes demeurés sans réponse concernant les femmes qui purgent une peine fédérale.
Consultations et recherche
A la première réunion du Groupe d'étude, on a convenu d'élargir autant que possible les consultations auprès des femmes purgeant une peine fédérale et auprès de la communauté. On a identifié dans plusieurs secteurs les priorités de recherche, dont la première semblait être une étude des besoins des femmes.
Principales contraintes ressenties par le groupe d'étude
Même si le Groupe d'étude a été aux prises avec plusieurs questions au fil de ses travaux, cinq préoccupations en particulier ont influé sur son travail et sur ses recommandations :
1. Comment le Groupe d'étude pouvait-il obtenir le point de vue des autochtones et en tirer profit
Les consultations initiales prévues par le Groupe d'étude n'ont pas réussi à vraiment rejoindre les communautés autochtones. Le Groupe d'étude a considéré que cet échec était inacceptable et a reconnu que, pour toute consultation future des autochtones, on devrait s'efforcer de mettre au point une stratégie plus sensibilisatrice. Cet échec et le travail qui suivit pour améliorer l'adéquation culturelle des divers instruments de recherche ont sensibilisé le Groupe d'étude à la nécessité d'approches innovatrices dans la collecte de renseignements. Le sondage sur les besoins des femmes purgeant une peine fédérale dans la collectivité est un exemple d'une telle approche. La composante autochtone du sondage a été mise au point et gérée indépendamment de la composante non autochtone, par une équipe autochtone travaillant à l'entreprise.
Dans ses efforts en vue d'apprécier plus en profondeur la réalité autochtone, le Groupe d'étude a également reçu l'aide d'un atelier avec la participation d'une Aînée, Joan Lavallee. A mesure que les travaux avançaient, le Groupe d'étude en est venu à la conclusion qu'il ne pouvait se borner à une initiative conjointe du Service correctionnel du Canada et de l'Association des sociétés Elizabeth Fry. Il devait plutôt la transformer en une initiative tripartite, si les voix des femmes autochtones devaient être entendues clairement et sans distorsion.
2. Comment le Groupe d'étude pouvait-il élaborer une nouvelle approche correctionnelle pour les femmes
Au cours de ses consultations, recherches et discussions, le Groupe d'étude s'est efforcé de dépasser les approches déjà utilisées pour les femmes purgeant une peine fédérale, dont les évaluations et les solutions pour les femmes s'inspiraient de celles adoptées pour les hommes. L'approche comparative s'est vite avérée limitée, voire régressive, puisque l'égalité, même en termes de parité avec les hommes purgeant une peine fédérale, équivaut à un endossement implicite des pratiques correctionnelles traditionnelles.
Le rejet de cette approche a amené le Groupe d'étude à formuler un plan qui répondrait aux besoins des femmes elles-mêmes et aux risques qu'elles représentent, et qui refléterait leurs perceptions et leurs interactions mutuelles et sociales. Cependant, il faut noter que la tâche de bâtir un système correctionnel sur la réalité des femmes plutôt que sur les stéréotypes sexuels et raciaux a été rendue plus ardue encore par le fait qu'il n'existe pas de modèle cohérent d'un système correctionnel pour les femmes, et en particulier d'un modèle qui répondrait également aux conceptions autochtones.
3. Comment le Groupe d'étude pourrait-il concevoir des recommandations pour un changement fondamental en moins d'un an
Le désir de mener en peu de temps des consultations sur une grande échelle et de recueillir des renseignements abondants sur les besoins des femmes incarcérées dans les prisons fédérales a tôt fait de conduire le Groupe d'étude à une conclusion importante - il étudierait les questions et les dilemmes en même temps que se dérouleraient les consultations et les recherches. Cette simultanéité retarderait l'intégration de l'analyse des implications des résultats de la recherche.
Les membres du Groupe d'étude ont également travaillé à partir de l'hypothèse que les derniers détails du plan recommandé seraient décidés au cours d'une phase globale de mise en oeuvre faisant suite au travail du Groupe.
4. Est-ce que l'existence du Groupe d'étude pourrait servir de prétexte pour différer les changements
Au tout début des travaux, une discussion portant sur les espoirs et les craintes du Groupe d'étude a permis d'identifier de sérieuses réserves quant au fait que l'existence même du Groupe et que le rapport qu'il déposerait pourrait légitimer des délais dans des actions jugées urgentes pour améliorer les conditions de détention des femmes qui purgent leur peine.
A titre de corollaire, on a adopté la position suivante, à savoir que toute initiative projetée devrait être soumise au Groupe d'étude. Cette position était considérée comme cruciale puisque les membres du Groupe d'étude reconnaissaient que tout plan recommandé exigerait un certain délai de mise en oeuvre.
5. Comment le Groupe d'étude pouvait-il excéder les limites de son mandat?
Enfin, le Groupe d'étude s'est buté aux limites de son mandat. Examiner la gestion du système correctionnel de l'entrée en vigueur de la sentence fédérale à l'expiration du mandat d'incarcération et élaborer un plan qui respecte la présente législation n'allait pas sans imposer de sérieuses contraintes. Le Groupe d'étude a été obligé d'exclure de son champ d'examen le cas des femmes purgeant une peine provinciale, l'incidence de la période présentencielle et la question de l'autodétermination des autochtones en regard du système correctionnel. De plus, les limites législatives écartaient la mise en place d'un système correctionnel fondé sur la communauté.
Les débats du Groupe d'étude ont ultimement abouti à la conclusion que ces préoccupations et ces buts plus vastes serviraient de toile de fond à notre plan recommandé.
Conclusion
Les tendances et les événements au sein du système-correctionnel et dans la société rendent tout à fait nécessaire une approche globale en faveur du changement. Comme l'aperçu de l'environnement résumé ci- dessus semble l'indiquer, il existe un très large consensus pour reconnaître le fait qu'une réforme fondamentale est urgente et que c'est maintenant le temps d'agir.
Chapitre IX : Enjeux et dilemmes
Introduction
Les voix du passé en témoignent clairement : les questions soulevées par le Groupe d'étude lors de ses consultations, de ses recherches et de ses délibérations n'ont rien de nouveau, et beaucoup de celles qui ont été débattue savaient déjà été reconnues et documentées.
Par exemple, la décentralisation des installations réservées aux femmes purgeant une peine fédérale et la prestation de ressources appropriées et suffisantes font l'objet de discussions depuis la construction même de la Prison des femmes. D'autres questions, comme celles de la dotation en personnel, de la sécurité et de la participation communautaire ont été explorées auparavant, mais on commence maintenant à mieux les saisir dans le contexte d'une nouvelle perception sociale des femmes et sous l'angle de la volonté qui s'est manifestée récemment, en matière correctionnelle, de dépasser l'approche traditionnelle axée sur la sécurité pour adopter un modèle fondé sur la responsabilité. Pourquoi alors, avec un ensemble aussi solide de connaissances, le changement a-t-il été aussi lent?
Facteurs qui ont entravé l'innovation
Malgré le vent de réforme, un certain nombre de facteurs ont ralenti le changement. Les membres du Groupe d'étude, de même que les auteures de deux recherches commandées aux fins du présent rapportFootnote c, ont noté les suivants :
- le taux élevé d'incarcération des hommes et des femmes au Canada porte à croire que le recours à l'incarcération est une habitude bien ancrée.
- le taux relativement élevé de crimes avec violence commis par des femmes autochtones et, par suite, la surreprésentation de celles-ci parmi les femmes purgeant une peine fédérale ne sont pas sans rapport avec le racisme et la violence dont beaucoup de ces femmes sont victimes. Leurs antécédents carcéraux, la violence qu'elles ont connue dans leur entourage et aux mains des autorités, l'alcoolisme et la toxicomanie, la violence qu'elles retournent fréquemment contre elles-mêmes et le racisme des établissements et de la société, tous ces facteurs contribuent à la surreprésentation des autochtones parmi les femmes purgeant une peine fédérale. Le racisme et la violence ont aussi une grande influence sur la façon dont ces femmes vivent et ils concourent à former des réactions inadéquates à leur surreprésentation.
- on a tendance à appliquer aux femmes et aux hommes les mêmes critères pour évaluer le risque, même si ces critères ne sont pas très appropriés dans le cas des femmes. Par conséquent, les femmes sont immanquablement incarcérées dans des établissements à niveau de sécurité supérieur au niveau exigé pour elles, et ce phénomène semble encore plus marqué dans le cas des autochtones.
- l'argument voulant qu'en raison du petit nombre de femmes purgeant une peine fédérale le coût, par personne, des programmes et du logement soit prohibitif a été si fréquemment utilisé qu'on a fini par l'accepter. On estime donc financièrement impossible d'offrir des programmes diversifiés et adaptés aux besoins des femmes.
- on continue de recourir aux mesures punitives pour maintenir l'ordre, même si les recherches démontrent que ces mesures aggravent généralement la situation.
- il semble que la volonté politique nécessaire pour effectuer le changement fondamental qui permettrait d'améliorer la situation des femmes qui purgent une peine fédérale soit absente.
L'énigme centrale
Le Groupe d'étude avait conclu que, pour offrir des choix valables aux femmes purgeant une peine fédérale, il fallait procéder à un changement fondamental. Mais cette conclusion posait une nouvelle énigme. Le Groupe d'étude croit en effet que la société doit s'engager sur la voie qui mènera, à long terme, à l'adoption de mesures de justice réparatrice qui aient un caractère communautaire et à l'instauration d'un système judiciaire autochtone. Pourtant, il a aussi conclu que des changements considérables doivent être faits immédiatement dans le milieu où se trouvent les femmes purgeant une peine fédérale. Or, ces changements nécessiteraient vraisemblablement des investissements de capitaux, sous une forme ou sous une autre, soit pour rénover la Prison des femmes, soit pour louer, acheter ou construire de nouvelles installations. L'importance de tels investissements ne détournerait-elle pas l'attention de l'objectif à long terme?
Le Groupe d'étude a reconnu que l'objectif à long terme ne peut être réalisé dans le contexte de son mandat, non plus que dans le cadre législatif actuel. Il a étudié la possibilité d'un système judiciaire autochtone pour conclure qu'un tel système fait partie intégrante de l'objectif plus vaste d'autodétermination des autochtones. Il a également reconnu que la création de la volonté sociale et politique nécessaire pour soutenir le changement fondamental dans le secteur correctionnel est un processus qui prendra beaucoup de temps.
Pour éviter tout risque de conflit entre l'objectif à court terme et l'objectif à long terme, le Groupe d'étude a cru essentiel de mettre au point, comme mesure provisoire, un plan recommandé qui respecte les principes de base de l'objectif à long terme et encourage la prise de responsabilité pour les personnes qui purgent une peine. Ce plan ne doit cependant pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la réalisation de l'objectif à long terme; il devrait plutôt constituer un pas significatif vers la concrétisation du plan recommandé et de l'objectif à long terme.
Ce sont ces prémisses qui ont guidé les discussions du Groupe d'étude. Nous vous en présentons ici le compte rendu sous les quatre rubriques suivantes: solutions à la question du logement; contexte opérationnel; prélibération et intégration dans la société; et réalités particulières.
Solutions à la question du logement
De la prison aux établissements qui recréent une atmosphère familiale
Pour encadrer ses discussions sur la question du logement, le Groupe d'étude s'est posé les questions suivantes :
- comment peut-on loger de petits groupes de femmes près de leur famille tout en leur donnant accès aux divers programmes dont elles ont besoin?
- quel est le genre d'installation qui favoriserait la vie communautaire?
- les prisonnières doivent-elles loger dans les mêmes établissements que les prisonniers?
- de quel ordre de grandeur les installations devraient-elles être?
En discutant de ces questions, le Groupe d'étude s'est demandé dans quelle mesure la législation autorisait le Service correctionnel du Canada à permettre aux femmes purgeant une peine fédérale de participer à des programmes communautaires. Son évaluation l'a amené à conclure que, pour ce qui est des possibilités de logement communautaire, la restriction des déplacements pendant la période qui précède la semi-liberté empêcherait encore l'accès à la communauté. Cependant, quoiqu'elle prescrive clairement, par des règles et contraintes, que les femmes purgeant une peine fédérale doivent être séparées physiquement de la société pendant un certain temps, la législation ne définit en aucune manière ce que doit être un pénitencier. Elle ne traite que de la protection de la société et de l'obligation de garder ceux qui purgent une peine dans des conditions humanitaires et sécuritaires.
Les consultations et les recherches ont bien mis en évidence le fait que les installations où logent actuellement les femmes sont vétustes et inadéquates. S'inspirant de ces sources, et après discussion, le Groupe d'étude a précisé certains critères d'aménagement qu'il considérait essentiel d'appliquer à toute nouvelle installation :
- plusieurs acres de terrain où les femmes pourraient se promener et être en contact avec la nature et où l'on trouverait à la fois un lieu destiné aux cérémonies spirituelles des autochtones et des zones réservées à l'exercice et aux loisirs pour les femmes et leur famille;
- une atmosphère accueillante et de petites unités de logement qui faciliteraient la vie en petits groupes;
- des structures d'habitation où il y aurait beaucoup de lumière, de couleur et une bonne aération, avec des espaces privés ainsi que des espaces qui pourraient être aménagés selon les besoins, pour favoriser une vie saine;proximity to large urban centres in order to facilitate visits by family members, attract appropriate professional, community and business resources, and to take advantage of existing educational, health, cultural and recreational facilities
- la proximité des grands centres urbains, pour faciliter les visites des familles et tirer parti des services communautaires, commerciaux et professionnels ainsi que des installations éducatives, culturelles, de santé et de loisirs qu'on trouve dans ces centres;
- le tout à une échelle qui favorise l'intimité et les relations interpersonnelles et ne rappelle pas la prison;
- des mesures de sécurité sans intrusion, étant donné que la plupart des femmes qui purgent une peine ne sont pas dangereuses pour la société.
Le Groupe d'étude a ensuite discuté d'autres facteurs selon lesquels évaluer les diverses possibilités en matière de logement. Là encore, les consultations et les recherches ont fourni de précieux renseignements. Les critères suivants ont été retenus pour l'élaboration d'une solution à la question du logement qui favorise le choix, la participation communautaire et le partage des responsabilités :
- faciliter la participation communautaire;
- permettre l'accès à des programmes appropriés;
- répondre aux besoins des femmes autochtones;
- répondre aux exigences linguistiques et culturelles;
- faciliter la mise en liberté;
- meet the articulated design features
- répondre aux critères d'aménagement précédemment énoncés;
- tenir compte des réalités existantes (par exemple, l'entente de Burnaby;
- assurer la proximité des familles et du milieu culturel;
- fournir des installations et des services compatibles avec les besoins et la vécu des femmes purgeant une peine fédérale;
- tenir compte des résultats des consultations communautaires et des recherches.
Enfin, le Groupe d'étude a relevé un certain nombre de solutions possibles à la question du logement parmi celles qui qui avaient été avancées lors des consultations :
- le maintien de la Prison des femmes et des ententes actuelles d'échange de services (en d'autres mots, le statu quo);
- la rénovation de la Prison des femmes et l'amélioration des ententes d'échange de services;
- la construction d'un nouvel établissement central et fédéral;
- la négociation de nouvelles ententes d'échange de services avec toutes les provinces;
- la mixité des établissements, nouveaux et existants;
- l'aménagement, pour les femmes, d'installations fédérales dispersées dans les régions.
Le Groupe d'étude a ensuite évalué chacune de ces solutions à la lumière des facteurs mentionnés précédemment pour déterminer laquelle était préférable. Ce processus l'a amené à constater que ni le maintien ni la rénovation de la Prison des femmes ne pourrait jamais être acceptable. C'est pourquoi les discussions sur ces deux premières solutions sont présentées ensemble dans le résumé qui suit.
Doit-on maintenir la Prison des femmes et les ententes d'échange de services
Compte tenu de l'ensemble des critères, cette solution était manifestement déficiente et, au mieux, marquée d'in pondérables. Maintenir le statu quo équivaudrait à perpétuer la discrimination dont souffrent déjà les femmes en ce qui a trait aux programmes, aux ressources et à la proximité des familles. Personne parmi les gens consultés n'était d'accord avec cette solution. Les résultats des recherches ont d'ailleurs démontré la nécessité d'un traitement équitable pour les femmes dans des milieux très différents de celui de la Prison des femmes. C'est pourquoi le Groupe d'étude a rejeté tant le statu quo que la rénovation de la Prison des femmes et l'amélioration des ententes actuelles.
Un nouvel établissement central, administré par le gouvernement fédéral, répondrait-il aux besoins des femmes
Certaines femmes purgeant une peine fédérale et moins de 20 % des autres groupes consultés ont dit préférer cette solution, mais leurs arguments n'étaient pas convaincants. Ainsi, certaines justifiaient la centralisation par la crainte que la dispersion géographique n'entraîne l'absorption de petits groupes de femmes dans le système carcéral masculin. Cependant, le Groupe d'étude a conclu qu'on pouvait facilement éviter cette situation par des mesures administratives et des mécanismes d'organisation appropriés. Cette solution, qui répondait néanmoins à quelques-uns des critères, a finalement été rejetée parce qu'elle ne permettait pas une plus grande proximité des familles, ne répondait pas aux besoins des femmes autochtones et ne remplissait pas les critères d'aménagement relatifs à la grandeur des établissements et à la sécurité.
L'amélioration des ententes d'échange de services avec toutes les provinces pourrait-elle être la solution
Cette option a été longuement discutée. Pour répondre aux critères d'évaluation fixés par le Groupe d'étude, le gouvernement fédéral aurait besoin de mettre en application un plan innovateur dans le secteur correctionnel. Cependant, avant d'inviter les gouvernements provinciaux et territoriaux à participer à toutes les étapes de l'approbation, de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'application d'un tel plan, il doit s'assurer de l'existence d'un certain consensus ou d'un intérêt commun. Or, ce consensus n'existe pas, et il faudrait beaucoup d'effort, de temps et d'argent pour l'obtenir. De plus, beaucoup d'établissements provinciaux sont vétustes. Le Groupe d'étude a donc rejeté cette solution, convaincu que le gouvernement fédéral (qui a compétence en ce qui a trait aux femmes purgeant une peine de deux ans ou plus) doit accepter la responsabilité des injustices actuelles et jouer un rôle de premier plan dans la recherche des solutions. Le Groupe d'étude a conclu qu'il était essentiel que le gouvernement fédéral soit maître de la mise en oeuvre du plan recommandé à l'intention des femmes, mais que ceci ne devait pas empêcher la participation des provinces intéressées. Cependant, il croit fermement que le gouvernement fédéral ne doit en aucun cas retarder son intervention pour chercher à obtenir la participation des gouvernements provinciaux ou territoriaux.
Les établissements, nouveaux et actuels, devraient-ils être mixtes
Les membres du Groupe d'étude ont entendu de nombreux exposés sur la mixité et consulté des recherches sur le sujet. Quoique la mixité offre certainement des avantages et qu'un nombre considérable de femmes se soient dites intéressées par un tel modèle, et malgré le fait que cette approche puisse être adaptée pour répondre à certains des critères d'évaluation, la majorité des membres ont conclu que la mixité n'était pas souhaitable pour le moment. Cette décision était fondée sur divers facteurs, notamment la conviction que les installations mixtes ne conviendraient pas aux femmes qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle, l'écart probable entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, et le danger de ne pas répondre adéquatement aux besoins des femmes au chapitre de l'évaluation et des programmes. Soulignons toutefois que certains groupes autochtones n'avaient pas des positions aussi fermes sur cette question, en raison des différences culturelles qui les lient d'abord comme peuples, puis comme femmes ou comme hommes, particulièrement en ce qui a trait à la possibilité d'un établissement réservé aux autochtones.
Les petites installations fédérales, dispersées dans les régions, seraient-elles préférables
Le principe des installations régionales pour femmes a été accueilli avec enthousiasme par les groupes consultés et il a été bien coté au regard des critères d'évaluation. Les recherches démontrent également qu'on est d'accord avec les installations qui permettraient aux femmes d'être plus près de chez elles, plus près aussi des centres dotés de ressources, et où elles pourraient loger dans de petites unités de type unifamilial.Footnote ci Le Groupe d'étude a conclu que cette solution était la plus compatible avec les possibilités d'hébergement communautaire au moment de la mise en liberté, qu'elle répondrait aux besoins de toutes les femmes purgeant une peine fédérale et qu'elle permettrait la souplesse dans les déplacements et les programmes.
La solution recommandée
D'après ces discussions, le Groupe d'étude a décidé de recommander l'aménagement d'un ensemble d'installations régionales, dirigées par le Service correctionnel du Canada et situées dans chacune de ses cinq régionsFootnote cii. Il s'est ensuite interrogé sur la grandeur que devraient avoir ces installations et le lieu où chacune devrait être situé :
De quelle grandeur chaque établissement devrait-il être
Sur ce sujet, les discussions du Groupe d'étude ont porté sur trois facteurs :
- le faible taux d'augmentation prévue relativement au nombre de femmes purgeant une peine fédérale;
- l'incidence éventuelle de l'adoption d'une stratégie dynamique de mise en liberté communautaire, et;
- la nécessité d'une certaine souplesse pour faciliter les transfèrements entre établissements.
Une analyse préliminaire effectuée par la division de la planification du Service correctionnel du Canada a corroboré les conclusions du Groupe d'étude. D'après les données, une augmentation annuelle de la population de 2 % serait réaliste. Étant donné le petit nombre de femmes qui purgent une peine fédérale, ce rythme de croissance ne changera pas grand-chose, en nombres réels. De plus, on prévoit de meilleures interventions de mise en liberté communautaire pour compenser la croissance minimale possible. Enfin, les données chronologiques confirment que le nombre de femmes de chaque province ou territoire est également très stable.
Par conséquent, le Groupe d'étude a conclu que les installations régionales pour femmes devraient être construites en fonction du nombre de places actuellement requises, et que l'espace supplémentaire permettant, à l'occasion, des transfèrements d'une région à une autre devrait être minimal. Le Groupe d'étude reconnait également que la grandeur de l'établissement à construire dans les Prairies ne pourra être déterminée qu'au moment de la planification des installations spéciales destinées aux femmes autochtones.
Où les établissements devraient-ils être situés
Pour choisir l'emplacement des établissements dans chaque région, le Groupe d'étude a appliqué deux critères essentiels : premièrement, la proximité des familles des femmes de chaque région et, deuxièmement, la facilité d'accès aux ressources communautaires essentielles, celles-ci comprenant au moins une université ou un collège, des services de santé mentale, un hôpital où l'on fait de l'enseignement et une communauté autochtone. Le Groupe d'étude a donc retenu les villes et régions suivantes : Halifax, Montréal, le centre ou le sud-ouest de l'Ontario, Edmonton, un endroit des Prairies qui reste à préciser relativement à des installations réservées aux autochtones (dont nous discutons plus loin), et le sud-ouest de la Colombie-Britannique.
Le Groupe d'étude a aussi étudié deux questions connexes à celle de l'emplacement des établissements : d'abord, la signature, récente, d'une entente avec la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux femmes purgeant une peine fédérale, ainsi que les ententes conclues avec le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve; ensuite, la situation particulière des femmes qui proviennent de régions lointaines et isolées.
Quels effets les ententes actuelles avec les provinces peuvent-elles avoir sur les décisions concernant l'emplacement des établissements
Le Groupe d'étude reconnaît que l'entente conclue avec la Colombie-Britannique (entente de Burnaby) permettra aux femmes de cette province qui purgent une peine fédérale d'être logées en Colombie- Britannique dans un avenir immédiat. Il reconnait aussi que cette entente est unique en ce qu'elle contient des normes sur les ressources et prévoit le maintien de la participation fédérale de même qu'une responsabilité fédérale-provinciale conjointe relativement aux femmes transférées en vertu de cette entente. Le Groupe d'étude a conclu que le Service correctionnel du Canada doit veiller à ce que l'entente soit appliquée de la manière la plus conforme possible aux principes énoncés par le Groupe d'étude en ce qui a trait aux femmes purgeant une peine fédérale (lesquels principes sont présentés dans le chapitre suivant). Cependant, on aura besoin d'un établissement fédéral pour femmes dans le sud-ouest de la province seulement si l'établissement de Burnaby ne répond pas aux critères qui sont à la base de son plan.
Sachant que l'entente actuelle avec le Québec (entente Tanguay) prend fin en avril 1992, le Groupe d'étude a conclu que, pour respecter les ententes d'échange de services comme celle-ci et pour protéger les intérêts des femmes, le Service correctionnel du Canada doit revoir les ententes actuelles et négocier (si nécessaire) des ententes provisoires qui faciliteront la transition vers l'utilisation des nouvelles installations.
Le Groupe d'étude a également discuté de la situation des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre- Neuve. D'une part, il y a rarement même une seule femme de l'Île-du-Prince-Édouard qui purge une peine fédérale. D'autre part, la seule entente signée avec Terre-Neuve en 1949 prévoyait que toute personne purgeant une peine fédérale demeurerait dans la province. On ne peut mettre fin à cette entente avant d'avoir aménagé un établissement fédéral dans cette province ou trouvé une autre solution en matière de logement. En étudiant ces deux situations, le Groupe d'étude a conclu que les femmes purgeant une peine fédérale ne devaient pas être obligées de purger leur peine sur le continent et que le Service correctionnel du Canada devait travailler conjointement avec ces provinces pour trouver des solutions innovatrices, adaptées aux besoins de chacune.
Les installations régionales du Sud peuvent-elles répondre aux besoins des femmes du Nord ou des localités isolées
La même question se pose dans les cas des femmes du Grand Nord. Les nouvelles installations régionales du Sud ne pourraient pas répondre entièrement aux besoins des femmes de ces régions. C'est particulièrement vrai des autochtones du Nord qui, en se trouvant dans un établissement du Sud, seraient radicalement coupées non seulement de leur famille mais aussi de leur culture. Un établissement réservé exclusivement aux autochtones pourrait répondre à certains de leurs besoins culturels, mais ne leur permettrait pas de rester en contact avec leurs proches. De plus, si l'on comptait seulement sur la facilité autochtone, on leur enlèverait effectivement toute possibilité de choix. Par ailleurs, il n'est pas possible d'aménager un établissement fédéral dans ces régions isolées, parce qu'il y a rarement plus d'une ou deux femmes du Grand Nord qui purgent une peine fédérale. Comme dans le cas des deux provinces insulaires, le Groupe d'étude a conclu que la situation des femmes des localités lointaines et isolées appelle une réponse particulière. Il faudra poursuivre les travaux pour trouver des solutions spéciales, parce qu'il semble que ces solutions exigeront une plus grande souplesse législative.
Contexte opérationnel
Le Groupe d'étude a étudié, sous ce titre, les enjeux et dilemmes relatifs aux quatre sujets suivants : programmes, dotation en personnel, sécurité et administration. Nous résumons ici des discussions sous chacune de ces quatre rubriques.
Des programmes aux ressources
Les écrits sur le secteur correctionnel ont bien démontré que, malgré les besoins, les programmes destinés aux femmes ont toujours été moins nombreux, moins variés et de moins bonne qualité que les programmes destinés aux hommesFootnote ciii. Les raisons qui expliquent ces différences ont été longuement exposées.
Quoique depuis quelques années on ait cherché à améliorer les programmes offerts à la Prison des femmes et dans les établissements provinciaux grâce aux ententes d'échanges de services, les consultations du Groupe d'étude et les recherches préparées à son intention démontrent clairement l'urgence d'adopter une approche nouvelle dans l'élaboration des programmes destinés aux femmes.
La question des programmes a été immanquablement soulevée dans toutes les discussions du Groupe d'étude, que celles-ci aient eu pour objet le logement ou la mise en liberté communautaire. A lui seul, ce phénomène souligne l'importance de la question des programmes; de plus, le fait que celle-ci revête différents aspects a finalement amené le Groupe d'étude à adopter une définition plus large des programmes, qui englobe tous les services, possibilités et mécanismes de soutien qui devraient être offerts aux femmes purgeant une peine fédérale. En adoptant cette position, le Groupe d'étude a conclu qu'on devrait abandonner le mot «programme» pour parler plutôt de «ressources».
Les programmes sont conçus pour répondre à des catégories bien précises de besoins - des besoins qui ne sont pas définis par les femmes mais par le chargé de programme ou les autorités correctionnelles. Selon ce modèle, ce sont les femmes qui doivent s'adapter aux programmes qui leur sont offerts. Par contre, une approche axée sur les « ressources » obligerait le Service correctionnel du Canada à aller chercher à l'extérieur ce qu'il faut pour répondre aux besoins définis par les femmes elles-mêmes.
Qu'est-ce qui rend les programmes efficaces
Le Groupe d'étude s'est demandé comment ce changement de perspective pouvait se traduire dans l'approche adoptée par le Service correctionnel du Canada. En consultant les recherches, et en particulier les enquêtes sur les programmes modèles et sur les besoins, le Groupe d'étude a noté plusieurs éléments qui semblent augmenter l'efficacité des programmes et qui servent en quelque sorte de postulats :
- les programmes sont axés sur les femmes, c'est-à-dire traduire la réalité sociale des femmes et répondre aux besoins de chacune;
- les programmes ont pour objectif de favoriser le respect de soi et l'autonomie;
- le choix personnel, en particulier dans des domaines comme les soins de santé et la nutrition, est essentiel;
- les programmes doivent être axés sur la libération;
- les programmes doivent être élaborés et offerts de manière à respecter les particularités culturelles;
A la base de ces postulats, il y a une vaste stratégie. Les programmes doivent être abordés dans une perspective globale, holistique; en d'autres mots, ils doivent s'agencer les uns aux autres pour tenir compte du fait que l'expérience des femmes est multiforme. Par exemple, on doit comprendre que le traumatisme psychique (celui qui résulte par exemple d'une agression sexuelle) peut avoir un effet sur toutes les actions d'une personne, y compris l'apprentissage de l'écriture. Les personnes engagées dans la prestation d'un programme particulier doivent donc être sensibles à ce qu'ont vécu et à ce que vivent les femmes ainsi qu'aux répercussions que leurs expériences présentes et passées peuvent avoir sur des facteurs comme la capacité de concentration ou d'apprentissage.
Quels sont les besoins les plus pressants
Le Groupe d'étude s'est servi des conclusions des recherches et des consultations pour déterminer les domaines les plus importants au chapitre des programmes.
Les domaines les plus fréquemment mentionnés étaient formation scolaire, la formation professionnelle, la santé physique et mentale, la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, et les programmes visant à maintenir et à consolider les liens familiaux et les relations communautaires. Les programmes qui s'adressent à des groupes particuliers - les autochtones ou les femmes purgeant une peine de longue durée, par exemple - ont également été soulignés. Le Groupe d'étude a conclu que chaque établissement régional devait offrir des ressources dans ces domaines essentiels.
La discussion sur la santé mentale a été particulièrement difficile. Quoiqu'il ait reçu des données préliminaires de la Diagnostic Interview Schedule Survey (étude DIS)Footnote civ sur les besoins en santé mentale des femmes séjournant à la Prison des femmes, le Groupe d'étude a conclu qu'il fallait procéder à d'autres analyses pour situer ces besoins dans un contexte social plus vaste. Ceci étant dit, les membres du Groupe d'étude reconnaissent néanmoins que l'étude DIS confirme l'opinion de bien des intervenants du secteur correctionnel selon laquelle les femmes qui purgent une peine fédérale ont grandement besoin de soutien et d'intervention en santé mentale.
En discutant des conséquences de l'hospitalisation pour les femmes qui traversent des phases psychotiques graves, le Groupe d'étude a conclu que sa méconnaissance des établissements actuels de santé mentale l'empêchait de faire une recommandation définitive. Il faudra donc procéder à d'autres recherches pour déterminer si on peut trouver des établissements convenables et, dans l'affirmative, où ils seront situés. - Entre temps, plutôt que de construire lui-même ce genre d'installations, le Service correctionnel du Canada devrait s'adresser aux établissements provinciaux de santé mentale, mais seulement quand l'hospitalisation s'avère absolument nécessaire. Dans ces cas, les agents de correction devraient être appelés à jouer un rôle tout au long de la durée du séjour de la femme, et celle-ci devrait demeurer à l'hôpital le moins longtemps possible.
Pourquoi la participation communautaire est-elle essentielle à l'efficacité des programmes
Le Groupe d'étude a discuté des avantages comparatifs des ressources internes et des ressources externes. Selon lui, il était important, pour maintenir les liens entre les femmes et la société, que les ressources soient fournies par des personnes de l'extérieur ou des organismes communautaires. Ces organismes sont en effet mieux placés pour s'assurer que les programmes sont constamment revivifiés et mis à jour. Les travailleurs des organismes communautaires sont souvent au courant des programmes qui existent dans d'autres secteurs que les services correctionnels, de sorte qu'ils peuvent adopter plus facilement une stratégie multidimensionnelle et faciliter la continuité au moment où la femme est mise en liberté.
Cependant, le Groupe d'étude a reconnu que la situation des ressources communautaires quant aux services offerts est actuellement instable, principalement, semble-t-il, parce que les subventions sont versées pour une année à la fois. Une structure plus stable et permanente de financement pourrait garantir les avantages importants reliés à la prestation de services communautaires.
De la surveillance à la relation d'aide
Quel rôle le personnel devrait-il jouer
Dans le passé, le débat sur la dotation a presque toujours porté sur les conflits entre la sécurité et les programmes: plus récemment toutefois, la tendance vers la sécurité dynamique et la gestion par unité a été axée sur l'intégration des concepts d'ordre, de soutien et d'aide. Il est cependant devenu de plus en plus clair que la pleine expression d'une telle intégration, parce qu'elle repose sur des relations personnelles stables et productives plutôt que sur les relations prescrites par l'établissement, sera difficile à réaliser dans le milieu carcéral traditionnel.
Assurément, au cours des recherches et des consultations, les femmes purgeant une peine fédérale ont dit aux membres du Groupe d'étude qu'elles avaient besoin de l'aide du personnel plutôt que de sécurité. Elles ont besoin de gens qui sachent répondre à leur souffrance et soutenir, motiver et consolider leur respect d'elles-mêmes et leur jugement.
Les femmes purgeant une peine fédérale ont déclaré avoir des relations positives avec le personnel qui n'est pas affecté à la sécurité, comme les infirmières et les psychologues, de même qu'avec le personnel qui s'occupe des programmes, qu'il s'agisse d'employés rémunérés ou de bénévoles des groupes communautaires. Bien qu'individuellement elles préfèrent certains membres du personnel de sécurité à d'autres, la grande majorité d'entre elles estiment que les gardes de sécurité remplissent une fonction de surveillance et n'ont pas les connaissances nécessaires pour les conseiller; de plus, il n'y a pas suffisamment de confiance entre les deux groupes pour que les prisonnières se confient aux gardes. Pourtant, il n'est pas rare, en particulier au milieu de la nuit ou en d'autres temps de crise, qu'il n'y ait personne d'autre sur place pour les aider.
Les femmes ont également souligné la nécessité de faire en sorte que les membres du personnel soient sensibles aux besoins culturels. Par exemple, si on a pris certaines mesures à la Prison des femmes et dans quelques établissements provinciaux pour offrir des programmes aux autochtones, les femmes constatent que les membres du personnel comprennent rarement la signification et l'importance de la spiritualité et des traditions autochtones, particulièrement dans les établissements provinciaux.
Les méthodes actuelles de dotation ne répondent pas bien aux besoins et aux préférences des femmes. Le système correctionnel est en effet axé sur la sécurité : la majorité des employés fait partie du personnel de sécurité, la plus grande proportion du budget des services correctionnels est affectée à la sécurité, et bien des restrictions et contraintes aux programmes et à d'autres activités sont justifiées par des «besoins de sécurité».
Le modèle actuel de dotation, selon lequel on embauche entre autres des anciens militaires ou des anciens membres de la GRC, n'est pas nouveau, et il conserve une certaine saveur paramilitaire, avec uniformes, grades et une stricte hiérarchie qui prescrit les relations entre les membres du personnel d'une part, et entre le personnel et les prisonnières d'autre part, et ce, malgré les tentatives acharnées du Service correctionnel du Canada pour adopter, depuis quelques années, un autre modèle. Selon les résultats des recherches, ce modèle pose des problèmes pour les femmes qui ne réagissent pas bien à ce genre de structure autoritaire.
Pour aider les femmes à assumer la responsabilité de leur vie en prison et les préparer à subvenir à leurs besoins quand elles seront en liberté, le personnel doit créer un milieu propice aux relations fondées sur l'exemple, l'aide, la confiance et les décisions démocratiques.
Comment la sélection et la formation du personnel peuvent-elles favoriser la relation d'aide
Pour que le personnel qui travaille auprès des femmes purgeant une peine fédérale puisse entretenir avec elles une relation d'aide, plutôt que de remplir une fonction de sécurité, il faudra donner une orientation nouvelle à la sélection et à la formation.
Ainsi, il faudra exiger du personnel une bonne expérience de la vie ainsi que l'expérience du travail social ou une formation académique préparant à travailler spécialement auprès des femmes. Les membres du personnel devront bien comprendre les divers aspects de la situation des femmes, y compris le processus de socialisation, savoir que beaucoup d'entre elles ont été victimes de violence toute leur vie, être en mesure d'apprécier les différences culturelles et être sensible à la dynamique et à l'expression du racisme.
Parmi les autres qualités professionnelles, mentionnons de très grandes aptitudes pour la communication interpersonnelle, l'intervention en cas de crise et la négociation. Les mesures visant à recruter du personnel autochtone et d'autres groupes ethniques devraient être prioritaires et appliquées d'une manière sensible aux particularités culturelles.
Doit-on embaucher du personnel masculin
Les recherches commandées par le Groupe d'étude ont clairement démontré que la majorité des femmes qui purgent une peine fédérale ont survécu à des agressions physiques ou sexuelles, qu'elles avaient subies surtout aux mains d'hommes avec qui elles vivaient quotidiennement.Footnote cv
De plus, dans la société canadienne, les femmes ne sont généralement pas considérées ou traitées comme des égales des hommes et elles dépendent souvent de ceux-ci sur le plan économique et émotif. Elles sont fréquemment soumises l'autorité masculine au travail comme au foyer.
Les femmes doivent pouvoir jouir de la plus grande liberté possible pour guérir les blessures du passé et acquérir la force nécessaire pour retourner dans un monde où elles pourront établir des relations avec les femmes et les hommes sur des bases solides. Le Groupe d'étude croit que la présence de personnel féminin, en particulier aux postes-clés, transmet aux femmes un puissant message d'autonomie. Le meilleur moyen d'enseigner à ces femmes la détermination et le respect de soi, c'est en effet de leur permettre d'observer chaque jour ces qualités chez d'autres femmes.
Compte tenu de ces réalités, l'embauche de personnel masculin aux postes de première ligne, où la relation d'aide s'établit quotidiennement, entraverait le cheminement vers l'indépendance et le respect de soi et nuirait à la guérison de celles qui ont été victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique.
Les membres du Groupe d'étude ont cependant convenu que certains rôles, dans le domaine de l'enseignement ou de la formation professionnelle par exemple, pourraient être remplis soit par des femmes, soit par des hommes qui sont sensibles aux besoins et au « vécu » des femmes. Cependant, pour offrir des choix valables aux femmes qui purgent une peine fédérale, tout le personnel doit comprendre que l'égalité et la justice ne seront possibles que quand des changements fondamentaux se seront produits dans les relations que le personnel entretient avec ces femmes.
De la gestion des risques à la planification personnelle
Dans le système correctionnel actuel, la gestion des femmes purgeant une peine fédérale est principalement fondée sur des considérations de sécurité. Or, cette approche repose sur plusieurs hypothèses qui, selon les consultations, les recherches et les délibérations du Groupe d'étude, ne sont ni appropriées ni constructives dans le cas des femmes.
Une de ces hypothèses veut que les femmes purgeant une peine fédérale soient un risque pour la société. On applique donc, pour les femmes, les mêmes catégories de sécurité et, dans bien des cas, les mêmes mesures de sécurité passive que pour les hommes. Pourtant, la plupart des femmes qui purgent une peine fédérale ne sont pas un risque pour la société. Si elles sont un risque, c'est habituellement pour elles- mêmes.
Une autre hypothèse veut que certains des besoins des femmes soient plus importants que d'autres. On répartit donc ces besoins en catégories que l'on classe ensuite selon un ordre de priorité. Les recherches et les consultations du Groupe d'étude ont toutefois bien démontré qu'il faudrait considérer ces besoins d'une manière globale, holistique.
Enfin, selon une troisième hypothèse, la gestion des cas devrait relever principalement du système correctionnel interne. D'après certaines indications cependant, il pourrait être très utile que la gestion des cas soit confiée à une équipeFootnote cvi.
La discussion de ces hypothèses et de leur signification dans le système actuel a soulevé plusieurs questions, qui portent sur les trois domaines suivants : sécurité, classement et gestion des cas.
Quels sont les besoins des femmes au chapitre de la sécurité
Tout au long des consultations et des recherches, les femmes qui purgent une peine fédérale ont rappelé au Groupe d'étude qu'elles avaient besoin d'aide, et non de sécurité. Bien d'autres parmi les personnes consultées croient également que le système traditionnel de sécurité a peu de signification pour les femmes, dont les valeurs sont davantage ancrées dans les relations interpersonnelles que dans les systèmes.
Les autochtones consultés ont également souligné que l'idée même de punition est étrangère à leur culture. La réparation des torts et la recherche de principes de conduite par les enseignements et la spiritualité dans la culture traditionnelle sont diamétralement opposées aux modèles punitifs qu'ont développés les peuples occidentaux non autochtones. C'est pourquoi le modèle punitif est particulièrement inapplicable aux femmes autochtones et il a sur elles des effets néfastes.
Au chapitre de la sécurité, le Groupe d'étude s'est donc interrogé surtout sur les moyens de créer un milieu ouvert tout en assurant la protection de la société.
Les femmes gui purgent une peine fédérale sont-elles un risque pour la société
L'expérience, maintenant confirmée par les recherches et les consultations du Groupe d'étude, a démontré que toutes les femmes qui purgent une peine fédérale ont de grands besoins, quelles que soient la durée de leur peine ou la nature de l'infraction commise.Footnote cvii Pour ce qui est du risque toutefois, ces femmes ne sont généralement pas dangereuses pour autrui. Quelques-unes d'entre elles en sont venues à recourir à la violence pour survivre aux agressions dont elles ont été victimes toute leur vie. On croit donc qu'elles réagiraient bien dans un milieu où elles trouveraient des encouragements.
Les femmes présentent toutefois un risque pour elles-mêmes, et les recherchesFootnote cviii indiquent que ce risque est étroitement lié aux agressions qu'elles ont subies. Manquant d'estime de soi, souffrant encore de la violence physique, sexuelle ou psychologique dont elles ont été victimes, elles retournent la violence contre elles-mêmes. C'est donc en les encourageant à acquérir l'indépendance et un plus grand respect d'elles- mêmes et en les aidant à guérir les blessures du passé qu'on les rendra moins dangereuses pour elles- mêmes.
Certains estiment en outre qu'un milieu punitif peut inciter à des comportements autodestructeurs, en d'autres mots, qu'il exacerbe la violence. Les mesures comme l'isolement préventif, qu'elles soient appliquées par suite d'infractions disciplinaires pour maintenir l'ordre dans l'établissement, ou même pour réagir à la victimisation d'une prisonnière par les autres prisonnières, ne sont donc pas appropriées si l'on veut donner aux femmes les moyens d'accepter la responsabilité de leurs actes et de faire des choix valables pour elles-mêmes.
Après de longues discussions, le Groupe d'étude a conclu que l'hypothèse qui devait sous-tendre la gestion des femmes purgeant une peine fédérale ne devrait pas mettre en parallèle le risque et la sécurité mais plutôt le risque et le soutien. Le Groupe d'étude estime que les quatre niveaux actuels de sécurité ne conviennent pas au petit groupe de femmes purgeant une peine fédéraleFootnote cix, et qu'il serait préférable d'y substituer un milieu sain, du personnel encourageant et un bon processus de planification. Cette forme dynamique de «sécurité-soutien» permettrait aux femmes d'affronter leurs problèmes pendant la période prescrite d'incarcération et de surmonter ainsi le traumatisme qui est à l'origine de la colère qu'elles retournent contre elles-mêmes.
Le Groupe d'étude a également conclu que, dans l'ensemble, les installations destinées aux femmes ne devraient pas être aménagées principalement selon des critères de sécurité. Chaque femme, quelle que soit l'infraction commise, devrait avoir la possibilité de réagir aux interventions dynamiques qui visent à l'aider. Dans les rares cas où une femme constitue une menace pour la sécurité d'autrui, on pourrait l'empêcher temporairement de se mêler aux autres. Mais même dans ces cas, on devrait recourir le moins possible aux mesures de sécurité passive. Il faut en effet tout mettre en oeuvre pour éviter de créer, par des mesures de sécurité passive, des obstacles aux réseaux de soutien humain (y compris les ami-e-s). De plus, il faut maintenir une intervention humaine intensive jusqu'à ce que la femme soit en mesure de renoncer à la violence et d'acquérir les mécanismes qui lui permettront d'affronter plus calmement la réalité.
Il est à noter que le concept de risque/soutien est conforme au principe de réparation des torts sans punition qu'on trouve dans les traditions autochtones.
Un classement est-il approprié
La recherche effectuée pour le Rapport ChinneryFootnote cx et le Rapport NeedhamFootnote cxi montre que les critères appliqués aux hommes ne sont pas applicables aux femmes et propose une méthodologie pour l'élaboration d'un système de classement propre aux femmes. En outre, à l'occasion des consultations, les membres du Groupe d'étude ont appris que les critères actuels ne sont pas appropriés à la culture et que, par conséquent, les femmes autochtones en particulier sont défavorisées par le système actuel de classement.
À l'origine, les membres du Groupe d'étude appuyaient, en se fondant sur des études antérieures, le concept de critères axés sur les femmes pour le classement, mais en sont finalement venus à la conclusion qu'une évaluation en vue d'une meilleure compréhension des besoins et des expériences des femmes est plus appropriée qu'un classement. Cette conclusion repose sur la perception du Groupe d'étude selon laquelle le classement maintient l'accent sur la sécurité et sur l'attribution d'une cote de sécurité. D'un autre côté, l'évaluation tient compte de l'ensemble des besoins des femmes selon une perspective holistique, y compris des besoins relatifs aux programmes, à la spiritualité, à la santé physique et mentale, à la famille, à la culture et aux projets de sortie. Par cette évaluation, le personnel peut répondre à l'ensemble des besoins par un soutien approprié et des stratégies d'intervention qui tiennent également compte de la protection de la société et de la réduction du risque.
L'expérience a montré qu'une bonne évaluation facilite une libération anticipée en déterminant le plus tôt possible pendant l'exécution de la peine quel programme et quel service il faut à chacune des femmes et quels sont ses besoins particuliers.
Les membres du Groupe d'étude estimaient qu'il faut poursuivre le travail d'élaboration, pour les délinquantes sous responsabilité fédérale, d'un modèle d'évaluation interactive axé sur les femmes.
Comment la planification peut-elle contribuer à offrir des choix valables
Bien des femmes qui purgent une peine fédérale sont souligné l'importance d'acquérir les connaissances et les moyens gui les aideront à gagner le respect d'elles-mêmes et à devenir autonomes. Mais pour réaliser ces objectifs, il faut une certaine planification. Or, beaucoup ont critiqué la façon dont on s'occupe actuellement de la gestion des cas, estimant qu'elles ne sont pas invitées à se prononcer sur le plan qui les concerne ni incitées au début du processus à assumer la responsabilité de leur vie.
Les recherches ont également confirmé l'opinion courante selon laquelle une très forte proportion de femmes qui purgent une peine fédérale ont souvent été victimes de violence dans le passé et, par conséquent, ont les besoins psychologiques et émotifs qui découlent d'une telle violence. Le rapport entre ces besoins et les besoins socio-économiques à caractère plus pratique (la formation professionnelle, etc.) est fondamental. Comment, par exemple, une femme peut-elle apprendre à lire quand elle est envahie par l'angoisse? Selon le Groupe d'étude, seule l'approche holistique permet une intervention significative et efficace. Une telle approche est diamétralement opposée aux stratégies de gestion des cas selon lesquelles on établit non seulement un ordre de priorité dans les mais aussi des distinctions sont particulièrement dénuées de sens dans le domaine des « besoins émotifs », où l'on perçoit la stabilité émotive comme indépendante des besoins reliés à la famille, au mariage et aux camarades.
Pendant l'enquête sur les besoins, les femmes gui purgent une peine fédérale ont dit énormément de bien de l'ancien poste d'agent national de liaison. L'agent, une employée de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry dont le salaire était payé par le Service correctionnel du Canada, était chargée de trouver des appuis communautaires, partout au Canada, avant la mise en liberté des femmes de la Prison des femmes. Le Service correctionnel du Canada a cependant mis fin au contrat en 1987 parce qu'il estimait que l'agent faisait le même travail que l'équipe de gestion des cas.
S'inspirant de cette formule, le Groupe d'étude s'est demandé si la gestion des cas ou la-planification ne serait pas plus efficaces si elle était confiée à quelqu'un d'extérieur au Service correctionnel du Canada, quelqu'un qui fasse partie d'un groupe communautaire. En effet, si le soutien communautaire est essentiel à la mise en liberté anticipée, pourquoi ne pas confier la planification à une personne d'un groupe communautaire?
Le Groupe d'étude a cependant conclu qu'il serait préférable de confier la planification à une équipe, composée de membres du personnel de l'établissement et de groupes communautaires qui seraient conjointement responsables d'encourager et d'aider chaque femme à élaborer et à gérer son plan personnel. Le Service correctionnel du Canada chargerait ainsi un membre de son personnel de former et de diriger une équipe de travail active et créative regroupant la femme purgeant une peine fédérale et un ou plusieurs travailleurs communautaires.
Le Groupe d'étude croit également que cette approche sera des plus fructueuses si elle poursuit un objectif d'égalité entre les services correctionnels, les groupes communautaires et les femmes qui purgent une peine fédérale. Le recours à des gens de l'extérieur permettrait non seulement d'établir plus facilement l'égalité entre le personnel correctionnel et les femmes qui purgent leur peine, mais aussi d'obtenir des services spécialisés au moment où on en a besoin (et donc, de manière rentable).
En étudiant les stratégies innovatrices inspirées de cette responsabilité tripartite (les femmes qui purgent une peine fédérale, le Service correctionnel du Canada et la collectivité), le Groupe d'étude a été frappé par la similarité des objectifs rattachés, d'une part, à la notion d'agent national de liaison et, d'autre part, à la planification axée sur les besoins du client, élaborée par Jerome MillerFootnote cxii du National Centre on Institutions and Alternatives des États-Unis. D'après ce dernier modèle, en recourant aux spécialistes du secteur privé pour élaborer des plans de correction et de mise en liberté, on empêche que les femmes ne soient perdues dans le « système de gestion des cas ... un système qui s'avère souvent incapable d'accorder suffisamment d'attention à la situation particulière de chaque personne ou de trouver des solutions innovatrices fondées sur la pleine connaissance des ressources qui existent dans la société.
Enfin, après consultations et recherches, le Groupe d'étude résume comme suit ce dont il faudra tenir compte pour passer à une approche axée sur la planification personnelle :
- la nécessité d'assurer que la planification est fondée sur les besoins de chaque personne, et non sur les ressources qu'on trouve habituellement en milieu correctionnel;
- la nécessité de rechercher ou de créer avec dynamisme de nouvelles ressources pour répondre aux besoins individuels;
- la nécessité de procéder à une première évaluation globale qui tienne compte de la situation socio- économique et psychologique de chaque personne;
- la nécessité d'établir des relations égalitaires avec les femmes qui purgent une peine fédérale;
- la nécessité d'intégrer la planification personnelle au plan opérationnel, pour éviter d'en faire un programme ou une fonction assuré par une personne en particulier;
- la nécessité de veiller à ce que la gestion des cas soit axée sur la personne, et non sur les besoins de l'administration;
- la nécessité de faire en sorte que la gestion des cas favorise activement la mise en liberté; et enfin
- la nécessité de veiller à ce que la gestion des cas soit faite dans une perspective holistique.
De la consultation à l'action
Les femmes qui purgent une peine fédérale peuvent-elles se faire entendre dans l'organisation actuelle
Quand on lit les écrits sur la criminologie et le secteur correctionnel, on constate très rapidement que presque toute l'attention est dirigée vers les hommes dans le système de justice pénale. Les membres du Groupe d'étude savent très bien que, au Canada, il y a environ 12 500 hommes dans les pénitenciers fédéraux et seulement 208 femmes. L'attention et les ressources que le Service correctionnel du Canada consacre aux hommes est donc fort compréhensible. Comme nous en avons discuté précédemment, les stratégies actuelles, en matière correctionnelle, sont d'abord élaborées en fonction des hommes, et l'on fait ensuite des ajustements ou des exceptions pour les femmes.
Ayant constaté cette réalité, le Groupe d'étude s'est demandé comment se traduirait, dans le système actuel, l'adoption d'une nouvelle approche aux besoins des femmes qui purgent une peine fédérale.
Lee Axon a conclu dans son analyse des systèmes correctionnels qu'on ne parviendra à mettre en oeuvre un régime correctionnel axé sur les besoins des femmes que si on nomme, à un poste très élevé de direction, une femme qui ait les responsabilités, le rang et l'autorité nécessaires pour appliquer des changements fondamentaux. Cette nécessité avait d'ailleurs été reconnue implicitement au Canada dès la publication du rapport Ouimet. En 1969, Ouimet recommandait en effet qu'une femme soit nommée à un poste supérieur de responsabilité et de directionFootnote cxiii. En 1981, l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry recommandait qu'on nomme une commissaire adjointe à la situation des femmes et que les femmes soient considérées comme une sixième région. Le fait que cette recommandation ait été reprise dans le rapport de l'Association du barreau canadienFootnote cxiv et mentionnée dans le rapport DaubneyFootnote cxv porte croire que, selon bien des gens, on n'a pas donné suite à la recommandation Ouimet et que l'orientation masculine continue de prévaloir dans le régime correctionnel destiné aux femmes.
La place même qu'occupe la Division des programmes des délinquants autochtones et de sexe féminin, à l'administration centrale du Service correctionnel du Canada, le confirme d'ailleurs : cette division remplit essentiellement un rôle consultatif auprès des unités opérationnelles, (c'est-à-dire de la Prison des femmes) et d'autres divisions chargées de questions connexes comme celles de la gestion des cas et de la mise en liberté communautaire. De plus, c'est une petite division, située assez bas dans la structure hiérarchique et dont le mandat porte sur divers groupes ayant des besoins spéciaux importants, ce qui fait qu'elle ne peut pas accorder aux femmes purgeant une peine fédérale ni aux autres groupes ayant des besoins spéciaux toute l'attention qu'ils méritent. Bien qu'en créant cette division le Service correctionnel du Canada ait implicitement reconnu la nécessité de donner aux femmes une voix au chapitre, la situation défavorable dans laquelle se trouvent toujours les femmes qui purgent une peine fédérale porte à conclure à l'inefficacité d'un tel moyen.
Ces questions d'organisation se poseront avec plus d'acuité encore quand on aura terminé la régionalisation des installations destinées aux femmes (un élément central du Plan du Groupe d'étude). En effet, une fois ce processus terminé, la structure devra être telle que toutes les composantes décentralisées puissent fonctionner dans le cadre national établi pour les femmes qui purgent une peine fédérale, avec un minimum de variations régionales dans des domaines fondamentaux, et que chaque composante puisse s'appuyer sur les autres et tirer parti de leurs expériences. Le Groupe d'étude craint que, sans relations organisationnelles directes, chaque établissement se trouve isolé dans sa propre région.
L'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et certains membres du Groupe d'étude croient que, pour bien intégrer l'approche axée sur les besoins des femmes, il faut confier la gestion du nouveau plan pour les femmes qui purgent une peine fédérale à une femme qui occuperait le poste de commissaire adjointe. Il est cependant difficile de prévoir comment ce principe sera appliqué, étant donné le style de gestion décentralisée du Service correctionnel du Canada: c'est pourquoi il faudra en discuter plus longuement, comme d'ailleurs d'autres solutions administratives.
Parallèlement à la nécessité de procéder à des ajustements administratifs internes pour mettre en oeuvre un nouveau plan à l'intention des femmes, le Groupe d'étude est d'accord avec la formation d'un conseil consultatif national qui conseillerait le commissaire du Service correctionnel sur les questions intéressant les femmes qui purgent une peine fédérale. Ce conseil serait formé de membres des conseils régionaux de planification rattachés à chaque établissement pour femmes, que le solliciteur général pourrait nommer après consultation des groupes communautaires intéressés.
Prélibération et intégration dans la société
Le régime actuel de mise en liberté aide-t-il vraiment les femmes à s'intégrer dans la société
D'après les recherches et les consultations du Groupe d'étude, il y aurait des lacunes à presque toutes les étapes du processus de mise en liberté communautaire. La distance souvent grande qui sépare la femme purgeant une peine fédérale de ses amis, de sa famille et de son foyer empêche les contacts suivis avec ceux et celles qui peuvent la soutenir. Elle pose également des problèmes administratifs et financiers quand on cherche à obtenir la mise en liberté provisoire pour que la transition vers la société se fasse de manière graduelle et efficace.
Les femmes ne sont pas suffisamment renseignées sur les régimes de mise en liberté sous condition et ne savent pas comment obtenir des laissez-passer, une semi-liberté et la libération conditionnelle totale. Les problèmes sont d'autant plus graves qu'il existe des différences complexes entre les régimes provinciaux et le régime fédéral. Par exemple, selon une étude récente réalisée conjointement par le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnellesFootnote cxvi, un très grand nombre de femmes ne savent pas que la loi fédérale leur accorde automatiquement droit à une audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles le jour où elles sont admissibles à la semi-liberté. Elles ne savent pas non plus qu'elles ont droit de renoncer à cette audience ni ce qui s'ensuit si elles y renoncent.
Les femmes qui purgent une peine fédérale ont déclaré au Groupe d'étude qu'elles avaient de la difficulté à obtenir des renseignements sur la mise en liberté sous condition auprès des représentants du Service correctionnel du Canada et qu'elles devaient souvent s'adresser à d'autres sources - les autres prisonnières ou les groupes communautaires, par exemple. Elles ont aussi de la difficulté à savoir quels services sont offerts dans diverses localités... un renseignement pourtant essentiel à la préparation de leur liberté.
Les femmes qui purgent une peine fédérale dans des établissements provinciaux sont encore plus mal placées pour préparer leur libération. Par exemple, elles ont encore plus de difficulté à obtenir les renseignements nécessaires.
Les femmes ont aussi moins de possibilités que les hommes de s ‘intégrer dans la société au moment de leur mise en liberté. Ainsi, bien des hommes peuvent obtenir la permission de sortir, d'abord avec surveillance puis sans surveillance, dans la localité où ils souhaitent retourner, de sorte que, si tout va bien, ils pourront obtenir quelque chose comme une semi-liberté dans une maison de transition. Ce processus par étapes aide l'organisme de libération conditionnelle à prendre la décision de donner leur chance à certains d'entre eux en leur accordant la libération conditionnelle totale. La situation est cependant différente pour bien des femmes, à cause des grandes distances qui séparent l'établissement de leur lieu d'origine (et donc des frais de transport élevés) ainsi que du nombre restreint de places dans les maisons de transition pour femmes.
Dans bien des cas, le personnel des maisons de transition préfère rencontrer la femme d'abord dans l'établissement puis l'accueillir pour une fin de semaine avant de décider de l'accepter. Là encore, à cause des distances, ce processus de libération graduelle est extrêmement difficile.
Un autre problème tient au fait que très peu de maisons de transition sont en mesure de répondre aux besoins des femmes qui purgent une peine fédérale. Ainsi, une femme admissible à la mise en liberté sous condition est souvent obligée de s'en aller dans une localité loin de chez elle si elle ne veut pas rester en prison.
Les femmes en liberté sous condition sont en général aux prises avec beaucoup de problèmes, entre autres s'occuper de leurs enfants (parfois en obtenir la garde ou trouver quelqu'un à qui les confier quand elles travaillent), gagner leur vie, trouver un logement décent à un prix abordable, obtenir des soins convenables, lutter contre l'alcoolisme ou la toxicomanie, et d'autres encore.
Ces problèmes se posent avec d'autant plus d'acuité que la formation qu'elles ont reçue en établissement ne les a généralement pas préparées à trouver un emploi après leur libération. Quand elles ont reçu une formation pertinente, l'équipement (les ordinateurs, par exemple) était désuet, ce qui réduisait leurs chances de trouver et de garder un emploi à l'extérieur.
Devant ces multiples problèmes, il est évident que les femmes ont besoin d'aide pour traiter avec les nombreux services et organismes qui existent dans la collectivité et, si nécessaire, trouver les autres ressources dont elles ont besoin. La majorité des femmes retournent un jour dans la société, et la façon dont la transition se fait est capitale pour qu'elles réussissent à s'y intégrer.
En bien des endroits cependant, il n'y a pas de coordination dans l'évaluation des besoins des femmes défavorisées et dans les réponses à apporter à ces besoins. Divers organismes fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux ainsi que divers groupes communautaires, groupes bénévoles et particuliers se partagent les pièces du casse-tête. Et bien souvent, personne n'a d'idée générale des services qui sont offerts ou qui manquent aux femmes, de sorte qu'il est impossible d'évaluer les besoins, encore moins d'y répondre. On fait rarement de l'éducation communautaire sur les besoins des femmes qui retournent vivre dans la société et sur les risques que ce processus comporte.
Pour accélérer l'intégration ou la réintégration des femmes dans la société, les membres du Groupe d'étude se sont entendus sur cinq principes directeurs qui favoriseraient la planification :
- les femmes doivent se préparer le mieux possible à leur mise en liberté et à la vie dans le monde extérieur durant la partie de leur peine qu'elles purgent en établissement. Il doit donc y avoir continuité entre les services et programmes offerts dans l'établissement et les services et programmes offerts dans la collectivité.
- les femmes doivent être suffisamment informées sur les régimes de mise en liberté pour faire des choix judicieux et préparer leur mise en liberté.
- pour que les plans de mise en liberté soient réalistes, concrets et adaptés aux besoins et à la situation de chaque femme, l'aide, le soutien et le contrôle communautaires doivent en faire partie intégrante.
- la décision de mettre une femme en liberté doit être fondée sur une bonne compréhension des services offerts, des besoins de cette femme et de toute contrainte qui pourrait empêcher qu'on réponde à ses besoins. La femme concernée, les membres des groupes communautaires qui l'aideront au moment de sa mise en liberté ainsi que les agents des services correctionnels doivent donc bien comprendre les problèmes et échanger les renseignements nécessaires.
- la partie de la peine que la femme purge en société doit être gérée de manière à assurer la présence de tous les éléments nécessaires à la réussite de son intégration ou de sa réintégration.
Le Groupe d'étude a conclu que, en donnant aux groupes communautaires et aux personnes de l'extérieur la possibilité d'offrir des conseils et des services tant dans l'établissement qu'à l'extérieur, on créerait entre l'établissement et la société un lien supplémentaire qui facilite la libération.
Réalités particulières
Des solutions après coup à de véritables choix
Comment peut-on faire entendre le point de vue des autochtones
Un des principaux problèmes sur lesquels le Groupe d'étude s'est penché en ce qui a trait à la situation des femmes autochtones, c'est celui de la discrimination dans la discrimination dont ces femmes sont victimes. Cette question l'a nécessairement amené à discuter de la lutte entreprise par les autochtones pour obtenir leur propre système de justice, dans le cadre de l'autonomie administrative qu'ils réclament. Le Groupe d'étude n'a pu s'attaquer à cette vaste question qui dépasse les paramètres de son mandat, mais sa reconnaissance de la lutte que mènent les autochtones l'a amené à décider d'aborder leurs problèmes de deux points de vue. D'abord, les membres du groupe d'étude ont convenu que les autochtones traitent à leur façon des questions fondamentales qui les intéressent dans un chapitre du présent rapport. Ensuite, les membres non autochtones du Groupe d'étude ont accepté de faire tout leur possible pour comprendre le point de vue des autochtones et, avec l'aide de ceux-ci, le faire valoir tout au long du rapport. Ils espèrent ainsi éviter de traiter «après coup» de la situation des autochtones, comme on le fait si souvent pour des groupes minoritaires ou défavorisés.
Pour mieux comprendre la situation des autochtones, le Groupe d'étude a voulu consulter les collectivités autochtones, mais n'y est pas parvenu, par manque de temps et manque de connaissance sur la façon de les rejoindre selon leurs paramètres à elles. Le Groupe d'étude a néanmoins pu profiter des avis et opinions de beaucoup de femmes autochtones purgeant une peine fédérale, de nombreuses organisations autochtones et de plusieurs Aînées. De plus, les recherches effectuées par Fran Sugar and Lana FoxFootnote cxvii l'ont aidé à comprendre de quelles façons ils pouvaient apprendre des femmes autochtones.
Les autochtones que le Groupe d'étude a réussi à consulter lui ont transmis un message clair : on ne peut « greffer » sur les femmes autochtones aucun système, qu'il soit masculin ou féminin, pas plus qu'on ne peut greffer sur les femmes un système conçu pour les hommes. Les prisonnières autochtones, par exemple, ont parlé au Groupe d'étude de leur besoin d'être avec d'autres femmes autochtones et d'avoir libre accès aux enseignements et aux remèdes de leur culture. Elles ont aussi parlé de l'importance de rester en contact avec leur famille et avec leur communauté. Les groupes autochtones, pour leur part, ont souligné la nécessité de s'inspirer du point de vue autochtone pour élaborer de nouveaux systèmes pour les femmes; ils ont rappelé l'importance de l'approche holistique pour aider les femmes en difficulté et parlé de la nécessité d'améliorer la formation interculturelle qui permettrait de profiter des qualités et valeurs des cultures autochtones.
Des nombreuses consultations qu'il a tenues comme de celles qui ont échoué, le Groupe d'étude a conclu qu'il n'est pas très réaliste de penser que les non-autochtones pourront élaborer et appliquer des programmes pour les autochtones. Le mieux que les femmes non-autochtones puissent faire, c'est d'être sensibles aux problèmes, de façon à ne pas créer involontairement d'obstacles et à faciliter l'élaboration et la prestation de programmes pour les autochtones.
Les femmes autochtones devraient-elles avoir leur propre établissement
Le Groupe d'étude sur les autochtones au sein du régime correctionnel fédéralFootnote cxviii s'est penché sur la question des prisons réservées aux autochtones pour conclure qu'il incombait au Ministère du solliciteur général de décider si la création d'un établissement entièrement autochtone était compatible avec sa politique. Une partie des inquiétudes que suscite la création d'une prison distincte, proposée en 1984 dans le rapport du comité CarsonFootnote cxix, tient au danger de confiner les autochtones dans un ghetto, loin de chez eux et où l'on appliquerait divers niveaux de sécurité gui ne leur conviennent pas. Même si le Groupe d'étude sur les autochtones n'a pas entièrement rejeté cette idée, la transformation des installations existantes ne lui semblait pas opportune.
D'abord sensible à ce point de vue, le Groupe d'étude en est cependant venu à l'idée qu'il faut adopter une approche parallèle, plutôt qu'une approche «après coup» pour répondre aux besoins des prisonnières autochtones. Les notions de planification personnelle et de services holistiques de santé mentale, par exemple, ont un sens pour les autochtones, mais elles doivent être appliquées selon leurs propres conditions. Deux autres éléments favorisent l'aménagement d'un établissement distinct pour les autochtones - la connaissance qu'un nouveau plan délogement pour les femmes purgeant une peine fédérale offrirait le choix aux femmes et, élément plus important encore, le fait que les représentants autochtones au Groupe d'étude ont eux-mêmes avancé cette idée.
Suivant les conseils de ses membres autochtones, le Groupe d'étude propose donc l'aménagement d'une loge de guérison, quelque part dans les Prairies, loge où les femmes autochtones pourraient choisir d'être incarcérées. Il était clair, dès le départ, que cette conclusion était celle du Groupe d'étude seulement. Pour être acceptée, elle doit non seulement être adoptée par le Service correctionnel du Canada mais reprise et élaborée par les collectivités autochtones elles-mêmes.
De la « prison à vie » à la vie en prison
A l'heure actuelle, 54 femmes purgent une peine fédérale de vingt ans ou plus. Le Groupe d'étude n'a pas recueilli de renseignements détaillés sur elles, mais il estime probable que, comme les autres groupes, elles n'ont en commun que la durée de leur peine et diffèrent sur les plans de l'âge, de la scolarité et des autres besoins.
Quoiqu'il n'ait pas commandé d'étude spéciale sur ces femmes, le Groupe d'étude a relevé un certain nombre de points importants dans les recherches déjà faites sur les personnes qui purgent une peine de longue durée, et notamment le résumé sur ce sujet dans le rapport de Lee Axon.
Comment le personnel doit-il répondre aux besoins des condamnées à perpétuité
Les membres du Groupe d'étude ont rencontré des femmes qui purgent une peine de longue durée et lu des recherches sur elles. Beaucoup de ces femmes ont dit préférer ne pas être avec celles qui purgent une peine de courte durée. D'autres, par contre, ont fait remarquer qu'elles ont souvent beaucoup en commun avec les femmes qui purgent une peine plus courte et qu'elles préféreraient ne pas être séparées seulement en fonction de la durée de leur peine. Le Groupe d'étude a relié cette question à celle de l'ennui gui s'installe nécessairement quand on vit la même vie au même endroit durant des années, et conclut que son plan doit offrir une certaine souplesse pour les transfèrements entre établissements régionaux, afin que les femmes qui purgent une peine de longue durée puissent avoir un certain choix.
Les personnes qui purgent une peine de longue durée traversent diverses phases qui, souvent, se recoupent : refus, affliction, rébellion, adaptation, socialisation. A chaque phase correspond un ensemble bien particulier de besoins. Le Groupe d'étude a conclu qu'il est essentiel que le personnel soit au courant de ces phases - dont la durée varie d'une femme à l'autre - et qu'il fournisse au bon moment es ressources et l'aide nécessaires.
Il n'est pas difficile de reconnaître que les effets débilitants de l'incarcération seront amplifiés chez les femmes qui purgent une peine de longue durée. La discussion sur cette question a amené le Groupe d'étude à réaffirmer le principe que tout plan doit viser à réduire la dépendance vis-à-vis de l'établissement et améliorer les chances de mener une vie normale et responsable pour toutes les femmes qui purgent une peine fédérale.
Il est important que les femmes qui purgent une peine de longue durée puissent affirmer leur autonomie, exprimer leur individualité et assumer les responsabilités de la vie quotidienne. Mais cela ne suffit pas. Le Groupe d'étude a conclu qu'il faut aussi créer des possibilités de «carrière en prison» et faire en sorte que ces carrières constituent des emplois utiles qui correspondent le plus possible à la réalité du monde extérieur.
De l'isolement à la création de liens
Comment peut-on nourrir les liens entre les mères et leurs enfants
Les deux tiers des femmes qui purgent une peine fédérale ont des enfants et en sont les principales responsables. Beaucoup d'entre elles ont parlé de la souffrance et de l'anxiété que causaient la séparation ainsi que du sentiment d'impuissance qu'elles éprouvaient quand leurs enfants étaient placés dans des foyers nourriciers. Les femmes qui ont choisi de purger une peine fédérale dans un établissement provincial en vertu des ententes d'échange de service ont dit aux chercheurs qu'elles avaient fait ce choix surtout pour rester en contact avec leurs enfants.
A l'heure actuelle, les règlements sur les visites varient d'une prison à l'autre. Le coût du transport et des appels téléphoniques et le manque d'empressement des parents nourriciers à faciliter les visites sont tous des facteurs qui, malgré les règles écrites, peuvent empêcher les femmes de rester en contact avec leurs enfants. Pour ce qui est des nourrissons, deux provinces seulement permettent aux femmes de les garder avec elles durant la phase critique qui suit la naissance.
Le Groupe d'étude a longuement discuté de la situation des mères. Après avoir examiné la documentation sur le sujet, il a conclu que le temps ne lui permettait pas d'accorder à cette question complexe toute l'attention qu'elle mérite, et qu'il n'y a pas de formule facile ou de solution simple. Le Groupe d'étude reconnait en outre que la mère, l'enfant et le Service correctionnel du Canada ne sont pas les seuls concernés : les autres membres de la famille et les organismes de protection de l'enfance ont aussi leur mot à dire.
Le Groupe d'étude a également reconnu que la plupart des établissements pour femmes au Canada n'offrent pas aux enfants un milieu convenable.
Bien qu'il ait conclu que cette question mérite qu'on s'y arrête plus longuement, le Groupe d'étude a néanmoins décidé ce qui suit :
- les nouvelles installations doivent recréer une atmosphère familiale et permettre suffisamment de souplesse pour que les enfants y vivent avec leur mère;
- chaque cas doit être étudié séparément;
- il incombe au Service correctionnel du Canada de faciliter la décision et, pour ce faire, d'aider et d'encourager la mère dans ses négociations avec l'organisme concerné de protection de l'enfance.
Le Groupe d'étude a également décidé que, dans les cas où la cohabitation n'est pas possible, le Service correctionnel du Canada doit fournir les ressources nécessaires pour permettre des contacts étroits et réguliers entre la mère et ses enfants.
Conclusion
En discutant de chacun de ces enjeux et dilemmes, les membres du Groupe d'étude ont été obligés de clarifier leurs propres principes pour déterminer la «meilleure» approche. Ces principes ont ensuite fait l'objet d'intenses discussions, dont nous rendons compte dans le chapitre qui suit.
Section C : Construire l’avenir avec sagesse
Chapitre X : Les principes du changement
Introduction
Le fondement de ces principes
Les principes du changement desquels sont tirées la vision et les recommandations du Groupe d'étude, trouvent leur origine aussi bien dans la sagesse du passé que dans les réalités du présent; ils ont été alimentés par les espoirs des membres du Groupe d'étude en vue d'une plus grande réforme judiciaire et sociale.
Ces principes font écho aux voix des femmes purgeant une peine fédérale, à celles des femmes et des hommes autochtones soucieux des injustices subies par leur peuple, à celles de tiers qui compatissent au sort des femmes qui purgent une peine fédérale, à celles des chercheurs et à celles des personnes siégeant à d'autres groupes d'étude ou comités qui ont travaillé d'arrache-pied afin de donner à notre système de justice plus d'efficacité, de sensibilité et d'équité.
Ces principes reflètent les valeurs essentielles de la Mission du Service correctionnel du Canada, insistant sur la dignité et les droits de l'individu, la capacité de croissance et d'épanouissement humain, l'apport et la participation de la communauté et le partage des idées, des connaissances, des valeurs et de l'expérience.
Vers un but à plus long terme
Ces principes sous-tendent un but à plus long terme, hors du mandat du Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale. Ce but, partagé par les membres du Groupe d'étude, vise un changement social qui réduira les inégalités dans la manière de traiter les personnes, ainsi que les crimes qui découlent de ces inégalités. Ce but vise un temps où le tort infligé aux personnes sera réparé de façon créatrice, avec soutien et sans incarcération. Ce but vise un avenir où toutes les communautés assumeront leurs responsabilités vis-à-vis les causes et les réponses reliées à l'inégalité et à la souffrance. Ce but vise un avenir où les autochtones auront à nouveau le droit de créer une justice conforme à leurs traditions.
Tout comme nous le rappellent les femmes autochtones qui ont mené l'enquête sur les femmes purgeant une peine fédérale dans la communauté :
«Aucune réforme à la pièce du système pénitentiaire ne pourra soulager les malheurs subis avant leur incarcération par les femmes autochtones qui vivent ou qui ont vécu à l'intérieur des murs carcéraux. La prison ne peut remédier au problème de la pauvreté qui sévit dans les réserves. Elle ne peut prendre de mesures contre les souvenirs récents et historiques du génocide de notre peuple par les Européens. Elle ne peut remédier à la violence, à l'alcoolisme, aux agressions sexuelles de leur enfance, aux viols et autres violences que les femmes autochtones ont subies aux mains des hommes. La prison ne peut guérir les abus passés des familles d'accueil, ni l'indifférence et le racisme du système de justice canadien lors de ses démêlés avec les autochtones. Cependant, le traitement des femmes autochtones emprisonnées peut commencer à reconnaître que ces choses SONT les réalités de la vie vécue par les prisonnières autochtones. Cette compréhension nous permettra d'amorcer les changements qui favoriseront la guérison plutôt que la colère.»Footnote cxx
Pour le moment, les restrictions législatives et les attitudes sociétales nous empêchent d'atteindre notre idéal. Les membres du Groupe d'étude comprennent qu'un changement dans la législation est nécessaire pour accéder à un système correctionnel plus souple et plus humain, qu'il devra y avoir parallèlement des changements de législation, de politique et d'attitude avant que le but à long terme puisse devenir réalité.
La nécessité d'une action immédiate
Cependant, il existe maintenant un besoin urgent de mesures pour répondre aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale. Il existe maintenant un besoin urgent d'élaborer des choix qui refléteront les expériences et pourvoiront aux besoins des femmes. Il existe maintenant un besoin urgent d'élaborer des choix qui à l'avenir réduiront les mesures préjudiciables. Nous croyons que les cinq principes suivants, ainsi que l'énoncé de principe général qui conclut le présent chapitre, peuvent inciter fortement à des mesures immédiates ainsi que baliser le chemin sur lequel nous avançons pour atteindre notre idéal.
En formulant ces principes, nous reconnaissons que nous ne possédons pas «la réponse». Notre rapport et ses principes directeurs ne constituent qu’une étape dans un processus qui doit poursuivre son évolution. Il est essentiel de s‘engager à encourager l'évolution de ce processus.
Premier principe : pouvoir contrôler sa vie
Que voulons-nous dire
Les inégalités et la restriction des choix de la vie que rencontrent généralement les femmes dans notre société, et que subissent avec plus d'acuité plusieurs femmes purgeant une peine fédérale, ont laissé à ces femmes bien peu d'estime de soi et de confiance dans leurs possibilités de prendre leur vie en main. Elles se sentent donc dépouillées de leur autorité, incapables d'élaborer ou d'arrêter des choix, incapables d'envisager un avenir plus valorisant et plus productif, même lorsqu'on leur présente des choix réalistes. Ce problème est exacerbé par le racisme que subissent les femmes autochtones.
Quelle est l'importance de ce principe
Research and the words of federally sentenced women have repeatedly stressed the connections between women's involvement in the criminal justice system and the inequities, hardships and suffering experienced by women in our society.
Les travaux de recherche et les paroles des femmes purgeant une peine fédérale ont à maintes reprises fait ressortir les relations entre l'implication des femmes dans le système de justice pénale et les inégalités, les épreuves et les souffrances subies par les femmes dans notre société.
Il est bien évident que le sexisme et le racisme se retrouvent à des degrés élevés dans notre pays. Au Canada, le salaire des femmes ayant un travail à plein temps correspond toujours en moyenne aux deux tiers du salaire gagné par les hommes. Approximativement 39 % des familles dont le chef est une femme se retrouvent sous le seuil de pauvreté, alors que le taux correspondant pour les hommes est de 9 %. En moyenne, après un divorce, le revenu des femmes diminue de 40 % alors que celui des hommes augmente de 70 %.Footnote cxxi
Les niveaux élevés d'exploitation des femmes dans notre société révèlent les conséquences violentes et directes du sexisme. Une femme sur quatre est agressée sexuellement pendant sa vie, dont la moitié avant l'âge de 17 ans, et chaque année un million de femmes sont battues par leurs conjoints légitimes ou de fait.Footnote cxxii Parmi les femmes purgeant une peine fédérale, comme l'ont révélé des recherches susmentionnées, la violence est encore plus répandue. Des femmes purgeant une peine fédérale qui ont été interrogées l'an dernier (1989), 68 % disent avoir été victimes de violence physique et 54 % de violence sexuelle à un moment ou à l'autre de leur vie.Footnote cxxiii
Les inégalités et l'exploitation subies par les femmes autochtones au Canada sont encore plus surprenantes que les réalités dépeintes par ces moyennes générales. Par exemple, on retrouve deux fois plus de foyers monoparentaux dont le chef est une femme parmi les familles autochtones. De plus, 90 % des femmes autochtones purgeant une peine fédérale ont été victimes de violence physique et 61 % de violence sexuelle.Footnote cxxiv
Les femmes autochtones ne font pas que subir les injustices généralement infligées aux femmes dans notre société. Elles souffrent aussi du déplacement et des inégalités qu'ont eu à endurer pendant plusieurs années les hommes, les femmes et les enfants autochtones.
Les attitudes, les obstacles et les souffrances, lesquelles sont les conséquences du sexisme et du racisme érodent l'estime de soi que possèdent habituellement les femmes. De plus, plusieurs femmes purgeant une peine fédérale sont parmi celles qui ont souffert le plus de sexisme et de racisme. Généralement les femmes purgeant une peine fédérale sont peu instruites, sans emploi et ont été victimes de violence physique ou sexuelle. Les circonstances de leurs vies, ajoutées aux sentiments de culpabilité, de peur, d'anxiété, d'aliénation et de confusion qui surgissent souvent au moment de leur arrestation et de leur condamnation par le système de justice, s'allient pour engendrer un groupe de femmes dont l'estime de soi est extraordinairement basse.
Une piètre estime de soi diminue la capacité d'une femme de fonctionner. Elle intensifie un comportement autodestructif très répandu chez les femmes purgeant une peine fédérale. Elle peut contribuer à la violence envers les autres. Une piètre estime de soi diminue la capacité d'une personne de planifier l'avenir, d'assumer les responsabilités de ses actes et de croire qu'elle puisse effectuer des choix valables qui l'aideront à vivre dans le respect et la dignité.
Inversement, l'accroissement de l'estime de soi augmente la capacité d'accepter et d'exprimer ses responsabilités vis-à-vis des gestes posés et des choix futurs. Accepter et exprimer ses propres responsabilités stimule la force et la bonne estime de soi, créant ainsi un cycle constructif de pouvoir.
L'accroissement de l'estime de soi est inter relié à la capacité des femmes autochtones de déterminer leurs rôles en tant qu'autochtones. En consultant les Aînés et les autres autochtones, les membres du Groupe d'étude ont appris que pour améliorer la notion d'identité et d'estime de soi parmi les femmes autochtones, il était nécessaire de concevoir des programmes qui augmenteront l'accès aux enseignements traditionnels et aux conseils des Aînés, ce qui permettra aux femmes autochtones d'exprimer leur spiritualité.
L'accroissement de l'estime de soi peut réduire la violence envers soi-même et envers les autres. Les recherches ont démontré que la violence est souvent liée à la perception d'une perte de contrôle vis-à-vis d'un autre individu ou vis-à-vis des conditions de vie.Footnote cxxv
Les femmes incarcérées veulent des programmes destinés à augmenter leur-estime de soi et leur pouvoir. Dans notre examen de programmes modèles demandés par le Groupe d'étude, nous avons résumé une étude portant sur les femmes incarcérées au Minnesota qui signalait que l'apprentissage et l'élaboration de la confiance en soi et de l'estime de soi étaient considérés comme un des plus grands besoins.Footnote cxxvi De façon similaire, les consultations faites pour le Groupe d'étude montraient qu'on accordait beaucoup d'importance à la prestation de programmes destinés à développer l'estime de soi.Footnote cxxvii
Deuxième principe : des choix valables et responsables
Que voulons-nous dire
Pour être en mesure d'obtenir un sentiment de contrôle sur leurs vies, lequel augmentera leur estime de soi et leur pouvoir, les femmes ont besoin d'options valables leur permettant d'effectuer des choix responsables. Ces choix doivent se rattacher à leurs besoins et suivre la logique de leurs expériences passées, de leur culture, de leur moralité, de leur spiritualité, de leurs habiletés ou leurs aptitudes, ainsi que des réalités et des possibilités de leur avenir. Des choix valables et responsables peuvent être offerts uniquement dans le cadre d'un environnement souple qui permet l'adaptation aux besoins variés et disparates des femmes purgeant une peine fédérale.
Quelle est l'importance de ce principe
La nécessité d'augmenter les choix tant pour les femmes purgeant une peine fédérale que pour les personnes qui tentent de leur venir en aide et de leur offrir un soutien en vue d'un avenir meilleur, découle directement d'un besoin de pouvoir.
Leur dépendance vis-à-vis des hommes, de l'alcool et de l'aide financière de l'État qui est partie intégrante de la vie de plusieurs femmes purgeant une peine fédérale, les a privées de la possibilité et de la capacité de faire des choix. Pour briser ce cercle de dépendance, ces femmes ont besoin de connaître le succès associé aux choix judicieux et responsables.
Les femmes purgeant une peine fédérale se trouvent devant des choix très restreints. Il n'existe que peu de programmes de formation et de soutien, les options de travail sont excessivement limitées, tout comme les choix quant au lieu d'incarcération sont lourds de conséquences. Une femme qui choisit de purger la partie incarcération de sa peine dans un établissement provincial n'aura que peu ou pas d'options de programmes, de travail ou de formation. Cependant, si elle opte pour la Prison des femmes, elle risque de se retrouver si loin de ses amis et de sa famille qu'elle devra s'attendre à ne les voir que rarement, sinon jamais.
Les choix dans les domaines de l'alimentation et des soins de santé des femmes purgeant une peine fédérale sont, eux aussi, limités. Par l'entremise des consultations effectuées pour le Groupe d'étude, les femmes demandent un plus grand contrôle sur leur alimentation, plus d'accès à l'air libre et plus de choix quant aux soins médicaux.Footnote cxxviii
Il existe dans la communauté peu de disponibilités pour la plupart des femmes. Il est essentiel d'avoir plus de choix concernant les maisons de transition, les maisons d'hébergement prolongé, les programmes, les services et le soutien si les femmes doivent faire un succès de leur réadaptation.
Par des choix réels qui leur apparaissent logiques, les femmes gagneront le contrôle de leur vie. Pour construire sa vie et apprendre à survivre en liberté, il faut des choix responsables. Si la période d'incarcération doit être un temps de préparation à la liberté, il faut donc qu'une partie de cette préparation serve à aider les femmes à prendre des mesures autant vis-à-vis des pressions que du pouvoir de faire des choix. Si des possibilités de poser des choix valables et responsables sont offertes, la vie à l'intérieur de la prison reflétera mieux la vie à l'extérieur et offrira ainsi un environnement plus réaliste au sein duquel la responsabilité et l'autosuffisance seront favorisées.
Troisième principe : respect et dignité
Que voulons-nous dire
Ce principe est fondé sur l'hypothèse que le respect mutuel est nécessaire entre les prisonnières, entre le personnel et entre les prisonnières et le personnel si les femmes doivent obtenir le respect d'elles-mêmes et des autres, éléments nécessaires pour assumer la responsabilité de leur avenir. Ce principe est aussi fondé sur la reconnaissance que le respect, en accord avec les principes directeurs de l'Énoncé de Mission du Service correctionnel du Canada, «devra répondre, dans les limites de la loi, aux besoins des individus et des minorités en matière de culture et de religion».Footnote cxxix Les besoins spirituels, de même que les pratiques et l'identité culturelles, seront reconnues comme étant parties intégrantes de l'individu, parties qui ne peuvent être négligées lorsqu'on vise la réhabilitation et l'aide pendant le processus de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce principe est fondé sur les observations concluant que le comportement des prisonnières est fortement influencé par le traitement qu'elles reçoivent, que si les personnes sont traitées avec respect et dignité elles seront plus sujettes à agir de manière responsable. Le respect est lié aux quatre principes de vie des autochtones : bienveillance, honnêteté, partage et force.
Quelle est l'importance de ce principe
Les établissements correctionnels au Canada ont souvent été critiqués pour leur tendance à encourager chez les femmes la dépendance et le comportement infantile.Footnote cxxx
Les femmes consultées pour ce rapport parlent des règles et règlements apparemment arbitraires de la prison et de la manière dont ces règles les humilient et contribuent à leur sentiment d'impuissance. Les femmes se disent privées d'intimité, de tranquillité et de dignité. Dans ces conditions, elles ont le sentiment d'être dépourvues de droits et de contrôle. Ce sentiment mène à une sensation accablante de désespoir et un manque total de motivation.
Parce qu'il n'y a que peu sinon pas de respect et de dignité accordés aux femmes purgeant une peine fédérale, celles-ci sont nettement d'avis qu'on ne fait pas véritablement d'efforts pour comprendre et accueillir convenablement les différentes traditions raciales, culturelles et spirituelles. Ce qui est particulièrement important pour les femmes autochtones, puisque les traiter avec respect signifie nécessairement respecter leur culture.
Quatrième principe : environnement de soutien
Que voulons-nous dire
On comprendra mieux la notion d'environnement en termes de constellation de plusieurs types d'environnements... politique, physique, financier, émotif, psychologique et spirituel, tout spécialement pour les femmes autochtones. Un style de vie positif qui peut encourager l'estime de soi, le contrôle, la dignité et le respect de soi-même et des autres nécessaires à une vie productive et valable, peut seulement être créé dans un environnement où tous les aspects sont positifs et offrent un soutien mutuel.
Quelle est l'importance de ce principe
La qualité de l'environnement peut promouvoir la santé physique et psychologique, et le développement personnel. Les environnements dans les quels vivent les femmes purgeant une peine fédérale sont souvent inadéquats au point de vue physique, psychologique et spirituel. Les femmes incarcérées ont trop peu d'accès à l'air libre, à la lumière, à une alimentation convenable, à des interactions sociales fondées sur la dignité et le respect, à des relations suivies avec les êtres chers à l'extérieur de l'établissement, et à des pratiques et expériences spirituelles et culturelles. L'intimité, la tranquillité, la dignité et la sécurité, parties intégrantes d'une qualité de vie acceptable, leur sont refusées. Dans la communauté, la quantité d'aide, de conseils et de représentation qu'une femme peut recevoir détermine si elle s'intégrera à son environnement de manière fonctionnelle ou non.
Ce principe ajoute au travail d'autres secteurs et disciplines. Il reflète le concept de «communautés en santé» que promeut présentement Santé et Bien-Être social Canada et qui se retrouve à l'échelle internationale. Ce concept environnemental met l'accent sur la nature interpersonnelle de l'environnement. Il insiste sur le fait que la volonté des personnes concernées est la plus grande ressource environnementale: tout comme il est relié de près aux principes précédents de contrôle, de choix, de respect et de dignité.
Ce principe souligne, à travers l'interdépendance de tous les aspects de l'environnement, que l'égalité des programmes, de l'environnement, de la sécurité ne peut être réduite à l'égalité de traitement au sens de «similitude» de traitement mais doit être vue dans la perspective de résultats égaux. En d'autres mots, il n'est pas suffisant de tendre vers un traitement identique, il faut assurer l'égalité. La sensibilité aux besoins et aux expériences qui assure l'égalité en terme de résultats valables, compte tenu de tous les aspects de l'environnement, est plutôt le fondement manifeste de l'égalité.
Cinquième principe : responsabilité partagée
Que voulons-nous dire
Tous les niveaux de gouvernement, les travailleurs en milieu correctionnel, les services bénévoles, le monde des affaires, le secteur privé et les membres de la communauté en général doivent assumer leurs responsabilités comme parties inter-reliées de la société. Cela est essentiel afin de favoriser parmi les femmes purgeant une peine fédérale l'indépendance et la confiance en soi qui leur permettront d'assumer la responsabilité de leurs actions passées, présentes et futures. Pour être en mesure d'effectuer des choix valables, les femmes doivent être soutenues par un effort coordonné et complet auquel contribueront toutes les parties de la société. Cette approche, comme nous l'apprennent les enseignements des autochtones, est essentiellement holistique.
Quelle est l'importance de ce principe
Les programmes holistiques et les occasions à multiples facettes qui soutiennent un environnement dans lequel les femmes trouvent le pouvoir, peuvent seulement être ériges sur un fondement de responsabilité parmi un large éventail de membres de la communauté. Présentement, parce que le mandat du Service correctionnel du Canada à l'égard des femmes incarcérées est défini par la loi, sa délégation au système correctionnel comporte souvent trop de restrictions.
Cependant, une conception étriquée de la responsabilité correctionnelle se répercute dans les choix de programmation et de facilités d'hébergement. Elle dérobe à la vue des planificateurs la diversité des communautés dont sont issues les femmes qui purgent une peine fédérale et la société élargie. Les choix sont limités à l'intérieur des systèmes correctionnels, les femmes ne reçoivent pas un traitement conforme à leur culture et trop souvent elles se voient refuser la possibilité d'exercer l'autodétermination qui leur permettra d'assumer la responsabilité de leurs vies.
Afin d'élaborer les systèmes de soutien et la continuité des services qui rendront les femmes en mesure d'assumer la responsabilité de leur vie, les femmes purgeant une peine fédérale doivent être intégrées dans leurs communautés. Pour atteindre ce but, il faut reconnaître et soutenir les responsabilités que les femmes purgeant une peine fédérale ont envers leurs enfants et les autres membres de leur famille. De plus, les bénévoles et les groupes communautaires peuvent être un lien vital pour les femmes entre les systèmes correctionnels et les communautés. En outre, tous les paliers de gouvernement, le monde des affaires, les groupes bénévoles et privés doivent accepter la responsabilité d'élaborer et d'implanter, de surveiller et d'évaluer les politiques correctionnelles.
Énoncé de principe général
Les membres du Groupe d'étude croient qu'à travers un engagement actif envers ces cinq principes, le Système correctionnel du Canada, en coopération avec un large éventail d'autres membres de la communauté, pourra créer les choix requis pour permettre de rapprocher les services correctionnels d'un idéal fondé sur la communauté. Cet idéal reconnaît et accepte de répondre avec bienveillance à la diversité des communautés au Canada, et aux besoins uniques des femmes purgeant une peine fédérale. Pour faire progresser cet idéal, le Groupe d'étude propose l'énoncé de principe suivant.
Le service correctionnel du Canada avec le soutien des communautés a la responsabilité de créer un environnement qui habilite les femmes purgeant une peine fédérale à faire des choix responsables et valables leur permettant de vivre dans la dignité et le respect.
Chapitre XI : La vision d'un changement : Une première étape dans la réalisation de notre objectif à long terme
Introduction
La mise en application de changements concrets qui donneraient de véritables choix aux femmes purgeant une peine fédérale est un défi de taille.
Les membres du Groupe d'étude ont longuement débattu la difficile question de savoir comment traduire leur objectif d'un changement social à long terme, brièvement décrit dans le chapitre précédent, en un appel impérieux à l'action. Car, tout au long du processus, ils ont été convaincus qu'un changement s'impose dès maintenant. Comment alors recommander des mesures immédiates qui n'entraveront pas les changements fondamentaux dont la nécessité est si évidente?
Les principes du changement affirmés dans le chapitre précédent trouvent leur meilleure expression dans un plan qui, tout en offrant des choix valables aux femmes dans l'immédiat, s'inscrit dans une perspective à long terme qui suscitera un changement fondamental dans la façon dont le système pénal traite les femmes qui ont eu des démêlés avec la justice.
Le Groupe d'étude est d'avis que le plan recommandé propose un schéma directeur pour que le changement se concrétise dans un proche avenir, et qu'il n'est pas incompatible avec la vision à long terme mais constitue plutôt un pas important vers ce changement fondamental.
La pierre de touche du plan recommandé
En élaborant le plan recommandé, le Groupe d'étude s'est posé un ensemble de questions qui lui ont servi de pierre de touche, c'est-à-dire de critère ou d'instrument d'évaluation pour s'assurer que les mesures proposées contribuaient réellement à la concrétisation de son objectif à long terme. Ces questions sont les suivantes :
- un éventail de choix ayant été posé comme l'un des principes moteurs du changement, tel programme, mesure ou orientation crée-t-il des choix pour les femmes qui purgent une peine fédérale
- jusqu'à quel point tel programme, mesure ou orientation reflète-t-il un service offert dans une perspective humanitaire par la collectivité, y compris les communautés autochtones et autres groupes ethniques
- telle mesure assure-t-elle que les femmes soient traitées avec respect et dignité? Donne-t-elle aux femmes le pouvoir d'assumer la responsabilité de leur vie
- st-ce que telle mesure «reflète la vérité et permet que la vérité soit entendue»"Footnote cxxxi
En revenant toujours à ces questions, le Groupe d'étude s'est bien rendu compte qu'aucun programme, aucun changement dans le milieu, ne pourrait à lui seul créer des choix fondés sur les principes qu'il avait énoncés. De toute évidence, un plan holistique s'avérait essentiel. Un programme en apparence sensé n'est pas sensé si le milieu dans lequel il est appliqué enlève aux femmes leur dignité et leur pouvoir. Un bel établissement perd sa beauté si le personnel qui y travaille ne respecte pas les femmes qui purgent leur peine.
Le plan recommandé vise à consolider les relations de collaboration entre l'État et les diverses collectivités. Il vise à traduire en mesures concrètes certains des principes enchâssés dans la mission du Service correctionnel du Canada. Il se bâtit sur l'adhésion aux principes d'égalité et de justice et sur le souci d'humanité qui existe dans la société, dans les organisations de services, au palier politique et dans le système correctionnel.
Pour donner suite à l'objectif collectif d'égalité, de justice et d'humanité, le Groupe d'étude a élaboré un plan holistique qui respecte les principes déjà posés de pouvoir, de choix valables, de respect et de dignité, d'environnement de soutien et de responsabilité partagée. Cependant, pour demeurer valable, ce plan doit être pris, évalué et mis en application dans son intégrité. Si on en isole des parties, si on en adopte ou en rejette certaines sans voir leurs relations essentielles à l'ensemble, on détruira l'intégrité du plan.
Pour cette raison, le Groupe d'étude vous demande de considérer le plan qui suit comme une seule et unique recommandation.
Le plan recommandé : Aperçu
Les établissements régionaux pour femmes
Le Service correctionnel du Canada administrera cinq établissements régionaux pour femmes, qui seront situés à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Montréal (Québec) (ou prés de ces villes), dans le centre ou le sud- ouest de l'Ontario, à Edmonton (Alberta) ou près de cette ville, et dans le sud-ouest de la Colombie- Britannique.Footnote cxxxii Ces Ces établissements logeront les femmes qui purgent une peine fédérale pour la partie de leur peine qu'elles doivent, selon la loi actuelle, purger dans un pénitencier.
La loge de guérison pour les autochtones
Une loge de guérison où les femmes autochtones pourront purger une partie ou la totalité de leur peine sera aménagé dans les Prairies. Les communautés autochtones rechercheront des emplacements, et le lieu retenu devra être acceptable tant pour elles que pour le Service correctionnel du Canada. Il est essentiel que cet établissement soit rattaché à une collectivité autochtone.
On fera appel à la compétence des femmes autochtones pour déterminer plus exactement ce que cet établissement doit être.
La stratégie de mise en liberté communautaire
On créera, dans diverses localités du pays, d'autres centres communautaires pour les femmes qui bénéficient d'une mise en liberté. On entend par centres communautaires les maisons de transition, les centres pour autochtones, les unités satellites, certains foyers privés, les centres de traitement de la toxicomanie et les centres polyvalents pour femmes.
Ces centres offriront toute une gamme de programmes et de services aux femmes qui n'ont plus besoin ou ne sont plus légalement tenues d'être gardées en milieu fermé.
Description détaillée : Les établissements régionaux pour femmes
Programme architectural
Ces installations nouveau genre exploiteront tous les éléments de l'environnement qui contribuent au bien- être, entre autres : lumière naturelle, bonne aération, couleur, espace, intimité et accès à de vastes terrains. Des pavillons ainsi que des maisons contenant des appartements privés y seront construits, et l'on y appliquera des mesures de sécurité sans intrusion.
Les cinq établissements régionaux pour femmes seront construits sur plusieurs acres de terrain et s'harmoniseront au paysage.
Les femmes qui purgent une peine fédérale logeront d'abord dans l'établissement de la région où leur condamnation et leur sentence ont été prononcées, mais elles pourront être transférées dans un autre établissement régional pour des raisons personnelles ou de programmes. Les autochtones pourront cependant choisir de se rendre directement à la loge de guérison.
Le bâtiment central
Un bâtiment central abritera les bureaux de l'administration et du personnel de même que les locaux réservés aux groupes de prisonnières. Des zones facilement transformables pourront être utilisées pour les programmes ou les activités sociales et récréatives en groupe. Un endroit sera réservé aux rassemblements à caractère spirituel.
Les espaces habitables
Les femmes habiteront dans de petites maisons dispersées sur le domaine. Les établissements régionaux n'auront pas tous la même grandeur, et le nombre de maisons variera avec le temps et d'un établissement à l'autre, pour les raisons suivantes : d'abord parce que la grandeur de l'établissement sera déterminée en fonction de la population régionale, et ensuite parce que là l'application de la stratégie communautaire devrait, avec le temps, réduire la nécessité d'un séjour en établissement de même que la durée de ces séjours.
De six à dix femmes habiteront dans chaque maison, et chacune y aura sa chambre. On trouvera dans chaque maison une salle de séjour, une salle pour l'étude et la détente, une cuisine, des salles de bain, une pièce réservée aux travaux d'entretien (couture, repassage, etc.) et un bureau pour le personnel. Une véranda ou un patio prolongeront la maison à l'extérieur; chaque maison aura sa cour, avec zone de jeu pour les enfants en visite, et un jardin.
Les besoins en personnel seront déterminés en fonction des besoins des femmes vivant dans chaque maison. Par exemple, là où des prisonnières qui purgent une peine de longue durée ont accepté leur situation et se sont installées dans une sorte de routine, on aura besoin de très peu de personnel et les mesures de sécurité seront minimes; par contre, dans les maisons réservées aux prisonnières qui sont perturbées ou agitées, on aura besoin de beaucoup de personnel et de soutien.
Certaines maisons seront affectées à un usage ou à un groupe particulier. Par exemple, l'une d'elles peut être réservée à un groupe de femmes qui luttent contre la toxicomanie; une autre à un groupe de femmes qui ont presque fini de purger leur peine et qui ont besoin de mener une vie assez indépendante avant leur mise en liberté; une autre encore aux autochtones qui ont décidé de ne pas habiter au loge de guérison mais qui souhaitent vivre conformément à leur spiritualité et à leurs traditions; une autre enfin peut être réservée aux prisonnières dangereuses ou à celles qui ont de grands besoins, et, dans ce cas, il faudra beaucoup de personnel, de soutien, de counseling et d'autres mesures de sécurité active. Chaque établissement décidera de l'affectation de chaque maison selon les besoins des femmes qui s'y trouvent à tel ou tel moment. La formule des maisons favorisera l'autonomie et le choix car ce sont les femmes elles- mêmes qui décideront de l'organisation des activités quotidiennes.
Le personnel
Tout le personnel des établissements régionaux pour femmes doit être sensible à la situation des femmes qui purgent une peine fédérale et réceptif à leurs besoins.
Des critères de recrutement détaillés permettront de choisir du personnel de formations et de milieux culturels divers. Quel que soit le poste occupé, tous les membres du personnel devront suivre une formation obligatoire mettant l'accent sur les domaines suivants : counseling, communication et négociation, sexisme, orientation sexuelle, racisme, traditions autochtones, spiritualité, pouvoir et classes sociales. Le personnel aura l'occasion de se tenir au courant de ce qui se fait dans les autres établissements régionaux et de profiter de cours et de stages de perfectionnement à l'extérieur.
Qu'il soit affecté aux programmes, à l'administration ou aux espaces habitables, le personnel de chaque établissement aura pour principales fonctions de favoriser les relations positives, de donner l'exemple et d'aider les femmes à acquérir le respect de soi et l'autonomie.
Le personnel aura de grandes responsabilités pour ce qui est de l'identification des problèmes, du soutien à apporter ainsi que de l'élaboration et de l'utilisation de techniques efficaces d'intervention auprès des femmes en difficulté.
Le pavillon d'évaluation
On encouragera chaque femme, le plus tôt possible au début de son séjour, à reconnaître l'illégalité de l'acte qu'elle a commis et à assumer la responsabilité de sa vie. Si elle est capable de faire face à la situation objectivement, elle participera à l'élaboration d'un plan personnel en vue d'acquérir les compétences, la force et la perspicacités nécessaires pour aller vivre dans un foyer communautaire le plus tôt possible.
Chaque femme aura son agent de soutien (qui fera partie du personnel de l'établissement), de même que son agent communautaireFootnote cxxxiii (une personne-ressource de l'extérieur choisie avec son accord). La femme collaborera avec ces deux personnesFootnote cxxxiv pour mettre au point son plan personnel, qui précisera ses besoins ainsi que les ressources offertes dans l'établissement et la collectivité.
Toute évaluation sera personnalisée et fondée sur des critères axés sur les besoins des femmes. La période d'évaluation permettra à chacune d'accepter la peine qu'elle doit purger, de s'occuper de ses urgents besoins physiques et psychologiques et de se remettre de tout traumatisme.
Pendant la phase d'évaluation et durant tout le séjour à l'établissement régional, l'agent communautaire veillera à ce que la femme entretienne des liens positifs avec sa famille et la collectivité et consolide ces liens en vue de sa mise en liberté.
L'agent de soutien et l'agent communautaire travailleront en équipe avec la femme afin que celle-ci puisse réaliser son plan personnel et, si nécessaire, l'adapter. Les deux agents devront, au besoin ou sur demande de la femme, aller chercher des spécialistes de l'extérieur et les faire participer au processus.
L'évaluation pourra durer plusieurs mois, selon la situation de chaque femme. Quand la femme aura déterminé ses besoins, qu'elle aura élaboré et approuvé son plan personnel et qu'elle sera prête à le mettre en application, elle ira s'installer dans une autre maison ou au loge de guérison pour les autochtones (à moins qu'elle ne soit déjà dans cet établissement depuis le début de sa peine)Footnote cxxxv.
Programmes
Les programmes occuperont une place importante dans tous les établissements. Leur élaboration et l'incitation à y participer se feront suivant une approche holistique. Le conseil consultatif régionalFootnote cxxxvi veillera à ce que les programmes répondent aux besoins et aux désirs exprimés par les femmes, individuellement et collectivement. Les programmes seront offerts, en grande partie, par des groupes ou organismes communautaires ou par les autorités provinciales concernées. Si on peut trouver un programme ou un service de bonne qualité dans la collectivité, et que l'uniformité et la continuité peuvent être assurées, l'établissement ne devrait pas faire double emploi. Par exemple, il s'adressera le plus possible aux commissions scolaires, universités et collèges communautaires locaux pour les programmes d'enseignement, et aux médecins, dentistes, guérisseurs et autres professionnels de la santé pour les soins de santé. Néanmoins, il serait sans doute préférable que certains services, comme le counseling d'urgence, soient assurés par les agents de soutien de l'établissement, qui connaîtront bien chaque femme et pourront être appelés à intervenir vingt-quatre heures par jour.
Chaque établissement offrira des programmes en fonction des besoins, mais on peut s'attendre à ce que les programmes suivants soient nécessaires, en permanence, dans tous les établissements.
Counseling individuel et en groupe
On offrira des séances de counseling individuel ou en groupe aux femmes qui, en préparant leur plan personnel ou plus tard pendant leur séjour, auront noté certaines expériences personnelles dont elles aimeraient parler. Il est probable qu'on formera ainsi des groupes qui discuteront d'inceste, de violence familiale, d'intégration au milieu, de réduction du stress et de relaxation. Des séances privées et confidentielles de counseling seront également offertes, sur rendez-vous et en cas d'urgence.
Ce sont surtout des particuliers ou des groupes de l'extérieur, spécialisés dans le domaine en question, gui s'occuperont du counseling. Pour assurer la continuité, l'agent communautaire veillera à ce que les programmes soient aussi offerts aux femmes après leur mise en liberté.
Soins de santé
Les femmes pourront, à leur choix, consulter des professionnels de la santé de l'extérieur ou se rendre dans une clinique pour femmes. Ces personnes ou cliniques ne seront liées par contrat au Service correctionnel du Canada qu'en ce qui a trait au paiement des services et devront respecter les normes communautaires en matière d'excellence et de confidentialité.
Les femmes obtiendront une permission de sortir, avec ou sans surveillance, pour rencontrer un médecin. C'est seulement dans les cas où les sorties sont impossibles que le médecin choisi pourra se rendre à l'établissement.
On ne prendra aucune mesure punitive envers les femmes que la maladie empêche de travailler ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes; on leur accordera plutôt un congé et la permission de demeurer dans leur maison pour se rétablir. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la femme sera transférée dans un hôpital de la région si l'hospitalisation s'impose. Les mêmes règles s'appliqueront pour les femmes qui se sont elles-mêmes infligées des blessures ou qui ont des comportements autodestructeurs. En aucun cas, l'état pathologique ne donnera lieu à des sanctions disciplinaires.
Services de santé mentale
Des soins prolongés et des soins d'urgence en santé mentale seront offerts par une équipe multidisciplinaire composée de psychologues, de psychiatres, de thérapeutes de formations diverses et de guérisseurs. Ces personnes assureront, par contrat avec le Service correctionnel du Canada, des services de thérapie, de counseling et de traitement individuel ou de groupe, d'intervention d'urgence et de formation ainsi que divers autres services. Tous ces services de santé mentale devront respecter les normes communautaires en ce qui a trait à la confidentialité et à la qualité.
On reconnaîtra que les femmes qui sont troublées ou agitées ont besoin d'un milieu stable et familier, en leur permettant de rester dans leur maison pour y recevoir le soutien et les soins psychiatriques nécessaires.
Les psychotiques et celles qui doivent être internées seront transférées dans un centre provincial de santé mentale ou un hôpital psychiatrique, de sorte qu'elles pourront recevoir des soins comparables à ceux qui sont offerts au reste de la population. L'équipe multidisciplinaire mentionnée précédemment travaillera en étroite collaboration avec ce centre ou cet hôpital, afin de s'assurer que les femmes reçoivent de bons soins et que le personnel comprend leurs besoins particuliers et y répond.
Programmes de lutte contre la toxicomanie
Chaque établissement offrira des programmes de lutte contre la toxicomanie. Ces programmes seront suffisamment variés pour répondre aux divers types d'assuétude et proposer plusieurs méthodes thérapeutiques. En particulier, on reconnaîtra que l'accoutumance à une substance toxique est souvent une réaction à des expériences personnelles non résolues. Il est essentiel que, pour les femmes autochtones, toute approche soit holistique et comporte notamment l'enseignement de la spiritualité et des traditions autochtones.
On pourra réserver une maison aux femmes qui ont décidé, dans leur plan personnel, de s'attaquer d'abord et avant tout à cette dépendance; on créerait ainsi un milieu propice tant au règlement des problèmes qui sont à la source de la toxicomanie qu'à la lutte contre l'accoutumance elle-même.
Visites des familles
On construira, dans chaque établissement régional, un pavillon pour les visiteurs, qui comprendra une zone transformable ou plusieurs zones habitables de superficies différentes. Chaque femme pourra y passer du temps avec les membres de sa famille et ceux et celles qui sont considérés comme de précieux amis personnels. Une femme qui, par exemple, suit à plein temps un cours de formation professionnelle pourra choisir de passer une semaine ou deux, pendant ses vacances annuelles, avec sa famille et ses amis au pavillon des visiteurs. Une autre pourra décider d'accueillir sa famille pendant un certain temps pour célébrer un événement spécial.
Relations avec les enfants
L'aspect le plus important de ce programme, c'est la possibilité pour les mères de vivre avec leurs enfants, selon les droits et besoins des enfants, des mères et des autres personnes importantes de leur entourage. Chaque établissement régional doit créer un milieu convenable pour que les enfants puissent habiter avec leur mère, et ce, soit dans sa maison, soit au pavillon des visiteurs.
Toute femme qui a déterminé, dans son-plan personnel, qu'elle devait assurer une présence suivie auprès de ses enfants aura accès à divers programmes, notamment : le rôle de parent, comment être parent malgré l'éloignement, techniques de communication, et développement de l'enfant.
Si les enfants doivent être placés en foyer nourricier parce que leur mère a été incarcérée, l'agent communautaire négociera avec l'organisme approprié de protection de l'enfance pour trouver des foyers nourriciers près de l'établissement, de façon à ce que les visites puissent être fréquentes.
Si les enfants sont confiés à des membres de la famille ou à des proches pendant la période d'incarcération de leur mère, le Service correctionnel du Canada fournira l'argent nécessaire pour que ceux-ci puissent amener les enfants voire leur mère régulièrement et pour des périodes de durée variable. Si les enfants sont assez vieux pour voyager seuls, le Service correctionnel du Canada fournira l'argent nécessaire pour qu'ils puissent rendre visite à leur mère et passer régulièrement du temps avec elle.
Spiritualité et religion
Chaque établissement régional veillera à ce que toutes les femmes puissent choisir leur expression spirituelle et obtenir les ressources spirituelles et religieuses dont elles ont besoin, en garantissant auprès d'elles la présence d'un guide spirituel. Ce guide sera une personne dévouée et empathique mais ne sera pas nécessairement un prêtre. Il aidera les femmes à combler leurs besoins spirituels et tentera de répondre à «toute la personne» en tenant compte du fait que certains besoins ou problèmes auxiliaires, concernant par exemple le travail, l'intégration au milieu ou la façon de venir à bout des difficultés, peuvent avoir des effets sur l'équilibre et le développement spirituels de l'individu. En choisissant le guide spirituel, on sera sensible au fait que les femmes traumatisées par l'abus sexuel ou la violence physique qu'elles ont subie ont souvent de la difficulté à établir des relations de confiance avec les hommes et ont besoin d'une personne-ressource avec qui elles peuvent se sentir à l'aise pour explorer leur spiritualité.
Le guide spirituel cherchera à établir des relations de confiance avec chaque femme et, si celle-ci le demande, s'adressera à des conseillers religieux ou spirituels de l'extérieur qui pourront l'aider à explorer sa spiritualité ou à pratiquer sa religion.
On trouvera aussi dans chaque établissement des ressources physiques qui favoriseront l'expression spirituelle. Des «lieux de recueillement» seront réservés à la prière et à la méditation. Les femmes pourront se procurer de la musique et des vidéos à caractère spirituel et universel. Des documents sur l'agression sexuelle, l'inceste, la violence envers l'épouse et d'autres questions connexes pourront être présentés, et ces questions pourront être discutées avec le guide spirituel ou des personnes-ressources de l'extérieur. De plus, des services à la chapelle et des séances plénières permettront de discuter de spiritualité.
Tout le personnel de l'établissement suivra des séances d'information et de sensibilisation. Ces séances viseront à faire reconnaître l'importance de la dimension spirituelle dans l'acquisition du pouvoir et de la responsabilité et à renseigner sur les programmes et services qui peuvent répondre aux besoins spirituels des femmes. Par des choix qui donnent vie à la croissance spirituelle, les femmes seront encouragées à cultiver le respect mutuel et à être sensibles aux besoins et aux droits d'autrui.
Programmes pour les autochtones
Chaque établissement régional pour femmes offrira et permettra d'offrir des programmes et des services aux autochtones. Mentionnons notamment les visites libres des Aînés, les zones extérieures et intérieures réservées aux cérémonies et aux rassemblements, et les cases de suerie.
Des programmes d'études autochtones pourront être offerts, sous contrat, par des collectivités ou des organisations autochtones. Tout le personnel, dont certains membres seront autochtones, devra être sensible à la spiritualité et aux priorités culturelles des prisonnières autochtones.
Études
Quel que soit leur niveau de scolarité, toutes les femmes, de tous les établissements, pourront suivre des cours. Diverses stratégies pédagogiques seront appliquées pour l'enseignement élémentaire de la lecture et de l'écriture.
Pour aider chaque femme à atteindre le niveau d'instruction qu'elle souhaite, un établissement d'enseignement offrira des cours pour adultes à tous les niveaux jusqu'à la 12e année.
Des cours de niveau post-secondaire, collégial ou universitaire seront offerts aux femmes qui le demandent, et l'on facilitera le plus possible leur participation.
Formation professionnelle
Chaque établissement régional pour femmes appliquera un programme de formation professionnelle. Ce programme sera élaboré par le conseil consultatif régional, de concert avec les entreprises locales partout où c'est possible, et assurera la formation professionnelle des femmes tant dans l'établissement qu'à l'extérieur.
On mettra sur pied une entreprise où les femmes pourront occuper divers emplois, notamment dans les domaines de la fabrication, de la mise en marché, de la gestion des affaires, du travail de bureau et de l'administration. Les femmes y postuleront un emploi; si elles sont acceptées, elles commenceront un stage, et si elles sont refusées, elles chercheront à acquérir les connaissances ou l'instruction nécessaires pour cet emploi avant de poser de nouveau leur candidature.
Les programmes de formation professionnelle devront recréer le plus possible un milieu de travail normal, avec les normes et indemnités qui s'y rattachent.
Les femmes qui purgent une peine de longue durée auront la possibilité de gravir les échelons jusqu'aux postes de surveillante ou d'instructrice et, ce faisant, pourront occuper des emplois utiles et de longue durée.
D'autres postes correspondant à ceux qu'on peut vraisemblablement trouver à l'extérieur, notamment des postes administratifs et d'autres emplois spécialisés, seront confiés, dans l'établissement, aux prisonnières qui possèdent les qualités requises.
Loisirs
Chaque établissement mettra l'accent sur l'exercice physique et embauchera du personnel gui encouragera les femmes à la participation. Des espaces en plein air et à l'intérieur seront réservés aux activités d'équipe, de groupe et individuelles. Là où l'aménagement d'installations de loisirs coûterait trop cher, on permettra aux femmes de sortir pour se rendre aux installations communautaires.
On trouvera également dans chaque établissement des zones réservées aux loisirs à l'intérieur (par exemple, ateliers, salles d'ordinateurs, studios d'artisanat et bibliothèques).
Participation des bénévoles
On encouragera les groupes communautaires locaux à faciliter la participation des bénévoles au plus grand nombre possible de programmes dans les établissements régionaux, et on leur versera de l'argent à cette fin. On incitera également les groupes locaux de femmes à recruter des bénévoles. En ce domaine, le financement sera essentiel à la réussite, en particulier pour faciliter la participation du plus grand nombre, susciter un sentiment de responsabilité communautaire à l'égard de l'établissement et mettre les femmes en contact avec des gens de l'extérieur au moment de leur mise en liberté.
A ces nombreux avantages s'ajoute le fait que la participation communautaire apporterait une variété sociale et intellectuelle aux femmes qui purgent une peine de longue durée.
La loge de guérison pour les autochtones
La présente section du plan recommandé a été conçue de concert avec les membres autochtones du Groupe d'étude. D'autres changements pourront être apportés par suite des consultations avec les collectivités autochtones pendant la mise en application des mesures recommandées dans le rapport.
Une loge de guérison sera construite dans les Prairies. Ce sont les collectivités autochtones qui rechercheront les emplacements possibles, et non le Service correctionnel du Canada. Le lieu choisi devra être acceptable tant pour elles que pour le Service correctionnel. Il est essentiel que cet établissement soit rattaché à une collectivité autochtone. Pour déterminer plus exactement ce qu'il doit être, on fera appel à la compétence des femmes autochtones, qui transmettront leurs propositions au Service correctionnel du Canada par l'intermédiaire d'un conseil consultatif formé à cette fin. La responsabilité générale des programmes pour les femmes autochtones sera confiée au Conseil des Aînés de chaque région.
Voici les principes selon lesquels la loge de guérison sera conçue :
- un endroit sûr pour les prisonnières autochtones;
- une attitude bienveillante à l'égard de soi, de la famille et de la collectivité:
- la confiance dans la planification individualisée et personnalisée;
- la compréhension des aspects transitoires de la vie pour les autochtones;
- l'appréciation du rôle guérisseur des enfants, qui sont plus près du monde spirituel;
- la fierté d'avoir survécu à un passé et à des expériences difficiles.
Programme architectural
L'établissement, qui s'harmonisera au milieu naturel environnant, se remarquera par sa structure circulaire. Il comprendra une salle de réunion centrale et circulaire, où se tiendront les cérémonies, les enseignements, les ateliers avec les Aînés, etc.; un appartement que pourront occuper tour à tour les Aînés, les enseignants et les guérisseurs qui joueront un rôle important dans les activités; et une garderie qui permettra aux femmes d'être avec leurs enfants.
Au chapitre du logement, mentionnons une zone de séjour commune, des unités familiales et la possibilité de vivre près de la terre.
Évaluation et plan de traitement de cas
Toutes les femmes autochtones qui purgent une peine fédérale pourront choisir de purger leur peine au loge de guérison. Elles seront informées de cette possibilité par une agente communautaire, soit pendant la période de détermination de leur peine, avant leur transfert sous responsabilité fédérale, soit après le prononcé de leur peine, a l'établissement régional pour femmes. On reconnaît que certaines femmes décideront de ne pas purger leur peine au loge de guérison, alors que d'autres choisiront d'y purger une partie ou la totalité de leur peine. C'est pourquoi il faudra prévoir des transfèrements entre le loge de guérison et les établissements régionaux.
L'évaluation sera faite à l'établissement de ressourcement, en étroite participation avec les femmes, en fonction des besoins de chacune et d'une manière pertinente pour les autochtones.
Les Aînés
La participation des Aînés et autres enseignants et guérisseurs sera essentielle au bon fonctionnement de la loge de guérison. Au moins un Aîné sera présent à plein temps, mais ce ne sera pas toujours la même personne. En effet, la rotation à ce poste permettrait de répondre aux besoins des femmes des diverses nations, et des quatre directions, et assurerait toute une gamme de services spirituels (par exemple chaman, «femme-médecine»). On reconnaîtra l'apport des conseillers spirituels au processus de guérison, ces conseillers pouvant parfois être des femmes qui purgent elles-mêmes une peine.
Programmes
Les programmes seront offerts dans une perspective holistique pour répondre aux besoins des femmes autochtones qui purgent une peine fédérale et, surtout, à la nécessité de se pencher sur les questions ayant trait à la santé, à la violence sexuelle, physique et émotive, aux relations et à l'accoutumance aux substances toxiques. Un programme d'extension facilitera la transition vers «la marche dans la nouvelle forêt»Footnote cxxxvii en offrant une formation préparatoire à la mise en liberté communautaire dans les domaines des études, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'intégration au milieu. Cette composante du programme assurera également un lien avec la collectivité autochtone, de même qu'avec un satellite urbain de l'établissement, où logeront les femmes au moment de leur mise en liberté surveillée. Les femmes pourront rester en contact avec leurs enfants, seront en présence de modèles positifs et pourront partager les expériences de vie du personnel et d'autres femmes qui les aideront dans leur rôle de parent.
Au moins une agente communautaire travaillera au programme d'extension et sera chargée d'établir des liens avec les femmes autochtones à leur entrée dans le système correctionnel et à leur sortie de ce système.
Administration et personnel
Dans toute la mesure du possible, le loge de guérison sera administré selon un modèle non hiérarchique. La personne chargée de la coordination devra rendre compte de certaines questions aux représentants du Service correctionnel du Canada. Cependant, elle devra aussi assurer la liaison avec le Conseil des Aînés, la collectivité autochtone et les femmes et travailler avec eux. Ces relations ne seront pas déterminées par une structure hiérarchique fixe, mais seront plutôt fondées sur le partage du savoir et l'échange des apprentissages.
Le personnel du centre sera composé d'autochtones que l'on recrutera surtout en fonction de leur expérience de vie et de leur capacité d'être un modèle positif pour les femmes qui purgent leur peine. Il y aura placé pour certains spécialistes, mais ceux-ci rempliront une fonction de soutien plutôt qu'une fonction de direction. On pourra de temps à autre recruter du personnel non autochtone ayant certaines connaissances ou compétences spéciales, également à des fonctions de soutien. Toutes les personnes travaillant à l'établissement, à tous les niveaux, devront pouvoir être un exemple vivant de ce qu'elles enseignent.
La stratégie de mise en liberté communautaire
Élaboration d'un plan personnel
Comme nous l'avons mentionné à la section sur le pavillon d'évaluation, chaque femme préparera, dès son admission et avec l'aide de son agent de soutien et de son agent communautaire, un plan personnel axé sur sa mise en liberté le plus tôt possible. On présumera qu'elle sera libérée le jour de son admissibilité à une semi-liberté. Au fur et à mesure que cette date se rapprochera, on évaluera le plan, on l'ajustera si nécessaire et on prévoira les ressources communautaires dont elle aura besoin au moment de sa mise en liberté. Ce plan personnel sera présenté à la Commission nationale des libérations conditionnelles qui, si c'est possible, lui donnera son approbation de principe avant la date d'admissibilité.
L'agent communautaire
L'agent communautaire sera un lien essentiel entre la femme et la collectivité. Elle aidera la femme à rester en contact avec sa famille, ses amis et son conjoint, et à obtenir les ressources dont elle a besoin. L'agent communautaire agit en qualité d'intermédiaire entre la femme et les organismes communautaires, les personnes-ressources de l'extérieur et le Service correctionnel du Canada. Avec la femme et son agent de soutien, elle forme une équipe à l'établissement régional. Une fois la femme mise en liberté, l'agent communautaire devient membre de l'équipe de soutien communautaire.
Le soutien communautaire
L'équipe de soutien communautaire sera composée de la femme, d'une représentante d'un groupe communautaire, de l'agent communautaire, de l'agent chargé de la mise en liberté et de toute autre personne dont la femme a besoin (Aîné, psychiatre, personnel des services de garde, etc.). L'agent chargé de la mise en liberté s'occupe de la surveillance, comme il en a le mandat, tandis que l'ensemble de l'équipe de soutien veille à ce que la femme reçoive les services prévus à son plan personnel et l'aide activement dans ses démarches auprès des organismes de ressources. Les membres de l'équipe de soutien doivent être capables de s'adapter pour tenir compte des besoins et préférences de chaque femme et de la durée de la peine; par exemple, quand la femme est autochtone, l'équipe de soutien communautaire doit comprendre le plus d'autochtones possible.
Conseils consultatifs régionaux
Des conseils consultatifs régionaux, rattachés à chaque établissement régional pour femmes, conseilleront le Service correctionnel du Canada sur les programmes et services, tant dans l'établissement qu'à l'extérieur.
Ces conseils évalueront les programmes, noteront les lacunes être commanderont la prestation de programmes ou de services supplémentaires. Ils veilleront aussi à ce qu'il y ait continuité des programmes entre l'établissement et l'extérieur et feront des recommandations pour améliorer la situation.
Les conseils consultatifs régionaux commanderont régulièrement des analyses des besoins dans diverses localités, tant en ce qui a trait aux femmes qui purgent une peine fédérale qu'à l'ensemble des femmes. Ces analyses permettront de savoir si les services en place répondent toujours aux besoins et de déterminer les nouveaux services à offrir. S'il faut offrir de nouveaux services, les conseils devront en élaborer le plan en collaboration avec tous les paliers de gouvernement et les collectivités elles-mêmes.
Enfin, les conseils joueront un rôle éducatif dans les collectivités locales, de façon à ce que les établissements régionaux pour femmes et les femmes qui en sont libérées soient considérées comme une partie intégrante et une responsabilité de la collectivité.
Centres communautaires pour les femmes bénéficiant d'une mise en liberté
Les groupes communautaires et d'autres organismes intéressés pourront fonder divers centres pour les femmes qui bénéficient d'une mise en liberté, centres dont l'emplacement, la structure et les services reflèteront les besoins de leur clientèle. Chaque centre devra favoriser la croissance, une vie saine et l'acquisition du respect de soi et de l'autonomie. Les différences culturelles y seront respectées. On mettra l'accent sur le choix personnel, en poursuivant l'objectif global de vivre avec dignité et respect de soi dans la société.
Durant son séjour dans un centre communautaire, chaque femme continuera à travailler à son plan personnel en se prévalant des programmes et services offerts dans la collectivité. La structure et l'effectif de chaque centre, de même que le nombre de programmes offerts, varieront selon les besoins des femmes qui y habitent.
Étant donné le manque d'information sur les femmes qui purgent une peine fédérale dans la collectivité, ce qui suit n'est pas une liste exhaustive des centres communautaires qui pourraient être créés pour les femmes bénéficiant d'une mise en liberté, mais plutôt un ensemble de propositions à étudier de plus près.
Maisons de transition
On ouvrira des maisons de transition pour femmes un peu partout au Canada en fonction des besoins régionaux. On en trouvera au moins dans les endroits suivants : Halifax, Terre-Neuve, Montréal et au moins une autre localité du Québec, le nord de l'Ontario, le centre ou le sud-ouest de l'Ontario, Winnipeg, la Saskatchewan, Edmonton, Calgary, Vancouver et le nord de la Colombie-Britannique. Le nombre de places dans ces maisons sera déterminé en fonction de la population de l'endroit et du nombre de places dans l'établissement régional pour femmes le plus proche. Ces maisons seront administrées par des organismes communautaires sous contrat avec le Service correctionnel du Canada.
Les femmes pourront habiter dans des maisons de transition, quelles que soient les conditions dont leur liberté est assortie. Dans certaines de ces maisons, elles pourront vivre avec leurs enfants.
Centres pour autochtones
Ces centres seront situés dans les régions où, selon les groupes et collectivités autochtones, on en a besoin. Certains seront vraisemblablement situés dans les Prairies ou dans les territoires. Ces centres seront mis sur pied et administrés par des groupes ou collectivités autochtones sous contrat avec le Service correctionnel du Canada; les femmes autochtones pourront y habiter quelles que soient les conditions de leur mise en liberté (y compris les programmes spéciaux).
Il est probable que le loge de guérison pour autochtones subventionnera des centres de deuxième étape et des unités satellites pour les femmes autochtones.
Unités satellites
Les unités satellites prendront diverses formes, par exemple, des appartements privés pour des femmes qui sont encore en liberté communautaire mais capables de beaucoup d'autonomie. Chaque unité sera reliée à un centre communautaire, afin que les femmes puissent avoir l'aide et l'encadrement dont elles ont besoin. Les unités satellites seront situées selon les besoins, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.
Foyers privés
Les femmes en liberté communautaire auxquelles la vie en groupe ne convient pas pourront, dans certains cas, être placées dans des foyers privés. On estime que cette formule donnera l'encadrement et l'aide nécessaires à celles qui ont des besoins particuliers, par exemple celles qui sont handicapées ou proviennent de localités lointaines.
Centres de traitement de la toxicomanie
On ouvrira des centres spécialisés et résidentiels de traitement pour la toxicomanie qui proposeront diverses approches pour lutter contre l'accoutumance à une substance toxique. Certains seront vraisemblablement destinés aux femmes seulement, d'autres aux autochtones et d'autres seront plus conventionnels. Les femmes qui désirent poursuivre le traitement qu'elles ont commencé à l'établissement régional ou à la loge de guérison pourront y séjourner temporairement.
Ces centres de traitement seront eux aussi diriges par des organismes ou des groupes communautaires sous contrat avec le Service correctionnel du Canada; on prévoit cependant qu'ils signeront aussi des contrats avec les services correctionnels provinciaux et d'autres organismes gouvernementaux semblables pour offrir des services à divers autres groupes de femmes.
Centres polyvalents pour femmes
L'aménagement de tels centres est fondé sur le fait que les femmes qui purgent une peine fédérale ont beaucoup en commun avec les femmes qui n'ont pas de démêlés avec la justice. Par exemple, celles qui souhaitent discuter de violence familiale choisiront peut-être d'être placées dans un centre où l'on traite de violence familiale dans la collectivité. Ces placements feront l'objet de contrats distincts, selon les besoins.
Logements regroupés
Les femmes qui purgent une peine fédérale pourront habiter avec d'autres groupes de personnes qui n'ont pas de démêlés avec la justice. Par exemple, on pourrait loger dans une même maison des femmes en liberté communautaire et des étudiants qui paieraient un loyer minime. Ce genre de regroupement permettrait à tous de profiter d'un milieu unique et propice à la croissance et au développement.
Centres pour mères et enfants
Des logements spéciaux pourraient être aménagés à l'intention des femmes qui veulent rétablir ou maintenir le contact avec leurs enfants. Des services de soutien destinés à favoriser les bonnes relations mères-enfants permettraient aux femmes d'assumer de nouveau leurs responsabilités familiales tout en purgeant une partie de leur peine dans la collectivité.
Chapitre XII : Que la vision devienne réalité
Stratégie de mise en oeuvre
La vision du changement intégrée dans le plan d'ensemble constitue une démarche en vue de répondre aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale au Canada. Elle représente une dérogation par rapport aux services correctionnels traditionnels sur un certain nombre de fronts, mais elle propose une démarche réaliste et applicable pour solutionner les problèmes de longue date auxquels fait face ce groupe de femmes. Le plan est conforme à la Mission du Service correctionnel du Canada et reflète les préoccupations et les perspectives d'une variété de groupes communautaires et autochtones.
Afin de mettre ce plan en oeuvre, le Service correctionnel du Canada doit garder à l'esprit le fait que tous les éléments du plan requièrent une action immédiate. Bien que le Groupe d'étude, sous pli séparé, ait proposé un certain nombre de recommandations visant des changements immédiats à apporter à la Prison des femmes, il est clair que ces mesures à très court terme devront être mises en oeuvre conjointement et parallèlement aux activités recommandées par le plan. Une action immédiate ne doit pas se substituer à la mise en oeuvre des recommandations du plan ni les retarder. Il est également d'une importance capitale de ne pas perdre de vue les principes, les prémisses et l'esprit sur lesquels s'appuie le plan au moment de le rendre opérationnel.
Afin d'atteindre ces objectifs, le Groupe d'étude recommande au commissaire de former un comité de mise en oeuvre composé de personnes de l'extérieur qui relèveraient directement de son autorité pour ce qui est de cette initiative importante. Ce comité doit être restreint afin d'être maniable et orienté vers l'action. Il doit comprendre une femme purgeant une peine fédérale de même que des représentants de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, d'un groupe de femmes autochtones et de Condition féminine Canada.
De plus, le Groupe d'étude recommande la création d'un conseil consultatif autochtone relevant du commissaire pour aider à la mise sur pied de la loge de guérison. Ce conseil consultatif, composé de femmes autochtones provenant de la communauté, devra établir aussi un lien avec les communautés autochtones qui doivent faire preuve de leadership.
En outre, on recommande que le Service correctionnel du Canada crée un poste de niveau très élevé aux seules fins de mise en oeuvre du plan. On devra lui affecter les ressources appropriées puisque les délais de mise en oeuvre exigent une action parallèle sur tous les plans, de la conception de l'établissement en passant par la politique de dotation en personnel, jusqu'à l'élaboration des programmes.
Grâce à ces trois recommandations, le Service correctionnel du Canada peut manifester de manière concrète et engagée son intention d'agir globalement et rapidement.
En ce qui concerne l'échéancier, le Groupe d'étude recommande les dates cibles suivantes, qui devront être détaillées dans la planification de la mise en oeuvre :
- que la planification et la construction des établissements régionaux pour les femmes soient complétées au cours de l'exercice 1993 à 1994. Cela présuppose que le Service correctionnel du Canada soumette le plan a l'approbation du Conseil du Trésor pour le budget d'immobilisations de l'automne 1990.
- qu'en ce qui a trait à la question de logements communautaires, la date visée pour l'ouverture de quelques nouveaux établissements résidentiels pour femmes soit l'exercice financier 1991 à 1992. Les prévisions à cet effet doivent donc être incluses dans le prochain budget que le Service correctionnel du Canada présentera au Conseil du Trésor.
Le projet de la loge de guérison pour les Autochtones devra comporter son propre échéancier car il s'agit d'un nouveau concept pour le Service correctionnel du Canada. Sa mise en oeuvre exige des consultations et des négociations considérables avec les communautés autochtones.
Les approbations financières pour la loge de guérison doivent être obtenues en même temps que celles du plan d'hébergement s'appliquant aux établissements régionaux à cause de son importance dans le plan d’ ensemble.
En conclusion, les membres du Groupe d'étude privilégient, pour la mise en oeuvre, une démarche holistique, axée sur l'action et qui reflète le partenariat qui a été à l'origine de cette vision.
Conclusion
"C'est MAINTENANT le temps d'AGIR!" Voilà le cri de ralliement des membres du Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale. La conviction qu'un changement fondamental dans notre façon de traiter les femmes purgeant une peine fédérale est nécessaire maintenant, et qu'il est finalement possible, a stimulé les membres du Groupe d'étude, leur permettant de créer une vision qui offre un nouvel espoir.
Cette vision créatrice est fondée sur des voix de femmes. Les femmes qui purgent des peines fédérales et qui ont parlé de leur expérience, et toutes les autres qui proviennent de collectivités des quatre coins du Canada et qui ont rédigé des mémoires et parlé aux membres du Groupe d'étude, ont souligné avec éloquence la nécessité de mieux comprendre la vie, les crimes, la douleur, les besoins et les espoirs des femmes dont il est question ici. Elles ont préconisé une approche davantage conçue pour les femmes. Elles ont parlé de nouvelles solutions fondées sur des choix judicieux. Elles ont parlé d'une responsabilité commune entre les gouvernements, les femmes purgeant une peine fédérale et la collectivité, à la fois à l'égard des torts causés du fait des crimes commis par ces femmes, et pour la recherche de moyens de prévention afin de réduire les souffrances.
Beaucoup s'impatientent de tant de temps, d'argent et d'énergie consacrés à la recherche de solutions dans le passé, et de si peu de progrès vers le changement. Une bonne partie des informations recueillies par le Groupe d'étude a consisté en une reprise ou une amplification de faits et de révélations provenant d'études, de commissions et de groupes de travail antérieurs… d'idées qui n'ont jamais vraiment et complètement été réalisées.
Toutefois, notre Groupe d'étude est unique parce que, après avoir recueilli les constatations faites antérieurement et les nouvelles perspectives, il les a dépassées. Ä travers les travaux, parfois encourageants et parfois difficiles, du Groupe d'étude, à travers les efforts faits pour écouter vraiment les points de vue et les exigences divers et même contradictoires, par un retour constant aux voix des femmes purgeant une peine fédérale, nous avons dépassé le stade de la confusion et de l'impuissance pour en arriver à des solutions holistiques, créatrices et dynamiques. Nous avons conçu une solution nouvelle fondée sur le choix.
Le rapport du Groupe de travail repose sur les principes du pouvoir, de meilleures possibilités, du respect et de la dignité, d'une responsabilité commune et de la confiance en un milieu favorable. Il reconnait que, en créant des choix, nous ne devons jamais oublier de respecter la dignité, les droits, les besoins et les espoirs des femmes. Il est fondé sur l'acceptation de la responsabilité par les femmes, par le système judiciaire, par les gouvernements et par les collectivités. Mais, si ce sens de la responsabilité comprend le besoin de reconnaître et de réparer le tort causé par les femmes purgeant une peine fédérale, il replace ces incidents dans le contexte des inégalités et des structures sociales qui définissent le crime et y conduisent.
Le plan présenté par le Groupe d'étude permet, enfin, de fermer la Prison des femmes et de rapprocher les femmes de leurs familles, de leurs cultures et de leurs collectivités.
Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté collective de mettre à exécution ce plan. Ce qu'il faut maintenant, c'est le courage de dire la vérité. Ce qu'il faut maintenant, c'est la création de partenariats tournés vers l'action pour profiter du consensus grandissant sur la nécessité d'un changement fondamental.
C'est MAINTENANT le temps d'AGIR! Nous ne devons pas transiger sur notre vision commune. Nous ne devons pas décevoir les femmes purgeant une peine fédérale… UNE AUTRE FOIS!
Liste de documentation
Document connexe # 1
Sugar, Fran, et Fox, Lana, "Sondage auprès des femmes autochtones purgeant une peine fédérale dans la collectivité", préparée au nom de l'Association des femmes autochtones du Canada à l'intention du Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale, Ottawa, Canada, le 15 janvier 1990
Document connexe # 2
Shaw, Margaret, et coll., "Sondage auprès des femmes purgeant une peine fédérale", préparée par l'entreprise pour le ministère du Solliciteur général, Ottawa, Canada
Document connexe # 3
Shaw, Margaret, "Les femmes incarcérées sous responsabilité. fédérale - Rapport d'une étude préliminaire", Ottawa, Canada, juin 1989
Document connexe # 4
Axon, Lee, "Programmes modèles pour les détenues - Examen de la situation internationale", préparés par l'entreprise pour le ministère du Solliciteur général, Ottawa, Canada, septembre 1989
Document connexe # 5
Evans, Maureen, "Un examen des programmes réalisés en établissement à l'intention des femmes purgeant une peine fédérale", préparé pour le Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine fédérale, Ottawa, décembre 1989