Étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto : Plan scientifique

Téléchargez le format alternative
(Format PDF, 1,6 Mo, 101 pages)
Résumé
L’Étude sur la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (ÉPAHT) est une étude scientifique intégrée sur la qualité de l’air en milieu urbain. Elle est dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et comprend des partenaires d’étude, des clients et des intervenants d’organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux et de plusieurs universités.
ÉPAHT vise à faire progresser notre compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés dans la compréhension et la gestion de la qualité de l’air au cours des dernières décennies, les niveaux de certains polluants n’ont pas diminué comme prévu. En outre, le mélange de polluants auquel nous sommes exposés simultanément est une préoccupation croissante. Le moment choisi pour l’ÉPAHT permet de mettre l’accent sur les conditions relativement peu étudiées qui sont présentes pendant l’hiver, et celles-ci diffèrent du reste de l’année en termes de conditions environnementales et d’émissions de polluants.
Le plan scientifique d’ÉPAHT présente des renseignements généraux sur l’étude, une description détaillée des activités de l’étude en référence à la littérature scientifique, et un aperçu des outils et des activités qui appuieront la production et la communication de ses résultats.
Les questions fondamentales qu’ÉPAHT doit aborder sont les suivantes :
- Quelles sources et quels processus sont responsables du mélange de polluants atmosphériques urbains?
- Qu’est-ce qui compose le mélange de polluants atmosphériques urbains et en quelles quantités?
- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains varie-t-il dans l’espace et le temps?
- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains est-il lié aux risques pour la santé humaine et environnementale?
Plus de quatre-vingt-dix experts scientifiques et techniques participent directement à la collecte de données et à l’interprétation des résultats de l’étude. Les activités d’étude comprennent quarante-quatre sous-projets sur des sujets de recherche sur la qualité de l’air en milieu urbain, allant des émissions des véhicules qui ont été garés à des températures froides aux impacts sur la faune urbaine de la pollution atmosphérique capturée par la neige qui tombe.
Un élément clé d’ÉPAHT est une campagne intensive de mesure sur le terrain de six semaines qui se déroulera de janvier à mars 2024 à plusieurs endroits à Toronto. Les données recueillies au cours de la campagne seront combinées aux résultats d’autres efforts en cours pour rendre compte du mélange de polluants atmosphériques urbains et améliorer les outils scientifiques et techniques que nous utilisons pour comprendre la pollution atmosphérique urbaine dans les villes du Canada.
Liste des figures
- Figure 1 : Questions générales à étudier dans le cadre d’ÉPAHT
- Figure 2 : Voies d’exposition, polluants et activités scientifiques pertinentes pour ÉPAHT
- Figure 3 : Sites de mesure fixes au sol dans le cadre de la campagne intensive ÉPAHT 2024. La grille d’arrière-plan représente la grille de 2,5 km du modèle de transport chimique d’ECCC, GEM-MACH
- Figure 4 : Méthodes de collecte de données sur les polluants de l’air ambiant dans le cadre d’ÉPAHT
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Réseaux, projets et plates-formes scientifiques existants dans le domaine de la pollution de l’air et pertinents pour ÉPAHT
- Tableau 2 : Disponibilité des données pour certains polluants atmosphériques urbains dans ÉPAHT
Annexes
- Annexe A : Auteurs et contributeurs
- Annexe B : Calendrier de la campagne intensive de mesures sur le terrain au début de l’année 2024
- Annexe C : Résumé des activités scientifiques d’ÉPAHT sous les thèmes 2, 3 et 4
- Annexe D : Équipe de direction d’ÉPAHT
Remarque sur les rapports de mélange, les concentrations et les niveaux
L’une des principales activités de la science de la pollution atmosphérique consiste à décrire l’abondance des polluants. L’abondance peut être exprimée de plusieurs manières et, dans le contexte de la pollution atmosphérique, les descripteurs courants sont le rapport de mélange, la concentration et le niveau. Le rapport de mélange et la concentration ont des définitions précises, bien qu’ils puissent tous deux prendre plusieurs formes, tandis que le niveau est un terme moins technique. Dans ce plan scientifique, les termes concentration et niveau sont utilisés le plus souvent pour décrire l’abondance des polluants dans l’air dans un sens générique, et le rapport de mélange n’est utilisé que lorsque cela est spécifié par le(s) scientifique(s) qui contribue(nt) au texte concerné.
« Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en utilisant le même raisonnement que celui que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés » - Albert Einstein
1. Introduction
L’étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (ÉPAHT) est une enquête scientifique intégrée sur la qualité de l’air urbain. L’étude vise à faire progresser notre compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains, et le calendrier de l’étude permet de se concentrer sur les conditions relativement peu étudiées qui sont présentes pendant l’hiver aux latitudes moyennes.
Le plan scientifique d’ÉPAHT présenté ici est divisé en trois sections. L’introduction présente des informations générales sur l’étude et s’adresse à des lecteurs non spécialisés ayant des connaissances générales sur les questions de qualité de l’air. La deuxième section est une description détaillée des activités de l’étude avec référence à la littérature scientifique pour identifier les lacunes dans les connaissances et justifier comment ÉPAHT contribuera à les combler. Enfin, la troisième section décrit les outils et les activités qui soutiendront la production et la communication des résultats d’ÉPAHT.
1.1 Contexte de l’étude
ÉPAHT est dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et comprend des partenaires d’étude, des clients et des parties prenantes d’agences gouvernementales fédérales, provinciales et municipales ainsi que plusieurs universités. Sur la base des discussions initiales, un cadre du plan scientifique a été présenté en novembre 2022. Le cadre a défini quatre questions primordiales à étudier par ÉPAHT (voir la figure 1).
Au cœur d’ÉPAHT se trouve une réponse à la demande d’amélioration de la caractérisation du mélange de polluants atmosphériques urbains. Cette demande a été exprimée par diverses parties prenantes qui s’appuient sur des informations scientifiques solides pour mener à bien la recherche, l’évaluation, l’élaboration de politiques, le développement et la mise en œuvre de programmes, ainsi que la communication. En ce qui concerne l’air urbain, ces parties prenantes ont constamment exprimé le besoin de comprendre l’étendue des polluants atmosphériques à des échelles spatiales fines, et ce besoin est interprété en relation avec les questions primordiales d’ÉPAHT ci-dessous.
Figure 1 : Questions générales à étudier dans le cadre de ÉPAHT.
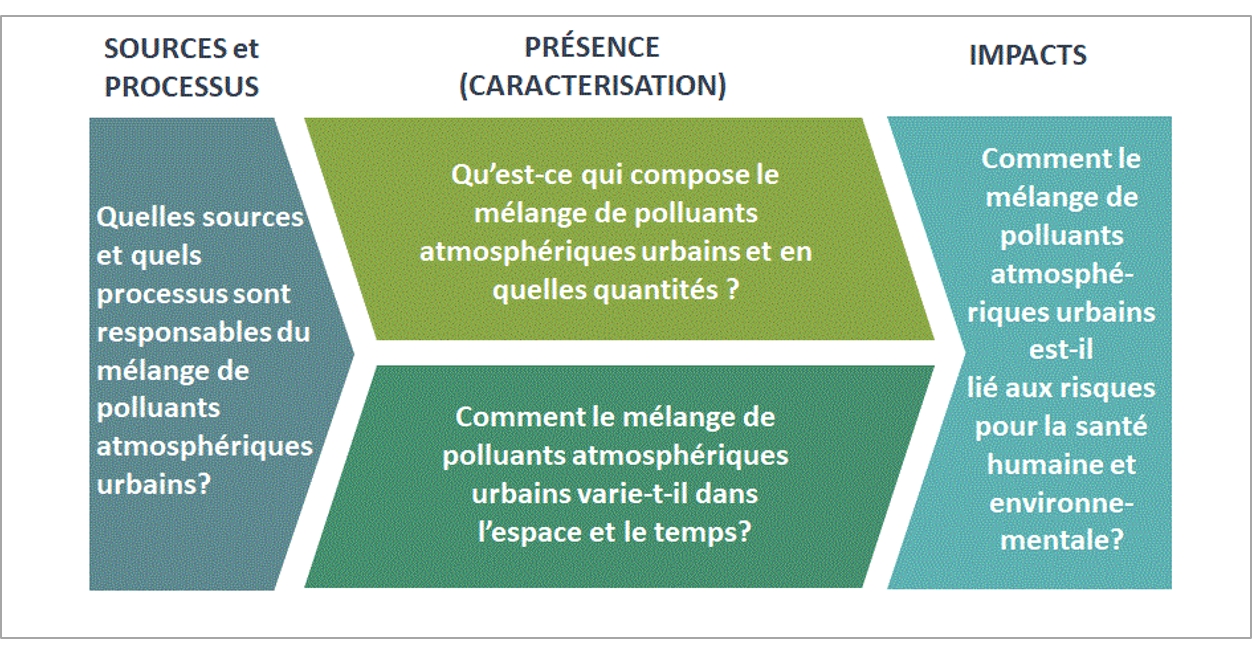
Description textuelle – Figure 1
Sources et processus
- Quelles sources et quels processus sont responsables du mélange de polluants atmosphériques urbains?
Présence (caracterisation)
- Qu’est-ce qui compose le mélange de polluants atmosphériques urbains et en quelles quantités?
- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains varie-t-il dans l’espace et le temps?
Impacts
- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains est-il lié aux risques pour la santé humaine et environnemental?
L’amélioration de la caractérisation du mélange de polluants atmosphériques urbains peut être divisée en deux parties. Le premier concerne les composants chimiques du mélange, dont beaucoup ont été étudiés et gérés dans le cadre de programmes distincts et manquent donc d’intégration. Le deuxième élément de caractérisation concerne la variation des niveaux de polluants individuels et combinés dans l’espace et dans le temps. Cette dernière composante est de plus en plus pertinente à mesure que les considérations d’équité et de justice prennent de l’importance dans la gestion de l’environnement.
La valeur ultime de la caractérisation réside dans sa contribution à la compréhension des sources et des impacts. L’identification des sources - y compris la différenciation entre les rejets de polluants naturels et anthropiques (causés par les humains) et entre les zones de sources géographiques ou les juridictions - est fondamentale pour la conception et la mise en œuvre d’actions de gestion environnementale. La complexité des processus de devenir de l’atmosphère, qui entraînent une variété de transformations physiques et chimiques, nécessite des investigations ciblées pour relier la présence des polluants atmosphériques à leurs sources et à leurs formes futures. La caractérisation de la présence de polluants dans l’air ambiant et dans les dépôts atmosphériques est également nécessaire pour comprendre leurs effets individuels et cumulatifs. La maxime toxicologique selon laquelle « la dose fait le poison » sous-tend la nécessité de disposer de niveaux de polluants ambiants bien caractérisés, tant pour les composés individuels que pour les mélanges, lors de la détermination des risques pour la santé humaine et environnementale.
Depuis sa création, ÉPAHT vise à favoriser les liens entre les silos associés aux différentes classes de polluants et les activités scientifiques nécessaires pour comprendre la présence, les sources et les impacts du mélange de polluants de l’air urbain. La figure 2 présente les grandes classes de polluants pertinentes pour la pollution atmosphérique urbaine, en fonction de leurs principales voies d’exposition, à savoir l’inhalation ou la captation après le dépôt atmosphérique.
Les classes de polluants représentées dans la figure 2 ont une maturité variable en tant que problèmes individuels de qualité de l’air. Au minimum, elles font toutes l’objet d’une surveillance et d’une recherche à long terme, et certaines sont également gérées dans le cadre de programmes nationaux et/ou internationaux. Considéré dans son ensemble, le mélange de polluants atmosphériques urbains est un problème émergent plutôt que mature. On sait peu de choses sur la composition et la distribution du mélange dans son ensemble, et aucun programme ciblé n’a encore été mis en œuvre malgré les appels à une recherche plus intégrée sur la pollution atmosphérique et à une plus grande attention portée aux effets cumulatifs. ÉPAHT a été conçu pour accélérer le changement de paradigme nécessaire pour passer d’une approche polluant par polluant à une approche totalement intégrée pour le mélange de polluants atmosphériques, depuis les sources jusqu’aux impacts.
Figure 2 : Voies d’exposition, polluants et activités scientifiques pertinentes pour ÉPAHT.
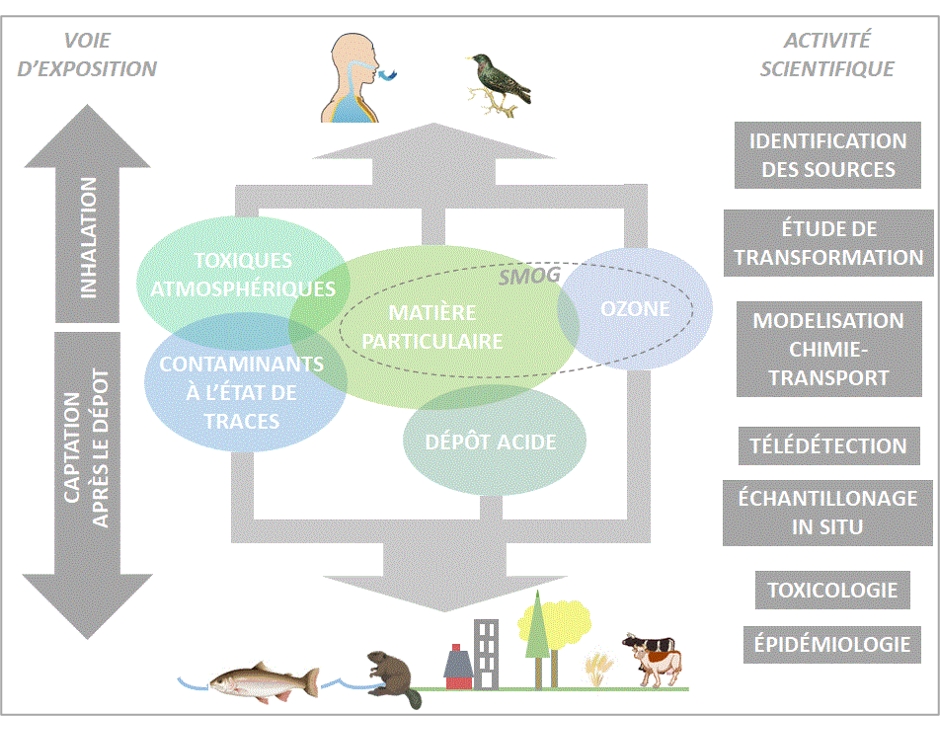
Description textuelle – Figure 2
Une image qui décrit une gamme de différents polluants atmosphériques qui peuvent être inhalés ou ingérés par les aliments ou l’eau, ainsi qu’une liste d’activités scientifiques pertinentes pour l’étude.
Voie d’exposition
- inhalation
- captation après le dépôt
Les classes de polluants
- toxiques atmosphériques
- contaminants à l’état de traces
- dépôt acide
- smog
- matière particulaire
- ozone
Activité scientifique
- identification des sources
- étude de transformation
- modelisation chimie-transport
- télédétection
- échantillonage in situ
- toxicologie
- épidémiologie
1.2 Défis liés à la prise en compte des mélanges de polluants atmosphériques
Comme le montre la figure 2, la qualité de l’environnement peut être altérée par la présence de plusieurs polluants atmosphériques. Les différences entre les polluants, telles que celles énumérées ci-dessous, empêchent une approche directe de l’évaluation de leurs caractéristiques en tant que mélange.
Critères de toxicité et modes d’action.
- La somme arithmétique des concentrations de polluants atmosphériques n’est pas représentative de leur potentiel d’effets néfastes cumulés. Tous les polluants d’un mélange ne contribuent pas à un effet donné, et ceux qui le font peuvent se comporter de manière antagoniste et/ou synergique. Le tout peut être supérieur ou inférieur à la somme de ses parties.
Échelle de temps des concentrations ambiantes.
- Les concentrations ambiantes sont déterminées par des méthodes qui diffèrent selon le polluant considéré. Ces méthodes fonctionnent à des échelles de temps allant de quelques secondes à plusieurs mois, et la combinaison des résultats nécessite d’ajuster les échelles de temps en tenant compte de la variabilité et d’autres facteurs temporels pertinents.
Échelle spatiale des concentrations ambiantes.
- Comme pour l’échelle temporelle, les concentrations ambiantes sont déterminées à différentes échelles spatiales en fonction de la méthodologie utilisée. Les mesures par satellite et les modèles de transport chimique fournissent des informations sur les concentrations couvrant des zones de plusieurs kilomètres carrés au sein desquelles la variabilité est inconnue, alors que la distance sur laquelle les mesures sur site fixe sont représentatives est incertaine. La combinaison des résultats pour comprendre la variabilité spatiale du mélange de polluants atmosphériques nécessite un examen attentif et une justification des hypothèses utilisées pour harmoniser les échelles spatiales. Ceci est particulièrement important lors de l’examen de l’air urbain en raison des changements importants dans les concentrations de polluants sur de petites distances.
Spécificité de l’identification des polluants.
- Les méthodes de caractérisation de l’air ambiant visent différents niveaux de spécificité chimique, ce qui est vrai pour les approches de mesure et de modélisation du transport chimique. Certains polluants sont identifiés comme des molécules entières (par exemple, l’ozone, le benzène), d’autres comme des paramètres agrégés (par exemple, les particules), et d’autres encore comme des quantités dérivées basées en partie sur des hypothèses concernant la composition de l’atmosphère (par exemple, le pH des aérosols) ou des fragments moléculaires (par exemple, la composition des particules à partir de la spectrométrie de masse des aérosols). Pour combiner les informations sur les polluants de manière à comprendre les sources et les impacts, il faut accorder une attention particulière à la spécificité chimique et à la comparabilité des différentes techniques.
Distribution de la taille des particules polluantes.
- Tout comme les particules ambiantes, les polluants qui leur sont associés existent dans une large gamme de tailles. Les techniques d’évaluation des concentrations de particules polluantes ne représentent généralement pas toute la gamme des tailles, les seuils de 1, 2,5 et 10 mm étant les plus courants. Les différences dans les distributions granulométriques des polluants doivent être prises en compte lors de l’évaluation du mélange dans son ensemble afin de comprendre le potentiel d’inhalation et de dépôt et de relier de manière crédible les émissions des sources aux concentrations ambiantes et aux impacts.
Multiplicité des sources.
- De nombreuses sources contribuent à la présence de polluants dans l’air urbain, et la détermination des sources les plus importantes dépend du polluant ou du mélange considéré. Il faut veiller à éviter les expressions génériques telles que « pollution de l’air » lorsque des descripteurs spécifiques seraient plus précis. Une telle prudence dans la dénomination facilitera à son tour l’identification des sources pertinentes et de leur rôle dans la présence et l’impact des polluants individuels ou de leurs mélanges.
Transformations environnementales.
- Le temps passé dans l’atmosphère modifie de nombreux polluants par le biais de divers processus physico-chimiques, et les transformations qui en résultent peuvent obscurcir les liens entre les sources et les impacts. Pour comprendre le mélange de polluants, il faut connaître en détail ces processus de transformation et la manière dont ils sont influencés par les conditions environnementales ainsi que par l’identité et la quantité des polluants présents.
Les facteurs énumérés ci-dessus illustrent certains des défis associés au passage d’une approche axée sur chaque polluant à une approche qui prend en compte le mélange de polluants. La prise en compte de ces facteurs nécessite des modes d’enquête exploratoires et descriptifs ainsi que des approches explicatives qui conduisent à des recherches physico-chimiques détaillées sur des polluants individuels ou des classes de polluants. Le succès de la représentation et de la compréhension du mélange dépendra de la structure et de la disponibilité de l’ensemble de données partagées qui sera produit dans le cadre d’ÉPAHT, et qui est décrit plus en détail dans la section 3.
1.3 Le mélange de pollution atmosphérique urbaine en hiver
Bien que la surveillance de l’air ambiant soit effectuée tout au long de l’année, les études détaillées de la pollution atmosphérique urbaine se sont généralement concentrées sur l’été, en particulier lorsque les températures élevées de l’air et les niveaux d’ensoleillement coïncident avec des modèles de flux d’air stagnant pour induire la production d’un smog photochimique. L’attention portée aux polluants atmosphériques communs tels que l’ozone et les particules à l’échelle urbaine n’a pas été suivie par les visions régionales et mondiales employées lors de l’examen des contaminants à l’état de traces et des substances acidifiantes. En conséquence, le mélange de polluants atmosphériques urbains est mal caractérisé malgré une compréhension détaillée de certains de ses constituants. L’examen de la pollution atmosphérique urbaine pendant la saison hivernale constitue un contrepoint précieux aux études estivales pour des raisons liées aux conditions météorologiques et aux émissions de polluants, comme indiqué ci-dessous.
Facteurs météorologiques affectant la pollution atmosphérique urbaine.
- L’hiver se caractérise par des températures et un rayonnement solaire inférieurs à ceux de l’été. Ces facteurs déterminent les émissions de polluants de certains secteurs (voir ci-dessous) et affectent également les processus atmosphériques tels que l’oxydation, la photolyse et la répartition particule/gaz. Le piégeage et le dépôt des polluants sont influencés par l’état de phase des précipitations ou des gouttelettes de brouillard/nuage, l’efficacité relative du piégeage des formes liquides et gelées dépendant des caractéristiques physicochimiques du polluant en question. La réduction de la végétation en hiver diminue l’absorption des polluants dans l’air, et la couverture de neige/glace réduit la volatilisation des contaminants semi-volatils dans les eaux de surface et le sol. L’hiver est associé à une couche limite atmosphérique moins profonde et plus stable qui peut entraîner une augmentation des concentrations de polluants en suspension dans l’air en raison du volume d’air réduit qui reçoit les émissions.
Présence ou absence de sources de pollution en hiver.
- Les sources de pollution de l’air urbain en hiver diffèrent de celles des périodes plus chaudes de l’année. La combustion de combustibles fossiles continue de dominer le chauffage des espaces intérieurs à Toronto et dans de nombreuses autres villes canadiennes, et le chauffage résidentiel au bois a d’autres usages récréatifs en hiver. Les agents de déglaçage tels que le sel de voirie libèrent du chlore et d’autres substances chimiques qui peuvent être elles-mêmes des polluants et contribuent à la chimie atmosphérique qui transforme d’autres émissions en polluants secondaires. Inversement, certaines sources de polluants, telles que les feux de forêt et les émissions biogènes provenant de la végétation caduque, sont réduites ou absentes en hiver. L’étude de la qualité de l’air sous différents régimes d’émissions permet de mieux comprendre le rôle des facteurs contributifs, ce qui améliore notre compréhension des sources et des impacts.
Des généralisations ont été faites sur les tendances saisonnières des concentrations de polluants, mais elles ne sont pas toujours exactes ou solides. Par exemple, l’augmentation des concentrations d’ozone et de particules pendant les épisodes de smog photochimique a conduit à des croyances généralisées sur la pollution estivale, malgré des concentrations hivernales plus importantes de plusieurs polluants observées dans les zones urbaines. Inversement, les composés aromatiques polycycliques (CAP) toxiques sont supposés avoir des concentrations atmosphériques plus élevées en hiver en raison des émissions de chauffage et de la diminution du mélange vertical, mais cette tendance n’est pas observée de manière cohérente dans les relevés de mesures à long terme. En concentrant ÉPAHT sur l’hiver, on contribuera à une meilleure compréhension globale du mélange urbain tout au long de l’année.
2. Activités scientifiques d’ÉPAHT
Un atelier de planification scientifique ÉPAHT a été organisé en janvier 2023 pour permettre aux participants à l’étude de traduire les questions primordiales (Figure 1) en activités concrètes. Cette traduction a été réalisée en utilisant les discussions de l’atelier pour développer et relier deux sujets connexes : (1) les lacunes dans les connaissances relatives à la présence, aux sources et aux impacts des polluants atmosphériques urbains en hiver aux latitudes moyennes, et (2) les capacités scientifiques et techniques mises à la disposition dÉPAHT par ses participants gouvernementaux et universitaires. Les discussions ont été soutenues par des outils interactifs en ligne qui ont permis aux participants de fournir des détails sur les instruments disponibles et les demandes d’emplacement pour les mesures sur le terrain ainsi qu’un outil cartographique Google Earth qui montre les emplacements des mesures avec les émissions de polluants déclarées dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) du Canada.
2.1 Infrastructure scientifique existante
Afin de garantir une utilisation efficace des ressources, la planification scientifique d’ÉPAHT s’est appuyée sur l’infrastructure scientifique existante. Les travaux supplémentaires menés dans le cadre d’ÉPAHT tirent parti de cette infrastructure, et la faisabilité et la pertinence des nouvelles activités sont amplifiées par les efforts coordonnés des participants à l’étude.
Une analyse des programmes scientifiques en cours sur la pollution de l’air révèle un riche éventail d’efforts pertinents pour la région du Grand Toronto-Hamilton (RGTH; voir le Tableau 1). Les relations positives entre les scientifiques gouvernementaux et universitaires ont permis à ÉPAHT de s’appuyer sur cette base solide de travaux en cours, et les données associées à ces travaux ont été généreusement offertes à l’effort d’ÉPAHT. Afin de permettre l’utilisation des données issues des activités en cours et nouvelles, des outils en ligne permettant la communication et le partage des données sont en cours de développement. Ils sont hébergés sur des services en nuage accessibles aux participants à l’étude d’ECCC et des organisations partenaires. Des archives de données seront ultérieurement mises à la disposition de la communauté scientifique élargie et du grand public par l’intermédiaire du Portail du gouvernement ouvert canadien (voir section 3).
Bien que plusieurs activités de mesure et de recherche sur la pollution atmosphérique soient en cours dans la RGTH, de grandes différences entre les polluants ciblés et les échelles de mesure compliquent le développement d’une compréhension intégrée du mélange de polluants atmosphériques urbains. Les activités ciblées dans le cadre d’ÉPAHT visent à combler les lacunes du paysage scientifique actuel - à la fois par des mesures effectuées lors d’une campagne intensive d’échantillonnage sur le terrain au début de 2024 et par l’analyse des données de mesure et d’autres techniques disponibles afin d’améliorer notre compréhension des sources et des impacts des polluants atmosphériques urbains.
Tableau 1 : Réseaux, projets et plates-formes scientifiques existants dans le domaine de la pollution atmosphérique et pertinents pour ÉPAHT.
| Réseau, projet ou plateforme | Brève description | Contact ÉPAHT | Agence pilote |
|---|---|---|---|
| RNSPA (Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique) | Mesures continues et intégrées de l’air ambiant au niveau du sol pour l’ozone et les particules (PM) ainsi que leurs précurseurs, les constituants des PM, les toxiques atmosphériques et les contaminants à l’état de traces. | May Siu (ECCC) | ECCC et ON MEPNP (y compris les partenaires territoriaux et municipaux ailleurs au Canada) |
| RCEPA (Réseau canadien de surveillance de l’air et des précipitations) | Mesures intégrées de l’air ambiant et des précipitations au niveau du sol, axées sur les dépôts acides. | Anne Marie Macdonald (ECCC) | ECCC |
| Réseau GAPS (Global Atmospheric Passive Sampling) | Mesures d’échantillonnage passif intégré de contaminants à l’état de traces sur des périodes d’échantillonnage de 1 à 3 mois au niveau du sol ou à proximité. | Tom Harner et Amandeep Saini (ECCC) | ECCC |
| IMPACT (Improved Assessment and Characterization of Traffic Emissions) | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des gaz atmosphériques à l’état de traces au niveau du sol + échantillonnage basé sur les véhicules des émissions routières au niveau du sol. | Greg Evans (Université de Toronto) | HEI (Health Effects Institute) |
| Étude d’échantillonnage passif à Hamilton | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des gaz à l’état de traces dans l’atmosphère et des substances toxiques de l’air sur des périodes d’échantillonnage d’un mois au niveau du sol ou à proximité. | Matthew Adams (Université de Toronto Mississauga) | Environment Hamilton et Clean Air Hamilton |
| ATOUSA (Assessing Toxicity of Organics in Urban Sectors for Air) | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des CAP associés aux gaz et aux particules et de leurs produits de transformation, des substances chimiques dérivées des pneus et d’autres substances chimiques émergentes, avec des liens avec les paramètres de toxicité. | Sabina Halappanavar (Santé Canada) et Tom Harner/Amandeep Saini (ECCC) | Santé Canada et ECCC |
| ECCC Division de recherche météorologique « Southern Ontario LIDAR Mesonet » | LIDAR Doppler mesurant les vents, la turbulence, la hauteur de la couche limite et la rétrodiffusion des aérosols avec une résolution de 10 minutes jusqu’à 4 km d’altitude depuis le sol. | Zen Mariani (ECCC) | ECCC |
| Réseau mondial Pandonia | Réseau mondial de spectromètres Pandora effectuant des mesures de gaz à l’état de traces dans l’atmosphère avec une résolution de 20 minutes pour l’ensemble de la colonne atmosphérique. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | NASA et Agence spatiale européenne |
| Aeronet (Aerosol Robotic Network) et AEROCAN (Aerosol Robotic Canadian Network) | Réseau mondial de photomètres solaires mesurant les propriétés optiques des aérosols dans la colonne atmosphérique totale. Le réseau AErosol RObotic CANadian (AEROCAN) est un sous-réseau d’AERONET. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | NASA et PHOTONS |
| COCCON (Collaborative Carbon Column Observing Network) | Réseau mondial d’instruments de télédétection au sol mesurant les gaz à effet de serre dans l’ensemble de la colonne atmosphérique. | Debra Wunch (Université de Toronto) | Agence spatiale européenne |
| NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) - Groupe de travail sur l’ultraviolet-visible (UV-Vis) | Réseau mondial d’observations par spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS), y compris MAX-DOAS pour le profilage des traces de gaz dans la troposphère. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | BIRA (Institut belge d’aéronomie spatiale) |
| NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) - Groupe de travail sur l’infrarouge (IR) | Réseau mondial d’instruments terrestres de spectroscopie à transformée de Fourier (FTIR) mesurant divers aérosols et polluants en phase gazeuse. | Kimberly Strong (Université de Toronto) | NASA |
| TROPOMI | Spectromètres basés sur un satellite héliosynchrone pour mesurer les aérosols et divers gaz à l’état de traces. | Chris McLinden (ECCC) | Agence spatiale européenne |
| TEMPO | Spectromètre basé sur un satellite géostationnaire pour mesurer divers gaz à l’état de traces. | Chris McLinden (ECCC) | NASA |
| ABI sur GOES | Radiomètre imageur basé sur un satellite géostationnaire pour mesurer la profondeur optique des aérosols | Chris Sioris (ECCC) | NOAA |
| MODIS | Radiomètre satellitaire pour mesurer la profondeur optique des aérosols | Chris Sioris (ECCC) | NASA |
| CRUISER | Plate-forme mobile d’échantillonnage des polluants atmosphériques dotée d’une grande capacité d’instruments et d’options d’itinéraires. | Ralf Staebler (ECCC) | ECCC |
| Véhicules d’échantillonnage mobiles de l’Université de Toronto | Plate-forme d’échantillonnage mobile pour les polluants atmosphériques avec une capacité d’instrumentation modérée et des options d’itinéraires de conduite. | Greg Evans (Université de Toronto) | Université de Toronto |
| Plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams | Plate-forme mobile d’échantillonnage des polluants atmosphériques dotée d’une capacité d’instrumentation modeste et d’options d’itinéraires flexibles. | Matthew Adams (Université de Toronto Mississauga) | Université de Toronto Mississauga |
| Plate-forme mobile de mesure des gaz à effet de serre de la Division de la recherche climatique d’ECCC | Plate-forme mobile d’échantillonnage du méthane et du dioxyde de carbone à Toronto. | Felix Vogel (ECCC) | ECCC |
| INRP (Inventaire national des rejets de polluants) | Inventaire des rejets, éliminations et transferts d’un grand nombre de polluants du smog et de leurs précurseurs, de substances toxiques pour l’air et de contaminants à l’état de traces, déclarés par les installations. | Anne Monette (ECCC) | ECCC |
| IEPA (Inventaire des émissions de polluants atmosphériques) | Inventaire des rejets estimés de toutes les sources anthropiques pour un nombre limité de polluants du smog et de leurs précurseurs, de substances toxiques pour l’air et de contaminants à l’état de traces. | Lindsay Pratt (ECCC) | ECCC |
| JAMS (Joint Air Management Strategy) | Aperçu de l’état des connaissances sur les problèmes de qualité de l’air liés à plusieurs polluants dans le sud-ouest de l’Ontario, avec des possibilités de gestion dérivées des tendances historiques et des modèles de projection. | Matthew Parsons (ECCC) | ECCC |
| GEM | Modèle de prévision hydrométéorologique capable de prévoir les conditions météorologiques proches de la surface. | Sylvie Leroyer (ECCC) | ECCC |
| GEM-MACH | Modèle de transport chimique capable de simuler les concentrations dans l’air ambiant et les dépôts atmosphériques pour une série de polluants atmosphériques courants et de substances toxiques. | Rosa Wu (ECCC) | ECCC |
2.2 Aperçu de la campagne de mesures intensives sur le terrain 2024
Une activité clé dans le cadre d’ÉPAHT est une campagne intensive de mesures sur le terrain qui se déroulera pendant six semaines au début de l’année 2024 (voir l’annexe B pour le calendrier). Les emplacements des mesures fixes au sol sont indiqués dans la figure 3. La majorité des emplacements sont des sites existants exploités par ECCC et/ou ON MEPNP (ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario) ou des universités locales (Université de Toronto et Université York).
Figure 3 : Sites de mesure fixes au sol proposés pour l’étude intensive de terrain ÉPAHT de 2024. La grille d’arrière-plan représente la grille de 2,5 km du modèle de transport chimique d’ECCC, GEM-MACH.
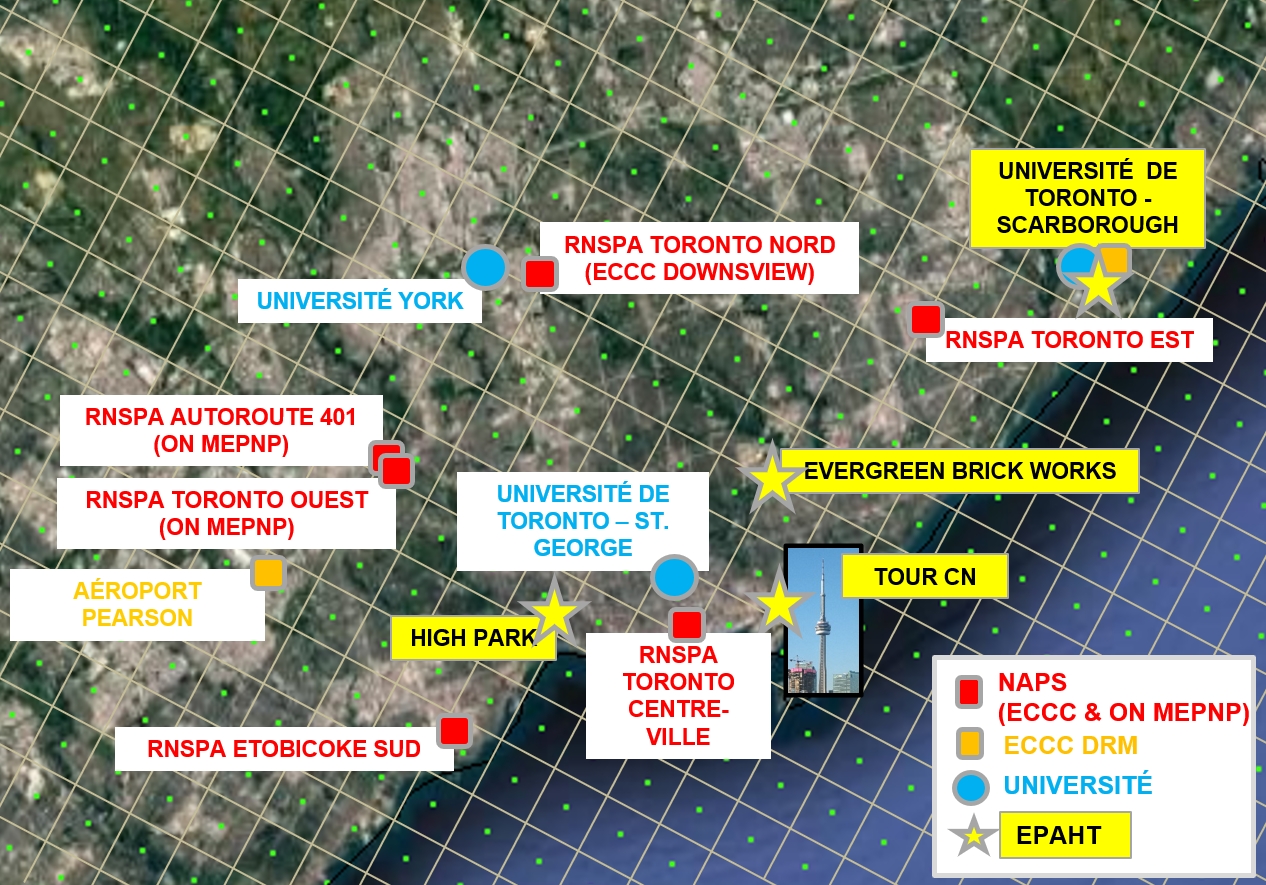
Description textuelle – Figure 3
Carte de Toronto montrant les emplacements de :
- 9 sites de mesures fixes au sol :
- 6 stations du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) :
- RNSPA Etobicoke Sud
- RNSPA Toronto Ouest – ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (ON MEPNP)
- RNSPA Autoroute 401 – ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (ON MEPNP)
- RNSPA Toronto Nord – ECCC Downsview
- RNSPA Toronto Est
- RNSPA Toronto centre-ville
- 1 station de la Division de la recherche météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC DRM) :
- Aéroport Pearson
- 2 stations universitaires :
- Université York
- Université de Toronto – St. George
- 6 stations du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) :
- 4 sites de mesure temporaires (EPAHT) :
- High Park
- Evergreen Brick Works
- Université de Toronto – Scarborough
- Tour CN
Quatre sites de mesure temporaires sont prévus pour l’étude intensive sur le terrain. Trois d’entre eux (High Park, Evergreen Brickworks et l’Université de Toronto Scarborough (UTSC)) accueilleront des mesures au sol. Ces derniers sites comblent des lacunes spatiales dans le centre et l’est de Toronto, représentent différentes utilisations du sol (urbaines mixtes, près des routes et sous le vent de l’arrière-plan urbain, respectivement), et mettent en valeur un transect le long de la direction prédominante du vent en hiver avec des flux provenant du sud-ouest. Le quatrième site temporaire ÉPAHT sera situé au centre-ville, à la Tour CN. Il permettra d’effectuer des mesures à plusieurs hauteurs le long de son pilier de soutien ainsi qu’à partir du toit de sa nacelle principale, à 356 m au-dessus du sol.
Les mesures seront effectuées sur les sites fixes à l’aide d’échantillonneurs actifs et passifs, d’analyseurs chimiques à haute résolution temporelle et d’instruments de télédétection. Des périodes de mesures super intensives sont également prévues sur les sites temporaires ÉPAHT de High Park, Evergreen Brickworks et UTSC. Ces périodes super intensives se dérouleront sur trois périodes consécutives de deux semaines au cours desquelles une plate-forme d’échantillonnage mobile hautement instrumentée (ECCC CRUISER et remorques associées) sera déployée en mode d’échantillonnage stationnaire sans moteur afin de compléter les autres instruments présents sur ces sites.
Des échantillonnages mobiles seront également effectués au cours de la campagne. Des véhicules de l’Université de Toronto (IMPACT et Plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams) examineront les émissions sur route dans toute la ville, et les différences entre les émissions des véhicules démarrant à froid et celles des véhicules en marche seront étudiées dans un parking pour navetteurs grâce à une collaboration entre le CRD d’ECCC et la plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams.
Malgré les progrès technologiques qui permettent des mesures plus rapides et à plus haute résolution chimique, la science de la pollution de l’air continue à rechercher des informations à plus haute résolution spatio-temporelle. Cette volonté est particulièrement importante dans les zones urbaines où des différences substantielles dans les niveaux de polluants atmosphériques peuvent exister sur de petites échelles spatiales. Les outils à la pointe des efforts visant à fournir des informations à haute résolution sur les polluants atmosphériques comprennent les mesures de télédétection spatiale (par satellite) et les modèles de transport chimique, qui sont tous deux des éléments importants d’ÉPAHT.
Par rapport aux réseaux de surveillance au sol, les instruments satellitaires fournissent des données sur les polluants atmosphériques à une densité spatiale élevée. Les zones de pixels actuels des satellites (par exemple, 9 et 25 km2 pour TEMPO et TROPOMI, respectivement) permettent un plus grand nombre de mesures quasi simultanées à l’intérieur d’une ville que les instruments de surveillance au sol existants. Néanmoins, la variabilité des niveaux de pollution atmosphérique urbaine peut ne pas être prise en compte par la densité spatiale basée sur les satellites, et les mesures par satellite sont en outre limitées aux conditions de ciel clair. Les campagnes de terrain avec de multiples sites de mesure au sol espacés à des échelles similaires à la taille des grilles de pixels des satellites sont utiles pour tester la représentativité des mesures satellitaires. Une demande de balayages spéciaux du satellite TEMPO récemment lancé a reçu une réponse initiale positive et permettra d’améliorer les observations pendant la campagne intensive d’ ÉPAHT. Étant donné que l’étude intensive sur le terrain se déroule pendant le premier hiver d’exploitation de TEMPO, ÉPAHT offre une occasion unique d’évaluer les performances du nouveau satellite sur les surfaces enneigées et d’autres caractéristiques de son exploitation. Les outils de partage et d’archivage des données d’ÉPAHT permettent de relier les données collectées sur les sites terrestres et les instruments satellitaires afin de faciliter les analyses pertinentes.
Les mesures effectuées par satellite fournissent des données sur l’ensemble de la colonne d’air au-dessus de la surface de la Terre. L’extraction de la concentration au niveau du sol, où se produit la majeure partie de l’exposition des humains et de l’écosystème, nécessite des hypothèses sur la distribution verticale du polluant. Ces hypothèses sont souvent tirées de modèles de transport chimique, mais la complexité de l’environnement urbain rend difficile une vérification approfondie au sol. Les mesures ÉPAHT effectuées à l’aide d’instruments de profilage vertical au sol sur plusieurs sites ainsi qu’à plusieurs hauteurs de la Tour CN fourniront des données sur les polluants atmosphériques résolues verticalement qui permettront d’évaluer les hypothèses actuelles et d’améliorer les outils utilisés pour les générer.
Les modèles de transport chimique ont de nombreuses utilisations au-delà de la génération de profils verticaux pour les polluants atmosphériques mesurés par télédétection. Ces modèles peuvent simuler les concentrations de polluants atmosphériques à des résolutions spatiales horizontales plus fines que celles des instruments satellitaires. Le modèle GEM-MACH d’ECCC est généralement configuré pour des mailles de ~6 km2 (2,5 km × 2,5 km), mais la capacité pour des mailles de deux ordres de grandeur plus petits (0,06 km2 = 0,25 km × 0,25 km) se développe rapidement. Les modèles de transport chimique sont également utilisés pour déterminer les contributions des sources et des lieux de polluants, et ils sont en outre utilisés comme outils de prévision pour examiner les impacts des mesures de gestion et des changements environnementaux.
La précision des simulations des modèles de transport chimique repose sur des données d’entrée telles que la météorologie et les émissions de polluants, ainsi que sur des représentations des processus atmosphériques qui transforment les polluants dans l’air ambiant. Bon nombre de ces données et processus sont mal limités par les observations existantes, et l’interaction complexe entre les données, les processus et les facteurs numériques et informatiques crée la possibilité d’erreurs de compensation. Même lorsque les résultats du modèle correspondent aux mesures disponibles, une évaluation rigoureuse est nécessaire pour confirmer que les résultats sont corrects pour les bonnes raisons. Cela donne confiance à l’attribution des sources et aux prédictions des modèles pour lesquels il n’existe pas de mesures comparatives. Grâce à son ensemble de données sans précédent, ÉPAHT est particulièrement bien placé pour améliorer la précision de GEM-MACH. Cela permettra d’approfondir les connaissances sur le mélange de polluants atmosphériques urbains, non seulement dans la RGTH, mais aussi dans d’autres zones urbaines du Canada et d’ailleurs.
Le texte précédent fournit un bref résumé des activités prévues dans le cadre de la campagne d’échantillonnage intensif sur le terrain d’ÉPAHT 2024. Une description plus complète et détaillée des activités scientifiques d’ÉPAHT est présentée ci-dessous sous l’angle de quatre thèmes d’étude : (1) caractérisation, (2) sources et processus, (3) impacts, et (4) évaluation et amélioration des outils scientifiques.
2.3 Activités scientifiques sous le thème 1 – Caractérisation
Une contribution importante d’ÉPAHT sera la production de l’ensemble de données le plus complet du mélange de polluants atmosphériques jamais produit dans une grande zone urbaine. De grandes études sur la qualité de l’air urbain ont été menées ailleurs, mais aucune n’a intégré la gamme de polluants atmosphériques dans l’air ambiant, la colonne d’air verticale et les dépôts atmosphériques qui sont pris en compte dans ÉPAHT. L’ampleur des informations sur l’air ambiant visées par ÉPAHT nécessite diverses méthodes de collecte de données, notamment des mesures directes et des simulations à l’aide d’outils de modélisation du transport chimique, comme le montre la figure 4.
Figure 4 : Méthodes de collecte de données sur les polluants de l’air ambiant dans le cadre de ÉPAHT.

Description textuelle – Figure 4
Une image des méthodes utilisées pour comprendre les niveaux de pollution atmosphérique à divers endroits dans la région de Toronto.
- satellite
- modèle chimie-transport
- laboratoire mobile
- analyseur de gaz
- spectromètre de masse (particule ou gaz)
- impacteur en cascade
- échantillonneur passif
- échantillonneur intégré
- échantillonneur de dépôts
- télédétection au sol
- Tour CN
À titre d’exemple, le tableau 2 détaille certains polluants atmosphériques urbains et la disponibilité attendue de données de concentration simultanées à la suite des activités d’ÉPAHT.
Tableau 2 : Disponibilité des données pour certains polluants atmosphériques urbains dans ÉPAHT.
| Plate-forme | SO2, NO2, O3 | PM2,5 | COV (spécifiés) | Métaux et oligo-éléments | CAP | SFPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au niveau du sol | 9 sites (6 sites pour SO2) | 9 sites (masse), 4 sites (spéciation) | 3 sites (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 1 site (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 1 site (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 3 sites (1 en temps réel) |
| Mobile | 3 plateformes | 3 plateformes | 1 plateforme | - | - | - |
| Colonne totale (au sol) | 6 sites | 6 sites (estimé à partir de la profondeur optique des aérosols) | 6 sites (HCHO uniquement) | - | - | - |
| Colonne totale (de l’espace) | Grille de 9 km 2 (TEMPO) ou 25 km2 (TROPOMI) (densité de la colonne verticale (VCD)) | 9 & 25 km2 (profondeur optique des aérosols (AOD) | 9 / 25 km2 (densité de la colonne verticale (VCD) pour HCHO uniquement) | - | - | - |
| Modèle de transport chimique (GEM-MACH) | 6 km2 grille | Grille de 6 km2 (masse et spéciation) | Grille de 6 km2 (agrégé, modification de la sortie du modèle nécessaire) | Grille de 6 km2 (Fe, Cu et Mn uniquement avec modification de la sortie du modèle) | 6 km2 grille | - |
La couverture la plus complète existera pour les quatre polluants soumis au système canadien de gestion de la qualité de l’air (SGQA) : SO2 , NO2 , O3 et PM2,5 . La couverture spatio-temporelle sera moins dense pour les autres polluants atmosphériques, mais permettra néanmoins des mesures simultanées et colocalisées d’un large éventail de polluants pertinents pour le mélange de pollution atmosphérique urbaine.
Une liste partielle des polluants et précurseurs d’ÉPAHT qui ne sont généralement pas mesurés ou modélisés dans le cadre des initiatives existantes (voir tableau 1) est présentée ci-dessous :
- particules fines spéciées à haute résolution temporelle
- carbone noir et brun des aérosols à haute résolution temporelle
- carbone élémentaire et organique dans les aérosols distribués en fonction de la taille
- ions majeurs dans les aérosols distribués par taille
- métaux et métalloïdes dans les aérosols distribués en fonction de la taille
- isotopes métalliques dans les matières particulaires en vrac et distribuées en fonction de leur taille
- mercure et isotopes spéciés dans les phases gazeuse et particulaire
- composés aromatiques polycycliques (CAP) et n-alcanes dans les aérosols distribués en fonction de la taille
- CAP substitués, y compris les alkyl-CAP et les oxy-CAP
- composés organiques volatils (COV) à haute résolution temporelle
- composés de chlore gazeux spécifiés à haute résolution temporelle
- composés azotés gazeux à haute résolution temporelle
- matières plastiques (microplastiques, nanoplastiques et particules d’usure des pneus)
- additifs pour plastiques/caoutchoucs (par exemple, les stabilisateurs ultraviolets à base de benzotriazole et autres additifs PMT [persistants, mobiles et toxiques])
- produits chimiques provenant de l’usure des freins
- esters organophosphorés
- carbazoles polyhalogénés
- SFPA (substances perfluoroalkylikes et polyfluoroalkylikes).
Résultats du thème 1 - Caractérisation
Ensemble de données de qualité contrôlée pour de multiples polluants dans le mélange atmosphérique urbain, disponible pour
- description et analyse de la variation spatio-temporelle
- l’étude des relations entre l’exposition et les facteurs socio-économiques
- identification de la source
- l’amélioration de la compréhension des phénomènes et processus atmosphériques
- évaluation et amélioration des modèles de transport chimique
- l’évaluation et le développement de méthodes de mesure
- des enquêtes toxicologiques et épidémiologiques.
L’application de l’ensemble de données de caractérisation aux activités susmentionnées est décrite ci-dessous dans les thèmes 2 (Sources et processus), 3 (Impacts) et 4 (Évaluation et amélioration des outils scientifiques), ainsi que dans la section 3 (Résultats : analyse, intégration et communication). L’ensemble des données sera ensuite mis à la disposition de la communauté scientifique élargie et du grand public (section 3) afin de faciliter les recherches supplémentaires et de fournir un ensemble de données complet des conditions actuelles pour de futures comparaisons rétrospectives.
2.4 Activités scientifiques sous le thème 2 - Sources et processus
La gestion de la pollution nécessite une connaissance crédible de ses sources et de leurs contributions à la charge de l’air ambiant. Comme la plupart des polluants atmosphériques sont soumis à divers processus atmosphériques qui les transforment physiquement et/ou chimiquement, les sources ne peuvent être comprises sans une connaissance détaillée de ces processus et de la manière dont ils agissent sur les échelles spatio-temporelles pertinentes pour les systèmes urbains.
Les informations sur les sources sont disponibles grâce à des inventaires ascendants tels que l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA) (voir tableau 1), et ces informations sur les émissions sont réparties dans l’espace et dans le temps pour obtenir les inventaires prêts à être modélisés qui alimentent les modèles de transport de substances chimiques tels que GEM-MACH. Malgré les efforts considérables déployés pour garantir la qualité et l’exhaustivité des inventaires ascendants, les lacunes dans les connaissances nécessitent l’utilisation de méthodes d’estimation. L’expérience récente dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca a mis en évidence des divergences entre les émissions déclarées dans les inventaires officiels ou les rapports des installations et celles déduites des conditions ambiantes pour les toxiques atmosphériques, les composés organiques volatils (COV), les particules et les gaz à effet de serre, entre autres (Parajulee et Wania, 2014 ; Galarneau et al, 2014 ; Li et al., 2017 ; Liggio et al., 2019 ; McLinden et al., 2020 ; Moussa et al., 2021 ; You et al., 2021 ; Wren et al., 2023). Ces résultats contribuent à l’amélioration des rejets officiellement déclarés. Les résultats de l’initiative ÉPAHT offriront des possibilités similaires de validation et d’amélioration des inventaires officiels et faciliteront les estimations d’émissions pour les polluants qui ne figurent pas sur les listes de composés inventoriés.
Les sources importantes de pollution atmosphérique dans les zones urbaines comprennent les émissions des véhicules à moteur, la combustion stationnaire, les rejets industriels, l’utilisation de pesticides, les émissions de la cuisine et la mobilisation de produits chimiques commerciaux tels que les retardateurs de flamme et les revêtements antiadhésifs provenant des espaces intérieurs et des installations de gestion des déchets. Les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique, tels que la transition vers des véhicules à zéro émission, entraînent une modification des émissions d’importants composés précurseurs de polluants (McDonald et al., 2018). Parallèlement, le nombre de produits chimiques commerciaux augmente de plus en plus rapidement (Persson et al., 2022), et nombre d’entre eux sont émis à des niveaux élevés dans les zones densément peuplées.
Les activités d’ÉPAHT visant à comprendre les sources d’émission et les processus atmosphériques qui les modifient sont détaillées ci-dessous.
2.4.1 Sources
ÉPAHT, grâce à sa campagne de terrain intensive de 2024, offre la possibilité de mesurer directement les polluants atmosphériques au niveau ou à proximité de leurs sources d’émission. Ces efforts comprendront des mesures mobiles ciblées des émissions non liées aux tuyaux d’échappement lors des déplacements sur route et des mesures stationnaires qui mettront en contraste les conditions de démarrage à froid et de fonctionnement dans un parking pour navetteurs. Les mesures stationnaires axées sur les sources mettront en contraste les particules dans des environnements proches de la route pour deux autoroutes ayant des parcs de véhicules diesel et essence différents (l’autoroute 401 et la Don Valley Parkway) et une intersection de route artérielle (la rue Keele près de l’Université York). Les mesures effectuées à proximité des routes porteront également sur les isotopes métalliques et l’ammoniac, tandis que les particules provenant de l’usure des pneus, qui représentent une préoccupation émergente en tant que polluant non lié à l’échappement des véhicules, seront mesurées sur trois sites fixes. Non seulement la campagne de terrain intensive d’ÉPAHT en 2024 fournira des mesures directes des polluants atmosphériques à proximité des sources, mais les partenaires de l’étude effectueront également des analyses supplémentaires après les mesures afin de mieux comprendre les sources de polluants. Ces efforts comprendront une analyse comparative des polluants observés avec l’ampleur et la localisation des rejets signalés dans les inventaires officiels, la modélisation des récepteurs pour comprendre les contributions des catégories de sources de COV, et l’analyse des quinones (oxy-CAP) pour déterminer l’importance des émissions primaires par rapport à la formation secondaire.
Projet 2.1 : Mesures sur un parking de banlieue comparant les émissions de démarrage à froid et de fonctionnement (Responsable : Felix Vogel, ECCC Division de la recherche climatique ; Collaborateurs/trices : Sébastien Ars, ECCC Division de la recherche climatique ; Debra Wunch et Matthew Adams, Université de Toronto)
Au cours des années précédentes, la plateforme mobile de la Division de la recherche climatique (DRC) a été utilisée pour déterminer les ratios d’émissions de CO/CO2 pour le parc de véhicules en mouvement dans la région du Grand Toronto et du Grand Montréal (Ars et al., 2020 ; Williams et al. 2022). Les ratios d’émission ont été attribués aux différents types de véhicules à l’aide des images des caméras embarquées. Cette analyse a révélé des écarts importants (rapports CO/CO2 plus faibles) entre les rapports d’émissions déclarés pour le secteur des transports routiers et les émissions observées du parc de véhicules, et ces écarts sont probablement attribuables aux émissions dues au démarrage à froid. Pour répartir correctement les rapports d’émission CO/CO2 entre les grands axes routiers, où les moteurs et les catalyseurs sont généralement optimaux, et les zones résidentielles, où se produisent les démarrages à froid, il est essentiel d’évaluer également les émissions dues aux démarrages à froid dans la région du Grand Toronto à l’aide d’observations directes. Dans le cadre d’ ÉPAHT, les plateformes mobiles de la DRC d’ECCC et Adams seront utilisées en mode stationnaire pour échantillonner l’air dans un parking de banlieue. Les plateformes seront équipées d’instruments capables de mesurer les ratios CO, CH4, particules, NO2, et BTEX par rapport au CO2 pour le parc de véhicules à l’arrivée (matin, moteur et catalyseur chauffés) et au départ (après-midi, moteur et catalyseur froids) dans toute une série de conditions météorologiques.
Projet 2.2 : Mesures des émissions à proximité d’une artère (Responsable : Mark Gordon, Université York)
Il a été démontré que les émissions de poussière de route et les émissions non liées à l’échappement dépendent des conditions de conduite (Beji et al., 2020) et que les traitements des routes en hiver ont un impact prolongé sur les émissions (Zhu et al., 2012). Pendant ÉPAHT, des mesures d’aérosols submicroniques résolues en taille, en plus des PM2,5, seront effectuées à l’angle de deux routes urbaines près de l’Université York (Keele Street et York Boulevard). L’analyse vidéo fournira des informations détaillées sur les conditions de circulation et les mesures d’aérosols seront étayées par des mesures de flux turbulents et de diffusion. Ces mesures hivernales seront comparées aux mesures printanières et estivales effectuées dans le cadre d’une campagne non apparentée (The CIX - Chercheure principale : Cora Young, Université York) ainsi qu’aux mesures hivernales effectuées dans le cadre d’ÉPAHT à proximité d’autoroutes présentant des caractéristiques de flotte contrastées (Autoroute 401 et Don Valley Parkway) afin de comprendre le rôle des différentes conditions de circulation. Il en résultera une amélioration de la caractérisation et des paramétrages du modèle des distributions de taille et des taux d’émission des poussières routières et des émissions non liées à l’échappement.
Projet 2.3 : Mesures des isotopes métalliques à proximité des routes (Responsable : Bridget Bergquist, Université de Toronto)
En milieu urbain, il est difficile de quantifier les sources de métaux dans les aérosols en raison du mélange complexe de sources locales et régionales. Traditionnellement, les concentrations de métaux, les corrélations et divers ratios dans les aérosols sont utilisés pour tenter d’identifier et de répartir les sources. Cependant, de nombreuses sources n’ont pas de suites distinctes de métaux, ce qui rend ces approches difficiles à appliquer dans des contextes complexes. Dans le cadre d’ÉPAHT, les mesures isotopiques des métaux dans les aérosols seront utilisées pour faciliter l’identification des sources. Les aérosols, fractionnés en taille et en vrac, seront collectés sur des sites fixes dans des environnements proches de la route pour contraster avec des échantillons provenant de différentes utilisations du sol dans la région du Grand Toronto, ainsi que sur un site de référence qui permettra de caractériser les signatures isotopiques des sources régionales. Les mesures isotopiques du plomb (Pb), du cuivre (Cu), du zinc (Zn) et du chrome (Cr) seront effectuées et devraient présenter d’importantes variations dans les compositions isotopiques qui sont principalement liées à la source. Parmi les systèmes d’isotopes métalliques, les isotopes de Pb sont ceux qui ont la plus longue histoire dans la répartition des sources et il existe de nombreuses études dans lesquelles les isotopes de Pb dans les aérosols sont utilisés avec succès pour identifier et quantifier les sources d’aérosols particulaires. La raison du succès de ce système isotopique métallique est qu’il s’agit d’un système isotopique radiogénique et que les différences isotopiques entre les sources, dues aux différences inhérentes entre les isotopes de Pb en fonction de l’âge et de la composition des sources, sont très importantes et plus faciles à mesurer par rapport à d’autres systèmes isotopiques métalliques. Les trois autres systèmes isotopiques sont des systèmes isotopiques stables dans lesquels les différences de composition isotopique sont le résultat de processus dans l’environnement qui fractionnent les isotopes. Étant donné que les métaux subissent des transformations et des biogéochimies différentes selon les matériaux d’origine (sols, matériaux industriels, matériaux de construction, gaz d’échappement des voitures, pneus), les sources ont souvent des compositions isotopiques différentes. Les isotopes de Cu et de Zn ont été utilisés en milieu urbain (San Paulo et Londres) pour différencier les sources d’aérosols telles que l’usure des pneus des autres sources industrielles. On en sait moins sur les isotopes de Cr dans les aérosols urbains, mais il s’agit d’un métal préoccupant et les isotopes de Cr varient suffisamment pour être utilisés dans les applications relatives aux eaux souterraines et aux sols. L’étude des isotopes de Cr est donc plus exploratoire. On s’attend à ce qu’une approche multi-métal isotope soit un outil puissant et nouveau pour l’identification des sources et la répartition des métaux dans les aérosols à Toronto, et qu’elle aide également à identifier les sources d’autres polluants associés à des sources similaires aux métaux.
Projet 2.4 : Caractérisation temporelle des émissions de particules provenant des tuyaux d’échappement et d’autres sources près d’une artère du centre-ville (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)
La modélisation des récepteurs basée sur des données de filtre d’un jour sur trois collectées de 2004 à 2016 dans le centre-ville de Toronto a révélé que la concentration de PM2,5 provenant de sources autres que les tuyaux d’échappement a augmenté de façon constante, dépassant les PM2,5 provenant des tuyaux d’échappement primaires en 2013. Dans le cadre de ce projet, des données à résolution temporelle de deux heures seront collectées à côté de College Street dans le centre-ville de Toronto en hiver et en été 2024, avec un moniteur de spéciation chimique des aérosols basé sur la spectrométrie de masse (ACSM, Aerodyne) et un moniteur de métaux basé sur la fluorescence X (XRF) (625 Xact, Cooper Environ). L’ACSM peut mesurer l’aérosol organique (OA) et l’aérosol inorganique (c’est-à-dire le sulfate, le nitrate et l’ammonium), tandis que le Xact peut mesurer les concentrations de K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Sr, Ba et Pb. Ces données seront combinées avec les données existantes dans la factorisation de matrice positive pour soutenir une étude à plus haute résolution temporelle des différences saisonnières dans les PM2,5. Ce projet devrait fournir des informations supplémentaires sur les modèles temporels (diurnes, week-end, saisonniers) dans le rapport entre les PM tuyaux et non-tuyaux. En outre, il pourrait aider à élucider les facteurs influençant la variabilité temporelle, tels que la façon dont la neige et le salage des routes influencent la composition et la concentration des PM2,5.
Projet 2.5 : Modèles spatiaux d’émissions véhiculaires de gaz d’échappement et autres que de gaz d’échappement (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)
Dans le cadre d’une étude parallèle IMPACT (Improved Assessment and Characterization of Traffic-Related Particulate Emissions) financée par Health Effects Institute, les modèles spatiaux du PM2,5 de tuyaux et non-tuyaux dans la région du Grand Toronto seront caractérisés à l’aide d’une combinaison de surveillance fixe et mobile. Grâce à ÉPAHT, nous étendrons cette recherche au cours de l’hiver 2024 afin d’accroître l’intégration des aspects avec d’autres projets ÉPAHT (par exemple, l’influence de la neige et du salage des routes).
L’échantillonnage mobile sera effectué à l’aide d’une Bolt électrique équipé d’instruments à haute résolution temporelle : PM2,5 (TSI DustTrak), PM10 (TSI DustTrak), particules ultrafines (Testo DiscMini), et carbone noir (Microaeth). Ce véhicule sera équipé de deux entrées, l’une sur la vitre arrière pour mesurer les concentrations de polluants dans l’air ambiant. Une seconde entrée mesurera les concentrations de PM2,5 et PM10 dans le passage de roue arrière. La différence entre ces deux mesures reflète l’ajout de polluants provenant de sources situées dans le passage de roue, telles que la poussière de pneu, la poussière de frein et la remise en suspension de la poussière de route. Pour ÉPAHT, la plate-forme d’échantillonnage mobile Adams sera également équipée pour l’échantillonnage des puits de roues afin de permettre une plus grande couverture spatiale de la ville à travers les itinéraires qu’elle suit. En outre, les PM2,5 et PM10 recueillies sur des filtres dans le passage de roue seront analysées pour détecter les marqueurs de l’usure des freins (Ba, Cu), de la poussière de route (Ca, Fe, Na) et des particules de pneu (6 PPD, DPG, DPQ). La Bolt prélèvera des échantillons sur un itinéraire aligné sur les sites fixes d’IMPACT (voir ci-dessous), afin d’étudier les sites censés présenter des niveaux contrastés d’émissions non-tuyaux. L’itinéraire d’échantillonnage sera également aligné sur les sites fixes d’ÉPAHT afin de faciliter l’intégration avec les autres projets d’ÉPAHT. L’échantillonnage aura lieu pendant six à dix jours au cours de la campagne de terrain d’ÉPAHT, de sorte que chaque segment de route sur l’itinéraire soit échantillonné au moins six fois.
Nous déploierons également sur 40 sites des échantillonneurs d’air personnels à ultrasons (UPAS) pour collecter les filtres PM2,5 et PM10 , ainsi que des badges Ogawa pour collecter les NO2 et les NOx. Ces échantillonneurs seront déployés sur des sites proches de la route censés présenter des niveaux contrastés d’émissions de tuyaux et non-tuyaux et, idéalement, des rapports différents entre les non-tuyaux et tuyaux. Les filtres de l’UPAS seront analysés pour détecter les marqueurs de l’usure des freins (Cu, Ba) et de la remise en suspension de la poussière routière (Ca, Fe). L’échantillonnage simultané des PM2,5 et PM10 à l’aide de deux UPAS servira à déterminer les différences entre la composition des PM fines et grossières. Les données sur les NO2 et les NOx provenant des badges Ogawa seront utilisées pour évaluer les émissions de gaz d’échappement. Ces données seront combinées pour mettre en évidence les différences de non-tuyaux/tuyaux sur les différents sites. Des données supplémentaires à haute résolution temporelle (5 minutes) seront collectées sur la moitié des sites à l’aide d’un réseau de 20 appareils AirSENCE. AirSENCE est une technologie de surveillance de la qualité de l’air basée sur des capteurs qui utilise un ensemble de capteurs pour mesurer les PM1, les PM2,5 et les PM10 , le CO2 , le CO, le NOx , et l’O3.
Projet 2.6 : Mesures à proximité de la route des particules d’usure des pneus dans l’atmosphère (Responsable : Alex Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Arthur Chan, Université de Toronto; Hayley Hung, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air).
Les particules d’usure des pneus (TWP) ont été reconnues comme l’une des principales catégories de pollution microplastique produite par le frottement entre les pneus et les surfaces routières. Ces particules non rejetées peuvent être transportées dans l’air et dans les eaux de ruissellement, ce qui entraîne une pollution de l’environnement et des problèmes de santé. Des études antérieures ont montré que les TWP peuvent contribuer à hauteur de quelques pourcentages en masse aux PM10 et PM2,5 en suspension dans l’air (Fussell et al., 2022), et leur contribution relative aux PM est probablement en augmentation en raison des diverses mesures d’atténuation des émissions de gaz d’échappement des moteurs. Une étude de modélisation mondiale a montré que le transport atmosphérique peut être une voie d’acheminement majeure des TWP vers des régions éloignées (par exemple, l’Arctique), avec une ampleur comparable au transport direct et fluvial total estimé des TWP vers l’océan (Evangeliou et al., 2020). Les TWP peuvent également servir de vecteur aux additifs chimiques (par exemple, le 6-PPD) et à ses produits de transformation (6-PPD-quinone), qui sont de nouveaux polluants préoccupants (Tian et al., 2021).
Dans le cadre d’ÉPAHT, des échantillons de filtres à particules atmosphériques seront prélevés dans des environnements proches de la route. Des techniques de spectrométrie de masse, notamment la spectrométrie de masse par pyrolyse et chromatographie en phase gazeuse (Pyr-GC/MS), seront utilisées pour mesurer la teneur en polymères de la bande de roulement et les additifs chimiques dérivés des pneus (tels que le 6-PPD) dans les échantillons de filtres. Les résultats seront analysés avec les données du trafic (par exemple, le volume du trafic et les types de véhicules) et d’autres mesures de polluants gazeux et de particules pour améliorer notre compréhension des caractéristiques de l’émission de TWP frais dans des environnements proches de la route en hiver.
Projet 2.7 : Résoudre le problème des émissions de l’aviation et du trafic en hiver (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateur : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto)
Des recherches menées dans plusieurs villes ont révélé des concentrations plus élevées de particules ultrafines (UFP) dans les régions entourant les aéroports. Ces contributions peuvent provenir des émissions des avions, du transport intermodal de marchandises et des niveaux de trafic plus élevés dans les zones entourant les aéroports. En outre, les concentrations de particules ultrafines provenant du trafic sont plus élevées en hiver qu’en été, probablement en raison d’une évaporation moindre et/ou d’une condensation accrue des composants volatils. Enfin, les avions et le trafic émettent également d’autres polluants tels que le NOx . Si les émissions de NOx des véhicules sont plus élevées en hiver, probablement en raison de la moins bonne performance des systèmes de traitement des émissions, on dispose de peu de données réelles sur l’influence de l’hiver sur les émissions des aéronefs.
Dans le cadre de ce projet, un Discmini sera déployé à l’aéroport Pearson pour mesurer les particules ultrafines, ainsi que deux échantillonneurs d’air personnels à ultrasons (UPAS) pour collecter les filtres PM2,5 et PM10, et une unité AirSENCE pour collecter des données à haute résolution temporelle sur les PM1 , PM2,5 et PM10 , CO2 , CO, NOx , et O3. Ces instruments seront utilisés en conjonction avec les données sur la direction du vent pour essayer de séparer les contributions aux concentrations de particules ultrafines de l’aéroport de celles du trafic sur l’autoroute 401 toute proche. Il pourrait également être possible de déterminer et de comparer les facteurs d’émission de ces deux sources. Les filtres de l’UPAS seront analysés pour les métaux afin d’évaluer les contributions des émissions non liées aux tuyaux d’échappement.
Projet 2.8 : Importance des émissions d’ammoniac (NH3 ) dans les gaz d’échappement des véhicules (Responsable : Ralf Staebler, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateur : Leiming Zhang, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Même si, à l’échelle nationale, les émissions de NH3 provenant des véhicules sont dérisoires par rapport aux émissions agricoles, elles peuvent être importantes à l’échelle locale/urbaine, en particulier à proximité des autoroutes, et jouer un rôle important dans la chimie atmosphérique locale. Ces émissions sont principalement dues aux convertisseurs catalytiques et ont été stimulées ces dernières années par l’introduction de la réduction catalytique sélective (SCR) pour les véhicules diesel. Des mesures antérieures effectuées près de l’autoroute 401 à Toronto (You et al., 2017) ont révélé des rapports de mélange allant jusqu’à 23 ppb grâce à des mesures FTIR à long trajet au-dessus de l’autoroute, avec un pic matinal moyen de 10 ppb. Étant donné la courte durée de vie atmosphérique du NH3 , des mesures directes à proximité de l’autoroute 401, associées à des mesures de la turbulence des véhicules, fourniront des données utiles sur les relations entre les schémas de circulation, la météorologie et les concentrations de NH3 afin d’éclairer les inventaires officiels et d’améliorer la compréhension de la formation d’aérosols dans les zones urbaines.
Projet 2.9 : Analyse comparative des polluants observés pendant ÉPAHT et déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Responsable : Alicia Berthiaume, ECCC Inventaire national des rejets de polluants - Division de l’information sur les substances)
L’INRP est un inventaire national des polluants rejetés par des sources ponctuelles institutionnelles dans l’air, l’eau ou le sol et/ou éliminés sur place ou transférés hors site à des fins de traitement, de recyclage ou d’élimination. Établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) (Canada, 1999), l’inventaire recueille les données des installations admissibles (>7000 en 2021, dans >280 secteurs industriels), conformément aux exigences de déclaration de l’INRP (Gouvernement du Canada, 2022a), et met les données à la disposition du public (Gouvernement du Canada, 2022b). Il s’agit de l’un des plus de 50 registres nationaux des rejets et transferts de polluants (RRTP) dans le monde, dont l’objectif est à la fois d’informer le public sur les émissions ou les éliminations de polluants à l’échelle locale ou nationale et d’aider à la prise de décision par les différentes parties prenantes/titulaires de droits dans le cadre de la gestion rationnelle des produits chimiques (CEE-ONU, 1998 ; 2009). En outre, comme d’autres RRTP à l’échelle mondiale, l’INRP peut contribuer directement à la réalisation de la cible 12.4 de l’Objectif de développement durable (ODD) 12 des Nations Unies, qui porte sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets en réduisant considérablement leurs rejets dans l’air, l’eau et le sol afin de minimiser les effets sur la santé humaine et l’environnement (Nations Unies, 2015; OECD, 2021). Toutefois, les lacunes en matière de qualité et d’exhaustivité des données d’inventaire limitent son utilité dans ce contexte (Berthiaume, 2021). Des recherches telles qu’ÉPAHT peuvent donc contribuer à combler ces lacunes, en améliorant non seulement l’INRP, mais aussi en créant des précédents qui permettront d’améliorer les RRTP à l’échelle mondiale et d’améliorer le suivi de l’ODD 12. Plus précisément, les substances et les mesures d’ÉPAHT seront comparées aux listes actuelles de substances de l’INRP et aux données déclarées afin d’identifier les lacunes dans la couverture des substances et, si possible, de valider les données annuelles déclarées au niveau local, d’améliorer les méthodes d’estimation (c’est-à-dire qu’elles soient très précises et techniquement/économiquement réalisables pour les déclarants), d’informer des améliorations potentielles des exigences de déclaration (par exemple, ajustements des seuils, ajouts de substances), des efforts de promotion de la conformité ou des mesures d’application potentielles. En outre, tout lien établi par ÉPAHT entre les rejets inventoriés et les impacts sur les humains et/ou l’environnement sera exploité pour situer les données de l’INRP dans le contexte des objectifs spécifiques des ODD et de la gestion nationale des produits chimiques en matière de minimisation des effets nocifs, et pour éclairer la mesure de la performance réglementaire.
Projet 2.10 : Modélisation des récepteurs des COV à l’aide de la factorisation à matrice positive (PMF) (Responsable : Samar Moussa, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air)
De nombreux composés organiques volatils (COV) sont connus ou soupçonnés d’être toxiques pour l’air, cancérigènes pour l’homme, irritants et liés à diverses maladies respiratoires (Gkatzelis et al., 2021). En raison de la complexité du mélange de COV dans l’air ambiant (sources de non-combustion ou de combustion; formation primaire ou secondaire), l’analyse des données sera difficile et nécessitera donc des niveaux d’analyse sophistiqués afin d’évaluer la contribution relative des différentes sources de COV au mélange de l’air urbain. Les mesures de COV provenant des trois sites ÉPAHT super-intensifs (High Park, Evergreen Brickworks et l’Université de Toronto Scarborough) seront analysées à l’aide d’une analyse par factorisation de matrice positive (PMF) afin de répartir les émissions de COV. L’outil PMF est un algorithme analytique bilinéaire qui sépare les séries temporelles de diverses masses en différentes sources représentées par des profils de facteurs, des séries temporelles de facteurs et des signaux résiduels non résolus par PMF. (Gkatzelis et al. 2021) Au cours d’ÉPAHT, l’analyse PMF sera effectuée et différents traceurs de sources de COV (par exemple, cuisine, soins personnels, circulation, chauffage au bois, etc.) En outre, étant donné que plusieurs sources peuvent présenter des schémas d’émission temporels et spatiaux similaires, des contraintes peuvent être utilisées pour isoler les émissions primaires des processus d’oxydation, et les profils des facteurs d’émission des sources mobiles d’autres sources non traditionnelles. Par exemple, les mesures effectuées à New York ont montré que même dans un environnement qui devrait être principalement dominé par les émissions de sources mobiles, il y avait de nettes augmentations des traceurs VCP (produits de consommation volatils) tels que le D5-siloxane et les monoterpènes (Coggon et al. 2021, Gkatzelis et al. 2021). Par conséquent, l’analyse PMF décrite ci-dessous par Gkatzelis et al. (2021) sera utilisée pendant ÉPAHT pour la répartition des sources de COV. Les profils de facteurs identifiés par l’analyse PMF seront comparés aux différents profils de COV utilisés dans GEM-MACH (par exemple VCP, combustion du bois, cuisson, mobile, etc.) et aux profils de l’inventaire des émissions de pollution atmosphérique. Les contributions des facteurs provenant des différentes sources de COV seront utilisées pour évaluer l’importance globale des différents facteurs dans un environnement urbain hivernal et peuvent également être comparées aux contributions des sources estimées par GEM-MACH.
Projet 2.11 : Contribution relative des oxy-CAPs primaires et secondaires (quinones) dans l’air ambiant (Responsable : Andrzej Wnorowski, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Les quinones sont des CAP contenant de l’oxygène que l’on trouve dans l’environnement à partir de sources d’émission primaires et de la transformation secondaire de HAP non substitués (Wnorowski 2017). La caractérisation du devenir des quinones est importante pour l’évaluation des risques, car des études ont démontré que les espèces oxydées sont plus nocives et plus persistantes que leurs HAP parents (Wang et al., 2011 ; Bandowe et al., 2014). Leur présence en tant que produits de transformation secondaires peut également nous aider à comprendre les processus de vieillissement des aérosols. À la suite des travaux menés dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca (Wnorowski et Charland, 2017 ; Wnorowski, 2017), les quinones seront mesurées sur plusieurs sites ÉPAHT dans les fractions granulométriques des PM, y compris les PM ultrafines et fines qui ont fait l’objet d’évaluations des risques pour la santé dans les environnements urbains. La détermination des relations entre les quinones et les autres polluants mesurés permettra de déterminer leurs contributions aux aérosols primaires et secondaires. Les profils de quinone observés seront en outre évalués pour être utilisés comme signatures représentatives de sources spécifiques. Les mesures effectuées dans le cadre d’ÉPAHT fourniront un point de référence pour les études futures sur les quinones et contribueront à la détermination d’une série élargie de CAP faisant l’objet d’une surveillance régulière, comme le recommande le récent Rapport sur l’état des connaissances sur les CAP dans l’environnement canadien (Galarneau, 2021). La teneur en quinone des particules réparties en fonction de leur taille permettra en outre d’évaluer la toxicité en fonction de la composition au moyen des techniques in vitro décrites dans le thème 3 (responsable : Errol Thomson, Santé Canada).
2.4.2 Processus atmosphériques
Le mélange de polluants urbains provient d’une combinaison de sources. Les émissions locales et transportées y contribuent, et les polluants peuvent être sous leur forme physico-chimique d’origine (primaire) ou transformés (secondaire) par divers processus atmosphériques. La compréhension des transformations physico-chimiques pertinentes est essentielle pour relier les concentrations ambiantes observées à leurs sources et à leurs formes futures. Dans le cadre d’ÉPAHT, les mesures visant à la caractérisation détaillée effectuée sous le thème 1 permettent en outre d’étudier un certain nombre de processus atmosphériques pertinents pour la compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains. Il s’agit notamment d’élucider les bilans de l’azote et du chlore et leur impact sur la formation des particules. L’effet de l’évolution du mélange de COV sur la formation de l’ozone et des particules sera également examiné. Bien que le carbone brun et les substances acidifiantes aient été largement étudiés en dehors des zones urbaines, les mesures effectuées dans le cadre d’ÉPAHT contribueront à documenter l’importance émergente de leurs sources et impacts urbains. Enfin, le traitement des polluants par le brouillard et les précipitations hivernales sera étudié pour une variété de polluants.
Bien que les polluants atmosphériques puissent être transformés chimiquement de composés primaires en composés secondaires, leur comportement dans l’atmosphère dépend également de phénomènes physiques. Afin d’améliorer notre compréhension et notre capacité de modélisation, les activités d’ÉPAHT étudieront les impacts de l’énergie cinétique turbulente, du mélange vertical, de la hauteur de la couche limite et de la turbulence induite par les véhicules, ainsi que le transfert de masse des composés semi-volatils sur l’ensemble du spectre granulométrique.
Projet 2.12 : Les budgets des composés contenant de l’azote et du chlore et leur impact sur la formation d’aérosols (Responsable : Sumi Wren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Jennifer Murphy et Jamie Donaldson, Université de Toronto; Jeremy Wentzell, Michael Wheeler, Craig Stroud, Colin Lee, Stefan Miller, et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
L’atmosphère urbaine hivernale se caractérise par une faible irradiation solaire et une faible humidité relative (par ex, moins de lumière solaire et de vapeur d’eau pour former le radical OH, qui est le principal moteur estival de la formation de polluants secondaires tels que l’ozone troposphérique et la fraction secondaire des PM2,5) ; des températures plus froides, qui favorisent les processus chimiques multiphasiques et influencent la répartition des gaz et des particules ; une couche limite souvent basse et stable (qui peut concentrer les polluants) ; une composition différente (mais mal définie) des COV urbains, due par exemple à des émissions plus faibles de substances biogènes telles que l’isoprène et les monoterpènes ; la couverture neigeuse ; et l’application d’agents de déverglaçage des routes (c.-à-d.. sel, sable). Ces conditions entraînent un déplacement chimique de la capacité d’oxydation de l’atmosphère par rapport à l’été (Haskins et al., 2019 ; Sommariva et al., 2021). Ces conditions hivernales distinctes ont également un impact sur les mécanismes de contrôle de la formation des particules (PM) et de leur spéciation en mode fin (PM2,5) et en mode grossier (PM10).
Cependant, l’importance des radicaux atypiques et de leurs précurseurs dans ces conditions hivernales, à Toronto, qui est un environnement urbain continental (sans influence marine) de latitude moyenne, n’est pas bien comprise (c’est-à-dire les rapports de mélange ambiants, les voies de formation, l’impact sur les polluants secondaires) ou bien représentée dans les modèles. Il s’agit notamment des précurseurs réactifs du radical chlore (par exemple, ClNO2 , HCl, Cl2 ), et HONO, HO2 NO2 et HCHO, qui sont des sources photolytiques de HOx (=OH + HO2 ). Des travaux antérieurs ont montré que la réaction multiphase de NO2 avec des particules contenant du chlorure pour former ClNO2 , qui se photolyse pour former des radicaux chlorés réactifs (Cl), contribue de manière significative au bilan des radicaux en hiver dans l’est des États-Unis (Haskins et al., 2019). L’épandage de sel de voirie est une source potentielle de chlorure particulaire (Mielke et al., 2011 ; Kolesar et al., 2018 ; McNamara et al. 2020) pour ces réactions multiphasiques, mais son importance n’est pas bien contrainte et n’est pas non plus prise en compte dans GEM-MACH. Les sources de production de HONO (par exemple, VandenBoer et al., 2014 ; Chen et al., 2020 ; Ye et al., 2017) et leur importance relative en général, et en particulier dans l’environnement urbain hivernal, restent également incertaines. Par exemple, la mesure dans laquelle la renoxification par photolyse des nitrates des particules (qui produit du NO2 et/ou du HONO) se produit est un débat ouvert (Shi et al., 2021). De même, l’absorption nocturne de NO2 dans l’aérosol pour former du nitrate de particules et du HONO peut être surestimée à tort par les modèles de transport chimique par rapport à la voie de l’hydrolyse de N2O5 (Travis et al., 2022). Les mesures détaillées prévues dans le cadre d’ÉPAHT permettent d’évaluer la représentation de cette chimie dans GEM-MACH.
Le nitrate d’ammonium (NH4NO3 ) est un composant majeur de la masse d’aérosols dans l’atmosphère urbaine hivernale (p. ex., Womack et al., 2019). On s’attend à ce que la production secondaire de nitrate d’ammonium en hiver dépende fortement de la température (par le biais de la constante de la loi d’Henry du NH3), mais on ne comprend pas encore bien les facteurs qui influent sur la répartition des particules de gaz du nitrate total (HNO3 + NO3- ) et du NHx total (NH3 + NH4+ ) dans l’atmosphère hivernale. Bien que les dépassements des PM2,5 en hiver soient principalement dus à des niveaux élevés de nitrate d’ammonium, le chlorure d’ammonium peut également contribuer de manière importante aux PM2,5 secondaires (Kelly et al., 2013). Les questions en suspens sont les suivantes : Quelles sont les fractions granulométriques des particules de nitrate et de chlorure et ces fractions sont-elles correctement représentées dans GEM-MACH? Le nitrate interagit-il avec le mode grossier? Comment la spéciation des particules est-elle influencée par les émissions de poussières routières et l’application d’agents de déverglaçage? Du chlore réactif est-il libéré des particules? Quelle est l’efficacité des stratégies d’atténuation existantes (c’est-à-dire la réduction des émissions de NOx) pour diminuer le nitrate d’ammonium (étant donné que l’on pense que sa formation se fait dans un régime sensible aux COV) (Womack et al., 2019) et quels sont les impacts de l’augmentation des émissions d’ammoniac?
En outre, le pH de l’aérosol en hiver (pH ~ 3) est plus élevé (modérément acide) qu’en été (pH ~ 2). Cette augmentation du pH a des répercussions sur l’absorption d’acides organiques (p. ex. oxalate) et d’autres espèces semi-volatiles, ainsi que sur la dissolution des métaux (p. ex. Fe et Cu) (Tao et Murphy, 2019). Quelle est l’importance du cycle diurne du pH des aérosols en hiver et GEM-MACH peut-il représenter cette variabilité du pH ? Quel est l’impact de l’augmentation des émissions de NH3 sur le pH et le pouvoir tampon des aérosols ? Quels sont les autres cations basiques présents et sont-ils correctement représentés dans GEM-MACH ?
Une série d’instruments ciblant les mesures en phase gazeuse et particulaire des espèces inorganiques sera déployée sur CRUISER/CAM-2 pendant les périodes d’échantillonnage super-intensif d’ÉPAHT à High Park, Evergreen Brickworks, et UTSC. Un spectromètre de masse à ionisation chimique à haute résolution et à temps de vol (Iodide CIMS) effectuera des mesures à haute résolution temporelle des halogènes inorganiques en phase gazeuse (par exemple, Cl2 , HCl, ClNO2 , Br2 , HBr, etc.) et des espèces azotées (par exemple, N2O5 , HONO, HNO3 , HO2 NO2 , etc.) L’instrument mesurera également les acides organiques en plus du HCN et du HNCO (qui sont tous deux des substances toxiques pour l’air dont les rapports de mélange sont mal connus en hiver, en milieu urbain). Les mesures de NO2 (LGR), NO (TECO) et de NOy (second TECO), effectuées au même endroit, permettront de clôturer une grande partie du bilan de l’azote impair (NOy), et un analyseur de phase gazeuse par spectroscopie d’absorption différentielle laser infrarouge accordable (TILDAS) mesurera le NH3 . Les mesures de la phase particulaire comprennent : la composition intégrée et résolue en taille des particules inorganiques (anions et cations) à partir d’un MOUDI à 11 étages (jusqu’à PM18 ) ; la spéciation intégrée (24 heures) des PM2,5 (mode fin) et des PM10 (mode grossier) (nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium, métaux, carbone organique et élémentaire) à partir d’échantillonneurs NAPS (Dąbek- Złotorzyńska et al, 2011) ; des mesures en temps réel et à haute résolution temporelle de la composition des aérosols à partir d’un AMS (PM1 ) - (NH4+ , SO42- , NO3- , Cl- , ORG) ; et la distribution de la taille des aérosols en temps réel (UHSAS, APS). En outre, l’échantillonnage régulier des ions inorganiques dans la neige (par chromatographie ionique) sur un site unique pendant les six semaines de la campagne fournira des informations sur l’importance des dépôts secs et humides en tant que processus d’élimination, ainsi que sur les concentrations d’ions pour la (photo)chimie dans les différentes couches du manteau neigeux et sur leur évolution dans le temps.
Ensemble, les instruments de mesure des gaz et des particules permettront de mieux comprendre le partage gaz-particules du nitrate total (HNO3 + NO3- ), du NHx total (NH3 + NH4+ ) et des espèces d’halogènes inorganiques, et contribueront à la caractérisation globale du mélange de polluants. Ces mesures visent à améliorer la compréhension des voies de formation, des rapports de mélange ambiants, des profils diurnes et de l’importance relative des espèces d’halogènes inorganiques et d’azote en phase gazeuse et en phase particulaire. Les mesures ambiantes seront interprétées dans le contexte de la localisation, de la météorologie et des données d’activité pertinentes (par exemple, l’épandage de sel de déneigement).
Les rapports de mélange et les profils diurnes mesurés seront comparés aux sorties GEM-MACH des espèces inorganiques d’halogène, d’azote (NOx , NOy , NO3- ) et de NH /NH4+3 dans la mesure du possible. Les profils diurnes modélisés et mesurés des COV et les rapports de mélange seront étudiés pour détecter les impacts de la chimie radicalaire atypique. En outre, les mesures ambiantes seront utilisées dans un modèle en boîte de chimie inorganique hétérogène hors ligne pour comprendre et valider la paramétrisation de la chimie (par exemple, les coefficients d’absorption, les dépendances de la température, les hypothèses) ; pour déterminer l’importance de l’inclusion d’une source de chlorure de particules dans les sels de voirie, et si un facteur d’émission induit par la météorologie peut être dérivé ; et pour améliorer la spéciation chimique de la poussière routière et la représentation des cations basiques dans le modèle. Les résultats de ces simulations donneront un aperçu des changements nécessaires pour améliorer les prévisions de GEM-MACH concernant les particules, l’ozone, les substances toxiques de l’air et les dépôts acides.
Projet 2.13 : L’impact des COV non émis, tels que les produits chimiques volatils (VCP), sur la formation d’aérosols organiques et le potentiel de formation d’ozone (Responsable : Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Patrick Hayes, Université de Montréal).
Les composés organiques volatils (COV) dans les zones urbaines jouent un rôle important dans la formation de O3 et d’aérosols organiques secondaires (SOA), une composante majeure des PM2,5, et peuvent donc avoir un impact sur la qualité de l’air. (McDonald, de Gouw et al. 2018) La réglementation des émissions des véhicules à moteur a entraîné une diminution des rapports de mélange de NOx et de COV dans les principales mégapoles d’Amérique du Nord et d’Europe. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les niveaux de COV et de NOx ont diminué respectivement de 51 % et de 40,5 % d’ici 2018 dans l’ensemble du Canada. Cependant, la réduction des niveaux d’ozone dans les mégapoles des États-Unis, d’Europe et du Canada commence à ralentir, ce qui suggère un changement dans le mélange de pollution de l’air vers un mélange dominé par des sources de non-combustion qui pourraient influencer l’efficacité de la production d’ozone (Khare et Gentner 2018, Coggon, Gkatzelis et al. 2021, Qin, Murphy et al. 2021). 2021) Avec le déclin des émissions de COV provenant de sources véhiculaires, les émissions de COV provenant de sources non traditionnelles, telles que les émissions de cuisson, les produits chimiques d’usure des pneus et des freins, et les produits chimiques volatils (PCV ; utilisés dans les produits de consommation, les produits ménagers, les produits de soins personnels, etc.), apportent une contribution relative plus importante à l’ensemble des COV urbains (McDonald, de Gouw et al. 2018, Gkatzelis, Coggon et al. 2021, Qin, Murphy et al. 2021) Des études récentes menées à Los Angeles ont montré que les VCP peuvent contribuer à hauteur de 50 % au total des COV dans les zones urbaines et jusqu’à 10 ppb d’ozone.(Coggon, Gkatzelis et al. 2021) Une étude récente menée à New York a montré que les émissions de VCP dues aux parfums ressemblent à celles émises par les forêts en été et représentent au moins 50 % de l’O3 attribuée aux VCP. (Coggon, McDonald et al. 2018, Coggon et al. 2021) En outre, les émissions de VCP et de cuisson contiennent une grande fraction d’espèces oxygénées dont le rendement en SOA est incertain.(Shah, Coggon et al. 2020) McDonald et al ont montré que les VCP pourraient être responsables d’au moins 50 % de la masse organique associée à la formation des SOA. (McDonald, de Gouw et al. 2018)
Les émissions de COV provenant de sources non traditionnelles et leurs produits de transformation dans l’air ambiant canadien ne sont pas encore bien comprises et leur contribution à la formation des SOA et au potentiel de formation d’ozone est sous-estimée. En outre, leurs émissions et leur chimie ne sont pas bien représentées dans le GEM-MACH et les inventaires nationaux. Il existe une lacune dans notre compréhension de la manière dont ces COV affectent la qualité de l’air dans les villes du Canada, d’autant plus que plus de 80 % des Canadiens vivent dans ces zones. Il est donc essentiel d’identifier et de quantifier les émissions de COV non traditionnels pour atténuer efficacement la pollution atmosphérique dans les villes et améliorer la santé des Canadiens.
Les mesures hivernales seront idéales pour estimer les émissions de COV hors échappement, car ces émissions ne seront pas influencées par les émissions biogènes de monoterpènes (traceurs de VCP pour les produits ménagers et les parfums) et par la chimie d’oxydation secondaire rapide.
Pendant ÉPAHT, un grand nombre de COV non traditionnels seront mesurés pendant les périodes d’échantillonnage super-intensif de deux semaines à High Park, Evergreen Brickworks et UTSC, et leur contribution au total des COV mesurés sera évaluée sur les trois sites au cours de l’étude. Les mesures en ligne des COV seront effectuées à l’aide d’un VOCUS-PTR-TOF avec des ions réactifs commutables (HO3+ et NH4+ ) qui sera déployé à bord du CRUISER. (McDonald, de Gouw et al. 2018, Gkatzelis et al. 2021) Le PTR est sensible à une large gamme d’espèces, y compris les composés oxygénés, les alcènes, les aromatiques et les espèces biogéniques. L’utilisation de NH4+ comme ion réactif permettra d’élargir la gamme des COV oxygénés mesurés (Khare, Krechmer et al. 2022). Les alcanes, les alcènes, ainsi que les isomères de COV qui ne peuvent être résolus par le PTR-ToF-MS seront mesurés à l’aide d’un GC en ligne AMA (en collaboration avec ON MEPNP) et d’échantillons de COV prélevés hors ligne par le RNSPA. Le PTR-ToF sera étalonné pour une large gamme de traceurs COV véhiculaires et non traditionnels (parfums, solvants, produits de soins personnels, produits de nettoyage, émissions de cuisson, combustion du bois, véhicules, liquides de lave-glace, peinture, solvants, etc...). Suivant la méthode décrite par Gkatzelis et al. 2021, les ratios d’augmentation des traceurs par rapport au benzène et les ratios d’émission (RE) par rapport au CO seront calculés (Gkatzelis, Coggon et al. 2021). Les émissions estimées seront ensuite utilisées pour évaluer les inventaires d’émissions de COV existants non liés à l’échappement (par exemple, les VCP et l’inventaire VCPy). En outre, les résultats des mesures ambiantes d’ÉPAHT seront utilisés pour fournir à GEM-MACH des taux d’émission actualisés provenant de sources de COV non traditionnelles, et pour obtenir de meilleurs profils de spéciation, qui seront utilisés pour évaluer leurs effets sur la formation des SOA et le potentiel de formation d’ozone. En outre, les mesures pourraient fournir au GEM-MACH des traceurs appropriés pour les COV non issus de la combustion et améliorer le regroupement des COV non traditionnels et des COVO dans le modèle. Des scénarios de réduction des émissions spécifiques aux sources (par exemple 10 %) dans GEM-MACH seront réalisés pour dériver la contribution de la source de la différence par rapport à un cas de base. Les résultats des mesures seront utilisés pour modifier la spéciation des émissions et le mécanisme chimique du modèle afin de mieux représenter les émissions de VCP et de COV dans le modèle en combinant les mécanismes générés par le KPP avec le GEM-MACH.
Projet 2.14 : Émissions primaires et formation secondaire du carbone brun atmosphérique (Responsable : Alex Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Jon Abbatt, Université de Toronto, Craig Stroud et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air).
Le carbone noir (BC) émis par les sources de combustion est reconnu comme l’un des principaux forçages climatiques à courte durée de vie dans l’atmosphère (Bond et al., 2013). Des études de modélisation récentes ont révélé que le carbone brun atmosphérique (BrC), la fraction absorbant la lumière des aérosols organiques (OA), peut avoir un impact important sur le réchauffement atmosphérique, équivalant jusqu’à ∼50 % du forçage radiatif positif causé par le BC ambiant, dans les régions où les émissions de BrC sont importantes (Feng et al., 2013, Wang et al., 2014). Toutefois, ces résultats sont entachés de grandes incertitudes en raison du manque de compréhension de leurs sources, de leurs processus de formation et de leur évolution dans l’atmosphère. Bien que la combustion de la biomasse ait été reconnue comme la principale source de BrC à l’échelle mondiale, il y a de plus en plus de preuves sur le terrain que les contributions d’autres sources primaires et processus secondaires au BrC dans les environnements urbains ne devraient pas être ignorées (Kasthuriarachch et al., 2020, Yan et al., 2017).
Pendant ÉPAHT, un spectromètre de masse de particules de suie (SP-AMS) sera déployé pendant les deux semaines de mesures super intensives à High Park, Evergreen Brickworks et UTSC. En raison de la capacité unique du SP-AMS à détecter simultanément et en temps réel le BC, l’OA, certains métaux (par exemple K, V, Ni) et les aérosols inorganiques, toutes les espèces d’aérosols mesurées seront intégrées dans l’analyse par factorisation à matrice positive (PMF) afin d’améliorer la répartition des sources de BC et d’OA (par exemple, le trafic local, le chauffage résidentiel au bois, la formation secondaire) sur plusieurs sites. En particulier, les signaux de BC et de métaux peuvent fournir des indications sur l’origine potentielle des émissions liées à la combustion fraîche/ancienne qui ne peuvent pas être facilement résolues par l’approche PMF conventionnelle (Rivellini et al., 2020). Avec la mesure des propriétés optiques des aérosols, y compris l’extinctiomètre photoacoustique et l’aethalomètre à longueurs d’onde multiples, les propriétés d’absorption de la lumière spécifiques à la source des BrC urbains primaires et secondaires seront déterminées en termes de section transversale d’absorption de masse (MAC) et d’exposant d’Ångström d’absorption (AAE) (Kasthuriarachch et al., 2020). Ces paramètres peuvent être utilisés comme entrées de modèle pour évaluer les impacts du BrC urbain sur l’absorption totale de la lumière des aérosols et l’étude de l’interaction entre la qualité de l’air et le climat.
Projet 2.15 : Impact des émissions urbaines sur le dépôt de substances acidifiantes (Responsables : Amanda Cole et Jason O’Brien, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaboratrice : Jennifer Murphy, Université de Toronto)
Les dépôts de composés azotés et soufrés de l’atmosphère vers la surface peuvent entraîner l’acidification et l’eutrophisation du sol et de l’eau, avec les conséquences qui en découlent sur la croissance et la diversité des plantes. Bien que les sites de surveillance à long terme des dépôts humides au Canada aient été délibérément situés de manière à minimiser l’impact des émissions locales, il en résulte un manque d’informations sur l’ampleur et l’impact des dépôts d’azote et de soufre sur les zones naturelles et semi-naturelles situées à l’intérieur et autour des zones urbaines. Des efforts ont été entrepris pour combler cette lacune dans certaines régions du monde (Decina et al., 2020), mais les données sur les gradients de dépôt d’azote dans les zones urbaines du Canada se limitent à une seule étude sur les gradients de dépôt sec (Zbieranowski et Aherne, 2012). Bien que limitées dans le temps, les six semaines de mesures sur deux sites de dépôt humide d’ÉPAHT (High Park et UTSC) permettront d’obtenir un ensemble de données des gradients de dépôt humide de NO3- , SO42- et NH4+ pendant l’hiver, lorsqu’elles seront combinées aux données des sites existants du RCEPA dans la région de Toronto. En outre, les mesures simultanées de NH3 , SO2 et NOx en phase gazeuse et de NO3 , SO42- et NH4+ liés aux particules permettront d’estimer les flux de dépôts secs et de quantifier les contributions relatives de chacun de ces composants aux dépôts totaux d’azote et de soufre, à des fins de comparaison avec des mesures similaires effectuées dans des zones rurales et éloignées (Zhang et al., 2008).
Projet 2.16 : Impact du traitement humide (précipitations, nuages et brouillard) sur les polluants urbains et les dépôts (Responsable : Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Michael Wheeler, Paul Makar, Craig Stroud, et Colin Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Les nuages jouent un rôle important dans le transport et la transformation des traceurs atmosphériques. Des études ont montré que la formation en phase aqueuse de sulfate et des SOA dans les gouttelettes des nuages et du brouillard peut contribuer de manière significative à la masse des aérosols ambiants. La mesure dans laquelle la transformation en phase aqueuse modifie les caractéristiques des aérosols n’est pas bien comprise, pas plus que les mécanismes pertinents (par exemple, la masse, la composition chimique, l’hygroscopicité et l’état d’oxydation) (Ervens et al., 2018). Les nuages jouent également un rôle dans la purification de l’atmosphère lorsqu’ils sont associés à des précipitations (c’est-à-dire l’élimination des traceurs en phase aqueuse des nuages par la production de précipitations, ou « rainout », et, sous les nuages, le piégeage des traceurs atmosphériques par la chute d’hydrométéores, ou « washout »). Les dépôts humides deviennent particulièrement importants en hiver, à basse température, pour certains contaminants organiques, car ils se répartissent davantage de la phase vapeur aux gouttelettes liquides, aux particules et aux surfaces neigeuses (par exemple, Lei et Wania, 2004).
Les représentations actuelles du traitement des gaz et des aérosols dans les nuages (absorption et répartition dans l’eau des nuages et chimie de la phase aqueuse) sont largement basées sur (et évaluées pour) des conditions estivales (chaudes). Dans des conditions hivernales, la répartition des gaz et des aérosols dans l’eau surfondue et la phase de glace n’est pas bien comprise ; la chimie de la phase aqueuse peut être différente à des températures froides, avec des polluants et des régimes de pH différents. Par exemple, des études ont indiqué que l’oxydation catalysée par les métaux de transition en phase aqueuse peut être importante dans les conditions hivernales lorsque l’activité photochimique est faible (Deguillaume et al., 2005 ; Itahashi et al., 2018). Récemment, les cations basiques et l’oxydation catalysée par les métaux de transition en phase aqueuse ont été ajoutés à GEM-MACH. Cependant, il n’y a pas eu d’évaluation des représentations du modèle pour le traitement du gaz et de l’aérosol dans les nuages hivernaux.
Bien qu’aucun échantillonnage direct dans le nuage ne soit prévu pour la campagne ÉPAHT, les échantillons de précipitations recueillis pour l’analyse des dépôts humides comprendront à la fois une composante de piégeage dans le nuage et une composante de piégeage sous le nuage. L’analyse des ions inorganiques et de certains ions organiques sur les échantillons de précipitations collectés sur les sites de dépôt humide proposés par ÉPAHT (et sur les sites régionaux environnants), en conjonction avec les mesures de gaz et d’aérosols spéciés prévues dans l’air ambiant, permettra de mieux comprendre le traitement en phase aqueuse du mélange de polluants atmosphériques urbains en hiver. En outre, les résultats des simulations GEM-MACH à haute résolution seront comparés aux données d’observation ÉPAHT afin d’évaluer et d’améliorer les représentations des processus humides dans les modèles.
Projet 2.17 : Interactions brouillard-polluants dans l’air urbain (Responsable : Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Michael Wheeler, Jason O’Brien, et Amanda Cole, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Rachel Chang, Université Dalhousie)
Le brouillard est souvent associé à une mauvaise visibilité qui peut entraîner des perturbations importantes dans les transports aériens, maritimes et terrestres. En fait, les pertes financières et humaines liées au brouillard et à la mauvaise visibilité peuvent être comparables aux pertes dues à d’autres phénomènes météorologiques violents (Gultepe et al., 2007). Une climatologie du brouillard sur 30 ans (1970-2004) a montré que la fréquence de formation du brouillard à l’aéroport Pearson de Toronto est élevée pendant les périodes d’octobre-novembre et de février-mars (Hansen et al., 2007). Il est bien connu que la visibilité est directement liée à la concentration du nombre de gouttelettes de brouillard (Nd ), qui est influencée par l’abondance et les caractéristiques physico-chimiques des aérosols ambiants (Gultepe et al., 2007). D’autre part, le brouillard contribue également à la transformation des gaz et des aérosols en phase aqueuse. Une étude récente sur la toxicologie des aérosols menée dans la vallée du Pô pendant la saison du brouillard hivernal a mis en évidence une toxicité accrue, ou une activité accrue des espèces réactives de l’oxygène (ROS), dans les aérosols traités par le brouillard (Decesari et al., 2017). Pendant la campagne ÉPAHT, la concentration en nombre et la distribution de taille des gouttelettes de brouillard seront mesurées à l’aide d’un moniteur de brouillard installé sur le pont d’observation de la Tour CN, ainsi que de granulomètres (SMPS et Grimm) afin d’étudier comment les aérosols urbains et régionaux influencent la formation et les caractéristiques du brouillard. En outre, un échantillonneur actif d’eau de brouillard sera utilisé pour collecter l’eau de brouillard en vue d’une analyse chimique des ions inorganiques par le CAPMoN afin d’élucider le traitement de la pollution atmosphérique urbaine et régionale par le brouillard. Ces mesures seront comparées à des simulations de modèles utilisant une version entièrement couplée de GEM-MACH afin d’évaluer la représentation du modèle de l’activation des aérosols et des interactions aérosol-nuage. Les mesures de la chimie de l’eau du brouillard seront également utilisées, en conjonction avec d’autres mesures de la chimie de l’air ambiant et des précipitations d’ÉPAHT, pour améliorer notre compréhension, et la représentation du modèle GEM-MACH, du traitement humide des gaz et des aérosols.
Projet 2.18 : Transformations des CAP déposés avec et sur la neige (Responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Bien que le modèle GEM-MACH fasse preuve d’une grande précision pour les CAP dans l’air ambiant (Galarneau et al., 2014 ; Whaley et al., 2018), les dépôts modélisés ne se comparent pas bien aux mesures disponibles, en particulier en hiver (Whaley et al., 2018). Cette situation est encore compliquée par les divergences entre les mesures hivernales qui observent le dépôt frais et le manteau neigeux vieilli (Tevlin et al., 2021). Afin de résoudre les divergences observées, les mesures CAP basées sur les événements et le manteau neigeux seront colocalisées sur les sites ÉPAHT. Les différences entre les méthodes d’échantillonnage seront interprétées en fonction des conditions météorologiques, des caractéristiques de la neige et des propriétés physico-chimiques dans toute la gamme des CAP examinés, afin d’améliorer les dépôts rapportés et la capacité de GEM-MACH à les modéliser.
Projet 2.19 : Évolution des substances toxiques semi-volatiles en fonction de la taille des particules (Responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de recherche sur la qualité de l’air)
Les composés aromatiques polycycliques (CAP) issus de la combustion de combustibles fossiles sont émis avec de fines particules de combustion (Alves et al., 2016 ; Horak et al., 2017 ; Cheng et al., 2019), alors qu’ils sont observés depuis longtemps dans tout le spectre granulométrique de l’air ambiant (par exemple, de Maio et Corn, 1966 ; Van Vaeck et Van Cauwenberghe, 1978). L’évolution de la taille des particules semble liée à la volatilité (Pistikopoulos et al., 1990 ; Offenberg et Baker, 1999), mais elle n’est pas bien comprise ou représentée dans les modèles de transport chimique. Les mesures précédentes effectuées à l’aide d’un impacteur en cascade ont été entravées par de petits volumes d’échantillons et des temps d’échantillonnage correspondants, mais un nouveau système d’impacteur en cascade à grand volume permet d’obtenir des échantillons de l’ordre de quelques heures. Le système sera déployé pendant ÉPAHT et les résultats concernant les CAP et d’autres groupes de composés organiques homologues (par exemple, les n-alcanes) seront évalués par rapport aux composés non volatils (par exemple, les traces de métaux). Les différences entre ces classes de composés seront interprétées à la lumière de la distribution globale de la masse des particules et des conditions environnementales telles que la température, afin de mieux comprendre les facteurs qui sous-tendent l’évolution de la taille des particules de composés semi-volatils dans l’air ambiant.
Projet 2.20 : Améliorer la compréhension de l’énergie cinétique turbulente et de la hauteur de la couche limite dans les environnements urbains (Responsable : Zen Mariani, ECCC Division de la recherche météorologique; Collaborateurs/trices : Ralf Staebler, Paul Makar, Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Sylvie Leroyer, Stéphane Bélair, ECCC Division de la recherche météorologique ; Mark Gordon, Université York)
La vérification et l’évaluation des résultats des modèles de prévision numérique du temps (PNT) sont cruciales pour les zones urbaines où les caractéristiques de la surface et le bilan énergétique diffèrent nettement des paysages naturels. Les résultats de l’énergie cinétique turbulente du modèle de prévision numérique du temps GEM d’ECCC dépendent fortement des schémas de paramétrage du modèle qui sont influencés par la rugosité et la topographie complexes de la surface dans les environnements urbains. Les observations LIDAR Doppler de la turbulence (mesurée depuis la surface jusqu’à la couche limite planétaire) peuvent être utilisées pour effectuer une vérification améliorée de la sortie de l’énergie cinétique turbulente du GEM à une résolution temporelle et spatiale sans précédent. En particulier, les limites inférieures de l’énergie cinétique turbulente du GEM et l’effet du mélange vertical dans le GEM-MACH seront comparés aux mesures d’ÉPAHT afin d’explorer les améliorations potentielles des deux modèles.
La hauteur de la couche limite (BLH) définit le volume d’air dans lequel les émissions de surface se mélangent et se diluent. Malgré son rôle essentiel dans la détermination des concentrations de polluants dans l’air ambiant, la hauteur de la couche limite est mal représentée dans les modèles météorologiques et de transport chimique. Les observations LIDAR Doppler permettent de détecter la hauteur de la couche limite en examinant la distribution verticale des vitesses. De telles observations LIDAR à plusieurs endroits fourniront des informations sur la variabilité spatio-temporelle de la hauteur de la couche limite à travers la GTHA et permettront d’évaluer et d’améliorer les modèles GEM et GEM-MACH.
Projet 2.21 : Etude des impacts de la turbulence induite par les véhicules dans l’environnement urbain proche de la route (Responsable : Ralf Staebler, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Zen Mariani, Sylvie Leroyer et Stéphane Belair, ECCC Division de la recherche météorologique; Paul Makar et Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Mark Gordon, Université York)
Il a été démontré que la turbulence induite par les véhicules (VIT) joue un rôle disproportionné dans la dispersion de la pollution générée par le trafic (cf. Makar et al., 2021). Les campagnes précédentes d’ECCC ont quantifié la VIT par des mesures mobiles avec CRUISER dans le trafic en mouvement, ainsi qu’à différentes distances perpendiculaires d’une grande autoroute (Gordon et al., 2012). Au cours d’ÉPAHT, la VIT sera étudiée à proximité de l’autoroute 401 au moyen d’une combinaison de mesures stationnaires. Un anémomètre sonique sera installé sur le toit de la remorque existante du site routier du RNSPA, face à la circulation en direction de l’est sur l’autoroute 401, pour une quantification continue in situ de la turbulence à quelques mètres de la route. Ces mesures ponctuelles viendront ancrer les données obtenues par un LIDAR à balayage HALO, installé sur le toit du site RNSPA Toronto Ouest (bâtiment Upper Garage), qui fournira des cartes tridimensionnelles des trois composantes du vent, de leurs variances et de l’énergie cinétique turbulente (TKE) dans l’air au-dessus et autour de l’autoroute. Cette série de mesures sera utilisée pour caractériser la VIT et évaluer une paramétrisation de la VIT récemment développée dans GEM-MACH pour les emplacements proches de la route.
Projet 2.22 : Évaluation des influences météorologiques sur les gradients de polluants liés au trafic près des routes (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateur : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto)
Des recherches antérieures ont montré que les concentrations de polluants atmosphériques liés à la circulation (TRAP) à 250 m sous le vent des grands axes routiers dépassent toujours celles en amont, ce qui indique que l’exposition de la population aux TRAP a une large empreinte autour des routes. Il a également été démontré que les métaux non-tuyaux présentaient un gradient en bordure de route beaucoup plus marqué que les polluants tuyaux, ce qui implique qu’il peut exister des différences entre l’exposition aux non-tuyaux et aux tuyaux dans ces environnements proches de la route. En outre, les épisodes de stagnation hivernale peuvent étendre considérablement l’empreinte spatiale de la région proche de la route. On en sait beaucoup moins sur les gradients verticaux de TRAP et encore moins sur la manière dont les stagnations hivernales influencent ces gradients.
Les gradients horizontaux de TRAP seront étudiés pendant ÉPAHT à côté de l’autoroute 401 sur le site du ON MEPNP. Au cours de l’hiver 2024, nous prélèverons des échantillons UPAS (PM2,5 et PM10 ) et Ogawa à différentes distances des routes afin de comparer les gradients de polluants tuyaux (NOx) et non-tuyaux (métaux). Des unités AirSENCE seront également déployées des deux côtés de l’autoroute pour collecter des données à haute résolution temporelle sur les PM1 , PM2,5 et PM10 , CO2 , CO, NOx , et O3 . Des données similaires seront collectées sur un site situé sur Allen Road. Les différences amont-aval seront utilisées pour déduire les taux d’émission de l’autoroute. Des unités AirSENCE supplémentaires peuvent être déployées le long du transect horizontal au MECP si l’énergie électrique est disponible. Le gradient vertical du TRAP sera étudié en déployant de petits instruments portatifs pour mesurer les PM2,5 (DustTrak II 8530) et le carbone noir (MA350), les particules ultrafines Discmini) à trois hauteurs au sommet (300 m), près du milieu (150 m) et près du bas (< 30 m) de la Tour CN.
Résultats du thème 2 - Sources et processus
- Facteurs d’émission, profils des sources et répartition spatio-temporelle des rejets provenant des gaz d’échappement des véhicules (démarrage à froid et fonctionnement), des émissions des véhicules autres que les gaz d’échappement et des COV autres que les gaz d’échappement
- Lieux d’émission vérifiés au sol pour les polluants de l’INRP déclarés par les installations
- Importance documentée de la chimie de l’azote, du chlore et des COV pour la formation de l’ozone et des particules secondaires en hiver
- Ampleur des contributions urbaines au carbone brun et aux dépôts acides
- Impact du traitement de la neige et du brouillard sur les polluants atmosphériques urbains
- Amélioration de la description de la turbulence atmosphérique et de la hauteur de la couche limite en milieu urbain
2.5 Activités scientifiques sous le thème 3 - Impacts
Bien que les incidences de certains polluants atmosphériques sur la santé humaine et environnementale soient bien quantifiées, les fourchettes d’exposition crédibles pour ces incidences restent incertaines et les effets d’interaction de l’exposition au mélange de polluants constituent un sujet de recherche actif (Giang et al., 2020 ; Fazakas et al., 2023). Plusieurs activités d’ÉPAHT visent à élucider les liens entre le mélange de polluants atmosphériques urbains caractérisé et les incidences négatives sur la santé humaine ou environnementale, et sont résumées ci-dessous.
Projet 3.1 : Relier le potentiel d’oxydation aux toxiques atmosphériques et aux contaminants à l’état de traces (Responsables : Tom Harner et Amandeep Saini, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Pourya Shahpoury, Santé Canada et Université Trent; Sabina Halappanavar, Santé Canada; Xianming Zhang et Cassandra Johannessen, Université Concordia; John Liggio, Samar Moussa, Jasmin Schuster et Craig Stroud, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air; Mark Parnis, Université Trent; Greg Evans, Université de Toronto)
Des échantillonneurs d’air passifs à disque en mousse de polyuréthane (PUF-PAS), qui recueillent des produits chimiques associés aux gaz et aux particules, ont été utilisés à Toronto dans le cadre de l’étude ATOUSA (2016-2019) pour évaluer plusieurs classes de toxiques/contaminants atmosphériques dans l’air urbain de différents secteurs et pour établir des liens avec les paramètres de toxicité, y compris, entre autres, le stress oxydatif (Halappanavar et al., 2021). Les classes chimiques mesurées comprenaient les CAP (Jariyasopit et al., 2019), les retardateurs de flamme (Saini et al., 2019) et leurs produits de transformation (Liu et al., 2021), les métaux traces (Gaga et al., 2019) et le carbone noir (Zhang et al., 2022). Récemment, Johannessen et al. (2023) ont recherché des antioxydants dans ces échantillons et ont révélé que plusieurs additifs pour pneus, notamment le DPG, les benzotriazoles et les benzothiazoles (entre autres), présentaient des concentrations élevées dans les sites influencés par la circulation ; en outre, le 6PPD et son produit de transformation, la 6PPD-quinone, ont été détectés dans l’air dans les sites influencés par la circulation. Le 6PPD et sa quinone provoquent une mortalité aiguë chez le saumon en raison du ruissellement sur les routes voisines lors d’événements pluvieux (Tian et al., 2020). Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’occurrence, au devenir, à l’exposition et aux risques pour la santé associés à la présence dans l’air de ces substances chimiques dérivées des pneus et de leurs produits de transformation (Zhang et al., 2022b ; Johannessen et al., 2022).
Le PUF-PAS sera déployé dans le cadre d’ÉPAHT afin d’évaluer les différences spatiales du potentiel d’oxydation (OP) dans la région du Grand Toronto (d’autres indicateurs de toxicité peuvent également être inclus). [Le PO est un indicateur de la santé des particules et est influencé par les niveaux de plusieurs classes chimiques, y compris les métaux traces et les quinones (qui peuvent inclure des produits de transformation des CAP et d’autres produits chimiques). Dans le cadre d’ÉPAHT, l’OP sera évalué à partir d’échantillonneurs PUF-PAS, au lieu des échantillons de filtres conventionnels provenant d’échantillonneurs actifs (Shahpoury et al., 2019, 2021, 2022, 2023 ; Jeong et al., 2020 ; Weichenthal et al., 2019). Cela permettra d’obtenir des échantillons intégrés dans le temps provenant d’un plus grand nombre de sites et devrait permettre de capturer la capacité pro-oxydante des produits chimiques particulaires et gazeux. Les résultats de l’OP seront interprétés à l’aide des données de caractérisation chimique des aérosols, par exemple les métaux traces mesurés dans le PUF-PAS. Outre l’évaluation de l’OP dans les différents secteurs urbains, l’un des principaux objectifs de ces travaux est de mettre au point des méthodes de prédiction de l’OP basées sur l’analyse de régression et de tester les modèles d’OP existants (Lelieveld et al., 2021 ; Shahpoury et al., 2023b).
En s’appuyant sur les travaux de Johannessen et al. (2022b, 2023), les échantillons de PUF-PAS provenant des sites ÉPAHT (y compris les études de transects spatiaux sur la Tour CN et l’autoroute 401) seront analysés pour une série de produits chimiques d’usure des pneus et leurs produits de transformation à l’aide d’un LC-Orbitrap à haute résolution (Johannessen et al., 2022). Le criblage ciblé à haute résolution s’appuiera sur les données expérimentales récentes issues des expériences d’oxydation menées par Liggio et al (en préparation) et Moussa et al (en préparation). En outre, un criblage non ciblé des échantillons de PUF-PAS sera effectué et contribuera à l’interprétation future des résultats (Zhang et al., 2020).
Projet 3.2 : Potentiel d’oxydation des particules provenant d’échantillons de terrain et de sources connues (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto ; Tom Harner, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Des recherches antérieures ont montré que les différents tests de potentiel d’oxydation (OP) réagissent différemment aux différents composants des PM, le test de l’acide ascorbique (AA) réagissant davantage aux métaux, en particulier au Cu, et le test du dithiothréitol (DTT) réagissant davantage aux substances organiques.
Dans ce projet, nous mesurerons l’OP des particules à partir d’échantillons de terrain collectés pendant ÉPAHT et de sources connues en utilisant trois tests (AA, GSH, DTT). Cette analyse inclura l’OP des poussières routières remises en suspension et collectées dans les passages de roues des véhicules lors de l’échantillonnage mobile et des filtres collectés sur des sites fixes à travers la ville. La solubilité dans l’eau des métaux présents dans certains de ces échantillons sera également évaluée, de même que l’OP des échantillons de particules extraits dans l’eau plutôt que dans le méthanol. L’OP des échantillons de terrain et des particules provenant de sources connues sera comparé aux valeurs précédemment mesurées pour les particules ambiantes sur 40 sites à travers le Canada. En outre, les valeurs OP seront comparées aux valeurs des échantillons PUF-PAS prélevés aux mêmes endroits (par ex. ON MEPNP, aéroport Pearson) dans le cadre du projet ÉPAHT 3.1.
Le potentiel oxydant de ces échantillons de terrain sera également comparé à celui d’échantillons de laboratoire générés à partir de sources connues, telles que des échantillons de pneus et de poussière de route. Ces échantillons générés en laboratoire feront également l’objet d’une caractérisation chimique détaillée afin de mieux comprendre les composés chimiques contribuant à l’OP observé. Nous analyserons la teneur en métaux des tranches de pneus par XRF et utiliserons la spectrométrie de masse à chromatographie gazeuse par pyrolyse sur des échantillons de caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et de caoutchouc butadiène (BR) afin d’identifier les marqueurs spectraux de masse. Cette même méthodologie sera ensuite appliquée à des échantillons d’air ambiant, de poussière de route et de particules de roues afin d’identifier et de quantifier les contributions des particules de pneus. Ces études en laboratoire compareront plusieurs méthodes et marqueurs potentiels des particules de pneus, puis les appliqueront à des échantillons du monde réel provenant de sources multiples, dans le but d’identifier un substitut permettant de résoudre plus facilement les contributions des particules d’usure de pneus.
Projet 3.3 : Évaluation de la toxicité in vitro des substances toxiques et des contaminants à l’état de traces présents dans l’air à proximité des routes et dans les zones urbaines de fond (Responsable : Errol Thomson, Santé Canada; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
La toxicité des particules ambiantes dépend non seulement des concentrations massiques, mais aussi de leurs caractéristiques physicochimiques, qui sont elles-mêmes fonction de la source. À la suite de travaux menés dans des sites canadiens présentant diverses sources urbaines et industrielles (Thomson et al., 2015 ; 2016), le pouvoir toxique relatif des particules fractionnées par taille collectées à proximité de conditions contrastées sera examiné et mis en relation avec la composition. Les particules en suspension dans l’air fractionnées par taille seront collectées par des impacteurs en cascade à grand volume sur des sites proches des émissions fraîches des véhicules et plus loin sous le vent, là où les émissions des véhicules se sont mélangées à d’autres sources urbaines. La collecte d’échantillons permettra de réaliser des analyses toxicologiques et d’évaluer l’évolution physico-chimique résultant du traitement atmosphérique. Les échantillons collectés seront analysés pour les polluants liés à la toxicité (par exemple, les métaux et métalloïdes), les composés aromatiques polycycliques, etc.), y compris les traceurs chimiques de l’usure des freins et des pneus. Les mesures effectuées au même endroit par les collaborateurs d’ÉPAHT fourniront un ensemble complet de mesures conventionnelles de la qualité de l’air, y compris les trois polluants de la cote air santé (O3 , PM2,5 et NO2 ), ainsi que plusieurs composés en phase gazeuse et particulaire. Les collaborateurs fourniront également les résultats de modèles de transport chimique à petite échelle qui décrivent les variations spatio-temporelles et permettent ainsi de suivre les émissions et leur dispersion. L’exposition in vitro de modèles pulmonaires pertinents sera effectuée sur une gamme de doses avec des matériaux de référence standard, et une batterie d’essais couvrant la cytotoxicité, le stress oxydatif, la réponse inflammatoire et le profilage de l’ARNm sera évaluée, avec des essais supplémentaires spécifiques effectués en fonction des besoins en données et/ou selon les indications de l’écran initial. Les estimations de puissance seront régressées en fonction de la composition des particules afin d’identifier les déterminants potentiels des effets.
Projet 3.4 : Identifier les dépassements des lignes directrices de qualité de l’air basées sur la santé (Responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaboratrice : Amanda Giang, Université de la Colombie-Britannique)
Le risque d’effets néfastes sur la santé est souvent évalué en comparant les concentrations de polluants dans l’air ambiant à des lignes directrices basées sur la santé. Bien qu’il n’existe pas de telles lignes directrices au niveau national ou fédéral, d’autres seuils peuvent être utilisés pour examiner les incidences potentielles. Diverses substances toxiques de l’air, dont le benzène et d’autres COV, les HAP et les métaux, font l’objet de directives provinciales basées sur la santé. Les critères de qualité de l’air ambiant (CQAA) de l’Ontario comprennent le plus grand nombre de polluants soumis à de telles limites au Canada (Galarneau et al., 2016). Les CQAA comprennent également les quatre polluants gérés dans le cadre du SGQA (SO2, NO2, O3 et PM2,5) pour lesquels certaines valeurs seuils sont conformes aux Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) (CCME, 2022) qui intègrent des considérations de réalisabilité et de santé. Les concentrations ambiantes des polluants soumis aux lignes directrices pertinentes seront évaluées pour les dépassements individuels et pour les dépassements cumulés du mélange de polluants. Pour le sous-ensemble de polluants pouvant être simulés à l’aide de GEM-MACH, la distribution spatiale des dépassements individuels et cumulés sera également développée à une résolution fine (2,5 km). Pour les polluants qui ne font pas l’objet de directives, les données ÉPAHT seront interprétées à l’aide de méthodes qui contextualisent les polluants par rapport à leur gamme de concentrations observées (Soares et al., 2018 ; Wren et al., 2020), entre autres techniques, ce qui permettra de donner une indication des impacts potentiels et de leurs différences à l’échelle de la ville. Ensemble, ces mesures fourniront des informations sur la charge de la pollution atmosphérique à différents endroits de la ville et permettront en outre d’interpréter cette charge en fonction de l’utilisation des sols, des émissions et des caractéristiques démographiques locales.
Projet 3.5 : Détermination des relations épidémiologiques entre l’exposition aux polluants atmosphériques et les effets néfastes sur la santé (Responsable : Markey Johnson, Santé Canada; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Des informations spatio-temporelles fiables sur les concentrations de polluants permettent d’examiner les relations entre les effets néfastes sur la santé et l’exposition à la pollution. Les ensembles de données multipolluants développés dans le cadre d’ÉPAHT seront examinés pour déterminer s’ils conviennent comme surfaces d’exposition pour les enquêtes épidémiologiques et, le cas échéant, seront utilisés pour mieux comprendre l’incidence et les effets des maladies en fonction de l’exposition à un seul ou à plusieurs polluants.
Projet 3.6 : Évaluation des effets de l’eau de fonte des neiges sur les embryons d’amphibiens (Responsable : Stacey Robinson, ECCC Division de recherche en toxicologie de la faune; Collaborateurs/trices : Hayley Hung et Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Roxana Suehring, Toronto Metropolitan University)
Des dépôts atmosphériques de contaminants atmosphériques dans la neige ont été constatés (Radke et al. 1980, Franz et Eisenreich 1988, Vasic et al. 2012, Nazarenko et al. 2017) et peut suivre un gradient avec des concentrations plus élevées dans la neige recueillie plus près des sources de polluants (p. ex., Kelly et al. 2010). La fonte des neiges peut contribuer de manière substantielle aux étangs éphémères et à certains étangs pérennes (Meyer et Wania, 2008 et 2011) qui pourraient être utilisés par les amphibiens indigènes du Canada pour se reproduire et se développer à travers les stades de la vie aquatique. Les effets des mélanges de contaminants issus de la fonte des neiges sur les réponses pertinentes pour la condition physique des amphibiens n’ont pas encore été évalués, mais ils peuvent constituer une exposition très pertinente pour les premiers stades de vie (c.-à-d. les embryons) des amphibiens qui se reproduisent au début du printemps dans les zones urbaines.
L’objectif de notre étude est d’évaluer les effets de l’eau de fonte des neiges provenant de sites urbains reflétant un gradient de pollution atmosphérique dans la région du Grand Toronto sur le succès d’éclosion, les malformations, la survie et l’expression génétique des embryons de grenouille léopard (Rana pipiens). Plus précisément, les embryons seront exposés à 100 % d’eau de fonte des neiges pendant 96 heures ou jusqu’à l’éclosion, évalués pour les malformations et les changements dans l’expression des gènes à l’aide de la nouvelle puce EcoToxChipMC de la grenouille léopard (https ://www.ecotoxchip.ca/). L’évaluation des effets apicaux et moléculaires des polluants atmosphériques présents dans la fonte des neiges aidera à comprendre le risque que représente la pollution atmosphérique hivernale pour les amphibiens qui utilisent les écosystèmes aquatiques urbains.
Projet 3.7 : Évaluation de l’impact des contaminants traces aéroportés sur la santé des poissons urbains (Responsable : Gérald Tetreault, ECCC Division de la recherche sur les contaminants aquatiques; Collaborateurs : Hayley Hung, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Zhe Lu, Université du Québec à Rimouski; Trevor VandenBoer et Cora Young, Université York ; Roxana Suehring, Toronto Metropolitan University)
Les produits chimiques émergents qui sont appliqués aux produits commerciaux, y compris les retardateurs de flamme, les plastifiants et les répulsifs contre les déversements d’huile et d’eau, sont associés aux populations urbaines (Venier et al., 2019 ; Rodgers et al., 2023 ; Li et al., 2017). Bon nombre de ces produits chimiques sont préoccupants car ils peuvent se déposer de l’atmosphère dans les écosystèmes aquatiques et terrestres urbains et se bioaccumuler dans le réseau trophique, ce qui a des effets néfastes sur la faune urbaine (Szabo et al., 2022 ; Knudtzon et al., 2021) et les humains (Domingo et Nadal, 2019). En outre, Tian et al. (2020) ont rapporté qu’une 6-PPD-quinone (6-PPDQ), un produit de transformation d’un antioxydant commun appliqué au caoutchouc des pneus pour prévenir la dégradation et la fissuration du caoutchouc, induit une toxicité aiguë pour le saumon coho dans le nord-ouest du Pacifique. Ces quinones dérivées du caoutchouc sont connues pour être présentes dans les eaux réceptrices affectées par le ruissellement et ont également démontré des effets (réduction du succès d’éclosion, de la survie, de la croissance) lors d’expositions en laboratoire chez le tête-de-boule (Pimephales promelas) (Prosser et al., 2017). De nombreux autres produits chimiques sont ajoutés aux polymères et aux plastiques, par exemple les stabilisateurs UV à base de benzotriazole (BT-UV) sont ajoutés pour empêcher les matériaux de changer de couleur ou de se dégrader sous l’effet des UV. On sait peu de choses sur le transport environnemental, le dépôt, le devenir et les impacts de ces produits chimiques émergents dans l’écosystème aquatique urbain.
Dans le cadre d’ÉPAHT, notre équipe étudiera les interactions air-précipitation-eau-sédiment-poisson de ces produits chimiques émergents afin de mieux comprendre le devenir et les effets environnementaux de ces substances en milieu urbain. Des échantillons d’air et de précipitations seront collectés à proximité de systèmes aquatiques urbains (par exemple, l’étang Grenadier, la rivière Don). Simultanément, l’eau et les sédiments seront échantillonnés dans ces systèmes aquatiques, si possible. Les échantillons atmosphériques et aquatiques seront analysés pour déterminer la présence de substances per- et polyfluoroalkylikes (SPFA) (répulsifs contre les déversements d’huile et d’eau), d’esters organophosphorés (retardateurs de flamme et plastifiants), de BT-UV, de filtres UV (utilisés dans les écrans solaires et les produits de soins personnels), de carbazoles polyhalogénés (PHCZ), de produits chimiques pour l’usure des pneus et des freins, y compris le 6-PPD, le 6-PPDQ et d’autres additifs pour plastiques et caoutchoucs, ainsi que d’autres contaminants persistants, mobiles et toxiques (PMT). Une analyse écotoxicologique sera réalisée à l’aide de « tests de toxicité pour les embryons de poissons (FET) utilisant des plaques de culture de tissus » (développement embryonnaire et éclosion) (OCDE, 2013), afin de comprendre les effets de ces substances sur l’habitat urbain. Les résultats de cette étude permettront d’identifier et de quantifier les sources atmosphériques, les dépôts et les impacts des produits chimiques commerciaux sur les systèmes aquatiques urbains. En outre, les résultats peuvent fournir des informations sur les charges atmosphériques de ces produits chimiques dans les Grands Lacs voisins, la ressource d’eau douce la plus importante d’Amérique du Nord, qui est affectée par les contaminants émis par certaines des plus grandes villes du Canada (y compris Toronto) et des États-Unis le long de ses côtes.
Projet 3.8 : Évaluation de la charge en contaminants à l’état de traces et des liens avec l’altération de l’état de santé des mammifères semi-aquatiques (Responsable : Philippe Thomas, ECCC Division de l’écotoxicologie et de la santé de la faune; Collaboratrice : Esther Attard, Services animaliers de Toronto)
De récents rapports in vitro sur la pollution atmosphérique urbaine suggèrent des effets sur le stress oxydatif, les réactions pro-inflammatoires et toxicogénomiques telles que les effets transcriptomiques et la cytotoxicité dans les lignées cellulaires de vertébrés (Shahriyari et al., 2022 ; Halappanavar et al. 2021). Cette situation a suscité des inquiétudes quant aux effets sur la santé des humains et des animaux sauvages des mélanges complexes de contaminants organiques et inorganiques présents dans la pollution atmosphérique urbaine. Ajoutée aux effets cumulatifs d’autres facteurs de stress environnementaux tels que la fumée des feux de forêt, le changement climatique, la dégradation et la fragmentation des habitats dans les parcs urbains et les ceintures vertes, la pollution atmosphérique urbaine peut avoir un impact négatif sur la santé, le comportement, la distribution, les populations et les communautés des espèces de mammifères.
Le rat musqué (Ondatra zibethicus) et le castor (Castor canadensis) sont d’importants animaux à fourrure semi-aquatiques que l’on trouve couramment dans les parcs urbains, près des marinas et des zones humides. Le vison (Neovison vison) est un carnivore de niveau trophique supérieur qui se nourrit de poissons et bioaccumule facilement les polluants environnementaux, tous endémiques dans la région du Grand Toronto. Une étude réalisée en 2003 sur des rats musqués vivant dans des paysages perturbés par l’industrie dans le nord de l’Ontario a révélé que les concentrations dans les tissus des rats musqués peuvent être en moyenne 2 fois et 3 à 6 fois plus élevées que les valeurs de fond et que l’on pense qu’elles reflètent les accumulations résultant de la contamination de la chaîne alimentaire dans les marais régionaux, y compris les niveaux dans les peuplements de quenouilles (Typha latifolia) - leur principale source de nourriture - et les sédiments qui peuvent être ingérés accidentellement pendant qu’ils se nourrissent (sédiments qui pourraient provenir en partie des dépôts atmosphériques de particules en suspension dans l’air) (Parker, 2003). Les modifications de l’état physiologique ou « sanitaire » résultant de l’exposition aux contaminants environnementaux peuvent influencer la manière dont les espèces de mammifères réagissent aux mélanges de contaminants après l’exposition, certaines des conséquences négatives de l’exposition étant probablement amplifiées par un état de santé plus médiocre et une capacité métabolique altérée.
En collaboration avec les Services animaliers de Toronto, des cadavres de rats musqués, de castors et de visons sont collectés dans toute la ville. Après un bref examen et l’administration de pentobarbital (si l’euthanasie est nécessaire) par le vétérinaire de service, les carcasses sont congelées à -20o C jusqu’à ce que des nécropsies et des échantillons de tissus soient prélevés au Centre national de recherche sur la faune (ECCC-Université Carleton, Ottawa, ON). Grâce à ces nécropsies, nous recueillerons des données morphométriques (poids, longueur, indice gonadosomatique, indice hépatosomatique, etc.) et des échantillons de tissus (foie et muscle) pour mesurer les contaminants qui intéressent ÉPAHT, mais aussi pour obtenir de l’ADN en vue d’analyses génétiques moléculaires. Chez les femelles, l’utérus sera prélevé afin d’évaluer l’état de gestation par identification visuelle des fœtus in utero ou par comptage des cicatrices placentaires. Les fœtus éventuels seront également prélevés pour l’analyse des contaminants. Si possible, les ovaires seront clampés à froid et conservés dans l’azote liquide (si possible) pour l’histologie, l’évaluation des lésions ovariennes et le séquençage de l’ADN.
Dommages pulmonaires et RNA-Seq : Des études récentes ont mis en évidence une association entre l’exposition à la pollution atmosphérique urbaine, les PM2,5 et les dommages pulmonaires. En fait, le stress persistant du réticulum endoplasmique est un mécanisme qui provoque des lésions pulmonaires lors de l’exposition aux PM2,5. Le gène Nrf2 facilite les lésions pulmonaires lors de l’exposition aux PM2,5 et le métabolisme CYP2E1 est impliqué dans ce processus. Les gènes en amont et en aval de cette voie, tels que le GRP94, sont également affectés par l’exposition aux PM2,5, avec des effets en cascade sur le stress inflammatoire et oxydatif dans les poumons (Ding et al. 2021). Afin de déterminer les voies moléculaires impliquées dans certains des effets biologiques mesurés chez les mammifères prélevés, nous effectuerons des analyses RNA-Seq (Université McMaster « Genome Facility ») dans les tissus pulmonaires d’animaux exposés à des contaminants préoccupants à des niveaux élevés (c’est-à-dire des résidus dans les tissus supérieurs au 90e centile) et faibles (c’est-à-dire des résidus dans les tissus inférieurs au 10e centile). Les informations issues des analyses RNA-Seq serviront de base à l’analyse des voies, des ensembles de gènes et de l’enrichissement de la Gene Ontology à l’aide de la suite « Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery », y compris l’examen des voies de régulation définies dans l’encyclopédie de Kyoto des voies des gènes et des génomes. Cette approche nous permettra d’identifier les gènes dérégulés, à l’échelle du génome, dans les poumons des animaux exposés aux contaminants préoccupants d’ÉPAHT par rapport à un groupe de référence moins exposé. Nous effectuerons une analyse de l’ontologie des gènes dérégulés pour trouver des similitudes et des différences dans les voies moléculaires et les réseaux fonctionnels qui sont perturbés par chaque paradigme d’exposition. Comme nous le faisons régulièrement dans d’autres études, nous confirmerons les données d’expression génomique en sélectionnant au hasard 5 à 10 % des cibles identifiées et en les soumettant à des essais de validation d’un seul gène par transcription inverse de la PCR en temps réel (RT-PCR). Ces données éclaireront les futures études mécanistiques et fourniront les informations nécessaires sur les biomarqueurs d’effets biologiques précoces, utiles aux programmes de surveillance de la pollution atmosphérique urbaine.
Dommages aux ovaires : Pour déterminer si l’exposition aux contaminants préoccupants d’ÉPAHT a des effets néfastes sur les ovaires, nous examinerons les changements dans le poids des ovaires et l’histopathologie ovarienne à l’aide de techniques bien établies par notre groupe. Nous déterminerons la quantité d’atrésie folliculaire (TUNEL), le nombre de follicules primaires, en croissance et antraux et la présence de follicules kystiques ou de rete ovarii. Les ovaires seront immunocolorés pour les marqueurs de prolifération (Ki67), d’angiogenèse (CD31, VEGF, VEGFR2, bFGF) et d’apoptose (TUNEL). Nous déterminerons également le nombre de follicules primordiaux ; il s’agit d’un marqueur de l’épuisement des cellules germinales (réserve ovarienne) qui est censé prédire la durée de vie reproductive.
Résultats du thème 3 - Impacts
- Mesures liées de la toxicité et des concentrations de polluants dans l’air ambiant
- Distribution spatio-temporelle des dépassements des lignes directrices en matière de santé
- Charge de morbidité et effets néfastes de l’exposition à la pollution atmosphérique chez les humains, y compris les populations vulnérables
- Relations entre l’exposition aux polluants et les effets néfastes chez les amphibiens, les poissons et les mammifères semi-aquatiques
2.6 Activités scientifiques sous le thème 4 - Évaluation et amélioration des outils scientifiques
Les grandes études sur la qualité de l’air offrent la possibilité d’évaluer et d’améliorer les outils utilisés par les scientifiques pour mesurer et comprendre la pollution de l’air. De telles opportunités sont facilitées dans le cadre d’ÉPAHT afin de poursuivre le développement de techniques permettant de mesurer les plastiques et le mercure dans l’air au niveau du sol. Le regroupement des mesures de polluants atmosphériques courants permet également d’évaluer les mesures satellitaires et les modèles de transport chimique avec une densité spatio-temporelle sans précédent. La stratégie de mesure de la campagne de terrain permet d’évaluer la variabilité sous-grille dans des grilles de pixels satellitaires et de modèles qui contiennent plusieurs sites de mesure fixes ainsi que des emplacements supplémentaires accessibles à des plateformes d’échantillonnage mobiles. L’évaluation des distributions verticales estimées est également possible grâce aux mesures résolues verticalement qui permettront d’évaluer la précision des procédures qui dérivent les concentrations au niveau du sol à partir des mesures de la colonne totale.
Projet 4.1 : Évaluation des techniques de mesure du mercure en suspension dans l’air dans les environnements urbains (Responsable : Alexandra Steffen, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Katrina MacSween et Geoff Stupple, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Bridget Bergquist, Université de Toronto)
Le mercure est soumis à la Convention internationale de Minamata sur le mercure, qui prévoit l’obligation de surveiller et d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction des émissions (Organisation des Nations unies – Programme pour l’environnement, 2013). Le mercure est introduit dans l’atmosphère à la fois par des émissions naturelles (par exemple, les volcans, l’altération des roches contenant du mercure) et par des rejets anthropiques (par exemple, la combustion du charbon, l’extraction et le traitement des métaux), ainsi que par la réémission de sources anthropiques et naturelles qui s’étaient déjà déposées (Streets et al., 2017, Amos et al., 2013). Les contributions relatives de ces sources restent incertaines. Les progrès récents dans la caractérisation des isotopes du mercure ont conduit au développement de techniques permettant d’identifier les contributions de ces sources potentielles. Le mercure présent dans l’atmosphère existe sous forme gazeuse (mercure élémentaire gazeux, GEM, et mercure gazeux réactif, RGM) ou peut se lier à des particules de taille variable (mercure lié aux particules, PHg). Les mesures du mercure réactif et du mercure lié aux particules sont difficiles à réaliser en raison de leur faible concentration et des incertitudes liées aux techniques de mesure.
En tant que polluant préoccupant à l’échelle mondiale, le mercure a été mesuré à divers endroits, et des efforts scientifiques considérables ont été déployés dans les régions éloignées susceptibles d’être transportées dans l’atmosphère sur de longues distances (Pirrone et al., 2010, Amos et al., 2013). Le comportement du mercure dans l’air urbain a fait l’objet de moins d’attention, bien que l’on sache que les concentrations sont supérieures aux concentrations de fond habituelles (Liu et al., 2007 ; Nie et al., 2020, Lynam & Keeler, 2006). Les sources d’émission locales, les schémas de circulation de l’air et le terrain propres à l’environnement urbain influencent la dispersion et la chimie du mercure atmosphérique. Dans la GTHA, du mercure a été détecté près des sources déclarées à l’INRP, bien que les relations quantitatives entre les émissions déclarées et les concentrations ambiantes mesurées ne soient pas cohérentes (McLagan et al., 2018). Le développement de l’échantillonneur d’air passif au mercure (MerPAS), disponible dans le commerce, qui utilise un charbon actif imprégné de soufre comme sorbant pour le mercure élémentaire gazeux, permet une mesure précise du GEM avec une plus grande couverture spatiale et sans nécessiter d’énergie ou d’infrastructure intensive (McLagan et al., 2016). Des échantillonneurs d’air passifs au mercure seront déployés sur six sites de mesure ÉPAHT afin de déterminer la distribution spatiale du GEM dans la région du Grand Toronto. Ils permettront en outre d’évaluer la variabilité entre les sites de mesure ÉPAHT, qui représentent des utilisations du sol et des sources différentes de celles des mesures effectuées par McLagan et al. (2018). Des échantillonneurs seront également déployés en haut de la Tour CN pour donner un aperçu de la distribution verticale du mercure dans la couche limite urbaine. Le MerPAS a également été identifié comme une méthode appropriée pour déterminer la caractérisation isotopique (Szponar et al., 2020), qui sera utilisée pour déterminer les sources locales et régionales de mercure et les transformations possibles que le mercure a subies dans l’atmosphère urbaine, ainsi que la variabilité spatiale de ces facteurs entre les sites ÉPAHT.
En plus de l’échantillonnage passif mentionné ci-dessus, des mesures colocalisées du mercure spécié dans les phases gazeuses et particulaires seront effectuées à proximité de l’autoroute 401 en utilisant deux techniques, si possible. L’objectif de ces mesures est de déterminer comment la combinaison de l’environnement urbain et des conditions limites hivernales influence la spéciation du mercure. En outre, il s’agit de comprendre si l’utilisation de sels de voirie, l’ozone et les radicaux OH ainsi que la météorologie hivernale produisent des réactions chimiques similaires à celles observées dans l’Extrême-Arctique, qui entraînent la conversion rapide du GEM en RGM et PHg (Steffen et al., 2008). La première technique utilise le système d’entrée Tekran 1130 et 1135, un système disponible dans le commerce pour la séparation, la préconcentration et la mesure des espèces de mercure réactives et particulaires, respectivement. La seconde technique compare les résultats de deux entrées distinctes qui mesurent le mercure atmosphérique total (entrée du pyrolyseur à haute température) et le mercure élémentaire gazeux (entrée du filtre CEM), qui peuvent ensuite être utilisés pour dériver la somme des espèces de mercure réactives et particulaires. Cette nouvelle méthodologie à double canal a été testée sur le terrain à Alert, NU, Canada, et des systèmes similaires ont été utilisés dans des campagnes de mesures aériennes (Jaffe et al., 2014). L’application de sels sur les revêtements routiers et la présence importante de particules peuvent être à l’origine d’une chimie du mercure localisée. Le site du RNSPA de Toronto Ouest, avec des mesures de spéciation du mercure colocalisées, contribuera à fournir une preuve supplémentaire de la méthode et à comprendre comment l’environnement urbain influence la chimie et le comportement du mercure atmosphérique.
Projet 4.2 : Relier les sources de microplastiques et de microfibres à leur présence dans l’air et les systèmes aquatiques (Responsable : Liisa Jantunen, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaboratrice : Miriam Diamond, Université de Toronto)
La mesure des microplastiques dans les échantillons atmosphériques est encore un domaine d’investigation émergent. Des comparaisons de méthodes dans les zones urbaines, les autoroutes urbaines, les zones suburbaines, les zones rurales et les zones agricoles sont en cours depuis deux ans en prévision d’ÉPAHT. Les méthodes comparées sont l’échantillonnage d’air à haut volume, le dépôt en vrac (jauge Nipher, bouteille et entonnoir), le dépôt humide uniquement et le dépôt passif (diapositives avec un adhésif collant et sacs de mousse) et ont été déployées sur quatre types d’utilisation des sols. Dans le cadre d’ÉPAHT, les sites urbains seront étendus au High Park et à l’aéroport international Pearson. Ces données seront utilisées pour déterminer la meilleure façon d’échantillonner l’air pour les microplastiques et comment les différentes approches d’échantillonnage se comparent. Ces résultats seront modélisés afin d’identifier les sources et les mécanismes de transport et de devenir des microplastiques dans l’air, en vue de l’élaboration d’une stratégie d’atténuation.
Projet 4.3 : Mesures de la profondeur optique des aérosols par satellite pour identifier les sources d’aérosols urbains (Responsable : Chris Sioris, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air)
Les mesures de la profondeur optique des aérosols (AOD) du MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) et de l’Advanced Baseline Imager (ABI) du GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) seront utilisées pour identifier les sources urbaines d’aérosols. L’approche de récupération de l’ABI AOD a été conçue pour la végétation sombre (Kaufman et al., 1997) et a tendance à rencontrer des difficultés dans les zones urbaines où la relation entre la réflectance de la surface dans le visible et à 2 μm est très différente de celle de la végétation sombre. La récupération ABI de la AOD sur les terres est essentiellement réglée pour réussir au-dessus de la végétation sombre en exploitant cette relation spectrale. Néanmoins, ABI a révélé des points chauds d’aérosols près de l’intersection de la 401 et de Don Valley Parkway et près de l’aéroport Pearson. GOES AOD a une résolution temporelle de 5 minutes, ce qui peut être utile pour suivre le mouvement d’un panache d’aérosols dans le temps jusqu’à son point d’origine. Les mesures d’aérosols par satellite effectuées pendant la campagne intensive ÉPAHT seront utilisées pour examiner la variabilité spatiale des particules. Les résultats seront comparés à d’autres techniques de mesure et de modélisation utilisées pendant la campagne ÉPAHT afin d’accroître la certitude et d’identifier les améliorations potentielles.
Projet 4.4 : Validation de la distribution verticale des polluants atmosphériques communs à l’aide de Pandora à la Tour CN (Responsable : Xiaoyi Zhao, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Vitali Fioletov, Ihab Abboud, Jonathan Davies, Akira Ogyu, Reno Sit, et Sum Chi Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Les fortes concentrations de NO2 dans la colonne totale et à la surface du centre-ville de Toronto ont été étudiées et signalées (Zhao et al., 2020, 2022 ; Griffin et al., 2020). Cependant, la distribution verticale du NO2 et d’autres polluants atmosphériques, tels que le HCHO, n’est pas encore bien connue. Les couches de polluants atmosphériques en altitude pourraient avoir un impact important sur la comparaison et la concordance des mesures satellitaires et des mesures de surveillance en surface (c’est-à-dire que les polluants en altitude peuvent être détectés par les mesures de la colonne satellitaire, mais ne peuvent pas être échantillonnés par les instruments de surveillance en surface). En outre, des travaux antérieurs montrent que l’accord entre la télédétection et le NO de surface modélisé par GEM-MACH2 présente un biais plus important en hiver, principalement en raison de problèmes de modélisation liés à la hauteur de la couche limite pendant les saisons froides (Zhao et al., 2019). Ce travail utilisera des Pandoras dans le centre-ville de Toronto à différentes altitudes (310 m à la Tour CN et 120 m à l’Université de Toronto St. George) pour fournir des changements détaillés de la structure verticale des polluants atmosphériques, afin de répondre à ces questions. Les observations du profil vertical et de la colonne de NO2 et de HCHO provenant d’autres sites Pandora dans la région de Toronto seront utilisées pour fournir la vérité de terrain pour les travaux de validation et de vérification par satellite. Notre objectif est d’améliorer la compréhension de la manière de relier les observations satellitaires à la qualité de l’air au niveau de la hauteur du nez.
Projet 4.5 : Évaluation des mesures hivernales du nouveau satellite TEMPO (Responsable : Debora Griffin, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Chris McLinden et Sumi Wren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
TEMPO (Zoogman et al., 2017) a récemment été lancé (7 avril 2023) et les mesures opérationnelles devraient commencer en octobre 2023. La validation est cruciale pour les nouveaux instruments satellitaires afin de déterminer l’exactitude et la précision des observations. Les observations d’ÉPAHT seront utilisées pour aider à valider les données TEMPO, en particulier sa capacité à capturer les gradients spatiaux à travers le GTA, ainsi que sa capacité à capturer les variations diurnes sur des échelles de temps d’une heure et moins. Pour ce faire, on comparera les extractions TEMPO aux résolutions temporelles opérationnelles et spécifiques à ÉPAHT aux données provenant d’une combinaison de stations de surface denses (dont 6 Pandora), de multiples plateformes mobiles (dont MAX-DOAS mobile), de mesures HCHO au sol (TILDAS - Tunable Infrared Laser Differential Absorption Spectrometer) et de sorties de modèles canadiens de qualité de l’air exécutés à la résolution du pixel et du sous-pixel TEMPO, de 2,5 km à 250 m. Un autre aspect important de la validation TEMPO est lié à la couverture neigeuse. Pendant toute la durée de la campagne, il y aura une couverture neigeuse intermittente, ce qui constitue une excellente occasion d’évaluer les performances de TEMPO dans des conditions de neige, d’absence de neige et de conditions mixtes.
Projet 4.6 : Émissions des véhicules sans échappement et représentation dans GEM-MACH (Responsable : Ali Katal, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Junhua Zhang, Craig Stroud et Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Alors que les émissions de combustion des véhicules diminuent lentement au fil du temps, les émissions de non-combustion gagnent en importance en termes d’impact sur la qualité de l’air (produits chimiques volatils, émissions de non-combustion des véhicules). Les modèles de qualité de l’air doivent également s’adapter au changement de spéciation chimique associé à ces nouveaux types d’émissions. ECCC crée de nouveaux inventaires d’émissions pour les produits chimiques volatils en utilisant le modèle VCPy de l’US EPA. Dans ce projet, les émissions de GEM-MACH seront traitées avec ce nouvel inventaire. Le mécanisme chimique de GEM-MACH sera également mis à jour pour mieux représenter les COV oxygénés, les alcanes à longue chaîne, les émissions des lave-glaces, des pneus et de l’usure des freins. Les émissions de poussières nécessitent également de meilleures contraintes pour l’utilisation des terres urbaines en fonction de la météorologie récente et actuelle. La poussière de construction routière est un défi à modéliser car elle est intermittente mais peut être importante. Les estimations des émissions de sels de voirie seront élaborées sur la base des données d’utilisation fournies par les agences municipales et provinciales concernées.
Projet 4.7 : Chimie aqueuse et potentiel oxydatif dans GEM-MACH (Responsable : Alex Lupu, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Craig Stroud, Kenjiro Toyota, Tom Harner et Amandeep Saini, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Pourya Shahpoury, Santé Canada et Université Trent)
Des études sur la bruyère ont montré l’importance du potentiel oxydant des particules (OP) dans la toxicité des PM2,5. Les oxydants en phase particulaire peuvent réagir avec les antioxydants présents à la surface des poumons humains pour former des espèces réactives de l’oxygène (ROS). L’intégration de la capacité à modéliser le potentiel oxydatif dans le GEM-MACH est opportune pour utiliser et développer l’ensemble des données de mesure d’ÉPAHT et pour répondre aux besoins futurs. La capacité de modélisation des OP dans GEM-MACH s’appuiera sur les corrélations observées entre les OP et la composition mesurée des particules, ainsi que sur les résultats de la modélisation de la boîte chimique, et servira de base au développement de mises à jour de la chimie aqueuse modélisée et à l’incorporation dans GEM-MACH de composants de métaux à l’état de traces pertinents pour les OP (Fe, Cu).
Les réactions hétérogènes de surface seront également ajoutées à GEM-MACH. Les surfaces en question comprennent l’environnement bâti froid (avec ou sans neige) et les surfaces de particules froides. Le dépôt sec de N2O5 peut produire du ClNO2 et/ou du Cl2 si la surface contient du sel de déneigement. Les rendements de ClNO2 et de Cl2 peuvent dépendre de l’acidité de la surface, de l’humidité ambiante (ou de l’humidité de la surface), de la température et des contaminants coexistants (composés organiques). Le HCl gazeux et le chlorure particulaire précédemment déposés à la surface peuvent également être recyclés par le biais de réactions de surface associées au dépôt sec de N2O5 . Les réactions de surface du NO2 formant du HONO et du HNO3 seront également évaluées pour les surfaces urbaines et les surfaces de particules. Toutes ces réactions contribuent au pool de radicaux disponibles dans l’atmosphère pour favoriser la formation d’ozone et de particules secondaires, et la pertinence de ces réactions peut être propre à l’hiver, lorsque la production de radicaux OH est réduite.
Projet 4.8 : Preuve de concept pour la modélisation inverse des émissions avec GEM-MACH (Responsable : Shuzhan Ren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Debora Griffin et Michael Sitwell, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
L’utilisation typique de GEM-MACH simule les concentrations de polluants ambiants sur la base des émissions, de la météorologie et des processus atmosphériques. La relation entre les émissions et les concentrations ambiantes peut être résumée mathématiquement sous la forme d’un opérateur hamiltonien, et cet opérateur peut être combiné avec des mesures, des cartes d’émissions préliminaires et une méthode statistique (inversion bayésienne) pour mieux affiner les estimations des émissions. La technique est la mieux adaptée aux espèces chimiques à durée de vie moyenne ou longue (CO2 , CH4 , CO, NOx , BC, SO2 ) dont la durée de vie chimique en hiver est supérieure à ~6 heures à l’échelle urbaine. Les mesures simultanées, horaires et réparties dans l’espace sont les plus appropriées. Elles peuvent provenir d’instruments de surface ou de satellites, à condition que les données satellitaires soient sensibles aux concentrations de la couche de surface. Sur la base des mesures disponibles de la campagne de terrain ÉPAHT, la preuve de concept de la modélisation inverse des émissions avec GEM-MACH sera testée pour le CO, le CH4 et le NOx.
Projet 4.9 : Amélioration de la modélisation de la couche limite et des dépôts à l’aide de GEM-MACH (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Shuzhan Ren, Ali Katal, Paul Makar, Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Sylvie Leroyer et Stéphane Belair, ECCC Division de la recherche météorologique)
Les prévisions de polluants primaires émis par GEM-MACH sont très sensibles à la météorologie de la couche de rugosité de surface (~ 100m). Le paramètre le plus important est la diffusivité verticale. L’hiver par rapport à l’été, et la nuit par rapport au jour, peuvent entraîner une concentration des polluants émis près de la surface. Les modèles de transport chimique utilisent généralement des paramétrisations de mélange à l’échelle de la sous-grille, car le modèle ne peut pas résoudre l’écoulement à fine échelle des tourbillons turbulents. Les mesures verticales collectées dans le cadre d’ÉPAHT fourniront des contraintes lors de l’essai de différentes paramétrisations du schéma de mélange à différentes échelles spatiales du modèle pour les zones urbaines. Pour les espèces à durée de vie modérée ou longue, la hauteur de la couche limite (BL) est également importante pour plafonner le mélange dans la troposphère libre. Les versions récentes du GEM se sont concentrées sur l’amélioration des prévisions de la hauteur de la couche limite. Celles-ci seront évaluées dans le cadre d’ÉPAHT afin de vérifier si elles sont suffisantes pour les prévisions de la qualité de l’air en milieu urbain. Les résultats du modèle seront comparés aux balayages LIDAR et aux gradients observés à la Tour CN et sur Resources Road au ON MEPNP.
Les polluants atmosphériques sont éliminés de l’atmosphère par les précipitations grâce à deux mécanismes : la condensation dans les nuages et le lavage sous les nuages. L’état de la phase des précipitations et les processus des nuages froids sont importants pour déterminer les dépôts humides hivernaux. Les aérosols sulfatés hivernaux sont actuellement surestimés à l’échelle régionale. L’état de la phase des précipitations pendant la saison froide peut également être évalué à l’aide des mesures ÉPAHT. Des paramétrisations récentes du piégeage humide en saison froide, qui dépendent de l’état de la phase de chute, ont été introduites dans GEM-MACH et leur importance sur les PM2,5 en hiver sera évaluée à l’aide de l’ensemble des données collectées lors de la campagne de terrain ÉPAHT.
Projet 4.10 : Évaluation de la modélisation des particules ultrafines dans GEM-MACH avec MOSAIC (Responsable : Ashu Dastoor, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateur : Kirill Semeniuk, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Un schéma actualisé de nucléation des particules pour GEM-MACH est en cours de développement avec MOSAIC (Model for Simulating Aerosol Interactions and Chemistry). Les distributions de taille des particules en mode ultrafin (D<100 nm) seront comparées aux mesures de la campagne de terrain ÉPAHT afin d’évaluer la précision du nouveau schéma.
Projet 4.11 : Évaluation du modèle GEM-MACH par facteurs de source (Responsable : Mahtab Majdzadeh, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Craig Stroud, Kenjiro Toyota et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Les modèles de qualité de l’air sont souvent évalués pour les conditions estivales en raison des niveaux plus élevés d’oxydants par rapport à l’hiver. Les modèles de qualité de l’air sont également généralement évalués pour des catégories génériques telles que l’est ou l’ouest, ou pour un ensemble de données complet qui masque les biais de compensation. La factorisation de la matrice positive (PMF) permet de séparer les masses d’air échantillonnées à un endroit donné en fonction de leur source. Les résultats de GEM-MACH pour les concentrations de polluants et les distributions de tailles de particules seront évalués par rapport aux mesures ÉPAHT qui ont été séparées par des facteurs de source déterminés par PMF afin d’identifier les biais du modèle pour certains types de sources. Le modèle sera également évalué pour des familles d’espèces chimiques telles que le carbone organique, le chlore réactif et l’azote réactif. Ces quantités sont mieux conservées et leur spéciation fractionnelle relative peut être évaluée et comparée aux résultats du modèle.
Projet 4.12 : Répartition des secteurs sources à l’aide de GEM-MACH (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air, Collaborateurs/trices : Junhua Zhang et Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Les traceurs spécifiques aux sources (par exemple, la combustion résidentielle du bois, les produits chimiques volatils, la cuisson des aliments) et leurs facteurs d’émission associés seront ajoutés à GEM-MACH avec leur chimie associée. En comparant les résultats du modèle aux mesures effectuées dans le cadre d’ÉPAHT, l’ampleur des incertitudes dans les inventaires d’émissions sous-jacents sera déterminée. Le modèle sera ensuite utilisé pour déterminer l’impact de petites réductions d’émissions (par exemple, 10 %) afin d’évaluer les changements dans la répartition des sources et les sensibilités des points finaux (par exemple, les changements dans les PM2,5).
Projet 4.13 : Évolution de la résolution horizontale de 2,5 km à 250 m en utilisant GEM-MACH avec le bilan énergétique de la ville (TEB) (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Paul Makar, Ali Katal, et Shuzhan Ren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
La modélisation du transport chimique continue d’évoluer vers des résolutions spatiales plus fines, en partie pour soutenir l’évaluation des sources et des impacts dans les zones urbaines (par exemple, les sources de transport telles que les gares de triage, les plateformes de camions et les aéroports, ou les inégalités entre les quartiers). Les modèles à très haute résolution peuvent résoudre les sources individuelles et fournir de meilleures estimations des émissions lors de l’utilisation de la modélisation inverse. Les données ÉPAHT pour une variété de toxiques atmosphériques (par exemple, le benzène, le toluène, le carbone noir, les métaux) et pour les polluants atmosphériques communs et les gaz à effet de serre provenant des mesures des véhicules à démarrage à froid seront utilisées pour développer et évaluer 1) des cartes d’émissions, 2) des schémas de mélange de surface, et 3) des cartes d’utilisation des sols à haute résolution capables de capturer les changements dans la longueur de la rugosité à une résolution horizontale de 250 mètres. Le développement et l’évaluation du modèle permettront également de déterminer si l’assimilation des données de surface pour l’humidité et la chaleur est nécessaire au-delà de la résolution actuelle la plus fine de 2,5 km.
Projet 4.14 : Amélioration des processus physiques hivernaux dans GEM à l’échelle urbaine (Responsable : Sylvie Leroyer, ECCC Division de la recherche météorologique; Collaborateur : Stéphane Belair ; ECCC Division de la recherche météorologique)
GEM utilise l’assimilation de données de surface afin d’appliquer des conditions hydrométéorologiques réalistes telles que la fraction de neige et l’humidité du sol au moment initial, mais la méthode actuelle n’est pas totalement adaptée aux zones urbaines. Les données recueillies dans le cadre d’ÉPAHT, telles que les photographies de l’évolution de la couverture neigeuse, seront utilisées pour l’améliorer. Les prévisions météorologiques en surface et près de la surface dans GEM (y compris dans TEB), telles que la température de l’air, les bilans de neige et d’eau sur les différentes couvertures urbaines (rues, jardins, toits) seront évaluées avec les mesures de la campagne, ce qui permettra d’apporter d’éventuelles améliorations à la modélisation et à l’assimilation des données de surface pendant l’hiver. Ces résultats seront analysés en tenant compte des caractéristiques de l’utilisation des sols dans les modèles et dans les données obtenues par ÉPAHT.
Résultats du thème 4 - Évaluation et amélioration des outils scientifiques
- Amélioration des techniques de mesure au sol du mercure et des plastiques
- Mesures de télédétection validées, basées sur le déploiement d’instruments terrestres en altitude ou sur de nouvelles plateformes satellitaires
- Nouvelle capacité de transport chimique pour les particules ultrafines, les métaux traces et le potentiel d’oxydation
- Amélioration de la modélisation du transport chimique à l’aide de GEM-MACH sur la base d’améliorations de la représentation des émissions hivernales, de la chimie aqueuse et des dépôts
- Preuve de concept pour la modélisation inverse des émissions à l’aide de GEM-MACH
- Amélioration de la modélisation météorologique avec le GEM grâce à l’amélioration des représentations de la turbulence, de la hauteur de la couche limite planétaire et des processus physiques hivernaux.
- Augmentation de la résolution horizontale de 2,5 km à 250 m pour la modélisation du transport météorologique et chimique en utilisant GEM et GEM-MACH, respectivement.
3. Résultats : Analyse, intégration et communication
ÉPAHT apportera une contribution substantielle à la compréhension de la présence, des sources et des impacts du mélange de polluants atmosphériques urbains sur la base de nouvelles données et de liens avec les efforts en cours. L’accès direct aux données et la promotion des possibilités de collaboration entre les partenaires d’ÉPAHT sont essentiels à la réalisation du potentiel de l’étude.
3.1 Acquisition et gestion des données
Le comité directeur d’ÉPAHT (voir annexe D) comprend deux postes de direction qui supervisent les questions relatives aux données. Le premier concerne l’acquisition des données et le second la gestion des données, bien que les deux travaillent en étroite collaboration. Ces questions de données sont fondamentales pour la planification d’ÉPAHT depuis le début de l’étude, lorsque la liste des instruments du site a été élaborée pour la première fois et affinée par la suite. Le partage des données d’ÉPAHT s’effectue sur une plateforme en ligne gratuite pour faciliter l’accès des partenaires de l’étude. Cette plateforme - le Google Drive partagé d’ÉPAHT- contient des documents de planification tels que l’éternel diagramme de Gantt du projet, ainsi que des présentations et des enregistrements d’ateliers et d’exposés scientifiques d’ÉPAHT.
Avant et pendant la campagne intensive ÉPAHT 2024, les participants impliqués dans la réalisation et le soutien des mesures utiliseront BAND pour communiquer. L’utilisation de BAND est gratuite, et ses versions application et navigateur sont navigables à partir de téléphones portables et d’ordinateurs. Les messages concernant les conditions météorologiques et les plans d’échantillonnage généraux seront diffusés à tous les participants chaque jour, et le partage d’informations entre les participants connectés à des sites ou à des plateformes spécifiques se fera par le biais de discussions en sous-groupes « selon les besoins ». Un système d’enregistrement en ligne Google Forms sera également mis en place pour permettre aux participants de signaler les conditions, les problèmes et d’autres informations pertinentes qui pourront être consultées par d’autres personnes afin de les aider à réviser les plans d’échantillonnage et à interpréter les données recueillies au cours de la campagne de terrain.
Les données issues des mesures, des simulations de modèles et des analyses ultérieures seront partagées selon une approche à multiples facettes. Pendant la campagne de terrain et pendant une période limitée par la suite, chaque chercheur responsable d’un échantillonneur, d’un instrument, d’un inventaire, d’un modèle ou d’un autre ensemble de données partagera ses données (ou un lien vers des données détenues par des programmes externes à ÉPAHT) par le biais d’un dossier dédié sur le Google Drive d’ÉPAHT, auquel les partenaires auront un accès en lecture seule. Pour les données produites par les instruments d’ECCC, un stockage interne à long terme des données est disponible avec une capacité de sauvegarde. Ce mécanisme n’est pas disponible pour les données externes à ECCC, et des méthodes de stockage alternatives sont en cours d’identification. Une archive finale des données sera mise à la disposition de la communauté scientifique élargie et du public intéressé via le Portail de données ouvertes d’ECCC.
3.2 Analyse et intégration des données
Les résultats d’ÉPAHT peuvent être considérés comme une collection de produits issus de l’ensemble des données de caractérisation décrites à la section 2.3 (thème 1) et des activités scientifiques décrites aux sections 2.4 à 2.6 (thèmes 2 à 4). Les activités ont été développées pour combler les lacunes de connaissances identifiées dans la littérature scientifique et en utilisant les outils et les ressources disponibles pour les partenaires d’ÉPAHT.
Ces idées et ces plans visent à apporter de nombreuses contributions nouvelles, de nombreux scientifiques collaborant à plus d’une activité scientifique. Bien que ces plans soient basés sur des avis d’experts, l’incertitude est inhérente à l’impossibilité de savoir a priori ce que les observations de l’étude révéleront et quel sera l’état des ressources disponibles dans les années à venir. Afin de prioriser les activités d’analyse et d’intégration des données, les partenaires d’ÉPAHT seront impliqués dans une série d’ateliers thématiques qui se tiendront dans les années suivant la campagne de terrain intensive de 2024. Ces ateliers rassembleront des experts compétents afin de déterminer comment les activités scientifiques conjointes devraient progresser pour apporter de nouvelles découvertes dans les limites des ressources disponibles.
Les ateliers porteront sur les thèmes suivants
- Partage d’échantillons pour des analyses chimiques et toxicologiques
- Fournir un ensemble de données d’observation de l’air ambiant faisant autorité pour les concentrations de polluants atmosphériques individuels et combinés
- Relier l’air ambiant, les dépôts et les systèmes terrestres/aquatiques grâce aux données ÉPAHT
- Fournir aux développeurs d’inventaires des facteurs d’émission, des ratios et des profils spécifiques aux sources observées et documenter les améliorations de l’inventaire qui en résultent.
- Utilisation de l’ensemble de données ÉPAHT pour une évaluation multifactorielle complète de GEM-MACH
- Priorité à l’amélioration des processus GEM et GEM-MACH, y compris la comparaison avec les performances antérieures à ÉPAHT.
- Priorité aux exécutions GEM-MACH pour la répartition des sources et les scénarios d’émissions
- Réalisation d’analyses épidémiologiques pour les estimations d’exposition aiguë et chronique à partir d’observations ambiantes, de résultats de modèles ou de nouvelles surfaces d’exposition à l’aide de la régression de l’utilisation des sols ou d’autres techniques.
- Préparer des publications omnibus sur des sujets clés à composantes multiples et interdisciplinaires (par exemple, la représentation du mélange vertical dans les zones urbaines, la composition et les sources des particules dans l’ensemble du spectre des tailles, etc.)
3.3 Communication des résultats
Les communications d’ÉPAHT aspireront à un niveau qui ne sera pas inférieur à l’excellence, et chercheront à atteindre la communauté scientifique, les clients et les parties prenantes, ainsi que le grand public.
Pour la communauté scientifique, l’excellence passe par la publication d’articles examinés par des pairs dans des revues de grande qualité, réputées et non affiliées à des éditeurs qui se livrent à des pratiques prédatrices. La publication en libre accès est encouragée dans la mesure du possible, tandis que la publication « salami » (c’est-à-dire le fait de répartir les résultats sur plusieurs articles pour gonfler les statistiques de publication) est découragée pour des raisons financières et éthiques. La présentation des résultats lors de conférences universitaires de haut niveau est également encouragée comme moyen de communication avec la communauté scientifique. Des sessions spéciales sont prévues lors des réunions de l’American Geophysical Union (AGU) et de la Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), et d’autres possibilités de diffusion des résultats scientifiques seront identifiées par les scientifiques collaborateurs.
Pour la communication avec les clients, les parties prenantes et le grand public, un plan de communication officiel est en cours d’élaboration par ECCC et comprendra une consultation avec les organisations partenaires. Une fois terminé, le plan sera disponible pour les partenaires ÉPAHT.
3.4 Applicabilité à d’autres lieux
Toronto est la plus grande ville du Canada, avec une population qui devrait atteindre 10 millions d’habitants d’ici 2046 (Ontario, 2022). Bien que cela constitue une justification solide du choix de Toronto comme site de la première étude intégrée d’ECCC sur la pollution atmosphérique urbaine, le lieu a été choisi en partie en raison de la capacité de recherche sur la qualité de l’air qui existe dans cette ville au sein des gouvernements et des universités locaux. Ce choix a été motivé par des considérations pratiques, dont la moindre n’était pas de minimiser les coûts de l’étude. Néanmoins, les efforts d’ÉPAHT au-delà de la campagne de terrain de 2024 viseront à garantir que les nouvelles connaissances et les outils scientifiques améliorés servent à l’amélioration de la qualité de l’air dans d’autres zones urbaines du Canada et d’ailleurs.
Les récentes modifications apportées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) consacrent le droit à un environnement sain, et le cadre de mise en œuvre à venir tiendra compte de principes tels que la justice environnementale et l’équité intergénérationnelle (Canada, 2023). Bien que la mise en œuvre ne soit pas une activité de recherche scientifique, elle nécessitera des informations et des outils scientifiques crédibles pour la soutenir. Les résultats d’ÉPAHT - y compris les nouvelles façons de représenter le mélange de polluants atmosphériques et les variations à petite échelle de leurs impacts dans les zones urbaines - sont alignés sur les besoins scientifiques associés à la réalisation des engagements de la LCPE modifiée dans des lieux autres que Toronto et la RGTH.
Remerciements
La pollution, pilier de la triple menace planétaire et indicateur des disparités sociétales, continue de susciter l’inquiétude. Des progrès considérables ont été réalisés grâce à l’utilisation d’une approche polluant par polluant pour étudier et gérer la pollution de l’environnement, mais l’impact des mélanges de polluants dans le monde réel est une préoccupation croissante. C’est dans ce contexte qu’ÉPAHT a vu le jour. Bien qu’il n’ait pas toutes les réponses, ÉPAHT fait néanmoins avancer le changement nécessaire pour aborder les complexités associées à la pollution de l’air dans les villes. De telles avancées ne sont jamais faciles ou ordonnées, et les efforts combinés d’un grand nombre de personnes ont été nécessaires pour développer cette première génération de tentative d’aborder la science de la pollution de l’air en milieu urbain au Canada.
Les responsables de la section de recherche sur les processus de la qualité de l’air d’ECCC ont joué un rôle essentiel dans le développement d’ÉPAHT, depuis l’approbation et le soutien initiaux de l’étude par Stewart Cober jusqu’à la traduction inlassable de la vision et du développmeent de l’esprit d’équipe par Alexandra (Sandy) Steffen, en passant par les soutiens pratiques continus facilités par Kathy Hayden. Rosa Wu, responsable de la section de recherche sur la modélisation et l’intégration d’ECCC, a soutenu très tôt les objectifs et la vision de l’étude, et a fourni des conseils stratégiques utiles pour faire avancer l’étude malgré les incertitudes initiales quant à sa portée et à son approche. Zoe Davis, Matt Cooper et Matt Parsons, du Bureau du programme de qualité de l’air d’ECCC, ont également fourni des conseils et un contexte précieux pour soutenir les objectifs d’ÉPAHT.
L’équipe de direction d’ÉPAHT, qui comprend le comité directeur ainsi que les responsables des sites fixes et des plateformes mobiles, a fait ses preuves à plusieurs reprises en réalisant des projets à la fois concrets et créatifs. L’équipe a été constituée en partie dans le but d’améliorer la représentation des femmes et de donner une expérience de direction aux jeunes collaborateurs. Les deux groupes ont démontré de manière convaincante leur valeur aux côtés de collègues masculins chevronnés qui ont ouvertement partagé leur expertise.
Même si le soutien et le leadership de la direction ont été précieux, ÉPAHT est en fin de compte une collaboration d’experts scientifiques et techniques. Plus de quatre-vingt-dix experts de plusieurs agences gouvernementales et de neuf universités ont accepté de partager des mesures, des données et des interprétations sous la bannière d’ÉPAHT, malgré l’absence de mandat ou de budget officiel. Il s’agit là d’un résultat remarquable qui démontre que sortir du statu quo peut rapporter énormément.
Nous remercions tout particulièrement Yushan Su et Chris Charron pour avoir facilité les mesures sur le site du ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs de l’Ontario à Resources Road. Nous sommes également très reconnaissants à High Park, à Evergreen Brickworks, à l’Université de Toronto Scarborough et à la Tour CN d’avoir accepté l’idée de prélever des échantillons sur leurs sites, ainsi qu’à Josée Lafontaine pour les efforts qu’elle a déployé dans la rédaction des accords avec nos partenaires.
Bibliographie
Alves C.A. et al. (2016) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their derivatives (oxygenated-PAHs, nitrated-PAHs and azaarenes) in size-fractionated particles emitted in an urban road tunnel. Atm. Res. 180 :128–137.
Amos, H. M., Jacob, D. J., Streets, D. G., & Sunderland, E. M. (2013). Legacy impacts of all-time anthropogenic emissions on the global mercury cycle. Global Biogeochemical Cycles, 27(2), 410–421.
Ars, S., Vogel, F., Arrowsmith, C., Heerah, S., Knuckey, E., Lavoie, J., Lee, C., Mostafavi Pak, N., Phillips, J.L., Wunch, D. (2020) Investigation of the Spatial Distribution of Methane Sources in the Greater Toronto Area Using Mobile Gas Monitoring Systems. Environ. Sci. Technol. 54 :15671-15679.
Bandowe, B.A.M., Meusel, H., Huang, R.-J., Ho, K., Cao, J., Hoffmann, T., Wilcke, W., 2014. PM2.5-bond oxygenated PAHs, nitro-PAHs and parent-PAHs from the atmosphere of a Chinese megacity : seasonal variation, sources and cancer risk assessment. Sci. Total Environ. 473, 77-87.
A. Beji, K. Deboudt, S. Khadari, B. Muresan, P. Flament, M. Fourmentin, L. Lumière (2020) Non-exhaust particle emissions under various driving conditions : Implications for sustainable mobility, Transportation Research Part D : Transport and Environment, (81) 102290
Berthiaume A. 2021. Use of the National Pollutant Release Inventory in environmental research: a scoping review. Environmental Reviews. 293
Bond, T. C.; Doherty, S. J.; Fahey, D. W.; Forster, P. M.; Berntsen, T.; Deangelo, B. J.; Flanner, M. G.; Ghan, S.; Kä rcher, B.; Koch, D.; Kinne, S.; Kondo, Y.; Quinn, P. K.; Sarofim, M. C.; Schultz, M. G.; Schulz, M.; Venkataraman, C.; Zhang, H.; Zhang, S.; Bellouin, N.; Guttikunda, S. K.; Hopke, P. K.; Jacobson, M. Z.; Kaiser, J. W.; Klimont, Z.; Lohmann, U.; Schwarz, J. P.; Shindell, D.; Storelvmo, T.; Warren, S. G.; Zender, C. S. Bounding the Role of Black Carbon in the Climate System : A Scientific Assessment. J. Geophys. Res. Atmos. 2013, 118 (11), 5380−5552.
Canada (1999) Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33). Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (justice.gc.ca); consulté 2023-05-05.
Canada (2023) Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique, Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique - Canada.ca.
Canada (2023) Projet de loi S-5 : : Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé Projet de loi S-5 : Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé - Canada.ca; consulté 2023-06-26.
CCME (Conseil canadien des ministers de l’environnement). (2022) Qualité de l’air;consulté 2022-11-04.
CEE-ONU (Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe) (1998) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement; consulté 2023-09-05.
CEE-ONU (Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe) (2009). Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants; consulté 2023-09-05.
Chen, D., Huey, L. G., Tanner, D. J., Li, J., Ng, N. L., and Wang, Y. (2017) Derivation of Hydroperoxyl Radical Levels at an Urban Site via Measurement of Pernitric Acid by Iodide Chemical Ionization Mass Spectrometry, Environ. Sci. Technol., 51 : 3355-3363, 10.1021/acs.est.6b05169, 2017.
Chen, Q., Edebeli, J., McNamara, S. M., Kulju, K. D., May, N. W., Bertram, S. B., Thanekar, S., Fuentes, J. D., Pratt, K. A. (2019) HONO, particulate nitrite, and snow nitrite at a midlatitude urban site during wintertime, ACS Earth Space Chem., 3 : 811 – 822.
Cheng, Y. et al. (2019) Size-segregated emission factors and health risks of PAHs from residential coal flaming/smoldering combustion. Environ. Sci. Pollut. Res. 26 :31793 - 31803.
Coggon, M. M., G. I. Gkatzelis, B. C. McDonald, J. B. Gilman, R. H. Schwantes, N. Abuhassan, K. C. Aikin, M. F. Arend, T. A. Berkoff, S. S. Brown, T. L. Campos, R. R. Dickerson, G. Gronoff, J. F. Hurley, G. Isaacman-VanWertz, A. R. Koss, M. Li, S. A. McKeen, F. Moshary, J. Peischl, V. Pospisilova, X. Ren, A. Wilson, Y. Wu, M. Trainer, C. Warneke (2021). « Volatile chemical product emissions enhance ozone and modulate urban chemistry. » Proceedings of the National Academy of Sciences 118(32) : e2026653118.
Coggon, M. M., B. C. McDonald, A. Vlasenko, P. R. Veres, F. Bernard, A. R. Koss, B. Yuan, J. B. Gilman, J. Peischl, K. C. Aikin, J. DuRant, C. Warneke, S.-M. Li, J. A. de Gouw (2018). « Diurnal Variability and Emission Pattern of Decamethylcyclopentasiloxane (D5) from the Application of Personal Care Products in Two North American Cities. » Environmental Science & Technology 52(10) : 5610-5618.
Dąbek- Złotorzyńska, E., Dann, T. F., Martinelango, P. K., Celo, V., Brook, J. R., Mathieu, D., Ding, L., Austin, C. C. (2011) Canadian National Air Pollution Surveillance (NAPS) PM2.5 speciation program : Methodology and PM2.5 chemical composition for the years 2003 – 2008. Atmos. Environ., 43 (3), 673 – 686.
Decesari, S., Sowlat, M. H., Hasheminassab, S., Sandrini, S., Gilardoni, S., Facchini, M. C., et al. (2017). Enhanced toxicity of aerosol in fog conditions in the Po Valley, Italy. Atmospheric Chemistry and Physics, 17(12), 7721–7731.
Decina, Stephen M., Lucy R. Hutyra, Pamela H. Templer (2020). Hotspots of nitrogen deposition in the world’s urban areas : a global data synthesis. Frontiers in Ecology and the Environment 18.2 : 92-100.
Deguillaume, L., Leriche, M., Desboeufs, K., Mailhot, G., George, C., & Chaumerliac, N. (2005). Transition metals in atmospheric liquid phases: Sources, reactivity, and sensitive parameters. Chemical Reviews, 105(9), 3388–3431.
DeMaio, L., Corn, M. (1966) Polynuclear aromatic hydrocarbons associated with particulates in Pittsburgh air. J. Air Poll. Control Assoc. 16 :67-71.
Domingo, J. L.; Nadal, M. Human exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) through drinking water : A review of the recent scientific literature. Environ. Res. 2019, 177, 108648.
Ervens, B., Sorooshian, A., Aldhaif, A. M., Shingler, T., Crosbie, E., Ziemba, L., Campuzano-Jost, P., Jimenez, J. L., and Wisthaler, A. : Is there an aerosol signature of chemical cloud processing?, Atmos. Chem. Phys., 18, 16099–16119, https ://doi.org/10.5194/acp-18-16099-2018, 2018.
Evangeliou, N.; Grythe, H.; Klimont, Z.; Heyes, C.; Eckhardt, S.; Lopez-Aparicio, S.; Stohl, A., Atmospheric transport is a major pathway of microplastics to remote regions. Nature Communications 2020, 11, (1), 3381.
Feng, Y.; Ramanathan, V.; Kotamarthi, V. R. Brown Carbon : A Significant Atmospheric Absorber of Solar Radiation. Atmos. Chem. Phys. 2013, 13 (17), 8607−8621.
Franz, T.P., Eisenreich, S.J. 1998. Snow scavenging of polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in Minnesota. Environ. Sci. Technol., 32 :1771-1778, 10.1021/es970601z
Fussell, J. C.; Franklin, M.; Green, D. C.; Gustafsson, M.; Harrison, R. M.; Hicks, W.; Kelly, F. J.; Kishta, F.; Miller, M. R.; Mudway, I. S.; Oroumiyeh, F.; Selley, L.; Wang, M.; Zhu, Y., A Review of Road Traffic-Derived Non-Exhaust Particles : Emissions, Physicochemical Characteristics, Health Risks, and Mitigation Measures. Environ.Sci.Technol. 2022, 56, (11), 6813-6835.
Gaga, E.O., Harner, T., Dąbek- Złotorzyńska, E., Celo, V., Evans, G., Jeong, C-H., Halappanavar, S., Jariyasopit, N., Su, Y. Polyurethane Foam (PUF) Disk Samplers for Measuring Trace Metals in Ambient Air. Environ. Sci. Technol. Letters 2019, 6, 545-550.
Galarneau, E., Makar, P.A., Zheng, Q., Narayan, J., Zhang, J., Moran, M.D., Bari, M.A., Pathela, S., Chen, A., Chlumsky, R. (2014) PAH concentrations simulated with the AURAMS-PAH chemical transport model over Canada and USA. Atmos. Chem. Phys. 14 :4065-4077.
Galarneau, E., Hollebone, B.P., Yang, Z., Schuster, J., 2014. Preliminary measurement-based estimates of PAH emissions from oil sands tailings ponds. Atmospheric Environment, 97 : 332-335.
Galarneau, E. et al., 2016. Air toxics in Canada measured by the National Air Pollution Surveillance (NAPS) program and their relation to ambient air quality guidelines. Journal of the Air & Waste Management Association, 66(2) : 184-200.
Galarneau, E. (2021) Polycyclic aromatic compounds in the Canadian environment : overview of results and knowledge gaps from the special issue. Environ. Pollut. 285 :117607.
Giang, A, Castellani, K. (2020) Cumulative air pollution indicators highlight unique
patterns of injustice in urban Canada. Environ. Res. Lett. 15 :124063.
Gkatzelis, G. I., M. M. Coggon, B. C. McDonald, J. Peischl, K. C. Aikin, J. B. Gilman, M. Trainer, C. Warneke (2021). « Identifying Volatile Chemical Product Tracer Compounds in U.S. Cities. » Environmental Science & Technology 55(1) : 188-199.
Gkatzelis, G. I., M. M. Coggon, B. C. McDonald, J. Peischl, J. B. Gilman, K. C. Aikin, M. A. Robinson, F. Canonaco, A. S. H. Prevot, M. Trainer, C. Warneke (2021). « Observations Confirm that Volatile Chemical Products Are a Major Source of Petrochemical Emissions in U.S. Cities. » Environmental Science & Technology 55(8) : 4332-4343.
Gkatzelis, G. I., M. M. Coggon, B. C. McDonald, J. Peischl, K. C. Aikin, J. B. Gilman, M. Trainer, C. Warneke (2021). « Identifying Volatile Chemical Product Tracer Compounds in U.S. Cities. » Environmental Science & Technology 55(1) : 188-199.
Gordon, M., Staebler, R. M., Liggio, J., Makar, P. A., Li, S.-M., Wentzell, J., Lu, G., Lee, P., Brook, J. R. : Measurements of enhanced turbulent mixing near highways, J. Appl. Meteorol. Clim., 51, 1618–1632, 2012.
Gouvernement du Canada (2022a). Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2022, 2023 et 2024; consulté 2022-08-11.
Gouvernement du Canada (2022b). Explorez les données de l’Inventaire national des rejet de polluants; consulté 2022-08-12.
Griffin, D., McLinden, C. A., Racine, J., Moran, M. D., Fioletov, V., Pavlovic, R., Mashayekhi, R., Zhao, X., Eskes, H. : Assessing the Impact of Corona-Virus-19 on Nitrogen Dioxide Levels over Southern Ontario, Canada, Remote Sens., 12, 4112, https ://doi.org/10.3390/rs12244112, 2020.
Gultepe, I., Tardif, R., Michaelides, S.C., Cermak, J., Bott, A., Bendix, J., Müller, M.D., Pagowski, M., Hansen, B., Ellrod, G., Jacobs, W., Toth, G., Cober, S.G. (2007). Fog Research: A Review of Past Achievements and Future Perspectives. Pure appl. geophys. 164, 1121–1159.
Halappanavar, S., Wu, D., Boyadzhiev, A., Solorio-Rodriguez, S., Williams, A., Jaroyasopit, N., Saini, A., Harner, T. Toxicity screening of air extracts representing different source sectors in the city of Toronto : In vitro oxidative stress, pro-inflammatory response, and toxicogenomic analysis. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2021, 872, 503415.
Hansen, B., I. Gultepe, P. King, G. Toth, and C. Mooney, 2007: Visualization of seasonal-diurnal climatology of visibility in fog and precipitation at Canadian airports. Preprints, 16th Conf. on Applied Climatology, San Antonio, TX, Amer. Meteor. Soc., P1.3. [Available online at http://ams.confex.com/ams/87ANNUAL/techprogram/paper_117973.htm.]
Haskins, J. D. et al., (2019) Anthropogenic control over wintertime oxidation of atmospheric pollutants, Geophys. Res. Lett., 46 : 14826 – 14835.
Healy, R.M., Sofowote, U., Su, Y., Debosz, J., Noble, M., Jeong, C.-H., Wang, M., Hilker, N., Evans, G.J., Doerksen, G., Jones, K., Munoz, A. (2017) Ambient measurements and source apportionment of fossil fuel and biomass burning black carbon in Ontario. Atmos. Environ. 161 :34-47.
Horak et al. (2017) PAH emissions from old and new types of domestic hot water boilers. Environ. Pollut. 225 :31-39.
Itahashi, S.; Yamaji, K.; Chatani, S.; Hayami, H.: Refinement of Modeled Aqueous-Phase Sulfate Production via the Fe- and Mn-Catalyzed Oxidation Pathway. Atmosphere 2018, 9, 132.
Jaffe DA, Ambrose JL, Gratz L, Jaegle L, Shah V, Selin NE, Song S, Giang A. Aircraft Observations of Mercury over the US : The Nomadss Experiment. AGU Fall Meeting Abstracts 2014 Dec (Vol. 2014, pp. B52B-02).
Jariyasopit, N., Tung, P., Su, K., Halappanavar, S., Evans, G.J., Su, Y., Khoomrung, S., Harner, T. Polycyclic aromatic compounds in urban air and associated inhalation cancer risks : A case study targeting distinct source sectors. Environmental Pollution 2019, 252, 1882-1891.
Jeong, C.-H., Traub, A., Huang, A., Hilker, N., Wang, J. M., Herod, D., Dąbek- Złotorzyńska, E., Celo, V., Evans, G. J. : Long-term analysis of PM2.5 from 2004 to 2017 in Toronto : Composition, sources, and oxidative potential. 2020. Environ. Pollut., 263, 114652.
Joe, P., and Coauthors, 2018: The Environment Canada Pan and Parapan American Science Showcase Project. Bull. Amer. Meteor. Soc., 99, 921–953.
Kasthuriarachchi, N. Y.; Rivellini, L. H.; Adam, M. G.; Lee, A. K. Y., Light Absorbing Properties of Primary and Secondary Brown Carbon in a Tropical Urban Environment. Environmental Science and Technology 2020, 54, (17), 10808-10819.
Kelly, E.N., Schindler, D.W., Hodson, P.V., Short, J.W., Radmanovich, R., Nielsen, C.C., 2010. Oil sands development contributes elements toxic at low concentrations to the Athabasca River and its tributaries. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107 (37), 16178–16183.
Kelly, K. E., Kotchenruther, R., Kuprov, R., Silcox, G. D. (2013) Receptor model source attributions for Utah’s Salt Lake City airshed and the impacts of wintertime secondary ammonium nitrate and ammonium chloride aerosol. Journal of the Air & Waste Management Association, 63(5) :575–590
Khare, P., D. R. Gentner (2018). « Considering the future of anthropogenic gas-phase organic compound emissions and the increasing influence of non-combustion sources on urban air quality. » Atmos. Chem. Phys. 18(8) : 5391-5413.
Khare, P., J. E. Krechmer, J. E. Machesky, T. Hass-Mitchell, C. Cao, J. Wang, F. Majluf, F. Lopez-Hilfiker, S. Malek, W. Wang, K. Seltzer, H. O. T. Pye, R. Commane, B. C. McDonald, R. Toledo-Crow, J. E. Mak, D. R. Gentner (2022). « Ammonium adduct chemical ionization to investigate anthropogenic oxygenated gas-phase organic compounds in urban air. » Atmos. Chem. Phys. 22(21) : 14377-14399.
Johannessen, C., Liggio, J., Zhang, X., Saini, A., Harner, T. Composition and transformation chemistry of tire-wear derived organic chemicals and implications for air pollution. Atmospheric Pollution Research 2022, 13, 101533.
Johannessen, C., Saini, A., Zhang, X., Harner, T. Air monitoring of tire-derived chemicals in global megacities using passive samplers. Environmental Pollution 2022b, 314, 120206.
Johannessen. C., Saini, A., Zhang, X., Harner, T. Screening study of tire-derived organic chemicals in urban air at the source-sector scale. 2023 (In Preparation)
Kaufman, Y.J., Andrew E. Wald, Lorraine A. Remer, Bo-Cai Gao, Rong-Rong Li, Luke Flynn (1997) The MODIS 2.1- m Channel—Correlation with Visible Reflectance for Use in Remote Sensing of Aerosol. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 35 :1286-1298.
Knudtzon, N. C.; Thorstensen, H., Ruus, A., Helberg, M., Bæk, K., Enge, E. K., Borgå, K. Human exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) through drinking water : A review of the recent scientific literature. Environ. Int. 2021, 152, 106478
Kolesar, K. R., Mattson, C. N., Peterson, P. K., May, N. W., Prendergast, R. K., Pratt, K. (2018) Increases in wintertime PM2.5 sodium and chlorine linked to snowfall and road salt application. Atmos. Environ., 177 : 195 – 202.
Lei, Ying D., Wania, F. (2004) Is rain or snow a more efficient scavenger of organic chemicals?, Atmospheric Environment, Volume 38, Issue 22, 2004, Pages 3557-3571, ISSN 1352-2310.
Lelieveld, S., Wilson, J., Dovrou, E., Mishra, A., Lakey, P. S. J., Shiraiwa, M., Pöschl, U., Berkemeier, T. : Hydroxyl Radical Production by Air Pollutants in Epithelial Lining Fluid Governed by Interconversion and Scavenging of Reactive Oxygen Species. 2021, Environ. Sci. Technol., 55, 14069–14079.
Leroyer, S., Bélair, S., Souvanlasy, V., Vallée, M., Pellerin, S., & Sills, D. (2022). Summertime Assessment of an Urban-Scale Numerical Weather Prediction System for Toronto. Atmosphere, 13(7), 1030.
Li, S..-M., Leithead, A., Moussa, S.G., Liggio, J., Moran, M.D., Wang, D., Hayden, K., Darlington, A., Gordon, M., Staebler, R., Makar, P.A., Stroud, C.A., McLaren, R., Liu, P.S.K., O’Brien, J., Mittermeier, R.L., Zhang, J., Marson, G., Cober, S.G., Wolde, M., Wentzell, J.J.B. (2017) Differences between measured and reported volatile organic compound emissions from oil sands facilities in Alberta, Canada. PNAS 114 :E3756-E3765
Li, W. L.; Ma, W. L.; Zhang, Z. F.; Liu, L. Y.; Song, W. W.; Jia, H. L.; Ding, Y. S.; Nakata, H.; Minh, N. H.; Sinha, R. K.; Moon, H. B.; Kannan, K.; Sverko, E.; Li, Y. F. Occurrence and Source Effect of Novel Brominated Flame Retardants (NBFRs) in Soils from Five Asian Countries and Their Relationship with PBDEs. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 11126-11135.
Liggio, J., Li, S.-M., Staebler, R.M., Hayden, K., Darlington, A., Mittermeier, R.L., O’Brien, J., McLaren, R., Wolde, M., Worthy, D., Vogel, F. (2019) Measured Canadian oil sands CO2 emissions are higher than estimates made using internationally recommended methods. Nature Communications 10 :1863.
Liu, Q., Li., L., Zhang, X., Saini, A., Li, W., Hung, H., Hao, C., Li, K., Lee, P., Wentzell, J.J.B., Huo, C., Li., S-M., Harner, T., Liggio, J. Uncovering global-scale risks from commercial chemicals in air. Nature 2021, 600, 457-461.
Lyapustin, A., Y. Wang, I. Laszlo, R. Kahn, S. Korkin, L. Remer, R. Levy, J. S. Reid (2011), Multiangle implementation of atmospheric correction (MAIAC) : 2. Aerosol algorithm, J. Geophys. Res., 116, D03211, doi :10.1029/2010JD014986.
Lynam MM, Keeler GJ. Source–receptor relationships for atmospheric mercury in urban Detroit, Michigan. Atmospheric Environment. 2006 Jun 1;40(17) :3144-55.
Makar, P. A., Stroud, C., Akingunola, A., Zhang, J., Ren, S., Cheung, P., and Zheng, Q.: Vehicle-induced turbulence and atmospheric pollution, Atmos. Chem. Phys., 21, 12291–12316, 2021.
McDonald, B. C., J. A. de Gouw, J. B. Gilman, S. H. Jathar, A. Akherati, C. D. Cappa, J. L. Jimenez, J. Lee-Taylor, P. L. Hayes, S. A. McKeen, Y. Y. Cui, S.-W. Kim, D. R. Gentner, G. Isaacman-VanWertz, A. H. Goldstein, R. A. Harley, G. J. Frost, J. M. Roberts, T. B. Ryerson and M. Trainer (2018). « Volatile chemical products emerging as largest petrochemical source of urban organic emissions. » Science 359(6377) : 760-764.
McLagan D S, Mitchell C P J, Huang H, Lei Y D, Cole A S, Steffen A, Hung H, Wania F. 2016. A high-precision passive air sampler for gaseous mercury Environ. Sci. Technol. Lett. 3 24–9
McLinden, C.A., , Cristen L F Adams, Vitali Fioletov, Debora Griffin, Paul A Makar, Xiaoyi Zhao, Andrew Kovachik, Nolan Dickson, Cassandra Brown, Nicolay Krotkov, Can Li, Nicolas Theys, Pascal Hedelt, Diego G Loyola (2020)Inconsistencies in sulfur dioxide emissions from the Canadian oil sands and potential implications. Environ. Res. Lett. 16 014012.
McNamara. S. M. et al. (2020) Observation of road salt aerosol driving inland wintertime atmospheric chlorine chemistry, ACS Cent. Sci., 6 : 684 – 694.
Meyer, T., Wania, F. 2008. Organic contaminant amplification during snowmelt. Water Res., 42: 1847-1865.
Meyer, T., Wania, F. 2011. Modeling the elution of organic chemicals from a melting homogeneous snow pack. Water Res., 45:3627-3637.
Moussa, S.G., Staebler, R.M., You, Y., Leithead, A., Yousif, M.A., Brickell, P., Beck, J., Jiang, Z., Liggio, J., Li, S.-M., Wren, S.N., Brook J.R., Darlington, A., Cober, S.G. (2021) Fugitive Emissions of Volatile Organic Compounds from a Tailings Pond in the Oil Sands Region of Alberta. Environ. Sci. Technol. 55 :12831–12840.
Nazarenko, Y., Fournier, S., Kurien, U, Rangel-Alvarado, R.B., Nepotchatykh, O., Seers, P., Ariya, P.A. 2017. Role of snow in the fate of gaseous and particulate exhaust pollutants from gasoline-powered vehicles. Environmental Pollution 223 : 665-675.
Nations Unies (2015) A/RES/70/1 - Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030; consulté 2021-12-02.
Offenberg, J.H., Baker, J.E. (1999) Aerosol size distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and over-water atmospheres. Environ. Sci. Technol. 33 :3324-3331.
Ontario (2022) Projections démographiques pour l’Ontario; consulté 2022-11-04.
OCDE (Organisation de coopération et développement économique) (2013). Essai no. 236 : Poisson, essai de toxicité aiguë au stade embryonnaire.
OECD (Organisation for economic cooperation and development) (2021). Using PRTR Information to Evaluate Progress Towards the Sustainable Development Goal 12, OECD Series on Pollutant Release and Transfer Registers, No. 25, OECD Publishing, Paris; consulté 2021-12-08.
Organisation des Nations unies – programme pour l’environnement (2013) Convention Minamata sur le mercure : texte et annexes. Organisation des Nations unies – programme pour l’environnement.
Parajulee, A.; Wania, F. (2014) Evaluating officially reported polycyclic aromatic hydrocarbon emissions in the Athabasca oil sands region with a multimedia fate model. PNAS DOI : 10.1073/pnas.1319780111.
Pirrone N, Cinnirella S, Feng X, Finkelman RB, Friedli HR, Leaner J, Mason R, Mukherjee AB, Stracher GB, Streets DG, Telmer K. Global mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic and natural sources. Atmospheric Chemistry and Physics. 2010 Jul 2;10(13) :5951-64.
Pistikopoulos, P., H.M. Wortham, L. Gomes, S. Masclet-Beyne, E. Bon Nguyen, P.A. Masclet, G. Mouvier. (1990) Mechanisms of formation of particulate polycyclic aromatic hydrocarbons in relation to the particles size distribution : effects on meso-scale transport. Atmos. Environ. 24A :2573-2584.
Prosser RS, Parrott JL, Galicia M, Shires K, Sullivan C, Toito J, Bartlett AJ, Milani D, Gillis PL, Balakrishnan VK. 2017. Toxicity of sediment-associated substituted phenylamine antioxidants on the early life stages of Pimephales promelas and a characterization of effects on freshwater organisms. Environmental Toxicology Chemistry 36 : 2730−2738. DOI : 10.1002/etc.3828
Qin, M., B. N. Murphy, K. K. Isaacs, B. C. McDonald, Q. Lu, S. A. McKeen, L. Koval, A. L. Robinson, C. Efstathiou, C. Allen, H. O. T. Pye (2021). « Criteria pollutant impacts of volatile chemical products informed by near-field modelling. » Nature Sustainability 4(2) : 129-137.
Radke, L.F., Hobbs, P.V., Eltgroth, M.W. 1980. Scavenging of aerosol particles by precipitation. J. Appl. Meteorol., 19 :715-722, 10.1175/1520-0450(1980)019<0715 :SOAPBP>2.0.CO;2
Rivellini, L. H.; Adam, M. G.; Kasthuriarachchi, N.; Lee, A. K. Y., Characterization of carbonaceous aerosols in Singapore : Insight from black carbon fragments and trace metal ions detected by a soot particle aerosol mass spectrometer. Atmospheric Chemistry and Physics 2020, 20, (10), 5977-5993.
Rodgers, T.F.M., Giang, A., Diamond, M. L., Gillies, E., Saini, A. Field-Based Distribution and Bioaccumulation Factors for Cyclic and Aliphatic Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in an Urban Sedentary Waterbird Population. Nat. Comm. 2023, 14, 1175.
Saini, A., Clarke, J., Jariyasopit, N., Rauert, C., Schuster, J.K., Halappanavar, S., Evans, G., Su, Y., Harner, T. Flame Retardants in Urban Air : A Case Study in Toronto Targeting Distinct Source Sectors. Environmental Pollution 2019, 247, 89-97.
Shah, R. U., M. M. Coggon, G. I. Gkatzelis, B. C. McDonald, A. Tasoglou, H. Huber, J. Gilman, C. Warneke, A. L. Robinson, A. A. Presto (2020). « Urban Oxidation Flow Reactor Measurements Reveal Significant Secondary Organic Aerosol Contributions from Volatile Emissions of Emerging Importance. » Environmental Science & Technology 54(2) : 714-725.
Shahpoury, P., Harner, T., Lammel, G., Lelieveld, S., Tong, H., Wilson, J. : Development of an antioxidant assay to study oxidative potential of airborne particulate matter, Atmos. Meas. Tech. 2019, 12, 6529–6539.
Shahpoury P., Zhang Z.W., Arangio A., Celo V., Dąbek- Złotorzyńska E., Harner T., Nenes A. The influence of chemical composition, aerosol acidity, and metal dissolution on the oxidative potential of fine particulate matter and redox potential of the lung lining fluid. Environment International. 2021, 148, 106343.
Shahpoury, P. et al. (2022). Inter-comparison of oxidative potential metrics for airborne particles identifies differences between acellular chemical assays. Atmospheric Pollution Research, 13, 101596.
Shahpoury, P., Lelieveld, S., Johannessen, C., Berkemeier, T., Celo, V., Dąbek- Złotorzyńska, E., Harner, T., Lammel, G., Nenes, A., Aerosol acidity, ligand complexation, and soluble metals influence the oxidative potential of fine particulate matter in urban environments. (en préparation)
Shahpoury, P., Lelieveld, S., Srivastava, D., Baccarini, A., Mastin, J., Berkemeier, T., Celo, V., Dąbek- Złotorzyńska, E., Harner, T., Lammel, G., Nenes, A. : Aerosol acidity and ligand complexation regulate the temporal changes in solubility of transition metals and oxidative burden of fine aerosols particles; a multi-year Canadian perspective. 2023 (In-preparation)
Shi, Q., Tao, Y., Krechmer, J. E., Heald, C. L., Murphy, J. G., Kroll, J. H., Ye, Q. (2021). Laboratory Investigation of Renoxification from the Photolysis of Inorganic Particulate Nitrate. Environ. Sci. Technol., 55, 854 – 861. https ://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.0c06049
Soares, J., Makar, P.A., Aklilu, Y., Akingunola, A. (2018) The use of hierarchical clustering for the design of optimized monitoring networks. Atmos. Chem. Phys. 18 :6543–6566.
Sommariva, R., Crilley, L. R., Ball, S. M., Cordell, R. L., Holliz, L. D. J., Bloss, W. J., Monks, P. S. (2021) Enhanced wintertime oxidation of VOCs via sustained radical sources in the urban atmosphere, Environ. Pollut., 274 : 116563 (doi : 10.1016/j.envpol.2021.116563)
Steffen A, Douglas T, Amyot M, Ariya P, Aspmo K, Berg T, Bottenheim J, Brooks S, Cobbett F, Dastoor A, Dommergue A. A synthesis of atmospheric mercury depletion event chemistry in the atmosphere and snow. Atmospheric Chemistry and Physics. 2008 Mar 12;8(6) :1445-82.
Strawbridge, K. B., Travis, M. S., Firanski, B. J., Brook, J. R., Staebler, R., and Leblanc, T.: A fully autonomous ozone, aerosol and nighttime water vapor lidar: a synergistic approach to profiling the atmosphere in the Canadian oil sands region, Atmos. Meas. Tech., 11, 6735–6759, 2018.
Streets DG, Horowitz HM, Jacob DJ, Lu Z, Levin L, Ter Schure AF, Sunderland EM. Total mercury released to the environment by human activities. Environmental science & technology. 2017 Jun 6;51(11) :5969-77.
Szabo, D.; Moodie, D.; Green, M. P.; Mulder, R. A.; Clarke, B. Field-Based Distribution and Bioaccumulation Factors for Cyclic and Aliphatic Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in an Urban Sedentary Waterbird Population. Environ. Sci. Technol. 2022, 56 (12), 8231-8244.
Szponar N, McLagan DS, Kaplan R J, Mitchell CP J, Wania F, Steffen A, Bergquist B A 2020 Isotopic characterization of atmospheric gaseous elemental mercury by passive air sampling Environ. Sci. Technol. 54 10533–43.
Tao, Y., Murphy, J. C. (2019) The Mechanisms Responsible for the Interactions among Oxalate, pH, and Fe Dissolution in PM2.5, ACS Earth Space Chem, 3, 10, 2259 – 2265. https ://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsearthspacechem.9b00172
Tevlin, A., Galarneau, E., Zhang, T., Hung, H. (2021) Polycyclic aromatic compounds (PACs) in the Canadian environment : ambient air and deposition. Environ. Poll. 271 :116232.
Tian, Z.; Zhao, H.; Peter, K. T.; Gonzalez, M.; Wetzel, J.; Wu, C.; Hu, X.; Prat, J.; Mudrock, E.; Hettinger, R.; Cortina, A. E.; Biswas, R. G.; Kock, F. V. C.; Soong, R.; Jenne, A.; Du, B.; Hou, F.; He, H.; Lundeen, R.; Gilbreath, A.; Sutton, R.; Scholz, N. L.; Davis, J. W.; Dodd, M. C.; Simpson, A.; McIntyre, J. K.; Kolodziej, E. P., A ubiquitous tire rubber–derived chemical induces acute mortality in coho salmon. Science 2021, 371, (6525), 185-189.
Thomson EM, Breznan D, Karthikeyan S, MacKinnon-Roy C, Charland JP, Dąbek- Złotorzyńska E, Celo V, Kumarathasan P, Brook JR, Vincent R. Cytotoxic and inflammatory potential of size-fractionated particulate matter collected repeatedly within a small urban area. Part Fibre Toxicol. 2015 Jul 16;12 :24. doi : 10.1186/s12989-015-0099-z. PMID : 26178321; PMCID : PMC4502610.
Thomson EM, Breznan D, Karthikeyan S, MacKinnon-Roy C, Vuong NQ, Dąbek- Złotorzyńska E, Celo V, Charland JP, Kumarathasan P, Brook JR, Vincent R. Contrasting biological potency of particulate matter collected at sites impacted by distinct industrial sources. Part Fibre Toxicol. 2016 Dec 1;13(1) :65. doi : 10.1186/s12989-016-0176-y. PMID : 27906031; PMCID : PMC5134226.
Travis, K. R., Crawford, J. K, Chen, G., Jordan, C. E., Nault, B. A., Kim, H., et al. (2022). Limitations in representation of physical processes prevent successful simulation of PM2.5 during Korus-AQ. Atmos. Chem. Phys., 22, 7933-7958.
Vandenboer, T. C., Markovic, M. Z., Sanders, J. E., Ren, X., Pusede, S. E., Browne, E. C., Cohen, R. C., Zhang, L., Thomas, J., Brune, W. H., Murphy, J. G. (2014) Evidence of nitrous acid (HONO) reservoir at the ground surface in Bakersfield, CA, during CalNex 2010, J. Geophys. Res. Atmos., 119 : 9093 – 9106.
Van Vaeck, L. and K. Van Cauwenberghe. (1978) Cascade impactor measurements of the size distribution of the major classes of organic pollutants in atmospheric particulate matter. Atmos. Environ. 12 :2229-2239.
Vasić, M.V., Mihailović, A., Kozmidis-Luburić, U., Nemes, T., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Antić, B. 2012. Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: correlation analysis of metal content and fine particles distribution. Chemosphere, 86:585-592.
Venier, M.; Salamova, A.; Hites, R. A. How to distinguish urban vs. agricultural sources of persistent organic pollutants? Curr. Opin. Environ. Sci. Health 2019, 8, 23-28.
Wang, W., Jariyasopit, N., Schrlau, J., Jia, Y., Tao, S., Yu, T.W., Dashwood, R.H., Zhang, W., Wang, X., Simonich, S.L., 2011. Concentration and photochemistry of PAHs, NPAHs, and OPAHs and toxicity of PM2.5 during the Beijing Olympic games. Environ. Sci. Technol. 45 (16), 6887-6895.
Wang, X.; Heald, C. L.; Ridley, D. A.; Schwarz, J. P.; Spackman, J. R.; Perring, A. E.; Coe, H.; Liu, D.; Clarke, A. D. Exploiting Simultaneous Observational Constraints on Mass and Absorption to Estimate the Global Direct Radiative Forcing of Black Carbon and Brown Carbon. Atmos. Chem. Phys. 2014, 14 (20), 10989−11010.
Weichenthal, S., Shekarrizfard, M., Traub, A., Kulka, R., Al-Rijleh, K., Anowar, S., Evans, G., Hatzopoulou, M. : Within-city spatial variations in multiple measures of PM2.5 oxidative potential in Toronto, Canada. 2019. Environ. Sci. Technol. 53, 2799–2810.
Whaley, C.H., Galarneau, E., Makar, P.A., Akingunola, A., Gong, W., Gravel, S., Moran, M.D., Stroud, C., Zhang, J., Zheng, Q. (2018) GEM-MACH-PAH (rev2488) : a new high-resolution chemical transport model for North American polycyclic aromatic hydrocarbons and benzene. Geosci. Model Dev. 11 : 2609-2632.
Williams, J.P., Ars, S., Vogel., F., Regehr, A., Kang, M. (2022) Differentiating and mitigating methane emissions from fugitive leaks from natural gas distribution, Historic Landfills, and Manholes in Montréal, Canada. Environ. Sci.Technol. 56 : 16686–16694
Womack, C. C., McDuffie, E. E., Edwards, P. M., Bares, R., de Gouw, J. A., Docherty, K. S., et al. (2019). An odd oxygen framework for wintertime ammonium nitrate aerosol pollution in urban areas : NOx and VOC control as mitigation strategies. Geophysical Research Letters, 46, 4971–4979. https :// doi.org/10.1029/2019GL082028
Wnorowski, A. (2017) Characterization of the ambient air content of parent polycyclic aromatic hydrocarbons in the Fort McKay region (Canada). Chemosphere, 174, 371–379.
Wnorowski, A., Charland, J.-P. (2017). Profiling quinones in ambient air samples collected from the Athabasca region (Canada). Chemosphere 189, 55–66.
Wren, S., Mihele, C.M., Lu, G., Jiang, Z., Wen, D., Hayden, K., Mittermeier, R.L., Staebler, R.M., Cober, S.G., Brook, J.R. (2020) Improving insights on air pollutant mixtures and their origins by enhancing local monitoring in an area of intensive resource development. Environ. Sci. Technol. 54 :14936–14945.
Wren, S.N., McLinden, C.A., Griffin, D., Li, S.,-M., Cober, S.G., Darlington, A., Hayden, K., Mihele, C., Mittermeier, R.L., Wheeler, M., Wolde, M., Liggio, J. (2023) Aircraft and satellite observations reveal historical gap between top–down and bottom–up CO2 emissions from Canadian oil sands. PNAS Nexus 2 :pgad140.
Xu, J., Zhang, M., Ganji, A., Mallinen, K., Wang, A., Lloyd, M., Venuta, A., Simon, L., Kang, J., Gong, J., Zamel, Y., Weichenthal, S., and Hatzopoulou, M. (2022) Prediction of Short-Term Ultrafine Particle Exposures Using Real-Time Street-Level Images Paired with Air Quality Measurements. Environ. Sci. Technol 56 :12885-12897.
Yan, C.; Zheng, M.; Bosch, C.; Andersson, A.; Desyaterik, Y.; Sullivan, A. P.; Collett, J. L.; Zhao, B.; Wang, S.; He, K.; Gustafsson, Ö . Important Fossil Source Contribution to Brown Carbon in Beijing during Winter. Sci. Rep. 2017, 7, 43182.
Ye, C., Zhang, N., Gao, H., Zhou, X. (2017) Photolysis of particulate nitrate as a source of HONO and NOx, Environ. Sci. Technol., 51 : 6849 – 6856.
You, Y., Staebler, R. M., Moussa, S. G., Su, Y., Munoz, T., Stroud, C., Zhang, J., and Moran, M. D. : Long-path measurements of pollutants and micrometeorology over Highway 401 in Toronto, Atmos. Chem. Phys., 17, 14119–14143, https ://doi.org/10.5194/acp-17-14119-2017, 2017.
You, Y. Samar G. Moussa, Lucas Zhang, Long Fu, James Beck, and Ralf M. Staebler (2021) Quantifying fugitive gas emissions from an oil sands tailings pond with open-path Fourier transform infrared measurements. Atmos. Meas. Tech. 14 :945–959.
Zbieranowski, Antoni L., and Julian Aherne (2012). Ambient concentrations of atmospheric ammonia, nitrogen dioxide and nitric acid across a rural–urban–agricultural transect in southern Ontario, Canada. Atmospheric Environment 62 : 481-491.
Zhang, H., S. Kondragunta, I. Laszlo, and M. Zhou, Improving GOES Advanced Baseline Imager (ABI) aerosol optical depth (AOD) retrievals using an empirical bias correction algorithm, Atmos. Meas. Tech., 13, 5955–5975, 2020.
Zhang, L., Vet, R., O’Brien, J. M., Mihele, C., Liang, Z., & Wiebe, A. (2009). Dry deposition of individual nitrogen species at eight Canadian rural sites. Journal of Geophysical Research : Atmospheres, 114(D2).
Zhang. W. Z., Shahpoury, P., Zhang, W., Harner, T., Huang, L. A new method for measuring airborne carbonaceous particles using PUF disk passive samplers. Chemosphere 2022, 299, 134323.
Zhang, X., Saini, A., Hao, C., Harner, T. Passive Air Sampling and Nontargeted Analysis for Screening POP-like Chemicals in the Atmosphere : Opportunities and Challenges. Trends in Anal Chem. 2020, 132, 116052.
Zhang, Y., Xu, C., Zhang, W., Qi, Z., Song, Y., Zhu, L., Dong, C., Chen, J., Cai, Z. p-Phenylenediamine Antioxidants in PM2.5 : The Underestimated Urban Air Pollutants. Environ. Sci. Technol. 2022b 56, 11, 6914–6921.
Zhao, X., Griffin, D., Fioletov, V., McLinden, C., Davies, J., Ogyu, A., Lee, S. C., Lupu, A., Moran, M. D., Cede, A., Tiefengraber, M., and Müller, M. : Retrieval of total column and surface NO2 from Pandora zenith-sky measurements, Atmos. Chem. Phys., 19, 10619–10642, https ://doi.org/10.5194/acp-19-10619-2019, 2019.
Zhao, X., Griffin, D., Fioletov, V., McLinden, C., Cede, A., Tiefengraber, M., Müller, M., Bognar, K., Strong, K., Boersma, F., Eskes, H., Davies, J., Ogyu, A., and Lee, S. C. : Assessment of the quality of TROPOMI high-spatial-resolution NO2 data products in the Greater Toronto Area, Atmos. Meas. Tech., 13, 2131–2159, https ://doi.org/10.5194/amt-13-2131-2020, 2020.
Zhao, X., Fioletov, V., Alwarda, R., Su, Y., Griffin, D., Weaver, D., Strong, K., Cede, A., Hanisco, T., Tiefengraber, M., McLinden, C., Eskes, H., Davies, J., Ogyu, A., Sit, R., Abboud, I., Lee, S. C. : Tropospheric and Surface Nitrogen Dioxide Changes in the Greater Toronto Area during the First Two Years of the COVID-19 Pandemic, Remote Sens., 14, 1625, https ://doi.org/10.3390/rs14071625, 2022.
D. Zhu, H.D. Kuhns, J.A. Gillies, V. Etyemezian, S. Brown, A.W. Gertler, Analysis of the effectiveness of control measures to mitigate road dust emissions in a regional network (2012) Transportation Research Part D : Transport and Environment, (17) 332-340.
P. Zoogman, et al. : Tropospheric emissions : Monitoring of pollution (TEMPO), JQSRT, Volume 186, 2017, Pages 17-39, https ://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2016.05.008.
Annexes
Annexe A : Auteurs et contributeurs
Auteure principale
- Elisabeth Galarneau, Environnement et changement climatique Canada, Division de la recherche sur la qualité de l’air
Contributeurs - Environnement et changement climatique Canada
- Ihab Abboud, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Stéphane Belair, Division de la recherche météorologique
- Alicia Berthiaume, INRP - Division de l’information sur les substances
- Elisa Boutzis, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Valbona Celo, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Amanda Cole, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Matthew Cooper, Bureau du programme de qualité de l’air
- Ewa Dąbek- Złotorzyńska, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Andrea Darlington, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Ashu Dastoor, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Jonathan Davies, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Zoe Davis, Bureau du programme de la qualité de l’air
- Andrew Elford, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Vitali Fioletov, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Bernard Firanski, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Wanmin Gong, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Debora Griffin, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Tom Harner, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Katherine Hayden, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Hayley Hung, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Liisa Jantunen, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Ali Katal, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Alex Lee, Division de la recherche sur la qualité de l’air
Colin Lee, Division de la recherche sur la qualité de l’air - Sum Chi Lee, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Sylvie Leroyer, Division de la recherche météorologique
- John Liggio, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Alex Lupu, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Anne Marie Macdonald, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Katrina MacSween, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Mahtab Majdzadeh, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Paul Makar, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Zen Mariani, Division de la recherche météorologique
- Chris McLinden, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Cristian Mihele, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Stefan Miller, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Samar Moussa, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Jason O’Brien, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Akira Ogyu, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Matthew Parsons, Bureau du programme de qualité de l’air
- Shuzhan Ren, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Stacey Robinson, Division de l’écotoxicologie et de la santé de la faune sauvage
- Amandeep Saini, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Jasmin Schuster, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Kirill Semeniuk, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Andrew Sheppard, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Chris Sioris, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Reno Sit, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Michael Sitwell, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- May Siu, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Ralf Staebler, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Alexandra Steffen, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Craig Stroud, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Geoffrey Stupple, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Gérald Tetreault, Division de la recherche sur les contaminants aquatiques
- Philippe Thomas, Division écotoxicologie et santé de la faune sauvage
- Kenjiro Toyota, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Felix Vogel, Division de la recherche climatique
- Jeremy Wentzell, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Michael Wheeler, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Luc White, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Andrzej Wnorowski, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Sumi Wren, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Rosa Wu, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Junhua Zhang, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Leiming Zhang, Division de la recherche sur la qualité de l’air
- Xiaoyi Zhao, Division de la recherche sur la qualité de l’air
Contributeurs - Santé Canada
- Sabina Halappanavar, Bureau de recherche et de science de la santé environnementale
- Markey Johnson, Bureau de l’eau et de la qualité de l’air
- Pourya Shahpoury, Bureau de recherche et de science de la santé environnementale
- Errol Thomson, Bureau de recherche et de science de la santé environnementale
Contributeurs - Université Concordia
- Cassandra Johannessen, Département de chimie et biochimie (doctorante)
- Xianming Zhang, Département de chimie et biochimie
Contributrice - Dalhousie University
- Rachel Chang, Département de physique et des sciences de l’atmosphère
Contributrice - Université métropolitaine de Toronto
- Roxana Suehring, Département de chimie et de biologie
Contributeur – Université Trent
- Mark Parnis, Département de chimie
Contributeur - Université de Montréal
- Patrick Hayes, Département de chimie
Contributeur - Université du Québec à Rimouski
- Zhe Lu, Institut des sciences de la mer
Contributrice - Université de la Colombie-Britannique
- Amanda Giang, Institut des ressources, de l’environnement et du développement durable
Contributeurs - Université de Toronto
- Jonathan Abbatt, Département de chimie (St. George)
- Matthew Adams, Département de géographie, géomatique et environnement (Mississauga)
- Bridget Bergquist, Département des sciences de la terre (St. George)
- Arthur Chan, Département de génie chimique et de chimie appliquée (St. George)
- Miriam Diamond, Département des sciences de la terre (St. George)
- Jamie Donaldson, Département des sciences physiques et environnementales (Scarborough)
- Greg Evans, Département de génie chimique et de chimie appliquée (St. George)
- Cheol-Heon Jeong, Département de génie chimique et de chimie appliquée (St. George)
- Jennifer Murphy, Département de chimie (St. George)
- Kim Strong, Département de physique (St. George)
- Yee Ka Wong, Département de génie chimique et de chimie appliquée (St. George) (PDF)
- Debra Wunch, Département de physique (St. George)
Contributeurs - Université de York
- Mark Gordon, Département des sciences et de l’ingénierie de la terre et de l’espace
- Trevor VandenBoer, Département de chimie
- Cora Young, Département de chimie
Contributrice - Ville de Toronto
- Esther Attard, Services animaliers de Toronto
Annexe B : Calendrier de la campagne de mesures intensives sur le terrain au début de 2024
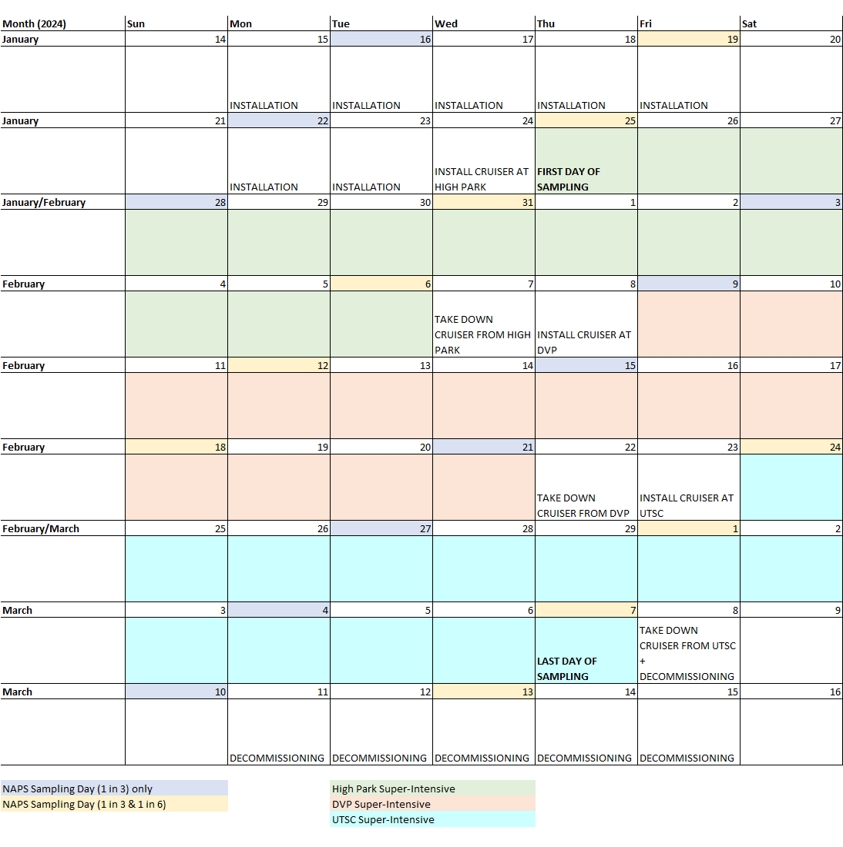
Description textuelle – Annexe B
| 15-19 janvier, 2024 | Installation |
| 22-23 janvier, 2024 | Installation |
| 24 janvier, 2024 | Installattion cruiser au High Park |
| 25 janvier, 2024 | Premier jour d’échantillonage |
| 7 février, 2024 | Desinstallation cruiser du High Park |
| 8 février, 2024 | Installation cruiser au Brick Works |
| 22 février, 2024 | Desinstallation cruiser au Brick Works |
| 23 février, 2024 | Installation cruiser à UTSC |
| 7 mars, 2024 | Dernier jour d’échantillonage |
| 8 mars, 2024 | Desinstallation cruiser à UTSC |
| 8 mars et 11-15 mars, 2024 | Declassement |
RNSPA Échantillonage (1 jour sur 3) :
16, 22, 28 janvier; 3, 9, 15, 21, 27 février; 4, 10 mars
RNSPA Échantillonage (1 jour sur 3)NAPS Sampling Day (1 jour sur 3 et 1 jour sur 6) :
19, 25, 31 janvier; 6, 12, 18, 24 février; 1, 7, 13 mars
Super intensif au High Park
25 janvier – 6 février
Super-Intensive à Brick Works
9-21 février
Super intensif à UTSC
24 février – 7 mars
Annexe C : Résumé des activités scientifiques d’ÉPAHT dans le cadre des thèmes 2, 3 et 4
Thème 2 : Sources et processus
Projet 2.1 : Mesures sur un parking de banlieue comparant les émissions de démarrage à froid et de fonctionnement (Responsable : Felix Vogel, ECCC Division de la recherche climatique ; Collaborateurs/trices : Sébastien Ars, ECCC Division de la recherche climatique ; Debra Wunch, Université de Toronto St. George; Matthew Adams, Université de Toronto Mississauga)
Projet 2.2 : Mesures des émissions à proximité d’une artère (responsable : Mark Gordon, Université York)
Projet 2.3 : Mesures des isotopes métalliques à proximité des routes (responsable : Bridget Bergquist, Université de Toronto)
Projet 2.4 : Caractérisation temporelle des émissions de particules provenant des tuyaux d’échappement et d’autres sources près d’une artère du centre-ville (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto ; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)
Projet 2.5 : Modèles spatiaux d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions autres que de gaz d’échappement (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)
Projet 2.6 : Mesures à proximité de la route des particules d’usure des pneus dans l’atmosphère (Responsable : Alex Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Arthur Chan, Université de Toronto; Hayley Hung, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 2.7 : Résoudre le problème des émissions de l’aviation et du trafic en hiver (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateur : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto)
Projet 2.8 : Importance des émissions d’ammoniac (NH3 ) dans les gaz d’échappement des véhicules (Responsable : Ralf Staebler, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateur : Leiming Zhang, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 2.9 : Analyse comparative des polluants observés pendant ÉPAHT et déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Responsable : Alicia Berthiaume, ECCC Inventaire national des rejets de polluants - Division de l’information sur les substances)
Projet 2.10 : Modélisation des récepteurs des COV à l’aide de la factorisation à matrice positive (PMF) (Responsable : Samar Moussa, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air)
Projet 2.11 : Contribution relative des oxy-CAPs primaires et secondaires (quinones) dans l’air ambiant (Responsable : Andrzej Wnorowski, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 2.12 : Les budgets des composés contenant de l’azote et du chlore et leur impact sur la formation d’aérosols (Responsable : Sumi Wren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Jennifer Murphy et Jamie Donaldson, Université de Toronto ; Jeremy Wentzell, Michael Wheeler, Craig Stroud, Colin Lee, Stefan Miller, et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air).
Projet 2.13 : L’impact des COV non émis, tels que les produits chimiques volatils (PCV), sur la formation d’aérosols organiques et le potentiel de formation d’ozone (Responsable : Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Patrick Hayes, Université de Montréal).
Projet 2.14 : Émissions primaires et formation secondaire du carbone brun atmosphérique (Responsable : Alex Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs : Jon Abbatt, Université de Toronto, Craig Stroud et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air).
Projet 2.15 : Impact des émissions urbaines sur le dépôt de substances acidifiantes (Responsables : Amanda Cole et Jason O’Brien, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaboratrice : Jennifer Murphy, Université de Toronto)
Projet 2.16 : Impact du traitement humide (précipitations, nuages et brouillard) sur les polluants urbains et les dépôts (Responsable : Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs : Michael Wheeler, Paul Makar, Craig Stroud, et Colin Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 2.17 : Interactions brouillard-polluants dans l’air urbain (Responsable : Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Michael Wheeler, Jason O’Brien, et Amanda Cole, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Rachel Chang, Université Dalhousie)
Projet 2.18 : Transformations des CAP déposés avec et sur la neige (Responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 2.19 : Évolution des substances toxiques semi-volatiles en fonction de la taille des particules (responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de recherche sur la qualité de l’air)
Projet 2.20 : Améliorer la compréhension de l’énergie cinétique turbulente et de la hauteur de la couche limite dans les environnements urbains (Responsable : Zen Mariani, ECCC Division de la recherche météorologique ; Collaborateurs/trices : Ralf Staebler, Paul Makar, Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Sylvie Leroyer, Stéphane Bélair, ECCC Division de la recherche météorologique ; Mark Gordon, Université York)
Projet 2.21 : Etude des impacts de la turbulence induite par les véhicules dans l’environnement urbain proche de la route (Responsable : Ralf Staebler, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Zen Mariani, Sylvie Leroyer et Stéphane Belair, ECCC Division de la recherche météorologique ; Paul Makar et Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Mark Gordon, Université York)
Projet 2.22 : Évaluation des influences météorologiques sur les gradients de polluants liés au trafic près des routes (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto ; Collaborateur : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto)
Thème 3 : Impacts
Projet 3.1 : Relier le potentiel d’oxydation aux toxiques atmosphériques et aux contaminants à l’état de traces (Responsables : Tom Harner et Amandeep Saini, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Pourya Shahpoury, Santé Canada et Université Trent ; Sabina Halappanavar, Santé Canada ; Xianming Zhang et Cassandra Johannessen, Université Concordia ; John Liggio, Samar Moussa, Jasmin Schuster et Craig Stroud, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air ; Mark Parnis, Université Trent ; Greg Evans, Université de Toronto)
Projet 3.2 : Potentiel d’oxydation des particules provenant d’échantillons de terrain et de sources connues (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto ; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto ; Tom Harner, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 3.3 : Évaluation de la toxicité in vitro des substances toxiques et des contaminants à l’état de traces présents dans l’air à proximité des routes et dans les zones urbaines de fond (Responsable : Errol Thomson, Santé Canada : Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 3.4 : Identifier les dépassements des lignes directrices de qualité de l’air basées sur la santé (Responsable : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaboratrice : Amanda Giang, Université de la Colombie-Britannique)
Projet 3.5 : Détermination des relations épidémiologiques entre l’exposition aux polluants atmosphériques et les effets néfastes sur la santé (Responsable : Markey Johnson, Santé Canada; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 3.6 : Évaluation des effets de l’eau de fonte des neiges sur les embryons d’amphibiens (Responsable : Stacey Robinson, ECCC Division de recherche en toxicologie de la faune; Collaborateurs/trices : Hayley Hung et Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Roxana Suehring, Toronto Metropolitan University)
Projet 3.7 : Évaluation de l’impact des contaminants traces aéroportés sur la santé des poissons urbains (Responsable : Gérald Tetreault, ECCC Division de la recherche sur les contaminants aquatiques; Collaborateurs : Hayley Hung, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Zhe Lu, Université du Québec à Rimouski ; Trevor VandenBoer et Cora Young, Université York ; Roxana Suehring, Toronto Metropolitan University)
Projet 3.8 : Évaluation de la charge en contaminants à l’état de traces et des liens avec l’altération de l’état de santé des mammifères semi-aquatiques (Responsable : Philippe Thomas, ECCC Division de l’écotoxicologie et de la santé de la faune; Collaboratrice : Esther Attard, Toronto Animal Services)
Thème 4 - Évaluation et amélioration des outils scientifiques
Projet 4.1 : Évaluation des techniques de mesure du mercure en suspension dans l’air dans les environnements urbains (Responsable : Alexandra Steffen, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Katrina MacSween et Geoff Stupple, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Bridget Bergquist, Université de Toronto)
Projet 4.2 : Relier les sources de microplastiques et de microfibres à leur présence dans l’air et les systèmes aquatiques (Responsable : Liisa Jantunen, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaboratrice : Miriam Diamond, Université de Toronto)
Projet 4.3 : Mesures de la profondeur optique des aérosols par satellite pour identifier les sources d’aérosols urbains (responsable : Chris Sioris, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air)
Projet 4.4 : Validation de la distribution verticale des polluants atmosphériques communs à l’aide de Pandora à la Tour CN (Responsable : Xiaoyi Zhao, Division de la recherche sur la qualité de l’air du CECC ; Collaborateurs/trices : Vitali Fioletov, Ihab Abboud, Jonathan Davies, Akira Ogyu, Reno Sit, et Sum Chi Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.5 : Évaluation des mesures hivernales du nouveau satellite TEMPO (Responsable : Debora Griffin, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Chris McLinden et Sumi Wren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.6 : Émissions des véhicules sans échappement et représentation dans GEM-MACH (Responsable : Ali Katal, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Junhua Zhang, Craig Stroud et Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.7 : Chimie aqueuse et potentiel oxydatif dans GEM-MACH (Responsable : Alex Lupu, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Craig Stroud, Kenjiro Toyota, Tom Harner et Amandeep Saini, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Pourya Shahpoury, Santé Canada et Université Trent)
Projet 4.8 : Preuve de concept pour la modélisation inverse des émissions avec GEM-MACH (Responsable : Shuzhan Ren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Debora Griffin et Michael Sitwell, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.9 : Amélioration de la modélisation de la couche limite et des dépôts à l’aide de GEM-MACH (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs/trices : Shuzhan Ren, Ali Katal, Paul Makar, Wanmin Gong, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Sylvie Leroyer et Stéphane Belair, ECCC Division de la recherche météorologique)
Projet 4.10 : Évaluation de la modélisation des particules ultrafines dans GEM-MACH avec MOSAIC (Responsable : Ashu Dastoor, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateur : Kirill Semeniuk, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.11 : Évaluation du modèle GEM-MACH par facteurs de source (Responsable : Mahtab Majdzadeh, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs : Craig Stroud, Kenjiro Toyota et Paul Makar, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.12 : Répartition des secteurs sources à l’aide de GEM-MACH (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air, Collaborateurs/trices : Junhua Zhang et Samar Moussa, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.13 : Évolution de la résolution horizontale de 2,5 km à 250 m en utilisant GEM-MACH avec le bilan énergétique de la ville (TEB) (Responsable : Craig Stroud, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air ; Collaborateurs : Paul Makar, Ali Katal, et Shuzhan Ren, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)
Projet 4.14 : Amélioration des processus physiques hivernaux dans GEM à l’échelle urbaine (Responsable : Sylvie Leroyer, ECCC Division de la recherche météorologique ; Collaborateur : Stéphane Bélair ; ECCC Division de la recherche météorologique)
Annexe D : Équipe de direction d’ÉPAHT
| Poste | Nom(s) |
|---|---|
| Chercheur principal | Elisabeth Galarneau |
| Planification technique et opérationnel | Andrew Sheppard |
| Sites fixes | Jasmin Schuster, Kenny Yan |
| Plates-formes mobiles et portables | Sébastien Ars, Colin Lee |
| Modélisation du transport chimique | Elisa Boutzis, Ali Katal, Craig Stroud |
| Acquisition de données | Andrew Elford |
| Gestion des données | Bernard Firanski |
| Gestion de projet et logistique | Andrea Darlington, Sandro Leonardelli, Stoyka Netcheva |
| Administration | Keta Joshi |
| Site | Nom(s) |
|---|---|
| Tour CN | Raymon Atienza |
| Evergreen Brick Works | Samar Moussa |
| High Park | Gang Lu |
| Aéroport international Lester B. Pearson | Zen Mariani |
| Paquet portable super-intensif | Jeremy Wentzell, Sumi Wren |
| Université de Toronto Scarborough | Cecilia Shin |
| Plate-forme mobile | Nom |
|---|---|
| Plate-forme DRC d’ECCC | Felix Vogel |
| Plate-forme du groupe Adams | Matt Adams* |
| Plate-forme du groupe Evans | Cheol-Heon Jeong ** |
- *Université de Toronto Mississauga
- **Université de Toronto St. George