Éditorial – Pour des recherches et des programmes antiracistes et culturellement adaptés destinés aux communautés noires canadiennes

Accueil Revue PSPMC
Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada
Date de publication : avril 2025
ISSN: 2368-7398
Soumettre un article
À propos du PSPMC
Naviguer
Table des matières | Page suivante
Jude Mary Cénat, Ph. D., M. Sc., C. Psych.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Aïsha Lofters, M.D.Note de rattachement des auteurs 3; Josephine Etowa, I.A., Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs 4
https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.4.01f

Attribution suggérée
Éditorial par Cénat JM et al. dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0
Rattachement des auteurs
Correspondance
Jude Mary Cénat, École de psychologie, pavillon Vanier, Université d’Ottawa, 136, Jean-Jacques Lussier, bureau 4017, Ottawa (Ontario) K1N 6N5; tél. : 613-562-5800; courriel : jcenat@uottawa.ca
Citation proposée
Cénat JM, Lofters A, Etowa J. Pour des recherches et des programmes antiracistes et culturellement adaptés destinés aux communautés noires canadiennes. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2025;45(4):157-160. https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.4.01f
Introduction
En 2021, les personnes noires formaient 4,3 % de la population générale au CanadaNote de bas de page 1. Comparativement aux autres groupes raciaux ou ethniques, ce sont elles qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des 20 dernières années : entre 2001 et 2021, leur nombre a doublé, passant de 662 210 personnes à 1,5 million de personnesNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3. Les communautés noires présentent une grande diversité culturelle, comptant 182 pays de naissance sur 230 pour l’ensemble de la population. Ces communautés sont formées à la fois de personnes dont les ancêtres sont installés au Canada depuis des siècles, comme c’est le cas en Nouvelle-Écosse, d’enfants et petits-enfants d’immigrants et d’immigrants récents originaires de pays tels que la Jamaïque, Haïti, le Nigéria et l’ÉthiopieNote de bas de page 1.
Selon les données du dernier recensement, quatre Canadiens noirs sur dix sont nés au Canada, et plus de trois jeunes Noirs de moins de 14 ans sur quatre sont nés au Canada (sur l’ensemble des jeunes Noirs de moins de 14 ans, 77 % sont nés au Canada)Note de bas de page 1. Les données du recensement de 2021 indiquent également que les membres des communautés noires sont beaucoup plus jeunes que les membres de la population généraleNote de bas de page 1. Dans l’ensemble, 42 % des personnes noires ont moins de 25 ans, comparativement à 28 % dans la population générale. Environ 26 % des personnes noires au Canada sont âgées de moins de 15 ans, contre 16 % dans la population générale. En outre, seulement 6 % des personnes noires sont âgées de 65 ans et plus, comparativement à 18 % dans la population généraleNote de bas de page 1.
Ces données témoignent d’une dynamique et de caractéristiques démographiques uniques qui influent sur les sphères sociales, économiques et éducatives. Les communautés noires affichent un visage jeune et dynamique qui contraste avec le vieillissement observé au sein de la population générale. Toutefois, les personnes noires, quel que soit leur lieu de naissance, se heurtent à diverses iniquités qui nuisent à leur santé physique et mentale, ce qui se traduit par un accès limité aux services de santé et par l’obtention de soins de moindre qualité en comparaison des personnes blanchesNote de bas de page 4Note de bas de page 5.
Comprendre les disparités raciales en santé touchant les communautés noires du Canada
Les disparités en matière de santé physique et mentale qui touchent les populations noires au Canada découlent d’une combinaison complexe de déterminants systémiques, sociaux, économiques, éducatifs et individuels qui structurent l’expérience de ces populations au sein de la sociétéNote de bas de page 6Note de bas de page 7Note de bas de page 8. Selon les études menées au cours des dix dernières années, cinq grands problèmes sont à l’origine de ces disparités : 1) le racisme systémique et institutionnel auquel font face les personnes noires dans différentes sphères de la société, racisme qui affecte leur santé physique et mentaleNote de bas de page 9; 2) le manque de données fiables, qui empêche l’élaboration de politiques de santé fondées sur des données probantes à l’intention des communautés noiresNote de bas de page 10; 3) le manque de formation des professionnels de la santé, qui limite leur capacité à fournir des soins antiracistes et culturellement adaptésNote de bas de page 11; 4) l’absence de stratégies politiques visant à cerner, à étudier et à réduire les inégalités raciales dans les soins de santéNote de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 12 et 5) un financement insuffisant de la recherche en santé des populations noires.
Ces inégalités sont exacerbées par des déterminants sociaux de la santé tels que l’adversité, l’insécurité économique, un emploi précaire, des inégalités de revenus et la pauvreté, l’insécurité alimentaire, un logement inadéquat, de l’exclusion et des expériences de discrimination raciale, notamment dans les services de santéNote de bas de page 13. Parmi les disparités observées figurent un accès insuffisant au dépistage des maladies chroniques (p. ex. diabète, hypertension, cancerNote de bas de page 14) de même qu’une prise en charge et une autoprise en charge limitées en matière de santé.
En ce qui concerne la santé mentale, des études publiées depuis 2021 ont établi la prévalence de la dépression, de l’anxiété, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de symptômes psychosomatiques, de la consommation d’alcool et de substances, d’idées suicidaires et d’autres éléments, ainsi que la présence de différents facteurs associés à tous ces élémentsNote de bas de page 15Note de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20. Ces études ont montré que la prévalence de symptômes sévères de l’anxiété, de la dépression, du TSPT et d’autres troubles est beaucoup plus élevée au sein des communautés noires. Elles ont également révélé que la discrimination raciale quotidienne, la discrimination raciale majeure dans différentes sphères de la société (soins de santé, éducation, interactions avec la police, etc.), les microagressions raciales et le racisme intériorisé sont les principaux facteurs qui contribuent à la mauvaise santé mentale des populations noires au Canada. D’autres études ont démontré que les personnes noires ont un accès limité aux soins de santé mentale et éprouvent une méfiance plus intense envers les professionnels de la santé mentale et les services offertsNote de bas de page 21Note de bas de page 22.
Ces inégalités ont de graves conséquences, conduisant à une diminution de la qualité de vie des personnes noires, à un fardeau accru affectant les communautés noires et à une amplification des iniquités socioéconomiques. Le manque de données probantes et d’études représentatives sur la santé des personnes noires au Canada limite la capacité des décideurs à élaborer des politiques efficaces aptes à réduire les disparités et à promouvoir l’équité en santé. Cette lacune entrave également la capacité à offrir aux étudiants et aux professionnels de la santé de la formation sur les questions raciales et à prodiguer des soins de santé antiracistes et culturellement adaptés. Les revues systématiques menées au cours des dernières années ont permis de faire ressortir plus particulièrement l’existence de disparités concernant le dépistage du cancer et les soins liés au cancer, la thromboembolie veineuse, la psychose, les problèmes de santé mentale et certains comportements en matière de santé, notamment la réticence des jeunes Noirs à l’égard de la vaccinationNote de bas de page 14Note de bas de page 21Note de bas de page 23Note de bas de page 24Note de bas de page 25.
La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les iniquités raciales en santé et a mis en lumière l’absence de personnes noires dans le processus de prise de décision en matière de santé publique. Non seulement les personnes noires ont été touchées de façon disproportionnée en termes d’infection et de mortalité, mais elles ont aussi été moins susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19Note de bas de page 26Note de bas de page 27, d’où la nécessité d’une initiative qui vise à faire place à la recherche sur les divers besoins en santé des communautés noires par une mobilisation antiraciste et culturellement adaptée.
Un numéro spécial consacré à la réalisation de recherches et de programmes culturellement adaptés destinés aux communautés noires canadiennes
Ce numéro spécial réunit cinq articles, soit trois articles qui font la synthèse de données probantes, un article qui décrit le protocole d’une étude proposant des réflexions méthodologiques sur la façon de mobiliser les jeunes Noirs en ce qui concerne leurs besoins en matière de santé mentale et un article de recherche qualitative qui repose sur une évaluation empirique du financement fédéral octroyé aux initiatives destinées à soutenir la santé mentale des personnes noires au Canada.
Le premier article, rédigé par Jamieson et ses collaboratrices, présente les résultats d’une revue exploratoire a porté sur le manque de données en matière d’inégalités raciales en santé au Canada et qui rend compte des difficultés en matière de mesure et de surveillance des disparités en santé touchant les populations racisées, en particulier les Canadiens noirs, ainsi que des possibilités d’amélioration de la mesure et de la surveillance de ces disparitésNote de bas de page 28. À l’aide d’une approche à plusieurs étapes, les auteures ont étudié les méthodes d’enquête utilisées au Canada et dans des pays comparables (États-Unis, Royaume‑Uni, Australie et Nouvelle-Zélande) afin de cerner les pratiques prometteuses qui permettraient d’améliorer les stratégies d’échantillonnage et la collecte de données. Les résultats montrent des lacunes importantes dans les enquêtes sur la santé menées au Canada, celles-ci ne faisant pas appel à des stratégies d’échantillonnage ciblé, ce qui supposerait par exemple d’utiliser la concentration raciale ou ethnique à l’échelle spatiale pour accroître la représentation des groupes racisés. En comparaison, des pays similaires adoptent ce type d’approche afin de produire des ensembles de données plus volumineux et plus représentatifs. Les auteures recommandent l’adoption au Canada de méthodes d’échantillonnage ciblé, de suréchantillonnage et de modélisation prédictive afin de mieux tenir compte des populations racisées. Elles soulignent également l’importance d’intégrer les données sur la race dans les bases de données administratives pour permettre une surveillance plus efficace des inégalités.
Une seconde revue exploratoire, celle-là réalisée par Mombo et sa collaboratrice, porte sur les méthodes de collecte, d’analyse et de diffusion des données sur la santé et les déterminants sociaux de la santé des communautés noires du QuébecNote de bas de page 29. Bien que les Québécois noirs représentent plus du quart des Canadiens noirs, ils ont fait l’objet de peu de recherches, notamment en ce qui concerne les répercussions de la pandémie de COVID-19. La revue exploratoire, qui inclut 43 études, décrit les difficultés et les stratégies liées à la collecte et à l’analyse des données, et s’intéresse plus particulièrement à la nécessité de mieux comprendre les réalités vécues par les populations noires du Québec. Les études portent sur quatre secteurs : la santé, les services sociaux, l’éducation et l’emploi.
Le troisième article, rédigé par Yusuf et ses collaborateurs, présente les résultats d’une revue rapide axée sur les approches de recherche en santé adaptées sur le plan culturel et structurel chez les communautés noires des provinces atlantiques canadiennesNote de bas de page 30. Même si cette région est habitée par des populations noires depuis la fin du 17e siècle, d’importantes inégalités subsistent : on y observe par exemple les taux de pauvreté infantile les plus élevés du pays. Quarante-sept études ont été incluses dans la revue rapide, et les résultats mettent en lumière les répercussions du racisme, l’importance de la mobilisation communautaire et l’adoption de cadres de recherche participative en tant que pratiques culturellement adaptées.
Dans le quatrième article de ce numéro spécial, Salami et ses collaborateurs s’intéressent à la façon de s’y prendre pour amener les jeunes Noirs à participer à la recherche et à étudier leurs besoins en matière de santé mentale, en utilisant une approche de recherche-action participative culturellement adaptéeNote de bas de page 31. L’étude s’est déroulée en deux phases : des entretiens individuels avec 30 jeunes et des cafés-causeries mensuels avec 99 jeunes sur une période de 4 mois. Les participants ont été recrutés par l’entremise de réseaux communautaires en Alberta qui favorisent l’autonomisation des jeunes et la collaboration avec ceux-ci. Les résultats, qui mettent de l’avant des stratégies culturellement adaptées pertinentes pour améliorer l’accès aux services de santé mentale, ont été communiqués aux intervenants.
Le dernier article, par Salami et ses collaborateurs, recense les leçons tirées du Fonds pour la santé mentale des communautés noires, un programme créé en 2018 par l’Agence de la santé publique du Canada pour remédier aux inégalités en matière de santé mentale subies par les Canadiens noirsNote de bas de page 32. Les chercheurs présentent les résultats de l’analyse des rapports annuels et finaux de 15 projets, ainsi que des entrevues qu’ils ont menées avec des représentants de 9 organisations ayant reçu du financement. Trois grands thèmes émergent de leur analyse : les facteurs de succès, les défis rencontrés et les leçons apprises. Les facteurs de succès sont la rétribution et les incitatifs, l’application d’un modèle de recherche-action participative et un leadership assuré par des personnes noires. Parmi les défis rencontrés figurent les retards dans l’obtention des fonds, les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les difficultés à maintenir des partenariats.
Conclusion
Ce numéro spécial de la revue Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada revêt une importance capitale, car il met en lumière les inégalités en santé qui touchent les communautés noires du Canada et propose des solutions pour y remédier. Ceci est d’autant plus important dans le contexte d’une Amérique du Nord en pleine transformation, où les programmes en matière d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité, ainsi que les programmes visant à contrer le racisme envers les personnes noires, sont de plus en plus menacés et font face à un avenir incertain. Ce numéro présente des travaux de recherche novateurs sur la collecte de données, la mobilisation communautaire et les méthodes de recherche qui tiennent compte des différences culturelles et structurelles. Le thème central est la nécessité d’intégrer davantage le point de vue des communautés noires dans la prise de décisions en matière de santé publique, d’améliorer la formation des professionnels de la santé et d’accroître la représentation des personnes noires au sein des organismes de financement à l’appui de politiques équitables en santé. Ce numéro marque une étape cruciale dans la lutte contre les difficultés affectant les populations racisées du Canada et dans la promotion de l’équité en santé au sein de ces populations.
Financement
Aucun.
Conflits d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.
Avis
Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.
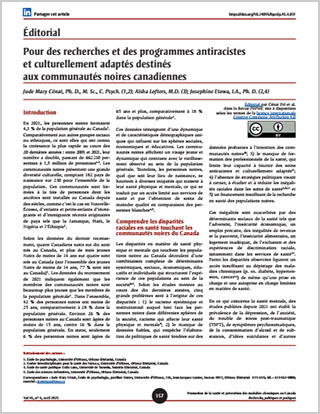 Télécharger en format PDF (514 ko, 4 pages)
Télécharger en format PDF (514 ko, 4 pages)