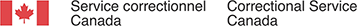Épisode 3 : Célébrons les femmes du service correctionnel
Dans cet épisode, nous recevons deux invitées bien spéciales : la commissaire du SCC, Anne Kelly, ainsi que la directrice de l’Établissement Joliette au Québec, Edith Isabelle. Elles nous racontent leurs parcours vers leurs brillantes carrières et les difficultés qu’elles ont surmontées. Dans leurs propres mots, elles nous disent ce que ça fait d’être une femme au sein du système correctionnel.
Durée : 26:09
Publié : 4 mars 2024
Animatrice : Kirstan Gagnon
Invitées : Edith Isabelle, Commissaire Anne Kelly
Transcription Épisode 3 : Célébrons les femmes du service correctionnel
Kirstan : En 2023, les femmes représentaient 51 % de l'effectif total du SCC. De nos jours, ce nombre peut sembler normal, mais à la fin des années 1970, il aurait été plus difficile à imaginer.
Les femmes ont joué un rôle important dans le système correctionnel canadien, mais leurs rôles limités ont créé des défis et des obstacles pour plusieurs d'entre elles qui espéraient poursuivre une carrière dans le domaine.
À travers les années et grâce aux efforts de nombreux employés. De plus en plus de femmes ont commencé à travailler dans le système correctionnel. Aujourd'hui, le SCC compte près de 11 500 femmes qui, par leur dévouement, ont contribué à façonner le système correctionnel qu'on connaît aujourd'hui.
Dans cet épisode, nous mettrons en valeur l'histoire de deux dirigeantes du SCC. Je suis votre animatrice, Kirstan Gagnon et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Au-delà des prisons.
Pour commencer, on s'assoit avec Edith Isabelle qui est la directrice de l’Établissement Joliette, une prison pour femmes, au Québec. Donc Edith, ça fait quand même un petit bout que vous travaillez pour le Service correctionnel du Canada. C'est quand que vous avez débuté votre carrière, puis c'était quoi, votre poste ?
Edith : Moi, j'ai commencé ma carrière au Service correctionnel du Canada en 2007 comme agente de libération conditionnelle, mais en milieu carcéral, à l'Établissement Leclerc, qui est un établissement à sécurité médium au Québec. Un établissement qui n'existe plus par contre. Mais oui, j'ai commencé au niveau des interventions auprès des détenus.
Kirstan : Puis, pourquoi tu as choisi ce travail? C'est quoi qui t'intéressait?
Edith : Ben moi, c'est sûr qu'à la base j'ai étudié en criminologie, donc tu sais, j'avais un intérêt et un attrait pour le travail qui impliquait toute l'intervention auprès de gens démunis ou de gens criminalisés. Puis, j'ai commencé ma carrière, par contre, après mon baccalauréat, j'ai commencé ma carrière dans un organisme communautaire qui était une maison de transition, en fait, qui hébergeait à la fois une clientèle judiciarisée autant au niveau provincial que fédéral.
Donc j'étais capable d'observer de l'extérieur à l'époque tous les moyens qu'on avait à la disposition au SCC pour soutenir la clientèle délinquante qui est souvent démunie, avec des enjeux qui sont complexes.
Mais j'ai vraiment été attirée par tous les moyens qu'on avait à notre disposition au SCC pour vraiment atteindre notre mandat de réinsertion sociale. Puis, j'ai bien constaté de l'extérieur encore avant de commencer au SCC, que c'est une grosse organisation avec plusieurs secteurs, plusieurs divisions, avec un esprit de travail multidisciplinaire. Donc, je voyais comme une opportunité en intégrant le SCC, une opportunité de faire carrière dans une organisation où j'aurais plusieurs opportunités différentes au sein d'une même carrière.
Kirstan: Puis là, vous êtes rendue directrice de l'établissement à Joliette. C'est quoi que vous aimez le plus de votre travail? Edith: Bien, c'est relativement nouveau. Ça fait deux mois que je suis à l'Établissement Joliette comme directrice. C'est un établissement strictement pour les femmes. Donc, ce qui est vraiment franchement intéressant à Joliette : les enjeux de la clientèle délinquante sur place sont importants.C'est des gens qui ont des histoires de vie parfois atroces, des enjeux de santé mentale importants, beaucoup de délinquants autochtones qui ont commis des délits de violence. Mais c'est de voir après ça comment, dans un petit milieu comme Joliette, qui est quand même relativement un petit pénitencier, et à quel point on a des moyens pour répondre efficacement à cette clientèle-là.
Il y a un travail interdisciplinaire à Joliette qui est vraiment intéressant, même du côté de la sécurité.
On parle plus d'intervenants de première ligne à Joliette, là, c'est pas juste des agents correctionnels, c'est des intervenants de première ligne, donc qui ont aussi un mandat d'intervention auprès de la population.
Puis, tout ce travail-là se fait autant avec nos partenaires des initiatives autochtones, que nos équipes de santé mentale.
Alors, c'est vraiment de voir tout ce travail-là, interdisciplinaire, autour d'une même personne pour arriver un peu à l'amener à être plus, à être fonctionnel en milieu carcéral, mais ultimement arriver à travailler ses facteurs contributifs, ses facteurs de risque, puis éventuellement arriver à une remise en liberté qui va être sécuritaire.
Kirstan : Parfait. Puis à Joliette, c'est quoi qui te motive le plus dans ton travail en tant que directrice?
Edith : Les gens à Joliette sont réellement engagés. Ils ont le sens du devoir assez prononcé. Puis, je pense que c'est la beauté d'une carrière au SCC. C’est que, assez concrètement, tu peux mesurer la portée de ton travail, tu sais, les répercussions de ton travail auprès de la clientèle délinquante. Puis ça, ça amène, des fois, je pense que ça amène l'équipe à être doublement engagée.
Tu sais, quand tu as le bénéfice de voir les résultats concrets des actions que tu poses. Mais ça fait en sorte que Joliette, c'est vraiment un milieu où le personnel est engagé, puis aussi le personnel est ouvert d'esprit.
Tu sais, on a depuis récemment une nouvelle directive au SCC, vous le savez probablement, mais au niveau de la considération liée au genre. Donc on doit adapter nos façons de faire au genre auquel s’identifie la personne.
Puis, si la personne souhaite être incarcérée dans un établissement pour femmes parce qu’elle se considère comme une femme, même si à la naissance c’est un homme, mais présentement, on incarcère cette personne-là dans un établissement en sécurité dans un établissement pour femmes, à moins qu’il y ait un enjeu de risque très spécifique à l’endroit des autres codétenus.
Mais tout ça, cette dimension-là, c’est présent à Joliette, donc ça amène, moi, je trouve que c’est une équipe qui est très ouverte d’esprit.
Kirstan : Donc avec tout ça, toute votre expérience, de quoi es-tu le plus fier ?
Edith : Potentiellement, ce dont je suis le plus fier, c'est, c'est un moment où j'ai eu un mandat. Il y a quelques années, j'ai eu le mandat d'implanter dans un établissement au Centre fédéral de formation, d'implanter au niveau de la division de la santé, toute une nouvelle fonction de gestionnaire des programmes de soins de santé. C’était une fonction qui était, qui n'existait pas au Québec, qui avait commencé à être implantée ailleurs au Canada. Donc, ça a été de contribuer à ce nouveau modèle-là, au plan de la santé, mais dans un contexte où ce n'était pas mon secteur, ce n’était pas mon champ d'expertise, en fait.
Moi, j'étais issue des interventions essentiellement en communauté. Donc ça a été un peu d'utiliser mes aptitudes au niveau de la gestion de mon leadership et tout, puis d'arriver à l'appliquer à un secteur d'activité qui, à la base n'était pas le mien.
Kirstan: Est-ce que vous avez vu des évolutions ou des changements importants au cours des années ? Edith: Si je me ramène à quand, en 2007 ? Quand j'ai commencé ma carrière comme agente de libération en établissement, je me souviens très bien qu'à l'époque, tu sais, dans la direction, c'était presque tous des hommes, mais à l'époque, c'était des gérants d'unités.À mon souvenir, ce n'était que des hommes. Tu sais, le maître-chien et les ARS, c'étaient des hommes. Au niveau des agents de libération, par contre, il y avait des femmes. Moi, j'ai essentiellement eu des patrons hommes, mais des patrons hommes qui ont fait beaucoup, qui ont fait beaucoup de place aux femmes, fait que je n’ai jamais senti qu'il y avait un écart en communauté au niveau de la représentativité des femmes. Même que je vous disais, je vous dirais qu'au contraire, je pense que j'ai été privilégiée. C'est essentiellement des patrons hommes qui m'ont poussé à chercher un peu, à me développer au niveau de ma carrière, puis à accéder à des fonctions supérieures et qui m'ont vraiment encouragé à faire de l'intérim après ça et développer pour faire des processus et tout.
Et après ça, je vous avouerai que quand je suis retournée en établissement au Centre fédéral de formation, c'est ça, comme je pense dans les années 2018. Mais là, il y avait pour moi la place de la femme qui était tout aussi significative que celle des hommes. Mais oui, je vois l'écart par contre entre mon passage au Leclerc en 2007, où là il n'y avait pas ce niveau de représentativité là, mais pas du tout.
Kirstan : C'est encourageant que vous ayez eu beaucoup d'appuis de vos collègues et vos supérieurs au cours des années, par exemple. C'est, c'est quelque chose de génial, vraiment.
Edith : Oui, moi, mon expérience personnelle, je n’ai jamais senti que j'ai été désavantagée par le fait d'être une femme.
Kirstan : Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui envisagent une carrière dans le service correctionnel?
Edith : Tu sais, c'est pas une question évidente à répondre, mais tu sais, si je me ramène un peu, si je fais l'effort de m'attarder un peu à toutes les discussions que j'ai eues avec des femmes à travers les années, on dirait que le constat, le bien personnel, le constat que je fais, c'est que les femmes ont souvent des très, très bonnes aptitudes. Mais ont souvent le sentiment que leurs connaissances ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs ambitions, que leur expérience n'est pas suffisante, qu'elles ont besoin d’aller accéder, qu’elles ont encore besoin davantage, de se perfectionner avant de, avant d'accéder à des postes de niveau supérieur ou accepter des nouveaux mandats.
En fait, j'ai souvent été confrontée à des collègues femmes pour lesquelles le sentiment, c'est une espèce de sentiment d'imposteur, les freiner un peu dans leurs ambitions pour accéder à ce qu’elles souhaitaient.
Alors moi, je pense que le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas se sous-estimer. Tu sais quand on fait partie d'une organisation comme le Service correctionnel du Canada, ça n'existe pas une personne parfaite, qui a toutes les connaissances, qui a toutes les expériences pour être à 150 % prête pour une nouvelle fonction ou un nouveau défi.
Ça n'a pas besoin d'être une promotion, mais ça peut être un mandat X. Moi, le conseil que je donnerais, c'est juste de ne pas sous-estimer comment c'est la présence de l'équipe qui peut nous amener à bien faire les choses et d'avoir confiance en leur capacité.
Le conseil, ce serait juste de ne pas sous-estimer la force de l'équipe et d'oser, finalement, d'oser accéder à des choses que les femmes souhaitent et de ne pas se freiner par cette espèce de sentiment là, d'imposteur ou de ne pas être suffisante, ou de ne pas avoir suffisamment d'habiletés ou suffisamment de connaissances.
C'est à partir du moment où il y a le discernement, la réflexion stratégique, bien après ça, c'est la façon dont on s'entoure, puis la façon dont on travaille avec les gens qui nous amènent des fois à bien diriger ou à bien atteindre nos objectifs.
Kirstan : C'est des très bons conseils Edith. Puis je te remercie beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé vous parler.
Edith : Non, non, vraiment merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est vraiment apprécié.
Kirstan : Notre prochaine invitée a débuté sa carrière en 1983 comme agente de gestion de cas. Au fil des ans, elle a travaillé plusieurs postes dans la communauté, dans les établissements, à une administration régionale et aussi à l'administration centrale. Commissaire Kelly, bienvenue au balado !
Edith : Merci Kirstan, ça me fait plaisir d'être ici.
Kirstan : Donc ça fait plusieurs années, au-dessus de 40, que vous êtes au Service correctionnel du Canada. Pouvez-vous nous parler de votre tout premier emploi au SCC?
Commissaire Kelly : Oui, bien, ça fait maintenant 40 ans, je suis dans ma 41ᵉ année avec le Service correctionnel du Canada et j'ai commencé le 3 octobre 1983. Et puis ma première position était comme agente de gestion de cas, qui aujourd'hui serait agente de libération conditionnelle en établissement. Ça, c'était mon premier, mon premier poste.
Kirstan : Puis parlez-moi un petit peu de la première journée que vous êtes arrivée au travail. C’est quoi qui s’est passé ?
Commissaire Kelly : Bien, j'avais fini mes années universitaires. La première chose que je me suis fait dire avant de prendre le poste était, peut-être que je voudrais avoir une auto, parce qu'il n'y avait pas d'autobus, donc j'ai pris, je me suis acheté une nouvelle auto. Puis la première journée, je me suis rendue à Collins Bay parce que c'est là où j'ai commencé mon premier emploi. Et puis je me suis stationnée, puis pour se rendre à l'entrée principale de Collins Bay, c'est quand même une bonne marche. Et puis quand tu longes le mur, il y a beaucoup de vent. Puis ça, je me rappelle de ça, de ma première journée.
Et puis là on m’a assigné un bureau et puis on m’a donné le, ce que dans le temps, on appelait le manuel de gestion de cas. L'autre chose, c'est qu'on m'a assigné un genre de mentor. Et puis c'est la personne que j'allais voir, si j'avais des questions au niveau du travail que je faisais.
Kirstan : Alors, vous deviez étudier des manuels, des cartables, de plein de documents pour savoir les politiques et tout ça. C'est parce que, en 1983, on n'avait pas d'ordinateur?
Commissaire Kelly : Non, en 1983, il n’y avait certainement pas d'ordinateur, tout était papier. Donc on donnait le gros manuel qu'il fallait que tu passes au travers pour savoir comment faire le travail d'un agent de libération conditionnelle. Et puis en 1983 aussi, la façon dont ça fonctionnait, s'il fallait que j'écrive, si j'écrivais un rapport sur un détenu, il fallait que je l'écrive à la main. Tu mettais ton travail dans un, ce qu'on appelle un typing pool.
Donc l'évaluation, en vue d'une décision, se faisait dactylographier par des gens qui te le redonnaient. Et puis là, il fallait que tu fasses le document pour s'assurer qu'il était de qualité. Donc s'il fallait aussi que tu écrives une note de service à quelqu'un, tu devais le faire par écrit, le mettre dans une enveloppe, puis ça s'en allait par courrier, puis là tu attendais pour la réponse. Donc tout était plus au ralenti.
Kirstan : Vous avez parlé un petit peu de votre mentor. Donc quand vous avez débuté votre carrière, il vous aidait à justement vous accoutumer au travail. Puis je suppose, si vous aviez des questions, vous pouviez aller le voir. Est-ce qu'il y avait des femmes, d’autres femmes dans le milieu de travail qui vous ont encouragé à travers les années?
Commissaire Kelly : Oui. Puis, quand j'ai commencé en 1983, il n'y avait pas, très très peu de femmes au niveau d’agent correctionnel. Ça venait juste, tout juste, de commencer. Mais au niveau de l'agent de gestion de cas, il y en avait quelques-unes. Donc les femmes, on se supportait.
Mais je dois dire que dans ma carrière après quand je suis devenue superviseure, après ça gestionnaire, il y a plusieurs réunions dans lesquelles j'étais comme la seule femme, puis parmi plusieurs hommes, mais cela a beaucoup changé maintenant. Puis, il y a beaucoup plus de femmes qui sont agentes correctionnelles, et puis beaucoup de femmes qui sont des agents de libération conditionnelle ou agent de programme. Je pense qu’on en a le même nombre, sinon plus que d’hommes en ce moment. Kirstan : Ça a vraiment changé. Aujourd’hui, en fait, on a plus de 50 % de femmes au Service correctionnel du Canada. C'est quand même un beau changement. Notre commissaire est seulement la deuxième femme à occuper le poste de commissaire. Alors c'est encourageant pour les femmes de vouloir monter dans leur carrière. Et vous, vous donnez un bel exemple, je pense.
Avez-vous des conseils à donner aux jeunes femmes qui, soit, veulent rentrer au Service correctionnel du Canada, ou qui veulent monter dans leur carrière à l'intérieur du service?
Commissaire Kelly : Bien, je pense que tu l'as dit Kirstan. Le fait est que, en ce moment, je suis la commissaire, je suis la deuxième. Aussi quand on regarde notre comité de direction, on a beaucoup de femmes, beaucoup plus que ce qui existait quand moi-même j'ai joint le comité de direction.
Puis, ça fait déjà au-dessus de 20 ans. La chose que je dirais, c’est être enthousiaste à propos de son travail, vraiment, vraiment se mettre dans le travail, comprendre ce que tu fais, c’est extrêmement important.
Puis aussi, il y a toujours deux devises si tu veux que j’utilise : Il n’y a pas plus grande responsabilité que d’avoir la garde et les soins d’autres êtres humains. Je pense que ça, c’est très important. Et puis aussi : Tout travail est un autoportrait de la personne qui l’a accomplie. Marquez votre travail du sceau de l’excellence. Ça, c’est quelque chose que j’ai essayé de faire tout au long de ma carrière.
Kirstan : Je pense que c’est de bons conseils. Puis, après toutes ces années, c'est quoi qui vous motive le plus dans votre travail?
Commissaire Kelly : Tu sais, dans mes discours, je dis souvent aux gens : j'espère que vous allez être aussi passionnés tout au long de votre carrière que je le suis encore après 40 ans. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais. Tout au long de ma carrière, j'ai aimé tous les postes.
Je dirais que ce qui me garde motivée, c'est vraiment les gens qui travaillent au service. On a des gens qui sont absolument extraordinaires, qui font du travail difficile, au service notre environnement est toujours changeant.
Tu ne peux pas prévoir ce qui va arriver. Que ce soit un établissement, que ça soit en communauté, c'est pas du travail facile, mais les gens viennent, ils croient à notre mission. C'est ça qui me, qui me garde motivée.
Kirstan : Avez-vous un exemple d'un détenu ou une détenue qui est revenu vous voir en disant « Madame Kelly, vous avez vraiment fait une différence dans ma vie ? »
Commissaire Kelly : Oui, il y a eu plusieurs exemples, mais un en particulier. En 1984, j’avais un jeune homme de 18 ans sur mon case load. Et puis souvent, ce que je faisais, c’est essayer pour de les faire imaginer, si ce qu'ils avaient fait, avait été fait à eux ou à une personne qu'ils aiment.
Et puis je suis devenue Commissaire. Dans ma deuxième ou troisième année, ce jeune homme-là m'a écrit un courriel et il m'a dit : Est-ce que vous êtes la Anne Kelly qui était mon agente de libération conditionnelle? Et puis si c'est vous, je voulais juste vous dire que les discussions que nous avons eues à ce moment-là ont eu beaucoup d'impact sur moi. Et puis, je n'ai jamais été encore dans le trouble avec la loi depuis ce temps-là. C'est ça. Ça, c'est, c'est vraiment ce qui le garde encore motivé. C'est des histoires comme celle-là.
Kirstan : Puis, vous semblez avoir beaucoup d'empathie dans votre approche, de mettre, de se mettre dans les souliers des autres et de réfléchir, à faire réfléchir les détenus, en fait, à leurs actions. Est-ce que c'est important l'empathie dans ce genre de travail?
Je pense que c'est très important. Quand on regarde, c'est qu'on voit souvent, les interactions en général peuvent apporter un changement chez quelqu'un, mais des interactions positives peuvent apporter des changements positifs. Je pense que c'est très important d'être capable de transiger avec les détenus et puis de leur faire voir, peut-être, premièrement, d'où ils viennent et puis aussi ce qu'ils ont fait, l'impact que ça peut avoir sur les gens, de leur faire voir certaines choses. Et je pense que c’est certainement le travail qu'on fait.
Puis ça, c’est dans tous les domaines, c’est pas juste comme agent de libération conditionnelle. Parce que les agents correctionnels ont beaucoup de, transige beaucoup avec les détenus. Nos agents des services alimentaires, nos agents de programmes, tout le monde, tous les gens qui transigent avec les détenus. C'est vraiment important parce que la recherche démontre que les interactions positives avec les détenus, quelles qu'elles soient, mènent à une réduction dans la récidive. Donc, je pense que c'est très important.
Kirstan : Puis, ça fait six ans que vous êtes commissaire, dans le fond, puis à travers les années, les derniers six ans, ça a été un petit peu turbulent. Il y a eu beaucoup de changements dans l'environnement externe, puis aussi, ce qu’on a, ce qu’on a vécu à l’interne ici, avec la COVID-19 et toute la gestion qu’on a faite pendant plusieurs années pour garder les détenus en fait, en santé.
Pendant ce temps-là, ça a été quand même quelque chose de difficile que les employés ont vécu. Comment vous faites? C'est quoi qui vous garde motivé à travers tous ces défis-là?
Commissaire Kelly : Définitivement. Il y a eu plusieurs moments maintenant, depuis que je suis commissaire. Je veux dire, on a éliminé l'isolement préventif, on a créé des unités de structure d'intervention, mais un des moments vraiment difficiles a été la pandémie. Puis, vraiment, c’est là où on a vu comment les gens se sont rassemblés, puis des circonstances extrêmement difficiles.
Ils ont fait du travail vraiment surhumain. Tu sais, on avait des gens qui étaient là, nos agents correctionnels, nos infirmières, nos agents de service alimentaire. Ils étaient là tous les jours, dans des situations extrêmement difficiles. Puis, c’est grâce à tout notre personnel qui est absolument incroyable, qui fait du travail extraordinaire, qu’on a été capables de s’en sortir.
Kirstan : Puis, aujourd'hui, c'est quoi qui vous motive de continuer ce travail?
Commissaire Kelly : Premièrement, c'est des gens. Quand je vais visiter des établissements, je peux voir qui ce qui arrive sur le terrain. Puis, je suis toujours épatée du, premièrement de l'innovation, du travail que les gens font, c’est absolument incroyable.
Puis, comment les gens croient en la mission du service, puis qu'ils y tiennent à cœur. Et puis c'est ça, c'est les gens qui travaillent au service.
Kirstan : Parfait. Puis, merci beaucoup de vous avoir joint à nous aujourd'hui.
Commissaire Kelly : Bien, merci beaucoup, Kirstan.
Kirstan : C'est tout pour notre épisode aujourd'hui. J’aimerais dire un grand merci à Edith et à la commissaire Kelly d’avoir participé à cet épisode. Ceci nous amène à la dernière partie de l’épisode appelé Démystifier les services correctionnels, dans lequel on tente de réfuter les mythes et de remettre les pendules à l’heure.
Dans le segment d'aujourd'hui, on traite la question suivante : Est-ce que les femmes ont toujours eu des prisons distinctes au Canada? Pour ce qui est du service correctionnel d'aujourd'hui, oui, c'est vrai.
Mais ce n'était pas toujours le cas. En 1835, presque 100 ans avant l'ouverture de la première prison officielle pour femmes, les premières détenues étaient dirigées au pénitencier provincial du Haut-Canada, aujourd'hui connu comme le pénitencier de Kingston. Malgré qu'elles étaient incarcérées dans une prison pour hommes, elles étaient séparées. Elles étaient aussi placées dans l'hôpital de la prison ou dans l'aile du Nord. Au cours des décennies qui ont suivi les départements pour femmes du pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick et du pénitencier de l'Alberta, à Edmonton, ont également accueilli des femmes à l'occasion.
Mais au fil des années, le besoin d'expansion s'est fait sentir avec la hausse du nombre de détenus. Au milieu des années 30, 99 ans après l'arrivée des premières femmes détenues au pénitencier de Kingston, les départements pour femmes à Dorchester et Edmonton ont fermé leurs portes pour fusionner en un seul établissement principal. En 1934, les femmes quittent les murs du pénitencier de Kingston pour entrer dans la toute première prison officielle pour femmes au Canada.
À ce jour, nous avons six établissements pour femmes, incluant un pavillon de ressourcement pour les autochtones. Dans le prochain épisode d'Au-delà des prisons, nous lançons la première partie de notre série intitulée L'envers du badge. Nous parlerons avec des agents correctionnels qui travaillent dans les établissements de différents niveaux de sécurité. Ceci est une production du Service correctionnel du Canada et je suis votre animatrice, Kirstan Gagnon. Merci et à bientôt.
Contactez-nous
Si vous avez des commentaires sur notre série de balados, n'hésitez pas à nous en faire part. Veuillez ne pas inclure d'informations personnelles ou privées. Envoyez-nous un courriel à l'adresse ci-dessous :