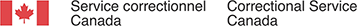Épisode 16 : Partez à la découverte du Musée pénitentiaire du Canada
Depuis 1964, le Musée pénitentiaire du Canada préserve l’histoire riche et complexe du système correctionnel canadien. Situé juste en face de l’ancien Pénitencier de Kingston – le tout premier établissement correctionnel fédéral du Canada – le musée abrite des artéfacts et présente des expositions qui donnent vie à cette histoire.
Dans cet épisode, Yvonne, adjointe à la conservation, et Mike, gestionnaire régional des Communications et passionné de l’histoire du SCC, nous présentent l’évolution du système correctionnel fédéral canadien, de ses débuts avant la Confédération jusqu’à aujourd’hui. Nous explorons en cours de route les jalons importants, les changements de philosophie en matière de services correctionnels et les histoires derrière les événements qui ont façonné le système correctionnel.
Durée : 21:56
Publié : 25 juillet 2025
Animatrices : Kirstan Gagnon et Véronique Rioux
Invités :
- Yvonne, adjointe à la conservation
- Mike, gestionnaire régional des communications, Ontario
Épisode 16 : Partez à la découverte du Musée pénitentiaire du Canada
Véronique : Chaque année, le musée pénitentiaire du Canada accueille plus de 50000 visiteurs curieux de découvrir à quoi ressemblait la vie derrière les barreaux à travers l'histoire du pays. Situé à Kingston, en Ontario, le musée est installé dans Cedarhedge, l'ancienne résidence des directeurs du Pénitencier de Kingston. Aujourd'hui, cette maison ne sert plus de logement. Les pièces sont plutôt remplies d'artefacts et d'histoires qui donnent vie à l'histoire des services correctionnels fédéraux au Canada.
Véronique : Avec autant d'histoires réunies en un seul endroit, nous voulions vous en parler pour piquer votre curiosité. Après avoir fait une visite guidée du musée, je me suis entretenu avec deux employés du Service correctionnel du Canada pour en apprendre davantage sur le musée et l'histoire du système correctionnel canadien. Je suis votre animatrice d'aujourd'hui, Véronique Rioux, et bienvenue dans un nouvel épisode d’Au-delà des prisons.
Véronique : Pour débuter, voici Yvonne, une assistante au musée, qui nous parle du fonctionnement du musée et de tout ce qu'on peut y retrouver.
Véronique : Donc Yvonne, pour commencer, pouvez-vous me parler un peu de du musée pénitentiaire du Canada?
Yvonne : Oui, bien sûr. Le musée se trouve en face du Pénitencier de Kingston, dans l'ancienne résidence du directeur. Sa construction a été autorisée en 1870 par le Premier ministre du Canada Sir John A. McDonald et entièrement réalisée par des détenus. La maison a été achevée en 3 ans au coût de 9000$ et a accueilli sa première famille le 28 août 1873, lorsque le directeur John Creighton a emménagé avec sa famille, ses, ses enfants et son père.
Véronique : Le musée se trouve l'autre côté de la rue du Pénitencier de Kingston. Pourquoi c'était important que le les directeurs soient à proximité comme ça de l'établissement?
Yvonne : À la fin du 19e siècle, la communication n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, donc les agents correctionnels devaient souvent traverser la rue pour transmettre des messages urgents au directeur et des cloches servaient aussi à alerter le personnel en cas d'urgence. Donc être tout près du pénitencier permettait au directeur de réagir rapidement.
Véronique : Ça fait combien de temps que le musée est ouvert?
Yvonne : Le musée a ouvert ses portes en mai 1964, donc ça fait 61 ans qu'il existe aujourd'hui. Il était d'abord situé au collège du personnel à Kingston, avant de déplacer dans l'ancienne résidence du directeur en 1985. Et il se trouve ici encore.
Véronique : Le musée est ouvert pour la saison estivale. Comment ça fonctionne? Est ce qu'il y a des frais d'entrée pour les visiteurs ?
Yvonne : Le musée est ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00 du 1er mai au 31 octobre cette année et l'admission se fait par don. Et c'est en visite libre avec cinq salles au rez-de-chaussée et trois à l'étage que les visiteurs peuvent découvrir à leur rythme. Et nos bénévoles, dont plusieurs ont travaillé pour le SCC comme des anciens agents correctionnels, des directeurs ou des membres de l'administration sont présents aussi pour répondre aux questions et partager leur expérience, ce qui rend la visite encore plus enrichissante.
Véronique : Oui ça, c'est intéressant. Les visiteurs peuvent parler directement avec des gens qui ont travaillé à l'intérieur des prisons à travers le Canada, puis pouvoir poser leurs questions, connaître les faits, connaître des histoires. Vous avez parlé de différentes salles dans le musée, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ce qu’on y retrouve dans ces salles-là, puis peut-être lesquelles sont les plus intéressantes ou les plus populaires auprès des visiteurs?
Yvonne : Parmi les sections les plus populaires du musée, la galerie des d'arts des détenus impressionne souvent les visiteurs. La collection d'armes artisanales et les différents types de punitions attirent aussi beaucoup d'attention. Nos expositions récentes, comme celles sur la prison des femmes et l'émeute de 1971 au Pénitencier de Kingston, ont également beaucoup de de succès.
Véronique : Puis vous avez beaucoup d'artefacts au musée. Pouvez-vous me donner des exemples de ce que les visiteurs peuvent voir quand ils visitent?
Yvonne : comme les différents types de punitions, par exemple, ils peuvent voir la boîte où c'était plus utilisé plus populairement pour les femmes, donc elles devaient se tenir debout dans la boîte comme une punition entre 15 minutes et 9 heures.
Véronique : C'est super intéressant. C'est un monde que auquel on n'a pas vraiment accès habituellement. Puis le musée démontre vraiment l'évolution du service correctionnel, du système carcéral au Canada. Donc on va arrêter là, on va inviter les gens à aller vous visiter cet été. Puis je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui.
Yvonne : Oui, merci beaucoup.
Véronique : J'ai aussi parlé avec Mike, le gestionnaire des communications régionales en Ontario, pour en apprendre davantage sur la riche histoire du Service correctionnel du Canada. Voici notre conversation.
Véronique : Allô Mike, merci d'avoir accepté notre invitation de participer à notre balado.
Mike : Bonjour, merci pour l'invitation.
Véronique : Donc, le musée pénitentiaire du Canada témoigne de la riche histoire du système correctionnel dans notre pays. À quand remonte le premier pénitencier?
Mike : Alors, si on remonte vraiment dans le temps. La, toute première prison au Canada, c'était le Pénitencier de Kingston, qui a officiellement ouvert ses portes le 1 juin 1835. Mais en réalité, le premier bloc de cellules existait déjà en 1834. À l'époque, c'était sous la responsabilité de la province et c'était comme ça jusqu'à la Confédération en 1867. Avant ça, oui, il y avait des prisons, mais le Pénitencier de Kingston, c'était vraiment le premier pénitencier. Au début, c'était pas mal tout le monde ensemble, les hommes, les femmes, les enfants, tous sous le même toit.
Véronique : Puis est-ce qu'on sait avec l'historique que vous avez au musée, est-ce qu'on sait qui étaient les premiers détenus qui ont été incarcérés là, qui ont eu une peine fédérale?
Mike : Ouais alors il y en avait 6, le 1er juin qui sont entrés dans le Pénitencier. C'était tous des hommes. Le tout premier inscrit, c'était un gars nommé Matthew Tavender. Mais en réalité, il y en avait un autre qui était condamné avant lui. Mais dans nos livres, dans nos archives, c'est Matthew Tavender, le premier nom qui est qui est entré dans nos établissements. Environ 3 mois plus tard, il y a trois femmes qui sont arrivées. La première femme incarcérée dans nos livres s'appelait Sarah Downs.
Véronique : OK puis vous avez parlé d'enfants incarcérés avec des adultes, on s'entend que ce n’est pas quelque chose qu'on voit maintenant. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'historique de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour se ramasser dans une prison avec des adultes?
Mike : Ouais alors il y avait, il y avait des enfants, puis on pense à ça aujourd'hui, puis c'est assez troublant. La plus jeune fille qu'on a vu dans nos dans nos livres, elle s'appelait Sarah Jane Pierce. Elle venait de Brockville. Elle avait 9 ans quand elle était condamnée à 7 ans pour vol. L'histoire, c'est qu'elle avait pris des trucs comme une couverture, du thé, du sucre. Elle s'est fait condamner à 7 ans, puis sa mère aussi. Elle était condamnée pour avoir accepté les objets volés. Pour le plus jeune garçon, son nom, c'était Antoine Beauché. Il venait du Québec et lui, il avait 8 ans. Puis lui, il volait des portefeuilles avec ses frères, puis ses amis. Quand il s'est fait condamner, le tribunal l’a même qualifié de voleur expérimenté, même à 8 ans. Alors les temps ont changé.
Véronique : Oui, pour le mieux, effectivement. Puis à quoi ressemblait la vie en prison quand on parle des années 1800?
Mike : Alors c'était dur, c'était très dur. Ce n’était pas trop visé vers la réhabilitation, c'était surtout du travail forcé, apprendre un métier, puis surtout le silence total. On s'entend, ce n'était pas toujours facile le silence total de respecter ce règlement-là. Alors par exemple, le jeune qu'on parlait, Antoine Beauché, le petit de 8 ans, lui, dans nos histoires, on a vu qu'il s'est fait fouetter 47 fois en neuf mois. Puis les raisons pourquoi il s'est fait fouetter, c'était pour avoir ri, sifflé, parlé ou même avoir juste fait du bruit. Alors vraiment, c'était travail forcé, silence total, très différent de ce qu'on a aujourd'hui.
Véronique : Oui puis donc vous parlez de châtiments corporels, de se faire fouetter. Est-ce qu'il y avait d'autres types de punitions qui existaient à ce moment-là pour s'assurer que les détenus, ils respectaient les règlements au pénitencier?
Mike : Il y avait des trucs assez extrêmes, le fameux bain d'eau froide, c'est une des idées qu'on voit au musée. En gros, on mettait la tête du détenu dans un tonneau rempli d'eau glacée. Puis l'idée c'était que ça pouvait calmer le sang qui bouillait. C'était censé calmer ceux qui qui étaient violents, mais on a vu ce que ça causait. Surtout, c'est des migraines. Mais vraiment, c'est ces exemples là, ça montre à quel point nous avons évolué. Aujourd'hui, vraiment, l'accent est mis sur la réhabilitation et pas des trucs extrêmes comme ceux qu'on utilisait dans les années 1800.
Véronique : Oui, comme vous dites, on utilise plus ces outils-là, mais au musée il y a une salle qui est dédiée dans le fond aux différents outils qui étaient utilisés pour la punition dans le fond. Puis c'est quand même impressionnant à voir les différentes techniques qu'il y avait à cette époque-là. Donc on voit vraiment l'évolution là, à travers le musée des conditions en prison au Canada.
Véronique : En parlant de conditions, les détenus, qu'est-ce qu’ils mangeaient à cette époque-là?
Mike : Alors dans le vieux temps, c'est les détenus eux-mêmes qui cultivaient, puis qui préparaient leur nourriture. Alors il y avait toujours un superviseur, quelqu'un qui travaillait pour l'établissement, mais c'était les détenus qui faisaient le boulot. Donc la diète, vraiment, se composait surtout de bœuf, de porc, de patates, de légumes. Juste de la nourriture, vraiment pour que les détenus soient en forme, fort, pour faire leur travail physique.
Véronique : Puis est-ce que à ce moment-là, donc maintenant on sait les détenus ont le droit de recevoir des visites, est-ce que ça a toujours été le cas?
Mike : Pas au début, ça s'est fait petit à petit, mais pour commencer, c'était toujours très encadré. Ça arrivait dans le bureau du directeur ou à travers des clôtures avec des gardes qui écoutaient. Plus tard encore, on a évolué, on a permis des visites familiales privées. Alors ça aussi, ça a beaucoup développé, beaucoup évolué au cours des années.
Véronique : Puis donc vous mentionniez que le Pénitencier de Kingston était le premier pénitencier au Canada qui a ouvert en 1835. Est-ce qu'on comptait beaucoup de détenus à ce moment-là?
Mike : Au 19e siècle, on parlait probablement en moyenne 600 à 800 détenus. Au milieu du 20e siècle, ça explosé explosé. Les nombres qu'on a vu, c'est les nombres les plus élevés. Je dirais environ 1000.
Véronique : Puis est ce qu'on sait pourquoi qu'il y a eu une augmentation au milieu du 20e siècle?
Mike : Ça serait vraiment, je dirais, les périodes d'après-guerre, puis la grande dépression ont certainement joué un rôle avec les soldats qui sont revenus sans emploi. Ils étaient perdus. Souvent, c'était juste s'ils voulaient trouver une façon de gagner de l'argent, une façon de rapide, puis les nombres ont vraiment explosé dans les années 1950, 1960.
Véronique : Puis je comprends qu'après la seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés au système carcéral. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces changements-là ?
Mike : Dans les années 1930, il y a eu des grèves, des émeutes qui ont mis en lumière les problèmes du système. Alors ça mené à la Commission Archambault. Ça, c'est en 1938. Puis la Commission Archambault, ils ont proposé 88 recommandations, dont vraiment un focus sur la prévention du crime et de la réhabilitation. On avance un petit peu en 1953 avec la surpopulation, comme je vous ai dit, les nombres vraiment élevés. Le comité Fauteux a proposé un nouveau type de prison, plus axé sur les programmes, les activités, l'embauche du personnel spécialisé, du travail social, psychologie, criminologie, ceux qui connaissent les droits. Alors ça encore beaucoup évolué avec le comité Fauteux.
Véronique : Donc on est parti de torturer les détenus pour essayer de les réhabiliter, à essayer de comprendre, puis à modifier le comportement. Donc un petit peu plus en ligne avec ce qu'on voit aujourd'hui là, avec les programmes puis les différentes interventions qui sont offerts en prison. Puis donc il y a eu d'autres réformes aussi. Il y a eu la création de la Commission des libérations conditionnelles en 1959. Il y a aussi eu des réformes sur les droits de la personne. Puis malgré toutes ces réformes-là, on a continué à avoir de la violence et des émeutes dans les dans les prisons.
Mike : Ouais, alors au Pénitencier de Kingston, on a eu trois grosses émeutes en 1932, en 1954 et surtout celle, la plus grosse, en 1971. Celle-là elle a duré, je pense, environ quatre jours. Les détenus ont pris contrôle de l'établissement. Six agents correctionnels ont été pris en otage. L'armée a dû encercler le site. Alors quatre jours, je pense environ 600 détenus.
Véronique : Est-ce qu’on sait pourquoi il y a eu une émeute à ce moment-là?
Mike : Il y avait des rumeurs qui avaient des plans de fermeture du Pénitencier de Kingston pour le remplacer par l'Établissement de Millhaven. Les détenus avaient vraiment leur routine. Puis l'idée d'une prison maximale moderne, ça faisait peur.
Véronique : Ça démontre un peu aussi le comme on dit, l’aversion au changement pour les êtres humains. En général, les gens n'aiment pas le changement. Puis même de l'idée de s'en aller dans une prison plus moderne, probablement avec un peu plus d'espace, des meilleures installations c’était comme angoissant pour la population carcérale à ce moment-là. Puis il y a aussi le Bureau de l'enquêteur correctionnel qui a été qui a été créé après cette émeute-là, puis les comités de détenus. Donc, dans le fond, j'imagine qu'à ce moment-là on a réalisé de l'importance de consulter la population carcérale sur les sur ce qui les touche dans le fond, dans leur vie de tous les jours.
Véronique : Plus tôt on parlait de l'ouverture de du Pénitencier de Kingston. Les femmes, les hommes, les enfants y étaient incarcérés ensemble au début. Je crois que c'est dans les années 30, il y a eu la Prison pour femmes de Kingston qui a ouvert ses portes. Pouvez-vous nous parler un petit peu du Pénitencier de Kingston pour femmes qui est maintenant fermé?
Mike : Ouais, dans les années 1930, la Prison pour les femmes de Kingston est déménagée de l'autre bord de la rue. Alors les femmes n'étaient plus sous le même toit que les hommes.
Véronique : C'était suite à des incidents encore une fois que qui avait eu un rapport qui avait été fait, puis qui avait ultimement recommandé la fermeture de l'établissement, puis de d'ouvrir des établissements à travers le Canada pour les femmes pour qu'elles puissent aussi être près de leur système de de de soutien dans la communauté. Parce qu'une femme qui venait de la Colombie Britannique, devait aller à Kingston, donc qui était loin de sa famille, loin de sa de son cercle de soutien.
Mike : Pour une centaine d'années, la seule prison pour les femmes au Canada était à Kingston. Puis là on a une prison pour les femmes dans chaque région du SCC.
Véronique : Puis il y avait aussi plusieurs initiatives qui étaient en place au dans les années 50. On parle d'une émission de radio qui était animée par des détenus en direct du Pénitencier de Kingston. Il y avait des groupes de musique. On gardait quand même les détenus occupés à ce moment-là. Donc vous, vous avez parlé plus tôt qu’il y avait du travail. On a parlé qu'il y avait des psychologues qui avaient été engagés, des travailleurs sociaux. Aujourd'hui encore là, il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont qui sont en place dans les établissements pour garder les détenus occupés. L'éducation, les programmes, les détenus peuvent travailler. Ça les aide à travailler sur eux-mêmes. Ça les aide à réfléchir à ce qui les a amenés à en prison, puis aussi les aider à s'améliorer. Puis maintenant, c'est aussi une exigence pour les détenus qui n’ont pas complété leurs études secondaires de de poursuivre leurs études. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu’il y a toujours eu une importance face à l'éducation dans le système carcéral.
Mike : Ben en fait, la réhabilitation, ça a toujours été un petit peu dans le décor, mais disons que ça l'a vraiment commencé à prendre de l'importance il y a 50, 60 ans. Avant, comme on a dit, c'était vraiment la punition qui dominait. Mais à partir des années 60, 70, on a commencé à se dire, OK, punir, c'est une chose, mais si on veut éviter que les gens reviennent, il faut les aider à changer. Alors de là, la réinsertion est devenu un vrai objectif, des programmes de soutien, comme tu dis, de l'éducation. Pour les programmes d'éducation, au début, c'était vraiment un peu bricolé, c'était les détenus ou c'était même des agents correctionnels qui donnaient les cours. Les enseignants, vraiment, c'est venu plus tard, au 20e siècle, pour offrir des cours plus structurés et pour vraiment mettre de l'importance dans l'éducation pour que les détenus, pour s'avancer, pour se réinsérer dans le la collectivité.
Véronique : Mike, vous nous avez donné vraiment un bel aperçu de l'histoire du système carcéral au Canada. Puis pour avoir visité le musée, c'est super intéressant toute l'histoire qu'on retrouve là. Il y a beaucoup, beaucoup d'items qui sont d'origine, des meubles qui qui appartenaient aux anciens directeurs du Pénitencier de Kingston. Comme on a parlé la salle de punition, il y a aussi une salle avec des armes artisanales qui ont été saisies dans les établissements au cours des années. Donc, j'encourage vraiment les gens qui sont dans le coin de Kingston de faire un petit détour puis d'aller visiter le musée. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Mike : Merci.
Véronique : Merci encore à Mike, Yvonne et à tout le personnel et les bénévoles du musée pour leur aide dans la réalisation de cet épisode. Comme Yvonne l'a mentionné plus tôt dans l'entrevue, le musée pénitentiaire du Canada est ouvert du lundi au dimanche, du 1er mai au 31 octobre.
Véronique : C'est tout pour cet épisode d'Au-delà des prisons. Cette émission est une production du Service correctionnel du Canada et j'ai été votre animatrice, Véronique Rioux. Merci d'avoir été à l'écoute.
Contactez-nous
Si vous avez des commentaires sur notre série de balados, n'hésitez pas à nous en faire part. Veuillez ne pas inclure d'informations personnelles ou privées. Envoyez-nous un courriel à l'adresse ci-dessous :