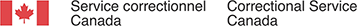Épisode 19 : Les services correctionnels dans les établissements pour femmes
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie dans une prison fédérale pour femmes au Canada?
Les services correctionnels pour femmes ont évolué au fil des décennies, notamment grâce au rapport marquant La création de choix publié en 1990. En fait, les cinq principes qui ont émanés de ce rapport guident encore aujourd’hui nos interventions avec les femmes incarcérées.
Dans cet épisode, nous allons explorer le monde des services correctionnels pour femmes à travers des discussions avec Edith, directrice de l’Établissement Joliette pour femmes, Julie, une gestionnaire de programmes et Cheryl Ann, une femme incarcérée.
Durée : 32:19
Publié : 5 novembre 2025
Animatrice : Véronique Rioux
Invitées :
- Edith, directrice de l’Établissement Joliette pour femmes
- Julie, gestionnaire de programmes à l’Établissement Joliette pour femmes.
- Cheryl Ann, détenue
Épisode 19 : Les services correctionnels dans les établissements pour femmes
Véronique : Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie dans une prison fédérale pour femme au Canada? La plupart d'entre nous n'ont jamais mis les pieds en prison et c'est à travers des émissions comme « Orange is the New Black » qu'on se forge une idée. Mais à quel point cela reflète-t-il la réalité? La réponse brève est que c'est très différent de ce que nous pouvons voir à la télé.
Les services correctionnels pour femmes au Canada ont évolué au fil des décennies, notamment grâce au rapport marquant la création de choix publié en 1990. En fait, les cinq principes qui ont émané de ce rapport guident encore aujourd'hui nos interventions avec les femmes incarcérées. Dans cet épisode, nous allons explorer les services correctionnels pour femmes à travers des discussions avec une directrice d'établissement, une gestionnaire de programmes et une femme incarcérée. Je suis votre animatrice, Véronique Rioux, et bienvenue à un nouvel épisode d'Au-delà des prisons. Il y a 35 ans, les services correctionnels fédéraux pour femmes étaient très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, il n'existait qu'un seul établissement pour femmes dans tout le pays. Les femmes de partout au Canada y étaient incarcérées, peu importe leurs antécédents, leur niveau de sécurité ou leurs besoins. Mais en 1990, les choses ont changé avec la publication du rapport La création de choix, un rapport qui jette un nouveau regard sur les besoins des femmes incarcérées. Une des transformations majeures a été la construction de prisons à travers le pays, conçu selon une approche centrée sur les femmes, axée sur la réinsertion et la sécurité des collectivités, avec l'idée de garder les femmes près de leur famille et leur cercle de soutien à l'extérieur. L'Établissement Joliette pour femme, situé au Québec, a ouvert ses portes en 1997. Notre équipe s'y est récemment rendue et a rencontré Edith et Julie, qui nous parlent de leur approche envers les femmes pour les aider à faire de meilleurs choix et contribuer à leur insertion sociale réussie. Voici notre entrevue. Donc, Bonjour Edith et Julie. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'Établissement de Joliette. Donc, Edith, vous êtes la directrice ici à l'établissement.Edith : Oui.
Véronique : Ça fait comment de temps?
Edith : Ça va faire bientôt 2 ans que je suis directrice en établissement ici à Joliette.
Véronique : Puis vous, Julie votre rôle ici à l'établissement.
Julie : Je suis gestionnaire des programmes actuellement et je suis à l'Établissement Joliette depuis 21 ans.
Véronique : Donc cette année, on célèbre le 35e anniversaire du rapport, La création de choix qui est comme la base dans le fond des services correctionnels fédéraux pour les femmes. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi ce rapport-là, les principes qui en sont ressortis? Puis comment est-ce que ça guide votre travail au quotidien?
Julie : Bien, la création de choix, c'est le fondement même des programmes correctionnels qu'on va donner aux femmes. C'est appuyé sur 5 grands principes. Donc ce qu'on veut, c'est travailler avec la délinquante pour lui donner du pouvoir, le pouvoir de contrôler sa vie, de faire des choix valables dans sa vie, ce qui a souvent fait défaut et l'a emmené en incarcération. Et Pour ce faire, bien, on va travailler en créant un environnement de soutien autour de la délinquante, que ce soit dans le pénitencier mais aussi au niveau de sa réinsertion sociale.
Donc on travaille avec des partenaires, donc le travail débute pendant l'incarcération. Mais elle va se poursuivre aussi avec une responsabilité qui est partagée avec la collectivité.Edith : Fait que c'est vraiment comme. C'est vraiment une approche qui est très présente auprès de l'ensemble de l'équipe. Ici, c'est de dire bien, on s'assure que l'environnement qui est offert aux personnes incarcérées, ça va être vraiment un environnement de soutien où la personne incarcérée, elle, aura des opportunités de reprendre sa vie en main après ça, il y a tout le temps le bout ou ça lui appartient. Mais puis ces opportunités-là peuvent se situer à plusieurs égards, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau de travailler une dépendance fait que le concept c'est de se dire bien, on va minimalement lui offrir un environnement qui sera très propice à ce qu'elle fasse si elle le souhaite, si elle le décide, le choix de travailler les éléments qui l'ont amené à sa criminalité.
Véronique : Donc on est dans un établissement pour femmes ici. Pouvez-vous dans le fond, juste en gros nous expliquer les différences majeures en fait entre un établissement pour hommes et un établissement pour femmes?
Edith : Bien, je pense que le premier si je peux me lancer, c'est que ici bien il y a un établissement pour femmes dans la région du Québec, il y a plusieurs établissements pour hommes. Fait que ce qui nous distingue, c'est qu'on retrouve au sein de notre établissement les 3 niveaux de sécurité qui généralement sont des niveaux de sécurité scindés par établissement. Donc il y a vraiment un secteur au sein de notre établissement qui est à sécurité maximum. Ensuite, un secteur qui est pour les détenus, qui requiert un niveau de sécurité minimum et médium.
Moi, ce que je trouve le gros avantage de travailler dans cette perspective-là, c'est qu'on suit les personnes incarcérées du début à la fin. Donc, même à partir du moment où elles obtiennent leur sentence, puis où on élabore tout leur profil criminel avec la planification correctionnelle, bien ça, ce travail là va nous appartenir finalement, où on va le faire conjointement avec la personne incarcérée jusqu'à ce qu'elle soit remise en liberté. Puis après ça, si elle est suspendue après une remise en liberté, elle va revenir ici. Fait que ça nous permet vraiment, je trouve, d'avoir une approche très entière de la gestion de sa sentence.Julie : Oui, puis les personnes aussi, les femmes qui vont être fragilisées. On a aussi une unité de santé mentale au sein même de notre établissement. Donc on a une équipe multidisciplinaire très riche et diversifiée avec des psychologues, psychoéducateurs, infirmières. Donc il y a vraiment un travail multidisciplinaire qui caractérise les établissements pour femmes avec ce service-là qui est offert sur notre site.
Edith : Sans oublier aussi un secteur qui est très atypique, là dans le milieu correctionnel c'est notre unité mère-enfant. Donc ici dans un établissement pour femme, on a l'opportunité d'avoir des personnes qui sont incarcérées avec leurs enfants. Naturellement, il y a toute une série de critères, mais donc on a une unité qui est dédiée aux mères qui sont incarcérées avec leurs enfants.
Véronique : La population de femmes incarcérées a augmenté à travers les dernières années. Est-ce que vous pouvez me donner un aperçu du profil de la population que vous avez ici?
Edith : Ben en fait, ce qu'on peut nommer d'emblée, c'est que le profil est très diversifié. Tu sais, dans le sens au niveau de la criminalité, considérant qu'on a les trois niveaux de sécurité, on a vraiment l'éventail possible de criminalité que vous pouvez connaître, que ce soit de l'homicide à même la délinquance sexuelle, il y a une certaine augmentation au niveau de la délinquance sexuelle chez les femmes incarcérées, ça peut être des voies de fait, de la fraude, du trafic de stupéfiants. On a vraiment l'ensemble des types de criminalité.
Ce qui est un peu à l'avant plan en termes de les facteurs qui ont contribué à la criminalité assez couramment, puis de façon plus importante chez les femmes que chez les hommes. Il va y avoir des enjeux de santé mentale, des troubles de la personnalité. Donc c'est des aspects des fois qui qui nous distinguent un peu plus au niveau de la criminalité.Julie : Oui, les clientes vont avoir aussi beaucoup de traumatismes. Je pense que c'est 80, 90% qui ont été victimes au niveau d'abus sexuels, abus de violence physique, psychologique. Donc c'est sûr qu'il y a une partie très traumatique qui est particulière aux femmes. On va avoir aussi au niveau de la santé mentale Edith en a déjà discuté mais beaucoup d'anxiété, des syndromes de choc post traumatique. Donc ça caractérise vraiment la clientèle féminine.
Véronique : Donc au niveau de vos interventions, vous prenez ça en compte aussi là, les traumatismes, le bagage que ces femmes-là ont. Comment est-ce que vous adaptez vos interventions pour pouvoir les aider ces femmes à guérir ou à cheminer pour vers la libération, puis acquérir les compétences dans le fond qui et les outils qu'elles ont besoin pour leur réinsertion sociale.
Julie : En fait, on travaille vraiment avec une approche holistique. Quand on rencontre une femme délinquante, si on tient pas compte de toute la partie où elle a été victime, où elle est traumatisée, on arrivera pas à l'amener vers une responsabilisation criminelle. Donc tu sais, la femme est aussi auteur de crime mais elle a toute un long bagage au niveau de ses traumas, puis de sa victimisation. Puis souvent les femmes, quand on les accueille, on se rend compte qu'ils se sont un peu laissées porter par les relations qui ont eu un peu les événements. Tu sais, ils ont eu peu de contrôle dans leur vie puis dans leur prise de décision.
Fait qu'on va offrir un peu ce cadre bienveillant là pour amener la femme à reprendre du pouvoir sur sa vie, faire des bons choix, augmenter ses compétences pour résoudre par elle-même ses problèmes. Souvent, ils ont eu la soupape au niveau des émotions difficiles de consommer, s'allier avec des fréquentations négatives, des fréquentations criminalisées. Donc c'est tout l'accent de faire un peu, d'augmenter leur compréhension de ce qu'ils ont conduit derrière les murs. Donc c'est quoi les facteurs de risque, c'est quoi leurs facteurs de protection puis tout en les outillant avec des nouvelles compétences de résolution de problèmes et de gestion des émotions.Edith : Oui et j'ajouterais aussi, on a quand même une bonne proportion de membres du personnel ici qui sont des hommes. On a auprès de notre clientèle tu sais une bonne proportion des femmes qui ont qui ont subi des traumas parfois de la part d'homme fait que moi en tout cas avec l'ensemble des discussions que j'ai l'opportunité d'avoir avec mon équipe, tu sais, on le voit, les hommes aussi, de façon plus spécifique dans leur travail, dans leur approche avec la femme incarcérée, sont très conscients de cette dynamique-là, de leur historique, du fait qu'elles sont porteuses de trauma, fait qu'il y a vraiment une approche qui tient compte de cet aspect-là. Puis quand on discute aussi avec les détenus, elles le nomme tu sais que parfois ici en établissement ça fait partie des quelques contacts positifs qu'elles ont eu avec des hommes.
Tu sais l'idée de réapprendre qu'il y a des hommes aussi qui sont bienveillants, qui sont pas une menace à leur intégrité, qui sont capables de de les approcher avec respect, qui sont capables de respecter leur dignité. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là qui est particulièrement intéressant.Véronique : Puis au niveau des programmes que vous offrez justement pour les aider à adresser les facteurs qui les ont amenés à la criminalité. Qu'est-ce que vous offrez ici aux femmes, puis pouvez-vous nous donner un aperçu des programmes, puis des aptitudes et des compétences qu'elles apprennent?
Julie : Bien, on offre un très large inventaire de programmes. Il y a ce qu'on appelle les programmes correctionnels qui vont travailler les facteurs de risque, donc souvent les ceux qui ressortent d'emblée, c'est la toxicomanie.
Ce qu'on appelle la vie personnelle, affective, donc toute le trauma, la gestion des émotions, l'impulsivité fait qu'il va y avoir dans le fond des programmes correctionnels qui vont vraiment s'attarder à ces cibles-là. Puis la femme va participer à un programme soit d'intensité faible, modérée ou élevée selon le niveau de risque qu'elle présente. Donc ça, c'est des programmes qui sont fortement recommandés à notre clientèle. C'est dispensé par une équipe d'agents de programme correctionnel. Puis ils prennent en compte justement les traumas des femmes. Puis tout ça. Il y a aussi tout l'aspect dans les programmes correctionnels. On va aborder aussi la sexualité des femmes, la spiritualité. Donc on fait vraiment un éventail de des aspects de la vie, pour qu'ils refassent un peu un examen de de leur passé, puis où ils veulent se diriger vers l'avenir. Puis c'est tout axé sur la prévention de la rechute, autant au niveau de la toxicomanie que de la récidive. Donc chaque femme va bâtir un peu ce qu'on appelle le plan de maîtrise de soi. Donc qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir? C'est quoi mes stratégies? C'est quoi mes indices quand je vais moins bien? Donc pour vraiment l’outiller au niveau de sa réflexion, de sa compréhension d'elle-même. Tu sais la femme quand elle arrive en dedans c'est vraiment un temps d'arrêt. Souvent ces femmes-là ont pas pris le temps, ils vivent un peu au gré des opportunités qu'ils ont eu, qui sont souvent pas favorables. Fait qu'on prend la sentence vraiment pour faire ce temps d'arrêt là. Ce bilan là pour les femmes qui veulent là c'est toujours une approche qui est volontaire, fait que ça c'est au niveau des programmes correctionnels. Tous nos programmes correctionnels sont aussi adaptés pour nos femmes autochtones. Là, il y a une forte surreprésentation des femmes autochtones dans les établissements fédéraux, donc à partir de ce moment-là, on va intégrer la culture autochtone. Souvent, la femme autochtone va redécouvrir sa culture, souvent ça a été laissé de côté ou ça a pas été enseigné dans sa communauté. Donc on va faire plein de cérémonies, on va enseigner les médecines traditionnelles, on va avoir un jardin sacré où on va faire de la culture de plante médicinale, de légumes. On va faire des cérémonies de changement de saison, des séances de smudge fait que il y a toute la partie autochtone aussi dans nos programmes.Et on a la partie des programmes sociaux dont on a discuté déjà le programme compétences parentales dans le fond, qui va viser à ce que la femme se réapproprie son rôle parental. Souvent, c'est quelque chose qu'elle a délaissé. Elle s'est pas occupée des contacts avec la DPJ, elle, elle s'est pas présentée en cours. Donc on va l'accompagner aussi pour qu'elle reprenne du pouvoir dans ce rôle-là de mère et qu'elle puisse reprendre ses responsabilités parentales à lors de sa réinsertion.
On a des programmes aussi national, en compétences, en employabilité, on a des programmes de réinsertion sociale. Ce qui vient dans ce dernier, c'est qu'on va inviter des organismes, des partenaires communautaires qui sont alignés avec les besoins des femmes. Donc ils vont venir rencontrer les femmes. Ça tisse déjà un lien entre les ressources qui sont disponibles en collectivité pour elles. Voilà.
Véronique : Vous avez touché un point super intéressant, c'est des programmes qui sont volontaires. J'imagine que c'est pas toutes les femmes qui arrivent ici qui sont ouvertes au changement, ouvertes à faire une introspection ou à travailler sur elles-mêmes. Puis on peut pas forcer personne au changement parce que souvent il y a beaucoup aussi de plus de réticence quand on essaie de forcer les gens. Donc comment est-ce que vous les amenez à les influencer ou à les motiver à participer à ces programmes-là puis à profiter des interventions qui sont disponibles ici?
Edith : Mais parfois, il y a des étapes préalables-là qui sont gagnantes. Je pense par exemple à une personne qui aurait des enjeux de santé mentale. Parfois, l'étape initiale va être de stabiliser la santé mentale. Puis quand il y a des gains qui sont faits au niveau de la santé mentale. Bien là on voit apparaître un intérêt, un engagement à travailler ces facteurs contributifs. Mais de façon générale, c'est assez fascinant comment la clientèle féminine d'emblée voit quand même un certain intérêt à reprendre un peu de pouvoir sur leur vie. Tu sais, il y a souvent beaucoup de détresse avant une période carcérale, là chez la clientèle féminine. Donc de façon générale, c'est pas c'est pas la motivation qui est l'enjeu, c'est beaucoup plus des fois l'effort que ça peut requérir. Puis bon, des fois c'est beaucoup de travail en lien avec différentes facettes de la vie qui sont à faire. Mais c'est pas tant au niveau de la motivation qu'il y a des difficultés, je trouve.
Véronique : Vous avez parlé qu'il y a aussi des programmes d'employabilité. On a fait une visite tantôt, puis on a vu des femmes qui travaillaient, qui faisaient de la couture. On a vu aussi des femmes qui aidaient au niveau des commandes d'épicerie. Qu'est-ce que vous offrez ici comme programme pour aider les femmes à acquérir des compétences en employabilité, mais aussi des compétences pour les aider sur le marché du travail après leur libération?
Julie : Dans le fond, ce qu'on veut axer, le service correctionnel, c'est vraiment de favoriser la formation académique. Donc il y a tout un levier motivationnel pour que les femmes atteignent leur secondaire 5 fait que nos politiques sont conçues ainsi. Puis, tout le travail de l'équipe des programmes, c'est vraiment de les encourager à bonifier leur scolarité parce que les femmes incarcérées sont vraiment sous scolarisés et ont été sous employés. Fait que ça, on va faire un gros travail pour les inscrire à l'école. Donc on va faire, on va offrir des cours secondaires.
On offre aussi une attestation d'étude collégiale avec le Cégep Marie-Victorin, donc une attestation en bureautique. On a aussi une commission scolaire qui enseigne qu'on appelle First Nation, qui est dédiée à l'enseignement scolaire auprès de nos femmes autochtones. Donc ça, c'est toute la partie scolaire.
Et puis au niveau de l'emploi, dans le fond, tout l'entretien de notre de notre site est fait par les femmes. Ici, il faut savoir dans les unités régulières, les femmes sont responsables de cuisiner leurs repas. Donc on a comme une épicerie, un peu un service alimentaire qui va offrir aussi des opportunités d'emploi. Puis c'est ça, dans le cadre de leurs emplois, si les femmes gardent une stabilité, persévèrent dans leurs emplois ça peut les amener à une certification pour obtenir une certification au niveau d'un métier semi spécialisé qui est reconnu par le ministère de l'éducation. Donc si elles cumulent 300 heures en entretien au niveau de l'alimentation comme commis sport, elles peuvent décrocher une certification qui va être utile à leur réinsertion sociale.
Puis on va combiner ça avec un une formation académique en classe un cours de 100 heures de préparation au marché du travail. Donc on vient vraiment bonifier les compétences en employabilité pour ces compétences-là puissent être transférables pour leur réinsertion sociale.
Véronique : Vous avez parlé des unités régulières donc pour ceux qui nous écoutent, qui ont aucune idée de quoi à l'air un pénitencier pour femmes, pouvez-vous juste nous expliquer un petit peu physiquement les lieux ont l'air de quoi ici?
Edith : Quand on parle souvent d'unité régulière versus, c'est juste que quand on prend le secteur à sécurité maximum, c'est vraiment l'image qu'on se fait d'un pénitencier avec les portes et tout. Puis c'est un secteur qui est très sécurisé, mais le reste de l'établissement, ce sont comme des unités d'habitation, fait que c'est des petits bâtiments. Il y a 10 détenus par unité d'habitation environ. Puis ces détenus-là, vivent ensemble, elles ont un espace commun, elles ont chacun leur chambre, elles ont un espace commun pour cuisiner. Puis c'est vraiment ce qui distingue, c'est le fait que bon, elles vont faire leur propre épicerie via nos services alimentaires, mais elles vont cuisiner leur propre repas. Fait qu'il y a il y a comme une perspective de vie communautaire qui est plus présente, plus significative que dans un autre établissement sécurité médium par exemple.
Véronique : Donc à travers votre expérience, avez-vous des exemples de d'histoires de réussite que vous pourriez partager avec nous?
Edith : Mais peut être que Julie aura plus des histoires spécifiques pour moi au quotidien. Tu sais, des réussites, des succès à Joliette, on en a quotidiennement. Puis c'est pas toujours des grandes réussites à grand déploiement. Mais comme je disais on a l'avantage d'avoir tous les niveaux de sécurité. Puis tu sais, on a vraiment une conviction profonde que c'est, tu sais, notre mandat premier, c'est clair, c'est la réinsertion sociale réussie fait que notre mandat, c'est pas juste de de faire des personnes incarcérées des bonnes détenues, tranquilles, gentilles, c'est vraiment de travailler dans l'idée qu'elles puissent retourner en communauté puis représenter un risque qui est acceptable. Fait que dans cette perspective-là, nous, ce qui nous habite beaucoup, c'est de toujours élargir leur cadre d'encadrement pour ultimement les préparer au retour en communauté.
Puis ça pour moi bien comme on a les trois niveaux de sécurité, des fois le succès c'est vraiment de prendre la détenue qui vient d'arriver qui est au maximum, qui est super agissante, super violente. L'amener à réduire les comportements violents ou les comportements qui l'amènent à requérir un niveau de sécurité max, puis l'amener à réintégrer graduellement le terrain comme on appelle, fait que le secteur à sécurité médium et ultimement diminuer sa cote de sécurité à médium. Ça c'est le genre de réussite qu'on voit couramment, qui peut paraître banal, mais qui vient quand même avec un bon nombre d'efforts, un grand travail de l'équipe interdisciplinaire pour amener à réduire les comportements problématiques. Puis après ça, ultimement, tu sais des réussites qu'on voit, des fois, c'est des programmes complétés, un programme là, Julie en a parlé. Ça peut paraître simple, mais c'est très exigeant pour une personne de réussir un programme. C'est à la limite un peu confrontant, tu dois vraiment nommer les choses.
Il y a beaucoup d'aptitudes à acquérir dans un contexte de programme pour certaines qui ont jamais fait ce travail-là, de remise en question ou de compréhension de leur dynamique criminelle, ou de même comprendre l'impact de leur comportement sur les victimes bien ou comprendre à mieux saisir leur assuétude peu importe laquelle c'est. Ou amener une détenue a adhéré à son traitement pharmacologique, par exemple, pour une personne qui a des enjeux de santé mentale importants, c'est le genre de réussite auquel on assiste régulièrement. Des remises en liberté, tu sais des remises en liberté discrétionnaires comme des semi-libertés, donc ils sont davantage à la discrétion de la CLCC, en lien avec notre recommandation. Donc c'est pas comme une libération d'office qui est d'emblée là au sens de la loi. Mais ça aussi c'est des grandes réussites.
Nous, on a l'avantage d'avoir environ 80% de notre population carcérale qui accède à une semi-liberté donc qui se voit accorder une semi-liberté par la Commission délibération conditionnelle du Canada.
Julie : Puis notre particularité aussi comme Établissement Joliette, c'est qu'on a on accueille des femmes qui entament des sentences à perpétuité. Alors cette femme-là va entamer sa sentence au maximum, va être suivie par une équipe. Moi j'ai déjà eu comme agent de libération conditionnelle accompagnée une femme pendant 12, 13 ans en suivi, donc on va l'amener au max, on en unité maximum, on va la réintégrer, par exemple, au milieu de vie structuré, qui est notre unité de santé mentale. On va y demander d'acquérir des compétences pour des fois c'est même l'hygiène, cuisiner. Puis ça peut être un succès, juste d'intégrer ensuite une unité régulière. Puis après ça, on l'a accompagné, on l'a eu pendant une vingtaine d'années en institution.
Vous imaginez que ça crée aussi l'effet pervers de l'institutionnalisation. À un certain moment, on devient des figures très significatives. Ils sont très à l'aise avec aller à l'emploi, à l'école, aux soins de santé. Toute la proximité des services fait qu'il y a aussi un travail, des fois avec nos sentences à perpétuité de désinstitutionalisation.
Par exemple, cette personne-là elle va. Elle a eu accès à des permissions de sortir avec escorte tranquillement, aller faire du bénévolat à l'extérieur, puis revenir en établissement. Donc elle sortait pour des périodes de courte période de jours. Et puis ensuite on a fait des permissions de sortir sans escorte avec notre partenaire de la maison de transition à Montréal.
Donc les femmes peuvent quitter, par exemple, pendant une période de 60 jours pour développer des nouvelles compétences, tisser des liens aussi avec des nouveaux intervenants, avoir des nouvelles figures significatives avec lesquelles ils se sentent en confiance. Puis après 60 jours, elle revient en établissement donc on a fait des programmes de réintégration progressive jusqu'à l'obtention d'une semi-liberté en maison de transition. Puis je regardais son dossier récemment. Bien là elle vit chez elle avec un conjoint, tu sais. C'est une femme qui a été incarcérée pendant 22 ans à l'Établissement Joliette.
Véronique : C'est intéressant ce que vous dites, on pense pas toujours à ce facteur là ça doit être intimidant de sortir de prison après 20, 25 ans. La société évolue énormément, donc de les exposer, de les refamiliariser à la société graduellement doit probablement aussi les aider à réussir leur réinsertion sociale.
Julie : Exactement avec les sentences, les longues sentences, donc les longues sentences, on les considère de 10 ans à perpétuité. La clé du succès, c'est vraiment la réintégration progressive. Mais le service correctionnel offre beaucoup d'opportunités là à ce niveau-là.
Véronique : Puis avant qu'on termine, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce que vous aimez de votre travail au quotidien.
Julie : Moi ce qui ce qui me mobilise à continuer à travers toutes ces années-là, c'est que les femmes ont très peu reçu la clientèle féminine. C'est une clientèle souvent qui a plus d'estime de soi, qui a plus de confiance, qui a très peu reçu, qui ont les femmes souvent ont pas eu de cadre, ont pas eu de modèles prosociaux dans leur famille. Tout ça fait que juste de les voir évoluer, faire des petits pas, des fois c'est pas la première semi-liberté qui est le succès. Des fois on en a qui vont faire, qui vont avoir une seconde sentence, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on fait des gains, tu sais, on les élève dans leur estime de soi.
Véronique : C'est vraiment super fascinant le travail que vous faites, c'est ça doit être un travail qui est parfois difficile mais aussi super gratifiant. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps dans votre journée super occupée aujourd'hui pour nous parler puis nous expliquer votre travail.
Edith : Non, c'est vraiment un plaisir. Merci à vous de l'intérêt.
Julie : Merci
Véronique : Nous nous sommes également entretenus avec Cheryl Ann, une femme incarcérée à l'Établissement Joliette. Lors de notre conversation, Cheryl Ann nous a parlé de son parcours et de l'importance des programmes conçus pour les femmes, notamment les possibilités de travail qui l'ont aidé à cheminer depuis son arrivée à Joliette.
Bonjour Cheryl Ann, merci d'être avec nous aujourd'hui.Cheryl Ann : Bonjour.
Véronique : Donc, vous vous êtes incarcéré ici à l'Établissement de Joliette. Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Cheryl Ann : Ça fait un an que je suis ici.
Véronique : Puis avez-vous été incarcéré dans d'autres établissements avant ou c'est vraiment vous êtes ici depuis le début de votre peine?
Cheryl Ann : J'ai été incarcéré au Leclerc pendant 8 mois, c'était la première fois que j'étais incarcéré de ma vie.
Véronique : Comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé ici à Joliette?
Cheryl Ann : Ben c'est sûr que là je suis arrivé dans le « minding » de vouloir m'accomplir devenir une meilleure personne. Donc moi j'ai eu 7 ans en tout. Donc j'avais vraiment un « minding » de vouloir devenir une meilleure personne, me trouver des buts. Donc en arrivant ici, tu sais, j'ai vraiment faites les démarches pour me trouver un emploi, me trouver une routine. Il y a des programmes aussi qui me sont offerts, qui me sont recommandés de faire que j’ai débuté dès le début, puis dans le fond aussi, ils nous offerts aussi les meetings AA que j'ai débuté dès mon arrivée qui m'avait grandement aidée dans le fond parce que moi j'avais un problème d'alcool sévère. Puis c'est vraiment là que je me suis trouvé un soutien, un sentiment d'appartenance. Je me suis senti compris, donc c'est vraiment là que je me suis sentie entourée puis soutenue. Puis ça m'a vraiment aidée. Le programme qui m'est offert ici, c'est ce qui m'a aidée à comprendre un peu. Qu'est ce qui m'a apporté à commettre les délits? Tu sais, c'est ça m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi qu'on agit à commettre un délit, qui nous apporte à faire certains actes. Puis dans le fond il nous, il nous aide à essayer de changer notre façon de penser pour pas refaire les mêmes erreurs.
Véronique : Puis est ce que il y a des trucs que vous avez appris pendant le programme que vous dites moi une fois que je vais être libérée, je vais appliquer ça dans ma vie de tous les jours.
Cheryl Ann : Oui mais tout c'est ça la façon de se poser des questions si je pense que je suis à une situation à risque, à la place de me dire je vais souvent me poser des questions, est-ce que je me je me mets à risque? C'est des outils dans le fond qu'ils nous ont donné pour faire attention à ne pas tomber dans le panneau ne pas recommettre les mêmes erreurs.
Véronique : Donc d'identifier dans le fond les facteurs ou les situations, les émotions qui vous amènent, qui vous amenaient peut être à faire avoir des comportements avant, puis que maintenant vous allez savoir, puis de vous retirer de cette situation-là.
Cheryl Ann : Oui, totalement.
Véronique : C'est important d'avoir un cercle de soutien. Vous avez un cercle de soutien ici à l'établissement, c'est un petit peu à portée de main quand qu'il y a un enjeu ou un conflit ou quelque chose qui se passe est-ce que vous avez ce cercle de soutien là que vous allez pouvoir compter?
Cheryl Ann : Oui, tout à fait. Ben j'ai ma famille, j'ai mes amis de longue date du secondaire qui sont là, qui qui m'ont toujours soutenu, puis qui sont même qui viennent me voir régulièrement en prison, puis aussi ici en établissement. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un psychologue. Puis de de pouvoir en parler parce que au début, j'étais pas capable d'en parler. Je faisais juste par fond dans larmes. Ça m'a pris vraiment du temps de pouvoir être capable de même encore aujourd'hui. Là, je fais juste y penser, puis je suis émotive là, mais c'est un long cheminement. Puis, sans ma famille et mes amis.
Véronique : Puis d'être capable d'en parler à votre famille, à vos amis, mais aussi à des professionnels, à des psychologues à fait partie du cheminement. Puis je pense que le début du cheminement vers le changement commence quand on est capable d'en parler.
Cheryl Ann : Oui, tout à fait. Mais mon but dans le fond, ça serait de faire les conférences, éventuellement pour des meetings AA parler de de mon parcours, puis d'être capable de parler de mon histoire, puis même essayer de faire de la sensibilisation auprès des jeunes.
Bien du monde pense que la prison c'est « rough » là, mais c'est ça peut apporté beaucoup de bien.Véronique : Puis vous avez mentionné au début aussi que vous travailliez ici.
Cheryl Ann : Oui tout à fait.
Véronique : Quel emploi vous occupez?
Cheryl Ann : Je suis cantinière, dans le fond c'est moi qui s'occupe, ça se trouve à être comme le dépanneur de l'établissement, c'est ce qu'ils vendent, on a le côté épicerie ici qu'on a, on fait comme notre épicerie avec nos légumes, nos fruits, nos conserves. Puis moi, c'est plus dépanneur fait que chip, cochonnerie, Pepsi. Donc c'est moi qui s'occupe dans le fond de commander les choses sur Internet avec quelqu'un bien sûr, puis de faire l'inventaire. Puis dans le fond, j'ai deux personnes qui m'aident à faire les paniers.
On est quand même un établissement on est une centaine fait que c'est quand même beaucoup à gérer.
Véronique : Puis vos plans pour la libération ça ressemble à quoi?
Cheryl Ann : Présentement je fait mes cours ici, ils ont-ils ont donné ASP construction, donc j'ai mes cartes de construction. Je prévois aller en construction et j'aimerais lancer mon cours. Bien en fait, j'ai mon cours en lancement d'entreprise pour lancer mon entreprise en nettoyage de conduit de ventilation. Ça fait longtemps que j'y pense, puis je m'en vais là-dedans c'est mon but fait que c'est sûr que en sortant je peux pas claquer des doigts puis tout de suite aller là-dedans fait que je vais aller en construction, je vais toucher un peu à tout mais je veux vraiment m'en aller c'est mon projet de de de sortie puis je sais que c'est ça que je vais faire, que je vais réussir à faire bien.
Véronique : Je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Cheryl Ann : Merci beaucoup.
Véronique : C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore à Edith et Julie et au personnel de l'Établissement Joliette pour femmes pour leur collaboration lors de ces entrevues.
Cette production est une réalisation du Service correctionnel du Canada et je suis votre animatrice, Véronique Rioux. Merci d'avoir été à l'écoute.
Contactez-nous
Si vous avez des commentaires sur notre série de balados, n'hésitez pas à nous en faire part. Veuillez ne pas inclure d'informations personnelles ou privées. Envoyez-nous un courriel à l'adresse ci-dessous :