Comparution de la Commissaire devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale : 25 novembre 2020
Budget principal des dépenses et budget supplémentaire des dépenses
Budget principal des dépenses et budget supplémentaire des dépenses
À la fin de l’exercice 2019-2020, le Service correctionnel du Canada (SCC) était responsable de 23 102 délinquants : 13 720 étaient sous garde et 9 382 étaient surveillés dans la collectivité. En ce qui concerne les délinquants dans la collectivité, 16,4 % étaient en semi-liberté, 48,7 % étaient en liberté conditionnelle totale, 29,7 % étaient en liberté d’office et 5,2 % étaient visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. (Source : Entrepôt de données. Données à jour jusqu’à la fin de l’exercice 2019-2020) À l’échelle nationale, le SCC gère 43 établissements (6 établissements à sécurité maximale, 9 établissements à sécurité moyenne, 5 établissements à sécurité minimale, 12 établissements à niveaux de sécurité multiples et 11 établissements regroupés), 14 centres correctionnels communautaires et 92 bureaux de libération conditionnelle et bureaux secondaires. Le SCC est également responsable de la gestion de 4 pavillons de ressourcement (comptabilisés dans les 43 établissements) et travaille en partenariat avec les collectivités autochtones pour soutenir la réinsertion sociale des délinquants autochtones dans leur collectivité. Le SCC compte environ 18 250 employés dans un grand nombre de secteurs. En date de septembre 2019, le personnel de première ligne du SCC comprenait : Voici les résultats dans plusieurs secteurs différents à la fin de l’exercice 2019-2020 : Répartition du budget de fonctionnement Autres dépenses de F et E 11 % ce qui comprend: Salaires et RASE (72 %) Le budget de fonctionnement du SCC est réparti comme suit : 72 % pour les salaires et les RASE, 17 % pour les Dépenses quasi législatives, et 11 % pour dépenses qui comprend de services juridiques et règlements de réclamations, formation de CORCAN et GI-TI. Notes d’allocution : La diminution proposée est attribuable à ce qui suit : Contexte – Budget principal des dépenses Faits saillants des éléments du Budget principal des dépenses La diminution proposée au budget du Service correctionnel du Canada (SCC) est de 26,3 M$ et est principalement attribuable à ce qui suit : Sommaire des changements annuels nets dans le Budget principal des dépenses par programme/initiative Sommaire des changements annuels nets dans le Budget principal des dépenses par crédit Crédit 1 – Fonctionnement – Diminution de 12,3 M$ Crédit 5 – Immobilisations – Diminution de 0,01 M$ Crédit législatif – Régime d’avantages sociaux des employés – Diminution de 14,0 M$ Notes d’allocution : Contexte – Budget supplémentaire des dépenses (B) Le Budget supplémentaire des dépenses (B) entraînera une augmentation nette de 154,2 millions de dollars des autorisations financières du Service correctionnel du Canada. Crédits votés (nouvelles autorisations de dépenser) Fonds affectés au fonctionnement : 121,7 M$ Crédits législatifs Régime d’avantages sociaux des employés : 23,6 M$ Biens et services : 8,8 M$ Fonds disponibles (dans les crédits existants) Transferts (vers/en provenance d’autres ministères) Notes d’allocution : Contexte – Investissements budgétaires depuis 2017 Voici les annonces budgétaires effectuées dans les budgets de 2017 à 2019 qui concernaient le Service correctionnel du Canada. Budget 2017 Soins en santé mentale Le Budget 2017 prévoyait 57,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, et 13,6 millions de dollars pour chaque année subséquente, en vue d’élargir les capacités en soins de santé mentale à tous les détenus dans les établissements correctionnels fédéraux. De cette enveloppe, 9,95 millions de dollars ont été accordés à l’Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones de Sécurité publique Canada, alors que les 55,2 millions de dollars restants et 10,9 millions de dollars pour chaque année subséquente ont été accordés au Service correctionnel du Canada pour l’aider à accroître sa capacité à fournir des interventions efficaces aux délinquants autochtones. Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones Le Budget 2017 prévoyait 65,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour aider les Autochtones incarcérés à se réadapter et à trouver un bon emploi. De cette enveloppe, 9,95 millions de dollars ont été accordés à l’Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones de Sécurité publique Canada. Les 55,2 millions de dollars restants et 10,9 millions de dollars pour chaque année subséquente ont été accordés au Service correctionnel du Canada pour l’aider à accroître sa capacité à fournir des interventions efficaces aux délinquants autochtones. Budget 2018 Le Budget 2018 prévoyait 98,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019. Intégrité des programmes De cette enveloppe, 74,7 millions de dollars ont été consentis en 2018-2019 pour permettre au SCC de poursuivre ses activités à l’appui de son mandat. Soins en santé mentale Une enveloppe de 20,3 millions de dollars sur cinq ans a été consentie (2,6 millions de dollars en 2018‑2019, 3,3 millions de dollars en 2019-2020, 4,1 millions de dollars en 2020-2021, 4,8 millions de dollars en 2021-2022 et 5,5 millions de dollars en 2022-2023) et 5,6 millions de dollars additionnels ont été consentis pour chaque année subséquente afin de mieux répondre aux besoins en santé mentale des détenus sous responsabilité fédérale. Les fonds devaient surtout servir à offrir un soutien accru en santé mentale aux femmes dans les établissements correctionnels fédéraux partout au Canada. Fermes pénitentiaires Une enveloppe de 3,7 millions de dollars sur cinq ans a été consentie, à compter de 2018-2019, pour appuyer la réouverture des fermes pénitentiaires aux établissements de Joyceville et de Collins Bay à Kingston, en Ontario. Les fermes devaient être exploitées par CORCAN. Budget 2019 Dans le Budget 2019, le SCC a obtenu un financement additionnel pour poursuivre ses activités en 2019-2020 seulement. Concrètement, le financement devait servir à fournir des ressources au SCC pour lui permettre de remédier aux pressions liées aux conventions collectives (37 millions de dollars), aux services juridiques/litiges (18,5 millions de dollars), aux prestations d’indemnisation des accidentés du travail (24 millions de dollars), et aux services aux personnes jugées non criminellement responsables au Centre de rétablissement Shepody du SCC (0,9 million de dollars), ainsi que des montants législatifs associés à ce qui précède (14,6 millions de dollars). Transformation du système correctionnel fédéral Le SCC a demandé un financement supplémentaire pour mettre en place l’initiative Transformation du système correctionnel fédéral (TSCF), une stratégie visant à éliminer la pratique de l’isolement et à transformer les services correctionnels fédéraux grâce à des investissements dans le diagnostic proactif, les interventions ciblées et le traitement des détenus en fonction de leurs besoins. Le mémoire au Cabinet sur la TSCF a été approuvé en septembre 2018 et le financement a été approuvé par le ministre du Conseil du Trésor en mai 2019. Notes d’allocution : Contexte – Planification liée à la COVID-19 pour les services correctionnels fédéraux Le SCC a mis en place avec succès un certain nombre de mesures pour protéger le personnel et la population carcérale contre la COVID-19. Mesures actuelles Cas de COVID-19 parmi les détenus Au 19 novembre 2020, on recensait 53 cas actifs de COVID-19 parmi les détenus à l’échelle du Canada. On s’attend à ce que plus de cas soient recensés. Équipement de protection individuel Le SCC continue de prendre des mesures exceptionnelles pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans ses établissements afin de limiter le risque pour les détenus et le personnel, ce qui comprend le port de masques par tous au sein des établissements. De l’équipement de protection individuelle additionnel est accessible au personnel, au besoin, y compris le personnel de la santé. Soutien financier du gouvernement Le 9 juin 2020, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Bill Blair, a annoncé l’intention du gouvernement d’accorder jusqu’à 500 000 $ à cinq organismes du secteur bénévole national afin de leur permettre d’élaborer des projets pilotes visant à adapter des services importants qui favorisent la réinsertion sociale des délinquants sous surveillance dans des établissements résidentiels communautaires (maisons de transition) et de développer les connaissances pour aider des organismes semblables à apprendre des réponses novatrices qui ont été mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19. Mise en liberté des délinquants Alors qu’il participe pleinement à l’effort de santé publique pancanadien pour lutter contre la COVID‑19, le SCC continue de remplir ses obligations en ce qui a trait aux soins et à la garde des détenus pour les préparer en vue de leur mise en liberté en toute sécurité dans la collectivité. Le SCC et la CLCC continuent de libérer des détenus admissibles conformément à la loi. Un certain nombre de facteurs sont pris en compte dans les décisions relatives à la mise en liberté, la sécurité publique étant le critère prépondérant. La COVID-19 et d’autres questions liées à la santé ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs pris en compte dans la mise en liberté de délinquants dans la collectivité. Le SCC, en consultation avec la CLCC, a travaillé à simplifier le processus de préparation des cas des délinquants. De plus, la CLCC veille à ce que les cas soient traités le plus rapidement possible, tout en continuant d’adopter un processus décisionnel fondé sur les risques et des données probantes. Depuis le début du mois de mars 2020, la population carcérale fédérale a diminué de 1 292 détenus (en date du 15 novembre 2020). Cette réduction est attribuable à une diminution des admissions en provenance des provinces et des territoires, combinée aux mises en liberté dans la collectivité. Nous prévoyons que cette tendance à la baisse au sein de la population carcérale fédérale se poursuivra au cours des prochains mois. Le SCC communique régulièrement avec ses partenaires de la collectivité pour veiller à ce que les délinquants mis en liberté sous condition bénéficient d’un environnement sûr, sécuritaire et positif à leur retour dans la collectivité. Il s’agit d’un élément important de toute mise en liberté sécuritaire et réussie dans la collectivité. Suspension des visites dans les établissements Le SCC a mis en place des mesures additionnelles en vue de limiter la propagation potentielle de la COVID-19 dans ses établissements et ses centres correctionnels communautaires (CCC) au Québec et en Alberta. Le SCC a suspendu les visites à toutes ses unités opérationnelles situées au Québec et en Alberta de même qu’à l’Établissement de Stony Mountain, ainsi que les permissions de sortir et les placements à l’extérieur des établissements. Les délinquants continueront de participer sur place aux programmes et activités qui favorisent leur réhabilitation. Les services de santé continueront d’être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Les délinquants sont encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence. À l’heure actuelle, les mesures additionnelles ne touchent pas les unités opérationnelles situées dans les autres provinces. Il s’agit d’une situation en évolution, et le SCC continue de collaborer avec les autorités de santé publique à surveiller la situation et à prendre des mesures supplémentaires, au besoin. Réduction du personnel en raison de l’isolement Des membres du personnel à un certain nombre d’établissements du SCC ont été déclarés positifs à la COVID-19. Le SCC collabore avec les autorités de santé publique à la recherche des contacts afin de veiller à ce que les contacts étroits s’isolent à la maison et qu’un dépistage additionnel soit réalisé, au besoin. Le SCC évalue régulièrement les décisions opérationnelles prises concernant les horaires et les activités lorsqu’il examine les niveaux de dotation. Les niveaux de dotation sont surveillés et évalués quotidiennement, puis ils sont ajustés au besoin. Les membres du personnel sur place font preuve de souplesse et certains ont fait des heures prolongées pour répondre aux exigences opérationnelles afin d’assurer la gestion des établissements. Notes d’allocution : Répercussions financières Contexte – Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée Les unités d’intervention structurée (UIS) permettent aux détenus d’être séparés de la population carcérale régulière, tout en maintenant leur accès aux programmes de réadaptation et aux interventions. Les détenus placés dans une UIS : Les UIS sont utilisées pour loger les détenus qui ne peuvent être gérés de façon sécuritaire dans la population carcérale régulière. Un détenu peut être transféré vers une UIS s’il met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, si sa propre sécurité est en danger ou si sa présence au sein de la population régulière nuit au déroulement d’une enquête et qu’il n’existe aucune autre solution valable. Des interventions structurées et des programmes sont mis à la disposition des détenus dans les UIS pour que l’on tienne compte de leurs risques et besoins particuliers, dans le but de faciliter dès que possible leur réintégration dans la population carcérale régulière. On s’attend à ce que les UIS améliorent les résultats correctionnels et aident à réduire le taux d’incidents violents en établissement, ce qui assurera un environnement plus sécuritaire pour le personnel, les délinquants et les visiteurs. L’ouverture des UIS dans les établissements pour hommes s’est faite de façon graduelle et progressive; les dix premières UIS ont ouvert le 30 novembre 2019. Les UIS dans les cinq établissements pour femmes ont ouvert le 30 novembre 2019. Comité consultatif sur la mise en œuvre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a mis sur pied le Comité consultatif sur la mise en œuvre des UIS en 2019, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à assurer une reddition de comptes et une transparence quant à la mise en œuvre des UIS. Le Comité, qui est composé de huit membres, a été chargé d’aider à surveiller et à évaluer la mise en œuvre des UIS instaurées suivant l’adoption du projet de loi C-83 par le Parlement en juin 2019. Le 30 novembre 2019, les dispositions du projet de loi C-83 sont entrées en vigueur, éliminant l’isolement préventif et disciplinaire dans l’ensemble des établissements correctionnels fédéraux et instaurant des UIS. Le nouveau modèle prévoit des exigences minimales pour le temps passé à l’extérieur de la cellule et les interactions humaines significatives, et il est soumis à une surveillance externe indépendante. L’objectif du Comité consistait à formuler des recommandations et des conseils non exécutoires à la commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) et à faire part au ministre de ses opinions sur la question de savoir si le modèle d’UIS est mis en œuvre comme prévu par la loi. En août 2020, le Comité consultatif a été dissout. Le ministère de la Sécurité publique et le SCC ont poursuivi leur collaboration avec M. Anthony Doob, ancien président du Comité consultatif, dans le but de veiller à ce que les données puissent être examinées et à ce que les constatations puissent être communiquées. Constatations préliminaires du Comité consultatif sur la mise en œuvre Les constatations préliminaires (publiées le 26 octobre 2020) de M. Doob et de Mme Sprott fournissent de précieux renseignements qui appuient le travail continu du SCC visant à surveiller le fonctionnement des UIS, à reconnaître les tendances et à apporter les modifications requises aux politiques, aux procédures et aux pratiques. Les constatations s’ajouteront à la rétroaction continue fournie par les décideurs externes indépendants dans le cadre d’examens sur des cas particuliers et de décisions. Des efforts sont faits pour renforcer les succès et améliorer les pratiques et les résultats. Parmi les autres éléments notables qui devront être pris en compte dans l'analyse de ces constatations, mentionnons la pandémie de COVID-19, qui a nécessité des ajustements pour veiller à ce que les détenus aient la possibilité de passer au moins quatre heures par jour en dehors de leur cellule et d'interagir avec les autres pendant au moins deux heures, compte tenu de l'importance du respect des mesures de protection de la santé publique. Le Service demeure déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour coordonner la recherche et la mise en œuvre de stratégies visant à assurer le respect des droits des détenus, tout en se conformant aux mesures de protection de la santé publique. Le SCC a mis en place une équipe de projet chargée de mettre l’accent sur trois sujets interreliés à l’avenir : favoriser une culture d’intendance des données en mobilisant le personnel de première ligne, optimiser les résultats en examinant les exigences opérationnelles des UIS et en harmonisant les solutions technologiques, et renforcer les ressources organisationnelles à l’appui des rapports sur le rendement et la conformité. Décideurs externes indépendants Les décideurs externes indépendants (DEI) assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les UIS et examinent leurs dossiers. Au 1er novembre 2020, les DEI avaient rendu et réalisé plus de 1 300 décisions et examens externes. Cet apport externe contribue à l’amélioration continue et au façonnage des UIS. Unités d’intervention structurée – services technologiques Le SCC se sert d’une application technologique pour procéder à la collecte de données sur les UIS afin de faciliter la production de rapports sur le rendement destinés aux dirigeants des établissements et aux cadres supérieurs. Le projet d’évolution à long terme pour les UIS a permis de créer une application moderne pour assurer la gestion des délinquants dans les UIS. Cette application recueille de l’information critique sur les interactions quotidiennes entre les employés et les délinquants, indiquant notamment l’état des interactions des détenus en temps quasi réel; les durées nettes et totales des séjours dans une UIS; le temps passé à l’extérieur de la cellule; les programmes et les interventions offerts; les périodes de loisirs; les visites effectuées par le personnel correctionnel et responsable des interventions; les examens menés par les Services de santé; et les survols de la direction. Les renseignements sur les interactions avec les détenus, les aiguillages vers des programmes et les décisions sont aussi saisis pour veiller au respect des politiques et des lois connexes. Notes d’allocution : Contexte – Cellules sèches Les cellules sèches sont l’un des nombreux outils utilisés pour prévenir l’introduction d’objets interdits dans les établissements. L’ingestion d’objets interdits peut avoir de graves conséquences sur la santé et la sécurité d’une personne. Ces cellules permettent d’assurer une surveillance étroite des détenus soupçonnés d’avoir dissimulé des objets interdits dans des cavités corporelles afin de veiller à leur sécurité. Selon l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit […] l’isolement en cellule sèche — avec avis en ce sens au personnel médical — jusqu’à l’expulsion de l’objet. Procédures relatives à l’utilisation de cellules sèches Les procédures relatives à l’utilisation de cellules sèches en place sont décrites dans la Directive du commissaire 566-7 ‒ Fouille des détenus. Elles prévoient la fouille de chaque selle par un agent correctionnel/intervenant de première ligne. Suivant l’expulsion possible d’un objet interdit, tout objet récupéré devra être traité en suivant les procédures énoncées dans la Directive du commissaire 568-5 ‒ Gestion des biens saisis. Un délinquant qui est placé dans une cellule sèche se voit offrir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat. Pendant son placement en cellule sèche, le détenu a de la literie, de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette adéquats. Le Service fournit un accès raisonnable à des services d’aide médicale, psychologique et spirituelle, et un professionnel de la santé rend visite au détenu quotidiennement. Des activités limitées sont autorisées pourvu qu’elles ne compromettent pas la récupération des objets interdits. Aucune limite de temps n’est prescrite par la loi et la politique pour le placement en cellule nue, mais la politique exige que le directeur de l’établissement examine chaque placement tous les jours, comme il est stipulé à l’annexe E de la Directive du commissaire 566-7. Le délinquant peut présenter des déclarations écrites qui seront prises en compte lors de cet examen quotidien. Améliorations relatives à l’utilisation des cellules sèches Au fil des ans, le SCC a apporté nombre d’améliorations aux exigences relatives aux cellules sèches. On a présenté dans le cadre stratégique (Directive du commissaire 5667 ‒ Fouille des détenus) mis à jour en juin 2012 des exigences nationales pour les placements en cellules sèches, qui comprenaient une supervision et une surveillance accrues. Les garanties procédurales énoncées dans la politique exigent que le directeur de l’établissement examine le placement tous les jours. Pour permettre qu’une personne autre que le directeur de l’établissement effectue la surveillance, il faut aviser le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, à l’administration régionale, de tout placement de plus de 72 heures. Le SCC envisagera des garanties et des mesures de surveillance additionnelles liées à l’utilisation de cellules sèches. Notes d’allocution : Répercussions financières Contexte – Surreprésentation de groupes particuliers dans les établissements fédéraux Le Service correctionnel du Canada (SCC) continue d’observer une augmentation du nombre de délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. Le SCC reconnaît aussi que d’autres groupes de délinquants ethnoculturels, comme les délinquants noirs, présentent des besoins particuliers. Délinquants autochtones Le SCC continue d’observer une augmentation du nombre de délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. À la fin de l’exercice 2019-2020, les délinquants autochtones représentaient 30 % de la population totale de détenus, et les délinquantes autochtones représentaient 44 % de la population totale de détenues. Le SCC s’emploie à contrer la représentation disproportionnelle des Autochtones dans les établissements carcéraux par une foule de programmes, notamment les suivants : Les décisions concernant la détermination de la peine échappent au contrôle du SCC. Cela dit, le SCC peut exercer une influence sur la période de détention des délinquants autochtones en offrant des programmes et des interventions adaptés à leur culture pour éliminer le risque qu’ils représentent, fournir des programmes de réadaptation efficaces et favoriser leur réinsertion sociale. Il y a eu une augmentation importante du pourcentage de mises en liberté discrétionnaires chez les délinquants autochtones; ce taux est passé de 23,5 % en 2013-2014 à 40,1% en 2019-2020. En outre, le SCC déploie des efforts ciblés pour recruter et maintenir en poste des employés autochtones. Le SCC est l’un des plus grands employeurs d’Autochtones dans l’administration publique centrale. Délinquants noirs À la fin de l’exercice 2019-2020, 8,8 % des délinquants incarcérés étaient identifiés comme étant noirs, alors que 7,1 % des délinquants sous surveillance dans la collectivité étaient identifiés comme étant noirs. De 2015‑2016 à 2019-2020, une baisse proportionnelle des délinquants incarcérés de race blanche de 17 % a été enregistrée, alors qu’une baisse des délinquants incarcérés de race noire de 3,2 % a été enregistrée. Le SCC investit dans la recherche afin de mieux comprendre l’expérience vécue par les délinquants ethnoculturels sous sa garde, dont ceux de race noire. Le projet de recherche pluriannuel mené a déjà permis de mettre en évidence le profil et la diversité de cette population, et des résultats de recherche émergents ont été publiés en 2019. Le SCC se penche actuellement sur les aspects de l’expérience carcérale, tels que la participation aux programmes correctionnels, l’éducation et les emplois. Le SCC étudiera aussi la façon dont les délinquants ethnoculturels réintègrent la société, examinant la participation aux programmes, les occasions d’emploi et l’atteinte de la fin de la peine. Le rapport de recherche devrait être publié dans son intégralité à l’automne 2020. Le SCC a investi 20 000 $ dans ce projet, et affecté environ 1,5 équivalent temps plein de la Direction de la recherche (combinaison de gestionnaires de la recherche, d’analystes et d’étudiants). Le SCC a fait appel à des ressources internes et externes et collaboré avec l’Université de Nipissing. En plus de disposer de professionnels de la recherche internes, le SCC entretient une collaboration positive avec plusieurs universités canadiennes en vue d’effectuer des études, de la recherche et des examens. Cette approche permet au SCC d’appliquer les normes les plus rigoureuses en matière de recherche. À l’heure actuelle, les délinquants noirs se voient offrir divers services et interventions visant à appuyer leur réinsertion sociale. Les initiatives mises de l’avant comprennent ce qui suit : la satisfaction des besoins en matière d’emploi et de mentorat en tenant compte de la culture; la participation à des exposés pertinents sur le plan culturel présentés par des membres de la collectivité; des activités de liaison offertes par des fournisseurs de services et des bénévoles dans la collectivité; l’accès à du matériel adapté à la culture à des fins de perfectionnement personnel; et la formulation de recommandations ainsi que la prise de mesures visant à favoriser la semi-liberté des délinquants dans leur collectivité d’origine, lorsqu’il y a lieu. De plus, les employés du SCC sont tenus de suivre une formation obligatoire sur la diversité et la compétence culturelle, et le Service offre des possibilités de perfectionnement professionnel continu et des ressources pour continuellement promouvoir et accroître la sensibilisation du personnel et les pratiques inclusives. Finalement, le SCC a renforcé la politique sur les délinquants ethnoculturels. Il n’existe aucun programme correctionnel adapté à la culture des délinquants noirs, mais leur taux de participation au Modèle de programme correctionnel intégré et aux Programmes correctionnels pour délinquantes et leur taux de réussite ainsi que leurs résultats sont positifs. L’origine ethnique et la culture des délinquants étant des facteurs de réceptivité importants pour l’efficacité des programmes correctionnels, la formation initiale offerte au personnel chargé des programmes aborde les facteurs de réceptivité, la manière d’en tenir compte et la façon d’adapter les interventions prévues dans les programmes aux besoins particuliers des délinquants ethnoculturels. Plus précisément, en juin 2011, le SCC a publié une étude intitulée « L’efficacité des programmes correctionnels auprès de divers délinquants : une méta-analyse ». Menée dans le but d’évaluer l’efficacité d’un traitement cognitivo-comportemental chez des personnes ayant diverses origines ethniques et culturelles, cette recherche a révélé ce qui suit : Certains établissements bénéficient également de la participation et des activités de groupes de détenus composés essentiellement de délinquants de race noire. Ces groupes, dont l’Association des détenus de race noire (BIFA), les groupes chrétiens, les groupes rastafariens et les groupes musulmans, veillent à la sensibilisation, à l’éducation et à la création d’un sentiment d’appartenance et d’estime de soi chez les délinquants noirs. Notes d’allocution : Répercussions financières Contexte – Comité d’enquête nationale conjointe du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada Eustachio Gallese, un délinquant sous responsabilité fédérale, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis le 16 décembre 2006. Il a été condamné pour le meurtre au deuxième degré de sa femme. L’infraction à l’origine de la peine a été perpétrée le 21 octobre 2004. Il s’est vu octroyer sa première semi-liberté (SL) le 26 mars 2019. Le 19 septembre 2019, sa SL a été prolongée, et sa libération conditionnelle totale a été refusée. Le 23 janvier 2020, sa SL a été suspendue en raison de sa participation présumée à un autre meurtre. Il a été accusé et reconnu coupable de meurtre au premier degré, le 27 février 2020, à la suite du décès de Marylène Lévesque. Le délinquant Gallese demeure sous responsabilité fédérale. Comités d’enquête Un comité d’enquête (CE) peut être convoqué conjointement par le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) pour se pencher sur le cas d’un délinquant accusé d’une infraction grave lorsqu’un examen préliminaire soulève des questions quant au respect des lois, des politiques ou du devoir d’agir équitablement. Les CE ont pour mandat de cerner les préoccupations systémiques auxquelles il faut donner suite, comme le besoin d’obtenir des renseignements complets, l’offre d’une formation sur l’évaluation du risque et le respect des lois, des politiques et des procédures. Le SCC répond aux recommandations formulées par les CE en les analysant ainsi qu’en apportant des modifications et des clarifications à ses politiques et à ses programmes de formation afin de réduire la probabilité que de tels incidents se produisent à l’avenir. Les CE sont des organes d’enquête administrative qui examinent rigoureusement les mesures prises par le SCC et la CLCC; ils ne mènent aucune enquête criminelle. État d’avancement des travaux du comité d’enquête nationale conjointe sur le cas de Gallese Le comité d’enquête nationale conjointe du SCC et de la CLCC sur le meurtre de Marylène Lévesque commis par le délinquant Eustachio Gallese a été convoqué le 3 février 2020. Le comité d’enquête a déjà effectué les préparatifs, des travaux d’examen et quelques entrevues. À la lumière des conseils de santé publique, la situation de la COVID-19 a forcé, le 20 mars 2020, la suspension des déplacements, des entrevues et des rencontres liés aux travaux du comité d’enquête. Avant la suspension de l’enquête conjointe le 20 mars 2020, le comité d’enquête avait mené neuf entrevues. Depuis la reprise des travaux du comité d’enquête le 8 septembre 2020, un total de 16 personnes ont été interrogées, et les entrevues sont maintenant terminées. Ces entrevues seront nécessaires afin d’assurer une collecte d’informations exhaustive et cruciale à l’optimisation de l’impartialité, de l’intégrité et de la transparence des constatations ainsi que des recommandations relatives à cette enquête. Une fois les travaux du comité d’enquête nationale conjointe terminés, les résultats de l’enquête, ainsi que les recommandations à mettre en œuvre, seront communiqués. Comité permanent de la sécurité publique et nationale Le 10 mars 2020, des cadres supérieurs de la CLCC et du SCC ont comparu devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) dans le cadre de l’étude intitulée « Commission des libérations conditionnelles et les circonstances entourant la mort d’une jeune femme ». Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale examine les lois, les politiques, les programmes et les plans de dépenses des ministères et organismes gouvernementaux qui ont compétence en matière de sécurité publique et nationale, de maintien de l’ordre et d’application de la loi, de services correctionnels et de mise en liberté sous condition des délinquants sous responsabilité fédérale, de gestion des urgences, de prévention du crime et de protection des frontières canadiennes. Processus décisionnel relatif aux libérations conditionnelles En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), lorsqu’ils prennent une décision relative à la libération conditionnelle, les membres de la CLCC doivent s’assurer : (1) que la protection de la société est le critère prépondérant; et (2) qu’ils prennent une décision qui, compte tenu de la protection de la société, est la moins privative de liberté. Conformément à la LSCMLC, la Commission peut autoriser la libération conditionnelle si ces deux critères sont satisfaits : Les commissaires effectuent une évaluation du risque rigoureuse dans tous les cas. Ils tiennent compte de tous les renseignements pertinents et disponibles pour évaluer le risque de récidive d’un délinquant, tels que les facteurs atténuants, neutres et aggravants, ainsi que de l’information présentée lors de l’audience ou de l’examen, afin de rendre une décision finale. Statistiques En 2018-2019, 99,9 pour cent des délinquants en semi-liberté ont terminé leur période de surveillance sans être accusés d’une infraction avec violence. Notes d’allocution : Contexte – Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel (2019-2020) En vertu des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) (Partie III), l’enquêteur correctionnel (EC) fait office d’ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Il a comme responsabilité principale de mener des enquêtes indépendantes et de faciliter le règlement des questions liées aux délinquants. La LSCMLC stipule que l’enquêteur correctionnel doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, remettre un rapport au ministre sur les activités menées par le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) au cours de cet exercice. Le ministre doit déposer le rapport devant le Parlement dans les 30 premiers jours de séance suivant sa réception. Le Rapport annuel 2019-2020 du BEC a été présenté au ministre le 26 juin 2020 et devrait donc être déposé au Parlement le 27 octobre 2020. Le Rapport annuel 2019-2020 renferme 13 recommandations, dont neuf sont adressées au SCC et quatre sont adressées au ministre de la Sécurité publique. Ces recommandations sont axées sur trois principaux thèmes : la coercition et la violence sexuelles dans les établissements correctionnels, les rangées de suivi thérapeutique dans les établissements pour hommes à sécurité maximale, ainsi que l’éducation et la formation professionnelle offertes aux délinquants dans les établissements. Les recommandations formulées portent également sur la question d’éthique liée à l’accès à l’aide médicale à mourir dans les établissements correctionnels, le transport des délinquants, les modèles indépendants de défense des droits des patients et l’utilisation d’artifices de diversion. Coercition et violence sexuelles impliquant des détenus dans les établissements correctionnels Le rapport renferme quatre recommandations adressées au SCC et deux recommandations adressées au ministre de la Sécurité publique concernant la coercition et la violence sexuelles dans les établissements. L’enquêteur correctionnel recommande notamment au SCC d’élaborer une stratégie fondée sur des données probantes pour prévenir la coercition et la violence sexuelles, d’élaborer une directive du commissaire, d’offrir des programmes d’éducation, de sensibilisation et de formation sur la coercition et la violence sexuelles, ainsi que d’établir une alerte précise dans le SGD pour les auteurs de coercition et de violence sexuelles. Il recommande au ministre de la Sécurité publique d’ordonner au SCC de désigner des fonds en vue de la réalisation d’une étude indépendante nationale sur la prévalence de la coercition et de la violence sexuelles, de présenter un ensemble de mesures législatives à l’appui d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles et d’établir un mécanisme de production de rapports destinés au public. L’adoption d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles est conforme à la politique du SCC et essentielle à ses activités. La priorité du SCC est de protéger la santé physique et mentale et la sécurité générale des personnes qui sont incarcérées et qui travaillent dans les établissements correctionnels fédéraux. Le SCC est d’accord avec le BEC et convient qu’il est important de mieux comprendre la question de la coercition et de la violence sexuelles au Canada. Le SCC a mis en place un cadre pour établir des milieux correctionnels sécuritaires, lequel favorise l’efficacité des opérations et des interventions correctionnelles au moyen des pratiques de sécurité active, contribuant ainsi à la sécurité du public, du personnel et des délinquants (Directive du commissaire [DC] 566 – Cadre pour des milieux correctionnels sécuritaires et efficaces). Plus précisément, tous les membres du personnel qui interagissent directement avec les délinquants doivent adopter des pratiques de sécurité active lorsqu’ils assument leurs fonctions. Ils doivent notamment approfondir constamment leurs connaissances des activités et des comportements (tant positifs que négatifs) des délinquants au moyen de l’observation directe et d’interactions. Le SCC favorise l’utilisation de pratiques de sécurité active en vue de prévenir les incidents de sécurité, y compris les incidents de coercition et de violence sexuelles. Les cas de violence sexuelle, lorsqu’ils sont rapportés au personnel, doivent immédiatement être signalés et faire l’objet d’une enquête. Dans le cas d’une agression sexuelle ou d’une allégation d’agression sexuelle, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, doit aviser le service de police ayant compétence principale, conformément à la DC 568-4 – Protection des lieux de crime et conservation des preuves. En outre, tout membre du personnel qui est informé d’une agression sexuelle doit la signaler conformément à la DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité. Les agressions sexuelles doivent aussi faire l’objet d’un Rapport de situation du directeur de l’établissement conformément à la DC 041 – Enquêtes sur les incidents. La rédaction d’un rapport du directeur de l’établissement nécessite que l’établissement recueille tous les faits pertinents concernant l’agression/allégation. Sécurité publique dirige une enquête sur la coercition et la violence sexuelles au sein des services correctionnels fédéraux qui sera menée par des experts externes entièrement indépendants. L’enquête servira à recueillir de l’information qui orientera les politiques et les pratiques relatives à la violence sexuelle dans les établissements fédéraux. La recherche permettra de recueillir de l’information et des données afin de cerner les lacunes en matière de connaissances. La recherche se penchera sur les défis uniques auxquels doivent faire face les populations vulnérables, notamment les détenus ayant subi un traumatisme, les personnes LGBTQ2+, les femmes et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Un rapport provisoire sur les travaux entrepris devrait être élaboré d’ici le printemps 2021 et contribuera à éclairer les actions futures requises pour détecter, prévenir et répondre à la violence sexuelle dans les établissements correctionnels. En outre, compte tenu de la gravité de la question, le ministre de la Sécurité publique a accepté d’écrire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour lui demander d'envisager la réalisation d'une étude indépendante, accompagnée d'un rapport sur ses conclusions, sur la coercition et la violence sexuelles dans les établissements correctionnels fédéraux. Rangées de suivi thérapeutique Le rapport renferme une recommandation selon laquelle le SCC devrait mener un examen externe de son modèle de ressources pour les rangées de suivi thérapeutique et veiller à ce que le nombre de places et la dotation en personnel reflètent les besoins réels des Services de santé mentale. Le SCC s’est engagé à mener un examen des rangées de suivi thérapeutique d’ici la fin de 2022. L’examen s’appuiera sur les connaissances d’experts externes et sera dirigé par notre psychologue principal national. On tiendra également compte des recommandations formulées dans le cadre d’un examen externe réalisé pour le compte du SCC sur l’intégration des pratiques de guérison traditionnelles et occidentales, et des options de mise en œuvre dans les rangées de suivi thérapeutique. Le but de cet examen sera de s’assurer qu’un environnement thérapeutique a été mis en œuvre, et que les possibilités d’intervention et de collaboration avec les Aînés et le personnel des services aux Autochtones sont maximisées. Le SCC continuera d’examiner les exigences en matière d’infrastructure et de dotation pour soutenir un environnement thérapeutique, y compris l’emplacement optimal pour les cellules d’observation et les places pour le système de contrainte Pinel. La satisfaction des besoins en santé mentale des délinquants grâce à une évaluation en temps opportun, à une gestion efficace, à des interventions judicieuses, à la prestation d’une formation pertinente au personnel et à une surveillance rigoureuse, est une priorité organisationnelle pour le SCC. Le Service a mis en place la Stratégie intégrée en matière de santé mentale ainsi qu’un modèle de prestation connexe dans le but de veiller à ce que les services essentiels de santé mentale correspondent aux besoins de la population de délinquants. Les délinquants ont accès à des soins de santé mentale offerts par des professionnels qualifiés en santé mentale. Les soins offerts sont fondés sur une évaluation individuelle des besoins. Éducation et formation professionnelle L’enquêteur correctionnel recommande, dans son rapport, que le ministre de la Sécurité publique établisse un groupe de travail composé d’experts pour orienter la mise en œuvre des recommandations actuelles et passées du BEC concernant l’éducation et la formation professionnelle dans le système correctionnel fédéral. Les résultats en matière de réinsertion sociale pour les délinquants sous responsabilité fédérale peuvent être améliorés en fournissant un accès à des possibilités qui contribuent à la réhabilitation, telles que des possibilités d’éducation et de formation professionnelle. Conformément à son mandat qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants, le SCC s’est engagé à continuer de moderniser ses programmes d’éducation. Le SCC examinera et tiendra compte de toutes les recommandations formulées par des partenaires et des intervenants externes et internes pour améliorer la formation professionnelle et l’éducation offertes aux personnes dans les établissements correctionnels fédéraux. Plusieurs initiatives sont actuellement en cours et devraient être mises en œuvre et évaluées, ainsi que faire l’objet de rapports. Par conséquent, un groupe de travail composé d’experts, tel qu’il a été recommandé par l’enquêteur correctionnel, ne sera pas mis sur pied pour l’instant. La question pourrait être examinée plus tard, une fois que les initiatives actuelles auront été évaluées et, le cas échéant, mises en œuvre. La commissaire fournira une mise à jour sur les progrès réalisés au ministre de la Sécurité publique en juin 2021. Le SCC convient que la littératie numérique est un élément essentiel d’une éducation moderne et a entamé des travaux en vue de l’améliorer. Par exemple, le SCC mettra en œuvre le projet pilote d’éducation numérique à l’Établissement de Bath d’ici la fin du présent exercice. Ce système de gestion de l’apprentissage numérique permettra aux délinquants d’obtenir certains crédits d’études secondaires grâce à une connexion Internet restreinte aux sites autorisés au moyen d’un réseau virtuel privé. Le SCC examinera les résultats du projet pilote et utilisera ce qu’il aura appris pour étudier la possibilité d’élargir les activités d’éducation et de formation en ligne pour les délinquants. Les améliorations futures seront harmonisées aux exigences en matière de sécurité et dépendront également de la disponibilité des ressources. Il incombe de noter que le SCC a déjà élaboré et mis en œuvre des interventions et des programmes complets, ainsi que des stratégies d’éducation et d’emploi afin que les délinquants puissent avoir les outils et les compétences dont ils ont besoin pour retourner en toute sécurité dans la collectivité. Plus précisément, les initiatives d’emploi en établissement et dans la collectivité à l’échelle du pays ont été améliorées pour les délinquantes afin de répondre à leurs besoins en matière d’emploi. À titre d’exemple, le SCC continue de travailler avec les collectivités et les partenaires autochtones aux échelles nationale, régionale et locale afin de répondre aux besoins des délinquants autochtones. L’Initiative d’emploi pour les délinquants autochtones continue de s’appuyer sur son succès depuis qu’elle a été mise en œuvre en 2017. Le rétablissement du programme d’emploi agricole du SCC à l’Établissement de Collins Bay et à l’Établissement de Joyceville est aussi un excellent exemple de l’appui de programmes qui permettent aux délinquants d’acquérir des compétences. Aide médicale à mourir L’enquêteur correctionnel recommande également, dans son rapport, que le ministre de la Sécurité publique, de concert avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada, constitue un comité d’experts qui aura pour mandat de discuter de questions pratiques et d’éthique concernant l’aide médicale à mourir dans tous les endroits de détention. Le ministre sait que le ministère de la Justice a récemment examiné la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir, en collaboration avec les Canadiens, les spécialistes, les praticiens, les intervenants, les groupes autochtones ainsi que les gouvernements des provinces et des territoires. Le SCC est le seul responsable de toute question liée à la mise en œuvre de la législation sur l’aide médicale à mourir dans les pénitenciers fédéraux, et le SCC et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) se partagent la responsabilité de diverses options de mise en liberté pour les délinquants qui souhaitent se prévaloir de l’aide médicale à mourir. Toutefois, on reconnaît que solliciter le soutien d’experts en matière d’éthique médicale et autres afin qu’ils se penchent sur cette question complexe et profondément personnelle aidera à orienter le processus relatif à l’aide médicale à mourir dans les établissements correctionnels. Le ministre de la Sécurité publique s’est engagé à ce qu’un examen des questions d’éthique relatives à l’aide médicale à mourir dans les établissements correctionnels soit mené d’ici la fin de 2021 afin de mieux comprendre et de mieux régler les questions en suspens. Notes d’allocution : Contexte – Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la Loi sur l’accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels Conformément à l’article 72 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit déposer les rapports annuels du Service correctionnel du Canada (SCC) sur les deux lois à la Chambre des communes dans les 15 jours de séance suivant le 1er septembre 2020. Les renseignements que contiennent les rapports annuels du SCC reflètent les activités exécutées durant l’année portant sur les demandes d’accès à l’information et de communication des renseignements personnels, statistiques à l’appui. Le SCC continue de recevoir un volume élevé de demandes en vertu de la LAI et de la LPRP, demandes dont la complexité ne cesse de croître. Accès à l’information En 2019-2020, le SCC a reçu 435 demandes présentées en vertu de la LAI; 444 demandes ont été reportées de la période de référence précédente, portant le total à 879 demandes à traiter en 2019-2020. La Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) a répondu à 508 demandes d’accès à l’information officielles au cours de la période visée par le rapport, dont 72 % ont été réglées après le délai statuaire, soit une hausse de 19 % par rapport à l’exercice précédent. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive étant donné l’arriéré et le nombre de demandes reçues. De plus, la Division de l’AIPRP a reçu au total 283 demandes non officielles; 408 demandes ont été reportées de la période de référence précédente, ce qui porte à 691 le nombre de demandes non officielles à traiter en 2019-2020. Au cours de la période visée par le rapport, 31 demandes non officielles ont été réglées. Les demandes non officielles comprennent la divulgation de renseignements par des moyens non officiels, lorsque cela était possible, y compris l’examen de rapports d’audit et d’évaluation, des listes de notes d’information et des documents déjà divulgués. Protection des renseignements personnels En 2019-2020, le SCC a reçu 7 063 demandes présentées en vertu de la LPRP; 16 008 demandes ont été reportées de la période de référence précédente, portant le total à 23 071 demandes à traiter en 2019-2020. La Division de l’AIPRP a répondu à 3 128 demandes officielles de communication de renseignements personnels au cours de la période visée par le rapport, dont 84 % ont été réglées après le délai statutaire, soit une baisse de 4 % par rapport à l’exercice précédent. De plus, la Division de l’AIPRP a reçu au total 528 demandes non officielles; 1 196 demandes ont été reportées de la période de référence précédente, ce qui représente un total de 1 724 demandes non officielles à traiter en 2019-2020. Au cours de la période visée par le rapport, 555 demandes non officielles ont été réglées. Les demandes non officielles comprennent la divulgation de renseignements par des moyens non officiels, lorsque cela était possible; le traitement de demandes en vertu du paragraphe 8(2) de la LPRP, à l’exception des alinéas 8(2)e) et 8(2)m); et l’examen de rapports d’enquête, y compris de rapports concernant la recherche de faits, le harcèlement, les mesures disciplinaires et la violence au travail. Le SCC conserve une foule de renseignements personnels et, par conséquent, les plus grandes difficultés de la Division de l’AIPRP demeurent le volume des demandes fondées sur la LPRP qu’elle reçoit, et les ressources limitées au sein de la Division. Au dernier exercice, le SCC a continué de s’attaquer en priorité à l’élimination de son arriéré. Compte tenu du volume des demandes reçues, et dans le but d’empêcher tout autre retard, la Division de l’AIPRP continue d’avoir recours à deux équipes dévouées pour s’occuper de ces dossiers, tandis que le reste de l’équipe s’occupe des dossiers courants. De plus, des heures supplémentaires sont travaillées pour traiter les dossiers urgents en retard. Plaintes et audits Durant la période visée par le rapport, le Commissariat à l’information du Canada a informé le SCC de la réception de 62 plaintes concernant les demandes de renseignements en vertu de la LAI. Le nombre de plaintes reçues au cours du présent exercice a légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent (53 plaintes en 2018-2019). À la fin de l’exercice, il restait donc 93 plaintes en cours de traitement. Le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) a informé le SCC de la réception de 441 plaintes concernant les réponses aux demandes présentées en vertu de la LPRP traitées par le SCC, ce qui représente une légère augmentation du nombre de plaintes reçues au cours du présent exercice par rapport à l’exercice précédent (355 plaintes en 2018-2019). À la fin de l’exercice, il restait donc 501 plaintes en cours de traitement. Au cours du dernier exercice, la Division de l’AIPRP du SCC a collaboré étroitement avec le CPVP et s’est engagé à répondre aux 177 plaintes en suspens – 129 dossiers ont été réglés. Formation et sensibilisation La Division de l’AIPRP continue d’élaborer et de mettre à jour des procédures, des politiques et des documents sur les sites Web interne et externe du SCC, afin de fournir au personnel et aux demandeurs les renseignements les plus récents. En raison du très grand nombre de renseignements personnels gérés par le SCC, la Division de l’AIPRP continue de sensibiliser activement les employés à la protection de ses fonds de renseignements et insiste au cours de chaque séance de formation sur les manières d’éviter les atteintes à la vie privée. Au total, 18 séances de formation ont été données au cours de la période visée par le rapport – 201 employés ont bénéficié d’une formation en matière d’AIPRP à l’administration centrale et dans les régions. Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives La Division de l’AIPRP continue d’examiner des façons de simplifier et de mettre à jour les La Division de l’AIPRP continue d’examiner des façons de simplifier et de mettre à jour les procédures d’exploitation. Au cours de la période visée par le rapport, la Division de l’AIPRP a assuré la liaison avec les secteurs et les régions pour étudier la possibilité d’élargir la portée du traitement informel des demandes; a continué à travailler avec les Couronnes provinciales pour achever un protocole d’entente visant la simplification du processus en réponse aux poursuites judiciaires concernant la désignation de délinquants dangereux et les ordonnances de surveillance de longue durée; et a mis en œuvre un processus de divulgation proactive.. Atteintes importantes à la vie privée Au cours de la période de référence 2019-2020, la Division de l’AIPRP a signalé au CPVP et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 47 atteintes importantes à la vie privée. Ces atteintes consistaient en la divulgation de renseignements personnels (1) en raison d’une erreur humaine; (2) à des tiers; (3) par l’accès électronique à des renseignements sans le besoin de connaître; (4) par suite du vol ou de la perte de dossiers ou de biens électroniques; et (5) concernant des victimes. Le SCC prend très au sérieux les atteintes à la protection des renseignements personnels et poursuit l’éducation du personnel à ce sujet. Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) Aucune EFVP n’a été effectuée au cours de la période de référence 2019-2020. Mesures et stratégies d’atténuation en lien avec la COVID-19 Au début de la pandémie, la Division de l’AIPRP a dû relever certains défis, notamment : la capacité de travailler à distance puisque la plupart des employés n’avaient pas d’ordinateur portable; l’accès limité au réseau privé virtuel (RPV); l’acceptation de nouvelles demandes et de correspondance des demandeurs et des intervenants étant donné que le travail sur place n’était pas autorisé; et les bureaux de première responsabilité (BPR) qui assurent les services de première ligne ne pouvaient pas répondre aux demandes de récupération de document. Toutefois, la Division de l’AIPRP a rapidement mis en œuvre des stratégies d’atténuation, dont fournir des ordinateurs portables à tous les employés; des quarts de travail sur place échelonnés pour un nombre minimum d’employés administratifs afin de traiter le courrier entrant et le courrier sortant; l’accès progressif au RPV; l’adoption du service Postel; et la mise en œuvre des signatures numériques. Notes d’allocution : Gestion des incidents Le Service correctionnel du Canada (SCC) aide les délinquants à réduire le risque qu’ils présentent. Les délinquants nécessitant différents degrés de contrôle, le SCC gère des établissements selon trois niveaux de sécurité : minimale, moyenne et maximale. Il gère également des unités d’intervention structurée pour les délinquants qui ne peuvent pas être placés dans la population carcérale régulière, ainsi qu’une Unité spéciale de détention, dans la région du Québec, réservée aux délinquants qui posent un risque grave et permanent pour la sécurité du personnel, des délinquants et du public. La sécurité active, ou les interactions entre le personnel et les délinquants, constitue un élément important de la prévention des incidents, y compris les incidents avec violence. La sécurité active, qui comporte des activités d’observation et des interactions permanentes, permet au personnel d’évaluer le climat d’un établissement, de remarquer des changements dans le comportement des délinquants de façon à prévenir les incidents et de nouer des liens de confiance avec les délinquants, ce qui peut inciter ces derniers à communiquer des renseignements de sécurité au personnel. En plus d’employer la sécurité active comme moyen de tenter de prévenir la violence, le SCC s’est doté de stratégies de gestion de la population comprenant la gestion des groupes menaçant la sécurité, comme les gangs, des membres et sympathisants du crime organisé et des détenus incompatibles; la collecte et l’analyse de renseignements de sécurité; la prévention de l’introduction d’objets interdits et de drogues dans les établissements grâce à l’utilisation de détecteurs de métal, d’appareils de radiographie, de chiens détecteurs de drogue, de détecteurs ioniques, de systèmes périmétriques de détection des intrusions et de systèmes de détection à la clôture; ainsi que la réalisation d’analyses d’urine. Incidents d’agression sexuelle de détenus dans les établissements Le SCC prend très au sérieux toutes les allégations d’agression sexuelle. Les agressions sexuelles sont à la fois des infractions criminelles et des infractions aux règles d'un établissement; elles doivent immédiatement être déclarées. Il faut répondre immédiatement aux besoins en matière de santé physique et mentale, ainsi que de sécurité des détenus concernés. Lorsqu’un délinquant dévoile avoir été agressé sexuellement en établissement à un employé, celui-ci doit aussitôt informer son gestionnaire et les Services de santé de l’établissement afin que le personnel infirmier puisse procéder aux interventions nécessaires. Au besoin, des médicaments prophylactiques doivent lui être fournis et un traitement présomptif des infections transmises sexuellement doit lui être offert. Le détenu est interrogé sans tarder et les preuves sont recueillies, s’il y a lieu. Il faut parfois qu’un détenu soit transféré dans un hôpital de l’extérieur pour y être évalué et traité. Situation actuelle Unités à sécurité maximale – Un nouveau modèle a été élaboré pour les unités (de logement) à sécurité maximale. Les principales particularités de ces unités comprennent les programmes, les services et le soutien offerts au sein même de l’unité, ainsi que l’espace de loisirs prévu, ce qui réduit le besoin de procéder à des déplacements de détenus à l’extérieur de l’unité et permet un meilleur contrôle des activités et des associations; une observation accrue en matière de sécurité et des interventions armées; et l’inclusion d’une aire de travail ouverte située de façon stratégique dans le secteur principal de circulation pour faciliter l’application des techniques de sécurité active. Gestion des incidents – En cas d’urgence, les préoccupations immédiates des unités opérationnelles sont les suivantes : isoler et maîtriser la situation d’urgence le plus rapidement possible; rétablir l’ordre dans les plus brefs délais; assurer la sécurité des personnes; mettre fin à l’incident en ayant recours à une force limitée à la force nécessaire et proportionnelle; empêcher les évasions et limiter au minimum les dégâts matériels. Tous les établissements ont des plans d’urgence. Tous les employés ont suivi une formation leur permettant de faire face aux situations d’urgence, mais tous les établissements à sécurité plus élevée sont également dotés d’une équipe pénitentiaire d’intervention en cas d’urgence spécialisée (veuillez noter que les établissements à sécurité minimale et les pavillons de ressourcement ne disposent pas de leur propre EIU). La gestion et la maîtrise des situations reposent sur un cadre qui comprend, entre autres mesures, l’utilisation d’équipement de protection, de dispositifs d’alarme personnels portatifs, de matériel de contrainte, de produits chimiques et inflammatoires et d’armes à feu. Isolements cellulaires – Selon la nature de l’incident, un isolement cellulaire peut être ordonné pour une partie ou pour l’ensemble de l’établissement. Cette mesure vise à protéger les éléments de preuve, à permettre au personnel de chercher des armes et d’autres objets interdits et à assurer la sécurité des délinquants et du personnel. L’isolement cellulaire n’est pas ordonné seulement en cas d’incident. Ainsi, si des renseignements sont reçus indiquant qu’une arme est cachée dans l’établissement, on pourrait ordonner un isolement cellulaire pour qu’une « fouille exceptionnelle » soit effectuée en vertu de l’article 53 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Enquêtes – Des enquêtes sont effectuées en vue de déterminer les facteurs qui ont contribué à l’incident et fournir des renseignements qui aideront à prévenir de tels incidents à l’avenir. Le SCC évalue continuellement les résultats afin de veiller au maintien d’un environnement sécuritaire pour tous. Le lundi 2 novembre 2020 – de 18 h 30 à 20 h 30 Témoins : L’honorable Bill Blair, C.P., député, ministre Mot d’ouverture Dans son discours d’ouverture, le ministre Blair a donné un aperçu des mesures prises par le ministère de la Sécurité publique à l’égard de la pandémie en ce qui concerne la protection des frontières. Il a poursuivi en décrivant les dispositions législatives à venir sur les armes à feu et les pouvoirs d’examen de la Commission civile d’examen et de plaintes. Il a ajouté qu’il avait hâte de participer à l’élaboration d’un cadre législatif pour les services de police des Premières Nations, qui permettra de s’attaquer aux inégalités systémiques à toutes les étapes du système de justice pénale. Le ministère de la Sécurité publique se penche également sur les menaces que des entités étrangères hostiles font peser sur le Canada et sur la lutte contre le racisme systémique. Questions Parti conservateur Le ministre Blair a indiqué qu’à la suite de la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse, il a communiqué avec le gouvernement provincial. Il savait que les gens auraient besoin de réponses, et le gouvernement voulait s’assurer que les gens recevraient une réponse complète à leurs préoccupations. Il a expliqué que le gouvernement a accepté d’examiner tout ce qui s’est passé en Nouvelle-Écosse et de faire des recommandations au niveau provincial et fédéral. Il a souligné qu’il sait que les familles ont des préoccupations et qu’il a entendu dire qu’elles n’étaient pas satisfaites de l’examen, et qu’une enquête publique a été habilitée à travailler sur la question. En outre, le ministre a indiqué qu’il avait travaillé avec la Commission des libérations conditionnelles et que les 9 et 23 novembre, une initiative visant à faire participer les victimes aux audiences de libération conditionnelle sera mise en place. Le ministre Blair a expliqué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la violence des gangs, notamment : le financement des services de police, le renforcement du contrôle des armes à feu et le retrait des armes à feu illégales, une nouvelle législation sur les armes à feu, un investissement dans la GRC pour aider à lutter plus efficacement contre la contrebande d’armes à feu. Le ministre Blair a indiqué que le gouvernement a pris des mesures musclées pour lutter contre la pandémie. En réponse aux dispenses accordées aux PDG pour entrer au Canada, le ministre Blair a indiqué que ces dispenses ont été très efficaces et que les agents frontaliers ont travaillé efficacement. Le ministre Blair a indiqué que les activités des acteurs étatiques hostiles sont constamment surveillées, notamment en ce qui concerne le détournement d’équipements médicaux vers la Chine. Le directeur Vigneault a expliqué que le SCRS est au courant et qu’il enquête sur ces actions et prend des mesures pour enrayer ces menaces. Le ministre Blair a souligné le soutien que le gouvernement reçoit en réponse à l’interdiction des fusils d’assaut et qu’il prend les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle des armes à feu. Le ministre Blair a indiqué qu’il était d’accord avec la recommandation du BEC de mettre fin au programme d’aide médicale à mourir dans les établissements correctionnels. Le ministre Blair a indiqué qu’aucun milliardaire n’a reçu carte blanche pour franchir les frontières. Il a expliqué que des dérogations d’intérêt national sont accordées pour de nombreuses raisons et qu’il existe un régime permettant de s’assurer que les Canadiens ne sont pas mis en danger. Le ministre Blair a indiqué que le gouvernement a réinvesti dans la capacité des laboratoires de la GRC. Parti libéral Le ministre a indiqué que la pandémie a mis en lumière les problèmes importants auxquels sont confrontées les personnes à faibles revenus et qu’il examinera toutes les questions de nature systémique. Il a insisté sur la nécessité de réformer le système de casiers judiciaires, d’examiner les questions relatives à la détermination de la peine et de trouver des moyens de faciliter l’accès au pardon. Le ministre Blair a exposé les mesures prises par le ministère de la Sécurité publique pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les établissements correctionnels. Lorsqu’on lui a demandé s’il comptait mettre à jour sa lettre de mandat afin de préciser les délais et d’ajouter des objectifs en ce qui concerne des questions telles que la formation professionnelle des détenus, le ministre a indiqué qu’il fallait faire preuve de transparence. Il a expliqué avoir étroitement collaboré avec M. Zinger et que les rapports du BEC sont très utiles. Il a convenu que les délais doivent être clairement définis et que les commissaires veulent être efficaces. La commissaire Lucki a expliqué qu’il fallait du temps pour étudier les conclusions de l’affaireColin Bushi et que le rapport serait prêt avant la fin de l’automne de cette année. Le ministre Blair a mentionné qu’il a travaillé en étroite collaboration avec la commissaire de la GRC pour s’attaquer au racisme systémique. La commissaire Lucki a donné un aperçu des initiatives qui sont prises pour résoudre ce problème, y compris, mais sans s’y limiter : Le ministre Blair a indiqué que le Canada a maintenant retrouvé les niveaux de trafic commercial de 2019 et que les restrictions imposées aux voyages non essentiels ont permis de ralentir l’incidence de la COVID-19. Le ministre Blair a indiqué que le gouvernement est chargé de veiller à ce que les acteurs étatiques hostiles ne nuisent pas aux Canadiens. Il a mentionné le rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, qui a relevé le risque croissant d’activités de certains pays, particulièrement de la Chine, qui pourraient être préjudiciables aux Canadiens et a assuré le Comité que le gouvernement s’efforce de protéger les Canadiens contre toute influence indue. La commissaire Lucki a indiqué qu’en ce qui concerne le racisme systémique, la GRC procède à une étude interne de l’organisation dans son ensemble et examine les politiques et les procédures, y compris son processus de recrutement, pour s’assurer qu’elles reflètent les communautés qu’elle sert. La commissaire Kelly a expliqué que l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi sont des facteurs clés pour la réussite des délinquants. L’exercice 2017-2018 a été marqué par une augmentation significative de la formation. Elle a poursuivi en fournissant des statistiques sur les résultats obtenus en 2019-2020 aux certifications professionnelles de toutes sortes. Elle a ajouté que le SCC s’oriente vers les services numériques. Bloc québécois Le ministre Blair a indiqué que le ministère de la Sécurité publique a communiqué avec le gouvernement américain pour discuter de la restriction des voyages non essentiels tout en assurant la circulation des biens nécessaires, et que cela a été fait très rapidement pour que ces mesures soient prises. Il a également expliqué que les frontières demeureront fermées aussi longtemps que ce sera nécessaire. Il a affirmé au Bloc qu’il est en contact permanent avec le syndicat représentant le personnel frontalier et qu’il discute régulièrement avec ses homologues du Québec et de partout au Canada. Il a expliqué que les frontières seront fermées aussi longtemps que cela sera nécessaire pour protéger les Canadiens. Le ministre Blair a indiqué que les mouvements des migrants en situation irrégulière ont été restreints dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la COVID-19, ce qui s’est traduit par une diminution significative. Il a expliqué que le ministère de la Justice cherche à obtenir des éclaircissements de la part des tribunaux au sujet de l’entente sur les tiers pays sûrs et que le Canada et les États-Unis travaillent en étroite collaboration pour moderniser cette entente. Le ministre Blair a expliqué que les dirigeants d’entreprise ne bénéficient pas de dérogations pour traverser la frontière, à moins de participer à un travail essentiel. C’est uniquement dans ces circonstances que l’agent frontalier peut prendre une décision. Il a expliqué que des processus gérés par IRCC et l’ASPC ont été établis. Le ministre Blair a indiqué que les caméras d’intervention ne sont pas une panacée et que la meilleure preuve de leur efficacité est l’interaction avec le public. Il a souligné la nécessité d’entamer un dialogue. Il a expliqué que les éléments de preuve sur support vidéo sont convaincants et constituent la base d’une réforme solide. Il a également précisé que les caméras d’intervention ne sont qu’une des mesures prises pour réduire les incidents et que le gouvernement continue de modifier les modèles de maintien de l’ordre. Le ministre Blair a souligné que, selon lui, les mesures prises pour lutter contre la possession d’armes à feu ont été très efficaces et ont permis de mettre un terme au marché de ces armes. Il a indiqué que le projet de loi visera à établir un processus permanent pour recenser les armes à risque afin d’assurer la sécurité des Canadiens. Nouveau Parti démocratique Le ministre Blair a expliqué qu’en ce qui concerne la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse, il n’y avait aucune intention de cacher quoi que ce soit au public et que des mesures ont été prises pour mener une enquête publique. Il a poursuivi en expliquant que les incidents où des pêcheurs ont été attaqués relèvent de la police provinciale de la Nouvelle-Écosse. Il a précisé que des accusations ont été portées et que des enquêtes sont en cours. La commissaire Lucki a mentionné qu’elle a beaucoup appris au sujet du racisme systémique à la GRC auprès des nombreux groupes différents qu’elle a entendus et consultés. Elle a dirigé l’élaboration d’un plan d’action avec un éventail d’intervenants, et 17 initiatives sont actuellement examinées et mises en œuvre. Elle a indiqué que ces initiatives sont actuellement répertoriées sur le site Web de la GRC. Le ministre Blair a fait savoir qu’Anthony Doob a été chargé d’aider le gouvernement à mettre en place des UIS dans les établissements correctionnels et que des dispositions législatives visant à réduire les risques auxquels sont exposées les populations noires et autochtones dans le système pénitentiaire seront mises en œuvre. Le ministre a déclaré qu’il pensait que le Comité souhaiterait participer au processus de prise de décision touchant la législation concernant SCC. Il a souligné qu’il s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer les résultats pour les personnes placées dans les établissements correctionnels. Parti vert Le ministre Blair a convenu que le racisme systémique et les groupes haineux n’ont pas leur place dans les organisations policières. Points de suivi Le ministre a accepté de fournir au Comité la répartition du pourcentage de wagons qui sont inspectés lorsqu’ils traversent la frontière canadienne. La commissaire Kelly s’est engagée à fournir la répartition des dépenses d’infrastructure pour les UIS. Question Anne Kelly : En ce qui concerne l’affectation des fonds, pour la première année, 2019-2020, il y avait environ 48,5 millions de dollars. Une partie de cet argent est allée aux services de santé, une autre aux ressources humaines et une autre aux unités d’intervention structurée. Nous avons dû embaucher des agents correctionnels, des agents de programmes, des agents de libération conditionnelle et du personnel infirmier. Nous avons dû former le personnel, ce qui comprenait le Programme de formation correctionnelle pour les CX. Mme Pam Damoff : Madame la commissaire, pourriez-vous faire parvenir au Comité une ventilation des dépenses engagées pour les infrastructures et pour tout le reste? Réponse Établissement des UIS La mise en œuvre des unités d’intervention structurée (UIS) fait partie d’une transformation historique du système correctionnel fédéral qui a entraîné l’élimination de l’isolement préventif. Le Service correctionnel du Canada (SCC) est résolu à assurer la réussite de la mise en œuvre des UIS, laquelle a nécessité d’importants investissements dans l’infrastructure en vue de créer de nouvelles unités pour les UIS, de développer la technologie requise pour assurer le suivi des déplacements/activités des détenus dans les UIS et de veiller à la prestation de programmes renforcés et efficaces. Les UIS n’ont été lancées que trois mois et demi avant la pandémie mondiale sans précédent, laquelle continue d’avoir des répercussions opérationnelles importantes sur le SCC. Pour protéger les détenus, nos employés et les membres du public, nous avons mis en place de vastes mesures de prévention et de contrôle des infections. Nous déployons des efforts en vue d’évaluer de façon plus complète les répercussions de la pandémie actuelle sur nos opérations, y compris les UIS, et nous envisageons la prise de mesures additionnelles pour augmenter le temps passé à l’extérieur des UIS ainsi que les contacts humains réels. Les détenus dans les UIS ont la possibilité de passer au moins quatre heures par jour à l’extérieur de leur cellule, dont deux heures de contacts humains réels. Ces possibilités sont objectivement mesurables et permettront au SCC d’assurer le suivi du temps que passent les détenus à l’extérieur de leur cellule et de leurs interactions avec les autres. Ces renseignements sont fournis aux décideurs externes indépendants (DEI) dans le cadre des examens de cas, ainsi que pour rendre compte de l’efficacité des UIS. Bien que le SCC doive permettre aux détenus de passer un minimum de temps à l’extérieur de leur cellule, il y a des cas où : Les personnes placées dans une UIS reçoivent la rémunération prévue pour les détenus qui participent aux programmes auxquels ils sont affectés, ont du temps libre, peuvent recevoir des visites et ont accès à leurs effets personnels. En outre, les détenus dans une UIS peuvent poursuivre ou commencer des interventions et des programmes correctionnels et bénéficier de services connexes, qui traitent des risques ou des comportements particuliers qui ont mené à leur transfèrement vers l’UIS. Des enseignants sont présents dans les UIS pour offrir des programmes d’éducation fondés sur les évaluations, les besoins et les objectifs des détenus en matière d’éducation. Pendant qu’ils se trouvent dans une UIS, les détenus autochtones continuent d’avoir accès à des Aînés/conseillers spirituels et à des agents de liaison autochtones, et de pouvoir se livrer à des pratiques traditionnelles et spirituelles. Ils continuent également à avoir l’occasion de participer à des activités et des cérémonies spirituelles et culturelles, y compris des cérémonies de purification par la fumée et, si cela est permis, de participer à des sueries. Tous les détenus continuent d’avoir accès à des aumôniers de toutes les confessions et à des activités spirituelles. Pour appuyer la mise en œuvre des UIS, le SCC a mis en place une stratégie de recrutement pour veiller à ce qu’il dispose du personnel nécessaire pour appliquer le nouveau modèle avec succès. Cette stratégie prévoit la formation d’agents correctionnels et d’intervenants de première ligne, dont plusieurs travailleront dans les UIS. À l’heure actuelle, le SCC en est à l’étape de la planification préliminaire de la construction d’une Académie nationale de formation permanente à Kingston, en Ontario (les travaux de construction devraient être achevés d’ici le milieu de l’année 2025), mais, entre-temps, il a conclu un contrat avec le Holland College en mars 2019 visant la prestation des programmes de formation correctionnelle. Ce contrat permettra de veiller à ce que les UIS soient dotées d’un effectif adéquat. Depuis leur mise en place le 30 novembre 2019, les UIS ont fait l’objet d’une surveillance étroite par des organes indépendants qui ont été mis sur pied à titre de mesure de transparence et de responsabilisation. En plus du Comité consultatif sur la mise en œuvre présidé par M. Doob, des décideurs externes indépendants (DEI) ont été nommés afin d’assurer une surveillance des conditions et des périodes de détention dans une UIS, une tâche qui est accomplie en temps réel partout au pays. Dans la grande majorité des cas faisant l’objet d’un examen des conditions de détention, les DEI ont confirmé que le SCC remplit ses obligations d’offrir aux détenus des possibilités de sortir de leur cellule et d’avoir des interactions avec les autres. Les données découlant des décisions prises par les DEI à ce jour indiquent que dans environ 80 % des examens, les DEI étaient convaincus que le SCC avait pris toutes les mesures utiles pour offrir des possibilités au détenu concerné de passer du temps à l’extérieur de sa cellule et d’avoir des interactions ainsi que pour l’encourager à se prévaloir de ces possibilités. Dans les plus ou moins 20 % des cas restants, les DEI ont formulé des recommandations à l’intention du SCC auxquelles ce dernier a donné suite. Si un DEI n’est pas convaincu que le SCC a pris toutes les mesures utiles, il doit ordonner le retrait du détenu de l’UIS. Dans environ 2 % des cas, les DEI ont ordonné le retrait d’un détenu d’une UIS. Le SCC a également fait des investissements dans son infrastructure afin d’adapter des espaces existants conformément aux exigences relatives aux UIS. Lors de l’élaboration et du peaufinage du concept des UIS, le SCC a établi les exigences relatives aux installations, lesquelles se sont généralement traduites par la mise en place d’un nombre suffisant de salles communes, de salles de programmes, de salles d’entrevue, d’aires récréatives intérieures, de cours extérieures et d’aires de travail réservées au personnel d’une taille adéquate. Les projets gérés à l’échelle régionale ont été amorcés pour chacun des établissements comportant une UIS ciblés, afin de déterminer les travaux requis pour la mise en place de chacune des UIS. Chaque région a élaboré des stratégies d’atténuation qui devaient être appliquées si les travaux n’étaient pas achevés au plus tard le 30 novembre 2019, date à laquelle les UIS devaient être mises en œuvre. Les travaux sont en cours à la plupart des unités opérationnelles et, par conséquent, les stratégies d’atténuation, dont le recours à des espaces existants jusqu’à ce que les travaux de rénovation soient terminés, s’appliquent. Certains projets ont subi des retards en raison des restrictions en matière d’accès imposées aux entrepreneurs pour éviter l’introduction de la COVID-19 dans les établissements. Accroissement du soutien en matière de soins de santé Le projet de loi C-83 visait à assurer non seulement la mise en place des UIS, mais également l’accroissement du soutien en matière de soins de santé et des interventions offerts à tous les détenus, y compris au chapitre de la santé mentale. Il prévoyait le renforcement du soutien offert aux professionnels de la santé pour veiller à ce que le SCC respecte son obligation de fournir des soins conformes aux normes reconnues dans la collectivité. Avant de décider de placer un détenu dans une UIS, il faut évaluer ses besoins, y compris sa santé mentale. Si un détenu se retrouve dans une UIS, il continuera d’avoir accès aux services de santé essentiels afin de répondre à tous ses besoins, dont ceux au chapitre de la santé mentale. De plus, un professionnel de la santé peut recommander au directeur de l’établissement que les conditions de détention soient modifiées ou que le détenu soit retiré de l’UIS pour des raisons de santé. L’état de santé des personnes placées dans les UIS est surveillé et évalué de façon continue. Les professionnels de la santé agréés évalueront la santé mentale des détenus dans les 24 heures suivant leur transfèrement vers une UIS et tous les 14 jours par la suite. De plus, les détenus dans les UIS recevront chaque jour la visite d’un professionnel de la santé agréé et feront l’objet d’une évaluation approfondie de la santé mentale dans les 28 jours suivant leur transfèrement. La structure de gouvernance des soins de santé a été renforcée afin d’offrir une plus grande autonomie et une plus grande indépendance clinique aux professionnels de la santé dans les installations correctionnelles. Si, à tout moment, un professionnel de la santé agréé est d’avis que, pour des raisons de santé, un détenu ne devrait pas demeurer dans l’UIS ou que les conditions de détention de ce dernier devraient être modifiées, il formulera par écrit une recommandation en ce sens au directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement doit prendre une décision le plus rapidement possible. S’il ne met pas en œuvre la recommandation formulée, le Comité de la santé, qui est présidé par le commissaire adjoint des Services de santé, examinera le cas du détenu. Si la recommandation n’est toujours pas mise en œuvre, le DEI examinera à son tour le cas du détenu et décidera si ce dernier doit demeurer dans l’UIS ou si ses conditions de détention doivent être modifiées. Des services de défense des droits des patients sont également offerts aux détenus dans certains pénitenciers désignés afin de les aider à comprendre leurs droits et leurs responsabilités en matière de soins de santé, conformément aux recommandations découlant de l’enquête sur le décès d’Ashley Smith. En plus des services de santé propres aux détenus dans les UIS, le SCC améliore les services de santé pour tous les détenus ayant des besoins en santé mentale. Le financement découlant du projet de loi C-83 a permis l’obtention de ressources professionnelles supplémentaires en santé, y compris de services psychiatriques, en vue d’offrir des soins de santé intégrés ainsi qu’une évaluation et un diagnostic précoces de la maladie mentale. En pratique, cela signifie qu’il y a plus de ressources en soins de santé (y compris des infirmiers, des heures prolongées pour les services de psychiatrie, des travailleurs sociaux, des infirmiers praticiens, etc.) pour assurer la prestation d’interventions précoces, intégrées et soutenues en matière de santé afin de prévenir les circonstances qui pourraient mener à une admission inutile à une UIS. Ces améliorations permettront de trouver le bon protocole de soins pour les détenus atteints de maladie mentale afin qu’ils reçoivent un traitement approprié, en temps opportun. Return to footnote *2) Surveillance numérique et création d’une application pour les UIS. referrer *Comprend Services d’éducation, Services hospitaliers, Praticien du droit, Médecine, Ergothérapie et physiothérapie, Pharmacie, Psychologie et Service social.Return to footnote * referrer **Comprend Services administratifs, Commis aux écritures et aux règlements, Informatique, Groupe de la direction, Gestion des ressources humaines, Achats et approvisionnement, et Étudiants.Return to footnote ** referrer Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom Autre(s) rôle(s) Circonscription Province Langue de préférence Établissements du SCC dans la circonscription Première année d’élection Profession antérieure Déclarations sur la question Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : Nom : Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question : New Democratic Party Nom : Jack Harris Autre(s) rôle(s) : Circonscription : Province : Langue préférée : Établissements du SCC dans la circonscription : Première année d’élection : Profession antérieure : Déclarations sur la question :Table des matières
1. Faits saillants et statistiques clés sur la COVID-19
Population de délinquants
Environnement opérationnel
Effectif du SCC
Résultats obtenus par le SCC
2. Aperçu financier
Budget annuel
Structure des coûts et contraintes
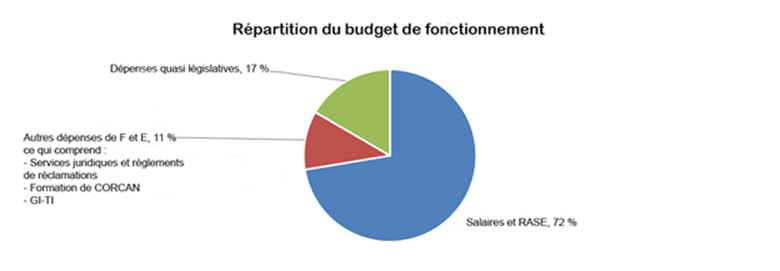
Répartition du budget de fonctionnement
Dépenses quasi-législatives (17 %)Questions d’actualité au SCC
Budget principal des dépenses
Budget supplémentaire des dépenses (B)
Investissements budgétaires depuis 2017
Planification liée à la COVID-19 pour les services correctionnels fédéraux
Unités d’intervention structurée
Cellules sèches
Surreprésentation de groupes particuliers dans les établissements fédéraux
Comité d’enquête nationale conjointe du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel (2019-2020)
Rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Gestion des incidents
4. Aperçu du comité
Sommaire de la réunion sur la lettre de mandat du ministre
M. John Ossowski, président, ASFC
M. David Vigneault, directeur, SCRS
Mme Anne Kelly, commissaire, SCC
Mme Jennifer Oades, présidente, CLCC
M. Rob Stewart, sous-directeur, SP
Mme Brenda Lucki, commissaire, GRC
Réponse du Service correctionnel du Canada sur le financement des unités d’intervention structurée
2019-2020
2020-2021
Dépenses de fonctionnement – Crédit 1
Financement
Dépenses
Financement
Dépenses à la P6
Santé
4,903,892
6,273,999
11,903,872
3,694,408
Établissement régulier
2,332,791
2,944,425
2,332,791
2,269,474
Responsables de la pratique professionnelle
1,523,349
641,815
2,899,500
320,180
Centres régionaux de traitement
1,047,752
2,687,759
6,671,581
1,104,754
Unités d’intervention structurée
16,567,659
25,743,860
31,075,147
15,849,044
UIS
15,081,630
15,651,032
29,589,118
14,487,086
Décideurs externes indépendants
1,486,029
652,334
1,486,029
669,977
Infrastructure1
7,257,263
279,186
Équipes de mise en œuvre et de gestion
1,672,710
387,921
Services de gestion de l’information2
433,707
1,512
Services d’aumônerie
76,814
23,36
Gestion des ressources humaines
21,199,636
13,636,637
8,318,817
4,035,949
Apprentissage et perfectionnement
17,176,125
9,896,624
8,318,817
4,009,063
Recrutement
4,023,511
3,740,014
26,886
Services internes
5,880,538
229,548
7,069,380
70,019
Total global – Dépenses de fonctionnement – Crédit 1
48,551,725
45,884,045
58,367,216
23,649,419
2019-2020
2020-2021
Dépenses en capital – Crédit 5
Financement
Dépenses
Financement
Dépenses à la P6
Infrastructure Footnote 1
6,107,718
241,421
Technologie de l’informationFootnote 2
1,445,912
705,412
Total global – Dépenses en capital – Crédit 5
7,553,631
946,832
Classification
Années-personnes réelles pour 2019-2020
Années-personnes réelles à la P6 de 2020-2021
Années-personnes prévues à la fin de l’exercice 2020 2021
Agent de libération conditionnelle, agent de programmes correctionnels, agent de programmes sociaux, agent de liaison autochtone
59.93
61.27
125.48
Infirmiers
13.79
10.21
21.39
Agents correctionnels
77.54
73.25
148.09
Autres – domaine de la santé et du bien-être Footnote *
16.18
12.04
23.91
Autres – administration et soutienFootnote Footnote **
41.9
22.69
54.58
Total
209.34
179.46
373.45
Profil des membres du comité
Parti libéral du Canada

John McKay
Président du SECU
Scarborough—Guildwood
Ontario
Anglais
Aucun
1997
Avocat et politicien canadien

Pam Damoff
Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones
Oakville-Nord—Burlington
Ontario
Anglais
Aucun
2015
Ancienne promotrice immobilière

Angelo Iacono
Membre de la Bibliothèque du Parlement
Alfred—Pellan
Québec
Français/anglais
Centre fédéral de formation
2011
Avocat

Kamal Khera
Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international
Brampton Ouest
Ontario
Anglais
Aucun
2015
Ancienne infirmière autorisée

Joël Lightbound
Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Louis-Hébert
Québec
Français/anglais
Aucun
2015

Gagan Sikand
Membre de la Bibliothèque du Parlement
Mississauga — Streetsville
Ontario
Anglais
Aucun
2015
Ancien avocat
AucuneParti conservateur du Canada

Shannon Stubbs
Vice-présidente du SECU
Lakeland
Alberta
Anglais
Aucun
2015
Consultante principale pour une entreprise de relations publiques

Damien C. Kurek
Membre du Comité permanent sur l’accès à l’information, la protection des renseignements personnels et l’éthique
Battle River - Crowfoot
Alberta
Anglais
Aucun
2019
Agriculteur

Glen Motz
Membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Medicine Hat – Cardston - Warner
Alberta
Anglais
Aucun
2016
Inspecteur

Tako Van Popta
Aucun
Langley - Aldergrove
Colombie-Britannique
Anglais
Aucun
2019
Avocat
Bloc Québécois

Kristina Michaud
Vice-présidente du SECU
Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia
Québec
Français
Aucun
2019
Professionnelle des communications

Vice-président du Comité sur les relations sino-canadiennes
St. John’s-Est
Terre-Neuve-et-Labrador
Anglais
Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Terre-Neuve-et-Labrador –
Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve-et-Labrador
2008
Avocat et politicien canadien