Comparution de la Commissaire devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale : 24 mars 2021
Budget principal et budget supplémentaire des dépenses
Budget principal et budget supplémentaire des dépenses
Table des matières
- Budget principal et budget supplémentaire des dépenses
- Tableau du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses
- Messages clés
- Unités d’intervention structurée
- Coercition et violence sexuelles
- Décès en établissement
- Audit sur la culture
- Changement du culture au SCC
- Détenus transgenres
- Programme de vaccination contre la COVID-19
- Rapport annuel 2019-2020 sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
- Racisme systémique
- Aperçu financier
- Questions d’actualité au SCC
- Unités d’intervention structurée
- Agression sexuelle envers un employé
- Décès en établissement
- Programme de vaccination contre la COVID-19
- Planification liée à la COVID-19 pour les services correctionnels fédéraux
- Outils d’évaluation du risque - Autochtones
- Incident survenu au Québec - Comité d’enquête nationale conjointe
- Cellules nues
- Faits et chiffres importants
- Rapports sommaires précédents de comités
- Aperçu du comité
- Logistique du comité
1. Budget principal et budget supplémentaire des dépenses
Tableau du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses - Budget des dépenses du SCC
Budget supplémentaire des dépenses C 2020-2021 - Financement total du SCC : 243 160 279 $
Budget principal des dépenses 2021-2022 - Financement total : 2 793 675 395 $
| No crédit | Nom du crédit | Budget principal 2020-2021 | Budget supp. dirigé « A » 2020-2021 | Budget supp. d’automne « B » 2020-2021 | Crédits centraux CT 2020-2021 | Pouvoirs 2020-2021 à ce jour | Présent budget supplémentaire des dépenses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suppl. « C » | Autorisations proposées à ce jour | |||||||
| - | -
|
A |
C |
C |
D |
E =A+B+C+D |
F |
G =E+F |
| 1 | Dépenses de fonctionnement |
2 145 688 776 |
- |
130 549 259 |
64 294 411 |
2 340 532 446 |
242 751 655 |
2 583 284 101 |
| 5 | Dépenses en immobilisations |
187 796 912 |
- |
- |
21 630 659 |
209 427 571 |
-9 193 420 |
200 234 151 |
| 10a | Fonds renouvelables CORCAN |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
| S | Dépenses prescrites par la loi |
220 353 432 |
- |
23 630 328 |
- |
243 983 760 |
9 602 044 |
253 585 804 |
| - | Total: |
2 553 839 120 |
1 |
154 179 587 |
85 925 070 |
2 793 943 778 |
243 160 279 |
3 037 104 057 |
| Crédit | Description du crédit | Budget suppl. provisoire 2019-2020 | CEB 2019-2020 | Budget principal des dépenses 2019-2020 | Budget principal 2020-2021 (hors CEB) | Écart ($) | Écart (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | A |
B |
C = A+B |
D |
E = D-C |
F= E/C* 100 |
| 1 | Dépenses de fonctionnement, subventions et contributions |
2 062 950 977 |
95 005 372 |
2 157 956 349 |
2 145 688 776 |
- 12 267 573 |
-0,57% |
| 5 | Dépenses en immobilisations |
187 808 684 |
- |
187 808 684 |
187 796 912 |
- 11 772 |
-0,01% |
| Dépenses prescrites par la loiStatutory | Dépenses prescrites par la loi |
234 334 808 |
- |
234 334 808 |
220 353 432 |
- 13 981 376 |
-5,97% |
| Total - Crédit | 2 485 094 469 | 95 005 372 | 2 580 099 841 | 2 553 839 120 | - 26 260 721 | -1,02% | |
Budget principal et Budget supplémentaire - Points à souligner:
- Le gouvernement du Canada fait les investissements nécessaires pour donner aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 tout en établissant les conditions essentielles à une reprise économique réussie.
- Au total, les budgets du SCC pour l’exercice financier actuel de 2020-2021, y compris le budget principal et les budgets supplémentaires (A, B et C), représentent une somme de 478,7 milliards de dollars. De ce montant, une somme de 159,5 milliards de dollars représente les autorisations de dépenses pour les mesures liées à la COVID-19.
- Les fonds seront utilisés pour faire face aux coûts réels et prévus liés à l’élargissement de la recherche de contacts en cas de COVID-19, à la fourniture d’équipements de protection individuelle au personnel et aux délinquants, à l’amélioration des pratiques de nettoyage en établissement et pour faire face aux coûts encourus dans les établissements pour compenser les effets négatifs sur la population des délinquants.
- Par le Budget des dépenses, le gouvernement du Canada fait preuve de transparence et rend des comptes aux parlementaires et aux Canadiens en donnant un aperçu de la façon dont l’argent des contribuables sera investi.
Messages clés
Unités d’intervention structurée
- Les unités d’intervention structurée (UIS) font partie d’une transformation historique du système correctionnel fédéral qui a entraîné l’élimination de l’isolement préventif.
- Nous sommes fermement résolus à assurer la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau modèle et le prenons très au sérieux.
- Certains détenus ne peuvent être logés en toute sécurité au sein de la population carcérale régulière en raison du risque qu’ils présentent pour eux-mêmes ou pour les autres. C’est pour ces délinquants que les UIS ont été créées.
- Les UIS n’ont pas pour but de punir ou de causer du tort.Elles servent de mesure temporaire pour aider les détenus et leur offrir, de façon continue, la possibilité de participer à des interventions et à des programmes en vue de favoriser leur réintégration en toute sécurité dans une population carcérale régulière dès que possible.
- Les détenus ont la possibilité, chaque jour, d’avoir des contacts humains réels et de passer du temps à l’extérieur de leur cellule, et ils continuent d’avoir accès à des interventions, à des services et à des programmes correctionnels qui ciblent les risques ou les comportements particuliers qui ont mené à leur transfèrement vers une UIS.
- La surveillance externe constitue une garantie essentielle. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce mécanisme. Des décideurs externes indépendants, qui sont en place à l’échelle du pays, assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les unités d’intervention structurée. Leurs décisions ont force exécutoire.
- Dans les cas où, pendant cinq jours consécutifs ou 15 jours civils sur 30, un détenu n’a pas passé au moins quatre heures à l’extérieur de sa cellule ou n’a pas eu de contacts humains réels avec les autres pendant au moins deux heures, son cas est examiné par un décideur externe indépendant. Souvent, ce type de situation se produit parce qu’un détenu refuse les possibilités qui lui sont offertes chaque jour.
- En date du 28 février 2021, les décideurs externes indépendants ont réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les décideurs externes indépendants ont conclu que le Service correctionnel du Canada avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les décideurs externes indépendants ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un décideur externe indépendant est reçue, le Service correctionnel du Canada dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les décideurs externes indépendants étaient satisfaits des mesures prises par le Service correctionnel du Canada.
- Le rapport de Mme Sprott et de M. Doob portant sur les unités d’intervention structurée a fait l’objet d’un examen minutieux, et leur analyse a relevé des problèmes et des tendances relatives aux données auxquels nous donnons suite.
- Nous sommes résolus à en faire davantage pour veiller à ce que les conditions permettent aux détenus de sortir de leur cellule et de participer à des programmes et à des activités.
- Des mesures importantes ont été prises pour atténuer certaines des tendances et des différences régionales cernées dans les données. Nous nous attaquons à ce problème en fournissant des directives opérationnelles supplémentaires et en partageant les pratiques exemplaires. Des réunions et des assemblées générales ont lieu régulièrement avec le personnel afin que l’on puisse comprendre les défis et adopter des solutions. Les établissements font le suivi de leurs progrès et produisent des rapports à cet égard.
- Nous constatons des changements dans le comportement des détenus. Grâce aux interventions et aux programmes actifs, ainsi qu’aux partenariats établis entre les régions, les détenus qui, auparavant, ne démontraient aucun intérêt à travailler à renforcer leurs compétences dans le but de s’adapter à la vie au sein d’une population carcérale régulière choisissent de participer à des programmes offerts dans les UIS. En conséquence, ils développent des attitudes plus positives et de meilleures compétences en matière de gestion des conflits, et nous constatons qu’ils appliquent ce qu’ils apprennent.
- Il y a beaucoup moins de détenus dans les UIS que dans l’ancien modèle. En 2014, on comptait 780 détenus en isolement préventif. En date du 16 mars 2021, on compte 188 détenus dans les UIS à l’échelle du pays, ce qui représente environ 1 % de la population carcérale.Cette moyenne continue d’être la tendance depuis leur création.
Coercition et violence sexuelles
- Le SCC ne tolère aucune forme de violence dans le système correctionnel fédéral. La sécurité des personnes au sein de nos établissements est une priorité absolue et aucune personne logée ou travaillant dans ces établissements ne devrait craindre pour sa sécurité.
- Le mandat principal de notre système correctionnel est de réhabiliter et de réintégrer en toute sécurité les délinquants dans la collectivité. Nous nous efforçons d’offrir des environnements sécuritaires pour soutenir les détenus afin qu’ils deviennent des citoyens respectueux des lois. Il s’agit là de notre responsabilité fondamentale.
- La coercition et la violence sexuelles au sein de nos établissements sont un problème que nous prenons très au sérieux, et nous prenons de nombreuses mesures pour y remédier et apporter le soutien nécessaire aux personnes dont nous avons la charge et la garde. Nous savons qu’il reste du travail à faire.
- Nous sommes en train d’élaborer une politique distincte; toutefois, un certain nombre de nos politiques renferment diverses exigences liées à la coercition et à la violence sexuelles.
- Nous signalons immédiatement au service de police ayant compétence tout incident ou toute allégation d’inconduite pouvant constituer une infraction criminelle.
- J’aimerais également souligner que différents mécanismes sont mis à la disposition des délinquants pour signaler les comportements inappropriés, qu’ils en soient victimes ou témoins, dont le système de règlement des plaintes et des griefs, qui contribue à assurer la sécurité des établissements en aidant le personnel à cerner les problèmes et à y remédier rapidement.
- Nous travaillons également à accroître la prévention et la sensibilisation par le biais de renseignements éducatifs dans le but de prévenir ce genre de situations et de veiller à ce que les détenus sachent quoi faire s’ils estiment être victimisés.
- Les détenus ont aussi toujours accès au Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). Le numéro de téléphone du BEC est programmé dans le compte téléphonique des détenus afin de leur permettre de téléphoner au Bureau en toute confidentialité pour lui demander de l’aide dans ces affaires.
- Nous assurons un suivi et une surveillance de tous les cas d’inconduite d’employés et de coercition et de violence sexuelles à l’égard de détenus. Ces données permettront d’orienter l’élaboration de stratégies fondées sur des données probantes afin de mieux prévenir la coercition et la violence sexuelles, particulièrement pour les personnes qui pourraient être plus vulnérables.
- Nous savons qu’il reste du travail à faire pour lutter contre la coercition et la violence sexuelles au sein de nos établissements fédéraux. Le SCC travaille en collaboration avec Sécurité publique Canada et est en train de mobiliser ses partenaires provinciaux et ses partenaires internationaux qui sont membres de l’Association internationale des affaires correctionnelles et pénitentiaires en vue de mener une recherche et d’apprendre de leurs pratiques. Cela nous aidera à renforcer notre approche et notre réponse à l’avenir.
- Nous sommes résolus à prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer notre approche à l’égard de cette importante question. La sécurité de nos établissements est indispensable à la réussite de la réhabilitation des délinquants et fondamentale dans le cadre de notre travail consistant à assurer la sécurité publique.
Décès en établissement
- Le Service correctionnel du Canada prend très au sérieux le décès de tout détenu. La perte d’une vie est toujours une tragédie.
- Comme dans tous les cas de décès en établissement, on fait appel à la police et au coroner pour qu’ils fassent enquête sur le décès, et le coroner détermine la cause du décès.
- Nous sommes tenus par la loi de fournir à chaque détenu sous responsabilité fédérale des soins de santé essentiels ainsi qu’un accès raisonnable aux soins de santé non essentiels, conformément aux normes professionnelles.
Audit sur la culture
- Nous sommes à l’étape de planification d’un audit interne sur la culture.
- L’audit a pour but de trouver des moyens de faire en sorte que tous les employés du SCC et les délinquants aient accès à un environnement plus sûr, plus sain, plus respectueux et exempt de violence.
- Cet audit est un moyen important de nous aider à évaluer tous les aspects de l’environnement du SCC.Il nous indiquera les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer et nous guidera dans la planification des changements qui nous aideront à améliorer notre culture et notre façon de travailler.
- Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 2020 sera aussi un outil précieux qui nous aidera à déterminer ce que nous faisons bien et ce que nous devons améliorer.
- Le sondage renferme une série de questions portant sur les sujets suivants :
- Santé mentale
- Rémunération
- Leadership
- Respect
- Diversité
- Harcèlement
- Discrimination
- Autres priorités liées au milieu de travail
- Le sondage a été conçu pour obtenir de la rétroaction sur les répercussions qu’a eues la pandémie sur le SCC en 2020, puisqu’elle a posé des défis uniques pour le personnel travaillant dans tous les secteurs de l’organisation.
- Les résultats du sondage alimenteront l’audit et fourniront de l’information à l’appui de l’amélioration continue des pratiques de gestion des personnes dans la fonction publique fédérale, ce qui, au bout du compte, nous aidera à améliorer les pratiques au SCC.
- Nous prévoyons que les résultats du sondage seront représentatifs de tous les secteurs, les régions et les groupes professionnels et qu’ils nous donneront un aperçu clair de la culture du SCC.
Changement du culture au SCC
Mesures prises pour accroître la sensibilisation :
- Campagne pour un milieu de travail respectueux.
- Rapport annuel sur le climat et le bien-être au travail.
- Des renseignements sur le processus de règlement des plaintes et la résolution informelle des conflits ont été publiés sur le site Web interne.
- Des séances d’information sur le bien-être familial ont été tenues dans les régions.
Pour renforcer la responsabilisation :
- Des engagements relatifs à la gestion des cas de harcèlement et d’intimidation ont été ajoutés aux ententes de rendement de tous les cadres supérieurs et des superviseurs.
- Une initiative d’évaluation des risques liés à l’éthique a été mise en œuvre pour favoriser un milieu de travail respectueux.
Pour améliorer l’accès et les procédures :
- Une ligne de dénonciation a été créée afin d’offrir aux employés d’autres moyens de signaler une inconduite.
- Des séances de formation obligatoire sont offertes aux employés sur le milieu de travail respectueux, la violence et les mesures d’adaptation.
- Le personnel a accès en tout temps à LifeSpeak, une plateforme numérique gratuite et anonyme axée sur le mieux-être.
- Des lignes directrices sur la prévention de la violence en milieu de travail, qui favorisent la résolution informelle des conflits, ont été élaborées et communiquées.
- Un Comité directeur sur les atteintes à la santé mentale en milieu de travail a été créé.
Stratégie globale sur le mieux-être en milieu de travail et le bien-être des employés
Pilier 1 - Améliorer la culture et accroître la fierté
Établir une structure inclusive en réduisant la stigmatisation, en favorisant la communication, en augmentant la fierté et en assumant notre responsabilité partagée dans la création et le maintien d’un milieu de travail sain, étant donné que la santé et le bien-être au travail sont fondés sur une culture de respect, de confiance, de diversité, d’inclusion et d’équité.
Pilier 2 - Renforcer les capacités
Promouvoir des programmes, des initiatives et des services intégrés fondés sur les pratiques exemplaires et satisfaire les besoins changeants des employés, des gestionnaires et de l’organisation afin d’établir et de maintenir un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif.
Pilier 3 - Favoriser des environnements sains, respectueux et résilients exempts de harcèlement, d’intimidation et de violence
S’assurer que tous les employés et les gestionnaires sont plus conscients et comprennent mieux que le harcèlement, l’intimidation et la violence sont inacceptables, quelles que soient les circonstances. Encourager le signalement de toute inconduite et s’assurer que tous se perçoivent comme des membres égaux de l’organisation qui jouissent du même soutien et sont traités en toute égalité.
Cadre pour lutter contre le racisme
- Un effort coordonné panorganisationnel doit être consenti pour le SCC.
- Toutes les mesures seront interdépendantes et se renforceront mutuellement.
- Nous devons écouter, apprendre et cerner les lacunes, ainsi que convenir avec nos intervenants, des mesures réalistes que nous pouvons prendre pour obtenir des résultats concrets.
Efforts liés à l’équité en matière d’emploi et à la diversité
- De nouveaux objectifs de représentation des Autochtones ont été établis pour aider à bâtir un effectif qui est plus représentatif de la population de délinquants :
- pondération de 30 % selon la représentation de la population de délinquants;
- pondération de 70 % selon la disponibilité au sein de la population active (DPA).
- Des objectifs similaires ont été établis pour les minorités visibles et un plan quadriennal a été élaboré pour combler les lacunes en matière de représentation pour les femmes et les personnes handicapées.
- Un examen des outils d’évaluation utilisés aux fins du recrutement des agents correctionnels est réalisé pour s’assurer qu’ils ne comportent aucun obstacle culturel.
- Un nouveau répertoire propre aux Autochtones a été mis sur pied dans la région des Prairies pour que les Autochtones puissent présenter leur candidature à divers postes. À ce jour, 12 nominations ont été faites à partir de ce répertoire.
- La représentation de tous les groupes visés par l’EE a augmenté entre le mois d’octobre et le 31 décembre 2020.
Audit sur la culture
- Engagement prévu dans le Plan d’audit axé sur les risques 2019-2020 du SCC.
- Occasion d’examiner tous les aspects de la culture du SCC et de veiller à ce que la bonne approche soit adoptée pour aller de l’avant.
- Dirigé par le Secteur de l’audit interne, avec l’appui du Comité ministériel d’audit.
- Mobilisation des intervenants suivants : la haute direction, les régions, les secteurs, divers experts en la matière du Comité consultatif national sur l’éthique, des consultants externes, les partenaires syndicaux et d’autres ministères et organismes fédéraux qui ont subi des changements liés à leur culture organisationnelle.
- Le SCC révisera ses priorités organisationnelles afin de communiquer clairement qu’il est résolu à bâtir une culture qui favorisera un milieu de travail sain et respectueux.
Événements annuels importants
- Journée Bell Cause pour la cause
- Journée du chandail rose
- Journée du respect au SCC
- Mois de la santé au travail
- Journée internationale des personnes handicapées
- Semaine de la diversité
- Mois de l’histoire des Noirs
- Journée des droits de la personne
- Mois de l’histoire des femmes
- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
- Jour du souvenir trans
Incidence positive pouvant déjà être mesurée - résultats du SAFF 2019
- Une diminution de 6 % du nombre de répondants ayant indiqué avoir été victimes de harcèlement par rapport à l’année dernière
- Augmentation de 7 % du nombre de répondants ayant indiqué être satisfaits de la qualité de la supervision qui est exercée à leur égard
- Augmentation de 6 % du nombre de répondants ayant indiqués être satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés dans leur unité de travail
- Augmentation de 5 % du nombre de répondants ayant indiqué que leur superviseur immédiat semble se soucier d’eux en tant que personne
Autres constatations tirées du Rapport sur le climat de travail de 2019-2020
- Les congés de maladie ont diminué, dans l’ensemble, de 2 % par rapport à 2018-2019.
- Le Bureau de la gestion des conflits (BGC) a fourni 2 088 services en 2019-2020 à 6 877 employés; dans 95 % des cas où le BGC a été contacté, des médiations et des discussions dirigées ont eu lieu et, dans 90 % de ces cas, elles ont permis de résoudre le conflit.
Détenus transgenres
- Le mandat principal de notre système correctionnel est de réhabiliter et de réintégrer en toute sécurité les délinquants dans la collectivité. Nous nous efforçons d’offrir des environnements sécuritaires pour soutenir les détenus afin qu’ils deviennent des citoyens respectueux des lois. Il s’agit là de notre responsabilité fondamentale.
- En ce qui concerne les détenus qui s’identifient comme étant transgenres, nous sommes résolus à veiller à ce qu’ils bénéficient de la même protection et du même traitement que tous les autres, en leur accordant la même dignité. Les délinquants peuvent être placés dans un établissement pour hommes ou pour femmes, selon leur identité de genre.
- Les demandes de transfèrement des délinquants transgenres sont évaluées au même titre que les autres demandes de transfèrement.
- Nous utilisons un certain nombre d’approches et d’outils fondés sur des données probantes pour évaluer le risque que présente un détenu, notamment des évaluations initiales, des réévaluations de la cote de sécurité, des plans correctionnels, des évaluations psychologiques du risque et d’autres évaluations.
- Lorsqu’un délinquant demande à être transféré dans un établissement qui correspond mieux à son identité ou à son expression de genre, on prend notamment en considération son état de santé, les préoccupations en matière de sécurité, l’accès aux interventions correctionnelles et le soutien dans la collectivité.
- Un délinquant ne sera transféré dans un établissement qu’après un examen rigoureux de son dossier et après la résolution adéquate des préoccupations liées à la sécurité.
- Le processus de transfèrement vise à gérer efficacement les populations carcérales en transférant les délinquants dans un environnement correspondant à leurs besoins en matière de sécurité et à faciliter leur participation aux programmes correctionnels et aux autres interventions prévus dans leur plan correctionnel.
- À l’heure actuelle, 10 femmes transgenres et 12 hommes transgenres sont incarcérés dans des établissements pour femmes. Aucun homme transgenre n’a été transféré dans un établissement pour hommes.
Programme de vaccination contre la COVID-19
- La santé et la sécurité du personnel, des détenus et du public sont notre priorité absolue pendant cette période sans précédent.
- Nous sommes tenus par la loi de fournir des soins de santé essentiels à environ 18 000 détenus dans les établissements correctionnels à l’échelle du pays.
- Nous avons collaboré étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus.
- Notre stratégie de vaccination est conforme aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et appuie l’attribution, la distribution et l’administration en temps utile des vaccins aux personnes sous responsabilité fédérale, et ce, de la façon la plus efficace, sécuritaire et équitable possible.
- Dans le cadre de la première phase de vaccination et selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation, un vaccin a été offert à environ 600 détenus âgés et médicalement vulnérables sous responsabilité fédérale.
- Au 12 mars 2021, 1 200 doses du vaccin de Moderna avaient été utilisées pour vacciner des détenus dans les pénitenciers fédéraux.
- Le SCC prévoit entamer la deuxième phase de vaccination le mois prochain, en avril. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels.
- Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.
Rapport annuel 2019-2020 sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
- Nous nous engageons fermement à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes des réponses en temps opportun aux demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
- Nous nous employons avec diligence à veiller à ce que la vie privée des Canadiens et des Canadiennes soit protégée et à ce que les renseignements soient communiqués seulement lorsqu’il est approprié de le faire, et ce, conformément à toutes les dispositions législatives, les politiques et les lignes directrices existantes.
- Des améliorations continuent d’être apportées à la fonction d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels pour renforcer l’engagement du Service à l’égard de cette responsabilité clé.
Racisme systémique
- Le racisme systémique est un problème complexe, qui doit tous nous mobiliser - à plusieurs niveaux du système de justice pénale. Nous devons tous jouer un rôle actif pour y remédier.
- Le racisme et la discrimination n’ont absolument pas leur place au Service correctionnel du Canada, et nous ne tolérons aucunement ces comportements.
- Nous reconnaissons que le racisme systémique existe au sein du Service correctionnel du Canada. Il faut reconnaître son existence pour pouvoir travailler de concert avec les peuples autochtones, les Canadiens de race noire, les intervenants et les collectivités que nous servons en vue de prendre des mesures ciblées pour lutter contre ce problème important.
- Nous sommes déterminés à travailler plus fort pour lutter contre le racisme systémique, notamment en augmentant la diversité au sein de nos postes de leadership et en favorisant une plus grande inclusion et équité dans tout ce que nous faisons.
- Nous avons réalisé un examen initial de nos politiques et programmes actuels qui traitent des besoins uniques des délinquants racialisés et qui visent à accroître la diversité de notre effectif. Cet examen a pris en compte les études existantes sur la question de la surreprésentation des Canadiens de race noire et des Autochtones au sein du système de justice pénale, y compris les recommandations du Caucus des parlementaires noirs.
- Afin de poursuivre notre travail, nous sommes en train d’élaborer un cadre de lutte contre le racisme et un plan d’action connexe.
- Nous menons présentement des consultations auprès d’intervenants et de groupes autochtones et ethnoculturels concernant les domaines sur lesquels nous devrions nous concentrer à l’avenir. Les employés aideront également à éclairer notre voie à suivre.
- Nous exigeons à nos employés de suivre une formation obligatoire sur la diversité et la compétence culturelle et leur offrons des occasions de perfectionnement professionnel continues et des ressources afin de promouvoir et de renforcer continuellement la sensibilisation du personnel et les pratiques inclusives.
2. Aperçu financier
Budget annuel
- Selon le Budget principal des dépenses de 2020-2021, le budget annuel du SCC est de 2 553,8 millions de dollars, répartis ainsi :
- 2 365,9 M$ en fonds de fonctionnement, y compris les régimes d’avantages sociaux des employés;
- 187,8 M$ en fonds d’immobilisations;
- 0,1 M$ en subventions et contributions.
- Cela représente une diminution de 26,3 M$ ou -1,0 % par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à ce qui suit :
- la diminution du crédit de fonctionnement de (12,3 M$) principalement liée au financement approuvé pour le Soutien au Service correctionnel du Canada (Budget 2019), compensé par le financement reçu pour la Transformation du système correctionnel fédéral (projet de loi C-83);
- la diminution de l’autorisation législative de (14,0 M$) pour l’affectation par le SCC de la part de l’employeur du régime d’avantages sociaux des employés;
- la diminution du crédit pour dépenses en capital de (0,01 M$) pour la contribution du SCC à l’initiative Transformation des systèmes administratifs.
Structure des coûts et contraintes
- Environ 90 % du budget du SCC est non discrétionnaire, ce qui comprend les dépenses liées à ce qui suit :
- effectif de première ligne/conventions collectives;
- obligations prévues par la loi.
- Les coûts opérationnels sont majoritairement fixes et liés à la sécurité passive et active.
- Dans le contexte de l’intégrité des programmes, dans le cadre du Budget 2020, le SCC a reçu une réponse positive à sa demande de financement à la suite de l’examen complet.
- La situation financière du SCC est incertaine et il sera mieux placé pour l’évaluer une fois :
- qu’une décision aura été prise concernant sa demande de financement pour les dépenses supplémentaires liées à la pandémie de COVID-19;
- que le financement supplémentaire pour les règlements judiciaires anticipés sera approuvé.
- Le SCC disposait d’un report du budget de fonctionnement de 51,8 M$ (2019-2020), soit 2,2 % de ses autorisations totales disponibles (2019-2020).
- Des changements dans les opérations pourraient engendrer des économies, mais ils auraient aussi une incidence sur les résultats.
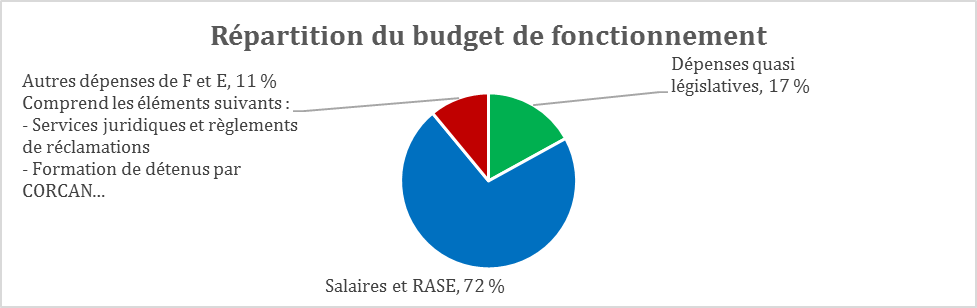
Répartition du budget de fonctionnement
Autres dépenses de F et E 11 %
Comprend les éléments suivants :
- Services juridiques et règlements de réclamations
- Formation des détenus par CORCAN
Salaires et RASE 72 %
Dépenses quasi-législatives 17 %
3. Questions d’actualité au SCC
Unités d’intervention structurée
Points à souligner :
- Les unités d’intervention structurée (UIS) font partie d’une transformation historique du système correctionnel fédéral qui a entraîné l’élimination de l’isolement préventif.
- Nous sommes fermement engagés dans la mise en œuvre réussie de ce nouveau modèle et le prenons très au sérieux.
- Certains détenus ne peuvent être logés en toute sécurité au sein de la population carcérale régulière en raison du risque qu’ils présentent pour eux-mêmes ou pour les autres. C’est pour ces délinquants que les UIS ont été créées.
- Les UIS n’ont pas pour but de punir ou de causer du tort. Elles servent de mesure temporaire pour aider les détenus et leur offrir, de façon continue, la possibilité de participer à des interventions et à des programmes en vue de favoriser leur réintégration en toute sécurité dans une population carcérale régulière dès que possible.
- Les détenus ont la possibilité, chaque jour, d’avoir des contacts humains réels et de passer du temps à l’extérieur de leur cellule, et ils continuent d’avoir accès à des interventions, à des services et à des programmes correctionnels qui ciblent les risques ou les comportements particuliers qui ont mené à leur transfèrement vers une UIS.
- La surveillance externe constitue une garantie essentielle. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce mécanisme. Des décideurs externes indépendants, qui sont en place à l’échelle du pays, assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les unités d’intervention structurée. Leurs décisions ont force exécutoire.
- Dans les cas où, pendant cinq jours consécutifs ou 15 jours civils sur 30, un détenu n’a pas passé au moins quatre heures à l’extérieur de sa cellule ou n’a pas eu de contacts humains réels avec les autres pendant au moins deux heures, son cas est examiné par un décideur externe indépendant. Souvent, ce type de situation se produit parce qu’un détenu refuse les possibilités qui lui sont offertes chaque jour.
- Au 28 février 2021, les décideurs externes indépendants avaient réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les décideurs externes indépendants ont conclu que le Service correctionnel du Canada avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les décideurs externes indépendants ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un décideur externe indépendant est reçue, le Service correctionnel du Canada dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les décideurs externes indépendants étaient satisfaits des mesures prises par le Service correctionnel du Canada.
- Le rapport de Mme Sprott et de M. Doob portant sur les unités d’intervention structurée a fait l’objet d’un examen minutieux, et leur analyse a relevé des problèmes et des tendances relatives aux données auxquels nous donnons suite.
- Nous sommes résolus à en faire davantage pour veiller à ce que les conditions permettent aux détenus de sortir de leur cellule et de participer à des programmes et à des activités.
- Des mesures importantes ont été prises pour atténuer certaines des tendances et des différences régionales cernées dans les données. Nous nous attaquons à ce problème en fournissant des directives opérationnelles supplémentaires et en partageant les pratiques exemplaires. Des réunions et des assemblées générales ont lieu régulièrement avec le personnel afin que l’on puisse comprendre les défis et adopter des solutions. Les établissements font le suivi de leurs progrès et produisent des rapports à cet égard.
- Nous constatons des changements dans le comportement des détenus. Grâce aux interventions et aux programmes actifs, ainsi qu’aux partenariats établis entre les régions, les détenus qui, auparavant, ne démontraient aucun intérêt à travailler à renforcer leurs compétences dans le but de s’adapter à la vie au sein d’une population carcérale régulière choisissent de participer à des programmes offerts dans les UIS. En conséquence, ils développent des attitudes plus positives et de meilleures compétences en matière de gestion des conflits, et nous constatons qu’ils appliquent ce qu’ils apprennent.
- Il y a beaucoup moins de détenus dans les UIS que dans l’ancien modèle. En 2014, on comptait 780 détenus en isolement préventif. En date du 16 mars 2021, on compte 188 détenus dans les UIS à l’échelle du pays, ce qui représente environ 1 % de la population carcérale. Cette moyenne continue d’être la tendance depuis leur création.
Contexte - Unités d’intervention structurée
Les unités d’intervention structurée (UIS) permettent aux détenus d’être séparés de la population carcérale régulière, tout en maintenant leur accès aux programmes de réhabilitation et aux interventions. Les détenus dans les UIS :
- ont accès à des interventions et à des programmes visant à répondre aux besoins ayant mené à leur transfèrement;
- ont la possibilité de passer au moins quatre heures par jour à l’extérieur de leur cellule, en plus du temps consacré à la douche;
- ont la possibilité d’interagir avec les autres pendant au moins deux heures par jour;
- reçoivent des visites quotidiennes de professionnels de la santé qui peuvent recommander, pour des raisons de santé, de modifier les conditions de confinement du détenu ou de ne pas le laisser dans l’unité.
Les UIS sont utilisées pour loger les détenus qui ne peuvent être gérés de façon sécuritaire dans une population carcérale régulière. Un détenu peut être transféré vers une UIS s’il met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, s’il met en danger sa propre sécurité ou que sa présence au sein de la population régulière nuit au déroulement d’une enquête et qu’il n’existe aucune autre solution valable.
Les détenus dans les UIS ont la possibilité de participer à des interventions structurées, à des passe-temps, à des activités de loisirs et à des activités physiques, ainsi qu’à des programmes fondés sur la recherche pour gérer leurs risques et répondre à leurs besoins particuliers, dans le but de faciliter leur réintégration au sein d’une population carcérale régulière dès que possible. On s’attend à ce que les UIS améliorent les résultats correctionnels et contribuent à réduire le taux d’incidents violents dans les établissements, ce qui se traduira par un environnement plus sûr pour le personnel, les délinquants et les visiteurs.
Les visites, la mobilisation d’organismes partenaires, des Aînés, des dirigeants culturels et spirituels et les possibilités d’interaction entre détenus constituent des moyens d’offrir des contacts humains réels. Lorsque les visites sont interdites en raison des mesures prises pour réduire la propagation de la COVID-19, des solutions de rechange comme les visites par vidéoconférence sont offertes.
L’ouverture des UIS dans les établissements pour hommes s’est faite de manière graduelle et progressive; les dix premières UIS ont ouvert le 30 novembre 2019. Les UIS dans les cinq établissements pour femmes ont ouvert le 30 novembre 2019. Le SCC examine actuellement les ressources affectées à chaque UIS pour déterminer si elles répondent aux besoins opérationnels.
Comité consultatif sur la mise en œuvre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a mis sur pied le Comité consultatif sur la mise en œuvre des UIS en 2019, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à assurer une reddition de comptes et une transparence quant à la mise en œuvre des UIS. Le Comité, qui est composé de huit membres, a été chargé d’aider à surveiller et à évaluer la mise en œuvre des UIS instaurées suivant l’adoption du projet de loi C-83 par le Parlement en juin 2019. Le nouveau modèle des UIS prévoit des exigences minimales pour le temps passé à l’extérieur de la cellule et les interactions humaines significatives et est soumis à un examen externe indépendant
L’objectif du Comité consistait à formuler des recommandations et des conseils non exécutoires à la commissaire du SCC et à faire part au ministre de ses opinions sur la question de savoir si les UIS sont mises en œuvre comme prévu par la loi
Décideurs externes indépendants
Les décideurs externes indépendants (DEI) assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les UIS, ainsi que de la fréquence de leurs placements dans une UIS, et examinent leurs dossiers.
Au 28 février 2021, les DEI avaient réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les DEI ont conclu que le SCC avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les DEI ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un DEI est reçue, le SCC dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les DEI étaient satisfaits des mesures prises par le SCC.
Cette surveillance externe contribue à l’amélioration continue et au façonnage des UIS.
Unités d’intervention structurée - Services technologiques
Le SCC se sert d’une application technologique pour procéder à la collecte de données sur les UIS afin de faciliter la production de rapports sur le rendement destinés aux dirigeants des établissements et aux cadres supérieurs.
Le projet « Évolution à long terme - UIS » a permis de créer une application moderne pour assurer la gestion des délinquants dans les UIS. Cette application recueille de l’information critique sur les interactions quotidiennes entre les employés et les délinquants, indiquant notamment l’état des interactions des détenus en temps quasi réel; les durées nettes et totales des séjours dans une UIS; le temps passé à l’extérieur de la cellule; les programmes et les interventions offerts; les périodes de loisirs; les visites effectuées par le personnel correctionnel et d’intervention; les examens menés par les Services de santé; et les survols de la direction.
Les renseignements sur les interactions avec les détenus, les aiguillages vers des programmes et les décisions sont aussi saisis pour veiller au respect des politiques et des lois connexes.
Employés accusés d’agression sexuelle
Points à souligner :
- Le SCC ne tolère aucune forme de violence dans le système correctionnel fédéral. La sécurité des personnes au sein de nos établissements est une priorité absolue et aucune personne logée ou travaillant dans ces établissements ne devrait craindre pour sa sécurité.
- Lorsqu’un délinquant présente une allégation d’agression sexuelle, le personnel des Services de santé de l’établissement rencontre immédiatement le délinquant et lui offre toute intervention médicale requise, y compris des services de soutien en santé mentale et physique, le cas échéant.
- Tous nos employés ont droit à l’application régulière de la loi, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor.
- Nous assurons un suivi et une surveillance de tous les cas d’inconduite d’employés et de coercition et de violence sexuelles à l’égard de détenus. Ces données permettront d’orienter l’élaboration de stratégies fondées sur des données probantes afin de mieux prévenir la coercition et la violence sexuelles, particulièrement pour les personnes qui pourraient être plus vulnérables.
- En cas d’inconduite donnant lieu à des accusations criminelles, nous coopérons pleinement avec nos partenaires policiers dans le cadre de leur enquête.
- Nous signalons immédiatement au service de police ayant compétence tout incident ou toute allégation d’inconduite pouvant constituer une infraction criminelle.
- Nous sommes en train d’élaborer une politique distincte; toutefois, un certain nombre de nos politiques renferment diverses exigences liées à la coercition et à la violence sexuelles. Un rapport provisoire sera disponible ce printemps.
- La sécurité des établissements correctionnels fédéraux, du personnel, des victimes et du public est une priorité absolue pour le Service correctionnel du Canada.
Contexte - Employés accusés d’agression sexuelle
Les employés du SCC sont tenus de respecter les Règles de conduite professionnelle. On s’attend aussi à ce que chacun des employés du Service connaisse et respecte les lois, les règlements et les politiques auxquels est assujetti le personnel du SCC, ainsi que les instructions et les directives du Service. Source :
Le SCC évalue chaque incident d’inconduite d’employés au cas par cas. Les mesures disciplinaires prises peuvent varier d’une réprimande verbale au licenciement. Pour des raisons de confidentialité, le SCC ne peut formuler de commentaires concernant les circonstances ou les détails d’un cas particulier. En cas d’inconduite menant à des accusations au criminel, le SCC collabore entièrement avec ses partenaires des services de police dans leurs enquêtes.
Mauvais traitements à l’endroit des délinquants
Tous les membres du personnel du SCC ont l’obligation de signaler toute situation où ils croient qu’un délinquant fait l’objet de mauvais traitements, de harcèlement ou de discrimination de la part d’un membre du personnel. Le SCC doit résoudre les situations de mauvais traitements, de harcèlement ou de discrimination portées à son attention, qu’une plainte ou un grief ait été déposé ou non, et prendre immédiatement des mesures correctives appropriées. Dès qu’il est mis au courant de telles allégations, le SCC prendra les mesures nécessaires et évaluera la validité et la gravité des allégations en obtenant les détails précis du cas.
Mesures disciplinaires
Le SCC ne tolère pas le non-respect, par ses employés, des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline énoncés dans la Directive du commissaire 060 - Code de discipline. Toutes les allégations d’inconduite du personnel font l’objet d’une enquête approfondie de la part du SCC, et des mesures disciplinaires peuvent être prises, au besoin, conformément aux Lignes directrices concernant la discipline du gouvernement du Canada et à l’Instrument de délégation des pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines du Service. Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels empêchent la divulgation du nom et du titre de poste des employés touchés.
Coercition et violence sexuelles impliquant des détenus dans les établissements correctionnels
Le Rapport annuel 2019-2020 du Bureau de l’enquêteur correctionnel renferme quatre recommandations adressées au SCC et deux recommandations adressées au ministre de la Sécurité publique concernant la coercition et la violence sexuelles dans les établissements. L’enquêteur correctionnel recommande notamment au SCC d’élaborer une stratégie fondée sur des données probantes pour prévenir la coercition et la violence sexuelles, d’élaborer une directive du commissaire, d’offrir des programmes d’éducation, de sensibilisation et de formation sur la coercition et la violence sexuelles, ainsi que d’établir une alerte précise dans le SGD pour les auteurs de coercition et de violence sexuelles. Il recommande au ministre de la Sécurité publique d’ordonner au SCC de désigner des fonds en vue de la réalisation d’une étude indépendante nationale sur la prévalence de la coercition et de la violence sexuelles, de présenter un ensemble de mesures législatives à l’appui d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles et d’établir un mécanisme de production de rapports destinés au public.
L’adoption d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles est conforme à la politique du SCC et essentielle à ses activités. La priorité du SCC est de protéger la santé physique et mentale et la sécurité générale des personnes qui sont incarcérées et qui travaillent dans les établissements correctionnels fédéraux. Le SCC est d’accord avec le BEC et convient qu’il est important de mieux comprendre la question de la coercition et de la violence sexuelles au Canada.
Le SCC a mis en place un cadre pour établir des milieux correctionnels sécuritaires, lequel favorise l’efficacité des opérations et des interventions correctionnelles au moyen des pratiques de sécurité active, contribuant ainsi à la sécurité du public, du personnel et des délinquants (Directive du commissaire [DC] 566 - Cadre pour des milieux correctionnels sécuritaires et efficaces). Plus précisément, tous les membres du personnel qui interagissent directement avec les délinquants doivent adopter des pratiques de sécurité active lorsqu’ils assument leurs fonctions. Ils doivent notamment approfondir constamment leurs connaissances des activités et des comportements (tant positifs que négatifs) des délinquants au moyen de l’observation directe et d’interactions. Le SCC favorise l’utilisation de pratiques de sécurité active en vue de prévenir les incidents de sécurité, y compris les incidents de coercition et de violence sexuelles. Les cas de violence sexuelle, lorsqu’ils sont rapportés au personnel, doivent immédiatement être signalés et faire l’objet d’une enquête. De plus, le numéro de téléphone du Bureau de l’enquêteur correctionnel est programmé dans le compte téléphonique des détenus afin de leur permettre de téléphoner au Bureau en toute confidentialité pour lui demander de l’aide dans ces affaires.
Dans le cas d’une agression sexuelle ou d’une allégation d’agression sexuelle, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, doit aviser le service de police ayant compétence principale, conformément à la DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves. En outre, tout membre du personnel qui est informé d’une agression sexuelle doit la signaler conformément à la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité. Les agressions sexuelles doivent aussi faire l’objet d’un Rapport de situation du directeur de l’établissement conformément à la DC 041 - Enquêtes sur les incidents. La rédaction d’un rapport du directeur de l’établissement nécessite que l’établissement recueille tous les faits pertinents concernant l’agression/allégation.
Une étude sur la coercition et la violence sexuelles sera menée, sous la direction de Sécurité publique, par des experts externes entièrement indépendants. L’étude permettra de recueillir de l’information qui contribuera à éclairer les politiques et les pratiques correctionnelles en matière de lutte contre la violence sexuelle dans les établissements fédéraux. La recherche permettra de recueillir de l’information et des données afin de cerner les lacunes en matière de connaissances. Elle se penchera sur les défis uniques auxquels doivent faire face les populations vulnérables, notamment les détenus ayant subi un traumatisme, les personnes LGBTQ2+, les femmes et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Un rapport provisoire sur les travaux entrepris devrait être rédigé d’ici le printemps 2021 et aidera à déterminer les prochaines mesures requises pour déceler, prévenir et régler les cas de violence sexuelle dans les établissements correctionnels.
En outre, compte tenu de la gravité de la question, le ministre de la Sécurité publique a accepté d’écrire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour lui demander d’envisager la réalisation d’une étude indépendante, accompagnée d’un rapport sur ses conclusions, sur la coercition et la violence sexuelles dans les établissements correctionnels fédéraux.
Décès en établissement
Points à souligner :
- LeService correctionnel du Canada prend très au sérieux le décèsde tout détenu. La perte d’une vie est toujours une tragédie.
- Commedans tous les cas de décès en établissement, on fait appel à lapolice et au coroner pour qu’ils fassent enquête sur le décès,et le coroner détermine la cause du décès.
- Noussommes tenus par la loi de fournir à chaque détenu sousresponsabilité fédérale des soins de santé essentiels ainsiqu’un accès raisonnable aux soins de santé non essentiels,conformément aux normes professionnelles.
- Jepeux confirmer que lorsqu’un détenu nouvellement admis arrive àun établissement, il fait l’objet d’une évaluation initialemenée par un professionnel de la santé agréé afin de déterminerses besoins en santé immédiats et à long terme.
- La Loi sur la protection des renseignements personnels ne mepermet pas de commenter des cas particuliers, mais je peux dire quetous les protocoles ont été respectés et que lorsqu’un détenunouvellement admis arrive à un établissement, il fait l’objetd’une évaluation initiale menée par un professionnel de la santéagréé afin de déterminer ses besoins en santé immédiats et àlong terme.
Contexte :
Au moment de son décès, Dwayne Simard purgeait une peine de deux ans, huit mois et 15 jours pour voies de fait graves. M. Simard avait été réincarcéré après son arrestation le 27 février pour avoir enfreint certaines conditions de la libération conditionnelle qu’il s’était vu octroyer à la suite d’une peine antérieure.
Le 1er mars 2021, Dwayne Simard, incarcéré à l’Établissement de Stony Mountain, un pénitencier à niveaux de sécurité multiples situé dans la région des Prairies, est décédé alors qu’il se trouvait sous la garde du SCC.
Décès en établissement
Le SCC doit s’acquitter de responsabilités légales bien définies lorsqu’un détenu décède en établissement. En cas de décès en établissement, le SCC doit en aviser les personnes suivantes dans les plus brefs délais, peu importe la cause du décès :
- la police;
- les administrations régionale et centrale du SCC;
- le coroner ou le médecin légiste ayant compétence dans la région oùse trouve le pénitencier, y compris lorsque le décès survient àl’extérieur du pénitencier (p. ex., dans un hôpitalcommunautaire);
- la personne locale chargée d’annoncer le décès, qui appelleraensuite rapidement la personne à contacter en cas d’urgence ou leplus proche parent du détenu, dans la mesure du possible;
- le Bureau régional des services aux victimes;
- l’administrateur régional, Communications et Services à la haute direction.
Enquêtes
Des dispositions législatives et des politiques régissent les examens et les enquêtes menés par le SCC sur les décès en établissement, ainsi que les enquêtes sur d’autres incidents impliquant des délinquants.
Une enquête est ordonnée en cas de décès ou de blessures graves d’un détenu. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le niveau d’enquête qu’il convient d’ordonner (niveau I, niveau II, enquête locale, examen du dossier), notamment :
- le niveau de violence et la gravité des blessures infligées;
- le profil du ou des délinquants en cause;
- l’incidence possible sur la capacité du SCC de mettre en œuvre des programmes;
- l’intérêt public;
- la fréquence à laquelle des incidents semblables se sont produits par le passé;
- la répétition d’incidents semblables dans une unité opérationnelle particulière ou impliquant un délinquant en particulier.
À la suite du décès en établissement d’un détenu sous responsabilité fédérale, le commissaire convoque un comité d’enquête nationale (dans le cas d’un décès de causes non naturelles) ou ordonne la tenue d’un examen du cas de décès (dans le cas d’un décès de causes naturelles) en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le sous-commissaire principal, en consultation avec le directeur général, Enquêtes sur les incidents, déterminera quelles dispositions seront appliquées et quel type de processus d’enquête sera utilisé. Dans le cas dont il est question, le SCC mènera une enquête de niveau I, ce qui signifie qu’un membre de la collectivité siégera au comité d’enquête.
Lorsqu’un incident se produit en établissement ou dans la collectivité, le commissaire, le directeur général, Enquêtes sur les incidents, le directeur de l’établissement ou le directeur de district peut ordonner la tenue d’une enquête ou d’un examen du dossier. Une enquête sur un incident vise à :
- examiner toutes les circonstances entourant l’incident et à produire un rapport à cet égard;
- fournir des renseignements aux responsables du SCC afin qu’ils puissent prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter que des incidents semblables se reproduisent;
- en apprendre sur les pratiques exemplaires et à les communiquer;
- à faire des constatations et à formuler des recommandations, au besoin.
Processus d’admission
Au cours du processus d’admission, les délinquants sont soumis à une évaluation des besoins en santé et à une vérification des besoins immédiats en matière de soins de santé mentale, clinique et/ou publique. Un agent correctionnel effectue une entrevue sur les besoins immédiats en santé mentale et un membre du personnel infirmier chargé des soins de santé physique effectue une évaluation préliminaire de l’état de santé dans les 24 heures suivant l’admission à l’établissement. Le Service correctionnel du Canada est tenu d’offrir des services de santé d’urgence aux détenus en tout temps. Les services sont assurés par des membres du personnel disponibles sur place ou sur appel, par d’autres établissements ou dans la collectivité.
À leur arrivée à un établissement, les détenus nouvellement admis sont soumis à une évaluation à l’admission effectuée par un professionnel de la santé agréé afin que l’on puisse déterminer leurs besoins immédiats et à long terme en matière de santé. Ils sont soumis au triage en vue de recevoir des soins de santé en fonction du caractère urgent de leurs besoins.
La politique du SCC stipule qu’un détenu présentant des besoins urgents à son admission fera l’objet d’une évaluation par un membre du personnel infirmier; ce dernier communiquera avec le médecin de service afin qu’une décision soit prise concernant l’initiation d’un traitement de façon urgente, au besoin.
Programme de vaccination contre la COVID-19
Points à souligner :
- La santé et la sécurité du personnel, des détenus et du public sont notre priorité absolue pendant cette période sans précédent.
- Nous sommes tenus par la loi de fournir des soins de santé essentiels à environ 18 000 détenus dans les établissements correctionnels à l’échelle du pays.
- Nous avons collaboré étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus.
- Notre stratégie de vaccination est conforme aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et appuie l’attribution, la distribution et l’administration en temps utile des vaccins aux personnes sous responsabilité fédérale, et ce, de la façon la plus efficace, sécuritaire et équitable possible.
- Dans le cadre de la première phase de vaccination et selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation, un vaccin a été offert à environ 600 délinquants âgés et médicalement vulnérables sous responsabilité fédérale.
- Au 12 mars 2021, 1 200 doses du vaccin de Moderna avaient été utilisées pour vacciner des détenus dans les pénitenciers fédéraux.
- Le SCC prévoit entamer la deuxième phase de vaccination le mois prochain, en avril. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels.
- Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.
Contexte - Programme de vaccination contre la COVID-19
Le 8 janvier 2021, le Service correctionnel du Canada a commencé à vacciner les détenus contre la COVID-19 conformément aux lignes directrices établies par le Comité consultatif national de l’immunisation. Des cliniques ont été organisées par le personnel médical afin de garantir que les détenus âgés et médicalement vulnérables puissent avoir accès au vaccin. Dans certains cas et lorsque cela est jugé sécuritaire, les établissements qui ont un ou quelques détenus âgés considérés prioritaires pourront les envoyer se faire vacciner dans un établissement à proximité.
Le 12 mars, le SCC a terminé la première phase de vaccination contre la COVID-19. Dans le cadre de la phase I, des détenus ont été vaccinés dans les établissements suivants :
- Région de l’Atlantique : Pénitencier de Dorchester, Établissement de Springhill et Centre de rétablissement Shepody
- Région du Québec : Centre régional de réception, Établissement de La Macaza, Centre fédéral de formation, Établissement de Cowansville, Établissement Drummond et Établissement Archambault
- Région de l’Ontario : Établissement de Bath, Centre régional de traitement (Établissement de Bath), Établissement de Beaver Creek, Établissement de Collins Bay, Établissement pour femmes Grand Valley, Établissement de Joyceville, Établissement de Millhaven, Centre régional de traitement (Établissement de Millhaven) et Établissement de Warkworth
- Région des Prairies : Établissement de Drumheller, Pénitencier de la Saskatchewan, Établissement de Bowden, Centre psychiatrique régional et Établissement de Stony Mountain
- Région du Pacifique : Établissement de Kent, Établissement William Head, Établissement de Matsqui, Établissement de Mission, Village de guérison Kwìkwèxwelhp, Établissement de la vallée du Fraser, Établissement Mountain et Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement
Approvisionnement
Le SCC a reçu des doses du vaccin de Moderna, lui permettant ainsi de commencer à vacciner les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical en janvier 2021. Le SCC s’attend à recevoir plus de doses de Santé Canada à mesure qu’elles sont disponibles et continuera à vacciner les détenus au cours des prochains mois. Le SCC dispose des fournitures nécessaires pour administrer le vaccin de Moderna, y compris les seringues et les tampons à l’alcool, lesquels proviennent de la réserve nationale de l’Agence de la santé publique du Canada. Le SCC possède des congélateurs surveillés (-20 °C) pour l’entreposage des doses des vaccins contre la COVID-19 dans ses pharmacies régionales. Des doses seront expédiées aux unités de soins de santé selon les besoins.
Phase I
Le SCC a mis en place un processus intégré de gestion du risque dans le cadre duquel des décisions opérationnelles sont régulièrement prises en étroite collaboration avec les autorités de santé publique, les syndicats, les Aînés et les intervenants afin de prévenir et de limiter la propagation de la COVID-19. Le SCC s’attend à vacciner environ 600 détenus dans le cadre de la phase 1. D’autres détenus pourront être vaccinés contre la COVID-19 au cours de phases ultérieures, à mesure que des doses seront reçues et selon les orientations du CCNI en matière de vaccination prioritaire. D’autres vaccins devraient être distribués tout au long de l’année.
Le SCC a mis en place une stratégie de vaccination qui cadre avec l’approche adoptée par le gouvernement du Canada, laquelle est fondée sur les recommandations et l’orientation du Comité consultatif national de l’immunisation. L’approche du SCC est conforme à celle adoptée lors de situations de santé publique antérieures, comme celle du H1N1, où un processus semblable a été suivi.
Le SCC est tenu d’offrir la vaccination aux personnes incarcérées dans les établissements correctionnels fédéraux. Conformément aux orientations du Comité consultatif national de l’immunisation, les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical ont eu la chance d’être vaccinés au cours de la phase I. Par la suite, le SCC entend offrir la vaccination contre la COVID-19 à tous les détenus sous responsabilité fédérale d’ici la fin de l’année 2021. Les délinquants dans la collectivité pourront être vaccinés par les autorités sanitaires provinciales et territoriales.
Mesures liées à la COVID-19 dans les services correctionnels fédéraux
Points à souligner :
- Le Service correctionnel du Canada est déterminé à assurer la santé et la sécurité de son personnel, des détenus et du public durant cette période sans précédent.
- Depuis le début de la pandémie, le Service correctionnel du Canada a mis en place une approche exhaustive et coordonnée pour limiter le risque lié à la COVID-19, tout en respectant l’orientation établie par l’Agence de la santé publique du Canada.
- De vastes mesures de prévention et de contrôle des infections sont en place dans les établissements correctionnels.
- Une vérification active est effectuée à chaque établissement, les détenus de même que les membres du personnel doivent porter un masque, pratiquer l’éloignement physique et se laver/désinfecter les mains souvent, et on procède à un nettoyage et à une désinfection accrus et fréquents des installations. De plus, le Service travaille en collaboration étroite avec les experts de la santé publique et la Croix-Rouge canadienne afin de veiller à ce que sa réponse soit conforme aux plus récentes données scientifiques et probantes.
- Dans les milieux où il y a des éclosions et où les taux de transmission communautaire sont plus élevés, des mesures opérationnelles accrues sont en place. Nous avons notamment limité les allées et venues au sein des établissements, suspendu les visites et modifié les horaires et les déplacements afin de prévenir une possible propagation du virus.
- Au 21 mars 2021, on recensait 15 cas actifs de COVID-19 parmi les détenus.
- Les détenus déclarés positifs sont placés en isolement médical et sont surveillés de près.
- Le Service a terminé sa première phase de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre de laquelle il a vacciné les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical, conformément aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation.
- Le Service correctionnel du Canada collabore étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les autorités locales de santé publique et tous ses partenaires syndicaux et intervenants.
- Ces précautions sont prises en réponse aux situations où l’on signale une transmission de la COVID-19 dans la collectivité, y compris parmi les membres du personnel.
- Au 19 mars 2021, on recensait 22 cas actifs de COVID-19 parmi les employés.
- Lorsqu’un employé présente des symptômes ou est déclaré positif à la COVID-19, il doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il obtienne l’autorisation médicale de retourner au travail. Nous procédons immédiatement à la recherche des contacts pour s’assurer que les personnes ayant été en contact étroit s’isolent à la maison et effectuons d’autres tests de dépistage, au besoin.
- Le personnel de première ligne est également un groupe prioritaire aux fins de la vaccination. Les travailleurs de la santé et d’autres membres du personnel de première ligne travaillent dans des milieux où le risque est élevé. Comme à l’habitude, ces employés seront vaccinés dans leur province ou territoire de résidence en fonction de l’orientation établie par le Comité consultatif national de l’immunisation en matière de priorisation.
- Le Service correctionnel du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces afin d’identifier les membres du personnel des soins de santé et les travailleurs de première ligne qui devraient recevoir le vaccin en priorité. Certains travailleurs de la santé ont déjà été vaccinés et le Service continuera de suivre la situation de près.
Contexte - Mesures liées à la COVID-19 dans les services correctionnels fédéraux
Le SCC a mis en place un certain nombre de mesures pour protéger le personnel et la population carcérale contre la COVID-19.
Mesures en place
Cas parmi les détenus
Dans la région des Prairies, l’Établissement de Drumheller (sécurité moyenne) recense 13 cas et le Pénitencier de la Saskatchewan (sécurité moyenne) en recense un. Dans la région de l’Ontario, l’Établissement de Millhaven (sécurité maximale) en recense un. À ce jour, cinq décès liés à la COVID-19 ont été signalés dans les établissements fédéraux.
Équipement de protection individuelle
Le SCC continue de prendre des mesures exceptionnelles pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans tous ses établissements afin de limiter le risque pour les détenus et le personnel, ce qui comprend le port de masques par tous au sein des établissements. De l’équipement de protection individuelle additionnel est mis à la disposition des employés qui en ont besoin, y compris le personnel des soins de santé.
Vaccination
Le 8 janvier 2021, le SCC a commencé à vacciner les détenus contre la COVID-19 conformément aux lignes directrices établies par le Comité consultatif national de l’immunisation. Des cliniques ont été organisées par le personnel médical afin de garantir que les détenus âgés et médicalement vulnérables puissent avoir accès au vaccin.
Le 12 mars, le SCC a terminé la première phase de vaccination contre la COVID-19. Dans le cadre de la phase I, des détenus ont été vaccinés dans les établissements suivants :
- Région de l’Atlantique : Pénitencier de Dorchester, Établissement de Springhill et Centre de rétablissement Shepody
- Région du Québec : Centre régional de réception, Établissement de La Macaza, Centre fédéral de formation, Établissement de Cowansville, Établissement Drummond et Établissement Archambault
- Région de l’Ontario : Établissement de Bath, Établissement de Beaver Creek, Établissement de Collins Bay, Établissement pour femmes Grand Valley, Établissement de Joyceville, Établissement de Millhaven, Centre régional de traitement (Établissement de Millhaven et Établissement de Bath) et Établissement de Warkworth
- Région des Prairies : Établissement de Drumheller, Pénitencier de la Saskatchewan, Établissement de Bowden, Centre psychiatrique régional et Établissement de Stony Mountain
- Région du Pacifique : Établissement de Kent, Établissement William Head, Établissement de Matsqui, Établissement de Mission, Village de guérison Kwìkwèxwelhp, Établissement de la vallée du Fraser, Établissement Mountain et Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement
Le SCC prévoit être en mesure de procéder à la deuxième phase de vaccination au printemps. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels. Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.
Suspension des visites dans les établissements
Le SCC surveillera la situation de près à mesure qu’elle évoluera et adaptera son approche en consultation avec ses partenaires de la santé publique à l’échelle du pays. Dès que l’on signalera un cas de transmission dans une unité opérationnelle, les employés non essentiels et les visiteurs ne seront plus autorisés à y entrer jusqu’à ce que l’éclosion soit maîtrisée. La liste des établissements touchés par des fermetures se trouve ici.
L’accès des visiteurs aux établissements sera restreint s’ils visitent un établissement dans une région où le risque est identifié comme étant modéré à élevé selon le Cadre national de gestion du risque associé à la COVID-19 du SCC ou lorsque des restrictions liées aux déplacements interprovinciaux et intraprovinciaux s’appliquent.
Les délinquants continueront de participer aux programmes et aux activités sur place qui favorisent leur réadaptation. Les services de santé continueront d’être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Les délinquants sont encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence.
Visites par vidéoconférence
Depuis le début de la pandémie, le SCC a installé, partout au pays, des bornes supplémentaires pour les visites par vidéoconférence. De plus, le SCC a prolongé les heures auxquelles les visites par vidéoconférence sont disponibles à plusieurs unités opérationnelles et a augmenté la bande passante pour soutenir le recours à la vidéoconférence.
En plus d’avoir accès à des appels téléphoniques, les détenus peuvent communiquer avec leurs visiteurs par vidéoconférence directe, au moyen de la technologie virtuelle d’un ordinateur de l’établissement, ce qui leur permet de développer et de maintenir des liens familiaux et communautaires lorsque des visites en personne ne peuvent avoir lieu.
Avant la pandémie de COVID-19, 57 bornes pour les visites par vidéoconférence étaient accessibles aux détenus dans les établissements du SCC. Depuis, ce nombre a augmenté de 78 %, puisque 102 bornes sont maintenant accessibles. En moyenne, 223 séances de visite par vidéoconférence ont été tenues chaque jour dans les établissements du SCC à l’échelle du pays, ce qui représente une augmentation importante comparativement à la moyenne de 41 séances tenues quotidiennement avant la pandémie.
Mise en liberté des délinquants
Alors qu’il participe pleinement à l’effort de santé publique pancanadien pour lutter contre la COVID-19, le SCC continue de remplir ses obligations en ce qui a trait aux soins et à la garde des détenus pour les préparer en vue de leur mise en liberté en toute sécurité dans la collectivité.
Le SCC et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) continuent de libérer des détenus admissibles conformément à la loi. Un certain nombre de facteurs sont pris en compte dans les décisions relatives à la mise en liberté, la sécurité publique étant le critère prépondérant. La COVID-19 et d’autres questions liées à la santé ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs pris en compte dans la mise en liberté de délinquants dans la collectivité.
Le SCC, en consultation avec la CLCC, s’est efforcé de rationaliser le processus de préparation des dossiers des délinquants. De plus, la CLCC veille à ce que les cas soient traités le plus rapidement possible, en continuant de suivre un processus décisionnel fondé sur les risques et des données probantes.
Depuis le début du mois de mars 2020, la population carcérale fédérale a diminué de 1 531 détenus (en date du 14 mars 2021). Cette réduction est attribuable à une diminution des admissions en provenance des provinces et des territoires, combinée aux mises en liberté dans la collectivité. Nous prévoyons que cette tendance à la baisse au sein de la population carcérale fédérale se poursuivra au cours des prochains mois.
Le SCC mobilise continuellement ses partenaires de la collectivité pour veiller à ce que les délinquants mis en liberté sous condition bénéficient d’un environnement sûr, sécuritaire et positif à leur retour dans la collectivité. Il s’agit là d’un aspect important de toute réinsertion sociale sécuritaire et réussie.
Réduction du personnel en raison de l’isolement
Des membres du personnel à un certain nombre d’établissements du SCC ont été déclarés positifs à la COVID-19. Le SCC collabore avec les autorités de santé publique à la recherche des contacts afin de veiller à ce que les contacts étroits s’isolent à la maison et qu’un dépistage additionnel soit réalisé, au besoin.
Le SCC évalue régulièrement les décisions opérationnelles prises concernant les horaires et les activités lorsqu’il examine les niveaux de dotation. Les niveaux de dotation sont surveillés et évalués quotidiennement, puis ils sont ajustés au besoin. Les membres du personnel sur place font preuve de souplesse et certains ont fait des heures prolongées pour répondre aux exigences opérationnelles afin d’assurer la gestion des établissements.
Programmes offerts pendant la pandémie de COVID-19
En juillet 2020, le SCC a repris la prestation des programmes correctionnels en groupe dans ses établissements. Un cadre intégré de gestion du risque a été élaboré en collaboration avec des experts en santé publique. Ce cadre décrit différentes catégories de risque et des stratégies d’atténuation associées à chaque activité opérationnelle visant à protéger le personnel, les délinquants et le public. Si, à tout moment, les risques associés à une activité changent, le cadre intégré de gestion du risque définit les mesures à prendre en réponse à ce changement.
La participation aux programmes demeure un élément essentiel de la réinsertion sociale. Le SCC s’emploie à relever les défis engendrés par la pandémie de COVID-19 tout en reprenant la prestation des programmes dans le respect des nouvelles mesures de santé et de sécurité en place. Le SCC a accordé un accès prioritaire aux programmes aux délinquants à risque élevé et à ceux dont la mise en liberté approche. Compte tenu des réalités opérationnelles et en matière de santé publique, le SCC a favorisé le recours à des méthodes différentes pour la prestation des programmes, comme la vidéoconférence. Le SCC offre également des programmes dans la collectivité. Les délinquants qui n’ont pas terminé de programmes en établissement peuvent participer à des programmes/programmes de maintien des acquis dans la collectivité.
Outils d’évaluation du risque - Autochtones
Points à souligner :
- Le Service correctionnel du Canada reconnaît que les peuples autochtones, les Canadiens noirs et les autres personnes racialisées sont bien trop souvent victimes de racisme systémique et obtiennent des résultats disparates au sein du système de justice pénale.
- Nous travaillons sans relâche à éliminer les obstacles systémiques dans les établissements correctionnels fédéraux et veillons à ce que tous les détenus aient accès à des programmes et à des évaluations appropriés et efficaces.
- Pour veiller à ce que les décisions liées à l’évaluation du risque que présentent les délinquants soient efficaces et appropriées, le Service mène actuellement des consultations à l’égard de ses outils d’évaluation pour déterminer s’ils doivent être revus.
- À l’heure actuelle, le personnel chargé d’évaluer le niveau de sécurité des détenus reçoit une formation exhaustive sur la manière de prendre en compte leurs besoins ethniques, culturels, religieux et/ou linguistiques.
- Le personnel reçoit aussi une formation obligatoire sur les préjugés inconscients et la sensibilisation aux réalités culturelles. De plus, des ressources lui sont fournies pour veiller à ce que les évaluations tiennent compte du profil des délinquants.
- Une trousse de ressources pour les délinquants ethnoculturels est également mise à la disposition du personnel pour l’aider à répondre aux besoins des délinquants ethnoculturels, y compris des délinquants noirs et autochtones.
- Le Service correctionnel du Canada est déterminé à en faire plus pour créer un environnement favorisant l’inclusion, l’équité et la diversité - et un environnement où l’on s’engage à effectuer une autoréflexion, à prendre des mesures et à veiller à l’amélioration continue.
- Ils effectuent des recherches, en collaboration avec les universités et d’autres partenaires universitaires, afin de mieux comprendre l’expérience vécue par les délinquants ethnoculturels.
- Ils travaillent aussi en étroite collaboration avec le Comité consultatif national sur les questions autochtones afin de discuter d’idées et de mesures se rapportant aux délinquants autochtones, notamment l’examen des obstacles auxquels sont confrontées diverses communautés au sein du système de justice pénale.
Contexte - Outils d’évaluation du risque - Autochtones
Tous les délinquants admis dans un établissement correctionnel fédéral sont soumis à une évaluation afin de s’assurer qu’ils sont placés au niveau de sécurité approprié et qu’ils reçoivent les programmes et les services requis pour répondre à leurs besoins particuliers. L’évaluation de la cote de sécurité d’un délinquant est réalisée conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( RSCMLC).
L’approche adoptée par le SCC en vue de l’évaluation initiale et de la réévaluation de la cote de sécurité mise sur l’utilisation d’instruments d’évaluation fondée sur des données probantes, comme l’Échelle de classement initial par niveau de sécurité, l’Échelle de réévaluation du niveau de sécurité et l’Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes, qui sont combinés à l’exercice d’un jugement professionnel par des employés spécialisés et à la réalisation d’évaluations psychologiques, le cas échéant. Conformément à l’article 18 du RSCMLC, le SCC doit considérer les trois facteurs suivants pour déterminer la cote de sécurité d’un délinquant : l’adaptation à l’établissement; le risque d’évasion; et le risque pour le public en cas d’évasion. La cote de sécurité d’un délinquant est réévaluée régulièrement tout au long de sa peine, y compris après la réussite d’un programme, pour veiller à ce qu’il continue d’être placé au niveau de sécurité approprié.
Formation du personnel
Étant donné l’importance d’évaluer soigneusement les besoins uniques de chaque délinquant, y compris les facteurs sociaux et culturels qui peuvent avoir une incidence sur la manière dont ils réagissent tout au long du processus correctionnel, le personnel chargé d’évaluer le niveau de sécurité d’un détenu reçoit une formation complète sur la manière de prendre en compte ses besoins ethniques, culturels, religieux et/ou linguistiques.
Tous les employés doivent suivre une formation obligatoire sur la diversité et la compétence culturelle dans le cadre de laquelle ils doivent démontrer une compréhension de la diversité inclusive pour tous; repérer les places individuelles de privilège et déterminer comment elles sont liées à leur travail au sein du SCC; et trouver des façons de mieux travailler dans une optique de diversité et de compétence culturelle auprès des délinquants, des employés, des visiteurs et du public.
Délinquants autochtones
Le SCC continue d’observer une augmentation du nombre de délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. À la fin de l’exercice 2019-2020, les délinquants autochtones représentaient 30 % du nombre total de délinquants incarcérés, et les délinquantes autochtones représentaient 44 % du nombre total de délinquantes incarcérées.
En 2018, en réponse au rapport publié en 2014 par le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) intitulé « La préparation des détenus autochtones à la mise en liberté », le SCC a précisé dans sa politique qu’une réévaluation de la cote de sécurité doit être effectuée dans les 30 jours suivant la réussite d’un programme principal par un détenu autochtone ayant une cote de sécurité maximale ou moyenne. De plus, une réévaluation de la cote de sécurité est effectuée au moins tous les six mois pour les détenus autochtones participant aux interventions préparatoires aux Sentiers autochtones/unités des Sentiers autochtones. Au cours des dernières années, le SCC a effectué plusieurs études sur certains de ces principaux outils de classement, et il mène, à l’heure actuelle, d’autres recherches connexes. Par exemple, le SCC collabore avec des partenaires universitaires afin de mener des consultations auprès des collectivités autochtones sur l’élaboration d’outils d’évaluation du risque pour les délinquants autochtones.
Le SCC s’emploie à contrer la représentation disproportionnelle des Autochtones dans les établissements carcéraux par une foule de programmes, notamment les suivants :
- le Plan national relatif aux Autochtones, qui renferme les conseils et les orientations du BVG et du Comité consultatif national sur les questions autochtones (CCNQA), est un cadre national visant à transformer le processus de gestion des cas et les services correctionnels destinés aux Autochtones. Le Plan comprend la rationalisation des ressources et des services existants destinés aux Autochtones pour que les délinquants qui choisissent d’accéder aux interventions du Continuum de soins pour les Autochtones se voient accorder la priorité pour le placement dans des établissements bien précis;
- les centres d’intervention pour Autochtones (CIA), qui sont un élément clé des plans d’action régionaux pour les Autochtones. Ils intègrent l’admission, les programmes et les interventions et mobilisent les collectivités autochtones au début de la peine purgée par un délinquant autochtone ou au moins deux ans avant sa première date d’admissibilité. Les CIA offrent des interventions centrées et ciblées en misant sur une gestion de cas spécialisée ainsi que le soutien et la coordination nécessaires en vue de préparer les délinquants autochtones qui purgent des peines moins longues à obtenir une libération conditionnelle plus tôt au cours de leur peine. Les CIA offrent aussi des interventions et des programmes correctionnels pour Autochtones dans le but de favoriser la préparation opportune à la libération conditionne des délinquants autochtones;
- le SCC a mis en place l’initiative des Sentiers autochtones destinée aux délinquants qui s’engagent à suivre un cheminement traditionnel de guérison intensive qui prévoit une participation active des Aînés. Le Continuum des Sentiers autochtones pour les femmes permet aux délinquantes autochtones de participer à des interventions de guérison intensives avec l’appui des Aînées lors d’activités spécifiques;
- les Programmes correctionnels pour délinquantes autochtones, qui incluent un continuum de programmes propres aux délinquantes autochtones;
- le SCC a élaboré et mis en œuvre des programmes correctionnels destinés aux Autochtones et aux Inuits.
Les décisions concernant la détermination de la peine échappent au contrôle du SCC. Le SCC peut toutefois exercer une influence sur la période de détention des délinquants autochtones en offrant des programmes et des interventions adaptés à leur culture pour éliminer le risque qu’ils représentent, fournir des programmes de réadaptation efficaces et favoriser leur réinsertion sociale. Il y a eu une augmentation importante du pourcentage de mises en liberté discrétionnaires chez les délinquants autochtones; ce taux est passé de 23,5 % en 2013-2014 à 40,1% en 2019-2020.
Délinquants de race noire
À la fin de l’exercice 2019-2020, 8,8 % des délinquants incarcérés étaient de race noire, alors que 7,1 % des délinquants sous surveillance dans la collectivité étaient de race noire. De 20152016 à 2019-2020, une baisse proportionnelle des délinquants incarcérés de race blanche de 17 % a été enregistrée, alors qu’une baisse des délinquants incarcérés de race noire de 3,2 % a été enregistrée.
Le SCC mène des recherches pour mieux comprendre l’expérience des délinquants ethnoculturels qui sont sous sa responsabilité, y compris les délinquants de race noire. Ce projet pluriannuel a déjà mis en évidence le profil et la diversité de cette population, et des résultats de recherche émergents ont été publiés en 2019. Le SCC examine actuellement certains aspects de l’expérience en milieu carcéral, y compris la participation aux programmes correctionnels, l’éducation et les emplois. Le SCC se penchera également sur la réinsertion sociale des délinquants ethnoculturels en ce qui a trait à la participation aux programmes, aux possibilités d’emploi et à l’atteinte de la fin de la peine. Le rapport de recherche complet devrait être disponible à l’automne 2021.
À l’heure actuelle, les délinquants noirs se voient offrir un ensemble varié de services et d’interventions visant à appuyer leur réinsertion sociale. Les initiatives mises de l’avant comprennent ce qui suit : répondre aux besoins en matière d’emploi et de mentorat d’une manière adaptée à la culture; offrir aux délinquants et au personnel des exposés adaptés à la culture présentés par des membres de la collectivité; se livrer à des activités de liaison avec la collectivité; offrir des interventions régulières effectuées par un agent de projet, Engagement communautaire et Services ethnoculturels; et offrir du matériel adapté à la culture. De plus, le SCC offre une formation obligatoire visant à accroître les compétences culturelles des employés.
Il n’existe aucun programme correctionnel adapté à la culture des délinquants noirs, mais leur taux de participation au Modèle de programme correctionnel intégré et aux Programmes correctionnels pour délinquantes et leur taux de réussite sont positifs. Certains établissements bénéficient également de la participation et des activités de groupes de détenus composés essentiellement de délinquants de race noire. Ces groupes, dont l’Association des détenus de race noire (BIFA), les groupes chrétiens, les groupes rastafariens et les groupes musulmans, veillent à la sensibilisation, à l’éducation et à la création d’un sentiment d’appartenance et d’estime de soi chez les délinquants noirs.
Délinquantes
En novembre 2019, l’Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes (ERNSD) a été modifiée pour refléter l’élimination de l’isolement et les placements dans une unité d’intervention structurée. La nouvelle ERNSD tient compte de différents indicateurs, comme le nombre de condamnations pour des infractions disciplinaires graves, le nombre d’incidents signalés, le niveau de rémunération, la motivation et les progrès dans le cadre de l’exécution du Plan correctionnel et le maintien de contacts positifs avec la famille.
En septembre 2019, la Direction de la recherche au SCC a évalué la fiabilité et le bien-fondé de la nouvelle ERNSD et déterminé que son utilisation demeure pertinente pour les délinquantes autochtones et non autochtones.
Incident survenu au Québec - Comité d’enquête nationale conjointe
Points à souligner :
- L’incident survenu au Québec le 22 janvier 2020 est une terrible tragédie qui n’aurait jamais dû se produire.
- Nos pensées continuent d’accompagner la famille et les amis de Madame Levesque en cette période de deuil.
- À la suite de cet incident, un comité d’enquête nationale conjointe a été convoqué par le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- Le comité d’enquête était coprésidé par deux membres de la collectivité indépendants du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui sont criminologues. Il avait comme objectif d’examiner les circonstances ayant mené à cet événement tragique.
- Le comité d’enquête a relevé un certain nombre de lacunes liées à la surveillance de ce délinquant. Le Service correctionnel du Canada est résolu à donner suite aux recommandations et prend des mesures concrètes pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.
- En réponse aux recommandations, le Service correctionnel du Canada modifie son modèle de surveillance directe au Québec; il renforce les politiques et les outils relatifs à la surveillance dans la collectivité et à la collecte et à la communication de renseignements, et il met en œuvre une nouvelle formation obligatoire sur la violence dans les relations intimes.
- Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada prennent ce rapport et ses recommandations très au sérieux, et ils continueront de travailler fort pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.
Contexte - Incident survenu au Québec
Eustachio Gallese, un délinquant sous responsabilité fédérale, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis le 16 décembre 2006. Il a été condamné pour le meurtre de sa femme. L’infraction à l’origine de la peine a été perpétrée le 21 octobre 2004. Il s’est vu octroyer sa première semi-liberté (SL) le 26 mars 2019. Le 19 septembre 2019, sa SL a été prolongée, et sa libération conditionnelle totale a été refusée. Le 23 janvier 2020, sa SL a été suspendue en raison de sa participation présumée à un autre meurtre. Il a été accusé et reconnu coupable de meurtre au premier degré, le 27 février 2020, à la suite du décès de Marylène Levesque. Le délinquant Gallese demeure sous responsabilité fédérale.
Recommandations du comité d’enquête nationale conjointe
Le comité d’enquête nationale conjointe du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) sur les circonstances entourant le meurtre de Marylène Levesque commis par le délinquant Eustachio Gallese a été convoqué le 3 février 2020. Il était composé de cinq membres possédant les compétences et l’expérience requises pour mener cette enquête, dont deux coprésidents externes indépendants du SCC et de la CLCC, qui sont criminologues. Ils ont mené des entrevues et examiné tous les documents et les faits entourant la mise en liberté et la surveillance du délinquant qui était en semi-liberté au moment où l’incident est survenu, puis ils ont présenté des conclusions et des recommandations portant sur les thèmes suivants : la collecte et la communication de renseignements, la surveillance dans la collectivité, la formation et le processus décisionnel de la CLCC.
Dans son rapport, le comité d’enquête a formulé cinq recommandations :
- Que le SCC révise la Directive du commissaire (DC) 705-2 - Collecte de renseignements afin de définir en quoi consiste une infraction grave et de préciser les documents requis, y compris les transcriptions des procès, comme documents sources pour les délinquants condamnés ayant des antécédents d’infractions avec violence.
- Que le SCC révise la DC 715-1 - Surveillance dans la collectivité afin d’y ajouter un mécanisme de contrôle de la qualité des contacts avec le réseau de tiers.
- Que le SCC intègre une formation axée sur la violence conjugale dans le cadre de la Formation initiale des agents de libération conditionnelle et que cette formation soit offerte pendant le Perfectionnement continu des agents de libération conditionnelle.
- Que le SCC élabore un instrument pour les conférences de cas comprenant des indicateurs minimaux à respecter.
- Que la composante de surveillance directe prévue par l’entente contractuelle soit retirée au Centre résidentiel communautaire (CRC) Maison Painchaud et remise au SCC, et que le SCC révise les modèles de services avec tous les autres CRC présentement responsables de la surveillance directe des délinquants.
Aucune recommandation n’a été formulée pour la CLCC. Toutefois, le comité d’enquête a constaté ce qui suit en ce qui a trait à la CLCC :
- Les commissaires ayant pris part aux décisions de mise en liberté les 26 mars 2019 et 19 septembre 2019 répondaient à toutes les exigences de formation de la CLCC et disposaient du niveau de connaissance nécessaire pour exécuter leurs tâches.
- Le plan de formation de la CLCC pour les nouveaux commissaires était complet et bien structuré.
- Les commissaires ont appliqué correctement les critères de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- Les commissaires ont bien appliqué le cadre d’évaluation du risque énoncé dans le Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires.
- La CLCC avait à sa disposition toutes les informations pertinentes disponibles permettant une prise de décision judicieuse.
- Bien que la décision écrite du 19 septembre n’ait pas reflété pleinement ce qui s’est produit à l’audience, cela n’a pas été identifié comme un facteur dans le décès de Madame Lévesque.
Fait important, il a été précisé dans le rapport que les commissaires avaient explicitement interdit au délinquant de fréquenter des salons de massage pour fins sexuelles.
Réponse du SCC aux recommandations du comité d’enquête
Le SCC a examiné et analysé attentivement les recommandations du comité d’enquête, puis les a acceptées dans le cadre de son engagement à faire tout en son pouvoir pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.
Le SCC prend les mesures suivantes pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport :
- Il modifie le modèle de surveillance directe au Québec. À l’heure actuelle, les centres résidentiels communautaires (CRC) offrent un logement et du soutien aux délinquants, et certains d’entre eux assurent également la surveillance directe d’un petit nombre de délinquants (155 sur 2 000) en liberté dans la collectivité au Québec. D’ici le 31 mars 2021, le SCC prendra en charge toutes les fonctions liées à la surveillance dans la collectivité incombant au CRC Maison Painchaud. De plus, le SCC examine tous les autres contrats au Québec dans le but de ramener, sous la responsabilité du Service, toutes les fonctions liées à la surveillance directe des délinquants sous responsabilité fédérale. Ces entrepreneurs continueront toutefois de loger des délinquants, comme c’est le cas ailleurs au pays. Le SCC apprécie ces partenariats, car ils sont essentiels en vue de favoriser la transition des délinquants des établissements à la collectivité.
- Il renforce les politiques et les outils relatifs à la surveillance dans la collectivité, ce qui permettra de veiller à ce que des éléments précis, dont les contacts avec des tiers (employeurs, membres de la famille, amis), fassent régulièrement l’objet de discussions lors des conférences de cas entre les agents de libération conditionnelle et leurs responsables pour aider à réévaluer continuellement le risque que présente un délinquant. Le SCC révise sa politique en matière de collecte de renseignements afin de définir clairement ce qui constitue une infraction grave aux fins de la collecte de renseignements, de préciser les types de documents qui sont requis et pertinents selon les antécédents de chaque délinquant et de mettre en œuvre un mécanisme de suivi officiel.
- Il met en œuvre une nouvelle formation obligatoire sur la violence dans les relations intimes qui deviendra une composante principale du Programme de perfectionnement continu des agents de libération conditionnelle. Elle sera obligatoire pour tous les agents de libération conditionnelle et leurs responsables afin qu’ils soient mieux outillés pour évaluer et gérer le risque que présentent les délinquants.
Maintenant que le comité d’enquête a terminé son rapport, le SCC a lancé des enquêtes disciplinaires, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, afin de déterminer si des mesures d’imputabilité additionnelles sont requises. Depuis l’incident, les employés qui ont participé directement à la surveillance et à la supervision de ce cas ont été réaffectés à d’autres tâches et n’assurent plus la surveillance de délinquants.
Enjeu médiatique actuel concernant Dannick Lessard
En octobre 2012, Ryan Wolfson a tiré neuf balles sur Dannick Lessard, ancien joueur de hockey, à l’extérieur d’un bar de la région de Mirabel, au Québec. Au moment de l’infraction, Ryan Wolfson était illégalement en liberté dans le cadre de sa libération d’office et il purgeait sa troisième peine de ressort fédéral pour introduction par effraction (5 chefs) et introduction par effraction avec intention de commettre une infraction (2 chefs). Dannick Lessard a intenté une action en justice, alléguant que le SCC et la CLCC n’ont pas protégé la sécurité du public en libérant Ryan Wolfson trop tôt, et a comparé son histoire à celle de Marylène Levesque, indiquant que les mêmes erreurs ont été commises. Dannick Lessard réclame maintenant au SCC la somme de 3,2 millions de dollars.
À la suite de l’infraction, Ryan Wolfson a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en octobre 2016, pour meurtre au premier degré (1 chef), tentative de meurtre (2 chefs) et possession d’une arme à feu (1 chef).
Cellules nues
Points à souligner :
Le Service correctionnel du Canada est résolu à offrir des services correctionnels sécuritaires, humains et efficaces aux délinquants du Canada.
- D’après la loi, le Service correctionnel du Canada doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit pour le placer en cellule nue.
- Les cellules nues sont l’un des nombreux outils utilisés pour prévenir l’introduction d’objets interdits dans les établissements.
- L’ingestion d’objets interdits peut avoir de graves conséquences sur la santé et la sécurité d’une personne. Les cellules nues permettent d’assurer une surveillance étroite des détenus afin de veiller à leur sécurité.
- Les placements en cellule nue sont limités à ce qui est raisonnablement nécessaire et à la période la plus courte possible. Le détenu reçoit de la literie, de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette adéquats. Le SCC fournit un accès raisonnable à des services d’aide médicale, psychologique et spirituelle, et un professionnel de la santé rend visite au détenu quotidiennement.
- Le Service examine la situation et envisagera, au besoin, des garanties et des mesures de surveillance additionnelles liées à l’utilisation de cellules nues.
Contexte - Cellules nues
Les cellules nues sont l’un des nombreux outils utilisés pour prévenir l’introduction d’objets interdits dans les établissements. L’ingestion d’objets interdits peut avoir de graves conséquences sur la santé et la sécurité d’une personne. Les cellules nues permettent d’assurer une surveillance étroite des détenus soupçonnés d’avoir dissimulé des objets interdits dans des cavités corporelles afin de veiller à leur sécurité.
Selon l’article 51 de la LSCMLC,le directeur de l’établissement peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré un objet interdit ou l’a dissimulé dans une cavité corporelle, autoriser par écrit le placement du détenu dans une cellule sans appareils sanitaires, avec avis en ce sens au personnel médical, jusqu’à l’expulsion de l’objet.
Procédures relatives à l’utilisation de cellules nues
Les procédures relatives à l’utilisation de cellules nues en place sont décrites dans la Directive du commissaire 566-7 ‒ Fouille des détenus. Elles prévoient la fouille de chaque selle par un agent correctionnel/intervenant de première ligne. Suivant l’expulsion possible d’un objet interdit, tout objet récupéré devra être traité en suivant les procédures énoncées dans la Directive du commissaire 568-5 ‒ Gestion des objets saisis.
Dès qu’un délinquant est placé dans une cellule nue, il se voit offrir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat. Pendant son placement en cellule nue, le détenu a de la literie, de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette adéquats. Le SCC fournit également un accès raisonnable à des services d’aide médicale, psychologique et spirituelle, et un professionnel de la santé rend visite au détenu quotidiennement. Des activités limitées sont autorisées pourvu qu’elles ne compromettent pas la récupération des objets interdits.
Aucune durée maximale n’est prescrite par la loi et la politique pour le placement en cellule nue, mais la politique exige que le directeur de l’établissement examine chaque placement tous les jours, comme il est stipulé à l’annexe E de la Directive du commissaire 566-7. Le délinquant peut présenter des observations écrites qui seront prises en compte dans le cadre de cet examen quotidien.
Améliorations relatives à l’utilisation des cellules nues
Au fil des ans, le SCC a apporté nombre d’améliorations aux exigences relatives aux cellules nues. On a présenté dans le cadre stratégique (Directive du commissaire no 5667 - Fouille des détenus) mis à jour en juin 2012 des exigences nationales pour les placements en cellules nues, qui comprenaient une supervision et une surveillance accrues. Les garanties procédurales énoncées dans la politique exigent que le directeur de l’établissement examine le placement tous les jours. Pour permettre qu’une personne autre que le directeur de l’établissement effectue la surveillance, il faut aviser le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, à l’administration régionale de tout placement de plus de 72 heures. Le SCC envisagera des garanties et des mesures de surveillance additionnelles liées à l’utilisation de cellules nues.
4. Faits et chiffres importants
Population des délinquants
À la fin de l’année civile 2020, le SCC gérait 21 996 délinquants, soit 12 588 en établissement et 9 408 sous surveillance dans la collectivité. Parmi les délinquants dans la collectivité, 17 % étaient en semi-liberté, 48 % étaient en liberté conditionnelle totale, 30 % étaient en liberté d’office et 5 % étaient visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.
(Source : Système intégré de rapports-modernisé - Entrepôt de données. Données à jour jusqu’au 2020-12-27.)
Milieu opérationnel
À l’échelle nationale, le SCC gère 43 établissements (6 établissements à sécurité maximale, 9 établissements à sécurité moyenne, 5 établissements à sécurité minimale, 12 établissements à niveaux de sécurité multiples et 11 établissements regroupés), 14 centres correctionnels communautaires et 92 bureaux de libération conditionnelle et bureaux secondaires. Le SCC est également responsable de la gestion de quatre pavillons de ressourcement (comptabilisés dans les 43 établissements) et travaille en partenariat avec les collectivités autochtones pour soutenir la réinsertion des délinquants autochtones dans leur collectivité.
Effectif du SCC
Le SCC compte environ 18 261 employés dans un grand nombre de secteurs. Au 21 janvier 2021, le personnel de première ligne du SCC comprenait :
- 6 308 agents correctionnels;
- 448 intervenants de première ligne;
- 1 252 agents de libération conditionnelle;
- 473 agents de programmes correctionnels;
- 122 agents de liaison autochtones;
- 101 agents de programmes correctionnels pour Autochtones;
- 122 agents de programmes sociaux;
- 893 membres du personnel infirmier;
- 227 membres du personnel de psychologie.
Résultats du SCC
Voici les résultats dans un certain nombre de secteurs différents à la fin de l’exercice 20192020 :
- Le SCC continue d’observer une baisse de la population carcérale fédérale globale, qui est passée de 14 886 personnes à la fin de l’exercice 2014-2015 à 13 720 en 2019-2020, soit une diminution de 8 %. Le SCC constate également une augmentation du nombre de délinquants gérés dans la collectivité, qui est passé de 8 075 à la fin de l’exercice 20142015 à 9 382 en 2019-2020. Cela représente une augmentation de 16 %.
- Le SCC constate une augmentation du nombre de délinquants bénéficiant d’une semiliberté au cours des six dernières années, passant de 1 975 en 2014-2015 à 2 542 en 2019-2020, soit une augmentation de 29 %. Par ailleurs, le nombre de délinquants en semiliberté a diminué au cours de l’année écoulée, passant de 2 683 en 2018-2019 à 2 542 en 2019-2020, soit une diminution de 5 %.
- Le SCC observe une diminution du nombre de révocations de la mise en liberté sous condition au cours des six dernières années, lequel est passé de 2 503 en 2014-2015 à 2 285 en 2019-2020, soit une diminution de 9 %. Toutefois, le nombre de révocations de la mise en liberté sous condition augmente depuis 2017-2018, où il est descendu à son plus bas niveau en six ans, soit 2 131.
- Le SCC constate également une diminution du nombre de révocations à la suite d’une infraction au cours des six dernières années, passant de 496 en 2014-2015 à 455 en 20192020, soit une diminution de 8 %. Le nombre de révocations à la suite d’une infraction a fluctué au cours des six dernières années; en 2016-2017, ce nombre a atteint son plus bas niveau, soit 412.
5. Rapports sommaires précédents de comités
22 février 2021 - SECU (projet de loi C-228, Loi établissant un cadre fédéral visant à réduire la récidive)
Rapport Sur La Réunion D’un Comité De La Chambre Des Communes
Nom du Comité :Comité permanent de la sécurité publique et nationale
Date et heure : Le lundi 22 février 2019 - de 16 h 30 à 18 h 38
Objet :Projet de loi C-228, Loi établissant un cadre fédéral visant à réduire la récidive
Témoins :
Parrain du projet de loi
Richard Bragdon, député
À titre individuel
Graydon Nicholas, titulaire d’une chaire fondée en études autochtones, St. Thomas University
Société John Howard
Catherine Latimer, directrice exécutive
Texas Offenders Reentry Initiative
Tina Naidoo, directrice exécutive
Aperçu
Dans son discours d’ouverture, M. Bragdon a expliqué que près de 25 % des personnes mises en liberté finissent par revenir dans le système carcéral dans les deux ans qui suivent, un chiffre qui atteint près de 40 % dans la population autochtone. Il a insisté sur le fait que le cycle doit être brisé et que le projet de loi permettra d’y parvenir. Il créera un groupe de travail qui examinera les problèmes qui conduisent à la récidive, y compris les modèles de travail qui ont eu du succès. Il a indiqué qu’il existe d’excellents modèles et organisations dont nous pouvons apprendre et importer des pratiques exemplaires, ainsi que des secteurs qui travaillent ensemble pour apporter des changements durables.
M. Nicholas a donné un aperçu de son parcours et de ce qui l’a amené à traiter avec des délinquants en tant que travailleur social et juge provincial. Il a décrit les conditions dans lesquelles les délinquants peuvent récidiver et le feront, et a souligné les obstacles auxquels sont confrontés les délinquants noirs et autochtones.
Mme Naidoo a donné un aperçu de son organisation et a expliqué que le Texas est connu comme la capitale de l’incarcération aux États-Unis. Elle a indiqué qu’au moment où son organisation a été créée, un Américain sur trente-deux était sous le contrôle du système judiciaire américain et que pour deux dollars dépensés dans le cadre de leur programme, les États-Unis versaient un dollar. Plus de 400 citoyens ont bénéficié du programme dans sa première année d’existence. Elle a expliqué que le programme a connu des succès en matière de logement, d’emploi et de renforcement des familles. Pendant la pandémie de COVID-19, son organisation s’est bien adaptée à une plateforme virtuelle et peut maintenant servir plus d’individus en moins de temps. Parmi les réussites, le taux d’emploi des clients a augmenté de 40 %. Elle a souligné que le projet de loi C-228 placera le Canada à l’avant-garde du système de justice.
Mme Latimer a donné un aperçu de son organisation et a indiqué que ses racines sont dans le soutien à la réinsertion sociale des prisonniers. Elle a expliqué qu’il y a un large consensus sur le fait que nous voulons que les individus qui sortent de prison soient des citoyens respectueux des lois, mais que le chemin du retour pour les prisonniers est difficile et comporte de nombreux obstacles. Malgré les difficultés qu’ils rencontrent, la majorité d’entre eux ne retournent pas en prison, mais ils sont encore nombreux à le faire. Les enjeux clés sont le logement, les soins de santé et l’emploi. Des solutions ont été créées pour lutter contre ces problèmes, mais il est nécessaire de collaborer davantage. Elle a plaidé en faveur du soutien à l’adoption du projet de loi C-228.
Points saillants de l’audience pertinents pour le SCC
En réponse à des questions concernant les enjeux autochtones, Mme Latimer a indiqué que toute intervention proposée doit trouver un écho chez la personne qui la reçoit. Il faut mettre à l’essai les programmes et modifier les outils de calcul des risques pour certains groupes. M. Nicholas a expliqué qu’il manque, dans le système carcéral, un élément de spiritualité autochtone qui aiderait les Autochtones à s’y intégrer.
Suivi
Aucun.
Information complémentaire : Pour une transcription officielle détaillée des débats, consultez le site Web du Comité. Notez que les transcriptions prennent plusieurs jours ouvrables avant d’être disponibles. Dans certains cas, les « bleus » officieux de l’audience peuvent être fournis par les Relations parlementaires du SCC, sur demande.
1er février 2021 - SECU (Circonstances entourant la mort d’une jeune femme)
Rapport Sur La Réunion D’un Comité De La Chambre Des Communes
Nom du Comité : Comité permanent de la sécurité publique et nationale
Date et heure : Le jeudi 1er février 2021 - de 15 h 10 à 17 h 30
Objet : LaCommission des libérations conditionnelles et les circonstances entourant la mort d’une jeune femme
Témoins :
Project Intervention Prostitution Québec Inc.
Josianne Grenier, adjointe au développement
Stella, l’amie de Maimie
Sandra Wesley, directrice générale
Association des services de réhabilitation sociale du Québec
David Henry, directeur général et criminologue
Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice
David Neufeld, vice-président national et vice-président régional, Services communautaires du Service correctionnel du Canada/Commission des libérations conditionnelles du Canada - Ouest
Stan Stapleton, président national
Aperçu
Dans son discours d’ouverture, Mme Grenier a donné un aperçu de son organisation et a expliqué qu’elle collabore et échange son expertise avec d’autres organisations, comme les écoles et la police. Elle a expliqué que son organisation a une position neutre sur la prostitution. Son message de base est que la décriminalisation de la prostitution doit être soutenue. Elle a souligné que le cas de Marylène Levesque a été très médiatisé parce qu’elle était blonde et avait les yeux bleus, mais qu’en réalité, des prostituées sont tuées tous les jours. Elle a demandé une révision complète de la législation et souligné que la loi actuelle a une idéologie et un objectif qui maintiennent que la prostitution est mauvaise; si les lois, les programmes et les politiques nient qu’elle existe, nous plaçons les valeurs devant la sécurité des personnes.
Mme Wesley a donné un aperçu de son organisation. Son message au Comité était semblable à celui de Mme Grenier. Les travailleuses du sexe ont droit à la sécurité et, à moins que la prostitution ne soit décriminalisée et que la stigmatisation qui entoure le commerce du sexe ne soit inversée, elles ne seront pas en sécurité ni protégées.
M. Henry a donné un aperçu de son organisation et de son processus de consultation. Il a expliqué que les maisons de transition sont un lieu où les délinquants peuvent avoir accès à divers programmes. Il a donné un aperçu des trois types de maisons de transition. Il a expliqué que les CRC sont des maisons de transition classiques, entièrement autonomes, gérées par des bénévoles de la collectivité et qui choisissent leurs résidents. Ils ont des normes pour définir les programmes à offrir, les admissions et une variété d’autres questions. Leur succès est indéniable, puisque le taux de récidive est inférieur à 2 % pendant le séjour du délinquant. Il a convenu que les recommandations du comité d’enquête permettront d’améliorer la surveillance dans les collectivités, mais croit que le SCC devrait aller au-delà des recommandations.
M. Stapleton a donné un aperçu de son organisation. Il a expliqué que le travail des agents de libération conditionnelle commence par une évaluation à l’arrivée dans un établissement. Il a expliqué que la Commission des libérations conditionnelles du Canada impose des conditions à la mise en liberté des délinquants. Il a poursuivi en expliquant que les agents de libération conditionnelle n’ont pas toujours le temps d’examiner les documents judiciaires parce que des postes ont été supprimés et qu’il faut beaucoup de temps pour recevoir les documents. De nombreux agents de libération conditionnelle doivent se débrouiller avec des procédures administratives complexes. De plus, en raison des réductions budgétaires, la quasi-totalité de la formation est désormais virtuelle et ne correspond pas toujours à leurs besoins. Il a donné un aperçu du rapport de 2019 du SESJ et a expliqué que les agents de libération conditionnelle ne peuvent pas toujours prédire ce que fera un délinquant, soulignant que la diminution de la charge de travail faciliterait leur travail. Il a indiqué que le SCC n’a pas répondu au rapport et exhorte le Comité à examiner le rapport du comité d’enquête et à se rappeler que si l’on ne donne pas aux agents de libération conditionnelle les outils dont ils ont besoin, d’autres tragédies se produiront.
Points saillants de l’audience pertinents pour le SCC
En réponse aux questions concernant l’évaluation des délinquants, Mmes Grenier et Wesley ont indiqué que, de l’avis général, le rapport indique clairement que M. Gallese a bénéficié de services de réhabilitation appropriés, mais qu’une réévaluation n’a pas été effectuée. Il a été expliqué que même si le SCC et la CLCC avaient pu empêcher ce décès tragique, il aurait pu tout aussi bien s’agir d’un délinquant qui ne présentait aucune menace évidente.
En réponse aux questions concernant la Maison Painchaud, M. Henry a expliqué que la surveillance directe s’inscrivait dans une longue tradition au Québec et que le SCC doit pouvoir compter sur des partenaires pour assurer la sécurité et la réinsertion sociale. Il a convenu qu’il n’existe pas d’approche unique de surveillance, mais que le SCC est allé au-delà des recommandations du rapport du comité d’enquête. Il a déclaré que son organisation n’a pas attendu le rapport pour agir sur le terrain et trouve regrettable que tout le travail qui a été fait n’ait pas été examiné par le SCC.
Il a indiqué qu’il est difficile de généraliser les reproches. La Maison Painchaud existe depuis 50 ans, et, durant cette période, une seule personne a commis un meurtre. Tous les rapports précédents ont été positifs.
En réponse aux questions concernant les réductions de financement, M. Neufeld a expliqué que de 6 à 7 % du budget du SCC est alloué à la collectivité et que le reste est destiné à la structure des établissements et à la sécurité. En ce qui concerne le travail général, chaque employé joue un rôle concret dans la réhabilitation. Des investissements doivent être faits là où le problème se pose, et il est important de comprendre que n’importe qui peut être incarcéré, mais qu’une fois de retour dans la collectivité, il peut y avoir de nombreux problèmes qui ne peuvent être résolus que par des ressources supplémentaires dans ces collectivités.
En réponse à des questions concernant les programmes, M. Stapleton a indiqué que les délinquants doivent parfois attendre longtemps avant de pouvoir participer à un programme de réhabilitation et que certains programmes ne conviennent pas à certains délinquants. Afin d’offrir les programmes, il faut davantage de personnel.
Suivi
Aucun.
Information complémentaire : Pour une transcription officielle détaillée des débats, consultez le site Web du Comité. Notez que les transcriptions prennent plusieurs jours ouvrables avant d’être disponibles. Dans certains cas, les « bleus » officieux de l’audience peuvent être fournis par les Relations parlementaires du SCC, sur demande.
6. Aperçu du comité
Profil des membres du comité
Parti libéral du Canada

Photo: John McKay
Nom :
John McKay
Autre(s) rôle(s) :
Président du SECU
Circonscription :
Scarborough—Guildwood
Province :
Ontario
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
1997
Profession antérieure :
Avocat et politicien canadien
Déclarations sur la question :
- Intérêts liés aux Autochtones dans le système correctionnel fédéral

Photo: Pam Damoff
Nom :
Pam Damoff
Autre(s) rôle(s) :
Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones
Circonscription :
Oakville-Nord—Burlington
Province :
Ontario
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Profession antérieure :
Ancienne promotrice immobilière
Déclarations sur la question :
- Manifeste beaucoup d’intérêt pour les sujets liés aux services correctionnels
- S’est récemment prononcée en faveur d’une étude sur la manière de réhabiliter les personnes en prison afin de s’assurer que les délinquants ne récidivent pas
- A manifesté de l’intérêt pour les délinquantes autochtones
- A récemment pris la parole à propos de l’augmentation du nombre d’Autochtones et de Canadiens de race noire incarcérés
- A récemment manifesté un intérêt à l’égard des programmes

Photo: Angelo Iacono
Nom :
Angelo Iacono
Autre(s) rôle(s) :
Membre de la Bibliothèque du Parlement
Circonscription :
Alfred—Pellan
Province :
Québec
Langue préférée :
Français/anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Centre fédéral de formation
Première année d’élection :
2011
Profession antérieure :
Ancien avocat
Déclarations sur la question :
- A récemment posé une question concernant les mesures liées à la COVID-19 dans les établissements correctionnels

Photo: Kamal Khera
Nom :
Kamal Khera
Autre(s) rôle(s) :
Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international
Circonscription :
Brampton Ouest
Province :
Ontario
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Profession antérieure :
Ancienne infirmière autorisée
Déclarations sur la question :
- A soutenu le processus de nomination actuel des commissaires de la CLCC
- A récemment manifesté de l’intérêt envers le racisme systémique et le recours à la force en prison

Photo: Joël Lightbound
Nom :
Joël Lightbound
Autre(s) rôle(s) :
Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Circonscription :
Louis-Hébert
Province :
Québec
Langue préférée :
Français/anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Déclarations sur la question :
- A manifesté de l’intérêt pour les questions relatives aux femmes dans les établissements correctionnels fédéraux
- A posé des questions sur le Programme d’échange de seringues dans les prisons
- S’est renseigné sur les avantages de la libération conditionnelle, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des détenus
- A récemment posé une question sur les programmes d’éducation dans les établissements correctionnels

Photo: Gagan Sikand
Nom :
Gagan Sikand
Autre(s) rôle(s) :
Membre de la Bibliothèque du Parlement
Circonscription :
Mississauga — Streetsville
Province :
Ontario
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Profession antérieure :
Ancien avocat
Déclarations sur la question :
Aucune

Nom :
Emmanuella Lambropoulos
Autre(s) rôle(s) :
Membre du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie
Circonscription :
Saint-Laurent
Province :
Québec
Langue préférée :
Anglais/français
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Profession antérieure :
Ancienne enseignante
Déclarations sur la question :
Aucune
Parti conservateur du Canada

Photo: Shannon Stubbs
Nom :
Shannon Stubbs
Autre(s) rôle(s) :
Vice-présidente du SECU
Circonscription :
Lakeland
Province :
Alberta
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2015
Profession antérieure :
Consultante principale pour une firme de relations publiques
Déclarations sur la question :
- A récemment pris la parole pour présenter la motion visant à reprendre l’étude sur les circonstances qui ont conduit à la mort d’une jeune femme
- A récemment posé une question concernant l’euthanasie dans les établissements correctionnels

Photo: Damien C. Kurek
Nom :
Damien C. Kurek
Autre(s) rôle(s) :
Membre du Comité permanent sur l’accès à l’information, la protection des renseignements personnels et l’éthique
Circonscription :
Battle River - Crowfoot
Province :
Alberta
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2019
Profession antérieure :
Agriculteur
Déclarations sur la question
- A manifesté de l’intérêt pour le Programme d’échange de seringues dans les prisons

Photo: Glen Motz
Nom :
Glen Motz
Autre(s) rôle(s) :
Membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Circonscription :
Medicine Hat - Cardston - Warner
Province :
Alberta
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2016
Profession antérieure :
Inspecteur
Déclarations sur la question :
- S’est récemment exprimé sur l’incident survenu au Québec
- A manifesté de l’intérêt envers le racisme systémique
- S’est renseigné sur la mise en liberté des délinquants pendant la pandémie de COVID-19
- S’est renseigné sur les mesures mises en place dans les prisons en vue de prévenir la propagation de la COVID-19
- A récemment posé des questions concernant la violence sexuelle et l’euthanasie en établissement

Photo: Tako Van Popta
Nom :
Tako Van Popta
Autre(s) rôle(s) :
Aucun
Circonscription :
Langley - Aldergrove
Province :
Colombie-Britannique
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2019
Profession antérieure :
Avocat
Déclarations sur la question :
- A récemment pris la parole en faveur d’une formation obligatoire pour les agents de libération conditionnelle et les membres de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
- A récemment posé des questions concernant la violence sexuelle en établissement
Bloc Québécois

Photo: Kristina Michaud
Nom :
Kristina Michaud
Autre(s) rôle(s) :
Vice-présidente du SECU
Circonscription :
Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia
Province :
Québec
Langue préférée :
Français
Établissements du SCC dans la circonscription :
Aucun
Première année d’élection :
2019
Profession antérieure :
Ancienne professionnelle des communications
Déclarations sur la question :
- S’est récemment exprimé sur l’incident survenu au Québec
- A récemment pris la parole en faveur d’une formation obligatoire pour les agents de libération conditionnelle et les membres de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
- A récemment posé des questions concernant la violence sexuelle en établissement
New Democratic Party

Photo: Jack Harris
Nom :
Jack Harris
Autre(s) rôle(s) :
Vice-président du Comité sur les relations sino-canadiennes
Circonscription :
St. John’s-Est
Province :
Terre-Neuve-et-Labrador
Langue préférée :
Anglais
Établissements du SCC dans la circonscription :
Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Terre-Neuve-et-Labrador -
Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve-et-Labrador
Première année d’élection :
2008
Profession antérieure :
Avocat et politicien canadien
Déclarations sur la question :
- S’est exprimé sur l’incident survenu au Québec et la surveillance dans la collectivité
- A posé une question concernant le traitement de la toxicomanie dans les pénitenciers fédéraux
- A demandé des statistiques sur les prisonniers affectés par des problèmes de santé mentale
- A récemment montré de l’intérêt envers le racisme systémique dans les prisons
- A récemment posé des questions concernant la coercition et la violence sexuelles en établissement
7. Logistique du comité
Information Sur Les Réunions Virtuelles Des Comités Parlementaires
- Tous les témoins sont tenus de remplir un formulaire de confirmation. Le formulaire demande l’adresse électronique du témoin, son numéro de téléphone, la personne à joindre en cas de problèmes techniques pendant la réunion, et une question visant à déterminer si le témoin possède un casque d’écoute approuvé par la Chambre des communes ou en a besoin.
- En raison de la nouvelle plateforme de webinaire Zoom, les techniciens de la Chambre des communes doivent attendre que les renseignements sur les témoins soient saisis dans leurs systèmes internes avant de générer les noms d’utilisateur et les mots de passe temporaires pour tous les témoins.
- Une fois que la Chambre des communes a reçu le formulaire et les identifiants, ses responsables de la logistique communiquent directement (par courriel) avec tous les témoins afin de fixer un moment pour effectuer un essai.
Remarque : Si le témoin préfère qu’une autre personne fasse l’essai en son nom, il est très important de l’indiquer lorsqu’il renvoie le formulaire à Sécurité publique Canada - Affaires parlementaires.
Bien que le formulaire ne comporte pas de champ spécifique à cet effet, vous trouverez ci-dessous un exemple de ce que vous devez faire si une autre personne effectue l’essai au nom du témoin : (extrait du formulaire de confirmation virtuel)
- Les témoins ou leur représentant doivent répondre au courriel pour indiquer leur disponibilité pour effectuer l’essai. Il n’y a pas d’exigence générale pour réserver un essai; il est fait dès que possible (le plus tôt est le mieux), au moment où le témoin est disponible, pendant les heures normales de travail (de 9 h à 17 h).
- Le matin de la réunion, un agent de logistique de la Chambre des communes enverra directement aux témoins le lien Zoom et le mot de passe pour la réunion (que le témoin ou une personne désignée ait ou non effectué ou réussi l’essai).
-
- Nom de l’organisation (si vous comparaissez au nom d’une organisation) ou à titre individuel
- Nom du témoin
- Titre professionnel
- Courriel
- Courriel et mot de passe temporaires
- Ville et province (lieu où se trouvera le témoin le jour de la réunion)
- Numéro(s) de téléphone (en cas de problème technique avant ou pendant la réunion)
- Nom et coordonnées de la personne à joindre (technicien ou personnel administratif, le cas échéant)
- Langue parlée par le témoin
- Flux audio vers le témoin