Rapport sur la situation des aires protégées et de conservation 2016-2020
Le rapport de situation des aires protégées et de conservation 2016-2020 comprend la majorité des aires établies en 2020, à quelques exceptions près. Dans le cadre du processus pancanadien de compilation des aires protégées, ECCC lance un appel annuel de données à inclure dans la Base de données sur les aires protégées et de conservation du Canada (BDACPC). La version 2020 de la DBACPC a été utilisée pour informer le rapport sur l’état des aires protégées 2016-2020, car cette version rend le mieux compte des aires protégées au cours de cette période. Cela comprenait les données reçues par ECCC jusqu’au 31 décembre 2020. Dans l’appel de données de 2021, le Québec a déclaré 53 476 km² de territoire conservé en 2020. Les données ont été reçues à la fin de 2021; toutefois le Québec considère que ces zones ont été établies en 2020. Bien que ces zones ne soient pas incluses dans les tableaux de données, l'analyse, les résumés et le texte du rapport 2016-2020, elles seront prises en compte dans la prochaine édition du rapport de situation (2021-2025).
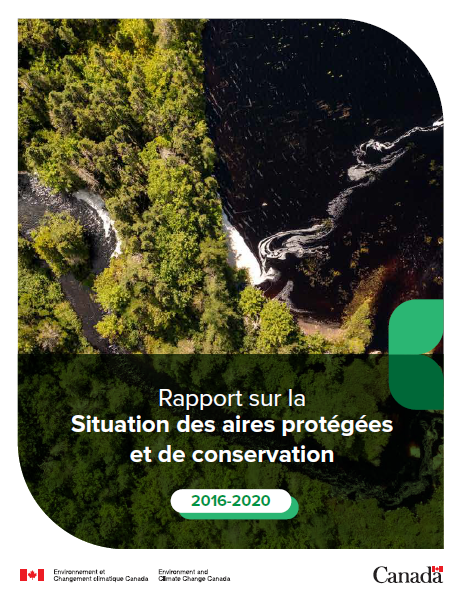
Téléchargez le format alternatif
(Format PDF, 4232 Ko, 134 pages)
Introduction
Aires protégées au Canada
En tant que Canadiennes et Canadiens, nous avons la chance de vivre dans un pays riche en paysages naturels. Ces paysages sont intimement liés à la culture et aux moyens de subsistance des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui sont indissociables de la trame du Canada. Des parcs, des réserves fauniques, des aires de loisirs et une myriade d’autres aires protégées et de conservation ont été créés pour protéger et conserver cet héritage naturel. Ces aires forment aujourd’hui un réseauNote de bas de page 1 qui joue un rôle essentiel dans la conservation de la nature face à l’urbanisation, au développement industriel et aux changements climatiques. Les aires protégées et de conservation préservent la biodiversité, protègent les écosystèmes et les habitats fauniques et nous aident à atténuer les effets des changements climatiques et à nous y adapter. Elles offrent des occasions de loisirs, soutiennent les activités touristiques et culturelles, et favorisent des relations saines avec la nature qui améliorent notre qualité de vie et notre santéNote de bas de page 2 .
À propos du rapport
Ce Rapport sur la situation des aires protégées du Canada est le quatrième d’une série de rapports qui offrent un aperçu détaillé de l’étendue et de la croissance du réseau d’aires terrestresNote de bas de page 3 et marines protégées et de conservation du Canada. Le rapport fournit un point de référence pour évaluer les progrès et les tendances de la conservation par zone au Canada. Ce rapport est le quatrième de la série et couvre la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. La précédente édition de ce rapport couvrait une période de quatre ans, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, et les deux premières éditions couvraient une période de six ans, allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, respectivement.
Ce rapport résume les mesures mises en place par les gouvernements, les peuples autochtones, les fiducies foncières et d’autres acteurs pour protéger les écosystèmes importants, conserver la biodiversité, préserver les services fournis par les écosystèmes, planifier et gérer efficacement les aires, et améliorer la connectivité entre les aires de conservation. Le présent rapport porte sur le réseau d’aires protégées et de conservation du Canada dans son ensemble, à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale.
Types d’aires protégées et de conservation traitées dans le présent rapport
Le réseau de conservation du Canada est aussi diversifié qu’unique et ne se limite pas aux réserves nationales de faune et aux parcs nationaux. Les terres et les eaux de conservation du Canada comprennent également les aires protégées et les parcs régionaux, provinciaux et territoriaux, les aires protégées privées, les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Ensemble, ces terres de conservation contribuent à notre réseau d’aires protégées et de conservation, et favorisent l’accomplissement de progrès vers la réalisation de l’objectif 1 du Canada. Aux fins du présent rapport, les aires protégées et de conservation sont regroupées en deux catégories : les aires protégées et les AMCEZ. On trouve les directives et les exigences minimales pour l’évaluation des sites en tant qu’aires protégées ou AMCEZ au Canada dans l’outil d’aide à la décisionNote de bas de page 4 de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Les directives pour l’évaluation des AMCEZ fédérales en milieu marin se trouvent dans les Directives relatives aux AMCEZ en milieu marin du gouvernement du Canada.
Aires protégées
Toutes les aires protégées incluses dans le présent rapport répondent à la définition pancanadienne du terme, laquelle cadre avec la définition internationale :
« Un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liésNote de bas de page 5 . »
Les organisations d’aires protégées au Canada classifient les aires protégées en fonction de l’approche de gestion et du régime de gouvernance, conformément aux catégories de gestion et à la typologie de gouvernance de l’UICNNote de bas de page 6 . Il s’agit notamment des aires protégées régies par les différents ordres de gouvernement (fédéral, provincial, territorial, régional) ainsi que des aires dirigées par les Autochtones, des aires protégées privées et des modèles de gouvernance partagée (p. ex., les aires protégées en cogestion).
Autres mesures de conservation efficaces par zone
Les AMCEZ sont des zones qui sont régies et gérées de manière à assurer la conservation de la biodiversité à long terme, quel que soit l’objectif principal pour lequel la mesure par zone a été mise en place initialement. La conservation de la biodiversité n’est donc pas l’objectif premier des AMCEZ terrestresNote de bas de page 7 , contrairement aux AMCEZ marines établies au Canada jusqu’à présent, qui ont souvent eu pour objectif premier la conservation de la biodiversité. Les directives pancanadiennes relatives aux AMCEZ terrestres et les directives opérationnelles pour déterminer les AMCEZ dans le milieu marin du Canada (en place pendant la période du rapport 2016-2020) s’harmonisent avec les lignes directrices et les normes internationales établies par l’UICN et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB). La définition d’« AMCEZ » de la CDB, adoptée par le Canada, est la suivante :
« Une zone définie géographiquement autre qu’une aire protégée, qui est régie et gérée de manière à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la biodiversité, avec les fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques et autres valeurs pertinentes à l’échelle locale.Note de bas de page 2 »
Parmi les AMCEZ Figurent des parties de zones d’entraînement militaire et des bassins hydrographiques municipaux réservés à la protection de l’eau. Au Canada, les AMCEZ marines et terrestres ont été officiellement reconnues en 2017 et en 2018, respectivement, ce qui a contribué à l’élargissement et à la croissance du réseau d’aires protégées et de conservation du Canada de 2015 à 2020.
Initiatives stratégiques pour la conservation de la nature
La période de 2016-2020 cadre avec le rapport du Canada sur les buts et objectifs du Canada pour la biodiversité d’ici 2020 (y compris l’objectif 1 du Canada) et le rapport destiné à la CDB sur sa contribution au Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la Convention.
Objectifs internationaux
En 2010, le Plan stratégique pour la diversité biologique a été adopté à l’échelle internationale lors de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique afin de préserver la biodiversité et d’en accroître les avantages pour la population. Ce plan comprenait 20 objectifs mondiaux en matière de biodiversité, connus sous le nom des « objectifs d’Aichi ». Chaque partie à la CDB a accepté de contribuer à l’atteinte des objectifs d’ici 2020. Le Canada, la Communauté européenne et les 195 autres parties à ce plan mondial ont été invités à définir leurs propres objectifs nationaux en s’appuyant sur les objectifs d’Aichi comme guideNote de bas de page 9 . Le Canada a donc établi en 2015 une série d’objectifs nationaux, soit les buts et objectifs du Canada pour la biodiversité d’ici 2020Note de bas de page 10 . Les quatre buts et les 19 objectifs couvrent différentes questions, allant des espèces en péril à la foresterie durable, en passant par les efforts pour rapprocher la population canadienne de la nature. Le premier objectif, l’objectif 1 du Canada, inspiré de l’objectif d’Aichi 11 (voir l’encadré ci-dessous), visait à conserver 17 % des zones terrestres et des eaux intérieures du Canada, soit environ quatre fois la taille de l’Allemagne, et 10 % des zones marines et côtières d’ici la fin de 2020, et ce, grâce à des aires protégées ou à d’AMCEZ.
Objectif mondial d’aichi pour la biodiversité 11
« D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin. »
En route vers l’objectif 1 du Canada
L’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada (ci-après appelée « En route ») a été lancée en 2016 afin d’accélérer les progrès pour atteindre l’objectif de 17 % de conservation des zones terrestres et des eaux intérieures de l’objectif 1 du Canada. Cette initiative est un partenariat entre les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la biodiversité, des parcs et des aires protégées ainsi que les organisations qui représentent les Autochtones et les administrations municipales. Les membres ont travaillé de concert à étendre le réseau d’aires protégées et de conservation dans l’ensemble du pays, à renforcer le soutien de la conservation, et à promouvoir une plus grande reconnaissance des droits et des priorités des Autochtones en matière de conservation. Ces efforts comprennent notamment la création du Comité de conseil national multilatéral et du Cercle autochtone d’experts. Ces organismes consultatifs d’experts ont été invités à formuler des recommandations relativement à la manière dont l’ensemble de la population canadienne pourrait atteindre l’objectif 1 du Canada en s’appuyant sur les meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles accessibles. La composante marine et côtière de l’objectif 1 du Canada est planifiée dans le cadre d’un processus distinct mené par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres intervenantsNote de bas de page 11 .
Énoncé de vision de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada
« Dans l’esprit et la pratique de la réconciliation, le Canada conserve sa diversité naturelle dans des réseaux interconnectés des aires protégées et de conservation pour le bénéfice durable de la nature et des générations futures, grâce à des efforts collectifs dans le cadre de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et au-delà. […] Le moment est venu pour tous les Canadiens d’adopter une approche collaborative pour la conservation de la biodiversité qui :
- reconnaît le rôle intégral des Autochtones en tant que leaders en matière de conservation et qui respecte les droits, les responsabilités et les priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis;
- recherche la coopération transfrontalière, holistique et basée sur un écosystème, incluant les gouvernements locaux et d’autres partenaires de la conservation;
- prend en compte le changement climatique, les processus et services écosystémiques ainsi que les échelles et les rythmes de changement associés;
- offre des opportunités économiques locales liées à la conservation telles que le tourisme et les loisirs durables, qui favorisent l’appréciation de la nature et de la culture autochtone, tout en encourageant des modes de vie sains et actifs. »
La publication La voie à suivre : retour sur l’approche renouvelée de la conservation des terres et des eaux douces au Canada de 2016 à 2020 a été élaborée du point de vue du Comité directeur national (CDN) d’En route. Ce rapport met en lumière les travaux menés de 2016 à 2021, les leçons retenues par les membres du CDN d’En route ainsi que les mesures et considérations proposées pour les personnes qui poursuivront ces travaux au-delà de la fin du mandat d’En route vers l’objectif 1 du Canada, qui a officiellement pris fin en 2020. Visitez le site En route vers l’objectif 1 du Canada pour plus d’information sur cette initiative.
Unis avec la nature
En 2018-2019, les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des parcs, des aires protégées, de la conservation, de la faune et de la biodiversité ont publié des directives pancanadiennes relatives aux aires protégées et de conservation dans le rapport Unis avec la nature. Ce rapport multilatéral met en évidence les priorités et les mesures que les membres d’En route peuvent mettre en place et promouvoir pour soutenir les progrès vers la réalisation de l’objectif 1 du CanadaNote de bas de page 10 . Le rapport Unis avec la nature accorde la priorité à l’expansion des réseaux fédéral, provinciaux et territoriaux d’aires protégées et de conservation et définit l’approche concertée du nouveau système de comptabilisation pancanadien pour de nombreux types d’aires protégées et de conservation.
Fonds de la nature du Canada
En 2018, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement historique de 1,35 milliard de dollars sur cinq ans pour l’initiative Patrimoine naturel du Canada. Il s’agissait à l’époque du plus important investissement dans la conservation de la nature jamais réalisé au Canada. L’investissement visait à conserver 17 % de ses terres et de ses eaux intérieures d’ici 2020, à faire passer le Programme sur les espèces en péril de la planification au rétablissement, à soutenir la réconciliation avec les peuples autochtones et à assurer une gestion efficace et un agrandissement des aires protégées fédérales. Cette annonce comprenait un investissement de 500 millions de dollars dans les aires protégées et de conservation, sous la forme du Fonds de la nature du Canada (FNC), en vue de la protection et du rétablissement des espèces en péril, et du maintien de la biodiversité. Le FNC a été mis à la disposition d’organisations sans but lucratif et d’organisations autochtones, de gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres acteurs. Il se composait de deux volets : le volet des espaces (284 millions de dollars) et le volet des espèces en péril (215 millions de dollars)Note de bas de page 11 . Le volet des espaces du FNC a fourni des ressources qui ont permis aux partenaires de progresser vers l’objectif 1 du Canada. Plus précisément, le volet des espaces visait à mobiliser les principaux partenaires et intervenants afin d’accroître la couverture, l’intégrité écologique et la connectivité du réseau canadien d’aires protégées et de conservation; d’établir de nouvelles aires protégées et de conservation, comme les aires protégées et de conservation autochtone (APCA), les parcs provinciaux et municipaux, les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) et les terres privées; de maintenir et d’améliorer la biodiversité du Canada; de rapprocher les Canadiennes et les Canadiens de la nature; de soutenir la réconciliation par la cogestion des aires protégées et de conservation.
Le FNC a été conçu pour tirer parti des ressources des provinces et des territoires et de celles d’autres organisations, y compris le secteur des fondations philanthropiques, et pour harmoniser le financement fédéral avec les sorties de fonds des autres intervenants pour la conservationNote de bas de page 14 .
On trouve une évaluation du FNC à l’adresse : publications.gc.ca.
Ministères et organismes ayant contribué au rapport
Le Rapport sur la situation des aires protégées et de conservation du Canada 2016-2020 a été rédigé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, Pêches et Océans Canada (MPO) et Parcs Canada, sous la supervision des sous-ministres adjoints fédéraux, provinciaux et territoriaux membres du Groupe directeur sur la conservation, la faune et la biodiversité (GDCFB).Le rapport s’appuie sur des renseignements et des données fournis par plusieurs ministères et organisations responsables d’aires protégées et de conservation.
- Alberta : Parks Operations Division, Alberta Forestry; Parks and Tourism et Lands Division, Alberta Environment and Protected Areas
- Colombie-Britannique : BC Parks et Ministry of Water, Land and Resource Stewardship
- Manitoba : Environnement et Changement climatique (anciennement Développement durable)
- Nouveau-Brunswick : ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie; ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
- Terre-Neuve-et-Labrador : Policy, Planning and Natural Areas Division, Department of Environment and Climate Change; ParksNL, Department of Tourism, Culture, and Recreation
- Territoires du Nord-Ouest : Direction générale de l’environnement et du changement climatique, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
- Nouvelle-Écosse : Protected Areas and Ecosystems Branch, Nova Scotia Department of Environment and Parks Division; Nova Scotia Department of Natural Resources and Renewables
- Nunavut : Parcs et endroits spéciaux, ministère de l’Environnement
- Ontario : Parcs Ontario, ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
- Île-du-Prince-Édouard : Forests, Fish and Wildlife Division, PEI Department of Environment, Energy, and Climate Action (anciennement Communities, Land and Environment)
- Québec : Direction principale des aires protégées, ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des ParcsNote de bas de page 13
- Saskatchewan : Ministry of Environment, Fish, Wildlife and Land Branch; Ministry of Parks, Culture and Sport
- Yukon : Direction des parcs et Direction de la faune aquatique et terrestre, ministère de l’Environnement
- Gouvernement du Canada : ECCC; MPO; Parcs Canada
- Organisations non gouvernementales : Conservation de la nature Canada; Canards Illimités Canada
Sources des données
La Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) est la principale source de données de l’analyse présentée dans ce rapport. La BDCAPC est gérée par ECCC. La responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité des données sources incombe aux fournisseurs de données sur les aires protégées et de conservation.
Données de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation
La BDCAPC, gérée par ECCC, est utilisée aux fins des rapports nationaux et internationaux. Elle contient les données spatiales et les données d’attribut les plus récentes sur les aires marines et terrestres protégées et les AMCEZ, lesquelles ont été consolidées par toutes les autorités ayant des responsabilités au chapitre des aires protégées et de conservation au CanadaNote de bas de page 14Note de bas de page 15 . Bien que la BDCAPC soit le système commun pour les rapports collectifs, elle n’empêche pas les autorités d’avoir leurs propres systèmes de déclaration en matière de données et d’espace.
Au moins une fois par an, les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux soumettent à la BDCAPC des données géospatiales et d’attributs concernant les aires protégées et de conservation relevant de leur compétence. Les données sur les aires relevant d’organisations autochtones ou d’ONG, comme Conservation de la nature Canada et Canards Illimités Canada, sont incluses lorsqu’une autorité compétente a reconnu et déclaré ces aires. Les données soumises comprennent le nom de l’aire, son emplacement géospatial, ses limites, sa superficie officielle, le type de biome (terrestre ou marin), la catégorie de gestion des aires protégées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’autorité compétente responsable de la gestion et la date de protection, entre autres renseignements.
Les pourcentages des aires terrestres et marines protégées et de conservation ont été calculés en fonction d’une zone terrestre du Canada de 9 984 670 km2 et d’une zone marine du Canada de 5 750 000 km2. Les données sont à jour en date du 31 décembre 2020. On trouve en annexe des renseignements détaillés sur les sources de données et les méthodes relatives à la BDCAPC.
Données recueillies à l’aide du questionnaire
Les organisations responsables d’aires protégées et de conservation ont rempli un questionnaire normalisé à l’automne et à l’hiver 2022-2023 afin de rendre compte des conditions pour la période de rapport 2016-2020. En répondant au questionnaire, les organisations ont fourni des renseignements sur plusieurs sujets, notamment : la conception, la planification et l’établissement des aires protégées; la législation, les politiques, les objectifs et la gestion; la surveillance et les rapports; la participation, la collaboration et le leadership des peuples autochtones; la mobilisation et la consultation des collectivités locales, des propriétaires fonciers privés et d’autres organisations relativement à l’établissement et à la gestion des aires protégées; l’intégrité écologique et la connectivité; les changements climatiques, les menaces écologiques et d’autres défis; les mises à jour et les réalisations; les ressources financières pour les aires protégées et la fréquentation des aires.
Ce questionnaire est une source d’information essentielle pour la série de Rapports sur la situation des aires protégées et de conservation du Canada, car il permet de comprendre les progrès réalisés dans chacune des provinces et chacun des territoires. De nombreuses questions des versions précédentes du questionnaire sont demeurées inchangées à des fins de comparaison avec les résultats antérieurs. Certaines questions ont été modifiées par souci de clarté et pour faciliter les réponses, et quelques questions ont été ajoutées.
Limites des données
Données recueillies à l’aide du questionnaire
Les données recueillies à l’aide du questionnaire sont intrinsèquement soumises à certaines limites méthodologiques. Premièrement, l’exactitude des données recueillies dépend de la capacité des répondants à fournir des réponses exactes. Deuxièmement, l’interprétation des questions par les répondants peut différer de l’intention du concepteur du questionnaire, ce qui, le cas échéant, génère des données inexactes. Contrairement aux méthodes qualitatives comme les entretiens, les questionnaires peuvent manquer de profondeur et de contexte. Ils sont statiques et ne permettent pas de poser des questions de suivi en fonction des réponses. Cela peut limiter la richesse des données recueillies.
ECCC a conçu et analysé les questionnaires en tenant compte des limites potentielles et des différentes interprétations des questions. Les questionnaires ont été peaufinés au fil du temps afin de réduire le plus possible les ambiguïtés signalées par les répondants. ECCC a envoyé le questionnaire spécifiquement à des praticiens bien informés dans les aires protégées et de conservation, en partant du principe que les répondants connaissaient les sujets abordés. Au cours de la phase d’analyse, toute réponse hors sujet ou ambiguë a été signalée afin de ne pas biaiser les résultats.
La responsabilité d’assurer l’exactitude des données recueillies à l’aide du questionnaire incombe en dernier ressort aux répondants (provinces, territoires, ONG et ministères fédéraux responsables de la conservation par zone).
Données de la BDCAPC
Les données de la BDCAPC sont régulièrement révisées et mises à jour. L’exhaustivité de la base de données est améliorée sur une base continue, au fur et à mesure que les aires protégées et de conservation qualifiées sont examinées et ajoutées à la base. Les données sur la date de protection des sites pour lesquels aucune date n’a été communiquée précédemment peuvent influer sur les calculs des tendances. Les données de ce rapport ne concernent que les aires qui ont été officiellement déclarées dans la base de données nationale. Certaines aires protégées et de conservation pourraient ne pas avoir été officiellement déclarées.
Les tendances sont estimées d’après la date à laquelle un site a été établi, plutôt qu’en fonction de la date à laquelle il a été reconnu comme une aire protégée ou une AMCEZ. Ainsi, les totaux d’une année précédente peuvent changer au fur et à mesure que les données sont mises à jour. Les comparaisons avec les rapports précédents doivent être effectuées avec prudence, car la qualité et l’exhaustivité des données continuent de s’améliorer. Les terres privées protégées et les AMCEZ contribuent à la réalisation des objectifs du Canada, mais nombre d’entre elles ne sont pas encore répertoriées dans la base de données.
Pour en savoir plus sur les limites des données, voir l’annexe 2.
Chapitre 1 : Portrait des aires protégées et de conservation du canada : étendue, croissance, gouvernance et représentativité écologique
Contexte
La période de 2016 à 2020 a été cruciale pour les efforts de conservation du Canada. Au cours de cette période, le pays s’est fixé pour objectif de conserver 17 % de ses aires terrestres et 10 % de ses aires marines d’ici 2020 (objectif 1 du Canada). Plus important encore, pendant cette période, on a reconnu les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), lesquelles sont des zones qui ne répondent pas à la définition officielle d’« aires protégées », mais qui sont gérées de manière à préserver efficacement la biodiversité à long terme.
Ce chapitre donne un aperçu de l’étendue et de la croissance du réseau d’aires terrestres et marines protégées et de conservation du Canada entre le début de 2016 et la fin de 2020. De plus, il présente une analyse de la représentativité écologique, de la gouvernance et de la répartition géographique des aires protégées et de conservation.
Terminologie
Le terme « aires protégées et de conservation » est utilisé tout au long du présent rapport pour désigner deux mesures de conservation : 1) les aires protégées et 2) les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ).
Parmi les exemples d’aires protégées Figurent les parcs nationaux, provinciaux, territoriaux, les réserves nationales de faune, les refuges d’oiseaux migrateurs, les aires marines protégées et les aires protégées par les Autochtones : des aires pour lesquelles l’objectif principal est la conservation de la biodiversitéNote de bas de page 16 .
Dans le contexte du présent rapport, le terme « aires de conservation » désigne les AMCEZ. Les objectifs de gestion des AMCEZ doivent être compatibles avec la conservation in situ (sur place) de la biodiversité. Cela dit, la gestion des sites peut servir d’autres objectifs (p. ex., la préservation des sites culturels autochtones)Note de bas de page 17 . Au Canada, les AMCEZ marines et terrestres ont été officiellement reconnues dans les bases de données sur la conservation en 2017 et en 2018, respectivement. Depuis, les AMCEZ ont contribué à l’étendue et à la croissance du réseau d’aires protégées et de conservation du Canada.
Le terme « réseau d’aires protégées et de conservation » comprend donc toutes les mesures de conservation reconnues au Canada, qu’elles visent directement la biodiversité ou qu’elles lui profitent indirectement.
Répartition et taille des aires protégées et de conservation
La répartition et la taille des aires protégées et de conservation varient. Il n’est pas surprenant que les plus grandes aires terrestres protégées et de conservation se trouvent généralement dans le nord du Canada, où la concurrence pour l’utilisation des terres est moindre et où l’agriculture, la sylviculture, la présence de collectivités et les réseaux routiers sont limités, voire inexistants. Les plus grandes aires marines protégées et de conservation sont généralement situées au large des côtes ou dans le nord du Canada, où les activités humaines sont souvent moins intensivesNote de bas de page 18 . Dans les zones où la population est plus dense et où la concurrence pour l’utilisation des terres est plus importante, les aires protégées et de conservation ont tendance à être plus petites, mais plus nombreuses (carte 1).
Le Canada comptait plus de 9 292 aires protégées et de conservation en zone terrestre ainsi que 844 aires protégées et de conservation en zone marine à la fin de 2020.
Carte 1. Carte du réseau canadien d’aires protégées et de conservation (2020)Note de bas de page 19 .

Consultez les données à partir de cette carte interactive.
Remarque : Les aires terrestres comprennent les terres et l’eau douce. Les données sont à jour en date du 31 décembre 2020.
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2020). Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation.
Long description
Une carte montrant toutes les aires protégées et conservées du Canada. Les aires protégées et conservées sont divisées en catégories suivantes :
- Aires protégées terrestres
- Mesures de conservation terrestres autres mesures de conservation efficaces par zone
- Aires marines protégées
- Autres mesures de conservation marines efficaces par zone
Province ou territoire |
Superficie provinciale/territoriale |
Aire protégée (AP) |
AMCEZ |
Total |
AP |
AMCEZ |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta |
661 848 |
101 594 |
- |
101 594 |
15,4 |
- |
15,4 |
Colombie-Britannique |
944 735 |
146 224 |
38 004 |
184 227 |
15,5 |
4,0 |
19,5 |
Manitoba |
647 797 |
71 330 |
231 |
71 561 |
11,0 |
- |
11,0 |
Nouveau-Brunswick |
72 908 |
3 548 |
- |
3 548 |
4,9 |
- |
4,9 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
405 212 |
28 110 |
- |
28 110 |
6,9 |
- |
6,9 |
Territoires du Nord-Ouest |
1 346 106 |
173 140 |
39 181 |
212 321 |
12,9 |
2,9 |
15,8 |
Nouvelle-Écosse |
55 284 |
7 071 |
- |
7 071 |
12,8 |
- |
12,8 |
Nunavut |
2 093 190 |
211 373 |
- |
211 373 |
10,1 |
- |
10,1 |
Ontario |
1 076 395 |
114 857 |
38 |
114 896 |
10,7 |
- |
10,7 |
Île-du-Prince-Édouard |
5 660 |
213 |
24 |
237 |
3,8 |
0,4 |
4,2 |
QuébecNote de bas de page 20 |
1 512 418 |
194 586 |
- |
194 586 |
12,9 |
- |
12,9 |
Saskatchewan |
651 036 |
63 559 |
- |
63 559 |
9,8 |
- |
9,8 |
Yukon |
482 443 |
56 808 |
- |
56 808 |
11,8 |
- |
11,8 |
Canada |
9 984 670 |
1 172 342 |
77 476 |
1 249 818 |
11,7 |
0,8 |
12,5 |
Étendue et croissance du réseauNote de bas de page 21
À la fin de 2020, le Canada a réussi à protéger et à conserver une superficie de 1,25 million de km² de terres et d’eau douce, soit une zone plus grande que l’Ontario, ainsi que 795 000 km² d’océans, soit une zone plus grande que l’Alberta. Cette superficie couvre 12,5 % de la surface terrestre du Canada et 13,8 % de ses océans et zones côtières. Bien que les efforts de conservation se poursuivent depuis des décennies, la période de 2016 à 2020 a été particulièrement importante pour l’expansion du réseau canadien d’aires protégées et de conservation (comme le montrent les Figures 1 et 2). Au cours de cette période, 120 312 km² supplémentaires de terres et d’eau douce ont été conservés, ce qui représente une augmentation de 11 % de la taille du réseau d’aires terrestres. De plus, la superficie du réseau d’aires marines a décuplé grâce à la conservation de 723 459 km² de territoire marin.

Long description
Un diagramme de beignet montrant les cibles pour la quantité de zones terrestres et marines protégées et conservées, ainsi que les progrès actuels vers ces cibles. Les deux valeurs sont données en pourcentage. La barre supérieure du diagramme représente la cible et la barre inférieure représente la progression. La carte à gauche représente les zones terrestres, et la carte à droite représente les zones marines.

Long description
Un graphique linéaire montrant la croissance du réseau d'aires terrestres et marines protégées et conservées du Canada au fil du temps. Ce graphique montre les données pour quatre catégories :
- Aire marine conservée (y compris protégée)
- Superficies terrestres conservées (y compris protégées)
- Zone terrestre protégée
- Aire marine protégée
Objectif en matière d’aires marines surpassé
Le Canada a dépassé son objectif 1, à savoir protéger 10 % de ses océans d’ici 2020. À la fin de l’année, le pays avait conservé 13,8 % de son territoire marin, soit 795 000 km². Un exemple notable est la création en 2019 de Tallurutiup Imanga, une aire marine nationale de conservation s’étendant sur 108 000 km², au Nunavut. Classifiée en tant qu’aire marine protégée, Tallurutiup Imanga protège l’écosystème marin de l’est de l’Arctique canadien, tout en gérant durablement la pêche de subsistance et la pêche commerciale, fournissant ainsi des ressources marines pour la consommationNote de bas de page 22 .
Les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) en milieu marin ont joué un rôle crucial dans la réalisation de cette étape. À la fin de 2020, les AMCEZ marines contribuant à l’objectif 1 étaient des mesures de gestion des pêches établies par Pêches et Océans Canada (MPO) qui répondent aux critères pancanadiens des AMCEZ. Ces aires, également appelées « refuges marins », représentent environ 5 % des aires marines protégées et de conservation du Canada. On trouve une liste des refuges marins établis par le MPO à l’adresse suivante.
Gouvernance des aires protégées du canada
La gouvernance décrit qui détient l’autorité et la responsabilité d’une aire protégée et de conservation donnée. Les aires protégées et les AMCEZ font partie du spectre des « types de gouvernance »Note de bas de page 23 reconnus par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit :
- Gouvernance par le gouvernement (gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et administrations locales et municipales);
- Gouvernance partagée (gestion collaborative, conjointe ou transfrontalière);
- Gouvernance privée (propriétaire individuel, organisations sans but lucratif, organisations à but lucratif);
- Gouvernance par les peuples autochtones et des communautés locales (aires et territoires conservés par des peuples autochtones ou des communautés locales).
Les gouvernements et les organisations du Canada ont commencé à déclarer les types de gouvernance de l’UICN des aires protégées en 2015 (voir la Figure 3). On a élargi la portée de la déclaration afin d’inclure les AMCEZ marines en 2017Note de bas de page 24 et les AMCEZ terrestres en 2018Note de bas de page 17 .

Long description
Un graphique montrant la proportion des aires protégées et conservées du Canada (terrestres et marines) par type de gouvernance par zone. Les proportions sont représentées par des cercles de différentes tailles. Les catégories de gouvernance sont les suivantes :
- Gouvernance par le gouvernement
- Gouvernance partagée
- Gouvernance par les peuples autochtones et les communautés locales
- Gouvernance privée

Long description
Un graphique montrant la proportion des aires protégées et conservées du Canada (terrestres et marines) par type de gouvernance détaillé par zone. Les proportions sont représentées par des cercles de différentes tailles. Les catégories de gouvernance sont les suivantes :
- Gouvernement national
- Gouvernement infranational
- Gouvernement collaboratif
- Non déclaré
- Gouvernement autochtone
- Organismes à but non lucratif
- Peuples autochtones
- Propriétaires fonciers individuels
- Gouvernance conjointe
Gouvernance par le gouvernement
Un examen des sites selon la superficie montre que la grande majorité des aires protégées et de conservation déclarées sont régies par les gouvernements provinciaux, territoriaux ou fédéral (Figures 4 et 5). De celles-ciNote de bas de page 21 :
- les gouvernements provinciaux et territoriaux administrent ou administrent conjointement 57 % (738 000 km2) des aires terrestres protégées et de conservation et 1,5 % (11 800 km2) des aires marines protégées et de conservation;
- le gouvernement fédéral administre ou administre conjointement 43 % (541 000 km2) des aires terrestres protégées et de conservation et 98 % (787 000 km2) des aires marines protégées et de conservation.

Long description
Une carte montrant le pourcentage de zones terrestres protégées ou conservées par chaque administration. Les catégories représentent les plages de pourcentage suivantes :
- 4-8%
- 8-12%
- 12-16%
- 16-20%
À l’échelle fédérale, si l’on examine la superficie totale, on constate que Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) sont responsables de la majorité des aires protégées et de conservation en zone terrestre, et que Parcs Canada, ECCC et Pêches et Océans Canada (MPO) sont responsables de la majorité des aires protégées et de conservation en zone marine. De plus, la Commission de la capitale nationale est responsable de la gestion du parc de la Gatineau au Québec, et Affaires autochtones et du Nord Canada a toujours participé à la gestion conjointe de la partie du refuge faunique Thelon située au Nunavut. Le ministère de la Défense nationale gère la réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes (BFC) Suffield et les parties de la BFC Shilo qui ont été reconnues comme la première AMCEZ du Canada.
Gouvernance partagée
La gouvernance partagée fait généralement référence à une collaboration entre des organismes gouvernementaux (gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux) et d’autres parties (peuples autochtones, municipalité, propriétaire foncier ou fiducie foncière), dans laquelle les partenaires partagent l’autorité en prenant des décisions collectivement. Cela peut se faire par la mise en place d’un organe de gouvernance ou d’autres mécanismes de coopération ou de cogestionNote de bas de page 6 . Plus de 40 000 km2 d’aires terrestres et marines protégées et de conservation, réparties dans six provinces et trois territoires, sont administrées dans le cadre d’accords de gouvernance partagée. Il s’agit principalement d’aires protégées et de conservation qui sont cogérées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les gouvernements ou communautés autochtones.
Gouvernance privée
Les aires de conservation sur des terres privées apportent une contribution importante au réseau d’aires protégées et de conservation du Canada : elles protègent souvent des habitats naturels fragiles et importants dans des paysages autrement aménagés. Les aires de conservation privées se trouvent presque exclusivement dans le sud du Canada.
Parmi les aires protégées privées Figurent les aires régies par des propriétaires fonciers individuels et des organisations non gouvernementales. Les aires de conservation privées comprennent les terres détenues en pleine propriété (en fief simple) par des organisations de conservation ainsi que les intérêts partiels, y compris les servitudes, les conventions et les accords de conservation.
Gouvernance par les peuples autochtonesNote de bas de page 25
Cette forme de gouvernance s’étend aux aires protégées et aux AMCEZ où l’autorité et la responsabilité de la gestion des terres incombent aux peuples autochtones. Les aires protégées et de conservation autochtone (APCA) sont un exemple de gouvernance par les peuples autochtones qui protègent la nature et les valeurs culturelles. Les APCA sont des terres et des eaux où les gouvernements autochtones ont le rôle principal de protéger et de conserver les écosystèmes au moyen de systèmes de lois, de gouvernance et de connaissances autochtones. Elles peuvent couvrir diverses initiatives de protection des terres, notamment les parcs tribaux, les paysages culturels autochtones, les aires protégées autochtones et les aires de conservation autochtones. Si les APCA peuvent être cogérées, de nombreuses formes de gouvernance sont possibles et varient en fonction des préférences des gouvernements autochtones. Citons par exemple Wehexlaxodıale, une zone de 976 km2 dans les Territoires du Nord-Ouest qui a été créée en 2013 en vertu du Tłįcho˛ Land Use Plan Act et qui est exclusivement régie par le gouvernement Tłįcho˛.
Représentativité écologiqueNote de bas de page 26
Écozones
Une écozone est une zone où les organismes et leur environnement physique subsistent en tant que système. Chaque écozone est unique et peut présenter une valeur particulière susceptible de profiter de la conservation. Le Canada peut être divisé en 18 écozones terrestres (tableau 1, carte 2), 12 écozones marines (tableau 2, carte 2) et une écozone d’eau douce (tableau 2, carte 2). Le pourcentage de protection dans chaque écozone varie considérablement, allant de moins de 1 % dans le complexe de la baie d’Hudson à plus de 35 % dans la toundra de la Cordillère et le bassin arctiqueNote de bas de page 27 . La disparité de la protection peut être attribuée à de nombreux facteurs. Certaines écozones sont bien protégées parce que leur valeur esthétique a attiré les efforts de protection au fil des décennies (p. ex., les montagnes et les glaciers). À l’inverse, d’autres écozones ont suscité peu d’efforts de protection parce qu’elles sont considérées comme éloignées et moins utiles à l’humain (p. ex., les tourbières, les marécages et les milieux humides des basses terers).
Les différentes écozones du Canada composent avec des menaces différentesNote de bas de page 28 . Par exemple, à la suite de la conversion rapide de l’écozone des prairies pour l’agriculture en rangs, cette écozone continue d’être menacée par la perte d’habitat au profit de l’agriculture, du développement urbain et de l’industrie. Les écozones du bouclier boréal et des plaines boréales sont gérées principalement pour l’extraction de fibres, ce qui fait qu’une grande partie n’est pas disponible pour la création d’aires protégées. En milieu marin, l’écozone maritime du Pacifique est touchée par l’urbanisation, la pollution et la perte d’habitat ainsi que par les changements climatiques, qui affectent les courants océaniques, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans.
La carte ci-dessous montre dans quelle mesure les aires protégées et de conservation du Canada étaient représentatives des différentes écozones en date du 31 décembre 2020.

Remarque : L’aire de conservation comprend l’aire protégée ainsi que la zone conservée par d’autres mesures. Les données sont à jour en date du 31 décembre 2020.
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2020). Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation.
Long description
Une carte montrant la proportion d'aires protégées et conservées dans les écozones canadiennes en 2020. Chaque écozone terrestre ou marine est désignée comme l'une des catégories suivantes :
- 0-5%
- 5-10%
- 10-15%
- 15-20%
- 20-25%
- 25-30%
- 30-100%
L'écozone des Grands Lacs est désignée à 13,3 %.
La plus grande forêt boréale protégée au monde
Le 15 mai 2018, plusieurs parcs provinciaux en milieu sauvage, nouveaux ou agrandis, ont été annoncés dans le nord de l’Alberta : Kazan, Richardson, Dillon River, Birch River et Birch Mountains. Ces parcs provinciaux contribuent pour plus de 1,36 million d’hectares au réseau d’aires protégées de la province. Le gouvernement de l’Alberta s’est associé au gouvernement du Canada, à la Première Nation de Tallcree, à Syncrude Canada Ltd et à Conservation de la nature Canada pour créer ces aires protégées. Cette réalisation historique montre ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements, les Premières Nations, l’industrie et les organisations environnementales travaillent ensemble.Note de bas de page 29
Écozones terrestres
- À la fin de 2020, la majorité des écozones terrestres du Canada (15 sur 18), principalement dans le nord et l’ouest du pays, avaient au moins 5 % de leur superficie protégée et conservée, et plus de la moitié (11 sur 18) avaient 10 % ou plus de leur superficie protégée et conservée. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2015, où moins de la moitié (sept sur 18) des écozones terrestres comptaient 10 % ou plus de leur superficie protégée et conservée. L’augmentation la plus importante a été enregistrée dans l’écozone de la toundra de la Cordillère, qui est passée de 24,6 à 35,8 % d’aires protégées et de conservation.
- Deux écozones terrestres (les plaines à forêts mixtes et les hautes terres de l’Atlantique) avaient moins de 5 % de leur superficie protégée en 2020, et ce, malgré l’expansion de la superficie protégée dans les deux cas depuis 2015.
Écozones marines et d’eau douce
À la fin de l’année 2020, une forte croissance des aires protégées et de conservation a été observée dans la majorité des écozones marines du Canada, 9 sur 12 affichant une augmentation entre 2016 et 2020. Il s’agit d’une amélioration substantielle par rapport à la période de référence 2010-2015, au cours de laquelle seule l’écozone du golfe du Saint-Laurent avait enregistré une légère augmentation de ses aires protégées et de conservation, passant de 1,6 à 1,9 %.
- Sur les 12 écozones marines, neuf (75 %) avaient au moins 5 % de leur superficie protégée et conservée en 2020, et trois d’entre elles (haute mer du Pacifique, bassin arctique et est de l’Arctique) avaient plus de 20 % de leur superficie protégée et conservée. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2015, année au cours de laquelle une seule écozone (plate-forme Nord) était protégée à au moins 5 %.
- Plus de 13 % de l’écozone des Grands Lacs était protégée en 2020, soit le même pourcentage qu’en 2015.
Écorégions
Les écozones terrestres peuvent être divisées en unités plus petites appelées écorégions, qui contiennent des assemblages caractéristiques et géographiquement distincts de communautés et d’espèces naturelles. Ces caractéristiques couvrent divers éléments tels que les régimes climatiques, les types de relief, le couvert végétal, la composition du sol et la présence d’une flore et d’une faune spécifiques (voir carte 3). Le Canada compte 215 écorégions terrestresNote de bas de page 30 .
Le Cadre écologique terrestre canadien (CETC) contient les données spatiales et d’attributs actualisées sur les écozones et les écorégions du Canada à partir de 2019. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour officielle des écorégions du Canada, le CETC a été créé pour soutenir les rapports nationaux sur la représentation écologique dans le cadre de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Le CETC est compilé et géré par ECCC, en collaboration avec les provinces et les territoires.
Sur les 215 écorégions du Canada, à la fin de 2020 :
- 75 % (161 écorégions) avaient moins de 17 % de leur superficie conservée.
- 10 % (22 écorégions) avaient de 17 à 30 % de leur superficie conservée.
- 15 % (33 écorégions) avaient plus de 30 % de leur superficie conservée.

Long description
Une carte montrant la proportion d'aires protégées dans les écorégions canadiennes en 2020. Chaque écorégion terrestre ou marine est désignée comme l'une des catégories suivantes :
- 0-5%
- 5-10%
- 10-15%
- 15-20%
- 20-25%
- 25-30%
- 30-100%
L'écorégion des Grands Lacs est désignée à 13,3 %.
Remarque : L’aire de conservation comprend l’aire protégée ainsi que la zone conservée par d’autres mesures. Les données sont à jour en date du 31 décembre 2020.
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2020). Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation.
Toutes les écorégions ont au moins une partie de leur superficie protégée. Les écorégions dotées de vastes aires protégées, comme l’écorégion du delta Paix-Athabasca (94 % : parc national Wood Buffalo) et l’écorégion du mont Logan (100 % : parc national et réserve de parc national Kluane), affichent les proportions les plus élevées d’aires protégées. En revanche, les écorégions situées dans des paysages urbains ou agricoles présentent les taux les plus faibles. Les écorégions du lac Simcoe et du lac Érié-lac Ontario ont chacune moins de 3 % de leur superficie conservée.
Catégories de gestion de l’union internationale pour la conservation de la natureNote de bas de page 21
Le Canada utilise les catégories de gestion de l’UICN (carte 4, Figure 7) pour classifier les aires protégées en fonction de leurs objectifs de gestion. Les catégories de l’UICN ne concernent que les aires protégées, et non les AMCEZ. Les entités gouvernementales responsables des aires protégées les classifient dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) en utilisant l’une des catégories de gestion suivantes :
- Ia. Réserve naturelle intégrale
- Ib. Zone de nature sauvage
- II. Parc national
- III. Monument ou élément naturel
- IV. Aire de gestion des habitats ou des espèces
- V. Paysage terrestre ou marin protégé
- VI. Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles
Les aires protégées sont classifiées en fonction de leurs objectifs de gestion, et non de leur désignation. Par exemple, les parcs nationaux du Canada ne sont pas toujours gérés conformément à la catégorie II de l’UICN. Si l’objectif du parc national comprend l’utilisation durable des ressources naturelles, il sera classé dans la catégorie VI. Inversement, la catégorie « parc national » (catégorie II) ne désigne pas nécessairement une aire protégée désignée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. La catégorie II regroupe plutôt de grandes aires naturelles ou quasi naturelles protégeant des processus écologiques à grande échelle et abritant des espèces et des écosystèmes caractéristiques.

Long description
Une carte montrant le réseau d'aires protégées et conservées du Canada par catégorie de gestion de l'UICN. Les aires protégées et conservées sont décrites comme l'une des catégories suivantes :
- Catégorie Ia de l'UICN
- Catégorie Ib de l'UICN
- Catégorie II de l'UICN
- Catégorie III de l'UICN
- Catégorie IV de l'UICN
- Catégorie V de l'UICN
- Catégorie VI de l'UICN
- Non classé dans le cadre de l'UICN
Autres mesures de conservation efficaces par zone

Long description
Un graphique à barres montrant la couverture des aires protégées par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories, de haut en bas, sont les suivantes :
- Parc national (catégorie II)
- Réserves intégrales (catégorie Ib)
- Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles (catégorie VI)
- Zone de gestion de l'habitat et de l'espèce (catégorie IV)
- Réserve naturelle intégrale (catégorie V)
- Monument ou élément national (catégorie III)
- Non classifié (c.-à-d. est admissible aux qualifications de l'UICN mais n'a pas été attribué)
- Autres mesures de conservation efficaces par zone (non applicables aux qualifications de l'UICN)
Pour les aires terrestres protégées :
- La grande majorité (95 % de la superficie) des aires terrestres protégées du Canada appartient aux catégories Ia à IV, catégories qui tendent à se concentrer sur le maintien des conditions naturelles.
- Les aires de catégorie II (parcs nationaux) représentent la plus grande proportion des aires terrestres protégées (60,2 %). Dans ces dernières, l’accès du public et les activités récréatives sont généralement autorisés.
- La deuxième plus grande proportion des aires terrestres protégées, avec 31,1 %, est classée dans la catégorie Ib (zones de nature sauvage). Il s’agit majoritairement de grands refuges d’oiseaux migrateurs fédéraux, principalement situés dans le nord, ainsi que de parcs provinciaux et territoriaux. La gestion de ces aires est axée sur le maintien des conditions naturelles. L’accès du public peut être autorisé, mais les infrastructures construites sont généralement minimes.
Pour les aires marines protégées :
- Un pourcentage de 7,8 % des aires marines protégées au Canada est classifié dans les catégories Ia à IV.
- La plus grande proportion des aires marines protégées (68 % de la superficie) n’est pas classifiée.
- La deuxième catégorie la plus étendue (23 % de la superficie) est la catégorie VI (aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles).
Perspective internationale
À l’échelle mondiale, à la fin de 2020, 16,6 % des aires terrestres et des eaux intérieures et 7,7 % des aires marines étaient classifiées comme aires protégées et de conservationNote de bas de page 31 .

Long description
Un graphique à barres montrant le pourcentage de la superficie mondiale conservée par rapport aux objectifs mondiaux de 2020. Les deux barres supérieures représentent le biome terrestre, et les deux barres inférieures représentent le biome marin. La barre supérieure de chaque biome représente la zone de conservation (y compris l'aire protégée) et la barre inférieure ne représente que la zone protégée. Un petit point représente la cible pour la zone protégée et conservée pour chaque biome.
En mai 2021, seuls cinq pays avaient soumis des AMCEZ à la base de données mondiale sur les autres mesures de conservation efficaces par zone. Le Canada comptait pour 22 % de la superficie totale des AMCEZ. Les efforts entrepris pour reconnaître les AMCEZ ont permis d’accroître considérablement la couverture terrestre depuis 2019. Cependant, la protection des aires terrestres a été dépassée par la croissance de la protection des eaux côtières et des océans. Cela est dû principalement à la désignation d’un nombre croissant de très grandes aires marines protégées. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie, la protection de 8,8 millions de km2 supplémentaires ayant été promise ou planifiée au début de 2021, alors que seulement cinq aires marines protégées avaient été proposées initialementNote de bas de page 31 .
Une comparaison avec dix pays, basée sur les données de la base de données mondiale sur les aires protégées, aide à comprendre la position du CanadaNote de bas de page 32 . Les pays sélectionnés sont les autres pays du G7 (France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), l’Australie (dont la densité de population et l’étendue territoriale sont similaires à celles du Canada), la Fédération de Russie (un grand pays nordique) et la Suède (climat similaire). Le Canada s’est classé quatrième sur dix pays en ce qui concerne la superficie terrestre totale protégée, derrière la Fédération de Russie, l’Australie et les États-Unis. Les résultats pour le Canada sont les suivants :
- Le Canada s’est classé au neuvième rang sur dix pays en ce qui concerne le pourcentage de la superficie terrestre protégée.
- Le Canada s’est classé quatrième sur dix pays en ce qui concerne la superficie marine totale protégée.
- Le Canada s’est classé huitième sur dix pays en ce qui concerne le pourcentage de son territoire marin qui est protégé.
Les résultats pour le Canada, présentés ici en utilisant uniquement des sources de données internationales, ne sont pas aussi actuels ou complets que les données nationales pour le Canada présentées ailleurs dans ce rapport. Toutefois, ces renseignements fournissent une base de comparaison entre les pays.
Chapitre 2 : Planification des aires protégées et de conservation : objectifs, stratégies et engagements
Le Canada a une longue tradition de planification et de création d’aires protégées. Le Canada a créé son premier parc municipal (Mont-Royal) à Montréal en 1872. Quinze ans plus tard, le Parlement du Canada a promulgué la Loi sur le parc des Montagnes-Rocheuses, créant ainsi le parc national Banff, alors connu sous le nom de « parc national des montagnes Rocheuses ». Les parcs nationaux ont été créés à des fins récréatives et touristiques. Parallèlement, le concept de mise en réserve d’aires pour la protection de l’environnement naturel est apparu. En juin 1877, deux semaines avant la promulgation de la Loi sur le parc des Montagnes-Rocheuses, le gouverneur en conseil a déclaré le lac Last Mountain en tant que refuge pour les oiseaux sauvages; il s’agissait du premier refuge d’oiseaux fédéral d’Amérique du Nord.
En 1911 et en 1930, la Division des parcs du Dominion (aujourd’hui Parcs Canada) et la Loi sur les parcs nationaux ont été créées pour superviser le réseau de parcs nationaux. À l’époque, le mandat établi par la Loi sur les parcs nationaux mettait autant l’accent sur les loisirs publics que sur la conservation de la faune et de la flore. Les outils législatifs ultérieurs, tels que la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1917), la Loi sur les espèces sauvages du Canada (1973) et les révisions de 2000 de la Loi sur les parcs nationaux ont permis au Canada de réglementer la chasse aux oiseaux migrateurs transcontinentaux, de mettre en place des mesures de conservation axées sur la protection de la faune et de faire de l’intégrité écologique la principale priorité de la gestion des parcs nationaux.
À la lumière des investissements et des cadres importants développés au cours des 20 dernières années pour la conservation de la nature, une approche pancanadienneNote de bas de page 25 a été élaborée en 2018 pour soutenir les progrès vers la réalisation des objectifs de conservation des zones terrestres et des eaux intérieures à l’aide des moyens suivants :
- mettre en œuvre (et si possible améliorer) les programmes, les plans et les stratégies de création d’aires protégées du Canada en reconnaissant l’importance d’étendre les aires protégées pour atteindre l’objectif 1 du Canada;
- prendre en compte les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) dans les normes pancanadiennes et reconnaître leur contribution à l’objectif 1 du Canada.
Comme suite au chapitre précédent, le chapitre 2 examine plus en détail les objectifs et les engagements relatifs aux aires protégées et de conservation, à l’échelle des provinces et des territoires. Il donne un aperçu des lois, des mesures de planification, des collaborations et des objectifs importants pour soutenir la conservation (biodiversité, connectivité des habitats, atténuation des changements climatiques, etc.). Il met également en lumière certains défis liés à la création d’aires protégées et de conservation.
Objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
Outre les objectifs nationaux du Canada, les provinces et les territoires ont leurs propres objectifs de conservation par zone (voir tableau 1). Les objectifs de certaines provinces et de certains territoires reflètent l’objectif 1 du Canada (conservation de 17 % des zones terrestres et de 10 % des zones marines d’ici 2020), mais la plupart ne le font pas.
Administration |
Objectifs |
Date d’adoption |
Date cible |
|---|---|---|---|
Colombie-Britannique |
17 % des zones terrestres |
2015 |
2020 |
Manitoba |
12 % des régions naturelles |
1993 |
Sans date |
Nouveau-Brunswick |
10 % du Nouveau-Brunswick |
2019 |
2023 |
Nouvelle-Écosse
|
12 % des zones terrestres |
2007 |
2015 |
1 % supplémentaire au-delà de 12 % (soit 13 %) des zones terrestres |
2015 |
2016 |
|
Ontario |
50 % des zones terrestres et des eaux intérieures du Grand Nord |
2010 |
Sans date |
Île-du-Prince-Édouard |
7 % |
1991 |
Sans date |
Québec
|
17 % des zones terrestres |
2015 |
2020 |
10 % des zones marines |
2015 |
2020 |
|
20 % de la zone visée par le Plan Nord |
2015 |
2020 |
|
50 % de la zone visée par le Plan Nord |
2015 |
2035 |
|
Saskatchewan |
12 % dans chacune des 11 écorégions |
1997 |
Sans date |
Yukon |
Objectif de représentation des écorégions dans la Loi sur les parcs et la désignation foncière |
2002 |
Sans date |
Canada
|
25 % des zones terrestres et des eaux intérieures |
2020 |
2025 |
25 % des zones côtières et marines |
2020 |
2025 |
|
30 % des zones terrestres et des eaux intérieures |
2020 |
2030 |
|
30 % des zones côtières et marines |
2020 |
2030 |
Administration |
Engagement ou plan |
|---|---|
Territoires du Nord-Ouest |
Dans le document Territoire en santé, population en santé, publié en 2016, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) s’est engagé à créer Thaidene Nëné (26 300 km2, y compris la réserve de parc national). Il s’est également engagé à mener à bien des exercices de planification dans d’autres régions (Ts'udé Nilįné Tuyeta, Dınàgà Wek'èhodì, Edéhzhíe, Sambaa K'e, Ka'a'gee Tu, Łue Túé Sųlái et Ejié Túé Ndáde). Lorsque la Loi sur les aires protégées a été officiellement promulguée en 2019, le GTNO s’est engagé à évaluer trois aires candidates au titre de cette loi : Thaidene Nëné (9 105 km2), Ts'udé Nilįné Tuyeta (10 060 km2) et Dınàgà Wek'èhodì (790 km2). En 2020, la plus grande partie de l’aire Thaidene Nëné (23 085 km2) a été établie. |
Nunavut |
Le Nunavut a annoncé la création du parc territorial Agguttinni (14 047 km2) en 2019, le plus grand parc relevant de la compétence de ce gouvernement territorial. La planification du parc territorial Kingngaaluk (13 km2) à Sanikiluaq a débuté en 2010, et un comité mixte de planification et de gestion composé de membres du comité local a vu le jour en 2016. Le processus de planification de ce parc a été récompensé par l’Association des architectes paysagistes du Canada pour son approche coopérative. Le gouvernement du Nunavut n’appuie pas la création de nouvelles aires protégées, proposées, provisoires ou autres sur son territoire avant la conclusion des négociations finales sur le transfert des responsabilités et la conclusion d’une entente sur le pétrole et le gaz en zones extracôtières. |
Yukon |
Les gouvernements du Yukon, les Tr'ondëk Hwëch'in, la Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun, la Première Nation des Gwitchin Vuntut et le Conseil tribal des Gwich'in ont finalisé le Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel en 2019. Ce plan désigne une grande partie (55 851 km2) du bassin hydrographique en tant qu’aire de conservation qui favorise la protection écologique et culturelle et le maintien à long terme des caractéristiques de la nature sauvage. En 2019, le gouvernement du Yukon et les Tr'ondëk Hwëch'in ont créé la Commission d’aménagement des terres de Dawson. Cette dernière se mobilisera auprès du public et travaillera avec les gouvernements du Yukon et des Tr'ondëk Hwëch'in afin d’élaborer un plan pour la conservation et l’utilisation future des terres dans la région. La Stratégie sur les parcs du Yukon, signée en 2020, fournit des orientations stratégiques qui permettront d’assurer de façon viable les bienfaits des parcs : des terres, une population et une économie saines. |
Nouveau-Brunswick |
Le Nouveau-Brunswick s’est engagé à protéger le bassin versant de la Restigouche (15 342 km2) en 2010 et a entrepris des consultations publiques pour cette zone en 2019. Il s’est également engagé à protéger le mont Shepody (510 km2) dans le sud de la province. |
Nouvelle-Écosse |
La Nouvelle-Écosse a poursuivi la mise en œuvre du plan sur les parcs et les aires protégées de 2013 et s’est engagée à élaborer une nouvelle stratégie pour atteindre 20 % d’ici 2030. Des dizaines de nouvelles aires protégées et de conservation ont été déclarées dans la BDCAPC. |
Saskatchewan |
Le processus de planification de l’utilisation des terres de la Saskatchewan, qui commande de consulter les titulaires de droits et de collaborer avec eux, a permis de déterminer quelles aires sont importantes pour la protection et la conservation. Aucun autre détail n’a été fourni par la Province. |
Manitoba |
Le Manitoba n’a pas annoncé de nouveaux engagements ou plans pour étendre son réseau d’aires protégées et de conservation. |
Ontario |
En 2017, l’Ontario a créé un nouveau parc provincial, le parc provincial Brockville Long Swamp Fen (de la catégorie réserve naturelle), et a modifié les limites de 23 autres parcs provinciaux et réserves de conservation. Ces changements ont permis d’ajouter 41 km2 au réseau provincial d’aires protégées de l’Ontario. |
Terre-Neuve-et-Labrador |
Terre-Neuve-et-Labrador a ciblé 33 sites candidats pour des aires protégées et de conservation, et prévoit des consultations publiques comme prochaines étapes. |
Colombie-Britannique |
La Colombie-Britannique a signé un protocole d’accord en vue de la création d’une réserve de parc national dans la région Okanagan Sud-Similkameen. La Province a également commencé à moderniser sa planification de l’utilisation des terres en 2017 afin d’obtenir des résultats en matière de conservation, d’économie et de réconciliation avec les peuples autochtones. |
Alberta |
Aucun nouvel engagement n’a été pris au cours de la période visée par le rapport. Toutefois, les plans régionaux approuvés précédemment, tels que le Lower Athabasca Regional Plan, comportaient encore des engagements visant à établir ou à agrandir un total de 11 aires protégées, couvrant 2 410 km2 (et 12 aires de loisirs provinciales supplémentaires, couvrant 512 km2). |
QuébecNote de bas de page 20 |
Le Québec a annoncé qu’il avait atteint son objectif de protéger 17 % de son territoire terrestre et d’eau douce avant la fin de 2020Note de bas de page 33 . Cela a été rendu possible par la désignation de 34 réserves de territoire aux fins d’aires protégées (RTFAP) couvrant 12 647 km², auxquelles s’ajoutent de grandes aires protégées (île d’Anticosti, Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan) couvrant 96 000 km². |
Île-du-Prince-Édouard |
L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas annoncé de nouveaux engagements ou plans pour étendre son réseau d’aires protégées et de conservation. |
Le Québec annonce une protection de 17 % d’ici la fin de 2020
Le 17 décembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il avait atteint son engagement de protéger 17 % de son territoire terrestre et d’eau douce avant la fin de 2020Note de bas de page 35 . Cela a été rendu possible grâce à la désignation de 34 réserves de territoire aux fins d’aire protégée (RTFAP) ainsi qu’à d’autres désignations. Le Québec est la deuxième province à atteindre cette étape, après la Colombie-Britannique. La superficie protégée totale déclarée du Québec (257 528 km2) est plus grande que le Royaume-Uni et se classe au premier rang du pays pour la taille absolue des aires protégées.Note de bas de page 34
Lois relatives aux aires protégées et de conservation
Toutes les administrations du Canada ont élaboré un large éventail d’outils législatifs et réglementaires pour l’établissement et la gestion des aires protégées. Ces outils sont divers, ce qui peut conduire à une variété de désignations possibles, par exemple les parcs nationaux, les parcs provinciaux, les réserves d’espèces sauvages, les aires de conservation, les pâturages patrimoniaux, les réserves naturelles privées, les sanctuaires et les parcs marins. À l’heure actuelle, il existe 56 lois distinctes qui sont utilisées, ou qui pourraient être utilisées, pour établir des aires terrestres et marines protégées au Canada (tableau 3). Certaines aires font l’objet d’une double désignation afin d’atteindre les objectifs de conservation dans les cas où une seule loi ne suffit pas à protéger toutes les valeurs d’un site.
Administration |
Types d’aires protégées |
Nombre de lois |
|---|---|---|
Gouvernement fédéral |
6 |
6 |
Alberta |
8 |
3 |
Colombie-Britannique |
6 |
5 |
Manitoba |
6 |
7 |
Nouveau-Brunswick |
2 |
2 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
6 |
4 |
Territoires du Nord-Ouest |
3 |
3 |
Nouvelle-Écosse |
4 |
5 |
Nunavut |
1 |
2 |
Ontario |
4 |
3 |
Île-du-Prince-Édouard |
3 |
3 |
Québec |
14 |
5 |
Saskatchewan |
10 |
5 |
Yukon |
4 |
2 |
Total |
77 |
56 |
De 2016 à 2020, plusieurs mises à jour des lois habilitantes provinciales, territoriales et fédérales relatives aux aires terrestres et marines protégées et de conservation ont été effectuées; elles sont résumées ci-dessous :
- Le Manitoba a mis à jour Loi sur les terres domaniales pour permettre la désignation de pâturages communautaires, bien qu’aucun pâturage communautaire n’ait été déclaré en date de décembre 2020. Les pâturages communautaires favorisent le pâturage et la fenaison sur les terres d’une manière qui maintient et conserve l’intégrité écologique et la biodiversité naturelle de la région.
- Le Nouveau-Brunswick a apporté des modifications administratives à un règlement en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées afin de remplacer les cartes administratives par des cartes plus précises.
- Les Territoires du Nord-Ouest ont fait entrer en vigueur la Loi sur les aires protégées en 2019. Cette nouvelle loi a regroupé les autorités responsables des aires protégées en un seul texte législatif (en supprimant les classifications des aires protégées de la Loi sur les parcs territoriaux). Elle permet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de conclure des accords juridiques de cogestion des aires protégées avec les gouvernements et les organisations autochtones.
- La Nouvelle-Écosse a apporté plusieurs modifications au Wilderness Areas Protection Act en 2019 afin de permettre l’établissement de stationnements dans les aires de nature sauvage, de désigner deux pistes supplémentaires pour les véhicules hors route dans deux aires de nature sauvage et de permettre l’octroi de permis d’accès par véhicule motorisé aux propriétaires privés qui ne sont que partiellement entourés d’une aire de nature sauvage.
- L’Ontario a modifié la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation afin d’améliorer la gestion de l’utilisation et de l’occupation des terres par des tiers, de simplifier la formulation des plans de gestion et d’actualiser les méthodes de gestion financière.
- Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a modifié le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en 2020. Cette modification vise à interdire les activités susceptibles de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage – mort ou vivant –, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage. Cette interdiction a été élargie dans le règlement modifié pour inclure l’ensemble des espèces sauvages et de leurs résidences ou habitats.
- Parcs Canada a modifié la Loi sur les parcs nationaux du Canada en y ajoutant des dispositions mineures concernant l’application de la loi et en ajustant les limites des aires de ski dans le parc national Banff.
- Pêches et Océans Canada (MPO) a apporté des modifications à la Loi sur les océans dans le cadre du projet de loi C-55, qui a reçu la sanction royale le 27 mai 2019. Ces modifications comprenaient l’ajout de la possibilité d’une protection provisoire par le biais d’un arrêté ministériel, des mises à jour des dispositions d’application et l’inclusion d’un principe de précaution.
Avec la reconnaissance des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) marines et des AMCEZ terrestres en 2017 et en 2018, respectivement, plusieurs provinces, territoires et organismes du gouvernement fédéral ont mis en place une politique permettant la reconnaissance des AMCEZ terrestres et marines. Contrairement aux aires protégées, les AMCEZ terrestres ne nécessitent pas d’outils législatifs pour être reconnues, car tout mécanisme conduisant à la conservation efficace et à long terme de la biodiversité peut être utilisé et reconnu. Toutefois, des outils législatifs sont nécessaires dans les AMCEZ marines. Étant donné que le terme « AMCEZ » est un terme politique et qu’il peut inclure une variété d’activités autres que la conservation, il n’existe pas de politique ou de loi unique pour les AMCEZ marines dans quelque administration que ce soit.
Planification du réseau et stratégies
La conservation de la biodiversité dépend non seulement de la protection d’une quantité suffisante d’habitats, mais aussi de la protection d’aires pertinentes, de sorte que les aires protégées et de conservation puissent fonctionner ensemble comme un réseau écologique. Les stratégies, y compris les stratégies systématiques et les cadres de planification, aident les administrations à établir un ensemble d’aires protégées et de conservation, tant à l’échelle nationale qu’au sein d’une région donnée, qui fonctionnent collectivement pour protéger les espèces, les habitats et leurs interactionsNote de bas de page 25 .
Planification du réseau et planification du système
Les termes « planification du réseau » et « planification du système » sont parfois utilisés de manière interchangeable dans le présent rapport. Un système est un ensemble de sites individuels gérés séparément, mais présentés comme un tout à des fins de rapports ou de planificationNote de bas de page 37 . Un réseau est un ensemble de sites qui fonctionnent en collaboration et en synergie et qui ont été créés et sont gérés en vue d’atteindre les objectifs écologiques d’une manière plus collective et plus exhaustive que ne le feraient des sites individuelsNote de bas de page 38 .
Les mises à jour concernant l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies à l’échelle provinciale, territoriale et fédérale sont résumées ci-dessous et dans la Figure 1. Les réponses sont basées sur le questionnaire du rapport sur la situation, envoyé à 13 provinces et territoires ainsi qu’à trois entités fédérales de conservation (ECCC, Parcs Canada et MPO).

Long description
Un tableau montrant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies relatives aux aires protégées et conservées. Le tableau compare l'état de ces stratégies dans chaque administration en 2006, 2011, 2015 et 2020, en attribuant à chaque administration l'un des statuts suivants pour chaque année :
- Mise en œuvre complète
- Mise en œuvre substantielle
- Partiellement mis en œuvre
- En cours d'élaboration
- Aucune stratégie en place
- Aucune donnée disponible
- Stratégie nouvelle ou révisée
Aires terrestres protégées et de conservation
- Sur les 13 provinces et territoires, huit (61 %) avaient mis en place une stratégie pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un réseau (Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Ontario, Québec et Saskatchewan). Le Manitoba et le Québec mettaient à jour leurs stratégies, tandis que le Yukon élaborait un plan de système de parcs dans le cadre de la Stratégie sur les parcs. La Nouvelle-Écosse, le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard n’avaient pas de stratégie en place au moment de la rédaction du rapport. En Colombie-Britannique, la stratégie pour les aires protégées a été révoquée et les aires protégées ont été agrandies de manière ponctuelle.
- Parmi les provinces et territoires ayant mis en place une stratégie :
- Sept (87 %) ont déclaré que la planification de leur réseau était basée sur un cadre écologique (Alberta, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Ontario et Québec).
- Trois (37 %) ont indiqué que leur stratégie avait été substantiellement mise en œuvre (Alberta, Ontario et Québec), et trois (37 %) ont indiqué que leur stratégie avait été partiellement mise en œuvre (Nouveau-Brunswick, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan). Le Manitoba a indiqué que la mise en œuvre de sa stratégie actualisée n’avait pas encore commencé. Terre-Neuve-et-Labrador a publié une stratégie en 2020.
- Au sein du gouvernement fédéral, ECCC a indiqué que sa stratégie était en cours d’élaboration et partiellement mise en œuvre, tandis que Parcs Canada a déclaré que sa stratégie était élaborée et substantiellement mise en œuvre. ECCC et Parcs Canada ont tous deux indiqué que la planification de leur réseau était basée sur un cadre écologique.
Protéger la rivière Peel
En août 2019, après 15 ans de négociations, de consultations, de protestations et de contestations judiciaires allant jusqu’à la Cour suprême du Canada, le gouvernement du Yukon, les Premières Nations de Na-Cho Nyäk Dun, les Tr'ondëk Hwëch'in, les Gwitchin Vuntut et le Conseil tribal des Gwich'in se sont réunis pour approuver conjointement le Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel. Dans le cadre de ce plan, 55 % du bassin hydrographique, soit 3,7 millions d’hectares, seront protégés de manière permanente par divers mécanismes. Vaste aire de nature sauvage presque intacte, le bassin de la rivière Peel abrite six cours d’eau importantes, est peu développé et ne compte aucun résident humain permanent. Soutenu en partie par le financement du Défi de l’objectif 1 du Fonds de la nature du Canada, le bassin de la rivière Peel, dans le nord-est du Yukon, deviendra l’un des plus grands complexes d’aires protégées du Canada, protégeant l’habitat de 15 espèces en péril, dont le caribou de la toundra et le caribou boréal.Note de bas de page 29

Photo : Gouvernement du Yukon, 2019.
Long description
Photo d’un groupe de 20 personnes, y compris des chefs des Premières Nations et des membres du conseil tribal, dans une tente souriant pour l’établissement officiel du bassin versant de la rivière Peel.
Aires marines protégées et de conservation
- Sur les sept provinces et territoires qui déclarent des aires marines protégées et de conservation (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Manitoba, Colombie-Britannique), deux (29 %) ont mis en place des stratégies qui ont été soit partiellement mises en œuvre (Colombie-Britannique), soit substantiellement mises en œuvre (Québec). Les deux provinces ont indiqué que la planification de leur réseau était basée sur un cadre écologique. Les autres provinces et territoires n’ont pas mis en place de stratégies. Cependant, les aires marines protégées et de conservation du Manitoba sont généralement une composante d’aires terrestres protégées et de conservation plus vastes.
- Au sein du gouvernement fédéral, ECCC a indiqué que sa stratégie était en cours d’élaboration et partiellement mise en œuvre, tandis que le MPO et Parcs Canada avaient des stratégies en place et partiellement mises en œuvre. Le MPO et Parcs Canada ont tous deux indiqué que la planification de leur réseau était basée sur un cadre écologique.
Coordination fédérale du réseau marin
Pour assurer la coordination des efforts, la planification par les trois autorités fédérales compétentes en matière d’aires protégées (ECCC, MPO et Parcs Canada) est guidée par la Stratégie fédérale sur les aires marines protégées. Cette stratégie vise à contribuer à la santé des océans du Canada grâce à un cadre de gestion intégrée des océans et à une collaboration renforcée.
De plus, le Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada fournit une orientation stratégique conforme aux meilleures pratiques internationales et contribue à la réalisation d’objectifs plus larges en matière de conservation et de développement durable, définis dans les processus de planification spatiale marine.
Collaboration intergouvernementale
La plupart des collaborations intergouvernementales concernant les aires protégées ont eu lieu entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux, ainsi qu’avec les gouvernements autochtones (le chapitre 5 décrit plus en détail la collaboration avec les gouvernements autochtones). Un plus petit nombre de collaborations ont lieu entre des provinces ou des territoires adjacents et entre le gouvernement fédéral et les États-Unis pour établir ou gérer des aires protégées transfrontalières interprovinciales ou internationales (tableau 5).
Biome |
Projet/réseau |
Partenaires |
Description |
|---|---|---|---|
Terrestre |
Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et divers États américains, organismes à vocation environnementale, établissements universitaires et autres groupes et personnes |
Cette initiative vise à protéger les paysages naturels, la faune et la flore et les populations dans une aire qui s’étend dans quatre administrations canadiennes, cinq États américains et au moins 75 territoires autochtones. Elle atteint ces objectifs en protégeant l’habitat principal, en donnant la priorité à la connectivité des habitats et en encourageant les gens à contribuer aux efforts de conservation. |
|
Réseau d’aires protégées des Grands Lacs |
Parcs Canada, NOAA, US National Park Service, Parcs Ontario |
Le Réseau d’aires protégées des Grands Lacs est un réseau informel qui facilite la discussion et la progression des réseaux de conservation au Canada et aux États-Unis. |
|
Crown Managers Partnership |
Colombie-Britannique, Alberta, Montana, Idaho, Parcs Canada |
Ce partenariat américano-canadien vise à améliorer la gestion de l’écosystème de la Couronne du continent, un écosystème de 73 000 km2 qui s’étend sur le sud‑ouest de l’Alberta, le sud-est de la Colombie-Britannique et le nord du Montana. Pour ce faire, il convient d’aborder les problèmes qui se posent dans l’ensemble de ce paysage, en collaboration avec les Premières Nations. |
|
Colombie-Britannique et État de Washington |
La limite sud du parc E. C. Manning borde le parc national North Cascades aux États-Unis, tandis que le parc provincial Skagit Valley est adjacent à la limite ouest du parc E. C. Manning. Ensemble, ces aires protégées forment un grand bloc d’habitat qui peut contribuer à la survie de la population d’ours grizzlis du parc national North Cascades, population présente des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Canada. |
||
Complexe Kluane/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek |
Colombie-Britannique, Parcs Canada et US Forest Service |
Un site du patrimoine mondial et un complexe composé de quatre grandes aires protégées situées de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ce complexe est géré en collaboration avec les Premières Nations. |
|
Espèces marines |
Framework for a Pan-Arctic Network of Marine Protected Areas |
Entités fédérales (y compris le MPO), États membres du Conseil de l’Arctique (notamment le Groenland/Danemark, l’Islande, la Norvège, la Russie et les États-Unis) |
Le réseau pan-arctique d’aires marines protégées (AMP) vise à protéger et à restaurer la biodiversité marine, le patrimoine culturel et les ressources de subsistance. Il y parviendra en offrant de l’information pour le développement de réseaux d’AMP et d’AMCEZ dans les États de l’Arctique. |
MPO, États-Unis, Mexique |
Le projet NAMPAN vise à préserver les aires marines et côtières d’Amérique du Nord grâce à une collaboration trinationale. Le projet met l’accent sur la conservation de la biodiversité tout en tenant compte des questions écologiques, économiques, sociales et culturelles. |
||
Pikialasorsuaq (polynie des eaux du Nord) |
MPO, Groenland, Danemark |
Pikialasorsuaq est une polynie, étendue d’eau demeurant non gelée toute l’année et entourée de glace de mer, qui est située au nord de la baie de Baffin. Pikialasorsuaq soutient les activités essentielles de nombreuses espèces. Ces eaux relèvent de la compétence du Canada et du Groenland, qui collaborent à la protection et à la conservation de la zone. |
|
North Pacific Landscape Conservation Cooperative |
Colombie-Britannique, divers organismes fédéraux canadiens et américains, certains États, Premières Nations, établissements universitaires et organisations non gouvernementales (ONG) |
Cette initiative vise à rassembler les données et les ressources relatives à la conservation dans la région du Pacifique Nord, dans le but de soutenir la conservation à l’échelle du paysage dans la région. |
Biome |
Projet/réseau |
Partenaires |
Description |
|---|---|---|---|
Terrestre |
En route vers l’objectif 1 (et projets financés par le Défi de l’objectif 1) |
Gouvernement du Canada, toutes les provinces et tous les territoires à l’exception du QuébecNote de bas de page 39 , Assemblée des Premières Nations, Ralliement national des Métis, diverses ONG |
L’objectif 1 du Canada est de conserver 17 % des zones terrestres (y compris les eaux intérieures) et 10 % des zones marines (y compris les zones côtières) grâce aux aires protégées et aux AMCEZ d’ici 2020. Le Défi de l’objectif 1 du Canada finance des projets dans tout le pays. Ces projets visent soit à créer de nouvelles aires protégées dans un avenir proche, soit à renforcer les capacités qui permettront de soutenir les aires protégées et de conservation à plus long terme. Par exemple, il peut s’agir d’améliorer la connectivité, d’apporter des bénéfices aux espèces en péril ou de faire progresser la conservation menée par les Autochtones. |
Thaidene Nëné |
Première Nation des Dénés Łutsël K'é, Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, Première Nation Deninu Kųę et Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, gouvernement du Canada, Territoires du Nord-Ouest |
Thaidene Nëné est une aire protégée autochtone des Territoires du Nord-Ouest qui s’étend sur 26 300 km2. Elle est gérée par des gouvernements autochtones pour qui la zone revêt une importance culturelle. |
|
South of the Divide |
Saskatchewan, Saskatchewan Stock Growers Association, Saskatchewan Cattlemen’s Association, Crescent Point Energy, Ranchers Stewardship Alliance, SaskPower, Conservation de la nature Canada et Saskatchewan Association of Rural Municipalities |
Le South of the Divide Conservation Action Program Inc. réunit le gouvernement et divers autres intervenants pour travailler à la réalisation des objectifs du South of the Divide Multi-Species Action Plan. Ce plan est axé sur la conservation de 13 espèces en péril, dont des espèces en voie de disparition et menacées, en tenant compte de leurs interactions. |
|
Conseil canadien des parcs |
Toutes les agences des parcs des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada |
Le Conseil canadien des parcs favorise les liens et la collaboration entre les différentes agences des parcs au Canada. Cela leur permet de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. |
|
Coastal Islands Prioritization Toolkit |
Nouvelle-Écosse, ECCC, Nova Scotia Nature Trust, Conservation de la nature Canada et autres membres du Kespukwitk Conservation Collaborative |
Les collaborateurs ont créé une base de données sur les données spatiales, l’état des îles, la biodiversité et les pressions subies par de nombreuses îles côtières de la Nouvelle-Écosse. Cette boîte à outils a été conçue pour soutenir la prise de décisions en matière de conservation des îles côtières, et elle a également permis de renforcer le dialogue entre les organisations travaillant à la conservation des îles. |
|
Réseau des rivières du patrimoine canadien |
Gouvernement fédéral, diverses provinces et divers territoires, divers groupes communautaires et autorités de conservation |
Il s’agit d’un réseau de 41 rivières reconnues pour leur patrimoine culturel, naturel et récréatif. Diverses organisations et personnes agissent à titre de gardiens de ces rivières. |
|
Parc interprovincial Kakwa-Willmore |
Colombie-Britannique, Alberta |
Ce parc interprovincial comprend le parc provincial Kakwa Wildland et le parc sauvage Willmore, en Alberta, ainsi que le parc provincial Kakwa, en Colombie-Britannique. Les deux provinces collaborent à la gestion des ressources et à la planification du parc. |
|
Parc interprovincial de Cypress Hills |
Alberta, Saskatchewan, Parcs Canada |
Ce parc interprovincial se trouve en Alberta et en Saskatchewan. |
|
Initiative Beaver Hills |
Alberta, Parcs Canada, divers groupes environnementaux, universitaires et municipaux |
Cette initiative aborde des questions liées au développement, à la planification de l’utilisation des terres, à la durabilité économique et à la conservation de l’environnement dans la moraine de Beaver Hills. |
|
Site du patrimoine mondial Pimachiowin Aki |
Première Nation de Bloodvein River, Première Nation de Little Grand Rapids, Première Nation de Pauingassi, Première Nation de Poplar River |
Pimachiowin Aki est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui a été reconnu comme un site « mixte », car il possède à la fois des valeurs naturelles et culturelles. |
|
Aire de nature sauvage interprovinciale Manitoba-Ontario |
Manitoba, Ontario |
Cette aire de nature sauvage interprovinciale englobe le parc provincial Atikaki et une partie du parc provincial Nopiming au Manitoba, ainsi que la réserve de conservation Eagle-Snowshoe et le parc provincial Woodland Caribou en Ontario. Le Manitoba et l’Ontario collaborent à la gestion des ressources, à la recherche et aux loisirs dans l’aire de nature sauvage afin d’assurer une conservation efficace de cet important écosystème de la forêt boréale. |
|
Complexe des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes |
Colombie-Britannique, Alberta, Parcs Canada |
Ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO comprend les parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho ainsi que les parcs provinciaux Mount Robson, Mount Assiniboine et Hamber. Les différents parcs et leurs autorités respectives collaborent à des éléments transfrontaliers tels que la conservation des espèces en péril et la gestion des ressources, le cas échéant. Les parcs voisins collaborent à résoudre des problèmes communs tels que l’accès aux parcs ou la gestion des incendies de forêt. |
|
Marine |
Zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique |
Gouvernement du Canada, Colombie-Britannique, Premières Nations |
Cette collaboration fédérale-provinciale-Première Nation a abouti à un plan stratégique qui met en évidence les buts, les principes, les objectifs et les stratégies pour la région. Elle permettra d’orienter la planification et la gestion des ressources marines à l’avenir. |
Réseau d’AMP de la biorégion de la plate-forme Nord (BPN) |
ECCC, MPO, Parcs Canada, Colombie-Britannique, 17 Premières Nations |
Le réseau d’AMP de la BPN protège une grande variété d’habitats et d’espèces marines et, par extension, la communauté marine au sens large. |
|
Réseau d’AMP de la biorégion de l’Arctique de l’Ouest – Partenariat pour la mer de Beaufort |
Société régionale inuvialuite (SRI), Conseil inuvialuit de gestion du gibier (CIGG), MPO, Parcs Canada et ECCC |
Le MPO, Parcs Canada et ECCC dirigent la conception du réseau d’AMP dans la biorégion de l’Arctique de l’Ouest. Ce projet consiste à recueillir des données et à participer à la planification afin de repérer les aires d’importance écologique et culturelle dans la biorégion de l’Arctique de l’Ouest. À terme, ce projet vise à développer des outils de gestion des océans pour les aires prioritaires afin de parvenir à un équilibre entre la conservation et l’utilisation durable des ressources. |
|
Mise en place d’un réseau d’aires marines protégées au Québec |
Divers ministères du gouvernement du Québec, MPO, ECCC |
Cet accord fédéral-provincial vise à créer conjointement un réseau d’aires marines protégées près du fleuve Saint-Laurent, de la baie d’Hudson et de la baie James. Les parties gèrent le réseau en collaboration. |
|
Marine Plan Partnership for the North Pacific Coast (MaPP) |
Colombie-Britannique, 17 gouvernements des Premières Nations |
Cette initiative utilise les connaissances scientifiques ainsi que les connaissances locales et traditionnelles pour élaborer des plans d’utilisation du milieu marin pour la côte du Pacifique Nord en Colombie-Britannique. Les plans marins mis en œuvre dans le cadre du MaPP favoriseront les possibilités de développement économique durable, le renforcement des collectivités côtières et la protection des environnements marins. |
Collaborer pour la conservation en Nouvelle-Écosse
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et d’autres partenaires mettent en place de nouveaux réseaux pour transmettre les connaissances et faire avancer les travaux sur les aires protégées et de conservation dans toute la province.
Bénéficiant d’une subvention par l’intermédiaire du Défi de l’objectif 1 du Fonds de la nature du Canada, cette initiative collaborative mobilise les Mi’kmaq de Nouvelle-Écosse, des fiducies foncières, des partenaires municipaux, etc. Les actions clés consistent à explorer les possibilités de créer des aires protégées et de conservation autochtones (APCA), à conserver les habitats importants tels que les forêts anciennes et les milieux humides, à améliorer la protection de la qualité de l’eau et à renforcer la connectivité écologique.
Ce projet donne déjà des résultats intéressants en matière de collaboration et de conservation. En voici quelques exemples :
La protection de plus de 15 000 hectares de terres publiques dans 27 parcs et aires protégées, nouveaux ou agrandis.
Le lancement d’une grande campagne de protection des terres par la Nova Scotia Nature Trust, qui aspire à doubler son réseau de terres protégées d’ici 2023.
La publication d’un nouveau rapport sur les APCA par l’Institut des ressources naturelles de l’Unama'ki.
Une annonce de l’Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse présentant le travail lié aux APCA.
La protection de terres de conservation essentielles en Nouvelle-Écosse par Conservation de la nature Canada.Note de bas de page 29

Long description
Image d’une rivière sombre avec des rapides dans l’aire de nature sauvage du lac Archibald en Nouvelle-Écosse, entourée de forêt.
Objectifs de conservation pour la planification des aires protégées et de conservation
Cette section fait état des progrès réalisés par chaque autorité responsable vers l’atteinte des objectifs de conservation suivants :
- Diversité biologique (biodiversité)
- Représentation écologique
- Connectivité des habitats
- Grandes zones intactes ou non fragmentées
- Services écosystémiques
- Intégrité écologique
- Atténuation des changements climatiques et adaptation
- Soutien au leadership autochtone en matière de conservation ou de progression de la réconciliation
Certaines autorités ont des objectifs de conservation supplémentaires, notamment l’incitation aux loisirs, la protection des aires de valeur culturelle et historique, la protection des espèces en voie de disparition ou menacées, l’amélioration du stockage du carbone, la mise en œuvre de solutions basées sur la nature, la protection des aires d’approvisionnement en eau et l’atténuation des inondations. Pour les aires marines, les autres objectifs de conservation comprennent la préservation des lieux de pêche commerciale et non commerciale et la conservation d’habitats uniques. Toutefois, le présent document porte principalement sur les objectifs énumérés ci-dessus, étant donné qu’ils font l’objet d’un rapport systématique de la part des autorités responsables canadiennes.
La Figure 2 ci-dessous illustre l’ordre de priorité des objectifs de conservation pour les réseaux d’aires terrestres et marines protégées et de conservation, tel que déclaré par les provinces, les territoires et les organismes fédéraux. Des détails supplémentaires sur chaque objectif de conservation sont fournis dans les sections suivantes.

Long description
Un diagramme à barres montrant comment les compétences ont priorisé les objectifs de conservation pour les zones terrestres. Les objectifs étaient les suivants :
- Domaines représentatifs
- Diversité biologique
- Intégrité écologique
- Zones vastes, intactes ou non fragmentées
- Soutenir le leadership autochtone en matière de conservation ou faire progresser la réconciliation
- Adaptation aux changements climatiques
- Connectivité de l'habitat
- Atténuation des changements climatiques
- Services écosystémiques
Le graphique montre combien d'administrations (%) ont placé chaque objectif dans les catégories suivantes :
- Objectif principal de conservation
- Objectif de conservation secondaire
- Objectif de conservation mentionné
- L'objectif de conservation n'est pas reconnu
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres montrant comment les compétences ont priorisé les objectifs de conservation pour les aires marines. Les objectifs étaient les suivants :
- Diversité biologique
- Domaines représentatifs
- Intégrité écologique
- Zones vastes, intactes ou non fragmentées
- Soutenir le leadership autochtone en matière de conservation ou faire progresser la réconciliation
- Adaptation aux changements climatiques
- Services écosystémiques
- Connectivité de l'habitat
- Atténuation des changements climatiques
Le graphique montre combien d'administrations (%) ont placé chaque objectif dans les catégories suivantes :
- Objectif principal de conservation
- Objectif de conservation secondaire
- Objectif de conservation mentionné
- L'objectif de conservation n'est pas reconnu
- Inconnu
Conservation de la biodiversité
La diversité biologique, ou biodiversité, est la variété de la vie sur Terre, sous toutes ses formes, depuis les gènes et les bactéries jusqu’aux écosystèmes entiers tels que les forêts ou les récifs coralliens. En conservant la biodiversité, nous pouvons protéger le patrimoine naturel de notre planète et assurer sa résilience face aux changements environnementaux naturels et anthropiques. Le succès du Canada en matière de conservation de la biodiversité à long terme dépend non seulement de la protection d’un nombre suffisant d’habitats pour soutenir des populations viables de toutes les espèces, mais aussi de la protection des zones pertinentes. De plus, les aires protégées et de conservation doivent fonctionner en réseau et être représentatives d’une large gamme d’écosystèmesNote de bas de page 36 .
Zones clés pour la biodiversité
Les zones clés pour la biodiversité (ZCB; l’acronyme anglais « KBA » est aussi utilisé) sont des sites qui contribuent à la persistance de la biodiversité à l’échelle nationale et mondialeNote de bas de page 41 . Présentes dans les milieux terrestres, marins et d’eau douce, les ZCB abritent des espèces et des écosystèmes rares et menacés ainsi que des processus naturels clés. Les ZCB sont désignées en fonction de critères précis et mesurables. La désignation ne donne pas au site une prescription de gestion particulière ou un statut juridique. Les ZCB peuvent englober des terres privées ou publiques, et chevauchent parfois, partiellement ou totalement, des sites protégés par des lois.
Dans le cadre du groupe de travail de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sur la biodiversité et les aires protégées, les pays et les organisations de protection de la nature se sont réunis pour créer un nouveau système d’identification de ces zones. Ce système a été décrit dans la norme mondiale de l’UICN pour l’identification des ZCB et adopté en 2016.
En 2019, l’Initiative canadienne sur les KBA a été lancée dans le cadre du programme En route vers l’objectif 1 du Canada. Cette initiative a été conçue pour aider le Canada à atteindre les objectifs fixés en matière d’aires protégées et d’autres objectifs convenus dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Elle a été le point de départ du travail d’identification, de délimitation et d’examen des ZCB dans tout le pays. Ce travail est mené par la Coalition KBA canadienne, une initiative collaborative mobilisant des organisations non gouvernementales, des gouvernements, des partenaires autochtones, des établissements universitaires, des experts et des détenteurs de connaissances qui participent au travail d’identification, de délimitation et d’examen des ZCB.Note de bas de page 40
Au moyen d’un questionnaire, les autorités responsables ont été invitées à indiquer dans quelle mesure elles reconnaissaient la conservation de la biodiversité dans leurs buts, mandats ou objectifs de conservation, si elles disposaient de renseignements complets sur la biodiversité au sein de leur réseau, si elles évaluaient les progrès réalisés ou entreprenaient une analyse des lacunes par rapport à cet objectif, et si leur réseau était complet en ce qui a trait à la biodiversité. Voir les résultats dans les Figures 4 (biomes terrestres) et 5 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les administrations ont atteint les objectifs liés à la diversité biologique dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les administrations ont atteint les objectifs liés à la diversité biologique dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Représentation écologique
La conservation d’un échantillon représentatif de la diversité des écosystèmes naturels est essentielle à la conservation de la biodiversité que l’on trouve entre les écosystèmes et à l’intérieur de ceux-ciNote de bas de page 42 .
Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière de représentation écologique au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 6 (biomes terrestres) et 7 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à la représentation écologique dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à la représentation écologique dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Conservation des grandes zones intactes ou non fragmentées
L’objectif premier des aires protégées devrait être le maintien à long terme de la biodiversité, mais il faut reconnaître que de nombreuses aires protégées n’ont pas nécessairement été créées dans ce but. L’un des débats actuels dans le domaine de la biologie de la conservation consiste à déterminer si la meilleure façon d’atteindre cet objectif est de créer de vastes aires protégées, ou plusieurs petites aires protégées reliées entre ellesNote de bas de page 43Note de bas de page 44 . La réponse est probablement une combinaison des deux, mais elle dépend du contexte localNote de bas de page 45 . Cependant, un principe établi de la biogéographie insulaire est que la taille a une incidence sur l’efficacité d’une aire protégée à maintenir une diversité d’espèces au fil du temps. La plupart des organisations responsables d’aires protégées et de conservation reconnaissent la nécessité d’inclure de grandes zones intactes ou non fragmentées, mais le niveau d’importance de cet objectif varie.
Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière de conservation d’aires représentatives au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 8 (biomes terrestres) et 9 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les administrations ont atteint les objectifs liés à la conservation de vastes zones intactes ou non fragmentées dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un graphique à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à la conservation des grandes zones intactes ou non fragmentées dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Efforts pour maintenir l’intégrité écologique
Un écosystème présente une intégrité écologique lorsqu’il contient les éléments vivants et non vivants attendus dans sa région naturelle et que ses processus (les interactions qui assurent le fonctionnement d’un écosystème, par exemple les incendies, les inondations et la prédation) se produisent avec la fréquence et l’intensité attendues dans sa région naturelleNote de bas de page 46 . Au Canada, l’intégrité écologique est un objectif clé pour les parcs nationaux et, selon la Loi sur les parcs nationaux du Canada, elle est la priorité du ministre lorsqu’il examine tous les aspects de la gestion des parcs.
Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière d’intégrité écologique au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 10 (biomes terrestres) et 11 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à l'intégrité écologique dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à l'intégrité écologique dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Préserver la connectivité des habitats
La connectivité des habitats désigne la mesure dans laquelle les aires protégées et de conservation facilitent le déplacement des individus entre les habitats et permettent le fonctionnement de processus écologiques à grande échelleNote de bas de page 47 . En permettant la libre circulation des individus, la connectivité des habitats permet aux individus de trouver de la nourriture et des partenaires, ce qui favorise un flux génique sain.
Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière de connectivité des habitats au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 12 (biomes terrestres) et 13 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à la connectivité de l'habitat dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés à la connectivité de l'habitat dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Passages fauniques dans le parc national Banff
Lorsqu’il a été décidé que le tronçon de la route transcanadienne traversant ce parc de 6 641 km2 passerait de deux à quatre voies, la création de passages fauniques et les recherches connexes sont rapidement devenues une priorité absolue. Aujourd’hui, avec six passages supérieurs, 38 passages inférieurs et 82 km de clôtures routières, le parc national Banff possède le plus grand nombre de telles structures dans un seul parc au monde.Note de bas de page 29

Long description
Photo d’un passage pour la faune allant au-dessus d’une autoroute qui est bordée par la forêt sur les deux côtés.
Conservation des services écosystémiques
Les services écosystémiques sont les avantages que nous procurent nos systèmes naturels, individuellement et collectivement. Les services écosystémiques peuvent être catégorisés comme suit, selon le Système de comptabilité économique et environnementale des Nations UniesNote de bas de page 47 :
- Les services d’approvisionnement, qui représentent les contributions matérielles et énergétiques générées par ou dans un écosystème pour les activités économiques et humaines.
- Les services de régulation, qui résultent de la régulation du climat, des cycles hydrologiques et biochimiques, des processus de la surface terrestre et de divers processus biologiques par les écosystèmes.
- Les services culturels, qui sont générés par les paramètres physiques, les lieux ou les situations qui génèrent des avantages intellectuels et symboliques que les personnes tirent des écosystèmes grâce aux loisirs, au développement des connaissances, à la relaxation et à la réflexion spirituelle.
L’un des nombreux avantages des aires protégées est qu’elles contribuent à maintenir les processus écologiques qui génèrent des services écosystémiques. Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière de services écosystémiques au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 14 (biomes terrestres) et 15 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés aux services écosystémiques dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les compétences ont atteint les objectifs liés aux services écosystémiques dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Planification des aires protégées dans le contexte des changements climatiques
Par rapport aux périodes précédentes, les autorités responsables ont mis davantage l’accent sur l’atténuation des effets des changements climatiques au cours de la période 2016-2020. Les aires protégées et de conservation sont des outils essentiels pour atténuer les effets des changements climatiques et soutenir l’adaptation aux changements climatiquesNote de bas de page 49 . Elles peuvent contribuer à la résilience climatique en protégeant les biens et services écosystémiques qui atténuent les effets des changements climatiques. De plus, les mesures de gestion, y compris la remise en état des écosystèmes endommagés, peuvent renforcer l’adaptation au climat et sa régulation et améliorer la connectivité des aires protégées afin de faciliter le déplacement des espèces en réponse à l’évolution des conditionsNote de bas de page 50 .
Dans le questionnaire du rapport sur la situation, les autorités ont été invitées à évaluer leurs progrès en matière d’atténuation des changements climatiques au cours de la période 2016-2020. Voir les résultats dans les Figures 16 (biomes terrestres) et 17 (biomes marins).

Long description
Un diagramme à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les administrations ont atteint les objectifs liés à l'atténuation des changements climatiques dans le biome terrestre. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu

Long description
Un graphique à barres empilées montrant la mesure dans laquelle les administrations ont atteint les objectifs liés à l'atténuation des changements climatiques dans le biome marin. Les objectifs sont les suivants :
- Détermination des objectifs, indicateurs ou cibles de conservation
- Disponibilité de l'information scientifique
- Évaluation active des progrès
- Entreprendre une analyse des lacunes
- Compléter leur réseau en ce qui concerne la diversité biologique
Les objectifs peuvent être les suivants :
- Entièrement disponible/exécuté
- La plupart du temps disponible / exécuté
- Partiellement disponible/exécuté
- Pas du tout disponible/exécuté, ou
- Inconnu
Certaines autorités (7 sur 15) ont évalué ou évaluent actuellement les effets des changements climatiques sur leurs aires terrestres protégées et de conservation, et certaines (5 sur 15) ont intégré des mesures d’adaptation ou d’atténuation dans leur planification ou leur gestion. Cependant, seules quelques-unes (3 sur 10) ont fait de même pour leurs aires marines protégées et de conservation, qui sont plus vulnérables aux effets du réchauffement des océans, de l’acidification et de l’élévation du niveau de la mer.
L’Île-du-Prince-Édouard a été pionnière dans l’intégration de mesures d’atténuation des changements climatiques dans les plans de gestion des aires protégées ou de conservation terrestres. La Colombie-Britannique est la seule autorité responsable à avoir évalué les répercussions des changements climatiques sur le milieu marin et à avoir intégré des mesures d’adaptation à l’échelle de son réseau ainsi que dans ses plans de gestion du milieu marin.
Disponibilité de l’information et des ressources pour soutenir la conception d’aires protégées et de conservation
Les organisations responsables d’aires protégées et de conservation s’appuient sur diverses sources d’information pour soutenir la conception des aires protégées et de conservation. Les cartes ci-dessous illustrent l’étendue de l’information disponible pour de nombreuses sources de données (en pourcentage des autorités).

Long description
Une série de cartes montrant l'étendue de l'information disponible pour diverses composantes de la conception des aires terrestres protégées et conservées. Chaque carte indique si l'information est facilement disponible, disponible ou non (ou si la disponibilité de l'information ne s'applique pas) pour une composante différente. Ces différentes composantes sont les suivantes :
- Identification/évaluation des domaines candidats
- Élaboration de modèles pour la conception des zones
- Évaluation du stress et indicateurs
- Conception et développement de bases de données
- Détermination des domaines d'importance culturelle pour les communautés autochtones
- Connaissances autochtones
- Cartographie et analyse SIG
- Données spatialement explicites sur la faune
- Données d'inventaire et de surveillance

Long description
Une série de cartes montrant l'étendue de l'information disponible pour diverses composantes de la conception des aires marines protégées et conservées. Chaque carte indique si l'information est facilement disponible, disponible ou non (ou si la disponibilité de l'information ne s'applique pas) pour une composante différente. Ces différentes composantes sont les suivantes :
- Identification/évaluation des domaines candidats
- Élaboration de modèles pour la conception des zones
- Évaluation du stress et indicateurs
- Conception et développement de bases de données
- Détermination des domaines d'importance culturelle pour les communautés autochtones
- Connaissances autochtones
- Cartographie et analyse SIG
- Données spatialement explicites sur la faune
- Données d'inventaire et de surveillance
Comme le montrent les Figures, l’information sur les sources de données terrestres est disponible (et parfois facilement accessible) dans le cas de la plupart des autorités, bien que les évaluations des facteurs de stress et les indicateurs puissent être améliorés. Cependant, pour les sources de données marines, l’information est moins disponible que pour les sources de données terrestres, dans l’ensemble. Les renseignements nécessaires à laconception des aires, à l’évaluation des contraintes et à la surveillance font défaut chez de nombreuses autorités.
Défis posés par la planification et l’établissement des aires protégées
Presque toutes les organisations produisant des rapports sur les aires protégées (14 sur 15 pour les aires terrestres et huit sur neuf pour les aires marines) ont indiqué qu’elles étaient confrontées à de multiples défis liés à l’établissement d’aires protégées et de conservation au Canada.
Pour les organisations qui établissent des rapports sur les aires protégées :
- La difficulté la plus fréquente pour créer des aires terrestres et marines protégées réside dans les intérêts concurrents pour les terres et les eaux disponibles.
- Le manque de ressources est également souvent cité comme un obstacle, qu’il s’agisse des ressources en personnel pour la planification du réseau ou des ressources financières pour l’acquisition de terres.
- Parmi les autres défis importants liés à l’établissement Figurent le manque d’outils juridiques ou politiques appropriés pour soutenir la connectivité écologique, le manque de soutien public à l’égard des sites candidats, le manque d’outils juridiques appropriés pour désigner des aires marines protégées à l’échelle provinciale et la lenteur des processus réglementaires.

Long description
Un diagramme à barres montrant combien d'administrations (en pourcentage) ont identifié chaque défi ou obstacle potentiel comme un défi ou un obstacle principal à l'établissement d'aires protégées terrestres (barre supérieure) et marines (barre inférieure) au Canada. Les défis et les obstacles comprennent :
- Conflits d'intérêts ou intérêts concurrents dans l'utilisation des zones disponibles
- Absence de priorité en matière de conservation
- Manque de ressources pour la planification du réseau
- Capacité des partenaires autochtones
- Manque de ressources pour l'acquisition de terres
- Absence d'inventaires adéquats des ressources naturelles
- Disponibilité de zones appropriées pour la protection
- Manque de soutien du public pour les sites candidats
- Travailler avec des partenaires pour répondre à des intérêts mutuels
- Manque d'outils juridiques/politiques pour la connectivité entre les aires protégées
- Outils juridiques/politiques pour la connectivité entre les aires protégées
- Obstacles juridiques et politiques à l'acquisition de terres
- Absence d'outils juridiques appropriés pour la désignation d'une aire marine protégée
- Obstacles fiscaux à l'acquisition ou à la propriété
- Autres
Une série de cartes montrant l'étendue de l'information disponible pour diverses composantes de la conception des aires marines protégées et conservées. Chaque carte indique si l'information est facilement disponible, disponible ou non (ou si la disponibilité de l'information ne s'applique pas) pour une composante différente. Ces différentes composantes sont les suivantes :
- Identification/évaluation des domaines candidats
- Élaboration de modèles pour la conception des zones
- Évaluation du stress et indicateurs
- Conception et développement de bases de données
- Détermination des domaines d'importance culturelle pour les communautés autochtones
- Connaissances autochtones
- Cartographie et analyse SIG
- Données spatialement explicites sur la faune
- Données d'inventaire et de surveillance
Pour les organisations qui font des rapports sur les AMCEZ :
- Les défis les plus courants pour la reconnaissance des AMCEZ sont les utilisations concurrentes des terres et le manque de compréhension des AMCEZ, y compris de la part des décideurs et des gestionnaires des terres.
Chapitre 3 : Gestion des aires protégées et de conservation
Des efforts en cours visent à accroître la superficie du Canada qui est protégée et conservée. Une fois établies, les aires protégées et de conservation doivent être gérées efficacement. Dans ce chapitre, qui examine les défis posés par la gestion, on cherche à savoir si les aires protégées et de conservation remplissent les objectifs de conservation pour lesquels elles ont été créées.
Efficacité de la gestion
Par efficacité de la gestion, on entend la manière dont les aires protégées et de conservation sont gérées – essentiellement la mesure dans laquelle la gestion permet d’atteindre les buts et les objectifs pour lesquels une aire a été créée. Toutes les autorités responsables ont reconnu la nécessité de mesurer l’efficacité de la gestion. L’évaluation et l’amélioration de l’efficacité de la gestion sont un objectif clé du programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique (objectif 4.2).
Des outils tels que l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) sont disponibles pour évaluer si des systèmes (juridiques et de gouvernance) et des ressources (financières et humaines) appropriés sont en place pour garantir l’atteinte des buts et des objectifs de gestion (voir l’encadré ci-dessous)Note de bas de page 51 . Une autorité compétente, soit Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), a déclaré utiliser le METT pour suivre l’efficacité de la gestion. Certaines autorités ont assuré le suivi de l’intégrité écologique en tant que résultat de l’efficacité de la gestion, mais n’ont pas fait le suivi des intrants (p. ex., statut juridique, objectifs de gestion, plans de gestion, nombre d’employés, budget actuel, etc.).
Pour les aires terrestres, six autorités sur 17 (35 %) évaluent activement l’efficacité de la gestion, et trois autres (17 %) procèdent actuellement à l’élaboration d’un processus d’évaluation. Pour les aires marines, trois autorités sur 10 (30 %) évaluent activement l’efficacité de la gestion, et deux autres (20 %) procèdent actuellement à l’élaboration d’un processus d’évaluation.
Qu’est-ce que l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT)
L’Alliance Banque mondiale/WWF pour la conservation et l’utilisation durable des forêts a conçu en 2002 l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) afin d’évaluer rapidement l’efficacité de la gestion des aires protégées et de conservation. Depuis, il a été utilisé dans plus de 127 pays.
Le processus d’évaluation et d’examen comporte trois volets. Il commence par la collecte d’information sur une fiche de données (nom de l’aire protégée, sa taille, le type d’habitat, etc.) ainsi que par la détermination des principaux objectifs et des menaces pesant sur l’aire protégée. Ensuite, les intrants de gestion sont évalués à l’aide d’une série de questions basées sur le cadre de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN. Les évaluateurs choisissent les réponses qui correspondent le mieux à la situation de leur aire protégée. Enfin, les évaluateurs fournissent des renseignements supplémentaires, notamment les sources de données, les justifications de leurs réponses et les actions nécessaires à l’amélioration. Ce processus aboutit à une note qui indique si les intrants, les systèmes et les outils appropriés sont en place pour gérer efficacement un site. Il est important de noter que les extrants (diversité et abondance des espèces, intégrité écologique, etc.) sont mesurés séparément.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le METT Handbook de l’UICN.Note de bas de page 52
Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion
Les plans de gestion sont des plans directeurs servant à pour guider les activités quotidiennes et la prise de décisions à long terme en vue de l’atteinte des objectifs.
De 2016 à 2020, la plupart des autorités ont progressé dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion.
Province ou territoire |
Nombre d’aires protégées et de conservation visées par un plan de gestion |
Pourcentage des aires protégées et de conservation de l’administration visées par un plan de gestion |
Nombre d’aires protégées et de conservation dont le plan de gestion est en cours d’élaboration |
|---|---|---|---|
Yukon |
13 |
S.O. |
4 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
S.O. |
2 |
Nunavut |
3 |
19 % |
8 |
Colombie-Britannique |
744 |
72 % |
56 |
Alberta |
61 |
24 % |
19 |
Saskatchewan |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
Manitoba |
27 aires protégées provinciales, 3 aires protégées municipales, 397 aires protégées privées |
80 % |
8 |
Ontario |
623 |
98 % |
4 nouveaux plans, 17 plans de remplacement et 6 modifications |
Québec |
27 parcs, 256 écosystèmes forestiers exceptionnels et 2 819 refuges biologiques |
S.O. |
0 |
Nouvelle-Écosse |
13 |
9 % |
0 |
Nouveau-Brunswick |
7 |
3 % |
10 |
Île-du-Prince-Édouard |
443 aires naturelles, 11 aires de gestion de la faune |
100 % |
0 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
18 |
35 % |
1 |
Remarque : La Saskatchewan n’a pas indiqué le nombre total d’aires visées par un plan de gestion. Cependant, toutes les réserves écologiques des zones représentatives, tous les parcs provinciaux et toutes les aires protégées créées par des organisations non gouvernementales (ONG) étaient visés par un plan de gestion.
En outre, la plupart des aires gérées par Canards Illimités Canada (62 %), Conservation de la nature Canada (95 %) et Parcs Canada (93 %) faisaient l’objet d’un plan de gestion. ECCC a déclaré que 45 % de ses aires protégées et de conservation étaient visées par un plan de gestion.
L’efficacité des plans dépend de leur mise en œuvre. Douze autorités surveillent la mise en œuvre d’une grande partie de leurs plans de gestion, et six d’entre elles ont fait état de progrès significatifs dans leur mise en œuvre. Pour les aires marines protégées et de conservation, la plupart des autorités (5 sur 7) ont surveillé la mise en œuvre des plans de gestion, et quatre d’entre elles ont fait état d’une mise en œuvre substantielle.
Les plans de gestion sont plus utiles lorsqu’ils sont actualisés. La proportion d’aires protégées et de conservation dotées d’un plan de gestion datant de moins de 10 ans est restée faible. Elle varie de 0 à 36 % selon les provinces et les territoires. Les ministères fédéraux ont rapporté des chiffres légèrement plus élevés, soit 45 % pour ECCC et 46 % pour Parcs Canada. Conservation de la nature Canada a la plus forte proportion de plans de gestion récents (94 %).
Information à l’appui de la gestion
Les gestionnaires des aires protégées et de conservation s’appuient sur diverses sources d’information pour prendre leurs décisions. Les données obtenues par observation directe et sondages ainsi que par télédétection et surveillance environnementale sont utilisées pour éclairer la gestion. De plus, le savoir autochtone est de plus en plus reconnu et intégré dans le processus décisionnel.
La disponibilité de l’information varie selon les catégories : processus écologiques, inventaires des ressources naturelles, utilisation par les visiteurs, connectivité écologique, connaissances autochtones, effets causés par les visiteurs, structure et fonction des communautés, espèces envahissantes et activités humaines adjacentes (Figures 2 et 3).

Long description
Une série de cartes montrant la portée de l'information disponible pour gérer les aires terrestres protégées et conservées. Chaque carte se concentre sur un sujet différent et montre si chaque administration dispose d'une portée complète, modérée et limitée de l'information disponible sur ce sujet (ou si aucune réponse n'a été fournie). Les sujets abordés sont les suivants :
- Processus écologiques
- Inventaires des ressources naturelles
- Utilisation par les visiteurs
- Connectivité écologique
- Connaissances autochtones
- Impact sur les visiteurs
- Structure et fonction de la communauté
- Occurrence d'espèces envahissantes
- Activités adjacentes

Long description
Une série de cartes montrant la portée de l'information disponible pour gérer les aires marines protégées et conservées. Chaque carte met l'accent sur un sujet différent et montre si chaque administration dispose d'une portée complète, modérée et limitée de l'information disponible sur ce sujet (ou si aucune réponse n'a été fournie, ou si elle n'a pas de composante maritime). Les sujets abordés sont les suivants :
- Processus écologiques
- Inventaires des ressources naturelles
- Utilisation par les visiteurs
- Connectivité écologique
- Connaissances autochtones
- Impact sur les visiteurs
- Structure et fonction de la communauté
- Occurrence d'espèces envahissantes
- Activités adjacentes
Pour chaque catégorie, la disponibilité de l’information a été évaluée. Pour l’ensemble des autorités, aucune catégorie ne faisait l’objet d’information complète. L’information sur les processus écologiques semble particulièrement limitée dans le cas de toutes les autorités. Par ailleurs, l’information disponible sur les aires marines protégées et de conservation était plus limitée que celle sur les aires terrestres.
Évaluation et production de rapports
L’évaluation et la production de rapports fournissent de l’information sur divers aspects de la gestion, depuis la santé de l’écosystème jusqu’aux activités quotidiennes. Ce processus est souvent une obligation légale et politique visant à garantir la responsabilité et la transparence dans la gestion des aires protégées et de conservation.
Aires terrestres protégées et de conservation
Dans six des huit provinces et territoires qui ont répondu, l’évaluation et la production de rapports étaient inscrites dans des politiques ou des lois (Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Ontario, Colombie-Britannique et Alberta). Il en va de même pour Conservation de la nature Canada, Parcs Canada et ECCC. Huit autorités sur 17 ont systématiquement évalué l’état des aires terrestres protégées et de conservation et ont produit des rapports à ce sujet, bien que le Nunavut et l’Alberta n’aient fait état que d’une mise en œuvre sporadique, et que la Nouvelle-Écosse n’ait pas produit de rapports. Des rapports en ligne sont disponibles pour les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et Parcs Canada.
Aires marines protégées et de conservation
L’évaluation du milieu marin et l’établissement de rapports sont inscrits dans des lois ou des politiques dans le cas d’ECCC, de Parcs Canada, du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et du gouvernement de la Colombie-Britannique, mais pas pour le Nouveau-Brunswick, l’Île‑du‑Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart des autorités responsables qui gèrent des aires marines protégées et de conservation (Nouveau-Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, ECCC, MPO et Parcs Canada) procédaient à des évaluations et à des rapports de manière systématique. L’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse n’ont pas établi de rapports réguliers, tandis que le Québec l’a fait de manière sporadique.
Protocoles de surveillance
La surveillance permet de recueillir les données nécessaires à l’évaluation de la santé des écosystèmes et à la prise de décisions en matière de gestion. Lorsque les données des protocoles de surveillance sont recueillies de manière uniforme, elles permettent de comparer les aires protégées et de conservation.
Aires terrestres protégées et de conservation
Huit autorités sur 15 (53 %) ont mis en place des protocoles de surveillance pour au moins une de leurs aires protégées et de conservation. La proportion des aires protégées couvertes par un protocole de surveillance varie, allant de moins de 3 % au Manitoba à 97 % à l’Île-du-Prince-Édouard.
Parmi les autorités responsables disposant de protocoles, seule une minorité (5 à 20 %) avait des protocoles datant de moins de 10 ans. L’Île-du-Prince-Édouard était une exception (35 %). La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick travaillent activement à l’élaboration de nouveaux protocoles afin d’englober d’autres sites. À l’échelle fédérale, ECCC était en voie d’élaborer le Programme de surveillance écologique et de conservation, censé être opérationnel dans l’ensemble des 154 aires protégées et de conservation d’ici 2030. Parcs Canada a réalisé des progrès considérables dans l’élaboration de protocoles de surveillance; en effet, 90 % de ses 47 parcs ont établi un protocole.
Aires marines protégées et de conservation
Trois provinces sur sept (43 %), c’est-à-dire le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique, ont établi un protocole de surveillance pour au moins une de leurs aires marines protégées et de conservation, et la plupart des protocoles datent de moins de 10 ans. Toutefois, le pourcentage d’aires marines couvertes par ces protocoles reste faible, avec moins de 5 % de couverture dans les provinces.
Si l’on se projette dans l’avenir, deux provinces font part de leur intention d’intensifier leurs efforts de surveillance. La Colombie-Britannique élabore des protocoles pour deux autres aires marines, et le Québec surveillera la réserve aquatique de Manicouagan. À l’échelle fédérale, Parcs Canada dispose de plans de surveillance pour les deux tiers de ses aires marines de conservation, et en élabore actuellement un pour le site restant. Le MPO a mis en place des protocoles de surveillance pour la moitié de ses aires marines protégées, et des plans sont en cours d’élaboration pour l’autre moitié. Les rapports de surveillance de certaines aires marines protégées du MPO sont également disponibles en ligne, comme le rapport de surveillance de la zone de protection marine d’Eastport. ECCC doit encore élaborer des protocoles de surveillance pour ses aires marines.
Surveillance et gestion de l’intégrité écologique
L’intégrité écologique des écosystèmes est assurée lorsque les espèces indigènes, les paysages et les fonctions qui s’y trouvent sont intactsNote de bas de page 46 . L’écosystème comprend l’environnement physique, comme le sol et l’eau, ainsi que la variété et le nombre d’espèces indigènes et de leurs communautés, et l’interaction entre elles au fil du tempsNote de bas de page 53 .
Le tableau ci-dessous résume la fréquence de la surveillance de l’intégrité écologique par les différentes autorités responsables.
Biome |
Surveillance dans toutes les aires protégées |
Surveillance dans la plupart des aires protégées |
Surveillance dans certaines aires protégées |
Peu ou pas de surveillance |
|---|---|---|---|---|
Terrestre |
- |
ECCC, Parcs Canada |
Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon, Ontario, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta |
Nunavut, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse |
Marine |
- | ECCC, Parcs Canada |
MPO, Colombie-Britannique |
Québec, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador |
Aucune province ni aucun territoire ne disposaient d’un programme de surveillance de l’intégrité écologique dans toutes ses aires protégées. En ce qui concerne les AMCEZ, deux administrations surveillaient partiellement ou totalement l’intégrité écologique (Manitoba et Saskatchewan), tandis que les trois autres ne le faisaient pas (Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse), et qu’une (Colombie-Britannique) était à l’étape de l’élaboration d’un programme de surveillance. Les deux administrations qui ont produit un rapport sur les AMCEZ marines ne surveillaient pas l’intégrité écologique.
Les renseignements obtenus lors de la surveillance de l’intégrité écologique peuvent servir à orienter la gestion. Les écosystèmes étant en constante évolution, les gestionnaires des aires protégées et de conservation doivent évaluer si les processus écologiques reflètent les conditions naturelles. Le tableau ci-dessous résume l’état de la gestion de l’intégrité écologique.
Biome |
Entièrement – Dans toutes les aires protégées et de conservation |
En grande partie – Dans la plupart des aires protégées et de conservation |
Partiellement – Dans quelques aires protégées et de conservation |
Aucune |
|---|---|---|---|---|
Terrestre |
Ontario |
Québec, ECCC, Parcs Canada, Nouveau-Brunswick, Yukon, Terre-Neuve-et-Labrador, Colombie-Britannique |
Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Alberta |
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut |
MarineNote de bas de page 54 |
ECCC |
Québec, Parcs Canada, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique |
MPO, Manitoba |
Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador |
Rétrogradation, réduction et déclassement des aires protégées
Les autorités responsables modifient parfois les aires protégées en ajustant leurs niveaux de protection ou en modifiant leur taille et leurs limites. Ces ajustements font partie de la nature dynamique de la gestion des aires protégées et garantissent que ces aires continuent à répondre aux objectifs de conservation.
Les modifications peuvent être motivées par différents facteurs. Il s’agit notamment de modifications du cadre cadastral, de la nécessité de faire face ou de répondre à des activités et à des menaces, et de l’agrandissement ou du réalignement d’infrastructures. Parfois, un changement de statut est justifié si l’aire ne répond plus aux critères d’une aire protégée. Cette section porte sur trois types de modifications des aires protégées :
- la rétrogradation, qui réduit le niveau de protection ou assouplit les restrictions à l’intérieur de l’aire;
- la réduction, qui diminue la taille de l’aire en modifiant ses limites;
- le déclassement (ou désinscription ou déréglementation), qui révoque le statut d’aire protégée à une zone, la retirant ainsi de la liste des sites protégés.
Rétrogradation
À l’échelle nationale, une seule aire protégée a été rétrogradée. Saskatoon Mountain, en Alberta, a été rétrogradée en zone de loisirs provinciale en 2018. La raison invoquée pour la rétrogradation était de mieux équilibrer l’utilisation récréative et la conservation des terresNote de bas de page 55 . Des problèmes de longue date liés à l’utilisation des terres à des fins récréatives, pour les véhicules tout-terrain en particulier, avaient des répercussions sur le paysage et perturbaient les autres utilisations de la région. La reclassification a permis d’élargir l’éventail des outils réglementaires pour gérer les utilisations récréatives.
Réduction
La Colombie-Britannique a réduit la taille de 20 parcs provinciaux et aires protégées (totalisant moins de 1 km2), et l’Ontario a également procédé à une telle réduction (0,5 km2), aux fins de réalignement de routes, d’affectation de terres à des usages communautaires et de correction de la cartographie numérique.
Déclassement
Au cours de la période de référence 2016-2020, le déclassement a été la modification la plus courante des aires protégées. Au Manitoba, la réserve de parc de l’Île-Pemmican (0,2 km2) a été déclassée, car son statut a expiré et n’a pas été renouvelé. À l’Île-du-Prince-Édouard, 0,2 km2 de terres privées ont été déclassées lorsque le propriétaire a décidé d’en retirer la désignation d’aire protégée. En Saskatchewan, les terres de moindre valeur écologique selon le Wildlife Habitat Protection Act ont été déclassées et vendues à des locataires. De plus, 15 km2 ont été déclassés lorsque le protocole d’entente sur les zones représentatives de la Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Rocanville Division est devenu caduc.
Aucune aire marine protégée n’a été rétrogradée, réduite ou déclassée.
Menaces pesant sur les aires protégées et de conservation du Canada
Il y a une tendance à considérer les aires protégées et de conservation comme des zones vierges, protégées des influences extérieures. La réalité est très différente. Les aires protégées et de conservation portent l’empreinte des décisions antérieures en matière de gestion des terres, comme l’exploitation forestière, les activités de lutte contre les insectes, la construction d’ouvrages de régularisation des eaux et la lutte contre les incendies. Même les régions éloignées sont influencées par les polluants et les changements climatiques. La réalité est que les aires protégées et de conservation font partie d’écosystèmes plus vastes, qui dépendent du soutien et subissent des facteurs de stress provenant de diverses sources; elles doivent donc être gérées en conséquenceNote de bas de page 56 .
Les menaces qui pèsent sur les aires protégées et de conservation comprennent les facteurs de stress susceptibles d’avoir des répercussions sur la biodiversité actuelle et future, les processus écologiques ou les biens culturels de ces airesNote de bas de page 57 . Au Canada, les aires protégées et de conservation sont confrontées à tout un éventail de défis et de menaces, notamment l’utilisation des terres avoisinantes qui est incompatible avec la conservation. Les espèces envahissantes et les changements climatiques sont d’autres menaces qui trouvent leur origine en dehors des aires protégées et de conservation, mais qui affectent les écosystèmes et les espèces qui s’y trouvent. Cette section décrit les menaces déclarées et classées par les administrations. Vingt et une menaces principales ont été classées par chaque administration sur une échelle de 1 (aucune menace) à 5 (menace grave). Les notes de 4 et 5 représentent des menaces importantes. Les menaces pesant sur les aires terrestres protégées et de conservation ont été analysées afin de déterminer le pourcentage de provinces et de territoires ayant attribué une note de 4 ou de 5 à chacune d’entre elles (Figures 4 et 5).

Long description
Une collection de cartes de jauge montrant les menaces classées pour les aires protégées. Chaque jauge représente une menace différente et le nombre d'administrations (en pourcentage) classées cette menace comme une menace de 4 ou 5 sur une échelle de 1 (aucune menace) à 5 (menace grave).

Long description
Une collection de cartes de jauge montrant les menaces classées pour les OECMs. Chaque jauge représente une menace différente et le nombre d'administrations (en pourcentage) classées cette menace comme une menace de 4 ou 5 sur une échelle de 1 (aucune menace) à 5 (menace grave).
Pour les aires terrestres protégées, les provinces et les territoires ont classé les menaces différemment du gouvernement fédéral (ECCC et Parcs Canada) ou des ONG (Canards Illimités Canada et Conservation de la nature Canada). Les menaces classées comme les plus élevées par l’ensemble des répondants sont les changements climatiques, les utilisations incompatibles des terres et les espèces envahissantes. Les intervenants non gouvernementaux considèrent l’accès non autorisé aux aires protégées comme une menace importante. Les menaces de nature biologique (p. ex. les espèces envahissantes ou le déclin des populations) ont été classées à un niveau au moins aussi élevé que les menaces liées aux infrastructures ou à l’humain (p. ex. l’aménagement d’infrastructures, la fréquentation et les activités récréatives).
Pour les AMCEZ terrestres, les menaces classées comme les plus élevées sont les espèces envahissantes, l’accès non autorisé aux AMCEZ et les utilisations incompatibles des terres.
Des menaces pesant sur les aires marines protégées ont été déclarées en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec (ainsi que par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du MPO, d’ECCC et de Parcs Canada). Les changements climatiques sont le plus souvent considérés comme une menace grave, tandis que le déclin des populations d’espèces et les espèces envahissantes sont également considérés comme des menaces importantes. L’augmentation de la fréquentation et des activités humaines dans les aires protégées a été signalée comme une menace moins grande. Les réponses des ministères fédéraux sont similaires à celles des provinces et des territoires.
Seul le MPO a signalé des menaces pour les AMCEZ marines. La perte d’habitat, les espèces envahissantes et l’aménagement d’infrastructures à l’intérieur des AMCEZ ont été cités comme les menaces les plus graves.
Exploitation des ressources
Les provinces et territoires canadiens disposent de leurs propres procédures d’évaluation environnementale et de délivrance de permis qui prennent en compte les effets sur les aires protégées et de conservation avoisinantes. Une province (le Nouveau-Brunswick) n’a pas fourni d’information sur l’exploitation des ressources.
Alberta: Les aires protégées et de conservation, qu’elles soient existantes ou réservées pour préservation future, ont été intégrées dans la planification de l’utilisation des terres. Le gouvernement a collaboré avec les promoteurs pour atténuer les effets sur ces aires, en exigeant des examens environnementaux de tout projet à l’intérieur des parcs.
Colombie-Britannique : Les plans d’utilisation des terres antérieurs de la province, qui couvrent plus de 90 % de l’assise territoriale, aident à déterminer l’emplacement des zones d’exploitation des ressources et des aires protégées et de conservation. Les évaluations environnementales évaluent les effets potentiels des projets de développement dans ces régions.
Manitoba : L’Initiative des zones protégées a permis d’examiner les évaluations environnementales et les processus d’autorisation afin de cibler et de réduire le plus possible les effets négatifs potentiels sur les aires protégées désignées. Dans la mesure du possible, les grands projets ont évité les zones protégées proposées.
Terre-Neuve-et-Labrador : Les évaluations environnementales et les approbations de permis ont pris en compte les aires protégées existantes et prévues lors de la détermination des répercussions des projets proposés et de l’élaboration des mesures d’atténuation.
Territoires du Nord-Ouest : Bien que la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Convention définitive des Inuvialuit ne mentionnent pas explicitement les aires protégées, celles-ci ont été prises en compte dans les processus de réglementation et d’évaluation environnementale.
Nouvelle-Écosse : Les évaluations environnementales ont tenu compte des aires protégées existantes et prévues lors de la détermination des répercussions des projets proposés et de l’élaboration des mesures d’atténuation.
Nunavut : Les évaluations environnementales et la délivrance de permis ont été menées sur la base de projets individuels, les données actuelles étant insuffisantes pour se prononcer sur la protection des aires naturelles.
Ontario : La Loi sur l’aménagement du territoire, la Déclaration de principes provinciale du ministère des Affaires municipales et du Logement et le manuel de référence sur le patrimoine naturel du ministère des Richesses naturelles fournissent des orientations sur la conservation dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Île-du-Prince-Édouard : Les évaluations environnementales peuvent établir des zones tampons autour des milieux humides, mais elles n’influent pas directement sur les décisions relatives aux aires protégées.
Québec : Seules les entreprises forestières adhérant à une certification étaient tenues de prendre en compte les aires protégées et de conservation dans le cadre de leur processus décisionnel.
Saskatchewan : Les évaluations environnementales étaient axées sur les répercussions immédiates des projets sur les aires naturelles, sans tenir compte du contexte plus large de la conservation dans la région.
Yukon : Les activités d’utilisation des terres dans les zones adjacentes susceptibles d’avoir une incidence sur les aires protégées sont relevées par le gouvernement du Yukon, les Premières Nations du Yukon et les gouvernements et groupes autochtones au cours des processus d’évaluation et de réglementation.
Défis liés à la gestion des aires protégées et de conservation
La plupart des provinces et territoires ont déclaré avoir rencontré des difficultés ou des obstacles liés à la gestion des aires terrestres (100 %) et marines (90 %) protégées et de conservation au Canada. Ces défis vont des limites opérationnelles aux obstacles à une prise de décisions efficace en matière de conservation.
Les difficultés les plus fréquemment citées sont le manque de ressources pour la surveillance des sites et le manque de personnel pour la gestion des sites (voir Figure 6). En ce qui concerne la gestion des aires terrestres protégées et de conservation, près de la moitié des administrations ont mentionné l’absence d’objectifs de gestion ou de plans de gestion pour guider les décisions. En ce qui concerne le milieu marin, le défi le plus fréquemment cité est le manque d’outils juridiques ou politiques permettant de gérer les activités humaines de manière à ce qu’elles soient compatibles avec les objectifs de conservation.
Une administration a mentionné les défis suivants : la longueur des processus réglementaires, la faible capacité des partenaires, la nécessité de travailler avec de multiples propriétaires fonciers, le manque d’outils pour gérer une aire relevant de plusieurs compétences, la capacité limitée pour la conception et l’exécution d’études, et des bases de référence inadéquates pour la surveillance. Pour les aires marines, les défis comprennent également l’absence de mandats provinciaux pour faire progresser la protection du milieu marin et le coût élevé de la surveillance au large des côtes et en eaux profondes.
Les obstacles mis en évidence par les territoires diffèrent de ceux des provinces. Les Territoires du Nord-Ouest ont mentionné la lenteur des progrès dans le règlement des revendications territoriales. De même, le Yukon a souligné l’absence d’accords sur les revendications territoriales des Premières Nations dans certaines régions ainsi que la capacité limitée des partenaires autochtones à participer aux processus de planification susceptibles d’aboutir à la création d’aires protégées. Au Nunavut, des défis existent, mais n’ont pas été signalés par le territoire dans le questionnaire.

Long description
Un diagramme à barres montrant combien d'administrations (en pourcentage) ont identifié chaque défi potentiel comme un défi pour la gestion des aires protégées marines (barre du haut) et terrestres (barre du bas) au Canada. Les défis et les obstacles comprennent :
- Manque de ressources en personnel pour la gestion du site
- Manque de ressources pour la surveillance du site
- Manque d'outils politiques et juridiques pour gérer les activités adjacentes aux aires protégées
- Absence d'objectifs ou de plans de gestion pour guider les décisions de gestion
- Absence de lignes directrices ou de protocoles pour mettre en œuvre efficacement les décisions de gestion
- Capacité des partenaires autochtones
- Autres
Fréquentation
De nombreuses aires protégées et de conservation offrent des possibilités de tourisme, de loisirs et d’apprentissage sur la valeur de la nature. Pour une grande partie de la population canadienne, le fait de visiter des aires protégées et de conservation et d’y pratiquer des activités récréatives contribue à lui faire apprécier la nature. Les visiteurs établissent un lien personnel avec leur patrimoine naturel et culturel grâce à des expériences enrichissantes, ce qui favorise le soutien aux aires protégées et à la conservation.
Les gestionnaires des aires protégées et de conservation peuvent restreindre l’accès aux zones fragiles ou limiter la durée d’utilisation par les visiteurs afin de réduire le plus possible les effets négatifs causés par une fréquentation excessive.
Aires terrestres protégées et de conservation
De 2016 à 2020, les 15 administrations responsables des aires terrestres protégées et de conservation au Canada ont accueilli le public, mais dans des proportions variables. La plupart des administrations ont autorisé l’accès à 76‑100 % de leurs aires protégées, et le Québec autorise la visite de 51-75 % de ses aires.
En général, la fréquentation est considérée comme un aspect secondaire de la gestion des aires protégées et de conservation, mais elle constitue l’un des principaux objectifs dans trois administrations (Nunavut, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador).
Rapprocher les Canadiennes et les Canadiens de la nature dans la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
Le « déficit nature », terme utilisé pour décrire les effets néfastes sur le plan personnel, familial, communautaire et sociétal dont souffrent les humains lorsqu’ils sont déconnectés de la nature, est de plus en plus reconnu. Les parcs et les aires protégées sont des outils essentiels pour aider les gens à retourner à l’extérieur, et l’initiative Connecter les Canadiens à la nature d’Environnement et Changement climatique Canada vise précisément à atteindre cet objectif. En augmentant les programmes et les installations disponibles dans certains sites accessibles au Canada, cette initiative vise à offrir à la population canadienne la possibilité de profiter de la nature. La réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, située à environ 120 km de Montréal, au Québec, est l’un de ces sites. Il est possible d’y faire des balades en canot ou en kayak, de parcourir les 10 km de sentiers ou même de tenter le géocaching!Note de bas de page 29
Aires marines protégées et de conservation
La plupart des aires marines protégées et de conservation (entre 76 et 100 %) étaient ouvertes aux visiteurs au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. L’importance de la fréquentation en tant qu’objectif de gestion varie : deux provinces et Parcs Canada la considèrent comme un objectif principal, et une autre autorité la considère comme un objectif secondaire. De nombreuses provinces n’ont pas mentionné la fréquentation comme un objectif.
Que les visites soient encouragées ou non, toutes les autorités responsables contrôlent certains aspects des visites par une variété de politiques, de mesures ou de lignes directrices spécifiques. Les mesures les plus citées sont les suivantes :
- conception de bâtiments et d’infrastructures visant à réduire le plus possible les répercussions sur l’environnement;
- réduction de la consommation d’énergie;
- réduction de la consommation d’eau;
- gestion des déchets;
- restrictions spatiales de l’accès des visiteurs afin d’éviter les zones fragiles.
De plus, 10 autorités responsables d’aires terrestres sur 15 et une autorité responsable d’aires marines sur sept ont indiqué qu’elles avaient mis en place des programmes ou des initiatives pour augmenter le nombre de visiteurs. Ces programmes visent à mobiliser les jeunes et les nouveaux arrivants, à associer les parcs à un mode de vie sain et actif, et à offrir des possibilités de loisirs durables.
Étude de cas : Campagne de Parcs Canada pour augmenter la fréquentation des aires protégées
En 2017, Parcs Canada a lancé une campagne visant à augmenter la fréquentation de ses parcs à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération. La campagne offrait une entrée gratuite dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines de conservation. À la fin du mois de mars, près de 5,4 millions de cartes d’entrée Découverte avaient été commandées, dépassant les prévisions initiales d’un million. La campagne a entraîné une hausse de 24 % de la fréquentation des lieux historiques nationaux et de 10 % de la fréquentation des parcs nationaux en 2017Note de bas de page 59 .

Long description
Photo de 4 personnes dans le parc national Banff souriant et prenant une photo d’elles-mêmes, avec de hautes montagnes en arrière-plan.
Chapitre 4 : Contributions et leadership des peuples autochtones en matière de conservation
Depuis des millénaires, les peuples autochtones gèrent habilement les écosystèmes de leurs territoires traditionnels, façonnant la répartition et l’abondance de la faune et de la flore. Les visions du monde autochtones reconnaissent la nécessité de relations respectueuses entre les humains et la terre.
En 2017, des représentants des gouvernements autochtones, des Aînés et des membres des communautés ont formé le Cercle autochtone d’experts, lequel est chargé d’offrir des conseils sur la façon dont les initiatives de conservation dirigées par des Autochtones pourraient contribuer aux objectifs de conservation du Canada dans le cadre d’En route vers l’objectif 1 du CanadaNote de bas de page 60 . Le rapport Nous nous levons ensemble affirme que le temps est venu pour les systèmes de savoirs autochtones, les traditions juridiques et les pratiques culturelles des populations autochtones d’être reconnus comme des mécanismes de conservation tout aussi valables et contraignants que d’autres cadres.
À la fin de 2020, les gouvernements avaient progressé dans la reconnaissance des contributions autochtones à la conservation et dans le soutien au leadership autochtone. Selon l’Initiative de leadership autochtone, 90 % des aires protégées créées au Canada au cours des deux dernières décennies ont été soutenues par des partenariats autochtones ou le leadership autochtoneNote de bas de page 61 . De nombreuses nations autochtones créent des aires protégées et de conservation autochtones (APCA), qui favorisent la prise de décisions par les Autochtones, revitalisent les terres ancestrales et offrent des possibilités économiquesNote de bas de page 62 .
Ce chapitre rend compte de la participation des peuples autochtones à la création et à la gestion des aires protégées et de conservation ainsi que des progrès réalisés par les autorités responsables pour reconnaître les APCA et la conservation par zone menée par les Autochtones, protéger les sites d’importance culturelle, valoriser et appliquer le savoir autochtone, et élaborer des accords qui procurent des avantages économiques et sociaux aux Autochtones.
Établissement des aires protégées et de conservation
Toutes les autorités responsables (100 %) déclarent avoir mis en place des mécanismes de participation des peuples autochtones lors de la création d’aires protégées et de conservation.
Aires terrestres protégées et de conservation
- Huit autorités sur 15 (53 %) ont indiqué que la participation des peuples autochtones à la conception, à la planification et à la création d’aires protégées et de conservation résultait de processus liés à des revendications territoriales modernes, à des traités et à d’autres accords.
- Les mécanismes suivants ont été utilisés pour inclure les peuples autochtones dans la conception, la planification et la mise en place des projets :
- Consultations ciblées avec les communautés autochtones (100 %)
- Consultations publiques (77 %)
- Traités et autres accords (69 %)
- Planification de l’utilisation des terres (62 %)
- Organismes consultatifs (p. ex., conseils de gestion des ressources fauniques) (54 %)
- Autres mécanismes précisés dans des revendications territoriales modernes (54 %)
- Certaines autorités ont financé des organisations autochtones en vue de la détermination de domaines d’intérêt pour les communautés autochtones ainsi que de la création de comités directeurs des APCA pour soutenir l’avancement des propositions locales d’APCA (p. ex. le Forum tripartite Mi’kmaq-Nouvelle-Écosse-Canada en Nouvelle‑Écosse).
Autorité responsable |
Participation des Autochtones à la conception, à la planification et à l’établissement d’aires terrestres protégées |
|---|---|
Territoires du Nord-Ouest |
Les gouvernements autochtones participent à tous les aspects de la conception, de la planification et de l’établissement, par exemple la reconnaissance des droits, les accords d’établissement et le leadership autochtone en matière de conservation dans le cadre de « Territoire en santé, population en santé ». La Loi sur les aires protégées fournit des orientations claires sur la participation des Autochtones à la planification des aires protégées. |
Nunavut |
Une entente-cadre sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) concernant les parcs territoriaux a été officiellement approuvée en mai 2002. L’entente prévoit la protection des droits des Inuits à l’utilisation continue des terres pour la récolte et l’établissement de camps éloignés; la sélection, la création et la gestion de parcs territoriaux par les Inuits; la participation des jeunes et l’intégration de l’Inuit Qaujimajatuqangit (le savoir inuit) dans la gestion des parcs. L’habitat essentiel des espèces, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale créés en vertu de la Loi sur la faune et la flore du Nunavut sont également considérés comme des « aires de conservation » en vertu de l’Accord du Nunavut et, à ce titre, leur création nécessite la négociation d’ERAI connexes. Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut est habilité à limiter la récolte d’espèces sauvages, sous réserve d’un examen par le ministre. Les organisations de chasseurs et de trappeurs (OCT) et les organisations régionales des ressources fauniques (ORRF) exercent également des pouvoirs et des fonctions importants en ce qui concerne l’exploitation des espèces sauvages par les membres d’OCT. |
Québec |
Dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, des dispositions relatives à la consultation des peuples autochtones sont précisées. De plus, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel doit être interprétée d’une manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. |
Île-du-Prince-Édouard |
L’Île-du-Prince-Édouard suit les procédures liées à l’« obligation de consulter » dans le cadre del’initiative L’nuey pour la défense des droits des Mi’kmaq d’Epekwitk lors de la création d’aires protégées. |
Nouveau-Brunswick |
Le Nouveau-Brunswick a l’obligation de consulter si la création d’aires protégées entraîne des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités. |
Manitoba |
Le Manitoba engage des discussions avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par la création d’une aire protégée ou de conservation. La politique ministérielle sur la mobilisation autochtone a été mise à jour et rebaptisée en 2016. La Loi sur l’aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales permet aux Premières Nations de la rive est du lac Winnipeg de participer à la planification de l’utilisation des terres pour des zones désignées de terres de la Couronne qu’elles ont traditionnellement utilisées. |
Nouvelle-Écosse |
La Nouvelle-Écosse doit consulter les Mi’kmaq au sujet de la création d’aires protégées et de toute mesure de gestion susceptible d’avoir une incidence sur les droits autochtones et issus de traités. Nova Scotia Parks collabore avec les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse pendant le processus de planification de la gestion. |
Saskatchewan |
La Saskatchewan a élaboré le First Nation and Metis Consultation Policy Framework afin de consulter les communautés avant la prise de décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits ancestraux et issus de traités. De plus, le ministère de l’Environnement a élaboré et adopté des orientations politiques et des procédures opérationnelles pour la consultation des communautés des Premières Nations et des Métis. |
Ontario |
Les communautés autochtones qui ont des droits issus de traités ou des revendications crédibles sur une zone géographique pour laquelle la conception, la planification et l’établissement d’une aire protégée sont envisagés sont invitées à participer. |
Terre-Neuve-et-Labrador |
Il n’existe pas de loi ou de politique spécifique concernant la participation des peuples autochtones à la conception, à la planification ou à la création d’aires protégées dans la province. Toutefois, le gouvernement est tenu de procéder à des consultations conformément aux accords sur les revendications territoriales et dans le cadre d’une politique de consultation des peuples autochtones liée au développement. |
Colombie-Britannique |
La Colombie-Britannique a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par l’intermédiaire d’une loi. Les nouvelles mesures de conservation et de protection sont élaborées en collaboration et en consultation avec les Premières Nations. Les activités d’intendance, y compris la restauration, la gestion et l’application de la loi, sont mises en œuvre en collaboration avec les partenaires des Premières Nations. La Colombie-Britannique collabore également avec les Premières Nations à la planification et à la gestion des aires protégées. |
Yukon |
Au Yukon, à ce jour, les aires protégées ont été créées dans le cadre de l’un des 11 accords définitifs avec les Premières Nations du Yukon ou de la Convention définitive des Inuvialuit, soit directement, soit par l’intermédiaire des processus de planification régionale de l’utilisation des terres ou de recommandation du conseil ou de la commission établis par les conventions. Des aires protégées peuvent également être créées en collaboration avec les gouvernements autochtones dans les régions où il n’existe pas d’accord définitif et, bien qu’il n’y ait pas encore d’exemples à ce jour, l’exploration d’aires potentielles est en cours afin d’améliorer et de soutenir les aires de conservation dirigées par les Autochtones. La participation des gouvernements autochtones respectifs est nécessaire à toutes les phases de la conception, de la planification et de l’établissement des aires protégées. En outre, les plans de gestion des aires protégées du Yukon sont généralement élaborés en collaboration avec les gouvernements autochtones et cosignés par ces derniers et le gouvernement du Yukon. Dans certains cas, les parties conviennent de collaborer à la mise en œuvre des plans de gestion. |
Parcs Canada |
Parcs Canada travaille en consultation et en coopération avec les communautés, les organisations et les gouvernements autochtones, ce qui constitue un élément central de tous ses processus de planification et d’établissement d’aires protégées. Bien que les processus de Parcs Canada remplissent son obligation constitutionnelle de consulter, ils sont structurés de manière à aller plus loin. Toutes les étapes du processus sont réalisées en collaboration, afin que les droits et les intérêts des Autochtones puissent être intégrés et pris en compte de manière efficace dans le processus décisionnel dès le départ. Dans la plupart des cas, les accords d’établissement sont négociés sur la base d’une collaboration et d’un consensus. Les parties collaborent de bonne foi aux décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur les droits et les intérêts des Autochtones. Dans certains cas, en vertu d’un accord sur les revendications territoriales ou d’un traité moderne, des ententes sur les répercussions et les avantages sont également négociées. |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) |
La participation des Autochtones est requise sur les terres visées par un traité ou par un titre ancestral. Une consultation importante est nécessaire dans les aires visées par un traité. Dans les territoires traditionnels, la politique d’ECCC exige une consultation pour connaître les intérêts et les droits. ECCC a élaboré des lignes directrices détaillées à l’intention des négociateurs afin d’aider les responsables à déterminer l’ampleur et la profondeur de la participation des Autochtones. |
Pêches et des Océans Canada (MPO) |
Le MPO mène des activités de consultation et de collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements et communautés inuits et autochtones, l’industrie et les autres acteurs de l’économie maritime, les intervenants, les groupes environnementaux et les autres membres de la population canadienne intéressés afin de repérer les zones océaniques et côtières qui abritent des habitats, des espèces et des écosystèmes importants à protéger. |
Aires marines protégées et de conservation
- Quatre provinces et territoires sur sept (57 %) ont indiqué que les communautés autochtones participaient officiellement à la conception, à la planification et à l’établissement des aires protégées et de conservation. Un exemple notable est la participation des Autochtones à la création du réseau d’aires marines protégées (AMP) dans la biorégion de la plate-forme Nord en Colombie-Britannique. Les consultations (consultations publiques et consultations ciblées avec les populations autochtones) constituent le mécanisme de participation le plus fréquemment cité (42 %), suivi par les processus de planification de l’utilisation de la mer et les organismes consultatifs. Les mécanismes de participation dans les aires marines sont en grande partie les mêmes que dans les aires terrestres.
- La participation des Autochtones a été imposée par une politique ou une loi dans sept administrations sur dix.
Gestion des aires protégées et de conservation
La participation des Autochtones permet de s’assurer que les activités de gestion visent des objectifs importants pour les communautés autochtones. Il s’agit d’un moyen d’inclure le point de vue précieux des détenteurs de connaissances et d’aboutir à un processus décisionnel plus équitable.
Aires terrestres protégées et de conservation
- La mobilisation ciblée (92 %), les organismes consultatifs (p. ex. les conseils de gestion des ressources fauniques) (69 %), la cogestion des aires protégées (69 %) et la gestion dirigée par les Autochtones (23 %) sont les mécanismes de participation autochtone les plus cités.
- Dans toutes les administrations (100 %), la participation des Autochtones est imposée par une loi, une politique ou des plans de gestion d’aires spécifiques.
Étude de cas : Parc provincial Big Island (Alberta)
En 2019, le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à créer le parc provincial Big Island sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord. En 2020, la Nation crie d’Enoch et la Ville d’Edmonton ont demandé au gouvernement provincial de créer un partenariat tripartite afin d’élaborer la proposition d’établissement et de cogérer le parc une fois qu’il aura été créé. Des discussions et des collaborations ont eu lieu tout au long de 2020, et un cadre de référence officiel a été signé par les trois parties à la fin de 2021.

Long description
Photo du parc provincial de La Grande Île avec une île boisée entourée d’une rivière tranquille.
- Quatre administrations (Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard et Yukon) ont indiqué que certaines aires protégées et de conservation étaient entièrement gérées par des groupes autochtones.
- La plupart des administrations (69 %) ont indiqué que des régimes de cogestion étaient en place ou en cours d’élaboration avec les peuples autochtones.
Aires marines protégées et de conservation
- La participation des Autochtones a été déclarée dans 42 % des administrations responsables d’aires marines. La cogestion des aires marines de conservation et les organismes consultatifs sont les mécanismes de participation les plus cités.
- Les entités fédérales (MPO, ECCC, Parcs Canada) ont déclaré une obligation de négocier des ententes sur les répercussions et les avantages.
- La participation des Autochtones est prévue par la loi en Colombie-Britannique et au Manitoba, et dans les plans de gestion de certaines aires au Québec.
- À l’échelle fédérale, les politiques exigent la participation des Autochtones à la mise en place et à la gestion des projets.
- Le MPO expérimente la cogestion d’aires marines, comme la zone de protection marine (ZPM) de Tarium Niryutait et la ZPM d’Anguniaqvia niqiqyuam (avec les Inuvialuits et d’autres partenaires dans les deux cas). À Anguniaqvia niqiqyuam, un comité mixte de gestion de la pêche et la communauté de Paulatuk fournissent des orientations sur les décisions en matière de surveillance et de recherche pour la ZPM.
Le MPO a adopté une approche de cogestion adaptative, basée sur une combinaison de gestion adaptative et de cogestion. Ensemble, ces deux approches forment un processus dynamique dans lequel les mesures de gestion sont collaboratives et améliorées en permanence grâce au suivi des résultats et à l’intégration de nouvelles connaissancesNote de bas de page 63 . Ce processus est appliqué dans la ZPM du mont sous-marin SG̲áan K̲ínghlas-Bowie. Les systèmes de connaissances scientifiques et traditionnelles sont valorisés et utilisés, ce qui permet d’obtenir des résultats de gestion résilients et durables.
Savoir autochtone
Le savoir autochtone est un ensemble cumulatif de connaissances, de savoir-faire, de pratiques et de représentations conservés et élaborés par des peuples ayant une longue histoire d’interaction avec l’environnement naturel. Ces ensembles sophistiqués de compréhensions, d’interprétations et de significations font partie intégrante d’un complexe culturel qui englobe la langue, les systèmes de dénomination et de classification, les pratiques d’utilisation des ressources, les rituels, la spiritualité et la vision du mondeNote de bas de page 64 . Le savoir autochtone est de plus en plus valorisé et pris en compte dans la gestion des aires protégées (voir l’encadré ci-dessous).
Savoir autochtone
Le savoir autochtone, également appelé savoir traditionnel et science autochtone, fait référence à la sagesse, aux connaissances et aux pratiques des cultures autochtones dans le monde entier, y compris au CanadaNote de bas de page 65 . Le savoir autochtone englobe une vision holistique du monde qui reconnaît l’interdépendance du monde naturel et intègre les aspects sociaux, physiques et spirituels de l’écologieNote de bas de page 66 . Il comprend des connaissances sur la terre, l’eau, les végétaux, les animaux et les relations entre eux. Ces connaissances sont transmises de génération en génération par les traditions orales, les pratiques culturelles et l’expérience directe de l’environnement.
Le savoir autochtone est important pour la gestion de l’environnement, car il contribue à la compréhension des effets des changements climatiques, à la conservation de la biodiversité et à l’utilisation durable des ressourcesNote de bas de page 67 .
- Un territoire (le Nunavut) a déclaré que le savoir autochtone était pris en compte dans toutes les décisions relatives à la conservation. Quatre administrations indiquent que le savoir autochtone influence considérablement les décisions, et sept affirment qu’il influence un sous-ensemble de décisions. Seule une province déclare ne pas encore utiliser le savoir autochtone dans le cadre de la prise de décisions.
- Le respect et la reconnaissance des préférences et des droits des communautés autochtones constituent un élément important de la transmission du savoir autochtone. En Ontario, l’inclusion du savoir autochtone est traitée au cas par cas. Dans certains cas, les communautés peuvent choisir de ne pas communiquer les renseignements avec la Couronne pour diverses raisons. Il peut s’agir de problèmes relationnels, d’un manque de capacité ou de croyances culturelles, entre autres.
- Sur les sites d’ECCC, la prise en compte du savoir autochtone est requise lorsque les aires protégées sont cogérées ou établies sur des terres visées par un traité ou par un titre ancestral.
Reconnaissance des aires protégées et de conservation autochtone
Selon la définition du rapport Nous nous levons ensemble, les APCA sont des terres et des eaux où les gouvernements autochtones ont le rôle principal de protéger et de conserver les écosystèmes au moyen de systèmes de lois, de gouvernance et de connaissances autochtonesNote de bas de page 60 .
Le terme « APCA » englobe un large éventail de structures juridiques et de gouvernance existantes et possibles. Les APCA ne constituent pas une désignation légale des aires entièrement gérées ou cogérées par les peuples autochtones. Le fait qu’un gouvernement ou une communauté autochtone déclare une APCA dépend uniquement de la préférence de la communauté autochtone et n’a pas besoin d’être reconnu par les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Toutefois, pour être reconnues à l’échelle fédérale en tant qu’aires protégées ou AMCEZ, les APCA doivent répondre aux critères pancanadiensNote de bas de page 4 . Dans d’autres régions, comme en Colombie-Britannique, certaines APCA comprennent des zones où certaines formes d’exploitation sont possibles, et ces zones particulières peuvent ne pas répondre aux critères d’une aire protégée ou d’une AMCEZ.
Les partenaires autochtones ont la possibilité d’utiliser des noms culturellement pertinents, par exemple l’aire protégée d’Edéhzhié du Dehcho.
Bien que certaines administrations élaborent actuellement des désignations spécifiques pour des APCA marines et terrestres, la plupart d’entre elles ne déclarent aucune APCA marine ou aire assimilable à une APCA. Le degré de participation des Autochtones dans les aires marines protégées et de conservation varie d’une administration à l’autre.
- La plupart des administrations (86 %) n’ont pas de désignation spécifique pour les APCA, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marine. Cependant, trois autorités responsables élaborent actuellement des désignations pour les APCA : Parcs Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
- Au Manitoba, une aire peut être désignée comme « parc mettant en valeur les terres traditionnellement utilisées par les peuples indigènes » en vertu de Loi sur les parcs provinciaux si son objectif principal est de préserver des terres importantes pour les peuples autochtones. Le Manitoba peut également désigner des aires protégées en vertu de la Loi sur l’aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales. Cette loi a pour objet de permettre aux Premières Nations de la rive est du lac Winnipeg de participer à la planification de l’utilisation des terres et de la gestion des ressources dans les zones désignées des terres de la Couronne qu’elles utilisent traditionnellement.
- En 2020, la Colombie-Britannique ne disposait pas d’un cadre juridique ou politique lui permettant de reconnaître les APCA. Toutefois, la Province a créé la désignation de conservation en 2006 afin de préserver et de maintenir les utilisations sociales, rituelles et culturelles des terres par les Premières Nations lors de la création d’une aire protégée. Un total de 158 aires de conservation couvrant plus de trois millions d’hectares ont été créées en Colombie-Britannique en consultation avec les Premières Nations.
Cette section ne décrira que les APCA déclarées dans la BDCAPC comme étant des aires protégées ou de conservation répondant aux critères fédéraux. Au total, trois autorités responsables ont déclaré une APCA terrestre dans la BDCAPC : ECCC (aire protégée Edéhzhíe du Dehcho), Territoires du Nord-Ouest (Wehexlaxodiale) et Parcs Canada (réserve de parc national Thaidene Nëné).

Long description
Photo du parc provincial de La Grande Île avec une île boisée entourée d’une rivière tranquille.
En ce qui concerne les aires marines protégées et de conservation, une seule APCA a été déclarée : la réserve de parc national, réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas.
Sites d’importance culturelle
Les aires protégées et de conservation ne sont pas seulement importantes pour la protection des écosystèmes et des habitats fauniques, mais aussi pour la protection des sites d’importance culturelle. Les sites d’importance culturelle comprennent des aires où des pratiques traditionnelles d’utilisation des terres ont eu lieu, et continuent d’avoir lieu, ainsi que des aires qui ont une valeur spirituelle.
Aires terrestres protégées et de conservation
- Quatorze autorités responsables sur 15 (93 %) ont indiqué que des sites d’importance culturelle ont été relevés lors de la planification des aires protégées et de conservation.
- Les sites d’importance culturelle ont également été protégés par la création d’aires terrestres protégées et de conservation selon 13 autorités responsables sur 15 (86 %) et, dans de nombreux cas, sont également protégés par des lois autres que celles portant sur les aires protégées (86 %).
De nombreux sites d’importance culturelle ont été protégés dans tout le pays :
- Territoires du Nord-Ouest : Les sites d’importance culturelle chevauchent souvent des aires protégées. Citons par exemple Ezodziti (Accord définitif des Tłįchǫ), lac Kelly (Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu), Wehexlaxodiale (plan d’utilisation des terres des Tłįchǫ), Thaidene Nëné et Ts'udé Nilįné Tuyeta (Loi sur les aires protégées) et le zonage de conservation dans les plans d’utilisation des terres du Sahtu et des Gwich'in. Ces sites sont également protégés par des lois fédérales (Loi sur les parcs nationaux, Loi sur les espèces sauvages du Canada) et par les lois dénées.
- Nunavut : Tous les parcs territoriaux établis et les projets de parcs comprennent des sites d’importance culturelle. Ces sites sont également protégés par le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut (DORS/2001-220).
- Québec : Certains sites sont protégés ou conservés grâce à la création ou à la reconnaissance d’aires protégées. Citons par exemple la Montagne-de-Chert dans le parc national du Lac-Témiscouata.
- ECCC : Bien qu’ECCC ne dispose pas d’une stratégie pour repérer les sites d’importance culturelle, des aires importantes pour les espèces sauvages recoupent des aires d’importance culturelle pour les peuples autochtones. Citons par exemple les réserves nationales de faune (RNF) proposées dans les Territoires du Nord-Ouest, et les huit refuges d’oiseaux migrateurs et cinq RNF dans la région du Nunavut. Ces sites sont cogérés par les communautés autochtones, pour lesquelles les sites culturels constituent un aspect important de la planification et de la gestion.
- Île-du-Prince-Édouard : Aucun de ces sites n’est protégé ou conservé par l’établissement d’aires protégées et de conservation.
- Parcs Canada : Parcs Canada protège des sites d’une grande importance culturelle pour les communautés autochtones, comme le lieu historique national Saoyú-Ɂehdacho, protégé par le Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada.
- Nouveau-Brunswick : Aucun de ces sites n’est protégé ou conservé par l’établissement d’aires protégées et de conservation.
- Yukon : Comme les aires protégées du Yukon sont définies en collaboration avec les Premières Nations et les Inuvialuits, des sites d’importance culturelle chevauchent souvent des aires protégées. Citons par exemple le parc territorial Kusawa, le parc territorial Asi Keyi, l’habitat protégé Ch’ihilii Chìk, l’habitat protégé de Ddhaw Ghro, les terres visées par un règlement de Ni'iinlii Njik (Fishing Branch) et bien d’autres encore.
- Manitoba : Certains sites culturels sont inclus dans des aires protégées : le parc provincial Whiteshell, le parc provincial Anishinaabe du Lac-Chitek, la réserve écologique de Brokenhead Wetland, la zone de planification de l’utilisation traditionnelle d’Asatiwisipe Aki, la zone de planification de l’utilisation traditionnelle de Pimitotah, etc.
- Nouvelle-Écosse : La planification comprend la recherche de sites d’importance culturelle tels que les aires de nature sauvage de Kluscap, de Tobeatic, de Katewe'katik et de Pu'tlaqne'katik ainsi que plusieurs aires de nature sauvage et réserves naturelles plus petites : le parc provincial Blomidon, le parc provincial Five Islands et la réserve de parc provincial Mersey River. Le site mi'kmawey Debert est également protégé par le Special Places Protection Act.
- Saskatchewan : La planification comprend la recherche de sites d’importance culturelle pour les communautés autochtones.
- Ontario : Certains sites culturels sont inclus dans des aires protégées. Ces sites sont également protégés par la Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et par la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
- Terre-Neuve-et-Labrador : Les sites d’importance culturelle historique peuvent être protégés par des accords sur les revendications territoriales ou par l’Historic Resources Act.
- Colombie-Britannique : La Colombie-Britannique utilise le patrimoine culturel des Premières Nations comme critère pour trouver des aires protégées susceptibles d’être proposées. Par conséquent, un nombre important d’aires protégées dans cette province contiennent des sites d’importance culturelle. Bien que ces sites d’importance culturelle puissent être mentionnés dans les renseignements publics, les détails sur la nature de l’importance culturelle ou l’emplacement du site sont souvent gardés confidentiels à la demande de la Première Nation.

Long description
Photo de l’aire protégée Edehzhie Dehcho en été représentant un large paysage boisé et vert avec quelques lacs
- Alberta : Certains sites sont inclus dans des aires protégées, comme le parc provincial Writing-on-Stone/Aisinai'pi, qui a reçu la désignation de site du patrimoine mondial en 2019.
Aires marines protégées et de conservation
- Les sites d’importance culturelle font partie de la planification de la conservation de zones marines dans deux provinces ainsi que de trois entités fédérales (ECCC, MPO et Parcs Canada).
- Six autorités responsables sur neuf (67 %) ont indiqué que les sites d’importance culturelle étaient protégés par des lois autres que celles portant sur les aires protégées.
- Plusieurs AMP et AMCEZ du Canada protègent des sites ou des espèces d’importance culturelle, en plus d’être écologiquement importantes. Par exemple, le béluga de Tarium Niryutait revêt une importance culturelle en tant que partie intégrante de la culture et des traditions innues autour de la nourriture. La protection de cette aire permet d’assurer la survie de la population de bélugas qui, à son tour, préserve les pratiques et les traditions culturelles.
- Dans les aires marines protégées et de conservation du MPO, la pêche et la cueillette d’aliments traditionnels sont autorisées. Lorsqu’il y a chevauchement entre une aire marine protégée et un lieu de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles existant, cette pêche pourra continuer si les objectifs de conservation ne sont pas compromis.
- Bien que le MPO protège les sites d’importance culturelle, la Loi sur les océans (1996) ne prévoit pas la protection de ces sites. Toutefois, l’interdiction d’activités dans une zone géographique, dans le but d’atteindre les objectifs de conservation des aires marines protégées, peut assurer une protection indirecte des sites culturels autochtones.
Études de cas illustrant l’utilisation coutumière des ressources biologiques
- Les communautés autochtones peuvent pratiquer pleinement l’utilisation coutumière des ressources biologiques (p. ex. la pêche, la chasse, le piégeage et la cueillette) sur le territoire relevant de 53 % des autorités responsables, tandis que 46 % des autorités limitent l’usage coutumier à des aires précises. Cela est rendu possible grâce à des dispositions législatives et, dans certains cas, à des traités.
- Quant aux biomes marins, sept autorités sur neuf (78 %) ont indiqué que leurs lois permettaient l’utilisation coutumière des ressources biologiques dans toutes leurs aires marines protégées et de conservation.
Les indemnités pour l’utilisation coutumière des ressources biologiques varient en fonction de l’autorité responsable et de l’endroit à l’intérieur du territoire relevant de l’autorité responsable où elle a cours. Par exemple, la chasse et le piégeage sont interdits dans tous les parcs du sud gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), mais la pêche et la cueillette sont autorisées dans certaines zones de ces parcs. Toutefois, dans les parcs situés dans la région de la Baie‑James, les bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois sont autorisés à poursuivre des activités traditionnelles comme la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette.
Accords procurant des avantages économiques et sociaux aux peuples autochtones
Des accords officiels sur l’effet social, les avantages et la cogestion sous-tendent la collaboration entre les peuples autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ces accords garantissent que les avantages découlant de la création d’aires protégées et de conservation sont partagés avec les peuples autochtones, que de nouvelles possibilités sont créées et que la responsabilité de la gestion est répartie de manière appropriée.
Les accords peuvent prendre diverses formes. Au Nunavut, la loi impose la conclusion d’ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI; voir l’encadré ci‑dessous). Dans d’autres administrations, les accords découlent d’initiatives visant à soutenir les droits des Autochtones, à leur offrir des possibilités économiques et à promouvoir la réconciliation. Par exemple, en Alberta, les membres des Premières Nations vivant près du parc provincial Writing-On-Stone tirent des avantages économiques des programmes de stages et des ententes avec le personnel conclues avec Alberta Parks. En Colombie-Britannique, divers accords prévoient des possibilités économiques pour les Premières Nations.
Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
Les ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) soutiennent les efforts de conservation, en particulier dans la région du Nunavut. Ces ententes portent sur des activités susceptibles d’avoir des répercussions sur les communautés inuites ou qui pourraient raisonnablement conférer un avantage aux Inuits.
Par exemple, l’Accord du Nunavut exige qu’une ERAI soit établie pour tout parc ou toute aire de conservation dans la région du Nunavut. Les projets touristiques sont soutenus dans la région du Nunavut grâce à une ERAI, car le gouvernement du Canada fournit des fonds aux parties inuites pour l’administration du Fonds des entreprises touristiques inuites.
Aires terrestres protégées et de conservation
- Dix autorités responsables sur 15 (67 %) ont indiqué que ces types d’accords étaient en place pour certaines de leurs aires protégées et de conservation.
- Un seul territoire (le Nunavut) a déclaré que des accords étaient en place dans toutes ses aires. De plus, des accords ont été conclus dans toutes les aires fédérales situées sur des terres visées par un traité (ECCC et Parcs Canada).
- Trois autorités sur 15 (20 %) ont indiqué qu’aucun accord n’avait été conclu pour l’une de leurs aires protégées et de conservation.
Aires marines protégées et de conservation
- Trois autorités responsables sur six (50 %) ont déclaré que des accords étaient en place pour certaines de leurs aires protégées et de conservation. Deux autorités sur six (33 %) ont indiqué qu’aucun accord n’avait été conclu pour l’une de leurs aires protégées et de conservation.
- Deux entités fédérales (Parcs Canada pour ses aires marines nationales de conservation et ECCC au Nunavut) ont répondu que des accords étaient en place, dans lesquels des ententes sur les répercussions et les avantages avaient été signées.
Études de cas
Thaidene Nëné
En 2019, la réserve de parc national Thaidene Nëné est devenue le plus récent parc national du Canada. Le parc protège les biomes de la forêt boréale, de la toundra et de l’eau douce. La Première Nation des Dénés Łutsël K'é, la Première Nation Deninu Kųę, la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes et la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest travaillent en partenariat avec les gouvernements fédéral et territorial pour surveiller, gérer et protéger le territoire. En outre, les gardiens dénés Ni Hat'ni jouent un rôle important dans la gestion de Thaidene Nëné. Thaidene Nëné continue de préserver la biodiversité et la continuité culturelle pour les générations futures.
Thaidene Nëné se compose de la première aire protégée territoriale des Territoires du Nord‑Ouest, créée en vertu de la nouvelle Loi sur les aires protégées des Territoires du Nord‑Ouest, d’une aire de conservation de la faune créée en vertu de la Loi sur la faune des Territoires du Nord-Ouest et d’une réserve de parc national protégée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. L’ensemble de ces zones constitue l’aire protégée autochtone de Thaidene Nëné. D’une superficie de 26 300 km2, elle est à ce jour la plus grande aire protégée du Canada résultant d’une collaboration entre les gouvernements nationaux et infranationaux et les gouvernements autochtones. Les terres ont une importance culturelle pour les Métis et les Premières Nations de la région en raison des nombreux sites sacrés et des espèces culturellement importantes qu’elles abritent. Thaidene Nëné atteint des objectifs clés en matière de conservation de la biodiversité et permettra une continuité culturelle et des investissements touristiques qui profiteront directement aux communautés voisines. Les travaux de surveillance et de conservation sont effectués en collaboration entre ces quatre nations et les partenaires gouvernementaux, les décisions étant prises par consensus.
Edéhzhíe
En 2001, un comité composé de Dénés du Dehcho, du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest et du gouvernement du Canada a été créé pour élaborer le plan d’aménagement du Dehcho. Ce plan aboutira à la création d’Edéhzhíe en 2018, sur le plateau Horn, du côté ouest du Grand lac des Esclaves, au sud-ouest de Yellowknife.
Dehcho K’éhodi signifie « prendre soin du Dehcho » en Dehcho Dene Zhatié. Le programme d’intendance du Dehcho K'éhodi est l’une des plus grandes forces d’Edéhzhíe. Il s’agit d’un programme de terrain élaboré par toutes les communautés partenaires des Premières Nations du Dehcho qui propose des activités pertinentes sur le plan régional et culturel. Il s’appuie sur trois principes directeurs : 1) le programme doit être guidé par les valeurs dénées, 2) il doit renforcer la langue dénée, et 3) il doit garantir des relations entre les jeunes et les Aînés. Le Dehcho K'éhodi continue de croître, en mettant désormais l’accent sur les ateliers d’intégration et les liens tissés dans le cadre du programme d’intendance avec le programme de gardiens du Dehcho.
Le programme de gardiens est le prolongement de l’enseignement et de l’apprentissage dirigés par les Aînés. Les gardiens associent les connaissances et les méthodes traditionnelles de leurs ancêtres aux pratiques scientifiques occidentales de surveillance du climat et de l’eau et de la protection des écosystèmes. Le bureau des Premières Nations du Dehcho héberge le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) du Dehcho. Il s’agit d’un programme régional qui facilite la surveillance communautaire de l’eau dans le Dehcho tout en soutenant la souveraineté des Premières Nations.

Long description
Picture of Writing-on-Stone Provincial Park depicting a quiet river and a sandstone outcrop
Parc provincial Anishinaabe du Lac-Chitek
Ce parc est le seul endroit du Manitoba qui réunit les cinq espèces d’ongulés sauvages de la province : le cerf, l’orignal, le wapiti, le caribou et le bison. Deux d’entre elles, le bison des bois et le caribou des bois, sont des espèces menacées. En 2016, le gouvernement du Manitoba a signé un protocole d’entente avec la Première Nation Skownan afin de refléter la valeur de la protection des aires classifiées comme étant des « parcs mettant en valeur les terres traditionnellement utilisées par les peuples indigènes ». Il s’agissait d’un geste de reconnaissance et de respect des droits de la Première Nation Skownan à utiliser le territoire pour sa subsistance et sa culture. Les activités commerciales et industrielles ont été interdites dans plus de 99 % du parc, mais les activités traditionnelles ont été encouragées, notamment la pêche dans le lac Chitek, source de revenus et de nourriture pour le peuple Skownan. Le parc a également accueilli un camp culturel annuel, où les Aînés et les jeunes échangent leurs connaissances et leurs traditions.
Chapitre 5 : Participation des intervenants et conservation des terres privées
Ce chapitre explore la manière dont les collectivités locales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les partenaires privés contribuent à la conservation. Il examine les processus de consultation et les stratégies de mobilisation utilisés par toutes les autorités responsables ainsi que les programmes d’incitation qui soutiennent la conservation des terres privées.
Organisations non gouvernementales et groupes de citoyens
Les organisations locales du type « Amis du/de la/de l’/des » et les ONG gèrent des programmes éducatifs sur le site et mènent des initiatives de science citoyenne, souvent avec le soutien du gouvernement. Elles plaident également en faveur de la conservation et de la prise des mesures nécessaires pour y parvenir sur des sites précis. Plus de la moitié des autorités responsables interrogées (8 sur 15, soit 53 %) ont travaillé avec des ONG ou des groupes de citoyens. Ces partenariats aboutissent parfois à la création d’aires protégées privées et d’aires cogérées (53 %).
Aires terrestres protégées et de conservation
Par exemple, l’Ontario cogère des zones avec Conservation de la nature Canada. En outre, de nombreux groupes du type « Amis du/de la/de l’/des » aident à la réalisation de projets dans les parcs provinciaux, notamment la construction de promenades, la mise en œuvre de certains programmes d’éducation sur le patrimoine naturel, la vente de publications sur les parcs, etc.
Les parcs provinciaux de Nouvelle-Écosse ont conclu cinq accords de gestion de parc afin d’autoriser les associations de parcs et de sentiers et les municipalités à gérer les sentiers récréatifs dans les aires de nature sauvage. Sept autres accords sont en cours d’élaboration.
Au Manitoba, des ONG ou des groupes de citoyens créent des zones tampons et des corridors fauniques entre les aires protégées désignées, ce qui favorise la connectivité écologique. En vertu de la Loi sur les accords de conservation, les propriétaires fonciers privés peuvent mettre en place une servitude juridiquement contraignante sur leurs terres afin de garantir que les futurs propriétaires maintiendront les caractéristiques naturelles de ces terres.
De même, les propriétaires privés peuvent faire désigner leurs terres comme aires naturelles à l’Île-du-Prince-Édouard (Natural Areas Protection Act), au Québec (Loi sur la conservation du patrimoine naturel) et au Nouveau-Brunswick (Loi sur les zones naturelles protégées).
Aires protégées et de conservation
Quatre entités sur dix (40 %) ont établi des partenariats avec des ONG ou des groupes de citoyens. Citons par exemple le gouvernement du Québec, qui collabore avec l’organisme sans but lucratif Parc Nature de Pointe-aux-Outardes pour élaborer un plan de gestion pour la réserve aquatique de Manicouagan. Dans le cadre de l’Initiative sur les opportunités de conservation des communautés côtières, le MPO a également élaboré des programmes visant à faire participer les membres des collectivités à la conservation du milieu marin.
Participation des collectivités locales
Le succès de la création et de la gestion des aires protégées et de conservation dépend de leur contexte social. La consultation de divers intervenants, y compris les collectivités locales, peut faciliter le traitement de différentes questions, allant de la résolution de conflits à la négociation d’accords de collaboration ou de partenariats.
Aires terrestres protégées et de conservation
- Pour 14 autorités sur 15 (93 %), la consultation des collectivités situées à proximité d’aires protégées et de conservation ou adjacentes à celles-ci est exigée par la loi ou les politiques.
- Pour 12 autorités sur 15 (80 %), la plupart des plans de gestion incluent des dispositions relatives à la consultation des collectivités.
Les collectivités ont été consultées au sujet des décisions de gestion :
- Une autorité sur 15 (6 %) consulte les collectivités sur les décisions de gestion quotidienne (le Nunavut).
- Dix sur 15 (67 %) ont occasionnellement mobilisé les collectivités locales dans les décisions de gestion.
- Quatre sur 15 (27 %) ont rarement organisé des consultations ou n’ont consulté les collectivités locales que pour les décisions de gestion importantes.
- À l’échelle fédérale, ECCC a consulté les collectivités locales situées à proximité de réserves nationales de faune, ainsi que le grand public canadien. Parcs Canada a mené des consultations lors de la préparation des plans de gestion.
Certaines administrations, comme le Manitoba, mobilisent un large éventail d’intervenants lors de la mise en place de projets (peuples autochtones, collectivités locales et secteurs minier, forestier, pétrolier et hydroélectrique). Dans cette province, les collectivités locales et autochtones prennent des décisions de gestion avec les conseils de cogestion des ressources pour les sites relevant de leurs aires de gestion des ressources, par exemple en formulant des recommandations sur les activités proposées.
Aires marines protégées et de conservation
- Six autorités sur neuf (67 %) ont consulté les collectivités locales pour respecter une obligation légale ou politique.
- Pour cinq autorités sur neuf (56 %), la plupart des plans de gestion comprennent des dispositions relatives à la participation des collectivités locales.
- Cinq autorités sur neuf (55 %) ont consulté les collectivités occasionnellement, tandis que les autres ont procédé à des consultations peu fréquentes.
- L’article 31 de la Loi sur les océans oblige le MPO à consulter les collectivités locales . Des représentants des collectivités participent aux comités consultatifs des AMP, en particulier pour les sites côtiers (par opposition aux sites au large des côtes).
Industries du secteur des ressources
Les industries du secteur des ressources sont consultées par la majorité des autorités responsables d’aires terrestres (14 sur 15) et marines (8 sur 9).
Aires terrestres protégées et de conservation
- Dix organisations sur 15 (67 %) ont établi des relations de travail avec les secteurs de ressources concernés.
- Huit sur 15 (53 %) ont pris contact avec les industries des ressources au sujet du retrait des droits afin de permettre la création d’aires protégées et de conservation.
- Cinq mécanismes de consultation principaux ont été utilisés pour mobiliser les industries :
- Consultations publiques traditionnelles (86 %)
- Consultations ciblées pour les participants du secteur des ressources (73 %)
- Processus de planification de l’utilisation des terres (73 %)
- Participation à des organismes consultatifs (53 %)
- Participation de l’industrie aux conseils de cogestion (parc sauvage Kitaskino Nuwenëné en Alberta)
En Colombie-Britannique, les industries des ressources ont été représentées lors des tables de planification de l’utilisation des terres dans les années 1990 et 2000, au cours desquelles des recommandations sur les aires protégées et de conservation ont été élaborées. Dans certains cas, des industries des ressources ont volontairement renoncé à leurs droits d’exploitation pour que des aires protégées et de conservation puissent être créées.
Au Manitoba, les communautés autochtones, les collectivités locales, l’industrie et Manitoba Hydro participent à la planification des aires protégées. Manitoba Hydro s’efforce d’éviter ou de réduire le plus possible les effets environnementaux négatifs qui peuvent être associés à ses activités de développement à proximité des aires protégées et de conservation.
En Alberta, l’industrie est un partenaire important. Les sociétés d’exploitation des ressources naturelles telles qu’Alpac et TransCanada Pipelines ont activement collaboré avec Alberta Parks pour atténuer les perturbations de la biodiversité. En 2019, le parc provincial sauvage Kitaskino Nuwenëné a été créé grâce à une collaboration entre les partenaires des industries et les communautés autochtones.
Parc sauvage Kitaskino Nuwenëné
Avec le soutien de la composante Démarrage rapide du Fonds canadien pour la nature, la Première Nation crie Mikisew et le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta ont créé une nouvelle aire d’intendance de la biodiversité, qui a été officiellement désignée « parc provincial sauvage Kitaskino Nuwenëné » en mars 2019. Le parc, d’une superficie de 1 620 km2, protège les bisons, les caribous et le bassin hydrographique du delta Paix-Athabasca.
Après la création de Kitaskino Nuwenëné, la Première Nation crie Mikisew a reçu un financement supplémentaire dans le cadre du Défi de l’objectif 1 du Fonds de la nature du Canada et travaillera avec la province, l’industrie et les propriétaires fonciers à étendre l’aire existante pour protéger un plus grand nombre d’habitats importants et de territoires traditionnels.Note de bas de page 29
Aires marines protégées et de conservation
- Quatre autorités responsables sur 10 ont établi des relations de travail avec les secteurs de ressources concernés par les projets de conservation.
- Six sur 10 ont procédé à des retraits de droits spécifiques pour permettre la création d’aires marines protégées et de conservation.
- Quatre mécanismes de consultation ont été utilisés :
- Processus de consultation publique (80 %);
- Consultations ciblées ou spécifiques avec les secteurs des ressources (60 %);
- Processus de planification de l’utilisation de la mer (40 %);
- Organismes consultatifs (20 %).
Protection et conservation des terres privées
Les terres privées représentent officiellement moins de 1 % de la superficie totale protégée et conservée au Canada, mais elles sont probablement sous-déclaréesNote de bas de page 68 . Les aires protégées privées tendent à être situées sur des terres où la richesse en espèces, y compris en espèces en péril, est élevée, en particulier dans le sud du CanadaNote de bas de page 69 .
Définition d’« aire protégée privée »
En plus de répondre à la définition d’« aire protégée », une aire protégée privée relève d’une gouvernance privée par Note de bas de page 70:
- des personnes ou des groupes de personnes;
- des organisations non gouvernementales;
- des sociétés (qu’il s’agisse d’entreprises commerciales existantes ou parfois de sociétés créées par des groupes de propriétaires privés pour gérer des aires protégées privées);
- des propriétaires à but lucratif;
- des entités de recherche (p. ex., universités, stations expérimentales);
- des entités religieuses.
Programmes de soutien aux aires protégées privées
La conservation des aires protégées privées est totalement ou partiellement reconnue par 10 autorités responsables sur 15 (67 %). Certaines autorités ont créé des désignations spécifiques pour les aires privées protégées ou de conservation : « réserve naturelle » et « milieu naturel de conservation volontaire » au Québec, et « Private Conservation Lands » en Saskatchewan.
Les incitatifs fiscaux encouragent la création de réserves de conservation privées, par l’intermédiaire de la propriété en fief simple ou de l’établissement de servitudes, d’accords ou de conventions de conservation sur des terres privées :
- En Alberta, le Land Trust Grant Program permet l’acquisition de terres privées à haute valeur de conservation par l’intermédiaire de servitudes et de partenariats avec diverses agences de fiducie foncière. De 2016 à 2020, le Land Trust Grant Program a permis l’acquisition de 266 km2 de terres en Alberta.
- Les pâturages patrimoniaux de l’Alberta (prairies indigènes) permettent aux titulaires de baux de faire paître leurs animaux sur les sites visés et autorisent une utilisation récréative de faible intensité lorsqu’elle est compatible avec les objectifs de conservation. Les premiers baux de pâturage en Alberta ont été établis dès 1881. Ces baux sont bénéfiques pour les Alberta, car ils suscitent la mobilisation des titulaires dans les activités d’intendance. En effet, les titulaires de baux établis le plus près des terres concernées, qui totalisent 5,2 millions d’acres de terres de la Couronne, en assurent la gestion au quotidienNote de bas de page 71 .
- La Colombie-Britannique a créé le programme Marine Parks Forever pour favoriser le partage des coûts et le don d’infrastructures (ancres, attaches de poupe, bouées) afin de soutenir l’utilisation des parcs marins. BC Parks administre également de nombreuses propriétés appartenant à des ONG ou à des particuliers et louées au ministère pour une durée de 99 ans.
- L’Ontario collabore activement avec des partenaires extérieurs afin d’égaler les contributions privées aux projets d’acquisition des terres dans le cadre du Partenariat pour la protection des espaces verts. En 2020, un investissement de 20 millions de dollars sur quatre ans a été réalisé pour acquérir des terres d’importance écologique et promouvoir des espaces naturels sains. Ce financement a soutenu Conservation de la nature Canada et les membres de l’Ontario Land Trust Alliance dans leurs efforts pour conserver, remettre en état et gérer des aires naturelles de grande valeur pour la conservation au moyen d’aires protégées privées.
- À l’échelle fédérale, les projets de conservation sur les terres privées sont financés par de nombreux programmes, notamment le Programme d’intendance de l’habitat, le Fonds national de conservation des milieux humides (qui a fourni du financement jusqu’en 2019) et le Programme de conservation des zones naturelles.
- Géré par ECCC, le Programme d’intendance de l’habitat a pour objectif de soutenir des projets de conservation et de protection des espèces en péril et de leurs habitats qui contribuent à la préservation de la biodiversité dans son ensemble. Ces fonds encouragent la participation des collectivités locales, des ONG et d’autres organisations.
- Le Programme de conservation du patrimoine naturel aide les ONG sans but lucratif à sécuriser des terres écosensibles afin d’assurer la protection de divers écosystèmes, des espèces sauvages et de l’habitat. Le financement est assuré par ECCC, et le projet est géré par Conservation de la nature Canada. Les organisations fournissent du financement de contrepartie dans un rapport de 2:1 pour chaque dollar fédéral reçu afin d’acquérir des terres écosensibles ou d’élaborer des accords en matière de conservation avec des propriétaires privés. La priorité est accordée aux terres qui protègent l’habitat des espèces en péril et des oiseaux migrateurs, ou qui améliorent la connectivité entre les aires protégées. En outre, il est possible de protéger des terres qui ont une importance nationale ou provinciale sur la base de critères écologiques ou pour réduire les facteurs de stress liés à l’utilisation des terres adjacentes à des aires protégées.
- Le Fonds national de conservation des milieux humides est un programme quinquennal lancé en 2014-2015 et administré par ECCC. Le programme soutient les activités de terrain visant à remettre en état et à améliorer les milieux humides au Canada, y compris ceux situés sur des terrains privés. Certaines des activités financées ont abouti à la création de nouvelles aires protégées privées.
- D’autres provinces, comme la Nouvelle-Écosse, le Québec et le Manitoba, ont soutenu directement les initiatives de conservation des terres privées en fournissant un financement direct ou de contrepartie, ou en établissant des fonds fiduciaires pour l’acquisition de terres. Le Nouveau-Brunswick dispose de mécanismes juridiques permettant de reconnaître et de désigner officiellement les aires protégées privées. Le Québec peut également reconnaître des aires protégées privées au titre de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, lorsque le propriétaire en fait la demande.
Incitatifs et instruments financiers
Dix autorités responsables sur 15 (67 %) offrent d’autres mesures incitatives pour soutenir la protection de terres privées.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent avec les ONG et ECCC à améliorer la reconnaissance des terres privées de conservation. Le Programme des dons écologiques, par exemple, est géré par ECCC en coopération avec des dizaines de partenaires. Il offre des avantages fiscaux aux propriétaires fonciers qui font don d’un terrain ou d’un intérêt partiel dans un terrain à un bénéficiaire qualifié afin d’assurer la conservation à perpétuité de la biodiversité et du patrimoine naturel. Le Programme des dons écologiques a fêté son 25e anniversaire en 2020. Depuis le lancement du programme en 1995, plus de 1 500 dons écologiques d’une valeur de près d’un milliard de dollars ont été effectués par des propriétaires fonciers de tout le Canada, ce qui a permis de protéger plus de 200 000 hectares d’habitats fauniquesNote de bas de page 72 .
- À l’Île-du-Prince-Édouard, l’allégement de l’impôt foncier est accordé par le gouvernement au titre du Real Property Tax Act. Il est également possible de bénéficier d’avantages fiscaux pour les dons de terres à des organisations caritatives enregistrées (dans le cadre du Programme des dons écologiques).
- Au Manitoba, le crédit d’impôt sur les biens-fonds riverains a été mis en place par le ministère des Finances de la province. Il vise à encourager les exploitants agricoles à gérer les rives des lacs, des rivières et des ruisseaux. Les agriculteurs et les éleveurs qui s’engagent à protéger une bande de terre le long d’un cours d’eau sur des terres agricoles pendant cinq ans peuvent bénéficier d’avantages. De plus, le Manitoba a créé le Fonds en fiducie pour la conservation en 2018 avec une contribution de 102 millions de dollars à un fonds de dotation destiné à générer des revenus pour des projets de conservation. Deux autres fiducies, le fonds GROW et le fonds Wetlands GROW, ont également été créées, ce qui porte à 204 millions de dollars l’investissement total du Manitoba dans ces fiducies. La Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba gère les programmes de subventions qui administrent les revenus des fiducies. Parmi les activités financées par le Fonds en fiducie pour la conservation Figurent la conservation de la biodiversité, l’atténuation des inondations et des sécheresses, l’atténuation des changements climatiques par le stockage de carbone, l’amélioration de la santé des sols, la préservation des voies navigables et la réduction de l’érosion des sols. Le Fonds pour la conservation et le climat, créé en 2020, finance des projets qui soutiennent les priorités actuelles du Plan vert et climatique du Manitoba. Les catégories admissibles comprennent la nature et les paysages résilients ainsi que la conservation des eaux.
- De nombreuses provinces offrent également un allégement fiscal (réduction des taxes foncières, remboursement de l’impôt sur le revenu, délivrance d’un reçu fiscal provincial, etc.) pour les terres placées sous une servitude de conservation (Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard).
Chapitre 6 : Résumés provinciaux, territoriaux et fédéraux
Ce chapitre offre un aperçu des aires protégées relevant de seize autorités responsables gouvernementales, soit les provinces, les territoires et des entités du gouvernement fédéral. Il décrit la superficie couverte par des aires protégées et de conservation de chaque autorité et fournit une ventilation de ces aires par type de gouvernance et par catégorie de gestion de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le chapitre compare également la croissance des aires protégées de chaque autorité depuis 2015. Cette croissance est représentée par l’augmentation en pourcentage de la superficie des aires protégées et de conservation par rapport à 2015.
Ce chapitre met également en lumière certaines des réalisations importantes de chaque autorité au cours de la période couverte par le rapport et présente les priorités qu’elles ont définies en matière de planification et de gestion des aires protégées pour les cinq années à venir.
Alberta
Statistiques sur les aires
15,4 % (101 597 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
l s’agit d’une augmentation de 25,0 % par rapport à 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
55 630 |
8 |
Gouvernement infranational |
46 080 |
7 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
1 178 |
<1 |
Ib |
36 824 |
6 |
II |
59 710 |
9 |
IV |
85 |
<1 |
IV |
1 494 |
<1 |
Non classifiée |
2 419 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Reconnaissance de nouvelles AMCEZ
- Amélioration de la gestion des aires protégées et de conservation existantes
- Planification et gestion des changements climatiques
- Amélioration de l’expérience des visiteurs
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Collaboration avec le secteur privé
Réalisations
- Le parc provincial Castle et le parc provincial sauvage Castle ont été créés en 2017, et l’élaboration et l’approbation du plan de gestion des parcs Castle ont suivi en 2018. Collectivement, ces parcs protègent 105 179 ha, y compris des bassins hydrographiques précieux et des habitats pour plus de 200 espèces rares. Les parcs Castle sont reliés par des corridors fauniques et constituent un élément essentiel de l’écosystème de la Couronne du continent.
- Le gouvernement de l’Alberta a créé quatre nouveaux parcs sauvages dans le nord de la province en 2018, de même que le parc sauvage Kitaskino Nuwenëné en 2019. La création de ce dernier est le fruit d’une collaboration avec la Première Nation crie Mikisew et de plusieurs mois de discussions avec les populations autochtones, l’industrie et d’autres intervenants.
- Le parc provincial Writing-on-Stone/Áísínai'pi a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2019. Ce parc de prairie mixte est un site sacré pour le peuple des Pieds-Noirs et contient la plus importante concentration de pétroglyphes (gravures sur pierre) et de pictogrammes (peintures sur pierre) protégés des Premières Nations dans les grandes plaines de l’Amérique du Nord.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées en Alberta par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Colombie-Britannique
Statistiques sur les aires
19,5 % (184 277 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
l s’agit d’une augmentation de 29,5 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
6 115 |
1 |
Gouvernement infranational |
177 019 |
19 |
Organisations sans but lucratif |
1 049 |
<1 |
Gouvernance conjointe |
89 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
1 097 |
<1 |
Ib |
36 248 |
4 |
II |
103 921 |
11 |
IV |
1 421 |
<1 |
IV |
3 380 |
<1 |
V |
4 |
<1 |
VI |
197 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Amélioration de la gestion des aires protégées et de conservation existantes
- Gestion des répercussions liées à l’augmentation de la fréquentation
- Évaluation des programmes relatifs aux aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Intégration dans des paysages terrestres ou marins plus vastes
Réalisations
- Le réseau de parcs et d’aires protégées de la Colombie-Britannique, géré par BC Parks, continue de s’étendre grâce à de nouvelles désignations et à l’acquisition de terres, augmentant ainsi la superficie de terres à des fins de conservation et de loisirs. Au cours des années couvertes par ce rapport, le réseau de parcs provinciaux de la Colombie-Britannique s’est agrandi d’environ 42 000 hectares.
- La Fondation BC Parks a été créée en 2017 et a commencé ses activités en 2018. Voici quelques-unes de ses réalisations :
- la protection de 15 sites magnifiques couvrant plus de 50 km2 de territoire;
- le lancement du premier programme d’ordonnances de parcs nationaux au Canada, auquel se sont inscrits plus de 10 000 professionnels de la santé dans tout le pays. Le programme a reçu le prestigieux prix de l’innovation Joule de l’Association médicale canadienne et a été présenté par l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies dans le rapport de la COP26;
- la création du réseau WildCAM, qui réunit plus de 200 chercheurs utilisant des caméras à distance pour surveiller la faune en Colombie-Britannique et en Alberta.
- La stratégie d’avenir de BC Parks a été lancée en novembre 2016. Dans le contexte de cette stratégie, la Colombie-Britannique a investi environ 22,9 millions de dollars sur cinq ans pour l’agrandissement des emplacements de camping dans les parcs provinciaux et les sites récréatifs, en allouant des fonds supplémentaires à d’autres initiatives de loisirs et de conservation. Le principe directeur de la stratégie d’avenir de BC Parks sera de protéger l’héritage du patrimoine naturel afin que les générations futures puissent en profiter, comme l’ont fait les générations passées.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées en Colombie-Britannique par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Manitoba
Statistiques sur les aires
11,0 % (71 561 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
l s’agit d’une augmentation de 2,8 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
13 972 |
2 |
Gouvernement infranational |
44 260 |
7 |
Organisations sans but lucratif |
232 |
<1 |
Gouvernance collaborative |
13 099 |
2 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
429 |
<1 |
Ib |
34 385 |
5 |
II |
34 571 |
5 |
IV |
609 |
<1 |
IV |
1 336 |
<1 |
V |
1 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Amélioration de l’expérience des visiteurs
- Évaluation des programmes d’aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Production de rapports sur les aires protégées et de conservation
- Augmentation de la représentation écologique.
Réalisations
- Le gouvernement du Manitoba a reconnu la première AMCEZ au Canada – la Base des Forces canadiennes (BFC) Shilo – en 2019, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale. La BFC Shilo est une base d’opérations et d’entraînement des Forces armées canadiennes située dans une prairie mixte du centre-sud du Manitoba.
- Outre la BFC Shilo, le gouvernement du Manitoba a examiné trois propriétés municipales et de nouvelles aires protégées privées en vue de les inclure dans son réseau d’aires protégées et de conservation.
- En 2019, le gouvernement du Manitoba a désigné 614 hectares de forêt de tourbière minérotrophe et d’autres habitats humides, comme la zone de gestion de la faune de Skylake. Ces terres de basse altitude abritent de nombreuses espèces sauvages et une végétation diversifiée, y compris des espèces d’orchidées rares.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées au Manitoba par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Nouveau-Brunswick
Statistiques sur les aires
4,9 % (3 548 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 2,7 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
468 |
1 |
Gouvernement infranational |
3 062 |
4 |
Organisations sans but lucratif |
18 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
44 |
<1 |
Ib |
176 |
<1 |
II |
3 136 |
4 |
IV |
13 |
<1 |
VI |
20 |
<1 |
Non classifiée |
159 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Élaboration ou mise à jour des plans de gestion
- Création de nouvelles aires protégées
- Reconnaissance de nouvelles AMCEZ
- Modification ou élaboration de lois ou de règlements
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
Réalisations
- En 2019, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé une initiative visant à doubler la superficie des terres et des eaux protégées dans la province. Il a travaillé avec des partenaires pour établir des aires protégées s’inscrivant dans l’initiative « Patrimoine naturel ». Les aires de conservation ont été sélectionnées selon des facteurs tels que la valeur de la biodiversité, la valeur culturelle et le potentiel d’adaptation aux changements climatiques.
- Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a collaboré avec des organisations de fiducie foncière pour désigner légalement leurs terres comme aires naturelles protégées.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées au Nouveau-Brunswick par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Terre-Neuve-et-Labrador
Statistiques sur les aires
6,9 % (28 110 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 25,8 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
22 808 |
6 |
Gouvernement infranational |
5 302 |
1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
7 |
<1 |
Ib |
3 983 |
1 |
II |
24 052 |
6 |
IV |
3 |
<1 |
IV |
65 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Relevé des zones prioritaires pour la protection ou la conservation
- Création de nouvelles aires protégées
- Reconnaissance de nouvelles AMCEZ
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Amélioration de l’éducation et la sensibilisation
Réalisations
- En 2020, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a publié son plan d’agrandissement du réseau d’aires protégées sur l’île de Terre-Neuve, après plus de 20 ans de planification. Le plan propose 26 nouvelles aires protégées, représentatives de chacune des régions naturelles. La planification a donné la priorité aux habitats et aux espèces intacts et biologiquement importants ainsi qu’aux caractéristiques uniques, tout en tenant compte des effets des changements climatiques. Le plan a fait l’objet d’une consultation publique de six mois.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées à Terre-Neuve-et-Labrador par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Territoires du Nord-Ouest
Statistiques sur les aires
15,8 % (212 321 km2) de la superficie terrestre du territoire est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 70,9 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Gouvernement national |
130 115 |
10 |
Gouvernement infranational |
21 270 |
2 |
Peuples autochtones |
977 |
<1 |
Gouvernance collaborative |
60 046 |
4 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Ia |
111 |
<1 |
Ib |
78 208 |
6 |
II |
89 287 |
7 |
VI |
5 619 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Planification du réseau
- Élaboration de nouveaux plans de gestion
- Planification et gestion des changements climatiques
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
Réalisations
- Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a publié en 2016 deux documents stratégiques importants pour la planification des réseaux de conservation. Le document Territoire en santé, population en santé : Priorités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour la planification du réseau de conservation de 2016 à 2021 est un plan de travail quinquennal visant à faire progresser la planification collaborative des réseaux de conservation dans les Territoires du Nord Ouest. Le rapport sur l’état du réseau de conservation des Territoires du Nord-Ouest fournit de l’information, issue des connaissances scientifiques et traditionnelles, qui peut être utilisée comme référence pour faire progresser le réseau de conservation dans les Territoires du Nord-Ouest.
- Thaidene Nëné a été créée en août 2019. Il s’agit d’une aire protégée autochtone nationale et territoriale créée en vertu de règlements pris en application de la Loi sur les aires protégées (environ 9 105 km2). Une future aire de conservation de la faune sera créée en vertu de la Loi sur la faune (environ 3 120 km2).
- En septembre 2019, le gouvernement des Territoires du Nord Ouest et les K'asho Got'ı̨nę ont signé un accord d’établissement pour l’aire protégée autochtone et territoriale Ts'udé Nilįné Tuyeta.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées dans les Territoires du Nord-Ouest par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Nouvelle-Écosse
Statistiques sur les aires
12,8 % (7 071 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 5,1 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
1 436 |
3 |
Gouvernement infranational |
5 381 |
10 |
Organisations sans but lucratif |
120 |
<1 |
Propriétaires fonciers individuels |
1 |
<1 |
Gouvernance collaborative |
168 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
243 |
<1 |
Ib |
4 067 |
7 |
II |
1 722 |
3 |
IV |
133 |
<1 |
IV |
533 |
1 |
VI |
76 |
<1 |
Non classifiée |
332 |
1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Relevé des zones prioritaires pour la protection ou la conservation
- Création de nouvelles aires protégées
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Amélioration de la connectivité entre les aires protégées et de conservation
Réalisations
- Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a poursuivi la mise en œuvre de son plan pour les parcs et les aires protégées de 2013, en désignant ou en annonçant environ 30 000 ha depuis 2019. Les aires protégées nouvelles et agrandies contiennent certains des derniers vestiges d’aires naturelles relativement vastes et intactes ainsi que des forêts anciennes, des habitats d’espèces en péril, des côtes, des plages, des voies navigables et des îles.
- Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ainsi que des partenaires tels que les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, des fiducies foncières, des partenaires municipaux et d’autres ont créé de nouveaux réseaux pour échanger les connaissances et faire progresser les travaux sur les aires protégées et de conservation. Les actions clés consistent à explorer les possibilités de créer des aires protégées et de conservation autochtones, à conserver les habitats principaux tels que les forêts anciennes et les milieux humides, à améliorer la protection de la qualité de l’eau et à renforcer la connectivité écologique.
- Dans le cadre de son programme de renouvellement des infrastructures, Nova Scotia Parks a modernisé ses infrastructures pour les rendre plus durables, accessibles et inclusives. Ils ont également planifié et mis en œuvre l’intendance partagée de plusieurs parcs, plages et sentiers.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées en Nouvelle-Écosse par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Nunavut
Statistiques sur les aires
10,1 % (211 373 km2) de la superficie terrestre du territoire est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 16,2 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Gouvernement national |
220 539 |
11 |
Gouvernement infranational |
128 |
<1 |
Gouvernance collaborative |
1 462 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Ia |
2 660 |
<1 |
Ib |
103 029 |
5 |
II |
116 238 |
6 |
V |
128 |
<1 |
VI |
74 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Modification ou élaboration de lois ou de règlements
- Élaboration ou mise à jour des plans de gestion et amélioration de l’expérience des visiteurs
- Éducation et sensibilisation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
Réalisations
- L’entente-cadre sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) en matière de parcs territoriaux a été mise en œuvre dans la région du Nunavut. Il comprenait l’élaboration de plans directeurs, de plans de gestion et de plans de mise en valeur du patrimoine pour divers parcs territoriaux existants ou proposés.
- Le Programme des parcs du Nunavut (Kajjausarviit) a été mis sur pied. Kajjausarviit définit l’objectif et la nature des parcs territoriaux du Nunavut, et servira de base à l’élaboration d’une nouvelle loi et de nouveaux règlements sur les parcs territoriaux, conformément à l’Accord du Nunavut et à l’ERAI sur les parcs.
- Les comités de planification et de gestion des parcs conjoints entre les Inuits et le gouvernement ont reçu un soutien pour poursuivre leurs activités, et de nouveaux membres ont été nommés. Ces comités sont composés : de comités mixtes de planification et de gestion communautaires dans sept collectivités, de comités consultatifs sur les parcs dans deux collectivités et d’un comité mixte de planification et de gestion du Nunavut, comme l’exige l’ERAI sur les parcs.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées au Nunavut par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Ontario
Statistiques sur les aires
10,7 % (114 689 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 0,5 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
13 507 |
1 |
Gouvernement infranational |
88 848 |
8 |
Gouvernance collaborative |
3 497 |
<1 |
Non déclaré |
8 807 |
1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
1 220 |
<1 |
Ib |
48 214 |
4,5 |
II |
41 702 |
4 |
IV |
103 |
<1 |
IV |
3 535 |
<1 |
V |
45 |
<1 |
VI |
11 031 |
1 |
Non classifiée |
8 807 |
1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Élaboration ou mise à jour des plans de gestion
- Augmentation de la fréquentation
- Production de rapports sur les aires protégées et de conservation
- Collaboration avec des organisations non gouvernementales de conservation
Réalisations
- Le gouvernement de l’Ontario a collaboré avec des partenaires et des propriétaires fonciers privés afin d’examiner et de déclarer les aires protégées privées, ce qui a contribué à la comptabilisation de terres dans le cadre de l’objectif 1 du Canada. De 2016 à 2020, l’Ontario a ajouté 380 aires protégées privées et trois AMCEZ à la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation. Au total, les 383 aires couvrent 319,89 km2.
- En 2020, un investissement de 20 millions de dollars sur quatre ans a été réalisé dans le cadre du Partenariat pour la protection des espaces verts pour obtenir des terres d’importance écologique et promouvoir des espaces naturels sains. Ce financement permet à Conservation de la nature Canada et aux membres de l’Ontario Land Trust Alliance de conserver, de remettre en état et de gérer des aires naturelles de grande valeur pour la conservation.
- En 2020, des mises à jour administratives ont été apportées à Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. Les mises à jour reflètent les changements intervenus dans la structure gouvernementale et dans la gestion de l’utilisation et de l’occupation des terres par des tiers. Les mises à jour ont également permis de simplifier le langage de la planification de la gestion et d’actualiser les approches en matière de gestion financière.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées en Ontario par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Île-du-Prince-Édouard
Statistiques sur les aires
4,2 % (237 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 839 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
25 |
<1 |
Gouvernement infranational |
141 |
2 |
Organisations sans but lucratif |
25 |
<1 |
Propriétaires fonciers individuels |
29 |
1 |
Gouvernance collaborative |
18 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
II |
33 |
1 |
IV |
64 |
1 |
IV |
114 |
2 |
V |
2 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
- Modification ou élaboration de lois ou de règlements
- Élaboration ou mise à jour de plans de gestion
- Surveillance écologique dans les aires protégées et de conservation
- Production de rapports sur les aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Collaboration avec le secteur privé
Réalisations
- Au cours de la période visée par le rapport, l’Île-du-Prince-Édouard a commencé à déclarer les AMCEZ et les aires provisoires dans le réseau d’aires protégées et de conservation.
- La protection des terres privées reste un élément clé pour augmenter la taille du réseau d’aires protégées de l’Île-du-Prince-Édouard, car environ 90 % du territoire appartient à des propriétaires privés. Au cours de la période couverte par le rapport, 7 907 hectares d’aires protégées et de conservation ont été ajoutés (dont 2 096,21 ha d’aires naturelles, 1 650,8 ha d’aires de gestion de la faune et 4 000,35 ha d’AMCEZ), dont 61 % appartiennent à des propriétaires privés.
- Des partenaires tels que l’Island Nature Trust, Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la PEI Wildlife Federation ont acquis et protégé des terres et facilité les désignations avec les propriétaires privés.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées à l'Île-du-Prince-Édouard par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Québec
Statistiques sur les aires
12,6 % (194 586 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 31,4 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
1 465 |
<1 |
Gouvernement infranational |
197 363 |
13 |
Gouvernance collaborative |
233 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
1 692 |
<1 |
II |
185 464 |
12 |
IV |
480 |
<1 |
IV |
7 913 |
1 |
VI |
1 033 |
<1 |
Non classifiée |
2 479 |
<1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Planification du réseau
- Amélioration de la gestion des aires protégées et de conservation existantes
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Augmentation de la représentation écologique
Réalisations
- Le réseau de parcs nationaux du Québec a été enrichi par la création du parc national Ulittaniujalik en 2016. De plus, sept parcs nationaux situés dans le sud du Québec ont été agrandis (Fjord-du-Saguenay, Pointe-Taillon, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Frontenac, Yamaska et Mont Mégantic).
- Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la création d’aires protégées a fait passer le pourcentage d’aires protégées de la partie continentale du Québec (milieux terrestres et d’eau douce) de 9,9 à 16,40 %. Plusieurs autres territoires étaient également en cours de reconnaissance à la fin de 2020. En milieu marin, il est passé de 1,26 à 10,40 %.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées au Québec par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Saskatchewan
Statistiques sur les aires
9,8 % (63 559 km2) de la superficie terrestre de la province est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 15,8 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Gouvernement national |
6 346 |
1 |
Gouvernement infranational |
55 494 |
9 |
Gouvernance collaborative |
3 500 |
1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale de la province |
|---|---|---|
Ia |
1 598 |
<1 |
Ib |
20 541 |
3 |
II |
11 821 |
2 |
IV |
60 |
<1 |
IV |
6 954 |
1 |
V |
659 |
<1 |
VI |
23 706 |
4 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Relevé des zones prioritaires pour la protection ou la conservation
- Reconnaissance de nouvelles AMCEZ
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
- Surveillance écologique dans les aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
Réalisations
- Le projet de zonage « Protected and Conserved Areas Zoning: A Nature Saskatchewan Project » a progressé. Ce projet conduira à l’élaboration d’une politique ferme et soutiendra la création d’aires protégées en Saskatchewan. Ce travail de zonage permettra la réalisation de diverses activités, dont des activités de développement, dans différentes parties d’une même aire protégée. Il soutiendra le développement d’AMCEZ et d’APCA.
- Le ministère de l’Environnement a travaillé en étroite collaboration avec la Saskatchewan Stock Growers Association (SSGA) à élaborer un modèle de servitude de conservation qui concilie les objectifs de conservation et les exigences de l’élevage.
- Un projet de modèle de priorisation et un modèle de données ont été élaborés pour guider les projets d’établissement. Le modèle prend en considération des critères tels que la représentativité au sein du réseau, la connectivité, la qualité de l’habitat, les espèces en péril, les possibilités économiques, le savoir autochtone, l’importance culturelle et spirituelle et le potentiel de remise en état. Le modèle priorisera la conservation des terres provinciales, en tenant compte de critères culturels, économiques et écologiques.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées en Saskatchewan par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Yukon
Statistiques sur les aires
11,8 % (56 808 km2) de la superficie terrestre du territoire est protégée ou conservée.
Il s’agit d’une augmentation de 60,2 % depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Gouvernement national |
36 243 |
8 |
Gouvernement infranational |
16 |
<1 |
Gouvernement autochtone |
4 090 |
1 |
Gouvernance collaborative |
16 507 |
3 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du territoire |
|---|---|---|
Ib |
5 203 |
1 |
II |
44 409 |
9 |
IV |
240 |
<1 |
IV |
7 004 |
1 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Achèvement des processus relatifs aux plans de gestion concertés pour les aires devant être protégées dans le cadre d’accords définitifs avec les Premières Nations et de plans d’utilisation régionale des terres
- Création de nouvelles aires protégées
- Planification du réseau (planification régionale de l’utilisation des terres)
- Modification ou élaboration de lois ou de règlements
- Élaboration ou mise à jour des plans de gestion
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
Réalisations
- Après des années de collaboration, les plans de gestion de l’habitat protégé de Ddhaw Ghro (1 600 km2) et de l’habitat protégé Ch’ihilii Chìk (468 km2) ont été approuvés par les gouvernements des Premières Nations et du Yukon en 2018 et en 2019, respectivement. Il s’agit à la fois d’aires présentant une grande importance culturelle et un habitat faunique de grande valeur. Une fois les plans de gestion achevés, ces aires ont été désignées au titre de la Loi sur la faune.
- La Stratégie sur les parcs du Yukon a été approuvée, fixant l’orientation du réseau de parcs territoriaux du Yukon pour la période 2020-2030. La Stratégie définit des orientations stratégiques qui permettront d’assurer de façon viable les bienfaits des parcs : des terres, une population et une économie saines.
- Le Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel, élaboré par une commission publique de planification, a été signé par les gouvernements du Yukon, les Tr'ondëk Hwëch'in, la Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun, la Première Nation des Gwitchin Vuntut et le Conseil tribal des Gwich'in en 2019. Ce plan fournit des orientations sur la gestion des terres et des ressources dans le bassin de la rivière Peel. Le développement durable est la pierre angulaire du plan. Il formule des recommandations et fournit des conseils sur la protection de l’environnement, la protection du patrimoine et de la culture, et le développement économique. Le plan désigne une grande partie (55 851 km2) du bassin versant à titre d’aire de conservation. En 2020, le gouvernement du Yukon a appliqué des protections à ces aires de conservation pour soutenir les processus de planification ultérieurs.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées au Yukon par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
Statistiques sur les aires
ECCC est responsable de 119 924 km2 d’aires terrestres protégées et de conservation et de 31 171 km2 d’aires marines protégées et de conservation. Cela représente 1,2 % de la superficie terrestre du Canada et 0,5 % de la superficie marine du Canada.
Il s’agit d’une augmentation de 14,6 % des aires terrestres protégées et de conservation et d’une augmentation de 58,8 % des aires marines protégées et de conservation depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
|---|---|
Gouvernement national |
119 924 |
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
|---|---|
Gouvernement national |
31 171 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
|---|---|
Ia |
2 930 |
Ib |
103 503 |
II |
11 127 |
IV |
141 |
IV |
2 114 |
V |
24 |
VI |
110 |
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
|---|---|
Ia |
770 |
Ib |
16 937 |
II |
1 777 |
IV |
35 |
IV |
78 |
V |
0 |
VI |
11 574 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Relevé des zones prioritaires pour la protection ou la conservation
- Création de nouvelles aires protégées
- Reconnaissance de nouvelles AMCEZ
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
- Surveillance écologique dans les aires protégées et de conservation
Réalisations
- En juin 2018, ECCC a créé la réserve nationale de faune en milieu marin des Îles Scott, qui est la première aire uniquement marine protégée par la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Cette aire entoure un groupe de cinq îles au large de l’île de Vancouver. Il s’agit d’un site important pour les oiseaux de mer, qui présente une grande diversité biologique.
- ECCC et le Grand Chef des Premières Nations du Dehcho, ont signé l’Accord d’Edéhzhíe en octobre 2018. Par cet accord, le gouvernement du Canada et les Premières Nations du Dehcho se sont engagés à collaborer à l’établissement et à la protection d’Edéhzhíe, une région située dans le Dehcho, dans les Territoires du Nord Ouest. L’aire a été établie en tant qu’aire protégée du Dehcho en 2018.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées sous la juridiction d'ECCC par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Parcs Canada
Statistiques sur les aires
Parcs Canada est responsable de 353 079 km2 d’aires terrestres protégées et de conservation et de 122 089 km2 d’aires marines protégées et de conservation. Cela représente 3,5 % de la superficie terrestre du Canada et 2,1 % de la superficie marine du Canada.
Il s’agit d’une augmentation de 2,9 % des aires terrestres protégées et de conservation et d’une augmentation de 759,6 % des aires marines protégées et de conservation depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du Canada |
|---|---|---|
Gouvernement national |
53 191 |
0,6 |
Gouvernance collaborative |
299 888 |
2,9 |
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie marine totale du Canada |
|---|---|---|
Gouvernement national |
120 843 |
2 |
Gouvernance collaborative |
1 247 |
<1 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie terrestre totale du Canada |
|---|---|---|
II |
336 341 |
3 |
V |
45 |
<1 |
VI |
16 692 |
<1 |
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie marine totale du Canada |
|---|---|---|
II |
9 965 |
<1 |
V |
3 473 |
<1 |
VI |
108 652 |
2 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Création de nouvelles aires protégées
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation.
- Planification et gestion des changements climatiques
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Amélioration de la connectivité entre les aires protégées et de conservation
Réalisations
- En août 2019, le gouvernement du Canada et l’Association inuite du Qikiqtani ont signé une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) nécessaire à la création de l’aire marine nationale de conservation (AMNC) Tallurutiup Imanga. D’une superficie d’environ 108 000 km2, cette AMNC a contribué à hauteur de 1,9 % à l’objectif du Canada de protéger 10 % de ses zones marines et côtières d’ici 2020.
- Parcs Canada, en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations, continue d’évaluer la faisabilité d’un projet d’AMNC dans le sud du détroit de Georgia, qui pourrait protéger jusqu’à 1 400 km2.
- En 2020, il existait plus de 30 accords de collaboration officiels entre Parcs Canada et des partenaires autochtones. Parmi ces accords, 20 prévoient des structures de gestion coopérative où les peuples autochtones influencent la prise de décisions. Parcs Canada s’est engagé dans la voie de la réconciliation et continuera à mobiliser et à consulter les partenaires autochtones afin qu’un plus grand nombre de lieux soient dotés de dispositifs permettant aux partenaires autochtones de jouer un rôle décisionnel dans la gestion des lieux patrimoniaux.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées sous la juridiction de Parcs Canada par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
- Catégorie Ia
- Catégorie Ib
- Catégorie II
- Catégorie III
- Catégorie IV
- Catégorie V
- Catégorie VI
- Non classifié
- Autres mesures de conservation efficaces par zone
Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
Statistiques sur les aires
Le MPO est responsable de 634 283 km2 d’aires marines protégées et de conservation. Cela représente 11,0 % de la superficie marine du Canada.
Il s’agit d’une augmentation de 4 880 % des aires marines protégées et de conservation depuis 2016.
Types de gouvernance
Type de gouvernance |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie marine totale du Canada |
|---|---|---|
Gouvernement national |
310 865 |
5 |
Gouvernance collaborative |
323 519 |
6 |
Catégories de l’UICN
Catégorie de gestion de l’UICN |
Aire protégée (km2) |
Pourcentage de la superficie marine totale du Canada |
|---|---|---|
Non classifiée |
351 517 |
6 |
Principales priorités en matière de planification et de gestion des aires protégées pour la période 2021-2025
- Atteinte des objectifs en matière d’aires protégées et de conservation
- Amélioration de l’efficacité de la gestion des aires protégées et de conservation existantes
- Établissement de nouvelles aires protégées et de conservation
- Collaboration avec les gouvernements, les communautés ou les organisations autochtones
- Amélioration de la surveillance des aires protégées et de conservation
Réalisations
- Pêches et Océans Canada a désigné six nouvelles zones de protection marine (ZPM) en vertu de la Loi sur les océans au cours de la période 2016-2020, ce qui représente 6 % de l’ensemble du territoire marin du Canada et porte à 14 le nombre total de ZPM créées en vertu de la Loi sur les océans.
- Entre 2016 et 2020, le MPO a reconnu de nombreuses AMCEZ, qui ont contribué à hauteur de 4,9 % aux objectifs nationaux de conservation des zones marine du Canada. Ces AMCEZ protègent des habitats marins rares et uniques ainsi que des espèces importantes d’un point de vue écologique, économique et culturel.
- De nombreux règlements et politiques ont été élaborés, notamment :
- Directives opérationnelles pour déterminer les « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans le milieu marin du Canada
- Projet de loi C-55, modification à la Loi sur les océans en 2019
- Le 25 avril 2019, le Canada a annoncé de nouvelles normes de protection des aires marines protégées (AMP) fédérales et les AMCEZ marines fédérales. Par cette annonce, le gouvernement a fait part de son intention d’interdire les activités pétrolières et gazières, l’exploitation minière, l’immersion et le chalutage de fond dans la plupart des nouvelles AMP fédérales. Toutes les activités menées dans les AMCEZ fédérales continueront d’être évaluées au cas par cas afin de s’assurer que les risques pour la zone sont effectivement évités ou atténués.
- La norme de protection des AMP protège les zones de nos océans qui ont besoin d’être protégées contre les effets potentiellement néfastes des activités industrielles. Elle définit les activités qui y sont soumises et assure la cohérence lors de la création d’AMP fédérales ainsi que la clarté pour les partenaires et les intervenants dont les intérêts sont concernés par ces AMP. De même, la norme fédérale de protection des AMCEZ marines précise les exigences auxquelles les refuges marins ou les AMCEZ doivent satisfaire.
- Les normes sont basées sur les recommandations d’un groupe consultatif national indépendant composé d’experts nommés par le MPO pour consulter la population canadienne sur les normes de protection marine.

Long description
Une carte montrant les aires protégées et conservées sous la juridiction de Pêches et Océans Canada par catégorie de gestion de l'UICN. Les catégories suivantes sont présentes dans la légende :
Catégorie Ia
Catégorie Ib
Catégorie II
Catégorie III
Catégorie IV
Catégorie V
Catégorie VI
Non classifié
Autres mesures de conservation efficaces par zone
Annexe
Annexe 1. Sources des données et méthodes
Sources des données
Les données géospatiales sont tirées de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC). Les données des entités fédérales, provinciales et territoriales qui font autorité sont compilées par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
Description des données
La BDCAPC contient des données consolidées provenant de toutes les autorités ayant des responsabilités en matière d’aires de conservation au Canada. Les données sont à jour en date du 31 décembre 2020.
Les statistiques calculées dans ce rapport sont basées sur le sous-ensemble de la BDCAPC qui compte pour les objectifs des rapports internationaux.
Au moins une fois par an, les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux soumettent des données géospatiales et d’attributs concernant les aires de conservation relevant de leur compétence. Les données sur les aires relevant d’organisations autochtones ou non gouvernementales, comme Conservation de la nature Canada et Canards Illimités Canada, sont incluses lorsqu’une autorité compétente a reconnu et déclaré ces aires.
Les données sont notamment le nom de l’aire, son emplacement géospatial, ses limites, sa superficie officielle, le type de biome (terrestre ou marin), la catégorie de gestion de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’autorité responsable de la gestion et la date de protection.
Dans les cas où les mêmes données d’attributs ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’aire de conservation, cette dernière est divisée en zones pour l’établissement des rapports. Par exemple, une aire protégée unique qui traverse une frontière provinciale est divisée en zones correspondant aux différentes provinces. De même, une aire protégée qui fait ultérieurement l’objet d’une expansion est traitée comme plusieurs zones, chacune ayant sa propre date de protection. Les sections terrestres et marines sont traitées comme des zones distinctes, et l’eau douce est incluse dans la zone terrestre. Les données d’attributs sont gérées indépendamment pour chaque zone. Les aires de conservation qui ne sont pas divisées sont traitées comme une seule aire.
Des travaux sont en cours pour recueillir et intégrer des données sur d’autres aires protégées privées et sur les zones conservées par d’autres moyens que les mesures de protection formelles.
L’information sur la couverture des aires protégées dans les régions écologiques terrestres et marines du Canada (écozones et écorégions) est basée respectivement sur le Cadre écologique terrestre d’ECCC et sur les biorégions marines fédérales de Pêches et Océans Canada (MPO). En 2014, le Conseil canadien des aires écologiques, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, a mis à jour les données spatiales du Canada à l’échelle le plus élevée de la classification écologique, l’écozone. Ce cadre spatial a remplacé le cadre écologique de 1995 ainsi que le cadre temporaire Écozone+, auquel renvoyait le rapport précédent.
Sources de données sur les limites des différentes administrations
- Pour le Canada et pour l’ensemble des provinces et des territoires, sauf le Québec : Centre canadien de télédétection de Ressources naturelles Canada (2005), Superficie en terre et en eau douce, par province et territoire.
- Pour le Québec : ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
- Pour le territoire marin du Canada : Pêches et Océans Canada (2013), analyse ministérielle fondée sur les limites administratives des Données-cadres nationales de l’Atlas du Canada à l’échelle de 1/1 000 000 de Ressources naturelles Canada (2009).
Sources de données sur les frontières nationales
Ressources naturelles Canada (2019), Limites administratives - Série CanVec 1/1 000 000, régions géopolitiques.
Sources de données sur les écozones et les écorégions
Environnement et Changement climatique Canada (2019). Cadre écologique terrestre canadien. Les écozones marines sont basées sur les biorégions marines fédérales de Pêches et Océans Canada (2016) (Secrétariat canadien de consultation scientifique, Avis scientifique 2009/056).
Méthodes
La superficie conservée est estimée au moyen d’une analyse géographique basée sur les limites déclarées, qui tient compte des chevauchements. Des estimations distinctes sont faites pour les aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ).
Calcul des aires protégées et de conservation du Canada
La BDCAPC contient des renseignements sur la date de protection ou de conservation de chaque zone. Pour certaines zones, elle contient également une date de radiation.
Pour estimer l’évolution dans le temps des aires terrestres protégées et de conservation :
- Tous les polygones représentant des aires terrestres protégées en 1990 ou avant ont été sélectionnés dans la base de données.
- Les polygones sélectionnés ont été dissous pour ne former qu’un seul polygone (en éliminant les chevauchements), et la surface résultante a été calculée en utilisant la projection conique équivalente d’Albers.
- Le processus a été répété pour chaque année suivante (les aires radiées ont été retirées de l’analyse à partir de l’année de leur radiation).
- Les estimations ont été divisées par la superficie terrestre totale du Canada pour déterminer la proportion protégée.
Pour estimer l’aire marine protégée, un processus similaire a été suivi, en sélectionnant des polygones marins protégés à chaque étape. Le processus a été répété pour les AMCEZ, tant terrestres que marines. La superficie totale protégée et conservée a été calculée en additionnant la superficie des aires protégées et la superficie des AMCEZ.
Dans la base de données, 3,7 % des sites ont une année de qualification inconnue. Si un polygone dont l’année de qualification était inconnue était décrit comme « provisoire », son année de qualification est l’année où il a été déclaré pour la première fois dans la base de données (1,2 % du total des sites). Autrement, on considère que l’année de protection est antérieure à 1990.
Aires terrestres protégées ou de conservation, dans chaque province et territoire
La base de données contient des renseignements sur la province ou le territoire dans lequel se trouve une aire protégée ou de conservation. En utilisant une méthodologie similaire à celle utilisée pour rendre compte des tendances de l’indicateur national, pour chaque province et territoire, les polygones des aires terrestres protégées ont été combinés en un seul polygone et la superficie a été calculée. L’analyse a été répétée pour les AMCEZ terrestres. Seuls les chevauchements à l’intérieur d’une province ou d’un territoire sont supprimés. Des incertitudes inévitables dans les données spatiales peuvent causer des chevauchements entre provinces et territoires. Dans les cas où une aire protégée et une AMCEZ se chevauchent, l’aire protégée a priorité et la portion de l’AMCEZ faisant l’objet du chevauchement est ignorée dans le calcul de la superficie.
Aires terrestres et marines protégées et de conservation, par autorité déclarante
La base de données contient également de l’information sur l’autorité responsable de chaque aire protégée ou de conservation. Comme pour l’indicateur national, pour chaque autorité, les polygones des aires protégées ont été combinés en un seul polygone, et la superficie totale a été calculée. Une analyse supplémentaire a été réalisée pour estimer la superficie des AMCEZ. Dans les cas où une aire protégée et une AMCEZ se chevauchent, l’aire protégée a priorité et la portion de l’AMCEZ faisant l’objet du chevauchement est ignorée dans le calcul de la superficie.
Aires protégées et de conservation, par aire écologique
La BDCAPC ne contient pas d’information sur les aires écologiques. Une analyse géospatiale a été réalisée pour estimer la superficie conservée dans chaque écozone et écorégion. Les limites nationales des écozones et des écorégions sont plus générales que celles de la BDCAPC, ce qui peut influer sur les estimations dans les zones côtières. Pour pallier ce risque de catégorisation erronée, les aires marines de conservation situées en dehors d’une écozone marine ont été attribuées à l’écozone marine la plus proche. De même, les aires terrestres de conservation situées en dehors d’une écozone terrestre ont été attribuées à l’écozone terrestre la plus proche. Les étapes suivies sont décrites ci-dessous :
Une couche d’analyse a été créée pour les écozones marines afin d’éviter les erreurs de catégorisation. Cette couche d’analyse s’étend à l’intérieur des terres pour inclure les régions terrestres adjacentes. En utilisant un sous-ensemble d’aires marines protégées de la BDCAPC et cette nouvelle couche d’analyse, ces aires marines protégées ont été divisées par chaque limite d’écozone. Les polygones des aires protégées de cette couche combinée et la superficie corrigée en fonction du chevauchement ont été calculés pour chaque écozone, ce qui a permis d’attribuer les aires marines à la bonne écozone.
Ce processus a été répété pour les écozones marines, les aires terrestres protégées et les AMCEZ terrestres.
Tous les calculs de la superficie ont été effectués à l’aide de la projection conique équivalente d’Albers. La superficie de l’écozone des plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador a été corrigée pour tenir compte de la superficie de Saint-Pierre-et-Miquelon. La superficie totale conservée par écozone a été divisée par la superficie totale de l’écozone afin d’obtenir un pourcentage.
Pour l’analyse des écorégions terrestres, la superficie protégée corrigée en fonction des chevauchements et la superficie des AMCEZ au sein de chaque écorégion ont été calculées. Les aires terrestres de conservation situées en dehors des limites des écorégions ont été attribuées à l’écorégion la plus proche.
Chapitre 6 Répartition du type de gouvernance et des catégories de gestion de l’UICN, par autorité
Les données de la BDCAPC de chaque autorité responsable ont été dissoutes par catégorie de l’UICN et par type de gouvernance. Pour les provinces et les territoires, les totaux des zones terrestres sont affichés à la fois en superficie et en pourcentage de la superficie terrestre de la province ou du territoire. Les aires marines n’ont pas été incluses.
Pour les organisations nationales, les zones marines et terrestres ont été utilisées pour calculer la superficie et le pourcentage de la superficie marine ou terrestre du Canada.
Pourcentage d’augmentation de la superficie par rapport à 2016 :
Avant 2017, la BDCAPC était gérée selon un schéma différent et était connue sous le nom de Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC). Les données du SRSAC 2016 ont utilisé le même processus de dissolution que la BDCAPC 2020, l’augmentation totale de la superficie terrestre protégée et conservée étant exprimée en pourcentage du total de 2016. Pour 2016, seules les aires comptabilisées pour les objectifs d’Aichi ont été incluses (SRSAC : AICHI_T11 = 'Yes' OR AICHI_T11 = 'Interim').
Voir l’annexe 2 pour les limites des données relatives à l’UICN et au type de gouvernance.<
Annexe 2. Limites des données
Renseignements complémentaires
La superficie protégée ou conservée calculée à l’aide des limites des polygones peut différer de la « superficie officielle » indiquée dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC).
La responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité des données sources incombe aux autorités responsables. Le travail de ces dernières est guidé par le rapport issu d’une collaboration fédérale-provinciale-territoriale Unis avec la nature. Les documents d’orientation et les outils d’aide à la décision ont été adaptés en collaboration avec le Conseil canadien des aires écologiques. Néanmoins, il faut s’attendre à des différences dans l’approche adoptée par les autorités pour reconnaître les aires protégées et les AMCEZ.
Les aires qui ne sont plus reconnues comme protégées ou de conservation (« déclassées » ou « radiées ») ne sont pas prises en compte de manière exhaustive et peuvent être absentes de la BDCAPC. Les aires déclassées ou radiées sont comptabilisées à partir de leur date d’établissement jusqu’à leur date de radiation.
Les frontières complexes, comme les lignes de côte et les aires écologiques, doivent être généralisées à des fins de cartographie. Dans la nature, les écozones ou les écorégions n’ont pas de limites nettes. En raison de l’incertitude de ces limites, les résultats doivent être considérés comme des estimations plutôt que comme des mesures précises. Le décalage d’échelle entre les aires de conservation, cartographiées avec précision, et les cadres géographiques nationaux, cartographiés à grande échelle, peut entraîner des différences mineures entre les divers résumés, compte tenu de l’incertitude des mesures inhérente à ce type d’analyse. Les différences dans la délimitation des côtes peuvent entraîner un léger chevauchement des polygones des aires marines de conservation et des polygones des aires terrestres de conservation. Ces chevauchements n’ont pas été pris en compte.
Les écozones et les écorégions sont des cadres écologiques, et ne doivent pas être considérées comme l’expression de la souveraineté. Les mises à jour de 2019 des cadres des écozones et des écorégions ont été réalisées dans le but de rendre compte de la représentation écologique pour En route vers l’objectif 1 du Canada, et ne représentent pas une mise à jour officielle du Cadre écologique national de 1995. Bien que le cadre de 2019 contienne l’information la plus récente des autorités, il convient de noter que chaque fournisseur de données a utilisé une méthodologie différente pour déterminer les limites des écozones et des écorégions, et que cette couche nationale peut donc différer des couches provinciales et territoriales.
La protection est une désignation, et les indicateurs ne décrivent pas l’efficacité de la protection, le degré d’intégrité du fonctionnement écologique de l’aire ou la mesure dans laquelle les pressions exercées à l’extérieur d’une aire conservée peuvent influer sur la biodiversité qui s’y trouve.
Au chapitre 6, les superficies totales (en km2) associées aux catégories de gestion de l’UICN et aux types de gouvernance constituent des surestimations en raison du chevauchement des catégories. En cas de chevauchement, il n’est pas possible de choisir une classification plutôt qu’une autre. Si l’on additionne tous les types de gouvernance, la superficie totale protégée apparaît plus élevée que le total déclaré.
Annexe 3. Superficie protégée et conservée dans les écozones terrestres au cours de la période de référence
(du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020)
Nom de l’écozone |
Superficie de l’écozone (km2) |
Superficie protégée en 2015 (km2) |
Pourcentage de protection en 2015 |
Superficie protégée en 2020 (km2) |
Pourcentage de protection de l’écozone en 2020 |
Superficie conservée grâce à d’autres mesures en 2020 (km2) |
Superficie totale de conservation en 2020 (km2) |
Pourcentage de la région protégée et conservée en 2020 |
Évolution du pourcentage de protection et de conservation de 2015 à 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordillère arctique |
229 513 |
53 699 |
23 |
51 891 |
22,6 |
0 |
51 891 |
22,6 |
-0,4 |
Hautes-terres de l’Atlantique |
93 012 |
3 552 |
3,8 |
3 954 |
4,3 |
0 |
3 954 |
4,3 |
0,5 |
Maritime de l’Atlantique |
110 590 |
7 712 |
7 |
9 476 |
8,6 |
24 |
9 501 |
8,6 |
1,6 |
Cordillère boréale |
557 860 |
97 311 |
17,4 |
96 587 |
17,3 |
9 761 |
106 348 |
19,1 |
1,7 |
Plaines boréales |
780 010 |
58 048 |
7,5 |
68 574 |
8,8 |
1 682 |
70 257 |
9 |
1,5 |
Bouclier boréal |
1 902 001 |
183 766 |
9,7 |
190 779 |
10 |
0 |
190 779 |
10 |
0,3 |
Plaines hudsoniennes |
348 406 |
43 774 |
12,5 |
43 760 |
12,6 |
0 |
43 760 |
12,6 |
0,1 |
Plaines à forêts mixtes |
115 395 |
2 092 |
1,8 |
2 395 |
2,1 |
38 |
2 433 |
2,1 |
0,3 |
Cordillère montagnarde |
436 791 |
80 006 |
18,3 |
82 654 |
18,9 |
16 425 |
99 079 |
22,7 |
4,4 |
Haut-Arctique |
1 479 561 |
106 291 |
7,2 |
105 630 |
7,1 |
0 |
105 630 |
7,1 |
-0,1 |
Maritime du Pacifique |
217 022 |
52 449 |
24,2 |
52 421 |
24,2 |
7 559 |
59 980 |
27,6 |
3,4 |
Prairies |
464 422 |
27 253 |
5,9 |
27 702 |
6 |
231 |
27 933 |
6 |
0,1 |
Plateaux semi-arides |
56 464 |
5 263 |
9,3 |
5 339 |
9,5 |
2 037 |
7 377 |
13,1 |
3,8 |
Bas-Arctique |
958 299 |
150 760 |
15,8 |
186 150 |
19,4 |
6 772 |
192 922 |
20,1 |
4,3 |
Taïga de la Cordillère |
231 266 |
19 302 |
8,4 |
21 509 |
9,3 |
10 505 |
32 014 |
13,8 |
5,4 |
Taïga des Plaines |
553 374 |
38 160 |
6,9 |
60 498 |
10,9 |
18 212 |
78 710 |
14,2 |
7,3 |
Taïga du Bouclier |
1 322 962 |
105 763 |
8 |
143 992 |
10,9 |
1 032 |
145 024 |
11 |
3 |
Toundra de la Cordillère |
28 887 |
7 159 |
24,7 |
7 134 |
24,7 |
3 197 |
10 331 |
35,8 |
11,1 |
Grands Lacs |
89 236 |
11 672 |
13,2 |
11 894 |
13,3 |
0 |
11 894 |
13,3 |
0,1 |
Annexe 4. Superficie protégée et conservée dans les écozones terrestres au cours de la période de référence
(du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020)
Nom de l’écozone |
Superficie de l’écozone (km2) |
Superficie protégée en 2015 (km2) |
Pourcentage de protection en 2015 |
Superficie protégée en 2020 (km2) |
Pourcentage de protection de l’écozone en 2020 |
Superficie conservée grâce à d’autres mesures en 2020 (km2) |
Superficie totale de conservation en 2020 (km2) |
Pourcentage de la région conservée en 2020 |
Évolution du pourcentage de protection et de conservation de 2015 à 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archipel Arctique |
268 792 |
2 267 |
0,8 |
38 923 |
14,5 |
- |
38 923 |
14,5 |
13,7 |
Bassin arctique |
752 053 |
165 |
- |
284 091 |
37,8 |
- |
284 091 |
37,8 |
37,8 |
Est de l’Arctique |
782 636 |
8 656 |
1,1 |
115 296 |
14,7 |
58 725 |
174 021 |
22,2 |
21,1 |
Golfe du Saint-Laurent |
246 648 |
4 688 |
1,9 |
5 852 |
2,4 |
15 869 |
21 721 |
8,8 |
6,9 |
Complexe de la baie d’Hudson |
1 244 670 |
8 857 |
0,7 |
8 684 |
0,7 |
- |
8 684 |
0,7 |
0 |
Plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador |
1 041 588 |
215 |
- |
12 559 |
1,2 |
105 916 |
118 475 |
11,4 |
11,4 |
Plate-forme Nord |
101 663 |
7 141 |
7,0 |
16 669 |
16,4 |
- |
16 669 |
16,4 |
9,4 |
Haute mer du Pacifique |
315 724 |
6 200 |
2,0 |
10 547 |
3,3 |
82 431 |
92 977 |
29,4 |
27,4 |
Plate-forme néo-écossaise |
416 296 |
2 399 |
0,6 |
6 000 |
1,4 |
19 731 |
25 730 |
6,2 |
5,6 |
Plate-forme Sud |
28 158 |
783 |
2,8 |
785 |
2,8 |
- |
785 |
2,8 |
0 |
Détroit de Georgia |
8 969 |
425 |
4,7 |
425 |
4,7 |
32 |
458 |
5,1 |
0,4 |
Ouest de l’Arctique |
539 807 |
9 697 |
1,8 |
12 060 |
2,2 |
- |
12 060 |
2,2 |
0,4 |