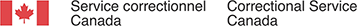Épisode 14 : Les soins de santé dans les prisons canadiennes
Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de professionnels de la santé travaillants du SCC qui nous amènent en coulisse pour nous donner un aperçu de la prestation des services de santé aux détenus dans les prisons fédérales du pays.
Dans le cadre de son mandat conféré par la loi, le SCC est tenu de fournir des soins de santé essentiels aux détenus, ce qui contribue à assurer la sécurité des prisons pour notre personnel et la sécurité des collectivités pour le public.
Découvrez les coulisses avec nos professionnels de la santé qui travaillent fort pour faire une différence et assurer la sécurité de tout le monde au quotidien.
Durée : 22:27
Publié : 9 juin 2025
Animatrice : Kirstan Gagnon
Invités :
- Julie, gestionnaire, programmes et services de soins de santé et de réadaptation
- Mohamed, infirmier
Transcription : Épisode 14 : Les soins de santé dans les prisons canadiennes
Julie : Juste ici, on a plus de 175 détenus qui sont suivis par la santé mentale sur 400. On calcule, le taux est quand même relativement important. Puis on n'est pas un, on n'est pas un établissement de santé mentale, là, non.
Kirstan : Le service correctionnel du Canada est légalement mandaté de fournir des soins de santé essentiels aux personnes incarcérées. En fait, la prestation de services de santé et de soins de santé mentale pendant l'incarcération contribue directement à des communautés plus sécuritaires.
Des évaluations de santé au traitement en passant par l'éducation à la santé et à la réduction des méfaits, le personnel du SCC travaille chaque jour avec vigilance pour appuyer ce mandat.
Ici, Kirstan Gagnon, votre animatrice et bienvenue à Au-delà des prisons.
Kirstan : Les problèmes de consommation sont parmi les problèmes de santé les plus courants auxquels est confrontée la population carcérale, ce qui peut influencer le comportement criminel. En fait, environ 60% des délinquants qui entrent dans le système correctionnel fédéral déclarent avoir des antécédents de toxicomanie lors de leur évaluation initiale.
Kirstan : Pour aborder ces problèmes de santé, le Service correctionnel du Canada offre une gamme d'intervention incluant la réduction des méfaits, le traitement par agoniste opioïde, le soutien par les pairs et la psychoéducation. Ces services font partie intégrante des soins de santé offerts par les prisons fédérales au Canada. La prestation de ces services aide les délinquants à réintégrer la collectivité avec succès et en tant que citoyen en meilleure santé et respectueux des lois, tout en réduisant les risques de transmission de maladies et les taux de récidive.
Kirstan : Afin d'en apprendre davantage sur ceci et les autres aspects des services de santé, ma collègue Véronique et moi, nous avons rencontré Mohamed et Julie au Centre fédéral de formation, à Laval au Québec.
Kirstan : Fait que bienvenue Mohamed et Julie et merci d'être là à notre balado. Mohamed, parle-moi un petit peu de de ta carrière à date.
Mohamed : Moi je suis infirmier depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai travaillé en communauté dans les hôpitaux, j'ai travaillé au CHSLD auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Par la suite, je me suis plus intéressé au milieu carcéral, l'action. J'étais vraiment curieux de savoir comment ça marche dans le milieu. Puis ça fait depuis 2019 que je travaille au Service correctionnel du Canada, au Centre fédéral de formation. Puis je ne pense pas prendre, partir ou changer de de de carrière. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Kirstan : J'ai eu l'occasion de rencontrer votre médecin ici, puis il me disait que lui, ce qu'il aimait, c'était le travail d'équipe. Puis vous est ce que vous direz, c'est aussi ça que je travaille d'équipe.
Mohamed : Je suis tout à fait d'accord avec notre médecin ici en en établissement, parce que le travail multidisciplinaire, c'est très, très important. On travaille vraiment avec l'équipe de santé, autant qu'avec l'équipe de santé qu'avec l'équipe de sécurité aussi. On travaille avec des délinquants que nous ici, au service de soins de santé, on nomme patients. On travaille en collaboration aussi avec les agents correctionnels. On travaille en collaboration avec les agents de libération conditionnelle. Puis ici au niveau des services de soins de santé, on travaille avec presque tout le monde. On parle de médecins, psychiatres, travailleur social, psychologue, nutritionniste, dentiste. Fait que oui je suis tout à fait d'accord avec qu'est-ce que le médecin mentionne.
Kirstan : Puis aidez-moi à comprendre un petit peu mieux votre rôle. Est-ce que vous travaillez avec des détenus à sécurité maximale, minimale, médium? Comment ça fonctionne?
Mohamed : Ici au Centre fédéral de formation, c'est un multiple niveau de sécurité, médium et minimum. Mais faut toujours pas oublier qu'on travaille avec des détenus donc faut toujours rester vigilant. Faut toujours comprendre qu’on ne travaille pas en communauté. D'abord faut toujours considérer ma sécurité, la sécurité de ma collègue et la sécurité aussi du détenu.
Kirstan : Bien, et vous Julie, parlez-moi un petit peu de votre carrière?
Julie : Donc moi je suis un petit peu plus vieille que Mohamed, donc ça fait plus que 19 ans que je suis pour le gouvernement fédéral, pour le Service correctionnel, ça fait à peu près 15 ans et j'ai 4 années qui sont à la Défense nationale. Donc moi ma carrière bien, bien sûr, je suis infirmière comme Mohamed, moi je suis spécialisée en santé mentale et actuellement bien j'occupe un poste de gestion qui est gestionnaire, programme, service de soins de santé et réadaptation donc en résumé, gestionnaire santé.
Kirstan : Puis vous nous avez amené sur une tournée des services des soins de santé, puis c'est un milieu qui bouge. C'est quoi que vous aimez de ce travail-là ? Bien, comme je vous l'ai dit aussi, c'est un monde qui a toujours des défis. Les défis sont au quotidien, on a des petits défis, on a des plus gros défis, des fois, qui vont prendre bien des semaines, des mois à régler. Mais au quotidien, bien il n’y a pas de routine, ça bouge toujours. Vous l'avez vu, on est beaucoup de monde dans un petit milieu. Le travail interdisciplinaire fait que bien il y a toujours du monde qui se rajoute à l'équipe de base. Donc on est en roulement continu pour alimenter communication, les discussions puis améliorer bien sûr les soins aux patients.
Kirstan : Il y avait plusieurs détenus aujourd'hui qui attendaient un rendez-vous soit avec un spécialiste ou un dentiste ou une infirmière. Comment ça fonctionne? Parle-moi d'une journée typique.
Mohamed : Oh une journée typique. Bien c'est quand même un peu compliqué à dire parce que oui on monte ce qu'on appelle «agenda infirmière » fait que l'agenda infirmière c'est vraiment toutes les rendez-vous les suivis de soins, on peut parler de dépistage, on peut parler de prise de sang, on peut parler de réfection de pansement. On peut parler d'évaluation pour un problème qui vient d'apparaître avec un patient. Puis bien sûr, comme vous l'avez bien observé, il y a une parade médicale, plusieurs parades médicales, qui consistent à distribuer les médicaments qu'on nomme TOD ou DOT « direct observation treatment ». Dans le fond, on administre les médicaments, puis le patient doit dans le fond ouvrir la bouche pour qu'on s'assure de l'observance thérapeutique, qu'on s'assure que le patient prend sa médication.
Kirstan : Pour pas les donner aux autres ou quoi que ce soit.
Mohamed : Exactement, exactement.
Julie : C'est surtout les médicaments contrôlés qu'on va donner de cette manière-là.
Mohamed : Les portes du centre de soins ne ferment pas, vraiment, c'est toujours, c'est constamment ouvert, c'est constamment en action. La santé, les soins de santé sont très très importants ici en établissement.
Véronique : Donc, on sait qu’il y a beaucoup de délinquants qui arrivent en établissement qui ont des problèmes de toxicomanie. Est-ce qu’une fois qu'ils arrivent, est ce qu'ils sont évalués au moment de leur arrivée? Comment ça fonctionne pour être capable de faire un suivi auprès d'eux ?
Mohamed : Dans le fond, oui, les problèmes de toxicomanie, c'est un enjeu très, très important. Quand qu'on reçoit un détenu patient admis à notre établissement suite à une nouvelle sentence ou avec un transfert inter-établissement, la première des choses, le patient est invité au centre de soins pour une évaluation initiale de tout son dossier médical, dont la toxicomanie, excusez-moi, en fait partie. Puis par la suite, bien si je pose la question à mon patient, puis il parle que oui moi je consomme, moi j'ai des habitudes de, je bois de l'alcool, je m'injecte telle substance et ces choses et par la suite bien on lui, on lui présente nos différents programmes de réduction de méfaits.
Véronique : Ça a l'air de quoi ces programmes-là exactement ?
Mohamed : Très bonne question. Dans le fond, c'est plusieurs programmes. On a plusieurs programmes on dont le programme d'échange de seringues en prison, on a le programme de traitement agoniste aux opioïdes, on a le programme thérapie – dans le fond, c'est des séances de thérapie programme – Smart qu'on nomme. C'est pas chaque personne qui répond à ces programmes là. Il y a des évaluations là qu'on doit, qu'on doit démarrer avec le patient, puis après par la suite on fait le ménage puis on cible vraiment qu'est-ce que le patient a besoin. Bien sûr que le médecin est impliqué. Bien sûr que les collègues infirmières, même le psychiatre et psychologue sont impliqués aussi pour vraiment identifier le bon traitement au patient.
Kirstan : C'est intéressant que vous dites ça parce qu'il n’y a vraiment pas un cheminement identique. Diriez-vous ça Julie ?
Julie : En effet, tu sais, il y a plusieurs types de problématiques de toxicomanie, comme il y a différents types de maladies, mais les patients aussi ont des implications qui sont différentes. Donc, quand on va évaluer la problématique de toxicomanie, on va y aller avec leur routine de consommation, mais on va aussi y aller avec leur implication par rapport à leur besoin de travailler la toxicomanie. Donc il y en a qui vont nous dire carrément bien j'ai aucune intention de travailler mais à l'intérieur je le sais que je ne peux pas consommer donc je vais avoir besoin d'un coup de main. Ça fait que on va l'embarquer souvent dans ces cas-là fait que le programme de TAO qu'on appelle donc le traitement antagoniste aux opioïdes, mais il y en a d'autres. Donc si on a un détenu qui a une problématique de consommation par injection bien là on va y aller vers le programme d'échange de seringues. On y va vraiment avec le type de consommation, la routine de consommation mais aussi la motivation du détenu à s'impliquer dans leur traitement.
Kirstan : Puis voyez-vous des succès avec tous vos interventions et les programmes qui sont offerts aux détenus?
Mohamed : Il faut que lui-même soit motivé. Il faut que cette personne-là soit responsable puis qu'elle soit honnête avec elle-même vis-à-vis les traitements proposés. Fait que, est ce qu'il y a des échecs? Oui il y a des échecs. Est ce qu'il y a des succès? Oui il y a des succès, mais en tant que, en tant qu'infirmier, on a toujours l'espoir que le patient comprenne son traitement, puis il comprenne le but de de pourquoi il prend tel médicament pour contrer ces comportements de toxicomanie
Kirstan : Donc beaucoup d'éducation et vous avez vraiment l'air à faire de la proaction, beaucoup de gestes proactifs pour assurer..
Mohamed : Autant qu'on prodigue des soins, on fait beaucoup de promotion de la santé, beaucoup d'enseignements. Moi, en tant qu'infirmier ici au Centre fédéral de formation, je travaille avec mes patients, puis je me rends compte que je répète et je répète et je répète et et c'est c'est bien. C'est bien parce qu'il y a des patients qui sont capables d'assimiler les choses, il y en a d'autres que ça prend du temps pour qu'ils comprennent et tout pour le but d'une bonne réinsertion sociale, vraiment pour que Monsieur, quand qu'il se retrouve à l'extérieur de l'établissement tout seul, qu’il comprenne où est ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il doit faire dans ses traitements.
Véronique : Vous parlez de réinsertion sociale, c'est le mandat premier du Service correctionnel, pourquoi est-ce que c'est important dans le fond de travailler les problèmes de toxicomanie quand ils sont, quand ils sont en établissement, dans le fond, avant de les renvoyer en communauté, puis pour leur réinsertion sociale.
Julie : En fait, quand qu'on parle de prévention de méfaits, jadis on parlait de toxicomanie jadis, puis on disait, ah faut qu'on arrête, c'est l'abstinence. On a évolué au niveau de la communauté, le Service correctionnel s'adapte avec les années. La prévention des méfaits ne vise pas l'abstinence. On va viser d'avoir des comportements beaucoup plus responsables par rapport à sa consommation. Donc c'est ce qu'on doit miser, pendant qu'ils sont incarcérés, à prendre responsabilité de leur consommation et à y aller de manière plus sécuritaire pour eux autres, mais aussi pour les autres. Donc le but est que une fois qu'ils vont réintégrer la communauté, qu'ils vont être libérés, il faut qu'ils aient une habitude de consommation qui va être responsable pour qu'ils puissent répéter la même chose. On va les diriger vers des ressources externes qui ont les mêmes programmes que nous pour qu'ils puissent continuer. Mais ces de là que va s’arrêter notre mandat on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire après, mais on va donner au moins les outils. Notre travail à nous, c'est de leur donner des outils, de rendre accessibles des programmes, de l'encadrement pour qu'ils prennent responsabilité, mais c'est eux autres qui vont décider au bout de la ligne.
Véronique : Vous parliez de l'importance de dans le fond, c'est la réduction des méfaits, ce n'est pas nécessairement d'arrêter complètement, mais est-ce que vous voyez beaucoup de détenus qui arrivent, qui ont des problèmes de consommation, puis qui arrêtent complètement pendant qu’ils sont en prison?
Julie : Bien c'est sûr que les détenus vont tous dire non, je ne consomme pas. La réalité est que oui, ils vont consommer. On doit, quand on traite un détenu, quand on accompagne un détenu, faut qu'on soit toujours conscient qu’il y a quand même une réalité qu’ils vont consommer en dehors de soit de la médication, les substances qu'ils vont faire rentrer d'une façon ou d'une autre, mais quand qu'on soigne il faut qu'on soit conscient qu'il y a une consommation qui est parallèle à ce que nous on donne comme médication. Fait que est-ce que ils arrêtent de consommer? Très peu s’ils ne sont pas accompagnés dans un programme, très peu.
Véronique : Parce qu'il y a des programmes en parallèle aussi. Il y a les traitements, mais il y a aussi les programmes pour dans le fond, pour leur apprendre d'autres habitudes de vie j'imagine.
Julie : On a à peu près une dizaine de programmes qui vont viser la prévention des méfaits, la réduction des méfaits. Donc, dépendamment il y en a qui vont pouvoir participer à un des fois à 2, à 3 programmes, tout dépend de leur implication, puis de leurs besoins.
Kirstan : Hier, on a rencontré quelqu'un à Archambault qui était dans le programme autochtone. Puis il disait que c'est un changement qu'il avait fait dans sa vie. Il a arrêté de consommer, puis il voyait les choses plus claires. Puis il était très ouvert, donc je me demandais, point de vue les succès, ce que vous en voyez beaucoup comme ça?
Julie : Ben il y en a, il y en a. Puis si je peux parler d'ici. Il y a une histoire que je me souviens. Il y en a un qui a commencé avec le programme de TAO donc méthadone, suboxone. Il n’aimait pas la pression par rapport au trafic de la suboxone donc a passé au sublocade qui est le suboxone injectable, donc c'est une injection à tous les mois que le la personne reçoit. Parce que lui, il voulait vraiment arrêter, il voulait vraiment adresser cette problématique-là, donc il a pris les moyens pour le faire. Donc si le détenu a vraiment la motivation d'arrêter, il y a les programmes et il y a les moyens, il y a les outils qu'on peut leur donner. On parle du programme d'échange de seringues qui va arriver bientôt ici, mais ailleurs, dans d'autres établissements, il est déjà actif et utilisé. Donc j'ai des histoires qu'on nous a rapporté de détenus qui ont participé à ce programme là qu'ils ont eu pendant toute leur sentence ou majorité du temps de leur sentence, la trousse avec eux, mais qu'ils l'ont jamais utilisé. Ils voulaient l'avoir au cas où qu’il y aurait une rechute ou au cas où que peut être la drogue de choix rentrait à l'établissement. Bien au moins il y aurait un comportement responsable de consommer avec une seringue propre. Fait qu’il y a aussi cet enjeu-là, cette vision-là qu'on doit regarder de diminuer l'utilisation des seringues contaminées et avoir un accès à une seringue propre, stérile.
Kirstan : Et l'éducation qui vient avec ça.
Julie : Un ne va pas sans l'autre, ça c'est clair.
Kirstan : Si vous avez autre chose à offrir par rapport aux autres programmes où est-ce que vous voyez un gros succès, ça serait intéressant. Comme vous avez parlé de Smart, je sais qu'il y a un acronyme pour un une intervention de soins de santé. Parlez-moi un petit peu de ça.
Mohamed : Dans le fond, je travaille avec un collègue qui anime le programme Smart. L'acronyme, bonne question, ce n'est pas moi qui anime le programme mais je sais que le programme Smart invite vraiment le patient à s'ouvrir, puis à parler de ses problématiques. Puis ça se fait en groupe, puis c'est confidentiel. Puis le patient, ce qui ce qui est vraiment avantageux de ce programme-là, c'est que le patient s'ouvre, puis parle en toute confidentialité de ses problématiques. Puis cette personne-là spécialiste qui anime ce programme-là bien il y a tous les outils, puis enseigne les stratégies pour surpasser ses problèmes de toxicomanie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire dans le futur? Fait que vraiment il l'amène vraiment le patient à réfléchir.
Kirstan : Oui puis je voulais parler un petit peu de l'intersection entre le plan correctionnel puis les services de santé, c'est clairement interrelié. Avez-vous des observations par rapport à ça? Le rôle que vous jouez par rapport aux objectifs qu'un détenu peut avoir dans son plan correctionnel pour faire des améliorations en vue d'être une meilleure personne en en en vue de pouvoir faire une meilleure réinsertion sociale?
Julie : On est 2 services qui sont complémentaires. On va essayer de collaborer le plus possible dans la planification de la mise en liberté avec eux autres. On est quand même tenu, toute la santé, on est tenu par un secret professionnel. Donc l'information médicale ne peut pas être transmise sans consentement du détenu concerné. Mais les deux plans, donc le plan correctionnel va être fait indépendamment des services de santé. Cependant, si on a des enjeux au niveau cognitif, au niveau bien au niveau de la compréhension des programmes, la participation des programmes, bien on va pouvoir peut-être accompagner le détenu à mieux comprendre c'est quoi les enjeux pour adapter l'accessibilité au programme. Ça c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Mais ce n'est pas fait automatiquement ou systématiquement avec tous les détenus. C'est quand qu'on a des enjeux, quand on a des problématiques qu'ils nous ont rapportés, bien on va pousser un peu les investigations pour aider le détenu à mieux compléter ou à parvenir tout simplement compléter le programme.
Kirstan : Vous semblez avoir une super de bonne équipe je dois dire. Ils sont souriants, sont actifs, sont impliqués. Cette collaboration-là paraît vraiment.
Julie : Pour être celle qui qui qui chapeaute cette équipe-là, bien c'est pour moi c'est quelque chose qui est une priorité dans un milieu qui n’est pas toujours facile, des fois plutôt sombre. Donc faut toujours qu'on se repositionne sur qui on est, qui on veut pour maintenir un peu, pour éviter que le milieu vienne nous affecter. Mais donc on se concentre sur les défis. Puis oui, on se concentre sur le bien-être de l'équipe.
Véronique : Puis, Julie, vous avez mentionné que vous avez travaillé dans le milieu hospitalier avant de travailler au Service correctionnel. Je pense Mohamed aussi, qu'est ce qui, qu'est-ce qui vous a apporté à travailler dans un milieu carcéral? Ça a été quoi votre motivation?
Julie : à ce moment-là, je travaillais de nuit sur une unité psychiatrique dans l'hôpital et j'étais tout seul d'infirmière avec une rangée d'à peu près une trentaine de de patients et je devais faire des tournées dans les chambres. Mais des fois j'avais quatre patients hommes complètement décompensés qui pouvaient à tout moment. Donc j'avais j'étais tout seul, fait qu’au point de vue sécurité, c'est quelque chose qui préoccupait. Puis bien il y a eu une ouverture au Service correctionnel. Je vais être honnête, c'est pas quelque chose que je prévoyais dans ma vie de travailler au Service correctionnel, il y a une porte qui s'est ouverte, puis j'ai appliqué, puis voilà. Ça fait déjà plus de 19 ans que je suis là.
Véronique : C’est intéressant ce que vous dites parce qu’une des infirmières avec qui on a discuté pour l'épisode en anglais disait qu’elle se sentait plus en sécurité à travailler en prison que de travailler de nuit à l'urgence. Elle avait fait de l'urgence pendant 8 ans je pense. Donc c'est intéressant ce que vous dites.
Julie : C'est vraiment cette réalité-là parce qu'on a toujours nos collègues officiers qui sont avec nous autres. Je ne peux pas faire un soin sans la présence d'un officier au moins dans le bâtiment là. Donc quand je fais mes tournées de nuit, bien la porte est fermée et je ne suis pas en contact direct avec les patients. En effet, ce côté-là sécuritaire est très rassurant pour nous autres.
Véronique : Bien, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous rencontrer ce matin. Vous avez un horaire super occupé, on a vu là tantôt quand on a fait la visite ça bouge, il y a beaucoup de monde, il y a des détenus qui rentrent, qui sortent pour des rendez-vous donc on apprécie énormément votre temps puis le travail que vous faites au quotidien.
Mohamed : Merci à vous.
Kirstan : C'est tout pour cet épisode d'Au-delà des prisons. Un grand merci encore une fois à Mohamed et Julie pour leur temps. Ceci est une production du Service correctionnel du Canada. Je suis votre animatrice, Kirstan Gagnon. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.
Contactez-nous
Si vous avez des commentaires sur notre série de balados, n'hésitez pas à nous en faire part. Veuillez ne pas inclure d'informations personnelles ou privées. Envoyez-nous un courriel à l'adresse ci-dessous :