Vérifiez vos connaissances
Liens vers la chronologie
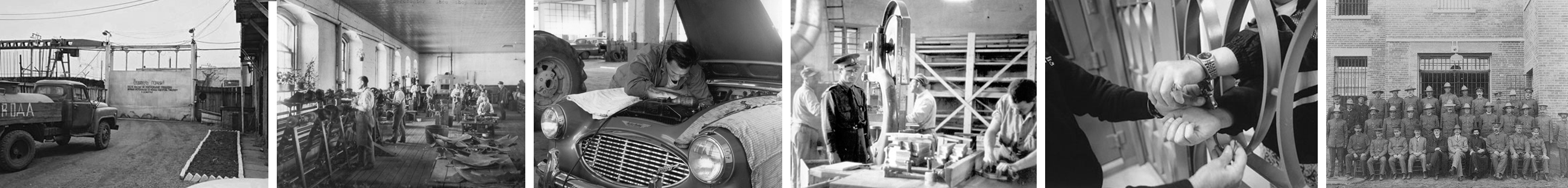
Après avoir eu l'occasion d'explorer l'histoire correctionnelle du Canada, voyons ce qui vous a marqué !
Répondez à notre court quiz et testez vos connaissances.
Maintenant que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de l'histoire des services correctionnels du Canada, voyons ce que vous en avez retenu! Répondez à notre jeu-questionnaire et mettez vos connaissances à l'épreuve.
1. À quelle date les six premiers détenus sont-ils arrivés au pénitencier de Kingston ?
le 1er juin 1835
Vers la fin du 18e siècle, de nouvelles idées concernant les services correctionnels se forment. L'un des grands concepts nés de cette époque est celui des maisons pénitentiaires, la création d'endroits où l'on pouvait isoler les prisonniers des autres membres de la société afin qu'ils puissent penser à leurs gestes et peut-être changer. Le « pénitencier provincial du Haut-Canada », situé à Kingston, en Ontario, fut le premier établissement du genre, accueillant six premiers détenus le 1er juin 1835.
Find out more about this subject at Pre-1920 : De la punition à la pénitence.
2. Au départ, le pénitencier de Kingston était une sorte d'attrait touristique, et les visiteurs devaient payer les frais d'admission. Quel visiteur célèbre a décrit la prison comme étant gérée « adéquatement et avec sagesse » ?
Charles Dickens
TMalgré les meilleures intentions, le pénitencier était un lieu de violence et d'oppression.
Find out more about this subject at Pre-1920 : De la punition à la pénitence.
3. Nommez l'une des sociétés bénévoles qui ont été formées dans les années 30 afin d'aider les délinquants canadiens.
la Société John Howard
la Société Elizabeth Fry
En plus des efforts déployés par certains groupes comme la Prisoners' Aid Association et l'Armée du Salut (qui ouvraient au sein des prisons canadiennes depuis 1882), un nouvel organisme visant à faciliter la réadaptation et la réintégration des détenus a vu le jour. Il s'agissait de la Société John Howard, fondée par le révérend J. Dinnage Hobden et nommée en l'honneur de cet artisan reconnu de la réforme carcérale en Grande-Bretagne au 19e siècle. En 1939, la première division de la Société Elizabeth Fry, un organisme offrant des services aux détenues et nommé en l'honneur d'une autre réformateure anglaise et défenseure des droits des détenus, a été mise en place au Canada.
Find out more about this subject at 1920–1939 : Dans l'adversité.
4. Quel était le nom de la commission qui, dans les années 30, a étudié le système correctionnel du Canada et y a proposé de nombreux changements ?
la commission Archambault
Vers la fin des années 1930, il y a eu de nouveaux appels en faveur d'une réforme des prisons. En 1936, une commission royale a été chargée d'examiner minutieusement le système pénitentiaire. Le rapport Archambault, rendu public en 1938, contenait un grand nombre de recommandations, menant à une version modifiée de la Loi sur les pénitenciers. Toutefois, des événements sur la scène mondiale ont retardé la mise en œuvre de ces changements durant plusieurs années.
Find out more about this subject at 1920–1939 : Dans l'adversité.
5. À quelle période les agents correctionnels du Canada ont-ils commencé à recevoir une formation officielle ?
1940 et 1959
Après la guerre, les efforts visant à changer les prisons canadiennes furent repris. Le major général Ralph B. Gibson, le premier Canadien nommé commissaire des Pénitenciers, mit en œuvre plus de 100 recommandations du rapport Archambault. On construisait de nouveaux pénitenciers, y compris des prisons fédérales distinctes pour les jeunes adultes de sexe masculin. Une formation régulière fut offerte au personnel des établissements.
Find out more about this subject at 1940-1959 : Époque de changement.
6. En quelle année la Commission nationale des libérations conditionnelles a t elle été créée ?
en 1959
Les critiques concernant les approches passées et actuelles en matière de services correctionnels, contenues dans le rapport Archambault, furent réitérées par un nouveau rapport publié en 1956 : le rapport Fauteux. La recommandation la plus importante d'entre toutes visait la création d'une commission des libérations conditionnelles qui devait s'occuper de tous les délinquants sous responsabilité fédérale. Le gouvernement donna rapidement suite à cette recommandation. L'ancienne loi fut remplacée par la Loi sur la libération conditionnelle de 1959, et la Commission nationale des libérations conditionnelles devint réalité.
Find out more about this subject at 1940-1959 : Époque de changement.
7. À quel endroit le premier programme de mise en liberté graduelle a-t-il été entrepris ?
à Collins Bay en Ontario
Dans les années 60, de nouvelles approches à l'égard de la réadaptation et de la réinsertion sociale ont été adoptées pour aider les prisonniers à réintégrer la société. À Collins Bay, près de Kingston, le tout premier programme de mise en liberté graduelle permettait aux détenus de travailler à l'extérieur de la prison et de rentrer à l'établissement le soir venu. En 1969, une unité résidentielle expérimentale a ouvert ses portes à l'établissement à sécurité moyenne de Springhill, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre d'un programme communautaire pilote visant à aider les détenus à se préparer à vivre « à l'extérieur ».
Find out more about this subject at 1960–1979 : Une ère marquée par l'innovation.
8. Quand le Canada a-t-il aboli la peine de mort ?
en 1976
L'abolition de la peine de mort en 1976 a marqué une étape importante dans l'avancement des droits de la personne – le droit à la vie tel qu'enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés.
Find out more about this subject at 1960–1979 : Une ère marquée par l'innovation.
9. Quel était le problème de santé majeur dans les établissements du Canada dans les années 80 ?
VIH/sida
Hépatite-C
Tuberculose
Tout au long des années 80 et 90, les questions relatives à la santé dans le système correctionnel sont devenues un sujet d'intérêt et de préoccupation croissants au Canada. Le nombre de cas de VIH/sida et d'hépatite-C dans les prisons fédérales et provinciales a continué d'augmenter tout au long des années 90. Dans les prisons fédérales, les cas signalés de VIH/sida ont augmenté, passant de 14 en janvier à 1989 à 159, en mars 1996—pour atteindre un sommet de 217 en décembre 2000. En 1998, un délinquant sur cinq qui entrait dans le système carcéral fédéral faisait l'objet d'un diagnostic de tuberculose – un chiffre considérablement supérieur à celui de la population générale.
Find out more about this subject at 1980–1999 : Nouvelles perspectives, nouvelles exigences.
10. Qu'est-ce que représentent Okimaw Ohci et Pê Sâkâstêw ?
ce sont des pavillons de ressourcement pour les délinquants autochtones
Les pratiques autochtones pour lutter contre le crime et punir les délinquants, dont les pratiques de réparation et de guérison, ont profité d'une reconnaissance accrue. Deux pavillons de ressourcement ont donc vu le jour, qui visent à répondre aux besoins uniques des Autochtones du Canada en matière de services correctionnels. Le premier de ces établissements, le pavillon Okimaw Ohci, situé à Maple Creek en Saskatchewan, a ouvert ses portes en 1995; il s'adresse aux femmes autochtones condamnées à une peine de ressort fédéral. En 1996-1997, le pavillon Pê Sakastêw, situé à Hobbema en Alberta, a été construit pour accueillir des hommes.
Find out more about this subject at 1980–1999 : Nouvelles perspectives, nouvelles exigences.
11. Quel ministère est aujourd'hui responsable du Service correctionnel du Canada ?
Sécurité publique Canada
Deux ans apres le 11 septembre, on créait Sécurité publique Canada (SP), qui allait remplacer le ministère du Solliciteur général. SP s'est engagé à assurer la sécurité du public; il cherche donc à diminuer le plus possible les risques auxquels sont exposés les Canadiens, qu'il s'agisse par exemple des risques pour la sécurité personnelle que présentent la criminalité ou les catastrophes naturelles, ou encore des menaces à la sécurité nationale qui découlent d'activités terroristes.
Find out more about this subject at 2000 à aujourd'hui : Les mesures entreprises.
12. Comment appelle-t-on le processus par lequel les victimes, les délinquants et les collectivités se réunissent afin de discuter des répercussions du crime commis ?
la justice réparatrice
En 2003, on a lancé le programme de justice réparatrice, ce qui a marqué l'arrivée d'une nouvelle attitude quant à la réadaptation des criminels. La justice réparatrice met l'accent sur les torts causés à une personne et à la collectivité. Elle reconnaît que le crime est autant une violation des relations entre des personnes en particulier qu'une attaque contre la collectivité. Le programme porte sur la participation volontaire à des discussions entre les victimes du crime et le délinquant et, idéalement, des membres de la collectivité. Ces exercices visent à « rétablir » les relations, à réparer les torts causés et à empêcher que d'autres crimes ne soient commis. Il existe maintenant différents types ou différentes pratiques de justice réparatrice utilisés et adaptés un peu partout au pays.
Find out more about this subject at 2000 à aujourd'hui : Les mesures entreprises.