Science du climat 2050 : Rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoir sur les changements climatiques

Téléchargez le format alternatif
(Format PDF, 2,01 Mo, 96 pages)
Sur cette page
- Chapitre 1 Orienter la lutte contre les changements climatiques
- Chapitre 2 Approche et méthodes
- Chapitre 3 La science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques
- Chapitre 4 Priorités thématiques
- Chapitre 5 Thèmes de recherche de convergence
- Chapitre 6 Faire progresser la science des changements climatiques
- Annexe – Priorités scientifiques en matière de changements climatiques
Chapitre 1 Orienter la lutte contre les changements climatiques
La science fournit des données probantes sur les répercussions du changement climatique, mais elle nous donne également les outils et les connaissances nécessaires pour y faire face. (...) Nous sommes entrés dans l'ère de la mise en œuvre, ce qui veut dire qu’il faut agir. Mais rien ne peut se faire sans les données, sans les données probantes qui peuvent orienter les décisions, ou sans la science qui soutient les programmes et les politiques.
— Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (2022)
Les changements climatiques ont des répercussions sur l’économie, les infrastructures, l’environnement, la santé et le bien-être social et culturel du Canada. La science des changements climatiques nous permet de mieux comprendre la façon de réduire le réchauffement futur en atténuant les émissions de gaz à effet de serre (GES), les risques liés au réchauffement ainsi que la vulnérabilité aux changements climatiques. Elle soutient donc des mesures de lutte contre les changements climatiques fondées sur des données probantes.
La mise en œuvre et la coordination des activités scientifiques doivent prendre en compte la diversité des expériences régionales et fondées sur l’équité des Canadiens en matière de changements climatiques. Les changements climatiques multiplient les risques pour toutes les communautés et régions, mais de manière différente, et leurs répercussions peuvent être ressenties de différentes façons. La planification scientifique doit également tenir compte du contexte plus large des progrès réalisés par le Canada vers une économie circulaire et un développement durable.
À mesure que nos besoins en matière de savoir et de renseignements évoluent, la planification stratégique et la mise en œuvre de la science doivent également évoluer pour prendre en compte les perspectives multiples et distinctes de toutes les personnes et communautés touchées par les changements climatiques et par les mesures de lutte contre ceux-ci.
1.1 Premier rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques
Le consensus scientifique sur les changements climatiques anthropiques est clair, tout comme la nécessité d’une action urgente pour atteindre la carboneutralité afin d’éviter les répercussions les plus gravesNote de bas de page 1. Pour ce faire, la capacité scientifique doit être renforcée afin d’apporter des données probantes là où elles sont le plus nécessaires pour guider la lutte contre les changements climatiques, définir de nouvelles possibilités de réduire les émissions de GES, élaborer des mesures d’adaptation et mesurer les progrès. La science et le savoirNote de bas de page 2 jouent un rôle essentiel en nous aidant à comprendre les interrelations complexes, les synergies et les compromis inhérents à l’édification d’un Canada prospère, résilient au climat, carboneutreNote de bas de page 3, juste et équitable.
Le rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques (SC2050) a été rédigé sous la direction d’Environnement et Changement climatique Canada. Il résume les résultats de deux années de vastes consultations auprès de plus de 500 responsables de programmes climatiques au sein des ministères et organismes fédéraux et des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’universitaires, d’experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques ainsi que d’organisations et de chercheurs autochtones. Ainsi, il prend sa place aux côtés d’autres initiatives nationales de politique et de planification en matière de climat. Il cerne les priorités scientifiques dans diverses disciplines – du cycle du carbone et de la science du système terrestre aux incidences sur la santé, les infrastructures et la biodiversité – afin d’éclairer les investissements scientifiques nécessaires maintenant pour fournir des résultats scientifiques au cours des six prochaines années (jusqu’en 2030) et pour guider la coordination scientifique en cours.
Les priorités décrites dans le présent rapport tiennent compte des besoins en renseignements exprimés par les personnes chargées d’élaborer les politiques et les programmes en matière de climat à tous les ordres de gouvernement. Elles reflètent également l’opinion des experts sur les nouvelles pistes de recherche scientifique qui permettront aux décideurs de tirer parti des nouvelles connaissances et données, ainsi que des nouveaux outils et renseignements. Dans tous les cas, les priorités scientifiques contribueront à faire avancer les efforts en cours pour atténuer les émissions de GES et s’adapter aux changements climatiques, notamment grâce à la détermination d’objectifs de réduction des émissions, au peaufinage des approches stratégiques existantes et à l’évaluation des progrès réalisés à ce jour. Le présent rapport s’adresse à tous ceux qui ont la possibilité de façonner les activités scientifiques liées aux changements climatiques au Canada, notamment la planification stratégique, le financement, la coordination et la mise en œuvre de ces activités.
Des scientifiques occidentaux et autochtones ont contribué à l’élaboration du rapport à l’occasion de tables rondes d’experts, d’enquêtes auprès des parties prenantes, de webinaires et de nombreuses discussions avec des partenaires, des experts et d’autres parties prenantes. La science est nécessaire pour garantir que les investissements dans les mesures d’atténuation, d’adaptation, de résilience des infrastructures et de reprise après sinistre soient aussi ciblés et efficaces que possible. Des mesures fondées sur des données probantes limitent les risques futurs et les coûts connexes. Le Canada subit déjà des coûts liés à l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, qui représentent environ 5 à 6 % de la croissance économique annuelle[4]. Les inondations, les ondes de tempête, les feux de forêt, les chaleurs extrêmes, les vents et les sécheresses des deux dernières décennies se sont traduits par des pertes économiques et des responsabilités financières. À l’avenir, ces conséquences devraient s’aggraver. Une partie de ces pertes futures peut être évitée grâce à des mesures d’adaptation et d’atténuation fondées sur des données scientifiques.
Publié en décembre 2020, le rapport SC2050 a constitué une étape importante pour le Canada, faisant le point pour la première fois sur l’étendue du savoir collaboratif et transdisciplinaire nécessaire pour éclairer la lutte contre les changements climatiques. Le présent rapport constitue la prochaine étape; il définit les activités scientifiques les plus urgentes pour permettre une évolution de la lutte contre les changements climatiques qui est conforme à notre meilleure compréhension du défi. Les solutions d’atténuation et d’adaptation doivent continuer à évoluer de concert avec le renforcement des données probantes qui sous‑tendent cette lutte.
Au-delà de l’orientation des investissements scientifiques, le processus d’élaboration du présent rapport a nécessité un dialogue continu sur la politique scientifique en matière de changements climatiques, afin d’améliorer la diffusion des résultats scientifiques qui éclairent à la fois les mesures d’atténuation et d’adaptation. Enfin, la préparation de ce rapport national multi-, inter- et transdisciplinaire sur la science et le savoir permet d’intégrer la planification stratégique de la science dans une planification plus large de la lutte contre les changements climatiques, alignant ainsi le Canada sur d’autres approches internationales.
1.2 Le contexte de la politique scientifique
Le présent rapport sur la science et le savoir vient compléter d’autres plans fédéraux d’atténuation et d’adaptation du Canada. Le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine, décrit les politiques, les programmes et les investissements fédéraux visant à atteindre les objectifs d’atténuation et d’adaptation. L’engagement du Canada à atteindre les objectifs de réduction des émissions est énoncé dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui a reçu la sanction royale en juin 2021. La Loi légifère la contribution déterminée au niveau national du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris pour 2030, qui est de 40 à 45 % inférieure aux niveaux de 2005, ainsi que l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050, et elle exige que le gouvernement du Canada fixe des objectifs supplémentaires tous les cinq ans jusqu’en 2050. La Loi précise que les futurs objectifs intermédiaires doivent être fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles. En guise de première étape importante en vertu de la Loi, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) en mars 2022. Le PRE est une feuille de route secteur par secteur comprenant une série de mesures et de stratégies visant à atteindre l’objectif que s’est fixé le Canada pour 2030 et à jeter les bases pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le PRE s’appuie sur les progrès réalisés par les plans climatiques précédents, notamment Un environnement sain et une économie saine (2020) ainsi que le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (2016).
Même avec des réductions rapides et importantes des émissions mondiales, un certain réchauffement supplémentaire au Canada est inévitable (Rapport sur le climat changeant du Canada, 2019). La Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA) reconnaît les répercussions et les risques actuels des changements climatiques que le Canada connaîtra en raison de changements à évolution lente ou de phénomènes extrêmes, et elle définit les objectifs de renforcement de la résilience partout au Canada. L’un des principes fondamentaux de la SNA est que la science éclairera des mesures prospectives, efficaces et ciblées visant à renforcer la résilience.
La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité et la SNA établissent le cadre général des priorités scientifiques présentées dans le présent rapport. Ces priorités présentent de multiples avantages, car elles permettent de relever de nombreux défis concomitants liés au climat auxquels la société est confrontée. En particulier, le présent rapport reconnaît la contribution et les avantages de la science pour relever les nombreux défis liés au climat auxquels la société est actuellement confrontée, notamment dans les domaines de la conservation de la biodiversité, de la sécurité de l’eau, de la préparation aux situations d'urgence, et du développement durable. Ainsi, la science des changements climatiques soutient les buts et les objectifs de multiples engagements et stratégies politiques nationaux et internationaux (figure 1.1).
Figure 1.1. Schéma de concordance entre le présent rapport et son contexte politique national, illustrant les politiques et programmes qui bénéficient de la science et du savoir en matière de changements climatiques.

Description textuelle
Graphique qui présente les politiques et les programmes qui bénéficient la science et le savoir sur les changements climatiques :
- Stratégie canadienne en matière de feux de forêt
- Cadre stratégique pour l’Arctique et le nord du Canada
- Commission de vérité et de réconciliation du Canada
- Leadership autochtone en matière de climat
- Stratégie de l’économie bleue
- Stratégie pour l’agriculture durable
- Rapport d’inventaire national des GES
- Plan d’action sur l’eau douce
- Agence canadienne de l’eau
- Plan de réduction des émissions
- Stratégie canadienne sur le méthane
- Stratégie pour les services climatiques et les données climatiques
- Partenariat canadien pour l’agriculture durable
- Stratégie canadienne pour les bâtiments verts
- Stratégie nationale d’adaptation
- Stratégie pour les services climatiques et les données climatiques
- Autres mesures intergouvernementales
- Plan d’action sur l’adaptation
- Loi fédérale sur le développement durable
- Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030
- Patrimoine naturel
- Convention sur la diversité biologique
- Fonds des solutions climatiques axées sur la nature
- Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience
- Programme d’accord d’aide financière en cas de catastrophe
- Dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts
- Politique alimentaire pour le Canada
- Programme d’identification et de cartographie des aléas d’inondation
Le présent rapport répond à la nécessité d’investir dans la science à tous les niveaux, des sciences de la découverte axées sur les disciplines jusqu’aux cadres de recherche transdisciplinaires. Il définit les priorités scientifiques qui permettent d’obtenir des résultats continus, notamment la synthèse et la mobilisation des connaissances, afin de permettre la mise à disposition de renseignements et de données pour répondre au besoin urgent de mesures de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, le présent rapport crée un espace favorable à la science transdisciplinaire et à la recherche participative, toutes deux essentielles pour combler les lacunes dans les connaissances. Le présent rapport précise quelles activités scientifiques sont prioritaires, et non comment ces activités devraient être mises en œuvre. Bien que la prise de décisions et la lutte contre les changements climatiques (c’est-à-dire les services, les politiques et la réglementation en matière de climat) soient cruciales et doivent s’appuyer sur la science et le savoir en matière de changements climatiques, elles ne relèvent pas du champ d’application du présent rapport.
En outre, le présent rapport n’aborde pas la recherche et le développement (R et D) des technologies propres, car une planification et des investissements considérables sont déjà en cours dans ces domaines, comme le processus fédéral de planification scientifique de la R et D en énergie qui a rassemblé des scientifiques fédéraux et des parties prenantes externes dans 12 domaines d’intérêt de la R et D en énergie. Ce processus oriente les cinq prochaines années d’activités fédérales de R et D en énergie, dont certaines sont complémentaires. Les activités de planification concomitantes liées aux technologies propres, à l’énergie et à l’économie ne relèvent pas de la portée du présent rapport. Cependant, il est nécessaire de comprendre le potentiel des énergies renouvelables, des technologies de séquestration du carbone et d’autres stratégies d’atténuation pour déterminer leur potentiel au Canada afin d’atteindre nos objectifs de carboneutralité. Cette compréhension est à la base de la science des voies critiques vers la carboneutralité, qui cadre avec la portée du présent rapport. La science ciblée et sectorielle n’est pas incluse ici, mais cela ne signifie pas qu’elle est sans importance. Les travaux et les orientations du Groupe consultatif pour la carboneutralité, de la Régie de l’énergie du Canada et de l’Institut climatique du Canada sont particulièrement importants pour guider les activités de recherche et de synthèse et de mobilisation des connaissances dans ce domaine.
Le présent rapport tient compte des principes directeurs de la science des changements climatiques élaborés en 2020, qui ont encore évolué en fonction du dialogue et de la mobilisation sur la politique scientifique (encadré 1.1). Ces principes sont destinés à façonner tous les aspects de la planification scientifique, de la coordination, du financement, de la collecte de données, de la recherche, ainsi que de la synthèse et de la mobilisation des connaissances.
En accord avec les principes directeurs, le gouvernement du Canada soutient les approches et les modes d’action autochtones en reconnaissant que la science autochtone fait partie des systèmes de savoir et des modes de connaissance des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Tous les acteurs de la science et du savoir autochtones et occidentaux en matière de changements climatiques devraient écouter et travailler en collaboration et dans le respect afin de parvenir à l’équité entre les systèmes de savoir, tout en augmentant les possibilités d’autodétermination des Autochtones, conformément à l’engagement du Canada envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (PDF) et envers le leadership autochtone en matière de science des changements climatiques (chapitre 3).
Les chapitres suivants présentent les données scientifiques nécessaires pour que nous puissions comprendre et évaluer les répercussions possibles des changements climatiques pour le Canada et le monde, prendre des mesures éclairées et ambitieuses, et réduire les risques climatiques pour faire du Canada un pays plus résilient et carboneutre d’ici 2050.
Encadré 1.1. Principes directeurs de Science du climat 2050
Les principes directeurs définis dans le rapport SC2050 (décembre 2020) ont orienté la préparation de ce rapport sur la science et le savoir. Ils offrent une orientation sur la manière dont la planification scientifique, la synthèse et la mobilisation des connaissances ainsi que les travaux de recherche peuvent s’appuyer sur les connaissances et la compréhension existantes d’une manière respectueuse, inclusive et interdisciplinaire qui profite à tous les Canadiens. Ces principes continuent d’évoluer, reflétant les discussions tenues et les conseils reçus lors de la préparation de ce rapport. Ces principes sont les suivants :- Assurer l’équité des divers systèmes de savoir, en accordant de la place au leadership et à l’innovation autochtones, et en reconnaissant que le savoir autochtone est un réseau distinct de systèmes de savoir qui ne peut être intégré à la science occidentale, mais qu’il existe des espaces où les deux peuvent coexister et cogénérer des connaissances.
- Adopter la multi- et la transdisciplinarité pour produire une science et un savoir qui reflètent la complexité et les interconnexions inhérentes à la lutte contre les changements climatiques et qui englobent différents systèmes d’affinités et de relations spirituelles avec la terre, les océans et les cours d’eau.
- Mettre l’accent sur la collaboration entre les générations, les disciplines, les secteurs, les ordres de gouvernement, les organisations et les régions afin de rassembler un éventail d’expériences, de perspectives et de domaines d’expertise.
- Adopter une approche souple et adaptative dans les activités liées à la science et au savoir afin de répondre aux nouvelles priorités, aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités.
- Appliquer une optique intersectionnelle qui tient compte des recoupements entre les changements climatiques et divers facteurs d’identité (p. ex. la race, la classe, le sexe) pour que des solutions visant à contrer à la fois les changements climatiques et l’inégalité puissent être élaborées, tout en éliminant les obstacles systémiques et en favorisant le bien-être.
- Répondre aux contextes, aux besoins, aux priorités, aux protocoles, aux cultures et aux modes de connaissance locaux et régionaux, en faisant participer les communautés touchées par la recherche pour que les mesures d’adaptation et d’atténuation soient adaptées et efficaces.
- Favoriser l’autodétermination des Autochtones dans la recherche afin de soutenir une approche de la science des changements climatiques qui soit holistique, adaptée au lieu et réactive, et qui respecte la souveraineté et la propriété des données autochtones.
- Envisager l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ceux-ci et le développement durable de manière intégrée afin de maximiser les nombreux avantages et les actions complémentaires qui se renforcent mutuellement.
Chapitre 2 Approche et méthodes
Résumé
L’approche et les méthodes utilisées pour préparer ce rapport étaient holistiques et fondées sur les résultats sociétaux, éclairés par la science. L’objectif premier du présent rapport est de soutenir les objectifs de carboneutralité et d’adaptation aux changements climatiques. Les priorités scientifiques identifiées visent également à atteindre des objectifs nationaux interreliés en matière d’action climatique, de conservation de la biodiversité et du développement durable. Les principaux moteurs de la sélection des priorités scientifiques sont leur pertinence aux besoins en renseignements des politiques et des programmes en matière de changements climatiques et leur capacité d’y répondre. La compréhension des lacunes actuelles en matière de connaissances, les perspectives relatives aux avancées scientifiques anticipées et les possibilités de faire progresser la science par une coordination et une collaboration nationales accrues ont également influencé la définition des priorités.
L’élaboration de ce rapport repose sur la participation, en 2021‑2022, d’un large éventail de responsables de programmes climatiques au sein des gouvernements et des secteurs, ainsi que d’experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques. Elle s’appuyait sur la mobilisation plus large du gouvernement du Canada concernant le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) et Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA).
Ce processus de mobilisation a montré que le Canada devrait donner la priorité à la fois à la recherche fondamentale, pour relever les défis dans les disciplines scientifiques, et à la recherche transformatrice, pour relever les défis complexes qui nécessitent les contributions collectives et intégrées des sciences sociales, économiques, naturelles et de la santé. Les principaux messages et résultats de la mobilisation sont résumés dans les priorités scientifiques présentées aux chapitres 3 à 6.
L’ensemble complet des priorités scientifiques répond aux besoins des utilisateurs en renseignements, c’est‑à‑dire les utilisateurs qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les politiques et les programmes en matière de climat.
Le présent chapitre décrit la façon dont le rapport a été élaboré, ce qui comprend la mobilisation et le classement des activités scientifiques en ordre de priorité. En accord avec les principes directeurs (encadré 1.1), le rapport a été élaboré selon une approche holistique, fondée sur les résultats sociétaux, qui doivent être éclairés par la science. Tout au long de l’élaboration, l’accent a été mis sur l’avancement de la science pour atteindre les objectifs climatiques et de développement durable du Canada dans un monde carboneutre. Toutefois, le rapport prévoit également des possibilités pour la science canadienne de contribuer à une réponse internationale de plus grande envergure face aux changements climatiques et à un développement résilient au climat.
Bien que les objectifs nationaux du Canada en matière de carboneutralité et d’adaptation soient à l’origine de ce rapport, de multiples avantages peuvent également découler de ces travaux scientifiques. Les activités scientifiques décrites dans ce rapport sont pertinentes pour relever les divers défis liés au climat (figure 1.1). La compréhension de ces défis et des liens avec des avantages multiples (p. ex. pour la biodiversité, la santé et le développement durable) a également orienté la définition des priorités scientifiques.
Publié en décembre 2020, le premier rapport SC2050 faisait le point sur le large éventail des sciences en phase avec la lutte contre les changements climatiques. Le présent rapport de suivi classe les activités scientifiques par ordre de priorité et vise à éclairer les investissements dans la recherche ainsi que la synthèse et la mobilisation des connaissances aux fins d’harmonisation avec une action ambitieuse pour le climat. Cette approche est similaire à celles adoptées par d’autres pays qui ont des contextes juridictionnels, culturels et géographiques pertinents. Bon nombre des priorités scientifiques définies dans le présent rapport représentent une base scientifique commune pour la planification des mesures d’atténuation et d’adaptation, lesquelles sont de plus en plus intégrées. La base scientifique commune est conçue pour aider à guider ces travaux afin qu’ils se renforcent mutuellement. Par conséquent, ce rapport définit des priorités scientifiques qui couvrent plusieurs disciplines, régions et secteurs, en s’appuyant sur le cadre initial du rapport SC2050.
2.1 Exemples à l’international
La compréhension de la manière dont d’autres nations ou organismes internationaux ont abordé la planification de la science des changements climatiques peut éclairer l’approche du Canada. Le précepte de base est que la lutte contre les changements climatiques doit se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques possibles, afin de gérer les risques et d’élaborer des stratégies d’atténuation efficaces. Pour trouver des comparateurs internationaux, un certain nombre de plans scientifiques ou de programmes stratégiques ont été examinés (voir ci-dessous). Aucun des plans scientifiques des autres administrations n’était fondé sur des résultats sociétaux et n’éclairait à la fois les mesures d’atténuation et d’adaptation dans une perspective holistique, contrairement à l’approche adoptée pour le présent rapport.
- Le Centre commun de recherche de la Commission européenne se compose de domaines de recherche distincts, qui comprennent principalement la science axée sur l’atténuation et un programme intégré de recherche sur la durabilité. Le plan stratégique 2021‑2024 (en anglais seulement) pour Horizon Europe comprend également la science du climat.
- L’Institut danois de recherche météorologique héberge un Centre national de recherche sur le climat, (en anglais seulement) un centre de collaboration interdisciplinaire qui met l’accent sur les sujets prioritaires pour le Danemark, notamment la cryosphère, les conditions météorologiques extrêmes et la transition verte grâce aux sources d’énergie renouvelable.
- En Australie, de nombreuses organisations participent à la science du climat, notamment la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation et le Bureau of Meteorology. L’Australian Academy of Science est chargée d’examiner les capacités de la science du climat (PDF) (en anglais seulement) et de définir la position actuelle du secteur de la science du climat et les besoins futurs en matière de recherche climatique.
- Au Royaume-Uni, le programme climatique du Met Office Hadley Centre assure la direction et la planification stratégique de la science des changements climatiques, avec le soutien du Department of Business, Energy and Industrial Strategy ainsi que du Department for Environment, Food and Rural Affairs. La Royal Society du Royaume-Uni produit des documents d’information (en anglais seulement) sur une série de sujets afin d’éclairer les priorités en matière de lutte contre les changements climatiques et de recherche. Les conseils sont coordonnés par le Climate Change Committee (en anglais seulement) du Royaume-Uni.
- Aux États-Unis, le Global Change Research Program (en anglais seulement), une collaboration de 13 départements et organismes fédéraux, est responsable de la planification scientifique stratégique et des évaluations scientifiques. C’est ce que prévoit la Global Change Research Needs and Opportunities for 2022–2031 (en anglais seulement).
- En Autriche, le Austrian Climate Research Programme (en anglais seulement) oriente la recherche sur le climat en ce qui concerne les répercussions des changements climatiques, l’adaptation et l’atténuation.
- Aotearoa New Zealand (en anglais seulement) reflète la relation entre la Couronne et les Māori dans le cadre du Te Tiriti o Waitangi (traité de Waitangi), en reconnaissant l’application du te reo Māori (la langue Māori) et du mātauranga Māori (la façon unique qu’ont les Māori de voir le monde, qui englobe à la fois les connaissances et la culture traditionnelles), dans un contexte environnemental, et plus particulièrement dans le plan d’adaptation national (PDF) (en anglais seulement) de la Nouvelle‑Zélande.
2.2. Mobilisation
Le rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques a été élaboré dans le cadre d’un dialogue stratégique scientifique continu qui a débuté en 2018 avec la mobilisation pour le premier rapport SC2050, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada. Pour ce faire, il a fallu réunir un large éventail de responsables de programmes climatiques de différents gouvernements et secteurs, ainsi que des experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques. Lors de l’élaboration du rapport, il était important de combler les lacunes dans les connaissances cernées par les responsables de la politique sur les changements climatiques et les décideurs dans les différentes administrations afin de mieux comprendre leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques et de savoir quels renseignements sont les plus importants pour la réussite de cette lutte. La communauté scientifique a également été invitée à réfléchir aux nouvelles synthèses scientifiques ou de connaissances nécessaires pour répondre à ces besoins en renseignements, ainsi qu’à déterminer où les avancées scientifiques futures permettront aux décideurs de combler les lacunes dans les connaissances et d’atteindre les objectifs en matière de changements climatiques.
En collaboration avec le réseau de conseillers scientifiques ministériels du Bureau de la conseillère scientifique en chef, un groupe consultatif scientifique a été créé pour guider la mobilisation, l’élaboration du rapport, l’établissement des priorités et l’examen par les pairs. Les responsables scientifiques fédéraux de plusieurs ministèresNote de bas de page 5 ont analysé les données recueillies lors de la mobilisation et ont rédigé le présent rapport. Tout au long de ce processus, il est apparu que les structures organisationnelles nécessaires à une coordination et une planification scientifiques nationales efficaces sont limitées, en particulier compte tenu de l’ambition et de la diversité des objectifs climatiques énoncés.
La mobilisation menée en 2021-2022 comprenait la mise à profit de la mobilisation plus large du gouvernement du Canada sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) et la Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA). En outre, une mobilisation propre à SC2050 a été entreprise, y compris une mobilisation provinciale et territoriale (encadré 2.1), une enquête ciblée auprès des parties prenantes, un processus de demande de renseignements auprès d’organisations universitaires et une série de sept tables rondes scientifiques d’experts (figure 2.1). Les tables rondes scientifiques ont permis une discussion sur les « grands défis » scientifiques essentiels à la réussite de l’atténuation des GES et de l’adaptation aux changements climatiques. Cette discussion a porté principalement sur les besoins en renseignements des responsables de programmes climatiques, exprimés dans le cadre du processus de mobilisation initial.
Un petit atelier de chercheurs universitaires autochtones a complété l’exercice de la table ronde scientifique, afin de recueillir les points de vue des systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cet atelier a permis de peaufiner le rapport et, en particulier, d’orienter l’élaboration du chapitre 3, en tenant compte de l’importance la science et des capacités indigènes dans l’intégration des approches scientifiques autochtones et occidentales.
L’ébauche du rapport a été examinée par 14 experts canadiens et internationaux aux perspectives multidisciplinaires ancrées dans leurs propres domaines d’expertise. Tous avaient une appréciation du contexte scientifique canadien grâce à une mobilisation ou à une collaboration substantielle avec des scientifiques canadiens.
Encadré 2.1. Mobilisation des provinces et des territoires : ce que nous avons entendu
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont d’importants utilisateurs du savoir en matière de changements climatiques. Ils appliquent les résultats scientifiques à la mise en œuvre de réduction d’émissions de GES et de mesures d’adaptation qui seront efficaces dans leur contexte géographique et décisionnel. Les besoins en renseignements de tous les ordres de gouvernement doivent continuer à alimenter la science des changements climatiques, notamment pour aborder les points suivants :
- renforcer la coordination de la recherche entre les secteurs et les acteurs, et améliorer la mobilisation des connaissances;
- créer un espace et une équité pour le savoir autochtone;
- améliorer les rapports sur le rendement en matière d’émissions, les méthodes d’estimation, la divulgation et les objectifs de responsabilité;
- améliorer le suivi, la collecte de données et la recherche sur le climat, les risques, les dangers et les possibilités, ainsi que la recherche visant à appuyer les évaluations de la vulnérabilité et des risques, et les paramètres, le suivi et l’évaluation des interventions, notamment dans les domaines de la pêche, de la foresterie, de l’agriculture, de la biodiversité et des écosystèmes;
- améliorer la prévision des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes;
- élaborer des projections des répercussions du climat sur la demande et l’approvisionnement en eau ainsi que sur la gestion de l’eau;
- élaborer des cartes des risques hydrologiques, d’inondations et côtiers pour faciliter la planification, la navigation et les interventions;
- élaborer des prévisions des changements climatiques à l’échelle locale et comprendre les répercussions sur les infrastructures, la santé, la sécurité, la culture et le patrimoine;
- mettre au point des projections, des observations, des données et des indicateurs pour informer les solutions fondées sur la nature et la gestion des terres, des eaux, des espèces sauvages, et des écosystèmes;
- élaborer conjointement des renseignements permettant l’application d’outils d’atténuation, d’adaptation et de planification que les municipalités, les communautés, les parties prenantes locales, le personnel chargé de la gestion des urgences, les urbanistes, les ingénieurs et d’autres peuvent utiliser pour intervenir face aux changements climatiques;
- élaborer des outils d’évaluation intégrés, qui tiennent compte des changements climatiques dans les politiques ainsi que dans la planification financière et économique; et
- comprendre et prévoir les répercussions du climat sur la sécurité alimentaire, y compris les aliments traditionnels et la récolte durable.
Figure 2.1. Processus d’élaboration de Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques.
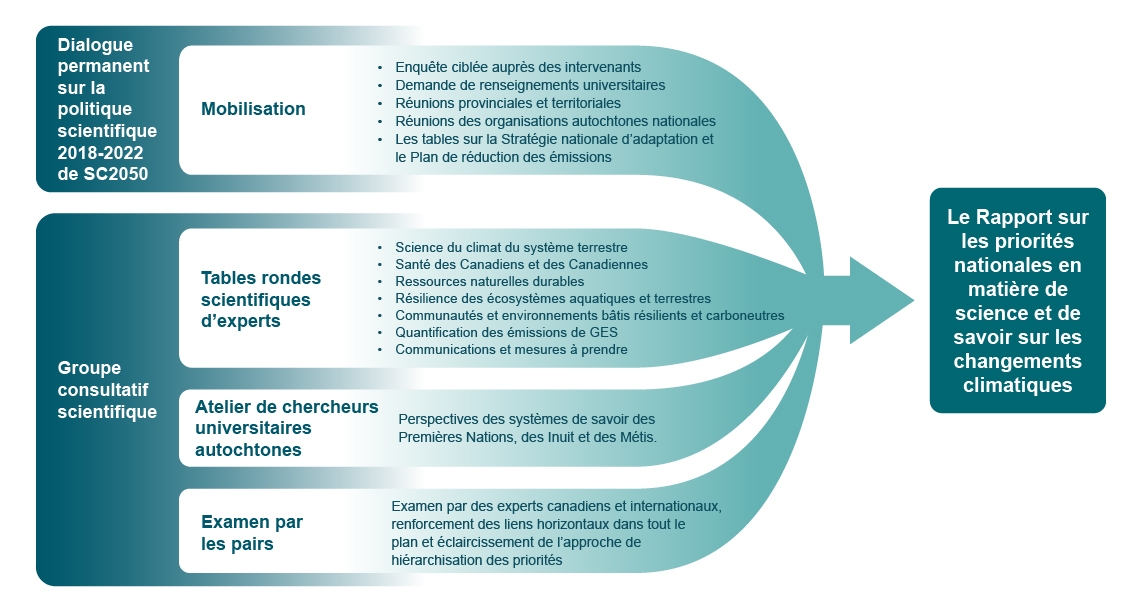
Description textuelle
Graphique qui décrit le processus d’élaboration du rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoirs sur les changements climatiques :
- Dialogue permanent sur la politique scientifique 2018-2022 sur la Science du climat C2050
- Mobilisation
- Enquête ciblée auprès des intervenants
- Demande de renseignements universitaires
- Réunions provinciales et territoriales
- Réunions des organisations autochtones nationales
- Les tables sur la Stratégie nationale d’adaptation et le Plan de réduction des émissions
- Mobilisation
- Groupe consultatif scientifique
- Tables rondes scientifiques d’experts
- Science du climat du système terrestre
- Santé des Canadiens et des Canadiennes
- Ressources naturelles durables
- Résilience des écosystèmes aquatiques et terrestres
- Communautés et environnements bâtis résilients et carboneutres
- Quantification des émissions de GES
- Communications et mesures à prendre
- Atelier de chercheurs universitaires autochtones
- Perspectives des systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis
- Examen par les pairs
- Examen par des experts canadiens et internationaux, renforcement des liens horizontaux dans tout le plan et éclaircissement de l’approche de hiérarchisation des priorités
2.3 Science transdisciplinaire et recherche de convergence
La mobilisation et les tables rondes d’experts ont montré que les cadres de recherche doivent être adaptés à la complexité croissante de la prise de décisions en matière d’atténuation, d’adaptation et de développement durable. Cette adaptation requiert l’évolution de ces cadres vers des modalités scientifiques transdisciplinaires (encadré 2.2). L’émergence de plusieurs sujets intersectoriels, où certaines disciplines se croisent, et de sujets de recherche de « convergence » (encadré 2.2) pendant les discussions est reliée à cette adaptation.
Encadré 2.2. Paradigmes de recherche pour une science transformatrice
Les lacunes les plus difficiles à combler en matière de connaissances nécessitent des cadres scientifiques transdisciplinaires afin d’inclure les sciences sociales, économiques, naturelles, de la santé et autochtones et d’intégrer les changements climatiques, la santé et le bien-être économique. Le rapport de 2017 intitulé Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (PDF) note que les défis multiformes auxquels la société est confrontée exigent une science qui va au-delà des disciplines, en jetant des ponts entre des champs de connaissances auparavant déconnectés et en créant de nouvelles disciplines.
Le développement des connaissances sur les changements climatiques nécessite des paradigmes de recherche participative, créant des relations plus fortes entre les experts des différentes disciplines et entre les experts et les décideurs. En outre, le fait d’accorder une valeur et un respect égaux au savoir autochtone parallèlement à la science occidentale constitue en soi un paradigme de recherche qui continue d’évoluer.
Dans le présent rapport sur la science et le savoir, les termes suivants sont utilisés (adaptés de The Difference Between Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Convergence Research | Research Development Office (ncsu.edu) (en anglais seulement) et de Research Types - Learn About Convergence Research | NSF - National Science Foundation (en anglais seulement). Les cadres transdisciplinaires devraient permettre l’équité et l’unité.
La science interdisciplinaire comprend deux disciplines ou plus qui s’unissent pour élaborer une définition coordonnée et inclusive du problème de recherche et pour concevoir et exécuter le projet de recherche.
La science multidisciplinaire met en relation des chercheurs de différentes disciplines, chacun apportant sa perspective disciplinaire.
La science transdisciplinaire crée une unité de cadres intellectuels, intégrant des approches au-delà des perspectives disciplinaires et aboutissant à une approche synergique et nouvelle de la définition du problème de recherche, des modalités, et de la synthèse et de la mobilisation des connaissances.
La recherche de convergence rassemble divers chercheurs pour qu’ils communiquent entre les disciplines afin de relever un défi commun en matière de recherche, ce qui entraîne une imbrication des connaissances, des théories, des méthodes, des données et des communautés. Elle est semblable à la recherche transdisciplinaire, mais permet de créer intentionnellement de nouveaux paradigmes ou disciplines.
L’approche à double perspective, un concept proposé par l’aîné mi’kmaq Albert Marshall (en anglais seulement), fait référence à l’apprentissage de la vision d’un œil avec les forces du savoir et des modes de connaissance autochtones, et de l’autre œil avec les forces du savoir et des modes de connaissance occidentaux, en tirant parti de multiples perspectives (voir Guiding Principles (Two Eyed Seeing) | Integrative Science (en anglais seulement)).
2.4 Architecture du rapport
L’architecture du présent rapportNote de bas de page 6 concorde étroitement avec les thèmes du premier rapport SC2050, mais reflète en plus la nécessité d’une science transdisciplinaire pour aborder les sujets de recherche de convergence. Le rapport témoigne également de l’importance de faire progresser la science sur plusieurs fronts en parallèle, car les changements climatiques continuent de toucher la prise de décisions dans chaque région, collectivité et secteur économique.
Les priorités de ce rapport mettent l’accent sur une intégration plus complète des sciences sociales dans la science des changements climatiques, en tant qu’élément essentiel pour faire progresser les travaux dans tous les domaines thématiques et pour favoriser l’action. Plus précisément, la science du comportement est nécessaire pour concevoir et évaluer la communication sur les changements climatiques afin d’accroître la sensibilisation et la compréhension et d’informer et d’inciter à l’action. La figure 2.2 illustre le cadre conceptuel de ce rapport.
Figure 2.2. Cadre conceptuel de Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques.
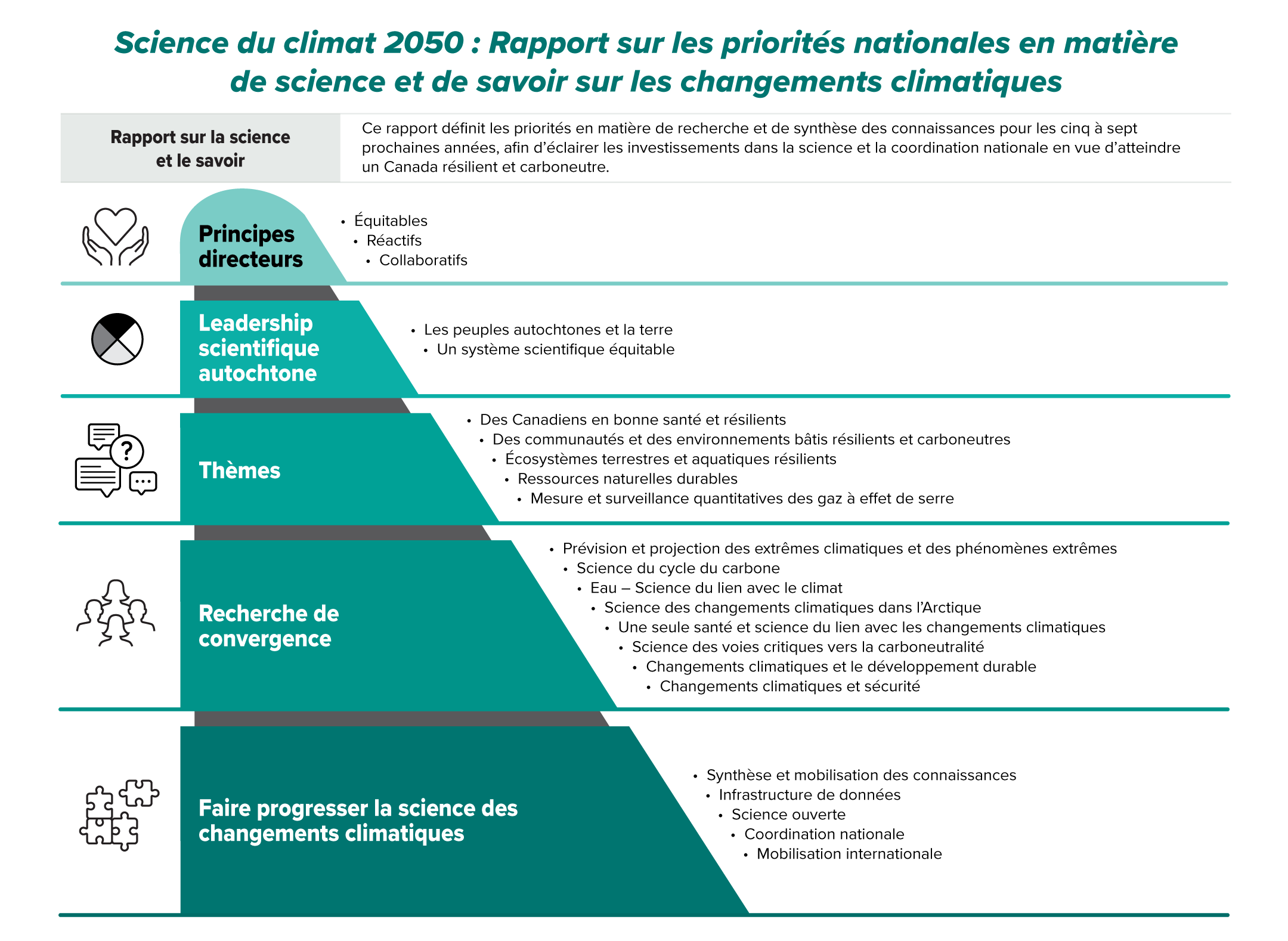
Description textuelle
Science du climat 2050 : Rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoir sur les changements climatiques. Ce rapport définit les priorités en matière de recherche et de synthèse des connaissances pour les cinq à sept prochaines années, afin d’éclairer les investissements dans la science et la coordination nationale en vue d’atteindre un Canada résilient et carboneutre.
Le graphique présente le cadre conceptuel de ce rapport sur la science et le savoir.
- Principes directeurs
- Équitables
- Réactifs
- Collaboratifs
- Leadership scientifique autochtone
- Les peuples autochtones et la terre
- Un système scientifique équitable
- Thèmes
- Des Canadiens en bonne santé et résilients
- Des communautés et des environnements bâtis résilients et carboneutres
- Écosystèmes terrestres et aquatiques résilients
- Ressources naturelles durables
- Mesure et surveillance quantitatives des gaz à effet de serre
- Recherche de convergence
- Prévision et projection des extrêmes climatiques et des phénomènes extrêmes
- Science du cycle du carbone
- Eau – Science du lien avec le climat
- Science des changements climatiques dans l’Arctique
- Une seule santé et science du lien avec les changements climatiques
- Science des voies critiques vers la carboneutralité
- Changements climatiques et le développement durable
- Changements climatiques et sécurité
- Faire progresser la science des changements climatiques
- Synthèse et mobilisation des connaissances
- Infrastructure de données
- Science ouverte
- Coordination nationale
- Mobilisation internationale
2.5 Analyse et hiérarchisation des priorités
Les chapitres 3 à 6 définissent les priorités en matière de recherche, ainsi que de synthèse et de mobilisation des connaissances. Les priorités tiennent compte à la fois du besoin de recherche fondamentale (faire progresser la science pour relever les défis dans les disciplines scientifiques) et de recherche transformatrice (relever des défis complexes qui nécessitent les contributions collectives et intégrées des sciences sociales, économiques, naturelles et de la santé); ces deux types de recherche sont nécessaires pour guider et évaluer les progrès dans l’atteinte des objectifs climatiques du Canada.
La hiérarchisation des priorités en matière de science et de savoir s’est appuyée sur les principes directeurs définis dans le rapport SC2050 (encadré 1.1). Trois principes supplémentaires ont été élaborés précisément pour ce rapport afin de garantir que les activités scientifiques les plus prioritaires reflètent les points suivants :
- leur pertinence aux besoins en renseignements des politiques et des programmes en matière de changements climatiques et leur capacité d’y répondre, afin de contribuer à la mise en œuvre de mesures transformatrices et ambitieuses de lutte contre les changements climatiques nécessaires pour parvenir à un Canada résilient et carboneutre;
- l’excellence scientifique, guidée par la science émergente et la prospective scientifique; et
- les avantages d’une coordination et/ou d’une collaboration nationales accrues.
De même, huit critères ont été élaborés pour guider la discussion sur les priorités scientifiques. Les priorités scientifiques devraient :
- donner lieu à d’importantes possibilités de mettre au point des évaluations scientifiques et des produits de synthèse des connaissances qui mobilisent les investissements déjà réalisés dans la science des changements climatiques;
- faire progresser les connaissances et les capacités grâce à une coordination nationale accrue et à des partenariats de recherche collaborative qui s’étendent à tous les ministères fédéraux et englobent des organismes provinciaux et territoriaux, autochtones, municipaux, universitaires, environnementaux non gouvernementaux et industriels;
- permettre des interventions multiéchelle face aux changements climatiques dans des contextes nationaux, régionaux et locaux;
- tirer efficacement parti du leadership et de la participation en matière de science et de savoir à l’échelle internationale pour mobiliser les connaissances et les outils dans l’intérêt et le contexte du Canada;
- refléter une approche multi- ou transdisciplinaire en vue de faire progresser la recherche ainsi que la synthèse et la mobilisation des connaissances, lorsqu’une intégration des connaissances entre disciplines est nécessaire;
- déterminer l’état de préparation des connaissances ou des outils afin de réaliser des progrès rapides grâce à un investissement ciblé et modeste;
- appliquer une optique intersectionnelle pour élaborer des solutions qui s’attaquent aux changements climatiques, au développement durable et à l’inégalité sociale; et
- recouper de multiples disciplines et interdépendances, de sorte que les progrès de la science du climat produisent des avantages accessoires pour d’autres objectifs sociaux ou environnementaux (p. ex. la santé, la conservation de la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau) ou des secteurs économiques précis (p. ex. l’agriculture, la pêche, la foresterie).
Sur la base de ces principes et critères, le processus a permis de définir des sujets de recherche de convergence qui :
- recoupent plusieurs thèmes et disciplines scientifiques;
- sont transdisciplinaires;
- sont pertinents dans toutes les régions et tous les secteurs; et/ou
- communiquent les interdépendances, les interactions et les rétroactions complexes entre les systèmes environnementaux, écologiques, socioéconomiques et sanitaires.
Ces sujets de recherche sur la convergence prennent en compte les domaines dans lesquels les investissements dans la recherche, la coordination et la collaboration nationales facilitées, l’infrastructure et les activités de synthèse et de mobilisation des connaissances auront la plus forte incidence sur la réalisation d’un Canada résilient et carboneutre. Ils prennent aussi en compte la recherche scientifique essentielle à l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs climatiques.
Les messages clés et les résultats des discussions et des tables rondes d’experts ont ensuite été synthétisés. Dans ce processus, nous avons reconnu l’importance des points de vue des utilisateurs – les personnes qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les politiques et les programmes climatiques – et nous avons écouté leurs besoins en renseignements et les lacunes qu’ils avaient cernées dans les connaissances. Cette perspective a façonné la hiérarchisation des activités scientifiques, tant pour la recherche que pour la synthèse et la mobilisation des connaissances (chapitres 3 à 6). Enfin, un examen holistique des priorités scientifiques par rapport aux contributions des participants a confirmé que la science devait progresser sur plusieurs fronts afin de répondre aux divers besoins en renseignements exprimés lors de la mobilisation.
Chapitre 3 La science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques
Ce chapitre a été rédigé par le Secrétariat de SC2050 d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en tenant compte de nombreuses conversations et documents préparés dans le cadre d’autres programmes climatiques nationaux. Plus précisément, ce chapitre résume les résultats de la mobilisation et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Stratégie nationale d’adaptation dirigée par le gouvernement fédéral, des trois tables conjointes avec des Nations autochtones et le Canada pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, de la communauté des Autochtones dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) à l’échelle fédérale, de la détermination de la portée du thème scientifique d’action et de sensibilisation pour le climat (Fonds pour dommages à l’environnement), d’un petit atelier de chercheurs universitaires autochtones et de la Division des sciences autochtones d’ECCC. Bien que ce chapitre porte en particulier sur la science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques en général, les chapitres suivants indiquent également des domaines particuliers où la science et le savoir autochtones sont importants pour combler les lacunes et la mobilisation des connaissances.
Les peuples des Premières Nations, des Inuit et des Métis, leurs connaissances et leurs liens avec la terre, l’eau et la glace apportent une contribution essentielle à l’élaboration de solutions et à la réponse aux défis environnementaux, notamment les changements climatiques. La voie de la réconciliation, telle que décrite dans le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada : appels à l’action de 2015 (PDF), appelle toutes les institutions canadiennes à revoir leurs relations, leurs politiques et leurs programmes afin de guérir les blessures du passé.
La colonisation a accru la vulnérabilité du bien-être physique, culturel, économique et spirituel des peuples autochtones aux changements climatiques. Les Autochtones ont des relations et des responsabilités uniques entre les systèmes de savoir autochtones et avec la terre, l’eau et la glace. Chez les peuples autochtones, ces concepts comportent de multiples facettes et sont fondés sur le territoire, avec des traditions, des langues, des cérémonies et des systèmes de savoir qui orientent la vision unique du monde des communautés et des nations autochtones. Les responsabilités inhérentes à ces systèmes de savoir et à ces manières d’être sont connues sous le nom de lois naturelles. Dans les contextes autochtones, la terre représente plus qu’un de simples reliefs physiques, des territoires ou des écosystèmes. Dans toutes les cultures autochtones, la terre, l’eau et la glace sont considérées comme des éléments fondamentaux de leur identité. Ces éléments constituent le paysage dans lequel les relations humaines et plus qu’humaines évoluent et se développent. Simultanément, ils créent des relations réciproques qui définissent les obligations de toutes les entités les unes envers les autres. Cette conception de la terre, de l’eau et de la glace en tant qu’éléments en interaction dans le réseau de la vie et en tant qu’arbitres de la responsabilité qui fait de la science et du savoir autochtones des éléments essentiels à la lutte contre les changements climatiques et à l’élaboration conjointe de solutions pour tous les Canadiens.
Les priorités scientifiques et le leadership autochtones doivent être intégrés dans tout le spectre de la pratique scientifique, depuis la formulation d’hypothèses à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, afin de soutenir les engagements du Canada en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones. Le rapprochement respectueux des sciences autochtones et occidentales permet cette réconciliation, mais doit tenir compte de la capacité des communautés autochtones à participer de manière équitable. L’une des façons de parvenir à cette réconciliation consiste à créer des espaces équitables qui reconnaissent le rôle du milieu universitaire, de la science et du colonialisme, et leurs répercussions sur la science autochtone.
Encadré 3.1. Science autochtone
La science autochtone est une méthode culturellement spécifique d’accumulation de connaissances, de peaufinage d’hypothèses et de modification des pratiques associées à la compréhension profonde du monde naturel par les Premières Nations, les Inuit et les Métis. La science autochtone est « holistique » (terme utilisé pour décrire l’écosystème dans son ensemble) et tresse, voire tisse en profondeur les nouveaux renseignements dans une perspective à long terme, tout en respectant les codes de conduite et la diligence raisonnable attendus en vue de l’intérêt collectif de toutes les composantes, y compris les humains, dans les écosystèmes. Les paradigmes de recherche autochtones ont un certain nombre de composantes communes; par exemple, la responsabilité relationnelle, l’utilisation et la transmission holistiques des données et des informations, et le respect des personnes dans le cadre de processus pouvant influencer les résultats scientifiquesNote de bas de page 7.
3.1 Création d’un système scientifique équitable grâce à la science autochtone
Approche fondée sur les distinctions
L’expression « approche fondée sur les distinctions » reconnaît les histoires, les intérêts et les priorités distincts des trois principaux groupes de peuples autochtones reconnus dans la constitution canadienne : les Premières Nations, les Inuit et les Métis.
Le leadership autochtone a toujours été réduit au silence, non reconnu et dévalorisé. Ce n’est que très récemment que le développement de la science des changements climatiques et de la politique mondiale en la matière a laissé une place au leadership autochtone, avec l’autodétermination et la gouvernance comme concepts fondamentaux qui façonnent la science et la politique environnementales. L’établissement d’un système scientifique représentatif, diversifié et inclusif au Canada exige le maintien et le renouvellement des relations. Le système doit intégrer facilement les méthodes et les modes de connaissance occidentaux et autochtones dans une voie à suivre renforcée.
Les activités de recherche et scientifiques dirigées par les Autochtones ou élaborées en collaboration avec les communautés autochtones favorisent la participation des populations locales et permettent aux communautés de tirer parti de renseignements récents pour prendre des décisionsNote de bas de page 8. Ces activités peuvent également mener à un engagement communautaire à long terme, réduisant ainsi la « lassitude liée à la consultation ». Le fait de choisir des communautés autochtones et éloignées pour des installations gouvernementales, de l’infrastructure de recherche et du personnel augmente encore le potentiel de relations à long terme avec ces communautés et favorise le renforcement de leurs capacités.
Pour obtenir des résultats équitables dans le domaine de la science des changements climatiques, il est nécessaire d’inclure des méthodes scientifiques autochtones en vue d’éclairer les mesures d’atténuation et d’adaptation. Les priorités suivantes visent à renforcer la science autochtone et l’équité entre les systèmes de savoir. Toutefois, les stratégies de recherche élaborées par les Autochtones représentent l’expression première des priorités des peuples autochtones.
SSA1. Développer le leadership autochtone dans la science des changements climatiques et les réseaux scientifiques autochtones; soutenir les groupes et les réseaux scientifiques et de connaissances qui établissent activement des relations avec les peuples autochtones en créant des voies qui respectent les préoccupations et les priorités locales en matière de science du climat. Cela comprend la préparation du système existant pour recevoir l’afflux de sciences autochtones, notamment en formant les professionnels existants, en intégrant les sciences autochtones dans le matériel d’enseignement des sciences à tous les niveaux à l’échelle nationale et en travaillant avec les organismes chargés des autorisations, entre autres. Il faudra en outre établir des relations, apprendre conjointement avec les communautés autochtones et créer des programmes de leadership ou de mentorat pour les jeunes autochtones dans le domaine des changements climatiques et de la science, afin de rétablir et d’augmenter le nombre de détenteurs de savoir dans les communautés, les nations autochtones, le milieu universitaire, l’industrie et la fonction publique.
SSA2. Harmoniser la planification et la mise en œuvre de la science autochtone et de la science occidentale avec les gouvernements, les organisations et les citoyens autochtones pour élaborer des approches régionales, pertinentes et fondées sur les distinctions en matière de science et de savoir sur les changements climatiques d’une manière qui respecte les droits et l’autodétermination des Autochtones. Cela comprend la création de réseaux de forums régionaux fondés sur les distinctions pour orienter la science des changements climatiques. Cela comprend également l’élaboration d’indicateurs déterminés par les Autochtones pour suivre les progrès du Canada en matière de mobilisation scientifique des Autochtones dans le domaine des changements climatiques, de sorte que les résultats scientifiques permettent d’atténuer les répercussions socioculturelles et socioéconomiques des changements climatiques.
SSA3. Créer des documents sur la science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques qui répondent aux objectifs de revitalisation culturelle des peuples autochtones et élaborer des politiques, des programmes et des initiatives qui respectent les langues autochtones. Cette approche nécessite l’élaboration et la production conjointes de documents techniques et de communication dans les langues autochtones.
SSA4. Renforcer les mécanismes d’établissement de la portée et de financement afin d’établir des capacités de recherche scientifique autochtones. Cela pourrait inclure l’élaboration de mécanismes pour créer des programmes de recherche, des centres ou un quatrièmeNote de bas de page 9 conseil ou organisme de financement de la recherche dirigé par des Autochtones, à l’échelle nationale ou régionale, afin de diriger la recherche et l’administration de programmes scientifiques par des organismes scientifiques autochtones (p. ex. un centre d’excellence autochtone sur les changements climatiques), ainsi que des programmes scientifiques autochtones à l’échelle de la communauté qui comprendraient des agents de liaison scientifiques autochtones dédiés (voir la section 3.2 ci‑dessous).
SSA5. Assurer une formation et renforcer les capacités des Autochtones en matière de pratiques scientifiques et des connaissances locales et régionales axées sur le lieu. Cette approche pourrait inclure une infrastructure de surveillance et de données dirigées par les Autochtones, des connaissances et des systèmes de gestion de l’environnement au niveau communautaire, des possibilités de formation pour les jeunes autochtones, l’apprentissage tout au long de la vie et des compétences techniques liées à l’environnement local et à la science autochtone, ainsi que la direction et la mise en œuvre autochtones de projets (voir la section 3.3 ci-dessous).
3.2 La relation sacrée des peuples autochtones avec la terre, l’eau et la glace
C’est à travers le prisme humain que nous observons, interprétons et construisons le cadre éthique qui régit notre interaction avec la terre, l’eau et la glace. Les liens avec la terre et, en fin de compte, avec le climat, sont inscrits dans les identités, les langues, les pratiques et les récits autochtones. Les connaissances historiques et contemporaines sur le climat et l’environnement peuvent revêtir diverses formes qui pourraient ne pas être universellement comprises ou pertinentes sans une interprétation et une traduction adaptées à la culture. L’établissement de relations entre les communautés et les chercheurs, ainsi qu’entre la Couronne et les populations de colons, nécessite de rétablir la confiance et la collaboration. La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones : les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Honorer les droits inhérents des peuples autochtones signifie reconnaître les droits, les accords, les traités, les intérêts et les circonstances culturellement distincts et variés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Cette approche fondée sur les distinctions et le lieu demeure essentielle à la science et au savoir autochtones.
La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques et la Stratégie nationale inuite sur la recherche, le rapport annuel 2021 du Comité mixte sur l’action climatique des Premières Nations et du Canada et l’Évaluation des changements climatiques et de la vulnérabilité de la santé de la Nation métisse (en anglais seulement) soulignent tous la nécessité de renforcer la capacité locale pour relever les défis uniques des peuples, des gouvernements, des organisations et des nations autochtones. Les systèmes scientifiques et de savoir autochtones comprennent des responsabilités définies sur le plan culturel. Par exemple, le rôle et la relation uniques des femmes autochtones avec l’eau sont traditionnellement encodés dans des pratiques et des protocoles culturels, représentant une branche de savoir à laquelle on ne peut accéder que par des processus précis, définis par les communautés locales.
Encadré 3.2. Respecter les peuples autochtones en tant que spécialistes du climat
Les peuples autochtones ont un lien indéfectible et sacré avec la terre et l’eau. Les relations entre les peuples autochtones, la terre, l’eau, la glace, la vie animale et les habitats environnants constituent le fondement de la science et du savoir autochtones. En retour, cette science et ce savoir peuvent fournir un contexte, une interprétation et une vision approfondie. L’article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones affirme le droit des peuples autochtones à maintenir et à renforcer leurs relations spirituelles distinctives avec la terre et l’eau. La science et le savoir autochtones sont hautement intégratives et reflètent une compréhension que les humains font partie des écosystèmes et doivent rester en équilibre avec ces derniers. Les pratiques autochtones de gestion des terres sont intrinsèquement orientées vers les systèmes et ont une portée globale. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont bien placés pour être les gardiens et les intendants des paysages sensibles sur le plan écologique, en particulier ceux qui concernent leurs terres traditionnelles.
Plus récemment, il y a eu une évolution vers le soutien de la propriété communautaire autochtone et le contrôle des données, de l’information et des résultats de recherche recueillis par les communautés autochtones (p. ex. le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations et la Stratégie nationale inuite sur la recherche) (PDF). Les efforts déployés pour mélanger les meilleurs renseignements scientifiques autochtones et occidentaux disponibles ont permis d’établir des partenariats significatifs, à long terme et fondés sur le lieu. Dans de nombreuses nations autochtones, les programmes de recherche dirigés par des Autochtones ou élaborés en collaboration avec eux constituent la nouvelle norme minimum (p. ex. les principes du partenariat avec les Mi’kmaq (PDF) [en anglais seulement]). Dans l’Inuit Nunangat (la terre des Inuit au Canada), les partenariats avec les Inuit sont essentiels pour évaluer et gérer les répercussions des changements climatiques (voir le chapitre 5.4. Science des changements climatiques dans l’Arctique). Pour mettre en place l’infrastructure de données essentielle à la prise de décisions fondées sur des données probantes, les droits et les protocoles autochtones doivent être reconnus, et les données autochtones doivent être considérées comme étant indissociables des personnes et des méthodes utilisées pour recueillir ces données (voir le chapitre 6.1. L’infrastructure des données).
Le Comité de coordination de la recherche au Canada a donné la priorité au renforcement des capacités en recherche autochtone pour répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et pour contribuer à la réconciliation au Canada. Ces approches, bien qu’elles soient bénéfiques, ne sont pas encore spécifiques ni adaptées aux défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones, tels que la sécurité alimentaire et énergétique et l’accès à l’eau potable. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour créer un espace et une capacité de leadership autochtone au sein des organismes de financement, en renforçant le leadership et la participation autochtones à l’établissement de la portée, à l’examen et à la prise de décisions qui prennent en considération les liens avec la terre, l’eau et l’air. Un financement flexible et des programmes dirigés par des Autochtones qui évitent la concurrence entre les systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis, et au sein de ces systèmes, sont particulièrement importants.
Comme l’indique la quatrième priorité (Renforcer les mécanismes d’établissement de la portée et de financement afin d’établir des capacités de recherche scientifique autochtones), de nouveaux modèles de financement dirigés par des Autochtones sont nécessaires pour améliorer la portée et les mécanismes de financement disponibles pour les capacités en recherche scientifique autochtone. Cette capacité sera renforcée grâce à la création de nouveaux programmes, conseils ou centres de subvention culturellement appropriés et dirigés par des Autochtones. La coordination scientifique est un élément clé de ce rapport, et en ce sens, les voix scientifiques autochtones et occidentales au Canada pourraient être réunies. Entre autres avantages, la coordination offrirait aux chercheurs et aux détenteurs de savoir autochtones de meilleures possibilités de publier leurs travaux, ce qui permettrait de faire entendre la voix des peuples autochtones à d’autres scientifiques, chercheurs et communautés.
3.3 Tirer des leçons de la terre, de l’eau et de la glace et en assurer l’intendance
La terre, l’eau et la glace sont les éléments essentiels qui régissent les relations entre les personnes et les écosystèmes et dont les peuples autochtones tirent leurs responsabilités. Ces relations sont célébrées, encodées et apprises par l’intermédiaire des traditions et des cérémonies. Il ne s’agit pas d’un concept exclusivement canadien, puisque les peuples autochtones sont reconnus dans le monde entier comme des chefs de file en matière de conservation des paysages et de la biodiversité. La science autochtone consiste à comprendre à long terme les cycles écologiques et les processus environnementaux qui sont ancrés dans la connaissance intime de l’environnement et des activités traditionnelles et culturelles. Cette compréhension a servi de force de résilience dans les stratégies autochtones d’adaptation et d’atténuation, en permettant aux communautés autochtones de surveiller les changements dans l’environnement et d’intervenir face à ces changements (encadré 3.1).
Dans de nombreuses cultures autochtones, le concept d’intendance est un élément clé de la relation entre l’humain et l’environnement. Se considérer comme faisant partie intégrante de la terre permet d’acquérir une riche connaissance des écosystèmes et de la biodiversité. Grâce à des concepts autochtones tels que « bien vivre avec la terre », « toutes mes relations » et « relations de parenté » avec la terre, les océans, les cours d’eau et les animaux, la science autochtone peut favoriser une meilleure compréhension et guider les interactions humaines avec la terre, l’eau, la glace et le climat. La science autochtone peut également favoriser une vision stratégique à long terme pour la protection des ressources, qui soit inclusive, collaborative et qui favorise la réconciliation.
Encadré 3.3. Programmes autochtones de lutte contre les changements climatiques permettant la mise en commun de la science et du savoir
Ces programmes encouragent le leadership autochtone dans l’aménagement et le maintien d’écosystèmes résilients qui sont essentiels pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter, ainsi que pour revitaliser la culture.
- En 2017, le gouvernement du Canada a lancé le programme Gardiens autochtones, qui donne aux peuples autochtones la possibilité d’exercer des responsabilités dans l’intendance des terres, de l’eau et de la glace, ainsi que des droits et des responsabilités dans la protection et la conservation des écosystèmes, le développement et le maintien d’économies durables ainsi que le maintien des liens profonds entre les paysages naturels et les cultures autochtones.
- Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones aide les peuples autochtones du Canada à surveiller le climat et les répercussions des changements climatiques à l’aide de systèmes de savoir et de la science autochtones.
- Aux États-Unis, la Branch of Tribal Climate Resilience du Bureau of Indian Affairs dispose d’agents de liaison régionaux, qui servent de liens essentiels entre les communautés autochtones et les centres scientifiques d’adaptation au climat du département de l’Intérieur. Les neuf centres d’adaptation aux changements climatiques (Climate Change Adaptation Centers) sont représentatifs des régions et sont gérés par le National Climate Adaptation Science Center de l’US Geological Survey, qui vise à mettre au point des données scientifiques, des renseignements et des produits exploitables qui répondent aux besoins scientifiques définis et qui sont directement utilisables pour soutenir les décisions, les mesures et les plans de gestion des ressources. Ce réseau de centres scientifiques est chargé de créer un nouveau leadership scientifique en matière de changements climatiques par l’intermédiaire de divers programmes de recherche, de bourses et de formation.
- Au Canada, le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone soutient la santé des Premières Nations, des Inuit et des Métis en améliorant les pratiques de santé publique fondées sur des données probantes grâce à une approche holistique et axée sur les points forts.
Il importe d’adopter des approches selon lesquelles les priorités sont déterminées par les peuples autochtones et qui cadrent avec les capacités autochtones et les contextes communautaires. Ces approches permettent d’obtenir des résultats scientifiques plus fructueux et plus pertinents et intègrent une formation culturellement pertinente et une représentation autochtoneNote de bas de page 10. Ces résultats devraient, dans la mesure du possible, être atteints par les peuples autochtones, grâce à une inclusion continue et concrète des peuples autochtones dans les activités et les programmes de recherche scientifique occidentaux en tant que partenaires égaux, afin de favoriser la confiance et l’établissement de relations. Cette inclusion contribue également à renforcer les capacités de la science autochtone basée sur la communauté (voir la priorité 5 de ce chapitre). La combinaison de la science et le savoir autochtones avec des investissements stratégiques et un soutien à la coordination ou aux partenariats peut constituer un outil puissant pour les peuples autochtones, les gouvernements et les parties prenantes dans la lutte contre les changements climatiques. Parmi les exemples, notons l’Initiative d’innovation autochtone, un programme de financement basé sur des défis qui repose moins sur « l’aspect concurrentiel au profit d’un cadre plus général axé sur l’esprit de communauté, qui privilégie les relations et les valeurs communautaires aux triomphes individuels ». Cette vision permet d’élaborer de nouveaux modèles de financement répondant aux besoins des communautés et reposant sur des valeurs fondées sur la culture, le lieu et les distinctions. Les modèles doivent éviter les cloisonnements, être dirigés par des scientifiques autochtones et favoriser une approche à guichet unique, dans laquelle tous les programmes sont coordonnés et accessibles dans un seul système ou une seule application.
3.4 Lacunes en matière de connaissances et possibilités de mobilisation
Bien que les impacts et les risques posés par les changements climatiques varient selon les régions et les communautés, des lacunes communes en matière de connaissances sont apparues lors de la mobilisation entreprise pour orienter le présent rapport, lacunes qui doivent être comblées afin de renforcer le leadership et les capacités scientifiques autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Dans chaque domaine, les lacunes communes en matière de connaissances reflètent notre compréhension des répercussions directes des changements climatiques ainsi que de l’efficacité des politiques, programmes et règlements canadiens qui constituent notre réponse aux changements climatiques :
Systèmes et sécurité alimentaires – Comprendre la sécurité alimentaire dans les régions éloignées et rurales par la chasse, la culture, la récolte et l’accès aux ressources, et, dans les contextes urbains, les risques pour les chaînes d’approvisionnement, l’accès aux aliments et le stockage des denrées alimentaires.
Sécurité énergétique – Répercussions de la transition vers des solutions énergétiques carboneutres et renouvelables sur l’emploi et l’environnement; de la sécurité énergétique et des répercussions sur la sécurité alimentaire, la santé et le logement; des possibilités de solutions et d’infrastructures énergétiques au niveau communautaire; des stratégies de transition des systèmes énergétiques.
Infrastructure – Comprendre en quoi le manque ou la condition dégradée d’infrastructures, notamment en matière d’accès routier et de connectivité (plusieurs routes et connexions desservant les points d’origine et les destinations), dans les communautés autochtones rurales et éloignées, limite la capacité à répondre aux changements climatiques et à mettre en œuvre des mesures pour réduire les émissions de GES.
Infrastructures et services essentiels résilients et durables – Comprendre les risques et les possibilités au niveau communautaire pour créer des communautés résilientes et carboneutres.
Santé et bien-être – Comprendre les effets des changements climatiques sur l’accès aux soins médicaux (pour la santé physique et mentale); la résilience des systèmes de services de santé; les risques de maladies à transmission vectorielle et de prolifération d’espèces envahissantes; l’accès à l’eau douce; la sécurité et la sûreté alimentaires; les dangers physiques; les répercussions des changements climatiques en matière de recherche et de sauvetage.
Extrêmes climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes – Comprendre comment les changements climatiques touchent les moyens de subsistance et le bien-être grâce à des recherches axées sur les communautés et adaptées à la culture sur les phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les feux de forêt et les inondations, afin de réduire les risques de catastrophe, d’améliorer l’intervention et de planifier les évacuations.
Résilience des écosystèmes – Comprendre comment les écosystèmes sainsNote de bas de page 11 , le stockage et la conservation du carbone ainsi que la protection de la biodiversité peuvent constituer une voie vers la résilience climatique, et considérer la terre, l’eau, la neige et la glace comme des infrastructures naturelles essentielles pour les peuples autochtones.
3.5 Perspectives d’avenir
Pour faire progresser la science et le savoir en matière de changements climatiques d’une manière qui à la fois est utile pour les peuples autochtones et les intègre, il est essentiel de créer ou d’élargir suffisamment à long terme les mandats des centres de recherche et des programmes de financement pour qu’ils soient accessibles, souples, équitables et intégratifs. Les centres et les programmes doivent en outre être holistiques et réunir des domaines connexes tels que l’énergie, les infrastructures, l’alimentation, l’eau et la santé. Les autorités et centres de recherche régionaux ou locaux, ainsi que la création de données et l’accès à celles-ci, doivent respecter la souveraineté des données et le savoir autochtones tout en renforçant les capacités scientifiques autochtones. Ce soutien devrait permettre la reconnaissance réciproque de la science et des systèmes de savoir autochtones afin de créer des espaces informés plutôt que normatifs pour la mise en commun des connaissances entre les scientifiques autochtones et non autochtones.
Un système scientifique canadien renforcé en matière de changements climatiques devrait améliorer notre compréhension des populations et des écosystèmes naturels et gérés, guider notre relation avec la terre, les océans et les cours d’eau afin de renforcer la résilience des écosystèmes, et éclairer les efforts de protection de la biodiversité et des personnes. Les approches fondées sur l’autodétermination et le lieu devraient être mises en évidence et respectées lors de l’établissement des priorités de recherche. Des politiques d’élaboration conjointe précises, comme les principes de l’élaboration conjointe entre les Inuit et la Couronne de 2022 (en anglais seulement) et la Politique de l’Inuit Nunangat (en anglais seulement) approuvés par le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne, orientent ce travail. Le leadership dans les systèmes scientifiques et de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis est essentiel pour créer le changement novateur et transformateur nécessaire à l’avènement d’un Canada résilient et carboneutre.
Chapitre 4 Priorités thématiques
Résumé
Ce chapitre définit les priorités scientifiques en fonction de cinq thèmes qui contribuent à la réussite des mesures d’atténuation et d’adaptation. Les priorités reflètent l’ampleur des changements climatiques et l’urgence des mesures à prendre. L’adoption de mesures dans ces domaines permettra d’élaborer des mesures d’atténuation et d’adaptation coordonnées et complémentaires.
Des Canadiens en bonne santé et résilients
Pour combler les lacunes en matière des connaissances sur les changements climatiques et la santé, la collaboration est nécessaire à tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs importants pour la santé. Les gouvernements et les secteurs de la santé doivent examiner la façon dont la santé physique et mentale des Canadiens est touchée par la hausse des températures et les phénomènes extrêmes catastrophiques. Ils doivent aussi prendre en compte les effets indirects, notamment sur la sécurité alimentaire. Les systèmes de santé jouent un rôle essentiel dans la protection des Canadiens contre les changements climatiques et, tout comme les infrastructures bâties et les services essentiels, ils sont vulnérables aux phénomènes extrêmes. Il existe également des possibilités de réduire les émissions dans le secteur de la santé en vue d’atteindre la carboneutralité. Les priorités de recherche visent ce qui suit :
- comprendre les effets des changements climatiques sur la santé et les systèmes de santé afin de trouver des moyens d’adaptation réalisables;
- mener des recherches pour créer des systèmes de santé durables et à faibles émissions de carbone; et
- comprendre les politiques, les programmes, les mesures et les technologies permettant d’élaborer des systèmes de santé durables.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances visent ce qui suit :
- évaluer les derniers renseignements scientifiques sur les changements climatiques et la santé;
- échanger les connaissances sur l’adaptation de la santé au sein du secteur des services de santé; et
- changer les comportements en communiquant les risques sanitaires des changements climatiques et les possibilités d’adaptation.
Des communautés et un environnement bâti résilients et carboneutres
La plupart des bâtiments et des infrastructures du Canada (transport, alimentation et approvisionnement en eau, énergie, logement, sécurité, soins de santé, télécommunications) n’ont pas été conçus ou construits en tenant compte de l’évolution du climat. Pendant et après des phénomènes météorologiques extrêmes, les Canadiens peuvent perdre des voies de transport, l’approvisionnement en eau et d’autres services vitaux. Des recherches sont nécessaires pour :
- améliorer les produits de données, les prévisions et les projections relatives aux changements climatiques afin de soutenir la prise de décision, les investissements dans les infrastructures, et de réduire les risques liés aux phénomènes extrêmes;
- guider la cartographie multialéas, reflétant les interdépendances et les défaillances et risques potentiels en cascade des infrastructures;
- élargir l’utilisation d’une conception fondée sur le rendement pour la construction et l’exploitation;
- établir une optique fondée sur l’équité pour mieux orienter l’action climatique;
- orienter la transition vers des bâtiments, des transports et des systèmes d’infrastructure résilients et à faibles émissions de carbone; et
- comprendre comment utiliser des solutions fondées sur la nature dans l’environnement bâti.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances sont les suivantes :
- comprendre la gouvernance pour guider une coordination et une mise en œuvre efficaces de l’adaptation et de l’atténuation pour les infrastructures;
- traduire les résultats de la recherche pour les praticiens;
- encourager l’action climatique efficace par la compréhension des sciences du comportement et du contexte socioéconomique; et
- faire progresser les méthodes, les outils et les technologies pour évaluer la résilience des communautés et l’améliorer.
Des écosystèmes aquatiques et terrestres résilients
Les écosystèmes naturels sont soumis à de multiples pressions – dont les changements climatiques – qui se combinent pour influer sur leur résilience et leur intégrité. Ces pressions combinées peuvent mettre en péril la capacité de nombreux écosystèmes à se maintenir et à fournir une diversité de services, de valeurs et d’avantages, notamment pour la nature, la santé, l’économie et la société. La compréhension de l’éventail des réponses des différents écosystèmes face aux changements climatiques permettra d’orienter les actions visant à maintenir et à restaurer ces écosystèmes pour la biodiversité et les services écosystémiques. Les priorités de recherche comprennent ce qui suit :
- comprendre comment les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes affectent les écosystèmes et biodiversité;
- examiner l'efficacité et la permanence des solutions fondées sur la nature; et
- trouver des solutions d’adaptation qui favorisent la résilience des écosystèmes grâce à une science pluridisciplinaire.
La priorité en matière de mobilisation des connaissances implique :
- de produire des rapports réguliers sur l’état et les tendances de la biodiversité et des écosystèmes afin d’améliorer la gestion adaptative et la prise de décision fondée sur des données probantes.
Ressources naturelles durables
Les changements climatiques continuent d’avoir une incidence sur les secteurs de la foresterie, de l’agriculture, de la pêche, des minéraux et de l’énergie. Par conséquent, l’accent est mis de plus en plus sur le renforcement des capacités pour des réponses intégrées d’atténuation et d’adaptation. Les incidences sont ressenties différemment dans chaque secteur. Toutefois, il est essentiel de mener des recherches qui permettent d’élaborer des solutions intersectorielles et d’opérer des transitions au niveau du système vers la carboneutralité et la résilience. Ces recherches permettront aux secteurs des ressources naturelles d’explorer les possibilités et de développer des outils d’aide à la décision dans le domaine de la bioéconomie circulaire ainsi que les technologies et pratiques « intelligentes sur le plan climatique ».
Les priorités de la recherche sont les suivantes :
- comprendre les risques émergents et les vulnérabilités des secteurs des ressources naturelles du Canada;
- accélérer la contribution des secteurs des ressources naturelles à l’action climatique;
- soutenir la résilience des ressources par la création et le suivi d’indicateurs de résilience; et
- étudier les mesures d’atténuation et d’adaptation dans tous les secteurs grâce à des approches de recherche collaboratives et transdisciplinaires, y compris une plus grande inclusion des sciences sociales.
Les activités de mobilisation des connaissances comprennent :
- l’élaboration d’outils pertinents pour orienter la politique et la prise de décision fondées sur des données probantes; et
- l’intégration des sciences sociales et comportementales pour éclairer la prise de décision et la communication plus efficaces.
Éclairer les progrès vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles
Afin de mesurer les progrès accomplis vers la carboneutralité, il faut utiliser plusieurs méthodes pour estimer et déclarer les émissions et les éliminations dans l’atmosphère. Les priorités de recherche nous permettent d’utiliser de nouvelles données sur l’activité des sources ainsi que de nouvelles observations en surface et par satellite afin d’améliorer la précision et l’actualité des émissions déclarées. Des recherches sont nécessaires pour :
- mettre au point des systèmes intégrés de surveillance des GES atmosphériques et réconcilier les différentes méthodes d'estimation des émissions anthropiques de GES;
- améliorer la quantification des stocks de carbone des écosystèmes et des flux naturels de GES;
- mieux comprendre et surveiller comment l’utilisation des terres et les changements d’affectation des terres et les pratiques de gestion influencent les flux de carbone et les progrès vers la carboneutralité; et
- examiner les compromis et les impacts sociétaux des politiques impliquant des réductions d’émissions des GES de l’atmosphère et des technologies d’élimination du dioxyde de carbone.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances visent à :
- harmoniser les données, les renseignements et les connaissances sur les émissions accessibles au public; et
- comparer et améliorer les modèles d’écosystèmes afin de comprendre les flux naturels de carbone et la manière dont l’homme entraine des changements dans le stockage du carbone terrestre.
Le rapport Science du climat 2050 : Faire progresser la science et le savoir sur les changements climatiques (SC2050), publié en décembre 2020, a déterminé quatre résultats en matière de science et de connaissances – et un cinquième domaine de recherche fondamentale – qui contribuent au succès des mesures d’atténuation et d’adaptation. Ce chapitre présente les priorités scientifiques pour ces cinq thèmes. Les priorités doivent se déployer en parallèle dans l’ensemble des thèmes, en continuant à orienter la lutte contre les changements climatiques en cours dans tous les secteurs et toutes les communautés et en reflétant l’ampleur des changements climatiques et l’urgence des mesures requises.
Les priorités en matière de recherche, de synthèse et de mobilisation des connaissances sont aussi importantes. La recherche continue apporte des connaissances et cerne des possibilités d’action, tandis que la synthèse et la mobilisation des connaissances aident à traduire les investissements de la recherche en mesures concrètes.
À titre d’exemple, les priorités de ce chapitre préconisent des informations plus fréquentes, plus précises et à plus haute résolution concernant les conditions météorologiques, le climat et les flux de GES. De tels renseignements sont utiles pour l’adaptation aux changements climatiques, l’évaluation des risques, la communication sur les changements climatiques et la connaissance du climat.
Pour toutes les priorités impliquant des données, des ensembles de données en libre accès qui respectent les principes FAIR (facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable) augmenteraient la capacité à définir, à prédire, à surveiller et à évaluer les changements climatiques et ses répercussions. De tels ensembles de données sont nécessaires pour comprendre les facteurs, élaborer des indicateurs et évaluer l’efficacité des mesures de gestion dans le cadre d’une série de scénarios futurs.
Toutes les recherches sur les changements climatiques doivent soutenir et créer un espace pour les peuples et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les chercheurs doivent apprendre des peuples et des communautés autochtones et travailler en partenariat avec eux. Comme indiqué au chapitre 3, les connaissances locales et les systèmes scientifiques et de connaissances des Premières Nations, des Inuits et des Métis doivent faire partie intégrante de la recherche. La recherche doit en outre tenir compte des effets des changements climatiques sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis et leurs pratiques traditionnelles distinctes et variées. Certains peuples et communautés autochtones peuvent être plus gravement touchés par les changements climatiques et se heurter à des obstacles plus importants en matière d’adaptation. Indépendamment des répercussions des changements climatiques, les peuples et communautés autochtones doivent contribuer au suivi des indicateurs ainsi qu’à la définition et à l’évaluation de la résilience de leurs communautés, de manière adaptée à leur culture.
4.1 Des Canadiens en bonne santé et résilients
Les risques des changements climatiques pour la santé humaine continuent d’augmenter. Ces risques ont notamment des répercussions sur la santé physique et mentale des Canadiens, sur les systèmes de santé du pays et sur les personnes vulnérables et touchées de manière disproportionnée. La santé humaine ne peut être protégée des effets des changements climatiques sans une connaissance approfondie des risques pour les Canadiens et leurs systèmes de santé, des coûts économiques des effets sur la santé et des mesures d’adaptation efficaces. Il s’agit notamment de nouvelles approches de la communication sur les changements climatiques qui favorisent les changements de comportement. Le rapport de l’administratrice en chef de la santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada en 2022 a mis l’accent sur la mobilisation de la santé publique contre les changements climatiques par le biais des fonctions de santé publique actuelles (p. ex. la planification d’urgence). La recherche dirigée par des Autochtones met en évidence l’interaction entre les effets des risques climatiques sur la santé et les facteurs sous-jacents de vulnérabilité (p. ex. le racisme, la colonisation actuelle et passée, les déterminants sociaux de la santé). Cette recherche met également en évidence des approches culturellement significatives pour protéger la santé (voir l’encadré 4.1 Les changements climatiques posent de graves risques pour les Métis). Toutefois, les lacunes en matière de connaissances continuent d’entraver les efforts d’adaptation de la santé. Les lacunes en matière de connaissances limitent également les efforts visant à concevoir et à mettre en œuvre la transition vers la carboneutralité de manière à soutenir les moyens de subsistance, à obtenir des avantages pour la santé et à élaborer la mise en place de systèmes de santé durables sur le plan environnemental.
Encadré 4.1. Les changements climatiques posent de graves risques pour les Métis
Les citoyens de la Nation métisse vivant dans l’Ouest du Canada sont particulièrement sensibles aux effets des changements climatiques, car ils dépendent de la terre pour leur identité, leur culture, leurs moyens de subsistance et l’économie de leurs ressources. Au fil des générations, les Métis ont trouvé des moyens novateurs de vivre dans leur environnement malgré un accès réduit à la terre et à l’eau. Cette résilience au changement, acquise au fil des générations, et les connaissances environnementales des Métis peuvent favoriser des solutions d’adaptation pour les populations autochtones et non autochtones. En 2020, le Ralliement national des Métis a publié son Rapport d’évaluation de la vulnérabilité en matière de changements climatiques et de santé des Métis (en anglais seulement) afin d’explorer les risques et les lacunes actuelles de la Nation métisse et de déterminer les mesures de soutien nécessaires pour tracer la voie à suivre en matière de résilience aux changements climatiques.
Pour répondre aux priorités scientifiques (ci-dessous), il faut s’engager dans des approches multisectorielles, transdisciplinaires et « systémiques ». Ces approches comprennent « la santé dans toutes les politiques » et « Une seule santé ». La « santé dans toutes les politiques » implique une collaboration, horizontale et verticale, entre tous les niveaux de gouvernement et entre les secteurs importants pour la santé (p. ex. l’énergie, le transport, la foresterie, la pêche, l’agriculture, l’eau, l’urbanisme, la conservation). Dans cette approche, les personnes concernées reconnaissent et exercent leur rôle en influençant les déterminants de la santé et les moteurs des résultats sanitaires. L’approche « Une seule santé » reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est interdépendante (voir le chapitre 5.5 Science du lien entre l’approche « Une seule santé » et les changements climatiques).
Les priorités de recherche suivantes soutiennent les efforts visant à protéger la santé et la résilience des Canadiens et à préparer les systèmes de santé pour un climat changeant.
R1 (CBSR). Comprendre les effets des changements climatiques sur la santé et les systèmes de santé, afin de promouvoir des mesures d’adaptation efficaces, équitables et réalisables dans le domaine de la santé. Desrecherches sont nécessaires pour comprendre les répercussions actuelles et les risques sanitaires prévus pour les Canadiens liés aux changements climatiques. Il s’agit notamment des risques affectant la qualité de l’air, la sécurité et la sûreté alimentaires (voir l’encadré 4.2 La sécurité alimentaire dans un climat futur incertain), ainsi que les maladies infectieuses ou chroniques, la santé mentale, la qualité et la sécurité de l’eau, et les risques naturels (voir l’encadré 4.3 Réduire les risques pour la santé des Canadiens liés à des phénomènes météorologiques graves). Un grand nombre de ces impacts menacent les moyens de subsistance et les traditions de chasse et de pêche, et risquent d’entraîner le déplacement des Premières nations, des Inuits et des Métis. La recherche est également nécessaire pour savoir la manière dont les facteurs sociaux et environnementaux sous-jacents, tels que les faibles revenus ou le statut socioéconomique, les logements inadéquats, le racisme et la colonisation, peuvent accroître ces risques.
Des méthodes, des outils et des indicateurs nouveaux et innovants sont nécessaires pour comprendre, mesurer et modéliser les risques sanitaires, les facteurs de stress climatiques et les vulnérabilités (p. ex. la surveillance de la chaleur à l'intérieur des bâtiments, en utilisant des applications d’intelligence artificielle et des outils moléculaires pour le suivi des agents pathogènes sensibles au climat et de la résistance aux antimicrobiens dans les aliments, le sol, l'eau, les animaux et les plantes). Il s’agit notamment de surveiller l’état de résilience des systèmes de santé. Il convient également d’analyser les coûts des répercussions et des risques des changements climatiques sur la santé des personnes vivant au Canada, sur les systèmes de santé et sur l’économie.
Encadré 4.2. La sécurité alimentaire dans un climat futur incertain
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Les changements climatiques ont déjà une incidence sur les systèmes alimentaires canadiens et contribuent à l’insécurité alimentaire. Par exemple, le Rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens 2022 a révélé que les changements climatiques ont contribué à l’augmentation des prix des denrées alimentaires. La mondialisation croissante a créé un système alimentaire mondial auquel le Canada participe en exportant et en important des produits alimentaires crus et préparés. Ainsi, les facteurs qui perturbent les systèmes alimentaires mondiaux, comme les effets aigus et chroniques des changements climatiques et l’instabilité politique, peuvent également avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire et perturber les systèmes alimentaires au Canada. Le chapitre 8 du rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement (publié en 2022) présente les données probantes existantes sur les impacts des changements climatiques pour la santé du point de vue de la salubrité et de la sécurité des aliments.
Encadré 4.3. Réduire les risques pour la santé des Canadiens liés à des phénomènes météorologiques graves
Le Canada connaît de plus en plus de phénomènes et de risques météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, inondations et incendies de forêt, par exemple), qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur la santé humaine. Par exemple, l’épisode de chaleur sans précédent qui a touché la Colombie-Britannique en juin 2021 a provoqué 619 décès et des incendies de forêt désastreux dans un certain nombre de communautés. Les changements climatiques augmentent également le risque de phénomènes cumulés ou en cascade qui peuvent dépasser la capacité de réaction des services sociaux et de santé. Cela peut avoir une incidence sur la disponibilité ou la qualité des soins. Ce problème peut être particulièrement aigu lorsque ces phénomènes surviennent en même temps que d’autres chocs et facteurs de stress pour la société.
Le chapitre 3 du rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement (publié en 2022) analyse les données probantes sur les effets des changements climatiques sur les aléas naturels et leurs impacts sur la santé mentale, sociale et physique des Canadiens et les lacunes dans les connaissances.
Des mesures efficaces, équitables et réalisables d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ses effets sur la santé doivent être élaborées afin d’accroître la résilience climatique des Canadiens et de leurs systèmes de santé. Des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les avantages connexes et les risques éventuels de ces mesures sur la santé humaine, ainsi que pour analyser leurs coûts économiques et leur efficacité. Cette recherche doit analyser les moyens d’éviter la « maladaptation », c’est-à-dire une action d’adaptation qui ne parvient pas à réduire les risques, mais l’accroît au contraire. Pour ce faire, il faut mieux comprendre l'impact des mesures d'adaptation et d'atténuation, prises à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de la santé, sur la santé humaine. Il serait ainsi possible de savoir comment réduire au minimum les risques et les inégalités en matière de santé au niveau régional et à différentes échelles de temps. Des recherches sont également nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes de gouvernance, la capacité institutionnelle et réglementaire, les approches de leadership et les possibilités de mise en réseau et de collaboration en vue de réduire les risques sanitaires liés aux changements climatiques.
Il est essentiel d’évaluer la capacité du système de santé à s’adapter aux risques liés au climat afin d’éviter l’interruption des services et les conséquences graves pour les patients et le personnel lors des risques climatiques, tel que les phénomènes extrêmes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les répercussions et les risques liées au climat et sur les vulnérabilités et les coûts pour les systèmes et les installations de santé face aux dangers immédiats (p. ex. les inondations) ou aux contraintes à plus long terme (p. ex. les sécheresses, les maladies infectieuses, les perturbations dues aux tempêtes pour les transports et les services essentiels). Il s’agit notamment des incidences sur les politiques, les programmes, les services, les infrastructures, les ressources humaines et les chaînes d’approvisionnement en matière de santé (médicaments, matériel médical, etc.), en particulier sur les systèmes de santé des régions rurales, éloignées et nordiques et sur ceux qui servent les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ces systèmes de santé sont souvent plus vulnérables et présentent des écarts entre les Premières Nations, les Inuits et les Métis d’une part, et les Canadiens non autochtones d’autre part.
R2 (CBSR). Mener des recherches pour soutenir la transition vers un système de santé durable et à faibles émissions de carbone. Les systèmes et services de santé jouent un rôle essentiel dans la protection des Canadiens contre les effets actuels et les risques futurs des changements climatiques. Ils offrent également la possibilité de réduire les gaz à effet de serre dans ce secteur, car ils représentent environ 5 % des émissions nationales annuelles du Canada. Les systèmes de santé durables, résilients aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone, offrent un triple avantage: une meilleure santé et une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des coûts des opérations et des services, et une réduction substantielle des GES. Le gouvernement du Canada a exprimé son soutien au programme de santé de la COP26 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en s’engageant à mettre en place des systèmes de santé durables, à faibles émissions de carbone et résistants aux changements climatiques.
La recherche est nécessaire pour soutenir le développement de systèmes de santé à faibles émissions de carbone. Des renseignements et des méthodes sont nécessaires pour mesurer et surveiller plus précisément les émissions de GES provenant des activités du secteur de la santé. Il s’agit des émissions directes provenant des activités des établissements de santé (p. ex. les chaudières sur site et les gaz médicaux) et des émissions indirectes produites par l’achat d’électricité et la chaîne d’approvisionnement.
R3 (CBSR). Améliorer la compréhension des politiques, des programmes, des mesures et des nouvelles technologies dont disposent les autorités sanitaires et leurs partenaires pour l’élaboration de systèmes de santé durables et à faibles émissions de carbone. Des méthodes sont nécessaires pour mesurer d’autres facteurs non climatiques ayant également une incidence sur les émissions des systèmes de santé, tels que l’évolution de la population, la demande et l’utilisation des soins de santé et l’élaboration de nouvelles technologies. La recherche peut contribuer à l’élaboration des pratiques exemplaires et de nouvelles technologies rentables pour gérer l’empreinte carbone du secteur de la santé, par exemple en modernisant les établissements de soins existants, en réutilisant les fournitures médicales, en recourant à des technologies de soins médicaux à distance et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des transports dans les chaînes d’approvisionnement. En outre, il est nécessaire d’évaluer les pratiques d’achat actuelles dans le système de santé canadien et les mécanismes financiers innovants, tels que les fonds renouvelables verts et les obligations vertes. Enfin, il convient de comprendre comment les mesures qui soutiennent la résilience climatique, l’adaptation et la réduction des GES peuvent réduire les coûts des actions climatiques pour le secteur des services de santé.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances sont les suivantes :
MC1 (CBSR). Réaliser régulièrement des évaluations des changements climatiques et de la santé à l’échelle nationale, régionale et locale. Les évaluations doivent résumer les plus récents renseignements sur les répercussions sur la santé humaine, les systèmes de santé et l’équité en matière de santé, les variations des vulnérabilités et des risques pour la santé, ainsi que les possibilités d’adaptation et de mise en place de systèmes de santé à faibles émissions de carbone et durables sur le plan environnemental.
MC2 (CBSR). Élaborer des stratégies et des approches innovantes pour la mise en commun de connaissances entre les professionnels de la santé, les praticiens et les administrateurs. Ces stratégies et approches devraient inclure du matériel et des outils d’éducation et de formation adaptés aux partenaires concernés, afin de répondre aux besoins d’adaptation à la santé de divers publics.
MC3 (CBSR). Faire évoluer les comportements des décideurs, des intervenants et du public en améliorant les stratégies de communication sur les risques sanitaires des changements climatiques, les possibilités d’adaptation et les avantages pour la santé d’une action proactive. Cette priorité comprend l’application de connaissances issues des sciences du comportement, de récits et d’approches participatives, y compris de voix diverses. Il s'agit notamment d'apprendre des Premières nations, des Inuits et des Métis, ainsi que d'autres communautés et personnes susceptibles d'être plus gravement touchées par les changements climatiques et confrontées à des obstacles plus importants en matière d'adaptation, puis d'établir des partenariats avec eux.
4.2 Des communautés et environnement bâti résilients et carboneutres
La plupart des communautés canadiennes n’ont pas été conçues et construites en tenant compte de l’évolution du climat. Par conséquent, les systèmes d’infrastructure sur lesquels nous comptons pour satisfaire nos besoins fondamentaux – comme l’approvisionnement en nourriture et en eau, l’énergie, le logement, la sécurité et l’accès aux soins de santé – sont de plus en plus vulnérables aux extrêmes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes. À mesure que les aléas comme les fortes précipitations, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les inondations deviennent plus extrêmes, ces systèmes sont confrontés à des risques accrus d’aléas composés et de défaillances en cascade. Le secteur des infrastructures contribue également aux changements climatiques, les transports et les bâtiments représentant les deuxième et troisième secteurs les plus émetteurs au Canada. Les actifs à long terme, les infrastructures et les bâtiments construits ou modernisés aujourd’hui doivent avoir une durée de vie de plusieurs décennies. Une conception et une planification soignées de notre environnement bâti qui permettent d’éviter les émissions et de contribuer à l’absorption du carbone (par l’utilisation, par exemple, de produits novateurs de captage du carbone, de bioproduits, et de solutions d’infrastructure fondées sur la nature).
Encadré 4.4. L’intersection de l’adaptation et de l’atténuation dans l’environnement bâti
Les mesures visant à s’adapter aux changements climatiques et à réduire les émissions de GES sont inextricablement liées et doivent être envisagées ensemble afin de maximiser les avantages accessoires. Voici des exemples de ces liens :
- Rendement environnemental tout au long du cycle de vie : Une résilience climatique accrue peut réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie grâce à une durée de vie plus longue et à des besoins de maintenance moindres.
- Solutions d’infrastructures fondées sur la nature: Puits de carbone naturels peut compléter ou remplacer les infrastructures conventionnelles à forte teneur en carbone afin d’atténuer les effets des inondations, de réduire les îlots de chaleur urbains et de diminuer les charges énergétiques liées au refroidissement des bâtiments.
- Solutions résilientes à faibles émissions de carbone et carboneutres : Dans la rénovation et l’entretien des bâtiments et des systèmes de transport, l’intégration de la résilience aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes peut accroître la résilience globale de la communauté, réduire les émissions et obtenir des résultats en matière de santé publique.
Pour s’adapter aux changements climatiques, il faut repenser de manière significative et profonde l’endroit et la manière dont nos communautés sont planifiées, construites et entretenues, depuis leur conception globale jusqu’aux maisons individuelles. Il est nécessaire de comprendre où les mesures d’adaptation et d’atténuation auront le plus d’impact, et où les objectifs de résilience et d’atténuation se renforcent mutuellement ou bien où il y a des objectifs divergents (voir l’encadré 4.4 L’intersection de l’adaptation et de l’atténuation dans l’environnement bâti). Les vulnérabilités et les risques ne sont pas répartis uniformément entre les régions ou les groupes sociaux, culturels et économiques. Il faut en tenir compte dans la détermination des priorités et des solutions.
Les priorités de recherche pour l’environnement bâti couvrent les besoins en renseignements de tous les ordres de gouvernement et des secteurs économiques qui doivent intégrer l’adaptation et les considérations relatives aux émissions de GES faibles ou nulles dans la prise de décision concernant la sécurité publique, les infrastructures et services essentiels, les moyens de subsistance et l’habitabilité de nos communautés.
R1 (CEBRC). Produire des données, des prévisions et des projections climatiques afin d’éclairer l’évaluation des risques, l’adaptation et les mesures visant à réduire les émissions de GES pour l’environnement bâti. Des observations, des prévisions et des projections climatiques à des échelles spatiales et temporelles pertinentes sont nécessaires, de même qu’une meilleure compréhension des incidences des changements climatiques sur l’environnement bâti. Ces renseignements sont essentiels pour passer à des bâtiments, des transports, de l’énergie et des systèmes d’infrastructure (p. ex. le logement, les transports en commun, l’énergie, l’eau potable, les télécommunications) carboneutres ou à faibles émissions de carbone. Les données doivent permettre d’estimer les émissions et de caractériser les aléas telles que les précipitations extrêmes, les vagues de chaleur et les vagues de froid, les incendies de forêt et la fumée, les tempêtes de poussière, l’accumulation de glace, les vents extrêmes, les hautes vagues lacustres et océaniques, les ondes de tempête, les inondations, ainsi que les perturbations plus lentes, comme l’élévation du niveau de la mer, les changements importants dans les cycles de sécheresse, la fonte du pergélisol et l’amincissement des glaces des rivières, des lacs et des océans.
R2 (CEBRC). Créer des cartes d’aléas multiples pour cerner et hiérarchiser les zones à haut risque, gérer les interdépendances et traiter les risques en cascade pour les systèmes d’infrastructure. Des progrès sont nécessaires pour permettre une cartographie géospatiale à plusieurs couches qui intègre les risques climatiques multiples et composés et fournit des renseignements pertinents aux décideurs, tels que :
- les détails du système d’infrastructure (localisation, administration, type, âge, état);
- les systèmes critiques (soins de santé, stations d’épuration, interventions d’urgence, électricité, communications, ponts, voies d’évacuation, services de sécurité, refuges communautaires et centrales de chauffage urbain);
- les infrastructures sociales (bâtiments gouvernementaux, écoles, universités, églises, bâtiments patrimoniaux et bibliothèques);
- les systèmes naturels (qualité de l’air, parcs, eau, sols, minéraux, charge combustible des incendies de forêt, insectes forestiers et agents pathogènes);
- les vulnérabilités de la population (p. ex. les personnes âgées, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques, les groupes socialement défavorisés); et
- les risques (p. ex. inondations, sécheresses, incendies de forêt, vagues de chaleur).
Cette recherche doit relever les défis actuels de l’intégration des couches cartographiques, ce qui permettrait de combiner les données et de comprendre leurs relations de manière novatrice. Ces défis sont notamment les suivants :
- l’indisponibilité ou le manque d’homogénéité des structures de données qui limitent l’utilisation simultanée à des échelles spatiales et temporelles communes;
- l’incertitude dans les projections climatiques, y compris celle due aux différents scénarios d’émissions mondiales; et
- l’intégration des données en temps réel ou quasi réel.
Ce travail doit également inclure des outils de cartographie intégrés permettant l’identification, l’évaluation et le classement des risques, des interdépendances entre les systèmes et des défaillances potentielles en cascade (p. ex. des inondations ayant une incidence sur la distribution d’énergie, l’approvisionnement alimentaire et les télécommunications).
R3 (CEBRC). Élargir l’utilisation de conception basée sur le rendement pour trouver des solutions innovantes en matière de construction et d’exploitation. Des recherches sont nécessaires pour passer d’une conception « prescriptive » à une conception « basée sur le rendement », une approche de conception axée sur les objectifs qui tient compte de critères liés à la performance du bâtiment ou de l’infrastructure, tels que la consommation d’énergie, le coût d’exploitation et le confort des occupants, entre autres. Les normes et codes nationaux fondés sur le rendement favoriseront l’innovation et la flexibilité dans la manière dont les réglementations sont respectées. Ils faciliteront en fin de compte la réalisation d’objectifs de rendement à faibles émissions de carbone et de résilience. La recherche devrait permettre de cerner des moyens d’évaluer le rendement des matériaux et des systèmes, et fixer des niveaux de rendement acceptables (p. ex. pour les émissions de carbone pendant le cycle de vie de l’ensemble de l’actif, la durabilité des matériaux, le confort des bâtiments, la résistance aux incendies de forêt, l’accessibilité). Des exigences de conception claires et fondées sur le rendement permettent d’uniformiser les règles du jeu pour toute une série de technologies, notamment les bioproduits et les solutions fondées sur la nature.
R4 (CEBRC). Élaborer et appliquer une approche fondée sur l’équité afin de mieux orienter les mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des émissions de GES. Des recherches sont nécessaires pour élaborer des ensembles de données socioéconomiques et géographiques (ou basés sur le lieu) et des mesures permettant de caractériser les différentes dimensions de la vulnérabilité. Ces renseignements peuvent être utilisés pour la conception et la gestion d’infrastructures et d’environnements bâtis carboneutres dans les communautés vulnérables. Les lacunes en matière de connaissances comprennent la compréhension des effets cumulatifs des changements climatiques, la manière dont ils interagissent avec les vulnérabilités existantes (p. ex. la pauvreté, ainsi que le manque d’eau potable, de transports en commun, de logement ou d’énergie) et la manière dont ils peuvent amplifier les inégalités systémiques ou sociétales et avoir une incidence sur les expériences vécues.
R5 (CEBRC). Orienter la transition vers des bâtiments, des transports et des systèmes d’infrastructure à faibles émissions de carbone. La recherche est nécessaire pour élaborer des méthodes, des technologies, des pratiques exemplaires et des conseils pour soutenir la transition vers des environnements bâtis à faibles émissions de carbone et une économie circulaire zéro déchet (voir l’encadré 4.7. Approches intersectorielles et transdisciplinaires pour l’économie circulaire). Cette recherche doit nous aider à passer des approches conventionnelles de planification et de conception prescriptives à des approches basées sur le cycle de vie, qui cernent les possibilités et les risques tout au long du cycle de vie, depuis les matières premières jusqu’à l’élimination. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour faire progresser l’évaluation du coût du cycle de vie et de l’environnement, de systèmes de chaîne d’approvisionnement à faibles émissions de carbone et de méthodes de construction rapides et peu coûteuses. Les solutions techniques pour les matériaux et les systèmes de construction devront également être mises en place et démontrées, et les risques connexes devront être atténués.
R6 (CEBRC). Améliorer la compréhension des solutions fondées sur la nature dans l’environnement bâti. Des études régionales, des projets pilotes, des modélisations et une surveillance à long terme du rendement des solutions fondées sur la nature sont nécessaires. Cette recherche déterminera où les solutions fondées sur la nature, seules ou en combinaison avec des solutions conventionnelles d’origine humaine, peuvent aider à gérer les risques associés aux changements climatiques, aux phénomènes extrêmes et aux aléas naturels associés. Ces risques comprennent les inondations urbaines, fluviales et côtières, les îlots de chaleur urbains, l’érosion et le dégel du pergélisol. La recherche peut montrer comment les solutions fondées sur la nature peuvent contribuer à l’absorption du carbone (p. ex. en retenant le carbone du sol dans les paysages naturels et aménagés). Des recherches sont également nécessaires pour déterminer les conditions des régions ou des sites qui ont une incidence sur la viabilité des solutions fondées sur la nature. Ces recherches peuvent contribuer à l’évaluation de la valeur (y compris la valeur économique) des écosystèmes et des solutions fondées sur la nature dans l’environnement bâti, y compris les contributions à la séquestration du carbone, à la réduction des risques (pertes évitées), aux services écosystémiques et à d’autres avantages accessoires (esthétique, culturel, santé et bien‑être, valeur récréative). Cette priorité est étroitement liée aux priorités scientifiques pour le cycle du carbone (voir chapitre 4.3. Des écosystèmes aquatiques et terrestres résilients).
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances sont les suivantes :
MC1 (CEBRC). Élaborer des lignes directrices pour une gouvernance, une coordination et une mise en œuvre efficaces de mesures d’adaptation et d’atténuation à différents échelons de gouvernement et à différentes phases du cycle de vie des infrastructures. La gouvernance est à la fois un catalyseur et un défi pour la mise en œuvre de mesures efficaces visant à réduire les émissions de GES et améliorer la résilience des communautés et des environnements bâtis qui leur sont associés. Une coordination et une mise en œuvre efficaces impliquent de comprendre le réseau complexe de relations, d’administrations et d’acteurs clés afin d’orienter une gouvernance efficace de l’adaptation et de l’atténuation. La recherche et l’orientation pour une action climatique efficace dans nos communautés et environnements bâtis sont nécessaires à différentes phases du cycle de vie des infrastructures, telles que la préplanification, la planification, le suivi du projet, l’évaluation et l’apprentissage.
MC2 (CEBRC). Traduire les résultats de la recherche en lignes directrices, protocoles et outils pour les praticiens afin de les aider à créer des environnements bâtis résilients et à faibles émissions de carbone. Pour faire passer la capacité et la sensibilisation scientifiques au niveau communautaire, les résultats doivent être traduits en guides, politiques et renseignements accessibles, pertinents au niveau local et faciles à utiliser, afin d’éclairer la prise de décision. Les outils, les normes, les orientations, les données et les autres produits de synthèse des connaissances doivent être ciblés et fortement alignés sur les utilisateurs visés. Les outils élaborés et les renseignements qu’ils fournissent doivent être utilisés pour éclairer la prise de décision. En particulier, ils doivent inclure une analyse des risques afin de donner la priorité aux environnements bâtis les plus menacés, ce qui permet de maximiser la valeur de l’action climatique.
MC3 (CEBRC). Tirer parti de la science du comportement et de la compréhension des contextes socioéconomiques pour inciter l’action climatique dans les secteurs des bâtiments, des transports et des infrastructures. Pour faciliter l’adoption des technologies et des politiques, il convient d’utiliser des stratégies efficaces fondées sur des données probantes qui tiennent compte des sciences du comportement et des facteurs socioéconomiques. Une analyse des voies de changement réglementaires, culturelles, sociales et économiques (y compris les codes, les normes et les outils d’évaluation) est nécessaire pour évaluer et déterminer les méthodes les plus efficaces pour atteindre les objectifs de rendement. Toutefois, une série de méthodes sera nécessaire pour répondre à une variété d’avantages souhaités, en fonction du contexte et des objectifs.
MC4 (CEBRC). Faire progresser les méthodes, les outils et les technologies permettant d’évaluer et d’améliorer la résilience des communautés, notamment les investissements dans la lutte contre les changements climatiques. Des progrès considérables sont nécessaires en matière de méthodes, d’outils et de technologies pour évaluer et accroître la résilience des communautés face au climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Des méthodes innovantes sont nécessaires pour évaluer rapidement et de manière fiable la capacité des bâtiments, des infrastructures, des systèmes énergétiques et des systèmes de transport existants à résister aux risques climatiques, et pour déterminer les besoins et les délais d’entretien et de modernisation. La prise de décision doit servir de base à une planification stratégique proactive et à des investissements, qui peuvent inclure la relocalisation et le démantèlement. La planification stratégique doit éviter de continuer à investir dans des zones à haut risque où la résilience climatique n’est plus possible.
4.3 Des écosystèmes aquatiques et terrestres résilients
Encadré 4.5. Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique appelle à la coopération scientifique pour réduire au minimum les menaces qui pèsent sur la biodiversité. La réunion de décembre 2022 de la COP15 à Montréal s’est achevée par l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal (en anglais), qui définit quatre objectifs et 23 cibles à atteindre d’ici 2030, y compris des mesures urgentes pour conserver la biodiversité dans un climat en changement et répondre aux besoins des populations par l’utilisation durable et le partage des avantages. Les objectifs 8 et 11 soulignent en particulier l’importance des solutions fondées sur la nature et des approches fondées sur les écosystèmes pour réaliser ces mesures. Ces objectifs reflètent d’autres accords internationaux dans lesquels les parties, y compris le Canada, soulignent le rôle des solutions fondées sur la nature dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci. Ces accords sont notamment le Plan de mise en œuvre de la CCNUCC à Charm el-Cheikh 2022 (COP27; en anglais seulement) et la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP14).
Des écosystèmes sains et biologiquement diversifiés sont plus résistants aux effets néfastes des changements climatiques et jouent un rôle essentiel dans la capacité du Canada à atténuer les émissions de GES et à s’adapter aux changements climatiques. Les écosystèmes résilients peuvent permettre de refroidir les villes, de séquestrer le carbone, de contrôler les maladies, de fournir de la nourriture et des matériaux aux personnes et aux communautés, d’amoindrir l’intensité des inondations et des sécheresses, et de contribuer à l’économie ainsi qu’à la santé et au bien-être des Canadiens (voir l’encadré 4.5. Convention des Nations Unies sur la diversité biologique).
Les écosystèmes résilients aux changements climatiques ne sont pas statiques. Ils évoluent et s’adaptent aux changements climatiques et continuent à fournir une diversité de services et de valeurs multiples aux humains et à la nature. Certaines de ces valeurs écosystémiques ne sont pas liées au climat, mais sont menacées par les changements climatiques, comme les valeurs intrinsèques et relationnelles (p. ex. les valeurs culturelles, spirituelles et sociétales). La prise en compte de ces valeurs multiples de la nature, parallèlement aux changements climatiques, peut contribuer à l’assimilation et la pertinence de la science des écosystèmes pour un large éventail de priorités canadiennes.
La science interdisciplinaire (dans laquelle deux disciplines ou plus se réunissent pour définir le problème de recherche et pour concevoir et exécuter le projet de recherche) est essentielle pour comprendre comment les facteurs de stress non climatiques interagissent avec les effets des changements climatiques. Les facteurs de stress non climatiques comprennent des problèmes comme les espèces exotiques introduites, la pollution, les contaminants, la perte d’habitat, la dégradation de l’habitat, les changements d’affectation des terres, de l’eau douce et des océans, ainsi que la variabilité naturelle. Ceux-ci peuvent interagir avec les effets du climat tels que l’acidification des océans, l’hypoxie, la sécheresse, la désertification et les changements dans la répartition et la productivité des espèces. Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne l’importance de l’utilisation d’informations scientifiques interdisciplinaires, du savoir autochtone, de connaissances locales et d’expertises pratiques pour cerner des solutions de gestion et d’adaptation des écosystèmes, comme la préservation, la protection, la création et la restauration. Des recherches sont nécessaires pour comprendre les défis écologiques, sociaux et économiques complexes et interdépendants associés aux changements climatiques, afin d’élaborer et d’appliquer une approche axée sur les solutions pour accroître le potentiel des avantages accessoires pour la biodiversité et les écosystèmes.
Pour comprendre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes, il faut relier les données sur la biodiversité et le climat à des données temporelles et spatiales pertinentes pour la prise de décision. Le Canada peut utiliser ces connaissances pour prendre des mesures qui permettront de maintenir et de restaurer les écosystèmes et les services écosystémiques, de mieux protéger la biodiversité et d’en faire profiter la santé humaine, l’environnement, l’économie et la société dans son ensemble.
R1 (EATR). Mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et la biodiversité. Cette priorité inclut la caractérisation de la résilience des écosystèmes dans des conditions climatiques changeantes afin de mieux comprendre la diversité des habitats, la variabilité naturelle, la connectivité et la biodiversité, ainsi que les effets des changements climatiques sur la fonction et les services des écosystèmes. Cela comprend :
- Élaborer des approches coordonnées, collaboratives et intersectorielles pour surveiller, prévoir, évaluer et caractériser les risques et les vulnérabilités des écosystèmes. Il est essentiel de comprendre les impacts et les facteurs climatiques, les extrêmes climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont une incidence sur l’intégrité des écosystèmes. Ces recherches sont nécessaires pour lever les incertitudes, en particulier dans les régions mal surveillées et mal comprises, comme l’Arctique et les zones côtières.
- Intégrer les données pour caractériser les principaux moteurs des changements dans les écosystèmes et la biodiversité, pour évaluer l’état et des tendances, ainsi que les attributs des écosystèmes résilients au climat et de leurs services. Ces renseignements peuvent ensuite être utilisés pour soutenir et orienter une variété de mesures climatiques, y compris la détermination de mesures climatiques fondées sur la nature et hybrides (qui regroupent des mesures techniques et des mesures fondées sur la nature) (voir l’encadré 4.6. Solutions fondées sur la nature), la gestion adaptative des écosystèmes, la reconnaissance et la caractérisation des refuges climatiques et l’élaboration d’indicateurs de la santé, de la connectivité, de la fonction et de la biodiversité des écosystèmes.
- Comprendre et évaluer les effets cumulatifs des changements environnementaux à long terme et des phénomènes extrêmes à court terme, ainsi que des facteurs de stress anthropiques (p. ex. le développement des ressources et des infrastructures). Cette recherche fournit des renseignements précieux pour déterminer le degré de vulnérabilité d’un écosystème aux changements environnementaux et pour prendre des décisions fondées sur des données probantes.
Encadré 4.6. Solutions fondées sur la nature
Les solutions fondées sur la nature protègent, gèrent durablement et restaurent les écosystèmes naturels ou modifiés afin de relever les défis sociétaux de manière efficace et adaptative, tout en apportant des avantages au bien-être humain et à la biodiversité (Groupe de travail III du GIEC des Nations Unies). Dans un contexte plus large, les écosystèmes résilients jouent un double rôle en tant que solutions fondées sur la nature pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci. Les écosystèmes résilients séquestrent, stockent et libèrent le carbone atmosphérique par le biais de processus naturels. Ils peuvent contribuer à l’atténuation des changements climatiques à long terme grâce aux interventions humaines dans le cycle naturel du carbone (p. ex. la biomasse aérienne et souterraine, comme celle que l’on trouve dans les sols). Les écosystèmes résilients et les multiples services et valeurs qu’ils fournissent permettent également l’adaptation au climat pour les humains et la nature, en amortissant les effets des changements climatiques (p. ex. les risques à évolution lente, les événements catastrophiques) et en permettant un rebond. Cette capacité d’adaptation des écosystèmes résilients protège les stocks de carbone et la capacité de séquestration au fil du temps. Ensemble, les avantages des écosystèmes résilients en termes d’atténuation et d’adaptation permettent de faire face à la double crise de la biodiversité et du climat.
R2 (EATR). Faire progresser la science et les connaissances multidisciplinaires pour orienter les solutions d’adaptation aux changements climatiques qui favorisent des écosystèmes résilients dans un climat en changement. Ces approches doivent respecter de multiples systèmes de savoir, soutenir les objectifs de carboneutralité et d’adaptation, maximiser les avantages accessoires pour les humains et la nature, et évoluer à mesure que de nouvelles connaissances deviennent disponibles. Cela comprend :
- Élaboration d’approches novatrices en matière d’outils multidisciplinaires et interactifs pour aider la prise de décisions et la visualisation, y compris l’exploitation et l’expansion des plateformes existantes (p. ex. GEO.ca, ClimateAtlas.ca) et de multiples façons d’acquérir du savoir pour orienter les actions de préservation, de protection, de création et de restauration des écosystèmes, des habitats et des zones protégées terrestres et aquatiques.
- La création de cadres de recherche et de surveillance multidisciplinaires pour cerner, caractériser et mesurer les multiples valeurs de la nature et leur interaction. Ces cadres peuvent être utilisés pour attribuer une valeur aux écosystèmes et aux services écosystémiques qui profitent à la nature, à la santé humaine, à l’économie et à la société. Ces cadres sont nécessaires pour élaborer des évaluations de base adaptées aux différents écosystèmes, systèmes socioécologiques et régions.Note de bas de page 12
- La compréhension de l’efficacité, de l’efficience et de la permanence des solutions, y compris des solutions fondées sur la nature. L’évaluation des solutions doit tenir compte des avantages, des compromis, des possibilités, de l’extensibilité et de l’efficacité dans divers écosystèmes et régions. Elles doivent également prendre en considération les modifications des écosystèmes et de la biodiversité dans les conditions climatiques futures. Des modèles améliorés de flux de carbone et la mobilisation de données sont nécessaires pour mieux évaluer l’efficacité des solutions fondées sur la nature. Dans l’ensemble, une meilleure compréhension est nécessaire pour déterminer des solutions, en particulier des solutions fondées sur la nature, qui s’appuient sur la recherche transdisciplinaire (en unifiant les cadres intellectuels, en intégrant les approches dépassant les perspectives disciplinaires).
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances sont les suivantes :
MC1 (EATR). Synthétiser et mobiliser les connaissances sur la résilience des écosystèmes pour soutenir et améliorer la gestion adaptative et la prise de décision fondée sur des données probantes dans un contexte de changements climatiques. Les principaux produits de synthèse comprennent des rapports réguliers et systématiques sur l’état, les tendances, les projections et les services en matière de biodiversité et d’écosystèmes à l’échelle nationale. Les rapports peuvent synthétiser des renseignements au niveau de l’écosystème, du bassin versant ou du biome, y compris les répercussions des facteurs de stress multiples sur le fonctionnement des écosystèmes pour les systèmes aquatiques et terrestres. Les produits de synthèse nécessaires sont les suivants :
- l’évaluation de l’efficacité des efforts de conservation régionaux et nationaux pour atteindre les objectifs de conservation et de lutte aux changements climatiques (p. ex. le Défi de l’objectif 1 du Canada en matière de biodiversité, qui consiste à conserver 25 % des terres et des océans d’ici à 2025; la conservation ciblée par le biais de la Loi sur les espèces en péril), y compris les zones protégées, d’autres mesures efficaces de conservation par zone, et les zones protégées et conservées par les populations autochtones; et
- des évaluations permettant de synthétiser les connaissances et les enseignements tirés des programmes mis en œuvre dans les différents secteurs et administrations pour promouvoir des solutions fondées sur la nature.
Il faut élargir les efforts actuels de synthèse et de mobilisation des résultats scientifiques pour les décideurs et les responsables politiques nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les systèmes de collecte et de diffusion des données. Il s’agit notamment d’élaborer des approches novatrices en matière d’outils d’aide à la décision et de visualisation multidisciplinaires (impliquant des chercheurs de différentes disciplines, chacun apportant son point de vue disciplinaire) et interactives. Ces outils doivent s’appuyer sur les plateformes existantes (p. ex. GEO.ca, une plateforme en ligne d’information géospatiale canadienne ouverte, gérée par Ressources naturelles Canada) et sur de multiples systèmes de connaissances, et les développer. Ils doivent être conçus pour orienter la préservation, la protection, la création et la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques, des habitats et des aires protégées.
Encadré 4.7. Approches intersectorielles et transdisciplinaires pour l’économie circulaire
La mise en place d’une économie circulaire solide nécessite davantage de collaborations intersectorielles et interdisciplinaires. L’économie circulaire permet à la société de passer d’un système économique de production de déchets à un système d’utilisation, de réutilisation, de recyclage et de réintégration des matériaux dans l’économie et la nature. De nombreux produits fabriqués à partir de combustibles fossiles, comme le plastique, seraient remplacés par des produits fabriqués à partir de la biomasse, comme les fibres de bois, et les sources d’énergie fossiles seraient remplacées par des sources renouvelables telles que l’énergie éolienne, solaire, marémotrice et la bioénergie. Le développement de l’économie circulaire est un moyen efficace de réduire les déchets, d’atténuer les émissions de GES et de protéger la biodiversité et les services écosystémiques.
La synthèse et la mobilisation des sciences et des connaissances sont nécessaires pour permettre des solutions transformatrices et éliminer les obstacles entre les secteurs. La recherche transdisciplinaire est nécessaire pour élargir les possibilités de l’économie circulaire afin de parvenir à la durabilité. L’économie circulaire ne peut être réalisée sans un effort concerté de l’ensemble de la société et sans les données, les connaissances, les connexions et les relations adéquates.
Des cadres de recherche transdisciplinaires doivent être utilisés pour élaborer, mettre à l’essai, surveiller, évaluer et mettre en œuvre de nouvelles pratiques, de nouveaux processus et de nouvelles technologies afin de construire l’économie circulaire qui permettra d’atteindre la carboneutralité dans un Canada résilient.
4.4 Ressources naturelles durables
Les priorités scientifiques pour les ressources naturelles durables mettent l’accent sur les perspectives multisectorielles, interdisciplinaires et transdisciplinaires, afin de renforcer les capacités pour une action intégrée d’atténuation et d’adaptation. Cette action dans les secteurs fondés sur les ressources naturelles, notamment les pêches, l’aquaculture, la foresterie, l’agriculture, l’exploitation minière et l’énergie, constitue des solutions durables à long terme et tient compte des liens entre les ressources naturelles du Canada. Les répercussions et les risques des changements climatiques sont ressentis différemment dans chaque secteur, mais ont des implications qui sont intersectorielles. Des solutions intersectorielles doivent donc être élaborées pour parvenir à une économie des ressources naturelles résiliente, carboneutre et durable.
Des stratégies propres à chaque région géographique sont nécessaires pour développer les connaissances pour ces solutions. Dans l’ensemble, les priorités suivantes permettent de mettre en place des outils d’aide à la décision fondée sur des données scientifiques, des technologies et des pratiques « intelligentes sur le plan climatique » et d’explorer les possibilités offertes par l’économie circulaire (voir l’encadré 4.7. Approches intersectorielles et transdisciplinaires pour l’économie circulaire).
Les priorités de recherche comprennent :
R1 (RND). Comprendre comment les secteurs des ressources naturelles au Canada sont touchés par les changements climatiques. Les observations et prévisions (comme le climat, la biologie, la physique, la chimie, les écosystèmes, la socioéconomie et la santé) doivent être accessibles et disponibles pour permettre l’évaluation des risques et de la vulnérabilité. Ces données sont essentielles pour caractériser les effets en cascade des changements climatiques sur les systèmes biologiques et socioécologiques qui composent chaque secteur. Elles nous aident à comprendre ces risques au Canada et dans le monde, ainsi que la manière dont les risques et les vulnérabilités peuvent évoluer selon les scénarios climatiques futurs, y compris l’impact des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes.
Pour renforcer la résilience socioécologique, nous devons améliorer la connaissance et la compréhension des éléments suivants dans tous les secteurs :
- les répercussions et les risques liés aux extrêmes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes;
- les répercussions et les risques des changements climatiques en cascade; et
- les effets cumulés de multiples facteurs de stress climatiques et non climatiques.
L’impact des phénomènes extrêmes et des perturbations (y compris le moment, la fréquence et l’intensité) sur les secteurs des ressources naturelles doit faire l’objet de recherches plus approfondies.
R2 (RND). Élaborer et suivre des indicateurs de résilience socioécologique dans les secteurs des ressources naturelles et dans les communautés, et comprendre comment ces secteurs contribuent à l’action climatique. Cette priorité exige de comprendre les processus et les seuils de résilience, afin de concevoir des indicateurs appropriés et de recueillir des données pertinentes. Il convient d’élaborer des indicateurs et de collecter des données pertinentes pour les zones gérées et non gérées et pour les systèmes socioécologiques.
Secteur forestier : Les indicateurs doivent permettre d’orienter et d’évaluer les pratiques de gestion adaptatives « intelligentes sur le plan climatique ». Ces pratiques favorisent la santé et la résilience des forêts, la biodiversité, l’habitat de la faune et de la flore, la sécurité et la résilience des communautés, la génétique forestière, l’approvisionnement futur en fibres, la production de biocarburants et l’infrastructure du secteur forestier. Des recherches sont également nécessaires concernant l’impact de la gestion forestière sur les stocks de carbone dans les forêts gérées; il s’agit notamment de mesurer le carbone forestier et la résilience socioécologique aux changements climatiques. Ce travail doit être inclusif et faire participer l’industrie forestière, d’autres secteurs de ressources, les communautés et d’autres détenteurs de droits, intervenants et décideurs pertinents.
Secteur de la pêche et de l’aquaculture : Les indicateurs doivent cerner et suivre les risques et les vulnérabilités des espèces, des écosystèmes, des industries et des communautés face aux répercussions des changements climatiques, y compris les phénomènes extrêmes et les changements à évolution lente, afin de renforcer la résilience du secteur. Il est également nécessaire d’améliorer la compréhension des effets de la perte d’habitats côtiers, des changements dans la répartition des espèces (y compris les espèces envahissantes), de l’évolution des conditions océaniques et des effets du développement des ressources (p. ex. les énergies marines renouvelables, l’exploitation minière en eaux profondes, l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière).
Secteur agricole : Des recherches sont nécessaires pour améliorer les indicateurs qui permettront d’éclairer les décisions et de prévoir les changements des conditions climatiques (p. ex. l’humidité du sol, la durée de la saison de croissance) et de la biodiversité et les efforts d’atténuation des conséquences des changements climatiques (p. ex. les changements des pratiques de travail du sol et de fertilisation) à diverses échelles de temps et d’espace. La recherche sur les impacts à long terme des pratiques de gestion dans des conditions climatiques changeantes – et leur lien avec le carbone du sol, la qualité/quantité de l’eau et la biodiversité – est essentielle pour la sécurité alimentaire à long terme (voir l’encadré 4.3. La sécurité alimentaire dans un climat futur incertain) et la réduction des émissions dans le secteur.
Secteurs de l’exploitation minière et de l’énergie : Des recherches sur les indicateurs de résilience opérationnelle sont nécessaires pour réduire les risques climatiques à mesure que ces secteurs évoluent. Ces recherches doivent permettre de mieux comprendre les lacunes réglementaires, les systèmes d’approvisionnement et de distribution dans un monde carboneutre, les minéraux critiques, l’accès aux sites, la gestion des déchets, la gestion des anciens contaminants (p. ex., la dispersion des contaminants dans les sédiments en raison du réchauffement), l’approvisionnement en eau, ainsi que les implications ou les compromis pour la restauration des écosystèmes, la remise en état, la conservation et la biodiversité. La recherche doit orienter la transition vers des systèmes énergétiques résilients carboneutres et les scénarios énergétiques futurs pour réduire les émissions de GES en développant les sources d’énergie renouvelable.
R3 (RND). Utiliser la recherche collaborative et les approches transdisciplinaires pour explorer les synergies et les compromis en matière d’atténuation et d’adaptation dans les secteurs des ressources naturelles. Une compréhension intégrée et globale des secteurs des ressources naturelles et de leurs systèmes naturels permettra de développer la bioéconomie circulaire et d’atteindre les objectifs de carboneutralité. Des recherches transdisciplinaires sont nécessaires pour élaborer des pratiques et des politiques intégrées qui renforcent la capacité d’adaptation dans tous les secteurs et au sein de ceux-ci, en soutenant la réduction des déchets, la diversification économique et l’élaboration de solutions « intelligentes sur le plan climatique » pour les infrastructures et les équipements. Des recherches sont également nécessaires pour l’adoption des technologies de carboneutralité afin d’obtenir des avantages multiples en matière de gestion durable des ressources, de planification de l’utilisation des terres et des milieux aquatiques, et de production alimentaire, de l’échelle nationale à l’échelle locale.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances sont les suivantes :
MC1 (RND). Élaborer des outils pertinents pour permettre des actions climatiques fondées sur des données probantes à tous les niveaux de la politique et de la prise de décision. Des outils intégrés et interactifs de visualisation et d’aide à la décision qui tiennent compte des scénarios climatiques futurs doivent être élaborés, utilisés et promus. Ces outils doivent être pertinents sur le plan spatial, temporel et culturel afin de permettre des décisions politiques et de gestion qui soutiennent les objectifs environnementaux, économiques, sociaux et culturels pour les secteurs des ressources du Canada et les communautés qui en dépendent, tout en réduisant au minimum les compromis. L’efficacité de ces outils innovants doit être évaluée afin de s’assurer qu’ils sont appropriés, accessibles et pertinents pour les communautés, les gouvernements, les praticiens et les décideurs qui les utilisent.
MC2 (RND). Intégrer les sciences sociales et comportementales pour éclairer la prise de décision et les stratégies de communication propres à chaque secteur. Des recherches sont nécessaires pour combler l’écart entre les connaissances et la mise en œuvre et pour déterminer les facteurs qui favorisent l’action climatique dans les secteurs des ressources naturelles et ceux qui y font obstacle. Les sciences sociales, et plus particulièrement la psychologie et la science du comportement, sont nécessaires pour comprendre :
- les défis liés à la désinformation et à la mésinformation; et
- comment mieux cibler l’information et les produits de synthèse et de mobilisation des connaissances.
La recherche en sciences comportementales doit étudier l’impact et l’efficacité des politiques et mesures actuelles, telles que les incitations aux pratiques « intelligents sur le plan climatique », et évaluer la manière dont elles peuvent soutenir plus efficacement l’action en faveur du climat. Cette recherche peut également être utilisée pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre conjointes de solutions avec les leaders de l’industrie dans les secteurs des ressources naturelles.
4.5 Éclairer les progrès vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles
La surveillance précise et en temps opportun de la réduction et de l’élimination des émissions (voir l’encadré 5.4. Élimination du dioxyde de carbone) est essentielle pour évaluer les progrès accomplis en vue de la carboneutralité. Les émissions peuvent être réduites ou éliminées par le biais de changements apportés aux systèmes énergétiques, manufacturiers, agricoles, et de transports, aux infrastructures urbaines, à la gestion du territoire et des écosystèmes naturels. La surveillance et la déclaration nous permettent d’évaluer l’efficacité des politiques et d’informer les décideurs et le public sur les progrès réalisés en vue d’atteindre la carboneutralité.
Le Rapport d’inventaire national est l’inventaire officiel du Canada des sources et des puits de GES d’origine anthropique. Il rend compte principalement à l’échelle annuelle et à l’échelle spatiale provinciale, avec un décalage de 16 mois. Le Canada dispose de méthodes de déclaration des émissions parmi les plus avancées au monde et continue d’améliorer ses déclarations. Toutefois, les estimations des émissions déclarées dérivées des méthodes basées sur les activités (c’est-à-dire les méthodes ascendantes) peuvent différer de celles basées sur d’autres méthodes, telles que les estimations des émissions à partir de mesures atmosphériques (c’est-à-dire les méthodes descendantes). Les deux approches comportent des incertitudes inhérentes. De nouvelles méthodes permettent d’améliorer la qualité et la quantité des renseignements utilisés pour estimer les sources et les puits de GES. Il s’agit notamment de modèles améliorés, de réseaux de surveillance pour des sources ou des régions particulières, de nouvelles technologies, de capteurs à faible coût et d’observations par satellite. Les priorités de recherche pour améliorer les estimations des flux de GESGES sont les suivantes :
R1 (EPENN). Améliorer la déclaration des données sur les GES en réalisant des progrès dans la mesure et la modélisation des émissions de GES et en conciliant des techniques complémentaires d’estimation des émissions. L’intégration de méthodes d’estimation et de sources de données complémentaires ainsi que le comblement des lacunes qui subsistent dans les observations permettent d’obtenir des déclarations plus précises et plus rapides, avec une transparence et à des échelles spatiales et temporelles plus fines. La collecte et la déclaration de données d’activité (p. ex. les volumes de combustible) plus fréquemment (p. ex. plusieurs fois par an) peuvent améliorer la compréhension des émissions. Des mesures systématiques et régulières sur le terrain peuvent fournir des renseignements sur ces échelles de temps plus courtes. Ces renseignements peuvent contribuer à déterminer les possibilités d’atténuation, à orienter les méthodes et modèles d’inventaire ascendants et à mesurer les progrès des programmes de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de méthane. L’intégration de sources de données et de méthodes multiples améliorera également les rapports sur les émissions et l’élimination dans le paysage canadien. Un exemple est l’utilisation de données de télédétection à haute résolution avec des modèles de paysage validés et spatialement explicites pour suivre les impacts humains sur les flux de GES sur l’ensemble du territoire canadien.
Les recherches visant à concilier les différences entre les estimations des sources et des puits obtenues à l’aide de méthodes complémentaires (c.-à-d. des méthodes descendantes et ascendantes) renforceront la confiance dans les données relatives aux GES. Une meilleure compréhension des différentes méthodes est nécessaire pour comprendre la source des divergences (p. ex. sources manquantes, limites de détection, données d’activité incomplètes, limites des données déclarées, mauvaise répartition des sources d’émission) et pour permettre une déclaration précise des changements dans les émissions au fil du temps.
Une meilleure quantification des émissions de GES nécessite également des systèmes intégrés de surveillance des GES dans l'atmosphère.
Des recherches sont nécessaires pour évaluer et orienter les méthodes d’observation des changements atmosphériques et de suivi continu les émissions, par exemple, les différences entre les observations in situ par rapport aux observations par télédétection, ou des observations fixes par rapport aux plateformes mobiles (véhicules terrestres et aquatiques, avions, drones et satellites). La recherche devrait également prendre en compte les différences entre secteurs, les GES et les échelles spatiales et temporelles. Une priorité à court terme est la détection, la mesure et la réduction des émissions fugitives de méthane provenant des activités pétrolières et gazières, comme indiqué dans le document intitulé Plus vite et plus loin : la stratégie canadienne sur le méthane.
R2 (EPENN). Surveiller, analyser et évaluer les changements dans les stocks de carbone des écosystèmes. Des stocks de carbone importants à l’échelle mondiale sont stockés dans la biomasse et les sols du Canada ainsi que dans les milieux aquatiques et côtiers. Des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre la permanence et la vulnérabilité des stocks de carbone dans les zones humides gérées et non gérées, les systèmes agricoles, côtiers et forestiers. Cette recherche doit s’appuyer sur les sources de données et les analyses existantes, telles que les inventaires forestiers provinciaux. D’autres recherches sont nécessaires pour élaborer des méthodes et des données permettant de mesurer régulièrement et plus fréquemment les puits de carbone naturels à différentes échelles spatiales. L’amélioration des données sur les puits de carbone permet de déterminer leur potentiel d’élimination du carbone de l’atmosphère et de contribuer aux objectifs nationaux de carboneutralité. Cette priorité est étroitement liée aux priorités scientifiques pour les solutions fondées sur la nature et le cycle du carbone (voir le chapitre 5.2 Science du cycle du carbone).
R3 (EPENN). Mieux comprendre la contribution de l’utilisation des terres et des changements d’affectation des terres pour parvenir à une carboneutralité en développant des systèmes de surveillance de l’utilisation des terres à haute résolution spatiale. Des recherches sont nécessaires pour améliorer la conception du réseau et les méthodes afin de fournir des systèmes de surveillance de l’utilisation des terres qui soient conciliés et fassent autorité. Des modèles continuellement validés par rapport aux données mesurées sont nécessaires pour évaluer la manière dont l’utilisation des terres et les changements d’affectation des terres peuvent affecter les flux de carbone et contribuer à l’atteinte de la carboneutralité. Des études comparatives sont nécessaires pour harmoniser les méthodes de surveillance et de modélisation dans les différentes catégories d’utilisation des terres (forêts, terres cultivées, zones humides et terres habitées) et dans les zones côtières. Des modèles d’utilisation des terres devraient être utilisés à la fois dans les déclarations d’inventaires nationaux et dans les méthodes basées sur les observations atmosphériques, au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles (voir le chapitre 5.6 Science des voies critiques vers la carboneutralité).
R4 (EPENN). Examiner les compromis comprenant les émissions et l’élimination des GES dans le contexte économique, environnemental, politique, de santé et social de la société canadienne. Des analyses intégrées sont nécessaires pour comprendre les compromis associés aux émissions et à l’élimination des GES et pour soutenir des politiques climatiques éclairées. Ces analyses devraient utiliser des modèles écosystémiques et socioéconomiques afin d’étudier les incidences des orientations politiques en matière de GES. La recherche doit également envisager des solutions économiques et technologiques ainsi que celles fondées sur la nature, y compris l’évaluation des avantages, des coûts et des risques potentiels des solutions, ainsi que l’incertitude qui y est associée. Par exemple, la recherche et/ou la modélisation doivent comparer les méthodes d’élimination du dioxyde de carbone, comme le piégeage technologique du carbone par rapport au piégeage naturel, dans le cadre de plusieurs scénarios climatiques, y compris dans le contexte de phénomènes extrêmes.
Les priorités en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances visent à rendre les connaissances et les données plus utiles et accessibles. Elles comprennent :
MC1 (EPENN). Harmoniser les données, les renseignements et les connaissances accessibles au public et nécessaires au calcul des émissions. Des données complètes, faisant autorité et accessibles sont nécessaires pour la modélisation des émissions et les analyses intégrées. Les infrastructures de données existantes doivent être coordonnées et reliées entre elles. De nouvelles infrastructures de gestion des données et des connaissances doivent être encouragées afin de permettre d’élargir l’éventail des contributions des universités, des intervenants et du public à l’analyse des possibilités et des progrès en matière d’atténuation des GES. Les produits de télédétection doivent également être harmonisés et intégrés avec d’autres sources de données, y compris les données basées sur des enquêtes. La technologie doit être mise au point pour intégrer les ensembles de données, valider les modèles et permettre la libre circulation des données et des produits de la connaissance entre les gouvernements à tous les niveaux, les universités et le public.
MC2 (EPENN). Mener des comparaisons et apporter des améliorations aux modèles écosystémiques pour comprendre les facteurs anthropiques du changement du carbone dans le secteur terrestre. Pour améliorer la précision et réduire l’incertitude des estimations d’émissions et d’élimination, des recherches sont nécessaires pour valider les modèles d’écosystèmes par rapport aux ensembles de données historiques existants et pour déterminer comment les activités humaines modifient les émissions et l’élimination dans les écosystèmes gérés. Une étude coordonnée comparant les modèles est nécessaire pour établir les forces et les faiblesses des différentes plateformes de modélisation et pour s’assurer que les éléments fonctionnels des écosystèmes touchant les cycles du carbone et de l’azote sont correctement simulés et cohérents à toutes les échelles. Il convient d’explorer des approches novatrices pour combiner et affiner les fonctions des modèles. Ces modèles, qui projettent les répercussions des changements climatiques sur le paysage canadien, devraient jouer un rôle dans les analyses socioéconomiques intégrées des stratégies d’atténuation (voir aussi le chapitre 5.2 Science du cycle du carbone et le chapitre 5.6 Science des voies critiques vers la carboneutralité).
Ces priorités en matière de recherche ainsi que de synthèse et de mobilisation des connaissances permettraient de mieux comprendre les émissions et les tendances des GES, et permettraient au Canada de contribuer aux efforts internationaux de surveillance des GES, comme l’initiative de l’Observatoire international des émissions de méthane du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le processus de bilan mondial de l’Accord de Paris. De plus, les priorités nous permettent de faire des progrès continus vers le respect des contributions déterminées au niveau national du Canada.
Chapitre 5 Thèmes de recherche de convergence
Résumé
L’impact considérable des changements climatiques et la complexité des relations entre notre environnement, notre économie et notre bien-être signifient que la recherche doit se déployer dans toutes les disciplines (« recherche de convergence », voir l’encadré 2.2, Paradigmes de recherche pour une science transformative). Des cadres pour la recherche transdisciplinaire doivent être mis en place pour orienter la manière dont la société agit face aux changements climatiques et à d’autres défis simultanés. La synthèse et la diffusion des connaissances garantissent que les informations sur ces sujets sont accessibles à un large éventail de responsables politiques et de décideurs. L’utilisation de ces informations nous permettra de transformer plus efficacement les systèmes sociaux et économiques pour lutter contre les changements climatiques tout en atteignant les objectifs d’adaptation au climat et d’atténuation de ses effets.
Prévision et projection des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes
Il est essentiel de disposer de prévisions et de projections précises sur l’évolution du climat pour caractériser les risques et planifier les mesures d’adaptation. Ces données sont également essentielles pour déterminer des stratégies climatiques qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES) et demeureront efficaces face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux changements climatiques en cours. Ces prévisions doivent aller au-delà des températures et des précipitations extrêmes. Elles doivent fournir des indications non seulement sur la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi leur possible simultanéité ou enchaînement, des situations qui augmentent les risques pour les communautés canadiennes, la santé et le bien-être des personnes et des écosystèmes, ainsi que pour l’économie. Les priorités scientifiques comprennent l’établissement de prévisions climatiques à l’échelle saisonnière, annuelle et décennale, ainsi qu’à l’échelle spatiale kilométrique. La région arctique en particulier bénéficierait grandement d’une meilleure surveillance du climat et de données permettant de prévoir les extrêmes climatiques. Le partenariat avec les communautés pour surveiller et prévoir les changements climatiques à l’échelle régionale est essentiel pour soutenir la lutte contre les changements climatiques.
Science du cycle du carbone
La science du cycle du carbone consiste à comprendre comment le carbone circule dans les écosystèmes, l’atmosphère, les communautés et les secteurs industriels et des ressources naturelles. Cela permet de cerner les possibilités d’atténuation et les stratégies d’adaptation. Par exemple, des solutions fondées sur la nature permettent de conserver et renforcer les puits de carbone naturels tout en soutenant l’adaptation au climat (p. ex. par des influences de refroidissement naturel dans les environnements urbains). L‘efficacité des solutions fondées sur la nature dépend de la manière dont le cycle du carbone réagira aux futurs changements climatiques. Des travaux de recherche sur le cycle du carbone sont nécessaires pour savoir comment intégrer ces solutions fondées sur la nature ainsi que les technologies qui éliminent le dioxyde de carbone dans les plans des voies vers la carboneutralité. Pour déployer efficacement les puits de carbone naturels et les déclarer, il faut renforcer la recherche collaborative afin d’inclure la prise en compte du cycle carbone dans les modèles climatiques. Des travaux de recherche sont nécessaires pour suivre l’évolution des stocks de carbone (terrestres et marins) afin de comprendre leur réaction à l’évolution des conditions climatiques et aux perturbations (naturelles ou d’origine humaine). En complément, il faudra en outre procéder à des évaluations scientifiques régulières afin de suivre les tendances et d’étayer des méthodes intégrées de mesure et de calcul du carbone. Ces évaluations permettent également de relever les avantages accessoires des solutions fondées sur la nature pour la biodiversité et la santé.
La science du lien entre l’eau et le climat
L’avancement de cette science du lien (dans laquelle les disciplines se croisent) éclairera les interventions visant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être des humains, ainsi qu’à maintenir des écosystèmes aquatiques et terrestres sains qui, à leur tour, font partie intégrante du bien-être de l’humain. Les priorités scientifiques comprennent l’élaboration d’outils permettant de prévoir l’approvisionnement en eau et la qualité de l’eau pour les communautés et les secteurs des ressources naturelles, y compris les installations hydroélectriques. Ces outils permettront de planifier la réduction des risques liés aux extrêmes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les priorités scientifiques comprennent la compréhension de la durabilité de l’approvisionnement en eau, la prévision des extrêmes liés à l’eau et de leurs répercussions sur les infrastructures construites et les services essentiels, la prévision des risques liés à l’eau pour la santé humaine et des écosystèmes ainsi que l’amélioration de la communication concernant l’eau et le climat afin d’assurer une meilleure connaissance du climat.
Science des changements climatiques dans l’Arctique
Les priorités de la science des changements climatiques dans l’Arctique sont transversales. Le réchauffement rapide en cours dans le nord du Canada a de profondes répercussions sur la société, l’environnement et l’écologie. Les implications mondiales de ces changements offrent au Canada la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans le domaine scientifique et d’y participer. Les organisations inuites, métisses et des Premières Nations doivent participer activement, en tant que partenaires, à l’établissement et au traitement des priorités de recherche dans tout le Canada, particulièrement dans le Nord du Canada, où la manière dont la recherche est menée est aussi importante que la nature de recherche effectuée. Des initiatives communautaires sont nécessaires pour améliorer la surveillance environnementale, accroître les capacités de recherche dans le Nord et l’analyser les scénarios futurs de changements climatiques et de leurs répercussions pour la sécurité alimentaire et hydrique, les transports, les infrastructures et les moyens de subsistance traditionnels. Les cinq thèmes de la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques constituent une base solide pour les besoins en matière de recherche et de capacités. Les priorités essentielles en matière de science et de connaissance dans l’Arctique comprennent l’élaboration de stratégies de surveillance qui intègrent mieux les observations de surface et les données satellitaires, ainsi qu’une meilleure représentation des processus arctiques (p. ex. la cryosphère) dans les modèles du système terrestre.
Science du lien entre l’approche « Une seule santé » et les changements climatiques
Une seule santé est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire visant à obtenir des résultats optimaux en matière de santé en reconnaissant l’interconnexion entre les personnes, les animaux, les végétaux et leur environnement commun (y compris les écosystèmes aquatiques et terrestres). Des recherches sont nécessaires pour renforcer notre compréhension des risques et des facteurs des changements climatiques et de leurs effets synergiques (également appelés les effets « intégrés complexes ») sur la santé, selon lesquels de nombreux facteurs de stress se combinent et nuisent à la santé. Ces travaux de recherche nous aideront à caractériser les risques sanitaires exacerbés par les changements climatiques, comme les maladies infectieuses et à transmission vectorielle, les espèces envahissantes et les agents pathogènes, et à intervenir dans ces situations. Ils nous serviront aussi à comprendre les risques associés à d’autres menaces et les facteurs de stress causés par les changements climatiques, notamment les contaminants environnementaux, la perte et la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité.
Science des voies critiques vers la carboneutralité
L’expression « carboneutralité » signifie que les émissions de GES d’origine humaine dans l’atmosphère sont équilibrées par l’élimination de GES par l’humain (au cours d’une période donnée). La science des voies critiques vers la carboneutralité cherche à comprendre les éléments nécessaires pour parvenir à zéro émission nette tout en répondant aux besoins de la société. Elle comprend les processus biophysiques, technologiques et socioéconomiques interconnectés qui influent sur les efforts de décarbonation. Ces recherches permettent de planifier un avenir dans lequel les émissions de carbone sont limitées, grâce à la compréhension des facteurs et des changements nécessaires dans un large éventail de facteurs naturels et socioéconomiques. Les priorités scientifiques comprennent la constitution d’ensembles de données et la compréhension des tendances des émissions, afin d’éclairer les scénarios de changement transformationnel au Canada. Il est également important de mieux représenter les processus sociaux, politiques, attitudinaux et comportementaux, et d’analyser leur incidence sur les voies vers la carboneutralité. Il est nécessaire d’intégrer les projections climatiques, y compris les extrêmes climatiques, aux modèles d’écosystèmes et aux tendances sociales et économiques, dans le cadre de l’analyse des voies possibles. Afin d’encourager ces activités scientifiques et de renforcer les capacités, le Canada doit se doter d’une stratégie nationale de modélisation pour les voies vers la carboneutralité.
Changements climatiques et le développement durable
La recherche et la lutte contre les changements climatiques sont essentielles au développement durable et aux efforts visant à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques et aux risques qui y sont associés. Cependant, la recherche sur la relation entre la lutte contre les changements climatiques et le développement durable au Canada est plutôt limitée. Les travaux de recherche sur ce sujet peuvent aider à montrer si la lutte contre les changements climatiques a favorisé ou entravé le développement durable et dans quelle mesure, notamment dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales.
Changements climatiques et sécurité
Les changements climatiques ont des conséquences sur de nombreux aspects du bien-être, de la sûreté et de la sécurité des personnes. Des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les répercussions possibles des changements climatiques sur le bien-être et la sécurité, les conflits, la défense nationale ainsi que la stabilité sociale et géopolitique. Ces travaux devraient viser à analyser les facteurs de stress croisés (liés ou non au climat), les risques environnementaux, ainsi que les répercussions et problèmes sociaux. Adopter une optique qui intègre à la fois les changements climatiques et la sécurité améliorerait la compréhension de la manière dont les changements climatiques ont une incidence sur les choix de développement futurs, leurs aspects distributifs et leurs solutions. Cette optique intégrerait les données et les connaissances existantes sur les facteurs environnementaux, socioéconomiques et sanitaires afin de mieux éclairer les solutions en matière de climat et de sécurité. La recherche doit également évaluer les transformations climatiques, économiques, politiques et financières à long terme pour le Canada et la manière dont elles s’inscrivent dans les changements à l’échelle mondiale. Des cadres de recherche transdisciplinaires sont essentiels pour évaluer les répercussions sécuritaires des politiques en matière de changements climatiques pour les risques géopolitiques, les risques pour les systèmes financiers et l’approvisionnement en énergie, les réponses humanitaires et la politique étrangère.
Sciences sociales et changements climatiques
Les sciences sociales et comportementales sont essentielles pour nous aider à comprendre les attitudes, les croyances, les valeurs et les préjugés des Canadiens à l'égard des changements climatiques. Ces informations peuvent être utilisées pour élaborer des stratégies de communication ciblées et traduire la science des changements climatiques de manière à toucher différents publics. Une communication efficace, fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et diffusée de manière claire et concise, peut contribuer aux changements d'attitude et de comportement nécessaires à la transformation de la société et à l'obtention d'émissions nettes de GES nulles.
Ces thèmes de recherche de convergence ont été déterminés en fonction de caractéristiques transversales communes, de leur grande pertinence pour de multiples composantes du système climatique et des régions, et de leurs répercussions générales sur les communautés et les secteurs socioéconomiques. Ils se concentrent notamment sur les interactions biophysiques, socioéconomiques et politiques, ainsi que sur les rétroactions (réactions qui intensifient ou minimisent l’effet initial). Ces thèmes requièrent une attention et un soutien particuliers afin de mettre en place des approches scientifiques multidisciplinaires et transdisciplinaires, allant au-delà de la relation de cause à effet pour refléter les réponses aux changements climatiques de plus en plus complexes et difficiles à gérer.
Pris ensemble, ces thèmes soulignent la nécessité d’acquérir des connaissances pour guider les approches intégrées visant à atténuer les émissions de GES et à s’adapter aux changements climatiques. Ces initiatives peuvent transformer les systèmes sociaux et économiques, promouvoir la santé des Canadiens et de l’environnement, et conserver les écosystèmes naturels et la biodiversité.
5.1 Prévision et projection des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes
Des recherches sont nécessaires pour améliorer la prévision (à court terme) et la projection (à long terme en fonction des émissions de GES) des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes (voir l’encadré 5.1, Extrêmes climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes). Les intervenants et les experts soulignent que cette recherche est fondamentale pour faire progresser un large éventail de sciences et de savoir sur les changements climatiques. Elle est également essentielle pour planifier des mesures d’adaptation et d’atténuation efficaces. Les progrès de la science et de la modélisation du climat du système terrestre en matière des phénomènes extrêmes nécessitent une meilleure compréhension de la manière dont les changements climatiques influenceront les processus terrestres, hydrologiques, océanographiques, biogéochimiques, cryosphériques et atmosphériques (y compris ceux associés aux nuages, aux précipitations et aux tempêtes).
Les prévisions et les projections reposent sur une forte capacité de modélisation du climat du système terrestre. Ces modèles simulent la façon dont la chimie, la biologie et les forces physiques interagissent. La compréhension des extrêmes peut également contribuer à l’acquisition de connaissances sur le climat, ce qui, à son tour, contribue à développer les compétences en matière d’adaptation au climat dans les secteurs public et privé et à sensibiliser davantage les citoyens aux risques climatiques, motivant ainsi l’action individuelle et collective pour lutter contre les changements climatiques.
Encadré 5.1. Extrêmes climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes
Les extrêmes climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent être de courte durée (comme les tempêtes et les vagues de chaleur qui se produisent en quelques heures, jours ou semaines) ou de longue durée (comme les sécheresses pluriannuelles). La prédiction et la projection de l’évolution de leur fréquence et de leur intensité doivent englober les extrêmes à toutes les échelles de temps et d’espace.
Extrêmes – Les extrémités (queues) de la distribution d’une variable particulière (p. ex. la température la plus chaude ou la plus froide).
Phénomènes météorologiques extrêmes – Phénomène rare à un endroit et à une période de l’année donnés (p. ex. vagues de chaleur, feux de forêt, inondations, sécheresses, ondes de tempête).
Phénomènes extrêmes combinés – Combinaison simultanée ou séquentielle d’extrêmes ou regroupement de phénomènes météorologiques ou d’aléas (p. ex. élévation du niveau de la mer et onde de tempête; sécheresse couplée à des vagues de chaleur ou des feux de forêt).
Encadré 5.2 Répondre aux urgences climatiques et météorologiques
Pour la Nation métisse de la Colombie-Britannique (MNBC), les défis posés par les changements climatiques, comme les tempêtes plus intenses, les fortes précipitations fréquentes de pluie et de neige, les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations extrêmes et l’élévation du niveau de la mer pourraient modifier considérablement les types et l’ampleur des aléas auxquels sont confrontées les communautés et les équipes de professionnels de gestion des urgences qui sont à leur service. Cela se reflète dans le projet de la phase 1 du cadre de soutien d’urgence lancé en 2020 pour aider la MNBC dans ses efforts pour soutenir les communautés reconnues de la MNBC et les citoyens métis dans la planification d’urgence et la préparation en cas de catastrophes futures. Le projet comprenait une évaluation des conditions existantes, des capacités d’intervention d’urgence, de l’état du programme et de la détermination des défis pour les citoyens métis concernant les opérations d’urgence. Cette évaluation préliminaire essentielle permettra de fournir un soutien d’urgence efficace à la MNBC en complément des systèmes existants gérés par les autorités locales, régionales et provinciales. Pour de plus amples renseignements : Publication du rapport final de la série d’ateliers sur la préparation aux changements climatiques – Nation métisse de la Colombie-Britannique (mnbc.ca) (en anglais seulement).
L’amélioration des capacités de prévision doit être associée à des outils d’évaluation des risques pour planifier les extrêmes climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les phénomènes extrêmes combinés. Les phénomènes combinés peuvent être plus susceptibles que les phénomènes individuels de pousser les secteurs des ressources naturelles, les infrastructures et la sécurité publique au-delà de leur seuil de résilience. Une étape supplémentaire dans la compréhension des conséquences des phénomènes extrêmes combinés consiste à prendre en compte les conditions socioéconomiques concomitantes, comme une récession économique, qui peuvent exacerber ou créer des vulnérabilités et des défis supplémentaires pour le rétablissement (voir l’encadré 5.2, Répondre aux urgences climatiques et météorologiques).
Des recherches et des investissements continus sont nécessaires pour améliorer les prévisions climatiques. Pour les priorités suivantes, les progrès peuvent être accélérés par une approche nationale plus coordonnée, une intégration plus étroite avec la communauté ou les intervenants, ou encore des approches interdisciplinaires qui incluent les sciences sociales et de la santé. Les priorités scientifiques sont les suivantes :
R1 (PPECPME). Améliorer les prévisions et les projections des extrêmes selon des échelles de temps (saison, décennies) et des échelles spatiales (kilomètres). Établir et améliorer les prévisions à l’échelle saisonnière et interannuelle, les projections à l’échelle décennale et centennale ainsi que les paramètres (mesures d’aspects particuliers du climat ou des conditions météorologiques) pertinents pour les utilisateurs au Canada. Il s’agit notamment des extrêmes et des conditions propices aux phénomènes météorologiques extrêmes, de la qualité de l’air, de l’état des océans et du niveau de la mer, ainsi que des paramètres hydroclimatiques liés à la sécurité de l’eau douce. Ces paramètres devraient être « réduits » à partir de modèles ou d’observations à grande échelle vers des échelles kilométriques, pour être ensuite exploités dans des modèles (p. ex. des modèles hydrologiques, océanographiques, de maladies à transmission vectorielle, de feux de forêt et d’érosion côtière). De meilleures projections des extrêmes climatiques permettront d’établir des mesures climatiques et des codes de conception pour des secteurs précis, de réduire les risques de catastrophes, d’assurer la planification d’urgence, de protéger la santé et la sécurité publiques et la sécurité alimentaire, en plus d’autres applications de la gestion des risques climatiques.
Les modèles à grande échelle fournissent des informations qui alimentent des modèles récepteurs à plus petite échelle, utiles pour la planification au niveau régional et local. Cette « chaîne de modélisation », laquelle va des modèles mondiaux aux modèles régionaux à haute résolution du système terrestre, doit être améliorée pour mieux représenter les conditions (p. ex. humidité du sol, pergélisol, température de l’océan) et les processus atmosphériques (p. ex. instabilités convectives, vents extrêmes, trajectoires des tempêtes), ainsi que pour prévoir le climat et les extrêmes climatiques. La chaîne de modélisation du système terrestre doit produire des données à haute résolution afin que celles-ci puissent être utilisées dans des modèles récepteurs régionaux ou locaux. Des recherches interdisciplinaires sont nécessaires pour élargir l’éventail des variables et des paramètres prédits et projetés afin d’y inclure ceux qui ont une incidence sur les Canadiens et les risques auxquels ils sont exposés (voir ci-dessus). Cela permettra aux modèles de poser les meilleures actions pour la santé et la sécurité, les infrastructures, la préparation aux catastrophes et d’autres résultats économiques et sociétaux. Par exemple, les données issues des modèles peuvent être intégrées dans les services climatiques afin d’aider les gouvernements et les communautés à se préparer et à réagir aux phénomènes météorologiques extrêmes.
Actuellement, les capacités de fournir les prévisions saisonnières, interannuelles et décennales sont limitées. Des progrès sont possibles dans les systèmes de prévision saisonnière et dans la qualité des observations et des analyses subséquentes pour initialiser les simulations. Pour élargir l’éventail des variables et des paramètres, des recherches sont nécessaires pour déterminer la façon dont l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pourraient s’appuyer sur les capacités canadiennes existantes en matière de prévisions saisonnières. Des modèles améliorés seraient précieux pour les prévisions environnementales (p. ex. inondations, ondes de tempête et feux) ainsi que pour les applications socioéconomiques, comme les pratiques agricoles et la gestion des ressources naturelles (p. ex. eau, foresterie, pêche).
R2 (PPECPME). Améliorer la surveillance, la collecte et l’accessibilité des données. Des ensembles de données d’observation du climat et du système terrestre accessibles, intégrés et interopérables sont essentiels pour étayer la modélisation du système terrestre et la prévision des extrêmes, pour comprendre l’évolution à long terme des phénomènes météorologiques extrêmes et pour orienter les investissements en matière d’adaptation et d’infrastructure. Ces ensembles de données doivent également être mis à jour régulièrement. La surveillance du climat (à la surface du sol et aux océans) doit être améliorée et mieux correspondre aux indices climatiques définis par l’utilisateur (utilisés pour caractériser un aspect d’un système, tel qu’un schéma de circulation), en particulier pour les phénomènes météorologiques extrêmes, les précipitations, les vents et les changements dans la cryosphère. Plus particulièrement, les régions peu observées, telles que l’Arctique, doivent être mieux couvertes (voir l’encadré 5.3, Combler les lacunes dans les observations atmosphériques de l’Arctique) et les systèmes de surveillance (c.-à-d. le choix d’emplacement et la technologie) doivent être maintenus à long terme. Parallèlement, des investissements sont nécessaires dans les nouvelles technologies pour soutenir et étendre la capacité de surveillance et fournir des produits à plus haute résolution. Cette technologie comprend des systèmes autonomes, des produits d’observation de la Terre à partir de l’espace et leur étalonnage, ainsi que des produits mixtes in situ et de télédétection.
Encadré 5.3. Combler les lacunes dans les observations atmosphériques de l’Arctique
Les températures dans l’Arctique canadien augmentent à un rythme de deux à trois fois supérieur à la moyenne mondiale, mais les observations atmosphériques de l’Arctique présentent encore un écart important par rapport au reste du monde. Il n’existe qu’un petit nombre de stations de mesure atmosphérique au sol (qui recueillent des données sur les variables météorologiques et climatiques ainsi que sur les GES) dans les régions nordiques du Canada, ce qui limite notre capacité à surveiller les changements dans les écosystèmes nordiques vulnérables et les rétroactions dues au rythme plus rapide du réchauffement dans ces régions. Par conséquent, les études visant à prévoir les conditions climatiques futures risquent de ne pas être suffisamment précises pour éclairer les efforts d’adaptation et évaluer les progrès accomplis en vue de stabiliser les températures mondiales. Même si les satellites prévus pour surveiller le dioxyde de carbone et le méthane augmenteront la couverture d’observation à l’échelle mondiale, les latitudes nordiques du Canada continueront d’être sous-observées. Le gouvernement du Canada propose la Mission sur la masse de neige au sol et la Mission d’observation de l’Arctique qui offrent une capacité d’observation de l’Arctique jamais vue auparavant. Ces missions, développées en partenariat entre Environnement et Changement climatiques Canada, l’Agence spatiale canadienne et Ressources naturelles Canada, en collaboration avec des institutions universitaires nationales et des experts scientifiques internationaux, disposeraient de capacités sans précédent pour observer les impacts des changements climatiques, améliorer la préparation aux situations d’urgence en cas d’évènements météorologiques extrêmes et soutenir l’adaptation résiliente des communautés dans le Nord. C’est l’occasion pour le Canada de jouer un rôle de premier plan au niveau international pour faire progresser les capacités d’observation de la Terre par satellite, en mettant l’accent sur le Nord.
R3 (PPECPME). Établir des approches de surveillance, de recherche et de prévision des changements climatiques en collaboration avec les communautés concernées. Les partenaires en matière de prévision des extrêmes et de surveillance des changements climatiques comprennent les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, les municipalités, les provinces et les territoires, ainsi que d’autres groupes concernés. Les activités scientifiques existantes doivent aller au-delà du rôle d’expert indépendant et, au contraire, cocréer des connaissances directement avec les communautés concernées afin de fournir des renseignements pertinents sur le climat, qui soutiennent l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation au climat. Il existe des possibilités de former ou de renforcer des partenariats pour des études d’observation et de processus ainsi que pour des efforts de surveillance et de modélisation à long terme. Les partenariats communautaires peuvent également augmenter les capacités locales et régionales, en améliorant la compréhension des changements climatiques et la mobilisation des citoyens, des organisations, et des communautés à l’égard de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation au climat.
Pour ce thème de recherche de convergence, il y une seule priorité pour la synthèse et la mobilisation des connaissances :
MC1 (PPECPME). Synthétiser et mobiliser les connaissances existantes sur la science physique des changements climatiques, y compris les extrêmes. Les connaissances doivent être synthétisées et mobilisées par de nombreux moyens (voir le chapitre 6, Faire progresser la science des changements climatiques).
En ce qui concerne les phénomènes météorologiques extrêmes plus particulièrement, des travaux sont en cours pour développer des « systèmes d’attribution rapide des phénomènes », lesquels permettraient d’évaluer et de communiquer l’incidence des changements climatiques sur ces phénomènes. Un nouveau programme fédéral fait appel à la « science de l’attribution », un domaine en plein essor, pour déterminer rapidement dans quelle mesure un phénomène météorologique extrême donné (p. ex. une inondation en Colombie-Britannique ou un feu de forêt au Québec) est attribuable aux changements climatiques.
Des outils, des conseils et des formations sont toujours nécessaires pour renforcer les compétences en matière de lutte contre les changements climatiques à tous les ordres de gouvernement et du secteur privé. Cela permettra aux décideurs d’intégrer les considérations relatives aux changements climatiques dans l’élaboration des politiques et les projets d’infrastructure, afin d’améliorer la résistance des projets aux extrêmes climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
5.2 Science du cycle du carbone
La science du cycle du carbone consiste à comprendre comment le carbone circule dans les communautés, le secteur industriel, le secteur des ressources naturelles, les écosystèmes et l’atmosphère. La science du cycle du carbone, qui témoigne des réponses des écosystèmes aux actions humaines délibérées et à l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère, est intégrée dans les inventaires nationaux des sources et des puits de GES ainsi que dans les modèles climatiques du système terrestre à divers degrés. Cette compréhension oriente les possibilités d’atténuation, notamment l’amélioration de la séquestration naturelle et la conservation in situ du carbone, ainsi que les stratégies d’adaptation qui s’appuient sur des solutions fondées sur la nature ou hybridesNote de bas de page 13. Dans l’ensemble, le potentiel d’atténuation des solutions fondées sur la nature qui visent à préserver ou à accroître le stockage du carbone n’est pas bien calculé dans l’espace et dans le temps. Qui plus est, les variables qui influencent ces calculs ne sont pas utilisées de manière cohérente et les différentes estimations des puits de carbone ne sont pas directement comparables.
La contribution possible de l’élimination du dioxyde de carbone pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions doit faire l’objet de recherches continues. Des recherches sont nécessaires pour améliorer le calcul de l’élimination et comprendre les effets du réchauffement en cours sur les efforts de séquestration du carbone à grande échelle (voir l’encadré 5.4, Élimination du dioxyde de carbone). Les nouvelles recherches devraient reposer sur des observations atmosphériques et des méthodes fondées sur des modèles pour estimer les flux de carbone, ce qui viendrait compléter les rapports d’inventaire nationaux. D’une manière générale, cette recherche contribue à :
- améliorer les stratégies d’atténuation;
- valider et peaufiner les méthodes de déclaration pour les technologies d’élimination du dioxyde de carbone et pour la séquestration naturelle du carbone;
- comprendre les contributions possibles aux objectifs de réduction des émissions; et
- atteindre et maintenir la carboneutralité.
Les solutions fondées sur la nature constituent un élément important des stratégies d’atténuation. Toutefois, des incertitudes et des lacunes limitent notre compréhension de leur capacité réelle et potentielle à séquestrer et à stocker le carbone dans les zones gérées et non gérées (p. ex. les zones humides, notamment les tourbières, les systèmes agricoles et forestiers, le bois récolté et les écosystèmes côtiers). La recherche sur la permanence de la séquestration naturelle doit tenir compte des effets du réchauffement futur et de la modification des précipitations sur le fonctionnement de l’écosystème. Cela comprend la libération possible de dioxyde de carbone et de méthane (p. ex. à partir du pergélisol et des sols) en réaction au réchauffement, aux perturbations dues à des phénomènes météorologiques extrêmes ou à l’activité humaine, et à des changements hydrologiques (p. ex. dans les zones humides et les zones côtières), ainsi que les rétroactions climatiques connexes dans le système terrestre qui amplifient les changements climatiques.
Il est de plus en plus nécessaire de prévoir, de mesurer et de valider les interventions directes visant à détourner le carbone par le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, notamment grâce aux technologies de captage directement dans l’air. Les possibilités émergentes offertes par la bioéconomie circulaire (une économie alimentée par la nature qui met l’accent sur les énergies renouvelables et minimise les déchets) et la bioénergie (carburants issus de la biomasse), y compris les solutions d’ingénierie hybrides et à faibles émissions de carbone pour les infrastructures, représentent de nouvelles interventions pour séquestrer le carbone, en détournant ou en retardant les flux de carbone vers les écosystèmes naturels. L’incidence de ces interventions sur la fonction des écosystèmes et la biodiversité est mal connue. Les approches hybrides et fondées sur la nature de la gestion des risques d’inondation et de feux de forêt, la création d’espaces verts et de parcs à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines, ainsi que le programme Patrimoine naturel du Canada (conserver 30 % de nos terres et de nos océans d’ici 2030) ont tous des répercussions sur la fonction des écosystèmes et la biodiversité ainsi que sur la séquestration du carbone à long terme.
Les priorités de la science du cycle du carbone (ci-dessous) comprennent une meilleure compréhension, fondée sur les processus, des sources et des puits de carbone liés à la végétation et au sol dans l’ensemble du paysage canadien, qui englobe les environnements agricoles, forestiers, humides et côtiers ainsi que la toundra.
Pour savoir comment les solutions fondées sur la nature influent sur le cycle du carbone, nous devons nous doter d’une compréhension globale des stocks et des flux naturels du carbone actuels (c.-à-d. les conditions de référence).
Il est essentiel d’établir une capacité nationale coordonnée pour appliquer la science du cycle du carbone au Canada. Il s’agit notamment de participer aux organisations et aux efforts internationaux dans le domaine de la science du système terrestre et du carbone, et de s’appuyer sur ces connaissances pour faire progresser les intérêts du Canada et ses objectifs en matière de climat. Les priorités scientifiques sont les suivantes :
R1 (CC). Mener des recherches collaboratives sur la modélisation du système terrestre et la compréhension du cycle du carbone. Cette priorité comprend le développement de stratégies gouvernementales et universitaires nationales et les partenariats pour : 1) le développement et l’évaluation de modèles climatiques du système terrestre; 2) la recherche et la surveillance du cycle du carbone. La recherche dans ce domaine devrait inclure un large éventail de données d’observation et d’études de processus afin de contribuer au développement et à la validation des modèles.
La recherche doit se faire selon une approche multidisciplinaire du système terrestre. Dans plusieurs régions du Canada, les écosystèmes et les processus climatiques ont un effet important sur le cycle global du carbone, mais il existe des incertitudes concernant les rétroactions associées. Ces régions comprennent les forêts boréales, les zones humides, les zones sujettes aux feux de forêt, le pergélisol et les régions océaniques côtières. Le climat, les processus du sol, la végétation, l’hydrologie et la cryosphère sont tous liés. Cela a des répercussions importantes sur les cycles biogéochimiques, notamment sur la séquestration et la libération possible du carbone stocké (sous forme de dioxyde de carbone, de méthane ou d’autres GES) et de l’azote.
R2 (CC). Faire la surveillance des stocks de carbone afin de comprendre leurs réactions à l’évolution des conditions climatiques et aux perturbations. La surveillance à long terme des aspects biologiques, chimiques et physiques des écosystèmes nous permettra de suivre l’évolution des stocks de carbone terrestres et marins au fil du temps et de les relier aux changements des conditions environnementales et aux perturbations, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine. Des recherches sont nécessaires pour comprendre le rôle des zones humides (notamment les tourbières) et des zones de pergélisol dans le réchauffement climatique. Des recherches sont également nécessaires pour comprendre l’effet de l’augmentation de la fréquence et de la gravité des perturbations naturelles, telles que les feux de forêt, sur le carbone forestier. Ces éléments doivent être pris en compte, conjointement à l’incidence des pratiques de gestion forestière et au transfert de carbone vers les produits du bois récoltés. La recherche doit également porter sur le rôle des lacs et des rivières dans le stockage et le transport du carbone entre les milieux terrestres et marins, ainsi que sur le potentiel de séquestration du carbone dans les herbes marines et les zones humides côtières, les marais salés et les peuplements d’algues brunes, afin de contribuer à la gestion des côtes et à la protection de ces écosystèmes marins (voir le chapitre 4.5, Éclairer les progrès vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles).
Des recherches sont nécessaires pour évaluer et orienter les méthodes basées sur l’observation (intégrant des données provenant de stations terrestres et de satellites) afin d’estimer les émissions, ainsi que les expériences de terrain à long terme pour estimer les stocks et les flux de carbone à l’échelle régionale et nationale. Si les flux de carbone naturels et anthropiques doivent être estimés, les techniques et les considérations de mise en œuvre diffèrent entre les deux en ce qui concerne la précision, l’exactitude, la couverture spatiale et temporelle, la fréquence et la mesure.
R3 (CC). Améliorer, comparer et appliquer les modèles d’écosystèmes pour estimer les flux de carbone à l’échelle nationale. Il est important de valider les principaux modèles utilisés pour simuler les émissions et l’élimination de carbone dans les écosystèmes canadiens en les comparant aux données historiques existantes. La validation garantit leur exactitude et nous aide à mieux comprendre l’incertitude des simulations du modèle. Un large éventail de modèles d’écosystèmes permettent de comprendre les cycles du carbone et de l’azote. Ces modèles fonctionnent à différentes échelles, du modèle propre à un seul site jusqu’au modèle à l’échelle du bassin versant, du paysage ou de la planète.
Dans le cadre de la validation, une étude coordonnée de comparaisons corrélatives des modèles pourrait établir les forces et les faiblesses de divers modèles. L’étude déterminerait également si les modèles à l’échelle du paysage, du bassin versant, de la région ou de la planète sont cohérents avec les modèles à plus petite échelle et si les principaux éléments fonctionnels des écosystèmes sont correctement simulés et cohérents à toutes les échelles. Les modèles d’écosystèmes validés devraient jouer un rôle clé dans l’analyse des stratégies d’atténuation, en impliquant des solutions basées sur la nature, dans la projection des effets des changements climatiques sur le paysage canadien, ainsi que dans la surveillance et la déclaration des émissions et de l’élimination de GES dans le paysage géré et non géré.
Voici la priorité pour la synthèse et la mobilisation des connaissances :
MC1 (CC). Effectuer des évaluations scientifiques périodiques du cycle du carbone et du potentiel d’absorption accrue du carbone au Canada. Des évaluations scientifiques régulières sont nécessaires pour établir des méthodes intégrées de comptabilisation du carbone et de suivi au fil du temps, y compris un suivi à long terme (au-delà de 2050). Ces évaluations des réserves et des stocks de carbone doivent être nationales (accompagnées d’une résolution régionale) et être menées régulièrement (environ tous les cinq ans). Elles devraient également tenir compte de la variabilité interannuelle et de la vulnérabilité aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes et au réchauffement.
Encadré 5.4. Élimination du dioxyde de carbone
L’élimination du dioxyde de carbone (EDC) consiste à extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits. Cela comprend les améliorations humaines existantes et potentielles des puits de dioxyde de carbone biologiques ou géochimiques et le captage et le stockage du carbone directement dans l’air, mais exclut l’absorption naturelle de dioxyde de carbone qui n’est pas directement causée par les activités humaines (voir le glossaire du sixième Rapport d’évaluation du Groupe de travail III du GIEC) (en anglais seulement).
La nécessité de disposer de plus de données scientifiques sur l’EDC est pressante si le Canada veut respecter son engagement de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, ce qui nécessitera le recours à l’EDC pour compenser les émissions de GES restantes qui s’avèrent difficiles à atténuer. Ces besoins scientifiques sont également soulignés par l’importance accordée à l’EDC dans les récents scénarios limitant le réchauffement de la planète à 2 °C ou moins, ainsi que par l’annonce d’importants engagements financiers privés et publics en faveur de projets d’EDC dans le monde entier.
Dans le contexte canadien, les besoins scientifiques de l’EDC se subdivisent en cinq catégories couvrant les sciences physiques, économiques et sociales. Les méthodes clés d’EDC sont les suivantes : captage et stockage du carbone directement dans l’air, bioénergie avec captage et stockage du carbone, biocharbon et solutions fondées sur la nature.
- Risques, compromis et avantages accessoires – Déterminer les principaux risques, compromis et avantages accessoires liés au déploiement de méthodes d’EDC au Canada.
- Faisabilité et répercussions économiques – Pour différents niveaux de déploiement d’EDC (mégatonnes de dioxyde de carbone par an, voir le point 5), déterminer les besoins en énergie et en matériaux sur l’ensemble du cycle de vie, estimer les coûts (y compris ceux de l’infrastructure habilitante) et les répercussions possibles sur le marché du travail, tenir compte de la nécessité d’une décarbonation directe et de l’EDC pour atteindre la carboneutralité, planifier des améliorations techniques et économiques au cours des prochaines décennies, estimer les synergies possibles entre les méthodes d’EDC et optimiser leur déploiement à travers le pays et au fil du temps.
- Gouvernance – Évaluer les cadres réglementaires et de gouvernance pour la recherche dans le monde réel et le déploiement à grande échelle de l’EDC au Canada, élaborer des protocoles pour la surveillance, la déclaration et la vérification de l’EDC, évaluer l’incidence du déploiement de l’EDC pour la déclaration et la comptabilisation des GES, et étudier les implications sociales et politiques des différentes approches de gouvernance pour l’EDC.
- Mobilisation des intervenants – Évaluer l’acceptabilité par la population et élaborer des stratégies pour mobiliser de manière constructive les intervenants sur le déploiement possible de l’EDC.
- Ampleur du déploiement – Estimer l’ampleur du déploiement (mégatonnes de dioxyde de carbone par an) que le Canada doit et peut atteindre pour parvenir à son objectif de carboneutralité d’ici 2050, pour l’EDC dans son ensemble et pour des méthodes précises d’EDC.
Les activités de recherche relevant de ces catégories doivent permettre de déterminer si les études scientifiques existantes sont directement applicables au Canada et s’il faut utiliser l’infrastructure nationale de recherche sur les changements climatiques (p. ex. les laboratoires fédéraux, le réseau d’observation et le calcul de haute performance) pour aller de l’avant.
5.3 Science du lien entre l’eau et le climat
L’eau réagit à l’augmentation des températures dans l’ensemble du système terrestre, ce qui a des répercussions sur la quantité, la qualité et la chimie de l’eau, ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes. Le réchauffement des températures a une incidence sur l’état physique de l’eau dans l’atmosphère (pluie, neige, glace) et à la surface, ce qui a des répercussions en cascade sur la santé humaine, la santé et les services des écosystèmes, la biodiversité, les infrastructures et services communautaires, la culture et la durabilité des secteurs des ressources naturelles. L’eau est impliquée dans d’importantes rétroactions climatiques. Les changements climatiques entraînent une augmentation de la variabilité liée à l’eau et des phénomènes météorologiques extrêmes (tels que les inondations et les sécheresses), le réchauffement et l’acidification des océans, l’évolution de la cryosphère et les changements de répartition des espèces. Cependant, la manière dont les milieux aquatiques, terrestres, cryosphériques, estuariens et marins réagissent aux changements climatiques, à la gestion de l’eau et aux mesures d’atténuation des GES de même qu’aux mesures de gestion de l’eau n’est pas entièrement comprise.
Les effets de l’augmentation des GES atmosphériques sur les écosystèmes aquatiques se manifestent souvent par des modifications de la qualité de l’eau, tant dans les milieux marins que d’eau douce. L’augmentation des températures de l’eau, les modifications des propriétés chimiques de l’eau, l’élévation du niveau de la mer, l’eutrophisation, la salinisation des milieux d’eau douce côtiers, les sécheresses et les inondations ne sont que quelques exemples de changements susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité de l’eau et sur les espèces écosensibles qui vivent dans ces milieux. Les environnements côtiers et arctiques sont particulièrement vulnérables au printemps, car l’augmentation des précipitations ainsi que la fonte des neiges et des glaces peuvent entraîner un afflux d’eau douce et de nutriments plus important. Ces changements peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’eau pour les personnes et les organismes qui en dépendent.
Les risques pour la santé humaine et des écosystèmes qui dépendent du lien entre l’eau et le climat sont notamment les suivants :
- répercussions sur la qualité de l’eau potable et l’eau utilisée à des fins agricoles et récréatives;
- menaces pesant sur l’approvisionnement en eau douce en raison des modifications des sources essentielles attribuables au climat (eau de fonte des neiges saisonnières et des glaciers, modification des régimes de précipitations régionaux);
- maladies d’origine hydrique;
- répercussions sur la biodiversité;
- blessures physiques et répercussions sur la santé mentale causées par les effets des inondations extrêmes sur les infrastructures et les services à l’échelle locale ou régionale; et
- répercussions sur l’eau et la sécurité alimentaire.
La science du lien entre l’eau et le climat guide les interventions visant à préserver la santé des écosystèmes aquatiques et terrestres. Elle améliore la confiance dans les outils permettant de prévoir l’approvisionnement en eau et d’améliorer ou de maintenir la qualité de l’eau pour les communautés et pour les secteurs des ressources naturelles. Cette science permet également de planifier la réduction des risques liés aux extrêmes et aux phénomènes météorologiques extrêmes hydroclimatiques, notamment les inondations, les tempêtes, les feux de forêt, la sécheresse et les efflorescences algales nuisibles. Ces défis nécessitent la mobilisation de la science occidentale et autochtone, ainsi que des partenariats avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis et leurs communautés, qui sont les intendants de l’eau dans de vastes régions du Canada.
Le regroupement des preuves scientifiques pour gérer efficacement les ressources en eau est complexe, mais nécessaire afin que les décideurs et les utilisateurs finaux disposent d’informations et d’outils clairs et compréhensibles pour prendre des décisions et des mesures appropriées. Les priorités scientifiques sont les suivantes :
R1 (LEC). Comprendre la future durabilité de l’eau, notamment en matière d’approvisionnement, de demande, de qualité et d’effets sur la santé des personnes et des écosystèmes. Des efforts scientifiques transdisciplinaires sont nécessaires pour comprendre le rôle de l’eau douce et projeter sa durabilité dans les décennies à venir. La durabilité signifie un équilibre entre l’utilisation des ressources en eau et la santé, les fonctions et les services des écosystèmes. Cette compréhension comprend dans quelle mesure l’approvisionnement en eau douce est vulnérable aux changements climatiques et si l’approvisionnement permettra de répondre à l’augmentation attendue de la demande des êtres humains et des écosystèmes. Cela sous-tend la recherche dans les domaines suivants et est essentiel pour déterminer le lieu et la saison où le futur réchauffement menace l’approvisionnement en eau et sa qualité. La gestion intégrée durable et la prise de décision devraient porter sur les questions suivantes :
- incidence du climat sur l’utilisation de l’eau douce et répercussions sur les utilisateurs de l’eau tels que les communautés agricoles et urbaines;
- pollution par les contaminants et les nutriments;
- la santé de l'habitat aquatique, y compris l'impact des espèces envahissantes; et
- les changements prévus dans les phénomènes météorologiques extrêmes (p. ex. inondations, sécheresses), leurs impacts sociaux et leurs implications pour l’infrastructure des ressources en eau.
La durabilité de l’eau douce implique l’intégration des exigences propres à certaines communautés et à la santé publique ainsi que la protection des écosystèmes et de leurs services, comme les opérations durables dans les secteurs des ressources naturelles (voir le chapitre 4.4, Ressources naturelles durables). La production d’énergie hydroélectrique continue de faire partie intégrante des énergies renouvelables dans de nombreuses régions. Des recherches sont nécessaires pour comprendre l’incidence des changements induits par le climat dans les régimes de débit sur la capacité et la résilience de l’énergie hydroélectrique. Une meilleure compréhension contribuera à la surveillance et à la gestion des ressources en eau douce, à l’échelle nationale et régionale.
Il est nécessaire de comprendre l’approvisionnement et la demande en eau douce à long terme au Canada afin d’élaborer des méthodes et des modèles permettant de prédire le moment et la gravité des contraintes d’approvisionnement dans les systèmes d’eau douce. Ces méthodes et ces modèles peuvent également contribuer à répondre aux demandes d’eau des ménages, des entreprises agricoles et de l’industrie, en particulier pendant les épisodes de chaleur extrême et les sécheresses. Cette recherche nécessite des efforts de collaboration pour établir des prévisions (saisonnières, selon une échelle locale ou régionale) ainsi que des projections (à long terme) de la future capacité de charge en eau douce pour les principaux bassins versants. Cela sera d’autant plus important que les modifications du manteau neigeux et la fonte des glaciers ont une incidence à la fois sur le moment et la quantité du ruissellement des eaux de fonte vers les systèmes hydrologiques. Ces prévisions et projections pourront servir de base à la planification de l’approvisionnement en eau douce et des infrastructures.
Les renseignements scientifiques à plusieurs échelles (p. ex. locale ou urbaine, régionale, écosystème, bassin versant) sont essentiels pour soutenir la gestion et l’intendance intégrées de l’eau douce.
R2 (LEC). Modéliser les risques liés à l’eau pour la santé des êtres humains et des écosystèmes, ainsi que la charge de morbidité (maladies et décès) due à la poursuite du réchauffement. Les modifications de la qualité et de la quantité de l’eau attribuables au climat ont des conséquences tant pour les écosystèmes naturels que sur la disponibilité et la salubrité de l’eau douce pour la consommation humaine. Les répercussions varient selon les régions et comprennent le réchauffement des eaux, l’augmentation des sédiments associés au dégel du pergélisol, les modifications du niveau de la mer, les inondations, les sécheresses, les modifications du régime des précipitations et l’augmentation du ruissellement terrestre. D’autres effets peuvent également perturber la santé des écosystèmes aquatiques et éroder leur capacité à fournir des services écosystémiques, notamment la sécurité alimentaire et hydrique des Canadiens. Des recherches sont nécessaires pour élaborer de nouvelles approches de surveillance et méthodes d’analyse renforcées pour détecter les risques sanitaires nouveaux ou précédemment rares. Ces approches et méthodes peuvent être appliquées pour élaborer des mesures efficaces visant à protéger la santé des êtres humains et des écosystèmes aquatiques. Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les feux de forêt, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations, peut entraîner une contamination, des pénuries ou le ruissellement de l’eau douce, une eutrophisation et d’autres problèmes. Les modifications de la qualité et de la quantité de l’eau peuvent avoir des effets en cascade sur la santé et le bien-être des communautés et des personnes, ce qui risque d’exacerber les inégalités sociales existantes. Les modifications des ressources en eau attribuables au climat peuvent également avoir une incidence sur la santé et le bien-être en entravant l’accès aux aliments traditionnels, en ayant des répercussions négatives sur l’agriculture et le tourisme, et en nuisant à la sécurité des déplacements et des lignes d’approvisionnement (p. ex. routes de glace) dans certaines communautés (p. ex. côtières, arctiques et nordiques).
Pour agir sur les risques modélisés, la recherche doit faire progresser la protection des sources d’eau et les interventions de santé publique de manière équitable et efficace, grâce à des cadres scientifiques transdisciplinaires et à des programmes d’acquisition des données nécessaires. Ces données peuvent servir à développer une compréhension mécaniste, de nouvelles technologies et des modèles permettant d’évaluer la charge de morbidité liée aux effets des changements climatiques sur la qualité et la quantité de l’eau. Les efforts visant à protéger la santé de ces effets doivent s’appuyer sur une compréhension des besoins des personnes les plus exposées, élaborée conjointement avec les communautés et les groupes concernés, dans la mesure du possible.
5.4 Science des changements climatiques dans l’Arctique
Encadré 5.5. Contexte scientifique dans l’Arctique
L’Inuit Nunangat, soit la patrie des Inuit et les zones de revendications territoriales établies, s’étend sur l’ensemble de l’Arctique canadien et représente 40 % de la masse terrestre du Canada. D’autres groupes autochtones, dont les Premières Nations et les Métis, résident également dans la région sur des territoires non cédés. Par conséquent, le Canada doit collaborer avec les communautés scientifiques mondiales sur la nature des recherches menées dans l’Arctique et sur la manière dont les sciences dans l’Arctique sont planifiées, dirigées, mises en œuvre et communiquées. Il s’agit notamment de prendre en compte la capacité scientifique de l’Arctique, l’infrastructure, la diffusion des connaissances et les partenariats, y compris l’élaboration conjointe et la direction d’initiatives de recherche avec les communautés autochtones.
Au cours des dernières décennies, la température de l’Arctique a augmenté trois à quatre fois plus rapidement que la moyenne mondiale, en raison des rétroactions climatiques qui amplifient les changements climatiques. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes en raison du lien culturel étroit que les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les autres habitants de l’Arctique entretiennent avec l’environnement naturel (voir l’encadré 5.5, Contexte scientifique dans l’Arctique). Les changements induits par le climat dans l’Arctique ont également des conséquences mondiales. Celles-ci comprennent :
- la réduction de l’albédo (réflexion de la lumière solaire vers l’espace) due à la diminution de la couverture neigeuse et glaciaire de l’Arctique, qui amplifie le réchauffement;
- d’importantes émissions de carbone dues au dégel du pergélisol;
- des modifications du comportement du courant-jet (dues à l’amplification du réchauffement de l’Arctique et à la réduction de la glace de mer); et
- l’élévation du niveau mondial de la mer associée à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires (dont une grande partie provient actuellement de l’Arctique canadien et du Groenland).
Ces effets globaux ont également des répercussions sur toutes les régions du Canada. Étant donné que l’Arctique influe sur les changements climatiques et en subit aussi les conséquences, les priorités de la recherche dans l’Arctique sont pertinentes pour tous les thèmes et sujets abordés dans le présent rapport.
L’Arctique de demain sera très différent de celui d’aujourd’hui. La science du climat est essentielle pour guider des activités d’adaptation et d’atténuation efficaces et fondées sur des données probantes dans tout le Canada arctique et subarctique.
La manière dont la recherche sur l’Arctique est planifiée, menée et réalisée au Canada est tout aussi cruciale que la nature elle-même de la science appliquée à l’Arctique. Les gouvernements et le milieu de la recherche doivent faire participer activement les organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis en tant que partenaires dans l’établissement et le traitement des priorités en matière de sciences et de savoir dans le Nord canadien. Des initiatives communautaires doivent être mises en œuvre dans le cadre de l’autodétermination en matière de surveillance environnementale, rendue possible par le renforcement des capacités du Nord. Les changements climatiques sont le principal facteur du changement environnemental dans l’Arctique, et la recherche sur le climat doit s’appuyer sur les systèmes de savoir autochtones. Ces systèmes de savoir devraient être mieux intégrés dans la conception de la recherche et la surveillance des conditions environnementales, lesquelles ont une incidence sur les facteurs sociaux, culturels et sanitaires des communautés du Nord.
La coproduction des connaissances, la mise en commun de l’information et la prise de décision fondée sur des données probantes sont des principes fondamentaux pour les activités de recherche et de synthèse et mobilisation du savoir dans le Nord canadien. La capacité actuelle de recherche dans l’Arctique est vaguement coordonnée entre une série d’institutions, d’intervenants, de détenteurs de droits et de programmes (p. ex. les ministères fédéraux et territoriaux ainsi que les réseaux universitaires comme ArcticNet et PermafrostNet). Il est possible d’accroître l’élaboration conjointe, la cogestion et la coordination dans ces domaines.
Un système de savoir et de sciences sur le climat de l’Arctique canadien doit être établi pour répondre aux besoins de renseignements sur le climat dans les régions et les communautés nordiques. Il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur les droits, sur la base de partenariats avec des représentants des Premières Nations, des Inuit et des Métis et dans le respect des systèmes de savoir multiples.
La capacité scientifique accrue dans le Nord devrait être structurée de manière à inclure la surveillance communautaire ainsi que l’analyse participative de scénarios, la planification et la gouvernance. Ces approches scientifiques sont essentielles pour parvenir à une intendance des écosystèmes fondée sur la résilience et à une gouvernance adaptative. Elles peuvent également aider à préserver les moyens de subsistance et le bien-être des personnes face à l’évolution des conditions environnementales. Les possibilités de formation et les installations de recherche dans le Nord (p. ex. la capacité des laboratoires) doivent être développées de manière continue. La communication et la coordination entre les réseaux scientifiques du Sud et du Nord peuvent être améliorées par le renforcement des capacités des courtiers des connaissances et des médiateurs communautaires.
La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques (PDF) préparée par l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) constitue une base solide pour établir les priorités scientifiques dans l’Arctique. Les cinq domaines thématiques établis par l’ITK (connaissances et capacités, santé, bien-être et environnement, systèmes alimentaires, infrastructures et énergie) correspondent directement aux priorités scientifiques de ce rapport. Ces priorités pour la recherche sur le climat arctique font partie d’un cadre qui peut être révisé pour inclure des perspectives supplémentaires et changeantes.
Les quatre principales priorités de recherche cadrent parfaitement avec les domaines thématiques établis par l’ITK (R1 – santé, bien-être et environnement, R2 – systèmes alimentaires, R3 – infrastructures et R4 – énergie) :
R1 (CCA). Comprendre l’influence des changements climatiques sur les activités traditionnelles et culturelles. La recherche est nécessaire pour :
- mettre en œuvre des programmes de surveillance innovants et collaboratifs pour les milieux terrestres, cryosphériques, d’eau douce et marins;
- comprendre l’évolution des conditions de l’océan Arctique et de la glace de mer; et
- améliorer la modélisation du système terrestre et les prévisions météorologiques, glaciaires, hydrologiques et océanographiques.
Ces travaux contribueront à l’élaboration d’approches visant à réduire les effets des changements climatiques sur les pratiques traditionnelles, les activités culturelles, la santé et la sécurité publiques, la mobilité ainsi qu’à la sécurité alimentaire des Canadiens des régions nordiques.
R2 (CCA). Mener des recherches pour soutenir des systèmes alimentaires sûrs et durables et surveiller l’exposition des habitants du Nord aux maladies infectieuses émergentes d’origine alimentaire et hydrique, aux contaminants et aux parasites. Les changements climatiques influent fortement sur les risques liés aux systèmes alimentaires. Les priorités de la recherche comprennent une meilleure compréhension du chevauchement des changements climatiques et écosystémiques, notamment les incidences sur la santé humaine et les menaces pour la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. Dans le Nord, les systèmes alimentaires comprennent la récolte traditionnelle de végétaux et d’animaux sauvages et les aliments au marché. Des recherches sont nécessaires pour évaluer les risques que les changements climatiques font peser sur l’accès aux aliments traditionnels et aux aliments au marché. Une surveillance est également nécessaire pour évaluer l’exposition des habitants du Nord aux maladies infectieuses d’origine alimentaire et hydrique, aux contaminants et aux parasites. Il importe notamment d’évaluer la résilience des communautés face à ces risques.
R3 (CCA). Réaliser une cartographie des risques et des évaluations de la vulnérabilité afin d’orienter la planification de l’adaptation pour les infrastructures construites dans les communautés du Nord. La connaissance des risques et de la vulnérabilité servira de base à la recherche dans le but de cerner les mesures d’adaptation nécessaires pour les infrastructures (routes, pistes d’atterrissage, bâtiments, quais) et les transports (véhicules, air, navigation), ce qui inclut une meilleure connaissance des futures conditions de glace et des perturbations du paysage dues au dégel du pergélisol et à l’érosion côtière. Les principaux résultats guideront la construction d’infrastructures résistantes au climat et durables, tout en répondant aux préférences et aux besoins culturels.
R4 (CCA). Concevoir des programmes de surveillance qui intègrent les observations de surface et les données satellitaires (missions existantes et prévues) afin de suivre les principaux indicateurs climatiques et de déterminer les risques liés à l’évolution des perturbations (comme les feux de forêt et la fonte de la glace de mer). De nouvelles missions satellitaires doivent être mises en œuvre pour combler les lacunes d’observations nationales (voir l’encadré 5.3, Combler les lacunes dans les observations atmosphériques de l’Arctique). Ces missions nous aideront à comprendre et à mesurer les changements cryosphériques (p. ex. l’équivalent en eau de la neige, l’épaisseur de la neige sur la glace de mer, l’état des rivières, des lacs et de la glace de mer) et les flux de GES à l’échelle du paysage. Nous devons adopter une approche coordonnée à l’échelle nationale pour le déploiement et l’entretien des instruments et soutenir les réseaux d’observation. Cette approche doit être soutenue par une infrastructure scientifique améliorée (p. ex. une meilleure capacité de télécommunication pour une transmission de données abordable et en temps quasi réel).
R5 (CCA). Faire progresser et évaluer les modèles du système terrestre afin de mieux représenter les processus atmosphériques, cryosphériques, hydrologiques, océanographiques, écologiques et du cycle du carbone dans les régions nordiques. L’amélioration de la compréhension et de la représentation du cycle du carbone est une priorité définitive pour pouvoir évaluer les futurs flux de carbone (sources et puits) provenant du dégel du pergélisol, de l’évolution de la forêt boréale (dont le nombre croissant de feux de forêt), de l’expansion de la végétation de la toundra et du réchauffement de l’océan Arctique. La compréhension de l’évolution des conditions de l’eau douce et de la glace de mer dans l’océan Arctique permettra d’établir des projections sur la stratification et l’acidification de l’océan Arctique, ainsi que sur les conséquences pour les écosystèmes, la pêche, la sécurité alimentaire et l’absorption du carbone. Les capacités de prévision météorologique doivent être améliorées pour mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont courants dans le Nord du Canada (brouillard, pluie verglaçante, blizzards). Des progrès sont nécessaires dans la prévision des rivières, des lacs, des océans et de la glace de mer à des échelles de temps opérationnelles (en temps quasi réel), saisonnières et décennales pour la sécurité, la navigation et le commerce. Des recherches sont également nécessaires pour mieux comprendre :
- le forçage climatique et les rétroactions dues à l’évolution des nuages et des aérosols dans l’Arctique;
- l’incidence des changements climatiques sur les contaminants (y compris le dépôt de carbone noir sur la neige et la glace, les changements du taux de mercure dans les environnements terrestres, aquatiques et marins);
- les conséquences écologiques des croûtes de glace résultant des pluies hivernales;
- l’évolution des conditions de l’océan Arctique; et
- les effets pour les écosystèmes marins, la navigation, la sécurité et le développement économique de l’Arctique.
Les changements physiques et écosystémiques qui se produisent dans l’Arctique canadien ne peuvent pas être envisagés dans une optique de disciplines individuelles. Les changements climatiques et environnementaux interreliés dans l’Arctique créent des effets et des risques en cascade. Une compréhension holistique et transdisciplinaire est nécessaire pour déterminer l’efficacité et les limites des stratégies visant à réduire les risques climatiques ainsi qu’à améliorer la résilience et la durabilité des écosystèmes et des populations de l’Arctique.
La priorité de la mobilisation des connaissances correspond au thème des connaissances et du renforcement des capacités de l’ITK.
MC1 (CCA). Élaborer conjointement une approche distribuée pour fournir des services climatiques aux communautés du Nord afin d’éclairer la prise de décision sur la base de données probantes. Cette priorité vise à garantir que les communautés du Nord disposent de renseignements sur le climat basés sur le territoire. Les organisations de prestation de services climatiques peuvent contribuer à améliorer la compréhension des vulnérabilités, des risques et des possibilités actuels liés au climat, ainsi qu’à soutenir la planification et la prise de décision afin de permettre aux habitants du Nord d’être plus résilients face aux effets attendus des changements climatiques futurs.
5.5 Science du lien entre l’approche « Une seule santé » et les changements climatiques
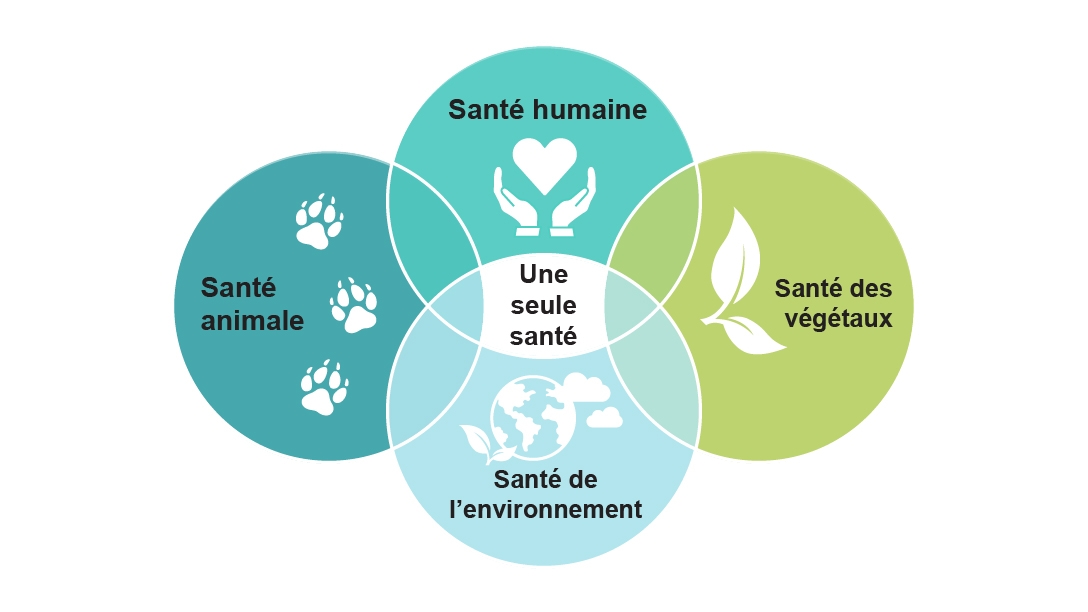
Description textuelle
Un diagramme de Venn de la santé humaine, de la santé végétale, de la santé environnementale et de la santé animale, qui se chevauchent tous au niveau d’une seule santé.
Les risques liés aux changements climatiques sont complexes et interconnectés, et les effets peuvent se propager dans les systèmes naturels et humains, mais de manière difficile à prévoir. L’étude de ces interconnexions dans l’optique d’un lien entre « Une seule santé » et les changements climatiques favorise une adaptation fondée sur la science. « Une seule santé » est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire qui vise à obtenir des résultats optimaux en matière de santé en reconnaissant l’interconnexion entre les personnes, les animaux, les végétaux et leur environnement commun, dont les écosystèmes aquatiques et terrestres (voir l’encadré 5.6, Une seule santé). En adoptant une approche « Une seule santé » pour lutter contre les changements climatiques, nous pouvons :
- mieux comprendre les effets des changements climatiques sur l’équité en matière de santé et sur la santé des Canadiens, des animaux, des végétaux et de l’environnement;
- trouver des approches collaboratives, efficaces et avantageuses sur le plan économique pour l’adaptation et l’atténuation (p. ex. la surveillance, la prévention et la gestion des risques, ainsi que des conseils pour soutenir la prise de décision réglementaire); et
- éviter les mesures d’adaptation et les réponses en silos qui ont des avantages limités ou ont des effets négatifs en dehors du secteur ciblé.
D’importantes lacunes dans les connaissances et des problèmes d’accessibilité, d’échange et d’interopérabilité des données limitent notre compréhension actuelle des répercussions interconnectées des changements climatiques sur la santé. Pour combler ces lacunes, faire progresser la collaboration et cerner les possibilités interdisciplinaires en matière d’adaptation, il faut réaliser les activités de recherche et de synthèse des connaissances décrites ci-dessous.
Encadré 5.6. Une seule santé
Telle que définie par l’Organisation mondiale de la Santé, « Une seule santé » est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des végétaux et de l’environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. Cette approche mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société afin de travailler ensemble pour favoriser le bien-être et lutter contre les menaces pesant sur la santé et les écosystèmes. Simultanément, ces secteurs, disciplines et communautés pourraient répondre au besoin collectif :
- d’eau, d’énergie et d’air propres;
- d’aliments sûrs et nutritifs; et
- de prise de mesures de lutte contre les changements climatiques.
R1 (LSSCC). Approfondir la compréhension des risques et des facteurs de changement à l’interface entre les humains, les animaux, les végétaux et l’environnement. Les changements climatiques continuent d’entraîner des effets synergiques (aussi appelés effets « intégrés complexes ») sur la santé des Canadiens, des animaux, des végétaux et de leur environnement commun. Ces effets sont attribuables à des phénomènes météorologiques extrêmes et à des changements à évolution lente, associés à une dégradation sans précédent de l’environnement, des inégalités sociales, de même qu’aux changements de la biodiversité, d’affectation des terres et de la démographie. Ces répercussions peuvent apparaître de manière inattendue en raison d’un manque de compréhension de la portée et de l’échelle des changements des écosystèmes, de la manière dont ces changements peuvent se croiser et des effets qu’ils auront sur la santé (la "santé" étant définie dans cette section comme la santé des Canadiens, des animaux, des plantes et de leur environnement commun). Il est nécessaire de mieux comprendre et de détecter les tendances actuelles, émergentes et souvent convergentes grâce à de meilleures capacités en matière de prévision, de modélisation, d’évaluation des risques, de surveillance et de diagnostic en laboratoire, notamment en ce qui a trait à :
- l’examen de la sensibilité de divers agents pathogènes, parasites et populations préoccupantes (p. ex. espèces envahissantes, vecteurs de maladies) aux changements climatiques afin de déterminer où et quand ceux-ci peuvent émerger ou émerger à nouveau au Canada;
- la prévision des changements dans l’écologie et les aires de répartition des espèces (p. ex. végétaux, faune, espèces envahissantes, vecteurs de maladies) en raison des changements climatiques et la façon dont l’interaction humaine, l’exposition et les facteurs socioéconomiques peuvent interagir avec ces changements; et
- la compréhension de l’influence des inégalités en matière de santé et des déterminants sociaux de la santé sur la vulnérabilité aux changements climatiques, exposant certaines populations à un risque accru d’aléas sanitaires liés aux changements climatiques ainsi qu’en créant des obstacles et des difficultés pour accéder aux mesures d’adaptation protectrices.
R2 (LSSCC). Faire progresser les approches transdisciplinaires ainsi que les modes de connaissance des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière d’échange de connaissances, de tressage des données et d’analyse. La nature complexe et interdépendante de la santé souligne le besoin d’adopter des approches coordonnées, collaboratives et intersectorielles, qui permettent à diverses équipes multidisciplinaires de mieux collaborer pour comprendre, évaluer, collecter, synthétiser et analyser les questions transversales. L’approche « Une seule santé » s’harmonise bien avec les sciences et le savoir autochtones, y compris une vision holistique de la santé qui lie la santé et le bien-être des humains, des animaux, des végétaux et de leur environnement commun. Les modes de connaissance des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans ce domaine de recherche introduiront de nouvelles approches pour la collecte, l’utilisation, l’échange et l’analyse des données socioéconomiques et environnementales. Ces approches nous aideront à mieux comprendre les effets, les risques et les solutions d’adaptation liés au climat. Pour cela, il faut :
- adopter des approches multisectorielles intégrées pour les systèmes de renseignement (collecte d’information pour déterminer les risques) et de surveillance des risques pour une alerte, une détection et une évaluation du risque précoces des menaces pour la santé;
- perfectionner les capacités des partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis, et conjuguer les sciences et les modes de connaissance autochtones avec les connaissances occidentales pour mener des projets de recherche et de surveillance sur les changements climatiques et divers risques sanitaires, en particulier les infections zoonotiques et la sécurité et la salubrité alimentaires;
- favoriser les innovations en matière d’évaluation des effets cumulatifs et de capacité de gestion des risques intersectoriels, ce qui permettra au Canada de mieux protéger la santé des personnes et des communautés, les écosystèmes ainsi que la santé des végétaux et des animaux; et
- évaluer les interfaces et les cadres existants à l’approche « Une seule santé » et les intégrer dans le contexte canadien.
La priorité pour la mobilisation des connaissances est la suivante :
MC1 (LSSCC). Mettre au point des outils interactifs et transdisciplinaires d’aide à la décision et de visualisation, favorisant la prise de décision et la gestion des écosystèmes. L’approche « Une seule santé » offre une possibilité d’intégrer des flux de données qui ne se sont pas traditionnellement croisés. Pour que les chercheurs et les utilisateurs de données puissent accéder aux renseignements dont ils ont besoin pour effectuer de la recherche transdisciplinaire, il faut :
- une infrastructure de données, y compris le calcul de haute performance (voir le chapitre 6, Faire progresser la science des changements climatiques);
- une surveillance communautaire intégrée; et
- des flux de données appropriés, accessibles et interopérables.
La surveillance de la santé publique, l’intelligence artificielle et les mégadonnées seront essentielles pour remédier aux lacunes en matière de sciences et de savoir. Pour mobiliser l’information, renforcer la collaboration et les partenariats externes, il importe d’établir des réseaux, des lieux de rencontre et des forums avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis.
L’avancement de ces priorités scientifiques permettra :
- d’atteindre les objectifs de l’approche « Une seule santé »;
- d’adopter une approche multisectorielle, transdisciplinaire et systémique; et
- d’intégrer les modes de connaissance des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
Ces principaux résultats permettront d’améliorer la surveillance, la prévision et la communication pour protéger les personnes, les économies, l’approvisionnement alimentaire et les systèmes naturels contre les risques climatiques actuels et futurs.
5.6 La science des voies critiques vers la carboneutralité
Cette recherche de convergence porte sur les voies de décarbonation, conformément à l’engagement pris par le Canada de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. La science des voies critiques explore les processus biophysiques, technologiques et socioéconomiques interreliés et impliqués dans la décarbonation. Ses priorités visent à faire comprendre les considérations sociales, institutionnelles et politiques, y compris les possibilités et les obstacles en vue d’une décarbonation réussie. Ce thème englobe également de multiples approches, modèles et méthodes, et reflète divers courants de connaissances et de valeurs pour comprendre – et finalement orienter – un changement transformationnel. Les priorités scientifiques sont ancrées dans les besoins des utilisateurs et les principes de la science ouverte, conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.
Les voies vers la carboneutralité sont bien plus que des lignes sur un graphique. Comme l’indique clairement le sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, les voies vers la carboneutralité requièrent des transformations systémiques dans tous les secteurs de la société pour réduire les émissions et obtenir des résultats sur le plan de la résilience, de l’adaptation et, plus largement, du développement durable. Cet effort trace la voie de l’avenir du Canada dans un monde sous contrainte carbone, y compris les changements sous-jacents dans la technologie, l’infrastructure, la politique, les institutions, les modèles d’affaires, les marchés, les comportements, la main-d’œuvre, la culture et les croyances, ainsi que de nombreux autres facteurs. Pour comprendre l’ampleur de ce changement, l’analyse des voies doit intégrer les changements sociaux et comportementaux, ainsi que les effets distributifs et les principes d’équité et de justice.
La science des voies critiques vers la carboneutralité repose sur les efforts de multiples disciplines et englobe divers flux de connaissances, modes de connaissance et valeurs qui informent les réponses sociétales aux changements climatiques.
Le cadre conceptuel de la science des voies critiques vers la carboneutralité, qui reflète les processus itératifs de développement, d’évaluation et de suivi des connaissances, est présenté à la figure 5.1. L’ingénierie et les sciences naturelles peuvent contribuer à comprendre les dimensions biophysiques et technico-économiques, en couvrant les puits et les cycles du carbone ainsi que les solutions climatiques technologiques et fondées sur la nature. Les sciences sociales et humaines peuvent apporter des contributions essentielles aux dimensions sociopolitiques et politiques nécessaires pour éclairer cette recherche et fournir des résultats pratiques. Les études sur la transition, l’innovation et l’histoire des sciences et des technologies offrent un aperçu de la manière dont les grands systèmes, tels que l’électricité, les transports et l’agroalimentaire, ont évolué au fil du temps. Ces efforts doivent également s’appuyer sur les arts et les sciences humaines afin de développer la capacité à envisager d’autres avenirs, de promouvoir la facilité d’utilisation et de favoriser l’apprentissage et les changements d’attitude.
Figure 5.1. Cadre conceptuel de la science des voies critiques vers la carboneutralité, reflétant les processus itératifs de développement, d’évaluation et de surveillance des connaissances.
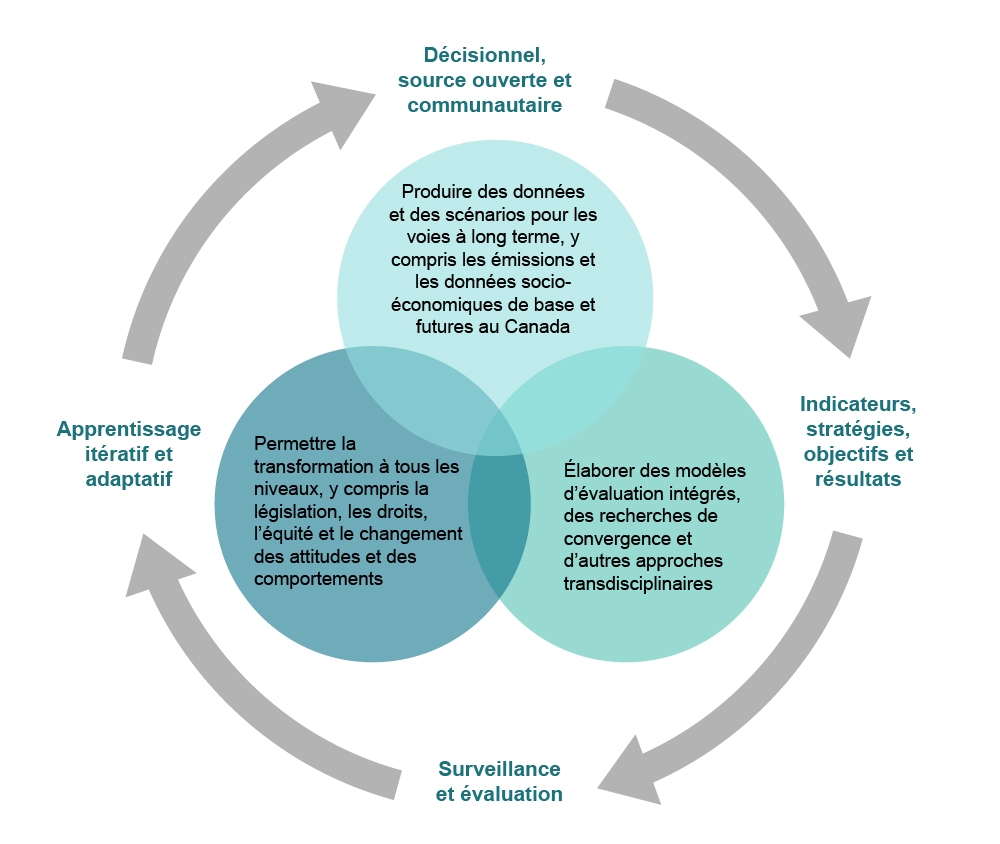
Description textuelle
Graphique conceptuel pour la science des voies critiques vers la carboneutralité, reflétant les processus itératifs de développement, d’évaluation et de surveillance des connaissances.
Le cycle se compose de quatre étapes:
- Décisionnel, source ouverte et communautaire
- Indicateurs, stratégies, objectifs et résultats
- Surveillance et évaluation
- Apprentissage itératif et adaptatif
Le diagramme de Venn à l’intérieur du cycle se compose des éléments suivants :
- Produire des données et des scénarios pour les voies à long terme, y compris les émissions et les données socio-économiques de base et futures au Canada
- Permettre la transformation à tous les niveaux, y compris la législation, les droits, l’équité et le changement des attitudes et des comportements
- Élaborer des modèles d’évaluation intégrés, des recherches de convergence et d’autres approches transdisciplinaires
Les priorités de recherche sont les suivantes :
R1 (VCCN). Développer des connaissances fondamentales sur les considérations sociétales et économiques pour élaborer des scénarios de carboneutralité en vue du changement transformationnel au Canada.
- Reconnaître les tendances et les changements socioéconomiques qui conduiront à des réductions d’émissions grâce à des méthodes telles que l’analyse prospective, la recherche sur l’avenir et l’élaboration de scénarios (p. ex. urbanisation, électrification, numérisation).
- Réaliser des modèles d’évaluation économique et intégrée qui reflète la complexité des sphères technologiques, économiques et sociales, y compris les autres paradigmes économiques.
- Analyser et comparer les voies au moyen de projets de comparaison de modèles (p. ex. ceux organisés par le Programme mondial de recherche sur le climat ou le Forum de modélisation de l’énergie) et d’évaluations scientifiques. Dans ces comparaisons, il convient de prendre en compte les objectifs environnementaux non liés au climat ainsi que le développement durable.
- Intégrer la prise en compte des voies canadiennes par rapport aux voies régionales et mondiales afin de comprendre les influences externes sur les voies vers la carboneutralité du Canada.
R2 (VCCN). Comprendre les processus sociopolitiques, attitudinaux et comportementaux des voies vers la carboneutralité et améliorer la façon dont ils sont intégrés dans les modélisations et les analyses.
- Tirer parti des connaissances attitudinales et comportementales pour comprendre comment donner les moyens aux Canadiens de prendre des décisions éclairées et d’adopter de nouvelles pratiques, par exemple en renforçant les capacités et en améliorant l’échange d’informations.
- Établir un lien entre les connaissances en sciences sociales et les considérations économiques, énergétiques et technologiques, afin d’explorer les liens entre les réglementations et les politiques, les mesures incitatives économiques, les campagnes de marketing social, les changements à l’échelle locale et les avantages accessoires de la lutte contre les changements climatiques, afin de comprendre leur influence sur l’action vers la carboneutralité.
- Comprendre l’efficacité de la politique climatique, des mesures incitatives, des réglementations, de la gouvernance et des responsabilités juridictionnelles afin de mieux adapter les programmes de carboneutralité de manière à ce qu’ils trouvent un écho auprès du public et l’incitent à progresser.
- Intégrer diverses formes de création de connaissances et de nouvelles perspectives. Il s’agit notamment de donner la priorité à de nouvelles voix susceptibles d’élargir l’adoption de ces approches ainsi que la science et les perspectives autochtones. Les perspectives des jeunes, de personnes de genre et d’origine ethnique divers et des voix historiquement et actuellement marginalisées sont toutes nécessaires pour élargir la base de connaissances et les cadres de référence vers un futur carboneutre. Cela peut se faire par la coproduction de propositions de modifications du système actuel.
R3 (VCCN). Élaborer une stratégie nationale de modélisation des voies vers la carboneutralité afin d’éclairer le changement transformationnel au Canada.
- Créer une communauté de scientifiques pour travailler sur des modèles de voies vers la carboneutralité dans un environnement de recherche ouvert et axé sur la prise de décision. Cet effort inclurait des modèles d’évaluation intégrés et permettrait l’élaboration transparente de modèles et l’intercomparaison de modèles et de résultats. S'inspirer, dans la mesure du possible, d'exemples et d'outils de modélisation internationaux.
- Faire progresser la compréhension du potentiel des solutions concurrentes qui permettent l’adaptation, la résilience et le développement durable.
- Améliorer la représentation des multiples facteurs de changement socioéconomique grâce à des approches systémiques et des recherches sur l’avenir (étude des avancées sociales et technologiques). Au fur et à mesure de l’évolution des approches de modélisation, les modèles devraient comporter moins d’incertitude et mieux répondre aux divers besoins d’information, afin d’éclairer la planification de la carboneutralité dans divers contextes régionaux et sectoriels.
- Il est nécessaire de disposer de modèles capables d’analyser les voies vers la carboneutralité au-delà du maintien du statu quo ou des changements progressifs, afin de refléter les processus de transformation permettant d’atteindre et de maintenir la carboneutralité. Si les modèles actuels ont été conçus pour un objectif donné dans un contexte précis, ils doivent être développés davantage pour permettre l’exploration de nouveaux scénarios comprenant des changements radicaux (changements d’étape dans les technologies, mais aussi crises et développements inattendus).
La capacité de la science des voies critiques au Canada se développe rapidement, des centres d’expertise émergeant dans toute la société. Or, pour orienter les voies vers la carboneutralité, il une plus grande coordination pour rendre disponibles des renseignements utilisables et pertinentes. De même, pour faire avancer ces priorités scientifiques, il faudra développer notablement les approches systémiques et transdisciplinaires. Ce thème de recherche de convergence met l’accent sur l’importance d’ouvrir le processus d’élaboration des voies vers de multiples perspectives et approches disciplinaires qui intègrent des données de source ouverte et des hypothèses transparentes et reflètent l’éventail des perspectives sociales, économiques, technologiques et considérations climatiques futures nécessaires pour faire avancer rapidement le Canada vers son objectif de carboneutralité. Ces approches contribueront à renforcer les capacités de la science des voies critiques du Canada et à acquérir des connaissances sur les principales caractéristiques de ces voies, notamment l’adoption de technologies, l’incertitude, les normes, la culture, la politique, l’équité et la justice. L’ensemble des connaissances et les capacités des laboratoires d’idées du Canada, du secteur privé, des institutions universitaires, de la société civile, des organisations artistiques, des peuples et des organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que les gouvernements sont nécessaires pour faire progresser la science des voies critiques. Cette science permettra au Canada d’envisager et d’évaluer sa transition vers un avenir résilient et carboneutre.
5.7 Recherche sur les changements climatiques et développement durable
La contribution du Groupe de travail III au sixième Rapport d’évaluation du GIEC constate, avec un niveau de confiance élevé, qu’une lutte accélérée et équitable contre les changements climatiques est essentielle au développement durable, étant donné le lien étroit entre le développement durable, la vulnérabilité et les risques climatiques. La recherche sur les changements climatiques et les mesures de lutte contre ces derniers sont essentielles au développement durable au Canada (voir l’encadré 5.7, Développement durable). Une participation équitable et importante de tous les acteurs concernés à la prise de décision en matière d’atténuation et d’adaptation facilite le passage à la durabilité.
Au Canada, la Loi fédérale sur le développement durable soutient le développement durable en vue d’améliorer la qualité de vie des Canadiens et de prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques. La loi définit les principes du développement durable, à savoir qu’il est fondé sur une utilisation efficace des ressources naturelles, sociales et économiques, et que le gouvernement du Canada doit intégrer les facteurs environnementaux, économiques et sociaux dans toutes ses décisions.
La recherche devrait s’attacher à comprendre la façon dont la science et la lutte contre les changements climatiques, notamment les activités d’atténuation et d’adaptation, peuvent influer sur le développement durable. Il s’agit notamment de soutenir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, de renforcer l’interface science-politique et de diffuser les expériences et les pratiques exemplaires en matière de développement durable.
Encadré 5.7. Développement durable
La signification de développement durable continue d’évoluer. Dans le rapport Brundtland de 1987 intitulé Notre avenir à tous, il a été défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins ». Il a été conceptualisé sous la forme de « trois piliers » ou de « dépendances imbriquées », comportant des dimensions sociales, économiques et environnementales. D’autres concepts de développement durable comprennent également la substitution de technologies et de compétences aux avantages traditionnellement fournis par la nature ou les écosystèmes.
Parmi les éléments du développement durable, les relations entre les éléments sociaux, économiques et environnementaux en font partie intégrante. Atteindre des objectifs dans une seule dimension est insuffisant. Au contraire, les ODD doivent être poursuivis et réalisés simultanément. C’est pourquoi les ODD sont décrits comme intégrés et indivisibles.
Un compromis désigne un résultat où l’on observe qu’une action dans une dimension du développement durable entrave ou fait régresser les progrès vers une autre dimension du développement durable.
Une synergie fait référence à un résultat où l’on observe que l’action soutient considérablement des progrès simultanés sur de multiples dimensions du développement durable.
Un avantage accessoire fait référence aux effets positifs qu’une politique ou une mesure visant un objectif peut avoir sur d’autres objectifs, indépendamment de son effet net sur le bien-être de la société dans son ensemble. Les avantages accessoires (ou avantages connexes) sont souvent incertains et dépendent, entre autres, du contexte local et des pratiques de mise en œuvre.
Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la science des changements climatiques et du développement durable, il existe une lacune dans la recherche sur la façon dont les mesures de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre au Canada favorisent ou entravent le développement durable, y compris ses dimensions sociales, économiques et environnementales.
La priorité de la recherche est la suivante :
R1 (RCCDD). Examiner et comprendre les relations entre la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. La recherche doit être propre au contexte canadien et soutenir les ODD. Il s’agit notamment de comprendre comment les mesures de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre au Canada influent sur le développement durable, d’élaborer des modèles et des cadres analytiques fondés sur l’équité pour prévoir ou évaluer les effets des mesures de lutte contre les changements climatiques sur le développement durable, puis de comprendre comment ces mesures interagissent avec les éléments socioéconomiques du développement durable. Des analyses sexospécifiques et intersectionnelles (chevauchements entre des systèmes d’inégalité) du développement durable, ainsi que la prise en compte des interactions entre les connaissances scientifiques fondées sur les distinctions et les visions du monde autochtones sont nécessaires pour soutenir cette recherche.
5.8 Changements climatiques et sécurité
Les changements climatiques influent considérablement sur la sécurité humaine, la stabilité politique et les infrastructures de sécurité (qui protègent les systèmes critiques contre les menaces pesant sur leur fonctionnement). Cela comprend l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, les effets sur la disponibilité de la nourriture, de l’eau et de l’énergie, l’incidence sur les moyens de subsistance et le bien-être, la concurrence accrue pour les ressources naturelles et l’augmentation des déplacements et des migrations.
Il est urgent de s’attaquer à l’ensemble des conséquences des changements climatiques sur la sécurité. Sans effort d’atténuation et d’adaptation urgent et considérable, les changements climatiques engendreront des risques de plus en plus graves, omniprésents et étendus pour la plupart des aspects de la nature et du bien-être des humains, ainsi que les moyens de subsistance, la sécurité publique, et la résilience et les résultats économiques. De nombreux changements climatiques ont des conséquences profondes sur la sûreté, la vulnérabilité et la sécurité, ainsi que pour la défense nationale, les conflits et l’instabilité sociale et géopolitique (voir l’encadré 5.8, Opérations de défense du Canada et changements climatiques). Les solutions climatiques visant à répondre à des considérations de sécurité doivent intégrer des stratégies, des politiques et des mesures ayant pour but de réduire les émissions de GES (atténuation). Ces solutions doivent être mises en œuvre parallèlement à la réduction de l’exposition aux aléas climatiques, à la conservation et à la protection environnementales et à la garantie du bien‑être pour tousNote de bas de page 14. La recherche doit permettre d’élaborer des solutions qui arrivent au bon moment et s’harmonisent avec d’autres objectifs de politique économique et environnementale, afin d’éviter d’exacerber les inégalités existantes et de favoriser les solutions qui renforcent l’équité et la justice. La recherche transdisciplinaire est essentielle à une compréhension intégrée des multiples facteurs qui pourraient guider les transitions ordonnées vers la carboneutralité, la planification de l’adaptation et le développement durable, tout en évitant l’aggravation des vulnérabilités.
Les priorités scientifiques pour ce thème de lien répondent aux principaux risques indiqués à l’échelle mondiale et leurs répercussions dans un contexte canadienNote de bas de page 15. Des recherches sont nécessaires pour étayer les évaluations des risques à l’échelle quotidienne, saisonnière et décennale dans tout le Canada, y compris une attention urgente à l’Arctique qui se réchauffe plus rapidement. Il importe de développer des modèles conceptuels, tels que ceux qui reflètent le cadre du risque-multiplicateur, les répercussions directes de changements climatiques continus au Canada ainsi que la nature réalisable et l’efficacité des mesures d’atténuation et d’adaptation. Cette recherche devrait permettre de comprendre les répercussions en matière de sécurité ainsi que l’action collective et coopérative par l’analyse des facteurs de stress croisés, liés ou non au climat. Cela comprendrait des analyses des risques environnementaux (phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité, maladies infectieuses et dommages environnementaux causés par l’humain) et des répercussions sociales (cohésion sociale, crises des moyens de subsistance et moyens d’y faire face, gestion des ressources naturelles, sécurité alimentaire, approvisionnement et transition énergétiques, crises de la dette, transition économique et juste, et équité entre les genres).
L’application de l’optique des changements climatiques et de la sécurité à la recherche sur les changements climatiques améliorerait notre compréhension de la manière dont les changements climatiques ont une incidence sur les choix de développement futurs, leurs aspects distributifs et leurs solutions. Cette optique s’appuie sur l’ensemble des données et des connaissances environnementales, socioéconomiques et sanitaires qui permettent de trouver des solutions canadiennes. Ce cadre de recherche peut inclure des perspectives extérieures au contexte national du Canada, afin de mieux comprendre les répercussions des interventions mondiales aux changements climatiques pour le Canada, et éclairer la contribution du Canada aux initiatives internationales (p. ex. les activités d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces derniers, les finances, la gestion des risques de catastrophe et l’aide étrangèreNote de bas de page 16). Ces recherches portent notamment sur les problèmes de sécurité immédiats et ceux prévus dans le cadre de divers scénarios climatiques futurs, notamment la façon dont les questions de sécurité peuvent influencer les tensions géopolitiques existantes et la dynamique de la violence, des conflits et de la coopération. Il peut également s’agir de comprendre comment les besoins en matière de sécurité, de santé et d’aide humanitaire seront cernés et satisfaits, et comment les répercussions des changements climatiques peuvent être gérées par la préparation aux catastrophes et le soutien à long terme au développement durable (p. ex. dans les pays en développement). Il est également nécessaire d’évaluer les transformations politiques, économiques et financières à long terme dans les contextes nationaux et mondiaux dans le cadre des scénarios climatiques futurs.
La capacité de poursuivre cette recherche au Canada est limitée et fragmentée. Les priorités scientifiques propres au Canada dans ce domaine sont les suivantes :
R1 (CCS). Évaluer les voies des politiques des changements climatiques et leurs répercussions en matière de sécurité. Ces voies couvrent de multiples contextes futurs, y compris ceux qui résulteraient de l’atteinte des objectifs en matière d’émissions, des contributions déterminées au niveau national actuellement déclarées, ou d’autres voies des émissions mondiales (voir le chapitre 5.6, La science des voies critiques vers la carboneutralité). L’évaluation de leurs répercussions en matière de sécurité peut mieux informer les décideurs, notamment en ce qui concerne les risques géopolitiques, les risques pour les systèmes financiers et de l’approvisionnement en énergie, les réponses humanitaires et la politique étrangère du Canada. Il convient de comprendre les répercussions à court et à plus long terme de ces voies sur la capacité d’adaptation, les mesures d’adaptation actuelles et la résilience qui en découle.
R2 (CCS). Déterminer les risques et les multiplicateurs de menace des changements climatiques pour les activités des institutions de sécurité et pour l’intervention et la planification d’urgence. Les changements climatiques amplifient la pénurie de ressources et aggravent l’incidence des facteurs sociaux, économiques et environnementaux existants. Des recherches sont nécessaires pour comprendre l’incidence du climat sur les activités des institutions de sécurité du Canada, les risques qu’elles courent et leur vulnérabilité, ainsi que sur l’intervention et la planification d’urgence.
R3 (CCS). Élaborer un ensemble d’interventions de sécurité face aux changements climatiques, dans des contextes et à des échelles appropriés. Il s’agirait notamment d’élaborer des stratégies de collaboration en matière de sécurité face aux changements climatiques qui tiennent compte des interactions entre les facteurs socioéconomiques (p. ex. les inégalités sociales) et de l’harmonisation possible avec d’autres objectifs de politique économique et environnementale.
R4 (CCS). Élaborer une intervention de type « système de systèmes » face aux changements climatiques, reflétant l’interconnexion et les interventions en cascade dans les secteurs sociaux et économiques et les communautés. Il s’agit notamment de déterminer où les risques climatiques en matière de sécurité peuvent être sous-estimés (c.-à-d. les « angles morts ») et où les répercussions seraient indirectes ou difficiles à prédire. La recherche doit prendre en compte le contexte de sécurité canadien ainsi que des considérations internationales plus larges afin de mieux comprendre les répercussions sur la sécurité, puis de déterminer des solutions.
Encadré 5.8. Opérations de défense du Canada et changements climatiques
Les effets croissants des changements climatiques constituent des menaces directes et indirectes pour la sécurité humaine et nationale dans le monde entier. La politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, reconnaît que les changements climatiques représentent un défi pour la sécurité, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Au Canada, les effets des changements climatiques transforment le paysage physique et de la sécurité, ce qui pose une série de défis en constante évolution. Par exemple, les effets graves tels que les inondations et les feux de forêt ont une incidence de plus en plus grande sur les communautés et menacent les infrastructures essentielles.
Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes fournissent des services essentiels pour assurer la sécurité du Canada, tant au niveau national qu’international. Le Ministère a pour objectif de mieux comprendre les demandes d’aide militaire lors de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les feux de forêt, à l’échelle nationale et internationale.
En juin 2022, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a annoncé qu’elle prévoyait de créer un Centre d’excellence pour le changement climatique et la sécurité (CECCS) au Canada, afin de travailler de manière cohérente avec les pays membres pour élaborer et promouvoir des solutions aux problèmes de sécurité climatique en créant de nouvelles possibilités de collaboration. Ces solutions comprennent les objectifs communs des pays membres, à savoir l’atténuation des émissions de GES dues aux activités de sécurité, ainsi que l’adaptation et le renforcement de la résilience aux changements climatiques.
5.9 Sciences sociales et changements climatiques
Pour changer la donne, les résultats de la recherche doivent être utilisés par d’autres chercheurs, par les décideurs impliqués dans la définition des politiques, par les praticiens des secteurs public et privé et par les membres du public. Les sciences sociales et comportementales peuvent aider à déterminer et à étudier ces différents publics et leurs besoins afin d'élaborer des outils, des produits et des évaluations ciblés pour mieux communiquer et traduire la science des changements climatiques d'une manière qui permet de toucher chaque groupe et d’aider à la lutte contre les changements climatiques.
Les résultats de la recherche en sciences sociales peuvent également éclairer les politiques climatiques telles que les réglementations, les mesures fiscales (mesures dissuasives comme la tarification du carbone et mesures incitatives comme les crédits d’impôt), les remises et autres incitatifs financiers similaires, les mesures de santé publique, les arrêtés municipaux et les programmes d’information et de promotion.
Les sciences sociales contribuent à la mobilisation et à la communication efficaces des connaissances, qui sont essentielles pour mettre les résultats de la recherche à la disposition des décideurs, des praticiens et du public. Les plans de synthèse et de mobilisation des résultats de la recherche doivent être intégrés dans chaque projet de recherche, plutôt que de les envisager seulement après coup.
La communication sur les changements climatiques joue un rôle de plus en plus important dans la mobilisation des connaissances. Les pratiques exemplaires, les boîtes à outils et les guides émergent pour rendre cette communication plus efficace. Les stratégies de communication s’appuient sur les sciences sociales, en particulier la science du comportement, pour contribuer à modifier les attitudes et les comportements dans les différents segments du public Canadien (voir l’encadré 5.9, Programme de recherche appliquée sur l’action pour le climat au Canada [PRAAC Canada])Note de bas de page 17 .
Toutefois, la recherche sur l’opinion publique et le sixième rapport d’évaluation (en anglais seulement) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies montrent qu’il est encore nécessaire :
- d’améliorer la connaissance du climat;
- de remédier au manque de confiance envers le gouvernement et les experts;
- de réagir à la désinformation et à la mésinformation; et
- de combler le fossé entre la compréhension des effets du climat et la nécessité d’agir, tout en s’efforçant de motiver cette action.
Les experts et les praticiens ont mis en évidence les lacunes en matière de compréhension :
- les attitudes et les croyances du public canadien;
- la manière d’atteindre efficacement ces publics; et
- la manière d’évaluer l’incidence des produits de communication et de leur diffusion sur les attitudes et les comportements du public canadien à l’égard de la lutte contre les changements climatiques.
Encadré 5.9. Programme de recherche appliquée sur l’action pour le climat au Canada (PRAAC Canada)
L’expérience et l’expertise du Canada en matière de science du comportement sont appliquées aux mesures de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques dans le cadre d’un programme de recherche pluriannuel, soit le Programme de recherche appliquée sur l’action pour le climat au Canada (PRAAC); une collaboration entre Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada et l’Unité de l’impact et de l’innovation du Bureau du Conseil privé. Le PRAAC produit des données probantes sur les motivations et les obstacles à la lutte contre les changements climatiques. Ces renseignements serviront à l’élaboration des politiques, aux interventions des programmes et à la communication.
Les efforts de communication ont plus de chances de réussir s’ils sont fondés sur les connaissances scientifiques les plus récentes et s’ils s’appuient sur des produits de communication clairs et cohérents. Élaborer le bon message à l’aide de méthodes fondées sur des données probantes, trouver les messagers appropriés et choisir l’outil de diffusion adéquat en fonction des segments du public sont autant d’éléments essentiels des stratégies de communication.
Pour mobiliser les connaissances, la communication sur les changements climatiques peut s’appuyer sur les sciences sociales et comportementales afin d’influencer les attitudes et les comportements des Canadiens. Des recherches sont encore nécessaires pour comprendre les segments du public Canadien et élaborer des produits de communication qui leur sont destinés. Pour instaurer un climat de confiance avec chaque segment du public, les communicateurs peuvent élaborer des exposés sur les effets des changements climatiques et les mesures à prendre qui se rapportent aux expériences vécues et aux perspectives des gens. Les exposés et les supports visuels (illustrations, vidéos) peuvent aider à faire comprendre aux Canadiens les questions complexes liées aux changements climatiques. La mésinformation, la désinformation et la malinformation sur les changements climatiques doivent être contrées par un flux de renseignements crédibles (voir l’encadré 5.10, Termes utilisés dans les renseignements sur les changements climatiques). Les messagers de confiance, qui peuvent être des membres de la communauté au-delà des sources traditionnelles d’information, sont essentiels pour faire passer les messages.
Encadré 5.10. Termes utilisés dans les renseignements sur les changements climatiques
Mésinformation : Information fausse, mais créée ou diffusée par quelqu’un qui pense qu’elle est vraie, sans intention de nuire (p. ex. quelqu’un qui publie un article contenant des renseignements obsolètes sans s’en rendre compte).
Désinformation : Information fausse et délibérément créée pour tromper ou nuire (p. ex. publication délibérée de fausses données dans l’intention de discréditer).
Malinformation : Information basée sur des renseignements réels et utilisés pour nuire à une personne, une organisation, un groupe ou un pays (p. ex. quelqu’un qui utilise des renseignements choisis de manière sélective et présentés hors contexte pour susciter la controverse ou la haine, ou quelqu’un qui réagit négativement à une idéologie, une politique ou un programme en particulier).
Capital scientifique : Compétences, compréhension, connaissances (sur la science et son fonctionnement), intérêt et contacts sociaux liés à la science (p. ex. connaître quelqu’un qui travaille dans un domaine scientifique).
Segmentation du public : Le processus qui consiste à trouver des sous-groupes stratégiques au sein de votre public cible, selon le comportement, les intérêts ou les attributs communs qui indiquent comment ils peuvent réagir au marketing.
Personnes incertaines, mais influençables : Ceux dont la demande d’action climatique est beaucoup plus faible que leur préoccupation déclarée, ce qui représente un manque global de soutien à l’action individuelle et/ou collective.
La synthèse des connaissances fournit des recherches actualisées que les décideurs politiques peuvent utiliser pour prendre des décisions fondées sur des données probantes et progresser vers les objectifs d’atténuation et d’adaptation. En fait, les preuves scientifiques peuvent motiver l’action en illustrant les répercussions des changements climatiques et donc le besoin urgent de lutter contre les changements climatiques.
La synthèse des connaissances comprend des évaluations périodiques de l’état des connaissances tous les cinq à dix ans, complétées par des mises à jour plus fréquentes et des produits ciblés en fonction des besoins. Il existe des évaluations dans divers domaines, notamment la science des changements climatiques, les changements climatiques et la santé, ainsi que les répercussions nationales et régionales des changements climatiques et l’adaptation. De nouvelles évaluations sont nécessaires sur des sujets tels que la science du cycle du carbone et ce qui motive la lutte contre les changements climatiques. La traduction de la science est également nécessaire pour élaborer des outils, des produits et des services pertinents pour les politiques et la prise de décision.
Jusqu’à présent, la synthèse des connaissances a principalement pris la forme de rapports évaluant et résumant les résultats scientifiques actuels. Il s’agit notamment de la série de rapports du gouvernement fédéral Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, y compris le Rapport sur le climat changeant du Canada, le Rapport sur les enjeux nationaux, La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement, et des rapports sur des questions régionales, nationales, nordiques et autochtones. De nombreuses organisations non gouvernementales (Fondation David Suzuki, Clean Prosperity for Canadians, Pembina Institute, entre autres) incluent également des résultats de recherche dans leurs rapports, souvent comme base factuelle de leurs recommandations.
Les priorités en matière de la recherche en sciences sociales, dans le cadre des changements climatiques, sont les suivantes :
R1 (SSCC). Comprendre les segments du public Canadien et élaborer des produits de communication qui ciblent ces publics. Des recherches sont nécessaires pour comprendre les segments du public au Canada, y compris les attitudes, les croyances, les valeurs et les préjugés de divers groupes démographiques, régionaux, socioéconomiques et sectoriels. Les segments peuvent être déterminés à partir de recherches et d’analyses statistiques de facteurs démographiques, socioculturels, contextuels ou situationnels. Comprendre la segmentation du public permet d’élaborer des communications qui ciblent différents publics. Elle permettra également de déterminer les canaux de communication (sites Web, médias d’information traditionnels, médias sociaux) et les types de médias (rapports, messages sur les médias sociaux, illustrations ou infographies, vidéos) à utiliser.
Pour instaurer la confiance, les communicateurs doivent également comprendre ce qui constitue une preuve crédible pour chaque type de public. Il est particulièrement important de rejoindre les secteurs les plus touchés par les politiques et les réglementations gouvernementales, afin de parvenir à des niveaux élevés de conformité aux politiques et aux réglementations.
R2 (SSCC). Élaborer des récits sur les effets des changements climatiques et les mesures à prendre pour responsabiliser les Canadiens, susciter l’espoir et accélérer la transformation de la société. Les communicateurs doivent élaborer des récits sur les effets des changements climatiques et les mesures à prendre qui responsabilisent et inspirent les segments du public Canadien cernés. Les méthodes de recherche participativeNote de bas de page 18, lesquelles impliquent une enquête systématique menée en collaboration avec les personnes concernées par une question, peuvent contribuer à cette communication. Ces approches, parmi d’autres, permettent d’établir un lien entre les personnes et leur expérience des changements climatiques, afin de comprendre et d’orienter les mesures. (Voir l’encadré 5.11, Les leçons de la santé publique pour une communication efficace sur les changements climatiques, et l’encadré 5.12, Le projet MECCE [Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education]).
Les récitsNote de bas de page 19 ou les scénarios mettent en contexte les renseignements scientifiques de manière à ce qu’elles soient en rapport avec les expériences et les perspectives vécues par les gens. Cette approche de la communication est fondée sur l’engagement auprès des publics cibles. Les récits peuvent aider les Canadiens à comprendre les données sur la variabilité et les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’autres sujets en matière de répercussions actuelles, de risques et de scénarios futurs.
Encadré 5.11. Les leçons de la santé publique pour une communication efficace sur les changements climatiques
La communauté de la santé publique compte des dizaines d’années d’expérience dans la communication des risques sanitaires aux Canadiens en vue de façonner les comportements. La communication sur les changements climatiques peut s’inspirer de cette riche expérience. Il faut s’efforcer de tirer des leçons des progrès réalisés dans le domaine de la santé et des connaissances liées aux pandémies pour traduire cette expérience et son incidence sur le comportement humain dans la lutte contre les changements climatiques. La communauté des chercheurs en santé s’est rapidement mobilisée et a travaillé directement avec les décideurs en politiques de santé et les praticiens en réponse à la COVID-19, entre autres, ce qui a permis de tirer des leçons immédiates pour la communication sur le climat.
Encadré 5.12. Le projet MECCE (Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education)
Le Projet MECCE (en anglais seulement) a pour objectif de faire progresser les connaissances sur les changements climatiques et la lutte contre les changements climatiques au niveau mondial en améliorant la qualité et la quantité de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation du public aux changements climatiques. Situé à l’Université de la Saskatchewan, c’est un partenariat de recherche universitaire international dirigé par le Canada qui regroupe plus de 80 chercheurs et organismes de premier plan. Le projet MECCE soutient la transformation par des domaines croisés de recherche et de mobilisation en matière de communication et d’éducation sur la lutte contre les changements climatiques, conformément aux engagements de l’Action pour l’autonomisation climatique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
R3 (SSCC). Comprendre la confiance du public et le flux d’information pour soutenir la communication de renseignements crédibles, tout en limitant la diffusion de renseignements climatiques incorrects ou trompeurs. La confiance est un facteur clé dans la manière dont les gens consomment l’information et agissent en conséquence. Le rôle critique des messagers est aussi important que le message lui-même. La recherche sur la formulation efficace et d’autres approches issues des sciences sociales et psychologiques seraient utiles pour cerner un groupe diversifié de messagers avec lesquels élaborer conjointement des récits sur la lutte contre les changements climatiques. Des segments de public différents peuvent également nécessiter des approches de communication différentes. Pour certains publics, le fait de mettre l’accent sur les systèmes de savoir et de répondre aux problèmes sociaux existants qui les concernent permet d’instaurer la confiance. Pour de nombreux Canadiens, les éléments visuels, tels que les illustrations et les vidéos, les aident à comprendre des renseignements complexes.
Il est essentiel de soutenir le flux de renseignements crédibles. Pour comprendre les flux de renseignements, il est essentiel de comprendre comment les renseignements se propagent, comment les messagers sont perçus comme crédibles et qui propage la mésinformation, la désinformation et la malinformation. Cette compréhension pourrait également contribuer à atténuer les effets néfastes des renseignements faux ou trompeurs et à élaborer des récits climatiques précis, objectifs et responsabilisants avec des membres de confiance des communautés.
Ainsi, la mobilisation des connaissances n’est pas l’étape finale de la recherche, mais un effort continu impliquant une élaboration conjointe avec les publics visés. Elle constitue un lien essentiel entre la science et la lutte contre les changements climatiques en contribuant au changement d’attitudes et de comportements nécessaire pour réduire les émissions de GES et prendre des mesures d’adaptation. De cette manière, la mobilisation des connaissances contribue grandement à la réalisation de l’objectif de l’Action pour l’autonomisation climatique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), lequel vise à donner à tous les membres de la société les moyens de prendre part à la lutte contre les changements climatiquesNote de bas de page 20.
La priorité en matière de synthèse et de mobilisation des connaissances est la suivante :
MC1 (SSCC). Réaliser des évaluations régulières et approfondies de la science et des connaissances (sur un cycle de cinq à dix ans), complétées par des mises à jour plus brèves et plus fréquentes et par des produits ciblés. Les experts ont souligné l’importance d’une mise à jour régulière de ces rapports (p. ex. tous les cinq à dix ans), ainsi que de mises à jour plus fréquentes et plus brèves (voir le chapitre 4.1, Des Canadiens en bonne santé et résilients, et le chapitre 5.2, Science du cycle du carbone, sur l’importance de ces évaluations pour la santé et pour la science du cycle du carbone, respectivement). Les évaluations examinées comprenaient à la fois des évaluations existantes sur la science des changements climatiques et sur les changements climatiques et la santé, ainsi que de nouvelles évaluations sur le cycle du carbone et sur ce qui motive la lutte contre les changements climatiques.
Les experts ont également souligné la nécessité de procéder à des évaluations des sciences et des connaissances dans les régions du Canada ainsi que dans l’ensemble du pays. Les rapports précédents ont ciblé des régions particulières du Canada ou ont inclus une ventilation régionale, car les évaluations régionales sont utiles aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu’aux communautés autochtones. Ces évaluations régionales devraient prendre en compte les résultats sociaux, culturels, écologiques et environnementaux, ainsi que les effets des changements climatiques sur la santé, la sécurité alimentaire et l’environnement. Le chapitre sur le Nord du Canada du Rapport sur les perspectives régionales a été publié en 2022. Il est essentiel de poursuivre les évaluations pour le Nord du Canada en raison du rythme plus rapide du réchauffement dans la région et de la dépendance des communautés du Nord à l’égard de la terre, des océans et de la glace pour l’alimentation, le transport et la culture.
Ces évaluations peuvent également contribuer aux efforts qui visent à renforcer la connaissance du climat chez les membres du public et les compétences en matière de climat chez les professionnels et les praticiens de nombreux domaines qui doivent intégrer des considérations climatiques dans leur travail.
Il est également nécessaire de produire des données climatiques et des produits d’information adaptés à des secteurs économiques et industriels particuliers (p. ex. la santé, les infrastructures, les ressources naturelles), afin que les données puissent être facilement accessibles et utilisées pour éclairer la politique et la prise de décision. En outre, les flux de renseignements et les produits destinés aux communautés urbaines, rurales, côtières, éloignées et autochtones peuvent contribuer à la prise de décision au niveau local. Ils doivent être disponibles à des échelles géographiques et de temps pertinentes pour les politiques et la prise de décision, et couvrir des aspects du climat utiles aux communautés, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, la santé et les ressources en eau.
Chapitre 6 Faire progresser la science des changements climatiques
Résumé
Plusieurs considérations primordiales ont été soulevées lors des engagements pris pour l’élaboration du présent rapport.
L’infrastructure de données est une condition préalable importante pour la science des changements climatiques. Le stockage, le traitement et l’analyse de grands volumes de données nécessitent des centres, des plateformes et des superordinateurs. Les progrès rapides de la technologie dans ce domaine aideront les scientifiques à collecter davantage d’informations à meilleure résolution. Cette technologie comprend des systèmes fondés sur l’infonuagique qui permettent le partage sécurisé de grands ensembles de données, l’intelligence artificielle et les technologies des « mégadonnées ». Les ensembles de données devraient couvrir non seulement les données relatives au climat, aux écosystèmes et à la biodiversité, mais aussi les indicateurs humains tels que les données socioéconomiques et sanitaires. Les plateformes de données devraient appliquer des normes internationales, permettant aux scientifiques canadiens de contribuer et d’accéder à des ensembles de données internationaux.
La « science ouverte » consiste à mettre l’ensemble du processus scientifique à la disposition de tous. À cet égard, les ensembles de données sur les changements climatiques devraient répondre aux principes FAIR (facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable). Le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur de la science ouverte pour ses activités scientifiques, et plus particulièrement en ce qui a trait aux renseignements sur les effets des changements climatiques. Cependant, la science ouverte doit être contrebalancée par des considérations éthiques, la protection des données privées concernant les personnes et le respect de la souveraineté des données et des droits de propriété intellectuelle. La collecte et l’analyse des données concernant les membres des Premières Nations doivent respecter les principes PCAP des Premières Nations (propriété, contrôle, accès et possession), et les données concernant les communautés inuites doivent respecter la Stratégie nationale inuite sur la recherche.
Les sciences au Canada, et la science des changements climatiques en particulier, manquent de coordination nationale. Le système fragmenté actuel est difficile à naviguer, crée des obstacles à la collaboration et ne permet pas de faire le lien entre les résultats scientifiques et l’élaboration des politiques. Les réseaux scientifiques ont été un moyen efficace de permettre la recherche collaborative transdisciplinaire dans des domaines précis. Il est nécessaire de faire des efforts ciblés pour mettre en place et encourager de nouvelles recherches collaboratives.
Le Canada a tiré parti de sa participation aux efforts internationaux qui visent à comprendre les changements climatiques. Les données et les connaissances canadiennes doivent répondre à des normes rigoureuses de qualité et d’exactitude pour être incluses dans ces efforts. Parmi les nombreux efforts internationaux auxquels le Canada participe, citons les évaluations scientifiques mondiales et régionales, les programmes de surveillance mondiale, les initiatives d’information sur les émissions et les programmes de recherche transdisciplinaires.
Les activités scientifiques prioritaires recommandées dans le présent rapport permettront d’accroître la création, la diffusion et l’utilisation de renseignements sur le climat dans tout le Canada. L’objectif est de faire progresser les outils, les services, les politiques et les programmes essentiels pour relever les défis à venir dans la création d’un Canada résilient et carboneutre.
Ce rapport portait principalement sur les priorités canadiennes de la science des changements climatiques qui sont les plus pertinentes pour éclairer la lutte contre les changements climatiques et évaluer les progrès. Toutes les priorités cernées peuvent aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité et d’adaptation aux changements climatiques. Bien que la recherche et le développement ainsi que les innovations technologiques n’entrent pas dans le champ d’application du présent rapport, les priorités scientifiques se recoupent avec les objectifs de R&D en matière de technologies propres et de réduction des émissions dans divers secteurs.
Les experts qui ont contribué à ce rapport ont été unanimes à souligner l’urgence de la lutte contre les changements climatiques. Ils ont fait remarquer qu’il existe déjà une importante base de connaissances pour guider les réductions d’émissions de GES et renforcer les efforts d’adaptation. La poursuite de la recherche scientifique permettra de faire évoluer la lutte contre les changements climatiques en caractérisant mieux les risques, en évaluant l’efficacité des approches d’atténuation et d’adaptation, en mesurant les progrès accomplis et en cernant de nouvelles possibilités d’action.
Pour faire progresser l’objectif défini dans le présent rapport, il convient d’aborder plusieurs questions primordiales liées à de nombreuses priorités. Ces questions ont été soulevées à maintes reprises lors de la mobilisation et sous-tendent les priorités:
- infrastructure de données
- science ouverte
- coordination nationale
- mobilisation internationale
6.1 Infrastructure de données
L’infrastructure de données, y compris les centres, les plateformes et des superordinateurs, permet le stockage, le traitement et l’analyse de grands volumes de données produites par les activités scientifiques liées aux changements climatiques. Ces données servent ensuite à alimenter les efforts de recherche et de modélisation, ainsi que des produits d'information personnalisés pour des activités telles que les services climatiques. Alors que les gouvernements et d’autres organisations exploitent actuellement de nombreux centres et plateformes de données, les progrès technologiques rapides dans les approches de surveillance (en surface, dans les océans et dans l’espace), la collecte de données et l’analyse offrent la possibilité de collecter davantage de renseignements, avec une meilleure résolution spatiale et temporelle.
L’infrastructure superinformatique est essentielle à la modélisation du climat et du système terrestre. Cette infrastructure devrait être axée sur la collaboration, y compris les systèmes fondés sur l’infonuagique qui permettent l’échange sécurisé de vastes ensembles de données. Les technologies d’intelligence artificielle et de « mégadonnées » pour la gestion automatisée de vastes ensembles de données et l’intégration et la validation de modèles devraient être prioritaires.
Une fois les données collectées et analysées, l’accès aux données pertinentes et à l’infrastructure superinformatique reste un obstacle pour la communauté de recherche. Les ensembles de données doivent également être interopérables afin que les données provenant de plusieurs ensembles de données puissent être analysées pour découvrir les relations et les tendances. Cette fonctionnalité revêt une importance particulière pour permettre la recherche transdisciplinaire, laquelle peut s’appuyer sur des données climatiques conjointement avec des données environnementales, socioéconomiques et sanitaires. Des plateformes de données sophistiquées sont nécessaires pour faciliter les contributions d’un large éventail de sources et de systèmes d’observation des secteurs public et privé. L’analyse doit permettre d’accéder à des données provenant de différentes sources et sous différents formats. Des « catalogues de données » doivent être élaborés afin que les utilisateurs puissent trouver des données intégrées et interopérables.
La priorité de la science de l’infrastructure des données est la suivante :
R1 (Données). Créer, maintenir et renforcer des plateformes accessibles et interopérables pour les données sur le climat, les gaz à effet de serre (GES), les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que les indicateurs socioéconomiques et sanitaires connexes. Les plateformes de données climatiques (terrestres, hydrologiques, océaniques et atmosphériques) doivent fournir ces données à des échelles multiples afin de soutenir la recherche et les déclarations à l’échelle régionale et nationale. Elles doivent comprendre :
- l’espace numérique nécessaire pour les plateformes, les données et les outils d’analyse des données;
- la sensibilisation et la formation afin que les plateformes puissent être utilisées par toutes les personnes impliquées dans la science des changements climatiques; et
- une gouvernance nationale permettant de coordonner et de soutenir les contributions des différentes plateformes concernées (fédérales, provinciales, universitaires, du secteur privé); de soutenir et de gérer les contributions; de mettre en œuvre et de soutenir l’infrastructure technique; et d’élaborer des protocoles d’utilisation respectant les besoins des contributeurs et des utilisateurs de la science.
Les plateformes de données doivent représenter une source scientifique de données sur les changements climatiques faisant autorité. Elles doivent comprendre des outils intégrés d’analyse et de production de déclarations afin de mieux éclairer la recherche et la prise de décision, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Les plateformes, les ensembles de données et les analyses doivent ensuite être utilisés par les services climatiques pour fournir des applications opérationnelles en temps quasi réel, ainsi que des déclarations à plus long terme (voir également le chapitre 6.2, Science ouverte).
Le leadership du gouvernement fédéral ainsi que les contributions des organisations autochtones, provinciales et territoriales, universitaires, non gouvernementales et du secteur privé peuvent s’appuyer sur les efforts actuels, notamment :
- le cinquième Plan d’action national pour un gouvernement ouvert – engagement en matière de changements climatiques et de croissance durable : le gouvernement du Canada prévoit améliorer l’accès à la science, aux renseignements et aux données sur le climat et l’environnement en temps opportun, en travaillant en partenariat avec les autres niveaux de gouvernement, les entreprises, les peuples autochtones et les citoyens;
- le Centre canadien des services climatiques et les organisations régionales de services climatiques;
- une stratégie relative aux données climatiques visant à faciliter l’accès à l’ensemble des données sur les changements climatiques détenues par le gouvernement fédéral;
- le Recensement de l’environnement de Statistique Canada; et
- la nouvelle plateforme Digital Earth Canada pour un système en réseau fondé sur les observations de la Terre.
Les plateformes de données devraient appliquer les normes internationales existantes afin que les scientifiques canadiens puissent contribuer et accéder aux ensembles de données internationaux. Ces normes garantissent également que les résultats scientifiques sont comparables d’un pays à l’autre et peuvent être utilisés dans l’élaboration des politiques internationales.
6.2 Science ouverte
La science ouverte consiste à mettre la science à la disposition de tous – scientifiques, décideurs politiques et public – de la conception aux méthodes et aux résultats. La science ouverte est essentielle au dialogue public sur la science du climat, car elle contribue à améliorer la compréhension et la confiance du public.
Un élément essentiel de la science ouverte est l’existence d’ensembles de données en accès libre qui respectent les principes FAIR; ces ensembles de données devraient faire partie intégrante de tous les aspects de la science des changements climatiques. Les plateformes de données ouvertes et interopérables sont particulièrement importantes pour la recherche collaborative et multidisciplinaire qui combine des ensembles de données provenant de plusieurs domaines (voir 6.1, Infrastructure de données).
L’engagement du Canada en faveur de la science ouverte a été reflété dans le Plan d’action national du Canada pour un gouvernement ouvert de 2018-2020 qui vise à élaborer une feuille de route sur la science ouverte pour le gouvernement du Canada. Publiée en 2020, la Feuille de route pour la science ouverte qui en résulte fournit des principes primordiaux et des recommandations pour guider ces activités au Canada. Les recommandations sont destinées à la science et à la recherche financées par les ministères et organismes du gouvernement fédéral.
En réponse à la feuille de route, les ministères et organismes fédéraux ont désigné des dirigeants principaux des données scientifiques et publié des plans d’action pour la science ouverte. Les trois organismes subventionnaires fédéraux (le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherche en santé du Canada) ont des politiques en matière de libre accès et de gestion des données de recherche qui visent à améliorer l’accès aux résultats et aux données de la recherche financée par ces organismes et à diffuser les résultats de la recherche.
Le Plan d’action national pour un gouvernement ouvert actualisé de 2022-2024 est allé plus loin en s’engageant à donner aux citoyens l’accès aux renseignements et aux outils dont ils ont besoin pour mieux comprendre les effets des changements climatiques. Lors des consultations sur le plan d’action, les Canadiens ont déclaré que le gouvernement du Canada devait mieux communiquer et s’engager auprès des citoyens sur ses décisions et ses progrès en matière de lutte contre les changements climatiques et de croissance durable. Dans cette optique, le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès à la science, aux renseignements et aux données sur le climat et l’environnement. Le gouvernement fédéral aidera également les autres niveaux de gouvernement, les entreprises, les communautés et organisations autochtones et les citoyens à mieux comprendre les changements climatiques et ses effets sur les écosystèmes.
La science ouverte doit être équilibrée par des considérations éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des données. Les plateformes de données doivent refléter les protocoles des utilisateurs pour une utilisation appropriée, en préservant l’anonymat et la confidentialité des données concernant les personnes, ainsi qu’en respectant la souveraineté des données et les droits de propriété intellectuelle.
À cet égard, la gouvernance et l’intendance des systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis doivent être respectées, comme l’exige la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (PDF) (en anglais seulement). La collecte et l’analyse des données doivent s’appuyer sur des protocoles et des régimes de droits précis, telles que les principes PCAP® des Premières Nations (propriété, contrôle, accès et possession). La Stratégie nationale inuite sur la recherche (PDF) (en anglais seulement) donne également la priorité à l’accès, à la propriété et au contrôle des données et des renseignements par les Inuit. Les priorités en matière de données doivent correspondre avec les pratiques exemplaires recensées par le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations et la Stratégie nationale inuite sur la recherche (PDF). Ces principes et pratiques prévoient des mécanismes inclusifs et respectueux pour le développement conjoint du savoir avec les peuples autochtones.
6.3 Coordination nationale
Figure 6.1. Schéma montrant le rôle des organisations et des priorités dans la science des changements climatiques.
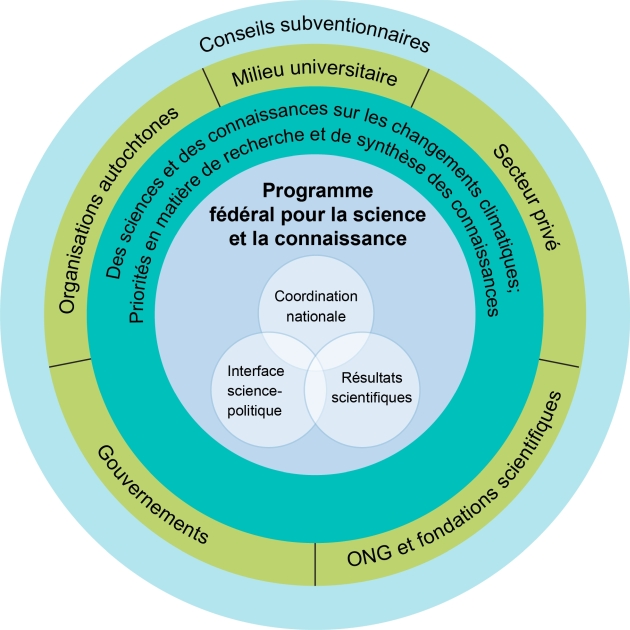
Description textuelle
Figure circulaire à quatre niveaux illustrant les communautés scientifiques et politiques participant à la science du changement climatique.
La couche la plus interne est celle du Programme fédéral pour la science et le savoir, avec un diagramme de Venn de la coordination nationale, des résultats scientifiques et de l’interface science-politique.
La deuxième couche est celle du Plan national des sciences et du savoir sur les changements climatiques; priorités en matière de recherche et de synthèse du savoir.
La troisième couche comprend les Organisations autochtones, les milieux universitaires, le secteur privé, les ONG et les fondations scientifiques, ainsi que les Gouvernements.
La couche la plus externe est celle des conseils subventionnaires.
La coordination de la science, y compris la science des changements climatiques, reste largement une mesure ponctuelle au Canada. Les activités scientifiques sont souvent menées de manière distribuée ou fragmentée; par conséquent, il se peut que ces activités ne soient pas stratégiques ou intégrées à l’échelle nationale.
La coordination nationale représente un défi, car le Canada compte un large éventail de personnes et d’organisations qui participent à la science des changements climatiques, du gouvernement aux organisations non gouvernementales en passant par les universités, les organisations autochtones, les communautés et le secteur privé (figure 6.1). Le système actuel est difficile à comprendre pour les personnes ou les organisations qui souhaitent collaborer au sein d’une même discipline ou entre disciplines (recherche multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire), ou encore entre secteurs. Les priorités définies dans le présent rapport seront plus efficaces si elles s’accompagnent d’une coordination scientifique nationale plus forte et de relations plus étroites entre la communauté scientifique et les décideurs politiques.
L’engagement pris pour élaborer ce rapport a mis en évidence quelques exemples de domaines importants pour la coordination nationale :
- La science des voies critiques vers la carboneutralité : Des réseaux de collaboration ou des centres d’excellence entre les gouvernements, les universités et les groupes de réflexion sont nécessaires pour enrichir les connaissances, ainsi que pour s’engager efficacement et tirer parti de l’activité internationale en plein essor dans le domaine des données et de la modélisation (voir le chapitre 5.6, La science des voies critiques vers la carboneutralité).
- Science du climat et du cycle du carbone du système terrestre : Bien que la recherche sur le système terrestre au Canada soit respectée au niveau international, une coordination accrue et une approche plus stratégique entre les institutions pourraient améliorer davantage la capacité nationale. Comme le souligne l’Atelier sur la recherche sur le cycle du carbone au Canada (PDF) de 2019, une approche de réseau nationale et intégrée de la recherche sur le cycle du carbone est essentielle pour améliorer la compréhension des sources et des puits de carbone canadiens (voir le chapitre 5.2, Science du cycle du carbone).
- Communication sur les changements climatiques et incitation à l’action : Une communauté de pratique sur les stratégies de communication et le changement de comportement est nécessaire. Cette communauté pourrait organiser des forums et des conférences pour permettre aux communicateurs de divers systèmes de savoir, y compris les savoirs autochtones et les sciences et savoirs traditionnels, de contribuer aux récits sur les changements climatiques (voir le chapitre 5.9, Sciences sociales et changements climatiques).
- Dialogue science-politique : Le dialogue est nécessaire pour informer les décideurs politiques des résultats scientifiques et des avancées de la recherche, et pour aider la communauté scientifique à comprendre les besoins en matière d’information de ceux qui conçoivent et mettent en œuvre les mesures de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement fédéral peut créer des occasions de dialogue science-politique pour :
- orienter l’établissement des priorités des activités scientifiques;
- faciliter les partenariats de recherche collaborative et le financement; et
- servir d’intermédiaire entre les résultats scientifiques et la lutte contre les changements climatiques à l’échelle nationale.
L’étape suivante consiste à élaborer des mécanismes et des structures pour améliorer la coordination nationale. Des possibilités de financement sont nécessaires pour permettre la mise en place de cadres de recherche transdisciplinaires et multipartenaires, y compris le financement du secteur privé et des fondations, les divers acteurs et de multiples systèmes de savoir.
Les réseaux scientifiques peuvent permettre la recherche transdisciplinaire en collaboration, ainsi que la synthèse et la mobilisation des connaissances à travers la diversité des communautés scientifiques. Des réseaux tels qu’ArcticNet, le réseau MEOPAR (Marine Environmental Observation, Prediction and Response) et PermafrostNet ont permis de faire avancer la science des changements climatiques au Canada.
L’encadré 6.1 résume certaines des considérations à prendre en compte pour renforcer la capacité de coordination nationale.
Encadré 6.1 Créer une capacité de coordination nationale
La coordination nationale de la science des changements climatiques représente un défi, mais elle est de plus en plus nécessaire. Le regroupement des communautés scientifiques permet d’établir des partenariats de recherche collaborative et de planifier les activités scientifiques de manière stratégique.
Il existe différents modèles de coordination scientifique : l’un d’entre eux a été discuté au cours de la mobilisation, à savoir une organisation de type secrétariat pour la science des changements climatiques au Canada. Une telle organisation aiderait à la planification stratégique et à l’établissement de relations, et donnerait des conseils sur la manière d’obtenir des résultats politiques.
Parmi ses objectifs, une organisation de coordination devrait prévoir ce qui suit :
- un dialogue sur la politique scientifique entre les experts et les décideurs à tous les niveaux;
- des priorités scientifiques nationales et multidisciplinaires en matière de changements climatiques;
- des réseaux scientifiques interdisciplinaires et une collaboration entre les gouvernements, les universités, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les partenaires autochtones, les communautés et les partenaires internationaux; et
- des évaluations scientifiques, des produits de connaissance et des conseils scientifiques.
Elle pourrait remplir les fonctions suivantes :
- coordonner la communauté nationale afin de fournir des normes pour les mesures, les données et la modélisation;
- organiser des occasions de réseautage afin que les chercheurs puissent trouver des partenaires au sein de leurs disciplines et dans l’ensemble des disciplines;
- cerner les grands défis scientifiques qui nécessitent des approches interdisciplinaires;
- communiquer des données scientifiques et des connaissances faisant autorité sur les changements climatiques; lutter contre la désinformation; et
- favoriser la collaboration grâce à une recherche interdisciplinaire, intersectionnelle et interjuridictionnelle.
6.4 Mobilisation internationale
Les changements climatiques sont un enjeu mondial; l’évolution du climat au Canada et les possibilités de lutte contre les changements climatiques contribuent à des efforts scientifiques internationaux plus vastes visant à comprendre les changements climatiques. La science canadienne tire parti de la participation à des programmes scientifiques internationaux. Pour participer, la science canadienne doit fournir des données et des connaissances qui respectent des normes scientifiques rigoureuses en matière de qualité et d’exactitude.
Les scientifiques canadiens jouent un rôle de premier plan et les résultats scientifiques canadiens ont été inclus dans les évaluations scientifiques mondiales et régionales produites par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. En outre, les chercheurs canadiens contribuent aux évaluations et aux rapports du Conseil de l’Arctique (en anglais seulement), qui offrent une perspective pan-arctique essentielle sur les changements climatiques, la biodiversité, la santé et le développement durable, entre autres sujets.
La participation du Canada aux programmes de surveillance mondiale permet à nos scientifiques d’accéder à l’ensemble des technologies, des plateformes et des bases de données de surveillance. Cet accès est particulièrement important dans la science sur le climat du système terrestre, où les observations mondiales de la surface, des océans et de l’espace sont essentielles pour comprendre les systèmes terrestres. Le Canada est membre du réseau international du Groupe des observations de la Terre (GEO) (en anglais seulement), qui soutient les programmes des Nations Unies pour l’environnement, le climat, les océans, le développement durable et la réduction des risques de catastrophe. Le Canada participe à plusieurs réseaux mondiaux d’observation du système terrestre, notamment le programme de Veille de l’atmosphère du globe (en anglais seulement), le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS) (en anglais seulement) et le Système mondial d’observation de l’océan (en anglais seulement). Le programme Copernicus d’observation de la Terre de l’Union européenne a accepté en 2022 de partager des données avec l’Agence spatiale canadienne; une coopération plus poussée avec Copernicus serait bénéfique pour de nombreuses priorités scientifiques.
Étant donné que les renseignements sur les émissions du Canada servent à la modélisation du climat du système terrestre, le Canada fournit des données cohérentes avec la contribution d’autres pays. La cohérence et la comparabilité des renseignements mondiaux permettent au Canada d’évaluer les progrès accomplis vers l’objectif de carboneutralité et d’évaluer les risques climatiques futurs. Les données fournies par le Canada renforcent sa position dans le cadre de la CCNUCC et d’autres tables sur la politique environnementale. Les Canadiens ont participé à des initiatives internationales sur les émissions, notamment le groupe de travail du GIEC sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, l’Observatoire international des émissions de méthane (en anglais seulement) et la base de données mondiale sur les émissions dues aux incendies (en anglais seulement).
La participation actuelle du Canada dans des organisations et des consortiums de recherche internationaux offre aux Canadiens la possibilité de contribuer à la science internationale de pointe. Il s’agit notamment de nombreux programmes de recherche disciplinaires et transdisciplinaires et d’exercices de planification stratégique, tels que le Programme mondial de recherches sur le climat (en anglais seulement), l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC) des Nations Unies, le nouveau groupe de travail de l’International Council for Research and Innovation in Building and Construction sur les solutions fondées sur la nature pour des bâtiments et des communautés résistants au climat (en anglais seulement), l’Integrated Assessment Modeling Consortium (en anglais seulement), le Partenariat mondial sur les sols de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre agricoles.
6.5 Conclusion
Les Canadiens constatent déjà des changements liés au climat et des phénomènes météorologiques extrêmes dans tout le pays. Ces changements et ces phénomènes ont eu des répercussions importantes sur les personnes, les entreprises, les communautés et l’environnement, et ils continueront d’en avoir. Pour faire face à ces répercussions, la prise de décision doit intégrer les sciences et le savoir relatifs aux changements climatiques, et ce, de manière plus urgente que jamais.
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large pour mettre en œuvre la lutte urgente contre les changements climatiques et renforcer la résilience des systèmes naturels et humains face aux effets des changements climatiques. Il met l’accent sur la surveillance, les données, la modélisation, la recherche et l’analyse en tant que base de données probantes pour l’action. Le rapport recommande des activités scientifiques prioritaires dans divers thèmes de recherche pour accroître la création, la diffusion et l’utilisation de renseignements sur le climat au Canada. L’objectif ultime du rapport est de faire progresser les outils, les services, les politiques et les programmes essentiels à l’atténuation des émissions de GES et à l’adaptation aux changements climatiques.
Le caractère urgent des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques exige un déploiement efficace des ressources scientifiques nationales. Tous les membres de la communauté des sciences et du savoir sur les changements climatiques auront un rôle à jouer pour faire en sorte que la lutte contre les changements climatiques soit fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ce rapport vise à orienter la science des changements climatiques et à permettre une meilleure coordination de la science pour obtenir des résultats au cours des cinq à dix prochaines années. La prochaine étape consistera, pour l’ensemble de la communauté scientifique canadienne des changements climatiques, à utiliser ce rapport pour orienter les investissements en sciences, coordonner et planifier les activités de recherche et mobiliser le savoir nécessaire pour soutenir et éclairer un avenir plus résilient et carboneutre pour le Canada.
Annexe – Priorités scientifiques en matière de changements climatiques
Les activités scientifiques prioritaires de recherche et de mobilisation des connaissances en matière de changements climatiques sont les suivantes :
Acronymes
- Priorité pour la recherche – R
- Priorité pour la mobilisation des connaissances – MC
- La science et le savoir autochtones – SSA.
| La science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques (SSA) | |
|---|---|
SSA1. |
Développer le leadership autochtone dans la science des changements climatiques et les réseaux scientifiques autochtones; soutenir les groupes et les réseaux scientifiques et de connaissances qui établissent activement des relations avec les peuples autochtones en créant des voies qui respectent les préoccupations et les priorités locales en matière de science du climat. |
SSA2. |
Harmoniser la planification et la mise en œuvre de la science autochtone et de la science occidentale avec les gouvernements, les organisations et les citoyens autochtones pour élaborer des approches régionales, pertinentes et fondées sur les distinctions en matière de science et de savoir sur les changements climatiques d’une manière qui respecte les droits et l’autodétermination des Autochtones. |
SSA3. |
Créer des documents sur la science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques qui répondent aux objectifs de revitalisation culturelle des peuples autochtones et élaborer des politiques, des programmes et des initiatives qui respectent les langues autochtones. |
SSA4. |
Renforcer les mécanismes d’établissement de la portée et de financement afin d’établir des capacités de recherche scientifique autochtones. |
SSA5. |
Assurer une formation et renforcer les capacités des Autochtones en matière de pratiques scientifiques et des connaissances locales et régionales axées sur le lieu. |
| Des Canadiens en bonne santé et résilients (CBSR) | |
R1. (CBSR) |
Comprendre les effets des changements climatiques sur la santé et les systèmes de santé, afin de promouvoir des mesures d’adaptation efficaces, équitables et réalisables dans le domaine de la santé. |
R2. (CBSR) |
Mener des recherches pour soutenir la transition vers un système de santé durable et à faibles émissions de carbone. |
R3. (CBSR) |
Améliorer la compréhension des politiques, des programmes, des mesures et des nouvelles technologies dont disposent les autorités sanitaires et leurs partenaires pour l’élaboration de systèmes de santé durables et à faibles émissions de carbone. |
MC1. (CBSR) |
Réaliser régulièrement des évaluations des changements climatiques et de la santé à l’échelle nationale, régionale et locale. |
MC2. (CBSR) |
Élaborer des stratégies et des approches innovantes pour la mise en commun de connaissances entre les professionnels de la santé, les praticiens et les administrateurs. |
MC3. (CBSR) |
Faire évoluer les comportements des décideurs, des intervenants et du public en améliorant les stratégies de communication sur les risques sanitaires des changements climatiques, les possibilités d’adaptation et les avantages pour la santé d’une action proactive. |
| Des communautés et un environnement bâti résilients et carboneutres (CEBRC) | |
R1. (CEBRC) |
Produire des données, des prévisions et des projections climatiques afin d’éclairer l’évaluation des risques, l’adaptation et les mesures visant à réduire les émissions de GES pour l’environnement bâti. |
R2. (CEBRC) |
Créer des cartes d’aléas multiples pour cerner et hiérarchiser les zones à haut risque, gérer les interdépendances et traiter les risques en cascade pour les systèmes d’infrastructure. |
R3. (CEBRC) |
Élargir l’utilisation de conception basée sur le rendement pour trouver des solutions innovantes en matière de construction et d’exploitation. |
R4. (CEBRC) |
Élaborer et appliquer une approche fondée sur l’équité afin de mieux orienter les mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des émissions de GES. |
R5. (CEBRC) |
Orienter la transition vers des bâtiments, des transports et des systèmes d’infrastructure à faibles émissions de carbone. |
R6. (CEBRC) |
Améliorer la compréhension des solutions fondées sur la nature dans l’environnement bâti. |
MC1. (CEBRC) |
Élaborer des lignes directrices pour une gouvernance, une coordination et une mise en œuvre efficaces de mesures d’adaptation et d’atténuation à différents échelons de gouvernement et à différentes phases du cycle de vie des infrastructures. |
MC2. (CEBRC) |
Traduire les résultats de la recherche en lignes directrices, protocoles et outils pour les praticiens afin de les aider à créer des environnements bâtis résilients et à faibles émissions de carbone. |
MC3. (CEBRC) |
Tirer parti de la science du comportement et de la compréhension des contextes socioéconomiques pour inciter l’action climatique dans les secteurs des bâtiments, des transports et des infrastructures. |
MC4. (CEBRC) |
Faire progresser les méthodes, les outils et les technologies permettant d’évaluer et d’améliorer la résilience des communautés, notamment les investissements dans la lutte contre les changements climatiques. |
| Des écosystèmes aquatiques et terrestres résilients (EATR) | |
R1. (EATR) |
Mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et de la biodiversité. |
R2. (EATR) |
Faire progresser la science et les connaissances multidisciplinaires pour orienter les solutions d’adaptation aux changements climatiques qui favorisent des écosystèmes résilients dans un climat en changement. |
MC1. (EATR) |
Synthétiser et mobiliser les connaissances sur la résilience des écosystèmes pour soutenir et améliorer la gestion adaptative et la prise de décision fondée sur des données probantes dans un contexte de changements climatiques. |
| Ressources naturelles durables (RND) | |
R1. (RND) |
Comprendre comment les secteurs des ressources naturelles au Canada sont touchés par les changements climatiques et peuvent contribuer à l’action climatique. |
R2. (RND) |
Élaborer et suivre des indicateurs de résilience socioécologique dans les secteurs des ressources naturelles et dans les communautés, et comprendre comment ces secteurs contribuent à l’action climatique. |
R3. (RND) |
Utiliser la recherche collaborative et les approches transdisciplinaires pour explorer les synergies et les compromis en matière d’atténuation et d’adaptation dans les secteurs des ressources naturelles. |
MC1. (RND) |
Élaborer des outils pertinents pour permettre des actions climatiques fondées sur des données probantes à tous les niveaux de la politique et de la prise de décision. |
MC2. (RND) |
Intégrer les sciences sociales et comportementales pour éclairer la prise de décision et les stratégies de communication propres à chaque secteur. |
| Éclairer les progrès vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles (EPENN) | |
R1. (EPENN) |
Améliorer la déclaration des données sur les GES en améliorant la surveillance, en réalisant des progrès dans la mesure et la modélisation des émissions de GES et en conciliant des techniques complémentaires d’estimation des émissions. |
R2. (EPENN) |
Surveiller, analyser et évaluer les changements dans les stocks de carbone des écosystèmes. |
R3. (EPENN) |
Mieux comprendre la contribution de l’utilisation des terres et des changements d’affectation des terres pour parvenir à une carboneutralité en développant des systèmes de surveillance de l’utilisation des terres à haute résolution spatiale. |
R4. (EPENN) |
Examiner les compromis comprenant les émissions et l’élimination des GES dans le contexte économique, environnemental, politique, de santé et social de la société canadienne. |
MC1. (EPENN) |
Harmoniser les données, les renseignements et les connaissances accessibles au public et nécessaires au calcul des émissions. |
MC2. (EPENN) |
Mener des comparaisons et apporter des améliorations aux modèles écosystémiques pour comprendre les facteurs anthropiques du changement du carbone dans le secteur terrestre. |
| Prévision et projection des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes (PPECPME) | |
R1. (PPECPME) |
Améliorer les prévisions et les projections des extrêmes selon des échelles de temps (saison, décennies) et des échelles spatiales (kilomètres). |
R2. (PPECPME) |
Améliorer la surveillance, la collecte et l’accessibilité des données. |
R3. (PPECPME) |
Établir des approches de surveillance, de recherche et de prévision des changements climatiques en collaboration avec les communautés concernées. |
MC1. (PPECPME) |
Synthétiser et mobiliser les connaissances existantes sur la science physique des changements climatiques, y compris les extrêmes. |
| Science du cycle du carbone (CC) | |
R1. (CC) |
Mener des recherches collaboratives sur la modélisation du système terrestre et la compréhension du cycle du carbone. |
R2. (CC) |
Faire la surveillance des stocks de carbone afin de comprendre leurs réactions à l’évolution des conditions climatiques et aux perturbations. |
R3. (CC) |
Améliorer, comparer et appliquer les modèles d’écosystèmes pour estimer les flux de carbone à l’échelle nationale. |
MC1. (CC) |
Effectuer des évaluations scientifiques périodiques du cycle du carbone et du potentiel d’absorption accrue du carbone au Canada. |
| Science du lien entre l’eau et le climat (LEC) | |
R1. (LEC) |
Comprendre la future durabilité de l’eau, notamment en matière d’approvisionnement, de demande, de qualité et d’effets sur la santé des personnes et des écosystèmes. |
R2. (LEC) |
Modéliser les risques liés à l’eau pour la santé des êtres humains et des écosystèmes, ainsi que la charge de morbidité (maladies et décès) due à la poursuite du réchauffement. |
| Science des changements climatiques dans l’Arctique (CCA) | |
| R1. (CCA) | Comprendre l’influence des changements climatiques sur les activités traditionnelles et culturelles. |
| R2. (CCA) | Mener des recherches pour soutenir des systèmes alimentaires sûrs et durables et surveiller l’exposition des habitants du Nord aux maladies infectieuses émergentes d’origine alimentaire et hydrique, aux contaminants et aux parasites. |
| R3. (CCA) | Réaliser une cartographie des risques et des évaluations de la vulnérabilité afin d’orienter la planification de l’adaptation pour les infrastructures construites dans les communautés du Nord. |
| R4. (CCA) | Concevoir des programmes de surveillance qui intègrent les observations de surface et les données satellitaires (missions existantes et prévues) afin de suivre les principaux indicateurs climatiques et de déterminer les risques liés à l’évolution des perturbations (comme les feux de forêt et la fonte de la glace de mer). |
| R5. (CCA) | Faire progresser et évaluer les modèles du système terrestre afin de mieux représenter les processus atmosphériques, cryosphériques, hydrologiques, océanographiques, écologiques et du cycle du carbone dans les régions nordiques. |
| MC1. (CCA) | Élaborer conjointement une approche distribuée pour fournir des services climatiques aux communautés du Nord afin d’éclairer la prise de décision sur la base de données probantes. |
| Science du lien entre l’approche « Une seule santé » et les changements climatiques (LSSCC) | |
R1. (LSSCC) |
Approfondir la compréhension des risques et des facteurs de changement à l’interface entre les humains, les animaux, les végétaux et l’environnement. |
R2. (LSSCC) |
Faire progresser les approches transdisciplinaires ainsi que les modes de connaissance des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière d’échange de connaissances, de tressage des données et d’analyse. |
MC1. (LSSCC) |
Mettre au point des outils interactifs et transdisciplinaires d’aide à la décision et de visualisation, favorisant la prise de décision et la gestion des écosystèmes. |
| La science des voies critiques vers la carboneutralité (VCCN) | |
R1. (VCCN) |
Développer des connaissances fondamentales sur les considérations sociétales et économiques pour élaborer des scénarios de carboneutralité en vue du changement transformationnel au Canada. |
R2. (VCCN) |
Comprendre les processus sociopolitiques, attitudinaux et comportementaux des voies vers la carboneutralité et améliorer la façon dont ils sont intégrés dans les modélisations et les analyses. |
R3. (VCCN) |
Élaborer une stratégie nationale de modélisation des voies vers la carboneutralité afin d’éclairer le changement transformationnel au Canada. |
| Recherche sur les changements climatiques et développement durable (RCCDD) | |
R1. (RCCDD) |
Examiner et comprendre les relations entre la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. |
| Changements climatiques et sécurité (CCS) | |
R1. (CCS) |
Évaluer les voies des politiques des changements climatiques et leurs répercussions en matière de sécurité. |
R2. (CCS) |
Déterminer les risques et les multiplicateurs de menace des changements climatiques pour les activités des institutions de sécurité et pour l’intervention et la planification d’urgence. |
R3. (CCS) |
Élaborer un ensemble d’interventions de sécurité face aux changements climatiques, dans des contextes et à des échelles appropriés. |
R4. (CCS) |
Élaborer une intervention de type « système de systèmes » face aux changements climatiques, reflétant l’interconnexion et les interventions en cascade dans les secteurs sociaux et économiques et les communautés. |
| Sciences sociales et changements climatique (SSCC) | |
R1. (SSCC) |
Comprendre les segments du public canadien et élaborer des produits de communication qui ciblent ces publics. |
R2. (SSCC) |
Élaborer des récits sur les effets des changements climatiques et les mesures à prendre pour responsabiliser les Canadiens, susciter l’espoir et accélérer la transformation de la société. |
R3. (SSCC) |
Comprendre la confiance du public et le flux d’information pour soutenir la communication de renseignements crédibles, tout en limitant la diffusion de renseignements climatiques incorrects ou trompeurs. |
MC1. (SSCC) |
Réaliser des évaluations régulières et approfondies de la science et des connaissances (sur un cycle de cinq à dix ans), complétées par des mises à jour plus brèves et plus fréquentes et par des produits ciblés. |
| Infrastructure de données (Données) | |
| R1. (Données) | Créer, maintenir et renforcer des plateformes accessibles et interopérables pour les données sur le climat, les gaz à effet de serre (GES), les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que les indicateurs socioéconomiques et sanitaires connexes. |