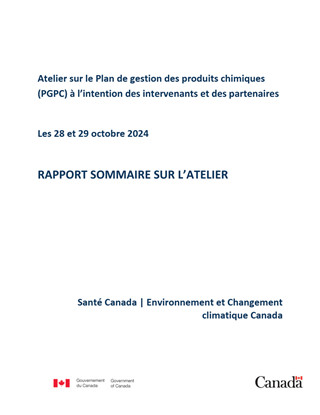Atelier sur le Plan de gestion des produits chimiques à l’intention des intervenants et des partenaires : Rapport sommaire (octobre 2024)
Télécharger en format PDF
(531 Ko, 17 pages)
Organisation : Santé Canada
Sur cette page :
- Introduction
- Atelier sur le PGCP à l'intention des intervenants et des partenaires
- Plan des priorités pour la gestion des produits chimiques au Canada
- Approche pour la Liste de surveillance
- Ébauche de la stratégie pour remplacer, réduire ou affiner les essais sur les animaux vertébrés
- En conclusion
Introduction
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement canadien visant à réduire les risques liés aux substances chimiques présentes dans les aliments, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l'eau potable et les rejets industriels. Pour ce faire, on utilise les outils de gestion les plus appropriés d'un large éventail de lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 (LCPE), la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les pêches et d'autres encore. Le PGPC est mis en œuvre conjointement par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé Canada (SC).
La LCPE est la principale loi environnementale du Canada, et le gouvernement du Canada l'utilise pour mettre en œuvre de nombreux programmes de protection de l'environnement et de la santé pour le bien-être de l'environnement et de la population au Canada. La Loi prévoit les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures concernant la pollution et les substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement. Elle permet, dans le cadre du PGPC, de recueillir des renseignements, de faire de la recherche, d'effectuer un contrôle et de la surveillance, d'évaluer des risques et de gérer des risques liés aux substances chimiques afin de protéger l'environnement et la santé humaine.
Le 13 juin 2023, la LCPE a été modifiée par le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement pour un Canada en santé. Ce projet de loi modernise la LCPE en reconnaissant que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE; en renforçant le Régime de gestion des produits chimiques du Canada; en augmentant la transparence dans la manière dont elle est administrée.
Pour soutenir ces efforts, le gouvernement du Canada continue de consulter la population du pays, les intervenants et les partenaires. La diversité des points de vue fait partie intégrante de l'élaboration et de la mise en œuvre des initiatives résultant d'une LCPE modernisée.
Atelier sur le PGCP à l'intention des intervenants et des partenaires
Les 28 et 29 octobre 2024, ECCC et SC ont organisé un atelier virtuel sur le PGPC à l'intention des intervenants et des partenaires afin de consulter sur diverses initiatives soutenant les nouvelles exigences de la LCPE, notamment :
- projet de plan des priorités pour la gestion des produits chimiques au Canada, y compris :
- les substances d'intérêt prioritaire pour l'évaluation,
- les activités ou initiatives prioritaires qui soutiennent l'évaluation, le contrôle ou la gestion des risques posés par les substances;
- ébauche de la stratégie pour remplacer, réduire ou affiner les essais sur les animaux vertébrés;
- une approche proposée pour la mise en œuvre d'une liste de surveillance (des substances susceptibles de devenir toxiques).
L'atelier virtuel a réuni 42 représentants de l'industrie, de la société civile et du monde universitaire ainsi que des organisations Autochtones et des jeunes. Au cours de l'atelier, les représentants des gouvernements ont présenté des renseignements sur chaque initiative afin de soutenir les discussions en petits groupes entre les participants. Les discussions de groupe ont ensuite été résumées lors de séances plénières. L'ordre du jour de l'atelier et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes A et B.
Tout au long des discussions tenues lors de l'atelier, certains thèmes généraux et transversaux ont émergé des contributions des intervenants et des partenaires, notamment :
- la nécessité d'obtenir des renseignements, des précisions et un contexte supplémentaires en ce qui concerne :
- les liens entre les différentes initiatives et les différents principes d'une LCPE modernisée (par exemple, comment le droit à un environnement sain, tel que le prévoit la LCPE, sera-t-il appliqué ou mis en œuvre dans le cadre du plan des priorités?),
- l'historique du PGPC et l'évolution du programme dans le cadre d'une LCPE modernisée (par exemple, les succès passés du programme, par rapport à ce qui est nouveau par rapport aux approches précédentes),
- la manière dont les initiatives du PGPC sont liées, abordent ou répondent à des initiatives plus larges (par exemple, les changements climatiques, la perte de biodiversité, le traité mondial sur les plastiques),
- les processus du PGPC, les critères et la justification de la priorisation, de l'évaluation et de la gestion des risques, ainsi que les détails sur les initiatives nouvelles ou prévues,
- les délais pour l'évaluation des priorités et la mise en œuvre des initiatives du PGPC;
- la nécessité d'un langage clair, d'une communication plus claire et d'une meilleure accessibilité pour soutenir l'engagement et la participation des intervenants et des partenaires, y compris la société civile, les groupes Autochtones et la population en général;
- la nécessité d'une collaboration étroite avec les universités, le milieu universitaire, les administrations internationales, les intervenants et les partenaires pour soutenir le partage des données et les pratiques exemplaires.
Ce qui suit est un résumé de haut niveau des principaux points de discussion qui ont été soulevés au cours des discussions plénières pour chaque initiative de l'atelier. Il vise à refléter les contributions des intervenants et des partenaires. Les contributions reçues au cours de cet atelier permettront d'affiner les initiatives en cours de développement dans le cadre d'une LCPE modernisée.
Plan des priorités pour la gestion des produits chimiques au Canada
Les modifications apportées à la LCPE exigent que le gouvernement établisse un plan prévisionnel qui précise, entre autres choses :
- les substances pour lesquelles il est jugé prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;
- d'autres activités visant à évaluer, à contrôler ou à gérer les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine que présentent des substances.
Un plan provisoire a été publié aux fins de consultation publique de 60 jours (qui s'est terminée le 4 décembre 2024).
Questions à aborder :
- Que pensez-vous des activités et initiatives proposées pour soutenir l'évaluation et la gestion des risques associés aux substances?
- Quelles sont les informations ou considérations supplémentaires à inclure, le cas échéant?
- Que pensez-vous de la faisabilité, des avantages et des défis de l'évaluation de la liste des substances proposées?
- Quelles substances supplémentaires, quels facteurs clés, quelles informations ou considérations, le cas échéant, devraient être inclus dans l'approche?
Résumé des contributions des intervenants et des partenaires
Clarifier ce qui est nouveau dans le cadre d'une LCPE modernisée : Il convient de mettre davantage l'accent sur ce qui se poursuit ou évolue par rapport aux approches antérieures, plutôt que sur les nouvelles initiatives. Par exemple, présenter le contexte de l'histoire du PGPC et de ses succès à ce jour; décrire en quoi la robustesse des évaluations est identique ou différente; identifier les différences en matière de délais; expliquer comment les nouvelles méthodes d'approche seront intégrées dans les évaluations. Il est utile de préciser ce qui a été fait dans le passé et si un nouveau départ est pris pour certaines substances (par exemple, le groupe des substances ignifuges organiques).
Améliorer la transparence : Il convient d'insister davantage sur le fait que le plan est destiné à évoluer en permanence au fil du temps, et de clarifier certaines définitions, certains délais et la manière dont le plan sera mis à jour lorsque de nouvelles données, telles que des données sur les nouvelles substances préoccupantes, seront disponibles ou que des substances seront ajoutées à la liste des substances prioritaires. Il existe un désir d'élaborer et de clarifier davantage les raisons de la hiérarchisation des priorités et du processus d'évaluation; l'utilisation autorisée de substances toxiques; les critères supplémentaires qui seront pris en compte pour classer les substances comme présentant le risque le plus élevé; les outils de gestion des risques; la manière dont les mélanges de produits chimiques et les effets cumulatifs seront traités par le programme. Il serait utile de détailler davantage chacun des domaines prioritaires, en les illustrant par des exemples. Enfin, il conviendrait de préciser comment d'autres initiatives gouvernementales hautement prioritaires (par exemple, le traité mondial sur les plastiques) seront intégrées dans le plan.
Intégrer le droit à un environnement sain : Le droit à un environnement sain prévu par de la LCPE devrait être reflété dans le plan des priorités en tant que principe directeur, y compris la manière dont il sera pris en compte dans le cadre du processus d'établissement des priorités et tout au long de la recherche, du suivi et de la surveillance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion des risques.
Rendre compte des progrès accomplis : Il est important de disposer d'indicateurs permettant de mesurer la réussite, de suivre les progrès et d'en rendre compte au fil du temps, et ces indicateurs devraient être intégrés au plan. Cela devrait inclure, par exemple, des mesures de résultats et le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre de nouvelles approches visant à réduire les essais sur les animaux (c'est-à-dire le nombre de tests qui ont été remplacés, réduits ou affinés; nombre d'animaux touchés/impact en termes d'animaux qui ne sont plus utilisés pour les tests, etc.).
Activités visant à étayer les approches d'évaluation et à guider les futures activités de hiérarchisation et de gestion des risques
Adopter une approche par catégorie : En général, les participants appuyaient une approche de la gestion des produits chimiques basée sur les catégories. Le regroupement des substances, en particulier de celles qui ont des effets spécifiques sur la santé comme la perturbation endocrinienne, est utile en termes de faisabilité et d'efficacité de l'évaluation des risques.
Toutefois, les évaluations par catégorie peuvent également poser des problèmes en termes de regroupement efficace des substances et risquent de créer des incertitudes pour l'industrie et les consommateurs. Pour éviter le risque de commencer trop large et de devoir réduire le champ des évaluations, il est important de garder le champ d'application ciblé et d'être clair sur les substances qui sont incluses dans ces évaluations. Il est également important de donner à l'industrie suffisamment de temps pour recueillir et soumettre des données sur les substances.
Évaluer les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes et les substances toxiques pour la reproduction : Il est important d'adopter une approche de précaution et de prendre en considération les voies qui vont de l'exposition initiale à des effets plus graves sur la santé pour des substances telles que les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes et les substances toxiques pour la reproduction. Une enquête scientifique rigoureuse et une collaboration avec des experts sont nécessaires pour mieux comprendre les voies d'exposition et les risques. Les effets combinés de ces substances doivent également être pris en compte.
Naviguer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales : La gestion des risques doit être envisagée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'utilisation finale, et doit inclure les partenaires commerciaux mondiaux dans le processus. La transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement sont importantes, compte tenu de leur caractère mondial. Toutefois, les chaînes d'approvisionnement mondiales devenant de plus en plus complexes, la transparence et la traçabilité sont difficiles à atteindre et il peut être nécessaire d'envisager d'autres options de gestion des risques, telles que des enquêtes volontaires de collecte de renseignements, lorsque possible.
Aborder les points chauds : Il est important de prendre en compte d'autres milieux que les émissions atmosphériques (par exemple, l'eau, le sol), de mettre l'accent sur les avantages pour la santé et l'environnement et de définir les critères d'identification d'un point chaud de pollution. Le public doit savoir où se trouve un produit chimique dans l'environnement, en particulier du point de vue des Autochtones.
Éviter les substitutions regrettables : Il est important d'éviter le cycle qui consiste à remplacer une substance nocive par une autre sans comprendre pleinement les risques de la nouvelle substance. Cela conduit souvent à un processus répétitif d'évaluation, de restriction et de remplacement des produits chimiques sans réduction efficace du risque global. L'abaissement du seuil d'évaluation des risques pour les nouvelles substances chimiques, notamment dans les mélanges dont le profil de danger est inconnu, et en particulier dans les contextes professionnels, permettra de mieux appréhender les risques possibles à un stade précoce. La prise en compte du caractère essentiel peut également contribuer à réduire le risque de substitutions regrettables.
Fixer des échéances : Si les délais d'évaluation doivent être plus ambitieux, ils doivent permettre à l'industrie de disposer de suffisamment de temps pour s'adapter lorsque des substitutions sont nécessaires. La prévisibilité des évaluations des risques pour les cinq à six prochaines années est utile pour soutenir la production de données et la recherche de solutions de remplacement.
Améliorer le mécanisme de demande publique : Le processus de désignation des substances à évaluer n'est pas considéré comme accessible au grand public et aux populations Autochtones. Les processus doivent être adaptés et plus accessibles afin d'impliquer les communautés concernées là où elles vivent et travaillent. Les gens ne peuvent pas s'engager dans des processus qu'ils ne comprennent pas. L'utilisation d'un langage simple, plutôt que d'un langage technique, est un moyen de surmonter cet obstacle. Un outil de communication montrant comment utiliser des processus tels que le mécanisme de demande publique serait également utile.
Envisager d'autres moteurs pour établir des priorités : Le caractère essentiel d'une substance doit être pris en compte pour déterminer si elle doit être autorisée sur le marché, évaluée et gérée. Des questions se posent également sur la pondération des données (par exemple, la façon dont les substances et les critères émergents sont comparés à d'autres qui ont été classés par ordre de priorité, ou comment les caractéristiques chimiques, telles que la sensibilisation, sont prises en compte).
Le plan devrait donner la priorité aux produits chimiques qui augmentent la sensibilisation et intégrer la polysensibilité aux substances chimiques (PSC) dans les évaluations des risques. L'avis des personnes ayant une expérience de la polysensibilité aux substances chimiques est essentiel pour mieux comprendre les vulnérabilités et améliorer les stratégies de prévention. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour appuyer ces populations.
Il est également important que les communautés Autochtones aient l'autodétermination, ou le pouvoir, de déterminer leurs propres priorités. Par exemple, il a été noté que les « moteurs clés » de l'approche devraient inclure le travail avec et pour les communautés Autochtones afin de mieux soutenir leur participation au processus de prise de décision concernant les substances prioritaires.
Recherche, surveillance et suivi
Combler les lacunes en matière de données : Les lacunes en matière de données compliquent la réalisation des évaluations. Il peut y avoir un préjudice même en l'absence de recherches ou de données le démontrant. Une approche pourrait être adoptée pour le principe de « pas de données, pas de marché », c'est-à-dire que s'il n'y a pas de données sur une substance, il est probable qu'elle ne soit pas utilisée au Canada.
Faire le suivi des expositions professionnelles : Les données de surveillance concernant les expositions professionnelles sont limitées; cela limite la capacité à regarder en arrière et à identifier les risques. Le système basé sur les plaintes n'est pas préventif; la surveillance doit être menée de manière proactive afin de faire le suivi des expositions et des dommages latents par rapport aux expositions aiguës, et d'informer sur des questions telles que les effets cumulatifs.
Faire le suivi des expositions des populations Autochtones : De plus amples renseignements sont nécessaires sur la manière dont le gouvernement collabore avec les communautés Autochtones pour surveiller les effets sur la santé. Les communautés doivent décider de la nature et des modalités de la recherche et du suivi.
Activités de mobilisation et de communication
Augmenter la collaboration : Une collaboration étroite entre les ministères, ainsi qu'avec les universités, le monde universitaire, l'industrie, les organisations de santé et d'environnement, les partenaires et les administrations est nécessaire tout au long du cycle de gestion des produits chimiques. Il s'agit notamment de collaborer avec d'autres pays, des agences internationales et des partenaires commerciaux en vue d'assurer la transparence de la chaîne d'approvisionnement, le partage des données et les pratiques exemplaires. La création d'un groupe consultatif pourrait contribuer à la réalisation de certains de ces objectifs.
Améliorer l'accessibilité : L'utilisation d'un langage clair dans le plan et dans les communications permettrait aux intervenants et aux partenaires de comprendre plus facilement les informations complexes et techniques présentées et de s'engager efficacement. Il serait utile que toutes les informations soient disponibles en un seul endroit (un « guichet unique »), plutôt que sur différents sites Web et listes. Il est important que les informations soient transmises de manière appropriée aux publics cibles et que des moyens efficaces soient mis en œuvre pour les impliquer dans le processus.
Informer et faire participer le public : L'information doit être transmise de manière à ce que le public puisse la comprendre ou l'utiliser, par exemple en éduquant ce dernier sur l'utilisation sûre des substances et sur ce qu'il peut faire pour réduire son exposition. L'étiquetage des produits est un moyen d'y parvenir, bien que cette approche puisse avoir des conséquences inattendues.
Approche pour la Liste de surveillance
Les modifications apportées à la LCPE exigent que le gouvernement établisse une liste des substances que les ministres soupçonnent d'être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu'elles sont potentiellement toxiques. Cette liste s'appelle la Liste de surveillance. Une approche proposée pour la Liste de surveillance, décrivant la manière dont la liste sera compilée et modifiée, a été publiée pour une consultation publique de 60 jours (qui s'est terminée le 4 décembre 2024).
Questions à aborder :
- Que pensez-vous de l'approche proposée pour la Liste de surveillance?
- Y a-t-il des considérations ou des informations supplémentaires à prendre en compte concernant l'approche?
Résumé des contributions des intervenants et des partenaires
Objectifs d'une Liste de surveillance
Renforcer le principe de précaution : L'établissement d'une Liste de surveillance pourrait servir d'outil pour informer la population canadienne des substances préoccupantes. Elle pourrait également signaler l'intention du gouvernement en ce qui concerne les engagements internationaux et encourager l'industrie à rechercher des solutions de remplacement plus sûres pour les produits chimiques préoccupants.
Tenir compte des doubles emplois et des conséquences involontaires : Des inquiétudes ont été exprimées quant à la redondance et au chevauchement avec d'autres listes et outils existants, tels que les dispositions relatives à une nouvelle activité, et en ce qui concerne le fait que la Liste n'est associée à aucune action législative. Cela a soulevé des questions quant à la possibilité que la Liste de surveillance devienne une liste de substances en suspens. Les conséquences involontaires associées ont également été signalées, telles que l'interprétation erronée de la Liste par le public; la désélection des substances susceptibles d'influencer le marché canadien; le poids perçu de l'augmentation des volumes de recherche et de développement pour l'industrie; la surcharge de données; les impacts économiques ou les implications en matière de commerce international.
Approche pour la Liste de surveillance
Combler les lacunes en matière d'information : Le document d'approche doit contenir davantage d'informations afin de clarifier les objectifs de la Liste de surveillance et de préciser pourquoi et comment les substances seront ajoutées à la Liste (par exemple, les critères permettant de déterminer le danger par rapport au risque). Il faut également préciser comment les substances seront ajoutées ou supprimées et comment elles seront évaluées; les échéanciers; les exigences en matière de consultation et la manière dont la Liste de surveillance interagit avec d'autres listes existantes ou s'y rattache.
Assurer l'ouverture et la transparence : Il doit être clair que la Liste de surveillance est un outil de communication. Il est important qu'elle soit précise et exacte afin d'obtenir l'effet désiré (par exemple, communiquer à l'industrie et aux intervenants les informations dont ils ont besoin pour les aider à déterminer si certaines substances doivent être évitées, et communiquer aux consommateurs pour les sensibiliser aux substances qui pourraient être préoccupantes). L'approche de la Liste de surveillance doit être communiquée dans un langage simple, afin que les Canadiens comprennent comment les substances sont inscrites sur la Liste de surveillance et comment elles en sont retirées. La Liste de surveillance pourrait être utilisée par les citoyens canadiens pour les aider à faire des choix de consommation éclairés. En outre, cette Liste pourrait servir d'outil de communication sur les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les risques ou y remédier.
Prendre en compte les critères de la Liste de surveillance : La Liste doit inclure un niveau de spécificité qui prend en compte les critères suivants : les risques pour l'humain et l'environnement; les modes de toxicité; les populations touchées de manière disproportionnée et les populations Autochtones; l'impact sur les générations et les perspectives Autochtones; les environnements vulnérables; les marqueurs de confiance permettant d'évaluer la qualité des données et des informations associées à une substance; les utilisations et les volumes de la substance sur le marché canadien (et les mises à jour au fur et à mesure des changements).
Appuyer l'industrie : L'établissement d'une procédure de Liste de surveillance qui minimise la charge pesant sur l'industrie contribuerait à promouvoir son utilisation. Des données ou des informations supplémentaires sur les alternatives appropriées aideraient l'industrie à éviter des substitutions regrettables. Le fait de ne pas se limiter à l'identification des substances, mais d'inclure également les produits et les utilisations spécifiques qui posent problème, aiderait l'industrie à cibler les expositions qui posent problème.
Ébauche de la stratégie pour remplacer, réduire ou affiner les essais sur les animaux vertébrés
La LCPE prévoit l'obligation, dans la mesure du possible, de recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l'utilisation des animaux vertébrés lors de l'évaluation des dommages potentiels que les substances peuvent causer à la santé humaine et à l'environnement. ECCC et SC s'efforcent de faire progresser ces travaux sur plusieurs fronts, notamment par le développement, la normalisation et l'intégration de nouvelles méthodes d'approche (NMA) dans les activités d'évaluation des dangers et des risques. Afin de poursuivre ses efforts, le gouvernement a élaboré un projet de stratégie visant à remplacer, réduire ou affiner les essais sur les animaux vertébrés dans le cadre de la LCPE. Le projet de stratégie a été publié pour une période de consultation publique de 60 jours (qui s'est achevée le 13 novembre 2024).
Questions à aborder :
- Que pensez-vous des principaux éléments proposés de la stratégie provisoire?
- Quelles sont les informations ou considérations supplémentaires à inclure, le cas échéant?
Résumé des contributions des intervenants et des partenaires
Soutien à la stratégie
La stratégie provisoire a reçu un large soutien; la réduction ou l'abandon de l'expérimentation sur les animaux vertébrés est perçu positivement. La stratégie représente une opportunité de définir une norme d'excellence pour le Canada.
NMA
Répondre aux préoccupations et aux défis en matière de données : Des inquiétudes ont été exprimées concernant l'utilisation des NMA, leur capacité à détecter les impacts sur les populations et les environnements affectés de manière disproportionnée, et la question de savoir si les données et les résultats seront transparents et reproductibles. Un problème potentiel est l'utilisation de données pour produire des données; il est essentiel que les données de base reflètent fidèlement les conditions et les circonstances des données de résultats. Une autre préoccupation potentielle concerne les implications en termes de ressources. Les NMA sont considérés comme coûteux, mais nécessaires.
Les défis anticipés soulignent l'importance de développer des méthodes robustes qui fournissent une représentation étendue des différents aspects examinés dans les évaluations des risques (par exemple, les effets sur la santé humaine, les effets sur la santé environnementale, les effets sur les rejets dans l'environnement, etc.). Il serait également utile de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les essais et les données acceptés, y compris ceux qui impliquent de nouvelles approches ou qui étudient de nouveaux mécanismes. Sans flexibilité, on risque de passer à côté des avantages potentiels que des techniques nouvelles ou novatrices pourraient apporter.
Garantir la transparence : Il sera essentiel de garantir la transparence en ce qui concerne la confiance dans les méthodes, en particulier lorsque l'on s'éloigne de l'expérimentation animale traditionnelle. Lorsque les limites de certaines méthodes d'essai sont identifiées, il convient de faire preuve de transparence en ce qui concerne les hypothèses, les lacunes en matière de connaissances ou les préjugés susceptibles d'influer sur les décisions. La clarification de l'approche pour le développement et l'utilisation des NMA influencera la manière dont les chercheurs ciblent et organisent leur travail.
Collaboration
Travailler avec la communauté scientifique et renforcer les capacités : Les chercheurs devront être impliqués. La validation des nouvelles méthodes sera essentielle pour garantir leur crédibilité et nécessitera un financement. Il est également nécessaire de coordonner les efforts de l'ensemble de la communauté scientifique.
Établir des partenariats : Par le biais de partenariats, le gouvernement peut servir de catalyseur pour renforcer les capacités dans l'ensemble du secteur en veillant à ce que les universités intègrent les NMA dans l'enseignement; former les évaluateurs de risques aux approches les plus récentes; coordonner les efforts entre les communautés scientifiques; partager des données entre les administrations; travailler avec les organismes de financement pour encourager l'allocation de fonds dans ce domaine et soutenir le développement des NMA.
Mise en œuvre
Garantir la faisabilité : Des questions se posent sur ce qui est possible et dans quel délai, en tenant compte de nombreux facteurs, tels que les attentes du public, les exigences légales, l'état de préparation réglementaire, l'état et l'acceptation de la science, et l'état de préparation des administrations. Les ressources et le renforcement des capacités seront déterminants pour la mise en œuvre de ces approches alternatives. Cela représentera un changement dans la manière dont l'information est générée, recueillie et évaluée.
Combler l'écart : Les approches centrées sur l'animal qui réduisent les impacts négatifs sur les animaux pendant que des tests de remplacement sont mis au point peuvent être envisagées dès maintenant. L'examen de l'essentialité; les domaines dans lesquels les tests pourraient être réduits de manière substantielle; des points d'intervention plus humains sont quelques idées de domaines prioritaires pour les efforts. L'industrie peut également s'engager volontairement à éliminer les tests sur les animaux, à moins que la loi ne l'exige (comme certains l'ont déjà fait). La priorité pourrait également être accordée aux zones où le plus grand nombre d'animaux est utilisé ou où les dommages sont les plus importants.
En conclusion
Le gouvernement du Canada remercie les intervenants et les partenaires d'avoir pris le temps de participer à cet atelier pour partager leurs connaissances et leur expertise sur ces questions. Les initiatives clés dans le cadre d'une LCPE modernisée continueront d'être façonnées par la rétroaction et la participation des intervenants et des partenaires, ce qui contribuera à faire évoluer la gestion des produits chimiques vers l'avenir pour le Canada. Pour vous tenir au courant des prochaines consultations, veuillez consulter notre liste des consultations publiques prévues.
Liens connexes
- Aperçu : substances potentiellement préoccupantes - la Liste de surveillance
- Mise en œuvre de la modernisation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
- Projet de Plan des priorités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
- Un droit à un environnement sain en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
- Consultation fermée :Ébauche de la stratégie pour remplacer, réduire ou raffiner les essais sur les animaux vertébrés
Annexe A : Ordre du jour
ATELIER SUR LE PLAN DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES (PGPC) À L'INTENTION DES INTERVENANTS ET DES PARTENAIRES
« L'avenir de la gestion des produits chimiques »
Du 28 au 29 octobre 2024, de 13 h à 16 h 30 (HNE)
Objectifs de l'atelier
- Faire le point sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et sur les orientations futures dans le cadre d'une version modernisée de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE)
- S'engager à l'égard des nouvelles exigences clés de la LCPE :
- Plan des priorités proposé pour la gestion des produits chimiques
- Proposition de liste de surveillance pour les substances susceptibles de devenir toxiques
- Faciliter la mise en réseau et l'établissement de relations entre les intervenants et les partenaires du PGPC, ainsi qu'avec les représentants du gouvernement du Canada
JOUR 1
| Heure | Point |
|---|---|
De 13 h à 13 h 10 |
Déclaration de reconnaissance territoriale Mot de bienvenue et présentations Greg Carreau Animateur |
De 13 h à 13 h 20 |
Rondes de réseautage (tous les participants) |
De 13 h 20 à 14 h 20 |
Présentation du gouvernement (30 minutes) Renforcer le régime canadien de gestion des produits chimiques dans le cadre d'une LCPE modernisée Greg Carreau Jacinthe David Jacqueline Gonçalves Foire aux questions (30 min) |
De 14 h 20 à 14 h 35 |
Pause-santé |
De 14 h 35 à 14 h 55 |
Présentation du gouvernement (20 minutes) 1) Plan des priorités pour la gestion des produits chimiques au Canada : Consultation sur les activités et initiatives proposées pour soutenir l'évaluation et la gestion des risques des substances Nicole Davidson Maya Berci |
De 14 h 55 à 15 h 40 |
Groupes de discussion (Tous les participants) Questions à aborder :
|
| De 15 h 40 à 16 h 15 | Séance plénière |
| De 16 h 15 à 16 h 30 | Synthèse et préparation de l'engagement pour le deuxième jour |
JOUR 2
| Heure | Point |
|---|---|
De 13 h à 13 h 05 |
Mot de bienvenue |
De 13 h 5 à 13 h 15 |
Présentation du gouvernement (10 minutes) 2) Plan des priorités pour la gestion des produits chimiques au Canada : Consultation sur le projet de liste de substances à évaluer en priorité Nicole Davidson Marc Demers |
De 13 h 15 à 13 h 45 |
Groupes de discussion (Tous les participants) Questions à aborder :
|
| De 13 h 45 à 14 h 5 | Séance plénière |
| De 14 h 5 à 14 h 15 | Pause-santé |
De 14 h 15 à 14 h 25 |
Présentation du gouvernement (10 minutes) 3) Mettre en œuvre une approche provisoire concernant la liste de surveillance : Consultation sur l'administration de la liste de surveillance Andrew Beck Maya Berci |
De 14 h 25 à 14 h 55 |
Groupes de discussion (Tous les participants) Questions à aborder :
|
| De 14 h 55 à 15 h 15 | Séance plénière |
| De 15 h 15 à 15 h 25 | Pause-santé |
De 15 h 25 à 15 h 35 |
Présentation du gouvernement (10 minutes) 4) Consultation sur un projet de stratégie visant à remplacer, réduire ou affiner l'expérimentation animale sur les animaux vertébrés Michèle Regimbald-Krnel |
De 15 h 35 à 16 h |
Groupes de discussion (Tous les participants) Questions à aborder :
|
De 16 h à 16 h 20 |
Séance plénière |
De 16 h 20 à 16 h 30 |
Prochaines étapes et mot de la fin Jacinthe David Jacqueline Gonçalves Animateur |
Annexe B : Liste des participants
| Participant | Organisation |
|---|---|
| Andrea Lesperance | Assemblée des Premières Nations |
| Jane McArthur | Association canadienne des médecins pour l'environnement |
| Simon Kinsman | Association canadienne de produits de consommation spécialisés (ACPCS) |
| Julie Dale | Conseil canadien de protection des animaux |
| Fe De Leon | Association canadienne du droit de l'environnement |
| Geoff Granville | Association canadienne des carburants |
| Alex Callahan | Congrès du travail du Canada |
| Nathan Hauch | Congrès du travail du Canada |
| Dave Saucier | Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement |
| Erica Phipps | Partenariat canadien pour la santé des enfants et l'environnement |
| Andy Dabydeen | Société Canadian Tire |
| YasminTarmohamed | Association canadienne des constructeurs de véhicules |
| Amardeep Khosla | CEPA Industry Coordination Group (ICG) |
| Christine Nahas | Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) |
| Beta Montemayor | Cosmetics Alliance Canada |
| Linitha Ganesh | Cosmetics Alliance Canada |
| Richard Parcels | Cosmetics Alliance Canada |
| Scott Thurlow | DOW Chemical Canada |
| Elaine MacDonald | Ecojustice |
| Cassie Barker | Environmental Defence |
| Rohini Peris | Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) |
| Jackie Crichton | Food, Health & Consumer Products of Canada |
| Ian Peace | Friends of Fish Society |
| Sophia Huang | Ralliement national des Métis |
| Nikita Saha Turna | Centre de collaboration nationale en santé environnementale |
| Christina Marciano | North American Flame Retardant Alliance (NAFRA) |
| Ishrat Sultana | NovaChem |
| Meg Sears | Prevent Cancer Now |
| Gulnara Gabidullina | Proctor & Gamble |
| Cathy Campbell | Responsible Distribution Canada |
| Harrison Brook | Conseil canadien du commerce de détail |
| Manvi Bhalla | Shake up the Establishment |
| Xiao Tan | Shell Canada |
| Sheila Cole | Sierra Club Canada, région de l'Atlantique |
| Katia Forgues | Sustainable Youth Canada |
| Charu Chandrasekera | Canadian Centre for Alternatives to Animal Methods (CCAAM) |
| Danielle Morrison | Association minière du Canada |
| Bill Jeffrey | Toxics Caucus |
| Don Spady | Toxics Caucus |
| Carole Yauk | Université d'Ottawa |
| Miriam Diamond | Université de Toronto |
| Lily Farinaccio | Women's Healthy Environment Network |
| Participant gouvernemental | Organisation |
|---|---|
| Jacinthe David | Environnement et Changement climatique Canada |
| Jacqueline Gonçalves | Environnement et Changement climatique Canada |
| Maya Berci | Environnement et Changement climatique Canada |
| Marc Demers | Environnement et Changement climatique Canada |
| Kara Arsenault | Environnement et Changement climatique Canada |
| Greg Carreau | Santé Canada |
| Andrew Beck | Santé Canada |
| Sonya Billiard | Santé Canada |
| Nicole Davidson | Santé Canada |
| Michèle Régimbald-Krnel | Santé Canada |
| Tim Singer | Santé Canada |