Rapport annuel sur les langues officielles 2020–2021
Sur cette page
- Message de la présidente du Conseil du Trésor
- Introduction
- Chapitre 1. Communications et services au public
- Chapitre 2. Langue de travail
- Chapitre 3. Les institutions fédérales et la participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise
- Chapitre 4. Les institutions et la gestion du dossier des langues officielles
- Chapitre 5. Les langues officielles et la COVID‑19
- Chapitre 6. Les langues officielles et le Secrétariat
- Conclusion du rapport
- Annexe A. Méthodologie pour rendre des comptes sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles
- Annexe B. Institutions fédérales tenues de soumettre un bilan pour l’exercice 2020-2021
- Annexe C. Définitions
- Annexe D. Tableaux statistiques
- Annexe E. Statistiques des événements organisés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours de l’exercice 2020-2021
- Annexe F. Répartition des bureaux et points de service fédéraux au 31 mars 2021
Message de la présidente du Conseil du Trésor

Présidente du Conseil du Trésor
Je suis heureuse de présenter le 33e rapport annuel sur les langues officielles pour l’exercice 2020-2021. Ce rapport décrit les mesures que les institutions fédérales ont prises afin de respecter leur obligation de servir le public en français et en anglais, et d’accroître l’utilisation de ces deux langues comme langues de travail au sein de l’administration publique fédérale.
Avec les langues autochtones, l’anglais et le français sont au cœur de l’histoire et de l’identité du Canada. Les langues officielles renforcent les valeurs de diversité et d’inclusion et contribuent à notre cohésion sociale et à notre résilience. Toutefois, les Canadiennes et Canadiens s’attendent à ce que nous fassions davantage pour renforcer le français et assurer la vitalité continue des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans tout le pays. La Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur il y a plus de 50 ans et sa dernière réforme d’importance remonte à plus de 30 ans. Depuis cette époque, notre monde a radicalement changé. Les médias sociaux sont devenus une force puissante qui a un impact sur la langue et la culture. L’immigration s’est accélérée, rendant le Canada plus dynamique et plus diversifié, mais nous devons en faire davantage pour que l’immigration profite également aux communautés francophones en situation minoritaire. Pour répondre à ces nouvelles réalités, le gouvernement a déposé en mars dernier un projet de loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Ce projet de loi propose un certain nombre d’améliorations importantes pour moderniser la Loi sur les langues officielles, de sorte qu’elle continue de servir la population canadienne au 21e siècle.
Ce rapport annuel identifie également les domaines dans lesquels les institutions fédérales peuvent s’améliorer. Le gouvernement fédéral doit être exemplaire dans son utilisation du français et de l’anglais, tant dans ses communications avec le public qu’au sein même de ses institutions. Pour m’en assurer, j’ai demandé à mes fonctionnaires de mettre en œuvre les mesures administratives décrites dans le document « Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ces mesures permettront de renforcer la dualité linguistique au sein des institutions fédérales, d’améliorer la prestation des services auprès des citoyens et citoyennes dans la langue officielle de leur choix et d’accroître la responsabilisation des institutions quant à leur rendement en matière de conformité avec la Loi sur les langues officielles.
Je vous invite à lire ce rapport pour savoir comment les institutions fédérales s’acquittent de leurs responsabilités et mettent en pratique l’engagement du gouvernement envers les langues officielles du Canada.
Original signé par :
L’honorable Mona Fortier
Présidente du Conseil du Trésor
Introduction
La Loi sur les langues officielles (la Loi) établit que le Conseil du Trésor est chargé de l’orientation et de la coordination générales des politiques et programmes d’application des parties IV, V et VI de la Loi dans les institutions fédérales. Le Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le Secrétariat) a la responsabilité d’établir et d’évaluer l’étendue de l’application de ces politiques et programmes et de mesurer leur degré d’incidence.
Concrètement, le Secrétariat aide quelque 200 institutions fédérales (soit des institutions faisant partie de l’administration publique centrale, des sociétés d’État, des organismes privatisés, des organismes distincts et des établissements publics assujettis à la Loi) à s’acquitter pleinement des obligations linguistiques prévues dans la Loi.
Ces obligations se classent en quatre grandes catégories. Tant dans des situations normales que dans des situations d’urgence, les institutions fédérales doivent :
- servir les membres du public et communiquer avec eux dans les deux langues officielles;
- mettre en place un milieu de travail bilingue dans les régions désignées bilingues;
- contribuer au maintien d’une fonction publique dont l’effectif tend à refléter la composition démographique canadienne sur le plan des langues officielles;
- faire une gestion adéquate du dossier des langues officielles.
Ce 33e rapport annuel décrit dans quelle mesure les institutions fédérales ont réussi à atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus au cours des trois derniers exercices, dont l’exercice 2020-2021. Ce rapport donne aussi des exemples d’activités que les institutions ont menées pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de bilinguisme.
Pour réaliser son analyse, le Secrétariat exige que les institutions fédérales soumettent un bilan sur les langues officielles au moins une fois tous les trois ansNote en bas de page 1. Afin de tenir compte de l’ensemble des institutions assujetties à la Loi, le Secrétariat a utilisé les résultats des plus récents bilans que les institutions fédérales lui ont remis pour les exercices 2018-2019, 2019‑2020 et 2020-2021 (l’annexe A du présent rapport présente la méthodologie précise utilisée pour réaliser cette analyse).
Les données présentées dans le présent rapport, contrairement à celles mises de l’avant dans les éditions précédentes, portent sur un cycle de trois exercices et sur toutes les institutions fédérales, plutôt que sur un seul exercice (p. ex., 2020-2021) et sur les institutions appelées à déposer un bilan pour cet exercice. Les données peuvent dans certains casNote en bas de page 2 être comparées à celles recueillies par le Secrétariat lors du cycle 2015-2018 pour vérifier si une situation particulière (p. ex., utilisation des deux langues officielles dans les réunions des institutions fédérales) s’est améliorée, est demeurée stable ou s’est détériorée.
L’analyse que le Secrétariat a réalisée des bilans du dernier cycle a permis de dégager différents constats. Comme le montre le chapitre 1 du présent rapport, qui porte sur les communications avec le public et les services rendus à celui-ci, deux énoncés comptent parmi celles auxquelles les institutions devraient chercher à s’attaquer avec le plus de vigueur dans les années à venir :
- l’offre active en personne;
- dans les contrats et les accords conclus avec des tiers agissant pour le compte d’une institution, l’inclusion de clauses énonçant clairement les exigences linguistiques auxquelles ces tiers doivent se conformer (p. ex., agents de contrôle aux aires d’embarquement des aéroports qui sont des sous-traitants de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien).
Le chapitre 2 montre que les institutions fédérales se concentrent sur des mesures qui favoriseront la mise en place, au sein des régions bilingues, d’un milieu de travail réellement propice à l’utilisation du français et de l’anglais. En particulier, il faut faire preuve d’un leadership accru afin que les employés fédéraux se sentent à l’aise de recourir à la langue de leur choix quand ils rédigent des textes ou participent à des réunions. Dans un ordre d’idées légèrement différent, des institutions devraient concentrer leurs efforts sur le développement des compétences en langue seconde que leurs employés souhaitent acquérir.
Le chapitre 3 porte sur la représentation des francophones et des anglophones au sein de la fonction publique fédérale. L’information qui y est présentée nous permet de conclure que celle-ci constitue globalement un bon reflet de la composition linguistique de la population canadienne, notamment en raison des mesures ciblées que prennent de nombreuses institutions.
Le chapitre 4, qui traite du thème de la gouvernance en matière de langues officielles, met en évidence la nécessité pour les institutions de se servir des outils à leur disposition pour assurer une désignation linguistique adéquate des postes.
Le chapitre 5 montre que davantage d’organisations gagneraient à tenir compte de la question des langues officielles au moment de se doter de plans en prévision de situations de crise ou d’urgence.
Enfin, le chapitre 6 décrit certaines des mesures prises en 2020-2021 par le Secrétariat pour favoriser le respect global de la Loi à l’échelle de l’appareil fédéral.
Chapitre 1. Communications et services au public
Dans cette section
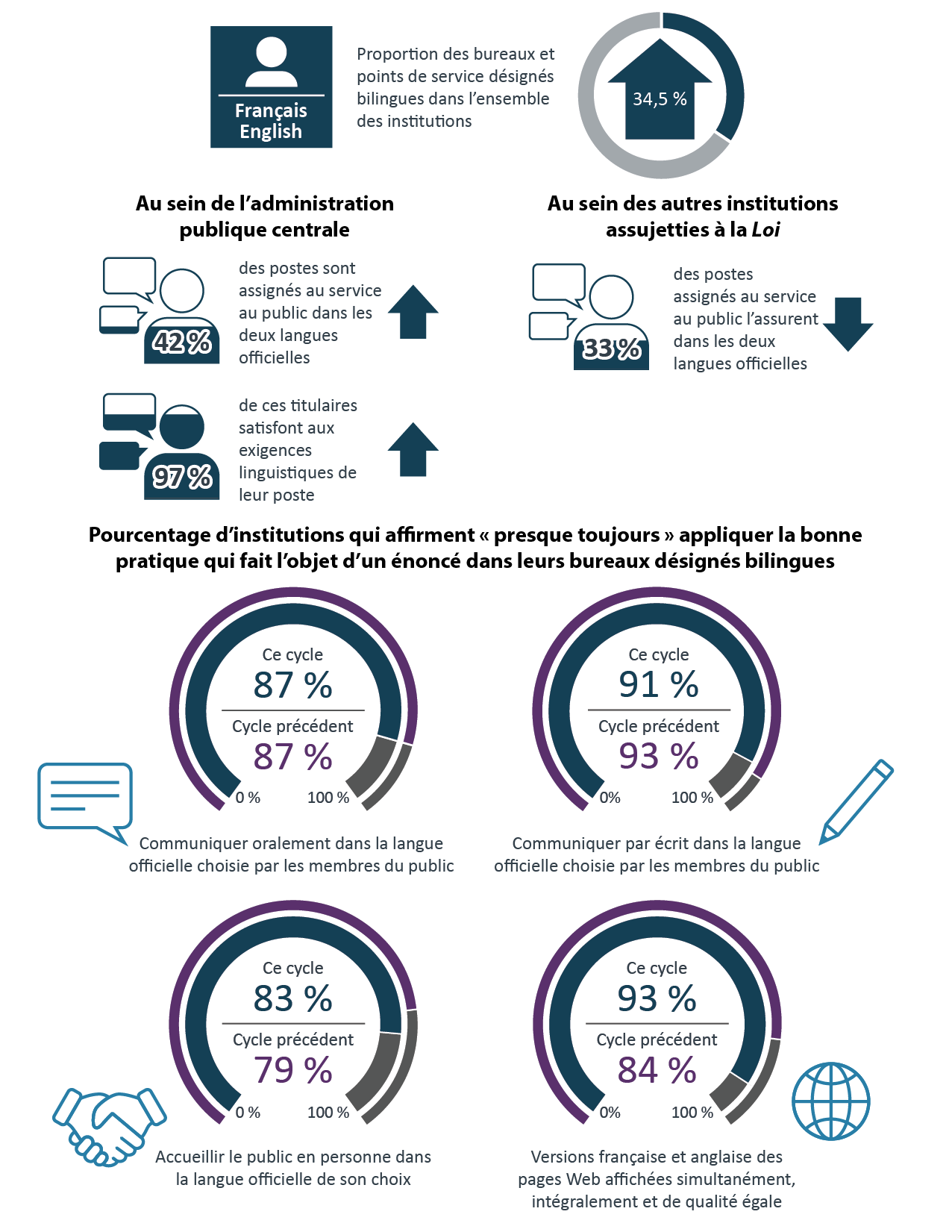
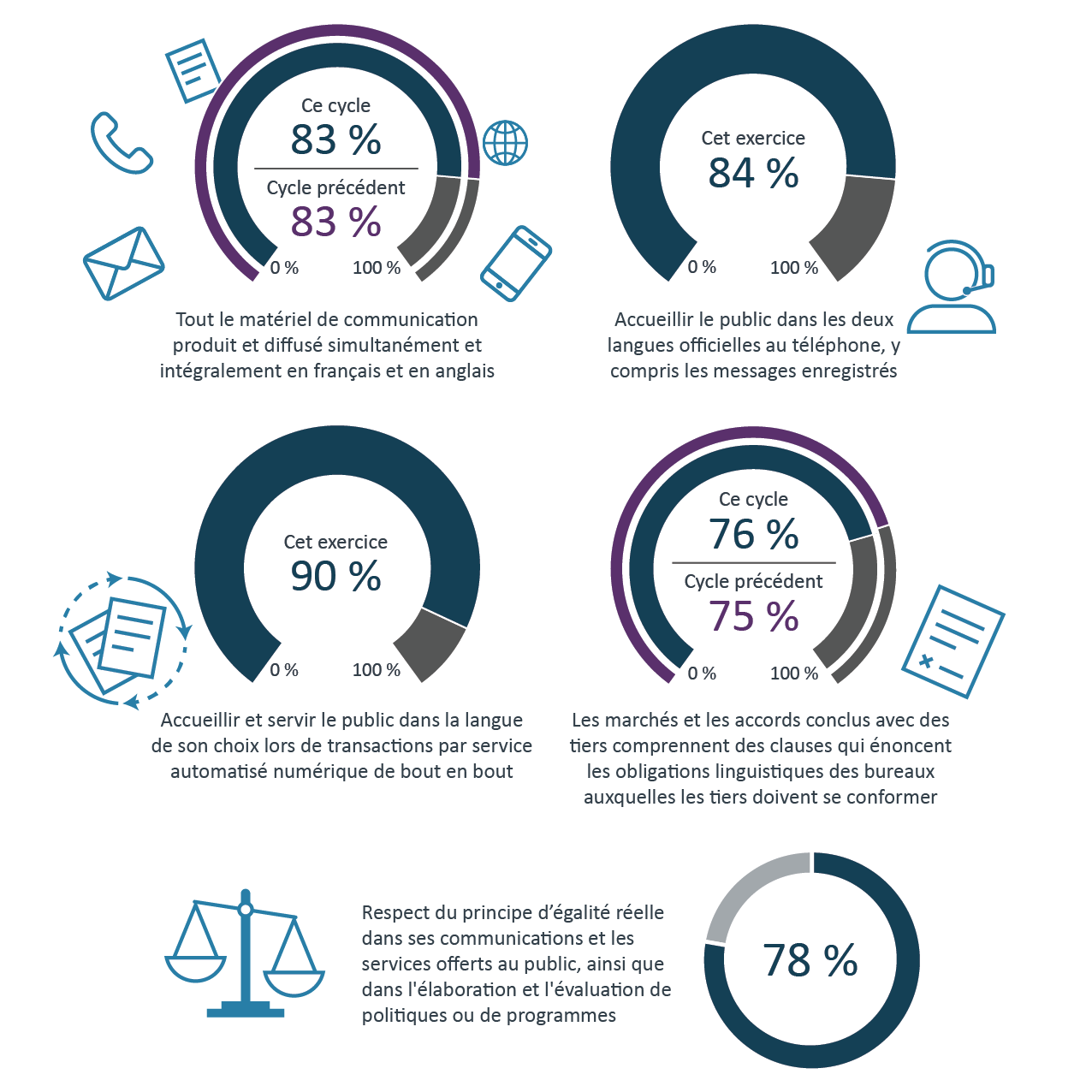
Graphique - Version textuelle
Proportion des bureaux et points de service désignés bilingues dans l’ensemble des institutions : 34,5 %, une tendance à la hausse.
Au sein de l’administration publique centrale : 42 % des postes sont assignés au service au public dans les deux langues officielles, une tendance à la hausse;
97 % de ces titulaires satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse.
Au sein des autres institutions assujetties à la Loi, 33 % des postes sont assignés au service au public dans les deux langues officielles, une tendance à la baisse.
Pourcentage d’institutions qui affirment « presque toujours » appliquer la bonne pratique qui fait l’objet d’un énoncé dans leurs bureaux désignés bilingues :
Communiquer oralement dans la langue officielle choisie par les membres du public : pour ce cycle, 87 %; pour le cycle précédent : 87 %
Communiquer par écrit dans la langue officielle choisie par les membres du public : pour ce cycle, 91 %; pour le cycle précédent : 93 %
Accueillir le public en personne dans la langue officielle de son choix : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 79 %
Versions française et anglaise des pages Web affichées simultanément, intégralement et de qualité égale : pour ce cycle, 93 %; pour le cycle précédent : 84 %
Tout le matériel de communication produit et diffusé simultanément et intégralement en français et en anglais : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 83 %
Accueillir le public dans les deux langues officielles au téléphone, y compris les messages enregistrés : pour cet exercice : 84 %
Accueillir et servir le public dans la langue de son choix lors de transactions par service automatisé numérique de bout en bout : pour cet exercice : 90 %
Les marchés et les accords conclus avec des tiers comprennent des clauses qui énoncent les obligations linguistiques des bureaux auxquelles les tiers doivent se conformer : pour ce cycle, 76 %; pour le cycle précédent : 75 %
Respect du principe d’égalité réelle dans ses communications et les services offerts au public, ainsi que dans l’élaboration et l’évaluation de politiques ou de programmes : pour ce cycle, 78 %
1.1. Bureaux et points de service
Le réseau de bureaux et de points de service au public des institutions fédérales s’étend dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, de même qu’à l’étranger. Il permet essentiellement au public d’obtenir des services au comptoir, au téléphone, à bord d’avions, de traversiers et de trains et par le truchement de bornes interactives.
Au 31 mars 2021, les institutions comptaient 11 164 bureaux et points de serviceNote en bas de page 3 , dont 3 847 (34,5 %) avaient l’obligation d’offrir des services au public et de communiquer avec celui-ci dans les deux langues officielles (l’annexe F présente une carte du réseau des bureaux et points de service).
1.2 Communications orales et écrites
Comme le montre le graphique 1, selon le dernier bilan présenté, 91 % des institutions ont affirmé communiquer avec le public par écrit (particulièrement par le truchement de communiqués et d’avis publics) « presque toujours » dans la langue officielle choisie par celui-ci, et 87 % ont indiqué que c’était aussi le cas pour les communications orales (lors de conférences de presse, dans le cadre de discours publics, dans des vidéos).
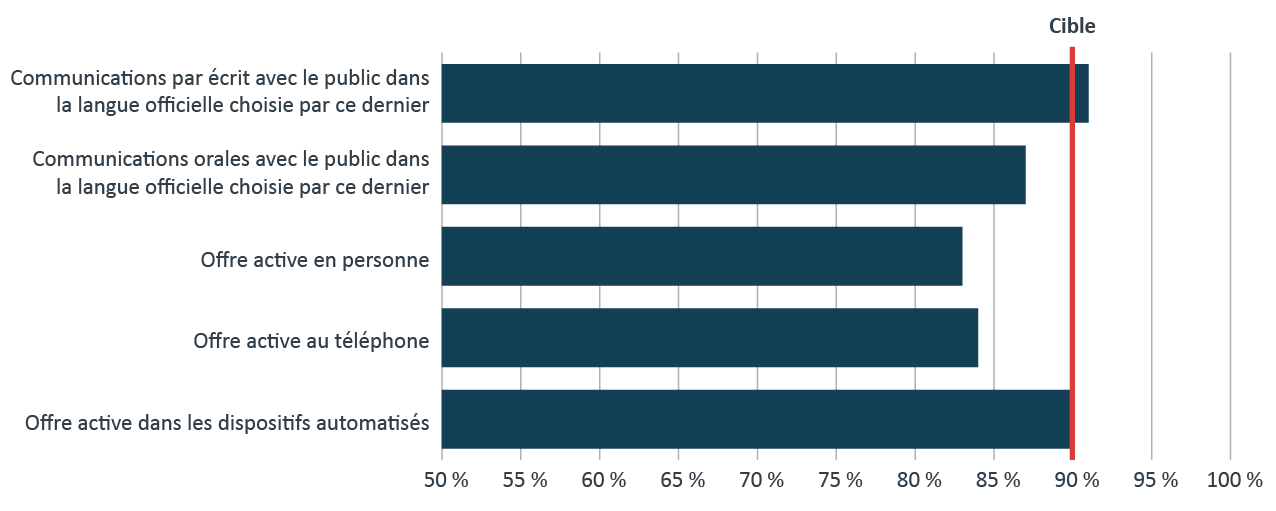
Graphique 1 - Version textuelle
Communications par écrit avec le public dans la langue officielle choisie par ce dernier : 91 %; communications orales avec le public dans la langue officielle choisie par ce dernier : 87 %; offre active en personne : 83 %; offre active au téléphone : 84 %; offre active dans les dispositifs automatisés : 90 %, avec pour cible, 90 %.
Lee résultat pour les communications écrites correspond à la cible fixée par le SecrétariatNote en bas de page 4 , mais le résultat pour les communications orales révèle une valeur qui est de 3 % inférieure à la cible fixée, comme lors du cycle 2015-2018.
Présentation de pratiques exemplaires
Le présent document comporte des passages mis en évidence portant sur des pratiques exemplaires que l’ensemble des institutions fédérales devrait chercher à imiter.
Pratique exemplaire
La Banque du Canada fait partie des institutions qui ont indiqué qu’elles communiquent « presque toujours » avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix. Les discours clés des représentants de la Banque sont prononcés dans les deux langues officielles, et chaque personne présente est invitée à intervenir en français ou en anglais. La Banque reçoit aussi des demandes d’organisations qui souhaitent l’inviter à prononcer un discours. Les représentants de l’institution font alors leur allocution dans la langue choisie par l’organisation hôte, tout en s’assurant d’y intégrer du contenu dans l’autre langue officielle. Les discours prononcés en public par les porte-parole de la Banque sont publiés sur le Web en français et en anglais.
Pratique exemplaire
De son côté, Sécurité publique Canada reçoit plus de 4 500 demandes de renseignements des médias et du public par année. Toutes les réponses de l’institution sont fournies dans la langue officielle dans laquelle la demande a été présentée, à moins que le demandeur n’y soit allé d’instructions contraires.
Les résultats ci-dessus s’expliquent en bonne partie par le fait que les institutions fédérales disposent de la capacité requise pour offrir des services dans les deux langues. En date du 31 mars 2021, 45 830 des 111 542 (41,1 %) titulaires de postes affectés aux services au public au sein de l’administration publique centrale devaient ainsi offrir des services en français et en anglais. Parmi ces 45 830 personnes, 96,9 % satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste. Une situation similaire prévalait dans les institutions assujetties à la Loi qui ne font pas partie de l’administration publique centrale. Ainsi, 21 763 employés sur les 66 076 (32,9 %) affectés aux services au public étaient en mesure d’offrir ces services dans les deux langues officielles dans les bureaux de ces institutionsNote en bas de page 5.
1.3 Offre active
Dans les bureaux bilingues, les institutions fédérales sont tenues de prendre des mesures pour assurer l’offre active de services au public dans les deux langues officielles. Selon la Politique sur les langues officielles, pratiquer l’offre active signifie pour une institution « indiquer clairement, visuellement et oralement, que les membres du public peuvent communiquer en français ou en anglais et obtenir des services d’un bureau désigné dans l’une ou l’autre de ces langues ». Il est important pour les institutions et leur personnel de pratiquer l’offre active, puisque des travaux de recherche ont montré que celle-ci incite fortementNote en bas de page 6 les membres du public à utiliser leur propre langue officielle quand ils communiquent avec le gouvernement ou cherchent à en obtenir des services.
Sur l’ensemble des institutions qui ont soumis un bilan lors des trois dernières années, 83 % ont indiqué prendre presque toujours des mesures appropriées pour accueillir dans les deux langues officielles le public qui se présente en personne à leurs bureaux, une hausse de 4 % depuis 2015-2018 (graphique 1).
Le téléphone est le moyen privilégié par de nombreux citoyens pour joindre les institutions fédérales. Les bilans recueillis par le Secrétariat pour l’exercice 2020-2021 montrent que 84 % de ces dernières pratiquent presque toujours l’offre active au téléphone, y compris dans leurs messages enregistrés. Finalement, les bilans tiennent maintenant compte du fait que les citoyens peuvent parfois obtenir les renseignements ou services fédéraux qu’ils convoitent sans interaction humaine. Selon les bilans, 90 % des institutions mettent presque toujours en œuvre des mesures pour que l’offre active soit assurée dans les dispositifs automatisés numériques qu’elles déploientNote en bas de page 7.
Certaines institutions prennent rapidement les mesures qui s’imposent lorsqu’elles se rendent compte que leur personnel ne pratique pas l’offre active comme il devrait le faire.
Pratique exemplaire
Par exemple, durant la pandémie, Transports Canada a été informé que certains des messages d’accueil en français de sa ligne automatisée sans frais étaient inadéquats. Le ministère rapporte dans son bilan 2020-2021 que, dès qu’elle a été avisée du problème, l’équipe responsable s’est assurée de le résoudre.
1.4 Diffusion de renseignements
Le Web est devenu avec le temps le premier moyen de diffusion de renseignements dont se servent les institutions fédérales. Tout comme le site www.canada.ca, les sites Web des institutions fédérales doivent être systématiquement accessibles dans les deux langues officielles.
C’est actuellement le cas de la plupart des sites Web fédéraux. En effet, 93 % des institutions ont indiqué dans leur dernier bilan que les contenus français et anglais de leur site Web sont presque toujours affichés simultanément (il n’y a pas de décalage notable dans le temps entre le moment où la version française et la version anglaise sont mises en ligne) et publiés intégralement (p. ex., la version française n’est pas un simple résumé de la version anglaise). Il s’agit là d’un bond majeur de 9 points de pourcentage depuis le cycle 2015-2018.
Pratique exemplaire
L’Agence de santé publique du Canada et Santé Canada font partie des institutions qui prennent des mesures vigoureuses pour assurer la dualité linguistique sur le Web. Ainsi, le logiciel de publication de ces institutions est conçu pour garantir que seules les pages Web contenant à la fois du contenu en anglais et en français peuvent être publiées sur www.canada.ca. En outre, un certain nombre de leurs directions générales ont mis en place des processus de traduction et de révision robustes pour garantir que les contenus en français et en anglais soient de qualité égale. Enfin, l’Agence surveille en continu les pratiques de diffusion Web de ses différentes directions.
Puisque le Web prend une importance croissante dans notre société, il demeure important que les institutions fédérales continuent de communiquer efficacement avec les citoyens par d’autres moyens. À cet égard, 83 % des institutions affirment dans leur dernier bilan que le matériel de communicationNote en bas de page 8 provenant de leurs bureaux désignés bilingues est presque toujours produit et diffusé simultanément et intégralement en français et en anglaisNote en bas de page 9.
Pratique exemplaire
Le Bureau du directeur général des élections (Élections Canada) figure parmi les institutions qui affirment appliquer cette pratique. Les plans et les stratégies d’Élections Canada prévoient l’application de mesures qui permettent à l’institution de s’assurer que son matériel de communication est diffusé intégralement et simultanément dans les deux langues officielles. Lors d’une élection, Élections Canada surveille aussi si ce matériel bilingue est, dans les faits, accessible. Des suivis sont enfin effectués auprès de tous les directeurs du scrutin pour leur faire part des résultats de cet exercice de surveillance et les inciter à corriger les problèmes qui se présentent.
1.5 Marchés et accords conclus avec des tiers
La Loi prévoit que les institutions fédérales doivent veiller à ce que les renseignements ou les services qu’un tiers fournit en leur nom aux membres du public le soient bel et bien dans la langue officielle privilégiée par ces derniers. Les institutions fédérales concernées ne le font pas toujours. En effet, seulement 76 % d’entre elles s’assurent que les marchés et les accords conclus avec des tiers qui agissent pour le compte de bureaux bilingues comprennent presque toujours des clauses qui énoncent les obligations linguistiques que ces tiers doivent respecter. La situation demeure virtuellement inchangée depuis 2015-2018, alors que cette proportion était de 75 %.
Pratique exemplaire
Les contrats qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada signe avec des tiers comprennent une disposition sur le bilinguisme. Le résumé de ces contrats contient une section obligatoire précisant dans quelles langues officielles les travaux devront être exécutés et les produits ou biens livrables, fournis. Les gestionnaires de projet de cette institution ont la responsabilité de veiller à ce que les obligations linguistiques énoncées dans ces contrats soient respectées. Par exemple, le Programme d’échange en matière de littératie numérique cible les groupes sous-représentés dans l’économie numérique, dont les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En 2020‑2021, le ministère s’est assuré que les six bénéficiaires de ce programme respectent les clauses linguistiques prévues dans les accords de contribution les liant au gouvernement.
1.6 Respect du principe d’égalité réelle
« L’égalité réelle est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est nécessaire, des différences dans les caractéristiques et les circonstances de la communauté minoritaire, en offrant des services avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de prestation différent afin d’assurer que la minorité reçoit les services de la même qualité que la majorité. Cette démarche est la norme en droit canadienNote en bas de page 10. »
Selon les bilans déposés ces trois dernières années, 78 % des institutions fédérales respectent presque toujours le principe d’égalité réelle lorsqu’elles communiquent avec le public ou lorsqu’elles lui fournissent des services. Cela laisse donc place à l’amélioration.
Pour s’assurer d’offrir des services de qualité véritablement égale en français et en anglais, les institutions fédérales gagnent à se servir de la Grille d’analyse des services et programmes fédéraux en regard du principe de l’égalité réelle. La grille comprend une série de questions pour aider les institutions fédérales à considérer les répercussions sur les enjeux de langues officielles lorsque de nouvelles initiatives sont proposées. Les questions portent sur les parties IV, V, VI et VII de la Loi et permettent de s’assurer que les obligations et les facteurs relatifs aux langues officielles sont pris en compte dès le début du processus d’élaboration d’une présentation au Conseil du Trésor.
Durant l’exercice 2020-2021, le Secrétariat s’est affairé à réviser son Guide à l’intention des rédacteurs de présentations au Conseil du Trésor , y compris l’analyse des incidences sur les langues officielles. Le Secrétariat a consulté la communauté de pratique sur l’ébauche de la nouvelle version du guide. Le guide a été diffusé en juin 2021. Le ministère du Patrimoine canadien a aussi rédigé un nouveau guide pour faciliter l’analyse des incidences sur les langues officielles, mais pour la préparation d’un mémoire au Cabinet. Il s’intitule Guide pour la rédaction d’un mémoire au Cabinet - Analyse des incidences sur les langues officielles. Le Secrétariat en a fait la promotion dans son bulletin La Connexion LO d’avril 2021 destiné à la communauté de pratique des langues officielles.
1.7 Conclusion
L’examen des bilans soumis au Secrétariat ces trois dernières années montre que de nombreuses institutions fédérales se conforment aux obligations que leur impose la partie IV de la Loi ou, encore, adoptent certaines pratiques jugées exemplaires. Ainsi, les communications par écrit et les sites Web gouvernementaux affichent un fort taux de conformité.
Cependant, il y a encore place à l’amélioration dans certains domaines.
En particulier, beaucoup d’institutions démontrent des lacunes en matière d’offre active en personne, lesquelles pourraient avoir pour effet d’insécuriser une partie des membres du public (particulièrement ceux appartenant aux communautés linguistiques en situation minoritaire). Cette insécurité peut en effet faire en sorte que les Canadiens ou les voyageurs n’osent pas demander à être servis dans la langue officielle de leur choix lorsqu’ils devraient bel et bien être en mesure d’exercer ce droit.
L’omission par certaines institutions de clauses linguistiques dans des ententes conclues avec des tiers est aussi un problème à corriger, puisqu’en l’absence de telles clauses, certains tiers pourraient ne pas offrir les services en français ou en anglais attendus par les membres du public. Les institutions fédérales doivent respecter les mêmes obligations linguistiques, peu importe si elles offrent elles-mêmes le service ou si elles font appel à un partenaire pour le faire.
Chapitre 2. Langue de travail
Dans cette section
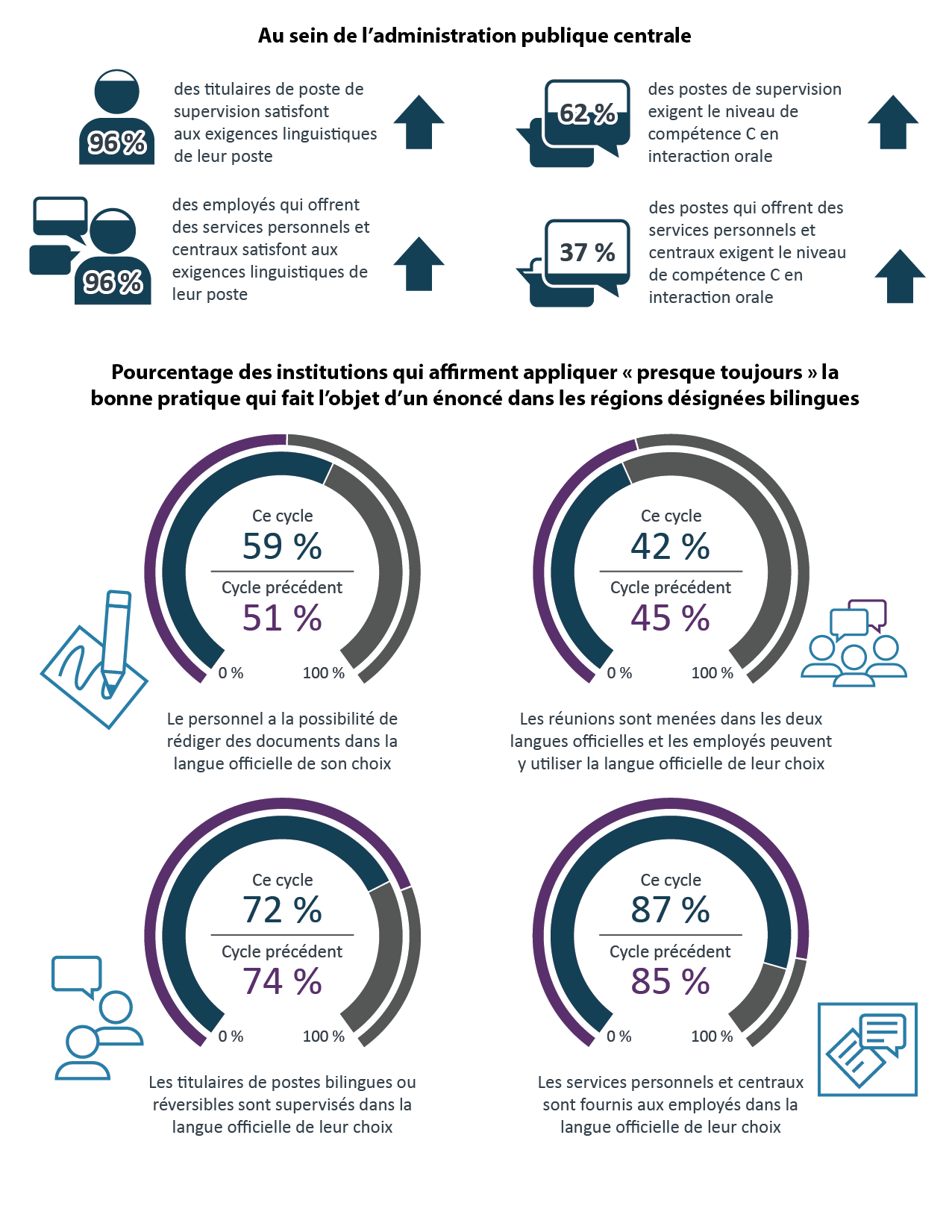
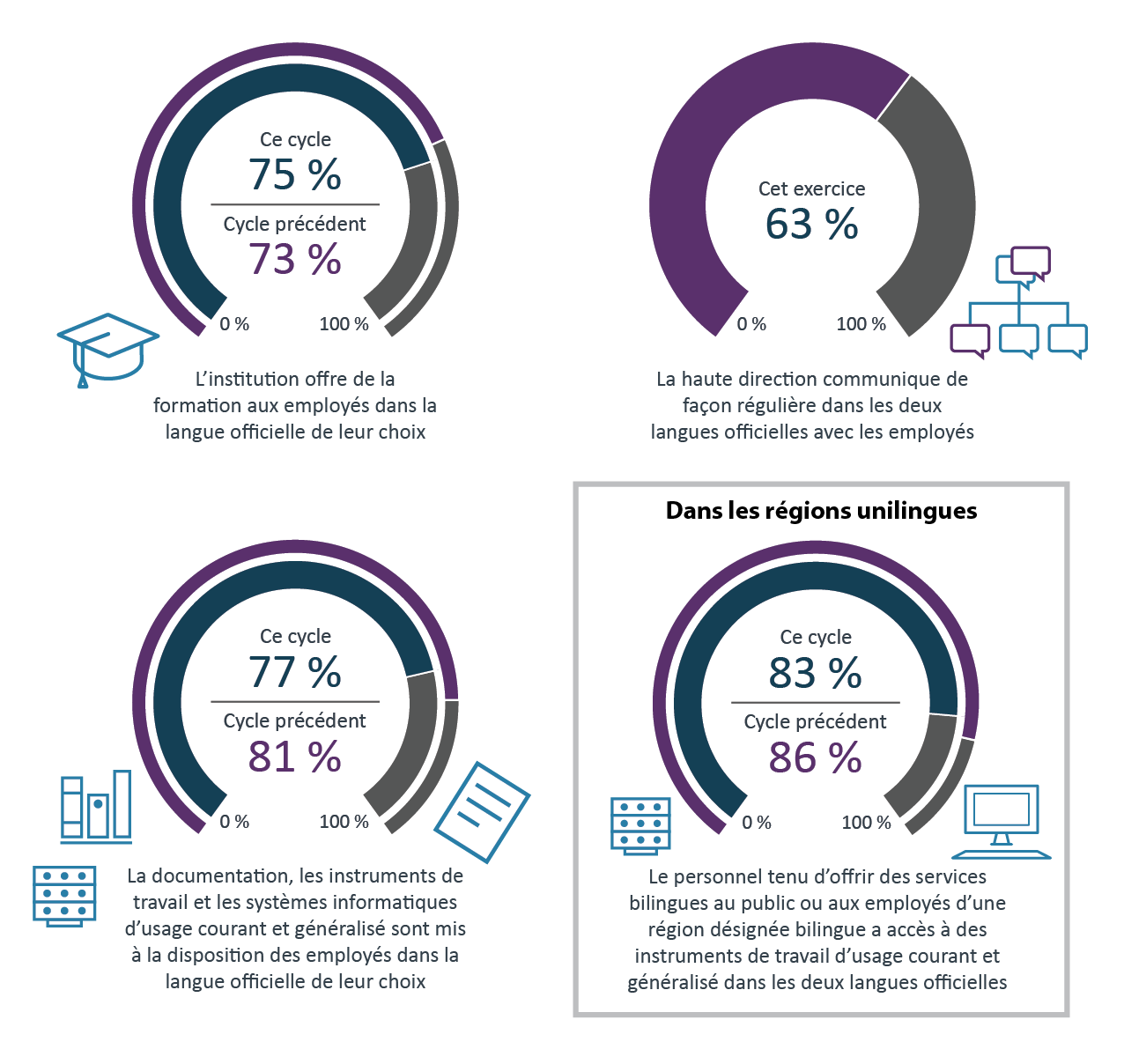
Graphique - Version textuelle
Au sein de l’administration publique centrale, 96 % des titulaires de poste de supervision satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse;
62 % des postes de supervision exigent le niveau de compétence C en interaction orale, une tendance à la hausse;
96 % des employés qui offrent des services professionnels et centraux satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse;
37 % des postes qui offrent des services personnels et centraux exigent le niveau de compétence C en interaction orale, une tendance à la hausse.
Pourcentage d’institutions qui affirment « presque toujours » appliquer la bonne pratique qui fait l’objet d’un énoncé dans les régions désignées bilingues :
Le personnel a la possibilité de rédiger des documents dans la langue officielle de son choix : pour ce cycle, 59 %; pour le cycle précédent : 51 %
Les réunions sont menées dans les deux langues officielles et les employés peuvent y utiliser la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 42 %; pour le cycle précédent : 45 %
Les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont supervisés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 72 %; pour le cycle précédent : 74 %
Les services personnels et centraux sont fournis aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 87 %; pour le cycle précédent : 85 %
L’institution offre de la formation aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 75 %; pour le cycle précédent : 73 %
La haute direction communique dans les deux langues officielles avec les employés de façon régulière : pour cet exercice, 63 %
La documentation, les instruments de travail et les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé sont disponibles aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 77 %; pour le cycle précédent : 81 %
Dans les régions unilingues, le personnel tenu d’offrir des services bilingues au public ou aux employés d’une région désignée bilingue a accès à des instruments de travail d’usage courant et généralisé dans les deux langues officielles pour : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 86 %
La partie V de la Loi définit les droits linguistiques des employés fédéraux. Elle vise d’abord à favoriser la pleine reconnaissance de la langue française et de la langue anglaise dans la fonction publique fédérale. Elle vise aussi à faire en sorte que les fonctionnaires jouissent de la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail.
L’analyse des bilans déposés par les institutions fédérales de 2018 à 2021 montre qu’il y a encore place à l’amélioration pour faire en sorte que les employés dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail puissent vraiment travailler dans la langue officielle de leur choix.
Suivi du rapport Borbey-Mendelsohn
En 2017, le greffier a confié au Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport Borbey-Mendelsohn intitulé Le prochain niveau : Enraciner une culture de dualité linguistique inclusive en milieu de travail au sein de la fonction publique fédérale. Depuis 2018, le Portail linguistique du Canada contient un tableau de bord pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 14 catégories de recommandations contenues dans le rapport Borbey-Mendelsohn. D’ailleurs, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations. Toutefois, les recommandations les plus complexes (p. ex., formation linguistique et rehaussement du profil linguistique des superviseurs) ont été intégrées dans une stratégie plus large sur la langue de travail et des propositions administratives dans le cadre de la modernisation de la Loi. Le Secrétariat fera désormais état des progrès réalisés dans les efforts visant à renforcer le bilinguisme dans la fonction publique.
2.1 Langue de rédaction
Selon le graphique 2, seulement 59 % des institutions fédérales (contre 51 % en 2015-2018) rapportent dans leur dernier bilan que leur personnel a « presque toujours » la possibilité de rédiger des documents dans la langue officielle de son choix.
Pratique exemplaire
Ressources naturelles Canada compte parmi les organisations qui veillent au respect du droit des fonctionnaires de rédiger des documents dans la langue de leur choix. Dans son plan d’action sur les langues officielles, ce ministère mise sur la prise de mesures pour mieux sensibiliser les employés au fait qu’ils ont le droit de travailler en français ou en anglais. De fait, dans une communication destinée à tous les employés, le sous-ministre les a encouragés à travailler dans la langue de leur choix lorsqu’ils préparent des notes d’information et des documents. Ressources naturelles Canada a aussi installé un logiciel de correction automatique bilingue sur tous les postes de travail de son personnel, suivant une recommandation contenue dans le rapport Borbey-Mendelsohn.
2.2 Langue des réunions
Le graphique 2 montre ensuite que seulement 42 % des institutions affirment dans leur dernier bilan que les réunions menées dans les régions désignées bilingues le sont presque toujours dans les deux langues officielles. Cela représente une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2015-2018. Autrement dit, une majorité d’institutions doivent en faire davantage pour respecter le droit des fonctionnaires d’utiliser le français ou l’anglais dans des rencontres se déroulant en mode présentiel ou virtuel.
Pratique exemplaire
Le Bureau du surintendant des institutions financières Canada a publié sur son intranet une infographie sur le thème spécifique des langues officielles et du télétravail. L’infographie présente aux fonctionnaires leurs droits et les pratiques qu’ils devraient observer lorsqu’ils organisent des réunions virtuelles ou lorsqu’ils participent à de telles réunions. Le Bureau a aussi produit des arrière-plans spéciaux que les employés peuvent installer lorsqu’ils sont en visioconférence pour envoyer le signal que chacun devrait se sentir à l’aise de recourir au français ou à l’anglais.
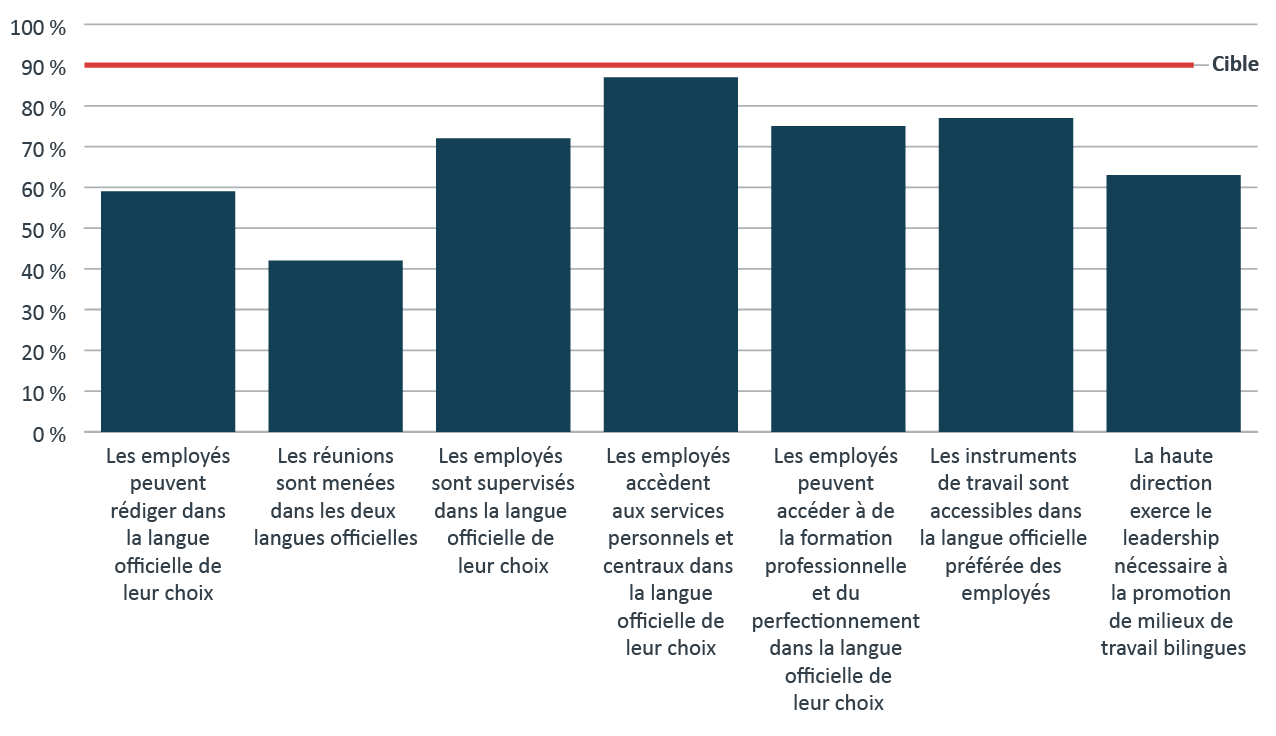
Graphique 2 - Version textuelle
Les employés peuvent rédiger dans la langue officielle de leur choix : 59 %; les réunions sont menées dans les deux langues officielles : 42 %; les employés sont supervisés dans la langue officielle de leur choix : 72 %; les employés accèdent aux services personnels et centraux dans la langue officielle de leur choix : 87 %; les employés peuvent accéder à de la formation professionnelle et du perfectionnement dans la langue officielle de leur choix : 75 %; les instruments de travail sont accessibles dans la langue officielle préférée des employés : 77 %; et la haute direction exerce le leadership nécessaire à la promotion de milieux de travail bilingues : 63 %, avec pour cible 90 %.
2.3 Langue de supervision des employés
En vertu de la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes, les gestionnaires et les superviseurs sont tenus de superviser « les employés qui travaillent dans les régions bilingues dans la langue officielle de leur choix quand ceux-ci occupent des postes bilingues ou réversiblesNote en bas de page 11 et dans la langue officielle du poste quand ceux-ci occupent des postes unilingues ».
Or, seulement 72 % des institutions ont indiqué dans leur dernier bilan que les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont presque toujours supervisés dans la langue officielle de leur choix (graphique 2).
Ces résultats ne semblent pas être attribuables à un manque de capacité que les superviseurs auraient sur le plan linguistique. En date du 31 mars 2021, 96,1 % des titulaires des 28 811 postes de supervision bilingues au sein de l’administration publique centraleNote en bas de page 12 satisfaisaient en effet aux exigences linguistiques de leur poste — des exigences élevées puisque 62 % des postes de supervision bilingues exigent un niveau de compétence C en interaction orale, soit la norme la plus élevée.
Pratique exemplaire
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada s’est, entre autres, donné comme priorité de respecter le droit de ses employés à être supervisés dans la langue officielle de leur choix. En juin 2021, le Centre lancera sa propre politique sur les langues officielles, laquelle rendra obligatoire l’atteinte du niveau CBC par les détenteurs d’un poste de supervision dans une région bilingue.
2.4 Services personnels et centraux
Comme le montre le graphique 2, 87 % des institutions qui ont soumis un bilan ces trois dernières années affirment que les services personnels et centraux qu’elles offrent aux employés des régions désignées bilingues le sont presque toujours dans la langue officielle préférée par chacun. Cela signifie par exemple que le fonctionnaire qui souhaite recevoir de l’aide pour régler un problème avec sa paie ou son ordinateur peut le faire à son choix, en français ou en anglais.
Au 31 mars 2021, 96,4 % des 68 581 titulaires de postes bilingues appelés à fournir des services personnels et centraux au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste, et 37,1 % de ces titulaires affichaient un niveau de compétence C en interaction orale.
2.5 Formation et perfectionnement
Dans les régions bilingues, les institutions doivent offrir la formation et les services de perfectionnement professionnel dans la langue officielle préférée de l’employé. Les trois quarts (75 %) des grandes institutions fédéralesNote en bas de page 13 , les seules tenues de se prononcer sur cet énoncé particulier dans leur bilan, affirment presque toujours le faire (graphique 2).
Pratique exemplaire
Certaines institutions ne se tournent pas seulement vers l’École de la fonction publique du Canada pour offrir des cours dans les deux langues officielles. Par exemple, les employés d’Emploi et Développement social Canada ont accès aux cours du Collège, un centre de formation créé par ce ministère. Le Collège a mis à l’essai 481 cours bilingues pour former les employés de tout le pays sur des questions priorisées par l’institution. Plus de 100 cours en français et en anglais ont aussi été créés par le bureau régional de l’Atlantique pour les employés de cette région. Des formations individuelles et en groupes, à temps partiel et à temps plein, sont aussi offertes au personnel pour qu’il améliore sa langue seconde.
2.6 Instruments de travail
Tant les employés situés dans les régions bilingues que les employés qui doivent offrir des services au public dans les deux langues officielles dans une région unilingue ont le droit d’accéder à de la documentation, à des instruments de travail et à des systèmes information d’usage courant et généralisé (p. ex., tableur ou application collaborative infonuagique) dans la langue officielle de leur choix. Selon les bilans examinés par le Secrétariat dans le cadre du présent cycle, 77 % des institutions fédérales estiment que leur personnel est presque toujours en mesure d’exercer ce droit, lequel revêt une importance particulière en cette ère de travail à distance, une baisse de 4 points de pourcentage depuis 2015-2018 (graphique 2).
Les données du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020Note en bas de page 14 , viennent cependant nuancer ce résultat. En 2020, 94 % des fonctionnaires ont répondu positivement à l’affirmation suivante : « le matériel et les outils mis à ma disposition dans le cadre de mon travail, y compris les logiciels et les autres outils informatisés, sont disponibles dans la langue officielle de mon choix ».
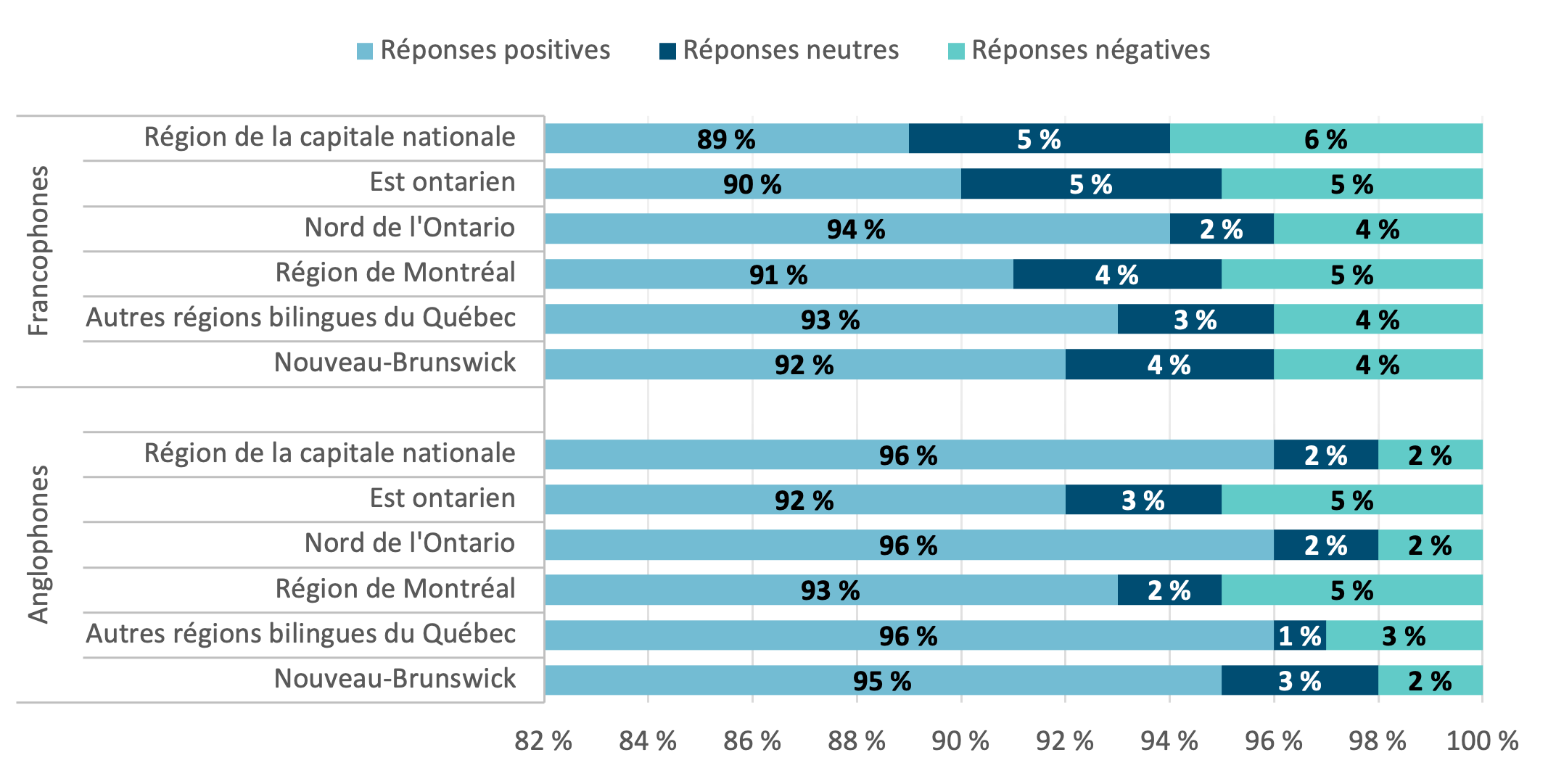
Graphique 3 - Version textuelle
Dans la région de la capitale nationale, 89 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans l’Est ontarien, 90 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre, et 5 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 94 % des francophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 4 % négativement. Dans la région de Montréal, 91 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 5 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 93 % des francophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 4 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 92 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre, et 4 % négativement.
Dans la région de la capitale nationale, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans l’Est ontarien, 92 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre, et 5 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans la région de Montréal, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 5 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 1 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 95 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre, et 2 % négativement.
Pratique exemplaire
Sécurité publique Canada fait partie des institutions qui font un effort particulier pour fournir à leurs fonctionnaires des instruments de travail dans leur langue officielle préférée. En 2020, le ministère a ainsi créé un groupe de travail pour s’assurer que les technologies de l’information acquises par l’organisation respectent bien les politiques en vigueur en matière de langues officielles, d’accessibilité et de sécurité. Les questions suivantes figurent dans le formulaire qui sert à approuver une technologie : « Cet outil sera-t-il utilisé par des employés situés dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail? Dans l’affirmative, l’outil devrait leur être offert dans la langue officielle de leur choix ». « Cet outil est-il requis pour permettre aux employés de communiquer ou d’offrir des services au public ou à des employés en français et en anglais? Dans l’affirmative, l’outil devrait leur être offert dans les deux langues officielles. »
2.7 Leadership
La Politique sur les langues officielles souligne que, dans les régions désignées bilingues, il relève de l’administrateur général de donner le ton approprié en matière de respect du français et de l’anglais. Toutefois, seules 63 % des institutions avancent dans leur dernier bilan que la haute direction dans ces régions désignées bilingues exerce presque toujours le leadership nécessaire à la promotion d’un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles (graphique 2). Selon l’édition 2020 du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux, 80 % des employés fédéraux dans les régions désignées bilingues aux fins de langue de travail affirment que les cadres supérieurs de leur ministère ou organisme utilisent les deux langues officielles dans leurs interactions avec les employés.
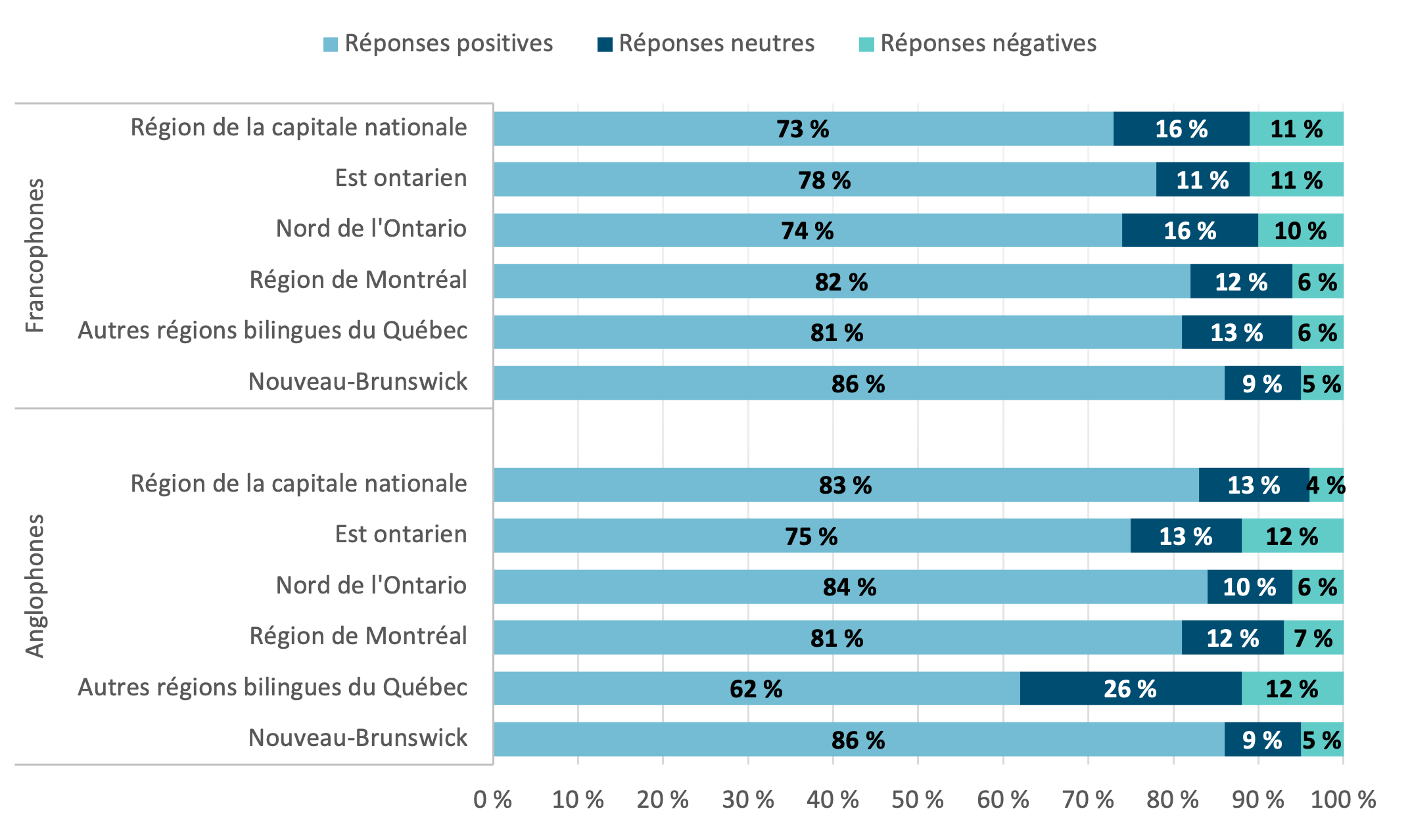
Graphique 4 - Version textuelle
Dans la région de la capitale nationale, 73 % des francophones ont répondu positivement, 16 % de façon neutre et 11 % négativement. Dans l’Est ontarien, 78 % des francophones ont répondu positivement, 11 % de façon neutre, et 11 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 74 % des francophones ont répondu positivement, 16 % de façon neutre et 10 % négativement. Dans la région de Montréal, 82 % des francophones ont répondu positivement, 12 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 81 % des francophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre et 6 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 86 % des francophones ont répondu positivement, 9 % de façon neutre, et 5 % négativement.
Dans la région de la capitale nationale, 83 % des anglophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre et 4 % négativement. Dans l’Est ontarien, 75 % des anglophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre, et 12 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 84 % des anglophones ont répondu positivement, 10 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans la région de Montréal, 81 % des anglophones ont répondu positivement, 12 % de façon neutre et 7 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 62 % des anglophones ont répondu positivement, 26 % de façon neutre et 12 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 86 % des anglophones ont répondu positivement, 9 % de façon neutre, et 5 % négativement.
2.8 Conclusion
La mise en place de milieux de travail réellement bilingues nécessite encore des efforts dans de nombreuses institutions. Deux lacunes sont particulièrement saillantes : près de cinq années après le dépôt du rapport Borbey-Mendelsohn, trop de fonctionnaires ne peuvent toujours pas écrire dans la langue officielle de leur choix ou participer en français ou en anglais aux rencontres. Cela dit, les institutions font mieux quant à l’offre bilingue de services personnels et centraux auprès des employés.
Comme le montre le chapitre 6, le Secrétariat a posé différents gestes, en 2020-2021, pour amener les institutions fédérales à corriger ces problèmes.
Le Secrétariat entend donc multiplier les interventions dans les années à venir pour améliorer considérablement la situation en ce qui a trait à la rédaction de documents dans la langue de préférence des employés et la tenue de réunions bilingues.
Chapitre 3. Les institutions fédérales et la participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise
Dans cette section

Graphique - Version textuelle
Représentation linguistique dans la fonction publique fédérale : anglophones au sein de la population canadienne en 2016 : 75,4 %, francophones, 22,8 %; anglophones au sein de l’administration publique centrale : 69,2 %, soit une tendance à la hausse, et francophones, 30,8 %, une tendance à la baisse; anglophones au sein des institutions qui ne font pas partie de l’administration publique centrale : 77,5 %, soit une tendance à la baisse, et les francophones, 22,3 %, une tendance à la hausse; anglophones au sein de l’ensemble des institutions, 73,8 %, soit une tendance à la baisse, et les francophones, 25,9 %, une tendance à la hausse. Sources : Recensement 2016; Système d’information sur les postes et la classification et Système d’information sur les langues officielles II en date du 31 mars 2021. Les tendances sont comparées aux données de l’année précédente. 90 % des institutions ont pris des mesures pour que leurs effectifs tendent à refléter la composition des deux communautés de langue officielle au Canada.
3.1 Analyse
Tout en prévoyant que le principe du mérite doit guider les approches de gestion des ressources humaines adoptées par le gouvernement fédéral, la partie VI de la Loi énonce que ce dernier doit « veiller à ce que les Canadiens d’expression française et ceux d’expression anglaise […] aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales ». Le gouvernement doit aussi s’assurer que « les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux ».
En tout, 90 % des grandes institutions affirment qu’elles ont pris des mesures au cours du cycle 2018-2021 pour que la composition de leur effectif tende à refléter la composition des deux communautés de langue officielle au Canada, et ce, en fonction de leur mandat, de leur public cible et de l’emplacement de leurs bureaux.
Par exemple, les bilans montrent que diverses institutions fédérales participent à des salons de l’emploi dans des établissements postsecondaires que fréquentent des membres des communautés de langue officielle en milieu minoritaire. Certaines institutions s’assurent que les offres d’emploi qu’elles publient le sont notamment dans les médias des communautés francophones ou anglophones. D’autres utilisent les médias sociaux et les plateformes de recrutement dans les deux langues pour joindre tous les candidats potentiels à l’échelle du pays.
Pratique exemplaire
Malgré la pandémie, l’équipe de recrutement et de sensibilisation de Service correctionnel Canada a ainsi continué de promouvoir les possibilités de carrière au sein de ce ministère en recourant aux médias sociaux, en faisant de la publicité par le truchement de panneaux d’affichage et de sites Web et en participant à des salons de l’emploi virtuels ouverts à tous, y compris aux membres des communautés de langue officielle. Lors de ces salons, l’équipe de recrutement et de sensibilisation a fait ses présentations en anglais et en français et les recruteurs, bilingues, s’adressaient aux participants dans leur langue officielle préférée.
Au 31 mars 2021, le taux de participation des anglophonesNote en bas de page 16 dans l’administration publique centrale se situait à 69,2 % et celui des francophones, à 30,8 %. Dans l’ensemble des institutions assujetties à la Loi, les anglophones représentaient 73,9 % de l’effectif et les francophones, 25,9 % (une hausse de 0,3 point de pourcentage en un an).
Ces proportions sont bien alignées sur les pourcentages tirés du recensement de la population de 2016, voulant que 75,4 % de la population ait l’anglais comme première langue officielle et 22,8 %, le français.
Les communautés de langue officielle sont bien représentées au sein de l’ensemble des institutions fédérales et des bureaux que celles-ci possèdent dans les différents provinces et territoires. Il faut, cela dit, relever que les Québécois d’expression anglaise de l’extérieur de la région de la capitale nationale constituent seulement 11,4 % des employés de l’administration publique centrale, alors qu’ils représentent 13,7 % de la population québécoise.
Pratique exemplaire
Le recrutement d’employés anglophones au Québec est notamment un enjeu pour Services publics et Approvisionnement Canada. Pour augmenter la représentation de ceux-ci, ce ministère a tenu deux activités de recrutement dans des établissements postsecondaires anglo‑québécois, lesquelles ont permis d’embaucher de nouveaux employés anglophones.
3.2 Conclusion
Il conviendra de toujours veiller à la représentation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise dans les institutions fédérales. Cela dit, la représentation paraît globalement satisfaisante selon les indicateurs actuels, sauf au sein de l’administration publique centrale au Québec où les anglophones sont sous-représentés.
En outre, les résultats de l’analyse des bilans montrent qu’un fort pourcentage d’institutions prend chaque année des mesures ciblées pour faire en sorte que francophones et anglophones y soient adéquatement représentés.
Chapitre 4. Les institutions et la gestion du dossier des langues officielles
Dans cette section
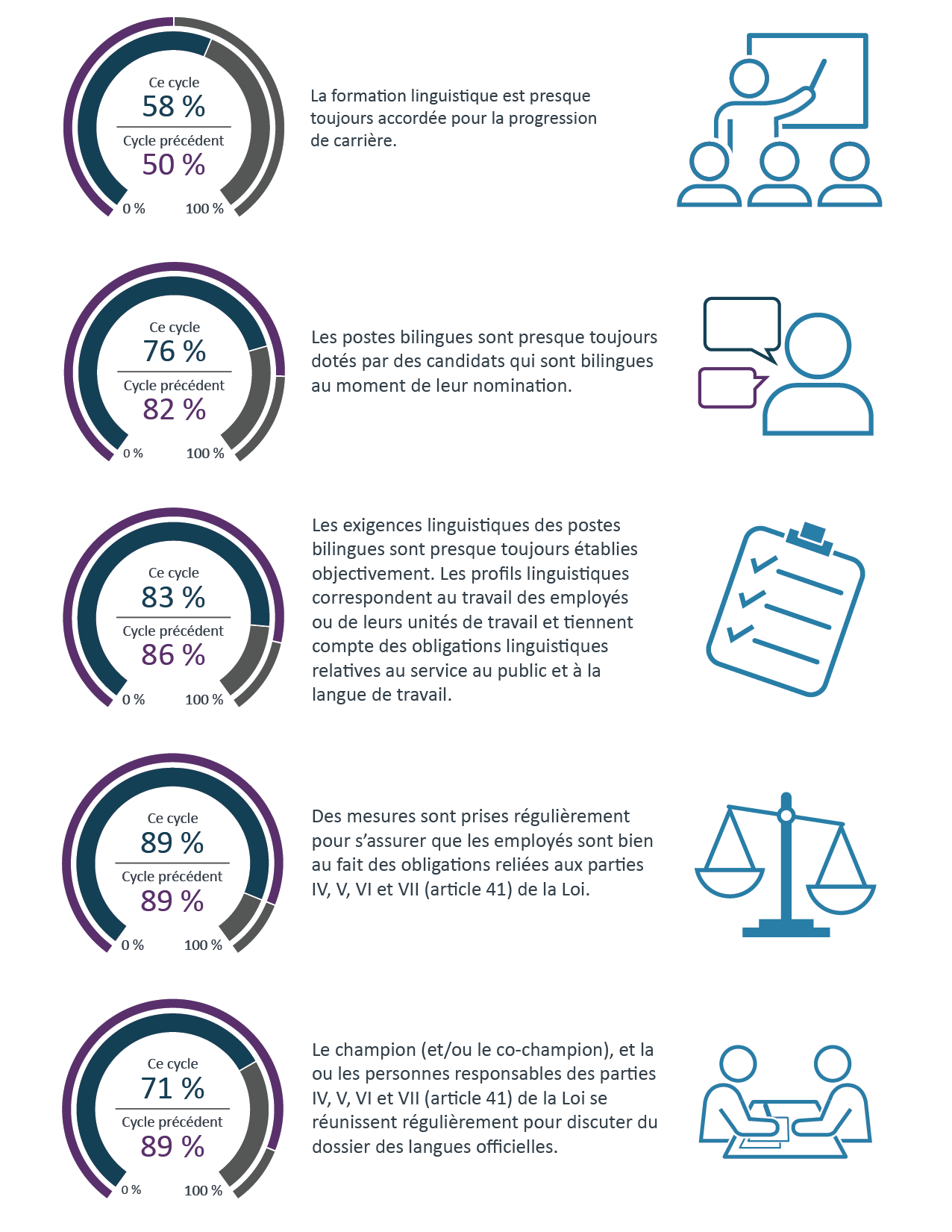
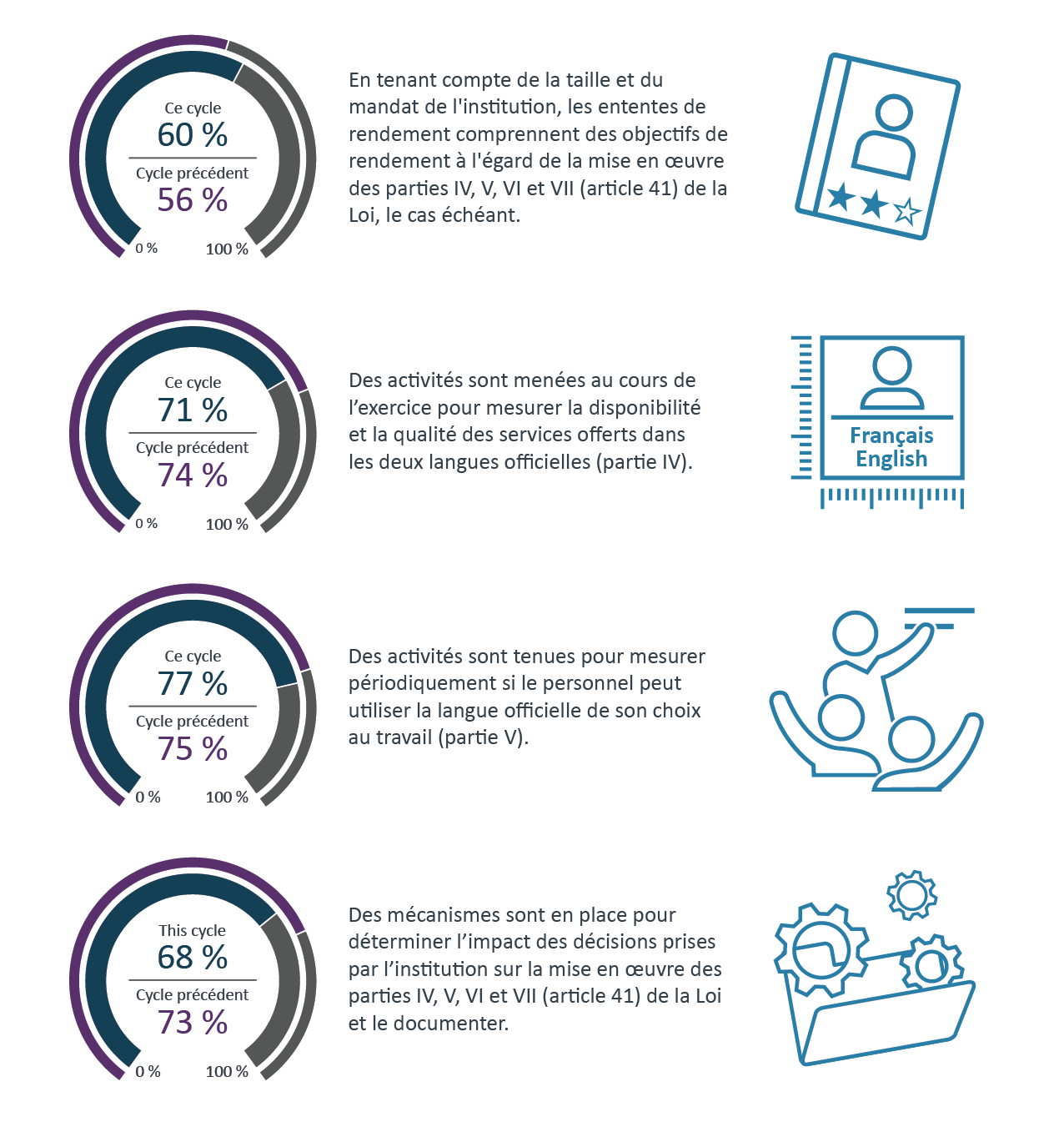
Graphique - Version textuelle
La formation linguistique est presque toujours accordée pour la progression de carrière : pour ce cycle, 58 %; pour le cycle précédent, 50 %
Les postes bilingues sont presque toujours dotés par des candidats qui sont bilingues au moment de leur nomination : pour ce cycle, 76 %; pour le cycle précédent, 82 %
Les exigences linguistiques des postes bilingues sont presque toujours établies objectivement. Les profils linguistiques correspondent au travail des employés ou de leurs unités de travail et tiennent compte des obligations linguistiques relatives au service au public et à la langue de travail : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent, 86 %
Des mesures sont prises régulièrement pour s’assurer que les employés sont bien au fait des obligations reliées aux parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi : pour ce cycle, 89 %; pour le cycle précédent, 89 %
Le champion (et/ou le co-champion), et la ou les personnes responsables des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi se réunissent régulièrement pour discuter du dossier des langues officielles : pour ce cycle, 71 %; pour le cycle précédent, 89 %
En tenant compte de la taille et du mandat de l’institution, les ententes de rendement comprennent des objectifs de rendement à l’égard de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi, le cas échéant : pour ce cycle, 60 %; pour le cycle précédent, 56 %
Des activités sont menées au cours de l’exercice pour mesurer la disponibilité et la qualité des services offerts dans les deux langues officielles (partie IV) : pour ce cycle, 71 %; pour le cycle précédent, 74 %
Des activités sont tenues pour mesurer périodiquement si le personnel peut utiliser la langue officielle de son choix au travail (partie V) : pour ce cycle, 77 %; pour le cycle précédent, 75 %
Des mécanismes sont en place pour déterminer l’impact des décisions prises par l’institution sur la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi et le documenter : pour ce cycle, 68 %; pour le cycle précédent, 73 %
Le respect de la Loi dépend de la mise en place de processus de gestion rigoureux du dossier des langues officielles. Cette section traite des mesures que les institutions ont prises pour créer et appliquer ces processus.
4.1 Gestion des ressources humaines
Suivant la Politique sur les langues officielles, les institutions fédérales adoptent diverses pratiques en matière de gestion des ressources humaines afin de s’assurer de disposer pleinement de la capacité d’offrir des services de qualité, en français et en anglais, au public et à leurs employés.
Selon l’examen des bilans mené par le Secrétariat, seulement 68 % des grandes institutions disposaient presque toujours, en 2018-2021, des ressources humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations linguistiques envers les membres du public et envers leurs employés. Plus précisément, ces institutions comptent suffisamment de personnel bilingue pour superviser et évaluer les employés des régions désignées bilingues aux fins de langue de travail, et communiquer avec eux, et leur offrir des services internes dans la langue officielle de leur choix. De plus, elles possèdent assez de personnel compétent dans chacune des deux langues officielles pour assurer des services au public dans la langue de son choix, en conformité avec la Loi.
Le graphique 5 présente les divers moyens que les institutions fédérales ont pris, selon leur dernier bilan, pour s’assurer de compter sur des employés capables de respecter les droits linguistiques de leurs collègues et ceux des membres du public. On y voit d’abord qu’aussi peu que 58 % des grandes institutions concernées ont indiqué qu’elles permettent presque toujours à leurs employés de suivre des cours de français ou d’anglais pour faire progresser leur carrière.
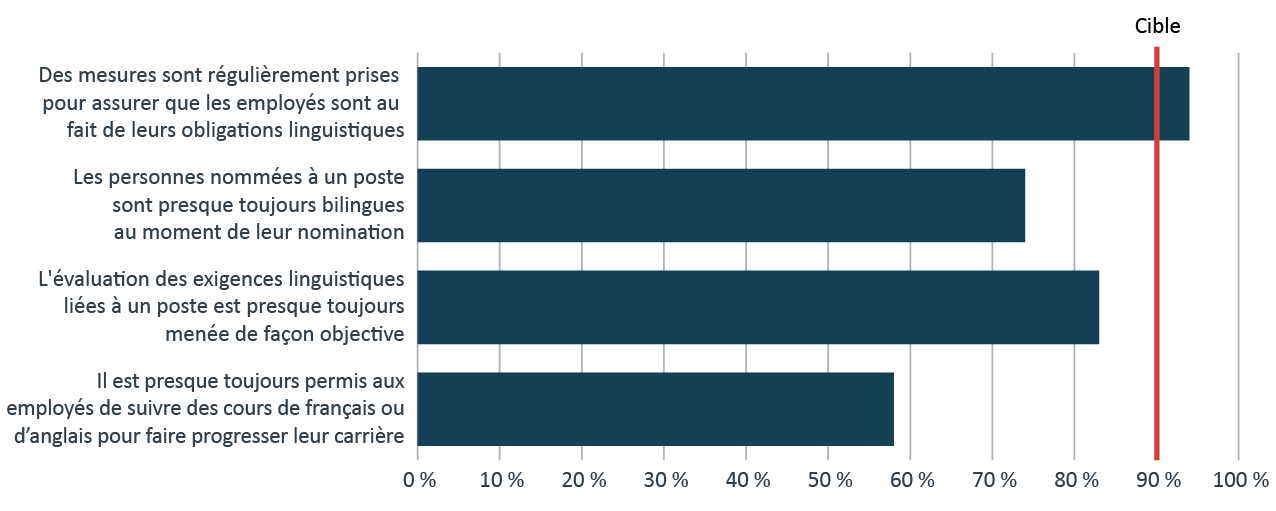
Graphique 5 - Version textuelle
Des mesures sont régulièrement prises pour assurer que les employés sont au fait de leurs obligations linguistiques : 94 %; les personnes nommées à un poste sont presque toujours bilingues au moment de l’être : 74 %; l’évaluation des exigences linguistiques liées à un poste est presque toujours menée de façon objective : 83 %; il est presque toujours permis aux employés de suivre des cours de français ou d’anglais pour faire progresser leur carrière : 58 %, avec pour cible 90 %.
Pratique exemplaire
Par exemple, l’Agence des services frontaliers du Canada possède sa propre école de langues. Les employés y ont accès s’ils en font la demande ou en fonction des besoins pour un service particulier. Ainsi, la Direction générale de l’information, des sciences et de la technologie de l’Agence a pu profiter de l’appui de cinq professeurs à temps plein pour permettre aux employés d’apprendre le français. La Direction s’est particulièrement engagée à aider les fonctionnaires en début de carrière à renforcer leur langue seconde, pour que rien n’entrave leur progression.
Pratique exemplaire
Toujours à titre d’exemple, le Plan d’action en matière de langues officielles 2020-2023 de Sécurité publique Canada établit que l’une des principales activités du champion des langues officielles du ministère consiste à encourager les employés à acquérir de nouvelles compétences en langue seconde, ou à conserver ou perfectionner celles qu’ils possèdent déjà. Le ministère compte trois offres à commandes avec des écoles de formation en langue seconde pour la formation individuelle ou en groupe et recourt également aux services des écoles en vertu des offres à commandes de Services publics et Approvisionnement Canada.
Pratique exemplaire
Au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le programme de formation en langue seconde, qui se tenait en salle de classe, a été adapté à la réalité du travail à domicile. Au début de la pandémie, la formation se faisait par téléphone. Dès que cela a été possible, la formation en salle de classe a repris, mais de façon virtuelle en utilisant une application de visioconférence. Les cours permettent ainsi aux employés du Commissariat de conserver et d’améliorer leurs acquis et d’atteindre le niveau de compétence recherché. Le comité de promotion des langues officielles a repris les dîners‑causeries. Ceux-ci se déroulent maintenant de façon virtuelle.
Pratique exemplaire
Air Canada offre différents programmes de formation linguistique pour assister les employés qui n’auraient pas le niveau de compétence nécessaire pour offrir le service dans les deux langues officielles, maintenir leurs compétences linguistiques ou améliorer leurs compétences orales et écrites. Différents outils sont également mis à la disposition des employés, tels les suivants :
- un module de formation en ligne élaboré à l’interne et accessible à partir de différentes plateformes comme des tablettes ou des téléphones intelligents;
- un lexique sur le transport aérien;
- une carte aide-mémoire;
- un livret contenant de la terminologie propre aux tâches des employés;
- des exemples de réponses à utiliser.
Des cours virtuels ont été offerts durant la pandémie.
Pratique exemplaire
Enfin, le Réseau de discussions des langues officielles d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a organisé diverses activités pour inciter les employés à utiliser leur seconde langue officielle au quotidien, notamment en leur envoyant des courriels à ce sujet, en lui lançant des défis et en poursuivant son programme de mentorat.
Réaliser, comme le prévoit l’article 91 de la Loi, l’évaluation objective des exigences linguistiques associées à un poste est une autre mesure que les institutions doivent prendre pour faire en sorte que leur personnel dispose pleinement de la capacité d’utiliser le français et l’anglais au niveau requis. L’étude du dernier bilan des institutions fédérales montre que 83 % d’entre elles mettent presque toujours cette pratique en œuvre (graphique 5).
Pratique exemplaire
Plusieurs institutions fédérales affirment qu’elles utilisent l’outil élaboré par le Secrétariat pour déterminer objectivement le profil linguistique des postes bilingues. D’autres recourent à celui que le Commissariat aux langues officielles a conçu afin de procéder à la définition des exigences linguistiques des postes, par exemple, pour déterminer si un poste devant être pourvu devrait être bilingue ou non.
Pratique exemplaire
Innovation, Sciences et Développement économique Canada a de son côté examiné les profils linguistiques de tous ses postes de supervision pour vérifier s’ils avaient été établis de façon objective. Le ministère a élaboré un plan afin de rehausser au niveau CBC les profils linguistiques de ces postes dans les régions bilingues. Ce plan sera mis en œuvre d’ici 2024.
L’embauche de candidats déjà bilingues pour pourvoir des postes bilingues est une autre mesure clé en matière de gestion des ressources humaines. De toutes les institutions qui ont soumis un bilan ces dernières années et qui comptent des postes bilingues, 76 % recrutent presque toujours des candidats qui sont déjà bilingues au moment d’y être nommés (graphique 5). En 2020-2021, 366 postes bilingues sur 368 ont par exemple été pourvus de cette façon par Sécurité publique Canada.
Enfin, le renforcement du bilinguisme officiel passe en bonne partie par la sensibilisation et la formation des employés, qui doivent savoir ce qui est attendu d’eux. Parmi les institutions ayant produit un bilan ces trois dernières années, 89 % affirment prendre régulièrement des mesures pour s’assurer que les employés sont au fait des obligations liées aux diverses parties de la Loi.
Pratique exemplaire
Par exemple, les lettres d’offre d’emploi qu’envoie la Banque du Canada font état du fait que ceux-ci évolueront dans un milieu de travail bilingue. Ces lettres indiquent également le niveau de bilinguisme requis pour le poste que chaque recrue occupera et les nouveaux employés sont informés de l’existence de la Politique sur le bilinguisme de la Banque et des obligations de la Banque aux termes de la Loi durant une séance d’information à laquelle ils sont conviés dès leur arrivée. Enfin, le personnel se voit périodiquement rappeler ses obligations en matière de langues officielles au cours de l’année.
4.2 Gouvernance en matière de langues officielles
La Politique sur les langues officielles exige que chaque institution fédérale comporte une unité, un responsable et un champion des langues officielles. C’est en grande partie grâce à ces acteurs que les institutions réussissent à respecter leurs obligations en matière de langues officielles.
L’analyse des bilans déposés ces trois dernières années révèle que dans 71 % des grandes institutions, le champion (ou le co-champion) et les responsables des langues officielles eu regard aux parties IV, V, VI et VII de la Loi se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux linguistiques (graphique 6).
La mise en place d’un comité ou d’un réseau interne sur les langues officielles constitue un autre mécanisme que plusieurs institutions utilisent pour favoriser la prise en compte coordonnée de leurs obligations et responsabilités linguistiques (graphique 4). Selon les bilans reçus de 2018 à 2021, 75 % des grandes institutions disposent d’un tel comité ou réseau, et 61 % de ces institutions s’assurent que celui-ci se réunit régulièrement.
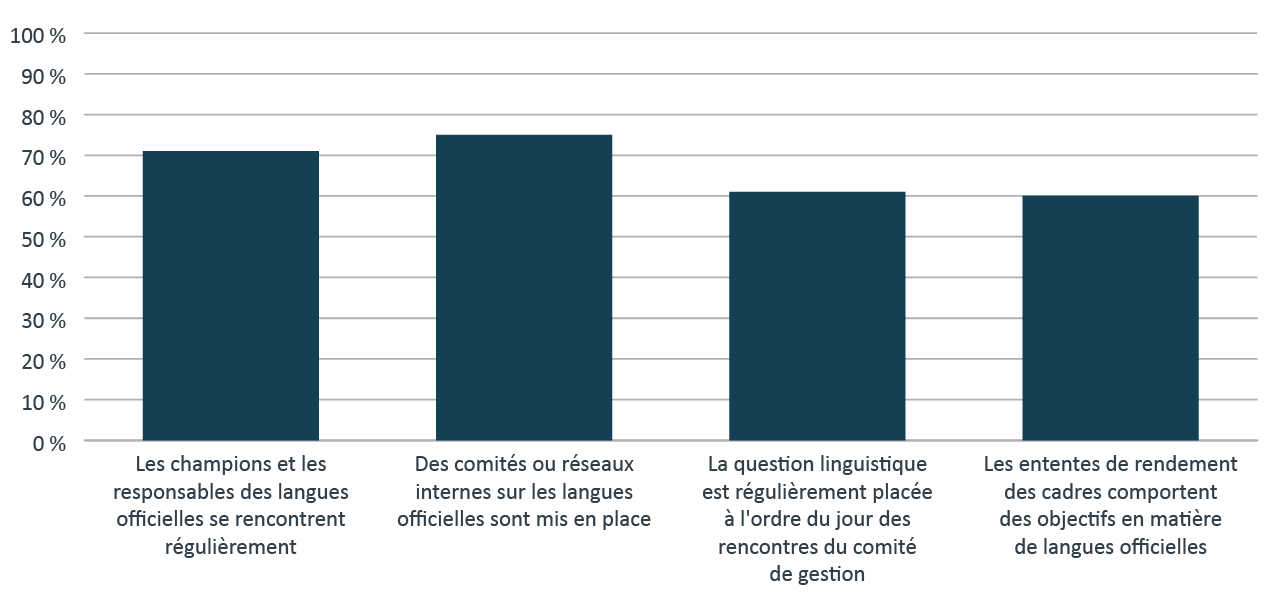
Graphique 6 - Version textuelle
Les champions et les responsables des langues officielles se rencontrent régulièrement : 71 %; des comités ou réseaux internes sur les langues officielles sont mis en place : 75 %; la question linguistique est régulièrement placée à l’ordre du jour des rencontres du comité de gestion : 61 %; et les ententes de rendement des cadres comportent des objectifs en matière de langues officielles : 60 %.
Pratique exemplaire
Par exemple, Anciens Combattants Canada a créé un comité consultatif sur les langues officielles dont la composition reflète sa structure et la répartition géographique de ses bureaux. En raison de son leadership, des mesures qu’il prend et des consultations qu’il mène, ce comité aide l’institution à améliorer ses capacités en matière de langues officielles. Il cerne les enjeux et les défis linguistiques à aborder, élabore et met en œuvre des stratégies à ce chapitre et promeut les langues officielles au sein du ministère. Les réunions du comité consultatif se tiennent tous les deux mois par téléconférence, en présence du champion des langues officielles et du conseiller ministériel pour les langues officielles.
Cela dit, le leadership de la haute direction est crucial en matière de langues officielles. Il est important que les enjeux linguistiques soient régulièrement placés à l’ordre du jour des rencontres du comité de gestion. Selon les derniers bilans reçus par le Secrétariat, c’est le cas dans 61 % des grandes institutions (graphique 6).
Pratique exemplaire
Par exemple, à l’Agence de santé publique du Canada, les obligations linguistiques sont régulièrement abordées durant les réunions de son comité exécutif ministériel et celles du comité exécutif de ses différentes directions générales. Durant ces rencontres, les meneurs de l’Agence abordent des questions comme les suivantes :
- les livrables et les stratégies prévues en matière de langues officielles;
- la planification et la promotion d’événements spéciaux, par exemple, la Journée de la dualité linguistique;
- le suivi des plans d’action en langues officielles de l’Agence et des directions générales.
L’établissement d’objectifs de rendement est une autre composante clé de la structure de gouvernance que les institutions doivent établir. Ces objectifs concernent souvent les cadres, parfois les gestionnaires et les superviseurs. Parmi les institutions qui ont déposé un bilan entre 2018 et 2021, 60 % ont des ententes de rendement qui comportent pour les cadres des objectifs à l’égard de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII de la Loi (graphique 6). Depuis l’adoption d’une modification de la Directive sur la gestion du rendement et des talents des cadres supérieurs, ces objectifs visent entre autres le maintien à jour des connaissances en langue seconde des cadres.
Pratique exemplaire
Depuis 2017-2018, Parcs Canada exige dans les ententes de rendement de ses cadres supérieurs que ceux-ci démontrent comment ils ont su prendre des mesures qui favorisent le bilinguisme. Parcs Canada s’est doté d’outils qui permettent aux gestionnaires et aux directeurs d’ajouter des éléments spécifiques sur les langues officielles dans les ententes de rendement liant les employés de l’Agence.
Pratique exemplaire
Agriculture Agroalimentaire Canada a de son côté créé un Guide des langues officielles pour les ententes de rendement qui est disponible sur son intranet. En 2020-2021, les ententes liant les cadres supérieurs du ministère contenaient entre autres la mesure de rendement « Encourager l’utilisation des deux langues officielles ».
4.3 Surveillance
Tout comme dans d’autres domaines, la mise en place de mécanismes de surveillance est ce qui permet aux institutions de prendre note des avancées qu’elles réalisent (ou des reculs qu’elles enregistrent) en matière de langues officielles, d’en rendre compte et, en fin de compte, de renforcer leurs acquis ou de corriger leurs manquements.
Selon les bilans du cycle 2018-2021, 71 % des institutions fédérales ont mené des activités pour mesurer le degré de disponibilité et de qualité des services qu’elles offrent au public en français et en anglais (graphique 7). Ces activités incluent la réalisation d’évaluations informelles (49 %), de contrôles aléatoires par les superviseurs (52 %) et de sondages auprès des clients (20 %).
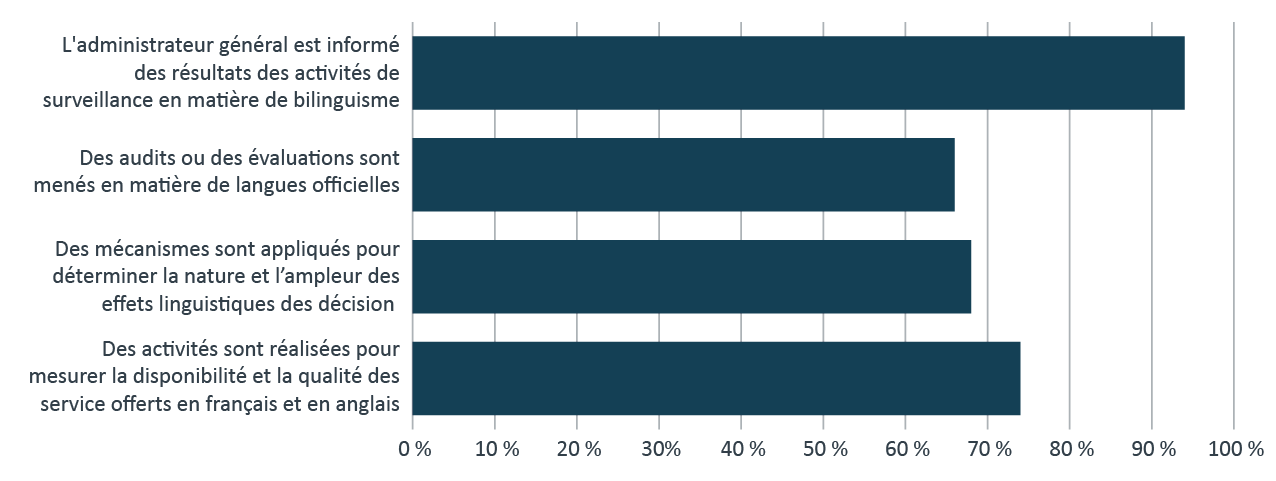
Graphique 7 - Version textuelle
L’administrateur général est informé des résultats des activités de surveillance en matière de bilinguisme : 94 %; des audits ou des évaluations sont menés en matière de langues officielles : 66 %; des mécanismes sont appliqués pour déterminer la nature et l’ampleur des effets linguistiques des décisions : 68 %; des activités sont réalisées pour mesurer la disponibilité et la qualité des services offerts en français et en anglais : 74 %
Par ailleurs, un tiers des institutions se sert des résultats de sondages menés auprès des fonctionnaires fédéraux pour mesurer le niveau d’utilisation des langues officielles en milieu de travail. D’autres recourent à d’autres mesures pour ce faire, comme des évaluations informelles, des contrôles aléatoires, des activités de surveillance et des enquêtes internes.
Pratique exemplaire
Par exemple, chaque année, tous les employés de la Banque de développement du Canada sont invités à répondre à un sondage omnibus qui comprend des questions spécifiques sur les langues officielles, comme pour savoir s’ils se sentent à l’aise de recourir au français ou à l’anglais.
D’après les bilans reçus par le Secrétariat, 68 % des institutions ont par ailleurs établi des mécanismes pour déterminer la nature et l’ampleur des répercussions des décisions qu’elles prennent sur les langues officielles, qu’il s’agisse de décisions relatives à l’adoption ou à la révision d’une politique, à la création ou à l’abolition d’un programme, ou à la mise en place ou à l’élimination d’un bureau (graphique 7). Ces mécanismes peuvent inclure la consultation du document Exigences et liste de vérification en matière de langues officielles pour les présentations au Conseil du Trésor .
Pratique exemplaire
Agriculture et Agroalimentaire Canada compte parmi les institutions qui appliquent de tels mécanismes. Lors de l’adoption d’une politique ou de la création d’un programme, l’équipe des langues officielles de ce ministère est systématiquement consultée pour aider les fonctionnaires à effectuer une évaluation d’incidence appelée « Filtre Agri pour les langues officielles ». Le questionnaire utilisé pour cet exercice sert à déterminer si les initiatives envisagées pourraient entraîner des répercussions sur le niveau de conformité du ministère à la Loi. Agriculture et Agroalimentaire Canada utilise également un outil spécifique pour « tenir compte des langues officielles lors de l’examen des décisions de dépenses » et un autre sur les « éléments que les gestionnaires doivent prendre en considération » lors d’un « réaménagement de l’effectif ».
Deux autres mécanismes de surveillance auxquels les institutions peuvent avoir recours sont les audits et les évaluations. Selon la revue des bilans reçus par le Secrétariat, 59 % des institutions ont eu recours à l’un ou l’autre de ces mécanismes durant le cycle triennal — par l’entremise de leur unité d’audit interne ou celle d’autres unités — pour mesurer le niveau de respect de leurs obligations en matière de langues officielles (graphique 7).
Pratique exemplaire
Ainsi, Services publics et Approvisionnement Canada s’assure tous les ans de vérifier si la désignation linguistique des postes se fait de façon adéquate, puis, s’il y a lieu, de corriger les problèmes rencontrés. Le ministère fait également une analyse régulière des plaintes qu’il reçoit et des anomalies relevées en ce qui concerne le versement de la prime au bilinguisme.
Finalement, la responsabilité d’appliquer les politiques sur les langues officielles incombe aux administrateurs généraux. Les institutions fédérales devraient donc avoir mis en place des processus pour faire en sorte que leur haute direction soit promptement informée de tout enjeu. Selon les bilans, presque toutes les institutions, soit 91 % d’entre elles, indiquent que leur administrateur général est informé en temps opportun des résultats des activités de surveillance en matière de bilinguisme.
Pratique exemplaire
Par exemple, la dirigeante principale des ressources humaines du Bureau du surintendant des institutions financières Canada se présente deux fois par année devant le comité de direction pour faire le point sur les dossiers qui relèvent d’elle, y compris celui des langues officielles. Parmi les questions abordées lors de ces rencontres figurent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux en ce qui a trait aux langues officielles.
4.4 Conclusion
Bon nombre des mécanismes ou processus qui favorisent le respect de la Loi au sein du gouvernement du Canada sont déjà en place dans une proportion élevée d’institutions fédérales. Il est, par exemple, encourageant de voir que les trois quarts d’entre elles mènent des activités diverses pour mesurer le degré de disponibilité et de qualité, en français comme en anglais, des services qu’elles offrent au public, car comme le dit l’adage, ce qui n’est pas mesuré ne peut être amélioré.
Cependant, certaines pratiques de gestion du dossier des langues officielles devraient être plus généralisées qu’elles ne le sont actuellement pour produire les résultats auxquels s’attendent les membres du public et les employés fédéraux. Par exemple, il faut améliorer l’accès des employés à de la formation en français ou en anglais, organiser plus fréquemment des réunions entre responsables des langues officielles et s’assurer que les enjeux linguistiques figurent davantage à l’ordre du jour des rencontres tenues par les membres de la haute gestion des institutions fédérales.
Toutefois, ce qui mérite d’être souligné, c’est que les institutions continuent d’organiser des activités de sensibilisation afin que les employés connaissent leurs droits et leurs obligations en matière de langues officielles et qu’elles inscrivent des objectifs visant les langues officielles dans les ententes de rendement.
Chapitre 5. Les langues officielles et la COVID‑19
Dans cette section
Les institutions fédérales ont l’obligation de respecter les dispositions de la Loi en temps de crise comme en temps normal. Marquée par la pandémie, l’année 2020-2021 a été évidemment une année de crise, au cours de laquelle les langues officielles ont posé des défis importants à certaines institutions, notamment parce que leurs services numériques ou téléphoniques ont fait l’objet d’une demande accrue ou parce que le travail à distance et les réunions virtuelles sont devenus la norme.
5.1 Planification en temps de crise
La plupart des institutions, soit 73 %, ont cherché à bien se préparer à composer avec la crise de la COVID‑19 sur le plan linguistique en s’assurant de tenir compte de la question des langues officielles dans leur planification d’urgence et dans leur plan de gestion de criseNote en bas de page 17.
Pratique exemplaire
Élections Canada fait partie des organisations qui ont cherché à anticiper et mitiger les effets potentiels de la crise de la COVID‑19 sur sa capacité à respecter ses obligations linguistiques. L’organisation a, en effet, entrepris l’élaboration d’un nouveau plan opérationnel pour s’assurer que, malgré la pandémie, les élections puissent être tenues d’une manière qui permette d’assurer la sécurité des Canadiens de langue française et anglaise et le respect de leurs droits. Le service des publications a offert des services express de révision et de traduction au personnel pour l’aider à répondre adéquatement à des demandes que le contexte rendait urgentes. L’organisation a aussi produit des lignes directrices que le personnel devait suivre en matière de communication.
Pratique exemplaire
La question des langues officielles est aussi prise en compte dans le plan d’urgence et de gestion de crise de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. L’organisation a défini des procédures normalisées dans le but d’assurer que même dans une situation exceptionnelle, elle puisse pleinement se conformer à la Loi dans ses communications avec la population. Une entente permet à tout membre du personnel d’accéder aux services du Bureau de la traduction. Les spécialistes des langues officielles de la Commission font partie de son équipe de gestion des urgences pour s’assurer du plein respect des droits des francophones et des anglophones.
5.2 Mesures prises en temps de COVID‑19
Les organisations qui ont soumis un bilan en 2020-2021 ont été nombreuses à décrire les mesures qu’elles ont prises, au cours de la pandémie, pour assurer le respect de leurs obligations en matière de communications avec le public et de prestation des services et en matière de langue de travail.
Pratique exemplaire
Parmi les mesures mises en place par l’Agence du revenu du Canada pour assurer le respect de ses obligations en matière de la langue de travail, on compte la diffusion, à l’échelle pancanadienne, d’un arrière-plan virtuel dans le cadre des réunions à distance qui fait la promotion de l’usage des deux langues officielles. L’Agence a aussi affiché dans son intranet de l’information sur les obligations et les droits linguistiques du personnel dans le contexte du travail virtuel.
Pratique exemplaire
Services partagés Canada a de son côté communiqué au personnel son protocole pour obtenir des services de traduction en mode urgent ou hors des heures de bureau. L’institution a aussi établi un processus de révision rapide des traductions reposant sur la participation d’employés bilingues.
Pratique exemplaire
Pour réagir adéquatement à la crise, les directions générales de Santé Canada se sont pour leur part assurées de développer leur capacité à communiquer avec le public et à lui fournir des services en français et en anglais. Elles ont déployé d’importants efforts de recrutement en 2020-2021 et les responsables du recrutement ont travaillé avec les responsables en langues officielles afin de faire une désignation linguistique adéquate des postes à pourvoir. Les directions générales ont aussi veillé à offrir une formation linguistique aux employés appelés à servir le public.
Dans l’ensemble, les fonctionnaires fédéraux se montrent satisfaits des mesures prises par leur employeur pour les renseigner pendant la crise de la COVID‑19. Selon une question du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020, 95 % des anglophones et 94 % des francophones des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail estiment qu’ils ont bel et bien reçu les renseignements sur la pandémie dans les deux langues officielles.
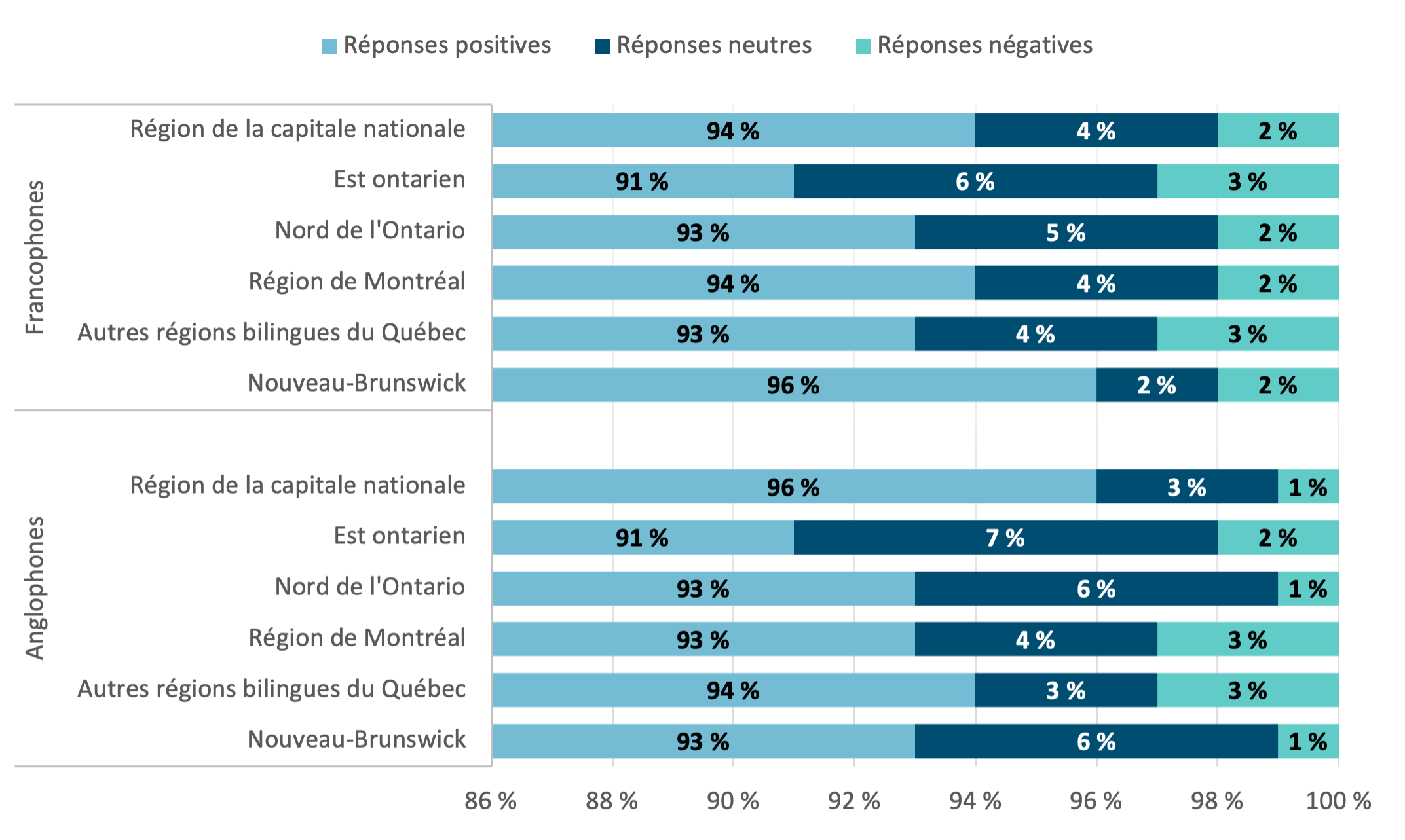
Graphique 8 - Version textuelle
Dans la région de la capitale nationale, 94 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans l’Est ontarien, 91 % des francophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre, et 3 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 93 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans la région de Montréal, 94 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 93 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 96 % des francophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre, et 2 % négativement.
Dans la région de la capitale nationale, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 1 % négativement. Dans l’Est ontarien, 91 % des anglophones ont répondu positivement, 7 % de façon neutre, et 2 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre et 1 % négativement. Dans la région de Montréal, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 3 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 94 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre, et 1 % négativement.
5.3 Groupe de travail sur les communications en situation de crise ou d’urgence
En octobre 2020, le commissaire aux langues officielles a publié un rapport spécial, Une question de respect et de sécurité : l’incidence des situations d’urgence sur les langues officielles, dans lequel il fait état de manquements aux obligations en matière de langues officielles lors de conférence de presse et dans des messages d’alerte, des communications d’agences gouvernementales et des communications avec des employés fédéraux dans les régions bilingues. Le rapport recommande que le Secrétariat révise et, s’il y a lieu, modifie les plans et les procédures de communication en situation d’urgence, forme les fonctionnaires qui collaborent aux communications en situation d’urgence et évalue l’efficacité des mesures prises.
Au début de l’exercice 2020-2021, le Secrétariat a mis sur pied un groupe de travail interministériel sur les communications bilingues en situation d’urgence ou de crise avec le mandat d’examiner les recommandations du commissaire, d’identifier les pratiques et les défis dans les institutions fédérales, et d’élaborer une stratégie et un plan d’action. Le groupe de travail comprend des représentants du Secrétariat, du Bureau du Conseil privé, de Patrimoine canadien, de Sécurité publique Canada et du Bureau de la traduction.
Le groupe a élaboré une stratégie qui permettra au cours des années de 2022 à 2024 :
- d’améliorer la gouvernance grâce aux mesures suivantes :
- renforcer les instruments de gouvernance permettant de prendre en compte les obligations linguistiques lors de communications en situation d’urgence ou de crise,
- consolider le leadership et la responsabilisation à l’égard des communications en situation d’urgence ou de crise,
- rehausser la capacité bilingue des postes qui nécessitent la transmission de communications en situation d’urgence ou de crise;
- d’outiller les institutions fédérales et de créer les conditions nécessaires afin de les aider à respecter leurs obligations en matière de langues officielles lors de situations de crise ou d’urgence en prenant les mesures suivantes :
- renforcer le rôle du Bureau de la traduction et sa capacité d’offrir des services de traduction et d’interprétation durant les situations d’urgence ou de crise,
- encourager l’utilisation effective des deux langues officielles au sein du gouvernement fédéral, c’est-à-dire consolider la sécurité linguistique et moderniser le cadre de formation linguistique,
- élaborer et échanger des pratiques exemplaires en matière de communications d’urgence, et en faire la promotion;
- de consolider la reddition des comptes et la surveillance en optimisant les mécanismes connexes en vigueur et l’utilisation d’outils d’autodiagnostic permettant d’appliquer efficacement la lentille des langues officielles dans la planification des priorités stratégiques.
5.4 Conclusion
L’année 2020-2021 n’a pas été une année comme les autres, notamment pour les institutions fédérales. Dans la plupart des cas, elles ont su composer avec les défis posés par la pandémie sur le plan des langues officielles. Il est clair qu’à l’avenir, les institutions devront prendre des mesures vigoureuses en matière de planification et de mise en œuvre pour s’assurer de respecter pleinement la Loi et de répondre aux attentes du public et des employés fédéraux, et ce, en temps de crise comme en temps normal.
Chapitre 6. Les langues officielles et le Secrétariat
Dans cette section
Le Secrétariat a joué en 2020-2021 le rôle qui lui revient en matière d’élaboration des politiques et des programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI de la Loi dans les institutions fédérales, et en matière de coordination générale et de surveillance des activités visant à mettre ces politiques et programmes en œuvre. Il a aussi contribué aux efforts entrepris pour moderniser et renforcer la Loi.
6.1 Mise en œuvre du programme et des politiques en langues officielles
En 2020-2021, comme à chaque exercice, le Secrétariat a pris des mesures pour renforcer la place du français et de l’anglais dans les secteurs relevant de sa responsabilité. Il s’est particulièrement efforcé, par ses actions, de corriger certaines des lacunes mentionnées dans les pages qui précèdent.
Une grande partie des efforts du Secrétariat avait pour but d’aider les institutions à faire face à la pandémie, puisqu’il est devenu clair que celle-ci mènerait à une transformation accélérée du milieu du travail et à une utilisation accrue des technologies de l’information.
Dès le début de la crise, le Secrétariat a travaillé de près avec les institutions fédérales pour les aider à s’ajuster aux nouvelles réalités du monde du travail dans le plein respect de leurs obligations en matière de langues officielles. Une attention particulière a été mise sur l’usage du français et de l’anglais dans les réunions virtuelles. Il fallait aussi veiller au maintien des compétences linguistiques des fonctionnaires dans le but de favoriser une bonne gestion des ressources humaines.
En conséquence, peu après le début de l’imposition des mesures sanitaires liées à la pandémie, le Secrétariat a tenu une rencontre virtuelle avec la communauté des experts en langues officielles afin de discuter de deux enjeux, soit celui des communications gouvernementales en situation de crise et celui soulevé par l’adaptation des mesures de la Commission de la fonction publique du Canada relatives aux tests linguistiques et à la validité des résultats d’évaluation de la langue seconde.
C’est aussi dans cette veine que dès le début de la pandémie, le Secrétariat a mis à la disposition des fonctionnaires de l’information relative au bilinguisme en milieu de travail à distance, notamment au moyen de la publication intitulée Garantir la dualité linguistique - Maladie à coronavirus (COVID‑19) : Travail à distance, pour leur rappeler les règles à respecter lors des rencontres à distance. Il a aussi utilisé une page Wiki sur le sujet et un bulletin d’information pour renseigner les institutions fédérales sur le respect des droits et des obligations en matière de langues officielles dans un milieu de travail virtuel. En octobre 2020, le Secrétariat a publié une boîte à outils sur le bilinguisme dans les réunions.
Le Secrétariat a en outre travaillé avec de nombreux intervenants, en 2020-2021, pour adapter ses politiques et faire en sorte que celles-ci soient mieux alignées sur l’intention du gouvernement de créer une fonction publique diversifiée et inclusive et de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones.
Les changements entrepris ont notamment eu pour effet de permettre aux fonctionnaires qualifiés qui ont un handicap affectant leur capacité à apprendre une seconde langue officielle d’occuper des postes de cadre de niveaux EX-02 à EX-05. Cette approche, qui existe déjà pour tous les autres niveaux, vise à améliorer la représentativité des personnes en situation de handicap sans affaiblir la dualité linguistique. Les institutions qui nomment ces personnes à des postes de cadre doivent mettre en place des mesures administratives afin de s’assurer que leurs tâches puissent être accomplies dans les deux langues officielles.
En 2020-2021, le Secrétariat a par ailleurs poursuivi ses efforts de mobilisation des institutions fédérales afin de préparer la mise en œuvre du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation de services (Règlement) modifié en 2019. Cette stratégie de mobilisation comprend notamment l’élaboration d’outils de politiques, des séances de formation pour les experts en langues officielles dans les institutions fédérales et des simulations de l’application des dispositions du nouveau Règlement sur les bureaux fédéraux. Le Secrétariat a aussi entamé des discussions avec des groupes d’intervenants pour assurer la mise à jour adéquate de la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services.
Pour répondre aux préoccupations concernant la participation équitable des Québécois d’expression anglaise au sein des institutions fédérales au Québec conformément à la partie VI de la Loi, le Secrétariat collaborera avec le Quebec Community Groups Network, d’autres intervenants et les institutions fédérales afin d’élaborer une stratégie visant à accroître le nombre de Québécois d’expression anglaise au sein des institutions fédérales situées au Québec.
6.2 Appui aux institutions fédérales et partage des connaissances
En 2020-2021, le Secrétariat a intensifié sa collaboration avec les institutions fédérales pour les aider à se conformer à la Loi. Il a notamment :
- fourni plus de 229 interprétations;
- organisé 20 rencontres et événements avec les communautés de pratique en langues officielles;
- participé à 46 rencontres avec des institutions fédérales;
- publié 8 infolettres.
De plus, les analystes du Secrétariat ont revu plus de 400 présentations au Conseil du Trésor sous la lentille des parties IV, V et VI de la Loi.
Les nombreuses rencontres organisées ou coorganisées par le Secrétariat pour discuter d’enjeux relatifs aux langues officielles (annexe E) ont réuni quelque 1 100 personnes et ont permis de discuter des sujets suivants :
- des obligations législatives des institutions;
- de leur application des politiques sur les langues officielles;
- du maintien des compétences en langue seconde;
- de formation linguistique;
- des impacts éventuels de l’intelligence artificielle sur la dualité linguistique;
- de l’avenir du travail;
- de leadership;
- des enjeux de la mise en œuvre de l’article de la Loi sur la détermination objective des exigences linguistiques (l’article 91);
- de l’insécurité linguistique des fonctionnaires, qui hésitent souvent à utiliser leur première ou seconde langue officielle en milieu de travail;
- de la modernisation de la Loi;
- des modifications à apporter au Règlement;
- des nouveaux outils, approches et pratiques à privilégier pour mieux appuyer les institutions en matière de langues officielles.
En particulier, le Secrétariat a organisé 30 séances de formation pour aider les personnes responsables du dossier des langues officielles à accroître leurs connaissances sur les aspects législatifs et pratiques de la Loi et les instruments de politique du Conseil du Trésor. Ces activités d’apprentissage visaient à donner aux responsables les outils qui leur permettront de pleinement jouer, au sein de leur institution, leur rôle de coordonnateurs de la mise en œuvre du programme des langues officielles.
Finalement, le Secrétariat a coordonné les efforts à travers la fonction publique pour faire face à divers enjeux horizontaux, que ce soit en lien avec des observations du commissaire aux langues officielles ou pour trouver des solutions à de nouvelles réalités. La question du leadership et celles de l’insécurité linguistique et des protocoles de communication entre fonctionnaires de régions différentes ont ainsi été des thèmes majeurs lors du Forum des bonnes pratiques en matière de langues officielles tenu en mars 2021.
Le Secrétariat a tenu des rencontres avec les institutions fédérales pour se pencher sur les questions associées au virage vers un gouvernement ouvert, notamment au démarrage ou au renforcement d’initiatives comme celle de la science ouverte. Le Secrétariat a aussi créé un groupe de travail pour se pencher sur une série d’outils qui aideront à réduire l’insécurité linguistique. Concrètement, il a commencé à adapter au contexte de la fonction publique un passeport de prise de risques créé par l’Université d’Ottawa. Il a aussi mis sur pied des cercles de coaching et réalisé des entretiens vidéo avec des meneurs modèles afin de mieux comprendre et d’expliquer comment le leadership authentique favorise la prise de risques soutenus en langue seconde et a un effet positif au sein des organisations.
6.3 Modernisation de la Loi
Le discours du Trône du 23 septembre 2020 a servi à réaffirmer l’engagement du gouvernement fédéral à entreprendre la modernisation et le renforcement de la Loi. Le 15 janvier 2021, le premier ministre a donné au président du Conseil du Trésor le mandat d’aider la ministre du Développement économique et des Langues officielles à moderniser la Loi et, en particulier, à travailler à améliorer la supervision et la coordination pangouvernementales des travaux de mise en œuvre de la Loi au sein de l’appareil fédéral.
Après avoir mené une vaste consultation auprès des Canadiens, le gouvernement du Canada a exposé sa vision de la réforme du régime linguistique au Canada dans un document public diffusé en février 2021 : Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. La vision du gouvernement s’articule autour des trois priorités suivantes :
- accroître la conformité des institutions fédérales en matière de langues officielles;
- renforcer la partie VII de la Loi;
- mobiliser les Canadiens de partout au pays pour faire de la Loi un outil clé visant à aider le pays à relever les défis de demain.
En mars 2022, le gouvernement a déposé un projet de loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, la première modernisation d’importance de la Loi sur les langues officielles en 30 ans.
Dans l’objectif de renforcer le bilinguisme dans la fonction publique, le gouvernement a proposé d’élaborer un nouveau cadre de formation en langue seconde pour la fonction publique, lequel garantirait une formation en français et en anglais accessible, de qualité et adaptée aux besoins spécifiques de tous les apprenants, y compris les Autochtones et les personnes en situation de handicap.
Conclusion du rapport
Le présent rapport annuel démontre que, selon les bilans déposés en 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, les institutions se rapprochent de la pleine conformité, mais que des améliorations dans certains domaines demeurent nécessaires.
Assurer, en temps normal comme en temps de crise, la pleine égalité du français et de l’anglais en matière de communications et de services au public ou en matière de langue de travail est l’un de ces domaines.
Les institutions devront veiller à sensibiliser leurs employés à leurs droits et obligations en matière de langues officielles, à améliorer l’accès à la formation linguistique, à faciliter le maintien des acquis des fonctionnaires en français ou en anglais langue seconde et à se préparer aux effets des modifications apportées au Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation de services.
La pandémie de COVID‑19 a accéléré la transition du gouvernement vers une utilisation accrue de la technologie, une organisation du travail plus flexible et une plus grande dispersion de son effectif à travers les différentes régions du pays. Un effectif plus réparti nous permettra d’attirer un bassin plus diversifié de candidats bilingues possédant les compétences et les habiletés dont le gouvernement a besoin.
Si les fonctionnaires peuvent travailler de façon hybride, ils peuvent également apprendre le français ou l’anglais à leur propre rythme, grâce à un nombre accru d’outils d’apprentissage en ligne, comme le Mauril, une application mobile élaborée par la Société Radio-Canada et offerte gratuitement à tous les Canadiens.
Le Secrétariat entend pleinement soutenir les efforts menés par les institutions pour améliorer leur rendement en matière de bilinguisme officiel. Le Secrétariat voit la formation linguistique évoluer vers un mélange d’autoformation, de formation dirigée par un instructeur et d’apprentissage coopératif ou entre pairs. Il faudra outiller tous les employés pour s’assurer que ceux-ci disposent des compétences dont ils ont besoin, y compris des compétences en langue seconde, pour contribuer aux efforts de la fonction publique. En appuyant les institutions fédérales, le Secrétariat continuera à bâtir et à maintenir la fonction publique que le Canada mérite et sur laquelle les Canadiens comptent.
Annexe A. Méthodologie pour rendre des comptes sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles
Les institutions fédérales doivent soumettre au Secrétariat un bilan sur les langues officielles au moins une fois tous les trois ansNote en bas de page 18. Le présent exercice correspond à la dernière année du cycle triennal 2018-2021. Cela dit, 68 organisationsNote en bas de page 19 devaient remplir un questionnaire sur les éléments liés à l’application des parties IV, V et VI de la Loi en 2020-2021.
Les institutions ont dû faire le point sur les éléments suivants :
- les communications avec le public et la prestation des services dans les deux langues officielles;
- la langue de travail;
- la gestion des ressources humaines;
- la gouvernance;
- la surveillance de la mise en œuvre des programmes de langues officielles.
Ces cinq éléments ont été évalués, principalement à l’aide d’énoncés à choix multiples. Le nombre d’énoncés est moindre pour les petites institutionsNote en bas de page 20 , afin d’alléger leur fardeau administratif. Les administrateurs généraux avaient la responsabilité de s’assurer que les réponses fournies par leur institution étaient appuyées par des faits et des éléments probants. Le tableau suivant décrit les échelles de mesure employées dans le Bilan sur les langues officielles 2020-2021.
| Presque toujours | Dans 90 % des cas ou plus |
|---|---|
| Très souvent | Dans 70 % à 89 % des cas |
| Souvent | Dans 50 % à 69 % des cas |
| Quelquefois | Dans 25 % à 49 % des cas |
| Presque jamais | Dans moins de 25 % des cas |
| Oui | Totalement d’accord avec l’énoncé |
| Non | Totalement en désaccord avec l’énoncé |
| Régulièrement | Avec une certaine assiduité |
| De temps en temps | Ici et là dans le temps sans régularité |
| Presque jamais | En de rares occasions |
| S. O. | Ne s’applique pas dans le contexte de l’institution |
Les sections précédentes exposent à grands traits l’exécution des programmes d’application en matière de langues officielles au sein des 68 institutions ayant soumis un bilan cette année ou, selon le cas, des résultats les plus récents des 168 institutions qui ont soumis un bilan au cours du cycle 2018-2021. Les tableaux statistiques de l’annexe D du présent rapport exposent les résultatsNote en bas de page 21 pour l’ensemble des institutions fédérales.
Annexe B. Institutions fédérales tenues de soumettre un bilan pour l’exercice 2020-2021
Au total, 68 institutions fédérales ont soumis un bilan pour l’exercice 2020-2021. La taille est ce qui distingue les petites institutions des grandes institutions. Les grandes institutions doivent répondre à un plus long questionnaire. Les petites institutions comptent moins de 500 employés. La liste des institutions fédérales qui ont soumis un bilan pour les deux exercices précédents du cycle de trois ans est accessible dans les annexes B respectives du Rapport annuel sur les langues officielles 2018-2019 et du Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020.
Grandes institutions
- Affaires mondiales Canada
- Agence canadienne de développement économique du Nord
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence du revenu du Canada
- Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Air Canada
- Anciens Combattants Canada
- Banque de développement du Canada
- Banque du Canada
- Bureau du surintendant des institutions financières Canada
- Bureau du vérificateur général du Canada
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Construction de Défense Canada
- Défense nationale
- Emploi et Développement social Canada
- Exportation et développement Canada
- Financement agricole Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada
- Monnaie royale canadienne
- Parcs Canada
- Patrimoine canadien
- Pêches et Océans Canada
- Postes Canada
- Ressources naturelles Canada
- Santé Canada
- Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Sécurité publique Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service correctionnel Canada
- Services partagés Canada
- Services publics et Approvisionnement Canada
- Société du Centre national des Arts
- Société immobilière du Canada Limitée
- Statistique Canada
- Transports Canada
- VIA Rail Canada Inc.
Petites institutions
- Administration portuaire de Belledune
- Administration portuaire de Halifax
- Administration portuaire de Hamilton-Oshawa
- Administration portuaire de Port-Alberni
- Administration portuaire de Prince-Rupert
- Administration portuaire de Saint-Jean
- Administration portuaire de Sept-Îles
- Administration portuaire de St. John’s
- Administration portuaire de Thunder Bay
- Administration portuaire de Vancouver Fraser
- Bureau de la sécurité des transports du Canada
- Bureau du directeur général des élections
- Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
- Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
- Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Comité externe d’examen de la GRC
- Commissariat à l’information du Canada
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Commission canadienne des droits de la personne
- Commission canadienne des grains
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Conseil des produits agricoles du Canada
- Énergie atomique du Canada Limitée
- Musée des beaux-arts du Canada
- Office de commercialisation du poisson d’eau douce
- Régie de l’énergie du Canada
- Société d’assurance-dépôts du Canada
Annexe C. Définitions
- « anglophones »
- employés dont la première langue officielle est l’anglais.
- « dossier incomplet »
- dossier sur les postes dont les données sur les exigences linguistiques sont incorrectes ou manquantes.
- « francophones »
- employés dont la première langue officielle est le français.
- « poste »
- poste doté pour une période indéterminée ou une période déterminée de trois mois ou plus, selon les données disponibles dans le Système d’information sur les postes et la classification (SIPC).
- « poste bilingue »
- poste dont l’ensemble ou une partie des fonctions doit être exercé en français et en anglais.
- « poste réversible »
- poste dont toutes les fonctions peuvent être exercées en français ou en anglais, au choix de l’employé.
- « première langue officielle »
- langue déclarée par l’employé comme étant celle à laquelle il s’identifie le mieux.
- « ressources »
- ressources nécessaires pour satisfaire aux obligations sur une base régulière, selon les données disponibles dans le Système d’information sur les langues officielles II (SILO II), soit une combinaison d’employés à temps plein et à temps partiel, ainsi que de ressources contractuelles. Dans certains cas, il s’agit de fonctions automatisées, d’où la nécessité d’utiliser le mot « ressource » dans le présent rapport.
Annexe D. Tableaux statistiques
Dans cette section
- Notes
- Table 1 - Postes bilingues et bassin d’employés bilingues au sein de l’administration publique centrale au 31 mars
- Table 2 - Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale au 31 mars
- Table 3 - Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale par province, territoire ou région au 31 mars 2021
- Table 4 - Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
- Table 5 - Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars
- Table 6 - Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
- Table 7 - Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars
- Table 8 - Services au public : postes au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires par province, territoire et région au 31 mars 2021
- Table 9 - Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
- Table 10 - Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars
- Table 11 - Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
- Table 12 - Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars
- Table 13 - Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale par province, territoire ou région au 31 mars 2021
- Table 14 - Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale par catégorie professionnelle au 31 mars 2021
- Table 15 - Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi
- Table 16 - Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi
- Table 17 - Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi
- Table 18 - Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi au 31 mars 2021
- Table 19 - Services au public : nombre de ressources servant le public au sein des bureaux bilingues des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, par province, territoire, région et mode de prestation au 31 mars 2021
- Table 20 - Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, par province, territoire et région au 31 mars 2021
- Table 21 - Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, selon la catégorie professionnelle ou une catégorie équivalente au 31 mars 2021
- Table 22 - Participation des anglophones et des francophones au sein de l’ensemble des institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles par province, territoire ou région au 31 mars 2021
Quatre sources de données principales ont été utilisées pour produire les tableaux qui suivent :
- Burolis est le répertoire officiel qui indique si les bureaux ont ou non l’obligation de communiquer avec le public dans les deux langues officielles;
- le Système d’information sur les postes et la classification (SIPC) contient les « postes » et le nom des employés au sein des institutions qui font partie de l’administration publique centrale;
- le Système d’information sur les langues officielles II (SILO II) fournit des renseignements sur les ressources des institutions qui ne font pas partie de l’administration publique centrale (c’est-à-dire les sociétés d’État et les organismes distincts);
- la Banque de données sur l’équité en emploi (BDEE) qui fournit des données à partir des déclarations volontaires des membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi et, pour les femmes, le Système de paie.
Le 31 mars est la date de référence utilisée pour les données figurant dans les tableaux statistiques et les systèmes de données (le Système de paie, Burolis, SIPC, SILO II et BDEE).
Notes
Les chiffres ayant été arrondis, le total des pourcentages des tableaux peut ne pas correspondre à 100 %.
Les données du présent rapport concernant les postes au sein de l’administration publique centrale sont tirées du SIPC, sauf pour les tableaux 15 à 18 qui utilisent également la BDEE. Parce que les données relatives aux langues officielles ont pour base le SIPC, elles ne concordent pas avec celles affichées dans le Rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique fédérale. La somme des groupes désignés en matière d’emploi ne correspond pas au total de tous les employés parce que les employés peuvent avoir choisi de s’identifier comme appartenant à plus d’un groupe et que les hommes sont compris dans le total.
Il est possible que les pourcentages des titulaires de postes bilingues qui satisfont aux exigences linguistiques de leur poste dans les tableaux 4, 6, 9 et 11 soient, en réalité, plus élevés, le Commission de la fonction publique du Canada ayant suspendu temporairement les évaluations des compétences en langue seconde au cours de la pandémie. Malgré les évaluations de candidats réalisées par les institutions durant cette période, seule la Commission peut mettre à jour le SIPC à partir de ses propres évaluations. Les résultats seront mis à jour à mesure que la Commission évaluera officiellement les recrues et les employés promus, soit dans les 12 mois suivant leur nomination.
Selon le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, les titulaires peuvent ne pas satisfaire aux exigences linguistiques de leur poste pour les raisons suivantes :
- parce qu’ils sont exemptés de ces exigences;
- parce qu’ils ont deux ans pour satisfaire aux exigences.
Le profil linguistique d’un poste bilingue est établi selon trois niveaux de compétence en langue seconde, à savoir :
- le niveau A, qui correspond à une capacité minimale;
- le niveau B, qui correspond à une capacité intermédiaire;
- le niveau C, qui correspond à une capacité supérieure.
Tableau 1
Postes bilingues et bassin d’employés bilingues au sein de l’administration publique centrale au 31 mars
En date du 31 mars 2021, le pourcentage de postes bilingues et celui du bassin d’employés bilingues au sein de l’administration publique centrale avaient diminué légèrement de 0,5 % et de 2,7 % respectivement, pour s’établir à 41,9 % et 40,7 %, comparativement au 31 mars 2020.
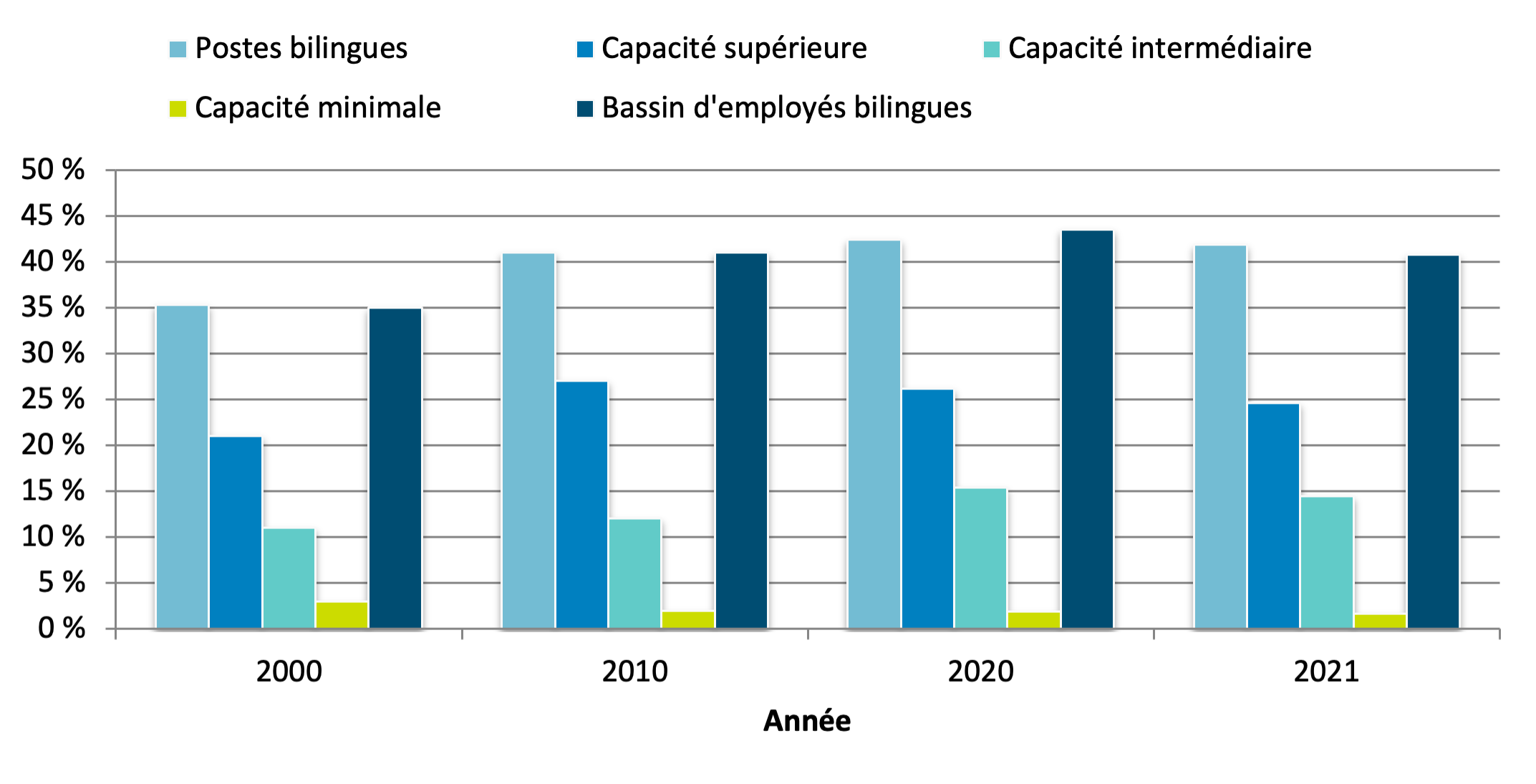
| Année | Postes bilingues | Capacité supérieure | Capacité intermédiaire | Capacité minimale | Bassin d’employés bilingues |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35 % | 21 % | 11 % | 3 % | 35 % |
| 2010 | 41 % | 27 % | 12 % | 2 % | 41 % |
| 2020 | 42 % | 26 % | 15 % | 2 % | 43 % |
| 2021 | 42 % | 25 % | 14 % | 2 % | 41 % |
Tableau 2
Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale au 31 mars
Au cours de l’exercice 2020-2021, le nombre de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale a augmenté de 5,1 %, mais le nombre de postes bilingues par rapport au nombre total de postes a diminué légèrement, soit de 0,5 %, par rapport à l’exercice 2019-2020.
| Année | Postes bilingues | Postes anglais essentiel | Postes français essentiel | Postes français ou anglais essentiel | Dossiers incomplets | Total des postes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 535 | 35,3 % | 75 552 | 52,8 % | 8 355 | 5,8 % | 7 132 | 5,0 % | 1 478 | 1,0 % | 143 052 |
| 2010 | 82 985 | 41,0 % | 102 484 | 50,6 % | 7 827 | 3,9 % | 8 791 | 4,3 % | 450 | 0,2 % | 202 537 |
| 2020 | 89 632 | 42,4 % | 105 062 | 49,7 % | 7 191 | 3,4 % | 9 334 | 4,4 % | 50 | 0,0 % | 211 269 |
| 2021 | 94 210 | 41,9 % | 112 513 | 50,0 % | 8 258 | 3,7 % | 9 989 | 4,4 % | 34 | 0,0 % | 225 004 |
Tableau 3
Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale par province, territoire ou région au 31 mars 2021
Des 225 004 postes que comptait l’administration publique centrale durant l’exercice 2020-2021, 94 210 étaient bilingues. La plupart des postes bilingues se trouvaient au Québec (excluant la région de la capitale nationale [la RCN]) (dans cette province, 65,4 % des postes sont bilingues), dans la région de la capitale nationale (63,4 % des postes) et au Nouveau‑Brunswick (51,7 %).
| Postes unilingues | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province, territoire ou région | Postes bilingues | Anglais essentiel | Français essentiel | Français ou anglais essentiel | Dossiers incomplets | Total des postes | |||||
| Colombie-Britannique | 545 | 2,9 % | 18 221 | 96,6 % | 1 | 0,0 % | 98 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 18 865 |
| Alberta | 437 | 3,9 % | 10 853 | 95,7 % | 0 | 0,0 % | 52 | 0,5 % | 1 | 0,0 % | 11 343 |
| Saskatchewan | 118 | 2,4 % | 4 848 | 97,3 % | 0 | 0,0 % | 18 | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 4 985 |
| Manitoba | 566 | 7,7 % | 6 718 | 91,4 % | 2 | 0,0 % | 62 | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 7 349 |
| Ontario (excluant la RCN) | 2 730 | 10,1 % | 24 165 | 89,0 % | 12 | 0,0 % | 236 | 0,9 % | 3 | 0,0 % | 27 146 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 66 695 | 63,4 % | 29 149 | 27,7 % | 377 | 0,4 % | 8 947 | 8,5 % | 17 | 0,0 % | 105 185 |
| Québec (excluant la RCN) | 15 454 | 65,4 % | 213 | 0,9 % | 7 656 | 32,4 % | 297 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 23 620 |
| Nouveau-Brunswick | 4 570 | 51,7 % | 3 925 | 44,4 % | 194 | 2,2 % | 148 | 1,7 % | 4 | 0,0 % | 8 841 |
| Île-du-Prince-Édouard | 552 | 24,3 % | 1 706 | 75,2 % | 2 | 0,1 % | 10 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 2 270 |
| Nouvelle-Écosse | 1 005 | 11,0 % | 8 027 | 87,9 % | 14 | 0,2 % | 83 | 0,9 % | 5 | 0,1 % | 9 134 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 103 | 2,7 % | 3 652 | 96,4 % | 0 | 0,0 % | 34 | 0,9 % | 1 | 0,0 % | 3 790 |
| Yukon | 11 | 3,2 % | 328 | 96,5 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 340 |
| Territoires du Nord-Ouest | 14 | 3,1 % | 441 | 96,9 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 455 |
| Nunavut | 8 | 2,9 % | 263 | 96,3 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 273 |
| Extérieur du Canada | 1 402 | 99,6 % | 4 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 1 408 |
| Total | 94 210 | 41,9 % | 112 513 | 50,0 % | 8 258 | 3,7 % | 9 989 | 4,4 % | 34 | 0,0 % | 225 004 |
Tableau 4
Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
Pour l’exercice 2020-2021, la proportion de titulaires de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale qui satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste a augmenté légèrement de 0,9 %, par rapport à l’exercice 2019-2020.
| Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Les titulaires satisfont aux exigences | Exemptés | Doivent satisfaire | Dossiers incomplets | Total des employés | ||||
| 2000 | 41 832 | 82,8 % | 5 030 | 10,0 % | 968 | 1,9 % | 2 705 | 5,4 % | 50 535 |
| 2010 | 77 331 | 93,2 % | 3 625 | 4,4 % | 831 | 1,0 % | 1 198 | 1,4 % | 82 985 |
| 2020 | 85 676 | 95,6 % | 3 297 | 3,7 % | 35 | 0,0 % | 624 | 0,7 % | 89 632 |
| 2021 | 90 893 | 96,5 % | 2 297 | 2,4 % | 50 | 0,1 % | 970 | 1,0 % | 94 210 |
Tableau 5
Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 marsNote en bas de page 22
Le pourcentage de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale exigeant un niveau de compétence C en interaction orale s’est accru de 0,9 %, de l’exercice 2019-2020 à l’exercice 2020-2021.
| Année | Niveau C | Niveau B | Niveau A | Autres | Total des postes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12 836 | 25,4 % | 34 677 | 68,6 % | 1 085 | 2,1 % | 1 937 | 3,8 % | 50 535 |
| 2010 | 26 738 | 32,2 % | 53 659 | 64,7 % | 724 | 0,9 % | 1 864 | 2,2 % | 82 985 |
| 2020 | 32 435 | 36,2 % | 55 471 | 61,9 % | 335 | 0,4 % | 1 391 | 1,6 % | 89 632 |
| 2021 | 34 964 | 37,1 % | 57 648 | 61,2 % | 333 | 0,4 % | 1 265 | 1,3 % | 94 210 |
Tableau 6
Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
De l’exercice 2019-2020 à l’exercice 2020-2021, le pourcentage d’employés au sein de l’administration publique centrale qui fournissaient des services au public en français et en anglais et qui satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste a augmenté de 1,3 %.
| Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Les titulaires satisfont aux exigences | Exemptés | Doivent satisfaire | Dossiers incomplets | Total des employés | ||||
| 2000 | 26 766 | 82,3 % | 3 429 | 10,5 % | 690 | 2,1 % | 1 631 | 5,0 % | 32 516 |
| 2010 | 46 413 | 93,0 % | 2 217 | 4,4 % | 555 | 1,1 % | 746 | 1,5 % | 49 931 |
| 2020 | 42 839 | 95,8 % | 1 468 | 3,3 % | 14 | 0,0 % | 378 | 0,8 % | 44 699 |
| 2021 | 44 405 | 96,9 % | 870 | 1,9 % | 20 | 0,0 % | 535 | 1,2 % | 45 830 |
Tableau 7
Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 marsNote en bas de page 23
Le nombre de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale s’est accru depuis l’exercice 2019-2020. Le pourcentage de postes bilingues offrant des services au public et exigeant un niveau de compétence C en interaction orale a augmenté de 0,4 %, pour atteindre 42,0 % durant l’exercice 2020-2021.
| Année | Niveau C | Niveau B | Niveau A | Autres | Total des postes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9 088 | 27,9 % | 22 421 | 69,0 % | 587 | 1,8 % | 420 | 1,3 % | 32 516 |
| 2010 | 17 645 | 35,3 % | 31 780 | 63,6 % | 340 | 0,7 % | 166 | 0,3 % | 49 931 |
| 2020 | 18 599 | 41,6 % | 25 872 | 57,9 % | 99 | 0,2 % | 129 | 0,3 % | 44 699 |
| 2021 | 19 261 | 42,0 % | 26 402 | 57,6 % | 101 | 0,2 % | 66 | 0,1 % | 45 830 |
Tableau 8
Services au public : postes au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires par province, territoire et région au 31 mars 2021
Au cours de l’exercice 2020-2021, des 111 542 postes au sein de l’administration centrale visant les services au public, 45 830 étaient rattachés à des services en français et en anglais et 44 405 des titulaires de ces 45 830 postes bilingues satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste.
| Postes bilingues | Postes unilingues | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province, territoire ou région | Les titulaires satisfont aux exigences | Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | Dossiers incomplets | Anglais essentiel | Français essentiel | Français ou anglais essentiel | Total des employés | |
| Exemptés | Doivent satisfaire | |||||||
| Ouest et Nord du Canada | 1 000 | 38 | 0 | 45 | 26 303 | 2 | 68 | 27 456 |
| Ontario (excluant la RCN) | 1 526 | 43 | 0 | 52 | 14 315 | 2 | 57 | 15 995 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 27 652 | 571 | 19 | 167 | 9 389 | 145 | 2 119 | 40 062 |
| Québec (excluant la RCN) | 9 025 | 114 | 0 | 137 | 71 | 3 819 | 114 | 13 280 |
| Nouveau-Brunswick | 3 093 | 54 | 0 | 23 | 2 487 | 180 | 36 | 5 873 |
| Autres provinces de l’Atlantique | 955 | 41 | 1 | 11 | 6 558 | 9 | 37 | 7 612 |
| Extérieur du Canada | 1 154 | 9 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 264 |
| Toutes les régions | 44 405 | 870 | 20 | 535 | 59 124 | 4 157 | 2 431 | 111 542 |
Tableau 9
Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
Durant l’exercice 2020-2021, 96,4 % des titulaires des 68 581 postes bilingues rattachés à des services personnels et centraux au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste, ce qui représente une hausse de 0,9 %, comparativement à l’exercice 2019-2020.
| Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Les titulaires satisfont aux exigences | Exemptés | Doivent satisfaire | Dossiers incomplets | Total des employés | ||||
| 2020 | 61 915 | 95,5 % | 2 385 | 3,7 % | 18 | 0,0 % | 545 | 0,8 % | 64 863 |
| 2021 | 66 106 | 96,4 % | 1 664 | 2,4 % | 16 | 0,0 % | 795 | 1,2 % | 68 581 |
Tableau 10
Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 marsNote en bas de page 24
Sur les 68 581 postes au sein de l’administration publique centrale, dont les titulaires offraient des services personnels et centraux en français et en anglais au cours de l’exercice 2020-2021, 37,1 % exigeaient un niveau de compétence C en interaction orale, ce qui représente une hausse de 0,6 %, par rapport à l’exercice 2019-2020.
| Année | Niveau C | Niveau B | Niveau A | Autres | Total des postes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 697 | 36,5 % | 39 879 | 61,5 % | 177 | 0,3 % | 1 110 | 1,7 % | 64 863 |
| 2021 | 25 467 | 37,1 % | 41 930 | 61,1 % | 169 | 0,2 % | 1 015 | 1,5 % | 68 581 |
Tableau 11
Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars
Au 31 mars 2021, 96,1 % des titulaires des 28 811 postes de supervision bilingues au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste.
| Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Les titulaires satisfont aux exigences | Exemptés | Doivent satisfaire | Dossiers incomplets | Total des employés | ||||
| 2020 | 26 089 | 95,9 % | 1 005 | 3,7 % | 22 | 0,1 % | 86 | 0,3 % | 27 202 |
| 2021 | 27 691 | 96,1 % | 879 | 3,1 % | 37 | 0,1 % | 204 | 0,7 % | 28 811 |
| Note : ce tableau n’inclut pas les employés travaillant à l’extérieur du Canada. | |||||||||
Tableau 12
Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 marsNote en bas de page 25
Au cours de l’exercice 2020-2021, 62,0 % des 28 811 postes de supervision bilingues au sein de l’administration publique centrale exigeaient un niveau de compétence C en interaction orale, ce qui est une hausse de 1,3 %, comparativement à l’exercice 2019-2020.
| Année | Niveau C | Niveau B | Niveau A | Autres | Total des postes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 502 | 60,7 % | 10 604 | 39,0 % | 36 | 0,1 % | 60 | 0,2 % | 27 202 |
| 2021 | 17 852 | 62,0 % | 10 890 | 37,8 % | 39 | 0,1 % | 30 | 0,1 % | 28 811 |
| Note : ce tableau n’inclut pas les employés travaillant à l’extérieur du Canada. | |||||||||
Tableau 13
Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale par province, territoire ou région au 31 mars 2021
Au 31 mars 2021, la province de Terre-Neuve-et-Labrador comptait le plus grand pourcentage d’anglophones (98,8 %) œuvrant au sein de l’administration publique centrale et la province de Québec (excluant la région de la capitale nationale), le plus grand pourcentage de francophones (88,6 %).
| Province, territoire ou région | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total des employés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie‑Britannique | 18 480 | 98,0 % | 383 | 2,0 % | 2 | 0,0 % | 18 865 |
| Alberta | 10 990 | 96,9 % | 353 | 3,1 % | 0 | 0,0 % | 11 343 |
| Saskatchewan | 4 915 | 98,6 % | 70 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | 4 985 |
| Manitoba | 7 045 | 95,9 % | 304 | 4,1 % | 0 | 0,0 % | 7 349 |
| Ontario (excluant la RCN) | 25 678 | 94,6 % | 1 467 | 5,4 % | 1 | 0,0 % | 27 146 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 64 931 | 61,7 % | 40 250 | 38,3 % | 4 | 0,0 % | 105 185 |
| Québec (excluant la RCN) | 2 697 | 11,4 % | 20 923 | 88,6 % | 0 | 0,0 % | 23 620 |
| Nouveau‑Brunswick | 4 764 | 53,9 % | 4 077 | 46,1 % | 0 | 0,0 % | 8 841 |
| Île‑du‑Prince‑Édouard | 2 026 | 89,3 % | 244 | 10,7 % | 0 | 0,0 % | 2 270 |
| Nouvelle‑Écosse | 8 618 | 94,4 % | 516 | 5,6 % | 0 | 0,0 % | 9 134 |
| Terre‑Neuve‑et‑Labrador | 3 745 | 98,8 % | 45 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | 3 790 |
| Yukon | 322 | 94,7 % | 18 | 5,3 % | 0 | 0,0 % | 340 |
| Territoires du Nord‑Ouest | 426 | 93,6 % | 29 | 6,4 % | 0 | 0,0 % | 455 |
| Nunavut | 247 | 90,5 % | 26 | 9,5 % | 0 | 0,0 % | 273 |
| Extérieur du Canada | 909 | 64,6 % | 499 | 35,4 % | 0 | 0,0 % | 1 408 |
| Toutes les régions | 155 793 | 69,2 % | 69 204 | 30,8 % | 7 | 0,0 % | 225 004 |
Tableau 14
Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale par catégorie professionnelle au 31 mars 2021
Au 31 mars 2021, la catégorie Exploitation comptait le plus grand pourcentage d’anglophones (78,8 %) et la catégorie Administration et service extérieur, le plus grand pourcentage de francophones (37,2 %) œuvrant au sein de l’administration publique centrale. Les résultats sont semblables à ceux constatés au 31 mars 2020.
| Catégories | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total des employés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion (EX) | 3 979 | 65,7 % | 2 074 | 34,3 % | 0 | 0,0 % | 6 053 | |
| Scientifique et professionnelle | 33 643 | 76,5 % | 10 354 | 23,5 % | 3 | 0,0 % | 44 000 | |
| Administration et service extérieur | 70 702 | 62,8 % | 41 902 | 37,2 % | 4 | 0,0 % | 112 608 | |
| Technique | 10 610 | 77,2 % | 3 126 | 22,8 % | 0 | 0,0 % | 13 736 | |
| Soutien administratif | 13 771 | 71,3 % | 5 555 | 28,7 % | 0 | 0,0 % | 19 326 | |
| Exploitation | 23 088 | 78,8 % | 6 193 | 21,2 % | 0 | 0,0 % | 29 281 | |
| Toutes les catégories | 155 793 | 69,2 % | 69 204 | 30,8 % | 7 | 0,0 % | 225 004 | |
Tableau 15
Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploiNote en bas de page 26
Au 31 mars 2021, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes en situation de handicap étaient sous-représentés parmi les titulaires de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale, et les femmes, surreprésentées.
| Groupes visés | Postes bilingues | Postes anglais essentiel | Postes français essentiel | Postes français ou anglais essentiel | Dossiers incomplets | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 55 923 | 45,1 % | 58 762 | 47,4 % | 4 504 | 3,6 % | 4 836 | 3,9 % | 19 | 0,0 % | 124 044 |
| Autochtones | 3 841 | 32,7 % | 7 358 | 62,7 % | 214 | 1,8 % | 322 | 2,7 % | 2 | 0,0 % | 11 737 |
| Personnes en situation de handicap | 4 871 | 38,8 % | 6 787 | 54,0 % | 280 | 2,2 % | 629 | 5,0 % | 1 | 0,0 % | 12 568 |
| Membres des minorités visibles | 15 043 | 35,7 % | 23 131 | 54,9 % | 924 | 2,2 % | 3 046 | 7,2 % | 5 | 0,0 % | 42 149 |
| Tous les employés | 94 210 | 41,9 % | 112 513 | 50,0 % | 8 258 | 3,7 % | 9 989 | 4,4 % | 34 | 0,0 % | 225 004 |
Tableau 16
Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi
Au 31 mars 2021, les membres des minorités visibles et les personnes en situation de handicap étaient légèrement sous-représentés parmi les titulaires de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale qui satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste.
| Les titulaires ne satisfont pas aux exigences | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupes visés | Les titulaires satisfont aux exigences | Exemptés | Doivent satisfaire | Dossiers incomplets | Total | ||||
| Femmes | 54 209 | 96,9 % | 1 189 | 2,1 % | 15 | 0,0 % | 510 | 0,9 % | 55 923 |
| Autochtones | 3 733 | 97,2 % | 72 | 1,9 % | 2 | 0,1 % | 34 | 0,9 % | 3 841 |
| Personnes en situation de handicap | 4 678 | 96,0 % | 148 | 3,0 % | 4 | 0,1 % | 41 | 0,8 % | 4 871 |
| Membres des minorités visibles | 14 473 | 96,2 % | 407 | 2,7 % | 15 | 0,1 % | 148 | 1,0 % | 15 043 |
| Tous les employés | 90 893 | 96,5 % | 2 297 | 2,4 % | 50 | 0,1 % | 970 | 1,0 % | 94 210 |
Tableau 17
Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars 2021 selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploiNote en bas de page 27
Au 31 mars 2021, seuls les membres des minorités visibles étaient sous-représentés parmi les titulaires de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale exigeant un niveau de compétence C en interaction orale.
| Groupes visés | Niveau C | Niveau B | Niveau A | Autres | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 21 101 | 37,7 % | 34 021 | 60,8 % | 59 | 0,1 % | 742 | 1,3 % | 55 923 |
| Autochtones | 1 446 | 37,6 % | 2 367 | 61,6 % | 14 | 0,4 % | 14 | 0,4 % | 3 841 |
| Personnes en situation de handicap | 1 828 | 37,5 % | 2 996 | 61,5 % | 11 | 0,2 % | 36 | 0,7 % | 4 871 |
| Membres des minorités visibles | 4 975 | 33,1 % | 9 945 | 66,1 % | 29 | 0,2 % | 94 | 0,6 % | 15 043 |
| Tous les employés | 34 964 | 37,1 % | 57 648 | 61,2 % | 333 | 0,4 % | 1 265 | 1,3 % | 94 210 |
Tableau 18
Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration publique centrale selon le groupe visé par l’équité en matière d’emploi au 31 mars 2021
Au 31 mars 2021, les femmes anglophones étaient sous-représentées au sein de l’administration publique centrale. Il en était de même pour les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes en situation de handicap francophones.
| Groupes visés | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 84 392 | 68,0 % | 39 650 | 32,0 % | 2 | 0,0 % | 124 044 | |
| Autochtones | 8 770 | 74,7 % | 2 967 | 25,3 % | 0 | 0,0 % | 11 737 | |
| Personnes en situation de handicap | 9 564 | 76,1 % | 3 003 | 23,9 % | 1 | 0,0 % | 12 568 | |
| Membres des minorités visibles | 32 914 | 78,1 % | 9 232 | 21,9 % | 3 | 0,0 % | 42 149 | |
| Tous les employés | 155 793 | 69,2 % | 69 204 | 30,8 % | 7 | 0,0 % | 225 004 | |
Tableau 19
Services au public : nombre de ressources servant le public au sein des bureaux bilingues des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, par province, territoire, région et mode de prestation au 31 mars 2021Note en bas de page 28
Durant l’exercice 2020-2021, 66 076 ressources ont offert des services au public dans les bureaux bilingues au sein d’institutions fédérales ne faisant pas partie de l’administration publique centrale. De ces ressources, 21 763 ont fourni des services en français et en anglais.
| Province, territoire, région ou mode de prestation | Ressources - anglais seulement | Ressources - français seulement | Ressources bilingues | Total des ressources |
|---|---|---|---|---|
| Ouest et Nord du Canada | 18 378 | 38 | 1 849 | 20 265 |
| Ontario (excluant la RCN) | 11 628 | 56 | 1 595 | 13 279 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 5 929 | 471 | 7 474 | 13 874 |
| Québec (excluant la RCN) | 252 | 1 453 | 8 322 | 10 027 |
| Nouveau-Brunswick | 406 | 136 | 1 188 | 1 730 |
| Autres provinces de l’Atlantique | 3 683 | 15 | 834 | 4 532 |
| Extérieur du Canada | 217 | 3 | 78 | 298 |
| Trajet | 333 | 0 | 26 | 359 |
| Téléphone | 1 314 | 1 | 397 | 1 712 |
| Total | 42 140 | 2 173 | 21 763 | 66 076 |
Tableau 20
Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, par province, territoire et région au 31 mars 2021
Au 31 mars 2021, la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador comptait le plus grand pourcentage d’anglophones (98,2 %) œuvrant au sein des institutions fédérales ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, et la province de Québec (excluant la région de la capitale nationale), le plus grand pourcentage de francophones (79,3 %).
| Province, territoire ou région | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total des ressources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie‑Britannique | 34 500 | 96,1 % | 1 290 | 3,6 % | 120 | 0,3 % | 35 910 |
| Alberta | 28 483 | 95,1 % | 1 378 | 4,6 % | 96 | 0,3 % | 29 957 |
| Saskatchewan | 7 755 | 96,5 % | 277 | 3,4 % | 1 | 0,0 % | 8 033 |
| Manitoba | 14 471 | 95,2 % | 732 | 4,8 % | 0 | 0,0 % | 15 203 |
| Ontario (excluant la RCN) | 69 685 | 93,3 % | 4 855 | 6,5 % | 115 | 0,2 % | 74 655 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 34 793 | 71,4 % | 13 936 | 28,6 % | 29 | 0,1 % | 48 758 |
| Québec (excluant la RCN) | 10 330 | 20,7 % | 39 652 | 79,3 % | 23 | 0,0 % | 50 005 |
| Nouveau‑Brunswick | 7 482 | 73,7 % | 2 670 | 26,3 % | 0 | 0,0 % | 10 152 |
| Île‑du‑Prince‑Édouard | 1 958 | 92,6 % | 156 | 7,4 % | 0 | 0,0 % | 2 114 |
| Nouvelle‑Écosse | 13 221 | 92,1 % | 1 127 | 7,9 % | 0 | 0,0 % | 14 348 |
| Terre‑Neuve‑et‑Labrador | 5 783 | 98,2 % | 105 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | 5 888 |
| Yukon | 370 | 90,7 % | 38 | 9,3 % | 0 | 0,0 % | 408 |
| Territoires du Nord‑Ouest | 624 | 87,6 % | 88 | 12,4 % | 0 | 0,0 % | 712 |
| Nunavut | 307 | 84,6 % | 56 | 15,4 % | 0 | 0,0 % | 363 |
| Extérieur du Canada | 1 803 | 73,4 % | 381 | 15,5 % | 273 | 11,1 % | 2 457 |
| Toutes les régions | 231 565 | 77,5 % | 66 741 | 22,3 % | 657 | 0,2 % | 298 963 |
Tableau 21
Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale, selon la catégorie professionnelle ou une catégorie équivalente au 31 mars 2021
En date du 31 mars 2021, la catégorie Exploitation comptait le plus grand pourcentage d’anglophones (80,0 %) œuvrant au sein des institutions fédérales ne faisant pas partie de l’administration publique centrale et la catégorie Forces armées canadiennes et membres permanents de la Gendarmerie royale du Canada, le plus grand pourcentage de francophones (26,1 %).
| Catégories | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total des ressources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion | 13 287 | 75,4 % | 4 246 | 24,1 % | 92 | 0,5 % | 17 625 |
| Professionnels | 32 453 | 75,3 % | 10 554 | 24,5 % | 117 | 0,3 % | 43 124 |
| Spécialistes et techniciens | 16 893 | 74,9 % | 5 659 | 25,1 % | 16 | 0,1 % | 22 568 |
| Soutien administratif | 34 959 | 76,5 % | 10 679 | 23,4 % | 39 | 0,1 % | 45 677 |
| Exploitation | 86 129 | 80,0 % | 21 125 | 19,6 % | 393 | 0,4 % | 107 647 |
| Forces armées canadiennes et membres permanents de la Gendarmerie royale du Canada | 47 842 | 73,9 % | 16 885 | 26,1 % | 0 | 0,0 % | 64 727 |
| Toutes les catégories | 231 563 | 76,8 % | 69 148 | 22,9 % | 657 | 0,2 % | 301 368 |
Tableau 22
Participation des anglophones et des francophones au sein de l’ensemble des institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles par province, territoire ou région au 31 mars 2021
En date du 31 mars 2021, la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador comptait le plus grand pourcentage d’anglophones (98,5 %) et la province de Québec (excluant la région de la capitale nationale), le plus grand pourcentage de francophones (82,3 %) œuvrant au sein de l’ensemble des institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles.
| Province, territoire ou région | Anglophones | Francophones | Inconnus | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie‑Britannique | 52 980 | 96,7 % | 1 673 | 3,1 % | 122 | 0,2 % | 54 775 |
| Alberta | 39 473 | 95,6 % | 1 731 | 4,2 % | 96 | 0,2 % | 41 300 |
| Saskatchewan | 12 670 | 97,3 % | 347 | 2,7 % | 1 | 0,0 % | 13 018 |
| Manitoba | 21 516 | 95,4 % | 1 036 | 4,6 % | 0 | 0,0 % | 22 552 |
| Ontario (excluant la RCN) | 95 363 | 93,7 % | 6 322 | 6,2 % | 116 | 0,1 % | 101 801 |
| Région de la capitale nationale (RCN) | 99 724 | 64,8 % | 54 186 | 35,2 % | 33 | 0,0 % | 153 943 |
| Québec (excluant la RCN) | 13 027 | 17,7 % | 60 575 | 82,3 % | 23 | 0,0 % | 73 625 |
| Nouveau‑Brunswick | 12 246 | 64,5 % | 6 747 | 35,5 % | 0 | 0,0 % | 18 993 |
| Île‑du‑Prince‑Édouard | 3 984 | 90,9 % | 400 | 9,1 % | 0 | 0,0 % | 4 384 |
| Nouvelle‑Écosse | 21 839 | 93,0 % | 1 643 | 7,0 % | 0 | 0,0 % | 23 482 |
| Terre‑Neuve‑et‑Labrador | 9 528 | 98,5 % | 150 | 1,5 % | 0 | 0,0 % | 9 678 |
| Yukon | 692 | 92,5 % | 56 | 7,5 % | 0 | 0,0 % | 748 |
| Territoires du Nord‑Ouest | 1 050 | 90,0 % | 117 | 10,0 % | 0 | 0,0 % | 1 167 |
| Nunavut | 554 | 87,1 % | 82 | 12,9 % | 0 | 0,0 % | 636 |
| Extérieur du Canada | 2 712 | 70,2 % | 880 | 22,8 % | 273 | 7,1 % | 3 865 |
| Toutes les régions | 387 358 | 73,9 % | 135 945 | 25,9 % | 664 | 0,1 % | 523 967 |
Annexe E. Statistiques des événements organisés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours de l’exercice 2020-2021
| Événement | Date | Auditoire | Principaux sujets ou enjeux |
|---|---|---|---|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) | 29 mai 2020 | Environ 80 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSÉLO) | 29 mai 2020 | Environ 50 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) | 22 juin 2020 | Environ 80 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSÉLO) | 22 juin 2020 | Environ 50 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) | 26 août 2020 | 80 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSÉLO) | 26 août 2020 | 54 participants |
|
| Journée de la dualité linguistique | 10 septembre 2020 |
|
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) | 28 octobre 2020 | Environ 80 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSÉLO) | 28 octobre 2020 | Environ 50 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) | 27 janvier 2021 | Environ 80 participants |
|
| Rencontre virtuelle - Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSÉLO) | 27 janvier 2021 | Environ 50 participants |
|
| Rencontre virtuelle avec la communauté des langues officielles – Champions, personnes responsables des langues officielles des ministères et sociétés d’État, coordonnateurs 41 | 25 février 2021 | Environ 250 participants |
|
| Forum virtuel sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles | Du 1er au 5 mars 2021 |
|
|
| Camp intensif de formation sur les langues officielles | De septembre 2020 à mars 2021 (23 séances) | Environ 200 personnes ont participé au camp (champions et personnes responsables des langues officielles). |
|
Annexe F. Répartition des bureaux et points de service fédéraux au 31 mars 2021
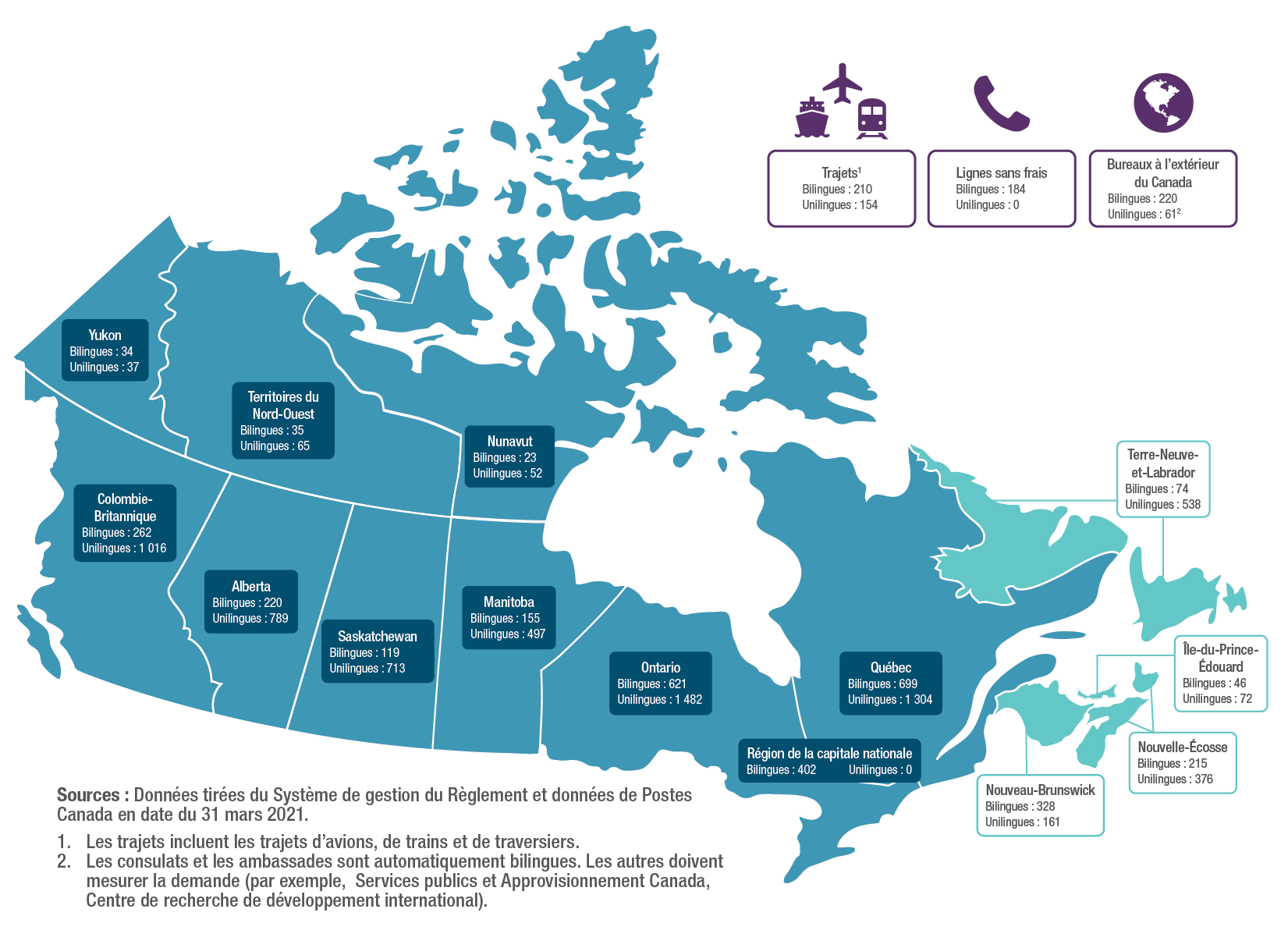
Graphique - Version textuelle
Colombie-Britannique : 262 bureaux bilingues, 1 016 unilingues; Alberta : 220 bureaux bilingues, 789 unilingues; Saskatchewan : 119 bureaux bilingues, 713 unilingues; Manitoba : 155 bureaux bilingues, 497 unilingues; Ontario : 621 bureaux bilingues, 1 482 unilingues; Région de la capitale nationale : 402 bureaux bilingues, aucun unilingue; Québec : 699 bureaux bilingues, 1 304 unilingues; Nouveau-Brunswick : 328 bureaux bilingues, 161 unilingues; Île-du-Prince-Édouard : 46 bureaux bilingues, 72 unilingues; Nouvelle-Écosse : 215 bureaux bilingues, 376 unilingues; Terre-Neuve-et-Labrador : 74 bureaux bilingues, 538 unilingues; Yukon : 34 bureaux bilingues, 37 unilingues; Territoires du Nord-Ouest : 35 bureaux bilingues, 65 unilingues; Nunavut : 23 bureaux bilingues, 52 unilingues; extérieur du Canada : 220 bureaux bilingues, 61 unilingues (Les consulats et les ambassades sont automatiquement bilingues. Les autres doivent mesurer la demande (par exemple, Services publics et Approvisionnement Canada, Centre de recherche pour le développement international)); 184 lignes sans frais bilingues, aucune unilingue; 210 trajets bilingues, 154 unilingues (les trajets incluent les trajets d’avions, de trains et de traversiers). Sources : Données tirées du Système de gestion du Règlement et données de Postes Canada en date du 31 mars 2021.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la présidente du Conseil du Trésor, 2022,
No de catalogue BT23-1F-PDF, ISSN : 1486-9691
