Chapitre 16 : Mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire
Partie II — Le sport sécuritaire au Canada
Sur cette page
- La voie vers un mécanisme de plainte indépendant au niveau national
- Le programme Sport Sans Abus : création, mise en œuvre et fonctionnement
- Le Programme canadien de sport sécuritaire : création, mise en œuvre et fonctionnement
- Perspectives des participants sur le programme Sport Sans Abus et le Programme canadien de sport sécuritaire
- Mécanismes établis par des tiers indépendants au niveau national
- Mécanismes de plainte au niveau provincial et territorial
- Mécanismes de plainte au niveau communautaire
- Perspectives des participants sur la centralisation et l’harmonisation des mécanismes de plainte
- Que se passe-t-il dans les autres pays?
- Obstacles systémiques au signalement de la maltraitance dans le sport
- Réponses à la maltraitance dans le sport: conclusions et recommandations préliminaires
- Soutien aux personnes touchées : conclusions et recommandations préliminaires
Au chapitre précédent, nous avons examiné les politiques existantes en matière de sport sécuritaire au Canada. Un élément important à noter est que ces politiques n’incluent généralement pas de procédures pour traiter les plaintes de maltraitance. Les politiques sont plutôt administrées et appliquées au moyen de mécanismes de plainte distincts.
Dans le présent chapitre, nous examinons d’abord les mécanismes de plainte utilisés au niveau national. Ces mécanismes ont été créés pour mettre en œuvre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et d’autres politiques relatives au sport sécuritaire applicables au niveau national. Cela inclut :
- Le programme Sport Sans Abus, par l’intermédiaire duquel le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a administré le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport jusqu’au 1er août 2025.
- Le Programme canadien de sport sécuritaire, par l’intermédiaire duquel le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administre actuellement le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport pour les organismes de sport de niveau national financés par le gouvernement fédéral.
- Les mécanismes établis par des tiers indépendants, engagés par les organismes de sport de niveau national pour administrer les plaintes qui, au sein de leur organisme, concernent le sport sécuritaire et qui ne relèvent ni de l’ancien programme Sport Sans Abus ni du Programme canadien de sport sécuritaire.
Ensuite, nous examinons les mécanismes de plainte existant au niveau provincial et territorial, y compris les mécanismes de plainte centralisés établis par les gouvernements provinciaux et territoriaux et les mécanismes établis par des tiers indépendants directement engagés par les organismes de sport provinciaux ou territoriaux. Nous examinons également les mécanismes de plainte qui sont utilisés au niveau local et communautaire et les différents obstacles qui entravent le signalement de la maltraitance dans le sport. Nous partageons également les perspectives des participants sur les différents sujets abordés.
Nous concluons ce chapitre avec nos conclusions préliminaires et nos recommandations sur (i) les politiques et les mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire et (ii) les processus et procédures de traitement des plaintes.
La voie vers un mécanisme de plainte indépendant au niveau national
Le consensus pour développer ce qui allait devenir le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport a émergé lors du Sommet national sur la sécurité dans le sport, tenu en 2019. Lors de ce sommet, les participants ont également convenu qu’un organisme indépendant devrait être désigné pour mettre en œuvre un tel codeNote de bas de page 1.
Plus tard, alors que l’élaboration du Code de conduite universel approchait sa phase finale, un groupe dirigeant a été constitué pour créer une structure permettant sa mise en œuvre. Ce groupe a pris la forme d’un partenariat informel composé d’athlètes et de représentants d’organismes nationaux de sport, d’organismes de services multisports, du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada et d’expertsNote de bas de page 2.
En juin 2020, le groupe dirigeant, avec le soutien du Centre de documentation pour le sport, a engagé un contractant privé. Ce contractant a été chargé d’analyser de manière indépendante les modèles de mécanismes de plainte existants. Son objectif était d’identifier le mécanisme le plus approprié et le plus efficace pour administrer de manière indépendante le Code de conduite universel auprès des organismes de sport financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 3. La société McLaren Global Sport Solutions Inc. a été choisie pour mener à bien cette analyse, élaborer des recommandations et produire un rapport final pour le groupe dirigeantNote de bas de page 4.
Le rapport final, préparé par McLaren Global Sport Solutions Inc. et intitulé « Viser haut : Approches indépendantes pour administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au Canada » a été publié le 5 octobre 2020Note de bas de page 5.
Au total, le rapport « Viser haut » comprend 101 recommandations qui traitent d’une variété de sujets, depuis la structure organisationnelle du mécanisme indépendant jusqu’à ses procédures et son financement. Un tableau des recommandations du rapport « Viser haut » est présenté à l’annexe 6.
Le rapport « Viser haut » a éventuellement conduit à la création du programme Sport Sans Abus.
Le programme Sport Sans Abus : création, mise en œuvre et fonctionnement
En novembre 2020, le gouvernement du Canada a officiellement lancé une initiative visant la création d’un mécanisme indépendant chargé d’administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 6.
En juillet 2021, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (ou « CRDSC ») a été choisi pour mettre en place et administrer ce nouveau mécanisme indépendant pour les organismes de sport financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 7.
Le 17 mai 2022, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada a annoncé que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (ou « BCIS ») verrait le jour en juin 2022 et recevrait, dans le cadre du nouveau programme Sport Sans Abus, les plaintes relatives aux violations du Code de conduite universel Note de bas de page 8.
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport est officiellement entré en fonction trois mois plus tard, soit le 20 juin 2022.
Comme nous le verrons plus en détail dans ce chapitre, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a finalement transféré ses activités au Centre canadien pour l’éthique dans le sport le 1er avril 2025 et a entièrement cessé ses activités le 1er août 2025.
La présente section commence par une présentation du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, en mettant l’accent sur son mandat et sa structure. Nous examinons ensuite la portée du programme Sport Sans Abus, son processus de traitement des plaintes et ses évaluations du milieu sportif.
Rôle et structure du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada est une société à but non lucratif créée en 2003 en vertu de la Loi sur l’activité physique et le sportNote de bas de page 9. Son mandat législatif est de fournir à la communauté sportive un service national alternatif de règlement des différends sportifs, en dehors des systèmes judiciaires traditionnels. Il fournit également une expertise et une assistance quant aux méthodes alternatives de règlement des différendsNote de bas de page 10.
Avant la création du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada offrait déjà deux services de base en vertu de la Loi sur l’activité physique et le sport.
Le Centre offre toujours ces services, soit le Secrétariat de règlement des différends et le Centre de ressources pour la prévention des différends.
Figure I : Structure du Secrétariat de règlement des différends (avant le 1er août 2025, date de la fermeture du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport)
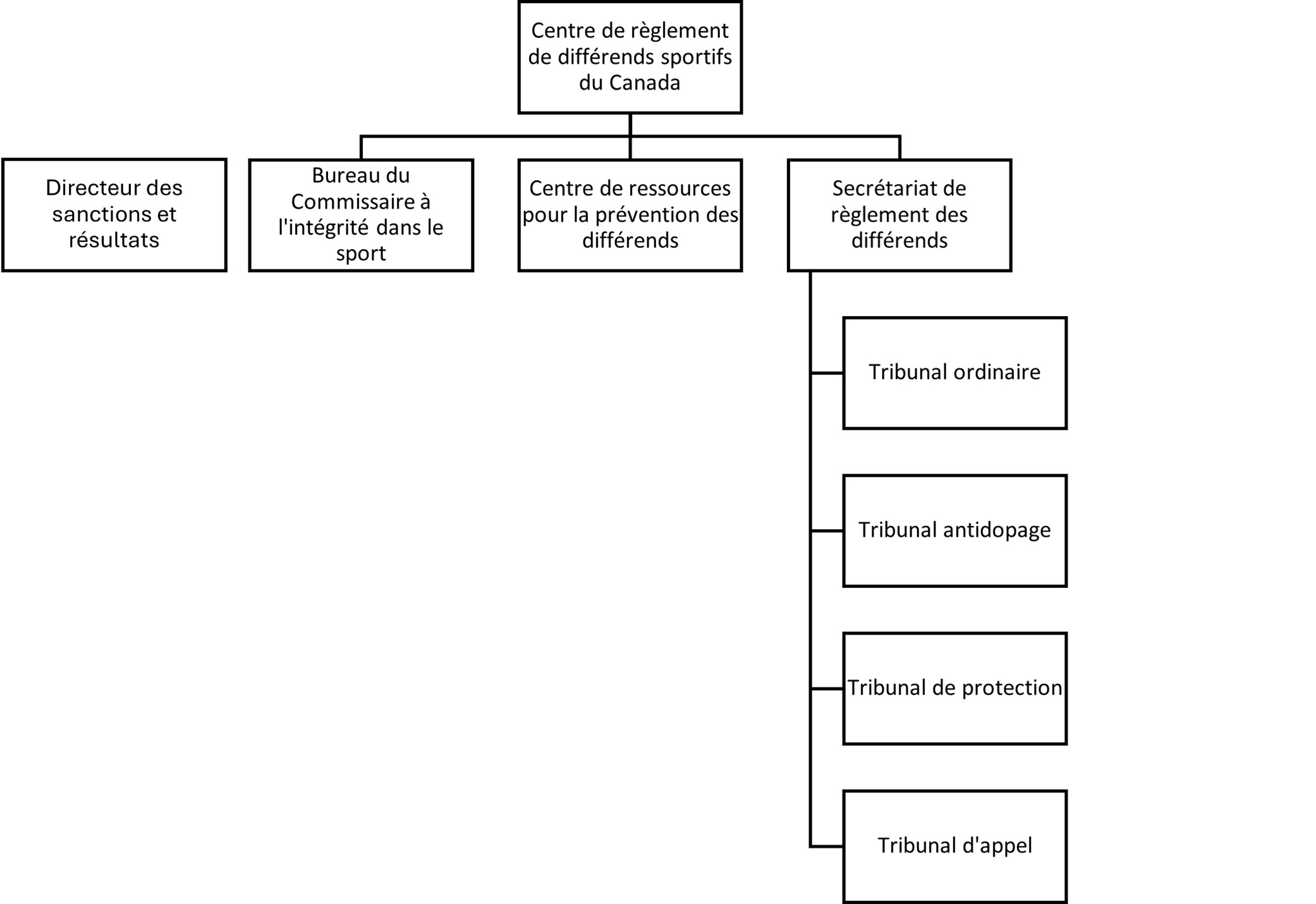
Figure I : Structure du Secrétariat de règlement des différends – Version textuelle
Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada comprend quatre composantes principales : le Secrétariat de règlement des différends, le Centre de ressources pour la prévention des différends, le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport et le Directeur des sanctions et résultats. Le Secrétariat de règlement des différends offre ses services par l'entremise de quatre divisions : le Tribunal ordinaire, le Tribunal antidopage, le Tribunal de protection et le Tribunal d'appel.
Secrétariat de règlement des différends
Le Secrétariat de règlement des différends offre des services alternatifs de règlement des différends à la communauté sportive. Ces services comprennent la facilitation, la médiation, la médiation-arbitrage et l’arbitrage.a
Le Secrétariat compte quatre divisions : le Tribunal ordinaire, le Tribunal antidopage, le Tribunal de protection et le Tribunal d’appelNote de bas de page 11.
- Tribunal ordinaire : Le Tribunal ordinaire sert de mécanisme d’appel final pour les décisions relatives au sport prises par les organismes qui disposent de leurs propres procédures d’appel internes. La plupart des affaires entendues par le Tribunal ordinaire concernent la sélection des équipes et les brevets des athlètes, mais il traite également des différends relatifs à l’admissibilité, à la discipline générale et à la gouvernance.
- Tribunal antidopage : Le Tribunal antidopage est une division spécialisée. Il s’agit de la première instance à statuer sur les violations des règles antidopage signalées par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dans le cadre du Programme canadien antidopage.
- Tribunal de protection : Le Tribunal de protection a été créé pour réviser les décisions rendues par le Directeur des sanctions et résultats dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Depuis avril 2025, il peut également réviser les décisions prises par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire.
- Tribunal d’appel : Le Tribunal d’appel entend les appels du Tribunal antidopage et du Tribunal de protection.
Le Code canadien de règlement des différends sportifs énonce les règles de procédure qui s’appliquent à tous les différends soumis au Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 12.
Centre de ressources pour la prévention des différends
Le Centre de ressources pour la prévention des différends se concentre sur la prévention des différends, l’éducation, la sensibilisation et le soutien à l’élaboration de politiques. Il offre une grande variété d’informations, d’outils et de documents pour aider chaque membre de la communauté sportive à prévenir les différends ou à en minimiser la gravité.Note de bas de page 13
Le Centre offre notamment :
- des modèles de contrats et de politiques, comme des modèles de médiation et des modèles de clauses contractuelles d’arbitrageNote de bas de page 14
- une base de données regroupant les décisions rendues par les arbitres du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 15
- Des articles et d’autres types de publicationsNote de bas de page 16
- une liste d’avocats et de ressources pro bonoNote de bas de page 17
Compétences du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et portée du programme Sport Sans Abus
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, qui a cessé ses activités le 1eraoût 2025, était un organe indépendant hébergé au sein du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. D’après ce que nous avons entendu, des mesures structurelles avaient été mises en place pour préserver l’indépendance du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et du Directeur des sanctions et résultatsNote de bas de page 18.
D’une manière générale, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport était habilité à administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport envers les organismes sportifs signataires du programme Sport Sans AbusNote de bas de page 19.
Entente de signataire du programme
Pour devenir un signataire du programme, un organisme de sport devait signer un contrat, appelé « Entente du signataire », avec le Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 20. En signant cette entente, l’organisme de sport retenait les services du Centre de règlement des différends sportifs du Canada pour mettre en œuvre son programme de sport sécuritaire. Ces services incluaient ceux du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, ceux du Directeur des sanctions et résultats et ceux du Secrétariat de règlement des différendsNote de bas de page 21.
En vertu de l’Entente de signataire, l’organisme de sport devait notamment faire ce qui suit :
- Adopter le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et veiller à ce que toutes les autres politiques et procédures internes soient conformes à ce Code.
- Obtenir le consentement des personnes affiliées au signataire du programme afin qu’elles soient assujetties au Code de conduite universel et à ses processus d’administration et d’application.
- Coopérer de bonne foi avec le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport pour tout processus lié à l’administration et l’application du Code de conduite universel.
- Appliquer les sanctions et les mesures imposées par le Directeur des sanctions et résultats, le Tribunal de protection et le Tribunal d’appelNote de bas de page 22.
Bien que les organismes sportifs de tous les niveaux pouvaient adhérer au programme Sport Sans Abus, la plupart des signataires du programme étaient des organismes nationaux de sport et des organismes de services multisports financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 23. Ces organismes devaient être des signataires du programme pour recevoir un financement du gouvernement du Canada.
Volleyball était le seul sport pour lequel le programme Sport Sans Abus s’appliquait à tous les niveaux, à savoir aux niveaux national, provincial, territorial et à celui des clubsNote de bas de page 24.
Nous comprenons du communiqué de presse publié à la suite de la Conférence de 2022 des ministres responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs des gouvernements fédéralNote de bas de page 25, provinciaux et territoriaux, que les provinces et territoires pouvaient choisir d'utiliser le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport à titre de tiers indépendant. Nous notons également que la Nouvelle-Écosse a été la première et la seule province à être une signataire du programme Sport Sans AbusNote de bas de page 26. Le premier organisme provincial de sport de Nouvelle-Écosse devait être intégré au programme avant la fin de l’année 2023Note de bas de page 27. À l’époque, il y avait un espoir que cela encourage d’autres provinces et territoires à adhérer au programme. Toutefois, cet espoir ne s’est jamais concrétisé puisqu’aucune autre province ni aucun territoire n’y a adhéréNote de bas de page 28.
En mars 2025, 90 organisations avaient adhéré au programme Sport Sans Abus :
- 63 organismes de sport de niveau national
- 21 organismes de services multisports
- 6 instituts et centres canadiens du sportNote de bas de page 29
Formulaire de consentement
Comme indiqué ci-dessus, tous les signataires du programme devaient obtenir le consentement des participants pour s’assurer qu’ils acceptent d’être assujettis à l’autorité du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Ce consentement devait être obtenu au moyen d’un formulaire de consentementNote de bas de page 30.
Selon l’Entente conclue par chaque signataire du consentement, les participants pouvaient être des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles, des administrateurs, des directeurs, des employés, des formateurs, des parents et des tuteursNote de bas de page 31. Pour les jeunes de moins de 13 ans, le formulaire de consentement devait être signé par un parent ou un tuteur.
En remplissant le formulaire de consentement, les participants acceptaient notamment:
- D’être assujettis au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.
- D’être assujettis à la l'autorité du signataire du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada en ce qui concerne l’administration et l’application du Code de conduite universel.
- Que le signataire du programme et le Centre de règlement des différends sportifs du Canada puissent recueillir, utiliser et divulguer leurs renseignements personnels afin de recevoir, traiter et régler les plaintes recevables déposées contre eux.
- Que la divulgation de certains de leurs renseignements personnels soient divulgués au moyen d’un registre public créé pour soutenir les objectifs du Code de conduite universel. Ces renseignements comprennent le nom complet, le nom des organismes auxquels ils sont affiliés, ainsi que la nature des allégations et de toute conclusion ou mesure disciplinaire imposée à leur encontreNote de bas de page 32.
Processus de traitement des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus
Le programme Sport Sans Abus a permis d’administrer et d’appliquer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, et ce, conformément aux procédures définies dans les politiques publiées sur le site Internet de Sport Sans Abus.
En bref, le processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus peut être résumé ainsi :
- Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport devait d’abord examiner les plaintes et s’assurer qu’elles relevaient de la compétence du programme Sport Sans Abus.
- Ensuite, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport procédait à une médiation (si les parties y consentaient) et à une enquête.
- Une fois l’enquête terminée, la plainte était transmise au Directeur des sanctions et résultats. Il déterminait alors s’il y avait eu des violations du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, puis imposait les sanctions.
- La décision rendue par le Directeur des sanctions et résultats pouvait être réexaminée par le Tribunal de protection du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Un autre recours était ensuite possible auprès du Tribunal d’appel.
Un résumé détaillé du processus de traitement des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus est présenté à l'annexe 7. Un organigramme illustrant le processus des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus est également accessible sur le site Web du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 33.
Évaluations du milieu sportif
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport réalisait des évaluations du milieu sportif pour les signataires du programme. Ces évaluations étaient conformes aux « Lignes directrices concernant les évaluations du milieu sportif »Note de bas de page 34.
Ces évaluations visaient à identifier et à traiter les enjeux systémiques liés au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. L’objectif principal était d’améliorer les milieux sportifs au bénéfice des participants actuels et futursNote de bas de page 35.
Les évaluations du milieu sportif identifiaient des problèmes systémiques et des solutions pour y remédier. Ces évaluations visaient à comprendre les problèmes et leurs causes profondes, puis à explorer les différentes solutions. Chaque évaluation était rendue publique et publiée dans un rapport du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport.
Les rapports des évaluations du milieu sportif étaient complets et comprenaient, entre autres, les éléments suivants:
- Une analyse des informations recueillies et des préoccupations soulevées à propos du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.
- L’identification de tout enjeu de nature systémique ou tout autre enjeu.
- Des recommandations pour résoudre les enjeux identifiés.
- Des recommandations pour améliorer l’expérience des participants actuels et futurs.
- D’autres observations et recommandations qui soutiennent les objectifs de l’évaluationNote de bas de page 36.
Les individus et les organismes sportifs avaient la possibilité de demander une évaluation du milieu sportif s’ils souhaitaient cerner, dans un environnement sportif particulier, des enjeux systémiques liés au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport pouvait également lancer une évaluation de sa propre initiative s’il prenait connaissance d’allégations concernant des enjeux systémiques liés au Code de conduite universel dans un environnement sportif spécifiqueNote de bas de page 37.
Le processus d’évaluation du milieu sportif comprenait généralement les étapes suivantes :
- Une évaluation du milieu sportif était soit demandée au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport ou lancée de sa propre initiative.
- Dans le cas où une demande était acceptée, la portée de l’évaluation, y compris ses objectifs et son calendrier, était définie.
- Un évaluateur indépendant ou une équipe d’évaluation procédait ensuite à l’évaluation et rédigeait un rapport.
- Le rapport achevé était communiqué à l’organisme sportif concerné et publié sur le site Web du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport.
- Enfin, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport supervisait la mise en œuvre des recommandations par l’organisme sportif concerné et publiait un rapport de suivi sur son site Web. Ce rapport de suivi devait être publié au plus tard un an après la publication du rapport d’évaluationNote de bas de page 38.
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport tenait également à jour son index des évaluations du milieu sportif. Cet index fournissait des informations sur les évaluations que le Bureau avait entreprises. Au fur et à mesure que les évaluations avançaient, selon le processus d’évaluation du milieu sportif, des mises à jour générales étaient publiées dans l’indexNote de bas de page 39.
Approche tenant compte des traumatismes
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport s’est engagé à administrer le programme Sport Sans Abus en tenant compte des traumatismesNote de bas de page 40.
Selon le Bureau, un processus tenant compte des traumatismes « [reflète] une compréhension de l’impact des traumatismes sur les personnes sur le plan psychologique, émotionnel et physique, et [vise] à prévenir un nouveau traumatisme grâce à des pratiques sécuritaires et respectueuses »Note de bas de page 41. De tels processus ont également été décrits comme étant « empathiques, efficaces et [offr[a]nt] justice, respect et équité à toutes les parties concernées » Note de bas de page 42.
Dans ce contexte, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a mis en place le Programme d’aide juridique Sport Sans Abus. Ce programme permettrait aux personnes admissibles qu’elles soient plaignantes ou qu’elles fassent l’objet d’une plainte, de bénéficier d’un accès gratuit et confidentiel à des avocats spécialisésNote de bas de page 43. Ceux-ci pouvaient leur fournir des conseils à chaque étape du processus de traitement des plaintes, de la réception jusqu‘à l’appel final. Ils pouvaient également offrir leur aide pour la première étape du processus d’évaluation du milieu sportif.
Le Programme canadien de sport sécuritaire : création, mise en œuvre et fonctionnement
Le 2 mai 2024, le gouvernement du Canada a annoncé que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport cesserait d’administrer le programme Sport Sans AbusNote de bas de page 44. C’est alors le Centre canadien pour l’éthique dans le sport qui assumerait la responsabilité du mécanisme indépendant chargé de mettre en œuvre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.
La raison invoquée pour ce changement était la préservation de l’indépendance du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, qui hébergeait le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 45.
À cet égard, c’est le 1er avril 2025 que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a commencé à administrer le Code de conduite universel dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire. Par conséquent, le 1er août 2025, après une période de transition, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a cessé de gérer le programme Sport Sans Abus.
Cette section commence par une description du mandat et de la structure du Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Nous expliquons ensuite la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire, ainsi que les changements apportés au Centre afin qu’il puisse prendre en charge l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Nous poursuivons avec une description de la portée du Programme canadien de sport sécuritaire et de son processus de signalement.
Un tableau comparatif des principales caractéristiques du programme Sport Sans Abus et du Programme canadien de sport sécuritaire est présenté à l'annexe 8.
Rôle et structure du Centre canadien pour l’éthique dans le sport
Rôle
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (ou « CCES ») est un organisme national de services multisports indépendant constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page 46. Son mandat est d’« adopter une approche collaborative pour adresser les comportements contraires à l’éthique et promouvoir une approche axée sur des valeurs, de sorte que tous vivent une expérience sportive positive »Note de bas de page 47.
Depuis le 1er avril 2025, le Centre est responsable du Programme canadien de sport sécuritaire. Dans le cadre de ce programme, le Centre administre et applique de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport auprès des organismes nationaux de sport et de services multisports financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 48.
En plus du sport sécuritaire, les domaines d’activité du Centre canadien pour l’éthique dans le sport sont la lutte contre le dopage et la manipulation de compétitions. En ce qui concerne la lutte contre le dopage, le Centre est chargé de lutter contre l’usage de « substances interdites et de méthodes interdites » par la dissuasion et la détection. Cet objectif est poursuivi dans le cadre du Programme canadien antidopageNote de bas de page 49, une initiative nationale visant « à prévenir, à dissuader et à détecter le dopage dans le sport » Note de bas de page 50.
En ce qui concerne la manipulation de compétitions, le rôle principal du Centre canadien pour l’éthique dans le sport est d’éduquer le public et de défendre l’intégrité du sportNote de bas de page 51.
Gouvernance et structure organisationnelle
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est dirigé par un conseil d’administration totalement indépendant. Ce conseil est composé de douze personnalités éminentes issues de divers domaines, dont le sport canadien et international, la médecine, le milieu universitaire, les affaires, le droit, l’éthique et l’administrationNote de bas de page 52.
Les membres du conseil d’administration sont sélectionnés et élus par les membres du conseil d’administration qui sont déjà en posteNote de bas de page 53. Ils sont sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leur expertise, plutôt qu’en fonction de leur affiliation à des organismes sportifs spécifiques. Cela assure une administration diversifiée et compétente. Ces personnes offrent bénévolement leur temps et leur expertise pour soutenir la mission du CentreNote de bas de page 54.
Les membres du conseil d’administration du Centre canadien pour l’éthique dans le sport en sont également les membresNote de bas de page 55. Le Centre compte actuellement 12 administrateursNote de bas de page 56. Conformément au règlement administratif du Centre, l’un de ces membres doit être un athlète d’élite à la retraiteNote de bas de page 57.
Les responsabilités du conseil d’administration comprennent la supervision stratégique, la gestion des finances, l’élaboration de politiques et la conformité aux normes internationales et nationales. Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dispose aussi d’une série de groupes de travail et de comités qui se concentrent sur des aspects précis de l’administration, comme les finances, la gestion des risques et l’éthiqueNote de bas de page 58.
Le Centre fonctionne selon un plan stratégique pluriannuel qui oriente ses priorités et ses objectifs. Le dernier plan a été publié en 2022. Puisque le Centre assume désormais la responsabilité d’administrer le Programme canadien de sport sécuritaire, il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau plan stratégiqueNote de bas de page 59.
Le président et directeur général, nommé par le conseil d’administration, est responsable de la mise en œuvre des plans stratégiques et des politiques de l’organisationNote de bas de page 60. Les directeurs généraux, qui relèvent du président et directeur général, dirigent les services axés sur différents aspects du travail du Centre.
Annonce de la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire
Le 2 mai 2024, la ministre du Sport et de l’Activité physique du Canada a annoncé que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administrerait le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport à partir du 1er avril 2025Note de bas de page 61.
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a été choisi pour administrer le Programme canadien de sport sécuritaire et son mécanisme de plainte, et ce, afin de préserver l’indépendance du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (qui hébergeait le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport)Note de bas de page 62.
Pendant la première phase de la transition, soit du 1er février 2025 au 31 mars 2025, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a continué d’accepter les plaintes de maltraitance dans le cadre du programme Sport Sans Abus, mais n’a ouvert aucune nouvelle enquête. Ces plaintes ont été examinées et des mesures provisoires ont été prises lorsque nécessaire. Les plaintes ne nécessitant aucune action immédiate ont été mises en attente jusqu’au 1er avril 2025.
Le 1er avril 2025, le Programme canadien de sport sécuritaire a été lancé et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a commencé à traiter les signalements de maltraitance et à offrir des services de soutien. À ce moment, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a cessé d’accepter de nouvelles plaintes, bien qu’il ait eu la possibilité de finaliser les dossiers reçus avant le 1er février 2025Note de bas de page 63. Les plaintes qui avaient été mises en attente pendant la période de transition ont été transmises au Centre canadien pour l’éthique dans le sport, sous réserve que les parties y consentent et que les plaintes répondent aux critères du nouveau Programme canadien de sport sécuritaire.
Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a fermé ses portes le 1er août 2025. Si des dossiers qu’il traitait n’étaient pas résolus à cette date, les parties étaient informées que leur dossier ne pouvait être résolu dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Avec le consentement des parties, ces dossiers ont été transférés au Centre canadien pour l’éthique dans le sport, qui a déterminé leur admissibilité au Programme canadien de sport sécuritaire.
Changements apportés au Centre canadien pour l’éthique dans le sport afin de prendre en charge l’administration du Code de conduite universel
Afin de se préparer à remplir son nouveau rôle en matière de sport sécuritaire, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a modifié sa gouvernance, sa structure organisationnelle et son orientation stratégique.
En ce qui concerne la gouvernance, le Centre a ajouté deux nouveaux membres à son conseil d’administration. Ces personnes possèdent une expertise dans des domaines clés du sport sécuritaire et de l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 64.
Le 31 janvier 2025, le conseil d’administration a également approuvé la Résolution sur l’indépendance, formalisant ainsi l'indépendance du Centre par rapport aux personnes et aux organismes qu’il encadreNote de bas de page 65. Les principes clés de cette résolution sont les suivants :
- Bien qu’il collabore avec de nombreux organismes nationaux de sport, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport insiste sur le fait que ces organismes n’ont strictement aucun pouvoir de décision ni d’influence sur ses politiques.
- Le Centre ne cautionne, ne certifie, ni ne parraine aucun organisme sportif ou les participants.
- Le gouvernement du Canada n’est pas impliqué dans la sélection ou l’élection des membres du conseil d’administration du Centre et n’a aucun pouvoir sur la façon dont celui-ci met en œuvre le Programme canadien antidopage, le Programme canadien de sport sécuritaire et le Programme canadien pour la prévention de la manipulation de compétitions.
- Les membres du conseil d’administration doivent se conformer à une politique en matière de conflits d’intérêts. Ils sont sélectionnés et élus par les membres du conseil d’administration qui sont déjà en poste.
En ce qui concerne les changements apportés à sa structure organisationnelle, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a également accueilli une nouvelle personne à la direction générale, Sport sécuritaire. Cette personne est chargée de superviser l’administration du Programme canadien de sport sécuritaire. Il a été annoncé publiquement que l’organisation avait recruté une équipe ayant une expérience en matière de maltraitance et une expérience de travail de première ligne au sein d’un mécanisme de signalement Note de bas de page 66.
En ce qui concerne sa programmation, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a revu sa stratégie organisationnelle afin de se concentrer sur les enjeux d’intégrité liés au sport sécuritaire, la lutte contre le dopage et la manipulation de compétitionsNote de bas de page 67. Comme mentionné précédemment, le Centre a également mis fin à son implication avec la marque Sport pur, invoquant la nécessité de se concentrer sur son mandat de régulateur indépendant pour l’intégrité dans le sportNote de bas de page 68.
À cet égard, nous avons été informés que le Centre a engagé un dialogue avec les personnes victimes ou survivantes, les athlètes et l’ensemble de la communauté sportive lorsqu’il a été désigné comme le nouvel administrateur national du sport sécuritaire. Ces échanges ont révélé une perception de partialité ou de conflit d’intérêts liée au fait que le Centre était à la fois responsable du programme Sport pur et de l’administration des signalements relatifs au sport sécuritaire.
Compétence du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et portée du Programme canadien de sport sécuritaire
Comme abordé au chapitre 5, pour recevoir un financement de Sport Canada par l'entremise du Programme de soutien au sport, les organismes nationaux de sport, les organismes nationaux de services multisports ainsi que les centres et instituts canadiens de sport doivent respecter certaines conditions obligatoires. Ces conditions, qui sont incluses dans l'accord de financement de chaque organisme sportif, prévoient notamment l'adoption du Programme canadien de sport sécuritaireNote de bas de page 69.
Par l’intermédiaire du Programme canadien de sport sécuritaire, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administre et applique de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 70. Pour ce faire, il reçoit les signalements de comportements prohibés et y répondNote de bas de page 71.
Le pouvoir du Centre canadien pour l’éthique dans le sport d’administrer le Programme canadien de sport sécuritaire est fondé sur un contrat, tout comme l’était antérieurement le pouvoir du Centre de règlement des différends sportifs du Canada d’administrer le programme Sport sans abus.
Plus précisément, ce programme s’applique aux organismes sportifs qui y adhèrent au moyen d’une entente appelée « contrat d’adoption »Note de bas de page 72. Le programme est réservé aux organismes nationaux de sport, aux organismes nationaux de services multisports ainsi qu’aux centres et instituts canadiens de sport qui reçoivent un financement de Sport CanadaNote de bas de page 73. Selon le cadre actuel du programme, les organismes provinciaux et territoriaux de sport ne peuvent pas décider de l’adopter volontairement.
La liste des organismes sportifs qui ont adopté le Programme canadien de sport sécuritaire est présentée à l’annexe 9.
Il est important de noter que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport adopte une approche par étape pour mettre en œuvre le Programme canadien de sport sécuritaire. Le Centre prévoit d’élargir la portée et l’étendue du programme au fur et à mesure qu’il gagnera en expérience et stabilisera son financement.
Le Programme canadien de sport sécuritaire s’applique aux participants de niveau national au sein des organismes qui adoptent le programme. La liste des personnes appartenant à cette catégorie figure à l’article 3.1 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Il s’agit des personnes suivantes :
- Les membres des conseils d’administration et du personnel des organismes de sport de niveau national qui sont financés par le gouvernement fédéral et qui ont adhéré au Programme canadien de sport sécuritaire (appelés les « organismes de sport »).
- Tout athlète qui bénéficie d’un financement du Programme d’aide aux athlètes, qui fait partie du programme de l’équipe nationale d’un organisme de sport ou qui fait autrement partie du groupe national d’athlètes d’un organisme de sport.
- Tout membre du personnel d’encadrement des athlètes relevant de l’autorité d’un organisme de sport et qui participe directement ou offre des services au programme de l’équipe nationale de cet organisme. Cela comprend les entraîneurs, les formateurs, les agents, le personnel de l’équipe et le personnel médical et paramédical.
- Toute autre personne qui concourt, participe ou s’implique autrement dans un sport sous l’autorité d’un organisme de sport qui a adopté le Programme canadien de sport sécuritaire et a été autorisé par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport à la considérer comme « participant » aux termes du Programme canadien de sport sécuritaire.
- Tout officiel, juge, ou arbitre canadien qui est accrédité par un organisme de sport, tel que désigné par chaque organisme de sport et autorisé par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, et participe à une compétition internationale ou nationale tenue sous l’autorité d’un organisme national de sport ou régie par les règles d’un tel organismeNote de bas de page 74.
De plus, les organismes qui adoptent le programme peuvent désigner certains évènements au niveau national où tous les participants sont assujettis au Programme canadien de sport sécuritaire et au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Dans ce cas, le Programme canadien de sport sécuritaire s’applique uniquement pour la durée où l’individu participe à l’évènement désigné.
La situation ci-dessus est décrite en détail à l’article 3.2 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Ainsi, il est prévu que les Règlements peuvent s’appliquer à d’autres personnes (qui ne sont pas déjà identifiées comme participants en vertu de l’article 3.1) lorsqu’elles participent à certains évènements reconnus par chaque organisme de sport. Dans ces cas, pour être autorisées à participer, ces personnes doivent accepter ou autrement consentir, dans le cadre de la procédure d’inscription à l’évènement, à l’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et du Programme canadien de sport sécuritaire.
Les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire prévoient spécifiquement que les personnes impliquées dans les organismes qui ont adopté le programme ou celles qui participent à un évènement spécifique doivent signer un formulaire de consentement. Notons également que dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire, les participants sont tenus de suivre le module d’apprentissage en ligne sur le sport sécuritaire, offert par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, avant de signer le formulaire de consentementNote de bas de page 75.
Processus de signalement dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire
Le processus de signalement du Programme canadien de sport sécuritaire est défini dans ses RèglementsNote de bas de page 76. Les Règlements donnent au Centre canadien pour l’éthique dans le sport le pouvoir de déterminer si un participant a eu un comportement qui est contraire aux Règlements du Programme ou qui est prohibé en vertu du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Lorsqu’une telle décision est prise, le Centre peut imposer des sanctions conformément au cadre établi dans le Code de conduite universel.
Les Règlements du Programme couvrent toutes les étapes du processus de signalement, de la réception d’un signalement de comportement prohibé jusqu’à l’enquête, en passant par la détermination du bien-fondé du signalement et la révision ou l’appel d’une décision prise par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
Le processus de signalement dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire se déroule comme suit :
- Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est chargé de recevoir les signalements de comportements allégués qui sont prohibés par le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 77.
- Toute personne ou tout organisme sportif peut signaler un comportement prohibé (c’est-à-dire faire un « signalement ») sur la plateforme de signalement du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, accessible en ligne ou par téléphoneNote de bas de page 78.
- À tout moment après avoir reçu un signalement, le Centre a le pouvoir d’imposer des mesures provisoiresNote de bas de page 79. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à modifier des horaires ou des lieux d’entraînement, ou à déplacer des individus pour éviter des contacts.
- Le Centre envoie un avis écrit (un « avis de signalement ») à la personne intimée, l’informant qu’un signalement a été fait à son endroit. Le Centre avisera également l’organisme de sport concerné du signalementNote de bas de page 80.
- Dans les 30 jours suivant la remise de l’avis de signalement à la personne intimée, le Centre entame une ou plusieurs méthodes de résolution prévues à l’article 13 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Ces méthodes comprennent des avis de préoccupation, une résolution corrective, l’acceptation de la violation et de la sanction, une médiation réalisée par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada et une résolution officielleNote de bas de page 81.
- À tout moment après avoir pris connaissance du rapport, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport nomme une personne chargée de l’enquête sur le comportement signaléNote de bas de page 82.
- La personne chargée de l’enquête remet un rapport d’enquête au Centre. Ce rapport résume les preuves pertinentes et les conclusions sur les faits et la crédibilité des preuves relevés durant l’enquête, de même que les motifs à l’appui de ces conclusionsNote de bas de page 83.
- Le Centre fournit une copie du rapport d’enquête à la personne qui a fait le signalement et/ou à la personne touchée, de même qu’à la personne intimée. Toutes les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception du rapport pour présenter des observations écrites au CentreNote de bas de page 84.
- Après avoir reçu toutes les observations écrites, le Centre détermine si une infraction a été commiseNote de bas de page 85. Si c’est le cas, le Centre impose les sanctions appropriéesNote de bas de page 86.
- Le Centre impose des sanctions aux personnes intimées, conformément à l’article 15 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Cette disposition prévoit que les sanctions doivent être conformes à celles énoncées dans le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 87.
- Le Centre avise de sa décision la personne qui a fait le signalement et/ou la personne touchée, de même que la personne intimée et le ou les organismes sportifs concernés. Cet avis, appelé « avis de décision », comprend les motifs qui appuient la décision.
- Certaines décisions du Centre canadien pour l’éthique dans le sport peuvent faire l’objet d’une révision par le Tribunal de protection, une division spécialisée du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 88.
- S’ils participent à l’audience de révision devant le Tribunal de protection, la personne intimée, la personne qui a fait le signalement et/ou la personne touchée, ainsi que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, peuvent faire appel d’une décision du Tribunal de protection relative à une sanction. Cet appel serait porté devant le Tribunal d’appel du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 89.
Enfin, en vertu des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire, les organismes de sport sont responsables de l’application des sanctions. Ces sanctions sont imposées par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport ou par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, s’il s’agit de la révision ou l’appel d’une décisionNote de bas de page 90.
Un organigramme illustrant le processus de signalement suivi dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire est présenté sur le site Web du Centre canadien pour l’éthique dans le sportNote de bas de page 91.
Évaluations du milieu sportif
Les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire prévoient des évaluations du milieu sportifNote de bas de page 92. Bien qu’il soit possible que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport offre éventuellement ce service, nous comprenons que ce n’est pas le cas pour le moment.
Approche tenant compte des traumatismes
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport s’engage à administrer le Programme canadien de sport sécuritaire de manière à tenir compte des traumatismes. Cet engagement est explicitement énoncé dans les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire Note de bas de page 93.
Le Centre définit les pratiques sensibles aux traumatismes comme un « cadre axé sur les forces et tourné vers la personne […] [qui] repose sur une compréhension de l’impact des traumatismes sur la personne et une sensibilité à cet égard » Note de bas de page 94. Ces pratiques « [mettent] l’accent sur la sécurité physique, psychologique et émotionnelle de toutes les personnes qui interagissent avec le programme ou qui y travaillent »Note de bas de page 95.
À cet égard, des services de soutien sont offerts par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Une équipe de soutien peut, par exemple, répondre à des questions sur le Programme canadien de sport sécuritaire et donner des renseignements sur le processus de signalementNote de bas de page 96.
Par ailleurs, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport semble avoir engagé le Centre canadien de la santé mentale et du sport pour fournir des services de santé mentale aux personnes qui adhèrent au programmeNote de bas de page 97.
Toutefois, selon son site Web, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport n’offre actuellement pas d’aide juridique. Le site Web indique que Sport Canada est en train d’étudier différentes options pour offrir des services d’aide juridique aux personnes impliquées dans le processus de signalement du Programme canadien de sport sécuritaireNote de bas de page 98.
Perspectives des participants sur le programme Sport Sans Abus et le Programme canadien de sport sécuritaire
Avant d’examiner les perspectives des participants, la Commission tient à rappeler que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et le programme Sport Sans Abus ont été créés et devaient être pleinement opérationnels dans un délai extrêmement court. Nous comprenons que ce calendrier très serré était nécessaire en raison du besoin urgent qu’un mécanisme de plainte indépendant soit mis sur pied dans un contexte de crise liée au sport sécuritaire.
Plusieurs personnes nous ont informés qu’à moins d’un mois du lancement officiel du programme Sport Sans Abus, aucune politique ni procédure n’avait encore été mise en place. La révision du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport n’avait alors pas été finalisée, et le programme manquait d’installations et de financement. Dans l’ensemble, plusieurs participants ont comparé le déploiement du programme Sport Sans Abus au fait de « construire un avion en plein vol ».
Moins de 3 mois après sa création, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a démarré ses activités. Il a dû assumer son vaste mandat, qui comprenait la réception de plaintes d’infraction au Code de conduite universel, le lancement d’évaluations du milieu sportif et l'offre de formations, d’outils de prévention, de ressources et d’autres services comme de l’aide en santé mentale et de l’aide juridiqueNote de bas de page 99.
La Commission reconnaît que la création du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et du Programme Sport Sans Abus, en si peu de temps et, avec un soutien insuffisant, a nécessité des efforts herculéens.
Il est également important de noter que McLaren Global Sport Solutions Inc., dans son rapport intitulé « Viser haut : Approches indépendantes pour l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au Canada », a recommandé l’introduction par étapes d’un mécanisme de plainte sur une période de trois ansNote de bas de page 100. Selon cette recommandation, entre autres éléments, le mécanisme de plainte aurait progressivement intégré les organismes sportifs, en commençant par 12 organismes nationaux de sport et 2 fédérations provinciales d‘organismes sportifs, comme Sport Manitoba et Sask Sport. D’autres organismes auraient été ajoutés au cours des années suivant le programme piloteNote de bas de page 101.
La création d’un mécanisme de plainte d’une telle ampleur justifiait la recommandation d’une approche par étape. Sans une planification adéquate, le mécanisme pourrait être submergé, ce qui conduirait à « un manque de confiance, à de l’insatisfaction et à une mauvaise adoption [du mécanisme indépendant de traitement des plaintes] »Note de bas de page 102. Selon les auteurs du rapport, une approche par étape permettrait d’éviter ce résultat.
Avec le recul, le fait d’avoir exigé du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport qu'il se déploie de manière complète dans un délai aussi court, sans mise en œuvre progressive du programme, a probablement contribué à ses faiblesses. Il faut donc tenir compte de ce qui précède en lisant les perspectives des participants que nous partageons ci-dessous.
Compétence limitée du programme Sport Sans Abus
Nous avons été informés que, lors de son lancement initial, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport avait été présenté au public comme étant la solution à la crise relative au sport sécuritaire. Toutefois, on nous a signalé qu’en pratique, et de manière très constante, le Bureau n’était pas habilité à apporter son aide dans la plupart des cas en raison de sa compétence limitée. Le faible taux d’acceptation des plaintes illustre bien cette limitation.
Par exemple, au cours de sa première année de fonctionnement, le Bureau a reçu 193 plaintes, mais seules 66 ont été jugées recevables (ce qui représente un taux d’acceptation d’environ 34 %)Note de bas de page 103.
Nous avons appris que l’incapacité du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport à traiter les plaintes en raison de sa compétence limitée était particulièrement frustrante pour les personnes victimes ou survivantes et les parents. Plusieurs nous ont raconté d’innombrables histoires de personnes qui se sont vu refuser le dépôt d’une plainte, parfois sans autre explication que le fait que le Bureau n’avait pas compétence.
Toutefois, il est important de comprendre que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’avait pas été conçu pour avoir une compétence aussi limitée. Nous avons été informés que le Bureau pouvait en théorie traiter des plaintes à tous les niveaux du sport, même à celui des clubs.
À ce sujet, on nous a dit que le volley-ball était le seul sport où le programme Sport Sans Abus était appliqué à tous les niveaux du sport, y compris dans les clubs. Cela s’expliquerait par les relations étroites et harmonisées entre Volleyball Canada, les organismes provinciaux et territoriaux de sport membres et les clubs locaux. Ils ont pu ainsi élaborer un ensemble de politiques pancanadiennes qui s’appliquent uniformément à Volleyball Canada et à ses homologues provinciaux et territoriaux. Nous avons également été informés que cela leur avait permis de mettre en place une structure dans laquelle les personnes doivent être membres de Volleyball Canada pour être membres d’un organisme provincial ou territorial de sport, et vice versa.
En fait, le premier facteur limitant la compétence du programme Sport Sans Abus était précisément le fait que la plupart des organismes sportifs provinciaux et territoriaux n’y ont jamais adhéré. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, la plupart des organismes de sport nous ont répondu que le programme était trop cher à cause de son modèle de coût par service. Ils estimaient qu’il était plus abordable de faire appel à un tiers indépendant. Ils ont également indiqué que l’obligation d’obtenir le consentement explicite de tous leurs participants serait trop compliquée à gérer, soulignant qu’ils ne disposaient ni du temps, ni des ressources, ni de la capacité nécessaire pour satisfaire à cette exigence.
On a aussi attiré notre attention sur le fait que les organismes nationaux de sport estimaient que les formulaires de consentement étaient trop généraux et que, dans certains cas, des entraîneurs ont dû être remerciés parce qu’ils refusaient de signer le formulaire de consentement.
Le deuxième enjeu lié à la compétence du programme Sport Sans Abus était que les participants devaient consentir à être liés par le programme. En l’absence d’un tel consentement, nous comprenons que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport était tenu de rejeter la plainte. De nombreuses plaintes ont ainsi été rejetées parce que la personne intimée n’avait pas consenti au programme.
On nous a également dit que les participants pour chaque signataire du programme devaient être désignés par le signataire lui-même, et que par conséquent, le nombre de participants pour chaque signataire était relativement limité.
Préoccupations générales concernant le processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus
Nous avons entendu plusieurs frustrations au sujet du processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus. Plus précisément, on nous a parlé de frustrations concernant la clarté, le respect des délais, la transparence, l’équité du processus ainsi que le manque de soutien pour aider les parties pendant le processus. Ces facteurs ont entraîné une perte de confiance dans le processus.
Clarté
Des personnes plaignantes, des personnes intimées et des organismes et administrateurs sportifs nous ont répété à maintes reprises que le processus de traitement des plaintes était trop compliqué, embrouillé, confus et obscure. Les participants nous ont dit que les politiques qui détaillent le processus de traitement des plaintes étaient difficiles à comprendre parce qu’elles étaient rédigées dans un langage juridique complexe. Les participants ont indiqué à de nombreuses reprises qu’ils ne comprenaient pas les étapes à suivre et ce qui se passerait ensuite. Ils ne savaient pas comment s’orienter dans le système et nous ont dit qu’il n’y avait aucun soutien à leur disposition pour les aider.
De nombreuses personnes ont cité l’absence d’étapes claires pour signaler les cas de maltraitance pour démontrer le manque général de clarté du processus de traitement des plaintes. Il n’y avait aucune indication claire sur la façon de déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. Nous avons également appris que le système de dépôt de plainte en ligne était difficile à utiliser et que les formulaires de dépôt de plainte prêtaient à confusion.
Respect des délais
Nous avons entendu de nombreuses préoccupations au sujet de la durée excessive du processus de traitement des plaintes. Le processus a souvent été décrit comme étant sans fin, en particulier lorsque les décisions étaient portées en appel devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. À plusieurs reprises, on nous a informés que la résolution des plaintes pouvait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.
Des participants nous ont fait part de retards à chaque étape du processus, notant que des prolongations étaient fréquemment accordées, souvent sans raison valable. Ces retards ont également été mal communiqués aux parties concernées. Cela leur a donné l’impression que les délais n’étaient pas respectés, ce qui a ébranlé leur confiance dans le système. Dans certains cas, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’a fourni aucun calendrier aux parties.
Transparence et communication
Des participants nous ont souvent fait part d’un manque de communication entre le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et toutes les parties intéressées. Nous avons appris que ce manque de communication augmentait la confusion et créait un sentiment d’impuissance chez les personnes qui essayaient de s’orienter dans le processus de traitement des plaintes.
Des personnes plaignantes et des personnes intimées nous ont dit qu’elles recevaient rarement des renseignements à jour sur l’évolution de leur dossier. Des participants ont expliqué qu’elles ne savaient pas quelles mesures étaient prises pour remédier à leur situation, ni même si des progrès étaient réalisés. Elles ont noté que ce manque de communication, en particulier lorsque les dossiers demeuraient non résolus pendant de longues périodes, ajoutait un stress important et de l’incertitude à une situation déjà difficile.
Certains organismes nationaux de sport ont également exprimé leur mécontentement quant à la transparence du processus, expliquant qu’ils ignoraient parfois qu’une plainte avait été déposée contre l’un de leurs membres. Le manque de communication signifiait qu’ils n'avaient aucune visibilité une fois la plainte déposée. Souvent, ils ne connaissaient pas la nature ou la gravité des allégations formulées à l’encontre de leurs membres.
La Commission a été informée que cela posait problème, par exemple, lors de la nomination d’un nouvel entraîneur d’une équipe nationale. Les organismes nationaux de sport ont expliqué que dans ces circonstances, ils doivent accepter la responsabilité et le risque de nommer (ou de ne pas nommer) une personne contre laquelle une plainte a été déposée, sans avoir suffisamment d’informations sur le dossier.
Procédures justes et équitables
Le sentiment partagé par l’ensemble des participants était que le processus doit être juste et équitable sur le plan procédural, et ce, pour toutes les parties concernées. À cet égard, nous avons appris que le programme Sport Sans Abus n’offrait pas certaines garanties procédurales, en particulier en ce qui concerne les personnes intimées contre qui les plaintes sont déposées.
Des participants nous ont dit que des preuves habituellement irrecevables devant les tribunaux étaient admises dans le processus de traitement des plaintes et que les règles de preuve n’étaient pas appliquées de manière cohérente. D’autres ont souligné que les décisions étaient prises sans transparence et que des éléments de preuve étaient parfois exclus de l’enquête et des rapports finaux sans explication adéquate.
Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les personnes intimées n’ont pas toujours le droit de répondre aux allégations de maltraitance ou ne disposent pas d’informations suffisantes pour le faire de manière efficace. Par exemple, des personnes intimées ont déclaré que des mesures provisoires leur avaient été imposées sans qu’on leur ait donné la possibilité de présenter des observations. Nous avons été informés que les observations écrites n’étaient pas toujours prises en compte pour imposer des mesures provisoires. Dans certains cas, les personnes intimées n’avaient même pas eu connaissance de la plainte au moment où les mesures provisoires ont été imposées.
Certaines parties intimées ont également indiqué qu'elles se sentaient traitées comme si elles étaient « coupables » avant même qu’une décision officielle ne soit prise. De même, nous avons entendu des histoires de plaintes toujours en cours qui ont été communiquées aux médias, ce qui a conduit le public à juger la personne intimée avant la fin du processus.
Notons qu’il existe des règles de confidentialité qui régissent le processus de traitement des plaintes et qui empêchent la divulgation de dossiers en cours. Toutefois, des participants ont indiqué que de nombreuses personnes plaignantes violaient ces règles de confidentialité en divulguant les plaintes aux médias. Pourtant, la violation de ces règles n’a eu aucune conséquence. Certaines personnes intimées nous ont dit que leur réputation avait été ruinée même si aucun acte répréhensible n’avait été constaté.
Santé mentale et soutien juridique
La Commission a entendu de nombreux témoignages de personnes plaignantes et de personnes intimées qui ont traversé le processus de traitement des plaintes sans aucun soutien juridique ou de santé mentale. De nombreux participants n'étaient pas au courant des programmes de santé mentale et d’aide juridique offerts par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, ou ont souligné qu’il était trop difficile d’accéder à ses ressources.
Les participants nous ont partagé que la liste des avocats de l’aide juridique n’était pas à jour et que de nombreux avocats figurant sur la liste n’étaient pas en mesure de prendre en charge de nouveaux dossiers. Dans ces circonstances, les parties ont été laissées à elles-mêmes pour trouver un avocat et nombre d’entre elles ont traversé le processus de traitement des plaintes sans être représentées. Nous avons appris que le recours à un avocat était trop coûteux et que le nombre d’avocats disposés à entreprendre gratuitement (c’est-à-dire de manière pro bono) des dossiers longs et complexes était limité.
Nous avons été informés qu’un soutien limité était offert en matière de santé mentale lorsque les plaintes étaient traitées par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. À cet effet, le Bureau avait conclu un partenariat avec un groupe de psychologues sportifs qui offraient des séances de thérapie.
En plus des services de santé mentale et de soutien juridique, des personnes plaignantes et des personnes intimées ont exprimé le besoin d’être guidées tout au long du processus de traitement des plaintes. Nous avons appris qu’il était important de pouvoir parler à une personne capable de fournir de l’aide et d’expliquer le processus, en particulier une personne formée qui est sensibilisée aux traumatismes. L’importance du contact humain a également été soulignée, par opposition à la seule réception de correspondances numériques concernant les étapes à venir, ce qui a été décrit comme étant impersonnel et froid.
Préoccupations particulières liées aux étapes du processus de traitement des plaintes
Des participants ont fourni des renseignements à la Commission sur des enjeux précis liés au triage des plaintes, au processus d’enquête, à l’application des sanctions à la fin du processus et à la nécessité d’adopter une approche tenant compte des traumatismes. Ces enjeux ont davantage affaibli la crédibilité et l’efficacité du programme Sport Sans Abus.
Triage des plaintes
Bien que la plupart des participants étaient d'accord pour dire qu’une plainte officielle n’est pas toujours appropriée, les avis étaient partagés quant à savoir si les plaintes doivent atteindre un certain seuil avant de faire l’objet d’une procédure officielle. Dans le cadre du programme Sport Sans Abus, les plaintes faisaient l’objet d’une procédure de triage. Toutefois, cela n'était fait que pour déterminer les enjeux liés à la compétence, pour savoir si une plainte était de nature criminelle ou pour savoir si des obligations de signalement étaient déclenchées.
Certains participants ont demandé un meilleur triage ou un meilleur examen des plaintes, suggérant que les plaintes « moins graves » ou « administratives » soient renvoyées à l’organisme national du sport ou à d’autres organismes sportifs pour y être traitées. D’autres ont réclamé de meilleurs mécanismes pour trier les plaintes déposées en représailles (c'est-à-dire déposées contre une personne parce qu'elle a signalé un comportement prohibé potentiel ou parce qu’elle a participé à un processus de plainte). Des participants ont noté qu’en l’absence de seuils établis et d’un système de triage adéquat, le mécanisme de plainte risquait d’être submergé.
À l'inverse, certains participants ont souligné les risques associés au triage des plaintes. Par exemple, bien que certaines plaintes soient de nature plus administrative, comme celles qui concernent le temps de jeu, elles peuvent quand même comporter des éléments de maltraitance. Par ailleurs, un ensemble de plaintes « moins graves » concernant un même organisme sportif peut révéler des problèmes systémiques. Ces problèmes pourraient être ignorés si les plaintes sont triées, car l’examen initial d’une plainte ne révèle pas toujours l’histoire complète.
Processus d’enquête
Nous avons entendu de graves préoccupations concernant le processus d’enquête. De nombreux participants ont noté un manque de réglementation et de supervision des enquêtes, ainsi que l’absence de protocoles standard pour traiter les éléments de preuve. D’autres préoccupations liées au processus d’enquête et aux personnes chargées d’enquête ont été signalées :
- La durée du processus d’enquête (par exemple, des enquêtes qui durent plusieurs mois).
- Des enquêtes incomplètes ou qui présentent des lacunes factuelles (par exemple, lorsque les personnes chargées d’enquêter omettent d’interroger des témoins importants).
- Des personnes chargées d’enquêter qui n’ont pas la formation ou l’expérience requise, en particulier lorsque l’allégation est de nature criminelle, comme les abus sexuels ou les abus sur des enfants.
- Des personnes chargées d’enquêter qui ne comprennent pas l’impact d’une enquête sur des procédures criminelles qui se déroulent en parallèle, ce qui peut compromettre ces procédures.
- Des personnes chargées d’enquêter qui ne protègent pas la confidentialité des enquêtes.
De manière générale, et à des degrés divers, les participants ne faisaient pas confiance aux personnes chargées d’enquêter. Certains estiment que les enquêtes auraient dû être menées par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport plutôt que d’être confiées à des personnes de l’externe.
Application des sanctions
Des personnes plaignantes nous ont indiqué que l’un des principaux problèmes du programme Sport Sans Abus était que les organismes de sport n’appliquaient pas toujours les sanctions et que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’exerçait aucune supervision pour s’en assurer. Nous avons également appris que les sanctions n’étaient pas communiquées de manière efficace à tous les niveaux de sport (provincial, territorial et communautaire) dans lesquels les personnes sanctionnées étaient impliquées. Lorsque les sanctions étaient communiquées, nous avons été informés que les organismes nationaux de sport n’avaient généralement que très peu de contrôle ou d’influence sur les organismes provinciaux et territoriaux de sport. Cela a entraîné un manque d’imputabilité face aux personnes sanctionnées. Nous avons également appris que les mesures provisoires n’étaient pas systématiquement appliquées par les organismes sportifs.
Processus tenant compte des traumatismes
Beaucoup de participants ont insisté sur le fait que le processus de traitement des plaintes doit tenir compte des traumatismes de toutes les parties. Les personnes victimes ou survivantes, en particulier, nous ont dit qu’elles ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’elles signalaient de la maltraitance au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. Le processus de traitement des plaintes a été décrit comme étant difficile et traumatisant par de nombreuses personnes, notamment des personnes victimes ou survivantes et des parents. Le processus pourrait également causer du tort aux personnes intimées.
Les personnes victimes ou survivantes ont constaté un manque de protection tout au long du processus de traitement des plaintes. Elles ont déclaré avoir été forcées de revivre leur traumatisme à de multiples reprises puisqu’elles devaient rédiger des mémoires, passer par le processus d’enquête, participer à la médiation et assister à des audiences. Par exemple, bien que le contre-interrogatoire de la personne plaignante soit important pour vérifier les preuves lors de l’audience, les participants ont souligné qu’il devrait y avoir des processus et des procédures en place pour soutenir les personnes plaignantes lors de leur contre-interrogatoire.
Nous avons également appris que le processus de traitement des plaintes ne répondait pas aux besoins particuliers et aux réalités des personnes victimes ou survivantes. En effet, la Commission a entendu des personnes victimes ou survivantes et des témoins qui hésitaient à se manifester et à révéler certains types de maltraitance. Ils craignaient que les personnes en position d'autorité ou celles qui entendraient la plainte ne comprennent pas leur vécu.
Par exemple, dans les cas d’abus raciaux, un obstacle à la divulgation peut être créé si aucune personne racialisée n’est présente pour entendre la plainte. Il a également été noté qu’il n’y avait aucune personne en situation de handicap sur la liste des arbitres et des médiateurs, ce qui affectait la qualité de la prise de décision dans les dossiers impliquant des para-athlètes. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que, sans expérience vécue ni compréhension approfondie des enjeux liés au handicap, les réalités des para-athlètes étaient souvent négligées ou mal comprises.
Perspectives sur la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire
Étant donné que le Programme canadien de sport sécuritaire n’a été lancé que récemment, nous n’avons pas encore reçu de commentaires substantiels de la part des participants au sujet du nouveau processus. Nous avons toutefois reçu de premières impressions générales sur la transition vers le Programme canadien de sport sécuritaire.
D’un côté, certains participants ont salué cette transition. Ces participants estiment que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, en tant qu’organisme totalement indépendant du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, est bien placé pour bâtir la confiance au sein de la communauté sportive. Ils espèrent que le Centre tirera des leçons des difficultés que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a rencontrées et que cela permettra d’améliorer le processus de traitement des plaintes. D'un autre côté, certains participants craignent que rien ne change et que les problèmes décrits ci-dessus persistent.
Compétence limitée
Nous avons entendu des préoccupations concernant la compétence limitée du Programme canadien de sport sécuritaire, étant donné que la plupart des cas de maltraitance se produisent en deçà du niveau national du sport. Nous avons été informés que la majorité des appels et des demandes reçus par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport au cours du premier mois du programme ne relevaient pas de sa compétence.
Nous notons que dans certains cas, la compétence n’a pas pu être établie parce que la nature de la plainte n’entrait pas dans le champ d’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Cela dit, nous avons été informés que le Programme canadien de sport sécuritaire est mis en place progressivement et que le Centre espère l’étendre au-delà du niveau national dans les années à venir.
Toutefois, on nous a avisé que le Centre aura besoin de fonds supplémentaires pour étendre la compétence du Programme canadien de sport sécuritaire. Ce financement pourrait provenir du gouvernement ou d’un modèle de coût par service. À cet égard, il est important de rappeler que l’ancien programme Sport Sans Abus fonctionnait selon un modèle de coût par service et qu’il a rencontré des difficultés importantes pour rallier les organismes sportifs, en partie à cause de son coût prohibitif.
Double responsabilité en matière de lutte contre le dopage et de sport sécuritaire
Nous avons appris l’existence d’une perception parmi les athlètes voulant que la double responsabilité du Centre canadien pour l’éthique dans le sport en matière de lutte contre le dopage et de sport sécuritaire était une source de conflit d’intérêts. Cela s’explique par l’impression que le Centre travaille « contre » les athlètes dans le domaine de la lutte contre le dopage, alors qu’il vise à les soutenir en matière de sport sécuritaire.
Cela dit, de nombreux athlètes semblent avoir une opinion positive du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et d’être d’avis qu’il s’efforce de les protéger contre la tricherie et le dopage dans le système sportif.
Évaluations du milieu sportif
Nous comprenons qu’actuellement, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport n’effectue pas d’évaluations du milieu sportif. Des participants ont exprimé leur inquiétude à ce sujet, soulignant que les évaluations du milieu sportif sont un outil essentiel pour s’attaquer aux causes profondes des cultures sportives non sécuritaires au sein des organismes.
Cela dit, nous avons été informés que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport lançait progressivement le Programme canadien de sport sécuritaire et qu’il souhaitait éventuellement effectuer des évaluations du milieu sportif. Des participants ont noté que le Centre ne peut pas mener de telles évaluations sans recevoir un financement adéquat. Dans l’intervalle, nous comprenons que Sport Canada a assumé la responsabilité d’assurer la continuité de la phase de suivi, telle qu’énoncée dans les Lignes directrices du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 104 pour les évaluations du milieu sportif en coursNote de bas de page 105.
Pratiques réparatrices
Plusieurs participants ont fait remarquer qu’il n’y avait pas assez de possibilités de s’engager dans des pratiques réparatrices dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Ils cherchaient des solutions pour résoudre les conflits en dehors de la procédure de plainte officielle qui implique une enquête et une audience complètes. Il a été suggéré que des principes réparateurs fassent partie du programme Sport Sans Abus.
Mécanismes établis par des tiers indépendants au niveau national
Comme indiqué plus haut dans ce chapitre, la compétence du programme Sport Sans Abus était grandement limitée. Le programme recevait fréquemment des plaintes de maltraitance qui n’étaient pas liées à un signataire du programme ou à ses participants. Le Programme canadien de sport sécuritaire est confronté à des problèmes similaires.
Par exemple, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a reçu 299 plaintes du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Seules 134 plaintes ont été jugées recevablesNote de bas de page 106. Les autres plaintes étaient irrecevables, généralement pour des questions de compétence. Plus précisément :
- Dans 63 % de ces cas, la personne intimée n’était pas un participant au programme Sport Sans Abus.
- Dans 26 % des cas, la plainte n’était pas liée à un enjeu couvert par le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.
- Dans 8,2 % des cas, l’organisme n’était pas signataire du programmeNote de bas de page 107.
En raison de ces enjeux de compétence, la plupart des organismes nationaux de sport maintiennent d’autres mécanismes de plainte pour traiter les plaintes de maltraitance qui ne relèvent pas de la compétence du Programme canadien de sport sécuritaire. Cela se produit lorsque les participants ne sont pas au niveau national ou lorsque l’organisme sportif n’a pas adopté le programmeNote de bas de page 108. Dans ces cas, la plupart des organismes nationaux de sport s’appuient sur des mécanismes établis par des tiers indépendants.
Mécanismes établis par des tiers indépendants
Les mécanismes établis par des tiers indépendants sont généralement des personnes ou des agences externes qui sont engagées pour examiner les plaintes et mener des enquêtes de manière indépendante, ou encore pour transmettre les plaintes à l’autorité compétenteNote de bas de page 109. La compétence d’un tiers indépendant est généralement définie dans la politique de l’organisme sportif en matière de discipline et de plaintes (ou un équivalent)Note de bas de page 110.
Par exemple, la Politique sur le traitement des plaintes pour maltraitance de Hockey Canada (2023) reconnaissait la compétence du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport pour les plaintes relatives au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport qui avaient été déposées après que Hockey Canada en est devenu signataireNote de bas de page 111.
La politique prévoyait par ailleurs que le tiers indépendant, à savoir Plaintes SportNote de bas de page 112, serait responsable de l’administration de toutes les plaintesNote de bas de page 113, y compris :
- la réception et l’examen des plaintes
- la détermination de la compétence dont relèvent les plaintes et leur transmission au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, le cas échéant
- l’établissement de la procédure à suivre pour chaque plainte
- la sélection d’un arbitre ou d’un tribunal d’arbitrage chargé d’établir la véracité d’une violation et, le cas échéant, les mesures disciplinaires qui doivent être imposéesNote de bas de page 114
Une fois qu’une décision est rendue, la sanction est généralement appliquée par l’organisme national de sport.
Nous notons que des mécanismes de plainte autres que ceux établis par des tiers indépendants peuvent également exister au niveau national du sport. Par exemple, Athlétisme Canada a créé son propre bureau indépendant, le Bureau du Commissaire d’Athlétisme Canada, spécifiquement pour résoudre les plaintes au sein de son organismeNote de bas de page 115.
Certains organismes nationaux de sport, qui ne reçoivent pas de financement de Sport Canada, et qui ne sont donc pas tenus d’adopter le Programme canadien de sport sécuritaire, ont également eu recours à des mécanismes établis par des tiers indépendants pour traiter les cas de maltraitance dans le sport et d’autres enjeux, conformément à leurs politiquesNote de bas de page 116.
Nous notons également que les politiques des organismes nationaux de sport prévoient souvent le droit de demander la révision de toute décision prise par un tiers indépendant ou un autre décideur, et ce, devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada Note de bas de page 117.
Perspectives des participants sur les mécanismes établis par des tiers indépendants
Les mécanismes de plainte gérés par les organismes nationaux de sport sont complexes et fragmentés, parce que chaque organisme a son propre ensemble de règles et de procédures. Néanmoins, le transfert de plaintes à des tiers indépendants, qu’il s’agisse de personnes ou d’agences, est une pratique largement répandue dans le système sportif.
La plupart des organismes nationaux de sport font affaire avec un tiers indépendant. Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, les provinces et les territoires, ainsi que les organismes provinciaux et territoriaux de sport, utilisent également des mécanismes établis par des tiers indépendants.
Bien que les mécanismes établis par des tiers indépendants sont omniprésents dans le système sportif, de nombreux participants ont exprimé de sérieuses préoccupations à leur sujet. Les perspectives que nous décrivons ci-dessous sur les mécanismes établis par des tiers indépendants sont des observations générales et préliminaires qui s’appliquent au niveau national du sport ainsi qu’aux niveaux inférieurs.
Coûts
La forte dépendance de la communauté sportive à l’égard des tiers indépendants a essentiellement conduit à la création d’un nouveau secteur d’activité pour les avocats et les personnes chargées d’enquêter. Certains organismes nationaux de sport nous ont confié qu’il est coûteux d’engager des tiers indépendants pour enquêter et gérer leurs plaintes, ce qui ajoute une lourde charge financière pour des organismes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts.
Manque de supervision
Nous avons appris qu’il n’existait pas d’organisme pour superviser ou attribuer des permis aux tiers indépendants. De nombreuses personnes se sont inquiétées du fait que ces tiers indépendants n’étaient pas réglementés.
Des questions ont été soulevées quant à savoir si le personnel des tiers indépendants possède l’expérience et les connaissances adéquates pour gérer les plaintes relatives au sport sécuritaire. En effet, on nous a dit que de nombreuses personnes chargées d’enquêter travaillant pour des tiers indépendants n’ont souvent pas l’expertise requise pour traiter des enjeux sensibles, comme les cas de maltraitance impliquant des enfants. On nous a informés que des personnes chargées d’enquêter traitaient des affaires impliquant des enfants victimes sans avoir aucune expérience de travail avec les enfants. Il a également été noté que certains décideurs n’ont pas une compréhension suffisante du milieu sportif et des déséquilibres de pouvoir qu’on y retrouve.
Il n’existe actuellement aucune qualification ou certification obligatoire pour agir à titre de tiers indépendant. De nombreux participants ont convenu que la formation et des normes sont nécessaires pour les personnes chargées d’enquêter sur la maltraitance dans le sport.
Conflit d’intérêts
Certains participants ont exprimé leur méfiance quant à l’indépendance des mécanismes existants établis par des tiers indépendants dû au fait que ces parties sont engagées par des organismes nationaux de sport. Cette relation, à tout le moins, crée une perception de conflit d’intérêts. Des participants craignent que les tiers indépendants soient influencés à prendre des décisions favorables à l’organisme qui les paie. Nous avons entendu dire que le système était « très incestueux ».
D’autres conflits d’intérêts ont été relevés, notamment parce que les organismes sportifs engagent souvent des tiers indépendants pour élaborer leurs politiques, puis pour enquêter et rendre des décisions dans le cadre de ces mêmes politiques. Les tiers indépendants peuvent également effectuer d’autres tâches pour ces organismes.
Des participants ont également exprimé que les personnes responsables du sport sécuritaire au sein des organismes nationaux de sport devraient prioriser l’éducation et la promotion de pratiques sécuritaires. Elles ne devraient pas prioriser la réception ou le traitement des plaintes.
Une préoccupation importante a été soulevée quant au conflit d’intérêts potentiel inhérent au fait d’affecter une personne responsable du sport sécuritaire au sein d’un organisme de sport national, pour traiter des plaintes de maltraitance. Étant donné que ces personnes peuvent avoir des relations ou des affiliations avec les parties concernées (la personne plaignante, la personne intimée ou d’autres personnes), il y a un risque, ou du moins une perception, de partialité.
Inefficacité
Si certains participants ont fait état d’expériences positives avec les processus établis par des tiers indépendants, la majorité de ceux qui nous ont parlé ne partageait pas cet avis. Certains estiment que les tiers indépendants sont inefficaces et qu’ils ne permettent pas de résoudre les plaintes de manière satisfaisante. Il a également été noté que les tiers indépendants n’ont pas pour mission de se concentrer sur la prévention ou l’éducation des personnes pour s'assurer que la maltraitance ne se reproduise pas.
Préoccupations générales concernant le processus de traitement des plaintes dans le cadre des mécanismes établis par des tiers indépendants
Dans l’ensemble, nous avons appris que les procédures des tiers indépendants sont incohérentes et compliquées. Cette confusion provient entre autres du fait qu’il existe différentes agences de tiers indépendants qui fonctionnent chacune à sa façon.
Clarté et communication
L’une des principales préoccupations concernant les tiers indépendants est le manque de cohérence de leurs procédures, ce qui est une source de confusion pour plusieurs personnes. Les processus des tiers indépendants ont souvent été décrits comme peu clairs, imprévisibles, compliqués et obscurs.
De nombreux tiers indépendants emploient des gestionnaires de dossiers qui servent d’intermédiaires entre les parties et les personnes chargées d'enquêter ou de rendre des décisions. Ces gestionnaires de dossiers peuvent répondre aux questions de procédure et atténuer les conflits d’intérêts potentiels. Les arbitres et les professionnels du droit ont souligné l’importance de ce rôle, en particulier lorsque les parties se représentent elles-mêmes. Néanmoins, nous avons appris que certains gestionnaires de dossiers n’étaient pas réactifs et mettaient trop de temps à répondre aux questions. Il est nécessaire d’améliorer la communication avec les parties.
Respect des délais
On nous a informés que les processus des tiers indépendants sont généralement longs et souvent retardés. Le processus nous a été décrit comme « sans fin ». On nous a dit qu’aucun échéancier n’était imposé ou encore que les échéanciers n’étaient pas appliqués. Les participants ont raconté des cas où le droit de faire appel d’une décision a été accordé des mois après l’expiration du délai d’appel. Nous avons également appris que la procédure d’appel devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada est trop longue.
Procédures justes et équitables
Les participants se sont dits préoccupés par le manque de procédures justes et équitables dans les mécanismes établis par des tiers indépendants. Les politiques adoptées par les organismes sportifs, qui sont censées guider ces mécanismes, sont généralement tout à fait insuffisantes pour garantir des procédures justes et équitables. Dans de nombreux cas, les participants nous ont dit que les procédures n’étaient tout simplement pas équitables.
Les exemples suivants illustrent certaines des préoccupations qui nous ont été communiquées :
- des mesures provisoires qui ont été imposées aux personnes intimées sans qu’elles aient eu la possibilité de présenter des observations
- des problèmes d’interprétation et d’application incohérente des politiques
- des biais de la part des personnes chargées d’enquêter ou de rendre des décisions
- de longues journées d’audition
- des rapports d’enquête qui présentent des lacunes sur le plan factuel
- des notes et des rapports d’enquête qui ne sont pas divulgués aux parties
- un manque d’équité procédurale, comme la possibilité de lire une transcription à l’avance
Soutien et services juridiques
Tant les personnes plaignantes que les personnes intimées ont demandé de meilleurs services de soutien en ce qui concerne les processus établis par des tiers indépendants. Elles ont soulevé des difficultés à se faire représenter juridiquement. Nombreuses sont celles qui se résignent à traverser le processus sans avocat parce que le recours à un conseiller juridique est trop coûteux.
Le nombre d’avocats disposés à traiter gratuitement (c’est-à-dire de manière pro bono) des dossiers longs et complexes est limité. Toutefois, nous avons été informés que certains organismes nationaux de sport offraient une aide financière pour les frais d’avocat des personnes plaignantes, mais n’offraient aucune aide de ce type à leurs entraîneurs intimés.
Ingérence dans les enquêtes criminelles
Nous avons appris que certains tiers indépendants enquêtent sur des plaintes alors que des procédures criminelles sont en cours, sans apparemment saisir le risque de compromettre ces procédures.
Pour cette raison, il a été suggéré d’instaurer une obligation de déclarer les allégations de nature criminelle à la police et de suspendre l’enquête administrative jusqu’à ce que les procédures criminelles soient terminées.
Application de la loi
Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que personne, ni même les organismes nationaux de sport, ne contrôle l’application des sanctions imposées par les tiers indépendants. Il semble y avoir un manque d’imputabilité ou de transparence quant à savoir si les organismes sportifs appliquent les sanctions.
Par exemple, nous avons pris connaissance de nombreux témoignages voulant que des entraîneurs et d’autres personnes continuent de travailler et de faire du bénévolat dans le domaine du sport alors qu’ils sont activement suspendus. Cela met en évidence un manque de contrôle pour vérifier que les organismes de sport appliquent les sanctions.
Confidentialité
Des participants ont exprimé des inquiétudes quant aux pratiques de confidentialité des tiers indépendants. Nous avons entendu parler de cas impliquant des mineurs où le processus n’a pas été maintenu confidentiel, malgré des promesses de confidentialité. Des préoccupations en matière de respect de la vie privée ont également été soulevées relativement au stockage de renseignements sensibles au moyen de services infonuagiques comme OneDrive et SharePoint.
Mécanismes de plainte au niveau provincial et territorial
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs se sont réunis en 2019 pour approuver la « Déclaration de Red Deer – Pour la prévention du harcèlement, des abus et de la discrimination dans le sport ». Ils se sont réunis à nouveau en août 2022, cette fois pour discuter des prochaines étapes vers l’élimination des abus, du harcèlement, de la violence sexuelle et de la discrimination dans le sport. Ils s'étaient entendus pour mettre en place des mécanismes gérés par des tiers indépendants dans leur champ de compétence respectif afin de traiter les cas de maltraitance, et ce, d’ici 2023Note de bas de page 118.
À ce jour, certaines provinces et certains territoires ne disposent toujours pas d’un mécanisme de plainte officiel et centralisé pour traiter les cas de maltraitance dans le sport. Là où de tels systèmes existent, ils sont généralement administrés par la fédération d’organismes sportifs de la province (et non par le gouvernement) et s’appuient sur des mécanismes établis par des tiers indépendants.
Comme nous le verrons plus loin, le Québec est la seule province qui a choisi d’adopter une loi pour mettre en place un mécanisme de plainte centralisé. Cela a mené à la création d’un poste de protecteur ou de protectrice de l’intégrité en loisir et en sport, chargé de recevoir et d'enquêter sur les questions d’intégrité dans la province.
Par ailleurs, nous notons que la Colombie-Britannique est en train de mettre en place un mécanisme de plainte indépendant qui sera géré par un organisme sans but lucratif.
Un tableau résumant les mécanismes de plainte provinciaux et territoriaux actuels, y compris les mécanismes établis par des tiers indépendants, est présenté à l’annexe 10.
Mécanisme de plainte statutaire provincial
Le Québec est actuellement la seule province à disposer d’un mécanisme de plainte statutaire, c’est-à-dire prévu dans une loi. Ce mécanisme a été introduit dans le projet de loi 45 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports Note de bas de page 119. Le projet de loi 45 a reçu la sanction royale le 7 juin 2024 et la disposition créant le rôle de protecteur ou de protectrice de l’intégrité en loisir et en sport est entrée en vigueur le 7 juin 2025Note de bas de page 120.
Une caractéristique notable du modèle québécois est qu’il s’applique à tous les niveaux de sport, y compris au niveau des loisirs. Par ailleurs, son application ne dépend pas du fait qu’un organisme sportif reçoive des fonds publics ou soit membre d’une fédération provinciale ou territoriale d’organismes sportifs.
La loi prévoit que le gouvernement nomme un protecteur ou une protectrice de l’intégrité en loisir et en sport, qui est chargé de « recevoir toute plainte en matière d’intégrité et de formuler des recommandations en cette matière, notamment à une fédération d’organismes sportifs, à un organisme sportif ou à un organisme de loisir »Note de bas de page 121. La Loi autorise le protecteur ou la protectrice à agir après avoir reçu un signalement (une plainte) ou de sa propre initiativeNote de bas de page 122.
Une fois que le protecteur ou la protectrice de l’intégrité en loisir et en sport a terminé l’examen d’une plainte, il ou elle peut « déterminer les conclusions » et, le cas échéant, formuler des recommandationsNote de bas de page 123. La fédération ou l’organisme peut refuser de donner suite aux recommandations et aux conclusions, à condition de le faire par écrit. Dans ce cas, le protecteur ou la protectrice peut soumettre le dossier au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui a alors le pouvoir d’ordonner à cette fédération ou à cet organisme de prendre la mesure qu’il indiqueNote de bas de page 124. Le protecteur ou la protectrice n’est pas un tribunal et ne peut pas imposer ses recommandations.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut adopter des règlements pour détailler les procédures de dépôt de plaintes auprès du protecteur ou de la protectriceNote de bas de page 125. Au moment de rédiger ce rapport, aucun règlement de ce type n’a été publié.
Provinces et territoires disposant d’un mécanisme de plainte centralisé
Les mécanismes de plainte les plus courants au niveau provincial et territorial sont les mécanismes établis par des tiers indépendants. Les gouvernements suivants ont délégué à leurs organismes provinciaux de services multisports (également appelés fédérations provinciales d’organismes sportifs) la responsabilité de mettre en place des mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire:
| Gouvernements provinciaux | Organismes provinciaux de services multisports |
|---|---|
| Manitoba | Sport Manitoba |
| Nouveau-Brunswick | Sport NB |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Sport NL |
| Québec | Sport Québec |
| Saskatchewan | Sask Sport |
À leur tour, ces fédérations d’organismes sportifs ont conclu des contrats avec des agences tierces indépendantes. Par exemple, les organismes Sport NB, Sport NL et Sask Sport ont tous conclu un partenariat avec ITP Sport, une agence indépendante de traitement des plaintesNote de bas de page 126.
Nous notons que l’accès aux mécanismes établis par des tiers indépendants est limité aux participants des organismes provinciaux de sport qui sont membres de ces fédérations.
Les mécanismes établis par des tiers indépendants sont examinés plus en détail au Chapitre 16.
Provinces et territoires ne disposant pas d’un mécanisme de plainte centralisé
Dans les provinces et territoires suivants, il n’existe aucun mécanisme de plainte centralisé pour la maltraitance dans le sport:
- l’Alberta
- la Colombie-Britannique
- les Territoires du Nord-Ouest
- la Nouvelle-Écosse
- l’Ontario
- l’Île-du-Prince-Édouard
- le Yukon
En l’absence de mécanisme de plainte centralisé dans ces provinces et territoires, ce sont les organismes sportifs d’où proviennent les plaintes qui ont la responsabilité de traiter les plaintes conformément à leurs propres procédures internes (si de telles procédures existent). Par conséquent, les organismes provinciaux et territoriaux de sport choisissent souvent de s’appuyer sur des mécanismes établis par des tiers indépendants.
Un mécanisme de plainte indépendant et centralisé est en cours de création en Colombie-Britannique. Sport Safeguarding BC sera une société indépendante à but non lucratif chargée d’établir et de maintenir un système de plaintes pour le sport amateur dans la provinceNote de bas de page 127. Ses services seront uniquement accessibles aux membres des organismes sportifs désignés par viaSport, l’organisme provincial de services multisports de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 128. Sport Safeguarding BC devrait être opérationnel en 2025Note de bas de page 129.
En Nouvelle-Écosse, le ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine collabore avec Sport Nova Scotia pour mettre en place un processus indépendant géré par une tierce partie afin de traiter les plaintes de maltraitance dans le sport.
Perspectives des participants sur les mécanismes de plainte provinciaux et territoriaux
Programme Sport Sans Abus
Nous avons appris que certains gouvernements provinciaux et territoriaux envisageaient de devenir signataires du programme Sport Sans Abus. Plusieurs facteurs ont rendu l’adoption de ce programme difficile, voire impossible, au niveau provincial et territorial. Nombreux sont ceux qui estiment que le programme Sport Sans Abus était trop coûteux.
Certaines provinces et certains territoires estimaient que le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, qui est le fondement du programme Sport Sans Abus, avait été conçu pour les organismes nationaux de sport et les athlètes des équipes nationales. Ils estimaient que le langage utilisé dans le Code de conduite universel n’est pas bien adapté aux niveaux provincial, territorial et communautaire du sport.
Par ailleurs, l’obligation d’obtenir le consentement éclairé de tous les participants créait une trop grande complexité administrative. Le niveau de suivi requis pour garantir un consentement éclairé et explicite dépassait la capacité de nombreux organismes provinciaux et territoriaux de sport. Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport exigeait qu’un formulaire de consentement distinct soit lu et signé par chaque participant au sport, et il n’acceptait pas qu’une case à cocher soit utilisée lors de l’inscription.
Certains organismes provinciaux et territoriaux de sport notent encore leurs inscriptions manuellement sur papier ou à l’aide de feuilles Excel. Il arrive parfois qu’ils ne soient même pas au courant de tous les entraîneurs et de tous les responsables qui œuvrent dans leur sport.
Une autre considération pour certaines provinces était que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport ne faisait pas de distinction entre les allégations faites contre des jeunes et celles faites contre des adultes. Cela était incompatible avec les approches qui s’appuient sur des processus de réparation pour les mineurs.
Mécanismes de plainte indépendants
Comme mentionné ci-dessus, certaines provinces ont adopté leurs propres mécanismes de plainte centralisés. Différentes raisons ont été évoquées pour justifier ce choix, notamment le désir de réduire le nombre de mécanismes de plainte dans la province, l’autre option étant que les organismes provinciaux de sport se dotent de leurs propres mécanismes de plainte. La volonté de standardiser les processus de traitement des plaintes a également été exprimée.
Les mécanismes de plainte centralisés les plus courants au niveau provincial et territorial sont les mécanismes établis par des tiers indépendants. Si les tiers conservent le contrôle administratif de ces mécanismes, il a été reconnu que les gouvernements conservent une certaine forme d’influence sur eux par le financement qu’ils accordent à la fédération provinciale d’organismes sportifs.
Les gouvernements ont justifié la mise en place de mécanismes de plainte indépendants par le besoin de standardiser et de limiter la diversité des mécanismes dans le système sportif. Certains gouvernements avaient prévu que ces mécanismes soient le point de passage obligé pour les plaintes provenant de tous les organismes sportifs de la province ou du territoire. Des représentants des gouvernements ont déclaré qu’il y avait un appui populaire pour un tel mécanisme de plainte centralisé. Dans certains cas, ils ont déclaré que les organismes sportifs étaient « impatients » d’avoir accès à des mécanismes de plainte centralisés. Ces mécanismes retirent une responsabilité complexe à un secteur dont les ressources sont limitées et qui est largement soutenu par des bénévoles épuisés par des situations d’urgence importantes comme la gestion des dossiers liés au sport sécuritaire.
Les mécanismes de plainte indépendants semblent fonctionner sur la base d’un consentement implicite, ce qui rend la connaissance des procédures de plainte et des politiques applicables extrêmement importante. Toutefois, une meilleure prise de conscience s’accompagne d’un recours accru aux mécanismes de plainte indépendants. Certaines provinces et certains territoires ont géré ce problème en fournissant des fonds supplémentaires pour davantage de ressources, y compris du personnel.
Les mécanismes de plainte provinciaux et territoriaux ont toutefois une portée limitée. Tout comme les politiques provinciales et territoriales de sport sécuritaire, seuls les organismes de sport financés par le gouvernement sont tenus de les adopter. Cela signifie que plusieurs niveaux de sport n’entrent pas dans le champ d’application des mécanismes de plainte. Il s’agit notamment des organismes sportifs privés, du sport scolaire et du sport professionnel. Dans certains cas, les affaires impliquant des parents et des spectateurs échappent également au système.
Par ailleurs, certaines provinces et certains territoires ont mis en place une ressource ou un service d’assistance téléphonique grâce auxquels il est possible d’obtenir des renseignements ou d’être orienté vers le mécanisme de plainte approprié.
Nous notons également que certaines provinces ont recours à des tiers indépendants. Nos observations sur les tiers indépendants figurent au chapitre 16.
Certaines provinces et certains territoires envisagent le recours à des approches réparatrices. Nous avons appris que ces approches pouvaient être très exigeantes en matière de ressources humaines et qu'elles nécessitent un renforcement significatif des capacités pour être mises en œuvre. Elles coûteraient aussi très cher.
Mécanismes de plainte au niveau communautaire
De nombreux mécanismes de plainte différents sont utilisés au niveau communautaire du sport. Comme mentionné plus tôt dans ce chapitre, le Québec est le seul endroit où un mécanisme de plainte centralisé fonctionne au niveau communautaire. Plus précisément, le Québec a créé un poste de protecteur ou de protectrice de l’intégrité en loisir et en sport, habilité à traiter des plaintes déposées à tous les niveaux du sport, y compris au niveau communautaireNote de bas de page 130. Il n’existe aucun autre mécanisme de plainte centralisé pour les clubs, les associations communautaires et les autres organismes sportifs de niveau local.
Dans certains cas, les clubs peuvent être tenus de mettre en place un mécanisme de plainte en raison de leur affiliation à un organisme provincial ou territorial de sport. D’autres clubs, associations et organismes communautaires peuvent également décider de créer des mécanismes de plainte. Certains de ces organismes ont engagé des tiers indépendants. Nous constatons en outre que les universités et les collèges disposent généralement de mécanismes de plainteNote de bas de page 131 et que ceux-ci sont parfois imposés par la loiNote de bas de page 132.
Perspectives des participants sur les mécanismes de plainte au niveau communautaire
La grande majorité des problèmes liés au sport sécuritaire survient au niveau communautaire, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes de plainte appropriés dans ces milieux. Bien que des mécanismes et des procédures de traitement des plaintes existent au niveau communautaire, ils ne sont pas bien connus ni communiqués de manière efficace. Il y a peu ou pas de supervision des clubs et des associations communautaires, ce qui signifie que les procédures ne sont pas nécessairement suivies ou appliquées de manière stricte.
Les organismes locaux ne disposent généralement pas des ressources nécessaires pour gérer des mécanismes de plainte complexes. Les plaintes sont généralement traitées en interne, et de nombreux participants ont souligné que ces organismes sont principalement dirigés par des bénévoles qui ne disposent ni de l’expertise ni de l’expérience nécessaires pour cette tâche.
Nous avons entendu de nombreuses histoires de plaintes liées au sport sécuritaire qui ont été mal gérées au niveau communautaire. Dans certains cas, des personnes victimes ou survivantes nous ont dit que leurs plaintes étaient restées sans réponse ou n’avaient pas été prises au sérieux par les administrateurs sportifs, le personnel ou les conseils d’administration des clubs.
Des participants ont également noté que la plupart des universités, des collèges et des écoles sont présentement en dehors du mécanisme national de plainte (c’est-à-dire en dehors du programme Sport Sans Abus). Cela crée une certaine confusion lorsqu’il s’agit de signaler un cas de maltraitance.
Dans ce contexte, on nous a avisé qu’un processus de plainte simple, unique, transparent et cohérent était nécessaire pour le sport de niveau communautaire. Ce processus devrait également garantir une communication efficace, une supervision appropriée et des procédures qui tiennent compte des traumatismes.
Perspectives des participants sur la centralisation et l’harmonisation des mécanismes de plainte
De nombreux participants ont affirmé que les plaintes relatives au sport sécuritaire ne doivent pas être traitées en interne par les organismes sportifs ou par les tiers indépendants qu’ils engagent. De l’avis général, les mécanismes de plainte liés au sport sécuritaire doivent être totalement indépendants des organismes sportifs.
Des participants ont suggéré de simplifier et d’harmoniser les mécanismes de plainte dans tout le pays. Ils ont également demandé l’adoption de nouvelles lois pour garantir l’uniformité des exigences en matière de sport sécuritaire dans toutes les provinces et tous les territoires.
À plusieurs reprises, on nous a dit que l’approche décentralisée actuelle des mécanismes de plainte liés au sport sécuritaire ne fonctionnait pas. Des participants ont expliqué que les mécanismes de plainte étaient trop compliqués et qu’il était difficile de savoir de qui relevaient les plaintes relatives au sport sécuritaire. Certains ont indiqué qu’ils avaient déposé une même plainte auprès de plusieurs organismes différents parce qu’ils ne savaient pas qui pouvait les aider.
Plusieurs nous ont confié qu’ils souhaiteraient voir un mécanisme national unifié de plainte pour administrer un ensemble de règles uniformes, avec la capacité d’entendre des plaintes provenant de tous les niveaux du sport. Ces participants ont indiqué que la procédure de plainte devait être simple et claire. Ce sentiment était partagé par de nombreux petits organismes sportifs qui dépendent généralement de bénévoles et qui n’ont pas les ressources ni le soutien nécessaire pour gérer les plaintes en interne.
Certains participants ont estimé qu’un mécanisme de plainte avec un point d’accès unique où tout le monde pourrait déposer une plainte était souhaitable. On nous a également parlé de la nécessité d’une approche uniforme en matière de sanctions, en notant que les sanctions ne sont pas appliquées de la même manière d’une personne à l’autre.
Certains gouvernements provinciaux et territoriaux se sont montrés ouverts à l’idée d’un mécanisme de plainte national. Ils ont reconnu que tous les gouvernements partagent le même objectif, soit de créer un milieu sportif sécuritaire pour tous. Ils ont également noté qu’un mécanisme de plainte national favoriserait une harmonisation à travers le Canada, ce qui est particulièrement important pour suivre et surveiller la prévalence de la maltraitance, ainsi que pour mesurer et identifier les tendances. Cela permettrait également d’assurer que les sanctions sont appliquées de manière cohérente dans tous les niveaux du sport et dans toutes les régions.
À l’inverse, certains autres gouvernements considèrent qu’il est idéaliste de penser à la mise en place d’un mécanisme de plainte unifié. Si la nécessité d’un contrôle national a été généralement reconnue, des représentants des gouvernements et d’autres participants ont souligné l’importance d’une contribution et d’une représentation régionales. Ils ont également souligné la nécessité de faire preuve de souplesse pour permettre aux provinces et aux territoires de déterminer leur propre manière de mettre en œuvre les principes généraux convenus.
Des avantages et des inconvénients ont été soulevés en ce qui concerne l’utilisation d’un mécanisme de plainte national pour les participants au niveau communautaire du sport. Dans les petites communautés, par exemple, un mécanisme national permettrait de renforcer l’anonymat et la confidentialité. Un obstacle possible au signalement pourrait être le manque de confiance ou de proximité vis-à-vis d’un service national.
Au cours de nos entretiens avec les participants, certains ont commenté la vaste portée du Programme canadien antidopage, notant que la plupart des violations des règles antidopage sont renvoyées au Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Ils se sont demandé si le Programme canadien de sport sécuritaire pouvait être élargi de manière similaire pour que sa portée soit plus large.
Bien que les règles du Programme canadien antidopage permettent l'adhésion d'organismes nationaux, provinciaux et territoriaux de sport, on nous a informés que les limites de financement posaient un défi. Le niveau de financement accordé au Centre canadien pour l’éthique dans le sport afin d'administrer le Programme canadien antidopage n’a permis sa mise en œuvre efficace qu’aux niveaux national et international du sport.
Enfin, nous notons que certains participants se sont demandé pourquoi les conflits liés au sport sécuritaire n’étaient pas renvoyés aux systèmes existants, comme le système de justice pénale, les tribunaux de santé et sécurité au travail et les tribunaux des droits de la personne.
Que se passe-t-il dans les autres pays?
Comme le Canada, de nombreux pays ont examiné en profondeur les politiques et les procédures de traitement des plaintes liées à la maltraitance dans le sport. Ces études approfondies ont été motivées par des cas très médiatisés d’abus d’athlètesNote de bas de page 133, ainsi que par des cas d’abus et de maltraitance d’enfants en milieu institutionnelNote de bas de page 134. Comme nous l’avons abordé aux chapitres 6 et 7, cela a conduit à des réformes majeures en matière de gouvernance et à des améliorations substantielles des initiatives en faveur du sport sécuritaire.
Au cours des travaux de la Commission, plusieurs pays ont été présentés comme des modèles potentiels pour le système sportif canadien, notamment l’Australie et le Royaume-Uni. Nous reconnaissons l’importance des réformes entreprises dans d’autres pays et les leçons précieuses qui peuvent en être tirées. Notre rapport final fournira une discussion plus détaillée des avancées et des meilleures pratiques d’autres pays, y compris celles du voisin géographique le plus proche du Canada, les États-Unis. Pour ce rapport préliminaire, nous nous concentrerons sur les pays qui ont été mentionnés le plus souvent dans les discussions et qui ont entrepris des études et des réformes approfondies.
La Commission a été mise en garde que la capacité d’importer les meilleures pratiques d’autres pays pourrait être limitée par l’étendue géographique du Canada et par son système fédéral de gouvernement.
Australie
Les réformes du système sportif australien ont été motivées par deux enquêtes majeures; la commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels d’enfants et l’examen des dispositions visant à préserver l’intégrité du sport en Australie (le « rapport Wood »).
Le volume 14 du « Final Report of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse » (le rapport final de la commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels d’enfants) a examiné spécifiquement les institutions de sport et de loisir et a formulé quatre recommandationsNote de bas de page 135 :
- Que toutes les institutions de sport et de loisir qui fournissent des services aux enfants ou pour les enfants mettent en œuvre les normes de la Commission sur la sécurité des enfants.
- Que le bureau national pour la sécurité de l’enfant crée un comité consultatif sur la sécurité des enfants dans le domaine du sport et des loisirs, composé de membres d’organisations gouvernementales et non gouvernementales.
- Que le programme Play By The Rules (jouez selon les règles) soit étendu et financé afin de créer des ressources pour le sport et les loisirs.
- Que les organismes de surveillance responsables de la mise en œuvre des normes pour la sécurité des enfants partagent par courriel des renseignements avec le secteur du sport et des loisirs.
Quant au rapport Wood, il a été commandé par le gouvernement australien en réponse à de grands scandales de dopage, à des condamnations pour trucage de matchs dans plusieurs sports et à des pressions internationales accrues liées aux menaces à l’intégritéNote de bas de page 136. Le rapport final contenait 52 recommandations, dont la création d’une commission nationale pour l’intégrité du sport chargée de la réglementation, de la surveillance, de l‘élaboration des politiques et de la mise en œuvre des programmesNote de bas de page 137.
Par ailleurs, à la suite de la sortie de « Athlete A » (athlète A), un documentaire détaillant les abus commis sur des athlètes par le médecin de USA Gymnastics, Larry Nassar, d’anciens athlètes et des parents d’athlètes en Australie se sont manifestés via les médias sociauxNote de bas de page 138. Cela a conduit Gymnastics Australia à demander un examen indépendant de la culture de la gymnastique à tous les niveaux du sport. Le rapport a formulé 12 recommandations, dont l’adoption par Gymnastics Australia du National Integrity Framework (le cadre national d’intégrité) et des politiques et procédures de plainte qui y sont liéesNote de bas de page 139.
Le cadre national d’intégrité
Lancé en 2021, le cadre national d’intégrité établit un ensemble de règles que tous les membres d’un sport doivent respecter en ce qui concerne leur comportement et leur conduite dans le sportNote de bas de page 140. Ces règles sont décrites dans quatre politiques :
- une politique de protection des enfants et des jeunes
- une politique de protection des membres
- une politique en matière de manipulation de compétitions et de jeux d’argent dans les sports
- une politique relative à l’usage malhonnête de drogues et de médicaments
Dans une cinquième politique, celle sur la politique en matière de plaintes, de litiges et de discipline, le cadre national d’intégrité définit également les procédures à suivre pour traiter les allégations liées à une violation de ces règlesNote de bas de page 141.
Le cadre national d’intégrité est un cadre volontaire que les organismes nationaux de sport, les organismes nationaux de sport pour les personnes en situation de handicap et d’autres organismes administratifs de sports agréés peuvent adopterNote de bas de page 142. Les plaintes relatives au cadre national d’intégrité sont traitées par Sport Integrity Australia ou par l’organisme de sportNote de bas de page 143.
Pour les organismes de sport qui n’adoptent pas le cadre national d’intégrité, Sport Integrity Australia examine leurs politiques pour assurer une cohérence au sein du système sportif.
Sport Integrity Australia
Créé en vertu du Sport Integrity Australia Act (2020) (la loi créant Sport Integrity Australia), Sport Integrity Australia a été mis en place pour prévenir et traiter les menaces à l’intégrité sportive et coordonner une approche nationale pour traiter des questions relatives à l’intégrité du sport en AustralieNote de bas de page 144. La loi confère à Sport Integrity Australia un droit de regard sur le système national antidopageNote de bas de page 145, les matchs truquésNote de bas de page 146 et d’autres questions liées à l’intégrité du sportNote de bas de page 147.
Sport Integrity Australia est un organisme qui fonctionne de manière indépendante. Toutefois, le ministre peut donner des instructions à la direction générale de l’organisme en ce qui concerne l’exécution de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirsNote de bas de page 148. La direction générale est par ailleurs supervisée par le conseil consultatif de Sport Integrity Australia. Ce conseil fournit des avis à la direction générale quant à ses fonctions et à celles de Sport Integrity AustraliaNote de bas de page 149. Ces avis sont strictement stratégiques et ne doivent pas se rapporter à une personne ou à un cas particulierNote de bas de page 150.
Mécanismes de plainte
La compétence de Sport Integrity Australia en matière de plaintes s’appuie sur deux sources : d’une part, l’adoption du cadre national d’intégrité par l’organisme sportif, et d’autre part, la nature de la plainte.
Plus précisément, lorsqu’un organisme sportif adopte le cadre national d’intégrité, Sport Integrity Australia gère les plaintes relatives à la protection des enfants et celles relatives à la discrimination fondée sur des caractéristiques protégées, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultesNote de bas de page 151. Toutes les autres plaintes sont traitées par l’organisme sportif conformément à la Complaints, Disputes and Discipline Policy (la politique en matière de plaintes, de litiges et de discipline) qui fait partie du cadre national d’intégrité.
La compétence de Sport Integrity Australia couvre tous les niveaux du sport, du niveau national au niveau communautaire. Cette compétence nationale découle de l’adoption d’instruments juridiques internationaux par le gouvernement australien, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mais puisqu’il s’agit d’un pays fédéré, comportant un Commonwealth (un gouvernement national) ainsi que des États et des Territoires (des gouvernements étatiques et territoriaux), il existe des limites constitutionnelles aux pouvoirs de chaque palier de gouvernement.
Par rapport aux plaintes, les pouvoirs de Sport Integrity Australia sont limités aux enquêtes et au soutien. L’organisme n’a pas la capacité d’émettre des sanctions. Ces sanctions relèvent plutôt de l’organisme de sport concerné. Bien que des orientations soient offertes aux organismes sportifs à cet égardNote de bas de page 152, il peut toujours y avoir des incohérences à travers le système.
Royaume-Uni
Comme mentionné au chapitre 6, la responsabilité du sport au Royaume-Uni est partagée entre plusieurs organismes. UK Sport supervise le sport de haut niveau en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles. En revanche, l’activité physique et le sport communautaire sont répartis entre les nations constitutives du Royaume-Uni et leurs organismes sportifs respectifs : l’Angleterre (Sport England), l’Irlande du Nord (Sport Northern Ireland), l’Écosse (Sport Scotland) et le Pays de Galles (Sport Wales).
Chacun de ces organismes constitutifs dispose de ses propres normes en matière de protection des enfants et des jeunes dans le sportNote de bas de page 153. Ces normes sont ancrées dans le principe juridique du « devoir de diligence ». Cette obligation signifie que les organismes sportifs et les personnes en position d’autorité ont la responsabilité de veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour assurer la sécurité des personnes qui participent aux activités sportives qu’elles proposent ou qu’elles soutiennentNote de bas de page 154.
Sport Integrity
À la suite des recommandations du rapport Whyte sur les allégations de maltraitance dans la pratique de la gymnastique, UK Sport a imposé une condition selon laquelle les organismes nationaux de sport (ou organismes nationaux de régie du sport) doivent utiliser Sport Integrity pour recevoir du financementNote de bas de page 155.
Lancé en mai 2022, Sport Integrity est un service de signalement téléphonique indépendant et confidentiel et un processus d’enquête indépendantNote de bas de page 156. Il est géré par Sport Resolutions, un service indépendant de résolution des conflits sportifs, et est soutenu par l’organisme caritatif CrimestoppersNote de bas de page 157.
Sport Integrity traite les allégations d’intimidation, de harcèlement, de discrimination et d’abus dans le sport de haut niveau. Il mène aussi des enquêtes. Sport Integrity ne traite toutefois pas les plaintes relatives à la lutte contre le dopage, aux jeux d’argent ou aux matchs truqués, ni les questions liées à la sélection des équipesNote de bas de page 158. Les services de Sport Integrity sont offerts, sans frais, aux athlètes, au personnel d’encadrement des athlètes et aux titulaires de charge qui participent aux programmes olympiques et paralympiques financés par UK Sport ou qui en assurent le fonctionnementNote de bas de page 159.
Sport à l’échelle locale
L’appartenance d’un sport ou d’une activité à un organisme national de régie du sport a des répercussions sur le sport local et communautaire. Pour les organismes locaux affiliés à un organisme national de régie du sport, les procédures de protection qui s’appliquent sont celles de cet organisme de régie du sport, et une personne en particulier est généralement désignée pour recevoir les plaintesNote de bas de page 160. Par ailleurs, la fiducie Ann Craft Trust, un autre organisme caritatif, apporte son soutien aux organismes nationaux de sport pour renforcer la protection des adultes en danger.
Lorsque des organismes locaux ne sont pas affiliés à un organisme national de régie du sport, il existe de multiples chemins possibles pour déposer une plainte. On peut, entre autres, s’adresser directement au personnel local ou à la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, un organisme caritatif de protection de l’enfance.
Leçons tirées des approches utilisées dans d’autres pays
Malgré de grands efforts, des politiques fortes et une volonté de changement, les pays suggérés à la Commission comme modèles pour le système canadien n’ont toujours pas de point d’entrée unique pour les plaintes ni d’approche véritablement unifiée pour gérer des plaintes. Nous avons constaté que des pays ont rencontré des problèmes de compétence pour créer un code et un mécanisme de plainte uniformes. Les efforts visant à créer un tel code ou mécanisme de plainte ont généralement été limités au sport de niveau national ou aux programmes sportifs de haut niveau.
Une exception, l’Australie, s’est appuyée sur des instruments juridiques internationaux pour atteindre le sport communautaire. Le champ de compétence de ces instruments était toutefois limité à leur objet, notamment la protection des enfants et la discrimination fondée sur des motifs protégés.
En l’absence de compétence juridique précise, les systèmes uniformes reposent sur des accords volontaires et contractuels et utilisent souvent le financement comme outil de persuasion. Des lacunes et des incohérences continuent d'exister dans ces systèmes.
Comme indiqué précédemment, le Canada n’est pas le seul pays à avoir entrepris un examen approfondi de son système sportif, notamment en ce qui concerne les politiques et les procédures de traitement des plaintes liées à la maltraitance. Durant ses activités de mobilisation, la Commission a entendu parler de nombreuses réformes et a rencontré des homologues et des experts internationaux afin de mieux comprendre le travail qui a été entrepris. La Commission est reconnaissante envers ces personnes et ces organisations pour leur franchise. Nous sommes conscients que c’est en travaillant ensemble, par le partage d’information, de meilleures pratiques et de leçons apprises, que le monde du sport peut relever ces défis. Tout comme il l’a fait pour la lutte contre le dopage à la suite de l’enquête Dubin, le Canada a l’occasion d’être à nouveau un chef de file pour le changement et la réforme du monde du sport.
Obstacles systémiques au signalement de la maltraitance dans le sport
Avant d’explorer nos conclusions et nos recommandations préliminaires concernant les cadres et les mécanismes qui permettent de répondre à la maltraitance dans le sport, il est important de souligner qu’il existe des obstacles au signalement de la maltraitance. La culture de la peur et du silence dans le sport est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne font pas de signalement.
Des personnes victimes, des personnes survivantes et des témoins nous ont dit à d’innombrables reprises qu’ils craignaient de dénoncer la maltraitance. Nous avons appris que les personnes qui dénoncent la maltraitance font souvent l’objet de représailles, ce qui renforce davantage une culture du silence et de méfiance.
Les personnes victimes ou survivantes ont raconté avoir subi de nombreuses formes de représailles pour avoir signalé la maltraitance:
- avoir été exclues des équipes et rejetées par leurs coéquipiers
- avoir été étiquetées comme des agents perturbateurs ou des « athlètes à problèmes »
- avoir été ignorées et intimidées
- avoir perdu leur statut d’athlète brevetée et été exclue d’organismes sportifs
- avoir perdu leurs bourses et leur financement
Nous avons également entendu dire que les mécanismes de plainte étaient instrumentalisés et que des plaintes étaient déposées à des fins de représailles contre des personnes ayant signalé de la maltraitance. Des tactiques d'intimidations sont utilisées pour contrôler et réduire les enfants au silence afin de les empêcher de parler de situation à leurs parents. Nous avons également entendu des parents qui n’osaient pas s’exprimer par crainte que leurs enfants subissent des représailles. D’autres personnes victimes ou survivantes ont reçu des instructions explicites de la part de leurs entraîneurs, de membres de conseil d’administration et d’autres personnes pour éviter qu’elles divulguent ou signalent les cas de maltraitance. Cette culture de la peur isole les personnes victimes ou survivantes.
Le risque de perdre du financement si des cas de maltraitance sont signalés ajoute une autre couche à la culture de la peur et du silence. Cela décourage encore plus les personnes et les organisations de signaler la maltraitance. Par exemple, les organismes de sport, leurs athlètes et les autres participants hésitent à informer Sport Canada et À nous le podium de leurs préoccupations de peur de perdre leur financement.
Il existe également une culture de l’inaction et de tolérance face à la maltraitance, ce qui décourage encore plus les signalements. Des personnes victimes ou survivantes et des témoins nous ont dit que lorsqu’ils ont fait part de leurs préoccupations à des entraîneurs, à des parents ou à d’autres adultes, leurs plaintes n’ont pas été prises au sérieux. Bien que de nombreux représentants d’organismes sportifs interviennent lorsqu’ils sont témoins d’un comportement inapproprié et ont connaissance de plaintes liées à la maltraitance, une réponse rapide et adéquate fait toutefois souvent défaut. Cela envoie un message aux personnes victimes ou survivantes que leur voix n’a pas d’importance et que rien ne changera.
Lorsque nous explorons les divers moyens qui pourraient améliorer le sport sécuritaire, nous devons toujours garder à l’esprit ces obstacles systémiques.
Réponses à la maltraitance dans le sport: conclusions et recommandations préliminaires
Politiques de sport sécuritaire et mécanismes de plainte : conclusions préliminaires
Comme l’explique le chapitre 15, le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport ne s’applique qu’aux participants au sport qui sont associés à des organismes sportifs qui l’adoptent. Les organismes nationaux de sport, les organismes nationaux de services multisports ainsi que les centres et instituts canadiens de sport financés par le gouvernement fédéral sont tenus d’adopter le Code de conduite universel comme condition pour recevoir des fonds de Sport Canada. Les autres organismes sportifs peuvent adopter le Code de conduite universel volontairement ou élaborer leur propre politique de sport sécuritaire ou leur propre code de conduite.
Comme nous l’avons aussi déjà expliqué dans ce chapitre, même lorsque des organismes sportifs adoptent le Code de conduite universel, le Programme canadien de sport sécuritaire n’est accessible que dans certains contextes et pour certains participants des organismes nationaux de sport, des organismes nationaux de services multisports ainsi que des centres et instituts canadiens de sport qui sont financés par le gouvernement fédéral.
Au niveau provincial et territorial, seules la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont adopté une politique ou un cadre obligatoire et « universel » de sport sécuritaire pour les organismes sportifs financés par la province et relevant de leur compétence. Par ailleurs, plusieurs provinces et territoires n’ont aucun mécanisme de plainte centralisé. Lorsque de tels systèmes existent, comme au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan, ils sont administrés par la fédération d’organismes sportifs de la province et s’appuient sur des mécanismes établis par des tiers indépendants. Le Québec, quant à lui, a adopté une loi établissant un mécanisme de plainte centralisé chargé de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les questions d’intégrité sportive dans la province.
En plus des politiques gouvernementales en matière de sport sécuritaire et des mécanismes de plainte « centralisés », les organismes sportifs disposent de mécanismes de plainte « privés » pour traiter les plaintes qui ne relèvent pas de la compétence des mécanismes de plainte centralisés. À cet égard, la plupart des organismes nationaux de sport ont recours à des mécanismes établis par des tiers indépendants, le plus souvent des professionnels ou des organismes externes chargés d’examiner les plaintes et de mener des enquêtes de manière indépendante.
L’ancien programme Sport Sans Abus, le nouveau Programme canadien de sport sécuritaire et leurs équivalents provinciaux et territoriaux (pour ceux qui existent) ont une applicabilité et une portée limitées dans l’ensemble du système sportif canadien. Ils n’atteignent pas le sport local et communautaire, où se produisent la plupart des cas de maltraitance.
Tout comme le système sportif lui-même, les politiques de sport sécuritaire et les mécanismes de plainte sont fragmentés. Les participants au sport sont renvoyés d’un mécanisme de plainte à un autre et ne savent pas à qui s’adresser pour déposer leur plainte. Au-delà du nombre de mécanismes de plainte centralisés et de mécanismes établis par des tiers indépendants à tous les niveaux du sport, il ne semble pas y avoir de normes de qualité convenue à la grandeur du système sportif canadien. Cela est vrai tant pour les mécanismes de plainte « centralisés » que pour les mécanismes établis par des tiers indépendants. Plusieurs participants ont exprimé des inquiétudes quant à l’indépendance des organismes agissant en tant que tiers indépendants et quant à la sélection, la qualification et l’indépendance des personnes chargées de rendre des décisions.
La Commission reconnaît le progrès réalisé par le gouvernement du Canada, par plusieurs organismes nationaux de services multisports et par certaines provinces et certains territoires, pour élaborer des politiques universelles de sport sécuritaire et centraliser l’administration des plaintes. Cependant, notre processus de mobilisation et notre examen indépendant des mécanismes existants nous amènent à la conclusion que, pour améliorer le sport sécuritaire au Canada:
- Il doit y avoir une plus grande uniformité et une meilleure harmonisation entre les politiques de sport sécuritaire et les mécanismes de plainte à travers le pays.
- Le ou les mécanismes de plainte « centralisés » doivent avoir une plus grande portée afin de couvrir les cas de maltraitance survenant au niveau communautaire du sport.
Tout comme pour les efforts de prévention, il est urgent de mettre en place des mécanismes plus solides pour répondre efficacement aux incidents de maltraitance dans le sport. Cet enjeu va bien au-delà du fait d’assurer la sécurité dans les milieux de haute performance. Il s’agit fondamentalement de préserver le bien-être des personnes, y compris des enfants, et de protéger la société dans son ensemble. Comme nous l’avons entendu à maintes reprises tout au long de notre travail, et comme il ressort de divers rapports gouvernementaux et d’experts publiés avant le nôtre, les cas de maltraitance imprègnent tous les niveaux du sport et sont particulièrement répandus au niveau communautaire.
Compte tenu du partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux abordé au chapitre 3, nous pensons que l’amélioration du sport sécuritaire au Canada ne peut se faire que par une importante collaboration entre les deux paliers de gouvernement.
À quoi ressemblerait un cadre de collaboration
De l’avis de la Commission, le gouvernement du Canada et la plupart des provinces et territoires ont manifesté leur intention d’unir leurs efforts pour « faire en sorte que les athlètes et les participants bénéficient d’un cadre sécurisant vers lequel se tourner pour signaler des incidents de maltraitance »Note de bas de page 161. C’est ce qui se dégage de la collaboration intergouvernementale entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (abordée au chapitre 3), et plus particulièrement de la « Déclaration de Red Deer – Pour la prévention du harcèlement, des abus et de la discrimination dans le sport »Note de bas de page 162 adoptée en 2019. Trois ans plus tard, lors de la Conférence des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs de 2022, il a également été convenu que :
- Les ministres travailleraient à instaurer, au sein de leur gouvernement, un mécanisme tiers indépendant prévoyant des processus de signalement et de gestion des allégations de maltraitance pour tous les organismes sportifs financés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial en 2023.
- Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport, ou une autre entité, pourrait être utilisé comme tiers indépendantNote de bas de page 163.
Le processus de mobilisation de la Commission auprès des provinces et des territoires démontre également une volonté politique de poursuivre la collaboration avec le gouvernement du Canada sur le thème du sport sécuritaire. Il existe un désir de mieux harmoniser et de mieux intégrer les processus actuels de signalement et la résolution des enjeux de sport sécuritaire dans l’ensemble des provinces et territoires et à tous les niveaux du sport. En fait, plusieurs provinces et territoires ont indiqué qu’ils accueilleraient favorablement un « mécanisme de plainte » ou un tribunal unifié et centralisé pour administrer le sport sécuritaire à la grandeur du pays, à condition qu’il soit entièrement financé par le gouvernement du Canada.
Par conséquent, l’un des axes de travail de la Commission, en ce qui concerne l’amélioration du sport sécuritaire au Canada, a été de réfléchir à différents cadres de collaboration. Ces cadres permettraient aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble non seulement pour établir des mécanismes gérés par des tiers indépendants dans leurs champs de compétence respectifs, mais aussi (i) d’uniformiser et harmoniser les mécanismes de plainte et (ii) s’assurer que leur portée s’étende au niveau communautaire du sport.
À la lumière de ce qui précède, la Commission présente ci-dessous trois options pour établir un cadre de collaboration intergouvernementale. Nous sommes d’avis que chacune de ces trois options permettrait une approche intégrée pour répondre aux enjeux de sport sécuritaire à tous les niveaux du système sportif canadien. Pour chaque option proposée, nous avons décrit ce que nous pensons être le rôle du gouvernement fédéral, ainsi que les avantages et les inconvénients que nous percevons. L’objectif de cet exercice est de donner aux participants l’occasion de délibérer sur les options proposées, que ce soit lors du sommet national ou par l’entremise d’autres activités de mobilisation avant que la Commission ne remette ses recommandations finales au gouvernement du Canada.
Nous souhaitons également souligner que chacune des options proposées ci-dessous valorise et intègre les progrès déjà réalisés par les gouvernements et les organismes sportifs. Nous sommes d'avis que les structures et mécanismes actuels sont généralement bien pensés, et les options que nous proposons viennent s’appuyer sur ce qui existe déjà afin de permettre à tous les athlètes et participants au sport canadien d’en bénéficier. Nous soulignons que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et son Programme canadien de sport sécuritaire pourraient servir de point de départ pour toutes les options proposées ci-dessous.
Enfin, nous souhaitons souligner que le Comité permanent de la condition féminine, dans son rapport de 2023 intitulé Il est temps d’écouter les survivantes : agir afin de créer un milieu sportif sécuritaire pour l’ensemble des athlètes au Canada, avait formulé la recommandation suivante : que « le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les peuples autochtones afin de garantir que les participants aux sports aient accès à un mécanisme indépendant de plainte en cas de maltraitance, soit par l’entremise du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport ou d’autres mécanismes indépendants, pour assurer la transparence en matière d’inconduite sexuelle, les ressources pour les survivantes et les survivants et l’égalité des services dans les provinces et territoires et entre eux »Note de bas de page 164.
Politiques de sport sécuritaire et mécanismes de plainte : recommandations préliminaires
Option 1 : Une autorité nationale ou un tribunal national du sport sécuritaire
La Commission recommande que :
- Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour créer une autorité nationale ou un tribunal national du sport sécuritaire afin de veiller à l’application de lois fédérales, et provinciale et territoriale en matière de sport sécuritaire.
Une première possibilité serait que le gouvernement du Canada conclut un accord avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d'établir un cadre de collaboration. Selon ce cadre, les deux paliers de gouvernement adopteraient une loi sur le sport sécuritaire et habiliteraient une autorité nationale ou un tribunal administratif national à appliquer ces lois fédérale, provinciale et territoriale en matière de sport sécuritaire. Un tel cadre de coopération pourrait notamment comprendre :
- Des lois provinciales et territoriales uniformes en matière de sport sécuritaire, applicables aux participants et aux athlètes impliqués aux niveaux provincial et communautaire du sport.
- Une loi fédérale complémentaire sur le sport sécuritaire applicable aux athlètes impliqués aux niveaux national et international du sport.
- Une autorité nationale unique ou un tribunal administratif national unique habilité par les deux paliers de gouvernement à appliquer et faire respecter la législation fédérale et provinciale en matière de sport sécuritaire.
- Un conseil de ministres composé des ministres provinciaux et territoriaux responsables du sport pour chaque province et territoire participant et du secrétaire d’État fédéral responsable du sport, qui supervise l’autorité nationale ou le tribunal national.
- Des bureaux du greffe dans chaque province et territoire participant afin d’offrir la même gamme de services aux athlètes et aux participants au sport.
Cette recommandation s’inspire de cadres de collaboration similaires qui ont été élaborés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans deux autres domaines de compétence partagée, à savoir la réglementation des valeurs mobilièresNote de bas de page 165 et les évaluations environnementalesNote de bas de page 166.
Bien que l’autorité nationale ou le tribunal administratif national du sport sécuritaire serait probablement un organisme gouvernemental établi par une loi fédérale, il pourrait tirer parti de l’expertise, du personnel, des processus et des procédures du Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
Avantages de l’option 1 :
- Tous les participants impliqués dans le sport (et pas seulement les participants des organismes sportifs qui reçoivent un financement du gouvernement) seraient soumis aux mêmes normes législatives en matière de sport sécuritaire.
- Cette option permettrait de créer un tribunal national unifié qui aurait compétence pour entendre et juger les plaintes relatives au sport sécuritaire à tous les niveaux du sport, du niveau national jusqu’au niveau communautaire.
- Cette option offrirait uniformité et clarté grâce à un point d’accès unique pour les personnes plaignantes.
- Cette option permettrait de simplifier les processus et d’éliminer la duplication des lois, des politiques et des mécanismes de plainte.
- Cette option améliorerait globalement l’expérience des personnes qui naviguent dans le système de sport sécuritaire.
- Un tribunal national ou un tribunal quasi judiciaire du sport sécuritaire garantirait l’équité procédurale
- Les décisions du tribunal national du sport sécuritaire pourraient faire l’objet d’une révision judiciaire devant les tribunaux.
Inconvénients de l’option 1 :
- Certaines provinces et certains territoires pourraient refuser d’adhérer au cadre de collaboration.
- Un tel cadre de collaboration présenterait un certain degré de nouveauté.
- Les règles de procédure d’un tribunal administratif national pourraient ne pas être suffisamment flexibles pour traiter efficacement les plaintes relatives au sport sécuritaire.
- Un tribunal national du sport sécuritaire pourrait ne pas convenir pour traiter toutes les plaintes déposées dans l’ensemble du pays, du niveau national jusqu’au niveau communautaire du sport.
- La réalité de chaque province et territoire et des différents niveaux de sport pourrait nécessiter des approches distinctes.
- Cette option entraînerait probablement des coûts importants pour le gouvernement du Canada, en particulier s’il devait financer entièrement le tribunal national du sport sécuritaire.
- Le volume de travail du tribunal national de sport sécuritaire pourrait rapidement devenir trop élevé.
Option 2 : Un organisme indépendant à but non lucratif à titre d’organisme de règlementation du sport sécuritaire
La Commission recommande que :
- Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux conviennent de déléguer l’administration d’une politique universelle de sport sécuritaire à un organisme indépendant à but non lucratif.
Une deuxième possibilité serait que le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux acceptent de déléguer l’administration d’une politique universelle de sport sécuritaire à un seul organisme indépendant à but non lucratif.
Comme indiqué plus tôt dans ce chapitre, cette approche « contractuelle » est actuellement utilisée par Sport Canada, qui a confié au Centre canadien pour l’éthique dans le sport le mandat d’administrer de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport par l'entremise des nouvelles règles du Programme canadien de sport sécuritaire. Ce programme ne s’applique toutefois qu’aux participants des organismes nationaux de sport, des organismes nationaux de services multisports et des centres et instituts canadiens de sport financés par le gouvernement fédéral.
Nous notons également que l’ancien programme Sport Sans Abus, contrairement au nouveau Programme canadien de sport sécuritaire, offrait aux provinces et aux territoires la possibilité d’y adhérer. Cela permettait aux plaintes émanant d’organismes sportifs financés par les provinces ou les territoires d’être administrées par l’ancien Bureau du commissaire à l’intégrité du sport. On nous a également dit que l’une des raisons pour lesquelles les provinces et les territoires ont choisi de ne pas adhérer au programme était son coût prohibitif. Pour rappel, le coût du programme Sport Sans Abus, contrairement à celui du nouveau Programme canadien de sport sécuritaire, devait être partagé par les personnes et les organismes qui l’utilisaient, y compris les organismes nationaux de sport.
Par conséquent, la Commission estime que le gouvernement du Canada devrait envisager un cadre de collaboration dans lequel :
- Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux apporteraient les modifications nécessaires au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport afin d’assurer son application à tous les niveaux du sport.
- Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux confieraient au Centre canadien pour l’éthique dans le sport la responsabilité d’administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport par l'entremise des règles du Programme canadien de sport sécuritaire.
- Le gouvernement du Canada exigerait que tous les organismes sportifs qui reçoivent des fonds fédéraux adoptent le Programme canadien de sport sécuritaire.
- Le gouvernement du Canada exigerait que tous les organismes nationaux de sport qui reçoivent des fonds fédéraux modifient leurs règles d’adhésion afin d’obliger tous les organismes provinciaux et territoriaux de sport qui en sont membres à adopter le Programme canadien de sport sécuritaire.
- Les gouvernements provinciaux et territoriaux exigeraient que tous les organismes sportifs qui reçoivent des fonds provinciaux ou territoriaux adoptent le Programme canadien de sport sécuritaire.
- Les gouvernements provinciaux et territoriaux exigeraient que tous les organismes provinciaux et territoriaux de sport qui reçoivent des fonds provinciaux ou territoriaux modifient leurs règles d'adhésion afin d’obliger les organismes communautaires de sport qui en sont membres à adopter le Programme canadien de sport sécuritaire.
Nous notons que cette approche a déjà été avancée et qu’elle est soutenue par d’éminents chercheurs dans le domaine du sportNote de bas de page 167.
La Commission souligne que le succès d’une telle approche d’harmonisation et d’expansion pour lutter contre la maltraitance dans le sport canadien repose non seulement sur la collaboration des gouvernements, mais aussi de manière essentielle sur une coopération considérable entre les organismes nationaux de régie du sport et les organismes sportifs qui en sont membres à tous les niveaux du sport.
La Commission invite à nouveau le gouvernement du Canada à encourager la participation des provinces et des territoires en finançant les activités du Centre canadien pour l’éthique dans le sport pour les organismes nationaux, provinciaux et territoriaux et communautaires de sport qui adhèrent au Programme canadien de sport sécuritaire.
Dans le cadre de l’option 2, la responsabilité de réviser et superviser le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport devrait être assignée à l’entité sportive centralisée (Abordée au chapitre 6). Jusqu’à ce que cette entité soit mise en place par le gouvernement du Canada, cette responsabilité devrait être celle de Sport Canada.
Avantages de l’option 2 :
- La même politique universelle de sport sécuritaire s’appliquerait à tous les participants des organismes sportifs recevant un financement d’un gouvernement participant ainsi qu'à tous les participants des organismes sportifs qui sont membres d’organismes de sport recevant des fonds d’un gouvernement participant.
- Cette approche « contractuelle » permettrait de mettre en place un mécanisme de plainte unique et unifié pour gérer les plaintes provenant (i) des participants des organismes sportifs qui reçoivent un financement du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux et territoriaux participants et (ii) des participants des organismes sportifs qui sont membres de ces organismes financés.
- Un organisme indépendant à but non lucratif comme le Centre canadien pour l’éthique dans le sport offrirait plus de souplesse dans ses procédures et processus qu’un organe quasi judiciaire.
Inconvénients de l’option 2 :
- Certaines provinces et certains territoires pourraient refuser d’adhérer au cadre de collaboration.
- Un organisme indépendant à but non lucratif comme le Centre canadien pour l’éthique dans le sport offrirait potentiellement moins d’équité procédurale qu’un organe quasi judiciaire.
- Les organismes de régie du sport (c’est-à-dire les organismes nationaux, provinciaux et territoriaux de sport) ne disposent pas toujours d’un pouvoir suffisant pour exiger de leurs membres qu’ils adoptent le Programme canadien de sport sécuritaire.
- Les décisions rendues par l’organisme indépendant à but non lucratif ne feraient pas l’objet d’une révision judiciaire devant les tribunauxNote de bas de page 168 (nous notons toutefois que les décisions rendues par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada font actuellement l’objet d’une procédure d’annulation devant la Cour supérieure de justice de l’OntarioNote de bas de page 169).
- Un organisme à but non lucratif est dirigé par un conseil d’administration et n’est donc pas à l’abri des problèmes de gouvernance.
Option 3 : Subventions conditionnelles aux provinces et aux territoires pour encourager la mise en œuvre d’une politique universelle de sport sécuritaire et d’un mécanisme de plainte centralisé dans le cadre de leur compétence respective
La Commission recommande que :
- Le gouvernement du Canada :
- maintienne le Centre canadien pour l’éthique dans le sport afin qu’il administre de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, par l’entremise du Programme canadien de sport sécuritaire et pour les participants des organismes sportifs financés par le gouvernement fédéral.
- accorde des subventions conditionnelles aux provinces et aux territoires pour leur permettre de mettre en place, dans leur région respective, un mécanisme provincial ou territorial centralisé de traitement des plaintes chargé d’administrer une politique universelle de sport sécuritaire pour les participants des organismes sportifs qu’ils financent. La politique universelle de sport sécuritaire et le mécanisme de plainte indépendant devraient répondre à certaines normes établies par le gouvernement du Canada.
Dans le cadre de cette troisième approche, le gouvernement fédéral s’appuierait sur son pouvoir de dépenser pour parvenir à une plus grande uniformité et à une plus grande clarté entre les politiques fédérales, provinciales et territoriales de sport sécuritaire et les mécanismes de plainte centralisés.
Cette recommandation s’appuie notamment sur des subventions conditionnelles semblables qui ont été jugées constitutionnelles par la Cour suprême du Canada dans le domaine de la santéNote de bas de page 170. En vertu de la Loi canadienne sur la santéNote de bas de page 171, qui définit l’objectif principal de la politique canadienne en matière de soins de santé, le gouvernement fédéral est tenu de contribuer au financement des programmes provinciaux d’assurance maladie lorsque certaines conditions sont remplies.
Dans le cadre de l’option 3, l’entité sportive centralisée dont il est question au chapitre 6 devrait avoir la responsabilité d'attribuer les subventions conditionnelles aux provinces et aux territoires. Jusqu’à ce que cette entité indépendante soit mise en place par le gouvernement du Canada, cette responsabilité devrait être celle de Sport Canada.
Avantages de l’option 3 :
- Des subventions fédérales conditionnelles aux provinces et territoires pourraient les encourager à adopter des politiques provinciales ou territoriales de sport sécuritaire et des mécanismes de plainte centralisés.
- Des subventions fédérales conditionnelles aux provinces et territoires permettraient d’uniformiser les politiques fédérales, provinciales et territoriales de sport sécuritaire et de centraliser les mécanismes de plainte.
- Cette approche permettrait probablement aux provinces et aux territoires, dont le Québec, de maintenir et d’améliorer leur mécanisme de plainte centralisé.
Inconvénients de l’option 3 :
- Les provinces et les territoires pourraient refuser la subvention fédérale et adopter leur propre politique de sport sécuritaire et leur propre mécanisme de plainte.
- Cette approche entraînerait probablement un coût important pour le gouvernement fédéral qui financerait à la fois le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et ses équivalents provinciaux et territoriaux.
- Le gouvernement fédéral aurait besoin de ressources pour vérifier si les politiques de sport sécuritaire et les mécanismes de plainte des provinces et des territoires respectent les conditions de financement.
Option 4 : Une législation fédérale sur la sécurité dans le sport et un tribunal fédéral
La Commission recommande que :
- Le gouvernement du Canada adopte une loi fédérale sur le sport sécuritaire et crée un tribunal fédéral du sport sécuritaire.
Une quatrième option, qui ne nécessiterait pas l’accord des provinces et des territoires, serait que le gouvernement fédéral intègre le contenu du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport dans une loi fédérale et crée un tribunal fédéral du sport sécuritaire. De l’avis de la Commission, une telle loi fédérale et la compétence d’un tribunal administratif fédéral devraient être limitées aux personnes qui font de la compétition, qui participent ou qui sont autrement engagées aux niveaux national ou international du sport au Canada.
Si cette approche présente certains avantages, elle ne répond pas, selon nous, à la nécessité d’avoir une plus grande uniformité et une meilleure harmonisation entre les politiques et les mécanismes sur le sport sécuritaire. Elle ne permettrait pas non plus d’atteindre un plus grand nombre de personnes à travers tous les niveaux du sport.
Avantages de l’option 4 :
- Intégrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport dans une loi permettrait d’assurer que les mêmes normes s’appliquent à toutes les personnes engagées dans le sport de niveau national ou international au Canada, peu importe que l’organisme national de sport reçoive ou non des fonds fédéraux.
- Un tribunal administratif fédéral établi par une loi fédérale aurait l’avantage de garantir l’équité procédurale.
- Les décisions rendues par ce tribunal pourraient faire l’objet d’une révision judiciaire.
Inconvénients de l’option 4 :
- Le champ d’application de la loi fédérale serait probablement limité aux personnes qui font de la compétition, qui participent ou qui sont autrement engagées aux niveaux national ou international du sport.
- Un tribunal administratif fédéral ne pourrait vraisemblablement traiter que les plaintes relatives au sport sécuritaire aux niveaux national et international du sport.
Une fois de plus, nous rappelons que l’objectif de cet exercice est de donner aux participants l’occasion de délibérer sur les options proposées, que ce soit lors du sommet national ou par l’entremise d’autres activités d’engagement. La Commission profitera certainement de tous les points de vue avant de présenter ses recommandations finales au gouvernement du Canada.
Soutien aux personnes touchées : conclusions et recommandations préliminaires
Processus et procédures de traitement des plaintes : conclusions préliminaires
La Commission a conclu que le système de sport sécuritaire est fragmenté. Il se compose de plusieurs mécanismes de plainte centralisés et de mécanismes établis par tiers indépendants pour traiter les plaintes qui ne relèvent pas de la compétence des mécanismes centralisés. Nous avons également constaté un manque de cohérence et d’uniformité entre ces mécanismes en ce qui concerne les processus de sélection des personnes chargées de rendre des décisions, leurs qualifications et les exigences qu’ils doivent respecter en matière d’indépendance.
Nous pensons que la même conclusion doit être tirée en ce qui concerne les processus et les procédures de traitement des plaintes, lesquels semblent diverger d’un mécanisme de plainte à l’autre. Il est important de noter que le mandat de la Commission ne comprenait pas l’évaluation des processus et des procédures de tous les mécanismes de plainte à travers les différents niveaux du système sportif canadien.
Les conclusions préliminaires suivantes portent sur les processus et les procédures du programme Sport Sans Abus, administré par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport jusqu’au 1eraoût 2025. Nos conclusions préliminaires portent également sur les mécanismes établis par de tiers indépendants qui ont été mandatés par des organismes nationaux et provinciaux de sport pour statuer sur les plaintes relatives au sport sécuritaire.
Étant donné que le Programme canadien de sport sécuritaire a démarré ses activités le 1er avril 2025, nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, de formuler des conclusions concernant son processus et ses procédures.
Les recommandations suivantes reflètent le point de vue initial de la Commission sur les principales caractéristiques que les processus et les procédures des mécanismes de plainte devraient posséder. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais plutôt d’un résumé des principaux thèmes et idées recueillis jusqu’à présent. Avant de soumettre nos recommandations finales au gouvernement du Canada, nous avons l’intention d’explorer et d’affiner davantage ces recommandations préliminaires par le biais d’un engagement continu auprès des participants.
Il n’existe aucune approche uniforme quant à la manière dont les plaintes sont reçues, évaluées, examinées ou résolues, que ce soit entre le programme Sport Sans Abus et les mécanismes établis par des tiers indépendants ou entre les divers mécanismes établis par ces tiers indépendants eux-mêmes. La Commission a toutefois noté plusieurs lacunes récurrentes dans leurs processus et leurs procédures. Ces lacunes ont été régulièrement signalées par les différentes parties concernées et ont également été identifiées par la Commission dans le cadre de son examen indépendant. En voici la synthèse :
- Les procédures de plainte sont souvent peu claires et inutilement complexes. Des participants ont du mal à comprendre comment le processus fonctionne, quelles sont les étapes à suivre et quels sont leurs droits et responsabilités à chaque étape. Cette confusion décourage la participation et sape la confiance dans les mécanismes de plainte.
- Les processus de plainte sont lents et leur résolution prend trop de temps, les dossiers traînant pendant des mois, voire des années. Ces retards entraînent un stress prolongé pour toutes les parties concernées et nuisent à l’efficacité et à la crédibilité des mécanismes de plainte.
- Les processus de plainte ne sont pas assez transparents. Cette situation, associée à un manque de communication et de partage d’information entre le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, les gestionnaires de dossiers, les personnes chargées d’enquêter, les personnes chargées de rendre des décisions et les parties concernées, diminue la confiance dans l’équité du processus dans son ensemble.
- Les processus de plainte sont souvent dépourvus d’un soutien adéquat pour les personnes concernées. Des participants ont souligné l’absence de ressources accessibles en matière d’aide juridique, l’accès limité au soutien en matière de santé mentale et le manque général d’aide pour franchir les différentes étapes du processus.
- Les processus et procédures de plainte ne tiennent pas suffisamment compte des traumatismes et ne prennent pas en considération les besoins et les sensibilités des personnes ayant subi des préjudices. La Commission a entendu à plusieurs reprises que le processus de plainte lui-même causait un nouveau traumatisme auprès des personnes plaignantes. Cette situation est principalement due aux lacunes mentionnées ci-dessus : des procédures complexes, peu claires et non transparentes, un manque d’aide pour cheminer dans le système et l’absence d’accès à une représentation ou à des conseils juridiques. Des personnes plaignantes ont également décrit des interactions insensibles avec du personnel non formé et des approches trop rigides d’un point de vue juridique, ce qui n’a fait qu’aggraver leur détresse.
- Les processus et les procédures de plainte ne permettent pas d'assurer une procédure juste et équitable. La Commission nourrit de sérieuses inquiétudes quant à l’équité procédurale, en particulier pour les personnes intimées. Nos préoccupations portent notamment sur l’application incohérente des règles de procédure, sur le fait que la communication d’information et la possibilité d’être entendu sont inadéquates et sur l’accès insuffisant à une représentation juridique.
- L’exécution et la supervision des sanctions font défaut. Les sanctions imposées par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (en particulier par le Directeur des sanctions et résultats) et par des tiers indépendants ne sont pas appliquées de manière constante par les organismes sportifs. De plus, il manque de supervision pour assurer le respect des sanctions imposées.
En ce qui concerne les mécanismes établis par des tiers indépendants, plusieurs participants ont également exprimé des inquiétudes quant à leur capacité à garantir la confidentialité pendant tout le processus de plainte.
De l’avis de la Commission, soutenir la guérison exige que les processus et les procédures de plainte soient clairs, directs, rapides et transparents. Il est également important de fournir un soutien approprié et accessible, y compris un accompagnement pour cheminer dans le processus et des ressources d’aide juridique.
Enfin, les processus et les procédures de plainte doivent donner la priorité aux pratiques tenant compte des traumatismes, tout en incorporant des règles de procédure justes et équitables pour les personnes plaignantes et les personnes intimées. Les approches tenant compte des traumatismes ne doivent pas être considérées comme étant incompatibles avec l’équité procédurale. Au contraire, elles peuvent jouer un rôle essentiel pour assurer l’équité et la sensibilité tout au long du processus de plainte.
Processus et procédures de traitement des plaintes : recommandations préliminaires
La Commission recommande donc que :
- Tous les processus et toutes les procédures de plaintes relatifs au sport sécuritaire au Canada :
- soient clairs, simples et facilement accessibles à tous. Ils doivent être conçus de manière à minimiser la confusion, à réduire les obstacles procéduraux et à garantir que les personnes comprennent leurs droits, leurs responsabilités et les étapes du processus.
- soient rapides et efficaces. Des délais clairs et des mesures d’imputabilité doivent être établis et appliqués pour garantir une résolution rapide des différends.
- tiennent compte des traumatismes et soient adaptés aux personnes qui ont subi des préjudices. Cela ne signifie pas de compromettre l'équité procédurale, mais plutôt qu’il est nécessaire de veiller à ce que toutes les étapes du processus de traitement des plaintes soient menées avec sensibilité, respect et soutien afin d’éviter un nouveau traumatisme.
- assurent des procédures justes et équitables pour toutes les parties concernées, notamment pour assurer l’équité, l’impartialité, le droit d’être entendu, une communication adéquate de l’information et des garanties procédurales tant pour les personnes plaignantes que pour les personnes intimées, et ce, à toutes les étapes du processus.
- comprennent des mesures de suivi et d’imputabilité pour assurer que les organismes sportifs appliquent correctement les sanctions.
- Tous les mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire au Canada :
- soient transparents et assurent une communication constante avec toutes les parties concernées.
- offrent une assistance appropriée pour aider les personnes à cheminer dans la procédure et prévoient la désignation de gestionnaires de dossiers pour servir d’intermédiaires entre les parties et les personnes chargés d’enquêter ou les personnes chargées de rendre des décisions et pour répondre aux questions ou aux préoccupations relatives à la procédure.
- offrent des ressources d’aide juridique à toutes les parties concernées. Les personnes plaignantes et les personnes intimées doivent avoir un accès équitable à des conseils ou à une représentation juridique pour les aider à comprendre leurs droits et à participer efficacement au processus.
À cet égard, la Commission fait écho à la recommandation du Comité permanent du patrimoine canadien, dans son rapport intitulé La pratique sécuritaire du sport au Canada, que « le gouvernement du Canada établisse un processus officiel pour enquêter sur les cas de mauvais traitements et de violence sexuelle et physique dans le système sportif canadien, dans une optique éclairée qui tient compte des traumatismes et qui est axée sur les survivants »Note de bas de page 172.