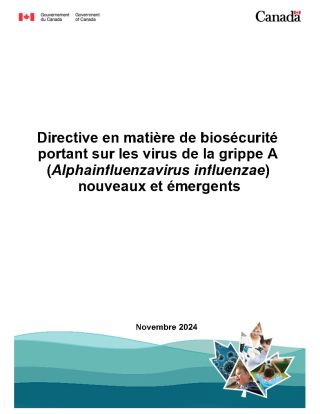Directive en matière de biosécurité portant sur les virus de la grippe A (Alphainfluenzavirus influenzae) nouveaux et émergents
Télécharger le format de rechange
(Format PDF, 1.2 Mo, 48 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Date publiée : Novembre 2024
Cat. : HP45-39/2024F-PDF
ISBN : 978-0-660-73008-0
Pub. : 240416
Aperçu
La présente directive fournit un aperçu complet des niveaux de confinement appropriés et des pratiques opérationnelles supplémentaires pour la manipulation d'échantillons qui pourraient, sont soupçonnés ou confirmés comme contenant une souche nouvelle ou émergente du virus de la grippe A. La présente directive a été révisée afin d'harmoniser les recommandations et les pratiques exemplaires avec le contenu mis à jour de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition.
Personnes visées par cette directive
- Titulaires de permis visant des agents pathogènes et des toxines
- Titulaires de permis d'importation/de transfert d'agents zoopathogènes
- Employés de laboratoires de diagnostic
- Agents de la sécurité biologique
Sur cette page
- Abréviations et sigles
- Résumé
- 1.0 Contexte
- 2.0 Description de l'agent pathogène et classification de groupe de risque
- 3.0 Types d'échantillons, de cultures et d'activités
- 4.0 Exigences relatives au niveau de confinement
- 5.0 Coordonnées
- 6.0 Glossaire
- 7.0 Références
Abréviations et sigles
- ABCSE
- Agent biologique à cote de sécurité élevée
- ACIA
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- APAT-DA
- Agent pathogène d'animaux terrestres désigné par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
- ASPC
- Agence de la santé publique du Canada
- ENC
- Évaluation du niveau de confinement
- ELR
- Évaluation locale des risques
- ERAAP
- Évaluation des risques associés à l'agent pathogène
- ESB
- Enceinte de sécurité biologique
- GR
- Groupe de risque (c.-à-d. GR1, GR2, GR3, GR4)
- IAFP
- Influenza aviaire faiblement pathogène
- IAHP
- Influenza aviaire hautement pathogène
- ICL
- Infection contractée en laboratoire
- LAPHT
- Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
- LSA
- Loi sur la santé des animaux
- NC
- Niveau de confinement (c.-à-d. NC1, NC2, NC3, NC4)
- NC2-Ag
- NC2-Agriculture (c.-à-d. zone de confinement de gros animaux de NC2)
- NC3-Ag
- NC3-Agriculture (c.-à-d. zone de confinement de gros animaux de NC3)
- NCB
- Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition
- OMS
- Organisation mondiale de la Santé
- PON
- Procédure opératoire normalisée
- PSA
- Plan de surveillance administrative
- RAPHT
- Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
- RSA
- Règlement sur la santé des animaux
- Zone GA
- Zone de confinement de gros animaux
- Zone PA
- Zone de confinement de petits animaux
Résumé
- Les souches nouvelles ou émergentes du virus de la grippe (influenza) A qui n'ont pas été attribuées à un groupe de risque sont considérées comme des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes de groupe de risque 3 (GR3) jusqu'à ce qu'une évaluation des risques associés à l'agent pathogène ait été complétée. Ces souches doivent être manipulées dans une installation de niveau de confinement 3 (NC3) et entreposées conformément aux exigences applicables de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB), sauf en cas d'indication contraire de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
- Une fois identifiées comme telles, toutes les souches d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont considérées des agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE) et des agents pathogènes d'animaux terrestres désignés par l'ACIA (APAT-DA). De ce fait, elles doivent être manipulées dans une installation qui satisfait aux exigences minimales applicables aux ABCSE et aux agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres énoncées dans les chapitres 3, 4 et 5 de la NCB. Veuillez vous référer à la section 2.2.1.1 de la présente directive pour des considérations supplémentaires.
- Dans le cas des virus de vaccins candidats contre la grippe A, des tests pour évaluer leur sécurité et les niveaux de confinement proposés pour leur manipulation sont décrits dans la Série de rapports techniques numéro 1016, annexe 3 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Guidelines for the safe development and production of vaccines to human pandemic influenza viruses and influenza viruses with pandemic potential (en anglais seulement), modifiées de temps à autre.
- Il est fortement recommandé que les laboratoires de NC2 dans lesquels sont effectuées des activités d'identification de la grippe A (p. ex. dans un contexte de diagnostic), lesquels sont exempts de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines ou auxquels des exclusions s'appliquent en vertu de la LAPHT, adoptent les pratiques opérationnelles supplémentaires détaillées dans la section 4.3.
- La présente directive ne s'applique pas aux souches saisonnières de la grippe A en circulation chez l'humain, lesquelles sont des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes de GR2 et peuvent être manipulées au NC2. Ces souches comprennent les virus de la grippe A qui sont adaptés à l'humain et causent des éclosions saisonnières. Ces souches sont définies en fonction des conclusions du programme de surveillance internationale de l'OMS en consultation avec les centres collaborateurs de l'OMS pour déterminer la composition optimale des vaccins.
- Une fois la matière biologique complètement inactivée (c.-à-d. rendue complètement non infectieuse), les procédures de laboratoire subséquentes avec la matière inactivée ne sont pas réglementées par l'ASPC ou l'ACIA.
1.0 Contexte
Les mots en gras sont définis dans le glossaire à la section 6.0.
Au Canada, la manipulation ou l'entreposage des agents pathogènes humains ou des toxines de groupe de risque 2 (GR2), GR3 et GR4 est réglementé en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT)Note de bas de page 1Note de bas de page 2. La manipulation et l'entreposage d'agents zoopathogènes importés de GR2, GR3 et GR4 ou de parties de ceux-ci (p. ex. une toxine) sont réglementés en vertu de la Loi sur la santé des animaux (LSA) et du Règlement sur la santé des animaux (RSA)Note de bas de page 3Note de bas de page 4.
En vertu de la LAPHT et du RAPHT, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) réglemente la manipulation et l'entreposage des agents pathogènes humains et des toxines. De plus, en vertu de la LSA et du RSA, l'ASPC réglemente l'importation et la réception ou le transfert subséquents d'agents pathogènes indigènes d'animaux terrestres ou de parties de ceux-ci dans une culture pure ou dans une matrice ne provenant pas d'animaux (p. ex. un échantillon humain, de plante, alimentaire ou environnemental), à l'exception des agents pathogènes d'abeilles ou de parties de ceux-ci.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglemente l'importation et la réception ou le transfert subséquents des autres agents zoopathogènes ou des parties de ceux-ci en vertu de la LSA et du RSA. Ceci comprend les agents pathogènes d'animaux terrestres désignés par l'ACIA (APAT-DA), tout agent pathogène d'animaux terrestres contenu dans un animal, un produit ou un sous-produit animal (p. ex. des tissus, du liquide allantoïdien, du sérum), les agents pathogènes d'abeilles et les agents pathogènes d'animaux aquatiques. APAT-DA est un terme utilisé pour regrouper les maladies animales exotiques (MAE), les maladies animales émergentes (MAÉ) et les agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sous l'autorité de l'ACIA.
Les agents pathogènes sont attribués à un groupe de risque et à un niveau de confinement en fonction d'une évaluation des risques associés à l'agent pathogène (ERAAP) et d'une évaluation du niveau de confinement (ENC) effectuées par l'ASPC et l'ACIA. Une ERAAP évalue les caractéristiques inhérentes à un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique), y compris la pathogénicité, la virulence, la transmissibilité, la gamme d'hôtes et la disponibilité de traitements prophylactiques ou thérapeutiques efficaces. Les catégories de groupe de risque vont du groupe de risque 1 (GR1) (risque faible pour la personne et faible pour la communauté) au GR4 (risque élevé pour la personne et élevé pour la communauté). Les définitions des groupes de risque et une liste des facteurs de risque associés aux agents pathogènes sont disponibles dans la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB) et dans la Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – Évaluation des risques associés à l'agent pathogène, respectivement Note de bas de page 5Note de bas de page 6. L'ENC examine les risques associés à un agent pathogène, tels que détaillés dans l'ERAAP et évalue si les exigences minimales en matière de confinement correspondant à la classification de groupe de risque de l'agent pathogène atténuent ces risques. Elle prend également en compte si des précautions supplémentaires pourraient être justifiées dans certaines situations, ou si des exemptions à des exigences physiques en matière de confinement spécifiques ou à des exigences opérationnelles spécifiques pourraient être considérées.
La NCB énonce les exigences physiques en matière de confinement, les exigences opérationnelles et les exigences relatives aux essais de vérification et de performance minimales qui s'appliquent aux installations où sont manipulés et entreposés des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines de GR2, GR3 et GR4Note de bas de page 5. En général, le niveau de confinement et le groupe de risque d'un agent pathogène sont les mêmes (p. ex. les agents pathogènes de GR2 sont généralement manipulés au niveau de confinement 2 [NC2]); il y a toutefois des exceptions. Plusieurs des exigences physiques en matière de confinement et des exigences opérationnelles au NC3 visent à réduire les risques associés aux agents pathogènes aéroportés ou transmis par les aérosols. De ce fait, certaines activités impliquant des agents pathogènes de GR3 qui ont un risque plus faible de transmission par les aérosols (p. ex. certaines activités de diagnostic) peuvent parfois être effectuées à un niveau de confinement inférieur tant que les pratiques opérationnelles nécessaires sont en place pour atténuer les risques associés à cette activité.
Les directives en matière de biosécurité, telles que celle-ci, décrivent les exigences en matière de confinement pour certains types d'activités avec un agent pathogène ou un groupe d'agents pathogènes spécifiques lorsque le niveau de confinement ne s'aligne pas directement avec le groupe de risque. La présente directive en matière de biosécurité a été élaborée par l'ASPC et l'ACIA pour aider les installations à déterminer le niveau de confinement approprié et les pratiques opérationnelles supplémentaires pour la manipulation sécuritaire des échantillons soupçonnés ou confirmés de contenir une souche de virus de la grippe (influenza) A nouvelle ou émergente. La présente directive en matière de biosécurité présente un aperçu complet des résultats de l'évaluation des risques, des décisions subséquentes relatives à l'ENC et des considérations pour ceux travaillant avec des virus de la grippe A nouveaux ou émergents.
La présente Directive en matière de biosécurité portant sur les virus de la grippe A (Alphainfluenzavirus influenzae) nouveaux et émergents doit être utilisée conjointement avec la NCB. Des renseignements plus complets sur la surveillance réglementaire des agents pathogènes et des toxines au Canada sont disponibles dans la série de Lignes directrices canadiennes sur la biosécuritéNote de bas de page 7. Les parties réglementées auxquelles l'ASPC a délivré un permis visant des agents pathogènes et des toxines, ou auxquelles l'ACIA a délivré un permis d'importation et/ou de transfert d'agent pathogène d'animaux terrestres, pourraient devoir respecter la présente directive en matière de biosécurité en tant que condition de leur permis.
Certaines installations où sont manipulés ou entreposés des virus de la grippe A nouveaux et émergents pourraient être exclues ou exemptes de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la LAPHT et du RAPHT. Deux Déclarations d'intention de l'ASPC ainsi que les sections 1.1.1 et 1.1.2 de la NCB y font référenceNote de bas de page 5Note de bas de page 8Note de bas de page 9. Dans les situations où les activités effectuées avec des virus de la grippe A nouveaux et émergents sont exclues de la LAPHT ou lorsque les installations sont exemptes de l'exigence relative à la délivrance de permis visant des agents pathogènes et des toxines en vertu de la LAPHT et du RAPHT, l'ASPC recommande fortement de suivre le contenu énoncé dans la présente directive. Il est important de noter que, bien qu'il y ait des exclusions et des exemptions en vertu de la LAPHT, celles-ci n'ont pas d'impact sur les exigences réglementaires en vigueur en vertu du RSA, lesquelles doivent tout de même être respectées.
Les exemptions et les exclusions ne s'appliquent pas aux activités avec des matières importées ou leurs dérivés qui pourraient contenir, sont soupçonnés de contenir, ou contiennent une souche de grippe A nouvelle ou émergente. Ceci comprend les cultures, les échantillons primaires humains, les échantillons primaires animaux, les échantillons environnementaux et les produits et sous-produits animaux, puisque ceux-ci sont réglementés en vertu de l'article 51 du RSA. Les exigences relatives aux laboratoires de diagnostic et aux cliniques vétérinaires se trouvent à la section 4.1 de la présente directive.
2.0 Description de l'agent pathogène et classification de groupe de risque
Les virus de la grippe sont membres de la famille des Orthomyxoviridae et ont un génome constitué d'acide ribonucléique (ARN) monocaténaire segmenté à polarité négativeNote de bas de page 10. Cette famille est composée des virus de la grippe A, B, C et D. La grippe C est endémique dans le monde entier et est généralement associée à des infections légèresNote de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13. La grippe D a été identifiée récemment dans des populations animales, mais il n'y a aucun cas connu de transmission à l'humainNote de bas de page 14. Des variants des virus de la grippe A et B circulent à travers le Canada et causent la grippe saisonnière, qui est l'une des principales causes d'infections respiratoires aiguës chez l'humainNote de bas de page 15. Au Canada, il est estimé que 12 200 cas d'hospitalisation et 3 500 décès liés à la grippe se produisent chaque annéeNote de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 18. Bien que le virus de la grippe B ait causé des épidémies, il n'a pas causé de pandémiesNote de bas de page 19. La grippe A est considérée comme étant le virus de la grippe ayant le plus d'impact sur la santé humaine et animale, et a causé plus d'une douzaine de pandémies documentées depuis les années 1700Note de bas de page 13. Depuis 2020, une épizootie de grippe A (H5N1) a mené à des éclosions chez les oiseaux sauvages, les mammifères et la volaille d'élevage, ainsi qu'un nombre considérable de décès chez les espèces aviaires en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du NordNote de bas de page 20.
2.1 Les virus de la grippe A
Les virus de la grippe A sont actuellement attribués à l'espèce Alphainfluenzavirus influenzae et sont classés en sous-types en fonction de la caractérisation des glycoprotéines de surface, l'hémagglutinine (H1 à H18) et la neuraminidase (N1 à N11)Note de bas de page 11. La protéine hémagglutinine se lie aux récepteurs qui sont exprimés à la surface des cellules épithéliales des voies respiratoires supérieures ou inférieuresNote de bas de page 21. La neuraminidase est une enzyme qui clive un virus lié à des cellules hôtes pour permettre une plus grande distribution.
Les virus de la grippe A sont endémiques dans le monde entier. Ils peuvent infecter et causer des maladies allant de légères à graves chez l'humain et chez une large gamme d'animaux, y compris les porcs et les oiseauxNote de bas de page 22Note de bas de page 23. Les virus de la grippe porcine A causent régulièrement des éclosions de maladies respiratoires chez les porcs et, bien qu'une maladie grave puisse survenir, les décès sont peu courantsNote de bas de page 24. Les virus de la grippe aviaire A existent généralement comme des résidents inoffensifs (c.-à-d. non pathogènes) de l'intestin de leurs hôtes naturels, soit les sauvagines et les oiseaux de rivage, mais ils peuvent infecter la volaille et d'autres espèces d'oiseaux et causer des maladiesNote de bas de page 22.
Une infection par un virus de la grippe aviaire A chez la volaille peut causer une maladie allant de légère à grave, tout dépendant du profil génétique du virus. Ainsi, en plus d'être classés en fonction de leur hémagglutinine et leur neuraminidase, les virus de la grippe aviaire A sont classés en fonction de leur pathogénicité chez la volaille. L'infection par le virus de la grippe aviaire A chez la volaille entraîne généralement une maladie légère, auquel cas cette souche est classée en tant qu'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP). L'IAFP peut évoluer ou muter en une forme d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) qui cause généralement des maladies graves avec des taux de mortalité élevés chez la volailleNote de bas de page 25. Un exemple de ceci est la grippe A (H5N1) qui existe à la fois sous forme d'IAFP et d'IAHP. À ce jour, les IAHP ont seulement été identifiés parmi les sous-types H5 et H7, lesquels ont fait l'objet de surveillance du virus de la grippe A chez la volaille à l'échelle mondiale (p. ex. H5N1, H5N2, H5N8, H7N9)Note de bas de page 26Note de bas de page 27Note de bas de page 28Note de bas de page 29Note de bas de page 30.
La transmission interhumaine des virus de la grippe humaine A peut se faire par inhalation de gouttelettes ou d'aérosols infectieux, ainsi que par contact direct ou indirect des muqueuses avec des surfaces contaminéesNote de bas de page 22. La transmission zoonotique du virus de la grippe A peut survenir par le contact des muqueuses avec des sécrétions, des excrétions ou des tissus infectieux lors de la manipulation d'animaux infectés ou lors de la consommation de volaille infectée qui n'est pas suffisamment cuiteNote de bas de page 31Note de bas de page 32.
2.1.1 Virus de la grippe A nouveaux et émergents
Une souche du virus de la grippe A est considérée comme nouvelle ou émergente par l'ASPC et l'ACIA si elle répond à l'un des critères suivantsNote de bas de page 33Note de bas de page 34 :
- Il s'agit d'un nouvel agent pathogène pour les hôtes humains ou animaux, d'origine naturelle ou issue du génie génétique.
- Il s'agit d'un nouvel agent pathogène résultant de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant.
- Il s'agit d'un agent pathogène existant qui a été introduit (ou réintroduit) dans une nouvelle population hôte sans immunité ou à faible immunité, ou qui se propage dans une nouvelle zone géographique.
- Il s'agit d'un agent pathogène existant dont l'incidence augmente dans la population hôte à la suite de modifications non caractérisées de l'agent pathogène.
Au Canada et partout dans le monde, des virus de la grippe A nouveaux et émergents sont identifiés fréquemment. L'adaptation et l'émergence de nouvelles souches de virus de la grippe A sont causées par des dérives antigéniques et des cassures antigéniques, lesquelles affectent fréquemment les antigènes de surface hémagglutinine et neuraminidase ainsi que d'autres gènes viraux. Une dérive antigénique se produit lorsque de petites modifications dans le génome du virus se produisent au fil du temps, générant éventuellement de nouvelles souches qui sont antigéniquement différentes des souches existantesNote de bas de page 22Note de bas de page 35. Ceci est courant dans les souches en circulation du virus de la grippe saisonnière, lesquelles peuvent subir quelques variations génétiques sans affecter leur pathogénicité chez l'humain de manière significative. Une cassure antigénique est un type de modification qui peut produire une souche complètement nouvelle à la suite d'un réassortiment génétique ou d'une nouvelle transmission zoonotique d'une source animale à un humainNote de bas de page 35. Une nouvelle souche, en particulier une souche qui résulte d'une cassure antigénique, a le potentiel d'introduire une combinaison de glycoprotéines qui n'a jamais été observée auparavant dans les souches en circulation existantes. Ceci peut mener à des changements de pathogénicité soudains et à des éclosions inattendues dans la communauté.
En raison de l'émergence imprévisible de nouvelles souches, il y a généralement un délai entre la détection d'un virus de la grippe A nouveau ou émergent et la communication de conseils appropriés en matière de biosécurité. Souvent, des conseils sont nécessaires pour les installations où ces agents pathogènes sont manipulés avant qu'ils aient été bien caractérisés et que leurs risques spécifiques aient été identifiés. De ce fait, les virus de la grippe A nouveaux ou émergents qui n'ont pas été attribués à un groupe de risque doivent être manipulés au NC3 et entreposés conformément aux exigences applicables de la NCB.
2.1.1.1 Modifications génétiques
Un réassortiment génétique peut se produire lorsque deux virus de la grippe distincts infectent un seul hôte de manière simultanée et échangent de l'information génétiqueNote de bas de page 11. Le processus d'évolution naturelle peut être lié à la génération de virus de la grippe à potentiel pandémique, puisque les nouvelles combinaisons de gènes des virus réassortis ne sont souvent pas reconnues par le système immunitaire de l'hôteNote de bas de page 36Note de bas de page 37. La pandémie de H1N1 de 2009 (grippe A[H1N1]pdm2009), un virus d'origine porcine transmissible à la population humaine, en est un exempleNote de bas de page 22Note de bas de page 38.
Certains animaux sont plus susceptibles au réassortiment génétique, ce qui augmente la possibilité de créer une nouvelle souche à potentiel pandémique. Les récepteurs préférés des virus de la grippe A humaine et aviaire se trouvent parmi les récepteurs exprimés sur les cellules épithéliales du système respiratoire des porcsNote de bas de page 39. Ainsi, les porcs sont susceptibles non seulement aux virus de la grippe A endémiques chez les porcs, mais aussi à ceux qui sont d'origine humaine et aviaire, et peuvent donc agir comme un hôte facilitant les mélanges avec un potentiel élevé de réassortiment génétique. En fait, des virus de la grippe porcine A réassortis portant des gènes de virus de la grippe porcine, humaine et aviaire ont été identifiésNote de bas de page 40. De même, les animaux transgéniques peuvent également être susceptibles aux virus de la grippe A qui proviennent de différentes espèces, ce qui augmente le risque de réassortiment génétique de la souche.
Le réassortiment génétique est également un mécanisme qui peut être utilisé pour la production de vaccins contre les virus de la grippe en co-infectant intentionnellement un hôte avec un virus atténué et une souche pandémique de la grippe pour obtenir un virus de la grippe réassorti atténué. En raison de la nature imprévisible des virus, le réassortiment génétique utilisé pour la production de vaccins contre les virus de la grippe doit être effectué avec précaution, puisque le virus de la grippe produit pourrait aussi être un virus avec une virulence accrueNote de bas de page 38.
La manipulation génétique du virus en laboratoire peut aussi modifier sa gamme d'hôtes, sa pathogénicité et son profil antigénique. Des souches peuvent être créées artificiellement par génétique inverse, une méthode par laquelle des plasmides contenant tous les gènes requis de la grippe sont utilisés pour transfecter des cellules permissives et créer un virus de la grippe actif biologiquement, y compris des virus réassortisNote de bas de page 38. Ces souches créées de virus de la grippe A sont des outils importants pour comprendre la biologie du virus, les mécanismes d'infection, ainsi que pour développer des vaccinsNote de bas de page 35. Bien que les méthodes de génétique inverse réduisent généralement la virulence en créant des mutations dans les gènes viraux, ces activités doivent être effectuées avec prudence, car les mutations survenant dans ces souches réassorties peuvent possiblement rétablir ou augmenter la virulenceNote de bas de page 35.
Le passage en série de virus de la grippe A recombinants à travers différents modèles animaux, tels que les porcs, les furets et les cochons d'Inde, doit aussi être effectué avec prudence, puisqu'il peut en résulter une pathogénicité et une transmissibilité accrues des virus de la grippe ANote de bas de page 41.
2.2 Classification de groupe de risque et évaluation du niveau de confinement
2.2.1 Classification de groupe de risque
Les classifications de groupe de risque humain et animal de plusieurs souches de virus de la grippe A sont disponibles dans ePATHogène – la base de données sur les groupes de risque de l'ASPCNote de bas de page 42.
Il a été déterminé par l'ASPC et l'ACIA que les souches saisonnières de la grippe A en circulation chez l'humain sont des agents pathogènes humains de GR2 et peuvent être manipulées au NC2. Celles-ci comprennent les virus de la grippe qui sont adaptés aux humains et causent des éclosions saisonnières. Celles-ci ne comprennent pas les sous-types 1918 H1N1, H2N2 et les IAHP. Les souches sont définies en fonction des conclusions du programme de surveillance internationale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en consultation avec les centres collaborateurs de l'OMS afin de déterminer la composition optimale des vaccins.
Les souches de grippe A nouvelles ou émergentes peuvent avoir une pathogénicité et une virulence accrues chez l'humain et chez les animaux. Elles peuvent également échapper à l'immunité existante de la population et aux vaccins ou traitements actuels. Ceci a été observé avec des souches impliquées dans des éclosions et des pandémies de grippe humaine et aviaire, comme les sous-types d'IAHP H5N1, H5N2, H5N8 et H7N9Note de bas de page 26Note de bas de page 27Note de bas de page 28Note de bas de page 29. Lorsqu'elles ont été attribuées à un groupe de risque, ces souches nouvelles ou émergentes sont souvent classées en tant qu'agents pathogènes humains de GR3, agents zoopathogènes de GR3, ou les deux. Tel qu'indiqué ailleurs dans la présente directive, ces souches doivent être manipulées au NC3 et entreposées conformément aux exigences applicables de la NCB, sauf en cas d'indication contraire de l'ASPC et de l'ACIA.
2.2.1.1 Exigences supplémentaires pour les souches d'IAHP
Toutes les souches d'IAHP (c.-à-d. des sous-types H5 et H7) sont considérées par l'ASPC comme des agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE), car elles présentent un plus grand risque en matière de biosûreté. À ce titre, elles font l'objet d'exigences accrues en matière de biosûreté, telles qu'énoncées dans la NCB, la LAPHT et le RAPHT. Communiquez directement avec l'ASPC pour connaître les exigences et obtenir des conseils avant d'effectuer des activités impliquant des ABCSE. Veuillez vous référer à la section 5.0 pour les coordonnées détaillées.
Tous les sous-types d'IAHP et les sous-types H5 et H7 d'IAFP sont considérés des APAT-DA. De ce fait, ils font l'objet d'exigences accrues en matière de biosécurité et de bioconfinement, telles qu'énoncées dans la NCB, ainsi que de surveillance réglementaire. En vertu de la LSA et du Règlement sur les maladies déclarables, les IAFP et IAHP doivent être déclarés à l'ACIA. Communiquez directement avec le Bureau de confinement des biorisques et sécurité de l'ACIA pour connaître les exigences et obtenir des conseils avant d'effectuer des activités impliquant des APAT-DA. Veuillez vous référer à la section 5.0 pour les coordonnées détaillées.
2.2.2 Évaluation du niveau de confinement
Les souches nouvelles ou émergentes de virus de la grippe A qui n'ont pas été attribuées à un groupe de risque, y compris tout sous-type d'IAHP, doivent être manipulées au NC3 et entreposées conformément aux exigences applicables de la NCB jusqu'à ce qu'une ERAAP et une ENC aient été effectuées et que l'ASPC et l'ACIA aient indiqué qu'elles peuvent être manipulées à un niveau de confinement inférieur. Dans le cas des virus de vaccins candidats, les tests pour évaluer leur sécurité et les niveaux de confinement proposés pour leur manipulation sont décrits dans l'Annexe 3 du numéro 1016 de la série de rapports techniques de l'OMS, Guidelines for the safe development and production of vaccines to human pandemic influenza viruses and influenza viruses with pandemic potential (en anglais seulement), modifiées de temps à autreNote de bas de page 43.
Dès que les données probantes appuient la présence possible d'une souche nouvelle ou émergente (p. ex. un virus a été identifié dans l'installation ou ailleurs), la présente directive :
- doit être suivie dans les installations titulaires de permis visant des agents pathogènes et des toxines lorsque le travail est effectué au NC2 (avec les pratiques opérationnelles supplémentaires énoncées dans la section 4.3 de la présente directive)
- est fortement recommandée d'être suivie dans les installations exclues de l'application de la LAPHT ou exemptes de l'exigence relative à la délivrance d'un permis visant des agents pathogènes et des toxines (p. ex. les laboratoires de diagnostic) pour la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de biosécurité (voir la section 4.3) afin d'atténuer les risques associés à la manipulation de virus de la grippe A nouveaux ou émergents
- doit être suivie dans toutes les installations où la grippe aviaire ou tout produit pouvant contenir la grippe aviaire (p. ex. un échantillon humain, animal, environnemental) est importé
- doit être suivie dans toutes les installations où sont manipulés ou entreposés les IAHP ou IAFP des sous-types H5 ou H7 qui ont été acquis au pays (c.-à-d. non importés)
- est fortement recommandée d'être suivie dans les installations lorsque le travail est effectué au NC2 (avec les pratiques opérationnelles supplémentaires énoncées dans la section 4.3 de la présente directive) avec des échantillons primaires animaux et des échantillons primaires environnementaux (associés à un animal) qui ont été acquis au pays (c.-à-d. non importés).
En plus des pratiques opérationnelles énoncées dans la section 4.3 de la présente directive, une évaluation locale des risques (ELR) spécifique au site est critique pour évaluer et déterminer quelles pratiques opérationnelles et stratégies d'atténuation spécifiques au travail sont nécessaires pour atteindre le niveau de protection approprié pour les différentes activités impliquant des souches de grippe A nouvelles ou émergentes (voir la Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – Évaluation locale des risques)Note de bas de page 44.
2.2.3 Développement de vaccins
L'Annexe 3 du numéro 1016 de la série de rapports techniques de l'OMS, Guidelines for the safe development and production of vaccines to human pandemic influenza viruses and influenza viruses with pandemic potential (en anglais seulement), énonce les dangers possibles associés au travail avec des virus de vaccins candidats réassortis, ainsi qu'une approche d'évaluation des risques pour la modification génétique ou la création de virus de vaccins candidats et les activités de production de vaccinsNote de bas de page 43. Ces lignes directrices spécifient également un certain nombre de tests nécessaires à l'évaluation de la sécurité des virus de vaccins candidats contre la grippe avant l'utilisation pour la production de vaccins. Les tests requis pour déterminer le niveau de confinement auquel ces souches doivent être manipulées dépendent du virus parent modifié, de sa similarité génétique à une souche testée précédemment et des activités effectuées. Les tests possibles comprennentNote de bas de page 43 :
- le séquençage pour confirmer l'identité et vérifier la présence de marqueurs atténuants et autres marqueurs phénotypiques
- les tests de pathogénicité chez les poulets
- les tests de capacité à former des plaques en l'absence ou en présence de trypsine ajoutée
- les tests d'atténuation chez les furets
- les tests de stabilité génétique
Les nouveaux virus de vaccins candidats contre la grippe A dont la sécurité n'a pas été testée doivent être manipulés au NC3 et entreposés conformément aux exigences applicables de la NCB.
3.0 Types d'échantillons, de cultures et d'activités
Le type d'échantillon et de culture de la grippe A, ainsi que les procédures spécifiques effectuées avec ces échantillons et cultures, ont une influence sur le risque. Par conséquent, les sections suivantes fournissent divers exemples d'activités avec différents types d'échantillons et de cultures et sont destinées à aider à classer les nouvelles activités.
3.1 Activités de diagnostic sans mise en culture
Cela comprend les activités avec des échantillons primaires prélevés directement chez des patients ou des animaux qui n'ont pas été cultivés et qui sont effectuées dans le but de diagnostiquer ou de surveiller une infection. Des recommandations en matière de biosécurité pour les activités de diagnostic humain sont disponibles dans la Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – Activités de diagnostic humainNote de bas de page 45.
Des exemples d'activités de diagnostic sans mise en culture comprennent, sans s'y limiter :
- les essais immuno-enzymatiques (ELISA)
- la centrifugation d'échantillons primaires (p. ex. des sécrétions respiratoires) sans intention de concentrer le virus dans un culot
- l'extraction d'acides nucléiques ou l'amplification d'acides nucléiques (p. ex. la transcription inverse suivie d'une amplification en chaîne par polymérase) à partir d'échantillons primaires
De plus, cela comprend les activités avec des échantillons primaires qui restent dans le même milieu à partir duquel ils ont été recueillis, même si l'échantillon a été modifié par d'autres ingrédients, tels que des stabilisants. Les échantillons primaires qui ont été traités, tant que l'agent pathogène n'a pas été extrait, sont également compris dans cette catégorie. Les échantillons primaires contiennent généralement une charge virale beaucoup plus faible que les cultures.
En raison de la transmissibilité de la grippe A par les aérosols, il y a un risque inhérent associé à ces activités. Le respect de la présente directive est fortement recommandé lorsque seules des activités de diagnostic sans mise en culture sont effectuées avec des échantillons primaires acquis au pays dans des installations de diagnostic (voir le Tableau 1 à la section 4.2). De plus, l'élaboration de pratiques exemplaires pour réduire le risque d'exposition à des virus de la grippe A nouveaux ou émergents et d'infections contractées en laboratoire (ICL) est fortement encouragée. Cependant, les échantillons primaires importés contenant ou soupçonnés de contenir des virus de la grippe A nouveaux ou émergents sont réglementés en vertu de la LSA et le respect de la présente directive est donc exigé pour l'importation ou le transfert de tels échantillons.
3.2 Activités in vitro avec et sans mise en culture
Cela comprend les activités avec les virus de la grippe A mis en culture, que ce soit en culture cellulaire ou dans des œufs, y compris les cultures mères d'isolats cliniques ou les cultures de souches de référence de l'agent pathogène, ainsi que les cultures diagnostiques provenant d'échantillons primaires lorsque l'agent pathogène a été identifié. Cela comprend également les virus de la grippe A qui sont concentrés sciemment de toute manière que ce soit (p. ex. par ultracentrifugation).
Des exemples de ces activités comprennent, sans s'y limiter :
- la mise en culture d'un virus de la grippe A nouveau ou émergent à des fins de recherche (p. ex. dans des œufs de poule embryonnés ou par culture tissulaire, par culture cellulaire rapide)
- la culture ou la propagation d'échantillons primaires qui sont confirmés comme contenant une souche de la grippe A nouvelle ou émergente
- le travail préparatoire pour les activités in vivo
- le traitement des cultures positives de la grippe A en vue de leur emballage et de leur distribution à d'autres laboratoires
- d'autres activités de recherche impliquant la grippe A nouvelle ou émergente cultivée ou concentrée
Lors des activités de diagnostic qui visent à sciemment propager, concentrer ou purifier la grippe A à partir d'échantillons primaires dans un contenant ouvert, ces activités ne sont plus exemptes de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la LAPHT et le respect de la présente directive est donc exigé (conformément au Tableau 1 à la section 4.2). Il n'y a pas d'exemptions ou d'exclusions en vertu de la LSA pour toute activité impliquant la manipulation d'échantillons importés de grippe A nouvelle ou émergente.
3.3 Activités in vivo
En vertu de la LAPHT et du RSA, les activités in vivo comprennent l'exposition expérimentale d'un animal à la grippe A et la manipulation subséquente de l'animal (et des échantillons prélevés de celui-ci) dans un cadre de recherche. En vertu de la LSA, les activités in vivo comprennent également tout animal infecté de manière naturelle par un agent zoopathogène.
Des exemples de ces activités comprennent, sans s'y limiter :
- l'inoculation des animaux
- la surveillance des animaux infectés
- la collecte d'échantillons provenant d'animaux infectés (p. ex. un écouvillonnage nasal ou de la gorge, du sang, un lavage bronchique)
Ces activités sont réglementées en vertu de la LAPHT et de la LSA. De ce fait, le respect de la présente directive est exigé (conformément au Tableau 1 à la section 4.2).
3.4 Activités avec des matières biologiques inactivées
Une matière biologique inactivée est tout échantillon primaire (p. ex. un écouvillon nasopharyngé), produit (p. ex. des culots, du virus concentré) ou culture (p. ex. de la grippe mise en culture) qui a été rendu totalement non infectieux par une méthode d'inactivation validée. Les méthodes d'inactivation peuvent comprendre la chaleur ou les produits chimiques, ainsi que l'extraction d'acides nucléiques. La capacité d'une méthode d'extraction des acides nucléique à inactiver un agent pathogène doit être validée et vérifiée.
L'inactivation doit être effectuée au niveau de confinement exigé pour l'agent pathogène et le type d'échantillon (voir le Tableau 1 à la section 4.2 pour les exigences et les recommandations en matière de niveau de confinement).
Des exemples d'activités avec des matières biologiques inactivées comprennent les tests de détection des antigènes, la transcription inverse suivie d'une amplification en chaîne par polymérase et la spectrométrie de masse à temps de vol couplée à une source de désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI-TOF).
Lorsque la matière infectieuse contenant la grippe A a été complètement inactivée par une méthode validée et vérifiée régulièrement, les activités subséquentes avec la matière inactivée ne sont pas réglementées en vertu de la LAPHT et de la LSA.
3.5 Activités avec des souches génétiquement créées ou modifiées
La modification d'un agent pathogène ou d'une toxine pour augmenter la pathogénicité ou l'infectiosité, évader les techniques de diagnostic ou de détection, ou résister aux traitements est considérée de la recherche à gain de fonction avec possibilité de double usage. Une ERAAP et une ENC pour le virus modifié est utilisée pour déterminer le groupe de risque approprié et les exigences en matière de confinement pour sa manipulation, respectivement. De plus, il est exigé que ceux détenant des autorisations de l'ASPC et de l'ACIA effectuent une évaluation des risques de biosûreté et élaborent un plan de biosûreté pour déterminer et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation appropriées afin de réduire le risque de rejet non autorisé, de perte, de vol, de mésusage ou de détournement de matières réglementées ou d'autres ressources connexesNote de bas de page 46. De plus, lorsque de la recherche scientifique est effectuée, un Plan de surveillance administrative (PSA) est exigé en vertu du RAPHT. Le PSA fournit un aperçu des mécanismes en place pour gérer et contrôler les risques en matière de biosécurité et de biosûreté. Pour de plus amples renseignements sur la possibilité de double usage, veuillez voir le Plan de surveillance administrative à l'égard des agents pathogènes et des toxines dans un contexte de rechercheNote de bas de page 47.
La présence de plusieurs souches et sources de virus de la grippe A augmente le risque de réassortiment génétique accidentel si elles sont manipulées en proximité temporelle et physique. Ainsi, la vérification de la pureté clonale et de la stabilité phénotypique permet de confirmer que seule la souche d'intérêt est présente et qu'il est improbable qu'elle se recombine ou redevienne une souche plus pathogène pendant les manipulations expérimentales.
Afin de prévenir tout nouveau réassortiment, il est fortement recommandé d'éviter de travailler avec différentes souches de grippe A simultanément, particulièrement dans les modèles in vivo. La séparation de ces travaux peut être spatiale (p. ex. dans des enceintes de sécurité biologique [ESB] différentes) ou temporelle (p. ex. la planification de l'horaire). Cela s'applique aux souches de la grippe A de GR2 et de GR3 ainsi qu'aux souches de la grippe A qui n'ont pas encore été attribuées à un groupe de risque.
4.0 Exigences relatives au niveau de confinement
Les niveaux de confinement font référence au confinement physique et aux pratiques opérationnelles minimales qu'une zone de confinement requiert pour la manipulation ou l'entreposage sécuritaire des matières réglementées. Les niveaux de confinement vont du laboratoire de base (c.-à-d. NC1) au niveau de confinement le plus élevé (c.-à-d. NC4). Des renseignements détaillés sur les différents niveaux de confinement et types d'espaces de travail (p. ex. les espaces de travail en laboratoire, les zones de confinement de petits animaux [zones PA], les zones de confinement de gros animaux [zones GA]) sont disponibles dans la NCB.
4.1 Exigences pour tous les types d'échantillons et d'activités
Afin de prévenir la production ou le rejet involontaire d'un virus de la grippe A nouveau ou émergent, toutes les installations où sont effectuées des activités avec la grippe A, quel qu'en soit le groupe de risque, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- Si un laboratoire de diagnostic humain détecte un échantillon non négatif ou positif pour un virus de la grippe A nouveau ou émergent ou pour une souche inconnue, tout travail avec l'échantillon doit être interrompu. Cet échantillon doit être transféré à une zone de confinement de niveau de confinement approprié (p. ex. NC3) ou au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour des tests de confirmation et toute autre manipulation. Les coordonnées de la section Virus de la grippe, virus respiratoires et coronavirus du LNM sont disponibles dans le Guide des services du LNMNote de bas de page 48.
- Si un laboratoire de diagnostic vétérinaire détecte un échantillon non négatif ou positif pour un virus de la grippe A (sous-types H5 ou H7), tout travail avec l'échantillon doit être interrompu. Cet échantillon doit être transféré au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) à Winnipeg pour des tests de confirmationNote de bas de page 49. De plus, en vertu de la LSA et du Règlement sur les maladies déclarables, les IAFP et IAHP des sous-types H5 et H7 sont déclarables à l'ACIA. Veuillez vous référer à la section 5.0 pour les coordonnées détaillées.
4.2 Exigences en matière de niveau de confinement pour la manipulation sécuritaire des virus de la grippe A nouveaux et émergents
Au Canada, les virus de la grippe A nouveaux et émergents qui n'ont pas encore été attribués à un groupe de risque sont présumés d'être des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes de GR3 jusqu'à ce qu'un groupe de risque soit attribué. Ces virus doivent être manipulés selon les procédures normales pour les agents pathogènes de GR3 au NC3 (voir le Tableau 1 à la section 4.2).
Les souches d'IAHP doivent être manipulées en tant qu'ABCSE et APAT-DA. Par conséquent, elles doivent être manipulées dans une installation qui répond aux exigences minimales applicables énoncées dans les chapitres 3, 4, et 5 de la NCB. Ces chapitres fournissent une liste complète des exigences physiques en matière de confinement, des exigences opérationnelles et des exigences relatives aux essais de vérification et de performance pour ces niveaux de confinement, respectivement. Si une zone de confinement ne peut pas répondre aux exigences en matière de niveau de confinement pour les types d'échantillons ou de cultures ou les activités énoncées dans les sections 3 et 4, ou si la manipulation d'ABCSE ou d'APAT-DA n'est pas autorisée dans l'installation, les échantillons ou les cultures doivent être transférés immédiatement à une zone de confinement qui répond aux exigences.
Il est fortement recommandé que les personnes effectuant des activités du type 3 dans le Tableau 1 suivent le niveau de confinement énoncé dans le Tableau 1. Cependant, si l'échantillon est importé, le fait de suivre le niveau de confinement est une exigence. Les personnes effectuant les activités des types 1, 2, 4, 5, 6 et 7 doivent respecter les exigences en matière de niveau de confinement énoncées dans le Tableau 1.
| Types d'activités | Niveau de confinementNote de bas de tableau 1 - a |
|---|---|
| 1. Activités in vitro avec mise en culture avec des virus de vaccins candidats contre la grippe A dont la sécurité a été testéeNote de bas de tableau 1 - c | NC2 avec des pratiques opérationnelles supplémentairesNote de bas de tableau 1 - b |
|
2. Activités in vivo avec des virus de vaccins candidats contre la grippe A dont la sécurité a été testéeNote de bas de tableau 1 - c |
NC2 avec des pratiques opérationnelles supplémentaires (pour les zones de confinement de petits animaux)Note de bas de tableau 1 - b NC2-Ag avec des pratiques opérationnelles supplémentaires (pour les zones de confinement de gros animaux)Note de bas de tableau 1 - b |
| 3. Activités de diagnostic sans mise en culture avec des échantillons primaires Voir la section 3.1 pour une description des activités de diagnostic sans mise en culture. |
NC2 avec des pratiques opérationnelles supplémentairesNote de bas de tableau 1 - b |
| 4. Activités in vitro avec mise en culture avec des virus de vaccins candidats contre la grippe A dont la sécurité n'a pas été testéeNote de bas de tableau 1 - c | NC3 |
| 5. Activités in vivo avec des virus de vaccins candidats contre la grippe A dont la sécurité n'a pas été testéeNote de bas de tableau 1 - c |
NC3 (pour les zones de confinement de petits animaux) NC3-Ag (pour les zones de confinement de gros animaux) |
| 6. Activités in vitro avec et sans mise en culture avec des souches de grippe A nouvelles et émergentes de GR3 ou qui n'ont pas été attribuées à un groupe de risqueNote de bas de tableau 1 - d | NC3 |
| 7. Activités in vivo avec des souches de grippe A nouvelles et émergentes de GR3 ou qui n'ont pas été attribuées à un groupe de risqueNote de bas de tableau 1 - d |
NC3 (pour les zones de confinement de petits animaux) NC3-Ag (pour les zones de confinement de gros animaux) |
4.3 Pratiques opérationnelles pour les activités avec la grippe A au NC2 et NC2-Ag
En plus des exigences pour le NC2 énoncées aux chapitres 3, 4 et 5 de la NCB, les pratiques opérationnelles (c.-à-d. les pratiques opérationnelles de NC3) sont exigées pour les activités des types 1 et 2, et sont fortement recommandées pour les activités du type 3 dans le Tableau 1. Cependant, si l'échantillon est importé, le fait de suivre les pratiques opérationnelles supplémentaires détaillées ci-dessous est une exigence. Les exigences suivantes s'appliquent à tous les membres du personnel qui sont autorisés à entrer dans la zone de confinement.
Dans le contexte de la présente directive, toutes les pratiques opérationnelles énoncées ci-dessous qui pourraient être déjà exigées au NC2 ou au NC2-Agriculture (NC2-Ag) doivent être mises en œuvre avec la rigueur d'une pratique opérationnelle de NC3 afin d'atténuer les risques associés aux virus de la grippe A nouveaux et émergents.
| Numéro de l'exigence de la NCB | Exigence de la NCB (E) et note explicative (NE) adaptée pour la directive portant sur la grippe A |
|---|---|
| 4.1.3 | E : Là où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, l'ACIA doit être avisée avant d'apporter des changements à la fonction du programme, à la structure physique de l'installation, à l'équipement ou aux procédures opératoires normalisées (PON) qui pourraient influer sur le bioconfinement, afin que ces changements soient approuvés. |
| NE : Compte tenu des risques pour la population animale, l'approvisionnement alimentaire et l'économie associés aux agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, tout changement apporté à la fonction du programme (qui décrit l'étendue des activités qui sont menées dans une installation, y compris les matières infectieuses et les espèces animales manipulées) ou tout changement qui pourrait avoir une répercussion sur le bioconfinement dans les zones de confinement où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres sont soumis à l'ACIA avant leur mise en œuvre. Cela permet à l'ACIA de confirmer que les changements sont acceptables et que le confinement des matières infectieuses sera efficace. Les changements qui pourraient avoir une répercussion sur le bioconfinement comprennent les changements à la structure physique de l'installation (p. ex. modifier l'emplacement des murs, des portes ou des conduits, desceller des drains de plancher), à l'équipement (p. ex. changer le type de filtre utilisé dans une ESB) ou aux PON (p. ex. une nouvelle procédure effectuée à l'extérieur d'une ESB). | |
| 4.3.3 | E : Des gants doivent être portés lors de la manipulation de matières réglementées ou d'animaux réglementés. |
| NE : Des gants appropriés (p. ex. en latex, en nitrile, en vinyle) qui protègent les mains contre toute contamination sont toujours portés lorsque des matières réglementées et des animaux réglementés sont manipulés afin de protéger les membres du personnel contre toute exposition et de prévenir la propagation de la contamination. | |
| 4.3.4 | E : Des appareils de protection respiratoire doivent être portés là où il existe un risque d'exposition à des aérosols infectieux pouvant être transmis par inhalation ou à des toxines aérosolisées, tel que déterminé par une ELR. |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, un appareil de protection respiratoire est exigé au moment de réaliser des activités particulières (p. ex. l'inoculation d'animaux), puisque la principale voie d'infection par le virus de la grippe A est l'inhalation de particules virales. Certaines souches de virus de la grippe A restent viables dans les aérosols jusqu'à 24 heures, ce qui présente un risque d'infection à la suite d'activités qui génèrent des aérosols. Certains types d'activités, y compris le travail in vivo, peuvent augmenter le risque de production d'aérosols. Les appareils de protection respiratoire sont particulièrement importants au moment d'effectuer du travail avec des animaux, puisque des études de transmission chez les furets indiquent que les virus de la grippe A H5N1 génétiquement manipulés peuvent devenir transmissibles par l'air chez les mammifères sans réassortiment grâce à seulement cinq mutations d'acides aminés. Cela peut entraîner la création de souches ayant un potentiel pandémiqueNote de bas de page 41. Le risque d'infection peut également être plus élevé si le travail implique la multiplication in vitro ou in vivo du virus, puisque la concentration ou la quantité d'agents pathogènes est augmentée. Ainsi, le port d'un appareil de protection respiratoire ajusté et approprié peut aider à protéger les individus contre une exposition à des particules virales de la grippe A et prévenir une infection. Le type d'appareil de protection respiratoire (p. ex. un N95, un N100, un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé) doit convenir à son utilisation, selon une ELR. Lorsque des appareils de protection respiratoire sont portés, les règlements en matière de santé et de sécurité au travail exigent la mise en place d'un programme d'essais d'ajustement. | |
| 4.4.10 | E : Les effets personnels et les articles destinés à un usage personnel qui ne sont pas nécessaires au travail doivent être laissés à l'extérieur de la zone de confinement ou dans les vestiaires situés à l'extérieur de la barrière de confinement. |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, les effets personnels et les autres articles destinés à un usage personnel (p. ex. les sacs à dos, les carnets, les sacs à main, les téléphones cellulaires) doivent être laissés à l'extérieur de la zone de confinement ou dans les vestiaires à l'extérieur de la barrière de confinement pour prévenir la contamination de ces articles avec la grippe A. Comme certaines souches de virus de la grippe A peuvent survivre sur des surfaces pendant plusieurs heures, cette mesure protège les individus contre une exposition et prévient la propagation de la grippe A à l'extérieur de la barrière de confinementNote de bas de page 50. | |
| 4.4.16 | E : L'équipement de protection individuel (EPI) propre à l'activité ou une couche supplémentaire d'EPI doit être enfilé avant de commencer l'activité dans la zone de confinement. |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, les ELR déterminent quel EPI est exigé pour protéger les membres du personnel contre une exposition à la grippe A au moment d'effectuer des activités particulières. Cet EPI peut être différent ou supplémentaire à l'EPI exigé pour entrer dans la zone de confinement. Les activités comprenant un risque plus élevé (p. ex. la création d'aérosols infectieux, le travail associé à une possibilité d'éclaboussures, le travail avec des animaux) peuvent exiger l'utilisation d'un EPI supplémentaire (p. ex. un appareil de protection respiratoire, une blouse ne s'ouvrant pas à l'avant, un tablier), alors que les activités comprenant un risque moins élevé peuvent permettre une protection d'un niveau moindre. Des éléments supplémentaires doivent être pris en compte lors de la réalisation d'une ELR pour les activités in vivo (p. ex. le risque élevé de production d'aérosols, l'imprévisibilité des animaux, le risque accru de déversement). Par exemple, le fait de travailler avec des animaux peut augmenter le risque d'ICL par une exposition des muqueuses à du matériel contaminé pendant la manipulation de tissus ou de sécrétions d'animaux infectés. Pour les laboratoires de diagnostic, l'épidémiologie de la maladie, la prévalence de la grippe A parmi la population de patients échantillonnés desservie par le laboratoire et le caractère saisonnier devraient être pris en compte lors de la sélection d'EPI. | |
| 4.4.18 | E : L'EPI dédié et l'EPI propre à l'activité doit être retiré de manière à réduire au minimum la contamination de la peau, des cheveux et des vêtements personnels (le cas échéant) et entreposé ou jeté à l'intérieur de la zone de confinement ou de la barrière de confinement. |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, le fait de retirer l'EPI dédié et l'EPI propre à l'activité dans un ordre particulier et de manière à prévenir la contamination de la peau, des cheveux et des vêtements personnels avec la grippe A (comme il est décrit dans les PON) réduit la possibilité de créer des aérosols et que l'EPI contaminé entre en contact avec la peau, les cheveux ou les vêtements personnels non protégés. Le fait de réduire ces risques protège les membres du personnel contre l'exposition à la grippe A. Une fois retiré, l'EPI est entreposé ou jeté à l'intérieur de la zone de confinement (ou à l'intérieur de la barrière de confinement, le cas échéant). | |
| 4.4.21 | E : L'EPI dédié ou l'EPI propre à l'activité doit être retiré en quittant la zone de confinement, la barrière de confinement, la salle animalière, le box ou la salle de nécropsie. [Non exigé pour les zones de NC4 dans lesquelles des combinaisons à pression positive sont portées.] |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, le retrait de l'EPI dédié ou de l'EPI propre à l'activité (p. ex. les blouses chirurgicales, les bottes, les combinaisons, les sarraus, les tabliers, les blouses, les vêtements de protection couvrant toutes les parties du corps, les couvre-chaussures, l'équipement de protection pour la tête et le visage) lors de la sortie de la zone de confinement, la barrière de confinement, la salle animalière, le box ou la salle de nécropsie protège les personnes contre l'exposition en empêchant la propagation de la contamination à l'extérieur de ces espaces. En fonction de l'ELR, l'EPI porté à l'intérieur des box ou des salles de nécropsie peut être porté dans des corridors « sales » et être retiré à la sortie de la zone de confinement ou de la barrière de confinement lorsque des PON appuient cette mesure. | |
| 4.5.21 | E : Toutes les activités comportant la manipulation de récipients ouverts qui contiennent des matières réglementées doivent être menées dans une ESB ou dans tout autre dispositif de confinement primaire. [Non exigé pour l'inoculation d'animaux réglementés hébergés dans des box ou pour le prélèvement d'échantillons chez ces animaux.] |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, les ESB et les autres dispositifs de confinement primaire assurent un confinement primaire efficace afin de protéger les membres du personnel contre l'exposition à des aérosols de la grippe A, et empêcher leur rejet. Comme la principale voie d'infection par le virus de la grippe A est l'inhalation de particules virales, le fait d'effectuer toutes les activités comportant des récipients ouverts qui contiennent la grippe A dans un dispositif de confinement primaire peut prévenir une infection. De plus, les virus de la grippe A peuvent survivre sur des surfaces pendant plusieurs heures et dans les aérosols jusqu'à 24 heuresNote de bas de page 50. Une infection pourrait résulter d'un contact avec une surface contaminée lorsque des particules aérosolisées générées pendant les activités de travail se déposent sur une surface qui est par la suite inadéquatement décontaminée. | |
| 4.5.24 | E : La centrifugation de matières réglementées doit être effectuée dans des godets de sécurité ou des rotors scellés qui sont déchargés dans une ESB ou un autre dispositif de confinement primaire à l'aide d'un mécanisme qui prévient leur rejet. |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, les godets de sécurité ou les rotors scellés doivent être utilisés pour empêcher le rejet d'aérosols de la grippe A qui peuvent être créés pendant la centrifugation. Étant donné que la principale voie d'infection par le virus de la grippe A est l'inhalation de particules virales, les godets de sécurité ou les rotors doivent être déchargés dans une ESB ou un autre dispositif de confinement primaire à l'aide de mécanismes particuliers (p. ex. des PON, de l'équipement, des dispositifs) pour empêcher une infection. | |
| 4.6.4 | E : Les animaux réglementés dans des zones PA doivent être gardés en tout temps à l'intérieur d'un dispositif de confinement primaire. [Non exigé pour les aires de production à grande échelle de NC2.] |
| NE : Dans le contexte de la présente directive, les systèmes de cages de confinement primaire conçus pour contenir un rejet potentiel de particules virales de la grippe A (c.-à-d. avec filtration HEPA) sont exigés pour le travail avec des animaux infectés, ou potentiellement infectés, par la grippe A. Cela comprend lorsqu'ils sont transférés d'une cage à une ESB et pendant l'hébergement, le nettoyage des cages, l'élevage, l'inoculation, la collecte des échantillons, les chirurgies, les nécropsies et toutes les autres procédures afin de protéger les membres du personnel contre une exposition et empêcher le rejet de la grippe A. Le confinement primaire dans une zone PA peut être assuré par une ESB, une cage ou un système de cages de confinement primaire ou un poste ventilé pour le changement des cages. |
4.3.1 Considérations supplémentaires
Les membres du personnel peuvent être partiellement ou complètement protégés contre une infection s'ils ont été infectés par la grippe saisonnière ou vaccinés contre celle-ci. Le taux d'anticorps peut donner une indication de leur état immunitaire; cependant, la protection offerte par l'immunité contre le virus de la grippe saisonnière peut être moins efficace contre une souche nouvelle ou émergenteNote de bas de page 51. Pour diminuer la probabilité d'infection, la vaccination contre la grippe saisonnière, ou l'administration de vaccins commerciaux approuvés contre les souches nouvelles ou émergentes (si disponibles), en fonction d'une ELR et du programme de surveillance médicale, peut faire partie de la politique de l'installation. La déclaration annuelle du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) sur les vaccins contre la grippe saisonnière recommande que la vaccination soit offerte chaque année à moins de contre-indications médicalesNote de bas de page 51. Pour les installations de production à grande échelle, il est recommandé qu'un vaccin ciblant le virus en production soit administré à tous les membres du personnel si un tel vaccin est disponibleNote de bas de page 43.
Pour les installations où sont produits des vaccins contre la grippe, il est recommandé aux membres du personnel d'éviter tout contact avec des animaux susceptibles (p. ex. des porcs, des oiseaux, des bovins) en dehors de la zone de confinement pendant 14 jours après avoir quitté l'installation de production de vaccinsNote de bas de page 43.
5.0 Coordonnées
Veuillez noter que la présente directive en matière de biosécurité est fondée sur les données scientifiques actuellement disponibles et peut être révisée et modifiée à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Si la présente directive en matière de biosécurité est modifiée, les renseignements mis à jour seront communiqués aux parties réglementées concernées et la directive en matière de biosécurité modifiée sera affichée sur le site Web du gouvernement du Canada. Pour de plus amples renseignements sur la présente directive en matière de biosécurité ou pour de plus amples renseignements sur la biosécurité, veuillez communiquer avec :
Agence de la santé publique du Canada, Centre de la biosûreté
Courriel : pathogens.pathogenes@phac-aspc.gc.ca
Site Web : Biosécurité et biosûreté - Canada.ca
Agence de la santé publique du Canada, Groupe d'octroi des permis, Centre de la biosûreté
Courriel : licence.permis@phac-aspc.gc.ca
Site Web : Programme de délivrance de permis - Canada.ca
Agence canadienne d'inspection des aliments, Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité
Courriel : biocon@inspection.gc.ca
Site Web : Confinement des biorisques et sécurité - Canada.ca
Agence canadienne d'inspection des aliments, Programme de santé des animaux terrestres
Courriel : cfia.notification-notification.acia@inspection.gc.ca
Site Web : Maladies à déclaration obligatoire : Animaux terrestres - inspection.canada.ca
Agence canadienne d'inspection des aliments, pour de plus amples renseignements sur les maladies animales ou les substances toxiques en ce qui concerne l'ACIA
Site Web : Contactez-nous - Agence canadienne d'inspection des aliments
6.0 Glossaire
| Aérosol | Fines particules solides ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux (p. ex. l'air); les aérosols peuvent se former lorsqu'une activité provoque un transfert d'énergie dans une matière liquide ou semi-liquide. |
| Agent pathogène | Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez l'humain ou l'animal. Les agents pathogènes humains et les agents zoopathogènes classés peuvent être trouvés à l'aide de la base de données sur les groupes de risque ePATHogène offerte par l'Agence de la santé publique du Canada. |
| Agent pathogène d'animaux terrestres | Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez les animaux terrestres; y compris ceux dérivés de la biotechnologie. Ceux-ci comprennent les agents pathogènes ayant la capacité de causer une maladie chez les oiseaux et les amphibiens, mais ce terme ne s'applique pas aux agents pathogènes qui causent des maladies seulement chez les animaux aquatiques ou les invertébrés. Ceci comprend également les agents pathogènes d'animaux terrestres ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine) présents sur ou dans des produits ou des sous-produits animaux, ou d'autres organismes. |
| Agent pathogène non indigène d'animaux terrestres | Agent pathogène qui provoque une maladie animale figurant sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, et qui est considéré comme allogène au Canada, ou toute autre maladie animale considérée comme allogène au Canada ayant une conséquence importante sur la santé des animaux, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (c.-à-d. un agent causant une maladie animale exotique qui ne se retrouve pas au pays). Ces agents pathogènes peuvent avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne. |
| Agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE) | Sous-ensemble d'agents pathogènes humains et de toxines qui présentent un risque accru en matière de biosûreté en raison de la possibilité qu'ils soient utilisés comme arme biologique. Au paragraphe 10 du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT), les ABCSE sont identifiés comme des agents pathogènes et des toxines « précisés ». Les ABCSE comprennent donc tous les agents pathogènes de groupe de risque 3 (GR3) et de GR4 qui se retrouvent sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation, publiée par le Groupe d'Australie et modifiée de temps à autre, à l'exception du virus Duvenhage, du virus rabique et de tous les autres du genre Lyssavirus, du virus de la stomatite vésiculaire, ainsi que du virus de la chorioméningite lymphocytaire. Les ABCSE comprennent aussi toutes les toxines qui se trouvent à la fois à l'annexe 1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation et qui sont présentes en quantités supérieures aux quantités seuils énoncées au paragraphe 10(2) du RAPHT. |
| Animal réglementé | Dans le contexte de la présente directive en matière de biosécurité, les animaux réglementés comprennent :
|
| Barrière de confinement | Structures physiques ou barrières qui créent une limite entre les espaces « propres » et les espaces « sales » ou entre les zones à plus faible risque de contamination et celles à risque plus élevé (p. ex. entre les espaces de travail en laboratoire, les aires de production à grande échelle, les salles animalières, les box et les salles de nécropsie, et l'extérieur de cette aire de confinement). La barrière de confinement est elle-même créée par les murs, les portes, les planchers et les plafonds qui entourent physiquement les espaces à l'intérieur du confinement, ainsi que par le courant d'air vers l'intérieur aux portes critiques (là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé). |
| Biosécurité | Ensemble des principes, des technologies et des pratiques liés au confinement mis en œuvre pour empêcher l'exposition involontaire à des matières réglementées, ou leur rejet accidentel. |
| Box | Salle ou espace conçu pour héberger un ou plusieurs animaux où la salle elle-même sert de confinement primaire. Ces espaces servent à héberger des gros animaux (p. ex. du bétail, des cerfs) ou des petits animaux qui sont hébergés dans des cages ouvertes (c.-à-d. pas des cages de confinement primaire). |
| Cage de confinement primaire | Cage pour animaux qui sert de dispositif de confinement primaire et qui empêche le rejet de matières réglementées. Ce type de cage comprend les cages ventilées à couvercle filtrant et les étagères à cages de micro-isolation ventilées, avec ou sans filtre à haute efficacité pour les particules de l'air. |
| Confinement | Ensemble de paramètres de conception physique et de pratiques opérationnelles visant à protéger les membres du personnel, le milieu de travail immédiat et la communauté contre toute exposition à des matières biologiques. Dans le même contexte, le terme « bioconfinement » est aussi employé. |
| Confinement primaire | Premier niveau de barrière physique conçu de façon à confiner des matières réglementées, et à prévenir leur rejet. On obtient le confinement primaire en se servant d'un dispositif, d'un équipement, ou d'une autre structure physique qui crée une barrière entre les matières réglementées et l'individu, le milieu de travail ou d'autres espaces à l'intérieur de la zone de confinement. Des exemples de ce type de confinement comprennent les enceintes de sécurité biologique, les boîtes à gants et les cages de micro-isolation. Dans les box, la salle elle-même sert de confinement primaire; l'équipement de protection individuel sert donc de protection primaire contre l'exposition. |
| Culture | Multiplication in vitro de microorganismes, de tissus, de cellules ou d'autres matières vivantes dans des conditions contrôlées (p. ex. la température, l'humidité, les nutriments) afin d'augmenter le nombre ou la concentration de ces organismes ou de ces cellules. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, le terme « culture cellulaire » réfère à une culture de cellules d'origine humaine ou animale. |
| Dispositif de confinement primaire | Appareil ou équipement conçu pour empêcher le rejet de matières réglementées et assurer le confinement primaire (c.-à-d. former une barrière physique entre les matières réglementées et la personne et/ou le milieu de travail). Les enceintes de sécurité biologique, les isolateurs, les centrifugeuses munies de godets ou de rotors étanches, l'équipement de procédé, les fermenteurs, les bioréacteurs, les cages de micro-isolation et les étagères à cages ventilées en sont des exemples. |
| Échantillons primaires | Échantillons provenant directement d'un humain ou d'un animal (p. ex. du sang, de l'urine, de la salive, de la peau, des cheveux). |
| Enceinte de sécurité biologique (ESB) | Dispositif de confinement primaire qui offre une protection aux membres du personnel, à l'environnement et aux produits (selon la catégorie d'ESB) lors de travaux avec des matières biologiques. |
| Équipement de protection individuel (EPI) | Équipement ou vêtement porté par les membres du personnel à titre de barrière afin de réduire le risque d'exposition aux matières réglementées. Des exemples d'EPI comprennent les sarraus, les blouses, les vêtements de protection couvrant toutes les parties du corps, les gants, les chaussures de sécurité, les lunettes de sécurité, les masques et les appareils de protection respiratoire. |
| Évaluation du niveau de confinement (ENC) | Évaluation des risques associés à un agent pathogène, tels que détaillés dans l'évaluation des risques associés à l'agent pathogène, et déterminant si les exigences minimales en matière de confinement correspondant à la classification de groupe de risque de l'agent pathogène permettent d'atténuer ces risques. L'évaluation prend en considération si des précautions supplémentaires ou des exemptions relatives aux exigences physiques en matière de confinement ou aux exigences opérationnelles spécifiques peuvent être exigées. |
| Évaluation des risques associés à l'agent pathogène (ERAAP) | Évaluation des caractéristiques inhérentes à un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique en comportant des parties) qui détermine la classification du groupe de risque. Une évaluation des risques associés à l'agent pathogène comporte l'analyse de quatre facteurs de risque clés, y compris la pathogénicité (c.-à-d. l'infectivité et la virulence), les mesures pré- et post-exposition, la transmissibilité et l'impact sur la population animale (c.-à-d. la gamme d'hôtes, la distribution naturelle et l'impact économique). |
| Évaluation locale des risques (ELR) | Évaluation propre à un endroit en particulier réalisée pour repérer les dangers associés aux activités menées ainsi qu'aux matières réglementées utilisées. Cette évaluation permet d'élaborer des stratégies d'atténuation des risques et des stratégies de gestion des risques, qui doivent être intégrées aux paramètres de conception relatifs au confinement physique et aux pratiques opérationnelles de l'installation. |
| Exigences opérationnelles | Procédures et contrôles administratifs respectés dans une zone de confinement pour protéger les membres du personnel, l'environnement et, ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé au chapitre 4 de la Norme canadienne sur la biosécurité. |
| Exigences physiques en matière de confinement | Mesures d'ingénierie et exigences relatives à la conception de l'installation visant à créer une barrière physique pour protéger les membres du personnel, l'environnement et, ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé au chapitre 3 de la Norme canadienne sur la biosécurité. |
| Exigences relatives aux essais de vérification et de performance | Essais de vérification et de performance nécessaires pour démontrer qu'une installation répond aux exigences physiques en matière de confinement énoncées au chapitre 3 de la Norme canadienne sur la biosécurité (NCB) et, dans certains cas, aux exigences opérationnelles énoncées au chapitre 4 de la NCB. Les exigences relatives aux essais de vérification et de performance figurent au chapitre 5 de la NCB. |
| Groupe de risque (GR) | Groupe dans lequel un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique contenant des parties de ceux-ci) est classé en fonction de ses caractéristiques inhérentes, comme la pathogénicité, la virulence, la transmissibilité et l'existence d'un traitement prophylactique ou thérapeutique efficace. Le groupe de risque indique quel est le risque pour la santé des personnes et du public ainsi que pour la santé des animaux et des populations animales. |
| In vitro | Du latin « dans le verre »; se rapporte à une expérience menée en milieu artificiel avec des composantes d'un organisme vivant (p. ex. manipuler des cellules dans une boîte de Pétri), y compris les activités comportant des lignées cellulaires ou des œufs. |
| In vivo | Du latin « dans le vivant »; se rapporte à une expérience menée dans un organisme vivant (p. ex. une étude des effets d'un traitement antibiotique sur des modèles animaux). |
| Installation | Structure, édifice ou espace défini à l'intérieur d'une structure ou d'un édifice dans lesquels sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. Il peut s'agir d'un unique laboratoire de recherche ou de diagnostic, d'une aire de production à grande échelle ou d'une zone où des animaux sont hébergés. Ce terme peut également désigner un ensemble de salles de ce type ou un édifice où se trouvent plusieurs espaces de ce type. |
| Intoxication et infection contractée en laboratoire (ICL) | Infection ou intoxication résultant d'une exposition à des agents pathogènes, des matières infectieuses, des animaux infectés ou des toxines manipulés ou entreposés dans la zone de confinement. |
| Maladie animale émergente (MAÉ) | Nouvelle maladie infectieuse qui résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant; maladie infectieuse connue se propageant à une nouvelle population ou zone géographique; ou maladie diagnostiquée pour la toute première fois ou causée par un agent pathogène auparavant inconnu qui pourrait avoir un effet important sur la santé animale, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. |
| Maladie animale exotique (MAE) | Maladie qui apparait sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, qui n'est pas considérée indigène au Canada, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); ou toute maladie à déclaration obligatoire réglementée par l'ACIA qui n'est pas présente au Canada et pour laquelle l'ACIA a une stratégie de réponse établie; ou toute autre maladie qui, après avoir été dûment examinée, est désignée comme telle par le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Les agents pathogènes causant une MAE peuvent également avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne. |
| Manipulation ou entreposage | « Manipulation ou entreposage » comprend la possession, la manipulation, l'utilisation, la production, l'entreposage, le transfert, l'importation, l'exportation, le rejet, l'élimination ou l'abandon de matières réglementées, ainsi que le fait de permettre l'accès à de telles substances. Cela comprend donc toutes les activités réglementées comportant des agents pathogènes humains ou des toxines énoncées au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. Tous les temps de verbe et toutes les variations de « manipulation ou entreposage » sont également utilisés dans ce contexte. |
| Matière infectieuse | Tout isolat d'un agent pathogène ou toute matière biologique qui contient des agents pathogènes humains ou des agents zoopathogènes, et qui présente donc un risque pour la santé humaine ou animale. |
| Matière réglementée | Dans le contexte de la présente directive en matière de biosécurité, les matières réglementées comprennent :
|
| Niveau de confinement (NC) | Exigences minimales liées au confinement physique et aux pratiques opérationnelles visant la manipulation sécuritaire des matières réglementées dans les laboratoires, les aires de production à grande échelle et les environnements de travail avec des animaux. Il existe quatre niveaux de confinement, allant du niveau de base (c.-à-d. NC1) au niveau le plus élevé (c.-à-d. NC4). |
| Pathogénicité | Capacité d'un agent pathogène de causer une maladie chez un hôte humain ou animal. |
| Permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres | Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu des alinéas 51a) et 51b) du Règlement sur la santé des animaux, l'importation au Canada d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine). |
| Permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres | Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu de l'alinéa 51.1a) du Règlement sur la santé des animaux, le transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine). |
| Permis visant des agents pathogènes et des toxines | Autorisation délivrée par l'Agence de la santé publique du Canada:
|
| Possibilité de double usage | Propriétés d'un agent pathogène ou d'une toxine, d'une méthode scientifique, de la propriété intellectuelle, ou d'une autre ressource connexe qui leur permettent d'être utilisés autant pour mener des activités scientifiques légitimes (p. ex. à des fins commerciales, médicales ou de recherche) que d'être volontairement mal utilisés pour causer du tort ou une maladie. Les agents pathogènes et les toxines qui pourraient être utilisés comme arme biologique (p. ex. pour du bioterrorisme), une méthode qui facilite la propagation de tels agents pathogènes dans un contexte de laboratoire non traditionnel, ou la découverte qu'une certaine mutation confère une résistance à tous les traitements disponibles sont des exemples de ressources à possibilité de double usage. |
| Procédure opératoire normalisée (PON) | Document qui normalise, en fonction d'une évaluation locale des risques, les procédures et les pratiques de travail sécuritaires utilisées dans le cadre d'activités réalisées avec des matières réglementées dans une zone de confinement. Les protocoles expérimentaux, les procédures d'entrée et de sortie, les protocoles de décontamination et les procédures d'intervention en cas d'urgence sont des exemples de PON. |
| Rejet | Libération de matières réglementées hors d'un système de confinement ou d'une zone de confinement (p. ex. découlant d'une fuite, d'une pulvérisation, d'un dépôt, d'une décharge, d'une vaporisation). |
| Salle de nécropsie | Salle située à l'intérieur de la zone de confinement, où sont menées des nécropsies et des dissections d'animaux à l'extérieur d'un dispositif de confinement primaire. |
| Souches en circulation du virus de la grippe | Virus de la grippe qui sont adaptés à l'humain et causent des éclosions saisonnières. Ces souches sont définies ainsi en fonction des conclusions du programme de surveillance internationale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui consulte les centres collaborateurs de l'OMS pour déterminer la composition optimale des vaccins. |
| Toxine (microbienne) | Substance toxique produite par un microorganisme, ou dérivée de celui-ci, qui peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou animale. Les toxines humaines sont énumérées à l'annexe 1 et à la partie 1 de l'annexe 5 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. |
| Validation | Fait de confirmer qu'une méthode permet d'atteindre l'objectif souhaité et convient à l'usage auquel elle est destinée grâce à des données probantes objectives. La validation peut être l'observation que des conditions particulières ont été respectées (p. ex. confirmer à l'aide d'indicateurs biologiques, d'indicateurs chimiques ou de dispositifs de surveillance paramétriques situés à des endroits difficiles à décontaminer qu'un cycle précis d'autoclavage peut décontaminer une charge représentative de déchets). |
| Vérification | Surveillance régulière de l'équipement et des procédés visant à confirmer leur efficacité continue entre les validations (p. ex. une mise à l'essai de la performance d'un autoclave en utilisant des indicateurs biologiques, la visualisation des jauges de courant d'air pour confirmer la fonction du ventilateur d'une enceinte de sécurité biologique). La comparaison de l'exactitude d'une pièce d'équipement avec celle prévue par une norme ou une procédure opératoire normalisée applicable est un exemple de vérification. |
| Virulence | Gravité ou sévérité d'une maladie causée par un agent pathogène. |
| Zone de confinement | Espace physique qui répond aux exigences liées à un niveau de confinement donné. Il peut s'agir d'une salle unique (p. ex. un laboratoire de niveau de confinement 2 [NC2]), d'une série de salles situées dans un même endroit (p. ex. plusieurs espaces de travail en laboratoire de NC2 non adjacents, mais verrouillables) ou d'une série de salles adjacentes (p. ex. des salles de NC3 comprenant des espaces de laboratoire réservés à certaines activités et des salles animalières ou des box séparés). Les espaces réservés au soutien de la zone, y compris les sas équipés de douches, les vestiaires « propres » et les vestiaires « sales », là où ils sont exigés, font partie de la zone de confinement. |
| Zone de confinement de petits animaux (Zone PA) | Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des cages de confinement primaire (p. ex. des micro-isolateurs) situées dans des salles animalières. Une zone PA peut contenir des souris, des rats ou des lapins, pourvu qu'ils soient hébergés dans des cages de confinement primaire. |
| Zone de confinement de gros animaux (Zone GA) | Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des box (c.-à-d. que la salle elle-même sert de confinement primaire). Une zone GA peut comprendre des box qui hébergent de gros animaux, comme du bétail ou des cervidés, ou des box qui hébergent de petits animaux, comme des souris ou des ratons laveurs, dans des cages ouvertes et non des cages de confinement primaire. Les salles de nécropsie, lorsqu'elles sont présentes, sont considérées comme faisant partie d'une zone GA. |
7.0 Références
- Note de bas de page 1
-
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24).
- Note de bas de page 2
-
Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44).
- Note de bas de page 3
-
Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21).
- Note de bas de page 4
-
Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296).
- Note de bas de page 5
-
Gouvernement du Canada. (2022). Norme canadienne sur la biosécurité (3e éd.). Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/troisieme-edition.html
- Note de bas de page 6
-
Gouvernement du Canada. (2018). Ligne directrice canadienne sur la biosécurité—Évaluation des risques associés à l'agent pathogène. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/evaluation-risques-pathogene.html
- Note de bas de page 7
-
Gouvernement du Canada. Lignes directrices canadiennes sur la biosécurité. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices.html
- Note de bas de page 8
-
Gouvernement du Canada. Exclusions de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/loi-agents-pathogenes-toxines/exclusions-loi-agents-pathogenes-humains-toxines.html
- Note de bas de page 9
-
Gouvernement du Canada. Exemptions de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/loi-agents-pathogenes-toxines/exemptions-exigence-relative-a-delivrance-permis-vertu-loi-agents-pathogenes-humains-toxines-reglement-agents-pathogenes-humains-toxines.html
- Note de bas de page 10
-
International Committee on Taxonomy of Viruses. (2023). Virus Taxonomy: 2023 Release. Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://ictv.global/taxonomy
- Note de bas de page 11
-
Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis). (2023). Types of Influenza Viruses. Department of Health & Human Services (États-Unis). Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm
- Note de bas de page 12
-
Matsuzaki, Y., Katsushima, N., Nagai, Y., Shoji, M., Itagaki, T. et al. (2006). Clinical Features of Influenza C Virus Infection in Children. Journal of Infectious Diseases, 193(9): 1229-1235.
- Note de bas de page 13
-
Taubenberger, J. K. et Morens, D. M. (2008). The Pathology of Influenza Virus Infections. Annual Review of Pathology, 3: 499-522.
- Note de bas de page 14
-
Quast, M., Sreenivasan, C., Sexton, G., Nedland, H., Singrey, A. et al. (2015). Serological Evidence for the Presence of Influenza D Virus in Small Ruminants. Veterinary Microbiology, 180(3-4): 281-285.
- Note de bas de page 15
-
Buckrell, S., Moussa, M. B., Bui, T., Rahal, A., Schmidt, K. et al. (2022). National Influenza Annual Report, Canada, 2021–2022: A Brief, Late Influenza Epidemic. Canada Communicable Disease Report, 48(10): 473-483.
- Note de bas de page 16
-
Schanzer, D. L., McGeer, A. et Morris, K. (2013). Statistical Estimates of Respiratory Admissions Attributable to Seasonal and Pandemic Influenza for Canada. Influenza and Other Respiratory Viruses, 7(5): 799-808.
- Note de bas de page 17
-
Schanzer, D. L., Sevenhuysen, C., Winchester, B. et Mersereau, T. (2013). Estimating Influenza Deaths in Canada, 1992-2009. Public Library of Science One, 8(11): e80481.
- Note de bas de page 18
-
Agence de la santé publique du Canada. (2023). Couverture saisonnière de la vaccination contre la grippe au Canada, 2022–2023. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation-vaccins/couvertures-vaccinales/resultats-enquete-grippe-saisonniere-2022-2023.html
- Note de bas de page 19
-
Glezen, W. P., Schmier, J. K., Kuehn, C. M., Ryan, K. J. et Oxford, J. (2013). The Burden of Influenza B: A Structured Literature Review. American Journal of Public Health, 103(3): e43-51.
- Note de bas de page 20
-
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation mondiale de la Santé et Organisation mondiale de la santé animale. (2024). Joint FAO/WHO/WOAH Preliminary Assessment of Recent Influenza A(H5N1) Viruses. Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://cdn.who.int/media/docs/default-source/global-influenza-programme/2024_04_23_fao-woah-who_h5n1_assessment.pdf?sfvrsn=3ca3dba6_2&download=true
- Note de bas de page 21
-
García-Sastre, A. (2010). Influenza Virus Receptor Specificity. The American Journal of Pathology, 176(4): P1584-1585.
- Note de bas de page 22
-
Hampson, A. W. et Mackenzie, J. S. (2006). The Influenza Viruses. Medical Journal of Australia, 185(S10): S39-43.
- Note de bas de page 23
-
Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis). (2022). How Flu Viruses Can Change: “Drift” and “Shift”. Department of Health & Human Services (États-Unis). Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm
- Note de bas de page 24
-
Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis). (2024). About Influenza in Swine (Pigs). Department of Health & Human Services (États-Unis). Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.cdc.gov/swine-flu/about/influenza-in-swine.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/flu/swineflu/keyfacts_pigs.htm
- Note de bas de page 25
-
United States Department of Agriculture et Animal and Plant Health Inspection Service (États-Unis). (2018). Guidelines for Avian Influenza Viruses. Department of Agriculture (États-Unis). Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.selectagents.gov/compliance/guidance/avian/docs/AIV_Guidelines_180220.pdf
- Note de bas de page 26
-
Organisation mondiale de la Santé. (2018). Human Infection with Avian Influenza A(H7N9) Virus – China: Update. Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/05-september-2018-ah7n9-china-en
- Note de bas de page 27
-
Gouvernement du Canada. (2024). Grippe aviaire A (H5N1) : Réponse du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-aviaire-h5n1/reponse-canada.html
- Note de bas de page 28
-
Pasick, J., Berhane, Y., Joseph, T., Bowes, V., Hisanaga, T. et al. (2015). Reassortant Highly Pathogenic Influenza A H5N2 Virus Containing Gene Segments Related to Eurasian H5N8 in British Columbia, Canada, 2014. Scientific Reports, 5: 9484.
- Note de bas de page 29
-
Organisation mondiale de la santé animale. (2024). Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) – Rapport de situation 61 (en anglais). Organisation mondiale de la santé animale. Consulté le 2024-07-29 à l'adresse https://www.woah.org/fr/document/influenza-aviaire-hautement-pathogene-iahp-rapport-de-situation-61/
- Note de bas de page 30
-
Lee, D. H., Kwon, J. H., Park, J. K., Lee, Y. N., Yuk, S. S. et al. (2012). Characterization of Low-Pathogenicity H5 and H7 Korean Avian Influenza Viruses in Chickens. Poultry Science, 91(12): 3086-3090.
- Note de bas de page 31
-
Hayden, F. et Croisier, A. (2005). Transmission of Avian Influenza Viruses to and Between Humans. The Journal of Infectious Diseases, 192(8): 1311-1314.
- Note de bas de page 32
-
Liu, Q., Lui, D. et Yang, Z. (2013). Characteristics of Human Infection with Avian Influenza Viruses and Development of New Antiviral Agents. Acta Pharmacologica Sinica, 34: 1257-1269.
- Note de bas de page 33
-
Woolhouse, M. E. (2002). Population Biology of Emerging and Re-emerging Pathogens. Trends in Microbiology, 10(10 Suppl): S3-S7.
- Note de bas de page 34
-
Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D. et al. (2008). Global Trends in Emerging Infectious Diseases. Nature, 451(7181): 990-993.
- Note de bas de page 35
-
Jia, X., Huang, L. et Liu, W. (2013). Biosafety Issues and Public Concerns on Recombinant Influenza Viruses Generated in the Laboratories. Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao, 29(12): 1736-1742.
- Note de bas de page 36
-
Ganti, K., Bagga, A., Carnaccini, S., Ferreri, L. M., Geiger, G. et al. (2022). Influenza A Virus Reassortment in Mammals Gives Rise to Genetically Distinct Within-Host Subpopulations. Nature Communications, 13(1): 6846.
- Note de bas de page 37
-
de Silva, U. C., Tanaka, H., Nakamura, S., Goto, N. et Yasunaga, T. (2012). A Comprehensive Analysis of Reassortment in Influenza A Virus. Biology Open, 1(4): 385-390.
- Note de bas de page 38
-
Sedova, E. S., Shcherbinin, D. N., Migunov, A. I., Smirnov, I. A., Logunov, D. et al. (2012). Recombinant Influenza Vaccines. Acta Naturae, 4(4): 17-27.
- Note de bas de page 39
-
Ito, T., Couceiro, J. N., Kelm, S., Baum, L. G., Krauss, S. et al. (1998). Molecular Basis for the Generation in Pigs of Influenza A Viruses with Pandemic Potential. Journal of Virology, 72(9): 7367-7373.
- Note de bas de page 40
-
Ma, W., Kahn, R. E. et Richt, J. A. (2008). The Pig as a Mixing Vessel for Influenza Viruses: Human and Veterinary Implications. Journal of Molecular and Genetic Medicine, 3(1): 158-166.
- Note de bas de page 41
-
Wei, K., Sun, H., Sun, Z., Sun, Y., Kong, W. et al. (2014). Influenza A Virus Acquires Enhanced Pathogenicity and Transmissibility after Serial Passages in Swine. Journal of Virology, 88(20): 11981-11994.
- Note de bas de page 42
-
Gouvernement du Canada. ePATHogène—La base de données sur les groupes de risque. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://health.canada.ca/fr/epathogene
- Note de bas de page 43
-
Organisation mondiale de la Santé. (2019). Guidelines for the Safe Development and Production of Vaccines to Human Pandemic Influenza Viruses and Influenza Viruses with Pandemic Potential, Annex 3, TRS No 1016. Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 2023-10-16 à l'adresse https://www.who.int/publications/m/item/human-pandemic-influenza-viruses-annex-3-trs-no-1016
- Note de bas de page 44
-
Gouvernement du Canada. (2018). Ligne directrice canadienne sur la biosécurité—Évaluation locale des risques. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/lignes-directrices-canadiennes-biosecurite.html
- Note de bas de page 45
-
Gouvernement du Canada. (2021). Ligne directrice canadienne sur la biosécurité—Activités de diagnostic humain. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/activites-diagnostic-humain/document.html#s00
- Note de bas de page 46
-
Gouvernement du Canada. (2018). Ligne directrice canadienne sur la biosécurité—Effectuer une évaluation des risques de biosûreté. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/effectuer-evaluation-risques-biosurete.html
- Note de bas de page 47
-
Agence de la santé publique du Canada. (2015). Plan de surveillance administrative à l'égard des agents pathogènes et des toxines dans un contexte de recherche—Éléments requis et lignes directrices. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/programme-delivrance-permis/plan-surveillance-administrative-a-egard-agents-pathogenes-toxines-contexte-recherche-elements-requis-lignes-directrices.html
- Note de bas de page 48
-
Agence de la santé publique du Canada. Guide des services—Virus de la grippe, virus respiratoires et coronavirus. Disponible à l'adresse https://cnphi.canada.ca/gts/laboratory/1013
- Note de bas de page 49
-
Gouvernement du Canada. (2024). Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) à Winnipeg. Disponible à l'adresse https://inspection.canada.ca/fr/sciences-recherches/nos-laboratoires/cnmae-winnipeg
- Note de bas de page 50
-
Otter, J. A., Donskey, C., Yezli, S., Douthwaite, S., Goldenberg, S. D. et Weber, D. J. (2016). Transmission of SARS and MERS Coronaviruses and Influenza Virus in Healthcare Settings: The Possible Role of Dry Surface Contamination. Journal of Hospital Infection, 92(3): 235-250.
- Note de bas de page 51
-
Agence de la santé publique du Canada. (2023). Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2023-2024. Ottawa, ON, Canada : Gouvernement du Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2023-2024.html