Partie 2 : Rapports de recommandations
Contexte des rapports de recommandations
Comme il est indiqué précédemment, l’évaluation des besoins de la phase I a donné lieu à un large éventail de domaines d’intérêt potentiels pour les recommandations des experts (voir l’annexe 3). Dans le cadre d’une série de réunions de définition de la portée, les représentants du Recours collectif Heyder-Beattie, et de l’Équipe de la Défense ont demandé aux experts de se concentrer sur trois thèmes : l’amélioration de l’éducation, la responsabilisation des dirigeants et le soutien dans le milieu de travail.
Le resserrement de l’évaluation des besoins s’est traduit par certains sujets qui se sont retrouvés en dehors de la portée des rapports des expertsNote de bas de page 18. Ces sujets ont été soulevés et sont pertinents pour le soutien des survivants et pour la lutte contre l’inconduite dans les FAC, et ils bénéficieraient donc d’une discussion et d’une délibération plus approfondies. Alors que les FAC déterminent la mise en œuvre des recommandations des experts, les éléments suivants doivent également être examinés :
Commémoration
- Broche commémorative pour les survivants d’inconduite
- Événement commémoratif pour reconnaître et éduquer les membres des FAC et de l’Équipe de la Défense sur les traumatismes sexuels militaires
Lors de la discussion sur la tradition militaire, l’importance de la cérémonie et de la tenue a été évoquée. Il a été suggéré que le début du changement de culture pourrait se produire avec l’adaptation des traditions, pour inclure un écusson, une épingle et/ou une cérémonie pour les survivants. Les membres ont fait remarquer que quelque chose de concret pour les vétérans serait très significatif pour la communauté.
Amélioration du soutien aux survivants
- Points de contact dédiés sur les bases et les escadres pour le soutien et la défense des survivants
- Examen du devoir de signaler
- Amélioration du soutien à la santé mentale et de la compréhension des dirigeants
- Amélioration de l’alignement entre la gestion des carrières et les services médicaux
Les moyens par lesquels l’Équipe de la Défense et les FAC soutiennent les survivants d’inconduite ou de discrimination ont été reconnus comme des domaines à améliorer. Les membres ont noté les disparités entre la gestion de carrière et le soutien médical, le manque de contrôle et d’organisme pour les survivants en ce qui concerne le processus de signalement, et la possibilité d’améliorer les services de soutien à l’aide de points de contact dédiés sur les bases et les escadres, bien informés et formés et tenant compte des traumatismes.
Amélioration de la reddition de comptes
- Examen du système de justice militaire en ce qui concerne les abus de pouvoir et les fautes professionnellesNote de bas de page 19
- Repenser et actualiser le serment, les valeurs et l’éthique pour les nouvelles recrues
La responsabilité des dirigeants est cruciale pour garantir la confiance et le bien-être des membres des FAC. Alors que l’Équipe de la Défense réfléchit à sa culture organisationnelle et aux obstacles, il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure les membres sont évalués sur la façon dont ils vivent et promeuvent les valeurs et l’éthique convenues lors du recrutement. Une meilleure réflexion sur ce qui est demandé aux membres et la confirmation de la compréhension de ces exigences lors du recrutement constituent également une occasion d’amélioration.
Notices biographiques des experts
Les rapports de recommandations suivants ont été créés par trois experts sous contrat. Bien qu’elles soient le fruit du processus de consultation, les opinions exprimées dans les rapports de recommandations des experts sont celles de leurs seuls auteurs. Après un aperçu des biographies des auteurs, les rapports peuvent être lus dans leur intégralité.
Maya Eichler, Mount Saint Vincent University
L'auteur de Redéfinir le milieu de travail des FAC pour permettre un changement de culture
Mme Maya Eichler est professeure associée en études politiques et canadiennes et en études féminines à Mount Saint Vincent University (MSVU). Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’innovation sociale et l’engagement communautaire et dirige le Centre for Social Innovation and Community Engagement in Military Affairs à MSVU. Mme Eichler s’intéresse au changement social et à l’engagement des citoyens dans la sphère militaire et sécuritaire, avec un accent particulier sur le rôle du genre. Elle mène des recherches sur la politique de défense canadienne; le genre, la violence sexuelle et les forces armées; la transition de la vie militaire à la vie civile et les histoires communautaires de guerre et de paix. Mme Eichler a publié le livre Militarizing Men: Gender, Conscription, and War in Post-Soviet Russia avec Stanford University Press (2012) et le volume édité Gender and Private Security in Global Politics avec Oxford University Press (2015). Ses articles ont été publiés dans l’International Feminist Journal of Politics, Critical Military Studies, Armed Forces & Society, Études Internationales, Critical Security Studies, Citizenship Studies, Brown Journal of World Affairs, International Journal, Military Behavioral Health, Journal of Military, Veteran and Family Health, the Journal of Family Theory and Review, et Canadian Public Administration/Administration publique. Plus récemment, elle a édité un numéro spécial d’Atlantis : Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice intitulé « Gender and the Canadian Armed Forces: Does Change Mean Feminist Progress? ». Elle est également responsable de l’ACS+ pour le Groupe de prospective en défense et sécurité financé par les bourses MINDS du MDN.
Nancy Taber, N2M Consulting
L'auteur de Éliminer les privilèges non mérités : Problématiser l’idéal guerrier ancré dans les politiques et les pratiques de recrutement, de rétention et de promotion
Mme Nancy Taber est professeure et directrice du programme d’éducation des adultes au Département des études pédagogiques de Brock University. Elle est un officier militaire à la retraite qui a servi comme coordonnateur tactique (TACCO) en tant que navigateur aérien d’un hélicoptère Sea King. Elle est titulaire d’un baccalauréat en Science politique du Collège militaire royale du Canada, d’une maîtrise en Éducation (axée sur l’éducation des adultes) de MSVU et d’un doctorat en Éducation (axé sur l’éducation aux adultes) de l’University of South Australia. Elle est membre et ancienne présidente de l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes, membre professionnel de la Canadian Authors Association et ancienne rédactrice en chef de la Revue canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes. Dans le cadre de ses recherches, elle explore les façons dont l’apprentissage, le genre et le militarisme se croisent dans la vie quotidienne, la culture populaire, les musées, les institutions éducatives et les organisations militaires. Elle enseigne dans les domaines de l’éducation critique des adultes et de l’apprentissage socioculturel, en mettant l’accent sur le genre et le militarisme. Mme Taber est l’éditrice ou la coéditrice de cinq livres et de deux numéros spéciaux de revues; elle est l’auteure ou la coauteure de 23 chapitres de livres, de 46 articles de revues et de 57 présentations à des conférences nationales et internationales. Elle est également l’auteure de nouvelles et d’un roman issu de ses recherches sur la fiction, qui explorent les expériences complexes des femmes par rapport à la guerre et aux FAC. Ses consultations portent sur le féminisme et le militarisme, ainsi que sur le rendement humain dans des environnements difficiles, pour des cabinets d’avocats, des organisations gouvernementales, des organisations militaires et des entreprises privées.
Grazia Scoppio, GS Global Consulting
L'auteure de Construisez et ils viendront : (re) construire des FAC inclusives inclusive, diversifiée, équitable et responsable par l’éducation
Mme Grazia (Grace) Scoppio est professeure au sein du Département des études de la défense du Collège militaire royal du Canada (CMRC), est nommée conjointement au Department of Political Studies de l’Université Queen’s et est agrégée au Centre for International and Defence Policy de l’Université Queen’s. Elle a été sélectionnée comme chaire de recherche Fulbright Canada en études sur la paix et la guerre à la Norwich University, au Vermont (États-Unis). Pendant sa résidence à Norwich, de janvier à mai 2021, elle fera des recherches sur la participation des immigrants dans les forces armées du point de vue international. Mme Scoppio était la doyenne des études des études permanentes au CMR de 2017 à 2020, après avoir agi à titre de doyenne associée de 2013 à 2016. De 2002 à 2013, elle a occupé de nombreux postes à l’Académie canadienne de la Défense et à l’Institut de leadership des Forces canadiennes (ILFC). Mme Scoppio détient un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université de Toronto, une maîtrise de l’université Stendhal-Grenoble 3 (France) et un doctorat en éducation de l’Université de Toronto. Elle est l’auteure d’un livre et a rédigé ou corédigé plus de 20 rapports techniques et scientifiques, plusieurs articles de revue et des chapitres dans des livres édités. Elle a fait des présentations à de nombreuses conférences nationales et internationales, et ses recherches ont été publiées comme auteure ou coauteure dans des publications, notamment des livres, des rapports scientifiques, des chapitres de volumes édités et des articles dans des journaux revus par des pairs, comme Armed Forces & Society. Elle a reçu plusieurs subventions et prix, notamment du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du MDN et de Fulbright Canada. Mme Scoppio est une membre active de diverses sociétés universitaires, y compris l’Inter-University Seminar on Armed Forces and Society et la Société canadienne d’éducation comparée et internationale, où elle fait partie de la direction depuis 2000.
Rapports de recommandations des experts
Redéfinir le milieu de travail des FAC pour permettre un changement de cultureNote de bas de page 20
Prémisse : l’armée en tant que lieu de travail exceptionnel pour les hommes et les femmes
Lorsqu’on examine les questions relatives à la culture militaire – de la représentation des genres et de la diversité à l’inconduite sexuelle dans les FAC – il est crucial de comprendre la nature exceptionnelle du milieu de travail militaire. La préparation opérationnelle est sa raison d’être : le travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, l’universalité du service, la responsabilité illimitée et la mission avant soi sont des caractéristiques essentielles de la vie militaire. Souvent décrite comme une « institution totale » (Goffman, 2006), l’armée contrôle de nombreux aspects de la vie des militaires, tels que leurs soins de santé, leurs relations familiales et leurs activités non professionnelles. L’armée est également un lieu de travail où la relation entre l’employeur et les employés est unique. Il n’y a pas de syndicat pour défendre les droits des employés militaires ou soutenir leurs préoccupations liées au travail, et aucun des organismes de surveillance indépendants que l’on trouve dans d’autres milieux de travail (c.-à-d. le système provincial des commissions canadiennes des accidents du travail, le système d’enquête du ministre fédéral du Travail).
La nature exceptionnelle du travail militaire a été utilisée dans le passé pour justifier le statut de l’armée en tant que milieu de travail typiquement masculin et masculinisé. Jusqu’à il y a 30 ans, tous les rôles et postes liés au combat étaient censés être réservés aux hommes. L’ensemble de l’infrastructure et du système militaire a été construit autour de la norme du membre de service masculin (anglophone), blanc, hétérosexuel et cisgenre. En raison de cette histoire, l’institution militaire et sa culture privilégient les membres masculins du service et les traits associés de la masculinité guerrière. Cela a créé des préjugés systémiques et des obstacles hérités du passé pour les femmes et les autres personnes qui ne correspondent pas à l’« idéal » ou à la « norme » présumés. Ces préjugés et ces obstacles sont tolérés et accommodés, mais ne sont pas systématiquement inclus de manière significative. C’est aux femmes et aux autres membres du service historiquement sous-représentés qu’il incombe de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour trouver la manière de s’intégrer dans un système qui n’a pas été conçu pour eux, un peu comme les gauchers qui doivent fonctionner dans un monde organisé pour les droitiers.
Ce rapport remet en question l’hypothèse selon laquelle le manque de représentation des sexes ou genres et de la diversité ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle peuvent être traités de manière significative sans changer le système. Les systèmes militaires (et de vétérans) ont historiquement été aveugles à, et caractérisés par, des préjugés systémiques et des lacunes dans la recherche à l’égard de tous les membres militaires et vétérans historiquement sous-représentés.
Ajouter davantage de femmes, de membres de la communauté LGBTQ2+, de Noirs, d’Autochtones ou de personnes de couleur « et remuer le tout » ne suffira pas à faire évoluer la culture militaire. Les tentatives antérieures pour aborder la représentation des sexes et des genres et de la diversité ainsi que l’inconduite sexuelle dans l’armée se sont concentrées sur des solutions superficielles et simplistes, telles que la levée des obstacles juridiques, l’augmentation du nombre de recrues féminines ou l’ordre donné aux membres de cesser de commettre des inconduites sexuelles. Jamais on n’a tenté d’élaborer une stratégie globale de changement culturel fondée sur l’élimination des préjugés systémiques et des obstacles hérités du passé.
Ce qu’il faut, c’est un changement fondamental dans la façon de penser : « Comment faire en sorte que plus de femmes et de Canadiens issus de la diversité se joignent aux FAC? » et « Comment créer un milieu de travail inclusif, accueillant, sécuritaire, respectueux et favorable, non seulement exempt de préjudice et de discrimination, mais dans lequel les femmes et les membres d’origines diverses peuvent s’épanouir? » La première question fait peser la responsabilité sur les femmes (voir p. ex. Earnscliffe Strategy Group, 2017). La deuxième question met en avant le rôle et la responsabilité de l’institution dans le changement de culture.
Ce rapport propose une feuille de route en trois volets pour le changement.
- Tout d’abord, nous devons aborder et supprimer les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé qui continuent d’exister et de nuire aux militaires historiquement sous-représentés.
- Deuxièmement, nous devons nous engager dans une refonte inclusive du milieu de travail militaire.
- Troisièmement, dans cette refonte, nous devons inclure les perspectives de ceux qui sont le plus négativement affectés par le milieu de travail militaire d’aujourd’hui. Cette refonte nécessite l’identification et l’élimination des préjugés et des obstacles liés au sexe et au genre, ainsi que le développement de soutiens, de services et de programmes adaptés et appropriés pour les sous-populations militaires historiquement sous-représentées.
Le manque de représentation des sexes et des genres et de la diversité et le problème de l’inconduite sexuelle dans l’armée sont des problèmes systémiques et nécessitent donc des solutions systémiques qui permettent un changement transformateur. Pour arriver à ce dernier, il faut repenser le milieu de travail militaire en s’attaquant aux causes profondes de la discrimination et de la violence fondées sur le sexe et le genre, ainsi qu’aux façons dont elle est renforcée par le racisme, l’homophobie et d’autres formes de discrimination et de violence à l’égard de ceux qui ne correspondent pas à l’« idéal » actuel du militaire blanc, hétérosexuel et cisgenre. Il faudra également redéfinir la culture militaire autour d’une compréhension nouvelle et inclusive de l’identité du soldat, du marin, de l’aviateur et de l’opérateur des forces spéciales canadiens.
Comprendre le problème
La conception historique de l’institution militaire : ce n’est pas un nouveau problème.
Il est essentiel, tout d’abord, de comprendre la longue histoire de l’armée, qui perpétue les inégalités entre les sexes et autres. Il ne s’agit pas d’un nouveau problème ou d’un problème contemporain, mais d’un problème aux racines historiques profondes. Si le genre est peut-être la caractéristique la plus déterminante de l’armée, il est important de noter que le genre fonctionne de concert avec d’autres structures de discrimination. Les FAC ont longtemps été non seulement une institution dominée par les hommes et masculiniste, mais aussi une institution hétéronormative, capacitiste et de colons blancs (George, 2016; Poulin et Gouliquer, 2012).
Les FAC, comme d’autres institutions militaires, ont été construites et conçues pour les hommes de service; plus précisément, pour les hommes hétérosexuels, blancs et cisgenres. L’institution a une longue histoire d’adoption de la norme masculine et de privilège de la masculinité, et de discrimination à l’égard des femmes de service. Pendant la majeure partie de l’histoire des FAC, les femmes n’étaient pas autorisées à servir de la même manière que les hommes. Elles ont été incluses que de manière sélective, et construites comme « l’autre » dans la culture militaire. Le privilège de la masculinité et la célébration du guerrier masculin sont des éléments clés de la culture et sont particulièrement difficiles à éliminer, car ils sont historiquement liés à la raison d’être de l’armée : l’efficacité opérationnelle. Cet héritage est profond et imprègne encore la culture aujourd’hui (Davis, 2020; Eichler, 2019a; Taber, 2018; Winslow et Dunn, 2002).
En raison de cet héritage historique, l’ensemble de l’environnement militaire a été conçu autour de la norme de l’homme militaire (blanc, hétérosexuel, cisgenre) marié à une épouse civile, ce qui a créé des obstacles systémiques pour les femmes et les autres personnes qui ne sont pas dans la « norme » (membres de la communauté LGBTQ2+, Noirs, Autochtones, personnes de couleur, membres handicapés et autres, comme les membres célibataires ou les parents seuls). Les salles de bains, les logements, la conception des équipements, la conception des uniformes, la taille et la conception des véhicules, les cockpits des avions et les normes de soins médicaux étaient basés sur la taille, le poids, la force, la forme et la physiologie de l’homme moyen. Il en va de même pour les politiques du personnel militaire conçues pour soutenir la vie et les besoins des hommes, leurs parcours professionnels et leurs styles de leadership. L’armée reflète, de manière exacerbée, les préjugés masculins que l’on retrouve plus largement dans la société (Criado Perez, 2019).
Outre la discrimination à l’égard des femmes, l’hétéronormativité et l’homophobie sont intégrées dans la conception historique des FAC. À partir de la fin des années 1950 et jusqu’au début des années 1990, l’armée s’est engagée dans une campagne concertée visant à « purger » les membres des services lesbiens et gais de l’armée et d’autres lieux de travail de la fonction publique fédérale (Fodey, 2018; Kinsman et Gentile, 2010; Poulin et Gouliquer, 2012).
Les minorités raciales et ethniques ont également l’habitude de devoir se battre pour obtenir le droit de participer à l’armée canadienne, notamment les Canadiens noirs (Ruck, 1987), les Canadiens japonais et chinois (Roy, 1987) et les Canadiens autochtones (Chambre des communes du Canada, 2019), surtout dans le contexte des deux guerres mondiales. Ils ont également dû se battre pour être reconnus après leur service, ce qui reflète la blancheur systémique de l’armée et un racisme sociétal plus large.
Les FAC ont également l’habitude de privilégier les hommes anglophones. Et même si le bilinguisme officiel est pratiqué depuis plus de 50 ans maintenant, il reste une dualité inhérente aux cultures anglophone et francophone au sein de l’armée d’aujourd’hui (Chouinard, 2020).
Cette histoire a conduit au privilège implicite de certains hommes et de certaines masculinités, à l’« altérité » des hommes qui ne correspondent pas à l’« idéal » du guerrier masculin blanc, hétérosexuel, anglophone et cisgenre, et à l’« altérité » de toutes les femmes et des comportements, traits et styles de leadership associés à la féminité. La première étape vers un changement de culture consiste à reconnaître l’impact continu de la conception historique de l’armée canadienne, et la façon dont elle imprègne encore aujourd’hui de nombreux aspects de l’institution et de sa culture. Lorsque nous prenons vraiment cela à cœur, nous pouvons comprendre pourquoi les changements superficiels à court terme ne suffisent pas à provoquer un changement transformateur. Il faudra un effort concerté de la part de l’institution pour défaire de manière systématique et complète l’héritage de cette histoire d’inégalité et d’« altérité ».
De la discrimination au sexe ou au genre et autres aveuglements intersectionnels.
Il y a un peu plus de 30 ans, les dirigeants institutionnels de l’armée se sont battus avec acharnement pour préserver la discrimination fondée sur le sexe et écarter les femmes des rôles de combat. Elle a plaidé avec véhémence devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour être autorisée à maintenir son quota d’hommes, l’« exigence minimale masculine » qui était en vigueur pour 84 professions, dont 29 réservées aux hommes, à l’époque. Les dirigeants militaires ont fait valoir que la présence de femmes dans les armes de combat minerait la cohésion des unités, le moral et, en fin de compte, l’efficacité opérationnelle (Tribunal canadien des droits de la personne, 1989).
En 1989, les FAC ont reçu l’ordre de supprimer l’exigence d’un minimum masculin dans toutes les professions. Mais la suppression de la discrimination légale n’est qu’une condition préalable au changement de culture, elle ne peut pas changer la culture de l’armée et ne l’a pas fait (Winslow et Dunn, 2002). Au lieu de cela, l’institution a adopté ce que Karen Davis (2013) a appelé une « approche neutre ce qui concerne le genre ». Le problème de la neutralité ou de l’indifférence à l’égard du genre est qu’elle ne tient pas compte des structures sexistes de l’armée, des programmes et des services militaires (et, d’ailleurs, de la société en général). La devise est devenue « un soldat est un soldat est un soldat ». Elle part du principe qu’il suffit de traiter tout le monde de la même manière, alors qu’en fait, ce traitement reproduit les inégalités existantes, les femmes devant être traitées de la même manière que les hommes. Mais lorsque les différences et les besoins spécifiques au sexe et au genre des femmes ne sont pas pris en compte, cela renforce les préjugés masculins (Criado Perez, 2019).
Les politiques ouvertement racistes ont disparu depuis longtemps dans les années 1990, mais l’enquête sur la Somalie a révélé la pertinence persistante du racisme en tant qu’aspect problématique de la culture militaire (Whitworth, 2004; Razack, 2004). Le racisme a été abordé dans le cadre du Code de prévention du harcèlement et du racisme (SHARP), une initiative de formation basée sur le changement de comportement, mais sans s’attaquer à la nature historique et systémique du racisme et de la supposée blancheur dans l’institution militaire. En 1992, les FAC ont commencé à autoriser les lesbiennes, les gais et les transsexuels à servir ouvertement dans l’attente d’une décision de justice, mais n’ont jamais reconnu explicitement le rôle de l’homophobie et de l’hétéronormativité dans la culture militaire.
Au cours des trois dernières décennies, depuis que les pressions externes en faveur du changement se sont intensifiées, les FAC se sont concentrées sur le comportement individuel et les objectifs numériques conformément aux exigences de l’équité en matière d’emploi (EE) (gouvernement du Canada, 1995). Les objectifs de l’EE s’adressent à des groupes particuliers, à savoir les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Mais les objectifs de l’EE ne tiennent pas compte du rôle systémique du sexisme, de la misogynie, du racisme et de l’homophobie dans la culture militaire. Ce n’est que récemment que les FAC ont commencé à reconnaître la nécessité de s’attaquer aux formes de discrimination qui se croisent, comme avec la création, en décembre 2020, du Groupe consultatif du Ministère sur le racisme systémique, la discrimination, notamment le racisme anti-Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2, la discrimination sexuelle et la suprématie blanche (gouvernement du Canada, 2021c).
Figure 1 : Compréhension du problème

Longue description
Divers facteurs se chevauchant renforcent la perpétuation des inégalités de genre et d’autres inégalités au sein des Forces armées canadiennes :
- la nature exceptionnelle du travail militaire
- les normes de la masculinité
- l’approche « ajouter et mélanger » et l'indifférence quant aux questions de genre
La culture militaire en tant qu’élément du problème et les tentatives imparfaites pour aborder le changement de culture.
La représentation des sexes ou des genres et de la diversité ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle dans les forces armées sont intrinsèquement liés à la question de la culture militaire. Aujourd’hui, la culture de l’armée est reconnue comme une préoccupation majeure, et le changement de culture a été cerné comme une priorité absolue. Comme le montrent le rapport Deschamps (2015) ainsi que les recherches canadiennes et internationales, le problème n’est pas simplement que les armées sont des organisations dominées par les hommes. C’est plutôt le type de masculinité promu par la plupart des armées, y compris celle du Canada, qui est problématique (Eichler, 2014; Taber, 2018). Cette forme de masculinité guerrière privilégie la robustesse, l’agressivité et la violence et se définit en opposition à ce que la société associe de façon stéréotypée à la féminité : la faiblesse, la vulnérabilité et l’émotion. En particulier dans les métiers à prédominance masculine, cette version « dure » de la vie de soldat limite la tolérance à l’égard des militaires qui ne « correspondent pas » : les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les personnes racialisées, les personnes handicapées ainsi que les personnes souffrant de TSPT et d’autres blessures (Whitworth, 2004). On peut soutenir que la culture de l’armée nuit également aux militaires identifiés comme étant des hommes. Elle limite les possibilités de parler des émotions et de la douleur, et peut décourager la recherche d’aide. La culture militaire est essentielle pour comprendre le genre, la diversité et le bien-être des militaires, car elle façonne leur identité pendant et après le service et le traitement qu’ils reçoivent de leurs pairs, des prestataires de soins de santé et de la chaîne de commandement. Lorsque les soldats quittent l’armée et retournent à la vie civile, ils doivent trouver des moyens de laisser cette culture derrière eux et de s’adapter à la vie civile (Whelan et Eichler, 2019; Eichler 2019b).
Le leadership du MDN et des FAC a reconnu et cerné le changement de culture comme une priorité absolue. Pourtant, la manière dont ce changement a été abordé jusqu’à présent pose trois problèmes principaux qui continueront à entraver la réussite de sa mise en œuvre. Premièrement, l’absence de définition claire de ce qui constitue la culture militaire (y compris ses fondements historiques sexospécifiques) signifie que des mesures sont prises sans une compréhension conceptuelle claire du statu quo ou du résultat souhaité. Deuxièmement, la préoccupation pour les chiffres et les objectifs est un jeu perdant, à la fois parce que les objectifs échouent généralement et parce que les objectifs numériques ne garantissent pas un changement qualitatif de la culture d’une organisation. Les mesures visant à changer la culture sont censées être des preuves du changement de culture sans que leur efficacité soit dûment évaluée sur la base de preuves. Troisièmement, on se préoccupe des comportements individuels et des symptômes plutôt que des causes profondes et des problèmes systémiques. L’opération Honour était basée sur le changement des comportements, mais pas sur le changement des conditions de service pour les femmes et les autres groupes historiquement sous-représentés. Il n’y a jamais eu de tentative stratégique globale pour défaire les causes profondes institutionnelles et culturelles de la discrimination et de la violence (Eichler, 2017, 2019b; English, 2018).
La stratégie intitulée La voie vers la dignité et le respect poursuit cette compréhension imparfaite de la manière dont les institutions évoluent. Toutefois, il lui manque une compréhension de la raison pour laquelle l’inconduite sexuelle a lieu ni quelles en sont les causes profondes. Une fois de plus, l’accent est trop mis sur le comportement individuel, alors même que le document vise à aborder le changement de culture. Elle n’identifie pas la masculinité comme un problème ou même une caractéristique de la culture militaire. Le document ne tient pas compte non plus de la manière dont le sexisme, la misogynie et le racisme s’entrecroisent pour renforcer la violence et la marginalisation. Bien que le document parle de changement de culture, il se concentre sur l’alignement ou le réalignement de la culture des FAC plutôt que sur son changement complet (gouvernement du Canada, 2020).
Figure 2 : Des approches biaisées et imparfaites à un changement transformateur
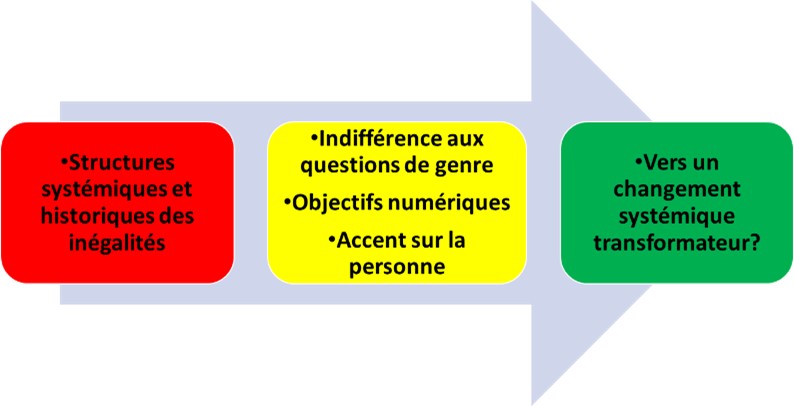
Longue description
Pour cheminer vers un changement systémique transformateur, il faut mettre l'accent sur l'amélioration du milieu de travail :
- en ciblant, en identifiant et en éliminant les structures systémiques et historiques génératrices d’inégalités;
- en s’éloignant des solutions individuelles ou numériques qui requièrent des femmes et des militaires de diverses identités de genre qu’ils s’adaptent à un système biaisé.
Vers un changement transformateur.
Les tentatives précédentes d’assimiler ou d’accommoder les femmes et les membres issus de la diversité n’ont pas suffi à réaliser un changement de culture (Davis, 2020; Okros, 2020). L’accent mis sur les objectifs numériques ou sur le contrôle des comportements individuels n’a pas non plus été une approche fructueuse pour parvenir à un changement de culture (English, 2018). Il convient de mettre davantage l’accent sur la responsabilité de l’institution en matière de changement (ou sur les mécanismes de contrôle externe pour soutenir une telle approche institutionnelle si l’institution ne peut le faire seule), et moins sur les individus (c.-à-d. les femmes et les membres issus de la diversité) pour contribuer au changement. Il incombe aux femmes et aux membres issus de la diversité de trouver des moyens de s’intégrer dans un système qui n’a pas été conçu pour eux. Ce qu’il faut plutôt, c’est un changement systémique transformateur de l’institution militaire. Comme l’explique Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) : « [L] e changement systémique permet de traiter ou de supprimer les obstacles fondamentaux qui entravent l’égalité des genres, plutôt que de chercher à changer les femmes pour qu’elles s’adaptent aux systèmes discriminatoires » (gouvernement du Canada, 2021 a).
Comme on l’affirme dans le présent rapport, l’une des façons d’évoluer vers un changement transformateur est de se concentrer sur l’amélioration de la qualité du milieu de travail en éliminant les préjugés et les obstacles systémiques et en le rendant plus inclusif, accueillant, sûr, respectueux et favorable pour tous les membres du service. La culture militaire est ancrée non seulement dans les idées, mais aussi dans les conditions matérielles du lieu de travail qui ont été façonnées par des préjugés historiques et des obstacles hérités. Si nous changeons ces conditions matérielles, nous avons plus de chances d’assister à un changement transformateur. Les mentalités changent lorsque le système et ses « éléments constitutifs » fondamentaux changent.
Une feuille de route pour le changement
Reconnaître, nommer et traiter les préjugés et les obstacles systémiques.
Les FAC devraient reconnaître et admettre les préjugés systémiques existants et les obstacles systémiques hérités du passé. La reconnaissance de ces préjugés et obstacles hérités du passé nous éloignerait de l’actuel accent imparfait sur les solutions basées sur les individus et les chiffres, et de l’attente que les femmes et les membres issus de la diversité s’adaptent à un système biaisé.
Il y a des leçons à tirer de la communauté autochtone et de la question de la réconciliation. Les universitaires autochtones ont fait valoir que la véritable réconciliation ne peut avoir lieu que lorsque toute la vérité est mise en lumière, que l’institution assume l’entière responsabilité, que le mal n’est plus fait et que la réparation va au-delà de la compensation pour inclure un changement transformateur (Palmater, 2019). Malheureusement, l’ERD Heyder-Beattie exclut déjà « un aveu de responsabilité de la part du Canada » (Heyder-Beattie c. Le Procureur général, 2019). Mais il faut souligner à quel point une certaine forme de bilan est importante comme première étape vers un changement véritable et significatif et le rétablissement de la confiance, en particulier si l’on considère la trahison institutionnelle vécue par les survivants de traumatismes sexuels militaires (TSM) (Eichler et coll., 2019; Holliday et Monteith, 2019).
Les résultats du service militaire ne sont pas équitables, comme nous le savons d’après la vaste documentation internationale et la documentation canadienne limitée sur le service militaire et la vie après le service (Eichler et Smith-Evans, 2018; Eichler et coll., 2020b). Le lieu de travail militaire est dangereux pour tous en raison de la nature exceptionnelle du travail, mais il comporte des risques supplémentaires pour les membres des minorités. Ce n’est pas que nous avons un « système neutre » qui ne fonctionne pas bien. Ce que nous avons, c’est un système biaisé qui a été conçu en fonction d’une certaine « norme ». Le travail militaire comprend de nombreux environnements, tâches, fonctions et expositions uniques, avec peu de recherches ou de compréhension de leurs impacts à court et à long terme sur la santé des femmes (Ritchie et Naclerio, 2015) ainsi que sur la santé et le bien-être des membres issus de la diversité. Mais la culture militaire elle-même, y compris un lieu de travail historiquement conçu autour d’une « norme » spécifique d’hommes blancs, hétérosexuels et cisgenres, constitue un facteur de risque majeur supplémentaire pour la santé et le bien-être de nombreux militaires.
Il est bien établi dans la littérature sur la santé des militaires et vétérans américains que les femmes en service et les vétérans libérés ou retraités sont confrontés à des risques accrus de blessures et de maladies en raison de contextes professionnels sexués. Pour les femmes militaires, cela inclut une foule de problèmes liés à la santé et au bien-être : des problèmes musculo-squelettiques résultant d’un équipement mal adapté et non conçu pour les corps féminins (Friedl, 2005) aux problèmes de santé reproductive liés à la pré-grossesse, à la grossesse, à l’allaitement et à la ménopause (Braun et coll., 2016), et bien plus encore (Eichler et coll., 2020b). Les séquelles potentielles sur la santé physique et mentale vécues par les hommes et les femmes survivants de TSM sont bien documentées dans la littérature, tout en notant que les femmes vétéranes sont plus à risque de vivre un TSM que les hommes vétérans (Pulverman et coll., 2019; Wilson, 2018). Les membres des services et les vétérans membres de la communauté LGBTQ+ américains sont davantage exposés au risque de subir des TSM (Lucas et coll., 2018). Ces membres ont de moins bons résultats en matière de santé mentale, comme des taux plus élevés de TSPT et d’idées suicidaires résultant du stress des minorités (Mark et coll., 2019). Les membres des services et les vétérans de la communauté LGBTQ+ sont également confrontés à l’insensibilité, voire à la discrimination et au harcèlement des prestataires de services (Ruben et coll., 2019). On constate que les vétérans américains racisés et autochtones connaissent des taux plus élevés de traumatisme et de TSPT après le service (ce qui est exacerbé pour les femmes vétéranes racisées et autochtones) et ils sont moins susceptibles de recevoir des diagnostics et un soutien médical pour les problèmes de santé mentale et physique que leurs homologues blancs (Goossen et coll., 2019; Muralidharan et coll., 2016). Comme le montrent les recherches, les sous-populations de militaires et de vétérans sont confrontées à des problèmes de santé uniques qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur bien-être.
Nous devons passer du problème de la représentation du sexe ou du genre et de la diversité au problème des préjugés sexistes, de genre et intersectionnels intégrés qui entraînent une discrimination, une marginalisation et un préjudice potentiel pour les femmes et les autres personnes qui ne correspondent pas à la « norme » du militaire blanc, hétérosexuel et cisgenre. Le service militaire a des effets à long terme, souvent chroniques, sur la santé des membres et des vétérans, qui sont ressentis de manière spécifique au sexe et au genre et à travers des lignes intersectionnelles.
Pour comprendre certaines des causes des problèmes de santé et de bien-être, nous devons cerner les obstacles systémiques hérités du passé qui conduisent à des résultats inéquitables en matière de services. Je suggère que les militaires se posent les questions suivantes : quels sont les obstacles systémiques hérités qui empêchent les femmes et les membres issus de la diversité d’obtenir des occasions de service et des résultats équitables? Comment les femmes et les membres issus de la diversité sont-ils actuellement lésés pendant le service? Cela nécessite des ressources et des recherches dédiées qui cherchent à cerner de manière exhaustive les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé. Par exemple, en quoi le système médical militaire actuel, le système de promotion actuel ou les exigences actuelles en matière d’universalité du service ne répondent-ils pas aux besoins des femmes et des membres issus de la diversité? Cette recherche doit être directement alimentée par la consultation des groupes concernés, tels que les femmes, les survivants d’un TSM et d’autres groupes historiquement sous-représentés. L’ACS+ et l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG) sont des outils essentiels pour réaliser cette comptabilité et analyse de l’état des lieux et créer une image plus complète des obstacles et des préjudices.
L’ACSG est un processus analytique qui applique une lentille de sexe et de genre, principalement, à la recherche en santé (gouvernement du Canada, 2018). L’ACS+ est définie par le gouvernement du Canada comme « est un processus analytique utilisé pour évaluer la façon dont les politiques, les initiatives et les programmes sont reçus par divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires » (gouvernement du Canada, 2021b). Le sexe est considéré comme une classification biologique qui désigne les personnes comme étant de sexe masculin, féminin ou intersexe, en fonction de distinctions anatomiques, hormonales, chromosomiques et génétiques. Le genre fait référence aux masculinités et aux féminités, ainsi qu’aux expressions non binaires et diverses du genre, comme elles se manifestent dans les normes, les comportements et les rôles socioculturels. Les personnes peuvent s’identifier ou non au genre associé à leur sexe de naissance assigné. La pratique exemplaire consiste à appliquer l’ACSG et l’ACS+ de manière intersectionnelle. L’intersectionnalité met en évidence la façon dont la discrimination, l’oppression et la marginalisation liées au sexe et au genre se croisent et sont exacerbées par les expériences de racialisation, de sexualité, d’indigénisme et de capacité, et ce, tant au niveau individuel que systémique (Crenshaw, 1989; Eichler et coll., 2020a). Les deux analyses sont toutes deux pertinentes et nécessaires dans le contexte du service militaire et de la santé et du bien-être des militaires. En mettant l’accent sur la santé, l’ACSG est particulièrement pertinente, car les FAC sont responsables de la santé de leurs membres et parce que les militaires et les vétérans ont des besoins uniques en matière de santé. L’ACS+ est utile pour examiner les conséquences potentiellement involontaires des politiques et des programmes sur les populations historiquement sous-représentées, notamment les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur (Eichler et coll., 2020b).
Les obstacles systémiques hérités touchent principalement les femmes, qui constituent le groupe minoritaire le plus important au sein des FAC. Mais les obstacles fondés sur le sexe et le genre sont renforcés par le racisme, l’homophobie, l’hétéronormativité, et bien d’autres choses encore, créant ainsi des couches de désavantages. Il est donc nécessaire d’examiner les obstacles systémiques hérités sous l’angle du sexe, du genre et de l’intersectionnalité. Plus important encore, les FAC doivent se fixer l’objectif stratégique d’offrir des occasions de service et des résultats équitables pour tous, sans distinction de sexe, de genre, de race, de sexualité, etc.
Redéfinir le milieu de travail militaire pour le rendre plus inclusif et égalitaire.
Nous devons partir de la prémisse de la prévention des dommages en amont plutôt que d’augmenter le recrutement. La littérature montre qu’il est plus efficace de prévenir les préjudices à un stade précoce que de s’occuper de répondre aux préjudices plus tard (Bharmal et coll., 2015). Une telle approche nécessite non seulement l’élimination des préjugés systémiques existants et des obstacles hérités du passé, mais aussi une refonte du milieu de travail militaire.
Les FAC devraient réaménager le milieu de travail en appliquant les principes de conception inclusive (Kern, 2019) et l’intégration intersectionnelle du sexe et du genre (ACSG/ACS+) afin de s’assurer qu’aucun préjudice supplémentaire n’est causé et que les résultats des services deviennent plus équitables. Les approches de conception inclusive et d’intégration intersectionnelle du sexe et du genre reconnaissent que la « taille unique » ne fonctionne pas en fait et que nous devons nous éloigner de la neutralité ou de la cécité du genre (Eichler, 2016). Le corps masculin et la trajectoire de carrière des hommes ont longtemps été considérés comme la norme universelle du milieu de travail militaire. Au lieu de cela, les FAC doivent se demander : À quoi ressemble un milieu de travail militaire qui est favorable et sûr pour tous? Quels changements doivent être apportés pour réaménager le lieu de travail afin qu’il réponde aux besoins des femmes et des membres issus de la diversité? Quels changements politiques et autres devraient être apportés pour soutenir une main-d’œuvre militaire plus diversifiée? Les FAC ont un « environnement construit » qui est basé sur la « norme » masculine. La conception inclusive ne désavantage personne, y compris les habituels utilisateurs masculins blancs et hétérosexuels. Il s’agit plutôt d’une meilleure conception, plus inclusive, du milieu de travail et de la carrière militaires pour tous.
Il existe une base matérielle à cette proposition de refonte. Par exemple, si l’armée vise à recruter davantage de femmes, elle devra s’assurer qu’elle peut fournir des installations (p. ex., des toilettes) et des uniformes qui fonctionnent pour elles et des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers. Les coûts d’adaptation et de réaménagement du milieu de travail doivent être pris en compte dans toute stratégie de changement de culture (Eichler, 2019b).
Cette étape nécessite également une réflexion sur les traits et les comportements qu’un soldat devrait idéalement présenter. Les FAC devront définir une identité nouvelle et inclusive pour le soldat, le marin, l’aviateur et l’opérateur des forces spéciales canadiens, qui s’éloigne explicitement des hypothèses masculinistes de la « norme » ou de l’« idéal » existant façonné historiquement (Duncanson et Woodward, 2016).
Actuellement, il y a toujours un « idéal » implicite en circulation basé sur la norme de l’homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Mais par quoi faut-il le remplacer? Cela renvoie également à la question plus large de savoir ce que nous considérons comme l’objectif principal de l’armée au XXIe siècle. S’agit-il toujours d’une force principalement axée sur les opérations de combat sur le terrain ou d’une force qui se considère comme hautement professionnalisée et axée sur la cybernétique? Il s’agit d’une conversation importante à avoir en interne au sein des FAC ainsi qu’avec les Canadiens et leurs représentants élus politiquement.
Enfin, non seulement les structures et les systèmes de soutien existants ne répondent pas nécessairement aux besoins des militaires et des vétérans historiquement sous-représentés, mais l’absence de services adaptés peut exacerber les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La documentation de recherche internationale appelle sans équivoque à l’élaboration de programmes et de soins spécifiquement adaptés qui peuvent répondre aux besoins des femmes vétéranes, des survivants de TSM et d’autres sous-populations vulnérables de vétérans comme les membres de la communauté LGBTQ+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur (Brunner et coll., 2019; Kehle-Forbes et coll., 2017; Kramer et coll., 2017; Rosen et coll., 2013; Rosentel et coll., 2016). Les États-Unis mettent en évidence les atouts d’une approche stratégique intégrée descendante pour créer des initiatives institutionnelles et politiques visant à soutenir la diversité des membres actifs et anciens. Dans ce contexte, le Department of Veterans Affairs (USDVA) et la Veterans Health Administration (VHA) des États-Unis, en particulier, ont fait de grands progrès pour cerner les besoins des femmes vétérans et les combler et, dans une moindre mesure, les besoins des vétérans membres de la communauté LGBTQ+, racisés et autochtones, grâce à un certain nombre d’initiatives : recherche (gouvernement américain, CDN); personnel désigné (p. ex. coordonnateurs pour les femmes vétérans) (gouvernement des États-Unis, CND); coordonnateurs pour les TSM (gouvernement des États-Unis, CDN); coordonnateurs pour les membres de la communauté LGBT (gouvernement des États-Unis, 2017); modèles de prestation de programmes et de services adaptés au sexe (gouvernement des États-Unis, CDN) et sensibilisation active (Hudak, 2021). Un autre exemple qui illustre le soutien proactif des femmes militaires est le manuel Unit Guide to Leading Pregnant and Postpartum Soldiers préparé par l’armée américaine (Barber et coll., 2021). D’autres initiatives américaines pertinentes qui pourraient être imitées au Canada comprennent de solides programmes de mentorat pour les femmes, comme WOVEN, un réseau de femmes vétéranes (WOVEN, 2019). Le cas des États-Unis souligne également l’importance d’un programme de recherche piloté et soutenu par le gouvernement pour combler les lacunes historiques de la recherche, en particulier en ce qui concerne les populations de militaires et de vétérans historiquement sous-représentées, comme les femmes (Eichler et coll., 2020b). De telles initiatives pourraient être imitées par les FAC et le MDN, et reflétées par ACC).
Améliorer l’obligation de rendre compte du changement transformateur.
Il est évident que le fait de donner des moyens d’action et de faire entendre la voix de ceux qui ont été historiquement réduits au silence et marginalisés est un mécanisme clé pour obtenir et maintenir un changement transformateur. L’engagement participatif des sous-populations et des communautés historiquement marginalisées ou opprimées dans la recherche de solutions est une pratique exemplaire normalisée dans des domaines de recherche et de politique tels que la santé (Snow et coll., 2018), les études sur le handicap (Charlton, 2000), le secteur public (Rioux, 2019), la réconciliation avec les Premières Nations (Commission de vérité et de réconciliation du Canada, 2015) et le programme Femmes, paix et sécurité (UNSCR, 2000), pour n’en citer que quelques-uns. Cela indique que les réalités vécues, les vérités et les besoins des personnes concernées devraient être le principe directeur du développement de la recherche, des politiques, des programmes, des services et des bénéfices.
Nous devons donc inclure dans le réaménagement du lieu de travail militaire les perspectives de ceux qui ont une expérience directe de la culture de travail problématique de l’armée. Il s’agit notamment de tirer les enseignements de la communauté des défenseurs des droits, des vétérans et de tous les groupes en quête d’équité. Il convient également de tirer des enseignements importants des efforts connexes visant à éliminer les préjugés et la discrimination, comme les recommandations du Rapport du Fonds Purge LGBT (2021). La responsabilisation signifie également que le principe de « ne pas nuire » doit être rationalisé dans toutes les initiatives de changement.
Ce principe vient du domaine médical, mais a également été largement appliqué dans le domaine de l’humanitaire et de l’aide (Charnacle et Lucci, 2018). L’importance du principe de « ne pas nuire » a été reconnue tout récemment dans la recherche sur les militaires et les vétérans dans le contexte du préjudice moral et de ses conséquences (Williamson et coll., 2021). Pour que l’on puisse aider le mieux possible les personnes concernées, il faut que toute recherche ou tout nouveau service de soutien s’articule autour de principes tenant compte des traumatismes. La sensibilisation aux traumatismes et le respect de la dignité de la personne touchée doivent toujours être renforcés et pris en compte à tous les niveaux de travail.
Une participation et des consultations significatives sont des éléments essentiels de la responsabilisation en vue d’un changement transformateur. Les consultations entre les FAC et les personnes concernées doivent être respectueuses, significatives et représentatives de la diversité des besoins des survivants d’un TSM, des femmes et des hommes en service et des vétérans, des membres de la communauté LGBTQ2+, des personnes racialisées et des Autochtones. Il faut également donner la parole à ceux qui ont récemment quitté l’armée, car souvent, ce n’est qu’après la libération que l’impact du TSM et d’autres préjudices est mieux compris et que les individus ont la possibilité de dire leur vérité. Le débat actuel sur le changement de culture, à l’intérieur et à l’extérieur des FAC, est toujours dominé par des voix qui parlent au sujet des membres et des vétérans des FAC, et non pour ou avec eux. Des mécanismes clairs doivent être mis en place pour que ces membres et ces vétérans puissent s’exprimer et contribuer aux initiatives de changement de culture en cours.
Les États-Unis offrent des exemples de ce à quoi peut ressembler une consultation significative des femmes et d’autres voix diverses. Par exemple, le Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS) est un organe composé de femmes et d’hommes civils qui conseille le secrétaire à la Défense « [Traduction] sur les questions et les politiques relatives au recrutement, à la rétention, à l’emploi, à l’intégration, au bien-être et au traitement des femmes militaires dans les forces armées » (DACOWITS, aucune date). Le Canada pourrait bénéficier d’un conseil consultatif permanent similaire qui inclurait des voix d’expérience vécue sur l’équité, la diversité et l’inclusion provenant d’un large éventail de membres des services/vétérans historiquement sous-représentés et de leurs alliés.
Enfin, la tâche à accomplir est trop complexe pour que les militaires s’y attaquent seuls. Une certaine forme de mécanisme de surveillance externe est nécessaire pour garantir que le changement de culture militaire transformateur est réalisé et soutenu (Eichler et Breeck, 2021; Eichler et Gagnon, 2021). Il est crucial que les militaires reconnaissent que la surveillance et l’implication externes représentent une occasion, et non une menace.
Principes directeurs
- Appliquer systématiquement l’« ACS+/ACSG ». L’ACS+ et l’ACSG sont des outils essentiels pour examiner les différences et les inégalités potentielles dans les expériences et les résultats des services en mettant l’accent sur le sexe, le genre et l’intersectionnalité.
- Mettre en pratique les principes d’« équité » et d’« inclusivité ». Chaque militaire doit être pris en compte et inclus dans la recherche, la politique, le programme et la conception des soins, avec une reconnaissance des préjugés systémiques historiques qui ont bénéficié à des groupes spécifiques plutôt qu’à d’autres, y compris dans la création de connaissances de recherche. Le soutien équitable sur le lieu de travail ne consiste pas à être traité de manière « égale » ou « identique »; il s’agit de comprendre et d’accommoder les différences et de créer des lieux de travail favorables qui fonctionnent pour tous. Il s’agit d’uniformiser les conditions de travail pour les femmes militaires et les membres issus de la diversité.
- Mettre en pratique le principe « Rien ne se fera pour nous sans nous ». Les groupes qui recherchent l’équité, dont les femmes constituent le groupe le plus important, doivent être inclus activement, en tenant compte des traumatismes, et avoir une voix organisée dans la recherche, les politiques, les programmes et la conception des soins des FAC.
- Mettre en pratique le principe « ne pas nuire ». Les soutiens doivent partir du principe de « ne pas nuire », ce qui signifie qu’il faut s’assurer que les mesures prises n’entraînent pas de risques, de charges ou de préjudices supplémentaires pour les personnes concernées. La pratique exemplaire consiste à exiger une formation pour assurer la sensibilisation aux traumatismes, la sensibilisation au sexe et au genre, la sensibilisation à l’ACS+, et un code d’éthique pour les personnes ayant un rôle de soutien direct aux membres des groupes en quête d’équité.
- Inclure les vétérans en tant que détenteurs du savoir. La communauté des vétérans est à l’origine d’une grande partie des leçons apprises. Les vétérans devraient donc participer activement aux initiatives de changement de la culture militaire (Eichler et coll., 2020b).
- Chercher à obtenir une contribution et une supervision externes. Le changement de culture militaire a été défini comme un « problème complexe », trop difficile à résoudre pour que l’armée puisse s’y attaquer seule. Il faut des solutions complexes et une surveillance externe (English, 2018). La surveillance et l’apport externes sont essentiels pour garantir le progrès et la responsabilisation (Eichler et Breeck, 2021; Eichler et Gagnon, 2021).
Figure 3 : Principes directeurs et étapes clés de la feuille de route pour le changement
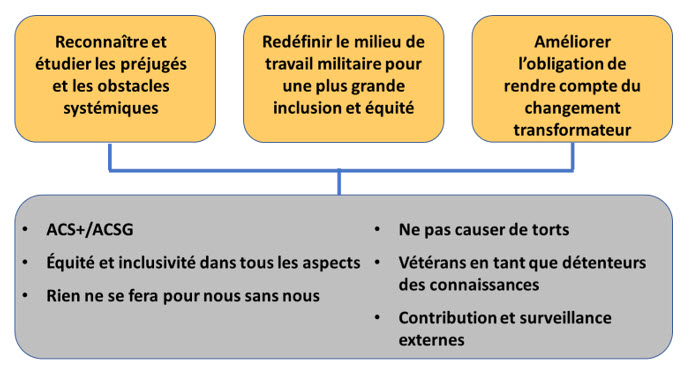
Longue description
Les trois étapes clés d'un changement systémique transformateur :
- Reconnaître et étudier les préjugés et les obstacles systémiques pour s’y attaquer
- Redéfinir le milieu de travail militaire pour une plus grande inclusion et équité
- Améliorer l'obligation de rendre compte du changement transformateur
Des principes directeurs sous-tendent la réalisation de ces étapes clés :
- Appliquer uniformément l’analyse comparative entre les sexes plus et l’ACSG
- Renforcer l'équité et l’inclusivité de manière significative
- Veiller à ce que « rien ne soit fait pour nous sans nous »
- Ne pas causer de tort
- Mobiliser les vétérans à titre de détenteur de connaissances
- Solliciter les contribution et la surveillance externes
Recommandations
Reconnaître, nommer et traiter les préjugés et les obstacles systémiques
- Affecter des fonds et des ressources à l’examen complet des préjugés systémiques liés au sexe, au genre et intersectionnels dans les politiques, les infrastructures, les équipements, la recherche, la formation, les soins de santé, etc.
- Créer un inventaire complet des obstacles systémiques hérités du passé à l’aide de recherches, d’examens et de consultations avec des survivants d’un TSM, des femmes, des membres en service et des vétérans de la communauté LGBTQ2+, des Noirs, des Autochtones et des autres personnes de couleur.
- Fixer l’objectif stratégique d’offrir des possibilités de service et des résultats équitables à tous les militaires, indépendamment du sexe, du genre, de la race, de la sexualité et d’autres facteurs d’identité.
- Continuer à renforcer l’ACS+ du milieu de travail militaire, y compris de la culture organisationnelle, du stress en milieu de travail militaire (opérationnel et non opérationnel), des caractéristiques de la conception du travail, de la justice organisationnelle, du harcèlement sexuel au travail, etc.
- Effectuer un examen de l’ACSG relativement à la politique, à la recherche, à la prestation des soins et aux résultats des Services de santé des Forces canadiennes (Svc S FC), y compris les niveaux de satisfaction des fournisseurs de soins de santé et des patients, ainsi que des examens indépendants réguliers de l’assurance de la qualité pour la santé des femmes au niveau de la prévention, des soins généraux, de la médecine du travail et de la médecine opérationnelle.
- Rechercher activement les pratiques exemplaires pour employer et déployer les femmes en toute sécurité et les retenir sur le lieu de travail, y compris la prévention de la violence fondée sur le genre (VFG), de la violence dans les relations intimes (VRI) et des accidents du travail liés au sexe.
- Élaborer une recherche sur le « parcours de vie » fondée sur l’ACS+ qui examine la trajectoire de santé des militaires avant, pendant et après le service militaire, y compris la boucle de rétroaction d’ACC sur les blessures et les maladies évitables. Ces recherches sur le parcours de vie devraient permettre d’élaborer des stratégies de prévention et d’intervention en amont afin d’améliorer et d’optimiser les résultats du service militaire et de la transition de la vie militaire à la vie civile.
- Inclure les militaires touchés et également les vétérans en tant que détenteurs du savoir dans l’identification des préjugés et des obstacles dans le milieu de travail militaire. Les vétérans ont tiré des leçons importantes qu’il ne faut pas oublier et qui peuvent être utilisées pour éviter de nuire aux membres actuels.
Redéfinir le milieu de travail militaire pour une plus grande inclusion et équité
- Prendre des mesures concrètes en vue d’une refonte de l’armée pour en faire un milieu de travail accueillant, inclusif, sûr, respectueux et favorable.
- Appliquer les leçons tirées des examens et des recherches ci-dessus en consultation avec les sous-populations de militaires et de vétérans touchées.
- Définir une nouvelle compréhension inclusive de l’identité du soldat, du marin, de l’aviateur et de l’opérateur des forces spéciales canadiens qui s’éloigne explicitement des hypothèses mâles/masculines (blancs et hétérosexuels) de la « norme » ou de l’« idéal » existant. Cette nouvelle identité inclusive devrait permettre aux militaires d’apporter leur authenticité sur le lieu de travail.
- Appliquer une optique de l’ACS+ au recrutement, au maintien en poste, à la libération ou la retraite, à la transition et à la santé et au bien-être (qualité de vie) des militaires (et des vétérans). Par exemple, assurer la représentation des femmes et d’autres groupes en quête d’équité dans les centres de recrutement; former les recruteurs à l’ACS+ et à la sensibilisation aux préjugés inconscients; effectuer une analyse et une stratégie de maintien en poste fondées sur l’ACS+ et élaborer une stratégie de transition et des mesures de soutien fondées sur l’ACS+. (Cela s’étend à l’importance d’appliquer l’ACS+ dans la commémoration, les avantages et les services aux vétérans d’ACC.)
- Rechercher activement et diffuser les connaissances sur l’atténuation des risques et les leçons apprises pour les militaires et les vétérans soucieux d’équité parmi les nouvelles recrues et les militaires en service et en voie de libération (prévention des dommages en amont).
- Mettre en œuvre les recommandations des examens de l’intersectionnalité dans les activités du Chef du personnel militaire (CPM), y compris toutes les recherches, politiques et programmes en général et spécifiques aux Svc S FC.
- Conformément à l’approche « le personnel d’abord » des FAC et au mandat de l’ACS+, mettre en œuvre les considérations de l’ACSG/ACS+ dans le système de soins de santé militaire afin d’assurer une recherche, des politiques et des considérations de soins et traitement équitables pour les militaires qui ne font pas partie de l’effectif militaire masculin hétérosexuel supposé normatif. Cela doit inclure des recherches sur les besoins spécifiques en matière de soins de santé des femmes, des membres de la communauté LGBTQ2+, des Autochtones et des membres racialisés, qui ne sont actuellement pas satisfaits. Effectuer une ACS+ des outils de dépistage médical existants et les modifier afin de refléter les besoins en soins médicaux des membres issus de la diversité. (Cela aura des répercussions concrètes sur l’admissibilité aux avantages et aux services d’ACC.)
- Fournir des prestations, des soutiens et des soins appropriés et adaptés qui répondent aux besoins des membres soucieux d’équité et qui atténuent activement les effets des obstacles systémiques hérités du passé tout en remaniant le système militaire pour tenir compte des besoins de soins des membres issus de la diversité.
- Élaborer des programmes de soins de santé spécifiques aux femmes (éclairés par l’examen stratégique de la santé des femmes en cours dans les Svc S FC) visant à assurer la santé des femmes, notamment la santé génésique, la réadaptation post-partum, etc. Veiller à ce que des prestataires de soins de santé féminins soient disponibles pour servir les patientes ou clientes militaires.
- Assurer un diagnostic, des soins, des avantages et des programmes équitables, y compris pour la prévention des accidents du travail liés au sexe. (Cette recommandation s’étend à ACC pour assurer l’équité des traitements, des programmes et des avantages pour toutes les blessures et maladies liées au service, qu’elles soient liées au combat, au déploiement ou au TSM.)
- Assurer un soutien équitable aux victimes et survivants d’un TSM. Introduire un dépistage régulier des TSM et des traitements adaptés aux survivants d’un TSM, un programme national de soutien par les pairs financé par le gouvernement fédéral (disponible en anglais et en français, pour les hommes et les femmes, au Canada et lors de déploiements internationaux), et un coordonnateur ou un défenseur contre les TSM pour soutenir les survivants dans le processus de recherche de soins ou de signalement. Réintroduire des psychologues cliniques en uniforme, afin que les survivants de TSM aient accès à des soins adaptés à la culture militaire.
- Élaborer une définition reconnue du TSM et préciser sa relation avec les blessures liées au stress opérationnel (BSO), les blessures morales et le TSPT. (Cette recommandation s’étend à ACC, et devra être mise en œuvre en collaboration avec ce ministère.)
- La recherche, la politique, les programmes, les services et le soutien en matière de TSM devraient inclure l’ACS+ dès leur création afin de garantir que les besoins de tous les membres, peu importe le sexe, le genre ou les intersectionnalités, soient pris en compte et satisfaits.
- Encourager le développement d’experts pour les fonctions secondaires comme des coordonnateurs pour la santé des femmes, des coordonnateurs qui s’occupent des TSM, des coordonnateurs pour les maternités, des coordonnateurs pour la santé des membres de la communauté LGBTQ2+, etc. dans les cliniques des FAC, comme dans le système médical militaire américain.
- Renforcer les initiatives de mentorat pour les femmes et les étendre à d’autres militaires en quête d’équité. Apprendre des exemples existants au sein et au-delà des FAC; notamment, le Réseau de mentorat intégré pour les femmes, les efforts de mentorat dans le cadre de l’Organisation consultative des femmes de la défense (OCFD) et la communauté des femmes vétérans du Collège militaire royal (CMR), et le Réseau des femmes vétérans des États-Unis (WOVEN). Le mentorat doit être éclairé par l’ACS+ et permettre à la personne encadrée de choisir son mentor. De plus, des lignes directrices pour les mentors devraient être élaborées pour créer des normes afin que les conflits d’intérêts soient abordés et que les conseils de mentorat soient en accord avec les impératifs de changement de culture.
- Élargir les soutiens familiaux, comme les garderies, les horaires de travail flexibles ou les politiques de congé familial, afin que les membres n’aient pas l’impression de devoir quitter le travail militaire pour fonder une famille. Introduire un congé payé pour fausse couche et perte de grossesse afin de reconnaître les preuves médicales des problèmes de santé reproductive des femmes militaires. Appliquer l’optique de l’ACS+ au soutien aux familles afin d’assurer un accès et des résultats équitables pour les membres qui recherchent l’équité.
Améliorer l’obligation de rendre compte du changement transformateur
- Donner du pouvoir aux groupes en quête d’équité en veillant à ce que leur voix organisée soit entendue.
- Créer des mécanismes internes pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité en matière de changement transformateur; notamment, à l’aide d’un groupe consultatif stratégique permanent de niveau ministériel sur la diversité, l’inclusion et l’équité (en plus de l’actuel groupe consultatif de niveau ministériel sur le racisme systémique, la discrimination avec un accent sur le racisme anti-autochtone et anti-noir, et les préjugés envers la communauté LGBTQ2, les préjugés sexistes et la suprématie blanche).
- Inclure les vétérans dans les mécanismes de responsabilisation; notamment, permettre aux vétérans de participer aux groupes consultatifs de la défense (GCD) et de formuler des commentaires de façon structurée aux bureaux d’EE des FAC (en l’absence de toute structure ou voix similaire au sein d’ACC).
- Soutenir les mécanismes externes pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilisation en vue d’un changement transformateur; notamment, en incluant les experts externes et la contribution des intervenants, tout en attendant les recommandations de la juge Arbour en ce qui concerne les mécanismes de contrôle externe.
- Mener régulièrement des examens internes et externes pour évaluer les progrès réalisés dans la suppression des obstacles systémiques pour les femmes et les autres membres du service historiquement sous-représentés. Les résultats de ces examens devraient être rendus publics afin d’accroître la transparence et la responsabilisation.
- Rendre publiques toutes les recherches internes et externes liées à l’ERD Heyder-Beattie afin d’accroître la transparence et la responsabilité.
Conclusion
Il est essentiel d’aborder avec succès la question de la représentation des sexes et des genres et de la diversité, ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle, pour que les FAC conservent leur légitimité dans la société canadienne. En outre, il faut s’attaquer à la culture problématique de l’armée, ce qui est également essentiel à la légitimité interne des FAC et à la reconstruction et au maintien de la confiance parmi ses membres actuels et futurs. Bien que la nature exceptionnelle du travail militaire ait été utilisée dans le passé pour justifier la discrimination à l’égard des femmes et des membres issus de la diversité, le moment est venu de défaire les préjugés systémiques existants et les obstacles hérités du passé. Au lieu de se concentrer sur le recrutement d’un plus grand nombre de femmes et d’autres membres historiquement sous-représentés, l’armée canadienne a besoin d’une stratégie globale axée sur son rôle institutionnel dans la reproduction, et sa responsabilité dans la prévention, de l’inconduite sexuelle ainsi que de toutes les formes de discrimination et de violence dans le milieu de travail militaire.
Ce rapport présente une feuille de route pour la création d’un milieu de travail inclusif et favorable pour tous les militaires, qui consiste en trois étapes primordiales. La première étape consiste à reconnaître, à cerner et à éliminer les préjugés et les obstacles systémiques qui continuent de causer des discriminations et des préjudices aux femmes ainsi qu’aux autres sous-populations qui ne correspondent pas à la « norme » masculine blanche, hétérosexuelle et cisgenre. La deuxième étape consiste à redéfinir le milieu de travail militaire dans un souci d’inclusion et d’équité en éliminant les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé; en créant de nouveaux soutiens adaptés aux besoins des militaires historiquement marginalisés et sous-représentés; en redéfinissant l’identité du soldat canadien de manière inclusive; en assurant l’équité des avantages, des services et des soins, et plus encore. La troisième étape, concomitante, consiste à renforcer la responsabilité interne à l’égard des femmes et des autres groupes en quête d’équité en ne leur faisant aucun mal et en leur donnant une voix organisée au plus haut niveau, par exemple à l’aide d’un groupe consultatif permanent au niveau ministériel. Étant donné les échecs constants à réaliser un changement transformateur, une surveillance externe indépendante à long terme, une collaboration avec des experts externes et un engagement transparent avec le public canadien sont également nécessaires pour progresser vers l’objectif stratégique de possibilités de service et de résultats équitables pour tous les membres et des FAC plus inclusives à l’avenir.
Ce rapport d’expert définit des étapes concrètes pour un changement de culture en se concentrant sur les conditions matérielles du lieu de travail militaire. Si l’objectif est de créer un système plus équitable qui fonctionne pour tous, il y aura une résistance de la part de ceux dont les privilèges non mérités devront être remis en question et supprimés. Le changement est possible, même s’il suscite une résistance, un malaise, voire un retour de bâton. En fin de compte, l’accent doit être mis sur ce qui est le mieux pour garantir la santé et le bien-être de tous les membres actuels et futurs du service.
Reférences
- Barber, C., Bell, K., Boston, M., Boursinos, K., Fleischmann, I., Gephart, M., Gonzalez, M., Dove, D. D., Harmon, S., Kelley, J., Pierce, N., Scholl, S., Stephens, S., et Williams, H. (30 avril 2021). « Athena thriving II: A unit guide to leading pregnant and postpartum soldiers. » (Anglais seulement) The Company Leader.
- Bharmal, N., Derose, K. P., Felician, M., et Weden, M. M. (2015). Understanding the upstream social determinants of health. [PDF, 938 Ko] (Anglais seulement) RAND Health.
- Braun, L. A., Kennedy, H. P., Womack, J. A., et Wilson, C. (2016). « Integrative literature review: US military women’s genitourinary and reproductive health » [PDF, 938 Ko] (Anglais seulement) Military Medicine, 181(1), pp. 35-49.
- Brunner, J., Cain, C. L., Yano, E. M., et Hamilton, A. B. (2019). « Local leaders’ perspectives on women veterans’ health care: What would ideal look like? » (Anglais seulement) Women's Health Issues, 29(1), pp. 64–71.
- Tribunal canadien des droits de la personne. Brown c. Forces armées canadiennes, D.T., 3/89. 1989.
- Charlton, J. I. (2000). Nothing about us without us: Disability oppression and empowerment. University of California Press.
- Charnacle, J. M. B., et Lucci, E. (2018). « Incorporating the principle of “Do No Harm”: How to take action without causing harm. » (Anglais seulement) Humanity et Inclusion Canada.
- Chouinard, S. 2020. « Francophone inclusion and bilingualism in the Canadian Armed Forces », Dans Edgar, A., R. Mangat et B. Momani (éd.), Strengthening the Canadian Armed Forces through diversity and inclusion, (pp. 101-13). University of Toronto Press, 1998.
- Crenshaw, K. 1989. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, University of Chicago Legal Forum, pp. 139–167.
- Criado Perez, C. 2019. Invisible women: Data bias in a world designed for men, Abrams Press.
- Davis, K. D. 2013. Negotiating gender in the Canadian Forces, 1970-1999, (thèse de doctorat non publiée), Collège militaire royal du Canada.
- Davis, K. D. 2020. « Negotiating gender inclusion », Dans Edgar, A., R. Mangat et B. Momani (éditeurs), Strengthening the Canadian Armed Forces through diversity and inclusion, (pp. 36-51). University of Toronto Press, 1998.
- Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS) (Anglais seulement). S.d.
- Deschamps, M. 2015. Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes. [PDF, 671 Ko].
- Duncanson, C., et Woodward, R. (2016). « Regendering the military: Theorizing women’s military participation. » (Anglais seulement) Security Dialogue, 47(1), pp. 3–21.
- Earnscliffe Strategy Group. (2017). Rapport de recherche sur le recrutement et l’embauche des femmes dans les Forces armées canadiennes, Directrice générale, recherche et analyse (personnel militaire), rapport contractuel, (DRDC-RDDC-2017-C003), Recherche et développement pour la défense Canada.
- Eichler, M., et Smith-Evans, K. (2018). « Gender in veteran reintegration and transition: A scoping review. » (Anglais seulement) Journal of Military, Veteran and Family Health, 4(1), pp. 5–19.
- Eichler, M. 2014. « Militarized masculinities in international relations », Brown Journal of World Affairs, 21(1), pp. 81-93.
- Eichler, M. 2016. « Learning from the Deschamps Report: Why military and veteran researchers ought to pay attention to gender » (Anglais seulement), Journal of Military, Veteran and Family Health, 2(1), pp. 5-8.
- Eichler, M. 2017a. « L’opération Honour en perspective : La politique changeante du genre dans les Forces Armées Canadiennes », Études Internationales, 48 (1), pp. 19–36. .
- Eichler, M. (2019a). « Military sexual violence in Canada ». Dans K. Malinen (éd.), Dis/Consent: perspectives on sexual violence and consensuality (pp. 75–82). Fernwood Publishing.
- Eichler, M. 2019b. « Culture change in the Canadian Armed Forces », Dans MOMANI, B. (éd.), Foresight & analysis in Canadian defence and security policy: Report for the Department of National Defence, (pp. 12–14). Canadian Network for Security and Defence Analysis.
- Eichler, M., et Breeck, K. (12 mars 2021). « Canada’s problematic military culture warrants an oversight agency. (Anglais seulement) Policy Options.
- Eichler, M., et Gagnon, M-C. (26 février 2021). « Only a fundamental culture change will address military sexual misconduct. » (Anglais seulement) Policy Options.
- Eichler, M, Gagnon, M.-C., et M. Lamothe. 2019. « Sexual violence as a veteran issue: The struggles (and successes) of military sexual trauma survivors in Canada », Dans D. T. MacLeod et H. O. Leduc (éd.), Treated like a liability: Veterans running battles with the Government of Canada, (pp. 71–95). FriesenPress.
- Eichler, M., Bouka, Y., Brown, V., Compaoré, N., George, T., Lane, A., Spanner, L. et Tait, V. (2020a). GBA+ toolkit [PDF, 140 Ko]. (Anglais seulement) Defence & Security Foresight Group.
- Eichler, M., Spanner, L., L. Tam-Seto et K. Smith-Evans. 2020b. Literature review on “Military to civilian transition: The importance of GBA+ for the Canadian Armed Forces”, Task 50 Report, Présenté au Groupe de transition des Forces armées canadiennes, 28 août.
- English, A. 20-21 octobre 2018. Comprehensive culture change’ and diversity in the Canadian Armed Forces: An assessment of Operation HONOUR after three years and implications for the latest CAF ‘diversity strategy (présentation papier), IUS Canada Conference, Ottawa.
- Fodey, S. (réalisateur). 2018. The fruit machine (Anglais seulement) (film), The Ontario Educational Communications Authority (TVO).
- Friedl, K. E. 2005. « Biomedical research on health and performance of military women: Accomplishments of the Defense Women’s Health Research Program (DWHR) » (Anglais seulement), Journal of Women’s Health, 14(9), pp. 764–802.
- George, T. 2016. Be all you can be or longing to be: Racialized soldiers, the Canadian military experience and the im/possibility of belonging to the nation [thèse de doctorat non publiée], Université de Toronto.
- Goffman, E. 2006. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates (2e éd.), Penguin Books.
- Goossen, R. P., Summers, K. M., Ryan, G. L., Mengeling, M. A., Booth, B. M., Torner, J. C., C. H. Syrop et A. G. Sadler. 2019. « Ethnic minority status and experiences of infertility in female veterans », Journal of Women’s Health, 28(1), pp. 63–68.
- Gouvernement du Canada. 1995. Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44). Ministère de la Justice.
- Gouvernement du Canada. 2018. Comment les IRSC appuient-ils l’intégration de l’ACSG à la recherche, Instituts de recherche en santé du Canada.
- Gouvernement du Canada. 2020. La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des Forces armées canadiennes en matière d’inconduite sexuelle, Ministère de la Défense nationale du Canada.
- Gouvernement du Canada. 2021a. Fonds de réponse et de relance féministes : À propos, Femmes et égalité des genres Canada.
- Gouvernement du Canada. 2021b. Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), Femmes et égalité des genres Canada.
- Gouvernement du Canada. 2021 c. Groupe consultatif du Ministère sur le racisme systémique, la discrimination, notamment le racisme anti-Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2+, la discrimination sexuelle et la suprématie blanche, Ministère de la Défense nationale du Canada.
- Heyder-Beattie c. Le procureur général, no T-2111-16/T-460-17 (Cour fédérale, le 25 novembre 2019).
- Holliday, R., et L. L. Monteith 2019. « Seeking help for the health sequelae of military sexual trauma: A theory-driven model of the role of institutional betrayal. » (Anglais seulement) Journal of Trauma & Dissociation, 20(1), 1–17.
- Chambre des communes Canada. Février 2019. Les vétérans autochtones : des souvenirs d’injustice à une reconnaissance durable, Rapport du Comité permanent des anciens combattants, 42e législature, 1re session.
- Hudak, T. 19 janvier 2021. « VA making extra effort to connect with women veterans » (Anglais seulement), VAntage Point : Official Blog of the U.S. Department of Veterans Affairs.
- Kehle-Forbes, S. M., Harwood, E. M., Spoont, M. R., Sayer, N. A., H. Gerould et M. Murdoch. 2017. « Experiences with VHA care: A qualitative study of U.S. women veterans with self-reported trauma histories » (Anglais seulement), BMC Women's Health, 17, pp. 1–8.
- Kern, L. 2019. Feminist city: A field guide. Between the Lines.
- Kinsman, G., et P. Gentile. 2010. The Canadian war on queers: National security as sexual regulation. UBC Press.
- Kramer, B. J., Côté, S. D., Lee, D. I., B. Creekmur et D. Saliba. 2017. « Barriers and facilitators to implementation of VA home-based primary care on American Indian reservations: A qualitative multi-case study », Implementation Science, (Anglais seulement) 12(109), pp. 1–14.
- Fonds Purge LGBT. 2021. Au lendemain de la Purge : État des lieux et recommandations en matière d’inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral, Égale Canada, Fondation Émergence et Optimus SBR.
- Lucas, C. L., Goldbach, J. T., Mamey, M. R., S. Kintzle et C. A. Castro. 2018. « Military sexual assault as a mediator of the association between posttraumatic stress disorder and depression among lesbian, gay, and bisexual veterans » (Anglais seulement), Journal of Traumatic Stress, 31(4), pp. 613–619.
- Mark, K. M., McNamara, K. A., Gribble, R., Rhead, R., M.-L. Sharp et S. A. M. Stevelink. 2019. « The health and well-being of LGBTQ serving and ex-serving personnel: A narrative review » (Anglais seulement), International Review of Psychiatry: Military Psychiatry , 31(1), pp. 75–94.
- Muralidharan, A., Austern, D., S. Hack et D. Vogt, D. 2016. « Deployment experiences, social support, and mental health: Comparison of black, white, and Hispanic U.S. veterans deployed to Afghanistan and Iraq » (Anglais seulement), Journal of Traumatic Stress, 29(3), pp. 273–278.
- Okros, A. 2020. « Introspection on diversity in the Canadian Armed Forces », Dans Edgar, A., R. Mangat et B. Momani (éd.), Strengthening the Canadian Armed Forces through diversity and inclusion, pp. 153-168. University of Toronto Press, 1998.
- Palmater, P. D. 17 mai 2019. « Reconciliation with Indigenous peoples in universities and colleges » (Anglais seulement), Indigenous Nationhood.
- Poulin, C., et L. Gouliquer. 2012. « Clandestine existences and secret research: Eliminating official discrimination in the Canadian military and going public in academia » (Anglais seulement), Journal of Lesbian Studies, 16(1), pp. 54–64.
- Pulverman, C.S., A. Y. Christy et U. Kelly. 2019. « Military sexual trauma and sexual health in women veterans: A systematic review » (Anglais seulement), Sexual Medicine Reviews, 7(3), pp. 393–407.
- Razack, S. 2004. « Dark threats and white knights: The Somalia affair, peacekeeping, and the new imperialism », University of Toronto Press, 1998.
- Rioux, M. 2019. « Roadmap to work: A model for employment for persons with disabilities, Disability Rights Promotion International (DRPI) » [PDF, 1 352 Ko] (Anglais seulement).
- Ritchie, E. C., et A. L. Naclerio (éd.). 2015. Women at war, Oxford University Press.
- Rosen, M. I., Afshartous, D. R., Nwosu, S., Scott, M. C., Jackson, J. C., Marx, B. P., Murdoch, M., P. L. Sinnott et T. Speroff. 2013. « Racial differences in veterans’ satisfaction with examination of disability from posttraumatic stress disorder » (Anglais seulement), Psychiatric Services, 64(4), pp. 354–359.
- Rosentel, K., Hill, B. J., C. Lu et J. T. Barnett. 2016. « Transgender veterans and the Veterans Health Administration: Exploring the experiences of transgender veterans in the Veterans Affairs healthcare system » (Anglais seulement), Transgender Health, 1(1), pp. 108–116.
- Roy, P. 1987. « The soldiers Canada didn’t want: Her Chinese and Japanese citizens » (Anglais seulement), Canadian Historical Review, 59(3), pp. 341–358.
- Ruben, M. A., Livingston, N. A., Berke, D. S., A. R. Matza et J. C. Shipherd. 2019. « Lesbian, gay, bisexual, and transgender veterans’ experiences of discrimination in health care and their relation to health outcomes: A pilot study examining the moderating role of provider communication » (Anglais seulement), Health Equity, 3(1), pp. 480–488.
- Kessler, C. W. 1987. The Black Battalion 1916-1920: Canada’s best kept military secret, Nimbus.
- Snow, M. E., Tweedie, KJ., et A. Pederson. 2018. « Heard and valued: The development of a model to meaningfully engage marginalized populations in health services planning » (Anglais seulement), BMC Health Services Research, 18(181), pp. 1–13.
- Taber, N. 2018. « After Deschamps : Men, masculinities, and the Canadian Armed Forces » (Anglais seulement), Journal of Military and Veteran Health Research, 4(1), pp. 100–107.
- Commission de vérité et réconciliation du Canada. 2015. Pensionnats du Canada : La réconciliation – Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, volume 6, McGill-Queen’s University Press.
- Conseil de sécurité des Nations unies (UNSCR). 31 octobre 2000. Résolution 1325.
- Gouvernement des États-Unis. S.d.–a. Center for women veterans (CWV) (Anglais seulement), Department of Veterans Affairs (VA).
- Gouvernement des États-Unis. S.d.–b. Military sexual trauma (Anglais seulement), Department of Veterans Affairs (VA).
- Gouvernement des États-Unis. S.d.–c. Research for women veterans (Anglais seulement), Department of Veterans Affairs (VA).
- Gouvernement des États-Unis. S.d.–d. Women veterans issues: A historical perspective (Anglais seulement), Department of Veterans Affairs.
- Gouvernement des États-Unis. 2017. Provision of health care for veterans who identify as lesbian, gay or bisexual: VHA directive 1340(1), Department of Veterans Affairs/Veterans Health Administration (modifié 2019).
- Williamson, V., Murphy, D., Castro, C., Vermetten, E., R. Jetly et N. Greenberg. 2021. « Moral injury and the need to carry out ethically responsible research » (Anglais seulement), Research Ethics, 17(2), pp. 135–142.
- Wilson, L. C. 2018. « The prevalence of military sexual trauma: A meta-analysis » (Anglais seulement), Trauma, Violence & Abuse, 19(5), pp. 584–597.
- Winslow, D., et J. Dunn. 2002. « Women in the Canadian Forces: Between legal and social integration » (Anglais seulement), Current Sociology, 50(5), pp. 641–667.
- Whelan, J., et M. Eichler. 2019. « Beyond medicalization: Military conditioning and the limits of military-to-civilian transition », Dans D. T MacLeod et H. O. Leduc (éd.), Treated like a liability: Veterans running battles with the Government of Canada, (pp. 5–17), FriesenPress.
- Whitworth, S. 2004. Men, militarism, and UN peacekeeping: A gendered analysis, Lynne Rienner Publishers.
- Women Veterans Network (WOVEN) (Anglais seulement). 2019.
Éliminer les privilèges non mérités : problématiser l’idéal guerrier ancré dans les politiques et les pratiques de recrutement, de rétention et de promotion
Consultations sur la représentation des genres et la diversité au sein des FAC : feuille de route du changement en matière de leadership et de culture organisationnelle
Introduction et prémisse : Problématisation de la perspective de la « voie unique »
Le présent rapport porte sur une feuille de route visant à modifier le leadership, les processus de promotion et la culture organisationnelle des FAC. Elle découle de la perspective communeFootnote 21 selon laquelle il n’y a qu’une seule voie pour accéder aux postes de direction dans les FAC, car cette croyance incarne les façons dont le genre et d’autres formes de discrimination sont ancrées dans les politiques, la doctrine et les pratiques des FACFootnote 22. Étant donné que le harcèlement et les agressions sexuelles sont plus susceptibles de se produire dans un contexte de discrimination fondée sur le genre (et d’autres formes de discrimination), cette perception de « voie unique » favorise le harcèlement et les agressions sexuelles à l’encontre de ceux qui sont considérés comme ne correspondant pas au récit du guerrier idéal.
Lorsque la promotion aux rangs les plus élevés est conçue de manière aussi étroite, non seulement elle exclut certains groupes de personnes, mais elle garantit virtuellement que les personnes qui se trouvent au niveau des rangs supérieurs associés n’ont pas fait l’expérience, et donc ne comprendront pas de manière viscérale, ni ne prendront en considération dans leurs pratiques et politiques de leadership, les défis auxquels les femmes et les personnes appartenant à des groupes divers sont confrontées dans les FAC. Par conséquent, les raisons et les processus par lesquels un membre des FAC est promu doivent être reconceptualisés et retravaillés. Cela ne signifie pas que tout le monde peut ou doit être promu à un poste de direction, mais qu’il doit y avoir des occasions, un accès et un soutien équitables tout au long de la progression de carrière et des systèmes de leadership des FAC. Cela nécessite un changement culturel en ce qui concerne la doctrine, les valeurs, les pratiques et les politiques du leadership militaire, qui remettent en question le privilège du récit du guerrier idéal des FAC. Ce rapport et les recommandations qu’il contient s’appuient sur l’expertise de l’auteur, la littérature connexe et le groupe de consultation sur l’annexe O des Recours collectifs Heyder et Beattie.Footnote 23
Ce rapport commence par une liste de concepts et de définitions. Il présente un aperçu de la recherche pour aider à comprendre le problème que les recommandations visent à résoudre. Le rapport détaille ensuite des recommandations de changement, en commençant par des recherches et des preuves provenant d’autres organisations à dominance masculine, puis en détaillant des recommandations spécifiques pour les FAC. Il convient de noter que la plupart de ces recommandations reprennent celles formulées précédemment par des chercheurs, des analystes, des journalistes et la responsable de l’examen externe (Deschamps, 2015), comme indiqué ci-dessous, mais n’ont pas encore été mises en œuvre par les FAC.
Concepts and définitions
Ce rapport utilise une variété de termes et de concepts qui peuvent être peu familiers aux lecteurs. À ce titre, ils sont définis et expliqués ici.
Sexe et genre : Généralement, ces deux concepts sont expliqués en définissant le sexe comme biologique (on naît homme, femme ou intersexe) et le genre comme sociologique (on apprend à s’identifier et à agir comme une femme, un homme, une personne transgenre ou une personne de genre différent). Cependant, ces termes sont trop souvent confondus, dans la mesure où le sexe est considéré comme lié au genre (c.-à-d. que si une personne est de sexe féminin, elle est censée s’identifier et agir comme une femme). L’idée même de séparer les gens en deux catégories, mâle et femelle, est une idée construite, et n’est donc pas naturelle en soi.
Cisgenre : personne dont le genre est considéré comme correspondant au sexe qui lui a été assigné à la naissance (p. ex. un homme qui s’identifie comme un homme).
LGBTQ2+ : sigle désignant les personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer/en questionnement ou bi-spirituelles, le + indiquant qu’il existe de nombreuses autres façons de s’identifier (comme non-binaire). Ce terme est en constante évolution. Dans le cadre de ce rapport, lorsque le terme LGBTQ2+ est utilisé, il inclut les personnes non cisgenres.
Discrimination fondée sur le sexe : discrimination fondée sur le sexe ou le genre d’une personne (en tenant compte de la complexité de la définition du sexe et du genre telle que décrite ci-dessus).
Intersectionnalité : les manières complexes dont les multiples formes de discrimination (capacité, classe, genre, hétéronormativité, homophobie, indigénisme, race) se croisent et se superposent.
Personnes issues de la diversité : personnes appartenant à des minorités dans des organisations, des cultures et des sociétés. Dans l’armée, cela inclut toute personne qui n’est pas un homme masculin blanc, cisgenre, hétéro et valideFootnote 24.
Masculinités et féminités : l’utilisation plurielle de la masculinité et de la féminité est une façon de démêler le lien généralement perçu entre le sexe et le genre. L’utilisation des seuls termes « masculinité » et « féminité » restreint les rôles et les façons d’être des personnes (c.-à-d. que l’on attend souvent des hommes qu’ils agissent comme des hommes masculins et des femmes qu’elles agissent comme des femmes féminines), ce qui renforce un faux binaire de genre, ne permet pas une diversité de rendement de genre et ne tient pas compte de la vie des personnes de la communauté LGBTQ2+. Dans la vie quotidienne, les hommes, les femmes et les personnes de la communauté LGBTQ2+ mettent en œuvre une variété de masculinités et de féminités de manière compliquée dans différents contextes. C’est le fait de privilégier une forme plutôt qu’une autre dans un contexte particulier par un organisme particulier qui est problématique. Dans l’armée, le problème est que des types particuliers de masculinité (masculinité hégémonique et militarisée telle que décrite dans les définitions ci-dessous, pour ceux qui s’identifient comme hommes) et de féminité (garder sa « féminité » tout en l’équilibrant avec la bonne dose de dureté, comme cela est décrit dans la section ci-dessous) sont valorisés et privilégiés par rapport aux autres. Cela pose des problèmes, car cela enferme les hommes et les femmes dans certains rôles et attentes en ce qui concerne leurs professions, leur rendement professionnel et leurs types de leadership, ce qui discrimine ceux qui ne sont pas considérés comme « adaptés » (c.-à-d. les hommes émotifs, les femmes stoïques et les personnes de la communauté LGBTQ2+).
Masculinité hégémonique : type de masculinité dans lequel les traits typiquement masculins (dureté, force, stoïcisme) sont censés être adoptés par les hommes, sont privilégiés sur le plan social et organisationnel et aboutissent à privilégier les hommes par rapport aux femmes et aux personnes de la communauté LGBTQ2+.
Masculinité militarisée : type de masculinité privilégié dans les contextes militaires (et paramilitaires), c.-à-d. une version hyper de la masculinité hégémonique qui intègre le militarisme.
Militarisme : valorisation sociétale et organisationnelle des idéaux militaires, tels que la hiérarchie, l’obéissance, la discipline et l’uniformité, la vie étant considérée comme un jeu à somme nulle (c.-à-d. que si une personne ou un groupe gagne ou fait des gains, un autre doit perdre), ce qui est patriarcal et colonial et entraîne l’exclusion de ceux qui sont considérés comme différents (femmes et personnes issues de la diversité) du membre sociétal et organisationnel « idéal ». Ces valeurs peuvent faire obstacle à la responsabilisation, notamment par des privilèges non mérités.
Privilège non mérité : privilège accordé uniquement en raison de l’appartenance à un groupe particulier, souvent à ceux qui sont blancs, masculins, cisgenres, hétérosexuels et valides. Dans les contextes militaires, cela se traduit par le privilège d’une masculinité hégémonique et militarisée à travers un idéal guerrier. Elle est pratiquée en favorisant ceux qui sont similaires (c.-à-d. jugés « bien adaptés ») dans les promotions et les occasions connexes (c.-à-d. les affectations, l’instruction) dans le cadre d’un « réseau de vieux copains ». Ceux qui n’ont pas ce privilège sont confrontés à un terrain de jeu inégal, ce qui rend plus difficile leur réussite organisationnelle, sans que ce soit de leur faute.
Idéal du guerrier : dans les organisations militaires, privilège non mérité des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, perçus comme pratiquant une masculinité hégémonique et militarisée. Les personnes considérées comme ne correspondant pas à cet idéal (c.-à-d. les femmes et les personnes issues de la diversité) sont dévalorisées et discriminées, ce qui peut entraîner du harcèlement et des agressions. Bien que certaines personnes bénéficient de cet idéal sur le plan organisationnel, il est néfaste pour tous et pour l’organisation dans son ensemble.
Continuum de la violence : le genre et les autres formes de discrimination sont liés au harcèlement sexuel et aux agressions sexuelles. Une organisation qui ignore, accepte ou permet la discrimination est une organisation dans laquelle le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont plus susceptibles de se produire.
Évolution des formes de masculinité : il est souvent dit que l’idéal du guerrier est une exigence pour les membres d’une organisation militaire. Cependant, cet idéal est un idéal construit qui a évolué au fil des années (voir Taber, 2018, à propos des FAC), ce qui démontre qu’il n’est ni intrinsèquement naturel ni requis. Dans la milice canadienne de la fin du 19e siècle, la virilité est de plus en plus assimilée au militarisme; pendant la Première Guerre mondiale, les jurons, le langage sexualisé et la féminisation de l’ennemi sont devenus des moyens pour les soldats de se rapprocher; pendant la Deuxième Guerre mondiale, le soldat idéal est passé du statut d’officier élégant à celui de soldat brut et dépenaillé; dans les années 1990, en Somalie, le régiment aéroporté a poussé ce phénomène à l’extrême en incluant des rites de bizutage qui comprenaient (sanctionnés ou, à tout le moins, tolérés) des actes de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle et de racisme et, dans les FAC contemporaines, le militaire idéal (idéal du guerrier tel que défini ci-dessus) est considéré comme un combattant masculin héroïque qui n’est pas encombré par une famille. Le problème que pose cette construction du militaire idéal, et les façons dont elle est discriminatoire à l’égard des femmes et des personnes issues de la diversité en ce qui concerne les pratiques et les politiques de recrutement, de rétention, de promotion et de leadership des FAC, font l’objet du présent rapport.
Comprendre le problème
Cette section détaille le besoin de changement systémique en ce qui concerne l’élimination des privilèges non mérités dans le leadership, les processus de promotion et la culture organisationnelle des FAC. Il aborde les concepts d’apprentissage situé et de communautés de pratique pour détailler comment les membres des FAC apprennent à valoriser un idéal guerrier qui privilégie certains membres par rapport à d’autres.
Il faut un changement systémique au niveau du leadership, des processus de promotion et de la culture organisationnelle des FAC
Il est bien établi que la culture des FAC est une culture sexualisée qui nécessite un changement systémique (Davis, 1997; Davis et McKee, 2004; Deschamps, 2015; Gill et Febbraro, 2013; Harrison, 2002; Kovitz, 2000; Mercier et Castonguay, 2014; O’Hara, 1998 a, 1998b, 1998c, 2014; Park, 1986; Poulin, Gouliquer, et Moore, 2009; Symons, 1990; Tanner, 1999; Waruszynski, 2017; Winslow, 1998; Winslow et Dunn, 2002). Cette culture, ainsi que les politiques et les pratiques qui lui sont associées, permet la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle des femmes, ainsi que le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle des hommes et de ceux qui ne s’identifient pas selon cette conception binaire (Taber, 2018, 2020). De plus, la féminisation (le fait de donner un genre à ceux qui sont perçus comme n’étant pas valides et n’incarnant pas la masculinité hégémonique et militarisée, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou de membres de la communauté LGBTQ2+) est liée au privilège blanc (Said, 1978). Dans un contexte militaire, ceux qui sont marqués comme ne correspondant pas à un récit guerrier sont dévalorisés d’une manière qui marginalise et discrimine non seulement les femmes et les personnes de la communauté LGBTQ2+, mais aussi d’autres groupes désignés par la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada, 1995), comme les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
La discrimination fondée sur le genre, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles ne sont pas des concepts distincts, ils sont liés sur un continuum de violence à l’égard des femmes et des personnes considérées comme autres; lorsque la discrimination fondée sur le genre est présente, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont plus susceptibles de se produire (Deschamps, 2015; Kelly, 1987; McMahon, Postmus, et Koenick, 2011; McMahon et Banyard, 2021; Stout, 1991). Par conséquent, pour éliminer le harcèlement et les agressions sexuelles (qui sont généralement considérés comme inacceptables), il faut également éliminer la discrimination fondée sur le genre et les autres formes de discrimination (bien qu’elles soient souvent considérées comme mineures, voire acceptées, en particulier dans les organisations militarisées), ce qui nécessite un changement culturel généralisé. Les FAC sont conscientes de la nécessité d’un changement culturel depuis des décennies, en particulier en ce qui concerne les expériences des femmes, mais elles y ont généralement résisté, ne répondant aux préoccupations que lorsque les médias et les organes directeurs extérieurs les pressaient (Davis, 2013; Taber, 2020; Winslow et Dunn, 2002).
Les politiques et pratiques des FAC se sont historiquement concentrées principalement sur les auteurs individuels de harcèlement et d’agression sexuels (avec une acceptation générale de la discrimination en fonction du genre). Cette approche est insuffisante, car les membres des FAC sont affectés par la culture dans son ensemble et l’affectent eux aussi. Comme le décrit Enloe (2016), l’accent ne doit pas être mis sur les « pommes pourries » (individus), car cela implique que l’organisation elle-même ne nécessite aucun changement et n’est pas problématique; si certains individus sont déracinés et arrêtés, alors le problème est perçu comme étant réglé. Cependant, il est clair que, dans les FAC, c’est l’ensemble du « tonneau » (l’organisation) qui est en cause et qui nécessite un changement de culture à grande échelle. Cette métaphore ne signifie pas que tous les membres de l’organisation sont nécessairement coupables, mais que l’organisation établit une culture dans laquelle certains actes sont rendus possibles et sont même implicitement encouragés ou ignorés par la chaîne de commandement.
En effet, les récentes allégations de comportement sexuel inapproprié à l’encontre de deux anciens chefs d’état-major de la défense (CEMD), le général Jonathan Vance et l’amiral Art McDonald, ainsi que de l’ancien commandant du commandement du personnel militaire (COMPERSMIL), le vice-amiral Haydn Edmundson, démontrent une fois de plus qu’il existe non seulement un problème organisationnel, mais aussi un problème de leadership. La nouvelle de ces accusations est d’autant plus dure à entendre que chacun de ces hommes cisgenres, blancs et âgés, s’est fait l’avocat de la fin de la discrimination sexuelle, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et du racisme dans les FAC (p. ex. l’opération Honour de Vance, voir CEMD, 2015; le discours de changement de commandement de McDonald, voir Berthiaume, 2021 a; la responsabilité d’Edmundson dans le dossier Heyder-Beattie, voir gouvernement du Canada, 2021a).
Ce n’est pas seulement la nature des allégations non prouvées qui est inquiétante, mais le fait que, dans le cas de Vance au moins, elles étaient connues de l’organisation et que Vance a été promu au poste suprême des FAC de toute façon (Berthiaume, 2021b). Il a maintenant été révélé que le ministre de la Défense nationale, le Cabinet du premier ministre et le Bureau du Conseil privé étaient au courant de ces allégations. Non seulement ils ont éludé la responsabilité de les traiter, mais ils ont permis la promotion de Vance à un poste où il dirigerait une organisation ayant un problème grave et documenté en matière de harcèlement et d’agression sexuels (Clark, 2021). Bien que les actions du gouvernement ne soient pas du ressort direct de ce rapport, il est important de noter les façons dont la société, l’État et l’armée sont entrelacés (voir Enloe, 2016). Dans le cas d’Edmundson, des rapports affirment qu’il a gagné le surnom de Mulligan Man pour avoir échappé à des mesures disciplinaires à la suite d’allégations connues d’inconduite sexuelle dans les années 1990 (Burke, 2021). Il a néanmoins été promu à un poste où il était chargé de traiter et d’éliminer les cas d’inconduite sexuelle.
Ces trois exemples sont importants, car ils démontrent que les compétences, les expériences, les relations et l’incarnation de ces hauts dirigeants (englobant un idéal de guerrier) ont été valorisées au sein de l’organisation et semblent donc avoir surpassé les préoccupations liées à leurs allégations de discrimination sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle envers les femmesFootnote 25. Il était tout à fait possible de considérer que, en raison de cet idéal guerrier, ils avaient le droit d’être des dirigeants. Mais le leadership n’est pas un droit. C’est un privilège. La manière dont ce privilège est gagné et accordé doit être problématisée et repensée. Comme l’explique Duval-Lantoine à propos de la manière dont les membres des FAC sont généralement promus dans les rangs :
« Vous pourriez être... un connard, mais si vous faites très bien votre travail, ça pourrait être balayé sous le tapis... Et je ne dis pas ça de manière très grossière. Mais ce que nous récompensons [dans] la chaîne de commandement, en montant les échelons, et comment on monte dans l’échelle, est problématique ». (dans LaPointe, 2021, para. 21)
En ce qui concerne la relève de Vance par McDonald en 2021, le lieutenant-général Christine Whitecross (aujourd’hui à la retraite) était également une candidate envisagée; cependant, cette dernière, qui était le commandant de l’Équipe d’intervention stratégique sur l’inconduite sexuelle des FAC, n’a pas été retenue (Patel, 2021). Le CEMD intérimaire qui a pris la relève de McDonald est le lieutenant-général Wayne Eyre. Ce dernier, un autre homme cisgenre, blanc et âgé dont la biographie (gouvernement du Canada, 2021b) correspond au modèle à voie unique. Sa nomination n’a rien de problématique en soi, si ce n’est qu’elle renforce l’idée que, pour devenir CEMD, le service et l’incarnation d’une personne doivent correspondre à un idéal particulier.
En résumé, ce qui est récompensé par l’organisation et la façon dont les militaires sont promus doit être remis en question et modifié. Il faudra repenser de manière significative ce qu’est l’armée et qui sont les militaires, en allouant des ressources pour les révisions nécessaires des politiques, de la doctrine et des pratiques. Si les événements récents ont indiqué quelque chose, c’est que les FAC ne peut pas continuer comme elle est.
Apprentissage situé dans une communauté de pratique basée sur un idéal guerrier
Les membres des FAC sont socialisés et endoctrinés dans un mode de vie militaire dans le cadre d’une instruction officielle et d’un apprentissage informel. Ce rapport se concentre sur l’apprentissage informel dans des contextes situés pour démontrer la manière dont les membres apprennent à se conformer à des normes organisationnelles dans des communautés de pratiques. Une communauté de pratique est un groupe de personnes qui s’engagent dans une entreprise commune qui est un aspect clé de leur propre identité (Lave et Wenger, 1991; Wenger, 1998). L’armée entre dans cette catégorie parce que les membres ne sont pas de simples travailleurs, mais adoptent un « mode de vie » qui englobe tout (Soeters, Winslow, et Weibull, 2006). Les nouveaux arrivants (c.-à-d. les recrues et le personnel subalterne) apprennent à penser et à se comporter en observant les anciens (personnel d’instruction, membres plus anciens) et en participant à des tâches partagées, qui deviennent progressivement plus centrales dans le travail de l’organisation. Cet apprentissage situé est un processus actif et engagé qui est inextricablement lié à l’identité de chacun. On apprend non seulement comment être membre du groupe, mais aussi qui est un membre, comment il doit agir, ce qu’il doit valoriser, comment il doit penser, ce à quoi il est engagé. Cet apprentissage n’est donc pas uniquement axé sur les compétences (bien que cela en soit un aspect), mais aussi sur la participation et l’appartenance sociales.
Dans les FAC, le parcours d’apprentissage commence par le processus de recrutement et se poursuit par l’instruction de base, la formation professionnelle, l’apprentissage en milieu de travail, les cours de qualification, les processus de promotion et les pratiques quotidiennes. Les membres apprennent à accepter l’uniformité, la collectivité et l’obéissance, ce qui exige de se conformer aux normes militaires et à un idéal guerrier (Taber, 2020).
Dans les FAC, un privilège non mérité est accordé aux nouveaux arrivants qui sont considérés comme correspondant à cet idéal guerrier (blanc, mâle, masculin, cisgenre, hétéro et valide). Ces nouveaux venus ont une voie claire vers l’adhésion au noyau dur, ce qui est rendu possible par le favoritisme, le « réseau des anciens », la croyance qu’ils sont toujours déjà dévoués à l’armée, et le fait qu’ils sont considérés comme une bonne adéquation organisationnelle avec laquelle les autres veulent travailler et promouvoir.
Les trajectoires d’apprentissage sont chargées de pouvoir dans la mesure où les nouveaux arrivants qui ne correspondent pas aux attentes de l’organisation peuvent voir leur participation inhibée par les anciens, leur chemin vers l’adhésion au noyau dur bloqué et ils peuvent être contraints de quitter l’organisation (Barton et Tusting, 2009). Ce pouvoir peut être fortement genré dans la mesure où il valorise des formes particulières de masculinité et de féminité tout en en dévalorisant d’autres, dans des communautés de pratique connexes (Paechter, 2003, 2006). Dans une organisation militaire créée par et pour des hommes blancs cisgenres et valides, le simple fait d’être une femme, une personne de la communauté LGBTQ2+, une personne de couleur, une Autochtone ou une personne à mobilité réduite (ou toute combinaison intersectionnelle de ces identités) peut empêcher une personne de réussir (c.-à-d. Eichler, 2016; Kovitz, 2000; Poulin, Gouliquer et Moore, 2009; Scoppio, 2009; Taber, 2011). Les FAC promeuvent un idéal de guerrier dans lequel on s’attend à ce qu’un militaire masculin héroïque, fort et valide consacre toute sa carrière à l’organisation; qu’il soit toujours prêt, disposé et capable de se déployer, de participer à l’entraînement et d’être affecté et qu’il ait un conjoint qui puisse s’occuper de ses enfants et des membres de sa famille (Taber, 2009). Selon les mots de Davis (2013), la norme privilégiée est une « identité guerrière hétérosexuelle masculine de combat » (p. 243).
Cet idéal guerrier est promu dans les documents de doctrine de leadership des FAC (Taber, 2009), comme le document Servir avec honneur (CEMD, 2003) qui fonctionne comme des textes « patrons » ou directeurs qui « régulent les autres textes et les pratiques quotidiennes dans leur contexte institutionnel » des FAC (Taber, 2009, p. 29). Cette doctrine encadre tous les ordres des FAC, elle « constitue donc la base philosophique et doctrinale de toutes les politiques de perfectionnement personnel et professionnel des Forces canadiennes » (CEMD, p. 2). Servir avec honneur fait la promotion du militaire idéal, qui est « discipliné, en forme et... dur » (Taber, 2009, p. 31), un homme « vrai combattant » (p. 32) dévoué à l’armée par-dessus tout dans le cadre d’une « idéologie de combat et d’une culture militaire hypermasculine » (p. 31).
Par conséquent, les militaires qui sont perçus comme ne correspondant pas à la norme du guerrier idéal font l’objet d’une discrimination organisationnelle – dans les politiques et dans la pratique – en raison du sexe, de la race, de l’indigénisme, de la capacité et de l’orientation sexuelle. Il est certain que les membres des groupes désignés ont obtenu de bons résultats dans l’armée et ont été promus à des grades supérieurs, mais ils sont confrontés à des obstacles que ne connaissent pas ceux qui semblent correspondre à la norme du guerrier idéal.
En particulier, les femmes ont souvent l’impression d’être la « femme de service » sous un « microscope omniprésent » ou un « projecteur gênant » qui les suit tout au long de leur service, où elles doivent continuellement faire leurs preuves (Taber, 2016, pp. 52, 53). Elles peuvent être considérées comme n’étant pas dévouées à l’organisation simplement parce que leur corps présente la possibilité d’une future grossesse, comme l’a démontré une femme à qui l’on a dit, lors de son premier jour dans son unité opérationnelle, « tu ferais mieux de ne pas tomber enceinte pendant que tu es ici » (Taber, 2011). Le service des femmes est contraint de marcher sur une « corde raide de la performativité du genre » (Taber, 2011, p. 346) afin de « se conformer à la définition des anciens de l’adhésion [militaire] » (p. 344). Les femmes négocient continuellement leur genre dans une culture masculine qui exige d’elles qu’elles soient dures, mais pas trop masculines, et sont souvent valorisées parce qu’on pense qu’elles peuvent apporter des qualités de leadership « féminines » et des compétences « douces », ce qui renforce la fausse dichotomie homme/masculin, femme/féminin, et essentialise le service des femmes à leur genre (Taber, 2016).
Au lieu de donner une dimension genrée au leadership et aux compétences, Davis (2009) préconise de se concentrer sur l’intelligence culturelle, une métacompétence qui « facilite la compréhension, la perception et l’adaptabilité dans des contextes ethniques et organisationnels multiculturels » (p. 432). Cela « demande la capacité de s’adapter à la différence et de la comprendre, y compris les différences qui remettent en question les croyances dominantes concernant le rôle du sexe et du genre au sein des organisations et des sociétés » (p. 432). L’intelligence culturelle est non seulement une meilleure façon de conceptualiser l’attitude, les compétences et les connaissances – en ce qui concerne l’autoréflexivité, les compréhensions culturelles, l’équité et la prise de décision connexe – mais c’est aussi quelque chose qui devrait être perfectionné et pratiqué par tous les membres des FAC, ce qui profitera à l’organisation dans son ensemble (Davis, 2009). Il s’agit, entre autres, d’« être conscient de nos propres suppositions, idées et émotions », d’avoir un « esprit ouvert », de « rechercher de nouvelles informations » et de « faire preuve d’empathie » (Thomas, cité dans Davis, p. 433). L’intelligence culturelle peut être enseignée et apprise; ce n’est pas quelque chose d’inné. Davis soutient que l’intelligence culturelle peut améliorer l’efficacité opérationnelle, démontrant ainsi qu’une optique critique de l’ACS+ peut être utile non seulement du point de vue de l’équité, mais aussi du point de vue opérationnelNote de bas de page 26.
Admettre que l’on s’est peut-être trompé dans le passé, que l’on ne sait pas quelque chose et que l’on a besoin de plus d’informations pour comprendre un problème et prendre des mesures peut être une expression inconfortable de vulnérabilité, en particulier pour les militaires entraînés à faire preuve de force et de confiance. En effet, demander aux militaires de remettre en question un idéal guerrier revient à leur demander de remettre en question l’armée elle-même, ce qui peut être une tâche difficile. Cependant, le fait d’être disposé à le faire devrait être valorisé et récompensé par l’organisation, dans l’éducation formelle et dans les contextes d’apprentissage situés grâce à l’apprentissage transformateur féministe (c.-à-d. English et Irving, 2012), ainsi que dans la doctrine, les politiques et les pratiques de recrutement, de promotion et de leadership.
En résumé, un trop grand nombre de ceux qui se heurtent aux obstacles organisationnels des FAC pour devenir membres de base sont expulsés de celles-ci en tant que nouveaux venus, l’organisation perdant ainsi leurs compétences et leur expérience. Ceux qui souhaitent remettre en question la culture masculinisée et sexualisée des FAC afin d’éliminer ces obstacles peuvent craindre de le faire, car toute critique organisationnelle pourrait avoir des répercussions négatives sur leurs propres évaluations de rendement et leurs possibilités de promotion. Les hauts dirigeants qui ont bénéficié de la culture guerrière sont en mesure d’apporter des changements, mais ils ont généralement bénéficié des normes organisationnelles, et peuvent donc croire qu’il n’y a guère besoin de changement structurel. Par conséquent, les personnes qui deviennent des anciens des FAC sont plus susceptibles de se conformer aux normes organisationnelles que de les remettre en question.
Les recommandations suivantes détaillent la façon de mettre en œuvre cette recherche de manière concrète afin d’augmenter le recrutement et la rétention des femmes et des personnes d’origines diverses en changeant la culture masculinisée et sexualisée des FAC ainsi que son approche du leadership et de la promotion. Les recommandations ne sont pas exhaustives, mais elles sont axées sur le mandat général du groupe de consultation de l’annexe des Recours collectifs Heyder et Beattie et sur le mandat spécifique de cet expert.
Recommandations
Systèmes, politiques et changements conceptuels
Il existe une pléthore de recherches sur les moyens de soutenir équitablement les femmes et les personnes d’origines diverses, et donc de les recruter et de les retenir dans le milieu de travail. Les exemples énumérés ci-dessous découlent des recherches mentionnées ci-dessus et ne représentent que quelques exemples de ce vaste corpus de littérature provenant de diverses disciplines et se rapportant à une variété de milieux de travail – y compris l’armée – et représentent la littérature dans son ensemble.
Ce rapport se concentre sur la littérature relative au recrutement, à la rétention et à la promotion des femmes dans les organisations masculines dominées par les hommes, car c’est là que se trouve le plus grand nombre de documentsFootnote 27 et il semble que les femmes en particulier suscitent une certaine résistance dans les organisations militaires. Par exemple, les FAC visaient à augmenter la représentation des groupes désignésFootnote 28 entre les chiffres réels de 2016 et les objectifs de 2026, comme suit : femmes, 14,9 % à 25,1 %; Autochtones, 2,6 % à 3,5 %; minorités visibles, 6,7 % à 11,8 % (Fuhr, 2019). En 2016, la société canadienne comptait environ 50 % de femmes, 4,3 % d’Autochtones et 19,1 % de minorités visibles (Division de la démographie, 2016). Par conséquent, le rapport de 2016 entre les effectifs militaires et la société est le suivant : femmes 14,9/50=29,8 %, Autochtones, 2,6/4,3=60,4 %, minorités visibles, 6,7/19,1=35 %, ce qui montre que, parmi ces trois groupes, les femmes sont les plus sous-représentées et les cibles sont plus faibles pour augmenter leur représentation.
Les femmes et les personnes issues de la diversité sont largement victimes de discrimination, de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles en raison de leur positionnement en tant que personnes féminisées dévalorisées par l’organisation et ne correspondant pas à un idéal guerrier. Par conséquent, la remise en question du privilège non mérité accordé à ceux qui sont considérés comme correspondant à cet idéal – en ce qui concerne l’identité d’un militaire, la voie que devrait suivre la carrière d'un militaire, qui doit être considéré comme un leader et qui doit être promu – devrait améliorer l’équité de l’organisation pour tous et toutes.
Preuves à l’appui
Dans l’ensemble, la littérature démontre qu’il est possible de recruter et de retenir les femmes en éliminant le privilège non mérité de certains membres de l’organisation; notamment, en modifiant les cultures organisationnelles masculines hégémoniques; en éliminant les stéréotypes sexistes, la discrimination, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles; en développant des politiques équitables en matière de genre qui ont un impact positif sur les pratiques organisationnelles; en créant des parcours de carrière adaptables ainsi que des options de travail flexibles; en soutenant la garde d’enfants et les familles; en promouvant les femmes à des postes de direction et en offrant des occasions pour l’augmentation du nombre de femmes dans les rangs, afin qu’elles soient considérées comme des modèles et des mentors.
- Milieu universitaire : « Les universités doivent tenir compte de la manière dont les engagements variables des femmes en matière de travail rémunéré, d’éducation et de responsabilités au foyer se traduisent par des trajectoires d’apprentissage souvent compliquées et non linéaires » (Gouthro, Taber, et Brazil, 2018, p. 36). Les politiques et les pratiques, ainsi que les processus de promotion associés, doivent être adaptés pour tenir compte de la réalité de la vie des femmes.
- Génie : les femmes qui ont bénéficié « d’une prise en charge et d’un soutien, de rétroactions, d’occasions et de responsabilités de haut niveau, et de modèles » (Fernando, Cohen, et Duberley, 2018, p. 485) étaient plus susceptibles d’éprouver « un sentiment positif à l’égard du climat de l’organisation et de voir un avenir dans l’ingénierie » (p. 486).
- Finances : « La menace du stéréotype chez les femmes dans le domaine de la finance est associée à une séparation identitaire, à un moins bon bien-être au travail et à une moindre volonté de recommander la banque et la finance comme option de carrière aux jeunes femmes. Ces résultats fournissent des preuves supplémentaires que la menace des stéréotypes peut conduire à un désengagement sur le lieu de travail et nuire au recrutement et à la rétention des femmes dans le domaine de la finance et constitue donc une préoccupation pour les organisations et pour les femmes qui y travaillent » (Hippel, Sekaquaptewa, et McFarlane, 2015, p. 412).
- Géosciences : pour améliorer le recrutement et le maintien en poste des femmes, il faut, entre autres, veiller à ce que « les politiques et stratégies d’équité et d’égalité entre les sexes soient ancrées aux niveaux supérieurs des organisations [...] [avec] un engagement clair en faveur du changement », « plaider en faveur d’un plus grand nombre de femmes dans des rôles prestigieux », « redéfinir le succès », « éliminer et traiter activement le sexisme et le harcèlement quotidiens » (Handley, Hillman, Finch, Ubide, Kachovich, McLaren, et coll., p. 222).
- Informatique : les femmes sont confrontées à des obstacles dus à « l’isolement et l’exclusion », aux « mauvaises relations de supervision » et aux « conflits entre vie professionnelle et vie privée » (Annabi et Lebovitz, 2018, p. 1060). Pour répondre à ces préoccupations, il est nécessaire, entre autres, de « créer une culture qui soutient la diversité » et de « fournir des arrangements flexibles » (p. 1063) en mettant l’accent sur « la correction de l’environnement, et non sur la correction des femmes » (p. 1067) afin de retenir les femmes.
- Droit : les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de quitter la pratique privée « afin de trouver des environnements de travail qui leur permettent d’équilibrer leur carrière et leur famille, qui permettent des arrangements de travail flexibles, qui n’exigent pas une charge de travail trop lourde, qui sont moins stressants et qui offrent ce congé de maternité/parental payé ainsi que d’autres avantages » (Barreau du Haut-Canada, 2013, p. 19).
- Police : la création de politiques favorables à la famille, l’autorisation du partage d’emploi et l’octroi de congés familiaux « attireront non seulement plus de femmes dans les forces de l’ordre, mais feront en sorte qu’elles restent suffisamment longtemps pour avoir une carrière complète », tout comme le fait de changer « l’académie de police et la culture policière dominées par les hommes » et de « renforcer les politiques en matière de harcèlement sexuel » (Cordner et Cordner, 2011, p. 222).
- Militaire : la littérature abordée dans la section « Comprendre le problème » définit le contexte des citations spécifiques citées ici qui se rapportent directement au mandat de ce rapport.
- Les commandants qui « donnent la priorité à la prise en charge des membres et de leurs familles (dans le contexte de la mission) » (King, DiNitto, Salas-Wright, et Snowden, 2020, p. 690) devraient être prioritaires pour les promotions; la chaîne de commandement devrait s’assurer que « les priorités de diversité et de maintien en poste à l’échelle macro sont comprises et soutenues localement » par les commandants (p. 691); et « les cheminements de carrière rigides et les exigences de déménagements fréquents » (p. 691) devraient être repensés en « développant des cheminements de carrière alternatifs (ou des pauses dans la voie rapide), et en permettant de s’établir [s’installer dans un seul endroit] » afin d’« avoir un impact positif sur la rétention des femmes » ainsi que sur celle des hommes (p. 692).
- « Les parcours de carrière structurés de l’armée et la politique rigide de promotion “vers le haut ou la sortie” créent une “voie rapide” qui pénalise institutionnellement les personnes qui perturbent la trajectoire de carrière. ... Les professions qui ne montrent pas qu’elles accordent de l’importance à leurs employés nouvellement qualifiés et à leurs familles continueront à être confrontées à un problème de rétention des talents. Les récentes initiatives militaires de gestion des talents (p. ex. l’augmentation des congés parentaux, les programmes d’interruption de carrière, l’augmentation de la disponibilité des services de garde d’enfants, l’ouverture de toutes les spécialités professionnelles aux femmes, l’augmentation des adhésions féminines et la création d’un environnement intolérant aux agressions sexuelles) envoient des signaux positifs aux femmes (et aux hommes) à tous les stades de leur carrière que l’armée les valorise et les respecte, ainsi que leurs intentions en matière de travail-famille » (Smith et Rosenstein, 2017, p. 275).
- « Les réponses efficaces de la chaîne de commandement [en ce qui concerne le signalement de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel] étaient associées à une diminution de la détresse émotionnelle et à une augmentation des intentions de rétention. De plus, les réponses inefficaces ou négatives de la chaîne de commandement étaient associées à une détresse émotionnelle accrue et à une diminution de la rétention » (Daniel, Neria, Moore, et Davis, 2019, p. 367).
Les paragraphes suivants décrivent comment mettre en œuvre les pratiques exemplaires abordées dans la littérature ci-dessus dans les processus de leadership et de promotion des FAC. Ils sont séparés à des fins de discussion, mais sont liés entre eux par la suppression du privilège non mérité accordé à certains membres parce qu’ils sont considérés comme correspondant à un idéal guerrier; par la redéfinition de ce qu’est un membre idéal dans une perspective d’équité et par la valorisation de l’équité dans l’ensemble du système de promotion et de la doctrine, des politiques et des pratiques associées. Il en résultera un modèle à voies multiples qui permettra à divers membres de devenir des leaders au sein des FAC. Ces recommandations doivent être correctement mises en œuvre, dotées de ressources, maintenues et évaluées de manière intentionnelle, holistique et systématique pour garantir leur succès. Il convient de noter que ces recommandations reflètent celles du rapport Deschamps (2015) et du Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes du Canada ou elles leur sont complémentaires (Fuhr, 2019).
Recommandations
Forces armées canadiennes
- Un changement culturel généralisé et approfondi pour supprimer les privilèges non mérités et remettre en question l’idéal guerrier, ainsi que pour éliminer la masculinité hégémonique et militarisée.
- L’ensemble du système de progression de carrière (de l’admission au recrutement, à la formation de base, aux cours de leadership, à la promotion dans les rangs) devrait être reconceptualisé et retravaillé dans l’optique de l’ACS+.
- La progression de carrière devrait valoriser et récompenser la sensibilisation, les connaissances, la compréhension, la prise de décision éclairée, la responsabilisation, l’éducation, l’affectation des ressources, la défense des intérêts et l’intelligence culturelle de l’ACS+. Ces aspects du leadership devraient être valorisés et récompensés tout autant que les capacités propres à la profession.
- Les centres de recrutement, les gestionnaires de carrière, les comités de mérite et les comités de planification de la relève devraient inclure des femmes et des personnes issues de la diversité et tous devraient être formés à la reconnaissance et à l’atténuation des préjugés inconscients en ce qui concerne spécifiquement l’embauche et la promotion. Le recrutement et la promotion ne doivent pas se faire uniquement sur la base de l’obtention de qualifications ou parce qu’une personne est considérée comme un guerrier idéal.
- Le système d’évaluation du personnel devrait valoriser et récompenser les compétences et les actions liées à l’intelligence culturelle, à l’éthique féministe intersectionnelle, à l’empathie, au respect et aux pratiques inclusives, ainsi qu’aux actions concrètes de l’ACS+ pour prévenir ou traiter la discrimination liée au genre et à la diversité, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles.
- Les doctrines de leadership telles que « le devoir avec honneur » devraient être reconceptualisées et réécrites afin de ne pas promouvoir un récit de guerrier idéal qui discrimine les femmes et les personnes diverses. Il s’agit de redéfinir qui est le militaire idéal du point de vue de l’ACS+.
- Des parcours de carrière adaptables doivent être établis, valorisés et soutenus afin que les femmes et les personnes issues de la diversité puissent être promues à des postes de direction. Bien que certains points de la liste ci-dessous existent déjà dans les FAC (c.-à-d. le congé de maternité et le congé parental, les garderies, les centres de ressources pour les familles des militaires), ils doivent être intégrés à la vie militaire afin que les membres qui prennent un congé parental, par exemple, ne soient pas pénalisés pour cela, que ce soit directement ou indirectement; les services de garde d’enfants devraient mieux s’adapter aux travailleurs par quarts et à l’exigence d’être toujours prêt pour le service et le déploiement et le soutien familial devrait être valorisé comme faisant partie de la mission, et non simplement comme un moyen de la faciliter. Cela implique de repenser les attitudes, les politiques et les pratiques en ce qui concerne :
- L’ordre d’universalité du service et le principe du soldat d’abord;
- Le congé de maternité et parental;
- La garde d’enfants et le soutien aux familles;
- Les possibilités de formation et les prérequis associés;
- Le système d’affichage;
- La reconnaissance des effets négatifs de la discrimination, du harcèlement et des agressions sur le rendement.
- Il ne suffit pas qu’une masse critique de femmes et de personnes issues de la diversité occupent des postes de direction, mais tous doivent s’engager dans des actes critiques de l’ACS+ avec les ressources associées.
- La réticence particulière des cadres intermédiaires (c.-à-d. les officiers subalternes et les sous-officiers subalternes) à valoriser l’ACS+ et à s’y engager devrait faire l’objet de recherches plus approfondies afin de formuler des recommandations spécifiques pour ce groupe. Des preuves anecdotiques suggèrent que les membres de l’encadrement intermédiaire craignent que le fait de soutenir l’ACS+ en agissant contre la discrimination liée au genre et à la diversité, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles puisse avoir des répercussions négatives sur leurs perspectives de promotion. Les résultats de cette recherche doivent être mis à la disposition du public.
- Recadrer les concepts et les compétences dans l’optique de l’équité :
- La définition et la compréhension de ce qu’est et devrait être un militaire idéal doivent être reconceptualisées afin de ne pas privilégier une norme masculine, cisgenre, blanche et valide. Une première définition du militaire idéal serait une personne de toute capacité, de tout sexe, de toute culture, de toute race, de toute religion et de toute sexualité qui est : compétente dans son métier (qu’il soit opérationnel ou de soutien), désireuse d’apprendre, ouverte d’esprit, inclusive, attentionnée, empathique, acceptante, culturellement intelligente avec une éthique féministe intersectionnelle, et qui s’engage dans les pratiques de l’ACS+.
- Il convient de contester et d’abandonner l’idée qu’il existe une « liste rose » (et les idées qui y sont liées) qui permet à des femmes (perçues comme) non qualifiées d’accéder à des cours de direction au détriment d’hommes (perçus comme) plus qualifiés. Il faut préciser que l’équité en matière d’emploi et les politiques connexes suppriment les privilèges non mérités (c.-à-d. les hommes blancs cisgenres de sexe masculin qui peuvent figurer sur la liste parce qu’ils sont valorisés par l’organisation par rapport aux autres) afin que ceux qui n’ont pas ce privilège soient traités équitablement. Une femme ou une personne issue de la diversité qui est promue ne prend pas la place de quelqu’un d’autre ou n’est pas promue uniquement parce qu’elle est une femme ou une personne issue de la diversité, mais c’est un membre qualifié qui, autrement, aurait pu être écarté de la promotion en raison d’obstacles organisationnels à sa réussite et du privilège non mérité de certains autres membres.
- Il ne devrait pas y avoir de distinction entre ce que l’on appelle souvent les « compétences générales » et les « compétences spécialisées » (ou les styles de leadership « féminins » et « masculins » qui y sont liés) dans les évaluations de rendement et les considérations de promotion, car cela ne fait que promouvoir un faux binaire de genre dans lequel les premières sont souvent associées aux femmes et à la féminité et les secondes aux hommes et à la masculinité, ce qui essentialise les différences entre les sexes et les styles de leadership et les actions. De plus, si l’un des types est perçu comme devant passer après l’autre, comme les compétences techniques et les styles de leadership masculins sont généralement considérés comme plus précieux, ils prendront le dessus. Au contraire, l’intelligence culturelle doit être encouragée. La capacité à diriger un navire et à faire preuve d’empathie à l’égard de ses subordonnés devrait être appréciée de la même manière, car il existe incontestablement des personnes capables de faire les deux. L’intelligence culturelle (ou un concept connexe) est cruciale pour tous les membres de l’organisation (indépendamment du sexe ou de la diversité) et profite à l’organisation. Cette intelligence devrait donc également être une considération clé dans les évaluations de rendement et pour les décisions de promotion (mise en œuvre à court terme).
- Des ressources suffisantes doivent être consacrées à ces recommandations, assorties d’un mécanisme de responsabilisation. Comme la hiérarchie peut entraver la responsabilisation, et que les FAC sont une organisation hiérarchique, il devrait y avoir un mécanisme de responsabilisation mis en œuvre par un organisme externe.
Conclusion
La mise en œuvre de ces recommandations, en accord avec celles des deux autres experts du groupe de consultation de l’annexe O, permettra aux FAC d’accroître la représentation des genres et de la diversité de manière éthique, de sorte que les femmes et les personnes issues de la diversité soient valorisées et soutenues sur le plan organisationnel. Cette mise en œuvre nécessite un changement significatif dans la perception du militaire et du leader idéal (dans la politique, la doctrine et la pratique); un tel changement est bénéfique non seulement pour les militaires, mais aussi pour l’organisation dans son ensemble. L’élimination des privilèges non mérités dans les processus et pratiques de leadership et de promotion est un aspect essentiel de la lutte contre la discrimination liée au genre et à la diversité ancrée dans l’organisation, qui peut à son tour réduire le harcèlement sexuel et les agressions sexuelle.
Références
- Annabi, H., et S. Lebovitz. 2018. « Improving the retention of women in the IT workforce: An investigation of gender diversity interventions in the USA », Information Systems Journal, 28(6), pp. 1049-1081.
- Barton, D., et K. Tusting. 2009. Beyond communities of practice: Language, power and social context, Cambridge : Cambridge University Press.
- Berthiaume, L. 14 janvier 2021a. « Military gets new commander in virtual low-key ceremony due to COVID-19 » (Anglais seulement), CTV News, récupéré le 1er mars 2021.
- Berthiaume, L. 22 février 2021b. « Retired Supreme Court justice laments progress on addressing military misconduct amid calls for external oversight » (Anglais seulement), The Globe and Mail, récupéré le 1er mars 2021.
- Burke, A. 9 mars 2021. « Military commander in charge of human resources facing claims of inappropriate behaviour » (Anglais seulement), CBC.
- Burke, A., et K. Everson. 28 avril 2021. « Sexual assault victim’s family denounces military brass for supporting attacker during sentencing », CBC.
- Canada. 1995. Loi sur l’équité en matière d’emploi L.C. 1995 ch. 44, Canada.
- Chef d’état-major de la Défense (CEMD). 2003. Servir avec honneur – La profession des armes au Canada, Ottawa : Académie canadienne de la défense – Institut de leadership des Forces canadiennes.
- Chef d’état-major de la Défense (CEMD). 2015. O op du CEMD – Op HONOUR, Ottawa : Défense nationale.
- Clark, C. 10 mars 2021. « Sajjan’s excuses highlight his failure on sexual harassment in the military » (Anglais seulement), The Globe and Mail, récupéré le 14 mars 2021.
- Cordner, G., et A. Cordner. 2011. « Stuck on a plateau? Obstacles to recruitment, selection, and retention of women police », Police Quarterly, 14(3), pp. 207-226.
- Daniel, S., Neria, A., A. Moore et E. Davis. 2019. « The impact of leadership responses to sexual harassment and gender discrimination reports on emotional distress and retention intentions in military members », Journal of Trauma & Dissociation, 20(3), pp. 357-372.
- Davis, K. D. 1997. « Understanding women’s exit from the Canadian Forces: Implications for integration », Dans L. C. Weinstein et C. White (éd.), Wives and warriors: Women in the military in the United States and Canada (pp. 179-198), Westport, CT : Bergin and Garvey.
- Davis, K. D. 2009. « Sex, Gender and Cultural Intelligence in the Canadian Forces », Commonwealth & Comparative Politics, 47(4), pp. 430-455.
- Davis, K. D. 2013. Negotiating gender in the Canadian Forces, 1970-1999, Thèse de doctorat non publiée, Kingston : Collège militaire royal.
- Davis, K.D., et B. McKee (2004). « Women in the military: Facing the warrior framework », Dans F.C. Pinch, A.T., MacIntyre, P. Browne et A.C. Okros (éd.), Challenge and change in the military : Gender and diversity issues (pp. 52-75), Kingston : Presses de l’Académie canadienne de la Défense.
- Division de la démographie. 2016. Regard sur la démographie canadienne (2e éd.), Canada : Statistique Canada.
- Deschamps, M. (2015). Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes, Responsable de l’examen externe.
- Eichler, M. 2016. « Learning from the Deschamps Report: Why military and veteran researchers ought to pay attention to gender », Journal of Military, Veteran and Family Health, 2(1), pp. 5-8.
- English, L. M., et C.J. Irving (2012). « Women and transformative learning », Dans Taylor, E. W., et P. Cranton (éd.), The handbook of transformative learning (pp. 245-259). San Francisco : Jossey-Bass.
- Enloe, C. (2016). Globalization and militarism: Feminists make the link (2e éd.), Lanham, MD : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Fernando, D., L. Cohen et J. Duberley (2018). « What helps? Women engineers’ accounts of staying on », Human Resource Management Journal, 28, pp. 479-495.
- Fuhr, S. (2019). Améliorer la diversité et l’inclusion dans les Forces armées canadiennes – Rapport du Comité permanent de la Défense nationale, Canada : 2014.
- Gill, R., et A. R. Febbraro (2013). « Experiences and perceptions of sexual harassment in the Canadian Forces Combat Arms », Violence against Women, 19(2), pp. 269-287.
- Gouthro, P., N. Taber et A. Brazil (2018). « Universities as inclusive learning organizations for women?: Considering the role of women in faculty and leadership roles in academe », The Learning Organization, 25(1), pp. 29-39.
- Gouvernement du Canada. 2021a. Chef du personnel militaire – Vice amiral Edmundson – Biographie, Gouvernement du Canada. Consultée le 10 avril 2021.
- Gouvernement du Canada. 2021b. Chef d’état-major de la Défense – Biographie, Gouvernement du Canada.
- Handley, H.K., Hillman, J., Finch, M., Ubide, T., Kachovich, S., McLaren et coll. 2020. « In Australasia, gender is still on the agenda in geosciences », Advances in Geosciences, 53, pp. 205-226.
- Kelly, L. (1987). « The continuum of sexual violence », Dans Hamner, J., et Maynard, M. (éd.), Women, Violence and Social Control (pp. 46-60), Palgrave Macmillan.
- King, E.L., DiNitto, D., C. Salas-Wright et D. Snowden (2020). « Retaining women Air Force officers: Work, family, career satisfaction, and intentions », Armed Forces & Society, 46(4), pp. 677-695.
- Kovitz, M. (2000). « The enemy within: Female soldiers in the Canadian Forces », Canadian Woman Studies, 19(4), pp. 36-41.
- Lapointe, M. (2021, 1er mars). « MPs, experts reeling following Vance allegations, McDonald’s voluntary departure from top military post », The Hill Times. Consultée le 1er mars 2021.
- Lave, J., et E. Wenger (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge : Cambridge University Press.
- McMahon, S., et V. L. Banyard (2012). « When can I help? A conceptual framework for the prevention of sexual violence through bystander intervention, » Trauma, Violence, & Abuse, 13(1), pp. 3-14.
- McMahon, S., Postmus, J. L., et R. A. Koenick (2011). « Conceptualizing the engaging bystander approach to sexual violence prevention on college campuses », Journal of College Student Development, 52(1), pp. 115-130.
- Mercier, N., et A. Castonguay (2014, 5 mai). « Our military’s disgrace: A special investigation », Maclean's, pp. 18-26.
- O'Hara, J. (1998 a, 25 mai). « Rape in the military » (Anglais seulement), Maclean's. Consulté le 3 mars 2017.
- O'Hara, J. (1998b, 1er juin). « Speaking out on sexual assault in the military » (Anglais seulement), Maclean’s. Récupéré le 3 mars 2017.
- O'Hara, J. (1998 c, 14 déc.). « Of rape and justice », Maclean's. Consultée le 3 mars 2017.
- O'Hara, J. (2014, 5 mai). « A war with no end in sight », Maclean’s, p. 27.
- Paechter, C. (2003). « Learning masculinities and femininities: Power/knowledge and legitimate peripheral participation », Women’s Studies International Forum, 26(6), pp. 541–552.
- Paechter, C. (2006). « Power, knowledge and embodiment in communities of sex/gender practice », Women’s Studies International Forum, 29(1), pp. 13–36.
- Park, R.E. 1986. Overview of the social/behavioural science evaluation of the 1979-1985 Canadian Forces trial employment of servicewomen in non-traditional environments and roles, Rapport d’étude 86-2, Willowdale, Ontario : Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes.
- Patel, R. (2021, 14 mars). « Canada’s former top female officer in shock, anger of military’s sexual misconduct allegations » (Anglais seulement), CBC News. Consultée le 15 mars.
- Poulin, C., Gouliquer, L., et J. Moore (2009). « Discharged for homosexuality from the Canadian military: Health implications for lesbians », Feminism and Psychology, 19(4), pp. 496-516.
- Said, E. (1978). Orientalism, New York : Vintage Books.
- Scoppio, G. (2009). « Diversity best practices in military organization in Canada, Australia, the United Kingdom, and the United States », Canadian Military Journal, 9(3), pp. 17-30.
- Smith, D.G., et J. E. Rosenstein 2017. « Gender and the military profession: Early career influences, attitudes, and intentions », Armed Forces & Society, 43(2), pp. 260-279.
- Soeters, J., Winslow, D., et A. Weibull (2006). « Military culture », Dans CAFORIO, G. (éd.), Handbook of the sociology of the military (pp. 237-254), New York : Springer.
- Stout, K. D. (1991). « A continuum of male controls and violence against women: A teaching model », Journal of Social Work Education, 27(3), pp. 305-319.
- Symons, E. (1990). « Under fire: Canadian women in combat », Canadian Journal of Women and the Law, 4(2), pp. 477-511.
- Taber, N. 2009. « The profession of arms: Ideological codes and dominant narratives of gender in the Canadian military », Atlantis: A Women’s Studies Journal, 34(1), pp. 27-36.
- Taber, N. 2011. « "You better not get pregnant while you’re here”: Tensions between masculinities and femininities in military communities of practice », International Journal of Lifelong Education, 30(3), pp. 331-348.
- Taber, N. 2016. « Women military leaders in the Canadian Forces: Learning to negotiate gender », dans Clover, D., S. Butterwick et L. Collins (éd.), Women, Adult Education, and Leadership in Canada, pp. 46-56. Toronto : Thompson Publishing.
- Taber, N. 2018. « After Deschamps: Men, masculinities, and the Canadian Armed Forces », Journal of Military and Veteran Health Research, 4(1), pp. 100-107.
- Taber, N. 2020. « The Canadian Armed Forces: Battling between Operation Honour and Operation Hop on Her », Critical Military Studies, 6(1), pp. 19-40.
- Tanner, L. (1999). ORD Report PR9901, Gender integration in the Canadian Forces – A quantitative and qualitative analysis, Ottawa : Défense nationale.
- Barreau du Haut-Canada 2013. Change of status research 2010-2012: Report of key findings submitted to The Law Society of Upper Canada.
- Von Hippel, C., D. Sekaquaptewa et M. McFarlane (2015). Psychology of Women Quarterly, 39(3), pp. 405-414.
- Waruszynski, B. (2017). « Female regular forces members’ perceptions on recruitment and employment of women in the CAF: Preliminary findings », Culture and diversity in the Armed Forces conference, Ottawa : ICRSMV, FAC et CIDP.
- Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity, Cambridge : Cambridge University Press.
- Winslow, D. (1998). « Misplaced loyalties: The role of culture in the breakdown of discipline in peace operations », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 35(3), pp. 345-367.
- Winslow, D., et J. Dunn (2002). « Women in the Canadian Forces: Between legal and social integration », Current Sociology, 50(5), pp. 641-667.
Construisez et ils viendront : (re) construire une armée canadienne inclusive, diversifiée, équitable et responsable par l’éducation
Préambule
Historiquement, les Forces armées canadiennes (FAC) semblent mettre en œuvre le changement social en réaction aux plaintes et aux décisions des tribunaux, plutôt que de manière proactive. En effet, ce rapport fait lui-même partie des mesures à mettre en œuvre en réponse à une entente de règlement récent découlant d’une décision de justice. Entre 2016 et 2017, sept anciens membres des FAC ont intenté des recours collectifs, les « Recours collectifs Heyder et Beattie », contre le gouvernement du Canada, entourant des questions relatives à l’inconduite sexuelle en lien avec leur service militaire ou leur emploi au ministère de la Défense nationale (MDN) ou au Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (FNP) (Règlement du recours collectif pour inconduite sexuelle FAC-MDN, 2019). Le 25 novembre 2019, la Cour fédérale a approuvé une entente de règlement qui, en plus d’offrir une indemnisation aux membres actuels et anciens des FAC, du MDN et des FNP qui ont été victimes d’inconduite sexuelle, stipule d’autres exigences, notamment « la possibilité de participer à un programme de démarches réparatrices pour permettre aux survivants de partager leurs expériences d’inconduite sexuelle avec les hauts représentants des FAC ou du MDN », et « des changements aux politiques des FAC et d’autres mesures visant l’Inconduite sexuelle dans les FAC » (Règlement du recours collectif relatif FAC-MDN pour inconduite sexuelle, 2019). Conformément à ces stipulations supplémentaires du règlement, des consultations sur la représentation des genres et la diversité ont été organisées en 2020-2021 entre des représentants du recours collectif, des représentants des FAC et des experts en la matière (experts), concernant l’augmentation de la représentation des genres et la diversité au sein des FAC. Bien que les consultations aient dû être déplacées virtuellement en raison des limites imposées par la COVID-19 sur les rassemblements en personne et aux déplacements, le groupe de consultation a travaillé fort et avec constance malgré ces contraintes dues à la pandémie. Ce rapport est l’un des rapports des experts issus des discussions des consultations, qui ont désigné l’« éducation » dans les FAC comme étant l’un des domaines prioritaires à traiter. Ce rapport s’appuie sur l’expertise et les recherches de l’auteur dans les domaines de l’éducation et de la diversité dans les organisations militaires, sur une sélection de la littérature et des pratiques exemplaires dans ce domaine.
Il part du principe que, malgré les efforts passés et actuels pour augmenter le taux de représentation des femmes en uniforme, les FAC n’ont pas réussi à atteindre une véritable diversité et inclusion des genres dans l’ensemble de l’organisation. Ceci, à son tour, affecte négativement l’efficacité opérationnelle et la légitimité des forces armées aux yeux de la société canadienne. Pour comprendre ce problème complexe, il faut tenir compte de multiples questions; notamment, les problèmes systémiques de harcèlement sexuel; le manque de volonté des organisations de tirer les leçons des expériences passées; le manque de réceptivité au changement social et la croyance erronée qu’une formation unique, à taille unique, résoudra ces problèmes. En fin de compte, l’approche consistant à « ajouter des femmes dans l’armée et remuer » n’a pas fonctionné. Afin de faire avancer les FAC et de réaliser un changement social au sein de l’organisation, ainsi que de façonner les comportements et les attitudes de ses membres, un programme éducatif tout au long de la carrière, fondé sur les valeurs d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité, est la clé. Il est indéniable que la responsabilité doit être intégrée dans un nouveau programme d’éducation afin que les membres soient conscients des conséquences de leurs actions s’ils persistent ou violent une politique, un code ou une loi.
Comprendre le problème
Problèmes systémiques
Les FAC sont un chef de file reconnu en matière de représentation des genres et pour avoir été l’un des premiers pays à ouvrir toutes les professions militaires aux femmes en 1989, à l’exception des professions du service sous-marin, qui ont été ouvertes en 2001 (MDN et FAC, 2020). Cependant, au cours des 30 dernières années, après ce changement de politique historique, le nombre de femmes servant dans les FAC a augmenté très lentement et semble avoir atteint un plateau. En 2020, le taux de représentation des femmes servant dans les FAC était de 16 % dans l’ensemble (15,8 % dans la Force régulière et 16,6 % dans la Première réserve), ce qui est loin d’atteindre l’objectif de 25 % de femmes dans les FAC d’ici 2026 (MDN et FAC, 2020). Les raisons de la faible représentation des femmes dans l’armée canadienne comprennent « la ségrégation professionnelle, les défis concernant l’équilibre entre les exigences militaires et la vie familiale, les préoccupations relatives au harcèlement sexuel et à l’inconduite sexuelle, une structure organisationnelle très traditionnelle et hiérarchique et une culture organisationnelle fermée » (voir Deschamps, 2015; Earnscliffe Strategy Group, 2017; Scoppio, Otis & Yan, 2018, cité dans Scoppio, Otis, Yan & Hogenkamp, 2020, p. 2).
Au fil des ans, les FAC ont été en proie à des problèmes systémiques de longue date liés à l’agression et à l’inconduite sexuelles qui ont fait l’objet d’enquêtes dans les médias (O’Hara, 1998; Mercier et Castonguay, 2014), qui ont été examinés par des chercheurs (Gill et Febbraro, 2013; Cotter, 2019) et qui ont été documentés par le rapport Deschamps (2015). L’ancienne juge Marie Deschamps, la responsable de l’examen externe concernant l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel au sein des FAC, a signalé qu’« il y a un lien incontestable entre l’existence d’attitudes négatives et discriminatoires à l’égard des femmes dans les FAC, la faible représentation des femmes dans les postes supérieurs de l’organisation, et la prédominance du harcèlement sexuel et de l’agression sexuelle » (2015, p. 24).
Manque de volonté de tirer des leçons et manque de réceptivité au changement social
Comme indiqué au début de ce rapport, il est important de reconnaître que les FAC semblent mettre en œuvre le changement social en réaction aux plaintes et aux décisions des tribunaux, plutôt que de manière proactive. Le changement social est défini en sociologie comme « l’altération des mécanismes de la structure sociale, caractérisée par des changements dans les symboles culturels, les règles de comportement, les organisations sociales ou les systèmes de valeurs » (Encyclopædia Britannica, 2020). Dans le contexte des organisations, les sociétés évoluent, tout comme les organisations, y compris l’armée. Les FAC doivent donc continuer à évoluer de manière proactive avec la société canadienne, afin de refléter l’évolution de la culture et des valeurs de la société et de conserver sa légitimité aux yeux de la société canadienne. Toutefois, l’histoire montre que ce ne fut pas le cas.
Plusieurs exemples de l’approche réactionnaire de l’armée canadienne face au changement social peuvent être trouvés dans son histoire. Le changement de politique visant à permettre aux femmes de servir dans tous les postes militaires découle d’une plainte déposée par quatre membres des FAC, Isabelle Gauthier, Marie-Claude Gauthier, Georgina Anne Brown et Joseph Houlden, qui « leur semblait injuste que les femmes ne puissent pas combattre ni occuper un poste lié au combat pour la seule raison qu’elles étaient des femmes » (Commission canadienne des droits de la personne, s.d., p. 1). À la suite de leur plainte pour discrimination fondée sur le sexe, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une décision historique du Tribunal canadien des droits de la personne, en 1989, a ordonné aux FAC de supprimer toutes les restrictions à l’emploi et d’intégrer les femmes dans tous les postes militaires (Commission canadienne des droits de la personne, s.d.). Un autre exemple est l’ancienne politique de « punition » ou de « purge » des membres lesbiennes, gaies, bisexuels, transgenres, queers, bispirituels ou d’un autre genre non binaire ou d’une identité sexuelle minoritaire (LGBTQ2+) servant dans l’armée canadienne, une politique discriminatoire qui a été renversée, suite à une nouvelle contestation judiciaire en 1992 (Levy, 2020). De tels exemples peuvent être trouvés dans d’autres armées du monde, y compris dans l’armée américaine, où la politique « Don't Ask, Don't Tell », une loi vieille de 17 ans interdisant aux personnes ouvertement gaies, lesbiennes et bisexuelles de servir dans l’armée, a finalement été abrogée en 2011, après de nombreuses contestations constitutionnelles (Feder, 2013; Bumiller, 2011).
Ces exemples reflètent, d’une part, l’approche réactionnaire des FAC, et plus largement des organisations militaires, face au changement social, en raison de leur culture organisationnelle et de leurs structures hiérarchiques « fermées », traditionnelles et patriarcales, et, d’autre part, l’incapacité de l’organisation à tirer les leçons des erreurs passées.
Une instruction à format unique n’est pas la solution
Une autre faiblesse organisationnelle récurrente des FAC est le point de vue erroné selon lequel une instruction unique, à format unique, est un moyen efficace de relever certains de ces défis. Encore une fois, nous trouvons des exemples de cela tout au long de l’histoire des FAC. À la suite des échecs de la mission canadienne de maintien de la paix en Somalie, qui ont culminé avec la torture et le meurtre d’un adolescent somalien par des membres du Régiment aéroporté du Canada, et en réponse au rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie (1997), les FAC ont mis en place une instruction obligatoire pour tout le personnel, appelée le Code de prévention du harcèlement et du racisme (SHARP). Malheureusement, le SHARP et d’autres formations similaires étaient « fondés sur deux hypothèses erronées : la première est que des instructions et des séances d’information autonomes et ponctuelles étaient suffisantes pour une carrière; la seconde est qu’un seul programme répond à toutes les exigences, de la simple recrue à l’officier général » (Scoppio, 2004, p. 226). En 2002, le Comité consultatif ministériel sur l’intégration des femmes et l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes a jugé que l’instruction existante sur l’équité en matière d’emploi et la diversité offerte par les FAC, comme Leadership dans une armée diversifiée et SHARP, était un ensemble de « nombreux programmes de formation sur la diversité, créés en réaction à des problèmes précis » (ministère de la Défense nationale, 2001). La Commission a plutôt encouragé l’adoption d’un « « programme d’éducation pour un milieu de travail respectueux » à l’appui de l’apprentissage continu qui permettra aux membres de reconnaître, d’apprécier et de valoriser la diversité… [qui] devra porter entre autres sur la compréhension de la dynamique des groupes, ainsi que sur les stratégies de communication interpersonnelle et de résolution des problèmes dans des groupes diversifiés. Elle devra aussi aborder les notions de dignité et de droits de la personne, ainsi que les questions qui touchent particulièrement les femmes, les Autochtones et les minorités visibles » (MDN, 2002). À ce jour, ce type de programme d’éducation sur le respect en milieu de travail, qui s’étend sur toute une carrière, n’existe pas dans les FAC. Cela dit, au fil des ans, divers documents sur la diversité et l’équité en matière d’emploi, ainsi que sur le harcèlement sexuel et l’inconduite, ont été inclus dans l’instruction et le perfectionnement professionnel des FAC. Toutefois, ces documents sont souvent des « présentations en boîte », ils ne sont pas présentés par des experts et ils n’ont pas le niveau d’ampleur et de profondeur requis.
Après avoir reconnu ces problèmes systémiques et ces lacunes organisationnelles, il n’est que juste de reconnaître également les récents efforts organisationnels visant à mettre en œuvre de nouvelles stratégies et politiques pour aborder les questions liées à l’inconduite sexuelle ainsi que l’équité en matière d’emploi et la diversité de façon plus générale, comme l’Opération Honour, la Stratégie des Forces armées canadiennes en matière de diversité, la Politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, et La voie vers la dignité et le respect (gouvernement du Canada, MDN, 2021, 2016, 2017, 2020b). Cependant, nous devons également réaliser que les changements de stratégies, de politiques et de processus sont importants, mais clairement insuffisants.
Aller de l’avant grâce à l’éducation sur l’inclusion, la diversité, l’équité et la responsabilité
Pour aller de l’avant et évoluer en tant qu’organisation, les FAC doivent élaborer et mettre en œuvre un nouveau programme éducatif complet et permanent sur l’inclusion, la diversité, l’équité et la responsabilité (IDER), obligatoire pour tous les officiers et les militaires du rang (MR) et intégré tout au long de la carrière d’un membre, de la recrue aux officiers généraux.
Objectif
L’objectif de l’élaboration du programme éducatif IDER est de mettre en œuvre un véritable changement social au sein des FAC et, en fin de compte, d’inclure, de valoriser et d’intégrer véritablement les femmes de manière significative dans l’organisation, ainsi que les membres de la communauté LGBTQ2+ et d’autres personnes issues de la diversité, dans l’ensemble des grades, des professions et des services militaires, et de tirer parti de leurs forces uniques et de leurs diverses perspectives.
Analyse comparative entre les sexes plus
Lors de la création du programme IDER, l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) devrait être utilisée comme outil d’analyse, tant dans l’élaboration que dans la prestation du programme, afin de s’assurer que les facteurs de genre et d’intersectionnalité sont toujours pris en compte (gouvernement du Canada, Condition féminine Canada, 2020).
Fondement des valeurs, des lois et des politiques en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité.
Le nouveau programme éducatif IDER devrait reposer sur les valeurs d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité, ancrées dans la législation et les politiques pertinentes, ainsi que sur les concepts, connaissances et compétences clés qui s’y rapportent.
L’inclusion, c’est d’abord parce que nous devons accueillir à bras ouverts tous les membres de la société avant tout. Elle consiste à mettre à profit et à promouvoir activement et intentionnellement la pleine participation et le sentiment d’appartenance de chaque membre de l’organisation (Center for Creative Leadership, 2021).
La diversité ensuite, car nous devons accepter toutes les différences et identités visibles et invisibles qui nous rendent uniques, et nous adapter mutuellement à des individus de tous horizons. Elle englobe le genre, le sexeFootnote 29, l’origine ethnique, la culture, la langue, la religion, les capacités et le handicap, l’éducation, le milieu socio-économique, l’orientation sexuelle et d’autres identités.
L’équité suit, afin d’accommoder les individus et les milieux de travail pour garantir l’égalité de tous et créer des conditions de concurrence équitables. L’équité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même façon, « Il s’agit de reconnaître et d’accepter les différences, et non de des ignorer et de les rejeter » (Abella, 1984, p. 13).
La responsabilité est toujours présente et appliquée de manière équitable et sans parti pris dans l’ensemble de l’organisation et de la société, pour le bien de tous. Ainsi, une fois que nous aurons accueilli tous les membres de la société, tout en acceptant leurs différences, que nous aurons fait des aménagements et créé l’égalité pour tous, nous pourrons objectivement appliquer la responsabilité de manière équitable à chacun.
Les valeurs d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité sont ancrées dans les lois canadiennes, notamment la Charte des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur le multiculturalisme canadien et la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui s’applique aux FAC depuis 2002 (gouvernement du Canada, ministère de la Justice, 1982, 1985 a, 1985b, 1995, 2002). De plus, il existe des politiques connexes des FAC, les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) telles que la DOAD 9005-1, Intervention sur l’inconduite sexuelle (gouvernement du Canada, Défense nationale, 2020a).
Connaissances et concepts clés
Voici d’autres connaissances et concepts clés qui devraient être incorporés au programme :
- Les préjugés personnels, le harcèlement, discrimination, racisme, intervention du spectateur et micro-agressions.Footnote 30
- L’intersectionnalité, y compris les intersections du genre, de la race, de l’ethnicité, de l’orientation sexuelle, de la génération, de la culture et d’autres identités de diversité pour mieux comprendre comment « l’exclusion sociale ou le privilège se produit différemment dans diverses positions sociales [...] en se concentrant sur l’interaction de multiples systèmes d’oppression » (Romero, 2017, p.8).
- Les femmes et les questions de genre dans le milieu de travail, y compris les femmes dans l’armée, l’inconduite sexuelle, les constructions sociales des rôles de genre, les stéréotypes de genre et l’équité de genre.
- Les questions relatives aux membres de la communauté LGBTQ2+ dans le milieu de travail, y compris les membres de la communauté LGBTQ2+ dans l’armée, les violations des droits de la personne et la discrimination à l’encontre des membres de la communauté LGBTQ2+.
- Les questions autochtones dans le milieu de travail, y compris le racisme systémique, le rôle des Autochtones dans l’armée et la compréhension des cultures autochtones.
- Les questions relatives aux minorités visibles et aux personnes handicapées dans le milieu de travail, y compris la discrimination et le harcèlement raciaux et liés au handicap.
- La culture et les cultures organisationnelles, y compris les dimensions de la culture et des sous-cultures; la manière dont les cultures organisationnelles sont créées et enseignées aux nouveaux membres; la manière dont les dirigeants peuvent façonner et transmettre la culture et la mise en œuvre du changement culturel dans les organisations (Schein et Schein, 2017).
- La culture militaire, notamment le cadre du guerrier, la masculinité hégémonique, la culture de la misogynie et de l’homophobie, le traumatisme sexuel militaire (TSM) affectant les survivants masculins et féminins (O’Brien, Keith et Shoemaker, 2015).
- Les questions de genre dans les contextes de la défense et de la sécurité, notamment la résolution de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) intitulée Les femmes, la paix et la sécurité, lancée le 31 octobre 2000 avec l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies (OTAN, 2020).
- La manière d’appliquer l’ACS+ au niveau stratégique, opérationnel et tactique des FAC (gouvernement du Canada, Condition féminine Canada, 2020).
- La manière de favoriser un milieu de travail inclusif, diversifié, équitable et respectueux.
- La manière de favoriser un espace sûr dans le milieu de travail, c’est-à-dire un lieu « destiné à être exempt de tout préjugé, conflit, critique ou action, idée ou conversation potentiellement menaçante » (Merriam-Webster, 2021).
Compétences essentielles pour travailler dans des environnements diversifié
Grâce à ce programme, les membres des FAC devraient développer davantage une variété de compétences essentielles pour travailler efficacement dans des environnements diversifiés, tant au Canada qu’à l’étranger, au sein d’équipes diversifiées, y compris des membres civils, d’autres ministères, des armées alliées et d’autres groupes.
Ces types de compétences sont parfois appelés « compétences générales », « compétences relatives à l’employabilité », « compétences non académiques » ou d’autres termes, mais, quel que soit le terme utilisé, ces aptitudes, ces compétences, ces attributs, ces comportements et ces caractéristiques sont essentiels pour rendre une personne capable de travailler de manière respectueuse dans des environnements interculturels et diversifiés, et en mesure de travailler avec les autres.
Voici les compétences essentielles pour travailler dans des environnements diversifiés, qui devraient être développées par le nouveau programme IDER :
- Volonté d’apprendre
- Professionnalisme/éthique
- Sensibilisation culturelle/diversité
- Compétences interpersonnelles/sociales
- Maîtrise de soi
- Établissement et maintien de la confiance
- Esprit d’équipe/collaboration
- Souplesse/faculté d’adaptation
- Résolution de conflits/problèmes
- Leadership/prise de décisions
- Diplomatie
- Communication verbale et écrite/écoute active
- Pensée critique
- Imagination/créativité
(adapté de Scoppio et Schock, 2011).
Programme d’éducation tout au long de la carrière
Le nouveau programme IDER devrait être un programme éducatif autonome, progressif, tout au long de la carrière, et il ne devrait pas être adapté aux structures existantes d’instruction et de développement professionnel des FAC, comme si l’on essayait de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Les activités existantes dans ce domaine au sein des FAC sont inadéquates, incohérentes et non coordonnées, et elles sont souvent des programmes d’« instruction » plutôt que des programmes « éducatifs ». Il est essentiel ici de souligner les principales différences entre les programmes d’instruction et d’éducation. Un programme éducatif vise à fournir une base de connaissances et de compétences intellectuellesNote de bas de page 31, ainsi que d’autres compétences, sur lesquelles l’information peut être correctement interprétée et un jugement sain exercé. En revanche, un programme d’instruction vise à développer des compétences et des connaissances spécifiques à un emploi ou à une profession pour effectuer des tâches précises, lesquelles peuvent être clairement observées et qui ont un début et une fin, comme l’utilisation d’un équipement (Scoppio, 2009).
Le programme devrait comprendre au minimum quatre niveaux, ce qui correspondrait à un minimum de quatre cours ou plus : un niveau d’introduction, un niveau de base ou fondamental, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. La durée approximative de chaque cours pourrait être en moyenne de deux semaines d’apprentissage à temps plein. De plus, elle pourrait varier en fonction du niveau du programme, car chacun des quatre niveaux devrait augmenter progressivement la profondeur du contenu et tenir compte des responsabilités accrues des membres à mesure qu’ils progressent en grade. En d’autres termes, les cours de niveau intermédiaire et avancé pourraient avoir une durée plus longue que les cours de niveau introductif ou de base. En outre, chaque cours doit s’appuyer sur les autres et son contenu doit s’adresser aux différents publics de chaque niveau. Les cours de niveau supérieur devraient impliquer des niveaux d’apprentissage plus élevés et inclure un contenu lié à la « gestion » du milieu de travail et à la résolution des problèmes dès le départ, comme toute action ou tout commentaire inapproprié, et à la prévention de la récurrence ou de l’escalade de violations similaires. Ils devraient être mis à jour régulièrement afin d’inclure les nouvelles recherches, la littérature, les politiques et la législation, ainsi que les développements positifs ou négatifs et les événements affectant les FAC qui ont pu être découverts, et qui peuvent être utilisés comme « études de cas » et fournir des occasions d’apprentissage.
Des « journées IDER » obligatoires devraient être mises en place, c’est-à-dire des événements de formation continue organisés régulièrement dans chaque unité des FAC par des professionnels qualifiés afin de permettre aux membres de rafraîchir leurs connaissances, d’obtenir des mises à jour sur la législation et les politiques et de s’engager dans des discussions dynamiques et significatives. La fréquence, la durée et le format de ces événements d’apprentissage pourraient varier. Par exemple, ils pourraient être organisés tous les trimestres sous la forme d’une demi-journée d’apprentissage « officiel », suivie d’une demi-journée d’apprentissage « informel » dans le cadre de petits groupes de discussion afin de créer un environnement décontracté dans lequel les membres se sentent à l’aise pour s’exprimer et partager des expériences pertinentes. Divers contrôles d’apprentissage doivent également être mis en place, allant de questions sur les mises à jour des législations et des politiques à des réflexions par soi-même sur la manière d’appliquer dans la pratique les concepts ou les compétences appris. Ces événements d’apprentissage ne devraient pas être « accolés » aux exposés annuels en place qui sont généralement réalisés dans les unités des FAC à l’aide de « présentations en boîte », avec peu ou pas d’interactions avec les participants.
L’achèvement réussi de chaque niveau du programme et les événements de formation continue doivent être suivis pour tout le personnel au fil des ans. Cela permettrait d’éviter qu’un nombre important d’infractions, comme l’inconduite sexuelle, ne se produisent, puisque les membres seraient plus sensibilisés après avoir suivi le programme et participé aux événements d’apprentissage annuels, et grâce aux mécanismes de suivi mis en place comme moyen de dissuasion. Ces données pourraient être utilisées, si elles sont jugées appropriées, dans des cas de violation présumée de la conduite d’un autre membre et utilisées comme preuve que la personne était consciente des ramifications de ses actions et de ce qui était inacceptable parce qu’elle avait reçu cette information chaque année et que le membre avait participé avec succès aux événements de formation continue chaque année.
De plus, alors que le nouveau programme aura des avantages intrinsèques en développant les membres et les leaders des FAC avec les connaissances, les compétences et les aptitudes requises dans le contexte de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de la responsabilité, des avantages extrinsèques tangibles pourraient inclure un certificat à la fin du programme.
Pratiques exemplaires
Le programme IDER devrait s’inspirer des pratiques exemplaires en matière d’éducation des adultes, d’apprentissage transformateur, de développement, de conception et de mise en œuvre de programmes. Le nouveau programme devrait être élaboré en utilisant les principes et les pratiques exemplaires de l’éducation des adultes, y compris l’apprentissage par l’expérience, l’apprentissage contextuel et l’apprentissage actif, afin de s’assurer que l’apprentissage est pertinent et significatif pour tous les apprenants adultes diversifiés des FAC (Collins, 2004; Imel, 2000). Parmi les exemples d’apprentissage par l’expérience, citons le fait de demander aux étudiants de partager leurs expériences pendant les composantes résidentielles du programme, ainsi que d’inviter des conférenciers, qu’il s’agisse d’experts dans le domaine ou de survivants d’inconduite sexuelle, en utilisant une approche tenant compte des traumatismes, en étant sensible à l’impact des traumatismes ainsi qu’en reconnaissant les signes et les symptômes des traumatismes et en évitant de traumatiser à nouveau (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). Le programme devrait également adopter une approche d’apprentissage transformateur, selon laquelle « les étudiants sont capables de former de nouvelles compréhensions et d’agir sur ces nouvelles perspectives » (Shepard Wong, 2006, p. 1). Les expériences d’apprentissage transformatif devraient être rendues possibles par des environnements d’apprentissage favorables qui « encouragent l’investigation et la réflexion de concert avec des occasions d’interaction significative, soutenue et en personne entre des personnes qui sont différentes les unes des autres, que ce soit sur le plan social, économique, ethnique, culturel ou idéologique » (Shepard Wong, 2006, p.1).
En suivant les pratiques exemplaires en matière de conception pédagogique, la conception et le développement doivent être menés par une équipe intergénérationnelle et interdisciplinaire comprenant des membres volontaires des recours collectifs, des experts civils et des membres en uniforme ayant une expérience de la diversité, des questions de genre et de l’équité en matière d’emploi, des concepteurs pédagogiques, des développeurs multimédias et des développeurs Web. Une équipe intergénérationnelle est nécessaire pour concevoir le programme en vue de comprendre les différences générationnelles des membres des FAC et leurs interactions et engagements les uns avec les autres, car quatre générations coexistent actuellement au sein de la main-d’œuvre, y compris les FAC (la génération du baby-boom, la génération X et la génération Y/millénariaux), et une cinquième génération (génération Z) est prête à entrer sur le marché du travail (Burton, Mayhall, Cross et Patterson, 2019).
Les pratiques exemplaires en matière de stratégies d’apprentissage devraient également inspirer la prestation des programmes (voir Hartwell et coll., 2017). Pour assurer un équilibre entre le besoin d’interaction entre les apprenants, ainsi que les besoins des nouvelles générations qui sont nées dans les nouvelles technologies, et les générations plus anciennes qui sont nées avant les nouvelles technologies, la prestation du programme devrait suivre une approche d’apprentissage mixte. En combinant l’interaction en personne en classe et les technologies d’apprentissage, à l’aide d’outils synchrones (tels qu’une conférence virtuelle à l’aide d’un système de vidéoconférence) et asynchrones (tels qu’un forum de discussion à l’aide d’un système de gestion de l’apprentissage), un environnement d’apprentissage mixte offre flexibilité et accessibilité et augmente en fin de compte la probabilité d’un apprentissage significatif (voir Scoppio et Covell, 2016).
Il est reconnu qu’il peut y avoir des programmes qui pourraient être des exemples utiles en ce qui concerne la mise en œuvre et les options de programme; par exemple, un programme du Service correctionnel du Canada, comme l’a noté l’un des membres du recours collectif au cours de l’une des consultations, bien qu’il n’ait pas été possible d’acquérir une documentation tangible sur le programme pour éclairer ce rapport.
Leçons apprises
Au-delà des niveaux tactiques et opérationnels, il semble que les militaires canadiens ne tirent pas toujours les leçons qui s’imposent, et cela inclut les incidents d’inconduite sexuelle qui se répètent au sein des FAC. Par conséquent, il est essentiel d’intégrer dans le nouveau programme certaines des leçons apprises dans le contexte de l’inconduite sexuelle.
Pour assurer l’apprentissage organisationnel, les FAC devraient s’appuyer sur les récits déchirants des représentants des recours collectifs et d’autres survivants de TSM, qui sont prêts à en parler, afin de les capturer dans un documentaire vidéo commémoratif. Cela permettra de s’assurer que ces histoires ne seront jamais oubliées et que l’organisation se souviendra de ces leçons pour les années à venir. Le film documentaire de la cinéaste Sarah Fodey (2018), The Fruit MachineFootnote 32, en est un exemple concret. Elle a documenté « des survivants de la chasse aux sorcières contre les homosexuels qui a sévi dans la fonction publique pendant des décennies racontent leur histoire personnelle de dévouement envers le gouvernement canadien ». Les femmes et les hommes survivants dans le documentaire comprennent d’anciens membres des FAC, de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres fonctionnaires, qui ont tous été pris pour cible lors de la purge homosexuelle qui a duré quatre décennies au Canada.Footnote 33
Assurance de la qualité, amélioration continue, responsabilité et ressources
Des activités d’assurance qualité, telles que l’évaluation et la validation du programme, doivent être menées régulièrement afin d’évaluer son efficacité, et des améliorations continues doivent être apportées à celui-ci afin de s’assurer qu’il reste « toujours d’actualité ». De plus, des rapports annuels de mise à jour sur le rendement du programme devraient être soumis à un ou plusieurs examinateurs externes pour assurer une surveillance, et ensuite mis à la disposition des membres des recours ainsi que des FAC et du public canadien pour promouvoir la responsabilité.
Ce programme pourrait être considéré par certains comme étant à la fois audacieux et visionnaire. Il est certain que pour mettre en œuvre le type de changement social requis au sein des FAC, il est important d’avoir une vision prospective de ce que nous voulons que l’organisation soit à l’avenir. Il ne fait aucun doute que l’exécution de ce programme « visionnaire » nécessite des actions rapides ainsi que des ressources dédiées et appropriées. Malheureusement, les organisations ont parfois tendance à mettre en œuvre de nouveaux programmes et activités en utilisant l’approche « neutre en ce qui concerne les ressources ». Toutefois, le nouveau programme IDER « visionnaire » ne peut être mis en œuvre avec succès avec des ressources nulles. En effet, comme l’a dit Thomas Friedman, « une vision sans ressources est une hallucination » (Kotkin, 2008). En fin de compte, le coût de ce type de programme éducatif est infime dans l’ensemble, si l’on considère l’impact sur la santé, les expériences vécues et les carrières des personnes touchées par des incidents d’inconduite sexuelle, de harcèlement, de racisme, de discrimination, d’exclusion ou d’autres comportements nuisibles, ainsi que les nombreux impacts sur l’organisation en ce qui concerne les ressources humaines, la réputation, les coûts financiers et les litiges potentiels.
Recommandations
Les recommandations suivantes sont présentées avec l’intention qu’elles ne peuvent pas se produire de manière isolée, car elles sont toutes liées. Les délais envisagés sont les suivants : un plan de communication et de déploiement du nouveau programme IDER devrait être lancé sans délai dans les trois mois (recommandation no 1); le nouveau programme devrait être développé à court terme, à savoir dans un délai d’un an pour les niveaux 1-2 et de deux ans pour les niveaux 3-4 (recommandations no 2 à 10); la mise en œuvre du programme devrait avoir lieu à court et moyen terme, à savoir dans les deux ans pour les niveaux 1-2 et dans les trois ans pour les niveaux 3-4 (recommandations no 11 à 13); enfin, les ressources et les activités d’assurance qualité devraient être permanentes (recommandations no 14 et 15). La dernière recommandation (no 16) porte sur la possibilité d’étendre le programme IDER aux employés civils du MDN à l’avenir, puisque certains d’entre eux sont des militaires à la retraite et apportent donc avec eux la culture organisationnelle des FAC.
- Les FAC devraient lancer sans délai un plan de communication et de déploiement concernant le nouveau programme en cours d’élaboration, en utilisant une approche multimédia, allant des assemblées publiques dans les bases militaires à travers le Canada, aux vidéos réalisées par les dirigeants des FAC, aux messages sur les médias sociaux et aux courriels transmis depuis le Réseau étendu de la Défense (RED).
- Les FAC doivent élaborer et mettre en œuvre un nouveau programme éducatif complet et permanent IDER, obligatoire pour tous les officiers et les MR et intégré tout au long de la carrière d’un membre, de la recrue aux officiers généraux.
- L’ACS+ devrait être utilisée comme outil d’analyse, tant dans l’élaboration que dans la prestation du programme, afin de s’assurer que les facteurs de genre et d’intersectionnalité sont toujours pris en compte (gouvernement du Canada, Condition féminine Canada, 2020).
- Le nouveau programme éducatif IDER devrait reposer sur les valeurs d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité, ancrées dans la législation et les politiques pertinentes, ainsi que sur les concepts et les connaissances clés, notamment :
- Les préjugés personnels, le harcèlement, discrimination, racisme, intervention du spectateur et micro-agressions;
- L’intersectionnalité;
- Les préoccupations féminines et problématiques hommes-femmes;
- Les préoccupations relatives à la communauté LGBTQ2+;
- Les préoccupations autochtones;
- Les préoccupations relatives aux minorités visibles et aux personnes handicapées;
- La culture et les cultures organisationnelles;
- La culture militaire;
- Les préoccupations relatives au genre dans les contextes de défense et de sécurité;
- La manière d’appliquer l’ACS+ au niveau stratégique, opérationnel et tactique des FAC;
- La manière de favoriser un environnement de travail inclusif, diversifié, équitable et respectueux;
- La manière de favoriser un espace sûr dans le milieu de travail.
- Grâce au programme, les membres des FAC devraient développer davantage une variété de compétences essentielles pour travailler dans des environnements diversifiés, notamment :
- Volonté d’apprendre
- Professionnalisme/éthique
- Sensibilisation culturelle/diversité
- Compétences interpersonnelles/sociales
- Maîtrise de soi
- Établissement et maintien de la confiance
- Esprit d’équipe/collaboration
- Souplesse/faculté d’adaptation
- Résolution de conflits/problèmes
- Leadership/prise de décisions
- Diplomatie
- Communication verbale et écrite/écoute active
- Pensée critique
- Imagination/créativité.
- Le nouveau programme IDER devrait être un programme éducatif autonome, progressif et s’étirer sur toute la carrière, et il devrait comprendre au minimum quatre niveaux, ce qui correspondrait à un minimum de quatre cours ou plus : un niveau d’introduction, un niveau de base ou fondamental, un niveau intermédiaire et un niveau avancé.
- Des « journées IDER » obligatoires devraient être mises en place, c’est-à-dire des événements de formation continue organisés régulièrement dans chaque unité des FAC par des professionnels qualifiés afin de permettre aux membres de rafraîchir leurs connaissances, d’obtenir des mises à jour sur la législation et les politiques et de s’engager dans des discussions dynamiques et significatives. Divers contrôles d’apprentissage doivent également être mis en place, allant de questions sur les mises à jour des législations et des politiques à des réflexions par soi-même sur la manière d’appliquer dans la pratique les concepts ou les compétences appris.
- Le programme devrait être élaboré en utilisant les principes de l’éducation des adultes, y compris l’apprentissage par l’expérience, l’apprentissage contextuel et l’apprentissage actif, ainsi que l’apprentissage transformateur, afin de s’assurer que le nouvel apprentissage est pertinent et significatif pour tous les apprenants adultes diversifiés des FAC.
- En suivant les pratiques exemplaires en matière de conception pédagogique, la conception et le développement doivent être menés par une équipe intergénérationnelle et interdisciplinaire comprenant des membres volontaires des recours collectifs, des experts civils et des membres en uniforme ayant une expérience de la diversité, des questions de genre et de l’équité en matière d’emploi, des concepteurs pédagogiques, des développeurs multimédias et des développeurs Web.
- Un documentaire vidéo commémoratif devrait être développé à des fins éducatives pour être inclus dans le programme, capturant les témoignages et les histoires des survivants de l’inconduite sexuelle, y compris les représentants volontaires de l’action collective.
- La prestation du programme doit s’inspirer des pratiques exemplaires en matière de stratégies d’apprentissage, comme l’apprentissage mixte, c’est-à-dire une combinaison d’interaction en classe en personne et de technologies d’apprentissage, en utilisant des outils synchrones et asynchrones, animés par des instructeurs compétents qui ont une expertise dans le domaine.
- La réussite des niveaux de programme et des événements d’apprentissage continu devrait faire l’objet d’un suivi pour tout le personnel au fil des ans afin de s’assurer que chaque membre des FAC est conscient et responsable des ramifications de ses actions s’il persiste ou enfreint une politique, un code ou une loi.
- Le nouveau programme aura des avantages intrinsèques en développant les membres et les leaders des FAC avec les connaissances, les compétences et les aptitudes requises dans le contexte de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de la responsabilité, des avantages extrinsèques tangibles pourraient inclure un certificat à la fin du programme.
- Des activités d’assurance qualité, telles que l’évaluation et la validation du programme, doivent être menées régulièrement et des améliorations continues doivent être apportées à celui-ci afin de s’assurer qu’il reste « toujours d’actualité ». En outre, des rapports annuels de mise à jour sur le rendement du programme devraient être présentés à des examinateurs externes pour assurer une surveillance, et ensuite mis à la disposition du public pour promouvoir la responsabilité.
- Des ressources dédiées et appropriées doivent être affectées dès le départ pour soutenir non seulement le développement et la prestation du programme, mais également les activités d’assurance qualité et les améliorations et mises à jour continues du programme.
- Il faudrait envisager d’étendre le programme IDER aux fonctionnaires du MDN à l’avenir.
Conclusion
Le présent rapport a montré comment les FAC n’ont pas réussi à atteindre une véritable diversité et inclusion des genres en raison de problèmes systémiques d’inconduite et de harcèlement sexuels, de l’absence de volonté organisationnelle de tirer les leçons du passé, combinée à l’absence de réceptivité au changement social, et de l’hypothèse erronée selon laquelle une formation unique, à format unique, permettrait de résoudre ces problèmes systémiques. En définitive, il ne suffit pas de réviser l’« instruction » des FAC existante, qui est inadéquate, incohérente et non coordonnée. Pour parvenir à un véritable changement social au sein des FAC, un nouveau programme « éducatif » » obligatoire pour tous les membres doit être mis en œuvre, fondé sur les valeurs d’inclusion, de diversité, d’équité et de responsabilité. Cette mise en œuvre du nouveau programme doit commencer immédiatement pour éviter de perdre l’élan, car chaque jour perdu n’améliorera pas la situation de l’organisation. Le programme IDER permettra aux militaires canadiens de (re) construire une organisation plus équitable, diversifiée, inclusive et responsable. Cela permettra aux FAC d’attirer et de retenir davantage de femmes, de membres de la communauté LGBTQ2+ et d’autres groupes divers. Grâce à la mise en œuvre du nouveau programme IDER, nous créerons une nouvelle réalité pour les militaires canadiens.
Au moment de finaliser ce rapport, les FAC font maintenant face à de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle contre les deux derniers chefs d’état-major de la Défense (Pugliese, 2021; Coletta, 2021) ainsi que d’autres membres du MDN et des FAC (Stephenson, 2021). À la suite de ces accusations, une femme officier d’infanterie décorée des FAC, le lieutenant-colonel Eleanor Taylor, a démissionné pour manifester son mépris envers une organisation dont elle ne souhaite plus faire partie (Global News, 2021; Austen, 2021). Cette récente crise au sein de l’armée canadienne a ébranlé l’organisation jusqu’au plus profond d’elle-même et a été comparée au scandale de la Somalie dans les années 1990 en ce sens qu’il s’agit « à la fois de crises du leadership et de la perception des leaders » (Brewster, 2021). Bien qu’il n’entre pas dans le cadre de ce rapport de s’engager dans une discussion approfondie sur ces allégations actuellement en cours d’investigation, il est important de souligner le caractère opportun et l’importance des recommandations du programme IDER, qui étaient déjà en cours avant que ces nouvelles accusations ne soient révélées. Indépendamment de l’issue de ces allégations, il est clair que les FAC ne peuvent pas « se réparer elles-mêmes » et qu’il existe un besoin encore plus grand pour ce nouveau programme, qui ne doit pas être considéré comme une « case à cocher » ou une « solution rapide », mais plutôt comme un apprentissage tout au long de la carrière qui résistera à l’épreuve du temps, et comme un moyen de commencer à restaurer le respect et la confiance du Canada envers ses militaires.
Références
- Abella, R. (1984). Égalité en matière d’emploi : rapport d’une commission royale [PDF, 8,2 Mo], Ottawa, Ontario : Ministre des Approvisionnements et Services Canada.
- Austen, I. (2021). « A Top Woman in Canada’s Military Issues a Stinging Rebuke of Its Culture » (Anglais seulement), The New York Times.
- Brewster, M. (2021). « Ghosts of scandals past stalk Canadian military as sexual misconduct fallout grows » (Anglais seulement), CBC.
- Bumiller, E. (2011). « Obama Ends ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ Policy », The New York Times.
- Burton, C., Mayhall, C., J. Cross et P. Patterson (2019). « Critical elements for multigenerational teams: a systematic review », Team Performance Management: An International Journal, vol. 25 no 7/8, pp. 369-401.
- Règlement du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle, 2019.
- Commission canadienne des droits de la personne. S.d. Des droits égaux pour les hommes et les femmes au combat.
- Center for Creative Leadership. 2021. 5 Powerful Ways to Take REAL Action on DEI (Diversity, Equity & Inclusion) (Anglais seulement).
- Coletta, A. 2021. « Sexual misconduct allegations against top commanders rock Canada’s military » (Anglais seulement), The Washington Post.
- Collins, J. 2004. « Education Techniques for Lifelong Learning. Principles of Adult Learning » (Anglais seulement), RadioGraphics, 24:1483–1489.
- Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie. 1997. Un héritage déshonoré : les leçons de l’affaire somalienne [PDF, 48.6 Mo], Ottawa, Ontario : ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
- Cotter, A. 2019. Les inconduites sexuelles dans la Force régulière des Forces armées canadiennes, 2018, Statistique Canada no 85-603-X au catalogue, ISBN 978-0-660-29978-5.
- Ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes. 2020. Femmes dans les Forces armées canadiennes.
- Ministère de la Défense nationale. 2001. Rapport du Comité consultatif ministériel sur l’intégration des femmes et l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes, Ottawa, Ontario : Gouvernement du Canada.
- Deschamps, M. 2015. Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes. [PDF, 671 Ko]
- Drummond, H., et M. Selvaratnam. 2009. « Intellectual Skills Needed for the Effective Learning and Application of Chemical Knowledge », South African Journal of Chemistry, Vol. 62, pp. 179–184.
- Earnscliffe Strategy Group. 2017. Rapport de recherche sur le recrutement et l’embauche des femmes dans les Forces armées canadiennes, Directrice générale, recherche et analyse (personnel militaire), rapport contractuel, (DRDC-RDDC-2017-C003), Recherche et développement pour la défense Canada.
- Encyclopædia Britannica. 2020. Social Change. (Anglais seulement)
- Feder, J. 2013. « Don’t Ask, Don’t Tell: A Legal Analysis » (Anglais seulement), Congressional Research Services.
- Fodey, S. (réalisateur). 2018. The Fruit Machine [Film] (Anglais seulement), The Ontario Educational Communications Authority (TVO).
- Gill, R., et A. Febbraro. 2013. « Experiences and Perceptions of Sexual Harassment in the Canadian Forces Combat Arms », Violence Against Women, 19(2) pp. 269–287.
- Global News. 2021. Top officer speaks about sexual misconduct in military (Anglais seulement).
- Gouvernement du Canada. Patrimoine canadien. 2020. Projets en cours – Art public et monuments, Monument national LGBTQ2+.
- Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice. 2002. Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes.
- Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice. 1995. Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, c. 44).
- Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice. 1985a. Loi canadienne sur les droits de la personne, (L.R.C. 1985, ch. H-6).
- Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice. 1985b. Loi sur le multiculturalisme canadien (L.R.C., 1985, c. 24 [4e suppl.]).
- Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice. 1982. Loi constitutionnelle de 1982 Partie I, Charte canadienne des droits et libertés.
- Gouvernement du Canada. Défense nationale. 2021. Opération Honour, Ottawa, Ontario : gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. Sur Internet : Défense nationale. 2020a. DOAD 9005-1, Intervention sur l’inconduite sexuelle.
- Gouvernement du Canada. Sur Internet : Défense nationale. 2020b. La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention en cas d’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes, Ottawa, Ontario : gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. Sur Internet : Défense nationale. 2017. Protection, Sécurité, Engagement – La politique de défense du Canada [PDF, 10.8 Mo], Ottawa, Ontario : gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. Défense nationale. 2016. Stratégie des Forces armées canadiennes en matière de diversité, Ottawa, Ontario : Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. Condition féminine Canada. 2020. Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), Ottawa, Ontario : gouvernement du Canada.
- Hartwell, E., Cole, K., Donovan, S., Greene, R., S. Burrell Storms et T. Williams. 2017. « Breaking Down Silos: Teaching for Equity, Diversity, and Inclusion Across Disciplines », Humboldt Journal of Social Relations, Numéro spécial 39 : « Diversity & Social Justice in Higher Education », vol. 39, pp. 143-162.
- Imel, S. 2000. Contextual Learning in Adult Education [PDF, 138 Ko], Columbus, OH : ERIC Clearing House on Adult, Career and Vocational Education.
- Kotkin, S. 2008. « A Call to Action, for Earth and Profit » (Anglais seulement), The New York Times.
- Levy, R. 2020. « Purges dans les Forces armées canadiennes pendant la Guerre froide : le cas des personnes LGBTQ », L’Encyclopédie canadienne.
- Mercier, N., et Castonguay, A. 16 mai 2014. « Our military’s disgrace », Maclean’s.
- Merriam-Webster. 2021. Safe space (Anglais seulement).
- Otan. 2020. Les femmes, la paix et la sécurité.
- O’Brien, C., Keith, J., et L. Shoemaker. (2015). « Don’t Tell: Military Culture and Male Rape », Psychological Services, 12(4), pp. 357-365.
- O'Hara, J. 1998. « Rape in the military (Anglais seulement) ». Maclean's.
- Pritchard, T. 2016. « How the Cold War 'fruit machine' tried to determine gay from straight (Anglais seulement) », CBC News.
- Pugliese, D. 2021. « Gen. Vance to be investigated — concerns about allegations were known for years in military circles » (Anglais seulement), Ottawa Citizen.
- Romero, M. 2017. Introducing Intersectionality, Polity Press.
- Schein, E.H., et P. Schein. 2017. Organizational Culture and Leadership, 5e éd., Wiley & Sons, Inc.
- Scoppio, G. 2009. « Validation of Educational Programmes: Comparing Models and Best Practices1 », Dans Maclean R., et D. Wilson D. (éd.), International Handbook of Education for the Changing World of Work, Springer, Dordrecht.
- Scoppio, G. 2004. « Managing Diversity in Organizations: Are we up to the Challenge? The experience of the armed forces », International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, vol. 4.
- Scoppio, G., et L. Covell. 2016. « Mapping Trends in Pedagogical Approaches and Learning Technologies: Perspectives from the Canadian, International, and Military Education Contexts », Canadian Journal of Higher Education, Revue canadienne d’enseignement supérieur, Volume 46, no 2, pp. 127–147.
- Scoppio, G., Otis, N., Y. Yan et S. Hogenkamp. 2020. « Experiences of Officer Cadets in Canadian Military Colleges and Civilian Universities: A Gender Perspective » (Anglais seulement), Armed Forces & Society.
- Scoppio, G., Otis, N., et Y. Yan. 2018. « Looking at recruiting and selection for the Canadian Military Colleges through the lens of Gender Based Analysis Plus », Res Militaris, Revue européenne d’études militaires, vol. 8, no 1.
- Scoppio, G., et R. Schock. 2011. The Importance of Culture: Soft Skills for Interagency, Complex Operations , rapport technique, recherche entreprise par Recherche et développement pour la défense Canada, Kingston, Ontario : Institut du leadership des Forces canadiennes.
- Shepard Wong, M. 2006. « Supporting Diversity and Internationalization through Transformative Learning Experiences » [PDF, 79.5 Ko], The Forum on Public Policy.
- Stephenson, M. 2021. The West Block: March 14, 2021 | New allegations of sexual misconduct in Canada's military (Anglais seulement), Global News.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration [PDF, 789 Ko] (Anglais seulement). 2014. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services, Administration Office of Policy, Planning and Innovation.
- Sue, D.W. 2010. « Microaggressions: More Than Just Race. Can microaggressions be directed at women or gay people? », Psychology Today.