Rapport sur les résultats ministériels de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour 2023–2024 : Rapport sur les résultats ministériels
Sur cette page :
- Message du ministre
- Message de l’administrateur général
- Résultats – Nos réalisations
- Dépenses et ressources humaines
- Renseignements ministériels
- Tableaux de renseignements supplémentaires
- Dépenses fiscales fédérales
- Définitions
Message du Ministre
En tant que ministre responsable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), j’ai l’honneur de partager le rapport sur les résultats ministériels de l’AEIC pour l’exercice 2023–2024. Ce document indique les principales activités réalisées par l’AEIC tout au long de l’année dans le cadre de l’exécution des évaluations d’impact et de la promotion de la durabilité environnementale, de la réconciliation avec les peuples autochtones et de la prospérité économique pour tous.
L’exercice 2023–2024 a été à la fois difficile et déterminant. En octobre, la Cour suprême du Canada a fourni des directives et des éclaircissements importants sur la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) qui façonneront les évaluations d’impact pour les années à venir. La Cour a affirmé l’autorité du gouvernement du Canada de mettre en place une loi sur l’évaluation d’impact, a indiqué que la LEI devait se concentrer clairement sur les domaines de compétence fédérale et a mis l’accent sur la collaboration avec les provinces pour protéger l’environnement.
Aujourd’hui, plus que jamais, le Canada a besoin d’investissements importants et durables du secteur privé dans l’électricité propre, les minéraux essentiels, les transports et d’autres grands projets, à mesure que le Canada s’oriente vers une économie carboneutre. C’est pourquoi le gouvernement du Canada s’est empressé de donner suite à la décision de la Cour. Le gouvernement a entrepris un processus de consultation auprès des provinces, des groupes autochtones, de l’industrie et des associations professionnelles afin de déterminer et de proposer des modifications pour que la LEI puisse être modifiée de façon à respecter la décision de la Cour, et ce, le plus rapidement possible. Le gouvernement a également établi des mesures provisoires pour l’exécution des évaluations d’impact fédérales pendant cette période afin d’assurer la continuité et les orientations nécessaires pour les projets déjà en cours d’évaluation.
En tant que membre du Groupe de travail ministériel chargé de l’efficacité réglementaire des projets de croissance propre, je me réjouis de la contribution de l’AEIC dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour trouver des façons d’accroître l’efficience des évaluations d’impact, ainsi que des processus de réglementation et de délivrance de permis pour les grands projets, de façon à ce que le Canada puisse faire avancer les projets de croissance propre dont il a besoin.
Dans le même temps, le gouvernement du Canada reste déterminé à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Il s’agit notamment de continuer à offrir des possibilités de mobilisation et de participation significatives des populations autochtones dans le cadre du processus d’évaluation, et de respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le présent rapport résume les travaux préparatoires importants réalisés au cours du dernier exercice, qui nous permettront d’accroître notre capacité à protéger l’environnement et les droits des peuples autochtones, d’approfondir nos relations avec les peuples autochtones et les provinces afin que nous puissions véritablement travailler en partenariat pour protéger l’environnement, et d’offrir la certitude et la clarté dont les investisseurs ont besoin pour favoriser une économie carboneutre.
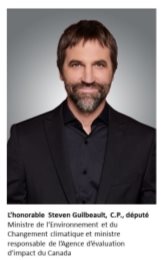
Message de l’administrateur général
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est fière de présenter son Rapport sur les résultats ministériels pour l’exercice 2023–2024, qui décrit de quelle façon l’AEIC a atteint ses principaux objectifs pour l’exercice.
Ce fut une année incroyable pour l’AEIC, et les compétences et la flexibilité du personnel ont été mises à l’honneur. Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), la jugeant partiellement inconstitutionnelle. Après que nos équipes eurent pleinement évalué les conséquences de la décision de la Cour, nous nous sommes empressés de proposer une voie à suivre pour le gouvernement et des solutions pour répondre aux préoccupations de la Cour. Nous avons mené des consultations avec les provinces, les groupes autochtones, l’industrie et les associations professionnelles. Le personnel de l’AEIC a travaillé rapidement et avec diligence pour élaborer les modifications proposées, afin qu’ils puissent être déposées au Parlement dans le cadre de la Loi d’exécution du budget au printemps 2024.
Mais ce n’est pas tout. Afin d’apporter un peu de clarté et de certitude aux projets déjà en cours d’évaluation, nous avons également élaboré des mesures provisoires pour bien administrer la LEI jusqu’à ce qu’une nouvelle loi soit adoptée. L’AEIC a donc fait progresser l’évaluation de nombreux projets tels que le projet de canaux de déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin, le projet de remise en état de Boat Harbour et le projet de jetée maritime sur l’île Tilbury, ce qui a permis de ne pas perdre de temps. Nous avons également fait progresser diverses évaluations régionales, notamment l’évaluation de la région du Cercle de feu en Ontario, une partie de la région du fleuve Saint-Laurent au Québec et l’évaluation de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans deux provinces de l’Atlantique.
Un esprit d’innovation et d’amélioration continue règne au sein de l’AEIC. Il n’est donc pas surprenant qu’elle se soit également mobilisée cette année pour trouver des façons d’accroître l’efficacité des évaluations d’impact et des processus de réglementation et de délivrance de permis dans le cas des grands projets, en soutenant collectivement le Groupe de travail ministériel chargé de l’efficacité réglementaire des projets de croissance propre. Dans le cadre de ces activités, l’AEIC cherche des façons d’améliorer la coordination avec les autorités fédérales afin que les évaluations puissent être réalisées et les permis délivrés en temps opportun et de manière efficace. À cette fin, l’AEIC a également apporté des améliorations à son Registre canadien d’évaluation d’impact afin que le public puisse accéder aux renseignements sur les projets et voir les échéanciers plus facilement.
Nous avons accompli des progrès considérables en matière de collaboration avec les peuples autochtones et de protection de leurs droits. Les peuples autochtones sont profondément attachés à leurs terres; c’est pourquoi l’AEIC intègre la réconciliation dans sa culture organisationnelle et cherche à améliorer son approche en matière de partenariat avec les peuples autochtones, notamment en maximisant le leadership autochtone dans le cadre des évaluations d’impact, et en respectant les systèmes de gouvernance et de savoir autochtones. À cette fin, nous avons également fait progresser notre propre cadre de réconciliation, collaboré avec divers gouvernements autochtones, notamment la Nation crie, la Nation Nisga’a et le Nunatsiavut, pour l’évaluation de projets, et fait avancer les travaux visant à élaborer des règlements qui permettant ententes de coadministration avec les instances autochtones afin que ces dernières puissent assumer les pouvoirs, les fonctions et les devoirs liés à l’évaluation des terres visées par les ententes.
Je suis extrêmement fier du rôle joué par l’AEIC pour aider à orienter les évaluations d’impact dans un climat d’incertitude. L’AEIC a contribué à offrir de la stabilité aux organisations autochtones, aux promoteurs et à divers groupes, tout en restant fidèle à ses engagements en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones, de la transparence, d’une mobilisation significative et de la réalisation d’évaluations rigoureuses en temps opportun. Le travail de base réalisé cette année permettra au Canada de procéder à des évaluations rapides, efficaces et significatives des grands projets dans les années à venir.

Résultats : Nos réalisations
Responsabilités essentielles et services internes
Responsabilités essentielles : évaluations d’impact
Dans la présente section
- Description
- Progrès à l’égard des résultats
- Principaux risques
- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
- Priorités pangouvernementales connexes
- Répertoire des programmes
Description
Pour favoriser la durabilité, l’AEIC entreprend des évaluations fédérales de grande qualité des projets proposés, fondées sur l’information scientifique et sur le savoir autochtone, afin d’évaluer les effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les répercussions sur les peuples et les droits des Autochtones. Ces évaluations éclairent les décisions du gouvernement quant à la question de savoir si les projets proposés sont dans l’intérêt public. L’AEIC mène des activités de promotion de la conformité et d’application de la Loi pour s’assurer que les promoteurs respectent la Loi, y compris les conditions énoncées dans les déclarations de décision.Note de bas de page 1
Progrès à l’égard des résultats
Cette section présente les mesures prises par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) pour atteindre les résultats et les cibles fixés pour l’évaluation d’impact. Les renseignements sont présentés par résultat ministériel.
Tableau 1 : Cibles et résultats de l’évaluation d’impact : Les projets désignés allant de l’avant favorisent la durabilité
Le tableau 1 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé au résultat ministériel 1.
Indicateurs de résultat ministériel |
Cible |
Date d’atteinte des cibles |
Résultats réels |
|---|---|---|---|
Pourcentage de projets pour lesquels les rapports indiquent que la grande majorité des mesures d’atténuation énoncées dans la déclaration de décision traitent efficacement les effets négatifs du projet |
90% |
Mars 2024 |
2021–2022 : Non disponible1 2022–2023 : Non disponible1 2023–2024 : 100 % |
1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021–2022 et 2022–2023, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023–2024 pour assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. |
|||
Tableau 2 : Cibles et résultats de l’évaluation d’impact : Les intervenants et les groupes autochtones participent de façon significative au processus d’évaluation
Le tableau 2 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé au résultat ministériel 2.
Indicateurs de résultat ministériel |
Cible |
Date d’atteinte des cibles |
Résultats réels |
|---|---|---|---|
Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones qui participent aux activités de mobilisation et de consultation liées à l’évaluation et qui conviennent qu’ils ont participé de façon significative au processus d’évaluation |
90% |
Mars 2024 |
2021–2022 : Non disponible1 2022–2023 : 78 % 2 2023–2024 : 88 % 3 |
1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021–2022, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023–2024 pour assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. 2 Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être collectés qu’en février 2023. Les résultats de 2022–2023 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne devrait être mise en œuvre qu’en 2024–2025. 3 Bien que l’objectif de 90 % n’ait pas été atteint, le résultat s’est amélioré de 10 % au cours de la deuxième année de suivi de cet indicateur. Les efforts se poursuivront pour améliorer encore ces résultats. Les résultats de 2023–2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne devrait être mise en œuvre qu’en 2024–2025. |
|||
Tableau 3 : Cibles et résultats de l’évaluation d’impact : De l’information scientifique et fondée sur des données probantes, ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, sont disponibles pour éclairer les processus d’évaluation de projet, y compris les rapports d’évaluation d’impact, les décisions et les conditions
Le tableau 3 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé aux au résultat ministériel 3.
Indicateurs de résultat ministériel |
Cible |
Date d’atteinte des cibles |
Résultats réels |
|---|---|---|---|
Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones qui conviennent que l’information scientifique et fondée sur des données probantes ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux sont accessibles |
60% |
Mars 2024 |
2021–2022 : Non disponible1 2022–2023 : 77 % 2 2023–2024 : 99 % 3 |
1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021–2022, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023–2024 pour assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. 2 Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être collectés qu’en février 2023. Les résultats de 2023–2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne devrait être mise en œuvre qu’en 2024–2025. 3 Les résultats de 2023–2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne devrait être mise en œuvre qu’en 2024–2025. |
|||
Tableau 4 : Cibles et résultats de l’évaluation d’impact : Les processus d’évaluation d’impact respectent les droits et la culture des peuples autochtones et l’engagement du Canada à établir des partenariats avec eux
Le tableau 4 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé au résultat ministériel 4.
Indicateurs de résultat ministériel |
Cible |
Date d’atteinte des cibles |
Résultats réels |
|---|---|---|---|
Pourcentage de groupes autochtones qui conviennent avoir une relation productive et collaborative avec l’AEIC |
Au moins 70 % |
Mars 2024 |
2021–2022 : Non disponible1 2022–2023 : Non disponible1 2023–2024 : Non disponible2 |
1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021–2022 et 2022–2023, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023–2024 pour assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. 2 Les résultats de l’indicateur ne sont pas disponibles pour 2023–2024, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne devrait être mise en œuvre qu’en 2024–2025. |
|||
Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada figurent dans l’InfoBase du GC.
Renseignements sur les résultats
La section suivante décrit les résultats de l’évaluation d’impact en 2023–2024 par rapport aux résultats prévus dans le Plan ministériel de l’AEIC pour l’année.
Résultat ministériel : Les projets désignés allant de l’avant favorisent la durabilité
Résultats obtenus
- À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) d’octobre 2023 sur la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), l’AEIC a soutenu le gouvernement dans l’élaboration des modifications proposées pour respecter la décision de la CSC. Parallèlement, le gouvernement a publié des orientations provisoires sur la LEI afin de garantir la clarté du processus pour les projets faisant déjà l’objet d’une évaluation, notamment pour les promoteurs, les partenaires autochtones, les investisseurs et le public jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications en juin 2024.
- Grâce à l’avancement continu des projets dans le cadre des orientations provisoires au cours du processus de modification, des décisions ont pu être prises en temps utile concernant des projets en cours, tels que le projet de jetée maritime sur l’île Tilbury, et pourront l’être.
- Le processus de modification de la LEI a fait l’objet d’une vaste consultation (83 réunions) avec les provinces, les groupes autochtones, l’industrie et les associations professionnelles. Les modifications de la LEI s’alignent sur la décision de la CSC, notamment en mettant l’accent sur la prise de décision dans les évaluations d’impact dans les domaines relevant clairement de la compétence fédérale. Les modifications augmentent également la flexibilité de la coopération avec d’autres instances en vue d’atteindre l’objectif « un projet, une évaluation » afin de soutenir un processus d’évaluation efficace et inclusif qui protège l’environnement.
- Le ministre et le gouverneur en conseil ont continué à bénéficier d’un soutien sous la forme de conseils rapides et pertinents afin d’éclairer les décisions relatives aux grands projets, comme le projet du Terminal 2 à Roberts Bank. En outre, un avis a été émis sur le projet aurifère Great Bear, indiquant qu’une évaluation d’impact était nécessaire, et un avis de commencement a été émis pour le projet de la route de raccordement du Nord. Il y a eu 53 évaluations de projet en 2023–2024, dont 37 évaluations dirigées par l’AEIC (13 évaluations environnementales et 24 évaluations d’impact) qui ont demandé une collaboration avec les autorités fédérales, une consultation des peuples autochtones et du public, y compris pendant la période d’orientation provisoire où les promoteurs ont pu continuer à faire progresser les évaluations sur une base volontaire.
- Dans le même temps, il a été établi que 60 % des projets (trois sur cinq) se trouvant à l’étape préparatoire du processus d’évaluation d’impact ne nécessitaient pas d’évaluation d’impact complète. Il s’agit du projet de centrale électrique Moraine, du projet de centrale électrique d’Aspen et du projet De Havilland Field, car ils ont un potentiel limité de répercussions négatives dans les domaines de compétence fédérale ou les effets seraient traités par d’autres cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants. En outre, aucune des 11 demandes de désignation n’a abouti à la désignation d’un projet par le ministre. Cinq d’entre elles étaient assujetties aux orientations provisoires, qui prévoyaient qu’aucun projet ne serait désigné avant l’adoption des modifications à la LEI.
- Les commissions d’examen indépendantes et les commissions d’examen intégrées ont continué à bénéficier d’un soutien. Pour les dernières, l’AEIC a collaboré avec les régulateurs du cycle de vie pour fournir un soutien technique et procédural; préparer des politiques, des cadres, des approches de consultation et des stratégies et remplir diverses fonctions administratives :
- Par exemple, pour faire avancer les priorités du gouvernement en matière de projets nucléaires (y compris celles des budgets 2023 et 2024), l’AEIC a collaboré avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour veiller à ce que les nouveaux projets nucléaires désignés dans le cadre de la LEI puissent progresser efficacement dans le processus d’évaluation d’impact. Par conséquent, les attentes et les délais ont été clarifiés pour les promoteurs, et l’AEIC et la CCSN sont prêtes à recevoir la première proposition de projet nucléaire.
- Afin de contribuer à une meilleure compréhension des effets cumulatifs et d’éclairer les évaluations de projet, l’AEIC a continué à effectuer des évaluations régionales, notamment l’évaluation régionale dans la région du Cercle de feu, grâce à laquelle l’AEIC a développé des relations avec les groupes autochtones concernés et a fait progresser le mandat de l’évaluation. En outre, l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse se sont poursuivies et la planification de l’évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent a progressé.
Type d’évaluation |
Nombre d’évaluations en cours reportées à 2023–2024 |
Nombre d’évaluations lancées en 2023–2024 |
Nombre d’évaluations achevées en 2023–2024 |
Nombre d’évaluations cessées en 2023–2024 |
Nombre d’évaluations se poursuivant en 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCEE 2012 |
|||||
Évaluations environnementales réalisées par l’AEIC |
13 |
Sans objet |
0 |
2 |
11 |
Évaluations environnementales réalisées par une commission d’examen |
4 |
Sans objet |
1 |
0 |
3 |
Évaluations environnementales de substitution |
6 |
Sans objet |
0 |
0 |
6 |
| LEI |
|||||
Évaluations d’impact réalisées par l’AEIC |
15 |
9 |
0 |
2 |
22 |
Évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen |
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
Évaluations d’impact de substitution |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Évaluations régionales |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Évaluations stratégiques |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Définitions : Évaluation environnementale réalisée par l’AEIC : évaluations environnementales réalisées par l’AEIC en tant qu’autorité responsable en vertu de la LCEE 2012. Évaluation d’impact réalisée par l’AEIC : évaluation des effets positifs et négatifs des projets désignés sur l’environnement, l’économie, la santé et la société. Elle comprend cinq phases : l’étape préparatoire, l’étude d’impact, l’évaluation d’impact, la prise de décision et la postdécision. Commission d’examen : évaluations environnementales ou évaluations d’impact menées par un groupe d’experts indépendants nommés par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (LCEE 2012) ou le président de l’AEIC (LEI) et soutenus par l’AEIC. Évaluations environnementales de substitution : processus provincial d’évaluation environnementale ou d’évaluation d’impact pouvant remplacer une évaluation environnementale fédérale ou une évaluation d’impact fédérale. Évaluation régionale : évaluation qui examine les effets d’activités concrètes existantes ou futures menées dans une région. Évaluation stratégique : évaluation qui examine les politiques, les plans ou les programmes existants ou proposés du gouvernement du Canada et qui sont pertinents à l’évaluation d’impact. Les évaluations stratégiques peuvent également se concentrer sur des sujets pertinents à une évaluation d’impact. |
|||||
- Afin d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation d’impact, de réglementation et de délivrance de permis pour les grands projets et de faire progresser les projets de croissance propre au Canada, le budget 2023 comportait l’annonce de la création du Groupe de travail ministériel chargé de l’efficacité réglementaire des projets de croissance propre. L’AEIC a soutenu ce groupe de travail en déterminant des moyens de rendre ces processus plus transparents et prévisibles, et d’accélérer les possibilités de produire l’énergie propre nécessaire pour alimenter notre économie carboneutre. En s’appuyant sur la collaboration interministérielle, l’AEIC a fourni des conseils au groupe de travail sur des questions liées aux sujets suivants :
- coordination des processus fédéraux de réglementation et de délivrance de permis;
- collaboration et coordination avec d’autres instances;
- clarification et réduction des délais;
- amélioration de l’efficacité du système réglementaire.
- En 2023–2024, l’AEIC a également dirigé des projets pilotes de coordination de la délivrance des permis afin de faire l’essai des approches visant à accroître la coordination réglementaire entre les ministères fédéraux et l’intégration des processus réglementaires pour les projets désignés.
Résultat ministériel : Les intervenants et les groupes autochtones participent de façon significative au processus d’évaluation
Résultats obtenus
- Pour soutenir une consultation et une participation significatives des peuples autochtones et du public dans les processus d’évaluation, virtuellement ou en personne, l’AEIC a offert des occasions de participation accessibles et inclusives et elle a fourni de l’aide financière pour soutenir la participation et le renforcement des capacités. Par exemple :
- des campagnes publicitaires géo-ciblées dans les médias ont été utilisées pour informer les personnes les plus concernées par les projets des mises à jour de l’évaluation de projet et des possibilités de participer à des séances de consultation, comme dans le cas du projet aurifère Great Bear;
- les outils du Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) ont été utilisés pour soutenir les possibilités de consultation des populations autochtones;
- les obligations découlant de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (Convention Espoo) ont été maintenues afin de faire participer les instances internationales (p. ex. la consultation sur le projet d’agrandissement du terminal maritime de Cooper Cove);
- les résultats du sondage de suivi de l’AEIC concernant la mobilisation du public et les séances de consultation suggèrent que le public a été en mesure de participer de manière significative. Par exemple, 94 % des répondants ont convenu qu’ils disposaient de l’information nécessaire pour participer de manière significative; 87 % ont indiqué qu’ils avaient eu la possibilité d’apporter leur contribution et 77 % ont estimé que leurs questions avaient reçu des réponses suffisantes.
- Grâce à ses programmes de financement, l’AEIC a réduit les obstacles financiers et facilité la participation à des séances de consultation et de mobilisation en personne et virtuelles pour aider à élaborer des rapports, obtenir des commentaires sur des documents liés à l’évaluation et soutenir la participation de groupes autochtones à des activités postérieures à la prise de décision :
- Par l’intermédiaire du Programme d’aide financière aux participants (PAFP), 4,47 millions de dollars ont été dépensés pour faciliter la participation du public et des populations autochtones au processus d’évaluation des projets. Ce montant comprend 1 million de dollars de subventions accordées à 114 bénéficiaires uniques pour participer à 28 processus d’évaluation de projet, et 3,47 millions de dollars de contributions accordées à 44 bénéficiaires de contributions pour participer à 14 processus d’évaluation d’impact. En outre, 1,19 million de dollars, pour soutenir les participants aux évaluations régionales, dont 190 000 dollars de subventions à 11 bénéficiaires uniques pour soutenir la participation à deux évaluations régionales et 1 million de dollars de contributions à 30 bénéficiaires uniques pour soutenir la participation à cinq processus d’évaluation régionale.
- L’AEIC a dépensé 12,63 millions de dollars en financement de contribution pour 63 bénéficiaires uniques dans le cadre du Programme de soutien des capacités autochtones (PSCA) afin d’accroître la capacité des groupes et des organisations à but non lucratif autochtones à participer et à collaborer de manière significative aux activités de consultation liées aux évaluations d’impact.
- Le Programme de dialogue sur les politiques (PDP) a dépensé un total de 2,55 millions de dollars pour soutenir la participation du public et des peuples autochtones à l’élaboration de politiques, de directives, de méthodologies, d’outils et de pratiques liés aux évaluations. Ce montant comprend 520 000 dollars de subventions accordées à 17 bénéficiaires uniques et 2,03 millions de dollars de contributions accordées à 65 bénéficiaires uniques. Le PDP a également facilité les discussions avec le Comité consultatif technique des sciences et des connaissances, le Comité consultatif autochtone et le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact.
- En outre, l’AEIC a parrainé et a participé à la conférence annuelle de la Conférence sur la coalition des grands projets des Premières Nations, qui a rassemblé des peuples autochtones, des chefs d’entreprise, des institutions financières et des partenaires provinciaux pour discuter de l’importance du consentement et de la maximisation du leadership autochtone dans les évaluations d’impact. Un soutien a également été apporté à la conférence annuelle du Programme de soutien des capacités autochtones, lequel favorise une meilleure collaboration entre les groupes autochtones et les bénéficiaires du PSCA.
- Tout au long de l’année, des consultations efficaces ont été menées avec plus de 60 partenaires des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des Traités modernes sur les modifications proposées à l’AEIC. Grâce à ces consultations, les relations avec les partenaires autochtones ont continué à se construire, ce qui contribuera à soutenir les futurs efforts de collaboration entre l’AEIC et les peuples autochtones.
- De même, des solutions de co-développement avec des partenaires autochtones devraient permettre d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation. Notamment, ce qui suit :
- élaboration conjointe du mandat pour l’évaluation régionale dans la zone du Cercle de feu avec les Premières Nations concernées;
- soutien des négociations et la mise en œuvre des traités modernes en Colombie-Britannique, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador;
- assurance de la participation effective de la nation Saugeen Ojibway aux projets non désignés sur les terres fédérales de l’Ontario;
- collaboration avec la Première Nation Tsawwassen pour aligner ses aspirations en matière d’intendance sur l’évaluation des grands projets sur son territoire.
Résultat ministériel : De l’information scientifique et fondée sur des données probantes, ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, sont disponibles pour éclairer les processus d’évaluation de projet, y compris les rapports d’évaluation d’impact, les décisions et les conditions
Résultats obtenus
- En tant que chef de file pour les évaluations d’impact fédérales, l’AEIC a collaboré avec les autorités fédérales pour veiller à ce que les preuves scientifiques soient intégrées dans les évaluations de la manière suivante :
- En facilitant l’élaboration de la documentation pour soutenir une étape préparatoire plus rapide et plus efficace afin de déterminer si une évaluation d’impact complète est nécessaire;
- En préparant des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact qui sont propres au projet afin de refléter les questions clés identifiées lors de l’étape préparatoire; d’identifier les éléments à prendre en compte au cours de l’évaluation et les renseignements requis de la part du promoteur pour que l’étude d’impact soit acceptable;
- En fournissant des orientations aux autorités responsables en ce qui concerne :
- les effets des projets sur le territoire domanial et à l’étranger qui ne sont pas des projets désignés et la mesure dans laquelle ces effets sont importants pour aider les autorités à remplir leurs obligations de déterminer les effets environnementaux d’un projet en vertu des articles 81 à 91 de la LEI;
- la façon dont les documents qui sont produits tout au long du processus d’évaluation éclaireront le processus décisionnel.
- Le Programme de recherche de l’AEIC a versé 600 000 dollars en subventions à 9 bénéficiaires uniques pour mener des recherches novatrices à partager avec le public, notamment en soutenant les projets suivants :
- la création du Réseau GiiiA (de l’anglais Gender-Based Indigenous Intersectional Impact Assessment), dirigé par l’Institut canadien de recherche sur les femmes (ICREF) et le centre de recherche Live Work Well de l’Université de Guelph. L’objectif de ce réseau est d’échanger des connaissances et de développer des outils sur les pratiques exemplaires ainsi que des stratégies pour inclure l’ACS Plus et l’ACS Plus sous l’optique autochtone dans l’évaluation d’impact;
- l’organisation d’un institut interactif, accueilli par l’Université de Guelph, qui s’est concentré sur le renforcement des capacités en vue de développer une approche autochtone de l’évaluation des risques pour la santé environnementale.
- La transparence du régime fédéral d’évaluation d’impact a été renforcée grâce aux améliorations apportées au Registre canadien d’évaluation d’impact, une plateforme en ligne qui permet au public d’accéder à des renseignements sur toutes les évaluations fédérales et qui facilite la tâche des Canadiens qui souhaitent en savoir plus ou soumettre des commentaires sur une évaluation :
- en 2023–2024, des renseignements ont été publiés dans le Registre sur plus de 1 200 évaluations (y compris des évaluations de projet, des évaluations régionales, des évaluations stratégiques et des évaluations sur le territoire domanial et à l’étranger).
- des améliorations ont été apportées au Registre en 2023–2024 afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs :
- en concevant et mettant en œuvre un tableau de bord interactif qui présente l’état d’avancement des projets et donne accès à des données clés, comme les échéanciers, les documents clés et les renseignements sur les permis et autorisations fédéraux qui peuvent être nécessaires, afin d’aider les utilisateurs à rester mieux informés;
- en faisant progresser le développement d’un système de notification par abonnement afin de fournir aux abonnés des mises à jour sur les projets, au fur et à mesure qu’elles se produisent. Il s’agissait notamment d’élaborer des validations de concept pour mettre en œuvre une application mobile qui aide l’AEIC à accroître ses outils en ligne et sa portée auprès du public.
- Afin de contribuer à une meilleure compréhension des effets cumulatifs et d’éclairer les évaluations de projets, tous les documents relatifs aux évaluations régionales et aux évaluations stratégiques sont également mis à la disposition du public par l’intermédiaire du Registre. Les nouvelles politiques et orientations élaborées par l’AEIC concernant les évaluations régionales et les évaluations stratégiques sont également communiquées à d’autres instances et autorités fédérales, et sont disponibles sur le site Web de l’AEIC.
Résultat ministériel : Les processus d’évaluation d’impact respectent les droits et la culture des peuples autochtones et l’engagement du Canada à établir des partenariats avec eux
Résultats obtenus
- L’AEIC a démontré son engagement à faire progresser la réconciliation dans le cadre de la réalisation des évaluations d’impact, ce qui inclut le respect des engagements pris sur la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies) et des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il s’agissait notamment d’aller au-delà du respect de l’obligation de consultation et des obligations constitutionnelles liées aux droits des peuples autochtones et aux droits issus des traités en mobilisant et en consultant de manière significative plus de 300 collectivités autochtones à travers le Canada.
- Pour mieux garantir le respect des droits et de la culture des peuples autochtones, l’AEIC a élaboré un Cadre de réconciliation qui a renforcé notre approche du partenariat avec les peuples autochtones en maximisant le leadership autochtone dans les évaluations d’impact, notamment en respectant les systèmes de gouvernance et de connaissances autochtones. Ce cadre n’intègre pas seulement la réconciliation dans notre culture organisationnelle, notamment en élaborant des pratiques d’éducation, de sensibilisation et d’inclusion avec les employés. Il appelle également à des actions tournées vers l’extérieur, comme l’établissement et le renforcement de partenariats significatifs avec des organisations autochtones pour faciliter l’échange de connaissances et d’informations sur les questions et les priorités liées à l’évaluation d’impact.
- Grâce à la collaboration entre l’AEIC et les partenaires autochtones, les travaux ont progressé sur un cadre politique et réglementaire pour les ententes de coadministration autochtones, par lesquels les corps dirigeants autochtones seront habilités à assumer les attributions liées aux évaluations d’impact sur les terres spécifiées dans ces ententes.
- L’AEIC a également collaboré avec le gouvernement de la Nation crie pour mettre à jour la Convention de la Baie James et du Nord québécois afin d’y inclure des dispositions relatives à la collaboration à toutes les étapes d’un processus d’examen par une commission, ce qui permettra de mieux intégrer les connaissances et les perspectives autochtones tout au long de ces évaluations, y compris dans la prise de décision.
- En 2023–2024, l’AEIC a démontré sa volonté de faire progresser les partenariats avec les peuples autochtones et d’établir des relations de collaboration avec les partenaires autochtones, ce qui est important pour s’assurer que les connaissances et les perspectives autochtones sont intégrées dans les évaluations afin que leurs droits et leurs cultures puissent être respectés. Il s’agit notamment de veiller à ce que la collaboration avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits et les partenaires des traités modernes soit intégrée dans les processus d’évaluation, par exemple :
- le projet de nouvel aéroport de Nain et le projet minier de Strange Lake, pour lesquels l’étape préparatoire comprenait une collaboration avec le gouvernement du Nunatsiavut afin de faciliter l’inclusion des perspectives autochtones dès le début du processus d’évaluation;
- le projet de la route de raccordement du Nord et le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy, dans lesquels les documents d’évaluation – comme les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact – ont intégré les commentaires des groupes autochtones potentiellement concernés tout en se concentrant sur les effets relevant de la compétence fédérale;
- le projet nickélifère Crawford, dans le cadre duquel l’AEIC a élaboré, en collaboration avec des groupes autochtones susceptibles d’être touchés, un mandat pour la création d’un groupe de travail technique chargé de discuter des principaux effets négatifs du projet afin d’éclairer l’étude d’impact du promoteur;
- le projet minier Troilus, où l’AEIC a aidé le promoteur à collaborer avec le gouvernement de la Nation Crie lors de la réalisation de leurs études d’impact, ce qui permettra de tenir compte des préoccupations soulevées par les peuples autochtones concernant les effets négatifs potentiels du projet et de définir des approches visant à les réduire au minimum;
- le projet de GNL Woodfibre, où l’AEIC a travaillé en collaboration avec la Nation Squamish pour traiter les changements dans la conduite de l’évaluation du projet, tout en respectant, dans une approche coopérative, le processus de chaque partie concernant les modifications potentielles des certificats et de la déclaration de décision;
- le projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime Ksi Lisims LNG pour lequel l’AEIC a collaboré avec la Nation Nisga’a, promoteur du projet et nation signataire d’un traité moderne, sur un chapitre spécifique décrivant les effets environnementaux, économiques, sociaux et culturels potentiels sur les résidents et les intérêts de ce peuple. Ce chapitre éclairera les processus décisionnels provincial et fédéral dans le contexte des effets du projet sur la Nation Nisga’a après la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
- De même, dans la région du Cercle de feu – une zone importante pour l’exploitation de minéraux critiques – l’AEIC a travaillé avec plusieurs collectivités de Premières Nations dans le Nord de l’Ontario pour créer un groupe de travail et des équipes spéciales afin de faire progresser le co-développement de l’évaluation régionale dans cette région.
- Par ailleurs, le comité indépendant chargé de l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador comprend des représentants des communautés autochtones. Dans le cadre de cette évaluation régionale et de l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse, le mandat des évaluations a été élaboré à la suite de consultations et d’accommodements avec les peuples autochtones afin de garantir la prise en compte du savoir autochtone.
Principaux risques
Principaux risques |
Stratégies d’atténuation |
|---|---|
Fluctuation de l’activité économique et des prix des matières premières L’AEIC fonctionne dans un environnement en constante évolution influencé par des facteurs extérieurs, y compris les effets évolutifs des changements climatiques. En particulier, les facteurs économiques affectent le type, le volume et la distribution des projets qui nécessiteront des évaluations, y compris la distribution régionale. |
L’AEIC a toujours entretenu des relations proactives avec les promoteurs afin d’obtenir des indications en amont sur les projets potentiels afin que le volume des projets puisse être prévu et que des ajustements soient apportés à son plan de travail. L’AEIC continuera d’entretenir ces relations afin de gérer et de planifier sa charge de travail. L’AEIC continuera de réaffecter des ressources, lorsque cela est possible et nécessaire, pour faire face aux fluctuations du volume des projets. |
Dépendance à l’égard de la performance de l’économie à l’échelle nationale et internationale, et reprise à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19 L’exécution efficace du mandat de l’AEIC est directement liée au rendement de l’économie à l’échelle nationale et mondiale, qui a affecté les opérations de l’AEIC (y compris la capacité des intervenants et des peuples autochtones à participer aux processus en lien avec la LEI). Cela devient particulièrement important au moment où le Canada entre dans la période de reprise post-COVID-19. |
L’AEIC continue de surveiller les effets liés aux dépenses et apporte des ajustements au besoin en ce qui concerne les dépenses liées aux catégories d’activités de la fonction publique comme les voyages, les retards dans les grands projets d’immobilisations, l’annulation de contrats, les retards dans la dotation prévue, etc. |
Consultations de la Couronne et participations autochtones inadéquates ou inefficaces Pour être efficaces, la consultation, la mobilisation, et le partenariat avec les peuples autochtones requièrent la participation significative des peuples ou organisations autochtones potentiellement concernés, ainsi que d’autres autorités, car les mesures proposées pour éviter ou minimiser les répercussions potentielles sur les peuples autochtones peuvent relever de leurs domaines de compétence. Cela comprend la création de conditions propices à une participation et à une consultation significatives. Pour s’acquitter de son obligation fédérale de consulter, l’AEIC agit à titre de coordonnatrice des consultations de la Couronne pour les projets désignés assujettis aux évaluations d’impact fédérales. Pour les évaluations menées par des commissions d’examen intégré qui portent sur des projets d’infrastructure énergétique proposés et qui constituent des projets désignés, les consultations de la Couronne seront menées conjointement par l’AEIC, la Régie de l’énergie du Canada ou par l’AEIC la CCSN. |
En vertu de la LEI, l’AEIC joue le rôle de coordinateur des consultations de la Couronne pour les projets désignés soumis à une évaluation d’impact fédérale afin d’assurer une mise en œuvre améliorée et plus cohérente de la LEI. Ce rôle a permis à l’AEIC d’être mieux placée pour mettre en œuvre les changements et partager les informations dans l’ensemble du système d’évaluation d’impact par l’intermédiaire des comités d’évaluation d’impact des sous-ministres adjoints et des sous-ministres. Bien que les pratiques actuelles de l’AEIC se soient avérées efficaces pour répondre à l’obligation de consultation de la Couronne, cette expérience doit s’amplifier et permettre à l’AEIC de s’adapter en permanence aux attentes et aux exigences accrues liées à la consultation, y compris l’évolution de l’environnement public et juridique, et les intérêts complexes des groupes autochtones. L’augmentation des ressources annoncée pour l’AEIC dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 assurera sa capacité à s’adapter à l’incertitude tout en continuant à améliorer la mobilisation des peuples autochtones afin que leurs préoccupations continuent d’être entendues et prises en compte tout au long du processus d’évaluation d’impact. Le Programme de dialogue sur les politiques contribue à atténuer ce risque en permettant aux peuples autochtones de participer à la définition de politiques et des orientations, par le biais d’une mobilisation ou d’une co-élaboration, qui façonnent la manière dont les évaluations sont menées, créant ainsi des processus qui répondent mieux à leurs préoccupations et à leurs besoins particuliers. Le succès de la mobilisation dépend de la coopération entre les autorités fédérales et de leur soutien. Un soutien adéquat au sein de ces autorités et de la part de celles-ci est la clé d’une consultation réussie. De plus, le Programme d’aide financière aux participants,(PAFP) qui couvre une partie des coûts engagés par les bénéficiaires autochtones, réduit les obstacles financiers à leur participation aux consultations sur les projets désignés. |
Manque de capacité technique des peuples autochtones pour participer aux évaluations et aux consultations de la Couronne Pour que les peuples autochtones puissent participer de manière significative aux processus d’évaluation et aux activités de consultation de la Couronne, ils doivent avoir la capacité de le faire. Cela signifie qu’il faut s’assurer qu’ils ont le soutien (y compris l’aide financière) les connaissances, l’information, les compétences et les capacités nécessaires pour participer, et que les possibilités sont accessibles et disponibles pour les peuples autochtones. |
Le PAFP couvre une partie des coûts encourus par les bénéficiaires autochtones pour participer aux évaluations et contribuera à réduire les obstacles financiers à leur participation aux consultations. De plus, le Programme de soutien des capacités autochtones de l’AEIC fournit de l’aide financière aux collectivités et aux organisations autochtones, en dehors du contexte des évaluations de projets spécifiques, pour appuyer le renforcement des capacités dans les collectivités autochtones afin qu’elles puissent mieux participer aux évaluations actuelles et futures. En plus d’accorder de l’aide financière, l’AEIC s’efforce de veiller à ce que les groupes autochtones aient la capacité de participer aux processus d’évaluation et aux consultations de la Couronne par divers moyens, par exemple :
|
Chevauchement des efforts en raison du partage des responsabilités En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, la gestion de l’environnement est un domaine de responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par conséquent, certains projets peuvent nécessiter une évaluation à la fois fédérale et provinciale. |
L’AEIC vise à renforcer la collaboration avec les provinces et les territoires par des approches coopératives afin de permettre une meilleure coordination, de réduire les chevauchements et d’harmoniser les échéances et les processus d’évaluation 1. Ces processus réduisent les doubles emplois et sont conformes aux objectifs de la LEI. |
Non-conformité aux conditions Les déclarations de décision comportent des conditions claires, mesurables et applicables, y compris des mesures d’atténuation et des exigences de suivi auxquelles les promoteurs doivent se conformer. À cela s’ajoute un manque potentiel de capacité à déterminer la nécessité d’une gestion adaptative ou de mesures de rechange si les mesures d’atténuation ne fonctionnent pas comme prévu ou sont impossibles à mettre en œuvre. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités liées à la capacité de l’AEIC à contrôler la conformité en raison des restrictions et des précautions associées aux inspections en personne. |
Comme indiqué dans sa Politique de promotion de la conformité et d’application pour les projets désignés, le programme de conformité et d’application de l’AEIC promeut et vérifie la conformité et détermine les réponses appropriées aux situations de non-conformité. La pandémie de COVID-19 a incité l’AEIC à évaluer de nouvelles approches en matière de vérification de la conformité, notamment l’utilisation de drones, de technologies de télédétection (par exemple, l’utilisation de l’imagerie satellite) et de l’intelligence artificielle. La faisabilité du déploiement de l’intelligence artificielle pour les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi est envisagée pour les prochaines années. Veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement définis entre l’AEIC et les autres autorités fédérales, y compris les exigences prévisibles en matière de mobilisation des autorités fédérales après la prise de décision, contribuera également à atténuer ce risque. |
Ne pas atteindre les objectifs ou les résultats attendus en raison de la nature horizontale de l’initiative De nombreux aspects et étapes du processus d’évaluation d’impact nécessitent une collaboration et une coordination entre les ministères et les organismes fédéraux, avec d’autres instances et des parties externes. Par exemple, pour l’évaluation d’un projet, les ministères ou les organismes doivent fournir des conseils d’experts à l’AEIC afin d’orienter son rapport ultérieur. |
L’AEIC préside les comités d’évaluation d’impact des sous-ministres adjoints et des sous-ministres, qui assurent la surveillance et la gestion de la mise en œuvre de la LEI, notamment la surveillance de la mise en œuvre et des résultats. L’AEIC continuera de collaborer avec les ministères et organismes concernés pour améliorer la mise en œuvre, au besoin, en fonction de la surveillance continue et des rapports, ainsi que de l’évaluation périodique. De plus, l’AEIC a des protocoles d’entente (PE) avec de nombreuses autorités fédérales qui clarifient les attentes et les processus. Tous les protocoles d’entente continueront d’être mis en œuvre et seront réexaminés et révisés, le cas échéant. Dans le cadre de projets particuliers, l’AEIC élabore également des plans de travail propres à chaque étape du processus d’EI, ce qui accroît la compréhension collective des livrables et des échéanciers prévus. |
Ne pas répondre aux attentes des peuples autochtones et des intervenants L’évaluation d’impact recoupe les intérêts de nombreuses parties, notamment les peuples autochtones, les provinces et les territoires, l’industrie, les groupes de défense de l’environnement et le public. La mise en œuvre de la LEI en août 2019 a considérablement fait augmenter les attentes en ce qui a trait aux résultats du processus d’évaluation d’impact. En ce qui concerne les peuples autochtones, la Déclaration des Nations Unies a introduit de nouvelles attentes, notamment des appels à la mise en œuvre du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) dans les politiques et pratiques fédérales. Les peuples autochtones ont des attentes élevées en ce qui concerne leur participation à la prise de décision en matière d’évaluation d’impact et leur partenariat pendant le processus d’évaluation d’impact. Ils s’attendent à ce que leurs droits et leurs territoires traditionnels soient protégés et ont des attentes élevées en ce qui concerne les engagements du gouvernement en faveur de la réconciliation et de l’application de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies. Les provinces et les territoires attendent des processus d’évaluation d’impact qu’ils respectent leurs compétences. Ils attendent une approche de type « un projet, une évaluation » qui évite les doubles emplois. L’industrie attend un processus rapide et prévisible. Les groupes de défense de l’environnement veulent un processus qui favorise la durabilité, et le public veut un processus transparent et digne de confiance. |
L’approche adoptée pour la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact a été élaborée en collaboration avec les intervenants et les peuples autochtones, ce qui atténue ce risque. L’AEIC continuera à travailler avec les intervenants et les peuples autochtones tout au long de la mise en œuvre des processus d’évaluation d’impact afin de s’assurer que l’approche adoptée répond aux besoins des intervenants et des peuples autochtones. La LEI a constitué des organismes consultatifs (c.-à-d. le Comité consultatif autochtone, le Comité consultatif technique et le Conseil consultatif du ministre) pour recueillir les commentaires des intervenants et des peuples autochtones pendant les processus d’évaluation d’impact. L’AEIC continuera de tenir compte des conseils de ces organismes afin d’améliorer et d’adapter les processus. L’approche d’évaluation d’impact est exhaustive, horizontale et multidimensionnelle. Elle comprend des éléments qui répondent à des critiques précises du précédent processus d’évaluation environnementale, notamment :
|
Exposition, perte ou dommage résultant de menaces liées à la cybersécurité La mise en œuvre de la LEI comprend l’utilisation de multiples systèmes en ligne, notamment le Registre, les réseaux, les serveurs et d’autres applications de l’AEIC. Compte tenu de l’importance de ce travail, le risque lié aux menaces de cybersécurité exige de la vigilance pour protéger les systèmes afin d’assurer la mise en œuvre efficiente et efficace des processus d’évaluation et la disponibilité des informations relatives aux évaluations et aux effets cumulatifs. |
L’AEIC a mis en place des programmes et des procédures pour rester vigilante et répondre aux menaces de cybersécurité le plus rapidement possible. De plus, l’AEIC a accru la capacité en cybersécurité de ses équipes de gestion de l’information et de technologie de l’information afin d’être mieux à même de surveiller et d’atténuer ces menaces de manière efficace si et quand cela est nécessaire et d’y répondre. |
1 À la suite de la décision de la CSC d’octobre 2023, des modifications à la LEI ont été déterminées et sont entrées en vigueur en juin 2024. Ces modifications renforcent la dépendance à l’égard des procédures provinciales et la flexibilité de la coopération avec les provinces. Par exemple, au cours de l’étape préparatoire, lorsqu’il s’agit de déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire, l’AEIC doit désormais tenir compte de la mesure dans laquelle un processus d’évaluation provincial traitera des effets relevant de la compétence fédérale. De plus, les modifications apportées aux dispositions relatives à la substitution (qui permettent de confier l’ensemble de l’évaluation à une autre instance) permettent désormais une évaluation harmonisée, dans laquelle le gouvernement du Canada et une autre instance peuvent déterminer ensemble la manière dont l’évaluation sera menée, en utilisant les domaines d’expertise et l’autorité de chaque instance pour des éléments particuliers de l’évaluation – tout en conservant la prise de décision finale au sein de chaque instance. Cela s’ajoute aux outils existants dans la LEI (p. ex. la délégation de certains éléments d’une évaluation aux provinces). |
|
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 7 : Aperçu des ressources requises pour l’évaluation d’impact
Le tableau 7 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.
Ressources |
Prévues |
Réelles |
|---|---|---|
Dépenses |
79 474 598 $ |
78 642 540 $ |
Équivalents temps plein |
427 |
401 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes de l’AEIC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Priorités pangouvernementales connexes
Analyse comparative entre les sexes plus
L’AEIC a intégré l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) dans ses travaux afin d’améliorer les possibilités et les mécanismes de participation du public et des populations autochtones aux évaluations. Il s’agissait notamment d’adapter les activités de mobilisation en fonction des besoins de divers groupes de personnes et de sonder la liste des membres actuels de la commission d’examen afin de mieux comprendre les caractéristiques de ces membres en termes d’équité, de diversité et d’inclusion, et d’analyser qui sont ceux qui deviennent membres de la commission d’examen et comment ils le deviennent. En 2023–2024, l’AEIC a également fait progresser l’inclusion de l’ACS Plus dans les processus d’évaluation en menant une analyse d’identification des intervenants et en incluant les groupes sous-représentés dans la promotion des occasions de mobilisation.
Afin de garantir que les décisions prises par le gouverneur en conseil s’appuient sur des renseignements qui tiennent compte des incidences potentielles sur divers groupes de Canadiens, l’ACS Plus a été réalisée pour toutes les présentations et tous les mémoires au cabinet que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a soumis au gouverneur en conseil. En outre, en suivant le guide L’analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact et l’Outil – Évaluation de la qualité d’une ACS Plus dans l’étude d’impact de l’AEIC, cette dernière et les promoteurs de projets ont intégré l’ACS Plus dans des documents clés relevant de leurs responsabilités respectives tout au long du processus d’évaluation d’impact. Par conséquent, les décisions prises tout au long du processus d’évaluation, y compris lors de la phase de prise de décision, sont fondées sur des renseignements qui tiennent compte des incidences sur divers groupes.
Pour s’assurer que le savoir autochtone est pris en compte dans l’évaluation des projets, l’AEIC a intégré les conseils d’experts et les commentaires des Keepers of the Circle, un centre urbain autochtone géré par le Temiskaming Native Women’s Support Group, et des collectivités autochtones sur la sécurité des femmes autochtones. L’AEIC a également collaboré avec Femmes et Égalité des genres Canada, l’autorité fédérale experte en matière d’ACS Plus et partenaire de la mise en œuvre de la LEI, afin d’intégrer leurs conseils d’experts dans son analyse et ses rétroactions aux promoteurs.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et objectifs de développement durable
Par son mandat et ses opérations quotidiennes, l’AEIC a soutenu quatre objectifs de développement durable (ODD) : ODD 10 – Réduction des inégalités, ODD 12 – Consommation et production responsables, ODD 13 – Action pour le climat et ODD 16 – Paix, justice et institutions fortes.
Pour contribuer aux engagements liés à la réduction des inégalités (ODD 10), l’AEIC a collaboré avec des partenaires autochtones pour déterminer la manière dont les groupes autochtones souhaitaient participer aux processus d’évaluation et travailler avec l’AEIC.
À l’appui de ses engagements visant à promouvoir un système judiciaire équitable et accessible, à faire respecter les lois environnementales et à gérer les impacts (ODD 16), l’AEIC a élaboré de nouvelles méthodes et approches pour identifier et faire participer les membres des groupes généralement sous-représentés aux séances d’information et de consultation pendant les processus d’évaluation. Par exemple :
- L’AEIC a soutenu l’Association québécoise pour l’évaluation d’impact (AQÉI) dans sa demande de financement pour son projet « Mieux communiquer les études d’impact », une initiative collaborative qui vise à éliminer les obstacles à une meilleure compréhension des études d’impact et à aider les participants à s’engager dans des évaluations d’impact.
- En tant que membre de la délégation canadienne à la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ) des Nations Unies, l’AEIC a encouragé un processus d’évaluation d’impact sur l’environnement qui tienne compte de l’avis des peuples autochtones et des collectivités locales, et qui soutienne une prise de décision éclairée sur les activités menées dans les zones marines situées au-delà de la juridiction nationale.
- Partenariat avec la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg pour présenter leurs travaux sur « l’opérationnalisation d’une approche consensuelle par le biais de l’évaluation environnementale » lors d’une séance sur le leadership autochtone en matière d’évaluation d’impact lors de la conférence de l’International Association for Impact Assessment (Kuching, Malaisie, mai 2023).
Plus de renseignements sur l’apport de l’AEIC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable. Cela inclut les actions entreprises pour soutenir les ODD 12 et 13.
Innovation
En 2023–2024, l’AEIC a mis en œuvre une initiative, dirigée par une équipe spéciale sur la simplification et l’efficacité, afin de rendre les processus internes plus efficaces et de créer une culture d’amélioration continue. Cette équipe spéciale a permis à l’AEIC de :
- faciliter l’accès de ses employés aux documents relatifs à l’évaluation d’impact (p. ex. les modèles, les orientations, les ressources relatives à la consultation des populations autochtones) grâce à un guichet unique sur son intranet;
- réduire d’environ 30 % les niveaux d’approbation pour les produits de communication et les étapes du projet, et d’environ 50 % pour la période de consultation post-décisionnelle et la disponibilité des fonds;
- lancer une étude visant à améliorer l’efficacité ses procédures d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
De plus, en réponse aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones et le public, et à la demande du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’AEIC a mené une étude sur les conséquences potentielles – dans les domaines de compétence fédérale – de la décision prise par le gouvernement de l’Ontario en décembre 2022 de supprimer les protections de conservation des terres de la ceinture verte de l’Ontario. Il s’agissait notamment de travailler en collaboration avec Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada et des groupes autochtones pour examiner les effets potentiels, y compris les effets cumulatifs, d’un éventuel développement futur des terres situées à proximité du parc urbain national de la Rouge sur l’intégrité écologique du parc et sa capacité à atteindre ses objectifs de gestion, à savoir :
- la protection de la biodiversité et des ressources et processus naturels;
- la connectivité écologique dans l’ensemble du parc et avec les zones naturelles adjacentes;
- le maintien des relations de travail importantes avec les communautés autochtones;
- le soutien d’une communauté agricole dynamique dans les parcs.
En décembre 2023, le gouvernement de l’Ontario a rendu les terres à la ceinture de verdure et a rétabli les protections de celle-ci. Compte tenu de cette décision, l’étude fédérale est désormais interrompue pour une durée indéterminée.
L’AEIC a également amélioré l’efficacité des processus d’évaluation par :
- la résolution des problèmes et la définition des mesures d’atténuation avant que les promoteurs ne soumettent leurs études d’impact en travaillant de manière proactive avec les autorités fédérales et les ministères provinciaux pendant les phases de planification et d’étude d’impact;
- l’élaboration d’une modification en réponse à la décision de la CSC qui permettra de décider plus tôt si une évaluation d’impact est nécessaire (c.-à-d. une décision qui peut intervenir après la description initiale du projet, si des renseignements suffisants sont fournis);
- l’harmonisation de l’étape préparatoire de trois processus d’évaluation environnementale pour le projet minier des terres rares de Strange Lake et le nouvel aéroport de Nain en collaborant avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Nunatsiavut;
- le renforcement de la participation des populations autochtones aux processus d’évaluation en élaborant une méthodologie pilote pour les groupes autochtones participant au projet d’agrandissement de l’installation de GNL Tilbury – phase 2 qui soutient le financement du leadership autochtone dans les activités d’évaluation d’impact, un projet pilote qui est envisagé pour d’autres régions;
- la promotion des projets au moyen de tableaux d’affichage communautaires et d’interventions sur des stations de radio à ligne ouverte;
- l’assurance que des processus sont en place pour faire avancer efficacement les projets nucléaires dans le cadre des commissions d’examen intégrées en collaborant avec la CCSN sur la préparation des évaluations d’impact, notamment en organisant des séances de consultation pour la phase de planification préalable dans le cadre du projet Bruce C afin de sensibiliser les groupes autochtones et les collectivités locales au processus d’évaluation et à la manière dont ils peuvent y participer.
Répertoire des programmes
L’évaluation de l’impact est appuyée par les programmes suivants :
- Administration, réalisation et surveillance de l’évaluation
- Relations avec les Autochtones et mobilisation des Autochtones
Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour l’évaluation d’impact se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC
Services internes
Dans la présente section
- Description
- Progrès à l’égard des résultats
- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
- Marches attribuées à des entreprises autochtones
Description
Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse respecter ses obligations intégrées et exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes :
- services de gestion et de surveillance;
- services de communication;
- services juridiques;
- services de gestion des ressources humaines;
- services de gestion des finances;
- services de gestion de l’information;
- services des technologies de l’information;
- services de gestion des biens immobiliers;
- services de gestion du matériel;
- services de gestion des acquisitions.
Progrès à l’égard des résultats
Les services internes offrent un soutien institutionnel pour renforcer la capacité de l’AEIC à mettre en œuvre la LEI, à assumer sa responsabilité principale et à soutenir les objectifs du gouvernement du Canada relatifs au lieu de travail hybride, à la santé, à la sécurité et au bien-être des employés, ainsi qu’à la bonne gestion de l’information et des ressources et à la diversité. En 2023–2024, les services internes représentaient 21 % des ETP et 19 % des dépenses réelles, ce qui témoigne de l’efficacité du soutien à la prestation des programmes et aux exigences opérationnelles.
- L’AEIC a aidé de manière proactive ses employés à se familiariser et à se sentir à l’aise avec le nouvel environnement de travail (Milieu de travail GC) en pilotant le nouvel espace de travail dans une partie de son bureau d’Ottawa avant de le mettre en œuvre dans l’ensemble du siège et dans ses bureaux régionaux dans le cadre du modèle de lieu de travail hybride.
- Pour faciliter la collaboration, la communication et la productivité dans l’environnement de travail hybride, de nouvelles technologies ont été installées à l’AEIC (p. ex. la technologie de vidéoconférence, l’accès à de nouvelles applications dans Microsoft Teams, etc.) Cela a également renforcé la capacité des employés des régions ou de l’administration centrale à collaborer et à communiquer plus efficacement avec leurs collègues d’autres bureaux.
- Dans le même temps, l’AEIC a sensibilisé les employés à la santé, à la sûreté, au bien-être et à la sécurité, que l’on travaille au bureau ou à distance. Il s’agissait notamment de mettre à disposition des évaluations ergonomiques au bureau ou sur le lieu de travail à distance, de fournir aux employés les outils et l’équipement nécessaires pour réussir et répondre à leurs besoins individuels, et de réitérer l’importance de la protection des renseignements et de l’équipement.
- Tout au long de l’année, l’AEIC a amélioré son approche de la technologie de l’information, de la cybersécurité et de la culture de la sécurité en créant une stratégie tournée vers l’avenir et en collaborant avec des partenaires nationaux pour solidifier ses pratiques et capacités de sécurité. En outre, différents projets pilotes et initiatives ont été mis en œuvre afin de mieux faire connaître et d’améliorer les pratiques et les processus de gestion de l’information et de technologie de l’information (GI/TI) dans l’ensemble de l’AEIC :
- mise en œuvre d’un projet pilote de GI/TI et de sécurité qui a examiné les pratiques de protection de l’information tout en sensibilisant à la manière de la stocker de manière appropriée;
- mise en place de zones sécurisées dédiées, intégration de liaisons de GI dans les bureaux régionaux et faciliter le nettoyage des dossiers papier et électroniques dans l’ensemble de l’AEIC;
- réalisation de sa première campagne de sensibilisation à l’hameçonnage, qui a permis d’améliorer de 577 % la détection et le signalement des contenus préoccupants par les employés par rapport à la situation de référence.
- De même, des améliorations ont été apportées à la bonne gestion des ressources publiques afin de mieux garantir l’optimisation des ressources pour les Canadiens grâce à la mise en œuvre de contrôles internes. Il s’agit notamment de la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques pour les programmes de subventions et contributions et de la création d’un nouveau Centre d’excellence pour les subventions et contributions.
- L’AEIC a continué à mettre en œuvre ses contrôles de gestion des marchés publics afin de s’assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace et que toutes les dépenses sont rentables. Par exemple, en 2023–2024 :
- environ 97 % de la valeur totale des biens achetés l’ont été à l’aide d’outils de SPAC, comme les offres permanentes et les arrangements en matière d’approvisionnement;
- environ 82 % de la valeur totale des contrats de services professionnels ont été attribués dans le cadre de procédures concurrentielles.
- De plus, un examen de l’accessibilité a permis de cerner les obstacles aux mesures d’adaptation pour les employés, ce qui a permis de mettre en œuvre des solutions, comme un budget centralisé pour éliminer ces obstacles.
- Pour identifier et recruter la prochaine génération d’employés, le personnel des ressources humaines a étendu sa présence aux salons de l’emploi en identifiant les universités canadiennes qui proposent des programmes liés au mandat de l’AEIC.
- Dans le cadre de l’Appel à l’action en faveur de la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale, des stratégies de recrutement et de promotion ont été mises en œuvre pour attirer les populations autochtones, les minorités visibles et les autres personnes racialisées. Pour combler les lacunes en matière de représentation, l’AEIC a également eu recours à des bassins prédéterminés de la Commission de la fonction publique et d’autres ministères du gouvernement du Canada.
- Pour réduire les obstacles à l’accès à la formation en langue seconde, l’AEIC a modifié le processus de participation à son programme de formation en langue seconde afin d’augmenter la capacité de formation, et elle a modifié le processus pour permettre aux employés de demander à participer directement plutôt que d’exiger des nominations de la part des gestionnaires. Ces deux changements combinés ont entraîné une augmentation de 51 % entre 2022–2023 et 2023–2024 du nombre d’employés inscrits au programme de formation en langue seconde de l’AEIC, 21 % des employés participant au programme.
- Afin de faire progresser davantage les efforts de réconciliation et l’inclusion des peuples autochtones dans les processus d’évaluation, l’AEIC a mis en place diverses approches visant à renforcer la communication et la collaboration avec les peuples autochtones :
- les produits de communication et les documents clés (p. ex. les rapports des comités consultatifs) ont continué à être traduits dans neuf langues autochtones;
- des services d’interprétation simultanée dans les langues autochtones ont été fournis pour les événements en direct;
- l’AEIC a intégré un design autochtone dans ses produits de communication et a élaboré des histoires mettant en scène la participation autochtone à différents projets.
- L’AEIC a également engagé un navigateur de carrière autochtone pour aider les employés autochtones à développer un plan de carrière au sein de l’Agence.
- En outre, l’AEIC a amélioré la transparence et l’accessibilité en interne, grâce à un projet de décloisonnement dans le cadre duquel les renseignements non protégés et non classifiés sont accessibles à tous les employés, et à l’externe, grâce à des améliorations apportées au Registre, notamment la mise à jour d’un didacticiel vidéo destiné à aider les utilisateurs à naviguer dans le Registre avec plus de facilité et de confiance.
- En tant que chef de file de l’Initiative horizontale relative aux processus d’évaluation d’impact, l’AEIC a collaboré avec 12 ministères et organismes partenaires pour finaliser le cadre de résultats horizontal. Ce cadre permettra à l’AEIC de diriger le suivi et la communication des résultats pour les Canadiens et d’accroître la transparence dans le cadre du rapport annuel sur l’initiative horizontale, y compris pour la première fois dans le cadre du présent rapport.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 8 : Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus en ce qui a trait aux services internes pour l’exercice
Le tableau 8 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des ETP requis pour obtenir ces résultats.
Ressources |
Prévues |
Réelles |
|---|---|---|
Dépenses |
19 868 649 $ |
18 902 276 $ |
Équivalents temps plein |
113 |
107 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes de l’AEIC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Marchés attribués à des entreprises autochtones
Chaque année, les ministères du gouvernement du Canada doivent respecter la cible de 5 % de la valeur totale des marchés en ce qui concerne l’attribution de marchés à des entreprises autochtones. Cet engagement doit être entièrement mis en œuvre d’ici la fin de l’exercice 2024–2025.
Résultat de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour 2023–2024
Tableau 9 : Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones 1
Comme il est indiqué dans le tableau 9 l’AEIC a attribué 20.1% de la valeur totale de tous ses marchés à des entreprises autochtones pour l’exercice.
Indicateurs de rendement liés à l’attribution de marchés |
Résultats 2023–2024 |
|---|---|
Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones 2 (A) |
947 800,18 $ |
Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones et non autochtones3 (B) |
4 717 560,26 $ |
Valeur des exceptions approuvées par l’administrateur général (C) |
0,00 $ |
Pourcentage de marchés attribués à des entreprises autochtones [A/(B − C) × 100] |
20,1 % |
¹ Aux fins de mesure du rendement quant à la cible minimale de 5 % pour l’exercice 2023–2024, les données présentées dans ce tableau reposent sur la façon dont Services aux Autochtones Canada (SAC) définit une « entreprise autochtone », c’est-à-dire une entreprise dont le propriétaire-exploitant est un Aîné, un conseil de bande ou un conseil tribal; qui est inscrite au Répertoire des entreprises autochtones; ou qui est inscrite à une liste d’entreprises bénéficiaires d’un traité moderne. ² Comprend les modifications de marchés conclus avec des entreprises autochtones et des marchés conclus avec des entreprises autochtones au moyen de cartes d’achat de plus de 10 000 $, et pourrait inclure les marchés de sous-traitance conclus avec des entreprises autochtones. 3 Comprend les modifications de marchés conclus et les marchés conclus au moyen de cartes d’achat de plus de 10 000 $. |
|
Le coordonnateur de l’approvisionnement auprès des Autochtones de l’AEIC est membre du groupe de travail interministériel sur l’objectif de 5 % de marchés attribués à des entreprises autochtones. L’objectif du groupe de travail est d’assurer une approche réussie et coordonnée à l’échelle du gouvernement pour atteindre l’objectif de 5 %. Grâce à la collaboration et à un dialogue ouvert, le groupe de travail entend arriver à un consensus sur les approches, les instruments et les outils dont les ministères et les organismes ont besoin pour atteindre et dépasser l’objectif de 5 %. En 2023–2024, l’AEIC a attribué les marchés suivants :
- douze contrats de moindre envergure avec des entreprises autochtones pour des logiciels, des fournitures informatiques et d’autres matériels;
- trois marchés pour les entreprises autochtones d’une valeur totale de 538 285,83 dollars par le biais d’une approche volontaire conformément à la stratégie d’approvisionnement pour les entreprises autochtones, en invitant exclusivement des entreprises autochtones à un processus de demande de proposition.
Dans son plan ministériel 2024–2025, le Ministère prévoit que, d’ici à la fin de 2023–2024, il attribuera 5 % de la valeur totale de ses contrats à des entreprises autochtones. L’AEIC a obtenu des résultats supérieurs au minimum de 5 % au cours des deux derniers exercices, soit 12,8 % en 2022–2023 et 20,1 % en 2023–2024, soit une augmentation de 57 %, ce qui démontre notre engagement à dépasser l’objectif et à veiller à ce que les peuples autochtones aient accès aux marchés publics.
En 2023–2024, l’équipe d’approvisionnement de l’AEIC a participé à des réunions officielles avec des entreprises autochtones afin de mieux connaître les fournisseurs préqualifiés de biens et de services. En outre, le coordonnateur de l’approvisionnement auprès des Autochtones a organisé des séances d’information sur l’évaluation à l’intention des entrepreneurs autochtones et a répondu aux demandes de renseignements sur la procédure d’approvisionnement afin d’aider les entreprises autochtones à répondre aux besoins futurs.
Dépenses et ressources humaines
Dans la présente section
Dépenses
Cette section présente un aperçu des dépenses prévues et réelles du ministère de 2021–2022 à 2026–2027.
Sommaire du rendement budgétaire
Tableau 10 : Dépenses réelles de trois exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau 10 indique la somme d’argent dépensée par l’AEIC au cours des trois derniers exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes
Responsabilités essentielles et services internes |
Budget principal des dépenses 2023–2024 |
Autorisations totales pouvant être utilisées pour 2023–2024 |
Dépenses réelles de trois exercices (autorisations utilisées) |
|---|---|---|---|
Évaluation de l’impact |
79 474 598 $ |
85 841 262 $ |
|
Total partiel |
79 474 598 $ |
85 841 262 $ |
199 074 261 $ |
Services internes |
19 868 649 $ |
21 456 958 $ |
|
Total |
99 343 247 $ |
107 298 220 $ |
242 051 030 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur total peut ne pas correspondre.
Analyse des dépenses des trois derniers exercices
L’augmentation des autorisations disponibles par rapport au budget principal des dépenses est attribuée au financement par les organismes centraux des coûts liés aux conventions collectives nouvellement signées. La décision de la CSC sur la constitutionnalité de la LEI et des orientations provisoires a entraîné des retards dans la mise en œuvre du programme. Par conséquent, les dépenses réelles pour 2023–2024 ont été inférieures aux autorisations disponibles.
D’autres données financières concernant les années précédentes sont disponibles dans la section Finances de l’Infobase du GC.
Tableau 11 : Dépenses prévues au cours des trois prochains exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau 11 indique la somme d’argent que l’AEIC prévoit dépenser au cours des trois prochains exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes.
Responsabilités essentielles et services internes |
Dépenses prévues 2024–2025 |
Dépenses prévues 2025–2026 |
Dépenses prévues 2026–2027 |
|---|---|---|---|
Évaluation de l’impact |
85 315 499 $ |
65 905 309 $ |
65 915 725 $ |
Total partiel |
85 315 499 $ |
65 905 309 $ |
65 915 725 $ |
Services internes |
21 328 875 $ |
16 476 327 $ |
16 478 931 $ |
Total |
106 644 374 $ |
82 381 636 $ |
82 394 656 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur total peut ne pas correspondre.
Analyse des dépenses des trois prochains exercices
Le tableau ci-dessus n’inclut pas les dépenses à coût recouvrable qui sont considérées comme des recettes. L’AEIC est autorisée à recouvrer jusqu’à 8 millions de dollars de coûts par année, qui sont déduits des autorisations votées.
Les dépenses totales prévues par l’AEIC pour le prochain exercice 2024–2025, s’élèvent à 106,6 millions de dollars.
La diminution des dépenses prévues en 2025–2026 dépend des projections de recettes de 2022 qui ont pris en compte une proposition de coûts révisés au moyen du Règlement sur le recouvrement, qui devrait être modifié en vertu de la LEI modifiée.
D’autres données financières concernant les années précédentes sont disponibles dans la section Finances de l’Infobase du GC.
Financement
Cette section présente un aperçu du financement voté et législatif du ministère par rapport à ses responsabilités essentielles et à ses services internes. Pour en savoir plus sur les autorisations de financement, consulter les budgets et dépenses du gouvernement du Canada.
Graphique 1 : Financement approuvé (législatif et voté) pour une période de six exercices
Graphique 1 résume le financement voté et législatif du ministère pour la période de 2021–2022 à 2026–2027.
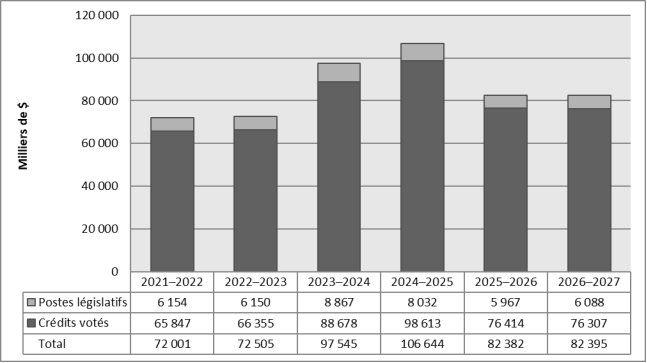
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur total peut ne pas correspondre.
Financement approuvé - Version texte
Ce diagramme à barres superposées présente les dépenses prévues et réelles (votées et législatives) pour chacun des six exercices financiers de 2021–2022 à 2026–2027. En 2021–2022, les dépenses législatives de l’AEIC étaient de 6,154 millions de dollars et les dépenses votées étaient de 65,847 millions de dollars pour un total de 72,001 millions de dollars. En 2022–2023, les dépenses législatives de l’AEIC étaient de 6,150 millions de dollars et les dépenses votées étaient de 66,355 millions de dollars pour un total de 72,505 millions de dollars. En 2023–2024, les dépenses législatives de l’AEIC étaient de 8,867 millions de dollars et les dépenses votées étaient de 88,678 millions de dollars pour un total de 97,545 millions de dollars. En 2024–2025, les dépenses législatives prévues de l’AEIC s’élèvent à 8,032 millions de dollars et les dépenses votées prévues sont de 98,613 millions de dollars pour un total de dépenses prévues de 106,644 millions de dollars. En 2025–2026, les dépenses législatives prévues de l’AEIC s’élèvent à 5,976 millions de dollars et les dépenses votées prévues sont 76,414 millions de dollars, pour un total de 82,382 millions de dollars de dépenses prévues. En 2026–2027, les dépenses législatives prévues de l’AEIC sont 6,088 millions de dollars et les dépenses votées prévues sont 76,307 millions de dollars pour un total de dépenses prévues de 82,395 millions de dollars.
Les définitions des dépenses votées et législatives sont disponibles à l’annexe : Définition.
Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2022, on a annoncé un financement nouveau et renouvelé pour l’AEIC, ce qui a conduit à une augmentation notable du financement en 2023–2024 par rapport à 2022–2023. Ce financement a permis de mettre pleinement en œuvre les objectifs du processus d’évaluation d’impact et d’améliorer l’efficacité de la réponse à un nombre croissant de grands projets proposés.
L’AEIC recouvre une partie des coûts liés à l’administration du processus fédéral d’évaluation d’impact. La diminution en 2025–2026 reflète les recettes qui ont été projetées en 2022 pour être recouvrées dans le cadre de règlements révisés sur le recouvrement des coûts en vertu de la LEI, pour lesquels l’AEIC planifie actuellement les prochaines consultations préalables.
Pour en savoir plus sur les dépenses votées et législatives de l’AEIC, consulter les Comptes publics du Canada.
Faits saillants des états financiers
Les états financiers de l’AEIC (audités ou non) pour l’exercice terminé le 31 mars 2024 sont publiés sur le site Web du ministère.
Tableau 12 : État condensé des résultats (non audité) pour l’exercice terminé le 31 mars 2024 (en dollars) – résultats réels par rapport aux résultats prévus
Le tableau 12 résume les charges et les revenus réels et prévus pour 2023–2024 qui affectent le coût de fonctionnement avant le financement du gouvernement et les transferts.
Renseignements financiers |
Résultats réels 2023–2024 |
Résultats prévus 2023–2024 |
Différence (réels moins prévus) |
|---|---|---|---|
Total des charges |
107 563 634 $ |
111 855 722 $ |
(4 292 088 $) |
Total des revenus |
237 637 $ |
2 700 000 $ |
(2 462 363 $) |
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts |
107 325 997 $ |
109 155 722 $ |
(1 829 725 $) |
Les renseignements sur les résultats prévus pour 2023–2024 proviennent de l’état des résultats prospectif et les notes de 2023–2024 de l’AEIC.
Tableau 13 : État condensé des résultats (non audité) pour l’exercice clos le 31 mars 2024 (en dollars) – écart annuel (résultats réels de 2023–2024 par rapport aux résultats réels de 2022–2023)
Le tableau 13 résume les dépenses et les revenus réels pour 2022–2023 et 2023–2024 qui correspondent au coût d’exploitation avant financement public et transferts.
Renseignements financiers |
Résultats réels 2023–2024 |
Résultats réels 2022–2023 * |
Différence (2023–2024 moins 2022–2023) |
|---|---|---|---|
Total des dépenses |
107 563 634 $ |
81 748 496 $ |
25 815 138 $ |
Total des revenus |
237 637 $ |
2 133 148 $ |
(1 895 511 $) |
Coût net des opérations avant financement public et transferts |
107 325 997 $ |
79 615 348 $ |
27 710 649 $ |
* Les informations comparatives pour 2022–2023 ont été retraitées ; voir la note 13 dans les États financiers de fin d’exercice de l’AEIC pour l’exercice financier 2023–2024. |
|||
Tableau 14 : État condensé de la situation financière (audité ou non) au 31 mars 2024 (en dollars)
Le tableau 14 fournit un résumé des passifs (ce qu’il doit) et des actifs (ce qu’il possède) du ministère, qui aident à déterminer la capacité de celui-ci à mettre en œuvre des programmes et des services.
Renseignements financiers |
Exercice en cours (2023–2024) |
Exercice précédent (2022–2023) * |
Différence (2023–2024 moins 2022–2023) |
|---|---|---|---|
Total du passif net |
20 940 043 $ |
14 961 597 $ |
5 978 446 $ |
Total des actifs financiers nets |
11 911 027 $ |
6 084 190 $ |
5 826 837 $ |
Dette nette du Ministère |
(9 029 016 $) |
(8 877 407 $) |
(151 609 $) |
Total des actifs non financiers |
1 037 789 $ |
708 716 $ |
329 073 $ |
Position financière nette du Ministère |
(7 991 227 $) |
(8 168 691 $) |
177 464 $ |
* Les informations comparatives pour 2022–2023 ont été retraitées ; voir la note 13 dans les États financiers de fin d’exercice de l’AEIC pour l’exercice financier 2023–2024. |
|||
Ressources humaines
Cette section présente un aperçu des ressources humaines réelles et prévues du ministère pour la période de 2021–2022 à 2026–2027.
Tableau 15 : Ressources humaines réelles pour les responsabilités essentielles et les services internes
Le tableau 15 fournit un résumé des ressources humaines, en équivalents temps plein, lesquels sont associés aux responsabilités essentielles et aux services internes de l’AEIC pour les trois derniers exercices.
Responsabilités essentielles et services internes |
Équivalents temps plein réels 2021–2022 |
Équivalents temps plein réels 2022–2023 |
Nombre d’équivalents temps plein réels 2023–2024 |
|---|---|---|---|
Évaluation de l’impact |
350 |
347 |
401 |
Total partiel |
350 |
347 |
401 |
Services internes |
84 |
84 |
107 |
Total |
434 |
431 |
508 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur total peut ne pas correspondre.
Analyse des ressources humaines des trois derniers exercices
L’AEIC progresse vers l’atteinte de ses niveaux maximums d’ETP, comme établis dans le renouvellement de l’évaluation d’impact de 2022. Des progrès substantiels ont été réalisés au cours de l’exercice écoulé et les efforts se poursuivent malgré les défis posés par le marché du travail actuel.
Tableau 16 : Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes
Le tableau 16 présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein réels, pour chaque responsabilité essentielle et les services internes de l’AEIC au cours des trois prochains exercices. Les ressources humaines pour l’exercice en cours sont prévues en fonction des données de l’exercice à ce jour.
Responsabilités essentielles et services internes |
Équivalents temps plein prévus en 2024–2025 |
Équivalents temps plein prévus en 2025–2026 |
Équivalents temps plein prévus en 2026–2027 |
|---|---|---|---|
Évaluation de l’impact |
466 |
337 |
337 |
Total partiel |
466 |
337 |
337 |
Services internes |
123 |
115 |
115 |
Total |
589 |
452 |
452 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur total peut ne pas correspondre.
Analyse des ressources humaines pour les trois prochains exercices
Le nombre d’ETP de l’AEIC augmentera en 2024–2025 en raison du financement reçu dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2022. L’AEIC prévoit d’utiliser 589 ETP en 2024–2025.
La diminution du nombre d’ETP en 2025–2026 reflète les recettes qui ont été projetées en 2022 pour être recouvrées dans le cadre de règlements révisés sur le recouvrement des coûts en vertu de la LEI, pour lesquels l’AEIC planifie actuellement les prochaines consultations préalables.
Renseignements ministériels
Profil du ministère
Ministre de tutelle : l’honorable Steven Guilbeault, C.P., député, ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Administrateur général : Terence Hubbard, président
Portefeuille ministériel : Environnement
Instruments habilitants : Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et Loi sur l’évaluation d’impact
Année d’incorporation ou de création : 1994
Autres : La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) est soutenue par trois règlements : le Règlement désignant les activités concrètes, le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné et le Règlement sur le recouvrement des coûts.
La Loi sur l’évaluation d’impact est soutenue par quatre règlements et un arrêté ministériel : le Règlement sur les activités concrètes, le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le Règlement sur le recouvrement des coûts (suite de la LCEE 2012), le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) et l’Arrêté désignant des catégories de projets. L’AEIC soutient son président qui est aussi l’administrateur fédéral en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.
Coordonnées de l’organisation
Addresse postale :
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Place Bell Canada, 160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H3 Canada
Téléphone : 613-957-0700
ATS : 1-866-582-1884
Télécopie : 613-957-0862
Courriel : information@aeic-iaac.gc.ca
Sites Web : www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html
Tableaux de renseignements supplémentaires
Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web de l’AEIC :
- Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
- Analyse comparative entre les sexes plus
- Réponse aux comités parlementaires et aux audits externes
- Initiatives horizontales
Dépenses fiscales fédérales
Il est possible de recourir au système fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’imposition, des exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Ce rapport fournit aussi des renseignements détaillés sur les dépenses fiscales, dont des descriptions, des objectifs, des données historiques et des renvois aux programmes de dépenses fédérales connexes ainsi qu’aux évaluations et aux résultats de l’ACS Plus liés aux dépenses fiscales.
Définitions
- analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA+])
- Outil analytique servant à soutenir l’élaboration de politiques, de programmes et d’autres initiatives et à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des initiatives sur divers ensembles de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre. L’ACS Plus est un processus permettant de comprendre qui est touché par l’occasion ou l’enjeu évalué par l’initiative, d’établir comment l’initiative pourrait être adaptée pour répondre aux divers besoins des personnes les plus touchées ainsi que de déterminer et de réduire tout obstacle à l’accès ou au bénéfice de l’initiative. L’ACS Plus est une analyse intersectionnelle qui va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour tenir compte d’autres facteurs, comme l’âge, les handicaps, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle.
- cadre ministériel des résultats (departmental results framework)
- Cadre qui établit un lien entre les responsabilités essentielles et les résultats ministériels ainsi que les indicateurs de résultat ministériel d’un ministère.
- cible (target)
- Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’un ministère, un programme ou une initiative prévoit d’atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.
- crédit (appropriation)
- Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.
- dépenses budgétaires (budgetary expenditures)
- Dépenses de fonctionnement et en capital, paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers ainsi que paiements à des sociétés d’État.
- dépenses législatives (statutory expenditures)
- Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
- dépenses non budgétaires (non-budgetary expenditures)
- Recettes et décaissements nets au titre de prêts, d’investissements et d’avances qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.
- dépenses prévues (planned spending)
- En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses prévues s’entendent des montants présentés dans le budget principal des dépenses.
- Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur les résultats ministériels.
- dépenses votées (voted expenditures)
- Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.
- entreprise autochtone (Indigenous business)
- Organisation qui, aux fins de l’Annexe E – Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement ainsi que de l’engagement du gouvernement du Canada d’attribuer obligatoirement au moins 5 % de la valeur totale des marchés à des entreprises autochtones, correspond à la définition et aux exigences définies dans le Répertoire des entreprises autochtones.
- équivalent temps plein (ETP) (full-time equivalent [FTE])
- Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget ministériel. Pour un poste donné, le nombre d’équivalents temps plein représente le rapport entre le nombre d’heures travaillées par une personne, divisé par le nombre d’heures normales prévues dans sa convention collective.
- indicateur de rendement (performance indicator)
- Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le rendement d’un ministère, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus.
- indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)
- Mesure quantitative des progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.
- initiative horizontale (horizontal initiative)
- Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.
- plan (plan)
- Exposé des choix stratégiques qui montre comment un ministère entend respecter ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.
- Plan ministériel (Departmental Plan)
- Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires au cours d’une période de trois ans. Les Plans ministériels sont habituellement présentés au Parlement au printemps.
- priorité ministérielle (departmental priority)
- Plan ou projet qu’un ministère a choisi de cibler et dont il rendra compte au cours de la période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être réalisé en premier pour obtenir les résultats ministériels attendus.
- priorités pangouvernementales (government-wide priorities)
- Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2022–2023, les priorités pangouvernementales correspondent aux thèmes de haut niveau qui décrivent le programme du gouvernement dans le discours du Trône du 23 novembre 2021 : bâtir un présent et un avenir plus sains, faire croître la croissance d’une économie plus résiliente, mener une action climatique audacieuse, travailler plus fort pour rendre les collectivités sécuritaires, défendre la diversité et l’inclusion, avancer plus rapidement sur la voie de la réconciliation et lutter pour un monde plus sûr, plus juste et plus équitable.
- programme (program)
- Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de service.
- rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)
- Rapport qui présente les réalisations réelles d’un ministère par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant.
- rendement (performance)
- Utilisation qu’un ministère a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que le ministère souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons ont été dégagées.
- répertoire des programmes (program Inventory)
- Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère et description de la manière dont les ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et aux résultats du ministère.
- responsabilité essentielle (core responsibility)
- Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.
- résultat (result)
- Conséquence attribuable en partie à un ministère, une politique, un programme ou une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’un ministère, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence du ministère.
- résultat ministériel (departmental result)
- Conséquence ou résultat qu’un ministère cherche à atteindre. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats des programmes.